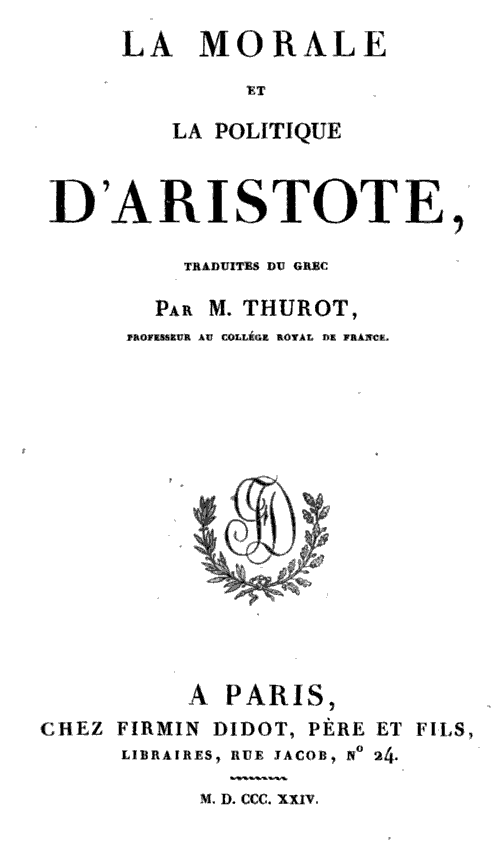|
ÉTHIQUE A NICOMAQUE
M. THUROT: DISCOURS PRÉLIMINAIRE, ou INTRODUCTION A LA MORALE D'ARISTOTE. Garnier : traduction par J. Voilquin Livre I
CHAPITRE
1 : Le bien et l’activité humaine La
hiérarchie des biens Livre II LA VERTU
CHAPITRE 1: La vertu, résultat de l’habitude s’ajoutant à la
nature.
LIVRE III
:
CHAPITRE 1: Actes volontaires et actes involontaires - De la
contrainte. - Actes involontaires résultant de l’ignorance. - Acte
volontaire.
ARGUMENT. I. La libéralité se manifeste dans les occasions où il est question de donner ou de prendre de l'argent, ou tout ce qui peut s'évaluer en argent. Le libéral est moins disposé à recevoir qu'à donner; mais il évite l'excès en ce genre, qui est la prodigalité; et il est plus loin encore de l'excès opposé, qui est l'avarice. Il donne toujours avec joie, mais avec discernement, et pour des motifs justes et honorables, observant à cet égard les convenances relatives au temps, aux personnes, aux occasions, etc. On est plus libéral du bien qu'on tient de ses pères, que de celui qu'on a acquis par son travail. Quelles que soient les dépenses d'un tyran, on ne l'appellera point libéral, pas plus qu'on ne donnera ce nom aux filous, aux voleurs, et à tous ceux qui s'enrichissent par le crime, et par des gains illicites. Le libéral ménage sa fortune, et s'occupe des moyens de la conserver; et, sous ce rapport encore, il tient un juste milieu entre la prodigalité et l'avarice. Mais, entre ces deux extrêmes, l'un est moins odieux et moins méprisable que l'autre; aussi le libéral s'en rapproche-t-il plus. Cependant le prodigue peut être conduit, par ses profusions indiscrètes, aux actions les plus criminelles; mais il est plus susceptible que l'avare de se guérir de sa passion. — II. La magnificence est la libéralité dans les grandes occasions, et qui exigent des dépenses considérables. Les vices opposés à cette qualité, sont la parcimonie, la mesquinerie, etc. A la différence près, que nous venons d'indiquer, on peut dire, sous beaucoup de rapports, de la magnificence, les mêmes choses qui ont été dites de la libéralité. L'ostentation, le faste insolent, sont les défauts de ceux qui, voulant paraître magnifiques, ne savent juger ni les personnes ni les choses, ni les occasions dans lesquelles la magnificence est convenable. — III. La magnanimité, ou grandeur d'âme, est le caractère de celui qui, non seulement est digne des plus grands honneur et capable d'exécuter les plus grandes choses, mais qui en a la confiance, qui s'apprécie lui-même ce qu'il vaut. La petitesse ou bassesse d'âme de celui qui ne s'apprécie pas lui-même ce qu'il vaut, et l'insolent orgueil de celui qui se croit capable de tout, quoiqu'il n'ait que des talents ou des vertus très ordinaires, sont les extrêmes opposés entre lesquels la magnanimité tient le juste milieu. Le magnanime est nécessairement vertueux et courageux ; il n'est même que médiocrement touché des honneurs ou des dignités, étant accoutumé à n'attacher que peu d'importance à tout ce qui séduit les âmes vulgaires. Il est bienfaisant, ami ou ennemi ouvert, franc et sincère dans son langage; peu empressé à parler des autres ou de lui-même, ou à se plaindre des torts qu'on a envers lui. L'étroitesse d'âme, ou la vanité impertinente, qui sont opposées à la magnanimité sont plutôt des travers que des vices. — IV. Il y a, a l'égard des honneurs et des dignités, un certain milieu entre l'ambition et l'absence totale d'ambition ; ce milieu serait à la magnanimité ce que la libéralité est à la magnificence ; mais on ne lui a point donné de nom. Celui qui ne recherche les honneurs ou les dignités qu'autant qu'il faut, et comme la saine raison l'exige, est appelé ambitieux par les uns, et homme sans ambition par les autres. Ainsi, faute d'une notion bien déterminée, et d'un nom qui lui soit approprié, les extrêmes opposés se disputent, en quelque sorte, la place et le nom du milieu où se trouve la vertu véritable. — V. La douceur ou l'indulgence est un juste milieu par rapport à la colère, et à l'espèce d'insensibilité qui fait qu'on ne s'émeut d'aucun outrage. Cet extrême, par défaut, na pas reçu de nom, parce qu'il se rencontre bien plus rarement que l'extrême opposé, ou l'humeur violente et emportée. L'indulgence consiste à se garantir des mouvements de colère et d'indignation pour des causes légères, et à observer encore, à cet égard, ce qu'exige la convenance par rapport aux personnes, aux temps, aux circonstances, etc. Il est difficile de déterminer les motifs d'une juste colère, et surtout le degré que la raison approuve. Et ici encore on loue souvent comme indulgents ceux qui ne sont pas assez indignés de ce qui mériterait le plus leur colère, et on appelle quelquefois courageux ou généreux ceux qui dépassent la limite d'un juste ressentiment. — VI. On peut pécher, dans le commerce et dans les relations habituelles que l'on a avec les autres hommes, ou par un désir excessif de leur plaire, en louant tout et approuvant tout, ou, au contraire, par une humeur morose et difficile qui se manifeste en toute occasion, et qui ne craint jamais d'affliger ou de déplaire. Le juste milieu, en ce point, consiste évidemment à ne louer et à ne blâmer que les choses et les personnes qui méritent véritablement l'éloge ou le blâme. Ce caractère n'a point de nom qui le distingue proprement, mais il s'éloigne également de la molle complaisance, et de l'humeur farouche. — VII. L'homme sincère observe, pareillement, un juste milieu entre la jactance ou l'arrogance de celui qui s'attribue des avantages qu'il n'a pas, ou qui veut faire croire ceux qu'il possède plus grands qu'ils ne sont, et la dissimulation de celui qui cache ses avantages, ou qui affecte de les croire moindres qu'ils ne sont. Le premier n'est digne que de mépris; le second mérite quelquefois des éloges, par la grâce aimable ou piquante qui se joint à sa dissimulation. Au reste, les motifs qui déterminent ces deux caractères peuvent les rendre plus ou moins blâmables. — VIII. Il y a encore, par rapport au commerce de la vie, et à la conversation des hommes entre eux, un milieu entre la bouffonnerie et la rusticité grossière : deux extrêmes, dont l'un pèche par excès, dans les choses qu'on peut se permettre de dire ou d'entendre, en fait de plaisanteries; et l'autre pèche par défaut, dans celui qui n'est capable ni de dire ni d'entendre rien qui soit agréable ou plaisant. Le caractère de l'homme qui observe les convenances relatives aux personnes, et aux circonstances, dans les choses qu'on peut dire ou entendre, est donc dans ce milieu, qui n'a pas de nom, et qu'il est difficile de définir avec justesse. — IX. La pudeur, ou la modestie n'est pas proprement une vertu; clic est plutôt une manière d'être affecté : elle convient particulièrement à la jeunesse. Elle est moins propre à l'âge avancé, parce qu'un homme de cet âge ne doit rien dire ou faire dont il ait à rougir. Cependant l'impudence est un vice : car on est réellement coupable quand on a commis des actions honteuses, et qu'on n'en rougit pas.
ARGUMENT. ARGUMENT. 1. On a distingue les vertus morales des vertus intellectuelles, on a examiné avec quelque détail en quoi consistent les premières, il convient à présent de considérer aussi les autres. On a également reconnu deux parties de l'âme; l'une, douée de raison, et l'autre qui en est privée: il faut encore considérer la partie raisonnable comme divisée en deux autres parties; l'une, capable de juger ou d'apprécier les choses nécessaires, et l'autre qui s'applique aux choses contingentes. - II. Entre les trois choses qui sont dans l'âme, le sens, l'intelligence et l'appétit, ou le désir, le sens n'est pas un principe d'action ; mais c'est le choix ou la préférence, déterminée par le désir et par l'intelligence. Rien de ce qui est passé ne peut être un objet de préférence, ni de délibération. La vérité est l'œuvre ou le produit des deux parties intelligentes de l'âme. - III. Les moyens à l'aide desquels elle connaît la vérité, sont au nombre de cinq : l'art, la science, la prudence, la sagesse et l'intelligence. La science est une habitude de croyance et de démonstration dont les objets sont nécessaires, éternels, ingénérables et incorruptibles. - IV. Il faut distinguer, dans les actions, celles dont le résultat est durable, et celles dont l'effet s'évanouit à mesure qu'Il est produit. L'art ne s'applique qu'aux actions du premier genre : il est une habitude d'agir, à l'occasion des choses contingentes, en prenant pour guide la véritable raison. Il n'y a point d'art des choses nécessaires et naturelles. - V. La prudence consiste à être en état de prendre las résolutions les plus conformes à note bonheur, en général. Elle se rapporte comme l'art, aux choses contingentes, mais elle n'est ni un art, ni une science: elle est une habitude d'appliquer la raison aux actions dont le résultat s'évanouit à mesure qu'elles ont lieu; c'est-à-dire, aux affaires humaines, comme la politique, l'économie domestique, etc. Elle est une vertu de cette partie de l'âme où se trouve l'opinion. - VI. La connaissance des principes ne peut être ni le produit de la science (car la science se fonde sur cette connaissance), ni celui de l'art, qui n'a de rapport qu'aux choses contingentes. Elle ne peut pas être le produit de la prudence et de la sagesse, à peu près par la même raison. La connaissance des principes appartient donc proprement à l'esprit, ou à l'intelligence. - VII. La sagesse (ou l'habileté), c'est-à-dire, la supériorité dans quelque genre que ce soit; suppose à la fois l'intelligence et la science, portées à un très haut degré de perfection. La sagesse s'applique plus aux choses ou aux vérités générales et nécessaires, au lieu que la prudence est plutôt relative aux choses particulières et contingentes. Voilà pourquoi la sagesse est supérieure à la politique ; elle est ce qu'il y a naturellement de plus admirable et de plus précieux parmi les hommes. La prudence est une vertu éminemment pratique; elle est, dans la vie, comme un art qui en dirige plusieurs autres qui lui sont subordonnés. - VIII. La prudence qui dirige les ressorts généraux de la société civile, c'est la législation; celle qui dirige les détails de l'administration, est plus proprement la politique. Les jeunes gens peuvent devenir habiles dans les mathématiques, dans les sciences naturelles; les enfants même peuvent, jusqu'à un certain point, s'appliquer à ces connaissances; mais ni les uns ni les autres ne peuvent acquérir la sagesse on la prudence. Celle-ci a pour objet une résolution définitive qu'il s'agit de prendre et d'exécuter : elle est l'effet d'une manière de sentir juste et conforme au vrai. - IX. Une sage résolution (effet de la prudence) n'est ni une science, ni une opinion, ni une heureuse rencontre: elle est le produit de la réflexion, et consiste dans une certaine rectitude d'esprit appliquée aux sujets sur lesquels on délibère: appliquée surtout à ce qui est utile et avantageux, et à la recherche des moyens de l'obtenir que la raison peut approuver, à la détermination du temps et de la manière la plus convenable pour cela. - X. Le discernement est relatif aux choses qui sont l'objet du doute ou de l'incertitude, et sur lesquelles ou est dans le cas de délibérer, et par conséquent s'applique aux mêmes objets que la prudence; mais il n'est pas tout-à-fait la même chose : sa fin est d'indiquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. II se confond presque avec l'intelligence ou connaissance exacte des choses. - XI. Le jugement (le sens commun on le bon sens); consiste dans un juste discernement de ce qui est équitable. L'indulgence est un jugement exact et juste de ce qui est bien, c'est-à-dire, de ce qui est conforme à la vérité. Sans doute aucun homme n'est naturellement sage, mais le jugement, l'esprit ou l'intelligence, et la sagacité, sont des facultés naturelles, qui se développent et se perfectionnent par le progrès des années. - XII. La sagesse ne se rapporte à rien de ce qui peut être créé ou produit par l'homme: la prudence a du moins cet avantage; mais si les vertus ne sont que des habitudes ou des dispositions, il ne dépendra pas de nous de les posséder; à quoi donc serviront la sagesse et la prudence ? D'ailleurs, si cette dernière faculté est inférieure à l'autre, n'est-il pas étrange que ce soit elle qui ait l'autorité, et qui décide de ce qu'il faut faire? On répond qu'elles sont toutes deux désirables, parce que la vertu rend estimable le but qu'on se propose, et parce que la prudence donne aux moyens le même caractère de convenance et de bonté morale. Le talent, qui consiste à exécuter avec succès ce qu'on a en vue, n'est digne d'éloges et d'estime qu'autant que ce but est honorable, et c'est la vertu qui le rend tel. - XIII. La partie de l'âme qui conçoit et apprécie les opinions, comprend le talent et la prudence, et la partie morale comprend la vertu naturelle et la vertu absolue, laquelle est, pour ainsi dire, principale et directrice, et ne saurait exister sans la prudence. En effet, c'est la prudence qui donne à toutes nos dispositions la rectitude qui les rend conformes à la raison: celle- ci se rapporte à la fin, et celle-là aux moyens propres à nous y conduire. Mais ce n'est pas la prudence qui commande à la vertu, ou qui en dirige l'emploi ; elle s'occupe des moyens de la produire et de la conserver.
ARGUMENT. ARGUMENT. I. L'amitié (en prenant ce mot dans le sens le plus étendu) est le lien universel qui unit, ou au moins rapproche tous les êtres animés : elle est, pour l'homme, le bien le plus précieux, puisqu'elle est le principal fondement de la société. L'amitié n'est pas seulement un sentiment nécessaire à l'existence des sociétés, elle est aussi un de ceux qui embellissent et honorent le plus la vie de l'homme. Quant à l'origine ou à la cause de ce sentiment, les uns la voient dans la ressemblance des êtres entre eux, les autres dans le contraste, d'autres en cherchent l'origine jusque dans la nature inanimée; on ne considère ici l'amitié que relativement aux moeurs et aux passions de l'homme. - Il. Il y a trois qualités ou conditions qui font naître l'amitié; ce sont la bonté, l'agrément, et l'utilité. Il faut, pour être amis, qu'au sentiment d'une bienveillance réciproque, fondée sur l'une de ces trois qualités, se joigne la connaissance du bien qu'on se veut mutuellement. - III. Les espèces d'amitiés diffèrent, comme les motifs sur lesquels elles se fondent. L'amitié qui n'a pour cause que l'utilité ou l'agrément, ne dure ordinairement qu'autant que la cause qui l'a fait naître. Les vieillards sont plus portés à rechercher des amis utiles, et les jeunes gens des amis agréables; mais l'amitié la plus parfaite et la plus durable est celle des hommes vertueux, parce qu'elle réunit a la fois les trois conditions qui rendent véritablement digne d'être aimé. - IV. L'amitié fondée sur l'agrément (particulièrement celle que l'on désigne par le nom d'amour) est sujette à s'évanouir, quand les qualités qui l'avaient fait naître ne se trouvent plus dans l'objet aimé. Cependant, l'habitude donne quelquefois plus de durée à cet attachement, et il est plus durable que celui qui n'a pour cause que l'utilité. Ces deux causes peuvent unir entre eux des hommes plus ou moins estimables ou méprisables : mais les hommes vertueux ne s'unissent qu'entre eux, et s'aiment uniquement pour eux-mêmes. - V. Un des caractères de l'amitié, c'est le besoin de vivre avec ceux qu'on aime. L'absence, ou l'éloignement, ne détruit pas toujours ce sentiment, mais il semble au moins le faire oublier. Ce qu'on appelle un simple goût, n'est guère qu'une affection fugitive; l'amitié est une disposition ou une manière d'être constante. L'égalité en est une des conditions essentielles. - VI. Ni l'amitié parfaite, ni l'amour, ne peuvent exister entre plusieurs personnes à la fois. Mais l'amitié fondée sur des qualités agréables, ou sur l'utilité, est moins exclusive. Les riches ne recherchent guère que l'agrément dans les relations de ce genre : les hommes puissants et élevés en dignités recherchent aussi l'utilité, mais ils ne se soucient pas de trouver ces deux qualités réunies dans les mêmes personnes: il y faudrait alors de l'égalité, ce qui ferait rentrer ces sortes d'amitiés dans l'amitié véritable et parfaite dont elles n'ont que l'apparence. - VII. L'affection d'un père pour ses enfants, celle d'un mari pour sa femme, d'un magistrat pour ceux sur qui il a autorité, etc., sont encore, pour ainsi dire, des espèces d'amitiés différentes, et qui se règlent sur les notions de justice et de proportionnalité. Il est difficile de marquer la limite où s'arrête le sentiment de l'amitié; une trop grande illégalité la détruit ou l'empêche de naître. De là la question de savoir jusqu'à quel point il faut souhaiter du bien à ses amis. - VIII. En général, on se plaît plus à être aimé, qu'à aimer soi-même, et c'est pour cela qu'on accueille volontiers les flatteurs, espèce d'amis subalternes. Cependant l'amitié consiste plutôt à aimer qu'à être aimé, comme le prouve la tendresse des mères pour leurs enfants. La ressemblance et l'égalité étant des conditions nécessaires à l'amitié, celle des hommes vertueux est durable, parce qu'ils ont de la constance dans toutes leurs déterminations; celle des hommes vicieux ne l'est pas, par la raison contraire. - IX. Tout ce qui est occasion de rapprochement, et d'une sorte de commerce entre les hommes, peut être compris sous le nom d'amitié, et les notions du juste et de l'injuste y interviendront à différents degrés, comme les sentiments d'affection. Les associations de tout genre ressemblent à la société politique, et lui sont subordonnées. Celle-ci n'a pour but et pour garant de sa durée que l'intérêt commun de tous les membres qui la composent. Les solennités même de la religion, et l'institution d'un culte public, n'ont pas d'autre fondement et d'autre origine. - X. Il y a trois formes générales de gouvernement : la royauté, qui devient tyrannie quand le monarque substitue son intérêt personnel à l'intérêt public. L'aristocratie, qui devient oligarchie, quand le petit nombre de ceux qui ont le pouvoir, sacrifient l'intérêt public à leur intérêt privé. La timocratie, ou république, qui devient démocratie, quand le plus grand nombre des citoyens abuse des pouvoirs dont il dispose. On peut trouver des images de ces formes diverses de gouvernement, et de leurs altérations ou dégénérations, dans les rapports de différents genres qui se trouvent entre les membres d'une même famille. - XI. L'amitié ou l'affection réciproque entre les sujets et le gouvernement, se trouve dans chacune de ces formes diverses, en même proportion que la justice. La même chose s'observe, à peu près, dans les relations de famille. - XII. Toute amitié est fondée sur une communauté de sentiments ou d'intérêts. L'affection qui unit les membres de la famille, tient essentiellement à celle qui unit les pères et les enfants. La tendresse conjugale est un effet direct des dispositions propres à la nature humaine. Elle petit être fondée sur la vertu; et c'est alors qu'elle contribue le plus au bonheur. Les enfants en sont le lien le plus précieux, et lui donnent plus de stabilité. - XIII. Entre les trois sortes d'amitiés (c. II), celle qui est fondée sur l'utilité donne plus occasion aux plaintes réciproques, et celle qui a la vertu pour base est exempte de cet inconvénient. Il y a une sorte d'amitié qu'on pourrait appeler morale, et une autre qu'on pourrait appeler légale, ou fondue sur des conventions. On doit généralement regarder les bienfaits, comme le résultat d'une amitié de ce genre, et rendre, autant qu'il est possible, plus qu'on n'a reçu. - XIV. Il faut, en cas d'inégalité ou de disproportion entre les amis, que chacun d'eux trouve pourtant quelque avantage dans l'amitié, et, par conséquent, qu'il s'y établisse une juste compensation, comme dans les états bien ordonnés, où l'on n'accorde des récompenses pécuniaires ou honorifiques qu'à ceux qui rendent des services à la chose publique. Il en est autrement par rapport aux liens de famille: un fils ne peut jamais se regarder comme complètement acquitté envers son père.
ARGUMENT. ARGUMENT. I. Les sentiments de plaisir et de peine influent sur toutes nos déterminations. Le plaisir est-il un bien ou un mal ? Quelques philosophes ont soutenu qu'il est un mal, moins peut-être par conviction, que dans la persuasion qu'il y aurait quelque utilité à le faire envisager ainsi. Mais une assertion ne peut obtenir l'assentiment des hommes, que lorsqu'elle est d'accord avec les faits. - II. Eudoxe regardait le plaisir comme le souverain bien, ou le bien absolu, parce que tous les êtres animés le cherchent avec ardeur, et fuient avec non moins d'ardeur ce qui lui est contraire, c'est-à-dire, la peine ou la douleur. Platon essaya de combattre l'opinion d'Eudoxe par des arguments qui ne sont pas tout-à-fait décisifs. - III. On objecte, par exemple, contre la volupté, qu'elle n'est pas une qualité, qu'elle est génération, (c'est-à-dire, sans cesse aspirant à une existence complète, et n'y arrivant jamais); qu'elle est mouvement, et, par conséquent, toujours imparfaite. On fait, contre la volupté, d'autres objections, qui prouvent qu'on n'a considéré que les plaisirs des sens, et qu'on a négligé de tenir compte de ceux de l'intelligence. Peut-être, au reste, est-on autorisé à penser seulement qu'il y a des plaisirs désirables en eux-mêmes, mais qui diffèrent d'espèce, ou à raison des causes qui les produisent. - IV. On a tort de dire que le plaisir soit mouvement, ou génération : car cela ne saurait se dire que des choses qui sont divisibles et qui ne composent point un tout; au lieu que le plaisir existe indépendamment de la condition du temps : celui qu'on éprouve, dans un moment indivisible, est quelque chose de complet et d'entier. Pourquoi n'y a-t-il point de plaisir constant? c'est que la faiblesse naturelle de l'homme ne lui permet pas de supporter un état de continuelle activité. D'ailleurs, c'est le plaisir qui donne à tous nos actes leur degré de perfection. - V. Nos actes sont de différentes espèces, et par conséquent aussi les plaisirs qui les perfectionnent. C'est pourquoi on ne fait avec succès que ce qu'on aime à faire, et l'on a bien de la peine à exécuter les actes d'une espèce, quand on est vivement touché des plaisirs d'une espèce différente. Il y a donc des plaisirs vertueux, puisqu'il y a des actions vertueuses : il y a aussi des plaisirs coupables, et dont on doit s'abstenir. Il suit de là que les plaisirs propres à l'homme de bien, au sage, sont les plaisirs véritables; les autres ne méritent ce nom que d'une manière secondaire ou relative, et non absolue. - VI. Une connaissance plus exacte de la nature du plaisir, nous met à même de mieux apprécier celle du bonheur. II est incontestablement du nombre des choses qu'on doit préférer pour elles-mêmes. En fait d'actions, par exemple, on pourra ranger dans cette classe celles où l'on ne cherche rien de plus que l'action ou l'activité elle-même. Celles qui n'ont pour but qu'un amusement frivole et passager, ne peuvent évidemment pas contribuer au bonheur: il faut donc préférer celles qui sont agréables à l'homme vertueux, c'est-à-dire, celles qui sont conformes à la vertu. - VII. L'activité purement spéculative, ou contemplative, est ce qu'il y a de plus éminemment propre à la nature d'un être doué de raison et d'intelligence : c'est donc dans l'exercice d'une telle activité qu'un tel être doit trouver le bonheur, puisque c'est par elle qu'il peut jouir des plaisirs les plus délicieux et les plus purs, de ceux qui méritent incontestablement la préférence, par la constance et la sécurité qui les accompagnent. Joignez à ces avantages d'une vie consacrée tout entière à l'activité purement contemplative, celui de se suffire complètement à elle-même. Mais une telle vie semble au-dessus de la condition humaine, et appartient peut-être exclusivement à la nature divine. Nous devons donc cultiver avec soin le principe sublime et divin qui fait partie de notre être, et nous appliquer, autant qu'il est possible, à nous rendre dignes de l'immortalité. - VIII. Si les vertus intellectuelles, qui ont un principe divin, sont au premier rang, les vertus morales, qui sont purement humaines, doivent être placées au second rang. Aussi le bonheur propre à la vie contemplative a-t-il moins besoin des biens extérieurs, que celui qui résulte de l'exercice des vertus morales. Dans celles-ci, il faut que les actes manifestent l'intention ou la volonté, ce qui n'est pas nécessaire dans la vie contemplative. Voilà pourquoi nous ne pouvons attribuer aux dieux les vertus morales, ni imaginer quels seraient en eux les actes de pareilles vertus, sans tomber dans des fictions absurdes ou ridicules. L'homme est donc une nature intermédiaire entre les dieux, qui ont l'activité contemplative dans toute sa pureté et dans toute sa plénitude, et entre les animaux, qui sont entièrement privés d'une pareille activité. Si les dieux prennent quelque soin des choses humaines, comme on doit le croire, sans doute ils voient avec faveur et ils récompenseront les hommes qui savent apprécier et qui s'appliquent à cultiver le principe qui leur est commun avec la nature divine. - IX. Il ne suffit pas de savoir ce que c'est que la vertu, il faut la pratiquer. Il y a des hommes qui naissent avec d'heureuses dispositions pour la vertu ; mais chez le plus grand nombre, elle peut être l'effet de l'instruction et des bonnes habitudes. Une surveillance commune, un bon système d'éducation publique, sont les moyens les plus propres à préparer la jeunesse aux habitudes vertueuses. Car l'autorité paternelle n'a pas communément la force nécessaire pour cela; il n'y a que la loi, qui n'excite aucun sentiment de haine en prescrivant ce qui est honnête et sage. La science de la législation est donc une de celles qu'il est le plus important de cultiver. Les sophistes, qui promettaient de l'enseigner, ont montré qu'ils n'en avaient aucune véritable notion. Ceux qui jusqu'à présent ont traité de la morale, ont entièrement négligé ce qui a rapport à la législation. Il convient donc de s'en occuper, si l'on veut perfectionner, autant qu'il est possible, la philosophie de l'humanité. Ce sera l'objet du traité qui suit immédiatement celui-ci [la Politique].
Commentaire de thomas d'Aquin
livre I :
leçon 1-
leçon 2 -
leçon 3 -
leçon 4 -
leçon 5 -
leçon 6 -
leçon 7 -
leçon 8 -
leçon 9 -
leçon 10 -
leçon 11 -
leçon 12 -
leçon 13 -
leçon 14 -
leçon 15 -
leçon 16 -
leçon 17 -
leçon 18 -
leçon 19 -
leçon 20
|