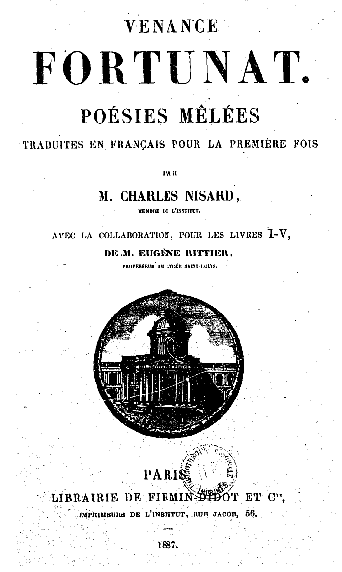POURQUOI FORTUNAT
N'A-T-IL JAMAIS ÉTÉ TRADUIT EN AUCUNE
LANGUE?
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE.
I.
Un assez grand
nombre d'auteurs ont parlé de Fortunat, et presque tous, les plus anciens
principalement, avec des éloges qui passent la mesure. Mettons à part
Grégoire de Tours, son correspondant et son ami, qui le pressa vivement de
publier ses poésies; car s'il est vrai que l'évêque les ait admirées, le
poète ne dit pas précisément en quels termes Grégoire lui témoignait son
admiration, il se borne à protester contre la bonne opinion que son illustre
ami a de son mérite, et à se défendre, tout en y obéissant, contre des
encouragements qui tentaient sa faiblesse, mais qu'il regardait comme des
ordres.
C'est ainsi, par exemple, que, pour le contenter, il fit des vers saphiques,
lesquels ne manquèrent pas, comme toute poésie exécutée à commandement,
d'être mauvais.
On se rend
mieux compte des louanges qu'il recevait de la reine Radegonde, fondatrice
et simple religieuse du couvent de Sainte-Croix de Poitiers, et d'Agnès,
abbesse de cette communauté. Il y est souvent fait allusion dans ses
poésies. Sortant de la bouche de deux personnes aussi considérables par
leurs dignités, leur caractère, leur esprit et leur savoir, ces louanges
souvent décochées, pour ainsi dire, à brûle-pourpoint, ne laissaient pas que
de mettre quelquefois à des épreuves fort délicates la modestie, d'ailleurs
très réelle, de notre poète. Nous voyons de plus, dans plusieurs de ses
poèmes adressés à de puissants personnages de la cour et du gouvernement de
Sigebert et de son fils, en quelle estime singulière il était auprès d'eux,
et quels efforts il faisait pour se diminuer, pour rabattre quelque chose de
leurs compliments, encore qu'il y entrât, sans qu'il s'en aperçût peut-être,
force eau bénite de cour.
Les jugements
des contemporains ne sont pas définitifs; il en est peu qui ne soient sujets
à révision. Il s'en doutait sans doute, et, par la manière dont il
réagissait contre les éloges, il semblait prévoir le sort qui les attendait
un jour à venir. Il ne se trompait pas tout à fait. La postérité commença
pour lui un siècle environ après sa mort, et ce fut Paul Diacre qui lui en
ouvrit les portes. Grâce à cet introducteur, qui n'avait rien négligé pour
tirer au clair son état civil assez embrouillé, et en qui commence la série
de ses apologistes,
la postérité ne montra pas seulement au poète la même faveur que celle dont
il avait joui de son vivant, mais, à partir de là jusqu'aux vingt-cinq
premières années du dix-septième siècle, elle prit et conserva l'habitude de
parler de lui comme elle eût fait d'un modèle en-toutes sortes de poésies.
Après Paul
Diacre viennent Hincmar,
Flodoard,
Aimoin,
Sigebert de Gemblours
et Tritheim.
Tous, en plus ou moins de paroles, tiennent un langage qui est comme un écho
multiple, d'autant plus fidèle qu'il a moins de sons à répercuter. Parmi ces
distributeurs d'encens, il en est à qui il semble monter à la tête, en même
temps qu'ils le dispensent à l'idole. Au commencement du seizième siècle, si
l'on en croit Pierre Crinito, Fortunat aurait été mis au rang des auteurs
classiques, ses hymnes étant en très haute recommandation auprès des
grammairiens d'Italie de cette époque,
et expliquées dans les classes. Comment croire qu'un poète coupable de tant
d'infractions à la grammaire latine ait eu un pareil crédit parmi ceux qui
étaient chargés de l'enseigner ? Selon Jérôme Bologni, poète trévisan,
Apollon et les Muses sourirent à la naissance de Fortunat, et le douèrent de
telle sorte que « ses hymnes pindaresques et célestes devaient rendre
modeste le poète de Vénouse ». Voilà Horace bien accommodé. Mais Bologni a
raison de louer Fortunat d'être resté pur, et de n'avoir chanté « ni les
exploits des forbans, ni les turpitudes des débauchés ». Sa muse, en effet,
si muse il y a, est d'une honnêteté et d'une chasteté irréprochable.
Gaspar
Barthius, ou Barth, est le premier qui ait mêlé un peu de critique à ces
éloges.
On sent avec lui qu'on entre dans le
xviie siècle. Il remarque que, né dans des temps
barbares et ennemis de toute science, Fortunat, avec toute la force de son
esprit, a plus corrompu la langue que tout autre moins favorisé que lui de
la nature. On ne pouvait mieux dire. Toutefois, cette critique est comme
noyée dans les louanges, et l'on se trouve à la fin en présence d'un poète
d'un savoir encyclopédique. Dupin
accorde qu'il approche des poètes d'un meilleur temps que le sien, a non
pas, ajoute-t-il, par la pureté des expressions, ni par la beauté des vers,
mais par le tour poétique et la facilité merveilleuse avec laquelle il écrit
en vers ». Tout cela n'est que jeu de mots. Qui dit pur dit clair, pour le
moins, et l’on tâtonne sans cesse dans les obscurités de Fortunat, et l'on
s'y perd souvent. Parler après cela de sa merveilleuse facilité, c'est comme
si l'on disait de Virgile et d'Ovide qu'ils sentent l'effort. Dom Ceillier
loue par-dessus tout la piété de Fortunat, qui était grande en effet, et
dont les témoignages abondent dans toutes ses œuvres poétiques; mais c'est
faire comme Simonide, et détourner sur l'esprit dont ces œuvres sont
pénétrées, l'hommage qu'elles lui semblaient ne point mériter d'ailleurs.
Dom Ceillier se montre, en effet, assez froid pour la poésie de Fortunat, et
se raille même un peu de ceux qui l'ont si fort exaltée. Cependant,
l'analyse suffisamment détaillée qu'il donne des pièces dont se compose
chaque livre du Recueil de notre poète prouve du moins qu'il l'a lu ; ce
qu'on ne saurait assurer de pas un des critiques, ses prédécesseurs.
Dans une
monographie de Fortunat, fort longue, fort érudite et très piquante, mais un
peu romanesque en ce qui touche la naissance, la famille et la patrie du
poète, Liruti
est si occupé à combattre les opinions confuses, mais reçues de son temps,
sur ces diverses circonstances et sur quelques autres encore, qu'il n'a
guère le loisir de s'engager dans un examen sérieux du talent poétique de
son auteur, et que les éloges qu'il lui décerne par occasion ne permettent
pas qu'on le déclare lui-même un apologiste de parti pris. Il paraît assez,
comme Dom Ceillier, avoir lu Fortunat; il y trouve également matière à
quelques critiques, mais elles n'ont pas le même poids.
De nos jours,
Fortunat a été le sujet de quelques études plus ou moins étendues; mais la
méthode et le caractère en sont plus relevés que les ébauches dont on vient
de parler, et l'intérêt qu'on y prend est autrement vif. Trois écrivains
d'un talent supérieur, Augustin Thierry, Ampère et Montalembert s'y font
principalement remarquer.
Augustin
Thierry n'a guère lu dans les poésies de Fortunat que ce qui se rapporte à
Radegonde, aux infortunes et au courage extraordinaire de cette princesse,
et à l'aimable familiarité dans laquelle elle vivait avec un poète qu'elle
aurait eu le droit d'appeler le sien, tant il l’a célébrée. Il y a aussi,
chemin faisant, recueilli maints passages ayant trait aux mœurs de Fortunat
sur qui celles des barbares avaient en partie déteint, et qui, de l'écolier
instruit et studieux des écoles de Ravenne avaient fait une manière
d'épicurien franc ou germain, toujours attiré vers les plaisirs de la table,
et victime quelquefois de ses excès.
Mais, au lieu d'insister sur ce vice et d'y trouver matière à de faciles
railleries, il se borne à le constater avec délicatesse et même avec grâce,
en philosophe indulgent et non pas en censeur austère. C'est ce qu'Ampère
qualifie d'optimisme et qu'il relève dans Augustin Thierry avec plus de
politesse que d'équité.
Quant à la valeur de Fortunat comme poète, Augustin Thierry ne paraît pas
s'en inquiéter; il s'en tient à ce qu'on peut tirer de ses poésies de bon
pour l'histoire, et il s'applique à le démontrer, au moins en tout ce qui
convient au sujet qu'il traite. On admire dans le savant historien avec quel
discernement il a choisi ses citations, avec quel art il les a disposées.
Cet art rappelle assez celui des prédicateurs qui prodiguent les citations
de l'Ecriture sainte, et savent si bien les ajuster à leur texte qu'elles
semblent y avoir leur place naturelle, l'Ecriture jusque-là n'en ayant eu
que le dépôt. C'est cette habile disposition qui donne un peu l'air de roman
aux charmants récits de l'historien, qui caractérise sa méthode et qui
exerce sur le lecteur une si grande séduction.
Ampère paraît
avoir vu Fortunat de plus près, sans pourtant l'avoir vu assez pour affirmer
qu'il le connaît bien.
L'homme ne lui inspire pas de sympathie, quoiqu'il soit très capable d'en
inspirer; mais il est de ceux dont la vie se prête davantage à une critique
spirituelle et amusante, et très propre par conséquent à donner de l'attrait
à des leçons publiques dont il serait l'objet. Par là, il devenait plus
intéressant aux yeux d'un professeur que d'un historien. Aussi, tout en
rendant hommage aux qualités de Fortunat, Ampère est au fond très sévère, je
ne dirai pas pour les mérites du poète qui n'ont pas plus à gagner aux
éloges qu'à perdre à la critique, mais pour l'homme privé sujet à de
mauvaises habitudes, comme par exemple la flatterie à outrance, et des
infractions à la sobriété, plus propres, dit-il, à un barbare sensuel qu'à
un épicurien délicat; sur ce dernier point, surtout, il répudie l'indulgence
qu'Augustin Thierry a montrée. Il y a du vrai sans doute dans cette
appréciation d'Ampère. Mais pourquoi ne pas mettre au compte du temps, comme
la vérité l'y obligeait, la plus grosse part de ces défauts qu'Ampère paraît
un peu trop attribuer à de mauvais penchants innés? Pour ce qui est de ces
défaillances morales, entre autres l'abus de la flatterie, qu'Ampère
reproche à Fortunat, à quel art autre que la flatterie le poète eût-il pu
demander main forte pour vivre en sûreté avec les puissants personnages dont
la protection était si nécessaire à lui étranger, et dont l'orgueil, ou se
fût offensé de louanges médiocres, ou n'eût rien compris aux louanges
raffinées; avec ces rois francs ou germains qui se trahissaient et
s'égorgeaient les uns les autres et qu'il n'eût pas été prudent d'avertir,
encore moins de réprimander? Fortunat n'avait point cet art; il était à la
fois bon et naïf, et, n'ayant jamais fait le mal dans une société où l’on ne
s'en gênait guère, il pouvait croire que, par l'excès de ses flatteries, il
empêcherait qu'on ne lui en fît à lui-même. Toute sa politique consistait
donc à ménager les partis et à avoir des casaques de rechange au cas où il y
aurait eu péril pour lui à porter toujours la même. Quant aux infractions du
poète à la sobriété, lesquelles, d'ailleurs, il avoue avec candeur, elles
ont fourni à Ampère l'occasion, de montrer beaucoup d'esprit aux dépens du
pécheur trop expansif, et cela en présence d'un auditoire dont les
plaisanteries sur les personnes et leurs infirmités ridicules ne manquent
guère d'exciter le rire et les applaudissements. A cet égard, il doit
quelque reconnaissance à Fortunat.
En écrivant la
vie si dramatique et si touchante de sainte Radegonde, dans les Moines
d'Occident,
Montalembert rencontre naturellement Fortunat sur son chemin. Il lui
emprunte quelques passages relatifs aux terribles catastrophes qui ont forcé
cette reine à se réfugier dans le cloître, et dispersé les restes de sa
famille échappés au fer des Francs. Il dit quelques mots des billets
familiers de Fortunat à la sainte recluse du monastère de Sainte-Croix de
Poitiers, et à l'abbesse Agnès; il rappelle les soins vigilants et gracieux
dont elles l'entouraient, et, en bornant là ce qu'il ne pouvait s'empêcher
de dire pour les besoins de son sujet, il montre assez qu'il a négligé de
lire ce qui ne s'y rapportait pas, c'est-à-dire plus des trois quarts des
poésies mêlées de Fortunat. Il y a tout au plus jeté un coup d'œil,
suffisant toutefois pour lui faire trouver à redire aux souvenirs classiques
que Fortunat introduit trop souvent dans des vers tout remplis des
témoignages de sa foi catholique. D'ailleurs, à l'exemple d'Ampère et
d'autres encore, qui ne se sont pas mis en peine de prouver cette assertion,
il croit Fortunat auteur de deux pièces
« où, dit-il, il fait parler Radegonde dans des vers où respire le sentiment
d'une véritable poésie, d'une poésie toute germanique de ton et
d'inspiration ». Rien n'est plus vrai; mais est-ce que Radegonde elle-même
ne faisait pas des vers, « des grands et des petits », comme le dit
Fortunat, et ces vers, de l'aveu de notre poète, n'étaient-ils pas
excellents?
Pourquoi donc n'aurait-elle pas fait ceux qu'on persiste à donner à
Fortunat? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il les a revus et chargés un peu
de sa rhétorique; il me semble, en effet, le reconnaître à certains traits
déclamatoires et ampoulés du genre de ceux qui lui sont habituels. Quant au
fond, qu'on veuille bien lire ces pièces avec soin, et l'on verra que le
sujet dont l'auteur s'est inspiré n'est pas de ceux qui se puissent traiter
par procuration. Mais ce n'est pas le moment d'insister là-dessus.
En 1847, M.
l'abbé Maynard soutint, à la Faculté des lettres de Poitiers, une thèse
latine sur Fortunat.
Le sujet n'y est qu'effleuré et n'offre rien de nouveau, bien que l'auteur
en eût certainement trouvé, s'il eût eu la patience de le chercher. Il
connaissait sans doute les écrits d'Augustin Thierry et d'Ampère mentionnés
plus haut, mais il n'avait guère à s'en souvenir, car sa thèse est plus
remplie du personnage ecclésiastique que du poète, et celui-ci n'eût
peut-être pas obtenu de M. l'abbé Maynard toute l'estime dont il est
l'objet, si la plupart de ses pièces n'eussent porté la forte empreinte de
sa foi catholique et du caractère sacré dont il était revêtu. Il est donc
douteux que les défauts du poète, dont les principaux semblent bien n'avoir
pas échappé à M. l'abbé Maynard, fussent devenus à ses yeux des qualités,
sans les mérites du prêtre qui leur valaient cette indulgence.
C'est dans le
même esprit, mais avec plus de méthode et surtout avec plus de sens
critique, que M. l'abbé Hamelin a traité le même sujet, dans une thèse
latine soutenue par lui à Rennes en 1876.
Elle est divisée en deux parties. La première est un résumé des faits qui
concernent la vie, la famille et le pays de Fortunat. L'auteur s'y autorise
tout simplement des témoignages de Paul Diacre, de Brower, de Lucchi, de
Liruti, de Grégoire de Tours, d'Hincmar, etc., joints à ceux qu'on doit à
Fortunat lui-même, et qui se trouvent soit dans ses poésies mêlées, soit
dans sa Vie de saint Martin; il y a rien de plus, rien de
moins, ce sont de simples répétitions. Pour la seconde partie, toute
consacrée aux écrits du poète, M. l'abbé Hamelin a mis à contribution les
ressources que lui offraient l’Histoire littéraire de la France et
les Récits d'Augustin Thierry. Pour avoir interrogé l'un et l'autre
avec une réserve qu'on pourrait qualifier d'abstention complète, M. l'abbé
Maynard a beaucoup diminué l'intérêt de sa thèse, laquelle en a contracté
même quelque aridité. Au contraire, celle de M. l'abbé Hamelin, par
l'excellent usage qu'il y est fait de ces deux documents, est plus
substantielle, plus dégagée et plus attrayante. Il y fait une remarque qui
peut passer pour neuve, et que j'ai moi-même faite souvent, en lisant et en
étudiant Fortunat; c'est qu'il y a dans ce poète une véritable originalité.
J'ajoute que cette originalité est surtout dans le caractère de l'homme, les
vers du poète ne pouvant être appelés originaux, par cela seul que leur
incorrection et leur rudesse ne les font ressembler à nuls autres. Ce
caractère, mélange de sensibilité, d'enjouement et de bienveillance, dut
faire, comme il fit en effet, du poète, un compagnon des plus agréables et
des plus recherchés. On a peine à se figurer que dans une société grossière
comme celle où vécut Fortunat, et où les accès de gaîté étaient plus ou
moins des actes de violence, cet homme ait pu avoir et ait su garder une
gaîté douce et naturelle. Telle était pourtant celle de Fortunat. Elle nous
rappelle, bien qu'elle en diffère du tout au tout et par l'esprit, et par le
genre de poésie où elle se manifeste, la bonne humeur dont Lucilius
tempérait l'âpreté de ses satires, et par laquelle il charmait et déridait
les Lélius, les Scipion et autres graves Romains de son temps. Et si on
cherchait vainement dans les poésies mêlées de Fortunat le sel et l'urbanité
que Cicéron et Horace remarquaient dans celles de Lucilius; si, plus
vainement encore au latin dégénéré et comme tombé en enfance du panégyriste
des rois mérovingiens, on demandait quelque chose de cette connaissance
supérieure de la langue latine qu'Aulu-Gelle (XVIII, 5) admire dans le
satirique romain, on y trouverait du moins de la finesse en certains
endroits, delà délicatesse et même de la grâce.
La
bienveillance, ou, pour mieux dire, la bonté de Fortunat ne contribua pas
moins à le rendre populaire parmi ses contemporains les plus illustres, que
son enjouement.
Toutefois elle
avait le défaut d'être banale, de se prodiguer avec excès, et finalement de
dégénérer en une flatterie outrée, où il a bien l'air d'oublier jusqu'au
sentiment de sa dignité personnelle. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire
là-dessus à la décharge de Fortunat; mais ce n'est pas ici le lieu.
M. Ebert est
le premier qui, pour venir après tous les autres critiques de Fortunat,
donne une idée juste de ses poésies, et qui le fait avec brièveté.
Il n'est pas, comme Ampère, toujours à la recherche de l'esprit et de
l'effet, mais il ne manque pas de bonne humeur et sait, à l'occasion,
caractériser le poète et son œuvre par un mot pittoresque et vrai. Sa
critique est savante, et charme autant qu'elle instruit. Peut-être la
trouverait-on un peu complaisante; tel est du moins mon humble avis; mais
elle a en somme assez d'autorité pour nuire au succès des objections qu'on y
pourrait faire, et par conséquent pour avoir le dernier mol. M. Ebert a fait
une étude de Fortunat, de son esprit et de son style, aussi approfondie que
s'il eût eu le dessein de le traduire, en tous cas avec la conviction qu'il
n'était pas possible d'en parler pertinemment, si l'on ne se l'était rendu
familier à force, pour ainsi dire, de petits soins, et si l'on ne s'était
nourri de sa substance.
Les poésies de
Fortunat communément et avec raison nommées poésies mêlées, le sont en effet
à tous égards. Une circonstance quelconque les fait naître, et elles
viennent se ranger les unes à la suite des autres sans qu'il y ait, la
plupart du temps, le moindre lien entre elles. A l'exception du quatrième
livre composé exclusivement d'épitaphes, et de l'Appendix dont toutes les pièces sont adressées à
Radegonde et à Agnès, sauf aussi un petit nombre de pièces qui, dans les
autres livres, se rapportent aux mêmes sujets et se suivent naturellement,
tout le reste est un pêle-mêle où il semble bien que les copistes de ces
poésies aient plus de part que le poète lui-même. Comme d'ailleurs, ainsi
qu'on l'a bientôt reconnu, il y a dans ce désordre matériel nombre de pièces
qui appartiennent à un genre déterminé, M. Ebert les a divisées en
catégories. La première consiste en panégyriques. De hauts personnages, tels
que des rois, des reines, des princesses, des fonctionnaires, comme on
dirait aujourd'hui, des évêques, des abbés, etc., en sont habituellement
l'objet. Le poète y chante leurs louanges dont il n'exempte même pas leurs
qualités physiques, allant jusqu'à établir des rapports entre celles-ci et
leurs qualités morales. Parfois ces louanges sont tellement outrées et
démentent si audacieusement l'histoire que, n'osant croire que l'auteur ait
menti sciemment, on conclut qu'il a dû ignorer de la vie de certains
personnages les faits qui contredisent avec éclat ses - assertions. C'est ce
qu'on remarque surtout dans les poèmes à la louange de Caribert,
Chilpéric et de Frédégonde; car pour ceux qui regardent Sigebert et
Brunehaut, Fortunat les ayant écrits à la cour de ce prince auquel il avait
de grandes obligations, il est excusable d'avoir puisé dans son enthousiasme
reconnaissant des motifs de donner plus d'essor à son penchant naturel pour
la louange et pour la flatterie.
M. Ebert range
dans la catégorie des panégyriques le poème en l'honneur de la Virginité
(VIII, 3) ; tel est bien en effet son caractère, et d'ailleurs l'on
conviendra que s'il est une vertu louable par-dessus toutes les antres,
c'est celle dont saint Augustin, parlant des vierges, a dit : « qu'elles ont
en la chair quelque chose qui n'est point de la chair, quelque chose qui
tient de l'ange plutôt que de l'homme.
» Dans ce poème, « l'auteur, dit M. Ebert (t. I, p. 558), peint avec des
couleurs peut-être un peu trop sensuelles l'amour des religieuses pour le
fiancé céleste, ainsi que la récompense réservée dans le ciel à la chasteté.
» Cela est vrai ; mais avec ou à part cela même, ce poème, pour dire ce que
j'en pense, est certainement l'œuvre la plus singulière du poète, et
peut-être, malgré la banalité d'un sujet déjà traité par saint Basile, saint
J. Chrysostome, Tertullien, saint Augustin et saint Ambroise, la plus
originale. Il y a là, notamment, un parallèle entre la condition de la
vierge et celle de la femme mariée, où, par des raisons physiologiques d'une
vérité cruelle et-sans idéal, le poète démontre les avantages de la
virginité sur un état où il a fallu nécessairement en faire le sacrifice.
Avec des couleurs qui ne sont point celles de l'Albane, mais qui
rappelleraient plutôt le sombre naturalisme de l'Espagnollet, il peint les
suites ordinaires de ce sacrifice, la grossesse et l'espèce de honte que la
femme grosse éprouve en présence des hommes, l'accouchement, l'allaitement,
la mort du premier né, le veuvage où la femme cesse d'être épouse sans
pouvoir redevenir vierge. Pour tous ces détails dont quelques-uns sont
véritablement émouvants, Fortunat s'est évidemment inspiré de saint Ambroise
qui, dans son traité
de
Virginitate,
fait le même parallèle.
En outre, il y
a dans ce poème de véritables beautés poétiques, beautés de forme et beautés
de sentiment. Au début, le poète nous introduit dans la cour céleste au
moment où elle est assemblée pour recevoir la vierge récemment arrivée au
ciel, et destinée à être l'épouse du Christ. Il donne entre autres des
détails gracieux et très intéressants au point de vue de l'art, sur la
toilette de la fiancée, il rappelle ses combats sur la terre et ses
souffrances pour se garder pure et digne de son divin époux, ses entretiens
mystiques avec lui, les consolations et la force qu'elle y puise, et enfin
son triomphe. Des images tour à tour éclatantes et pompeuses colorent et
animent toute cette poésie, et laissent à peine le temps d'apercevoir sous
leur brillant les duretés et les incorrections de style habituelles à
Fortunat.
Malgré tous
ces mérites, ce poème ne me touche pourtant pas d'une manière aussi vive et
aussi continue que les poèmes sur Galsuinthe (VI, 5), et sur la ruine de la
Thuringe (Append. i).
Les beautés sont là d'un ordre si supérieur et si dramatique, on les
attendait si peu du talent, du caractère, et j'ajoute du tempérament de
Fortunat, que les critiques, y compris M. Ebert, semblent s'être un peu trop
complaisamment mis d'accord, pour lui faire les honneurs de ces deux
touchantes élégies. J'ai dit précédemment les raisons qui me portent à
différer d'opinion avec eux à cet égard; je n'y reviendrai pas, mais je
dirai de plus que si, par le seul fait de maintenir ces poèmes à la place
qu'ils occupent parmi les poésies de Fortunat, je parais me ranger moi-même
à cette opinion, c'est moins par conviction que par respect humain.
M. Ebert s'est
si bien pénétré de son auteur, il en a si bien pesé les mérites et les
défauts que, sauf sur un point seulement, où je me permets de n'être pas de
son avis, et dont je parlerai tout à l'heure, il n'y a pas un mot à redire
dans ses jugements, et qu'en général on peut s'en reposer sur lui. Ainsi on
ne le contredira pas quand il dit que les épitaphes se rattachent aux
panégyriques; on pourrait même ajouter que c'en est la quintessence. La
rhétorique de Fortunat, jointe à un besoin de louer qui ne se peut assouvir,
y prend toutes ses aises, et soit qu'il loue en son nom, soit qu'il loue au
nom d'autrui, soit enfin qu'il le fasse, pour ainsi parler, sur commande,
il s'en donne à cœur joie et déborde. Mais ses épitaphes, si enflées et si
longues qu'elles soient, laissent le lecteur froid sinon incrédule, et ne
sont pas propres à lui faire oublier le dicton : Menteur comme une épitaphe.
Je passe, plus
rapidement encore que M. Ebert, sur les épigrammes, petites pièces qui ne
sont que de simples inscriptions où la raillerie et le trait n'ont point de
part, sur les pièces lyriques, sur les hymnes que tout chrétien sait par
cœur, sur les descriptions de voyages, sur les lettres missives et sur
d'autres pièces qui ne se rattachent à aucun genre spécial, et j'arrive à
celles qui sont de la catégorie des billets, c'est-à-dire de ces petites
lettres qui n'évoquent pas l'idée de correspondante, qu'on écrit à la hâte,
stans pede in uno, pour faire un compliment, annoncer l'envoi ou la réception de
quelque présent, charger d'une commission ou rendre compte de celle dont on
a été chargé, enfin adresser une prière ou un remerciement. Tels sont les
billets adressés à l'évêque Grégoire; tels aussi ceux adressés à Radegonde
et à Agnès. Ces derniers offrent, il est vrai, un mélange singulier de
tendresses telles qu'en comportent les billets les plus doux, et d'effusions
pieuses; on en est même tout d'abord et, eu égard à la qualité des
personnes, assez scandalisé. Mais à y regarder de près, on n'y voit que les
naïfs épanchements d'un cœur reconnaissant. Les attentions charmantes dont
le comblaient deux femmes aux yeux de qui la grâce aimable n'était pas
incompatible avec le cloître, exaltaient en quelque sorte celui qui en était
l'objet, et il profitait de la liberté autorisée, par le latin pour donner à
ce qui n'était qu'une vive mais chaste amitié le nom d'amour, et pour
appliquer les termes de ce langage profane aux sentiments de la plus pure
mysticité.
Dirai-je que
dans ces mêmes billets il est souvent question de l'appétit du poète, et des
aventures de son estomac au milieu des tentations de la bonne chère?
Dirai-je qu'en dépit de la tournure humoristique qu'il donne à ses récits,
encore que Radegonde et Agnès qui, en leur qualité de Germaines, n'étaient
pas sur ce point très collets montés, s'en divertissent peut-être, il s'y
oublie jusqu'à décrire en termes d'une crudité parfois grossière les
opérations ardues de sa digestion (XI, 22, 23), et ces terribles lendemains
qui succèdent à la crapule de la veille. Pendant son séjour assez long dans
une cour et dans une société germaines, il avait contracté l'appétit des
gens de cette nation, laquelle, comme les Thraces, ne passait pas pour un
modèle de sobriété, et il lui arriva plus d'une fois d'être incommodé d'un
régime trop brutal pour un homme qui, comme les ruminants, n'avait pas
plusieurs estomacs.
M. Ebert
s'étonne que Fortunat, malgré le talent qu'il a montré dans certaines
parties, ne se soit exercé qu'une seule fois dans la poésie lyrique des
anciens. Pourquoi cet étonnement? Fortunat ne nous dit-il pas lui-même qu'il
n'avait pas les ailes assez fortes pour voler à cette hauteur, et celle
espèce d'ode en vers saphiques, obscur et pompeux galimatias, qu'il écrivit
malgré Minerve et seulement pour obéir à Grégoire de Tours, est-elle autre
chose qu'une preuve de son impuissance à déférer convenablement à cet ordre?
Ah! qu'il aimait bien mieux faire des acrostiches en forme de croix, et
s'amuser à des jeux de versifications qui sont à la poésie ce que les
calembours sont à l'éloquence, à affronter les difficultés de l'épanalepse,
à s'admirer dans les combinaisons de plusieurs mots de suite commençant par
la même lettre c'est-à-dire dans l'allitération, enfin dans « les
métaphores, images et comparaisons poussées jusqu'au pathos, etc. »!
Les choses
étant ainsi, comment M. Ebert a-t-il pu dire (t. I, p. 575) : « Si nous
jetons ici un coup d'œil général sur les productions poétiques de Fortunat,
nous devons avouer, n'y eût-il d'autre preuve que celle qui est fournie par
tous ces artifices oratoires, que cet auteur possédait un grand talent pour
la forme, et qu'il avait par conséquent une véritable aspiration à trouver
l'expression poétique. » J'en demande pardon à M. Ebert, mais je ne saurais
souscrire à cette opinion. Trouver l'expression poétique n'est rien, si elle
est vide de sens, si l'idée qu'elle revêt n'est qu'un lieu commun, si elle
trahit des efforts pénibles pour la découvrir, si le défaut de discernement
ou la négligence se fait remarquer dans le choix dont elle est l'objet, si
les mots y perdent leur propriété ou y contractent des associations
contraires à leur génie naturel, si enfin elle n'est qu'une musique aux sons
cadencés et bruyants pareils à ceux que produisent les marteaux de plusieurs
forgerons frappant ensemble sur une enclume.
Ce sont là les traits qui, avec quelques autres, distinguent toute poésie de
décadence, ce sont ceux, à de notables exceptions près, de la poésie de
Fortunat. A ce titre il est un ancêtre de plus d'un de nos poètes
contemporains, parmi lesquels il en est qui ne sont pas des moins fameux.
Il reste à
parler des éditions, avec notes et commentaires,
des poésies de Fortunat. La première édition complète est due au Père
Brower. Outre quelques manuscrits interrogés par lui pour la première fois,
entre autres et principalement le manuscrit de Saint-Gall, il recueillit un
certain nombre de pièces publiées isolément, et en composa l'édition qu'il
donna en 1603, puis en 1617. Malheureusement, les notes et commentaires dont
il l'accompagna laissent beaucoup à désirer sous le rapport de l'exactitude
historique et de la clarté. Tantôt elles sont d'une prolixité fatigante,
tantôt d'une brièveté dont on ne peut rien tirer de ce qu'on est avide ou de
ce qu'il importe surtout de savoir. Les conjectures et les assertions
téméraires y sont nombreuses; il y a aussi de grosses erreurs de faits. Les
corrections du texte n'en sont pas moins très heureuses et excellentes pour
la plupart. Ce premier nettoiement, pour ainsi dire à grande eau, des
ordures qui salissaient ce texte, est le premier et le plus grand service
qui ait été rendu au poète, et pour lequel le savant jésuite a bien mérité
de lui. Désormais la voie était déblayée, il n'y avait plus qu'à suivre
l'audacieux qui s'y était engagé. C'est ce que fit Michel-Ange Lucchi, moine
du Mont-Cassin. Son édition de Fortunat parut à Rome en 1786, c'est-à-dire
cent quatre-vingts ans après la première de Brower.
Lucchi adopta
et reproduisit l'édition de son prédécesseur sans y faire aucun changement.
Mais, comme il avait pu consulter des manuscrits que Brower n'avait pas
connus, il en tira des leçons nouvelles que, par déférence peut-être pour
celui-ci, il se contenta d'indiquer dans ses notules. Seulement, et ses
grandes connaissances en histoire, principalement en l'ecclésiastique, l'y
autorisaient, il ne se fit pas scrupule de signaler les erreurs où, faute
des mêmes connaissances, Brower était assez fréquemment tombé. Il eût bien
fait de pousser plus loin sa critique, en écartant de son texte nombre de
pièces attribuées à tort à Fortunat ou, pour le moins, fort suspectes, que
Brower avait trop facilement mêlées aux pièces authentiques. Un autre après
lui, et longtemps après lui, M. Frédéric Léo, les reléguera dans un
Appendix spuriorum, où elles demeureront en quarantaine jusqu'à
production de leur patente nette.
En 1881, il y
avait quatre-vingt-quinze ans que l'édition de Lucchi avait paru, lorsque M.
Frédéric Léo donna la sienne qui fait partie des
Monumenta Germaniæ historiœ
en cours de
publication à Berlin. Le savant éditeur en indique les éléments dans sa
préface. Il a consulté une douzaine de manuscrits, entre autres les deux
moins mauvais, celui de Paris sous le numéro 13048, d'où feu Guérard, de
l'Académie des Inscriptions, a tiré les nombreuses pièces qui figurent dans
le premier
Appendix
de l'édition Léo,
et celui de Saint-Pétersbourg, qui date du huitième siècle. Il va de soi que
ni Brower, ni Lucchi n'avaient jamais seulement ouï parler du premier de ces
manuscrits ni du second. Les manuscrits autres que les douze cités plus
haut, M. Léo les indique sans les décrire, et il en désigne encore six qui,
ayant été décrits par différents critiques, n'avaient pas besoin, dit-il, de
l'être de nouveau. Pour les éditions, il a fait usage de celle de Venise,
qui, à son avis, a toute la valeur d'un manuscrit, et de celles de Brower et
de Lucchi.
Tant de
manuscrits, pour un auteur de l'espèce de Fortunat, démontrent assez
l'estime singulière dont il a joui à travers les âges, et expliquent en même
temps l'état de corruption, où le maintenaient, en l'aggravant, les copistes
par les mains desquels il a dû passer. Il semble, en effet, que l'ignorance
des copistes croissait en raison du nombre des copies. S'il arrivait à l'un
d'eux d'être frappé de quelque faute, il ne la corrigeait que pour la rendre
pire, ou il lui en substituait une nouvelle qui ne valait pas davantage. On
se rend compte de tout cela, en lisant les innombrables variantes
recueillies par M. Léo, et du sein desquelles on n'est jamais bien sûr
d'avoir déterré la meilleure. On penserait que les copistes de Fortunat
étaient recrutés à dessein parmi les moins lettrés, et que cette besogne
leur était imposée pour pénitence. Quant à moi, j'ose n'en pas douter. Quoi
qu'il en soit, si Fortunat, aux époques où il était l'objet de toutes ces
transcriptions, était populaire en quelque sorte parmi les gens lettrés, il
dut cette faveur plutôt au préjugé qui continuait à le tenir pour un
excellent poète, qu'à l'examen sérieux et à l'intelligence de ses écrits.
Cette dernière tâche devait être celle de ceux qui l'ont publié, annoté et
commenté. Je dirai plus tard comment ils s'en sont acquittés. Revenons à M,
Frédéric Léo.
Outre les
leçons, en nombre infini, comme je l'ai remarqué ci-devant, qu'il a tirées
des manuscrits, et qu'il a citées, sans en avoir, selon toute apparence,
omis aucune, il a récolté avec un égal scrupule ce qu'on appelle moins des
leçons que des corruptions de leçons, telles que mots désorganisés ou de
constitution avortée, particules de mots réduits quelquefois à une lettre
seule, tronçons impossibles à rattacher à aucun corps, mots divers fondus en
un seul avec perte pour chacun d'eux d'une ou plusieurs de ses parties, et
formant des espèces de monstres qu'on ne peut dénommer. On n'en a jamais
fait autant pour Cicéron, par exemple, dont Orelli a rassemblé tant de
variantes qu'on n'ose pas jurer que nous n'ayons pas un Cicéron de sang
mêlé. Certainement, la plus grande partie de ces énormités des manuscrits de
Fortunat n'ont apporté que peu de lumière à l'éditeur, tout au plus en
a-t-il jailli quelques étincelles; mais il n'y a pas moins eu je ne sais
quoi de chevaleresque de la part de M. Léo à s'engager dans ce fouillis
capable de décourager même les fées. Ajoutons qu'il a introduit quelquefois,
parmi les variantes, des notes explicatives très brèves, dont il lui a
semblé que le texte avait trop manifestement besoin, sous peine de s'exposer
au reproche d'avoir agi à l'égard de certains galimatias comme les
théologiens du moyen âge à l'égard du grec, et de s'être tiré d'affaire par
un
transeamus. Il est à regretter seulement qu'il n'ait pas donné ces
explications aussi souvent qu'elles étaient nécessaires, car il y fait
preuve d'une grande sagacité; c'est sans doute parce qu'elles eussent trop
grossi son édition, ou qu'il a voulu laisser aux futurs critiques du texte
de Fortunat le mérite d'achever ce qu'il a seulement ébauché.
Enfin M. Léo a
séparé et rendu à leur division naturelle quelques pièces réunies à tort
sous un seul titre par les précédents éditeurs. J'ai déjà dit qu'il avait
éliminé et réuni dans un appendice celles indûment attribuées à Fortunat;
j'ajoute qu'il croit trouver la preuve de cette fausse attribution dans la
liberté extrême dont on en use dans ces pièces avec la prosodie. Il est
pourtant bien vrai que, sous ce rapport, Fortunat ne s'est pas toujours fort
gêné avec les règles. Trois indices terminent cette édition. On a eu raison
de dire que les indices sont l'âme des livres, et pour ma part j'admire ce
genre de travail parce que j'en comprends la délicatesse et les difficultés.
Celles qu'offrent les poésies de Fortunat sont si minutieuses et si
considérables qu'elles en sont presque rebutantes; M. Léo les a
glorieusement vaincues. Il n'eut pas mieux travaillé et avec plus de succès,
s'il eût fait ces indices sur un livre qu'il eût composé lui-même.
Ces
préliminaires étaient une introduction nécessaire à ce qu'il me reste à dire
sur les causes qui ont empêché jusqu'ici les savants de tous pays de
traduire Fortunat chacun en sa langue. Ces causes se peuvent réduire à une
seule: l'insuffisance ou l'impuissance des anciens éditeurs à éclaircir le
texte, c'est-à-dire à expliquer- les nombreux passages dont l'extrême
obscurité arrête à chaque instant le lecteur et le plonge dans le dégoût et
le découragement. Car, dit le savant et regrettable philologue Louis
Quicherat, « faire comprendre intégralement les auteurs qu'on édite est une
tâche plus ardue et plus méritante que de recueillir seulement les
différentes leçons des textes ou des manuscrits
». En effet, on vient aisément à bout de cette dernière besogne, avec une
grande pratique des manuscrits, de la patience et du temps devant soi.
II.
Malgré les
travaux considérables dont Fortunat, ainsi qu'on l'a fait voir précédemment,
a été l'objet, malgré tous les efforts tentés pour le rendre plus
intelligible, malgré tous les éloges dont on l'a comblé, malgré, enfin, tous
les renseignements précieux qu'on en a tirés pour l'histoire de son temps,
il n'a pas encore eu l'honneur d'être traduit en aucune langue.
Il n'en aurait pas été ainsi peut-être si quelque habile érudit du
commencement du seizième siècle eût osé faire ce qu'ont fait depuis Brower
et Lucchi. Mais il n'y avait pas là de quoi tenter des hommes amoureux du
style avant tout, et dont la passion ne pouvait être satisfaite que par
l'étude, à peu près exclusive, des écrivains classiques, soit pour se former
le style sur celui de ces modèles, soit pour guérir les blessures que
d'ignorants copistes leur avaient faites. Admettons, cependant, que la
curiosité des critiques de la Renaissance ait été attirée sur Fortunat; qu'y
eussent-ils trouvé? Une latinité barbare et un texte qui n'était qu'une
plaie. En eût-il été autrement, que les délicats de ce siècle n'eussent pas
jugé digne de leurs études un poète dont, le vol ne faisait que raser la
terre et la plume torturer la poésie. Ils avaient tant d'autres malades plus
intéressants et plus pressés, qu'ils abandonnèrent celui-là à des médecins
subalternes ou moins dédaigneux, s'il avait la chance d'en rencontrer.
Il en
rencontra, en effet, qui, pour s'être fait longtemps attendre, ne laissèrent
pas que de l'arracher des limbes où il expiait les difficultés de son abord,
et où l'indifférence ou le mépris l'avaient condamné. Brower fut le premier,
Lucchi le second, enfin, et longtemps après eux, Guérard, pour les pièces
restées inconnues aux deux autres, qu'il découvrit et publia en
1831, pour la première fois,
dans, les Notices et Extraits des manuscrits, t. XII. Mais,
quelque méritoires que soient leurs commentaires, notes et éclaircissements,
ils n'ont, jusqu'ici, décidé personne à traduire leur auteur. Serait-ce donc
qu'ils n'ont point fait assez pour cela?
J'ai déjà dit,
d'après L. Quicherat, qu'il y a plus de mérite pour un éditeur à faire
comprendre dans toutes ses parties son auteur, qu'à en recueillir et à en
accumuler les variantes. A quoi bon, en effet, mettre vingt manuscrits au
pillage, en extraire et faire défiler sous nos yeux des leçons qui se
contredisent presque aussi souvent qu'elles s'accordent, et introduire les
unes dans le texte et laisser les autres à la porte, trois opérations
toujours faciles quand il ne s'agit que de simples mots, si l'on néglige,
d'ailleurs, d'expliquer des phrases, des passages même qui sont de
véritables énigmes, et sur lesquels le lecteur reste l'œil fixe et la bouche
béante? N'est-ce pas dire, ou à peu près, qu'on ne se tait sur ces passages
que parce qu'il est aisé de les comprendre, qu'on les comprend bien
soi-même, et que le lecteur sera sans doute aussi pénétré de leur clarté?
Mais c'est trop présumer à la fois du lecteur et de soi-même ; car, lorsque
je vois sur tous les passages obscurs et rebutants, comme ceux dont Fortunat
est rempli, les commentateurs glisser tour à tour avec la même insouciance,
j'en conclus volontiers qu'ils ne les ont point entendus, et que le
monologue qui se fait dans leur for intérieur est à la fois une manière de
dissimuler leur impuissance et une impertinence. Certes, tout lecteur ne
peut qu'être flatté de la bonne opinion qu'on a de son intellect; mais,
n'est-ce pas agir envers lui comme un banquier qui tirerait une lettre de
crédit sur un correspondant dont l'argent ne serait pas prêt, ou qui même
n'en aurait pas du tout?
Ce qu'on dit
ici des passages difficiles que l'indifférence où l'incapacité relative des
commentateurs abandonne à notre compréhension, peut également, et jusqu'à un
certain point, se dire des simples mots; car s'il est vrai que par leur
isolement ils offrent plus de prise à la réforme, il est aussi vrai que, vu
le nombre infini de variantes dont ils sont l'objet, il serait à peu près
impossible de ressaisir la personnalité de chacun d'eux, si l'on ne se
résolvait à leur imposer, en quelque sorte d'autorité, des corrections
radicales dont le sens général de la phrase pût logiquement s'accommoder, et
auxquelles le lecteur fût amené, sans efforts, à acquiescer. Loin de blâmer
ce procédé, surtout lorsqu'on a affaire à un auteur aussi mutilé que
Fortunat, je regrette que ses éditeurs, y compris M. Léo, n'aient pas montré
plus souvent un peu de cette hardiesse que le grand Scaliger avait avec
excès, mais dont tant d'auteurs anciens se sont si bien trouvés.
On peut, en
dépit d'un rigorisme qui exigerait le même traitement pour les désordres
constitutionnels d'un mauvais auteur que pour ceux d'un bon, on peut,
dis-je, se permettre sur le premier, dont la santé après tout nous importe
le moins, des expériences qu'on ne se permettrait pas sur l'autre. Avec un
Fortunat, on ose bien des choses qu'on n'oserait pas avec un Virgile. Il y
a, par exemple, telles corrections radicales dans Fortunat, que M. Mommsen a
suggérées à M. Léo, qui, si elles ne sont pas de génie, le génie étant un
bien gros mot pour une si petite chose, sont au moins d'intuition
supérieure. Toutefois, il y reste encore un très grand nombre d'expressions
et de phrases bien malades, autant des remèdes qu'on leur a appliqués que
par la faute du temps et des copistes. Je suis bien loin de croire au succès
des remèdes que je me propose d'essayer sur quelques-unes; mais, après
avoir, comme je l'ai fait, lu à fond, relu et traduit les onze livres
des poésies mêlées de Fortunat et leur Appendice, après avoir apporté à ce
travail un peu de cette passion pour les découvertes qui, sauf la différence
énorme du but, anime le grammairien comme l'astronome, j'ai cru être en
mesure de donner quelques exemples choisis parmi une centaine et plus, des
omissions, des timidités puériles, parfois même des fautes d'interprétation
que je reprochais plus haut aux éditeurs et aux commentateurs.
N° 1.
— Dans la pièce xvi de
l'Appendice, on lit les vers 10 et 11, qui suivent :
Hic
quoque sed plures carmina jussa per annos;
Hinc
rapias tecum quo tibi digna loquor.
Le premier
vers cloche d'un demi-pied et n'a ni sujet, ni verbe. Guérard, qui le donne
tel que le manuscrit le lui a offert, ne remarque pas même cette anomalie,
ou, s'il l'a remarquée, il la laisse passer avec une froide courtoisie. M.
Léo pense qu'au lieu de carmina jussa, il faut lire selon
toute apparence camina justa. Je confesse que cela ne
m'apparaît point du tout. Qu'est-ce que camina? Est-ce un nom au
pluriel neutre s'accordant avec justa. Le singulier serait
donc caminum, or caminum est le nom latin de Cumin,
ville prussienne sur le lac de ce nom. Est-ce un nom féminin au nominatif?
On trouve, en effet, dans Du Cange, deux exemples de ce nom, l'un qui paraît
indiquer un instrument à vanner, l'autre qui est un synonyme de curia.
Ni l'un ni l'autre n'ont rien à faire ici. S'agit-il de camina
impératif de caminare? Encore moins; outre que la quantité de la
première syllabe proteste contre son admission. Laissons donc carmina,
et voyons pourquoi.
Notre poète
dit en quelques pièces de son recueil qu'il fait des vers pour obéir aux
ordres de Radegonde et d'Agnès, il le leur redit ici, et, de plus, qu'il en
fait ainsi depuis plusieurs années. Il prie donc l'une ou l'autre (car on ne
voit pas précisément à laquelle des deux il s'adresse) de prendre (rapias)
ceux qu'il leur offre, n'y ayant rien qui n'y soit digne d'elles.
Fortunat a donc du écrire, et il a certainement écrit :
Hic
quoque sed plures [ago] carmina jussa per annos.
Le copiste de
la pièce du manuscrit d'où Guérard l'a tirée, a omis ago qui
s'imposait si naturellement, et qui rend à ce vers manchot le membre dont il
était privé depuis des siècles.
N° 2.
—Les petits cadeaux, dit-on en proverbe, entretiennent l'amitié :
Hæc
res et jungit junctos et servat amicos.
Nous voyons,
en maints endroits de notre poète, qu'il mettait ce proverbe en pratique
avec Radegonde et Agnès, quoique, à vrai dire, la nécessité n'en existât pas
du tout. Jamais amitié, comme celle dont il était l'objet, ne fut plus
désintéressée. Il en recevait donc des cadeaux et il leur en faisait de
temps en temps lui-même qu'il accompagnait d’envois en vers où il
s'excusait de la modicité de son hommage : c'étaient tour à tour ou des
châtaignes, ou des pommes, ou des prunes de son jardin, ou des prunelles ou
des mûres. Un jour que, au lieu de pommes qu'il aurait pu offrir, il se
trouva dans la nécessité de n'envoyer que des mûres, il dit :
Vel
dare qui potui pomula mora ioti.
Ioti
est un mot
si manifestement corrompu qu'il faut nécessairement l'évincer et lui trouver
un remplaçant. Guérard propose more joci, comme qui dirait par
plaisanterie. Cette correction n'est pas à dédaigner, d'autant plus qu'il
n'y a que deux lettres à changer au texte. Mais ces mots ne se rattachent à
rien. Il est évident qu'ils devraient et qu'ils doivent exprimer une
opposition à pomula, c'est-à-dire un cadeau moindre que ces
pommes. Or, pour exprimer celle opposition, il faut un verbe qui régisse
mora, et ce verbe ne peut être que le mot défiguré ioti.
En outre, la correction de Guérard est peu respectueuse, car toute
diminution de respect (et cette plaisanterie en était une), si petite
qu'elle soit, de la part de Fortunat, pour Radegonde et. Agnès, n'est pas
admissible. M. Léo, en proposant verba dedi « je vous en ai donné à
garder », aggrave encore le manque de respect, et une plaisanterie de ce
genre, avec des personnes d'une si haute et si sainte condition, n'eût pas
été autre chose. Il n'y a pas, d'ailleurs, l'ombre de plaisanterie ni dans
l'intention, ni dans les paroles de Fortunat. Il regrette seulement d'être
empêché par son absence de donner à Agnès, ainsi qu'il lui est arrivé
maintes fois, des pommes de son jardin, et d'être réduit ù lui envoyer des
mûres. Laissons donc mora, puisqu'après tout il s'agit de
mûres, et mettons dedi comme M. Léo, à la place d'ioti. Et
puis il est certain par le 4e vers,
Et
rogo quœ misi
dona
libenter habe,
que Fortunat
n'a pas payé de paroles ses amies, mais qu'il leur a bel et bien fait un
cadeau.
N° 3.
— Il ne faut quelquefois qu'une lettre à ajouter ou à retrancher pour rendre
la vie à un vers et le remettre sur ses pieds; mais cette lettre, tout
naturellement qu'elle soit indiquée, ne répond pas toujours à l'appel; on
dirait qu'elle tient à se présenter d'elle-même. Exemple : Fortunat vient en
personne offrir des fruits à ses amies et s'excuse de la nature insolite de
l'objet dans lequel ils sont enveloppés :
Sed
date nunc veniam quod fano tali habetur.
Guérard se
tait sur cette étrange fin de vers, et M. Léo ne voit pas comment y
remédier. Ni l'un ni l'autre ne s'expliquent non plus sur le sens à leur
attribuer. Or, fano est une serviette, une nappe ou toute bande d'un
tissu quelconque; mais c'est aussi le corporal qui se met sur l'hostie
pendant la messe, et de plus « ce que le prestre met en la main senestre »,
lorsqu'il officie. « Item, est-il dit dans un Inventaire du Trésor de
l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, fait en 1746,
l'estolle et fenon S. Médard. » Comme prêtre, Fortunat portait l'un et
l'autre à l'autel, et voilà pourquoi il s'excuse d'employer à un usage aussi
profane un linge réserve à un usage sacré. N'y ayant donc pas de doute sur
la signification de fano, il reste à le rapprocher de
l'adjectif tali qui le suit, et qui aspire à s'accorder avec lui. On
écrira donc :
Sed
date nunc veniam quod fano talis habetur,
et du même
coup on régularisera le vers en lui rendant la lettre qui manque pour former
le dactyle au cinquième pied.
N° 4.
—La physique, chez Fortunat, est, en général, enfantine, et dans les
questions qui sont du ressort de cette science, il emploie les métaphores
dont poètes et prosateurs se sont servis de toute antiquité. S'il nous dit
d'une part que le temps s'envole, que les heures se jouent de nous et que
nous marchons à la vieillesse sur un chemin glissant, nous le comprenons
sans difficulté; mais s'il vient à nous dire que « le monde tourne sur son
axe sans corde »,
Fine
trahit celeri sine fune volubilis axis,
nous sommes
arrêtés par cette corde, et nous allons aux recherches dans les notes des
éditeurs, pour voir si nous trouverons un renseignement qui nous débarrasse
de cet obstacle. Nous ne trouvons qu'une variante, fine pour fune
dans le Ms. de Paris. Mais le premier mot du vers est déjà fine.
Cette répétition du même mot à si courte distance a de quoi choquer, et,
comme le Ms. de Paris est le seul où elle se produise, il vaut mieux s'en
tenir au sine fune d'un Ms. ambrosien, admis dans le texte, et
chercher cependant ce que le poète entend par là. Il suppose que le monde,
pour tourner sur son axe, n'a pas besoin d'une corde comme, par exemple, le
treuil au moyen duquel on fait descendre un seau dans le puits. Entraînée
par le poids du seau, la corde enroulée autour du treuil se déroule et le
fait tourner sur son axe, avec une grande rapidité : ce qui n'aurait pas
lieu sans la corde. On voit combien celle interprétation était nécessaire.
N° 5.
— Dans la pièce
De
Excidio Thoringiæ,
il est un mot que M. Léo déclare corrompu, comme il l'est en effet, et dont
la restitution paraît, à première vue, radicalement impossible. Dans cette
pièce, Radegonde, ayant Fortunat, dit-on, pour interprète, parle, dès les
premiers vers, de l'effondrement du palais des rois thuringiens et des
richesses englouties sous les ruines; elle parle de ses hôtes (et elle-même
en était le plus noble et le plus intéressant) emmenés captifs chez leurs
vainqueurs et maîtres, et tombés des hauteurs de la gloire .dans la
condition la plus basse. « Une foule de serviteurs, dit-elle, ont péri et ne
sont plus que la poussière infecte de sépulcres. Un nombre infini
d'illustres et puissants personnages demeurent sans sépulture et privés des
honneurs qu'on rend à la mort. » Et elle ajoute :
Flammivomum vincens rutilans in crinibus aurum,
Strata solo recubat lacticolor amati.
Brower,
Leibnitz,
Luchi et Migne s'accordent à voir dans amati une forme altérée d'amethys
ou amethystus. Pas un d'eux n'a réfléchi qu'il faudrait au
moins amatys au nominatif, comme y est lacticolor, et
que cette épithète, non plus que la propriété attribuée à l'améthyste, de
jeter plus de feux que l'or, ne saurait convenir à une pierre de couleur
violette. M. Mommsen en a sans doute fait la réflexion, et il a tranché la
difficulté en proposant de substituer
mulier
à amati.
Cette substitution donne au pentamètre sa mesure et à la phrase un sens
excellent, car il s'agit d'une femme dans ces deux vers, et on peut les
traduire ainsi : « Une femme au teint de lait, aux cheveux d'un rouge vif et
plus brillants que l'or, terrassée par ses meurtriers, est gisante sur le
sol. »
Cependant la
substitution proposée par M. Mommsen ne laisse pas que de paraître un peu
forte; aucune variante ne la favorise tant soit peu; elle est comme tombée
du ciel. Si j'ose dire ce que j'en pense, je conjecture qu'il n'y a rien à
changer dans amati, si ce n'est l’i qu'il faut mettre à
la place du second a, et vice versa. On aurait
ainsi amita, qui a la quantité voulue, deux brèves et une
longue, pour régulariser le second hémistiche. Et, comme la césure rend
quelquefois longue, devant un mot qui commence par une voyelle, une syllabe
finale brève se terminant par une consonne (il y en a maints exemples depuis
Virgile jusqu'à Ausone),
la syllabe finale de lacticolor bénéficierait de cette licence.
Pour en
revenir à la femme à laquelle ces deux vers font allusion, je crois qu'il
s'agit d'une tante (amita) de Radegonde, qui fut enveloppée
dans un massacre exécuté pendant et après le sac du palais des rois de
Thuringe par les Francs. L'histoire, il est vrai, ne fait aucune mention de
cette princesse ; mais peut-être que, n'étant pas mariée et menant dans le
palais une vie relativement obscure, la princesse n'avait pas, pour mériter
que l'histoire parlât d'elle, cette notoriété que, à défaut d'autres, les
princesses mariées tirent de l'homme auquel elles sont unies. En tout cas,
ne pouvant me résoudre à accepter la substitution de mulier à
amati, dont la conformation n'a aucun rapport avec celle de ce
remplaçant, je n'hésite pas à proposer amita, qui satisfait à
la fois et au sens et à la mesure du vers.
N° 6.
— Je n'hésite pas davantage à mettre natas pour natos autorisé
pourtant par le manuscrit de Paris, 13048, dans ce vers où le poète appelle
la protection de Dieu sur Agnès et ses religieuses :
Et
te vel natos spes tegat una Deus.
Et te vel
natos
« et toi et
tes fils », car vel est ici conjonction copulative, comme elle l'est
fréquemment dans notre poète. Il y a quelque chose de si choquant dans ces
fils attribués par Fortunat à une personne de la qualité d'Agnès,
qu'on a peine à comprendre que Guérard et M. Léo ne l'aient point remarqué,
ou, s'ils l'ont remarqué, n'en aient rien dit. C'est montrer trop de
condescendance pour les manuscrits quels qu'ils soient, et reculer devant un
épouvantail à chenevière. « Si, disait encore L. Quicherat, certaines
corrections, sans être méprisables, ne portent pas avec elles la lumière
nécessaire pour rallier tous les esprits, elles laissent la carrière ouverte
aux recherches de la critique; mais d'autres présentent un tel caractère de
certitude qu'on ne peut, sans se compromettre, se refuser à les adopter. Si
nos pères avaient eu pour les manuscrits une superstition ridicule, les
monuments littéraires de l'antiquité seraient illisibles; mais, de leur
propre autorité, ils rectifiaient les erreurs,... et nombre de leurs
corrections sont tellement incorporées dans le texte, qu'elles ne se
discutent plus aujourd'hui. »
Il est donc surprenant que ni Guérard, ni M. Léo n'aient vu qu'il ne peut
être question, dans ce vers, que des filles de la mère Agnès,
c'est-à-dire de ses religieuses, ou que, s'ils l'ont vu, ils n'aient pas
chassé du texte natos pour y introduire d'office natas.
C'est ce que j'ai fait sans remords aucun.
Le poète,
d'ailleurs, ne nomme jamais les religieuses autrement. Mais ce natos
n'est-il pas une preuve évidente de l’ignorance des malheureux scribes qui,
par ordre, ou volontairement, se sont copiés les uns les autres, sans
s'apercevoir de cette impertinence?
N° 7.
— Fortunat, dans la pièce qui a pour titre : de Gelesuintha,
fait dire à Goïsuinthe, mère de Gélésuinthe, que, quand elle laissa partir
cette fille bien-aimée pour le Nord, c'est-à-dire pour la Gaule où celle-ci
allait épouser Chilpéric, il gelait si fort
Ut
nec rheda rotis, non equus isset aquis.
Cet equus
qui ne pouvait aller sur l'eau glacée ne suggère aucune observation à
Brower ni à Lucchi. M. Léo, moins réservé, et ne pouvant croire qu'il s'agit
là de quelque hippocampe, dit qu'au lieu d'equus il attendait
ratis : cette attente est bien naturelle, mais elle est vaine;
car ratis et equus signifient la même chose, c'est-à-dire
vaisseau. Homère l'a dit le premier, parlant de ce véhicule sur le liquide
élément,
ἁλος ἵπποι.
L'image a passé aux Latins. Plaute l'emploie dans le Rudens:
...
Nempe equo ligneo per vias cœruleas
Estis vectœ;
ce cheval de
bois était un vaisseau. L'épithète ligneus est un renchérissement sur
Homère qui n'en avait pas besoin pour être compris des Grecs, et une
obligation imposée à Plante qui ne l'eût pas été des spectateurs romains,
sans cette addition. Fortunat, si fécond d'ailleurs en métaphores
hétéroclites, n'a eu garde de négliger celle-là, et il faut la lui laisser.
N° 8.
— Le comte Galactorius résidait à Bordeaux où, entre autres devoirs de sa
charge, il avait celui de percevoir les impôts pour le roi Chilpéric.
Fortunat pensant, on ne sait pourquoi, qu'il pouvait y avoir quelque
excédent de recette, dont le comte aurait eu la libre disposition, lui écrit
pour lui exprimer le désir d'en avoir sa part. « Envoyez-moi, lui dit-il,
des pices en échange de mes apices », c'est-à-dire « de ma
lettre » :
^w
Si
superest aliquid quod forte tributa redundant,
Qui
modo mitto apices, te rogo, mitte pices.
A première vue
on est porté à croire que le poète ne fait pas seulement un jeu de mots avec
apices et pices, mais qu'il demande bel et bien de
l'argent à Galactorius. Brower le présume et suppose que par pices,
on pourrait entendre une espèce de monnaie. Je l'ai cru comme Brower et
j'ai fait tous les efforts imaginables pour le démontrer. Mais j'ai dû
bientôt reconnaître que, où que je dirigeasse mes recherches, je suivais de
fausses pistes, et que je n'arriverais jamais à découvrir une monnaie
mérovingienne dans un mot qui n'a jamais voulu dire que « poix ». C'est
alors que, faisant appel à la science de mes deux confrères MM. Ch. Robert
et Deloche, je leur demandai leur avis. L'un et l'autre furent d'accord pour
nier l'existence en aucun temps d'une monnaie appelée pyx, au
pluriel pices, et pour conclure que dans ce passage il s'agit
tout simplement de poix.
Reste à savoir à quoi le poète avait le dessein de l'appliquer. Tout
d'abord, j'avais pensé que c'était à ses chaussures, l'un rappelant l'autre
naturellement; mais cette pensée me parut bientôt aussi dépourvue de sel que
de respect, et j'allais l'abandonner, lorsqu'un passage où Fortunat parle de
ses chaussures me revint tout à coup en mémoire. Je m'y reportai, espérant
en tirer quelque lumière. C'est dans la pièce
xxi du livre VIII. Là donc Fortunat remercie Grégoire de
Tours de lui avoir envoyé des talaires avec de quoi les attacher, et des
peaux blanches pour couvrir les semelles :
Cui
das unde sibi talaria missa ligentur,
Pellibus et niveis sint sola tecta pedis.
Il est inutile
de faire remarquer que ces talaires n'avaient rien de commun, si ne n'est
peut-être les cordons, avec les talaires que les anciens prêtent à Mercure;
c'étaient de simples semelles qui emboîtaient légèrement le talon, et qui
adhéraient à la plante du pied au moyen de courroies; elles n'avaient point
d'empeignes. Telle était, comme le dit Alcuin,
la chaussure des ministres de l'église :
quo
induuntur ministri ecclesiœ, subterius solea muniens pedes a terra,
superius vero nihil operimenti habens. Comment donc Grégoire, qui devait connaître cette
particularité, envoyait-il de la peau blanche dont l'emploi eût été une
infraction à l'usage indiqué par Alcuin, en transformant en chaussure
couverte réservée aux évêques la chaussure d'un simple prêtre? Celle des
évêques s'appelait sandalia. L'empeigne en avait d'abord été
en toile blanche;
mais, comme on le voit ici, on y employa depuis de la peau de la même
couleur. Toujours est-il qu'il fallait aux simples prêtres une permission
spéciale des papes pour chausser des sandales. « Nous avons appris, dit
Grégoire le Grand,
que les diacres de l'église de Catane s'étaient arrogé de porter des
sandales, ce qui n'avait jusqu'ici été accordé à personne, excepté toutefois
aux diacres de Messine, par nos prédécesseurs ». Les successeurs de Grégoire
le Grand, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, et comme il paraît l'avoir
aussi fait lui-même, octroyèrent depuis et souvent ce privilège,
et il n'est pas impossible qu'à la considération de Grégoire de Tours,
Fortunat en ait été l'objet.
Ce qui me
porte à le croire, ce sont les deux derniers vers de la même pièce :
Pro
quibus a Domino datur stola candida vobis ;
Qui
datis hoc minimis inde feratis opes.
Pro quibus, c'est-à-dire pellibus. Par où l'on voit
qu'en retour de ces peaux qu'il a reçues de Grégoire, il lui souhaite la
robe blanche, stola candida, qui est le vêtement des papes.
C'est même pour la seconde fois, quoique en d'autres termes, qu'il lui fait
un souhait de ce genre, car il disait tout à l'heure à Grégoire :
Sic
te consocium reddat honore throno.
ce qui veut
dire « et te rende par l'honneur associé au trône ». Le vers se comprend
très bien. Or, comme on ne peut admettre que le poète veuille faire de
Grégoire l'associé de Dieu dans le ciel, et l'asseoir sur le même trône, il
ne peut être question que du trône terrestre, c'est-à-dire de la papauté.
Ces deux passages valaient au moins la peine d'être signalés; mais ici
encore les commentateurs se sont abstenus, ayant assez bonne opinion des
lecteurs pour croire qu'ils n'y seraient pas embarrassés. Quoi qu'il en
soit, ces peaux, devant être nécessairement cousues aux semelles, font, par
une suite naturelle des idées, penser au fil enduit de poix destiné à cette
opération. Est-ce à dire que Fortunat ait été le confectionneur de ses
sandales? Cela n'est pas soutenable même en plaisantant. Contentons-nous de
croire que le poète avait un autre dessein au sujet de cette poix, comme
pourrait être celui d'en faire des flambeaux résineux pour les cérémonies de
l'église, ou de l'employer pour l'embaumement des corps,
et ne nous en tourmentons pas davantage. Il résultera du moins de cette
discussion la connaissance à peu près certaine du genre de chaussure que
portait Fortunat, et les membres du clergé de Poitiers du même rang que lui.
N° 9.
— Voici encore deux vers dont il m'a été très difficile de pénétrer le sens
:
Esto
tamen quo vota tenent meliora parentum,
Prosperior quam te terra Thoringa dedit.
La
construction en est si bizarre, qu'il ne peut être que le texte ne soit
corrompu. Dans l'état où est le second vers, il faudrait lire quam tu
au lieu de te qui est un solécisme. Il est impossible, en effet, de
rendre raison de cet accusatif et de le rattacher à quoi que ce soit. Je
crois, en outre, que ce n'est pas prosperior qui appelle quam te,
c'est meliora, et encore, je le répète, est-ce quam tu
que ce comparatif exigerait : ce qui donnerait un sens absurde. Mais, si
au lieu de tu et te, on met quæ qui se rapporte
à vota, on rend à ces vers leur construction et leur sens
naturel, et on lit :
Esto
tamen que vota tenent meliora parentum
Prosperior quam quæ terra Thoringa dedit.
ou :
Vota meliora quem quæ Thoringa prosperior dedit.
«
Cependant reste où te retiennent les vœux de tes parents, vœux meilleurs que
ne le furent pour toi ceux de la Thuringe, quand elle était plus heureuse. »
Dans cette
rectification, il me semble, pour parler comme Louis Quicherat, « n'avoir
fait qu'un usage légitime de la critique », et si j'osais, j'ajouterais avec
lui « que, souvent la critique est restée en deçà de ce qu'elle pouvait se
permettre, et que « les textes se ressentent encore tristement de
l'excessive tolérance des éditeurs
». Ceci s'applique exactement au texte de Fortunat.
Si je
poursuivais ces remarques aussi loin qu'il serait nécessaire, il y faudrait
un volume, chacune d'elles demandant un certain développement. C'est le
privilège des auteurs de décadence de requérir plus d'explications et pour
de moindres objets, que les auteurs des belles époques. Je m'en tiendrai
donc ici à celles-là. On en trouvera plusieurs autres dans les notes qui
seront à la suite de chaque livre de Fortunat, comme aussi et souvent l'aveu
de mon impuissance à résoudre certaines difficultés. Mais j'aurai montré le
chemin; il ne manquera pas sans doute de plus habiles pour arracher les
ronces que j'aurai laissées derrière moi, et peut-être aussi pour
m'apprendre que j'en ai semé moi-même où il n'y en avait pas.
Charles
NISARD,
de l'Institut.
M. Salomon
Reinach, à qui je m'étais fait un plaisir d'offrir cette
Dissertation, lorsqu'elle fut publiée pour la première fois
(a), a bien voulu me faire part
de ses remarques au sujet de cette interprétation, comme aussi au
sujet de deux autres qu'on trouvera plus loin. Je tiens à honneur de
reproduire ici fidèlement ces remarques, en demandant toutefois à
l'aimable et docte critique la permission d'y répondre.
« Je
n'admets pas, m'écrit-il, le texte :
Fine trahit celeri sine fune volubilis axis;
il me
semble qu'il faut
écrire
:
Fune trahit celeri sine fine volubilis axis,
et que
cela donne un sens satisfaisant. Funis est une métaphore, « comme au moyen d'une corde
rapide. »
« Amita,
dit M. Salomon Reinach, est séduisant, mais j'avoue que je
préfère Mulier. Mulier pourrait être écrit ainsi :

Supposez la perte des deux dernières lettres par une déchirure du manuscrit, vous aurez
quelque chose comme amti, dont un copiste préoccupé du
mètre a pu faire amati. Le mol amita sans
explication me paraîtrait bien bizarre. »
Ces
rhabillages de mots dans les manuscrits et dans les inscriptions,
sont souvent très
heureux, et toujours d'une grande autorité aux yeux des érudits,
mais il ne faut pas en abuser, car alors ils peuvent donner lieu à
des discussions qui, après plus ou moins de bruit, viennent dormir,
comme la mer sur la grève de quelque anse écartée,
sans soupir et sans mouvement.
« Je ne puis
admettre, dit M. S. Reinach, l'ingénieuse explication que vous
donnez de ce vers :
Ut nec rheda rotis, nec equus isset aquis.
Equus-navigium,
est toujours, en grec comme en latin, accompagné d'une épithète.
Je proposerais :
Ut ne rheda rotis nec ratis leset aquis,
C'est-à-dire,
« de
sorte qu'un char ne pouvait s'avancer sur ses roues, ni un bateau
sur les eaux. » Rotis, ratis devaient tenter le
mauvais goût de Fortunat. Dans le manuscrit rotis a fait
disparaître ratis, qui a été remplacé par equus,
sous l'influence d'aquis.