![]()
ARISTOTE
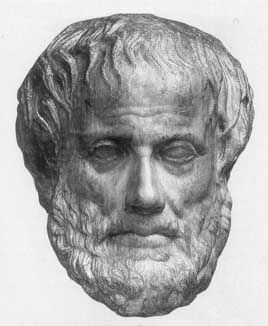
MÉTAPHYSIQUE
PRÉFACE
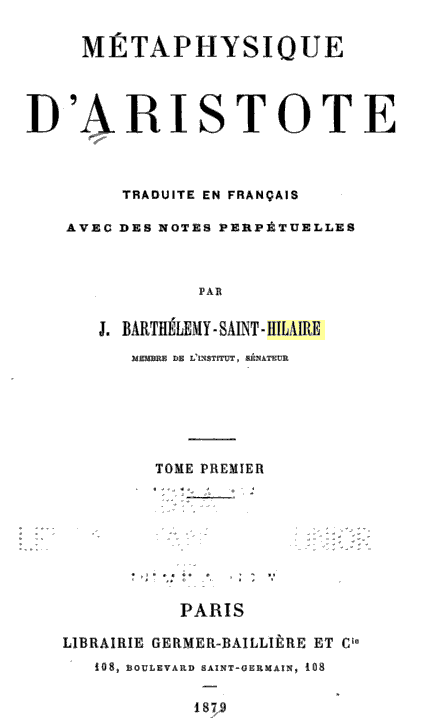
|
A LA MÉMOIRE DE M. VICTOR COUSIN QUI LE PREMIER PARMI NOUS A TENTÉ DE FAIRE CONNAÎTRE LA MÉTAPHYSIQUE D'ARISTOTE PAR LA TRADUCTION DU Ier ET DU XIIe LIVRES
HOMMAGE DE RECONNAISSANCE page I PRÉFACE Caractère général de la Métaphysique d'Aristote; questions principales qu'il y discute: Définition de la philosophie, réfutation de la théorie des Nombres et de la théorie des Idées, réfutation du Scepticisme, le principe de contradiction pris pour fondement de la certitude, théorie de la substance, théorie des quatre causes, Théodicée. - Aristote est un des plus grands métaphysiciens de tous les temps. Coup d'oeil sur l'histoire de la Métaphysique; sa nature propre et ses droits ; ses rapports avec la Religion et avec la Science; grandeur de l'homme; avenir de la Métaphysique.
Quand on lit la Métaphysique d'Aristote, il est deux choses qu'on ne doit jamais perdre de vue, pour ne pas être trop étonné des difficultés qu'on rencontre à chaque pas. C'est, d'abord, l'incurable désordre dans lequel cet ouvrage est arrivé jusqu'à nous; et, en second lieu, c'est le caractère général du style aristotélique. Cicéron, dans une phrase devenue célèbre, nous en avertit : « Il faut faire un très grand effort d'attention pour page II bien comprendre Aristote. Magna animi contentio adhibenda est in explicando Aristotele (01). » Cicéron étudiait aux écoles d'Athènes, deux cents ans environ après la mort du philosophe; il entendait les leçons et les explications de ses successeurs, encore tout imbus de la tradition. Il apportait lui-même à ces labeurs une aptitude des plus rares, et un zèle qui ne s'est jamais éteint. Si, dans des conditions si favorables, l'orateur Romain avait tant de peine à pénétrer la pensée d'Aristote, ne soyons pas surpris de la peine que nous avons nous-même à la saisir. Elle vaut les fatigues qu'elle coûte; et, malgré tout ce que vingt-deux siècles ont dû nous apprendre, elle peut encore nous instruire et nous intéresser puissamment. Il est impossible de rétablir un peu d'ordre et de régularité dans ce monument qu'une mort inopinée laissa inachevé, comme tant d'autres. Mais, parmi ces fragments mutilés et sans suite, il s'en trouve d'admirables, qui sont dignes d'être conservés à jamais ; dans page III ces ruines d'un Parthénon philosophique, nous pourrons recueillir quelques grandes et complètes théories, destinées à compter toujours parmi celles qui honorent le plus l'esprit humain, et qui lui apportent le plus de lumière. Les innombrables questions que la philosophie soulève n'apparaissent pas toutes à la fois sur la scène de la pensée ; toutes ne sont pas faites pour y demeurer définitivement. Les époques les plus fécondes n'en font naître que quelques-unes. Mais les questions que le génie découvre, et qu'il consacre, ne meurent pas; elles entrent pour toujours dans le domaine commun, et dans l'héritage que se transmettent les générations, les unes après les autres. Quand une fois ces questions ont été discernées et mises dans leur jour, elles ne peuvent plus périr ni tomber dans l'oubli ; elles regardent également tous les siècles et tous les peuples, qui ont assez d'intelligence pour s'en préoccuper. La Métaphysique d'Aristote peut nous offrir un certain nombre de ces graves problèmes, qui se posent encore pour nous, et qui, page IV de notre temps, sont controversés comme du sien. Nous n'énumérons que les principales : La définition de la philosophie, et surtout de cette partie de la philosophie qu'Aristote appelle de son vrai nom, « la Philosophie première » ; la théorie des Nombres ; la théorie des Idées; la réfutation du Scepticisme; le principe de contradiction; le principe de la substance; la théorie des quatre causes; la théorie de l'ordre universel; et enfin, la théodicée. De ces questions, les unes se rapportent à la polémique contemporaine d'Aristote; et, quand il traite des Nombres ou des Idées, c'est pour combattre l'école de Pythagore et celle de Platon; les autres représentent la pensée du maître, dans son originalité et sa profondeur. Mais aucune de ces questions, agitées, il y a deux mille ans passés, par les plus nobles esprits de la Grèce, n'est épuisée. Nous avons toujours à nous enquérir de la véritable nature des Idées et des Nombres; le sceptique Protagore a eu des successeurs; il en a parmi nous, et il en aura tant que l'homme voudra, comme c'est le droit de sa raison, scruter le page V fondement de ses connaissances; le principe de contradiction, aussi bien que le principe des substances, tient toujours sa place dans le large champ de la spéculation; la théorie des causes n'en peut être bannie, malgré les conseils chimériques de quelques savants ; et quant à la théodicée, les progrès immenses des sciences particulières ne font que lui assurer une importance qui croît de jour en jour; plus l'analyse des phénomènes devient exacte et plus elle s'étend, plus on sent le besoin de remonter à l'origine des choses et jusqu'au premier moteur. Sur tous ces problèmes, qui de nous pourrait n'être pas curieux de recevoir la déposition d'un témoin tel qu'Aristote, auteur tout ensemble de la Métaphysique et de l'Histoire des animaux, de la Politique et de la Météorologie, de la Logique et de la Morale, de la Rhétorique et du Traité de l'Âme? Sans doute, le vêtement des pensées antiques n'est plus le vêtement des pensées modernes; mais la forme importe peu ; c'est le fond qui est tout; et, si nous étions tentés de dédaigner les Anciens pour un motif aussi léger, une page VI réflexion devrait arrêter notre orgueil. Comme les choses sont perpétuellement mobiles, nous deviendrons des Anciens, à notre tour, ainsi que les jeunes gens deviennent des vieillards. Prenons garde, en étant injustes et aveugles pour ceux qui nous ont ouvert la carrière, de préparer et d'autoriser les dédains de ceux qui nous y succéderont, aussi éloignés de nous que nous le sommes nous-mêmes de Thalès, de Pythagore, de Xénophane, d'Anaxagore, de Socrate, de Platon et d'Aristote. D'abord, il faut se rappeler que le mot même de Métaphysique n'appartient pas à Aristote; il est venu de ses disciples, ou de ses commentateurs, peut-être d'Andronicus de Rhodes. Pour Aristote, ainsi qu'on vient de le dire, et qu'on peut le voir dans tout son ouvrage, cette partie de la philosophie, qui est la plus générale et la plus haute, se nomme la Philosophie première, et parfois aussi la Théologie, ou Théodicée. Si l'usage n'avait consacré le mot de Métaphysique, il y aurait quelque utilité à le changer, parce qu'il est décrié, non pas seulement auprès page VII des ignorants, mais aussi auprès des savants. Il l'est même auprès de quelques philosophes, qui, en cela, s'entendent très mal avec eux-mêmes, repoussant de la philosophie la partie qui en est la seule essentielle et nécessaire. On ne peut guère se flatter de modifier maintenant une locution qui remonte au temps de Sylla et de Cicéron. Cependant, d'illustres exemples nous y convieraient; et peut-être ferions-nous bien de nous y rendre. Descartes intitule ses Méditations : « Meditationes de prima philosophia, seu de Dei existentia et anima immortalitate. » Il ne repousse pas tout à fait l'expression de Métaphysique; mais il s'en sert le moins qu'il peut. Dans la traduction française de ses Méditations, qu'il fait faire sous ses yeux et qu'il corrige, il ne parle non plus que de la Philosophie première, traitant à peu près exclusivement de l'existence de Dieu et de la distinction entre l'âme et le corps de l'homme. Leibniz fait comme Descartes ; c'est la réforme de la Philosophie première « qu'il prétend accomplir en réformant la notion de substance». Selon lui, « la Philosophie page VIII première est la Reine des sciences». Mais, tout en la décorant de ce titre pompeux, il croit que cette science, qui doit résumer et régir toutes les autres, en est encore à se chercher comme au temps d'Aristote. En ceci, Leibniz se trompe. Aristote ne cherchait plus la Philosophie première, par cette bonne raison qu'il l'avait trouvée (02). Certainement, nous ferions bien d'imiter Descartes et Leibniz, et de ne plus parler que de Philosophie première au lieu de Métaphysique, puisque ce nom, sans être absolument faux, n'est pas parfaitement exact, et qu'il offusque tant de bons esprits. Mais ce sont là des changements dont l'usage seul décide, comme nous le dit Horace. Qu'est-ce que la philosophie pour Aristote? Il observe, d'abord, que, parmi tous les êtres animés, I'homme est le seul qui ait, par sa nature, la passion de connaître, et qui, par les facultés qu'il a reçues, puisse satisfaire, dans une certaine mesure, l'instinct qui le pousse à tout savoir. Bien des arts, page IX bien des sciences nécessaires aux besoins ou aux agréments de la vie se sont formés, longtemps avant la philosophie, et se sont développés, en donnant à I'intelligence de l'homme un emploi qui, sans contredit, était déjà très utile et très estimable. Mais, quand les arts les plus indispensables se furent constitués, il surgit des sciences nouvelles dont l'objet n'était plus, ni le besoin, ni même l'agrément. Elles naquirent de préférence dans les climats où l'homme pouvait plus facilement se ménager des loisirs; et c'est ainsi que les prêtres Égyptiens inventèrent les Mathématiques, et les poussèrent assez loin. Ces sciences eurent cet avantage éminent d'être cultivées avec ardeur, sans qu'on se proposât d'en tirer le moindre profit matériel. Les hommes, frappés d'étonnement et d'admiration par les phénomènes qu'ils avaient sous les yeux, le cours du soleil, les phases de la lune, le lever et le coucher des planètes et des astres, voulurent connaître les causes de ces prodigieux spectacles. Ils essayèrent de les comprendre, sans autre désir que de les savoir, pour les page X savoir. Bien plus, sous les causes particulières, ils ne tardèrent pas à s'élever à la conception d'une cause unique; ils se demandèrent comment l'univers s'était formé; et la curiosité de l'esprit ne s'arrêta que quand il fut parvenu à cette limite infranchissable de la cause qui embrasse et domine toutes les autres causes. Enfin, en voyant que le but dernier de chaque chose est le bien de cette chose, les hommes pensèrent que le but de la nature entière ne peut être, d'une manière universelle, que la plus grande somme de bien possible. La Philosophie première est donc, selon Aristote, la plus générale des sciences; elle est la science des principes et des causes; elle est la plus désintéressée et la plus libre de toutes, puisqu'elle n'est subordonnée à aucune, et qu'elle ne travaille que pour elle-même; il n'y en a pas de plus claire, parce que rien n'est plus clair que les principes ; elle est purement rationnelle, parce que la sensation est incapable de nous faire concevoir les principes et les causes; elle est plus exacte et plus précise que toute autre page XI science, parce que les éléments dont elle se forme sont très peu nombreux. Il est bien vrai que Dieu, qui, de l'aveu du genre humain, est la cause et le principe des choses, est le seul être qui puisse posséder une telle science dans sa plénitude, parce que « Dieu seul, comme le dit Simonide, jouit du privilège auguste de l'indépendance et de la liberté ». Mais l'homme se manquerait à lui-même, s'il ne s'efforçait pas de conquérir la parcelle de science qui est à sa portée. Bien que la nature humaine soit esclave de mille façons, la philosophie n'est pas interdite à l'humanité ; les Dieux ne sont point jaloux d'elle ; et, malgré les limites où l'homme est renfermé, il peut s'occuper des choses divines, en se disant que, si toutes les autres sciences peuvent être plus nécessaires que la philosophie, il n'en est pas une qui soit au-dessus d'elle et qui ait plus de prix. Que pourrions-nous ajouter aujourd'hui à cette définition antique de la philosophie, aussi juste que sublime, aussi rigoureuse que modeste? Que pourra-t-on même y ajouter jamais? Descartes et Leibniz n'en page XII ont pas parlé aussi bien. Dans toute l'histoire de la science, personne ne s'est trouvé qui ait su mieux qu'Aristote déterminer la nature et le domaine de la Philosophie première. Il a montré, avec une parfaite netteté, son point d'appui et de départ dans toutes les sciences secondaires, et son but, qui est de sonder, autant qu'il est permis à notre faiblesse, les secrets de la cause universelle et de la pensée divine. Que peut-on demander de plus? Et quand on croit à la philosophie et à la raison, que peut-on demander de moins? La Métaphysique eût évité bien des faux pas et se fût rendue plus respectable auprès de la foule, si elle avait toujours eu la prudence du philosophe grec, et si elle eût pris le soin de circonscrire aussi clairement le champ de ses investigations. Le terrain sur lequel Aristote s'est placé est inébranlable; mais il fallait un bien ferme regard pour voir, dès le début, les deux confins de la Métaphysique, l'un où elle commence, et l'autre où elle finit. D'ailleurs, on ne doit pas attribuer l'honneur de cette définition à Aristote seul. page XIII Trois ou quatre siècles avant lui, la philosophie était née sur les côtes de l'Asie Mineure, dans la patrie d'Homère, avec Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Xénophane de Colophon; elle s'était propagée dans l'Attique et dans la Grande Grèce; et, servie par un heureux instinct, elle avait déjà fait bien des découvertes, en s'occupant, il est vrai, beaucoup plus des choses extérieures que des phénomènes de l'intelligence. C'est Pythagore qui lui a donné son beau nom, en inventant celui de Philosophe. Socrate et Platon, qu'il ne faut jamais séparer, avaient, en termes magnifiques, célébré la philosophie, dont ils avaient conçu une pensée aussi haute qu'Aristote devait le faire après eux. A en croire Platon, c'était en pratiquant la philosophie, durant cette existence, que l'homme pouvait s'assurer une résurrection, et même une vie éternelle, dans un monde meilleur. Le philosophe seul, en contemplant l'essence immuable et absolue des choses, était en commerce avec le divin, sous la loi de l'ordre. Mais la Dialectique, telle que Platon l'expo- page XIV sait, était encore bien obscure et bien vague. Il en faisait bien le comble et le faîte des autres sciences ; mais il ne précisait pas ce qu'elle leur empruntait, et ce qu'elle pouvait leur donner en retour. C'était, selon lui, la partie la plus difficile de la philosophie, parce qu'elle ne s'attachait qu'aux choses intelligibles et repoussait toutes les données sensibles. Mais, souvent aussi, ces conceptions élevées s'abaissaient ; et la Dialectique se réduisait à n'être que l'art assez vulgaire d'interroger et de répondre. La Dialectique était donc quelquefois près de devenir la Philosophie première. Mais l'intervalle qui les séparait ne fut pas franchi, et c'est Aristote qui acheva l'oeuvre imparfaite de prédécesseurs nombreux et illustres. Une autre circonstance encore l'a favorisé. La philosophie Grecque, dans toute sa durée, n'a jamais eu auprès d'elle une autorité ombrageuse et persécutrice, qui prétendît lui imposer violemment des solutions toutes faites, dont elle ne devait pas s'écarter. Il n'y a jamais eu, dans son sein, ces discussions déplorables, et parfois homi- page XV cides, où la raison et la foi religieuse ont été aux prises. Dans la Grèce, la pensée a joui d'une absolue liberté, parce qu'elle n'a pas connu de livres sacrés, gardiens du dogme national; rien ne l'a gênée, depuis les temps de Lycurgue et de Solon jusqu'à ceux de Justinien, fermant, au nom de la religion, les écoles d'Athènes. Si, dans l'Antiquité, quelques philosophes ont été frappés, ce n'était pas par intolérance, comme ce fut plus tard. Ils étaient les victimes d'inimitiés individuelles, qui assouvissaient leurs vengeances; ou bien l'ordre public, troublé par des imprudences, exigeait un châtiment, d'ailleurs plus ou moins justifié. Mais jamais dans le Inonde hellénique, pendant plus de douze cents ans, personne ne fit à la raison humaine l'insulte de douter d'elle, et de la persécuter pour• des croyances qu'elle n'acceptait pas. Aristote a profité de cette liberté comme tout le monde ; mais il a défini et compris la philosophie mieux que qui que ce soit avant lui, et il l'a pratiquée avec une sécurité imperturbable, que Descartes n'a pas goûtée au page XVI XVIIe siècle, et que l'on nous conteste même encore quelquefois dans le XIXe. Il serait assez embarrassant de décider si la réfutation qu'Aristote a faite de la théorie des Nombres, mérite les mêmes éloges que sa définition de la philosophie. Cette réfutation peut nous paraître douteuse et incomplète par plusieurs motifs. Dans toute discussion, il faut pouvoir entendre les deux interlocuteurs pour juger en pleine connaissance de cause; et ici, nous n'en pouvons écouter qu'un seul. il ne nous est resté aucun ouvrage de Pythagore, ni de ses disciples. Les fragments très peu nombreux qui nous sont parvenus, ne portent pas sur cette théorie spéciale. Nous en sommes ainsi réduits à ce que nous en dit Aristote; et, quoique nous ne suspections pas sa fidélité, nous ne pouvons comprendre que très difficilement la valeur et le sens de l'objection, quand nous n'avons pas en même temps la pensée qu'elle doit rectifier ou détruire. Puis, l'obscurité habituelle aux réfutations d'Aristote est plus épaisse ici que partout ailleurs. Enfin, il a eu le tort de mêler à la page XVII réfutation d'une théorie plus mathématique que métaphysique celle des Idées platoniciennes; et cette confusion n'était pas faite pour éclaircir les choses. Malgré ces défauts, ce qu'Aristote nous apprend sur les Pythagoriciens est encore ce que l'Antiquité nous a transmis de plus précieux et de plus étendu, sur cette admirable école. S'il se tait forcément sur la personne trop peu connue de Pythagore, il nous entretient du moins des recherches qu'il avait provoquées dans toutes les voies qu'il avait ouvertes. Aristote rend d'abord aux Pythagoriciens un très légitime hommage, en les louant d'avoir étudié les mathématiques avec passion, et de leur avoir fait faire d'immenses progrès en tout genre. Aux mathématiques pures, telle que l'arithmétique et la géométrie, ils joignirent les mathématiques appliquées. Leurs travaux furent aussi divers que remarquables en astronomie, en optique, en mécanique, en musique, en géodésie, c'est-à-dire, dans toutes les branches de la science où les nombres et les lignes peuvent aider à l'observation et à l'explication des phénomènes. page XVIII Que Pythagore n'ait fait que transporter d'Égypte dans la Grande Grèce !es mathématiques naissantes, ou qu'il les ait lui-même inventées, c'est un point obscur; mais ce qui ne l'est pas, c'est que l'école Pythagoricienne a été par-dessus tout une école mathématique. De là, sa grandeur, que les siècles n'ont pas amoindrie; de là aussi, ses erreurs, que, à certains égards, on peut sans injustice appeler même des rêveries. Au premier aspect des vérités mathématiques, l'intelligence humaine en a été éblouie; et, comme il arrive trop souvent à notre vue débile, les clartés trop vives ont été remplacées bientôt par des ténèbres. Sans doute, ainsi que l'ont dit les Pythagoriciens, les Nombres se trouvent partout dans le monde où nous vivons, dans le ciel, que nous contemplons, dans la nature, que nous cherchons à interpréter. Le nombre est à l'état d'unité dans chacun des individus que nos sens perçoivent; il est à l'état de multiplicité dans les collections que les individus peuvent former, soit dans une même espèce, soit dans des espèces différen- page XIX tes. Sans doute encore, il y a dans l'univers, dans le inonde, des proportions et des harmonies, comme il y en a dans les sons que calculent les mathématiques. Mais conclure de là que le nombre est l'essence des choses, qu'il en est la substance, et même la matière; que le nombre est l'élément de tout, parce qu'il se trouve partout, c'est non seulement une conséquence hasardée; c'est, de plus, une assertion insoutenable. Il en résulterait que tous Ies êtres se confondraient, essence et matière, dans une apparente unité, qui semble les expliquer tous, et qui, réellement, n'en explique aucun. Les corps, que nous montre la nature, ne sont pas simplement doués d'unité. Ils ont aussi étendue, pesanteur, et légèreté relatives. Le nombre, immuable comme il est, toujours identique à lui-même, peut-il, en tant qu'élément essentiel des corps, leur communiquer des qualités qu'il n'a pas? Le nombre est-il étendu? Est-il pesant? A-t-il les trois dimensions? Et, s'il ne possède rien de tout cela, comment pourrait-il rendre raison de choses avec lesquelles il a si peu de rapport? Le nombre est page XX infini, si ce n'est réellement et en acte, du moins en puissance. Est-il un seul corps qui ne soit fini? Et comment concevoir un corps qui serait infini en acte, ou simplement même en puissance ? Ainsi, le nombre, tel que les Pythagoriciens l'entendent, n'est ni l'essence, ni la matière des êtres. Encore moins, est-il la cause du mouvement. Si le nombre a une propriété de toute évidence, c'est que, étant immuable et indestructible, de toute nécessité il est immobile. Étant lui-même soustrait au mouvement, comment pourrait-il transmettre aux choses le mouvement qu'il ne possède point? Or, le mouvement, le changement, est partout et perpétuellement dans la nature. Et qu'est-ce qu'une théorie qui supprime, dans les corps, leurs qualités les plus frappantes, leur étendue, leur poids et leur mouvement? Bien plus, le nombre qui ne peut expliquer la nature générale des êtres, n'explique pas mieux les entités mathématiques elles-mêmes. L'arithmétique, où règne le nombre, n'épuise pas les mathématiques; à page XXI côté d'elle, il y a la géométrie. Or, le nombre, qui ne peut pas nous dire ce que sont les êtres, ne nous dit pas davantage ce que sont les points, les lignes, les surfaces. Il faut pourtant le savoir. L'unité, d'où partent tous les nombres, n'est pas le point, d'où partent les grandeurs. Les nombres se divisent en pairs et impairs. Cette distinction, qui se poursuit dans une série indéfinie, ne se retrouve en aucune manière dans les surfaces, dans les lignes, dans les points. Il n'y a donc aucune ressemblance entre le nombre et ces entités, qui jouent cependant un rôle essentiel dans les mathématiques, tout aussi bien que dans la composition des corps. Mais voici une critique bien plus grave. Persuadés que les Nombres doivent régir l'univers, les Pythagoriciens ont essayé ce système sur les réalités, ne doutant pas que le monde ne dût y être parfaitement conforme. Mais les faits ont été rebelles à des hypothèses qui ne pouvaient se vérifier; la nature ne correspondait pas absolument à des théories factices. Qu'ont fait alors les Pythagoriciens? Ils ont violenté la nature; page XXII dans leur prétention d'organiser le monde par des nombres, ils ont imaginé des faits arbitraires, quand les faits réels les contredisaient. Ainsi, la Décade à laquelle ils attachent avec raison la plus grande importance, en tant que fondement de la numération, doit, selon eux, se reproduire dans le nombre des corps célestes et des sphères. Mais il n'y a en tout que neuf de ces corps, d'après la science de ces temps reculés: les cinq planètes, le soleil, la terre, la lune et le ciel des étoiles fixes. Où est le dixième corps? Les Pythagoriciens l'inventent; et ils donnent à la terre un contraire, un corps invisible, qui y est opposé, et qu'ils nomment l'Anti-terre, Antichthôn. Il peut être fort commode de suppléer ainsi les choses, et de combler ses propres lacunes par des mots. Mais la science ne s'arrange pas aussi aisément de ces solutions trop peu sérieuses; et la nature s'en arrange encore moins que la science imparfaite de l'homme. Sur cette pente, les Pythagoriciens ne pouvaient pas se retenir. A ces premières erreurs, ils en ont ajouté bien d'autres. On page XXIII doit avouer, à leur éloge, qu'ils ont été les premiers à essayer des définitions ; et c'était un complément à peu près inévitable de leurs études sur l'essence des choses. Mais ici encore, intervient le nombre pour tout définir, ou plutôt pour tout fausser. Veut-on définir la justice, la raison, l'opinion, le mélange, la division, le mariage, l'occasion et une foule d'autres choses? Rien n'est plus simple ; on en fait autant de nombres. La justice, par exemple, est un nombre carré ; l'injustice est un nombre de composition moins régulière; et ainsi du reste. Dans tout cela, il est clair qu'on dépasse la Décade. Si elle suffit aux corps célestes, elle ne pourrait suffire à des définitions qui seraient innombrables, comme le sont les choses elles-mêmes. Car chacune des choses avait son nombre particulier; et dans les élucubrations d'un Pythagoricien dont Aristote nous a conservé le nom, Eurytus, l'homme, le cheval avaient chacun leur nombre; le même philosophe représentait par des calculs arithmétiques jusqu'aux figures des plantes. En se payant de ces puérilités, on altère page XXIV tous les phénomènes naturels, et même les évènements historiques les plus notoires. Ainsi, les Pythagoriciens, remarquent qu'il y a sept voyelles dans l'alphabet, que la lyre a sept cordes, que la constellation des Pléiades a sept étoiles, que certains animaux perdent leurs dents à l'âge de sept ans, qu'il y avait sept Chefs devant Thèbes assiégée; et, prêtant au nombre Sept une vertu extraordinaire, ils veulent nous faire croire que ce nombre est la cause de tous ces faits, qui, sans lui, n'auraient point lieu. Néanmoins, tout le monde sait que, si les Chefs devant Thèbes n'ont été qu'au nombre de sept, c'est parce qu'il n'y avait que sept portes de la ville à défendre. Il est également avéré que les étoiles de la constellation des Pléiades sont au nombre de sept; mais il y en a douze dans la constellation de l'Ourse, et les Pythagoriciens eux-mêmes lui en attribuent davantage; quelques animaux perdent leurs premières dents à sept ans ; mais d'autres animaux ne Ies perdent pas à cette époque. Le nombre Sept n'a donc absolument rien à voir dans tous ces faits. On ajoute que, si, page XXV dans l'alphabet, il n'y a que trois lettres doubles Xi, Psi, Dzéta, c'est qu'il n'y a que trois consonances en musique. Mais, d'abord, il y a plus de trois consonances en musique; et, en outre, on pourrait combiner les consonnes deux à deux autant qu'on le voudrait, et représenter chaque combinaison nouvelle par un signe unique. S'il n'y a que trois lettres doubles, dans l'alphabet, c'est que, dans l'organe de la voix, il n'y a que trois articulations à la suite desquelles on puisse prononcer le Sigma sans trop d'effort. On dit encore que, de l'Alpha à l'Oméga, il y a autant d'intervalles que de la note la plus basse à la plus haute sur la flûte; et il se trouve que ce même nombre correspond, d'après les Pythagoriciens, à l'harmonie complète de l'univers. On fait des rapprochements non moins ingénieux, et non moins faux, entre les tons de la lyre et les syllabes du vers hexamètre. On pourrait en faire une multitude d'autres, qui seraient tout aussi brillants, et tout aussi trompeurs. Mais qui ne voit que, dans tous ces faits, il n'y a réellement que des coïncidences fortui- page XXVI tes, et que les nombres n'en sont causes en quoi que ce puisse être ? D'une manière générale, il est donc absurde de penser que le nombre soit cause de rien dans la nature ; il accompagne les choses; il est dans les choses; mais ce n'est pas lui qui les fait ce qu'elles sont (03). A côté de ces critiques, qui ne sont que trop fondées, il est un point sur lequel Aristote se plaît à rendre justice aux Pythagoriciens : c'est qu'ils n'ont jamais séparé les Nombres des choses sensibles. Tout au plus, ont-ils distingué le nombre abstrait du nombre concret, c'est-à-dire le nombre tel que le conçoivent les mathématiques, considéré en lui seul, et le nombre tel qu'il se montre effectivement dans une pluralité d'objets quelconques. Mais ils n'ont jamais songé à cette troisième espèce de nombre que quelques Platoniciens ont appelé le Nombre Idéal, et sur lequel on a amoncelé des hypo- page XXVII thèses plus vides encore que toutes celles du Pythagorisme. Pour les Pythagoriciens, le nombre n'est qu'une réalité de ce monde, quoiqu'ils en aient, d'ailleurs, mal compris la nature, l'origine et la véritable action. En somme, le jugement d'Aristote sur l'école de Pythagore est sévère; mais il est incomplet, si ce n'est partial. Aristote a omis, sans le vouloir, quelques doctrines qui font la gloire impérissable de cette école. Elle ne s'est pas absorbée dans la théorie des Nombres, comme il semble le supposer. Il eût été bon de ne pas oublier ce qu'elle a fait en morale; et quelques mots sur l'Institut pythagoricien n'auraient point été déplacés, même dans un traité de Métaphysique. Surtout, en blâmant certaines théories cosmiques, le philosophe aurait pu rappeler cette théorie si paradoxale, et cependant si vraie, du mouvement de la terre. Aristote, on le sait, a discuté la question dans un traité spécial sur le Ciel ; et il a fait prévaloir, pour de longs siècles, l'opinion contraire de l'immobilité du globe terrestre. Mais, dans un résumé philosophique du système pythagoricien, page XXVIII il est singulier de passer sous silence une doctrine dont un homme de génie ne devait point méconnaître la portée. Aristote, certainement, n'a pas voulu diminuer la gloire du Pythagorisme; mais on peut trouver qu'il l'a mutilée. Ce n'est pas de parti pris; et c'est une suite de la différence extrême de son point de vue personnel. On se cède toujours un peu trop à soi-même, tout en voulant ne rien ôter à autrui de ce qui lui appartient. Si c'est là une excuse en faveur d'Aristote à l'égard des Pythagoriciens, ce doit, à plus forte raison, en être une pour sa polémique contre Platon. A ne consulter que la Métaphysique, le Platonisme ne serait rien en dehors de la théorie des Idées ; il semblerait que cette théorie le remplit à elle seule tout entier ; et que, sans elle, Platon n'existe plus; c'est à elle qu'il aurait réduit toute sa philosophie première. Par bonheur, les monuments démontrent le contraire; et n'eussions-nous que le Timée, c'en serait assez pour attester qu'on se méprend étrangement, en imposant à la pensée Platonicienne de si étroites entraves. Aristote a commis ici une page XXIX méprise, que n'exigeait point le plan de son ouvrage. Mais, puisqu'il a considéré uniquement la théorie des Idées, nous devons le suivre sur ce terrain, quelque borné qu'il soit, et nous renfermer, autant que possible, dans le cercle qu'il s'est tracé lui-même, avec ou sans intention. Une première remarque, c'est qu'Aristote attribue à la théorie des Idées, dans le Platonisme, beaucoup plus de place que ne lui en attribue l'auteur lui-même. Il ne cesse de l'attaquer dans tout le cours de sa Métaphysique; il y revient même dans plusieurs de ses ouvrages, où cette discussion peut paraître assez inopportune. Il y insiste avec une opiniâtreté qu'on n'attend pas d'un disciple, surtout du disciple d'un tel maître. Au contraire, Platon, dans tous les Dialogues qui nous restent de lui, ne fait qu'indiquer la théorie des Idées ; nulle part, il ne la développe, et ne lui donne les dimensions que plus tard on lui a prêtées. En elle-même, la question a le plus grand intérêt, puisqu'elle renferme l'explication des choses, et que, selon qu'elle est bien résolue ou mal page XXX résolue, elle peut compromettre la réalité et la science, en les altérant toutes les deux. Mais dans la critique d'Aristote, c'est de la solution Platonicienne qu'il s'agit; il ne s'agit que de cela. Plus tard, il pourra poser le problème comme il l'entend, dans toute sa généralité; mais, d'abord, il faut l'accepter tel que Platon lui-même le pose, et ne point aller au delà. D'ailleurs, il se peut qu'Aristote, en voulant répondre à Platon, ait plutôt encore répondu à ses successeurs, qui ont bien pu exagérer la théorie des Idées, en y associant imprudemment les théories Pythagoriciennes. Dans ce cas, les arguments si nombreux et si pressants d'Aristote porteraient moins contre Platon que contre ses élèves, trop peu fidèles à ses leçons. Une autre remarque, qui ruinerait de fond en comble toute cette controverse, et qu'ont déjà faite des historiens de la philosophie, entre autres M. Cousin, c'est qu'Aristote n'aurait pas très bien compris son maître; par la même raison qui l'avait empêché de rendre pleine justice au Pythagorisrne. Quel est le principal tort qu'il impute à la théorie page XXXI des Idées? C'est de séparer l'essence des êtres de leur substance; et, pour expliquer les choses perceptibles à nos sens, de supposer, en dehors d'elles, d'autres êtres aussi nombreux au moins, ayant plus de réalité qu'elles n'en ont, ou, pour mieux dire, ayant seuls la réalité dont les choses sensibles sont dépouillées. Voilà le grief qu'Aristote répète d'une manière implacable, et d'où il tire toutes les conséquences sous lesquelles il accable la théorie qui lui semble les contenir, et les laisser échapper de son sein. Ce grief capital, essentiel, le premier et le dernier de tous, origine et cause de toute cette constante et vive polémique, est-il légitime ? Est-il exact que Platon ait séparé les Idées des choses sensibles, et transporté aux unes la réalité substantielle qu'il refuse aux autres ? Nous n'hésitons pas à répondre par la négative, quelque téméraire qu'il puisse paraître de contredire Aristote sur un tel sujet. Mais c'est là un point de fait ; et, les Dialogues en main, on peut affirmer que, dans la doctrine de Platon, les Idées ne sont pas séparées des choses réelles. page XXXII Que dit, en effet, Platon?
Instruit dans sa première jeunesse, comme nous
l'apprend Aristote, à l'école de Cratyle, élève lui-même
d'Héraclite, il partageait les opinions de l'un et de l'autre sur le
flux perpétuel des choses sensibles, et sur leur écoulement
insaisissable, qui ne permet pas d'asseoir rien de stable sur cette
base mobile et page XXXIII l'essence du défini, attendu que, si le défini n'était pas d'abord le genre, il n'existerait pas. Socrate, Callias, Coriscus, individus que nous apercevons isolément, ne sauraient exister sans le genre auquel ils appartiennent, et qui les rassemble sous son unité, c'est-à-dire, si, d'abord, ils n'étaient hommes. Voilà l'Idée Platonicienne dans toute sa simplicité; et le mot grec lui-même semble nous le dire, puisqu'il ne signifie pas autre chose que les Espèces et les Genres. Pour mieux éclaircir cette première notion, Platon étudie la nature de l'Idée et se demande quel mode d'existence elle peut avoir. Évidemment, le genre reste identique et le même dans les divers individus, dans les diverses espèces qui le composent, quelque nombreuses qu'elles soient. L'Idée est donc une unité, qui ne varie pas, une unité immobile et immuable. En outre, c'est une unité purement rationnelle ; nos sens ne peuvent la percevoir, comme ils perçoivent l'unité individuelle, qui éclate dans tous les êtres particuliers. On voit, on entend tel ou tel homme, qu'on a devant soi et avec qui page XXXIV l'on converse. Qui a jamais vu l'Homme? Cependant l'Homme-en-soi, l'Homme-même, pour prendre le langage Platonicien, est dans chacun des hommes individuels. Mais il n'y est que pour la raison ; il échappe à la sensibilité, qui ne l'y découvre point. L'Idée est donc rationnellement Une, puisqu'elle ne change pas d'un individu ou d'une espèce à l'autre ; et l'unité devient ainsi le caractère essentiel et dominant de l'Idée, qui résume en elle la pluralité. On peut s'égarer et se perdre parmi les individus, qui sont en nombre indéfini; on ne peut se tromper à l'Idée, qui est d'autant plus claire qu'elle est plus simple. Platon ne disconvient pas que l'existence des Idées ne soit difficile à comprendre, et qu'elle ne puisse sembler douteuse à la plupart de ceux qui essaieraient de faire cette abstraction. Mais, pour dissiper, autant qu'il le peut, les obscurités, il prend des exemples que tout le monde accepte, et qui facilitent cette analyse délicate. Il les emprunte aux mathématiques, que son école cultivait presque aussi ardemment que celle de Pythagore. page XXXV Ainsi, les unités dont s'occupe l'arithmétique sont considérées comme absolument égales entre elles, et ce n'est qu'à cette condition que l'arithmétique peut les étudier. Or, qui a jamais vu dans la réalité des unités absolument égales? Qui cherche même à les y découvrir? L'unité, telle que l'arithmétique la conçoit, n'est donc pas réelle au sens rigoureux du mot. Elle ne tombe pas sous les sens; et les unités que les sens atteignent, loin d'être parfaitement égales, n'offrent que des inégalités et des diversités infinies. Cependant, l'unité mathématique est tellement vraie qu'elle sert de principe à une science, qui est une des plus exactes que l'homme connaisse et qu'il puisse édifier. Ce qu'on dit des unités dans la science des nombres, on peut le dire tout aussi bien des entités sur lesquelles s'appuie la géométrie. Qui a jamais vu des points, des lignes, des surfaces, telles que les imaginent les géomètres? Nos sens ont-ils jamais perçu des points sans longueur, largeur ni épaisseur, des lignes sans largeur, ni épaisseur, des surfaces sans épaisseur? De plus, le géo- page XXXVI mètre ne raisonne-t-il pas continuellement sur des figures qui n'ont pas les dimensions effectives qu'il leur prête ? Et ses conclusions sont-elles moins solides et moins démonstratives, parce qu'il est parti d'hypothèses qui n'ont rien de matériel ? Il suffit que ces hypothèses soient admises et comprises par la raison, qui se passe du concours des sens et qui même les contredit. Qui oserait, cependant, révoquer en doute la certitude des mathématiques? Et le nom même qu'elles portent n'indique-t-il pas qu'elles prétendent à être les plus scientifiques de toutes les sciences? Probablement même, elles n'ont ce privilège qu'à la condition d'être rationnelles comme elles le sont; mêlées davantage à la matière, elles auraient moins d'autorité. Ces analogies demandées aux mathématiques peuvent faire entendre ce que sont les Idées, leur nature et leur existence. Les Idées sont dans les choses comme y sont les surfaces, les lignes, les points, les unités; et c'est la raison aussi qui les en tire. Néanmoins, il y a une grande différence entre les page XXXVII Idées et les entités de l'arithmétique ou de la géométrie. dans le monde mathématique, tout est non seulement immobile, mais impassible ; tout ce que les mathématiques exigent, c'est l'acquiescement de l'intelligence aux vérités qu'elles lui découvrent. En est-il de même pour les Idées? Et n'agissent-elles pas tout autrement sur notre âme? En présence de choses belles, ne sommes-nous pas profondément remués? Ne causent-elles pas en nous un enthousiasme, un amour, qui s'accroît avec leur beauté même? N'en sommes-nous pas d'autant plus émus qu'elles sont plus belles? Mais les choses, que nous qualifions toutes d'un même nom en les appelant belles, de quelque genre qu'elles soient, ne sont belles que par le reflet commun de la beauté, qui les fait ce qu'elles sont en tant que belles, et dont elles doivent toutes plus ou moins resplendir, pour recevoir le nom que nous leur donnons. Or, s'il y a manifestement des choses qui sont belles, combien ne doit pas être plus belle encore la beauté dont elles participent, chacune en quelque degré! L'Idée de la beauté, la page XXXVIII beauté en soi, une et parfaite, sans aucune limite, sans aucune de ces défaillances des beautés particulières, ne doit-elle pas être incomparablement plus belle? est-il rien qui puisse l'altérer et la corrompre? Et si les belles choses, imparfaites comme elles le sont toujours, nous ravissent d'admiration, de quels ravissements la beauté en soi, la beauté divine, ne pénètre-t-elle pas l'âme qui est capable de la concevoir et de la sentir! Ce qu'on dit de la beauté, au-dessus, si ce n'est en dehors, des choses belles, on le dirait de toutes les autres Idées. La justice en soi serait-elle moins juste que les actions justes? Le bien en soi serait-il moins bon que les choses bonnes? Et cette Idée du bien n'est-elle pas la plus haute de toutes les Idées, celle à laquelle tendent et se rattachent toutes les autres sans exception, l'Idée qui doit régler la vie de l'homme, qui régit la nature tout entière, qui gouverne l'univers, et qui est, on peut dire, la loi même de Dieu, si toutefois les regards humains peuvent s'arrêter sur de telles splendeurs, sans en être aveuglés, comme les im- page XXXIX prudents qui osent porter directement les yeux sur le soleil? Ceci doit nous montrer à la fois et le rapport des Idées aux choses sensibles, et le rapport des Idées entre elles. Sans leur donner une existence séparée, il faut leur accorder une existence supérieure. Les choses n'existent, à proprement parler, que par les Idées qu'elles représentent, et où elles trouvent leur nom et leur essence. Sans les Idées, les choses ne sont pas intelligibles ; et si l'on reconnaît que les choses existent réellement, on ne peut nier non plus que leur existence substantielle ne soit en sous-ordre, au point de vue de la raison. L'existence de l'Idée est donc au-dessus de celle des choses, autant que la raison est supérieure à la sensibilité, autant que l'âme est supérieure au corps. En second lieu, il y a des degrés entre les Idées, ainsi qu'il y en a entre les êtres. En tant qu'êtres, tous les êtres sont égaux; l'un n'est pas plus être que l'autre. Pourtant, ils ne tiennent pas tous la même place dans le monde ; et l'on peut observer entre eux une subordination et une hiérarchie, XL qui part des plus humbles pour monter jusqu'aux plus relevés. Il en est de même dans la hiérarchie des Idées ; et selon les genres, selon les espèces, selon les individus, où on l'es contemple, elles forment une continuité et une chaîne, qui s'étend, du monde obscur où nous sommes, jusqu'au sommet de l'Être, et au suprême ordonnateur, qui est Dieu. Ainsi les Idées, en nous apprenant d'abord ce que sont essentiellement les choses, nous révèlent en quelque sorte le plan de l'univers, le plan du Cosmos, l'Ordre, que les Pythagoriciens ont si bien nommé. Elles sont la marque du divin dans les choses. A ce titre, les Idées sont éternelles, comme le monde, comme Dieu. Tout en étant dans les choses périssables, elles ne périssent pas avec elles; ce sont des formes intelligibles et incorporelles, que l'école de Mégare plaçait avec raison dans une région supérieure et invisible, et dont elle faisait les véritables êtres. Platon n'hésite point à dire que cette faculté de comprendre le général, en d'autres termes, ce qui est renfermé sous une unité page XLI rationnelle, est le propre de l'homme, surtout du philosophe. Il cherche donc une méthode pour marcher sûrement du particulier au général, à l'universel, à l'absolu, qui, étant l'essence immuable des choses, est le seul fondement de la science; il n'y a science véritable que de l'absolu, qui ne change pas ; tout le reste n'est qu'une vaine opinion et qu'une ombre. Cette méthode Platonicienne, c'est la Dialectique, qui nous enseigne à saisir immédiatement les choses intelligibles; qui, sans l'intervention des sens, s'élève par la raison jusqu'à l'essence des choses, en discerne le premier principe, et parvient régulièrement, par la pensée seule, à l'essence même du bien. C'est ainsi que la Dialectique est le comble et le faîte de toutes les sciences, comme l'Idée du bien est le sommet de toutes les Idées. C'est la partie la plus difficile de la philosophie ; mais c'en est aussi la plus lumineuse et la plus utile. Maintenant, Platon se le demande : Les Idées ne sont-elles que des mots? Sont-elles uniquement des pensées qui, ne peuvent exister ailleurs que dans l'âme? A ces deux page XLII
questions, que notre Scholastique du Moyen-Âge devait
agiter si longuement, la réponse est évidente, après ce qui précède.
Oui, les Idées sont des mots; oui, elles sont des pensées, puisque,
d'une part, elles nous servent à nommer les choses, et que, d'autre
part, c'est la raison qui les conçoit. Mais ce serait une sorte de
contradiction sacrilège de croire que les Idées ne sont que cela.
Comme ce sont elles qui confèrent aux choses l'essence qui les fait
ce qu'elles sont, elles ne peuvent être de vains mots; elles ne
peuvent pas avoir moins d'existence que les choses où elles
apparaissent et qui en participent. Comme ce sont elles que la
raison comprend, elles sont bien dans la pensée de l'homme; mais
elles sont ailleurs aussi, puisque ce n'est pas la pensée qui les
produit ; elles sont dans les genres qu'elles constituent ; elles y
existent d'une existence qu'on peut nier d'autant moins qu'elle est
impérissable et éternelle (04). page XLIII telle que Platon l'a conçue, qu'il l'ait inventée ou qu'il l'ait empruntée aux Mégariques. Mais on doit avouer que, parfois, son langage est équivoque, et qu'il prête à des interprétations fâcheuses. Ainsi, lorsque, prenant l'exemple assez singulier d'un lit, il parle de trois Idées, l'une qui est à Dieu, l'autre qui est au tourneur, et la troisième qui est au peintre, on peut croire qu'il isole les Idées et les choses ; car il ne se peut guère que ce soit une même Idée qui appartienne tout ensemble à Dieu, à l'ouvrier, et à l'artiste. Et puis, y a-t-il donc des Idées de tout, et spécialement des choses que fabrique la main de l'homme? Le doute né de cette équivoque est encore plus permis pour ce mythe du Phèdre, où Platon représente les âmes à la suite des Dieux, parcourant le monde des essences et les contemplant étincelantes de lumière, avant de descendre dans les ténèbres et la caverne d'ici-bas. Les essences, les Idées sont donc séparées des choses, puisque les âmes ont pu les voir dans un monde autre que le nôtre, et qu'elles en ont fait le tour sur les chars qui les empor- page XLIV talent. Mais un mythe, quelque brillant qu'il soit, et des écarts passagers d'expressions, ne peuvent pas prévaloir contre le reste du système; et le système Platonicien est bien celui qu'on vient d'exposer. Prétendre que cette théorie soit vraie de tous points, et qu'elle nous explique définitivement le mystère des choses, ce serait une exagération ; mais penser qu'elle contient une grande part de vérité, et qu'elle a cet immense mérite de maintenir l'unité universelle, en ne séparant pas le monde sensible du monde intelligible, ce n'est que lui rendre justice. La théorie des Idées, malgré toutes les attaques dont elle a été l'objet, n'a pas succombé dans la lutte, si, d'ailleurs, elle n'en est pas sortie complètement victorieuse. Nous pouvons, maintenant, examiner les objections d'Aristote ; nous sommes en état de les apprécier mieux, sachant préalablement ce qu'a dit Platon. Partant de ce fait erroné, à savoir que les Idées sont séparées et indépendantes des choses, Aristote fait une première objection, qui ne laisse pas que d'être quelque peu iro- page XLV nique. Selon lui, pour expliquer les êtres, Platon commence par les doubler, à peu près comme si quelqu'un, qui serait embarrassé de compter un certain nombre de choses, allait s'imaginer que, en doublant ce nombre, il rendrait son calcul plus aisé. Mettre des Idées à côté des choses, c'est rendre le problème deux fois plus difficile, loin de le simplifier, puisque, après les choses qu'il s'agit de définir, les Idées exigent une définition nouvelle. Que deviennent alors toutes les sciences? Outre le ciel que nous observons, l'astronomie aura donc à observer un autre ciel, un autre soleil, d'autres astres; l'optique, l'harmonie, toutes les branches des mathématiques, auront de même un double objet. Les arts que l'homme pratique, et qui parfois sont d'une si urgente application, pourront-ils s'arranger de ces doublements, qui s'étendent à tout? Par exemple, la médecine devra-t-elle s'adresser à l'Idée de la maladie, au lieu de s'adresser à la maladie trop réelle dont souffre le patient, qui réclame sa guérison? Non seulement les sciences ne gagnent rien à cette superposi- page XLVI tion des Idées; mais elles s'y annulent en même temps que les arts, qui, encore moins que les sciences, permettent ces hésitations et ces alternatives. On est surpris qu'Aristote ait pu faire une telle objection, tant la réponse est facile. Platon est si loin de doubler le nombre des êtres, ainsi qu'on l'en accuse, que, tout au contraire, il le réduit de beaucoup. Les genres sont bien moins nombreux que les espèces, et surtout que les individus. Les Idées ne sont que les genres; et en substituant les Idées aux individus innombrables, Platon diminue les objets que considère la science. L'Idée étant l'unité dans la pluralité, la science, en contemplant l'Idée, loin d'accroître la foule des êtres, la supprime bien plutôt. En chaque genre, elle se borne à un seul terme, au lieu de cette multiplicité qui s'offre tout d'abord à la sensation, et qui obscurcit l'intelligence. Mais, ajoute Aristote, Platon n'a pas démontré l'existence des Idées. — Non, sans doute, et par une excellente raison, qu'Aristote peut repousser moins que personne ; page XLVII c'est qu'on ne démontre pas les principes. Or, s'il est un principe, certainement c'est l'essence, c'est l'Idée. On ne la démontre pas, parce qu'il est impossible de remonter, plus haut qu'elle, à un principe qui lui serait supérieur. Il suffit en quelque sorte de la montrer, comme Aristote lui-même a posé l'universel, en l'expliquant dans les Derniers Analytiques, sans le démontrer. C'est précisément ce qu'a fait Platon. Dans l'être, il a fait voir ce qui en est l'essence, c'est-à-dire le genre dans le particulier, dans l'individuel. Il n'avait pas à la démontrer. Il se borne à énoncer une explication qu'il affirme ; on peut la contester, si on la trouve fausse; mais, à la place d'une définition, on ne saurait exiger une démonstration, qui n'est point nécessaire, et que la nature du sujet ne comporte pas. Aristote l'a dit cent fois: Tout n'est pas démontrable, puisque alors il n'y aurait plus de démonstration possible. C'est même de cet axiome bien compris qu'il a tiré quelques arguments décisifs contre le Scepticisme. Encore une fois, Platon n'a point à démontrer les Idées; il les page XLVII trouve dans les choses, et il les prend telles que la réalité les lui offre et les lui impose. Ainsi, tombe le reproche qu'Aristote lui adresse, de n'avoir tenté que des démonstrations insuffisantes. Une objection plus spécieuse, mais qui n'est guère plus exacte, c'est que Platon, au lieu de définir les choses sensibles, aurait défini des êtres différents de ces choses. Différents certainement, en admettant, comme Aristote a le tort de l'admettre, que les Idées sont en dehors des choses. Mais, si les Idées ne sont pas indépendantes et séparées, en les définissant, on définit bien les choses elles-mêmes. L'essence, ou l'Idée, est l'élément le plus important de la définition, puisque c'est le genre. Platon ne se trompe pas, en croyant définir les choses quand il définit les Idées. Seulement, il choisit dans la définition, pour s'y arrêter expressément, la partie qui en est la plus nécessaire; et c'est à celle-là qu'il applique toute sa dialectique. Aristote n'essaie pas autre chose, quand il s'attache surtout à faire comprendre ce que c'est que le genre, dans sa profonde théorie page XLIX de la définition. En cela, il est beaucoup plus près de Platon qu'il ne se le figure; et son Universel, que la raison découvre sous les phénomènes particuliers, est à peine distinct de l'Idée, si vivement critiquée par lui. Mais voici une objection très fondée, quoique la faute commise par Platon fût presque inévitable. Platon n'a pas dit de quelles choses il y a des Idées, et de quelles choses il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des Idées de tout ? Par exemple, est-ce qu'il y a des Idées pour les relatifs ? Est-ce qu'il y en a pour des négations? Est-ce qu'il y en a pour les choses périssables, même après que ces choses sont détruites ? Comment y aurait-il une Idée, c'est-à-dire une essence, pour des choses qui n'ont d'existence que dans la relation qu'elles soutiennent avec d'autres choses, et qui n'existent plus du moment que ce rapport vient à leur manquer ? La relation peut-elle jamais devenir une substance, objet d'une définition essentielle? Y a-t-il des Idées pour les choses périssables que l'art humain produit, mais qu'il pourrait page L aussi ne pas produire ? Est-ce qu'il y a une Idée de la maison, soit avant que l'architecte ne la construise, soit après que cette maison ruinée ne subsiste plus? Est-ce qu'il y a une Idée de la santé, avant que l'habile médecin ne produise la santé, en la procurant au malade? Si les Idées s'étendent à tout dans le monde, alors les choses les plus viles ont des Idées, aussi bien que les choses les plus nobles. Dans toutes uniformément et sans distinction, relatifs, négations, produits des arts, on retrouve, aussi bien que dans les substances, l'unité dans la pluralité ; et si c'est là l'Idée, pourquoi l'Idée n'existerait-elle pas pour les choses sans substance, aussi bien que pour les substances les plus réelles, pour les vices les plus hideux, aussi bien que pour les vertus les plus admirables? Platon, selon Aristote, n'a rien examiné de ces questions, que la théorie des Idées laisse dans une entière incertitude. Tout cela est vrai; mais on peut retourner l'argument contre Aristote lui-même. Il loue quelque part son maître d'avoir reconnu autant d'Idées qu'il y a de choses dans le page LI
monde. Or, peut-on demander sérieusement à quelqu'un
une énumération complète des choses dont l'univers se compose?
Platon n'a pas dénombré les Idées. Mais est-ce qu'Aristote a énuméré
davantage ses universaux, bien qu'ils fussent moins nombreux que les
Idées platoniciennes, dont ils sont si rapprochés ? Aristote s'est
contenté d'en indiquer quelques-uns, en omettant les autres. C'est
également ce qu'a fait Platon pour les Idées. Il s'est borné à
quelques-unes, mais tellement choisies, et tellement importantes,
qu'elles suffisent pour faire entrevoir De même qu'Aristote blâmait les Pythagoriciens d'avoir pris les Nombres pour les cléments de tous les êtres, de même il blâme Platon d'avoir fait des Idées les éléments des choses; et il triomphe, en demandant comment il est possible de concevoir que les Idées, qui sont hors des choses et qui en sont séparées, puissent être la matière de quoi que ce soit; comment elles peuvent être substances là où elles ne sont même pas. Sans contredit, Aristote aurait élevé ici un page LII argument irréfutable, s'il était vrai que Idées platoniciennes fussent séparées des choses, où la raison les aperçoit et les discerne. Mais il n'en est rien ; et à moins qu'Aristote n'ait eu d'autres ouvrages de Platon que ceux que nous possédons, la théorie qu'il lui prête sur la matière n'est pas la sienne. Nous ne voudrions pas défendre de tous points la théorie platonicienne sur la composition matérielle des choses ; mais nous pouvons dire que cette théorie est autre qu'Aristote ne la fait. Lorsque, dans le Timée, Platon remonte à l'origine de choses, et que, dans ces pages solennelles, il nous fait assister à la naissance du monde, que Dieu organise, on voit qu'il fait la matière coéternelle à Dieu et antérieure aux Idées. Plus tard, les Idées descendront dans la matière, à laquelle elles se mêleront pour la rendre intelligible à l'âme ; mais elles ne sont pas la matière, qui les a précédées, ou qui, tout au moins, leur est contemporaine. Il est bien certain que Platon a dit souvent que les Idées du Grand et du Petit, c'est-à-dire que la grandeur et la petitesse relatives page LIII des êtres, sont les principes matériels des êtres. Mais cette expression signifie uniquement que les êtres ont, les uns relativement aux autres, plus ou moins d'étendue, selon qu'ils contiennent plus ou moins de cette matière primordiale, réceptacle commun de toutes les formes et de toutes les Idées. C'est si bien là la pensée de Platon qu'Aristote lui reproche à plusieurs reprises de n'avoir admis que deux principes, l'essence et la matière: l'une, cause du bien, et l'autre, cause du mal. Mais si, à ce titre, l'essence ou l'Idée est distincte de la matière, évidemment les Idées ne peuvent plus avoir été pour Platon les éléments des êtres, ainsi qu'on le prétend. Aristote se contredit, et, tout à la fois, il se trompe ; il faut bien l'avouer, malgré toute l'admiration qu'il nous inspire. Il se peut que des disciples de Platon, identifiant les Idées et les Nombres, aient conféré aux Idées la fonction que les nombres remplissaient dans l'école Pythagoricienne ; mais Platon ne doit pas être responsable des fautes commises après lui. Dans sa doctrine, les Idées ne sont pas plus les éléments page LIV des choses qu'elles ne sont des nombres. Après avoir essayé de prouver que Platon a inutilement, et sans motif, multiplié les êtres, qu'il n'a pas démontré l'existence des Idées, qu'il s'est mépris en définissant des êtres différents, en place des choses sensibles, qu'il n'a pas énuméré les Idées avec assez de soin, qu'il ne les a pas assez circonscrites, qu'il a eu tort d'en faire les éléments matériels des choses, erreur renouvelée des Nombres pythagoriciens, Aristote poursuit cette critique, amère plus souvent que juste; et il attaque la forme même sous laquelle Platon a cru pouvoir présenter sa théorie. Qu'entend-on par la participation des choses aux Idées? La Participation est-elle autre chose que l'Imitation Pythagoricienne ? Qu'est-ce que ces exemplaires sur lesquels les choses doivent se modeler? Ces exemplaires prétendus, ne deviennent-ils pas parfois des copies? Si l'espèce est exemplaire des individus, n'est-elle pas la copie du genre? L'exemplaire ne devra-t-il pas se répéter deux ou trois fois pour le même être? Et ainsi, un homme quelconque n'aura-t-il pas besoin des page LV trois exemplaires, de l'Homme-en-soi, de l'Animal et du Bipède ? Si l'être qui participe de l'Idée et l'Idée dont il participe sont d'un même genre, n'y a-t-il pas, dès lors, pour ces deux termes, un terme commun et supérieur, qui s'applique tout aussi bien au participé qu'au participant? S'il n'y a pas de genre commun aux deux, alors l'être et l'Idée ne sont-ils pas homonymes? Y a-t-il là une autre relation qu'une identité d'appellation purement verbale ? Dire l'Homme-en-soi, le Cheval-en-soi, le Cheval-même, l'Homme-même, n'est-ce pas une forme de langage parfaitement insignifiante? Et que croit-on ajouter ainsi aux expressions ordinaires dont tout le monde se sert, l'homme, le cheval ? De tout cela, Aristote croit pouvoir assurer que la théorie des Idées n'est qu'une accumulation de mots vides de sens, et de métaphores bonnes tout au plus pour les poètes. Il va jusqu'à déclarer que cette théorie, par trop logique, brave toute raison. Cette réprobation péremptoire peut être vraie, quand on suppose les Idées séparées; mais, encore une fois, ce n'est pas ainsi que Platon les a page LVI conçues; et nous devons le répéter, pour que des critiques aussi autorisées que celles d'Aristote, n'aient jamais l'air d'être acceptées sans protestation. En voici d'autres d'un genre différent. Aristote, qui a lui-même un système très arrêté et très profond sur les causes et les principes, conteste aux Idées de pouvoir être des causes, de quelque manière que ce soit. Elles ne le sont, ni en tant qu'essence, ni en tant que matière, ni en tant que mouvement, ni en tant que fin. Elles seraient tout au plus causes d'immobilité et de repos absolu ; et alors, Platon ne ferait guère que reproduire les doctrines des Éléates, et de Parménide, sur l'unité et sur l'immobilité universelles. Le Phédon a beau affirmer que les Idées sont causes de l'existence et de la production des êtres, ce n'est pas par l'intervention des Idées que les êtres naissent et se reproduisent. Nous le voyons : c'est un homme qui engendre un homme; ce n'est pas l'idée de l'homme. En admettant même un instant que les Idées soient des. exemplaires, c'est l'artiste qui produit son œuvre ; elle n'est pas page LVII produite par l'Idée, dont elle participe ou qu'elle imite. Sans l'artiste, l'Idée, réduite à elle seule, aurait-elle jamais enfanté l'image dont nous sommes charmés? Comme causes finales, les Idées ne sont pas plus fécondes; elles n'expliquent en aucune façon ce que c'est que le bien, fin dernière et perfection de tous les êtres, fin suprême de l'univers entier, sans laquelle on ne peut rien comprendre à l'ordre éternel, qui y règne, sous la main de Dieu. Parmi toutes ces assertions d'Aristote, la plupart très gratuites, nous ne nous arrêterons qu'à la dernière. Refuser à l'auteur du Timée et des Lois la croyance aux causes finales et au bien, nier que les Idées soient des causes, en présence des émotions irrésistibles qu'elles provoquent dans les âmes, c'est nier l'évidence. Aristote a donc oublié cette grande théorie, une des plus belles de sa Métaphysique, au XIIe livre, où il explique l'action divine par l'attrait tout-puissant que Dieu exerce sur les choses, comme l'objet désirable l'exerce sur le désir? Que cette explication de l'acte et du mystère page LVIII divins soit vraie ou qu'elle soit fausse, peu importe; Aristote, qui la donne pour exacte, et qui semble en tirer justement quelque gloire, peut-il la méconnaître, quand il s'agit des Idées platoniciennes? Ou le Dieu d'Aristote n'est pas cause finale au sens où il le dit, ou les Idées le sont au même titre. Le Banquet, le Phèdre, ne nous montrent-ils pas aussi les attraits invincibles de l'amour et de la beauté? La Vénus-Uranie n'est-elle plus une Idée? Ou Aristote doit renoncer à sa propre doctrine ; ou il doit accorder aux Idées qu'elles sont des causes finales, inférieures, mais analogues, au Dieu qu'il préconise, et qui, à bien des égards, est le vrai Dieu. Le Dieu d'Aristote est séparé du monde, au moins autant que les Idées sont séparées des choses, quand on les comprend mal ; et cependant Aristote ne refuse pas à son Dieu d'être une fin, puisqu'il en fait la cause finale de l'univers. Les Idées, même séparées, pourraient donc aussi être causes du mouvement; et elles ne réduisent pas les choses à l'immobilité, ainsi qu'on les en accuse. Sans le mouvement, la nature n'existe page LIX plus, et l'étude en devient impossible au philosophe, c'est Aristote qui nous l'assure ; mais les Idées ne condamnent pas les choses à l'éternel repos, pas plus qu'elles n'en excluent l'Idée du bien. En résumé, c'est à une condamnation absolue qu'Aristote en arrive. D'après lui, les Idées platoniciennes ne servent en rien à expliquer les choses. Heureusement, la sentence n'est pas sans appel, et le tribunal reste toujours celui de la vérité et de l'histoire. Ici l'on peut répéter : « Adhuc sub judice lis est. » Après ce long, mais respectueux dissentiment avec Aristote, on est heureux de trouver à le louer sans réserve. Sa réfutation du Scepticisme, et son exposé du principe de contradiction sont des chefs-d'œuvre. Les deux théories se tiennent étroitement. Le Scepticisme ébranle la raison humaine dans ses fondements les plus secrets; en la faisant douter de tout au dehors, il lui prépare ce suicide intime qui consiste à douter de soi, et à ruiner, du même coup, dans l'âme, toute croyance scientifique et toute moralité. page LX Aristote conjure ce danger, en y opposant le plus ferme de tous les principes, le principe de contradiction, que le Scepticisme, quelque aveugle ou quelque impudent qu'il soit, ne peut repousser sans se détruire de ses propres mains. Le remède le plus efficace se trouve ainsi à côté du mal le plus redoutable ; et le principe de contradiction rétablit inébranlablement tout ce que le Scepticisme tendait à renverser. Au temps d'Aristote, le Scepticisme n'avait pas la forme savante et précise qu'il essaya de prendre plus tard avec Aenésidème et Sextus Empiricus. Mais il n'en était peut-être que plus nuisible. La science, visant à paraître rigoureuse bien qu'elle ne le soit pas en effet, ne s'adresse qu'à quelques-uns; elle les égare, parce qu'elle est menteuse; mais ils sont peu nombreux; et le mal ne s'étend pas très loin. Au contraire, sous des formes plus faciles et moins sévères, il produit bien plus de ravages. Tel était le scepticisme des Sophistes, que Socrate et Platon n'avaient cessé de démasquer et de combattre. Leurs armes avaient été surtout l'ironie et la réfu- page LXI talion. Pour venger le bon sens, ils immolaient au ridicule des doctrines qui l'affrontaient insolemment. Les argumentations dérisoires de l'Euthydème valent bien les bouffonneries d'Aristophane ; et l'indignation du Gorgias n'est que l'écho de la conscience humaine, protestant contre les corruptions de cette morale relâchée. Aristote partage tous ces sentiments ; il les pousse peut-être même au-delà des bornes. Parmi les Sophistes qu'il poursuit, il comprend des personnages que nous n'y comptons pas habituellement. Passe pour Parménide et Protagore, passe pour Héraclite et Cratyle, partisans exagérés du flux perpétuel des choses. Mais Empédocle, Démocrite, et surtout Anaxagore, ne sont pas à mettre en une telle compagnie. Empédocle n'est pas très coupable pour avoir pensé que « Ce sont les choses présentes qui agissent sur nous le plus vivement ». Anaxagore ne l'est guère davantage, pour avoir dit à quelques-uns de ses amis que « Les choses ne seraient jamais pour chacun d'eux que ce que leur jugement voudrait bien les faire ». Mais c'est page LXIII particulièrement à Protagore qu'Aristote s'attache, et il le prend pour principal représentant du Scepticisme sophistique. Protagore était de son temps un très célèbre rhéteur; le Dialogue que Platon lui a consacré suffit à le témoigner. Dans sa lutte contre Socrate, il n'a pas toujours le dessous ; ce qui n'est pas un petit éloge. C'est un adversaire avec lequel il y a profit et plaisir à discuter. Mais, outre son talent et son habileté, Protagore avait eu la bonne fortune d'inventer une de ces formules qui résument à merveille l'état général des esprits, et qui sont accueillies par l'engouement de la mode. Parfois même, ces formules survivent et traversent les siècles. Celle de Protagore, arrivée jusqu'à nous, est bien connue : « L'homme est la mesure de tout. » Lorsqu'elle parut, elle causa, nous pouvons le croire, presque autant d'impression que la théorie de la sensation dans notre XVIIIe siècle. Protagore a été une sorte de Condillac au temps de Périclès. En quelques mots, dont chacun pouvait être juge, il avait exprimé ce que chacun pensait; il révélait, lui page LXIII aussi, le secret de tout le monde. Voilà pourquoi Aristote le choisit pour adversaire de préférence au reste des Sophistes. Avec une sagacité, dont nous ne saurions nous étonner, Aristote signale immédiatement la cause la plus fréquente, et presque unique, du Scepticisme. C'est qu'on accorde à la sensation une importance qu'elle n'a pas, et qu'on exagère démesurément son rôle, d'ailleurs très réel. Si l'homme est la mesure de tout, la conséquence qui ressort de ce principe, c'est qu'il n'y a plus rien au monde de vrai ni de faux. Tous les hommes sont également juges des choses, sans que l'un le soit plus que l'autre. Ce qui semble bon à celui-ci semblant mauvais à celui-là, il s'ensuit que rien n'est en soi, ni mauvais, ni bon. L'un soutient que la chose existe ; l'autre soutient, avec non moins de droit, qu'elle n'existe pas. La chose est donc, et, tout à la fois, elle n'est pas; car le jugement qui affirme vaut tout autant que celui qui nie. Alors, se produit cette confusion inextricable, que quelques philosophes plaçaient à l'origine des choses ; et elle se manifeste dé- LXIV sormais par toutes ces assertions contraires qui se multiplient, chaque jour, dans les discussions philosophiques. Aristote est trop impartial et trop sage pour ne pas reconnaître les droits de la sensation. Il accorde que l'apparence est pour chacun de nous ce qu'elle nous apparaît. Mais ce n'est pas elle qui est la vraie mesure des choses; et il limite les droits de la sensation par la sensibilité même. Un sens rectifie les informations d'un autre sens; et, d'une première information, nous en appelons à une seconde, qui la redresse. On connaît cette expérience, cent fois répétée, où un de nos doigts, glissé sous le doigt voisin, nous donne la sensation de deux objets là où il n'y en a qu'un. Du sens du toucher, on en appelle au sens de la vue, qui nous certifie qu'il n'y a qu'une seule boule et non deux; et nous nous en rapportons au témoignage irrécusable de nos veux. La sensation ne se trompe jamais sur son objet propre; ce qui nous trompe, c'est la conception que nous nous en formons. Mais il n'est pas un sens qui, au même moment et sur une même page LXV chose, vienne nous apprendre qu'elle est, et, tout ensemble, qu'elle n'est pas. La vue elle-même , qui paraît le plus fidèle de nos sens, peut nous tromper quelquefois et dans certaines circonstances; mais elle ne nous trompe que quand nous le voulons bien. Ainsi, en pressant un peu le globe de l'oeil d'une façon spéciale, les objets paraissent doubles ; la pression venant à cesser et l'organe reprenant son état naturel, les objets nous apparaissent simples de nouveau, comme ils le sont réellement. La pression les avait dénaturés ; ils reprennent, par notre volonté, leur nature, qu'une action étrangère avait métamorphosée. Sans même qu'il y ait intervention d'une force extérieure, nous changeons, nous aussi, à tout moment. Telle chose que nous aimions naguère nous répugne à un autre moment. Non seulement le vin, qui semble doux à l'un, semble amer à un autre ; mais le même individu, qui, dans telle disposition, goûtait ce vin, ne peut plus le souffrir dans telle autre disposition. Est-ce la liqueur qui a changé? Nullement; elle est restée ce qu'elle page LXI était; mais c'est nous qui avons changé, par une de ces modifications que nous n'observons pas, et qui bouleversent notre sensibilité. Il n'en est pas moins vrai que notre seconde sensation nous donne un goût amer, là où la sensation précédente nous avait donné une saveur agréable. Mais ce sont des sensations successives. Qui ne sait combien les changements de ce genre sont plus fréquents et plus actifs dans nos maladies, ou nos infirmités? Est-ce la maladie, est-ce la santé qu'on prendra pour arbitre? Et pour peu qu'on s'observe soi-même, n'est-ce pas à soi qu'on rapportera ce brusque revirement, où les choses ne sont absolument pour rien? Parfois même, il est possible que nos deux yeux né voient pas tout-à-fait d'une façon pareille; et alors, auquel des deux faudra-t-il nous en rapporter ? Bien plus, l'homme n'est pas le seul être sensible ; il n'a pas le privilège exclusif de la sensation. Les animaux sentent ainsi que lui ; et, à certains égards, beaucoup mieux que lui. Invoquera-t-on, pour juger de la nature des choses, l'exemple des animaux, éle- page LXVII vés au même rang que nous? Devra-t-on consulter leurs mouvements instinctifs, tout aussi attentivement que nous consultons notre raison? A ces arguments d'observation psychologique, Aristote en joint d'autres, qui relèvent encore plus directement du sens commun, outragé par le Scepticisme, et de la pratique de la vie, que les sophistes, en dépit de leurs théories, acceptent aussi docilement que le restant des humains. Il est si faux que la même chose soit et ne soit pas, il est si faux qu'il n'y ait ni vérité ni erreur, que ces gens, si dédaigneux des opinions de l'humanité entière, n'hésitent jamais, dans l'occasion, à prendre résolument tel parti plutôt que tel autre. Ils ne se trompent pas sur celui qu'ils doivent choisir. Sus ont quelque affaire d'intérêt à régler à Mégare, croiront-ils que ce soit la même chose de demeurer tranquillement à Athènes, ou de se rendre auprès du débiteur qui doit les payer? Si, en suivant un chemin, ils arrivent au bord d'un puits, où ils risqueraient de se tuer en tombant, continueront-ils leur route tout droit? page LXVIII Ou bien ne feront-ils pas un détour, pour éviter le précipice qui les menace? Admettront-ils encore, dans ce péril imminent, que tout est vrai et que tout est faux? Et leur conduite s'accordera-t-elle avec leurs doctrines? Se précipiteront-ils dans le trou, pour confirmer des paradoxes effrontés? Si le médecin ordonne une potion, iront-ils en prendre une autre, à la place de celle qui doit les soulager? S'ils ont soif, accepteront-ils des aliments solides, dont ils ne sentent pas le besoin, et qui seraient contraires au besoin trop réel qui les tourmente? Il est clair que, dans tous ces cas, ils jugeront que l'une des deux alternatives vaut mieux que l'autre; et, chose humiliante pour leur orgueil, ils seront, sans la moindre perplexité, de l'avis de tout le monde (05). Il y a donc quelque chose d'absolu, malgré tout ce qu'en peuvent dire les sophistes. Personne ne reste indifférent et n'ouvre l'oreille à leurs conseils. Ils sont eux-mêmes page LXIX moins indifférents que qui que ce soit, si ce n'est en paroles. Leur activité reste parfaitement saine et raisonnable, quoique leur intelligence soit dépravée par leurs théories. Il y a des philosophes qui poussent ces extravagances jusqu'à soutenir qu'il est impossible de distinguer la veille du sommeil. Mais, parce qu'ils ont rêvé, étant en Afrique, qu'ils étaient à Athènes, croiront-ils à leur réveil qu'ils doivent se mettre en route pour aller à l'Odéon?
Si, dans toutes les circonstances de la vie, il y a,
même pour les plus endurcis des sceptiques, du meilleur et du pire,
c'est qu'il y a aussi dans les choses du plus et du moins. page LXX mais qui est essentiellement bon ou mauvais. Deux est un nombre pair; Trois est un nombre impair; Cinq est Cinq, et non pas Mille ; on veille, et l'on ne dort pas; ou l'on dort, et l'on ne veille pas ; on est à Mégare ou à Carthage.
Aristote fait cette concession au Scepticisme que,
dans le monde sensible, tout est, si l'on veut, en un mouvement et
un flux perpétuels; dans le monde, tout change à tout instant ; il
n'y a rien de permanent que ce qu'y conçoit notre raison, se
substituant à notre sensibilité. Mais, si l'on veut bien sortir du
monde sensible et lever les regards vers le ciel, le spectacle est
autre ; et, à moins de renoncer au témoignage de la sensation, que
tout à l'heure on prisait tant, il faut avouer que, dans les cieux,
il y a une permanence immuable. Tout y est en mouvement page LXXI et ruine toute vérité, à en croire les Sophistes. Aristote leur demande de ne point conclure si légèrement du particulier au général. Parmi les objets sensibles eux-mêmes, c'est le moindre nombre, de beaucoup, qui est soumis au changement. Oui, le monde sensible qui nous environne, est sujet à la production et à la destruction ; mais il est seul à y être assujetti. Notre monde n'est qu'une parcelle, qui ne compte pour rien, à vrai dire, dans l'univers; et alors, n'est-il pas mille fois plus raisonnable d'absoudre notre monde par l'univers, plutôt que de condamner l'univers aux conditions de notre monde? Toutes ces objections d'Aristote contre le Scepticisme peuvent nous sembler surannées, parce que voilà deux mille ans, et plus, qu'on les répète, sous toutes les formes, sans d'ailleurs y beaucoup ajouter. Mais reportons-nous au temps d'Aristote, et convenons qu'alors elles étaient bien neuves. Il est d'ailleurs assez probable que ce n'est pas Aristote qui les a trouvées le premier, et que la plupart avaient cours déjà dans l'école de Platon, comme l'atteste le Théétète, et dans page LXXII d'autres écoles voisines. Mais Aristote a eu ce très grand mérite de rassembler méthodiquement toutes ces réponses éparses, et de leur donner, en les réunissant, la force d'un corps de doctrines. Ce qui paraît appartenir plus proprement au philosophe, c'est la théorie du principe de contradiction ; elle n'est qu'à lui. dans ce qui la précède, rien ne l'a préparée, si ce n'est peut-être quelques discussions des Dialogues de Platon, où Socrate amène adroitement des Sophistes, ses interlocuteurs, à soutenir alternativement le pour et le contre sur un même sujet. C'est un piège de conversation, qu'une dialectique puissante et sûre d'elle-même a bien le droit, en vue d'un but supérieur, de tendre à des adversaires peu loyaux et peu sensés. Mais il y a loin de là à une doctrine formelle, qui assure à notre raison un fondement inébranlable. Ces escarmouches légères et charmantes, quoique triomphantes, sont loin de ce combat en règle que livre Aristote, et de cette victoire définitive qu'il remporte en faveur de l'éternelle vérité. Entre ses mains, le principe de contradiction page LXXII une arme à laquelle rien ne résiste, et dont les ennemis ne peuvent se servir sans se blesser eux-mêmes mortellement. dans la philosophie antique, c'est l'Aliquid inconcussum que cherchait notre Descartes, et qu'il trouve dans son fameux axiome. Le principe de contradiction est le «Je pense, donc je suis» d'Aristote; et ce principe, moins psychologique que celui de Descartes, n'est, ni moins clair, ni moins solide. Dans la philosophie moderne, le principe de contradiction n'occupe pas tant de place ; il y est à peu près oublié; et, quand on en fait usage, il a quelque chose d'indécis et une apparence d'inutilité, même quand c'est un Leibniz qui l'emploie. Pour Aristote, au contraire, c'est le plus fécond de tous les principes, en même temps qu'il en est le plus élevé. C'est le principe universel de la raison, et l'axiome irréfragable, que le Scepticisme lui-même est contraint de subir, quoiqu'il en soit renversé. « Une même chose ne peut pas en même temps être et n'être pas, » voilà la formule, aussi simple et plus vraie que celle de Prota- page LXXIV gore, à qui Aristote semble encore ici vouloir répondre. La chose est ce qu'elle est; elle n'est pas le contraire d'elle-même. La substance peut bien recevoir tour à tour les contraires; elle ne peut pas les posséder en même temps; car alors, il serait impossible de discerner ce qu'elle est; et, par suite, on ne saurait en dire quoi que ce soit, en l'affirmant ou en la niant, puisqu'elle serait l'un des deux contraires tout aussi bien que l'autre. Par conséquent, les contradictoires ne peuvent toutes deux être vraies à la fois, ni fausses à la fois ; il faut que l'une des deux soit vraie, et que l'autre soit fausse. Ce principe posé, Aristote montre, avec une irrésistible clarté, quelle en est la nature et quelles en sont les conséquences. D'abord, ce principe est indispensable pour comprendre la réalité. Sans lui, tout dans la nature reste indéterminé, et sans aucune signification. Les choses étant indistinctement ceci ou cela, elles ne sont rien, ni en elles-mêmes, ni pour l'esprit qui essaierait de les concevoir. Elles ne peuvent pas môme avoir un nom ; car le nom contraire leur convient page LXXV
également; l'objet n'est pas blanc; il n'est pas noir
davantage; et il ne peut être non plus aucun des intermédiaires,
puisque, s'il y avait un intermédiaire quelconque, cet intermédiaire
pourrait, comme l'objet lui-même, à la fois être et ne pas être. En
outre, ce principe est pur de toute hypothèse. Pour en sentir
l'irrécusable vérité, il n'est pas besoin de faire préalablement
aucune supposition; il se suffit à lui-même; il n'exige aucun effort
d'une raison saine et non prévenue. Parmi les philosophes célèbres qui ont soutenu qu'une chose peut, tout ensemble, page LXXI être et n'être pas, on cite souvent Héraclite. Il est bien possible qu'il ait avancé un tel paradoxe ; mais on sait, de reste, qu'on n'est pas tenu de penser tout ce qu'on dit. Héraclite lui-même, s'il eût observé avec plus d'attention sa propre pensée, se serait convaincu de son erreur. De même que les choses ne reçoivent pas simultanément les contraires, de même il est de toute impossibilité qu'un même esprit puisse avoir des pensées contraires dans un même moment. A l'instant où il pense à une chose, il ne peut pas penser à une autre ; à l'instant où il pense à telle qualité de la chose, il ne peut pas penser à la qualité contraire. L'esprit passe successivement d'une chose à une autre chose, d'une qualité de certaine espèce à une qualité d'espèce différente. Mais la simultanéité des pensées est impossible, même en supposant que les pensées fussent semblables, parce que alors l'esprit ne pourrait être à aucune et serait absent des deux. A plus forte raison, si les pensées, au lieu d'être semblables, sont opposées. A ces conditions, aucun savoir n'est possible; et re- page LXXVII ainsi la vérité « ne serait, dit Aristote, que poursuivre des oiseaux qui s'envolent ». Mais que les philosophes se rassurent; que ceux qui en sont à leurs débuts ne se laissent pas troubler : la vérité est accessible à l'homme ; la science ne lui échappe pas, et le savoir est possible. Le principe sur lequel s'appuient la vérité et la science est d'autant plus ferme qu'il est absolument indémontrable; il porte son évidence avec lui. L'erreur des Sophistes et celle du Scepticisme, c'est de croire qu'on peut tout démontrer, ne s'apercevant pas que c'est le moyen de ne pouvoir démontrer rien. Si, pour savoir quelque chose, on doit démontrer tout, on tombe dans l'infini, et l'on s'y perd. Où s'arrêter en effet? D'une démonstration, on passe à une autre, qui en exige une troisième; et ainsi de suite, sans terme et sans fin. De toute nécessité, dans les démonstrations, et, d'une manière générale, dans la science, il faut un temps d'arrêt. C'est le principe de contradiction qui donne ce point fixe, parce qu'il est nécessairement page LXXVIII impliqué dans tout savoir, dans toute pensée, dans toute parole, qui a un sens quelconque. Chaque mot dans le langage a une signification, qui doit être identique pour celui qui le prononce et pour celui qui l'entend. Le mot exprime toujours quelque chose d'individuel et de déterminé; ce quelque chose, les mots combinés entre eux l'affirment ou le nient. Mais le mot doit être intelligible, et il ne peut pas avoir deux sens, en même temps, sur une même chose. Est-ce que, quand on prononce le mot Homme, l'auditeur peut supposer qu'il s'agit d'une trirème ou d'une muraille? Si le sens pouvait ainsi varier, il n'y aurait plus de langage possible, et toute communication cesserait entre les humains. On peut donc affirmer, sans crainte d'objection quelconque, qu'on ne peut pas même combattre le principe de contradiction; car, du moment qu'on ouvre la bouche pour exprimer quoi que ce soit, ce principe intervient à l'instant même dans toute sa force; et celui qui affiche la prétention de le nier, ne peut pas faire autrement que page LXXIX le commencer par s'en servir. Le mieux pour lui serait certainement de se taire, et de renoncer à cette faculté de la parole, qui est le premier lien des hommes en société. C'est, dit-on, ce que faisait Cratyle, ce partisan déclaré du flux perpétuel des choses ; il en était arrivé à ne plus vouloir parler; et il se contentait de lever le doigt, indiquant par signes ce qu'il voulait faire entendre. Mais, malgré toutes ces réserves assez puériles, Cratyle, qui trouvait déjà son maître Héraclite excessivement affirmatif, n'en affirmait pas moins, lui aussi, quelque chose, même en ne disant rien. Il semble qu'Aristote se lasse d'amonceler des arguments contre des doctrines si déraisonnables. Fatigué de l'entêtement de telles gens, qui ne posent de leur côté aucun principe, qui n'énoncent rien d'intelligible, qui se réfutent eux-mêmes dès qu'ils avancent la moindre proposition, qui confondent tout, qui détruisent toute substance, en un mot, qui empêchent toute discussion et tout savoir, il se laisse aller à une irritation bien naturelle ; il retranche de l'humanité raison- page LXXX
ces sophistes incorrigibles: et il déclare avec un
légitime dédain qu'on ne peut pas plus s'entretenir avec eux qu'on
ne le ferait avec une plante: pas plus qu'un végétal, c'est
l'expression du philosophe, ils ne font partie de la communauté des
Aristote indique néanmoins les procédés de discussion qu'il faut adopter, selon que les adversaires contré lesquels on lutte sont, ou ne sont pas, de bonne foi. Mais nous n'avons pas à le suivre dans ces détails, qui prouvent, du reste, l'extrême intérêt qu'il attachait à bien éclaircir le principe de contradiction, et à poursuivre le Scepticisme dans tous ses détours, et même dans ce qu'il peut avoir de peu sérieux. Après ces réfutations diverses de l'école Pythagoricienne, de Platon et de Protagore, deux grandes théories, qui y tiennent de très près, pourraient arrêter notre attention : ce sont celle de la substance, et celle des quatre principes ou des quatre causes. L'une et l'autre ne sont peut-être pas aussi complètes, ni aussi originales, qu'Aristote page LXXXI lui-même semble le croire. Sans qu'il les ait empruntées à ses prédécesseurs, ce ne sont pas des questions entièrement neuves qu'il soulève, et il ne les a pas résolues définitivement. La notion de la substance était compromise gravement par le Scepticisme; c'était surtout pour la rétablir que Platon avait été amené à la théorie des Idées, et qu'il admettait dans les choses un élément stable, et même éternel. Mais, selon Aristote, Platon s'était trompé; et, en séparant les Idées des choses qui en participent, il avait renouvelé la faute de la Sophistique, tout en voulant la combattre. Sans le savoir, il avait fait encore pis; il enlevait absolument aux êtres la substance, que les Sophistes leur avaient en partie laissée. Ce ne sont que des ruines qu'Aristote pense avoir devant lui, et qu'il doit restaurer. A-t-il réparé l'édifice ? Et l'a-t-il reconstruit sur des bases inébranlables? On peut en douter, sans, d'ailleurs, faire aucun tort à son génie. La question de la substance revient sans cesse dans la Métaphysique; mais elle n'y est nulle part développée et approfondie, comme on aurait pu s'y attendre. page LXXXIII Est-ce une de ces lacunes du genre de celles que présente en si grand nombre cette oeuvre inachevée, qui elle-même n'est qu'une ruine? Est-ce négligence de la part de l'auteur? Il serait peu sûr de le dire; mais certainement la théorie de la substance n'est pas très satisfaisante, dans l'état où la Métaphysique nous l'a transmise. Il est vrai que, dans un autre ouvrage, dans les Catégories, Aristote a consacré à la substance une de ces analyses profondes et sagaces qui sont l'honneur de la philosophie ancienne. Il a fait de fréquentes allusions à cette analyse, qu'on peut qualifier d'admirable ; et il doit croire qu'elle a épuisé le sujet. Il faut donc suppléer la Métaphysique par les Catégories ; et demander à la Logique ce que la Philosophie première ne nous donne pas assez complètement. La substance n'est l'attribut de rien ; elle n'a pas de contraire ; elle n'est pas susceptible de plus et de moins. Voilà ses trois caractères principaux, qui la distinguent de l'accident, et permettent de ne jamais la confondre avec lui. L'accident n'a d'exis- page LXXXIII tence, n'a d'Être que dans un autre; il ne peut exister seul, et il est toujours un attribut d'une substance; il peut avoir un contraire ; et il est tantôt plus, et tantôt moins, ce qu'il est. La substance est tout l'opposé; elle est en soi et pour soi; elle est par elle seule; et, pour exister, elle n'a pas besoin d'être dans une autre chose. Son existence, à l'état d'individu, lui donne une indépendance entière, à l'égard de toute autre substance individuelle. Elle a son domaine à part; et c'est là ce qui fait qu'elle n'a pas de contraire possible. Les contraires sont dans le même genre, chacun à une des extrémités de ce genre; mais la substance, étant à elle seule un genre, elle le remplit; et le contraire n'y pourrait trouver place. Ce qui n'empêche pas que la substance, sans avoir rien qui lui soit directement contraire, ne puisse recevoir les contraires, non à la fois, mais tour à tour. Elle a telle qualité à un certain moment; et la qualité contraire, à un autre moment. Mais c'est précisément parce qu'elle persiste, et subsiste, sous des qualités variables, qu'elle est la substance; les qualités page LXXXIV changent; la substance, qui les revêt l'une après l'autre, ne change pas, en tant que substance; et, ne subissant aucun changement, elle ne peut être, tantôt plus, tantôt moins, ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est d'une manière immuable. Ainsi, Socrate, considéré en lui-même, est Socrate et ne peut être un autre: il est en soi et pour soi. Ne pouvant jamais être attribué à aucun être, il n'est jamais, ni plus, ni moins, Socrate; enfin, il n'a pas de contraire. Mais, si l'on donne une qualité quelconque à Socrate, si l'on dit, par exemple, que Socrate est sage, la qualité de Sage n'existe pas par elle-même; elle est dans un autre, qui est Socrate; elle n'est pas en soi et pour soi; elle est l'attribut d'une autre chose, dans laquelle elle est. Elle est susceptible de plus ou de moins; car Socrate peut être plus ou moins sage; elle a un contraire; car, de même que Socrate est sage, il pourrait être insensé. Sage est donc un attribut et un accident variable , tandis que Socrate est une substance immobile. Parmi les différentes catégories, en d'au- page LXXXV tres termes, les différentes classes de l'Être, la substance est la première, attendu que, sans elle, les autres n'existeraient pas. Pour être doué d'une qualité quelconque, pour être d'une quantité ou étendue quelconques, pour être dans un temps, pour être dans un lieu, il faut, nécessairement, d'abord être ; et c'est cette existence pure et simple, cette existence nue, qui constitue la substance. Toutes les autres catégories doivent lui être attribuées, tandis qu'elle n'est attribuée à aucune d'elles. La sagesse est l'attribut de Socrate; mais Socrate n'est pas l'attribut de la sagesse. La substance et l'accident ne doivent jamais être confondus, bien qu'à chaque instant le langage vulgaire les confonde. Autre distinction non moins importante. Celle-là concerne non plus la différence de l'attribut et de la substance, mais plutôt la substance elle-même. Quand on parle d'une chose quelconque, et quand on lui accorde d'être ou de n'être pas, quand on l'affirme ou qu'on la nie, il faut bien prendre garde si l'on entend qu'elle est réelle, ou simplement possible : et, pour prendre les page LXXXVI formules aristotéliques, si elle est en acte, ou si elle est en puissance. Ces deux nuances de l'Être sont essentiellement distinctes; il faut les démêler, sous peine de commettre les plus graves erreurs. On prendrait alors le réel pour le possible; et réciproquement, le possible pour le réel. Quand une chose est actuellement, elle a une existence réelle; elle est ce qu'elle est. Au contraire, quand elle n'est qu'à l'état de possible, quand elle n'est qu'en puissance, on ne peut pas dire positivement qu'elle est; mais on ne peut pas non plus dire positivement qu'elle n'est pas. Possible, elle peut également et indifféremment être ou n'être pas. Le possible Est, quand, sortant de la simple puissance, il est devenu quelque chose; mais il n'Est pas, tant qu'il reste à l'état de possible. C'est précisément cette existence équivoque, et homonyme, du possible, qui est ce qu'on appelle le Non-Être, si cher aux Sophistes, à qui Platon le laisse en pâture. Le Non-Être n'est pas le néant, le rien, comme on l'a cru plus d'une fois; le Non-Être, c'est le possible, qui tout ensemble Est, s'il se réalise ; et qui N'est page LXXXVII pas, s'il n'est point encore parvenu à se réaliser. Les siècles n'ont rien ajouté et ils n'ajouteront rien à ces analyses ; ce sont des vérités que rien ne peut altérer, et qui vivront à jamais dans les annales de la pensée. Toutefois, on peut trouver qu'elles sont plus logiques que métaphysiques, et même qu'elles sont grammaticales autant que logiques. On peut trouver encore qu'elle ne donnent pas sur la substance tout ce que demande la Philosophie première. Mais, dans les limites où ces analyses se renferment, elles sont achevées, et si évidemment exactes que le temps les a respectées, et qu'il les respectera toujours. La théorie des quatre principes, ou des quatre causes, mérite les mêmes éloges, avec les mêmes restrictions. Entre toutes, elle est celle qu'Aristote revendique pour lui seul avec le plus d'insistance, et même avec quelque amour-propre. A l'en croire, ses prédécesseurs n'ont connu et étudié qu'une ou deux de ces causes; ils ont ignoré ou négligé les autres. Ces quatre principes sont: le principe page LXXXVIII de l'essence, c'est-à-dire celui qui fait que la chose est ce qu'elle est; le principe matériel, comprenant les éléments dont la chose est formée ; le principe du mouvement initial, qui a produit la chose; et enfin le principe du but, auquel tend la chose. Cause essentielle, cause matérielle, cause motrice, cause finale, telle est la série des causes, sans lesquelles on ne saurait comprendre entièrement l'Être et la substance. Un être étant donné, il faut que cet être ait une certaine essence, c'est-à-dire, une certaine espèce, ou forme, qui nous permette de le nommer et de le distinguer de tout autre. En second lieu, il doit avoir une certaine matière, ou sensible ou intelligible, dont il est composé. Troisièmement, il faut qu'un certain mouvement l'ait amené de l'état antérieur où il était, à l'état actuel où nous le voyons. Et quatrièmement, il faut que cet être ait une fin, un but, un pourquoi. Toutes ces théories sont irréprochables. Mais sont-elles bien complètes? Répondent-elles suffisamment au besoin des intelligences, et aux questions que la Philosophie pré- page LXXXIX mière est destinée à résoudre? Sans doute, il est fort utile de s'entendre avec soi-même; et. quand on parle de substance et de cause, de savoir avec précision ce que ces mots renferment sous leur généralité. Mais est-ce bien là tout ce que réclame la philosophie, et, avec elle, l'esprit humain, qui la cultive? Ce sont des notions qu'il est bon d'analyser et d'éclaircir; mais ce ne sont que des notions. A côté d'elles, au-dessus d'elles, il y a les phénomènes qu'elles représentent, mais qu'elles n'expliquent pas; la nature est toujours le mystère qu'il s'agit de percer. dans l'Antiquité tout entière, personne plus qu'Aristote n'a étudié les phénomènes et les faits réels ; après lui, personne ne peut se flatter de l'avoir surpassé, ni peut-être même égalé. Histoire des animaux, anatomie et physiologie comparées, météorologie, astronomie, et, dans la sphère purement humaine, logique, psychologie, morale, rhétorique, poétique, politique, il a traité de tout, avec une autorité magistrale, qui en a fait l'instituteur des siècles. Il semble donc que rien ne lui était plus facile que de résumer tant page XC d'études dans sa Philosophie première, et de nous dire ce qu'il pense de l'homme, du inonde, de Dieu, et de leurs rapports. Comment ce puissant, cet incomparable génie, ne l'a-t-il pas fait plus complètement? Est-ce à dessein qu'il s'en est abstenu? C'est peu probable; et l'essai de théodicée, qui se trouve dans le XIIe livre de la Métaphysique, prouve assez que la question s'était présentée, du moins en partie, à la réflexion du philosophe. Mais il la considérait d'un tout autre point de vue que celui où nous nous plaçons, quand nous lui demandons ce qu'il pense sur la grande énigme, et que nous essayons de juger sa pensée. Nous n'aurions pas à nous étonner de cette divergence entre Aristote et l'esprit moderne, si, de son temps, dans l'école où il a été vingt ans un disciple assidu, la question n'avait été posée dans toute sa grandeur par son maître. On peut bien ne pas approuver la solution que propose le Timée; Platon a mis dans ces matières plus d'imagination qu'il ne convient; et l'on pouvait y porter plus d'observation des faits. Mais c'est une gloire immortelle pour page XCI Platon d'avoir tenté de résoudre le problème essentiel de l'origine des êtres; et la Philosophie première manque à son devoir en le passant sous silence. Ce n'est pas seulement la question la plus haute; c'est surtout la question à laquelle toutes les autres doivent aboutir, qui en est le couronnement, et qui donne à chacune d'elles, dans l'ensemble des choses, la place et la valeur relatives qu'elles doivent avoir. Aristote aurait dû suivre Platon sur ce terrain, où la raison humaine n'a jamais hésité à mettre le pied, sous forme de philosophie ou sous forme de religion. Cependant, il ne faudrait pas exagérer la critique. Aristote a une théodicée; et, à quelques égards, la théodicée aristotélique mérite une très grande estime, bien qu'elle ne soit pas assez large, et qu'elle renferme des germes qui ont porté plus tard des conséquences funestes. Il faut se souvenir que, pour Aristote, la Philosophie première n'est pas seulement une science divine, en ce sens que Dieu seul peut la posséder dans sa plénitude infinie. L'homme n'en peut conquérir qu'une faible portion, mais si belle pourtant page XCII que les Dieux la lui envieraient, si les Dieux pouvaient être jaloux. De plus, la Philosophie première est si bien la science du divin, pour Aristote, qu'il n'hésite pas à l'appeler aussi la Théologie. Avant lui, quelques philosophes, qu'il nomme les Théologues, paraissent avoir eu la môme tendance, bien qu'ils rapportassent l'origine des choses et la naissance du monde à la Nuit et au Chaos. Mais le souvenir de leurs opinions remonte si loin dans le passé qu'il est à peu près oublié. Aristote reprend une tradition effacée ; et la Philosophie première peut recouvrer, grâce à lui, un beau nom, sous lequel on ne la connaissait plus, et qu'elle pourrait encore revendiquer légitimement. Aristote est pénétré d'admiration pour la nature; et plus il étudie ses œuvres, plus cette admiration augmente. Il sait, sur les êtres, sur leur organisation, sur leurs espèces, sur leur vie, sur leurs mœurs, tout ce qu'il est possible de savoir de son temps; dans l'histoire des sciences, personne, non pas même Linné, Buffon, Cuvier, n'a montré plus de passion, ni plus de sagacité, pour page XCIII ces vastes recherches. Les siècles ont fait bien des progrès; mais ils n'ont pas produit un savant, ni plus appliqué, ni plus clairvoyant. Les regards portés aujourd'hui sur le monde ont beaucoup plus d'étendue et descendent beaucoup plus profondément; mais ils ne sont pas plus perçants. Souvent même, Aristote exprime le sentiment qui l'anime en des termes dont la vivacité contraste avec la froide austérité qui lui est ordinaire. C'est lui le premier qui a dit et répété sous toutes les formes que « La nature ne fait rien en vain». L'homme est donc toujours amplement payé des labeurs qu'il lui consacre ; en cherchant à la comprendre, il n'a pas à craindre de poursuivre une énigme sans mot. Tout en elle a un but; tout a un sens ; et ses ténèbres, aussi bien que ses merveilles les plus éclatantes, sont un aiguillon pour la curiosité insatiable dont nous sommes, parmi tous les êtres, les seuls à être doués. Aussi, avec quel transport d'enthousiasme Aristote n'exalte-t-il pas cette grande parole d'Anaxagore, déclarant, au milieu de ses contemporains égarés, que le monde est régi par page XCIV une Intelligence ! Avec quel dédain ne repousse-t-il pas ces systèmes déplorables qui veulent rapporter tous les phénomènes de l'univers à un aveugle hasard, et qui en réduisent la constante succession à une suite d'épisodes défectueux, comme ceux d'une mauvaise tragédie ! De là encore, l'horreur qu'Aristote ressent pour ces autres doctrines non moins fausses, qui attribuent l'origine des choses à la Nuit, au Chaos, au Néant. D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusion en sens contraire ; et, fidèle à la modestie socratique, s'il connaît les grandeurs de l'intelligence humaine, il en connaît aussi les lacunes et l'infirmité. Tout est intelligible dans la nature ; mais ce n'est pas à dire que nous puissions tout y comprendre. Quand l'homme essaye de s'élever à Dieu, il lui sied mieux que jamais de montrer cette réserve et cette humilité, que recommande la vraie philosophie. Mais, tout en ayant cette prudence et cette sagesse, Aristote proclame hautement que tout dans l'univers tend au bien, et que le bien est la raison dernière des choses et leur cause finale. Platon l'avait déjà dit, en page XCV faisant, de l'Idée du Bien, la première et la plus féconde de toutes les Idées. Aristote a été plus affirmatif encore ; et ce n'est point lui attribuer un mérite qu'il n'aurait pas que de le regarder comme le fondateur de l'Optimisme. Il ne dit pas que tout est bien dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus dès lors de distinction entre le bien et le mal ; mais il dit, avec les plus sages des humains, que tout dans le monde est le mieux possible, et il pense sans doute que, si l'homme ne peut pas concevoir l'existence du mal, dans un monde parfait, c'est que Dieu a gardé ce secret pour lui seul. Avant tout, ce qui, dans la nature, occupe Aristote, c'est le mouvement, dont il a fait une théorie spéciale dans sa Physique. Le mouvement est encore plus apparent que l'ordre dans l'ensemble de l'univers. Dans le monde sensible, tout est sujet à une alternative perpétuelle de production et de destruction; dans le ciel, tout se meut avec une régularité inaltérable. Le mouvement est éternel, comme le sont le temps et l'espace infini, dans lesquels il se passe. Mais d'où page XCVI vient le mouvement ? Qui l'a imprimé à toutes choses, soit aux choses périssables, comme celles qui nous entourent et dont nous faisons partie, soit aux choses impérissables et éternelles, comme celles que nous contemplons dans les cieux? A cette question, qui a été et qui sera l'écueil de tant de philosophes, Aristote répond avec une clarté qui dissipe toutes les ombres : Le mouvement ne peut venir que d'un principe, qui n'est pas seulement capable de le produire, mais qui le produit effectivement et actuellement. Ce principe doit être en acte et non pas en simple puissance; car ce qui est en puissance peut aussi ne jamais arriver à réalité. Et comment supposer que le mouvement s'arrête, ou qu'à un certain moment de la durée, il ait pu ne pas exister? L'essence de ce principe, c'est donc d'être en acte, et d'y être uniquement et toujours. Il faut aussi qu'il soit sans matière; car la matière ne peut se donner le mouvement, et nous voyons que, sans l'artiste, l'œuvre qu'il façonne ne prendrait jamais d'elle-même la forme qu'elle reçoit de lui. page XCVII Il n'y a donc pas mouvement de mouvement, puisqu'on se perdrait alors dans l'infini; et le principe qui donne le mouvement au reste des êtres doit être lui-même éternellement immobile et immuable. Il faut qu'il soit essence et acte, et qu'il meuve les choses à peu près comme le désirable meut, sans être mû, le désir qu'il suscite; le désirable est à l'égard du désir complètement immobile; le désir seul est en mouvement, pour arriver à l'objet qui est sa fin suprême. Aristote aime trop la vérité pour ne pas rappeler que d'autres, avant lui, ont soutenu une doctrine à peu près semblable, et cru, comme lui, à un acte éternel, à un éternel présent. Il cite entre autres Leucippe et Platon; mais il leur reproche, à tous deux, de n'avoir pas parlé du principe et de la cause du mouvement. Platon, en particulier, a reconnu un principe qui se meut lui-même, et qui transmet le mouvement à l'ensemble des choses ; ce principe, c'est l'âme. Mais, comme Platon fait l'âme postérieure au ciel, ce n'est pas l'âme qui meut le ciel, et il reste toujours à expliquer comment il est mû. Cette page XCVIII critique n'est peut-être pas aussi fondée qu'Aristote semble le croire. Nous n'en pouvons pas bien juger pour Leucippe; mais, dans le Timée, ce n'est point l'âme qui donne le mouvement au monde ; c'est Dieu et Dieu seul. Du reste, peu importe qu'Aristote se soit trompé une fois de plus sur la doctrine de son maître; en ceci du moins, il lui rend cette justice que la grande pensée d'un acte éternel lui était venue. Mais Aristote poursuit. Oui, il existe une substance, éternelle, et éternellement en acte, immobile et produisant le mouvement, dans un temps et dans un espace infinis, séparée des choses, non sensible, sans grandeur, sans matière, sans divisions possibles, sans parties, une, impassible, immuable, éternellement identique à elle-même. C'est là le principe nécessaire et parfait auquel la nature et le monde sont suspendus. L'ordre universel en relève, et ne saurait se passer un seul instant de lui, puisque ce principe est éternellement actuel, et que, sans cet acte continu et incessant, les choses ne pourraient durer un seul moment page XCIX
ce qu'elles sont. Le mouvement qu'il imprime à
l'univers est le mouvement circulaire, parce que le mouvement
circulaire est le seul qui se suffise, et qui puisse recommencer
perpétuellement, sans s'interrompre jamais, toujours Tout cela est bien grand ; et l'on croirait, à deux mille ans d'intervalle, entendre déjà Newton, à la fin des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, concluant à l'existence nécessaire d'un premier moteur. Mais Aristote ne se borne pas, comme le fait Newton, à cette affirmation trop générale. Il tente de pénétrer jusque dans la nature intime et l'essence de Dieu. C'est le Saint des Saints pour la philosophie, aussi bien que pour les religions ; et Aristote, y portant le ferme regard qu'il a porté sur le monde des choses sensibles, explique Dieu par l'acte pur, l'acte éternel de l'intelligence. L'Intelligence ne s'adresse jamais qu'au meilleur, et l'Intelligence la plus parfaite ne peut s'adresser qu'à ce qu'il y a de plus parfait. Dieu, qui est l'être éternel et parfait, ne peut donc éternellement penser qu'à lui seul, c'est-à-dire à sa propre page C pensée ; l'intelligence divine est l'éternelle intelligence de l'intelligence. L'acte en soi est la vie de Dieu, sa vie éternelle, et son éternelle félicité (06). L'homme s'efforce vainement de se faire une juste idée de ce bonheur de l'être parfait, éternel, et Un; mais l'homme peut en apercevoir une fugitive image dans ces courts instants où il lui est donné, à lui aussi, de saisir, par la contemplation, l'acte de sa propre pensée et de sa propre intelligence. Cette théodicée est acceptable dans ses traits principaux; elle est exquise et vraie; et quand plus tard on a défini Dieu en disant qu'il est « un pur esprit », on ne faisait que reproduire Aristote, en termes plus concis, mais moins clairs que les siens. L'acte pur de l'intelligence, c'est bien l'esprit dans toute sa pureté : et faire de Dieu l'acte pur, c'est bien en faire un pur esprit. S'efforcer de le comprendre dans son infinitude, en partant de l'âme finie de l'homme, c'est la page CI seule méthode que puisse adopter notre débile raison; et c'est une des gloires les moins contestables de la philosophie, un des plus vrais services qu'elle ait rendus à l'esprit humain, de nous découvrir le chemin mystérieux et sûr qui peut nous conduire à Dieu, sans les insuffisances de l'instinct, ou les égarements de la superstition. Néanmoins, dans cette exacte et belle théodicée, on a dès longtemps signalé un bien grave défaut: Admet-elle la providence? Et si elle ne l'admet pas, qu'est-ce qu'un Dieu qui ne préside point, avec une sagesse infinie et une infinie bonté, à l'ordre qu'il a établi dans les êtres et dans les choses de l'univers? Il est assez étrange qu'on puisse même élever de telles objections contre la doctrine d'Aristote, et que, sur un tel sujet, le philosophe se soit expliqué si obscurément que le doute soit permis. On a pu, avec la même vraisemblance, soutenir, et que la providence résulte de son système, et que, au contraire, elle en est exclue. Si Dieu, en tant qu'acte pur et pur esprit, ne pense qu'à lui seul, il ne pense plus à l'univers, quoique, page CII tout au moins, il l'ait ordonné, sinon créé, et quoiqu'il le gouverne, selon la sentence d'Anaxagore. Ou bien, si Dieu pense au monde, c'est qu'il se confond avec le monde, puisqu'il ne pense éternellement que sa propre pensée. Donc, un Dieu ignorant les choses, ou un Dieu identifié avec elles, telle est la double conséquence qui ressort presque nécessairement de la théodicée aristotélique. Des deux côtés, elle est également fâcheuse ; et il est impossible de voir comment le philosophe peut se soustraire à ce dilemme. Il a dit, il est vrai, que la nature ne fait rien en vain; et cette opinion, cent fois exprimée par lui, semble bien impliquer que l'Intelligence régit aussi la nature, et cherche sans cesse les moyens les plus propres à y réaliser la fin qu'elle poursuit. Il y aurait donc là, dans l'accomplissement de tous les phénomènes que nous pouvons observer, la trace et la marque d'une providence, qui fait tout pour le mieux, et dont la vigilance, s'étendant à tous les êtres, ne peut jamais se lasser. Mais, à s'en tenir aux théories du philosophe, la nature est si loin de Dieu qu'elle pace CIII ne semble plus avoir aucun rapport avec lui. Elle a bien sa fonction distincte, qu'elle remplit merveilleusement ; mais elle est une force aveugle ; tout s'y passe par une sorte de mécanisme inconscient. Malheureusement, dans la doctrine d'Aristote, l'homme a encore moins de relations que la nature avec Dieu. Il peut jusqu'à un certain point le connaître ; il peut même partager, quoiqu'à une distance incommensurable, quelque chose de la vie divine. Mais, malgré ce magnifique privilège, le Dieu d'Aristote ignore l'homme plus encore qu'il n'ignore les choses ; l'humanité est à ses yeux comme si elle n'était pas. On peut donc présumer que, si Dieu n'est providence que dans une mesure excessivement étroite à l'égard de la nature, il ne l'est plus du tout à l'égard de l'homme. C'est l'homme, cependant, qui est l'être par excellence, puisqu'il est le seul qui ait le désir et la faculté de connaître, et que l'intelligence, à son degré suprême, est l'apanage essentiel de Dieu. Un être qui se rapproche de la divinité, ou plutôt le seul être qui s'en rapproche, peut-il page CIV être négligé par elle? est-il possible que nous nous occupions de Dieu, et que Dieu ne s'occupe pas de nous? Est-ce bien là le Dieu que cherche l'humanité, et surtout le Dieu que cherche la philosophie ? Cette erreur d'Aristote est d'autant plus regrettable, et elle doit d'autant plus nous étonner, qu'ici encore, il avait l'exemple de son maître. dans le Xe livre des Lois, dans le Timée, Platon affirme la Providence, après avoir affirmé l'existence de Dieu, avec une énergie que la foi chrétienne elle-même n'a pas surpassée; il a suivi les rapports de l'homme à la divinité jusque dans les derniers replis de la conscience. Après Platon, on a pu développer et approfondir ces vérités ; on ne les a, ni modifiées, ni accrues. Comment Aristote paraît-il les avoir méconnues, ou dédaignées? Pourquoi ne les a-t-il pas combattues, si elles lui semblaient des erreurs? Pourquoi, en tout cas, les a-t-il omises, par une de ces prétentions qui, entre autres questions,lui ont fait négliger, en psychologie, celle de l'immortalité de l'âme? Ce silence est peu philosophique ; il y a des pro- page CV blèmes qu'on ne doit pas laisser de côté, sans déclarer, tout au moins, pourquoi on ne les aborde pas. Ce n'est donc point être injuste envers Aristote que de conclure que le Dieu qu'il conçoit n'est pas une providence. Cette question semble avoir échappé à la perspicacité de son génie ; ou, s'il l'a entrevue, il n'y a pas attaché assez d'importance. Un autre doute peut s'élever qui serait aussi très grave, si, d'ailleurs, il n'était pas plus spécieux que réel. Aristote a-t-il cru à un Dieu unique? Ou bien, a-t-il cru à la multiplicité des Dieux ? Après tout ce que l'on vient de voir, on a peine à comprendre que cette question puisse être posée. Le premier moteur, immobile, éternel, immatériel, immuable, ne peut être qu'unique; la pluralité des premiers moteurs serait une contradiction et un désordre. Mais, c'est Aristote lui-même qui, après avoir établi l'unité du premier moteur, se demande s'il n'y a pas autant de substances éternelles, immobiles et motrices, qu'il y a de planètes et d'astres. Il répond par l'affirmative ; et, à l'en croire, le CVI
soleil, la lune, chacune des planètes, et
probablement la terre elle-même, sont mues par autant de substances
éternelles, immobiles, immatérielles, comme le premier ciel est mû
par le premier moteur. Mais ces moteurs des astres sont-ils
indépendants? Ou, sont-ils subordonnés? Aristote se tait sur ce
point; et, après avoir examiné les théories des astronomes de son
temps, Eudoxe et Callippe, sur les sphères des astres, au nombre de
cinquante-cinq ou seulement de quarante-sept, et à chacune
desquelles président autant de substances éternelles, il conclut que
les astres sont autant de Dieux, et qu'ainsi le divin enveloppe la
nature tout entière. Il met. d'ailleurs, ces croyances salutaires
sous Mais, hâtons-nous de le dire : Aristote ne se contente pas de ces traditions vénérables; et il en revient à sa propre théorie, pour affirmer de nouveau, et irrévocablement, l'unité du premier moteur, l'unité du ciel, page CVII l'unité de Dieu, présidant à l'ordre universel, comme le général est le chef de son armée, comme le père de famille est le maître unique d'une maison bien ordonnée. Il va même jusqu'à réfuter, en quelques mots, le système insensé des deux principes, entre lesquels se diviserait l'univers, livré, entre le bien et le mal, à la plus effroyable anarchie; et il termine le XIIe livre de sa Philosophie première, le plus précieux de tous, en répétant le fameux vers d'Homère : Plusieurs chefs sont un mal; il ne faut qu'un seul chef. Avec Aristote, arrêtons-nous quelques instants sur ces sommets, que bien peu de philosophes ont gravis d'un pas aussi puissant, et où bien moins encore ont trouvé plus de lumière. Aristote s'y est complu; il s'y est reposé, après une longue et pénible route, au travers de toutes les choses de la nature et de la pensée, au travers du monde sensible et du monde intelligible, parcourus dans tous les sens. Puisse son exemple servir d'enseignement à d'autres, qui croient marcher page CVIII sur ses traces, et qui, cependant, sont si loin de lui, non seulement par le génie, mais par la doctrine ! Quand on le connaît, peut-on l'invoquer encore comme un partisan du sensualisme? On le voit donc : malgré l'état ruineux où la Métaphysique nous est parvenue, et où l'auteur l'a laissée, elle n'en reste pas moins un des plus beaux monuments de la philosophie, soit dans l'Antiquité, soit dans les temps modernes. D'abord, c'est le premier en date, non pas que l'esprit grec avant Aristote n'eût point fait de la Métaphysique; mais la Métaphysique, si elle était répandue dans tous les systèmes qui s'étaient produits depuis Thalès, n'avait point reçu de forme distincte et scientifique. Platon même, quoiqu'il l'ait semée à pleines mains dans tous ses Dialogues, ne l'a point définie et déterminée. C'est Aristote, le premier, qui la constitue, en marque les limites, en fixe le domaine, et l'explore presque aussi complètement que personne l'a fait après lui. A ce mérite de priorité, avec les avantages et les inconvénients qu'il comporte, s'en page CIX joint un autre : c'est la gravité et le nombre des questions qu'Aristote a soulevées. Nous les énumérons encore une fois: Définition de la philosophie première, discussion sur la nature des nombres et sur les Idées, examen et réfutation du Scepticisme, théorie de la substance et de la cause, affirmation de l'ordre universel, optimisme, existence et nature du Dieu, voilà les problèmes principaux qu'il agite et qu'il résout, sans parler de bien d'autres. En est-il de plus grands ? En est-il qui sollicitent plus vivement notre raison? Et la plupart des solutions qu'il propose, ne comptent-elles pas parmi les meilleures qui en aient été données? Un rapide coup d'oeil jeté sur l'histoire de la Métaphysique jusqu'à nos jours nous fera voir à quelle hauteur Aristote s'est élevé, et quelle place il doit occuper parmi ses émules, qui sont en bien petit nombre, si l'on s'en tient à ceux qui sont vraiment dignes de lui être comparés. Mais, avant de le quitter, adressons-lui encore une louange, que justifie la Métaphysique, à chacune de ses pages. Que de choses page CX ne nous a-t-il pas apprises sur ses devanciers ! Il est vrai qu'il les critique plus souvent qu'il ne les approuve ; mais, en les critiquant, il nous les fait connaître. Bien plus, quelque confiance qu'il puisse avoir en lui-même, il sent le besoin de consulter les autres, et de savoir ce qu'ils ont pensé. Il se fait un devoir de cette étude scrupuleuse du passé ; et il l'impose à la science tout entière, comme une condition indispensable. C'est en ce sens qu'on a pu dire qu'il avait été le premier historien de la philosophie. Ce n'est pas là un mince honneur. Pour lui, c'est si bien un procédé général qu'il l'emploie et le recommande, en politique, en psychologie, en astronomie , en météorologie, en rhétorique, en un mot, dans tous les sujets qu'il a traités. Là où il ne l'applique pas, c'est qu'il n'y a rien eu avant lui, et qu'il est inventeur, comme dans la Logique. Partout ailleurs, il croit devoir faire une exacte revue des opinions qui ont précédé les siennes, pour profiter de ce qu'elles peuvent contenir de vrai, ou pour s'épargner des erreurs déjà commises. Cette prudente déférence pour le passé page CXI bien rare ; il est utile de la signaler comme un excellent exemple, trop peu suivi. Nous devons même rappeler d'autant plus soigneusement ce titre d'Aristote qu'on l'a trop souvent méconnu. A quelles invectives, à quelles calomnies, Bacon ne s'est-il pas livré, quand il accuse le philosophe d'avoir voulu égorger ses frères, comme le font les despotes de l'Orient, afin d'étouffer leur gloire au profit de la sienne ! La Métaphysique prouverait à elle seule jusqu'à quel point sont fausses ces imputations odieuses. L'accusation retomberait bien plus justement sur Bacon lui-même; et s'il n'eût dépendu que de lui, aurait-il hésité à supprimer la mémoire d'Aristote, afin d'assurer le triomphe, plus que douteux, du prétendu Novum Organum sur l'ancien ? Mais passons. Pour apprécier la valeur de la Métaphysique d'Aristote, il n'est pas nécessaire d'interroger toute l'histoire ; quelques noms, pris parmi les plus éclatants, y suffisent : Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel. Rapproché de chacun d'eux, si le philosophe page CXII
antique ne paraît inférieur à aucun, s'il est même
supérieur à la plupart, on peut être certain que la gloire ne s'est
pas trompée pour lui plus que pour eux. A quelque éloignement qu'il
soit de nous, il faut le placer parmi les génies qui ont été les
plus bienfaisants et les plus féconds. Étudié dans ses théories
principales, il semble être de nos contemporains; et, sauf quelques
singularités d'expression, il parle notre langue. Il faut l'écouter
très attentivement pour le bien entendre; mais c'est uniquement
parce qu'il est profond; ce n'est pas parce qu'il est obscur. S'il faut franchir deux mille ans entre lui et Descartes, c'est que, durant ce si long intervalle , la Métaphysique , sans avoir été stérile, n'a pas produit de monuments qu'on puisse assimiler au sien. Parmi les successeurs immédiats de Platon et d'Aristote, dans l'Académie et dans le page CXIII Péripatétisme, la Philosophie première avait été tout à coup négligée, peut-être parce qu'elle venait de jeter un grand éclat, et aussi parce qu'elle était trop sévère pour des esprits que le doute commençait à énerver. L'école d'Épicure était encore moins faite pour s'en occuper; la vie lui apparaissait sous des couleurs trop peu sérieuses pour que de telles spéculations pussent lui plaire. Le Stoïcisme, plein d'une foi magnanime dans la Providence, s'était borné à l'affirmer, sans analyser les principes sur lesquels repose cette forte croyance ; il se contentait de raffermir les âmes par la morale, allant au plus urgent, et laissant à des temps meilleurs des études plus relevées, mais moins pratiques. Les Alexandrins, Plotin en tête, ont fait beaucoup de Métaphysique ; on peut même dire qu'ils n'ont fait que cela. Mais leur mysticisme, né d'une rivalité inopportune contre le Christianisme, les a jetés dans des voies ténébreuses, aussi étrangères à l'esprit hellénique qu'inutiles au monde. Ils ont pensé sans méthode, sans suite, sans aucune régularité, trouvant par- page CXIV fois des éclairs sublimes, et tombant, le plus souvent, dans des subtilités séniles ou dans d'extravagantes superstitions. Ce sont de nobles âmes, mais de très faibles esprits; et Plotin est, à la fois, le plus grand d'entre eux et le moins sage. Avec l'école d'Athènes et Proclus, après la fermeture des écoles païennes, la haute philosophie disparaît comme elles; elle s'éclipse pour un millier d'années. La théologie la remplace, sans la faire tout à fait oublier. La longue querelle du Nominalisme et du Réalisme, portant sur la question même qui avait divisé Aristote et Platon, entretient les souvenirs de l'Antiquité, trop peu comprise. Mais, quand un moine audacieux ose tenter de sortir du dogme, pour exercer au moindre degré les droits de la libre pensée, il est ramené au giron commun par la plus implacable orthodoxie, depuis l'excommunication de Roscelin, d'Abélard, d'Amaury de Chartres, de David de Dinant, de Roger Bacon, d'Occam, jusqu'au bûcher de Jordano Bruno et de Vanini, et jusqu'à la torture de Campanella. La Métaphysique d'Aris- page CXV tote, apportée dans les écoles de Paris dès le début du XIIIe siècle, y devait produire si peu d'effet, en face de ces terribles répressions, que l'Église, après en avoir interdit la lecture, la permit bientôt, parce que cette lecture était sans danger. Après les découvertes du XVe siècle, l'esprit moderne s'éveille au souffle de la Grèce ; mais ses premiers essais sont bien aventureux et bien désordonnés. La Renaissance, emportée par son inexpérience el son enthousiasme, n'enfante rien de durable, ni de solide. Bacon a la gloire de briser définitivement le joug de la Scholastique ; mais il ne lui est pas donné de renouer la tradition, parce que son fol orgueil le pousse à dédaigner celui qui la représentait le mieux. Bacon a rendu service à l'esprit humain en lui rappelant sa puissance, et en le conviant à la recherche indépendante; mais s'il a fait beaucoup pour les sciences, il n'a rien fait pour la philosophie et la Métaphysique. C'est Descartes qui reprend la tradition véritable ; et l'on pourrait presque croire qu'entre Aristote et le XVIIe siècle, il ne s'est page CXVI rien passé, tant l'entreprise du philosophe français ressemble à celle du philosophe ancien, tant le progrès de l'un à l'autre semble régulier et presque insensible. Tous deux tiennent une place considérable dans l'histoire des sciences; et, si Descartes est un mathématicien de génie et un physiologiste, Aristote est un naturaliste incomparable, et un logicien, qui n'a laissé rien à faire, après lui, dans l'aride domaine qu'il a défriché le premier. les mérites se valent tout au moins; et Aristote l'emporte par l'étendue et la variété de l'intelligence. En philosophie, les titres scientifiques ne pèsent pas autant qu'on est, en général, porté à le penser ; on peut être très savant sans être philosophe ; mais ils ont leur prix quand ils peuvent s'ajouter à des titres supérieurs. C'est ce qui justifie Descartes d'avoir déclaré que ses démonstrations philosophiques sont fort au-dessus de ses démonstrations de géométrie. Aristote ne pensait pas autrement, quand il mettait la Philosophie première à la tête de toutes les sciences, parce qu'elle leur donne à toutes le secret de leurs principes. page CXVII Aristote et Descartes cherchent avec la même ardeur le fondement de la certitude, et tous deux le placent également dans l'évidence. Pour Aristote, c'est le principe de contradiction; pour Descartes, c'est son fameux axiome, plus profond encore que celui du philosophe grec. C'est un fait logique d'une certitude et d'une vérité indéniables, fût-ce au scepticisme le plus obstiné, qu'une même chose ne peut tout ensemble être et n'être pas. Cette base peut supporter tout l'édifice de la connaissance humaine ; il n'y a pas dans l'intelligence une seule notion qui ne doive s'y appuyer. Mais, si ce principe est de soi évident, combien l'intelligence qui le découvre et le sanctionne, n'est-elle pas encore plus évidente que lui? Sans doute, le principe éclaire l'esprit qui le conçoit; mais, sans l'esprit qui discerne et proclame l'évidence, que seraient, et l'évidence, elle principe? Si l'esprit reçoit de la lumière, c'est lui d'abord qui la donne; et le principe resterait à jamais caché et obscur, si l'intelligence ne le faisait pas sortir des ténèbres, en y projetant sa propre clarté. page CXVIII Ainsi, l'axiome cartésien va aussi loin qu'il est possible d'aller ; la raison, parvenue à cette limite dernière, ne peut la dépasser; elle s'affirme en se saisissant, et fait ainsi acte de foi à elle-même. C'est le nec plus ultra, qu'on ne peut franchir sans tomber dans les abîmes ; c'est l'inconcussum, qu'on ne peut renverser sans renverser tout le reste. Il n'y a que le Mysticisme qui essaye ce suicide de la raison, et qui répudie la réflexion, pour s'abandonner sans réserve à l'instinct du sentiment, qui est bien aussi une trace de Dieu dans l'homme, mais une trace d'un ordre inférieur. Ce qui confère à l'axiome cartésien un immense avantage sur le principe de contradiction, sur tout autre principe quel qu'il puisse être, c'est qu'il n'est pas seulement un fait de logique; il est, en outre, un fait vivant et actuel. Aristote voyait dans la pensée de la pensée l'acte éternel de la vie divine. Le « Je pense, donc je suis » est bien aussi la pensée de la pensée. La seule différence, c'est que l'infirmité humaine a des bornes; et que, au lieu d'un acte éternel et page CXIX immobile, comme celui de Dieu, l'homme n'a qu'un acte passager et sujet à mille variations. Mais, à l'instant où l'homme pense sa propre pensée, cet acte, bien que fugitif, lui révèle son existence. Son être est essentiellement sa pensée; elles deux phénomènes se confondent si bien qu'ils sont absolument inséparables, pour la syllogistique la plus subtile. Descartes ne distingue pas la pensée et l'existence ; il les identifie. Quiconque veut s'entendre avec soi-même ne peut plus adopter un autre point de départ. Si l'on redoute les atteintes délétères du Scepticisme, on ne découvrira pas de remède plus salutaire. Il est déjà bien difficile au sceptique de nier le principe de contradiction, puisque c'est nier ses propres arguments. Nier sa pensée est d'une impossibilité absolue, au moment où l'on s'en sert. Si l'on se permet cette puérile bravade, le mieux serait encore d'imiter le silence de Cratyle. Mais, alors, on abdique sa nature d'homme, et l'on se réduit à cet état de matière inerte dont parle Aristote, dans sa lutte contre les Sophistes de son temps. Descar- page CXX tes nous propose une « méthode pour bien « conduire notre raison et pour chercher la vérité dans les sciences » ; les règles qu'il conseille et qu'il s'était imposées à lui-même, sont excellentes sans contredit; mais ces règles ne sont ni aussi neuves, ni aussi utiles, qu'il le croyait. Sans elles, et avant lui, Copernic, Kepler et tant d'autres, pour ne point parler des Anciens, avaient fait faire aux sciences des progrès étonnants. Après lui, on ne voit pas que les sciences aient eu recours à la pratique rigoureuse de ces règles, que, d'ailleurs, tous les esprits bien faits appliquent spontanément, et presque sans réflexion. Descartes lui-ême a dû au génie que Dieu lui avait donné, et non à sa méthode, ses découvertes en dioptrique, en météorologie, en géométrie; et la preuve, c'est qu'aucun de ses disciples, parmi les plus dociles à suivre ses exemples et ses leçons, n'a rien produit de ce qu'avait produit le maître. La méthode n'est donc pas aussi féconde que, dans sa modestie, il le supposait. Mais ce qui est vrai à jamais, c'est que voilà mis à nu le foyer de « cette page CXXI lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ». Tous ne l'aperçoivent pas, bien que tous portent en eux le flambeau ; mais ceux qui tiennent à l'apercevoir doivent suivre désormais les pas de Descartes, pour affermir les leurs. C'est bien de son axiome que la philosophie peut dire, plus justement que personne : « Hors de là, pas de salut. » Tous les systèmes qui, depuis le XVIIe siècle, s'en sont écartés, ont payé cette erreur de leur chute, et le même échec attend tous les systèmes qui s'en écarteront, en se mettant en désaccord avec lui. La psychologie doit être le nécessaire commencement de toute philosophie qui redoute les chimères, et qui ne veut pas s'en contenter. En ceci, Descartes est supérieur à Aristote et à tous les grands esprits qui avaient cherché, plus ou moins heureusement, le critérium de la certitude. Quelques-uns l'avaient trouvé déjà dans l'évidence; mais personne avant Descartes n'avait montré le critérium de l'évidence elle-même. Après cette première supériorité que Descartes a sur page CXXII Aristote, on doit lui en reconnaître une autre. Il a rattaché indissolublement l'existence de Dieu à l'existence et à la pensée de l'homme. Sans sortir de l'enceinte de l'âme, il a pu établir cette preuve définitive, que d'autres n'ont demandée qu'au spectacle du monde extérieur. Le Cœli enarrati gloriam Dei est à l'usage des philosophes, aussi bien que de la foule ; et la théorie du premier moteur, dans Aristote, n'est pas autre chose que la traduction philosophique du sentiment commun de l'humanité. Mais, la preuve cartésienne nous est bien autrement intime, puisque, grâce à elle, l'athéisme devient la négation de notre propre existence, en même temps que la négation de Dieu. De l'être fini que nous sommes, et que nous sentons en nous, quand nous y rentrons, ne serait-ce que quelques moments , la raison remonte à l'être infini, d'où nous venons, et de qui, par conséquent, viennent aussi toutes choses. De l'idée que nous en avons, nous concluons à son existence nécessaire ; car il serait contradictoire qu'il nous eût accordé la pensée page CXXIII et la vie, et que, lui-même, il n'eût, ni la vie, ni la pensée. On a contesté la force de cette preuve ; mais c'est bien à tort. Elle est d'une inébranlable solidité ; et si Descartes avait besoin d'un appui, on pourrait invoquer celui d'Aristote. Après avoir démontré que l'acte éternel et immobile de la pensée est la vie de Dieu, ou du premier moteur, Aristote affirme que Dieu est le plus parfait des êtres, et, par suite, le principe de toutes choses (07). Aussi, blâme-t-il vivement les Pythagoriciens et Speusippe, qui ont refusé la perfection au principe, et qui l'ont transportée aux êtres que le principe produit, au lieu de la placer dans le principe lui-même. Selon eux, les animaux et les plantes, arrivés à tout leur développement, sont plus parfaits que les germes d'où ils sortent; et, par conséquent, c'est l'effet, et non la cause, qui réalise la perfection. Aristote leur répond que le germe lui-même vient nécessairement d'un être parfait et supérieur. Ainsi, dans la gé- page CXXIV nération, c'est le germe d'abord qui vient de l'homme, et non point l'homme qui d'abord vient du germe. Avant de pouvoir se développer, le germe doit être produit par un être complet. Aristote en conclut que c'est le principe qui est la perfection et l'infini, tandis que l'effet n'est que le fini et l'imparfait. Au fond, cet argument revient à celui de Descartes; et, sauf la forme, il est le même. Du fini que nous observons en nous, et de notre évidente imperfection, nous concluons légitimement que c'est d'un être infini, parfait et antérieur, que nous venons. Sur ce point comme sur tant d'autres, Aristote et Descartes pensent de même; et l'esprit humain peut s'en rapporter à leur double autorité. On reproche encore à Descartes d'avoir ouvert la porte à l'Idéalisme et au Scepticisme, en n'admettant la réalité du monde extérieur que sur la foi de la véracité divine. Nous ne croyons au témoignage de nos sens et de nos facultés, lui fait-on dire, que parce que nous croyons aussi que Dieu, dans sa perfection infinie, ne peut pas nous tromper; page CXXV
il est véridique, par cela seul qu'il est parfait.
Cette critique n'est peut-être pas page CXXVI et l'autre, sans doute, ils auront trouvé cette théorie à peu près inutile (08). Ainsi, la gloire de Descartes, c'est d'abord d'avoir donné à l'esprit humain non pas une méthode, mais la méthode proprement dite, d'avoir affirmé que l'essence de notre être, c'est de penser, d'avoir uni d'un lien nécessaire l'existence de Dieu à la nôtre, d'avoir démontré, tout ensemble, la providence et la spiritualité de l'âme, notre libre arbitre et notre personnalité, avec les conséquences morales et intellectuelles que portent ces principes sacrés. Le malheur de Spinoza, c'est d'avoir nié tout cela. Malgré les intentions les plus pures, il a été le promoteur d'un athéisme nouveau, qui, depuis deux siècles, a causé bien des naufrages, et ne cesse de faire des victimes. Spinoza, quoique Leibniz ait essayé de le rattacher à Descartes, n'a rien de Des- page CXXVII cartes. Il en serait bien plutôt l'ennemi, si la douceur de son âme ne lui avait évité ces violentes animadversions, qui passionnent doctrines aussi souvent que les individus. Il n'a jamais approuvé les principes Cartésiens, même lorsqu'il paraissait les enseigner ; et il s'est toujours défendu d'y montrer la moindre adhésion. Comme l'a si bien prouvé M. Cousin (09), le système de Spinoza n'a rien emprunté à celui de Descartes, pas même la fameuse définition de la substance. Si l'on veut trouver des ancêtres au Spinozisme, il faut les chercher parmi les philosophes arabes et juifs, Averroës, Maimonide, Levy Ben Gerson, et quelques autres. Tout ce que Descartes a fourni à Spinoza, c'est peut-être le fâcheux procédé d'appliquer aux matières philosophiques les formes de la géométrie , quoiqu'il convienne de les laisser aux mathématiques. La rigueur apparente de ces formules n'est qu'une difficulté de plus, dans des sujets qui ne les compor- page CXXVIII lent pas, et qui, par eux-mêmes, sont déjà bien assez épineux. La première cause de toutes les aberrations de Spinoza, c'est d'avoir pris une définition pour point de départ ; c'est d'avoir cru qu'il pouvait construire, sur cette base étroite et fragile, tout un système de philosophie, de morale, de métaphysique et de théodicée. Une définition est nécessairement arbitraire ; car, en supposant même qu'elle soit exacte, elle peut toujours sembler incomplète ; il est toujours permis d'y ajouter on d'en retrancher quelque chose ; elle ne porte jamais avec elle son évidence. On doit se garder de confondre une définition avec un axiome. Ce qui donne à l'axiome son autorité, c'est qu'il est évident par lui-même, et qu'il n'a pas besoin d'être démontré. C'est ainsi qu'Aristote a pu poser comme un axiome irréfutable le principe de contradiction, et s'en servir pour vaincre le Scepticisme ; c'est ainsi que Descartes a pu poser son axiome souverain, qu'on peut, à juste titre, appeler l'axiome des axiomes. Il n'y a rien d'arbitraire, ni dans le principe de con- page CXXIX tradiction, ni dans le « Je pense, donc je suis ». On ne peut les nier, l'un et l'autre, qu'à la condition de se mettre soi-même hors de toute raison, et, en quelque sorte, hors la loi. Au contraire, la définition de Spinoza est non seulement contestable ; elle est, de plus, absolument inapplicable aux réalités. Descartes, qui un instant en avait avancé une toute pareille, trente ou quarante ans avant son prétendu disciple, s'était hâté de la révoquer, parce qu'il s'était aperçu tout aussitôt de sa méprise. La substance est, si l'on veut, ce qui existe en soi et par soi ; Aristote l'avait dit le premier, et il l'avait répété à satiété. Mais, c'est la substance considérée dans ses rapports avec ses attributs ou ses accidents ; ce n'est pas la substance considérée dans ses rapports avec Dieu ; l'attribut n'existe que dans la substance, tandis que la substance est, relativement à l'attribut, par elle-même et en elle-même. Cette définition, qui est parfaitement vraie dans le Péripatétisme, où elle est spéciale et partielle, devient parfaitement fausse dans Spinoza, qui la rend page CXXX universelle, et qui l'applique à Dieu seul, anéantissant tout le reste, malgré les réclamations les plus éclatantes de la raison et de la conscience, et réduisant la substance infinie elle-même , telle qu'il la conçoit, à n'être qu'une abstraction, vide d'intelligence, de bonté, de providence, de liberté, et soumise à une nécessité que le Paganisme antique avait faite moins cruelle et moins sombre. dans la doctrine de Spinoza, l'humanité périt tout entière; la distinction du bien et du mal est abolie ; et il a beau intituler un de ses principaux ouvrages, la Morale, Ethica, il aboutit à une négation absolue de la morale, puisque la morale repose avant tout sur le libre arbitre. Si l'homme n'est qu'un des modes infinis de Dieu, si l'idée n'est en l'homme qu'un mode de la pensée divine, si notre corps n'est qu'un mode de l'étendue divine, alors que sommes-nous? Mis au rang de tous les êtres qui nous entourent, ramenés au niveau de la matière inorganique, n'est-ce pas notre anéantissement dès cette vie ? Alors, que devient l'homme, tel que la science et la page CXXXI
philosophie l'observent, l'étudient et le connaissent
, depuis que la philosophie et la science, avec les religions,
essayent d'éclairer les voies obscures où nous marchons? Spinoza
est-il donc seul à avoir raison contre le genre humain tout entier?
Si Descartes et Spinoza ne sont que des modes divins, pourquoi cette
différence entre leurs systèmes? Comment la pensée de l'un n'est-
On ne peut nier que, dans cette immolation métaphysique de .l'être humain, s'absorbant en Dieu avec l'univers, il n'y ait une certaine grandeur, et une sorte de majesté désolée, qui tiennent au contact même de l'infini. L'homme ne peut s'occuper de ces grandes choses sans en recevoir quelque reflet. Mais, en ceci, Spinoza n'a pas de privilège; tous ceux qui, parmi nous, ont été séduits à ses doctrines, ont quelque peu de ces lueurs grandioses et décevantes. Dans l'Antiquité, Lucrèce, interprétant Épicure, avait de ces accents. En remontant encore plus loin, l'Inde a connu, presque aussi bien que Spinoza, cette abdication de la nature page CXXXII humaine. les épopées brahmaniques ont chanté l'absorption de tous les êtres dans l'être unique et infini ; la Bhagavad-Guità (10) serait l'antécédent direct et l'ébauche du Spinozisme, si Spinoza avait pu la lire, avec les livres du Talmud et de la Cabale. Le mysticisme sans frein des Mounis hindous, ou des Arhats bouddhistes, a commis ces excès fanatiques, auxquels la solitude pousse des esprits vigoureux et méditatifs. La vie de Spinoza est fort honorable ; il a été un modèle de résignation, vertueuse et de constante spéculation ; mais s'il avait moins vécu avec lui-même, et qu'il eût pratiqué davantage les hommes et les choses, il est peu probable qu'il eût enfanté un système où il les défigure si étrangement les uns et les autres. Le spectacle des affaires humaines, vu de plus près, ne lui aurait pas permis de nier aussi résolument la liberté de l'homme, et de faire de nous, non pas même les instruments, mais les simples manifestations de Dieu. Renfermé sans cesse dans la prison de page CXXXIII sa propre pensée, il n'a vu qu'elle ; et il ne s'est pas douté que, en philosophie aussi bien qu'en morale et en politique, il composait un roman faux et triste, bien plutôt qu'une véritable doctrine. Bâti par sa puissante imagination, son système ne reposait sur rien ; mais il était fait pour séduire des esprits aussi peu pratiques que le sien et aussi aventureux. Il n'a eu que trop d'imitateurs, de même qu'il n'avait eu que trop de devanciers, plus inconscients et moins persuasifs que lui. On peut librement critiquer Leibniz sans risquer de porter la moindre atteinte à sa gloire. Il est tellement grand qu'on peut beaucoup lui retrancher, surtout en philosophie, sans le diminuer. Il s'est occupé de Métaphysique, comme il s'occupait de tout, par une curiosité d'esprit insatiable ; mais il n'a pas fait de la philosophie l'objet principal de sa vie, comme Descartes ou Spinoza, comme Aristote ou Platon. Il a été fort mêlé aux affaires de son temps ; mais il semble qu'il s'y est dispersé ; il a peut-être quelque-ibis perdu en régularité ce qu'il gagnait en page CXXXIV étendue. Il a eu beaucoup moins d'influence que Spinoza, qu'il combattait, non sans motif, et surtout moins que le Cartésianisme, qu'il a poursuivi, avec une malveillance et une injustice peu dignes d'un philosophe. C'est que Leibniz n'a point eu de méthode, et qu'il a méconnu la vérité de celle de Descartes. Aussi, n'a-t-il pas réformé la Philosophie première, ainsi qu'il s'en flattait; il n'a pas même donné une définition acceptable de la substance. Sa théorie des Monades, ainsi que l'Harmonie préétablie, sont reléguées dès longtemps parmi les rêves philosophiques. Son monument principal, c'est encore sa réfutation de Locke. Mais une polémique n'est point un système. Le même défaut se retrouve dans sa théodicée, où il est bien difficile, en dehors de l'Optimisme, de saisir ses opinions personnelles, parce qu'il est trop occupé à combattre les opinions d'autrui. Il ne réussit pas plus à établir la conformité de la raison et de la foi, qu'il n'avait réussi à concilier les protestants et les catholiques. En un mot, quel que soit son génie, il est en philosophie à une dis- page CXXXV tance considérable de Descartes, qu'il n'a pas toujours bien compris, et qu'il a peut-être calomnié. Leibniz n'avait fait qu'annoncer la réforme de la Philosophie première, sans l'accomplir. Kant reprend cette périlleuse entreprise. En se guidant sur Copernic, il se flatte de changer du tout au tout le point de vue, et de découvrir enfin la vérité, qui avait jusqu'à lui échappé à tout le monde. L'astronome réformateur avait fondé une science nouvelle et exacte, eu faisant tourner la terre autour du soleil, et en infligeant, au témoignage des sens et à l'opinion vulgaire, le démenti de la raison. Le philosophe crut pouvoir faire une révolution semblable pour la Métaphysique, en répudiant toute intervention de la sensibilité, et en se renfermant rigoureusement dans ce qu'il appelle la Raison pure. Selon lui, « la Métaphysique « consiste exclusivement dans la connaissance rationnelle spéculative, et elle s'élève au-dessus de l'expérience par les concepts seuls. Mais, ajoute-t-il, elle n'a pas été assez heureuse jusqu'ici pour con- page CXXXVI quérir le caractère d'une science, quoiqu'elle soit la plus ancienne de toutes, et qu'elle dût leur survivre, quand même toutes les autres viendraient à être englouties dans le gouffre de la barbarie(11). » Le novateur vise donc à faire de la Métaphysique une science aussi régulière qu'aucune autre. Mais, tout révolutionnaire qu'il se croit, il soupçonne néanmoins qu'il peut bien avoir eu des prédécesseurs; et, parmi eux, il cite Platon « qui, dédaignant, dit-il, « le monde sensible, où la raison est tenue dans des bornes si étroites, se hasarde, au-delà du monde, sur les ailes des Idées, dans l'espace vide de l'entendement pur. » Cette appréciation bizarre ne donne qu'une notion très insuffisante de la Dialectique platonicienne, qui, loin de dédaigner le monde sensible, y prend au contraire son point d'appui. Même avant Platon, Socrate déclarait déjà que, après bien des excursions dans le monde sensible, il avait trouvé qu'il ne devait avoir recours qu'à la raison page CXXXVII et regarder en elle la vérité des choses. Après Platon, Aristote avait eu ses Universaux, qui se trouvent certainement dans le domaine de l'entendement pur, tout aussi bien que les Idées, avec lesquelles on peut les confondre. Les Alexandrins s'étaient adressés aussi à la pure raison; et leur mysticisme avait également l'orgueil de s'élever au-dessus du monde sensible. Bien plus, sans remonter aussi haut dans l'histoire, Kant avait tout à côté de lui Descartes, dont la méthode rationnelle n'emprunte non plus quoi que ce soit au monde extérieur, et qui, se bornant au monde de la pensée et de la conscience, ne consulte exclusivement que la pure raison. La tentative de Kant n'est donc pas aussi neuve qu'il se le figure; mais il eût importé peu qu'elle ne fût pas originale, si elle avait été heureuse. Loin de là, elle a radicalement échoué. Après avoir fait quelque temps beaucoup de bruit, et avoir joui d'une vogue éphémère, elle est, après moins d'un siècle, désormais oubliée ; et l'histoire de la philosophie ne peut pas, dans sa justice, faire page CXXXVIII appel d'un jugement si mérité. Kant se promettait de réhabiliter la Métaphysique, et de la relever du décri où elle était tombée, par suite de ces discussions vaines, de « ces combats simulés » entre des philosophes qui ne sont que des rhéteurs, et à cause de « ces tâtonnements, qui sont d'autant plus déplorables qu'ils se passent entre de simples concepts. » Le Criticisme de Kant n'a fait que compromettre encore davantage la Métaphysique, auprès de tous les esprits sérieux et pratiques; et, si jamais elle pouvait périr, c'est de la main de tels défenseurs qu'elle périrait. Devant cet appareil formidable de déductions logiques, devant ce néologisme aussi inventif qu'inutile, devant cette prodigalité de formules sans fin, qui n'ont rien d'indispensable, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux retourner aux carrières de la Scholastique et du Moyen-âge, qui ont, du moins, l'avantage d'être dès longtemps connues. Kant voit si peu le dédale où il s'engage, qu'il reproche aux écoles « leurs toiles d'araignées », et qu'il est persuadé qu'il fait « un traité de la page CXL méthode , si ce n'est précisément le système de la science elle-même ». Il était difficile de se tromper plus complètement, on pourrait presque dire, plus lourdement. A l'écouter, la Critique doit restreindre l'usage de notre raison au lieu de l'étendre. C'est très bien; mais voyez comme Kant restreint les audaces de cette raison effrénée, qu'il veut soumettre au joug! Il l'autorise à révoquer en doute ces simples choses et ces banales croyances : L'âme, la liberté, Dieu; et il ne lui permet d'ajouter foi qu'au devoir, qui cependant ne repose plus que sur un absolu néant , du moment que l'on ne peut croire ni à Dieu , qui a fait la loi morale, ni à la pensée, qui la comprend, ni au libre arbitre , qui l'accomplit héroïquement, à travers tous les sacrifices. Si c'est là restreindre la raison, qu'est-ce donc que lui lâcher la bride? On a dit que Kant avait commis une généreuse inconséquence (12); mais il vaut mieux n'être pas inconséquent, quand on peut, avec si peu de peine, éviter page CLX de l'être ; et Descartes, tant négligé par Kant et ses successeurs, n'est-il pas mille fois plus sage? Kant ajoute que « les objets considérés comme phénomènes se règlent sur notre mode de représentation » ; et, selon lui, l'espace, le temps, ainsi que Dieu, le libre arbitre et l'âme, ne sont que des formes de notre raison subjective, et, en dehors d'elle, ne répondent à aucune réalité substantielle. Mais Kant ne pense donc pas à Protagore, qui, vingt siècles auparavant, au grand scandale de Socrate et de la Grèce, déclarait que « L'homme est la mesure de tout! » L'homme de Kant ressuscite et aggrave l'homme de Protagore ; et le philosophe du XVIIIe siècle, entraîné par son système, se joint aux sophistes anciens, qu'il oublie, et aux sophistes de son temps, qu'il avait la résolution de réfuter. Sans le vouloir, il n'a fait que leur préparer des armes, qui ne sont pas plus fortes que les leurs, mais qui semblent plus nouvelles. En même temps qu'on s'étonne de voir Kant rendre tout son arsenal à ses ennemis, on ne peut qu'être touché de sa franchise, page CXLI qui va jusqu'à la plus étonnante naïveté. Il demande, pour la Critique de la Raison pure, la faveur des gouvernements, parce que « la Critique est le seul moyen de couper les racines mêmes du matérialisme, du fatalisme, de l'athéisme, de l'incrédulité, du fanatisme, et de la superstition, enfin, aussi celles de l'idéalisme et du scepticisme ». Pas un gouvernement n'a répondu à une invitation peu opportune et peu philosophique. La Convention seule a honoré Kant du titre de citoyen français. Mais il n'est pas probable que l'assemblée révolutionnaire entendît assurer sa protection aux théories de la Critique, qui devaient lui être assez peu familières, puisque, vingt ou trente ans plus tard, elles étaient à peine connues de quelques penseurs en France. Quant à couper les racines de l'idéalisme, le philosophe a pu voir personnellement ce qu'il en était par l'Idéalisme transcendantal de Fichte, conséquence directe de la Critique de la Raison pure. Jamais l'idéalisme n'avait été poussé à cet excès, pas même par Berkeley. Mais si Fichte avait page CXLII outré les théories de son maître, dans la pratique il restait fidèle à ses nobles leçons, en sachant mourir pour sa patrie ; et les vertus du citoyen semblaient grandir de toutes les erreurs de l'École. Pour l'athéisme, l'incrédulité et le scepticisme. Kant s'est encore plus abusé ; c'est depuis l'apparition de la Critique que ces fléaux se sont déchaînés sur le monde germanique, avec le panthéisme, inconséquent dans Schelling, et d'une hardiesse sans bornes dans Hegel, intelligence d'une étendue et d'une puissance extraordinaires, mais qui, en croyant renouveler Aristote, n'a guère fait que renouveler les obscurités du vieil Héraclite et celles de Spinoza. L'Idée, dans l'esprit de l'homme, a pris la place de Dieu dans la nature et dans l'univers ; dominatrice et souveraine, l'Idée règle les mondes, et elle est bien près de les créer. L'homme, devenu l'être infini, se décerne l'apothéose. Il n'y a plus qu'un chef dans l'ensemble des choses ; ce chef, c'est lui, comprenant tout, et disposant de tout. Mais ce n'est pas là précisément cette unité de commandement que demandait page CXLIII
Aristote, à la fin de sa Métaphysique. Ce n'est pas
là non plus ce que demande le sens commun ; et ces démences d'une
spéculation sacrilège, autant qu'immodeste, ont amené un chaos de
systèmes qui ne devait finir que par un scepticisme général, et par
le mépris de toute philosophie. Kant n'est pas responsable de tout
ce mal ; mais c'est lui qui l'a provoqué, quoiqu'on voulant le
prévenir. En supposant qu'il sentît les approches de cet effroyable
orage, il n'aura La conclusion qui ressort de cette rapide revue de l'histoire de la philosophie, c'est qu'Aristote doit être rangé parmi les plus grands métaphysiciens de tous les siècles ; sa doctrine est, avec celle de Descartes, une des plus solides et des plus claires qui se soient jamais produites. Mais, sans négliger l'histoire et ses enseignements, élevons-nous au-dessus d'elle ; et recherchons, à cette heure, non plus ce que la Métaphysique a pu être dans le passé, et chez tous les peuples un peu éclairés, mais page CXLIV bien ce que la Métaphysique est en elle-même, quels sont ses droits, quelle est sa place parmi les sciences, quelles sont les questions qui lui appartiennent. Sachons si l'étude de ces questions est un besoin essentiel et permanent de l'esprit humain, ou si, comme on l'a répété trop souvent, depuis Aristophane, ce n'est qu'un nuage, poursuivi par des penseurs moins raisonnables qu'obstinés. Aujourd'hui, par ce temps de libre examen, d'indépendance et de sécurité, il serait assez inutile de réclamer pour la philosophie des droits que personne ne peut tenter de restreindre, ou qui, du moins, sont si peu menacés que les défendre, c'est paraître en douter gratuitement. Cependant, la persécution n'est pas tellement ancienne qu'il faille en perdre tout souvenir ; et quoique, selon toute apparence, elle ne doive jamais renaître, il est bon de redire, encore une fois, ce qu'est la philosophie, en présence de la théologie, qui la supprime quand elle le peut, et autant qu'elle le peut, et aussi en présence de la science, qui, pour d'autres motifs et sous d'autres formes, page CXLV
n'est pas beaucoup plus indulgente. L'une traite la
philosophie de téméraire et lamblique, dans la Vie du sage de Samos, lui attribue une opinion qui est si vraisemblable qu'on peut penser qu'elle est vraie ; une tradition intelligente et pieuse l'a conservée à notre usage et à notre admiration. « Les sociétés que les hommes forment sur cette terre, disait Pythagore, ressemblent assez bien à la foule qui se presse aux fêtes solennelles de la Grèce. Les gens qui se rendent à ces réunions et à ces jeux, sont de toutes les classes, et chacun s'y rend avec des vues différentes. L'un, poussé par le désir du gain, y porte des marchandises, qu'il compte vendre à grand page CXLVI profit ; un autre y est attiré par l'amour de la gloire, et il ne veut que montrer sa vigueur corporelle. Enfin, il y a une troisième espèce de gens, qui sont les plus libres et les plus désintéressés. Ceux-là n'ont d'autre but que de visiter le lieu de la fête, d'y regarder à leur aise les beaux ouvrages qu'y étalent les artistes, et d'y entendre les curieux discours qu'on peut toujours recueillir dans ces nombreuses assemblées. C'est de la même façon que les hommes, dans leurs relations sociales, sont adonnés aux soins les plus divers. Les uns ont la passion de l'argent et du plaisir, qui les entraîne ; les autres n'ont soif que du pouvoir, et veulent commander à l'univers, pleins d'orgueil et avides de renommée. Mais ce que l'homme peut faire de mieux en ce monde, c'est de contempler les objets magnifiques qu'il a sous les yeux ; et, quand on prend ainsi la vie, on s'appelle philosophe. Rien n'est plus beau que le spectacle du ciel rempli des astres qui s'y meuvent, pourvu qu'en admirant l'ordre qui les régit, on remonte à page CXLVII leur premier principe, que la raison seule peut concevoir. (13) » Nous n'avons pas à comprendre la philosophie autrement que ne la comprenait Pythagore. Pour nous, elle est ce qu'elle était pour lui, ce qu'elle sera pour nos successeurs, à savoir : la spéculation en grand, la spéculation désintéressée et systématique, circonspecte et indépendante, n'acceptant d'autres guides que la raison et la vérité. Ce qui distingue la philosophie de toutes les sciences particulières, c'est qu'elle essaye d'embrasser l'ensemble des choses. Tandis que les sciences de détail ont chacune leur sujet spécial et déterminé, comme Aristote l'a si bien vu, la philosophie a pour objet propre la totalité des êtres. C'est là tout à la fois sa force et sa faiblesse. La science peut paraître plus facile et plus exacte, quand elle est plus circonscrite ; mais, à y regarder de près, ce n'est là qu'une illusion. L'infini se rencontre dans la petitesse, aussi bien que dans la grandeur ; et une science spé- page CXLVIII ciale, avec ses analyses minutieuses, n'épuise pas plus l'infini que ne l'épuisé la science générale, dans sa sphère sans limites. Certainement, ce que nous apprennent les sciences analytiques est très curieux, et souvent très utile. La philosophie le conteste moins que personne, puisqu'elle doit faire usage, dans une certaine mesure, de toutes les découvertes scientifiques. Mais, s'il est intéressant de connaître l'organisation rudimentale de la matière inerte, l'organisation plus compliquée du végétal, l'organisation supérieure du règne animal, dans toutes ses variétés et à tous ses échelons ; s'il est intéressant de reconstituer les annales du globe que nous habitons, de pénétrer dans les profondeurs infinies des cieux, pour y marquer, pas à pas, la marche régulière des mondes innombrables ; s'il est intéressant d'observer l'action des corps les uns sur les autres depuis l'attraction moléculaire jusqu'à l'attraction universelle, n'est-il pas d'un intérêt mille fois plus grand encore de rechercher, ainsi que nous le pouvons, l'origine de toutes ces merveilles, la cause pré- page CXLIX mière de tous ces phénomènes admirables ; et à côté d'eux, au-dessus d'eux, d'étudier l'homme dans sa nature intellectuelle et morale et dans sa destinée, l'homme, c'est-à- dire l'être que nous sommes, accessible à notre observation mieux que tout ce qui nous entoure et n'est pas nous? Bien plus, c'est l'esprit de l'homme qui fait la science, à tous les degrés. En réunissant les Matériaux que la réalité lui fournit, il y ajoute beaucoup du sien ; et, quelquefois même, il y met à peu près tout, comme dans les Mathématiques. Les sciences spéciales n'ont point à s'occuper de cette part immuable que l'homme apporte dans chacune d'elles, en les cultivant. Mais, il faut qu'il y ait une science qui s'en occupe ; et c'est la philosophie, ou la science générale, qui se charge de ce soin, au grand avantage de toutes les autres sciences, moins vastes qu'elle. Ainsi, l'objet de la philosophie étant l'universalité des choses, cet objet peut se décomposer en trois autres : l'homme d'abord, le monde ensuite, et la méthode que l'intelligence humaine doit employer à sa propre page CL
étude et à l'étude de l'extérieur. Voilà comment la
philosophie a pu être prise à juste titre pour la science des
principes et des causes, pour la science des choses divines et
humaines; voilà comment Aristote la nomme déjà la plus divine page CLI la méthode, de la pensée, et de Dieu, manifesté à l'homme par les phénomènes de la nature et par notre raison. Devant la généralité et l'importance de ces problèmes, tous les autres s'effacent, ou pâlissent. C'est en vue de cet intérêt supérieur qu'à certaines époques, chez certains peuples, la religion a été chargée d'en garder le monopole et le dépôt inviolable. C'est surtout dans, le Christianisme du Moyen-âge qu'a sévi l'intolérance, qu'aucune autre religion n'a portée aussi loin. La philosophie, qui a eu tant à en souffrir, peut aisément aujourd'hui être équitable, et reconnaître que cette intolérance, impossible désormais, venait, dans le passé, de deux causes à peu près irrésistibles. Lorsque l'on croit sincèrement, comme l'ont fait de longs siècles, que Dieu a parlé, et que sa parole est renfermée dans un livre, on ne saurait permettre aucune contradiction. Auprès de la parole divine, quel poids peut avoir une parole humaine, quelque sage qu'elle puisse être? Si le salut de la société semble attaché au maintien de la foi, à quels excès ne se laisse- page CLII t-on pas emporter, quand les mœurs sont encore grossières et farouches? L'ardeur même des convictions redouble la cruauté des supplices, et l'on en arrive à punir par le fer et le feu des opinions qui méritaient à peine d'être discutées dans les écoles, d'où elles ne sortaient pas. A cette cause, s'en ajoutait une autre presque aussi puissante. La religion, qui n'occupait dans les sociétés antiques qu'une place subordonnée, avait usurpé la première dans les sociétés issues des débris de l'Empire romain. L'Europe a été sur le point de devenir une théocratie; l'Église a été, pendant quelque temps, la souveraine dispensatrice des couronnes et l'institutrice des sciences. Aussi, a-t-elle subi l'influence fatale que le pouvoir, quand il est absolu, a toujours sur la fragilité humaine, de quelque caractère auguste qu'elle soit revêtue. La Tiare n'exempte pas de ces ivresses et de ces défaillances. Si les Césars, tant accusés, livraient les martyrs aux bêtes du Cirque, l'Église livrait aux flammes les hérétiques et les libres penseurs. Les vindictes de l'orthodoxie avaient peut-être page CLIII même quelque chose de plus blâmable , puisque c'était au nom de Dieu qu;on lesexerçait. Causée par les enivrements de la puissance et de la foi, cette ardeur de persécution témoigne, du moins, dans quelle estime jalouse les sociétés chrétiennes ont tenu les problèmes que la Philosophie première étudie, comme la religion. Elles voulaient, à tout prix, les interdire aux profanes ; et elles en prohibaient la discussion par des sévices atroces, dont le siècle qui a précédé le nôtre avait encore à frémir. Parles progrès de la raison et par l'adoucissement des moeurs, la lutte a pris actuellement une autre forme. On ne peut plus frapper la personne des philosophes; mais c'est l'esprit humain qu'on frappe d'incompétence. On consent à ce que l'homme, à l'aide des facultés qu'il a reçues de Dieu, puisse comprendre ce qu'on nomme les vérités naturelles; mais on lui refuse de s'élever jusqu'aux vérités dites surnaturelles. Cette distinction, que n'a pas connue l'Antiquité, n'a par elle-même aucune valeur; en tout cas, elle ne pourrait en avoir que pour les page CLIV croyants. Elle n'a pas de sens aux yeux de la philosophie, qui implique, avant tout, la liberté illimitée de l'esprit. A cette injonction hautaine, qui exigeait une abdication, la philosophie a répondu comme ce philosophe ancien, qui, pour démontrer le mouvement, se mettait à marcher devant ses contradicteurs. Elle n'admet qu'une seule vérité, celle que Dieu place à la portée de l'homme, en lui accordant l'intelligence; elle n'accepte de limites que celles qu'il nous a imposées par notre propre nature. Dans ses libres investigations, elle ne tient aucun compte des obstacles que les hommes veulent parfois lui susciter. Elle ne craint que l'erreur; mais elle ne craint, ni la lutte, ni même le martyre. Cette énergique conviction de son droit lui a réussi; et après quatre mille ans, elle en est, dans ses rapports avec la théologie, revenue au point où, en Grèce et à Rome, elle en avait toujours été. C'est aussi une sorte d'incompétence et d'anathème que la science décrète contre la Métaphysique. Se rapprochant ainsi de la théologie plus qu'elle ne le pense, et, proba- page CLV blement, beaucoup plus qu'elle ne le voudrait, elle déclare que l'homme ne peut rien savoir de positif sur Dieu, sur l'âme et sur ses destinées, sur les principes et sur les causes. Elle incline à douter du libre arbitre, quand elle ne le nie pas résolument; et elle conseille à l'esprit humain, trop orgueilleux, de laisser là des questions stériles, pour se borner à des questions bien autrement utiles et pratiques. Tout au plus, concéderait-elle que la Métaphysique peut s'occuper de la question de la méthode. Mais, comme chaque science spéciale prétend avoir des méthodes à elle, on se soucie médiocrement de la méthode générale, qui s'applique au fondement de la certitude On s'en fie instinctivement au témoignage des sens ; et même aussi, sans le remarquer, on s'en fie au témoignage de la raison, qui intervient toujours, pour une part considérable, bien que cachée, dans tout ce que font les sciences. En s'en tenant à la surface des choses, on a pour soi l'unanimité du genre humain, qui, sauf des exceptions fort rares, n'aime pas davantage à descendre dans ces profondeurs, page CLVI où reposent les assises de tout l'édifice scientifique et moral. Mais, si, dans des questions de méthode et de logique, la science est d'accord avec la foule pour rester indifférente, il faut bien que la science le sache et se le dise : elle est, au contraire, en un désaccord radical avec l'humanité entière, quand elle veut étendre cette indifférence jusqu'à l'âme et jusqu'à Dieu. Les religions, les plus infimes comme les plus sublimes et les plus vraies, sont la philosophie des peuples ; et l'on peut voir, dans tout le cours de l'histoire, avec quelle invincible ténacité les peuples s'attachent et se dévouent à leurs croyances. Ils sont toujours prêts à verser leur sang pour les défendre et les conserver. Ils n'ont pas de trésor plus cher, ni de richesses plus précieuses. Ils les gardent éternellement, au milieu de toutes les défaites et de toutes les ruines ; ils les emportent avec eux dans l'exil, sur la terre étrangère; et ils les y entretiennent à jamais, loin de la patrie, qu'ils ne doivent plus revoir. Les guerres qu'ils engagent contre des croyances hostiles, sont les plus page CLII implacables elles plus longues de toutes les guerres. La Grèce, quoiqu'elle n'eût pas de livres saints, a connu la Guerre Sacrée. les annales de l'Europe moderne, il dansn'est pas un seul siècle qui se soit écoulé sans conflits religieux-. La Réforme a nécessité une guerre de Trente ans, dont notre Occident n'a pas perdu la mémoire. La Chrétienté a lutté, depuis six ou sept siècles, contre le Mahométisme ; et les passions ne se sont refroidies, ni de part, ni d'autre. Par lassitude, on conclut des trêves; mais on n'a jamais vu, entre les deux cultes, la concorde et la paix; dans tous les deux, cependant, les principes essentiels sont identiques. Ce sont là des faits et des considérations que la science doit se remettre sans cesse sous les yeux, quand elle croit devoir détourner le genre humain de la Métaphysique et de la Religion. Jusqu'ici, le genre humain n'a guère prêté l'oreille à cette invitation; et, pas plus que la philosophie, il ne prend au sérieux ces charitables avis. La science n'hésite pas, de son côté, à condamner cet entêtement de l'ignorance, et elle en appelle page CLVIII à une humanité plus éclairée. Mais, la philosophie, qui n'est pas sans lumières, persiste à imiter Socrate et Platon, Aristote et Descartes, et à se conformer aux ordres de la raison, qui en sait plus encore que la science, dont seule elle connaît les principes. La philosophie ne se démet en faveur de personne: elle peut dire à la Théologie et à la Science, ce que Socrate disait à ses juges: « Athéniens, je vous honore et je vous aime; mais j'obéirai plutôt au Dieu qu'à vous: et tant que je respirerai, et que j'aurai un peu de force, je ne cesserai de m'appliquer à la philosophie, et de vous offrir mes avertissements et mes conseils... Je ne ferai jamais autre chose, quand je devrais mourir mille fois (14). » Les questions qui se posent pour la religion et la philosophie étant les mêmes nécessairement, et les solutions étant généralement pareilles, en quoi peuvent donc consister les différences, qui vont parfois jusqu'aux plus regrettables hostilités? En quoi page CLIX la Philosophie première et la Religion sont-elles séparées? En quoi sont-elles unies? Leur divorce, qui remonte au passé le plus lointain, peut-il un jour cesser? L'accord de la raison et de la foi, tenté par de sincères et puissants esprits, doit-il se réaliser un jour? Une première différence, qui est la plus frappante et qui entraîne toutes les autres, c'est que la Religion doit être considérée comme l'œuvre collective de peuples entiers, tandis que les systèmes philosophiques ne sont jamais que des œuvres individuelles. Quelque obscure que soit l'origine du livre saint, il devient, une fois adopté, la règle de la nation ou de la race ; il semble même que l'énergie de la croyance soit d'autant plus vive que les ténèbres sont plus épaisses. Tantôt, ce sont des révélations que Dieu dicte à des prophètes chargés par lui de les transmettre à la multitude, comme la Bible, le Zend-Avesta, ou le Coran ; tantôt, ce sont des hymnes de poètes inspirés, comme le Véda des Rishis hindous ; tantôt, ce sont les enseignements d'un sage recueillis par ses disciples directs, comme les Soûtras boud- page CLX dhiques, ou ses maximes écrites par lui-même, comme le Chou-king de Confucius ; tantôt, ce sont de simples légendes populaires et poétiques, comme dans le Paganisme grec et romain ; tantôt enfin, ce sont les récits d'écrivains ou de témoins qui semblent suffisamment autorisés, comme nos quatre Évangiles, ou même l'Apocalypse. Les bigarrures et les invraisemblances séduisent la foule, loin de la rebuter; et plus lard, la libre pensée a tort de les soumettre à des critiques trop faciles et trop amères. En ceci, les critiques sont inutiles autant, au moins, qu'elles sont justifiées. Les peuples ne peuvent pas changer leur foi religieuse, quelque peu raisonnable qu'elle soit à certains égards, sur les démonstrations de l'érudition et de la philologie. Le livre saint est ce qu'il est; et, le peuple qui l'adore étant donné, ce livre est en somme trop bienfaisant, malgré ses lacunes ou ses insanités, pour que ses sectateurs l'abandonnent. C'est toute leur vie morale ; et ils renoncent à celle-là, moins facilement encore qu'ils ne renonceraient à l'autre. On dit : La religion page CLXI de Moïse, la religion de Zoroastre, la religion de Confucius ou de Mahomet; mais, au fond, ce n'est que la religion du peuple hébreu, la religion du peuple perse, la religion du peuple chinois, la religion des peuples musulmans. Si les peuples n'avaient pas apporté leur sanction et leur foi à tous ces livres, quels qu'en fussent les auteurs, ces livres seraient restés des systèmes de philosophie. Le caractère sacré et collectif leur eût fait défaut, parce qu'il n'y a que les peuples qui puissent le conférer. Loin de là, l'origine des systèmes philosophiques, qui sont toujours individuels, ne présente pas la moindre obscurité. On sait à qui les attribuer; on sait où ils sont nés, à quelle époque, dans quelles circonstances ; on sait combien de temps ils ont duré, quelles transformations ils ont subies, avant de disparaître, et ce qu'ils ont légué à l'héritage commun. Tout au plus, se forme-t-il, autour de quelques personnages éminents, ce qu'on appelle des écoles, c'est-à-dire, la réunion d'un petit nombre d'esprits moins forts, mais tout aussi indépendants, qui se rangent page CLVII à la doctrine d'un maître, parce qu'ils ne sont pas capables d'enfanter eux-mêmes une doctrine. Il est arrivé que les écoles se sont prolongées pendant plusieurs siècles, quand leurs chefs deviennent des professeurs, qui se succèdent,comme on l'a vu dans la Grèce. Mais les disciples discutent les leçons qu'ils reçoivent; l'adhésion facultative que l'on donne à l'enseignement, n'ôte absolument rien à la plus entière liberté. Si l'on se sépare, on n'est point hérétique ; c'est une opinion qu'on change pour en choisir une meilleure; ce n'est point une abjuration, ni même un schisme. Les choses se sont toujours passées ainsi depuis que la philosophie existe ; et parmi nous, Descartes, qui a fait école, n'a point hésité à le déclarer, à peu près, comme Socrate pouvait le faire dans Athènes : « Mon dessein n'est pas d'enseigner la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne (15). » CLXIII Mais qu'est-ce que des écoles en comparaison de peuples ! Elles ne comptent pas, pour ainsi dire, dans l'histoire de l'humanité; et c'est une délicate affaire d'érudition que de constater leurs noms et les phases de leur existence. Que peuvent en savoir les nations, lorsque tant de savants les ignorent et ne s'en inquiètent pas ? Une doctrine philosophique n'a de valeur réelle que pour celui qui se l'est faite, et pour ceux qui veulent bien la lui emprunter. Ils sont toujours en une minorité imperceptible, parce que la gloire de la philosophie est ailleurs que dans la multitude de ses adhérents. On a beaucoup reproché à la philosophie cet individualisme ; et souvent le grief a paru tellement sérieux qu'on est allé jusqu'à la faire passer pour l'ennemie de la société, parce qu'elle n'en acceptait pas aveuglément toutes les croyances. Pourtant, cet individualisme est la philosophie même ; si on le réprouve, il faut la réprouver avec lui ; elle est supprimée du même coup. Mais on aurait beau faire, l'un et l'autre sont solidaires et indestructibles. La philosophie ne dispa- page CLXIV
raîtra pas plus que l'individu. Ce n'est pas elle qui
a mis l'individualisme dans la nature des choses ; il est l'œuvre de
Dieu ; et, tant que l'individu sera l'être raisonnable et libre, que
le créateur a fait de nous, l'exercice libre et raisonnable de nos
facultés sera toujours soustrait, quand nous le voudrons, à toute
violence et à toute corruption étrangère. La Métaphysique est
l'exercice de notre faculté la plus haute ; elle subsister autant
que notre raison. Sans doute, nous vivons de la même vie que nos
semblables ; mais nous ne vivons pas en eux, nous vivons en nous.
Sans doute, nous pensons tous au même titre; mais notre pensée n'est
pas De ce que la philosophie est nécessairement individuelle, il s'ensuit évidemment page CLXV qu'elle ne peut jamais, sous quelque prétexte que ce soit, être intolérante, comme l'est souvent la Religion. La liberté, qu'elle revendique pour elle, est également le patrimoine d'autrui, tout aussi respectable dans la plus humble des âmes que dans le philosophe le plus instruit. L'intolérance, qui est partout une faute, devient pour la philosophie un suicide ; refuser la liberté aux autres, tandis qu'on en fait pour soi-même son seul droit à exister, c'est une contradiction que les peuples et leurs gouvernements ont commise plus d'une fois ; mais, la philosophie ne peut pas la commettre. De fait, elle n'est jamais descendue à cette honte. L'histoire, dans ses douloureuses annales, ne pourrait pas citer un seul philosophe qui ait été persécuteur, au nom de la noble science qu'il cultivait. Ceci ne veut pas dire que la philosophie soit insensible à ce qu'elle regarde comme l'erreur ; mais elle en est beaucoup moins préoccupée que de la vérité, qu'elle cherche. Quand elle jette les yeux autour d'elle dans la société, elle s'en fie exclusivement à l'action lente des siècles et page CLXVI de la raison, pour corriger ce qu'elle blâme ; elle y contribue, pour sa part ; mais elle ne précipite pas la réforme ; et, comme son rôle n'est pas de gouverner les hommes, elle se borne à se gouverner elle-même. Voilà comment le vrai philosophe respecte toujours, dans toute la sincérité de son cœur, le culte du pays où Dieu l'a fait naître. Ce respect se fonde sur les meilleurs motifs. D'abord, si la philosophie choisit librement la voie qui la mène à la solution des grands problèmes, pourquoi d'autres ne seraient-ils pas libres de prendre une voie différente ? La Religion associe les hommes dans une pensée et une solution communes ; le philosophe marche seul dans le chemin pénible qu'il s'est tracé ; mais le but est le même, si la route ne l'est pas. La religion peut dédaigner la philosophie ; la philosophie ne doit jamais dédaigner la religion, parce que ce serait se désavouer soi-même en principe. Puis, l'inspiration instinctive des peuples les conduit à la vérité sur les points essentiels, aussi sûrement que la réflexion la plus attentive y peut conduire page CLXVII le philosophe. Si la raison, par la bouche d'Aristote, démontre la nécessité d'un premier et unique moteur, la plupart des religions proclament aussi, sans hésitation, l'existence de Dieu et sa providence. De part et d'autre, le résultat est identique, quoiqu'il soit obtenu par des procédés opposés ; la philosophie serait bien aveugle de ne pas le voir. les religions ont, spontanément, leur métaphysique ; et il n'est pas difficile de la dégager, du milieu des légendes qui la cachent, sans l'effacer. Enfin, la philosophie peut souvent se retrouver tout entière dans la morale religieuse, et jusque dans les dogmes. N'est-ce pas elle qui, dans cette grande société grecque et romaine, avait préparé l'avènement et le triomphe du Christianisme, reçu et propagé par les Gentils? Un bon citoyen a-t-il besoin de tant de motifs, sans parler des exigences de l'ordre public, pour respecter la foi de ses compatriotes ? Socrate a été condamné pour avoir méconnu, disait l'accusation, les Dieux de la patrie. Mais c'était une calomnie ; Socrate était innocent, malgré tout ce qu'en page CLXVIII ont pu dire ses ennemis ; il n'a succombé qu'à leurs fureurs ; ils l'ont tué, mais ils n l'ont pas flétri. Autre conséquence de l'individualisme philosophique. La plupart des religions ont un Credo et un symbole ; le Christianisme n'est pas seul à avoir le sien; la Bible, le Bouddhisme, le Mazdéisme , le Mahométisme, ont les leurs. Mais la philosophie n'en a pas, et elle n'en doit jamais avoir. Les philosophes peuvent, chacun à part, s'étudier à condenser de plus en plus leur doctrine, comme les religions se concentrent dans un acte de foi. C'est ainsi que, dans l'Antiquité, s'est formé le Manuel, dit d'Épictète. C'est ainsi que, au XVIIe siècle, Descartes tentait, pour obéir à la manie de son temps, de réduire les axiomes de son système à la forme géométrique. Spinoza et Leibniz en faisaient autant, et sans plus de succès, s'ils espéraient par là se faire mieux écouter du genre humain. Le même échec attend tous ceux qui seraient séduits par la même illusion , où l'amour-propre a peut-être autant de part que le désir, d'ailleurs très louable, d'être : page CLXIX utile à l'humanité. Ce n'est pas précisément à l'humanité que parle le philosophe ; c'est surtout à lui-même, comme le faisait Marc-Aurèle. Pour peu qu'on ait dans le cœur le sentiment du bien, on peut révérer les sages; mais on ne jure pas en leur nom. Aussi, l'on peut se le demander : Est-il au monde rien de plus ridicule que la philosophie consentant à rédiger un catéchisme, comme on l'a essayé dans les temps troublés de notre Révolution, ou même s'essayant à fonder un culte, comme celui de la Théophilanthropie, qui, en dépit de bonnes intentions, a échoué misérablement, sous la réprobation et l'ironie universelles? Tout ceci doit nous faire voir dans quel abîme tombe la philosophie, quelle entreprise impraticable et illégitime elle poursuit, quand elle projette de se substituer à la religion. Elle ne l'a tenté un peu sérieusement qu'au siècle dernier, si toutefois il n'y a pas une complète méprise dans la pensée qu'on lui prête. La philosophie du XVIIIe siècle n'est pas, à proprement dire, de la philosophie ; c'est une croisade ardente, page CLXX et malheureusement trop justifiée, de tous les écrivains courageux et indépendants contre des abus devenus insupportables. La religion a été enveloppée, comme tout le reste, dans cette guerre civile, qui devait aboutir à la rénovation de l'ordre social. Mais cette révolution était politique et non philosophique. L'établissement de l'Église avait ses abus, qu'il fallait aussi réformer ; et, parmi les soi-disant philosophes, ce ne furent que les plus violents et les moins sages qui songèrent à renverser l'antique religion, pour la remplacer par une nouvelle, dont personne n'aurait pu même indiquer les bases. Voltaire, qui a dirigé, contre un clergé intolérant et barbare, une polémique infatigable, n'a jamais songé à faire succéder une religion d'invention contemporaine au Christianisme, si mal interprété par ses ministres. Auteur lui-même de traités de Métaphysique (16), qui sont peut-être les meilleurs de son temps, son bon sens l'eût fait reculer page CLXXII levant une révolution religieuse. Lui qui, sans faiblir un instant, défendait contre ses amis et même contre ses admirateurs la croyance à l'existence de Dieu, il n'eût pas trouvé assez de moqueries et de sarcasmes contre le pontife d'un culte improvisé sous ses yeux. dans tout le passé, on ne cite guère que l'empereur Julien, qui aurait entrepris, dit-on, de mettre la philosophie à la place de la religion. Mais ceci encore est une erreur. Bel esprit, plus rhéteur que philosophe, Julien n'a voulu que rendre la vie au Paganisme expirant. L'Église chrétienne ne lui a point encore pardonné cet effort désespéré du patriotisme. Mais la philosophie n'a rien à voir dans cette tardive restauration d'un culte suranné ; c'est la politique qui en est seule responsable, puisque la lutte s'est passée exclusivement entre les deux religions. Ainsi le XVIIIe siècle, si ce n'est pas le calomnier que de le juger sur ses représentants les moins dignes, n'a pas été plus heureux contre le Christianisme que Julien ne l'avait été au IVe siècle. De nos jours, la religion a plutôt gagné que perdu aux attaques page CLXXII passionnées dont elle a été l'objet dans le siècle dernier. Ce doit être là un décisif avertissement pour tous ceux qui voudraient recommencer cette aventure. Elle a contre elle la nature des choses; et l'avenir ne lui réserve pas une victoire, qui jusqu'à présent lui a été refusée. La discussion n'en doit pas moins rester toujours ouverte, et toujours être libre, sur les sujets sacrés aussi bien que pour tous les autres; une religion qui a déclaré que Dieu livre le monde aux disputes des hommes, ne peut pas réclamer un privilège qui la délivrerait de l'examen. La discussion, d'ailleurs, a ses limites, qu'elle ne doit pas franchir, sous peine d'y être ramenée invinciblement par la puissance publique. Quand on veut changer les croyances religieuses de sa patrie, on doit, tout d'abord, savoir qu'une religion ne peut être remplacée que par une autre religion, et qu'elle ne l'est jamais par la philosophie. Ce n'est pas la philosophie quia succédé au Paganisme, miné par elle; c'est la religion chrétienne. Ce n'est pas elle non plus qui, pour une bonne partie de l'Europe, a succédé au Catholicisme; page CLXXIII c'est le Protestantisme de Luther et de Calvin. Platon formait déjà un vœu irréalisable, en disant que les peuples ne seraient heureux que quand leurs chefs seraient philosophes. Mais espérer que tous les hommes deviendront philosophes, c'est-à-dire, que tous les hommes se formeront à eux-mêmes leurs croyances personnelles, au lieu des croyances nationales, n'est-ce pas un rêve, qui est cent fois plus creux, et qui, dans bien des circonstances, pourrait devenir un danger social? Il faut donc que la philosophie et la religion se tolèrent mutuellement, puisqu'elles sont, ainsi qu'on l'a si bien dit (17), « deux sœurs immortelles ». Elles ont toujours été, elles seront toujours contemporaines; et, quoique leur influence soit essentiellement diverse, elles sont toutes deux indispensables à l'esprit humain. Elles satisfont des besoins également nécessaires; et c'est là ce qui fait qu'elles ne peuvent pas mourir, l'une plus que l'autre. L'accord semblerait devoir être page CLXXIX facile, si Ton ne consultait que l'intérêt commun; mais, des deux parts, les passions interviennent, et rendent la paix impossible, quelque avantageuse et quelque sage qu'elle serait. La philosophie se flatte, avec toute raison, d'être plus pure, et d'atteindre plus directement la vérité ; la religion ne peut éviter le mélange d'éléments multiples et hétérogènes, comme l'est la vie des peuples qui l'embrassent. Mais la religion est infiniment plus puissante, et, par ce motif, plus agressive, tant que les peuples mettent à son service les forces immenses dont ils disposent. Pourtant, la religion n'est pas tellement sûre d'être sans mésalliance que, souvent, elle ne doive accomplir elle-même l'office qu'elle interdit impitoyablement à la critique ; elle fait un choix dans les documents qu'elle emploie, excluant les uns et retenant les autres. Les conciles bouddhiques s'y sont repris jusqu'à trois fois pour changer et arrêter le canon de la « Triple Corbeille », avant d'en fixer la forme définitive. Les conciles chrétiens, et notamment celui de Nicée, ont fait des éliminations ana- page CLXXV logues dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau. Défendre la lecture sainte aux profanes, et la réserver à des adeptes, ne prouve pas non plus une assurance complète. Le Veda ne peut être lu que par les Brahmanes; le Catholicisme a toujours vu d'un œil inquiet les traductions en langue vulgaire. Aujourd'hui même, il n'autorise que les traductions du latin de saint Jérôme; celles de l'hébreu ou du grec des Septante sont presque suspectes. Puisque la religion a tant de scrupules, ce serait un motif pour elle de permettre à d'autres d'en avoir à son exemple. Mais la seule pensée d'une telle concession révolte les églises ; et l'on doit convenir qu'il est assez naturel qu'elles ne la fassent jamais; on dirait qu'elles préfèrent appliquer la fameuse sentence : « Sint ut sunt, aut non sint. » La philosophie qui, toute modestie à part, peut avoir la conscience d'être, en général, plus raisonnable, se fait honneur en montrant plus de condescendance qu'on n'en a pour elle, quand elle croit devoir s'écarter de son objet propre pour discuter et criti- page CLXXVI quer les religions. Sans doute, on est fort excusable d'être choqué de ces légendes merveilleuses et absurdes, qui ne répondent qu'aux délires de l'imagination, de ces miracles le plus fréquemment sans but et de simple fantaisie, de ces mythes inintelligibles qu'on trouve dans le Bouddhisme, dans les monuments brahmaniques, dans le Mazdéisme, dans le Paganisme, et dans tant d'autres cultes. Mais on doit se sentir porté à l'indulgence quand on se rappelle comment se fondent les religions, et de quels éléments se compose l'étrange diversité du genre humain. Ce qui donne tant de prix à la sagesse, c'est qu'elle est excessivement rare ; et si quelque chose peut nous causer de l'étonnement, c'est que, d'un pareil mélange, il soit sorti tout ce bien et toutes ces vérités sublimes, qu'une raison sagace et bienveillante découvre, sans trop de peine, sous des ténèbres et sous des non-sens. Et puis, la philosophie doit être assez impartiale, dans sa propre cause, pour avouer que, elle aussi, prête à des critiques que la religion n'est pas seule à mériter. La métaphysique, telle qu'elle a page CLXXVII été conçue par bien des philosophes, se perd dans des subtilités qui révoltent le sens commun, autant au moins que les légendes religieuses peuvent blesser la raison philosophique. Rêveries d'une part, arguties de l'autre, il serait difficile de se décider si l'on avait à choisir; et il ne semble pas que la vérité profite beaucoup plus de celles-ci que de celles-là. Les attaques de la science contre la philosophie se justifient encore moins que celles de la religion, déjà si peu fondées. Jusqu'à un certain point, la religion peut se croire menacée ; et elle entrevoit, dans ses appréhensions, on ne sait quel fantôme de rivalité et de concurrence, espérance inoffensive de quelques utopistes. Mais la Science, que peut-elle craindre de la philosophie et de la Métaphysique? Quel mal pourrait-elle en éprouver? Et, au contraire, quels secours n'en peut-elle pas recevoir! Quels emprunts fructueux ne peut-elle pas leur faire! Quelle féconde alliance! La science ne devrait jamais oublier que. au début, elle a été réunie à la philosophie, ou plutôt qu'elle est née page CLXXVIII de la philosophie, de même qu'elle aura toujours dans la philosophie ses racines profondes. Le premier coup d'oeil jeté par les hommes sur le monde n'a pu leur l'aire voir, tout d'abord, que l'obscur ensemble et la totalité mystérieuse des choses. Comme on ne distinguait pas encore les parties, on ne percevait que le Tout. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'est venue l'observation des détails et des phénomènes particuliers. L'analyse s'est étendue de jour en jour, parce que le Tout est sans limites; mais évidemment la synthèse initiale, quelque imparfaite qu'elle fût, avait précédé l'analyse. La philosophie, qui est essentiellement synthétique, refait, à l'heure qu'il est, la synthèse qu'elle tentait dès ses premiers essais. Elle la recommencera perpétuellement, de même que les sciences poursuivront perpétuellement leur œuvre, accumulant de plus en plus les matériaux qu'emploient les synthèses universelles. Les deux écoles de philosophie les plus anciennes dans la Grèce, notre mère vénérée, ont été, l'une, une école de physiciens, celle de Thalès; l'autre, une école mathématique, page CLXXIX celle de Pythagore. C'est l'ensemble des choses que tous deux veulent expliquer, soit par les Nombres, soit par un élément matériel. Quelque dissemblable que soit leur explication, c'est sur l'univers et sur la totalité des êtres que Thalès et Pythagore ont les yeux fixés ; et c'est là ce qui les a rangés parmi les philosophes. dans les temps modernes, Descartes et Leibniz, que la science ne peut pas récuser, sont des savants et des mathématiciens; mais, par-dessus tout, ce sont des philosophes, et ils comptent parmi les plus illustres. A l'origine, la philosophie contient donc toutes les sciences dans son sein ; et si elle n'a pas désormais à les y ramener, elle peut, du moins, leur rappeler quelquefois d'où elles sortent, et à quel centre elles se rattachent. Avec la suite des temps et la suite des observations, les sciences, se multipliant, ont dû se séparer de la philosophie, et aussi, se séparer de plus en plus les unes des autres. La division était poussée déjà loin au siècle d'Aristote ; et lui-même a contribué beaucoup à l'accroître et à la régulariser. page CLXXX Depuis lors, le nombre des sciences s'est augmenté de jour en jour; et il s'augmentera sans cesse. Chaque siècle en a vu naître; et le nôtre n'a pas été moins productif que ceux qui l'ont précédé ; ceux qui le suivront le seront encore davantage. La subdivision, toujours croissante, a fait que les sciences perdent de vue leur berceau commun. Chacune d'elles tend à se renfermer plus étroitement dans son domaine propre, parce que, chaque jour, ce domaine devient plus vaste et plus riche. Une existence humaine ne suffit plus à parcourir une seule science ; bien mieux, l'étude d'une simple branche d'une science spéciale remplit la vie des plus laborieux observateurs, et fait la gloire des plus ambitieux. On se plaint souvent de cette dispersion et de cet éparpillement indéfini des sciences; on va même jusqu'à s'en effrayer. Quant à la philosophie, qui sait d'où vient ce mouvement inévitable et combien il est naturel, elle ne peut s'en inquiéter. Tant de conquêtes de détail ne doivent que servir à rendre l'ensemble des réalités moins inaccessible pour la science page CLXXXI générale, qui est la Métaphysique. Aristote, s'il lui était donné de refaire son ouvrage, parlerait aujourd'hui du système du monde d'après Copernic, Newton, Laplace et Leverrier, au lieu d'en parler d'après Eudoxe et Callippe, à propos du premier moteur. A cette communauté d'origine, qui est déjà un lien indissoluble entre la philosophie et la science, s'en joint un autre, plus intime : c'est la communauté de nature. La science, prise en soi et sans regarder à ses applications pratiques, est désintéressée autant que la philosophie peut l'être. Elle aussi ne recherche la vérité que pour la vérité; elle aussi veut savoir pour savoir. C'est son but supérieur et son but unique. Plus tard, et selon les besoins toujours renouvelés des sociétés humaines, selon les circonstances plus ou moins favorables, les arts, issus de la science, se chargent d'en tirer les conséquences matérielles; mais la nature de la science ne change pas pour cela; elle ne convoite aucun autre profit que d'enrichir, ou de modifier, le trésor des con- page CLXXXII naissances acquises. Sous ce rapport, la science pure se confond absolument avec la philosophie. Elles ne se distinguent entre, elles que par une différence de forme à peu près insignifiante, l'une se limitant à la spécialité d'un objet, l'autre s'efforçant à être complète et totale. Une autre ressemblance, c'est que la science ne vit pas plus que la philosophie, sans liberté et sans indépendance. Elle a les mêmes revendications, peut-être plus vives encore, quand ces deux biens, qui lui sont indispensables, viennent à lui être contestés. Quelles plaintes n'a pas soulevées le procès de Galilée ! Quels souvenirs, souvent exagérés, n'a-t-il pas entretenus dans la mémoire de tous les savants! On n'a point à s étonner de ces doléances, qui sont très justes. Pourtant, si l'on compare le sort de Galilée, en le supposant aussi déplorable qu'on voudra, avec le sort de Campanella, son contemporain, avec le sort de Jordano Bruno, de Vanini, et, dans l'Antiquité, avec celui de Socrate, on voit que le martyrologe de la science est bien doux à côté de celui de la philosophie. Mais, il ne s'agit point ici page CLXXXIII d'un parallèle d'héroïsmes et de supplices ; il suffit de savoir que la philosophie et, la science sont d'une nature tellement identique qu'elles ont à réclamer les mêmes droits, quand on les leur refuse, et qu'elles excitent les mêmes ombrages de la part de ceux qui veulent empêcher, l'une de démontrer le mouvement de la terre, et l'autre de discuter sur l'existence de Dieu. Peut-être les préventions de la Science contre la Métaphysique s'expliquent-elles , en grande partie, par celles qu'elle peut nourrir contre la Religion. Il est certain que, quand la Religion, sortant de sa sphère sacrée, empiète sur la science, qu'elle ne comprend pas, elle s'expose à des contradictions, qui peuvent tourner à sa confusion. Non seulement , elle est vaincue dans un litige qu'elle est incapable de soutenir; mais, en outre, son incompétence en fait de science est si flagrante qu'elle frappe ; les juges les plus bienveillants. Est-ce donc parce que la Philosophie première débat les mêmes questions que la Religion, que la Science l'enveloppe dans la récusation qu'elle oppose à la page CLXXXIV théologie? Ce n'est pas à la philosophie de répondre. La philosophie est la mère des sciences,comme Descartes l'a répété tant de fois; c'est elle qui leur montre d'où leur vient la certitude dont elles se piquent; elle aime ;elle les admire. comment la science pourrait-elle la tenir pour suspecte et surtout pour ennemie? La philosophie use, pour ses études, de procédés exclusivement scientifiques. Comme la science, elle observe elle constate des faits d'un certain ordre. Bien plus, c'est la philosophie qui a enseigné aux sciences la puissance et la nécessité de l'observation, longtemps avant que les sciences n'eussent appris à se soumettre à cette loi salutaire. Bacon se figurait, au XVIIe siècle, qu'il était le premier à découvrir la méthode d'observation, et qu'il faisait présent à l'esprit humain d'un instrument nouveau ; mais la plus légère lecture d'Aristote ou d'Hippocrate atteste qu'ils n'ont pas seulement observé, mais que, en outre, ils ont constamment recommandé l'observation, comme la seule voie qui puisse conduire au vrai. Encore une fois, d'où peut page CLXXXV venir le l'utile préjugé de la science contre la Métaphysique? Nous touchons au grand reproche, à celui qui résume tous les autres, et que tous les autres impliquent : « La métaphysique, dit-on, n'est pas une science ! » Et sur cet arrêt, peut-être un peu légèrement rendu, on exécute la Philosophie première, et on la voue dédaigneusement au ridicule, qui doit la tuer à jamais. Malgré ce jugement et cette condamnation sommaires, il faut continuer à soutenir que la Métaphysique est une science. Seulement, ce n'est pas une science comme une autre ; et c'est parce qu'on ne se rend pas assez compte de sa nature particulière, qu'on prononce contre elle cette sentence impitoyable, qui tend à lui ôter la vie, en lui ôtant tout sérieux. Néanmoins, en attendant d'autres preuves, est-il bien vraisemblable que des hommes tels que Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, pour ne citer que ceux-là, se soient mépris à ce point, et qu'ils n'aient couru toute leur vie qu'après de pures chimères? Est-il même beaucoup plus vraisemblable que les fonda page CLXXXVI leurs de religions, qui sont aussi des métaphysiciens à leur manière, se soient trompés du tout au tout, et que, en expliquant à l'homme ce qu'il est, d'où il vient, et le monde où il vit, ils n'aient donné à sa foi à la leur que l'appui d'un rêve? Enfin, genre humain, en croyant aux philosophes et aux chefs de ses religions, en les admirant et en les suivant docilement, n'a-t-il fait que marcher à l'obscurité, en s'imaginant qu'il marchait à la lumière? Sans doute, le genre humain, et ses instituteurs religieux, ne font pas œuvre de science. Mais les philosophes, qui portèrent les noms que nous venons de rappeler, n'avoir pas fait de science, tandis qu'ils ont été convaincus, pendant toute la durée de leur glorieuse carrière, qu'ils faisaient de la science la plus solide, et la plus utile! C'est là un paradoxe tellement surprenant qu'il semble à peine discutable. Réprouver tout ensemble, et le genre humain, elles religions, et la philosophie! Qui peut être assez sûr de soi pour se permettre une telle outrecuidance? Afin de savoir si la Métaphysique est une page CLXXXVII science, demandons-nous d'abord ce que c'est qu'une science. Toute science est un assemblage de faits, de même genre, que l'intelligence de l'homme recueille, et qu'elle classe, d'après leurs analogies et leurs ressemblances, pour les isoler de tous les autres phénomènes. La science est bien faite, quand les phénomènes qu'elle rapproche et coordonne sont effectivement rapprochés dans la nature, et qu'ils y forment un groupe, où les affinités sont assez évidentes pour que le doute sur leur liaison ne soit pas possible. Si les phénomènes d'abord recueillis ne sont pas suffisamment homogènes, la science s'épure peu à peu ; et, rejetant les plus disparates, elle se constitue, avec les faits semblables ou analogues, à peu près comme sont ces édifices bien construits, où toutes les pierres sont choisies de même dimension et de même espèce. La science, d'ailleurs, ne se demande pas comment elle acquiert la connaissance de ces phénomènes, qu'elle étudie, qu'elle analyse, et qu'elle scrute dans leurs moindres nuances. Sans réflexion, elle s'en rapporte, avec une foi page CLXXXVIII entière, au mouvement instinctif de l'intelligence et à la spontanéité de l'esprit, qui croit imperturbablement à la véracité de ses facultés, et en use, sans ressentir aucune de ces perplexités déplorables, que le scepticisme ne vient éveiller que bien postérieurement. Toute science, pour faciliter ses études, se fait des méthodes appropriées à son objet ; mais toutes ces méthodes particulière sont secondaires et superficielles, quelque sérieuses et efficaces qu'elles soient, parce que les sciences ne doivent pas remonter jusqu'au principe général de la connaissance, ou que si, par hasard, elles y remontaient, elles cesseraient d'être spéciales et entreraient alors sur le terrain de la philosophie. Ce terrain n'est interdit à personne ; mais une science n'y peut venir qu'en désertant le sien, et en cessant d'être ce qu'elle est. Si c'est là, d'une manière exacte, quoique bien concise, ce qu'est la science, considérée généralement, comment peut-on nier que la Métaphysique ne doive compter parmi les sciences? Elle a son objet spécial, aussi nettement déterminé que peu page CLXXXIX l'être un genre quelconque de phénomènes. Même, il faut dire que cet objet est mieux circonscrit et plus déterminé qu'aucun autre. Descartes nous l'enseigne, avec l'autorité qui entoure son grand nom. La pensée, repliée sur elle-même, est l'objet scientifique que la Philosophie première étudie, et qui lui fournit tous les faits qu'elle observe. Elle y trouve à la fois, par l'évidence, le critérium de toute vérité, et le fondement de toute certitude ; elle y trouve la notion de Dieu, de qui vient la pensée dans l'homme ; et la notion du monde extérieur, qui, tout aussi bien que la pensée, est réel et est œuvre divine. Un avantage incomparable qui appartient à la Métaphysique, c'est qu'elle n'a pas besoin de sortir de sa propre enceinte, comme le reste des sciences, pour avoir une méthode. L'esprit, en se prenant pour le sujet immédiat, et toujours présent, de son observation, trouve, dans la réflexion et dans la conscience, une lumière qu'aucune lumière du dehors ne peut égaler, et qui est le foyer de toutes les autres. Les phénomènes exté- page CXC rieurs peuvent avoir leur clarté et leur évidence relatives. Mais, pour eux, cette évidence ne peut jamais être que proportionnée et subordonnée à celle du dedans. Si donc la Philosophie première n'a pas de méthodes partielles, comme en ont les sciences analytiques, elle a la méthode qui éclaire et sanctionne tout le reste, sans aucune exception, méthode dont elle est seule à se servir, et qui est la base commune et essentielle de toutes les sciences, puisque, sans cette base, elles seraient contestables et caduques. Ôtez la méthode, telle que Descartes l'a entendue, il n'y a plus de science ; et c'est là ce qui a porté Descartes à déclarer que : « S'il y avait encore des hommes qui ne fussent pas assez persuadés de l'existence de Dieu et de leur Âme par les raisons qu'il en a apportées, ces hommes devaient savoir que toutes les autres choses dont ils se pensent peut-être plus assurés, comme d'avoir un corps et qu'il y a des astres et une terre et choses semblables, sont moins certaines (18). » CXCI Ce ne sont pas seulement Descartes, Spinoza, Leibniz et tous les métaphysiciens modernes, qui seraient étonnés d'apprendre que la Philosophie première n'est pas une science. Quelle surprise non moins grande ne ressentirait pas l'Antiquité tout entière, elle qui, si longtemps, n'a pas séparé le savant du philosophe, et qui les réunissait sous un même nom, dans une seule et même estime ! Aristote, qui n'avait point à répondre aux objections qu'on fait depuis peu à la Métaphysique, se pose, cependant, la question à peu près comme nous sommes obligés de nous la poser ; il la résout par quatre ou cinq arguments, plus forts les uns que les autres. Il est bon de les rappeler, en les résumant, pour édifier nos savants, à qui la Métaphysique inspire de si violentes répulsions. D'abord, selon lui, la science générale est plus science que la science particulière, parce que, quand on sait la généralité, on sait aussi, en une certaine mesure, tous les cas particuliers qu'elle comprend. En second lieu, la science générale est la plus rationnelle ; or, c'est surtout la raison qui fait page CXCII la science. Puis, s'adressant directement aux premiers principes, la science générale a plus de précision scientifique. Par suite, elle étudie les causes ; et par là, elle s'attache à ce qui peut être le mieux su, puisqu'on ne croit savoir une chose que quand on en connaît la cause. Enfin, la science générale recherche et donne le pourquoi des choses, ce qui est le vrai but de toute recherche scientifique (19). Sous des formes un peu différentes, n'est-ce pas ce que nous disons nous-mêmes? Et ne pouvons-nous pas joindre Aristote à Leibniz, à Spinoza, à Descartes? Oui, la Métaphysique est une science, ne craignons pas de le redire, puisqu'on l'accusera bien souvent encore de n'en être pas une. Il faut même oser la proclamer la plus scientifique de toutes les sciences, à cause de sa méthode, qui est absolument générale, à cause de son objet, qui est si nettement délimité, à cause des questions qu'elle traite, et qui embrassent toutes les questions possibles, attendu qu'il n'y en a pas en dehors de l'homme, du monde, et de Dieu. page CXCIII Mais, si la Philosophie première est une science, voici le caractère qui la distingue de toutes les autres sciences, bien qu'elle reste de leur famille. L'objet de la Métaphysique est intérieur, tandis que l'objet de toutes les sciences, quelle que soit celle qu'on veuille considérer, est extérieur. Dans la Métaphysique, la pensée reste en elle-même ; elle en sort partout ailleurs, et c'est une nécessité que toutes les sciences, hormis celle-là, subissent uniformément. Les Mathématiques elles-mêmes, tout abstraites qu'elles sont, n'échappent pas à cette loi ; elles empruntent encore quelque chose à la réalité extérieure ; elles ne sont pas complètement rationnelles. Il n'y a que la Métaphysique qui le soit, ainsi que voulaient le faire entendre Kant, par sa Raison pure, et Platon, par sa Dialectique. La portée de cette différence, entre la Métaphysique et les sciences ordinaires, ne saurait être exagérée ; elle n'a jamais été remarquée autant qu'elle devrait l'être. Si la science contemporaine s'y arrêtait davantage, elle ne se laisserait pas aller à proscrire la Philoso- page CXCIV phie première et à la bannir de son sein. La Philosophie première ne souffre en rien d'un exil immérité ; mais la vérité en souffre beaucoup ; la science se donne un tort et commet une erreur, qui la diminue, loin de la rehausser. A ce désaveu, il n'y a que deux explicalions possibles. Ou l'on croit que l'esprit ne peut pas s'observer lui-même immédiatement ; ou l'on croit que la science ne s'appuie que sur l'observation extérieure et suila sensation. Mais ces deux assertions sont également insoutenables et fausses. L'esprit s'observe lui-même plus facilement, et plus fréquemment, qu'il n'observe quoi que ce soit d'extérieur. Sans faire de la psychologie, tant redoutée, la science peut se convaincre de cette vérité, par les hésitations et par les doutes qu'elle éprouve constamment dans ses recherches, et qu'elle ne se fait pas faute de constater, toutes les fois qu'elle le croit nécessaire. L'esprit, pour ses œuvres les plus impersonnelles, doit à tout instant s'occuper de lui-même, à côté de l'objet étranger, qui l'occupe sans l'absor- page CXCIV ber. Loin que ce retour réfléchi soit une diversion et un obstacle, c'est, au contraire, un secours puissant et indispensable pour les sciences. Sans cet auxiliaire, elles ne feraient, pour ainsi dire, aucun progrès ; et puisque, dans toutes les sciences autres que la Métaphysique, l'esprit s'observe sans en avoir toujours la conscience expresse, les sciences ne peuvent refuser à la Métaphysique de faire directement et plus largement ce qu'elles font, elles aussi, dans une mesure moindre et d'une manière indirecte. Quant à soutenir que la science ne s'acquiert que par la sensation, c'est une erreur si vieille, et si souvent réfutée, que ce serait perdre son temps que d'y insister de nouveau. Les savants qui y croient encore, s'il en est, n'ont qu'à demander à une science des mieux faites, à l'astronomie, ce qu'elle en pense. « L'astronomie, qui, parla dignité de son objet et par la perfection de ses théories, se vante d'être le plus beau monument de l'esprit humain et le titre le plus noble de l'intelligence, se fait gloire de n'être plus séduite par les illusions des page CXCVI sens, d'avoir éliminé entièrement l'empirisme, et de s'être réduite à n'être qu'un grand problème de mécanique, où la plus profonde géométrie est nécessaire, mais où l'observation ne l'est plus (20).» Ce langage de l'astronomie peut être celui de toutes les sciences, et surtout des Mathématiques, dont les axiomes sont aussi rationnels, au moins, que la loi de la pesanteur universelle. L'astronomie, pour la solution de son problème, se contente, comme elle se plaît à le dire, de trois données arbitraires : Le mouvement des astres, leurs figures et leurs masses ; et, de ces trois données, elle tire la théorie de nombreux phénomènes que les cieux nous présentent, et prédit, sans même y regarder, toutes les révolutions qui s'y passent et doivent s'y passer. La Métaphysique n'en exige même pas tant; au lieu de trois arbitraires, une seule lui suffit; mais cette arbitraire est la pensée. Un des caractères essentiels de la science, c'est de pouvoir être enseignée ; Aristote en page CXCVII a fait la remarque, le premier. A cet égard encore, on peut affirmer que la Métaphysique est une science comme toute autre; elle s'enseigne ; et ce qui le prouve, c'est la constitution des écoles philosophiques, où les disciples apprennent ce que le maître peut avoir découvert ou observé. Seulement, les choses ne se développent point tout à fait dans la philosophie comme ailleurs; les générations n'accumulent pas d'observations nouvelles, qu'elles puissent joindre aux observations antérieures, procédé des sciences ordinaires. En philosophie, chaque génération reprend l'œuvre pour son propre compte; ou pour mieux dire, ce ne sont pas même des générations, ce sont des individus. Chaque philosophe fournit une carrière qui lui est personnelle. Tout au plus, peut-il mettre à profit l'exemple des prédécesseurs pour s'éviter quelques faux, pas, ou pour aplanir sa route; il doit la parcourir, comme si jamais elle n'eût été parcourue par personne avant lui. Mais c'est ici que les détracteurs de la philosophie croient l'accabler et qu'ils triomphent. Du moment page CXCVIII que la Métaphysique ne peut pas amonceler des faits les uns après les autres, on la juge digne d'ostracisme. est-ce une que la science qui ne peut se transmettre, et qui meurt avec celui qui l'a faite? Est-ce une science que celle qui n'a rien de définitivement acquis, et qui doit recommencer sans cesse un tissu sans cesse défait? L'objection peut sembler très sérieuse ; en réalité, elle ne l'est pas. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à interroger un des savants les plus illustres de notre siècle, celui que nous venons de citer, l'auteur immortel de la Mécanique céleste : « Il n'en est pas des sciences, dit-il, comme de la littérature ; celle-ci a des limites qu'un homme de génie peut atteindre, lorsqu'il emploie une langue perfectionnée. On le lit avec le même intérêt dans tous les âges ; et sa réputation, loin de s'affaiblir par le temps, s'augmente par les vains efforts de ceux qui cherchent à l'égaler. Les sciences, au contraire, sans bornes comme la nature, s'accroissent à l'infini par les travaux des page CXCIX rations successives (21). » La Métaphysique pourrait donc, sous la protection d'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, revendiquer une place à côté de la poésie; et cette place pourrait paraître encore bien belle, quand on songe à ce qu'est Homère. Mais par l'importance de son objet, par la sûreté infaillible de sa méthode, par la grandeur des résultats obtenus, tout individuels qu'ils sont, la Philosophie première ne peut pas être assimilée à un poème épique, quoique plus d'un métaphysicien se soit permis bien des licences d'imagination. Le philosophe fonde sa science personnelle et ses convictions, à peu près comme le poète chante, pour exprimer les émotions puissantes qui l'inspirent. Le poète n'en est pas moins grand, parce que, lui aussi, il travaille dans son individualité solitaire. Son œuvre transporte les hommes d'enthousiasme et d'admiration ; elle les charme à jamais, quand elle a su être belle et être vraie. L'œuvre du philosophe, en visant plus haut, page CC
agit de la même manière. Son influence s'exerce comme
celle de la poésie; il pense pour lui ; mais sa pensée, si ses
semblables l'acceptent, les éclaire et les conduit dans les sentiers
austères et lumineux de la conscience et de la réflexion. Si elle ne
charme pas, elle peut instruire, et, même, persuader. Il y a une foi
philosophique comme il y a une foi religieuse ; celle-ci s'appuie
sur le témoignage d'autrui ; celle-là s'appuie sur l'étude de la
conscience individuelle; et quand on voit dans l'histoire de
l'humanité la part immense qu'ont eue le Platonisme, le Stoïcisme,
et, de nos temps, la doctrine Cartésienne, on se tient pour
satisfait di rôle de la Métaphysique. Tout ce qu'on peut ambitionner
pour elle, c'est qu'elle continue, sans se lasser, à rendre au genre
humain des services aussi réels et aussi relevés. Le genre humain
reconnaissant a toujours trouvé, et trouvera toujours, que la
croyance à l'existence de Dieu, à la spiritualité et à l'immortalité
de l'âme, au libre arbitre, confirmée et démontrée par la
philosophie, vaut toutes page CCI les sciences ont faites et peuvent faire.
Les savants devraient donc traiter la Métaphysique un
peu. mieux qu'ils ne le font d'ordinaire; et ne pas nier, sans
examen, qu'elle soit une science. Mais ce qui excuse leur méprise,
au moins en partie, c'est qu'ils n'en sont pas seuls responsables,
et qu'ils ont rencontré des complices dans le camp qu'ils attaquent.
Parmi les philosophes, il en est qui, se trompant comme les savants,
ont prétendu faire de la philosophie une science naturelle. A leurs
yeux, ce pourrait être pour elle une gloire longtemps attendue, et
même une réhabilitation, si elle voulait bien se livrer, après tant
d'écarts, à de patientes et véridiques observations, qui se
transmettraient de siècle en siècle, et qui constitueraient enfin un
système régulier et réellement scientifique, destiné à se développer
d'âge en âge. A en croire ces réformateurs timorés, la philosophie
n'auraitguère fait jusqu'à ce jour que s'égarer ; elle serait hors
du droit chemin ; et ce serait aux page CCII être pas très neuve, et l'on pouvait la restituer à Locke et à l'École Écossaise, qu'on prenait pour guides. Mais cette réforme devait réussir moins encore que celle de Kant. Notre siècle a eu le bon esprit de ne pas s'y laisser prendre. Tout en pensant que la philosophie est une science, il a très bien senti qu'elle ne peut pas être une science naturelle, au sens habituel de ce mot, et qu'elle périrait tout entière, si on la soumettait à des conditions qui l'altèrent essentiellement.
Dans les sciences naturelles, le contrôle est
toujours possible. L'.objet extérieur que chacune d'elles étudie, ne
change pas. Toujours le même dans la nature des choses, on le
retrouve dès qu'on veut , avec son immuabilité invariable ; c'est là
ce qui permet d'accumuler les observations et de les vérifier. page CCIII pour les autres. La faculté de la conscience est bien la même pour nous tous ; et la perdre, c'est cesser d'être homme. Mais l'emploi de cette -faculté varie avec chacun de nous, d'un individu à un autre individu. La conscience de Spinoza ne voyait pas les choses sous le même jour que la conscience de Descartes, ou celle de Leibniz. Lequel d'entre eux a le mieux vu la vérité? C'est au genre humain de décider, comme il décide entre les religions, en embrassant les unes et en repoussant les autres. La seule différence, c'est que, pour les religions, ce sont des multitudes innombrables et sans lumières, qui cèdent à leur irrésistible et sublime instinct, tandis que, pour les philosophies, les esprits réfléchis qui les créent, ou qui les adoptent, sont nécessairement en très petit nombre. Mais, c'est l'élite. La philosophie peut le dire sans immodestie, puisque, parmi les siens, elle compte en même tempsun esclave, dans Épictète, et le maître dumonde, dans Marc-Aurèle. Voilà donc en quel sens la Métaphysique est une science, et en quel sens elle ne l'est page CCIV pas. Par les labeurs qu'une croyance philosophique demande à celui qui veut se la faire, par la clarté incomparable qu'il trouve en cette croyance, par la certitude absolue qu'elle a pour lui, par les conséquences que sa raison en tire, c'est une science, qui n'est pas seulement l'égale de toutes les sciences dites exactes, mais qui leur est infiniment supérieure, parce qu'on croit à soi-même bien plus encore qu'on ne croit au monde sensible. Mais, d'autre part, la Métaphysique n'est point une science, en ce sens qu'une doctrine ainsi formée ne s'impose pas comme les faits attestés par la sensation s'imposent à qui veut les observer. On acquiesce, ou l'on résiste, aux faits de conscience observés par un autre, selon qu'on les retrouve, ou qu'on ne les retrouve pas dans sa propre conscience. Mais des croyances, instinctives ou réfléchies, qui obligent les peuples et les individus aux derniers sacrifices, peuvent passer pour aussi certaines, au moins, que les observations scientifiques les plus précises et les mieux constatées. Descartes a cru faire de la science dans son page CCV Discours de la Méthode et dans ses Méditations, plus encore que dans sa Géométrie et dans sa Dioptrique. Mais dira-t-on, c'est revenir à l'erreur de Protagore , si bien réfutée par Aristote; à l'exemple du Sophiste grec, c'est faire de l'homme la mesure de tout. Qu'on se rassure ; il n'en est absolument rien ; et si la philoophie devait aboutir à cet absurde et dangereux système, devenu son dernier mot, elle mériterait les anathèmes et les critiques, dont elle a été trop souvent l'objet. Le tort de Protagore n'a pas été de penser que les choses, pour chacun de nous, sont ce qu'elle nous paraissent. Cela est aussi vrai que de dire de chacun de nous qu'il a sa physionomie et son caractère propres. Mais la faute très grave grave de Protagore, c'était de soutenir qu'il il n'y a rien de vrai ni de faux, et qu'on peut en morale tout aussi bien que dans les sciences, adopter indifféremment le pour et le contre. La philosophie est si loin de croire,avec le Scepticisme, qu'on puisse, à titre égal, tout affirmer ou tout nier, qu'elle prétend, au contraire, qu'il existe une vé- page CCVI rité éternelle et indéfectible, éclatante, infinie, dont l'homme, quelque faible qu'il soit, peut recueillir des rayons, dont la découverte successive , quoique toujours incomplète, est son privilège et sa gloire, et qui doit servir à éclairer son esprit, et à régler sa conduite dans ce monde, pour qu'il y soit de plus en plus en harmonie avec l'ordre universel, où il a été placé pour l'admirer, et où il vit un instant. L'homme est si peu la mesure des choses qu'il serait bien plutôt mesuré par elles ; sa valeur s'accroît avec l'intelligence qu'il en a; les plus grands des humains sont ceux qui les ont le mieux comprises. Notre esprit ne fait pas les choses, ainsi que le suppose un idéalisme intempérant ; mais il s'associe à elles, en les connaissant; et il ne les connaît qu'en l'observant, et en appliquant à cette étude ses facultés presque divines. Sous la doctrine de Protagore et de nos idéalistes modernes, il se cache un orgueil, que la philosophie n'est pas tenue de ressentir. Plus elle pénètre dans les mystères et les profondeurs de la nature, plus elle est portée à déplorer l'in- page CCVII firmité de l'homme, au lieu d'exalter sa puissance, outre mesure. De toutes parts aux prises avec l'infini, le savoir humain s'annule et disparaît, à peu près comme, dans les Mathématiques, toutes les quantités, quelque grandes qu'elles puissent être relativement et entre elles, s'évanouissent, quand on les compare à l'infini, qui les réduit à zéro. L'humilité n'est pas même une vertu pour la philosophie ; c'est une nécessité; il y a bien longtemps qu'elle s'est dit que, plus on sait, plus on sent tout ce qu'on ignore. Reste une dernière objection que l'on élève quelquefois au nom de la science contre la philosophie première. Mais celle-là n'atteint pas uniquement la Métaphysique ; à y bien regarder, elle frappe également la Science, qui s'en sert, sans la bien comprendre, et elle la frappe mortellement. Cette objection, qu'on croit formidable, la voici : « L'homme, assure-t-on, ne peut savoir les causes des phénomènes; il ne peut qu'en constater les lois. » On en conclure que, cherchant par-dessus tout à connaître les page CCVIII causes, y compris la cause universelle, la Métaphysique doit, plus docilement encore que les autres sciences, se soumettre à cette décision, qui la ruine et la détruit. Sans la notion de cause , la Philosophie première est sans objet. Aristote ne se trompait pas, quand il attachait tant d'importance à sa théorie des quatre causes ou principes. Mais c'est la science qui se trompe, quand, sur les pas de Hume, elle ne veut voir dans les phénomènes extérieurs qu'une simple succession, et qu'elle nie toute relation de cause à effet. La science ne s'aperçoit pas qu'en d'autres termes, elle rapporte tout au hasard, et bannit de l'univers toute intervention de cause finale. C'est rendre l'univers parfaitement inintelligible. A cette opinion, qui est si peu scientifique, bien que soutenue par des savants,il faut opposer encore celle de Laplace, un des génies dont les sciences peuvent le plus justement s'honorer. En terminant son Exposition du Système du monde et après avoir célébré Newton, il ajoute : « Des phénomènes aussi extraordinaires ne sont point dus à des causes page CCIX irrégulières. En soumettant au calcul leur probabilité, on trouve qu'il y a plus de deux cent mille milliards à parier contre un qu'ils ne sont point l'effet du hasard ; ce qui forme une probabilité bien supérieure à celle de la plupart des évènements historiques, dont nous ne doutons point. Nous devons donc croire, au moins, avec la même confiance, qu'une cause primitive a dirigé les mouvements planétaires (22). »
Ainsi, Laplace ne s'effraie pas, comme d'autres
savants, de trouver une cause aux phénomènes, dont mieux que
personne il avait établi les lois. En cela, il n'est pas seulement
d'accord avec Newton et Descartes, il est également d'accord avec le
sens commun, et avec le genre humain, qui, sans s'arrêter à des
scrupules sophistiques, croit fermement qu'il y a des causes, dans
le monde, page CCX instinctivement cette notion aux phénomènes du dehors, qui, sans cette condition, demeurent absolument inexplicables pour lui. Mais on a réfuté tant de fois déjà, et si victorieusement, le paradoxe de Hume, qu'il est inutile d'insister. Désormais, il est sans autorité auprès de tous les esprits un peu sages ; il faut le laisser, comme un passe-temps et un jouet, aux mains des savants qui croient encore pouvoir s'en servir, tout usé qu'il est. La science antique avait pensé qu'on ne sait une chose que quand on en connaît la cause ; tenons-nous en à cet axiome que rien ne peut démentir, et qui vaut toujours pour nous ce qu'il valait pour les Anciens. La Métaphysique peut, en toute sécurité, se livrer à la recherche des causes, ainsi qu'elle l'a fait et qu'elle doit toujours le faire. Bien qu'il ne soit pas donné à l'homme de savoir la totalité des causes, comme il le voudrait. il en connaît assez sur lesquelles il ne se trompe pas, à commencer par celle qui constitue son libre arbitre. pour être assuré de son pouvoir, et pour repousser les conseils pusillanimes. Refuser page CCXI à l'homme la connaissance des causes est une autre forme de scepticisme ; et sur cette pente, si la science s'y laissait entraîner, elle en arriverait bientôt au suicide moral que le Scepticisme n'évite jamais. La Métaphysique ne peut-elle pas adresser à la science cet avis, en retour de ceux que la science veut bien lui donner quelquefois ? La religion et la science sont donc à peu près aussi peu bien bienveillantes l'une que l'autre pour la Métaphysique, par haine ou par dédain. Mais qu'elles aient tort ou qu'elles aient raison, il se trouve qu'elles sont également impuissantes. La philosophie n'a été étouffée, ni par les persécutions, dont, au reste, elle ne se plaint guère, parce qu'elle plaint davantage les persécuteurs, ni par les railleries de la science et de la foule. En fait, elle a poursuivi et poursuivra son œuvre, parce que l'esprit humain ne cessera jamais de vouloir élucider et résoudre de tels problèmes. Ce besoin inextinguible, qu'on peut blâmer, mais qu'on ne saurait nier, garantit à la Métaphysique sa durée, en même temps que sa force bienfaisante. Du page CCXII moins, la religion, en lui contestant son droit, par un sentiment peu généreux de jalousie, ne conteste pas l'importance suprême des questions débattues ; elle tendrait plutôt à l'exagérer. Mais que penser de la science, quand elle n'entend admettre d'autre compétence que la sienne, et quand, perdue dans les détails d'une analyse sans fin, elle veut qu'on oublie l'ensemble, qui seul donne à ces détails une place et un sens? On peut toujours, et souvent à bon droit, critiquer les métaphysiciens et leurs systèmes ; mais critiquer la Métaphysique, c'est une aberration inconcevable. Un obstacle qui est beaucoup plus sérieux que ceux-là, sans être insurmontable cependant, c'est la nature même des études philosophiques. Ouverte à tous, aussi bien que le reste des sciences, la philosophie semblerait plus abordable qu'aucune d'elles, puisque chacun de nous porte en soi tous les éléments qui la forment : « Les Dieux, dit Sénèque, dans une de ses Lettres admirables au jeune Lucilius, n'ont concédé à personne la connaissance spontanée de la page CCXIII philosophie ; mais ils ont accordé à tout le monde la faculté de l'acquérir. S'ils eussent rendu ce trésor plus commun, si nous naissions avec la sagesse, elle perdrait le plus précieux de ses avantages, celui de n'être pas un effet du hasard. Ce qu'elle a de plus grand et de plus estimablé, c'est qu'elle n'est point donnée naturellement à l'homme ; c'est qu'on ne la doit qu'à soi-même, et qu'on ne peut l'emprunter d'autrui (23). » Comment se fait-il donc que, dans le cours entier des âges, si peu d'hommes se livrent à la philosophie? On se l'explique en considérant les nécessités de la vie ordinaire, toujours pressantes et toujours renouvelées. L'immense majorité des hommes est soumise, même chez les peuples les plus civilisés, aux incessants labeurs, sans lesquels l'existence matérielle leur serait impossible. Quand, devenue plus facile pour quelques-uns, elle leur permet un choix du loisir, ceux-là sont encore subjugués par les passions, par les intérêts, par les motifs de toutes sortes, qui les enchaînent page CCXIV aux objets du dehors, sans qu'ils songent, un seul instant, à ramener leurs regards distraits sur leur intelligence et sur leur raison (24). Le spectacle extérieur est si attrayant et si dominateur, qu'on s'y livre sans réserve; et le spectacle interne, qu'on néglige, s'obscurcit, et s'éclipse, comme s'il n'était pas. Pour les hommes qui, en nombre infinie, s'approchent de la philosophie, la difficulté est différente , mais elle n'est pas moins ardue. Platon la signalait déjà, en traçant le portrait du philosophe, au VIe livre de la République. Aujourd'hui, cette difficulté est restée, pour nous, la même qu'elle était aux plus beaux temps de la Grèce. Voici les qualités principales que Socrate veut trouver dans les élèves qu'il destine à la philosophie, à la dialectique, à la vertu, et au gouvernement de l'État. Selon lui, pour cultiver avec succès la science de l'éternel et de l'immuable, il faut avant tout aimer passionnément le vrai et haïr le mensonge, sous page CCXV quelques couleurs qu'il se dissimule. Pour que l'âme puisse se consacrer sans partage à cette virile contemplation, il faut, en outre, qu'elle soit au-dessus des exigences déraisonnables du corps,et qu'elle fuie ses dangereux plaisirs. Tempérante, désintéressée, magnanime, incapable d'aucun sentiment bas, courageuse, sans crainte de la mort, juste et douce, telle doit être l'âme du futur philosophe. Est-ce là tout? Non ; Socrate désire encore quelques qualités qui tiennent davantage à l'intelligence : une grande facilité à apprendre, une heureuse mémoire qui garde tout ce qu'on lui confie, et enfin la grâce de l'esprit, qui sache faire accepter les vérités, que le philosophe recommande à l'examen de ses semblables. On le voit, c'est demander beaucoup, bien que ce ne soit pas demander plus qu'il ne convient ; et, comme la nature humaine ne change point, la possession complète de tant de qualités éminentes est un trésor, qui est très rare, aussi bien de nos jours qu'au temps de Socrate et d'Alcibiade. De ces qualités, les unes peuvent être acquises ou page CCXVI développées ; les autres sont des dons du ciel, auxquels l'homme ne peut rien que de savoir en user, quand il les a reçus de la faveur des Dieux. Mais ces difficultés, trop réelles, qui s'opposent à la culture de la sagesse, ne doivent nous causer, ni découragement, ni désespoir ; elles sont bien plutôt un aiguillon pour les âmes vigoureuses et sincèrement amies du bien. Plus la philosophie coûte de peine, plus elle doit être chère à ceux qui parviennent, sinon à réaliser l'idéal dont Platon même détourne ses regards, du moins à ne pas trop le défigurer. La philosophie, d'ailleurs, peut voir qu'elle n'est pas seule astreinte à cette loi sévère. Les vertus qu'elle réclame sont en très grande partie celles que toutes les sciences, sous leurs diverses formes, réclament presque aussi impérieusement. Les qualités de l'intelligence, celles même du cœur et de l'âme, ne sont guère moins indispensables au savant qu'au philosophe. Seulement, lorsqu'on étudie la pensée, on est plus près de Dieu et de l'infini que quand on observe le monde extérieur. Mais si l'infini et le divin page CCXVII écrasent l'homme presque jusqu'à l'anéantir, ils le soutiennent aussi ; et, parmi les sciences les plus belles, il n'en est pas une qui nous élève, nous éclaire et nous satisfasse, aussi pleinement que la philosophie, par son étendue et par sa certitude. Sans doute, c'est concevoir une bien grande idée de l'homme que de le trouver capable de raison, de vertu, et de sagesse. Mais cette estime, quelque haute qu'elle soit, est-elle fausse ? Et quand on considère l'homme, dans l'exercice de ses facultés les plus puissantes, sans s'arrêter aux imperfections, peut-on surfaire son incomparable dignité? La plus simple observation, le moindre retour de l'intelligence sur elle-même, témoignent que c'est un être à part que celui qui se connaît ainsi, qui peut connaître à peu près aussi bien les autres êtres, et qui, par sa raison, communique avec le principe universel des choses. L'homme, exclusivement, jouit d'une faculté qui lui révèle le vrai et le faux, le bien et le mal ; et ce don prodigieux en fait une nature supérieure, distincte de toutes les autres dans le page CCXVIII monde entier, une nature qui n'a de ressemblance et d'analogie qu'avec celle de Dieu. Cette grandeur, cependant, passe pour une illusion de la vanité humaine auprès de quelques savants de notre siècle ; et ils s'efforcent, plus témérairement peut-être qu'on ne l'avait fait avant eux, de confondre l'homme avec les animaux et de l'abaisser au niveau de la bête. Triste spectacle que nous offre la science, quand elle veut prouver à l'esprit humain, en se dégradant elle-même, que la science n'est en lui rien de plus que l'instinct dans la brute ! Mais l'humanité ne se laisse pas convaincre ; elle résiste, appuyée sur la religion et sur la philosophie ; et cette doctrine monstrueuse, qui peut troubler quelques instants le domaine des sciences, n'est pas aussi près de triompher qu'elle l'espère. Elle s'est déjà produite sans succès à plusieurs époques; et, bien qu'elle se présente avec un nouvel appareil scientifique, elle ne prévaudra pas davantage aujourd'hui. On ne conteste pas que l'homme, par son corps, ne soit un animal. L'histoire natu- page CCXIX relle doit le classer parmi les animaux ; qui en doute? Mais le corps est la moindre partie de l'homme. C'est l'âme, la raison, l'intelligence, qui sont l'homme proprement dit. L'âme n'appartient qu'à l'homme tout seul, tandis que le corps lui est commun, sauf des différences superficielles, avec une multitude d'êtres, dont quelques-uns sont même, sous ce rapport, bien plus parfaits que lui. On n'attend pas que les savants s'en rapportent aux philosophes, qui n'ont cessé d'accumuler sur ce sujet capital les démonstrations les plus décisives. Mais les savants devraient en croire les naturalistes, et à leur tête, Buffon, le plus grand de tous. Après avoir décrit l'âme de l'homme, en traits dlignes de Descartes, Buffon s'écrie, avec une indignation qui rappelle celle d'Aristote contre le Scepticisme : « Pourquoi vouloir retrancher de l'histoire naturelle de l'homme l'histoire de la partie la plus noble de son être ? Pourquoi l'avilir mal à propos, et vouloir nous forcer à ne le voir que comme un animal, tandis qu'il est, en effet, d'une nature très différente, page CCXX très distinguée, et si supérieure à celle des bêtes, qu'il faudrait être aussi peu éclairé qu'elles le sont, pour pouvoir les confondre?» Puis, Buffon montre les différences qui le frappent : La domination et l'empire de l'homme sur les animaux; le langage qui tient à la pensée, que nous seuls possédons, et non aux organes corporels, complets chez quelques êtres autant qu'ils peuvent l'être en nous ; le progrès illimité de l'intelligence humaine en face de l'immuabilité de l'instinct, que ne perfectionne pas la réflexion ; le mécanisme purement matériel de l'animal, et l'immatérialité de notre âme, douée de libre arbitre. Buffon en conclut que « la nature, qui marche toujours et agit en tout par degrés imperceptibles et par nuances, se dément ici par une exception unique, et qu'il y a une distance infinie entre les facultés de l'homme et celle du plus parfait animal (25). » Cuvier, le Buffon du XIXe siècle, en dit autant d'un seul mot, en signalant l'hiatus page CCXXI infranchissable » que la nature a creusé entre l'animal et nous. Dans l'Antiquité grecque, cette controverse déplorable n'avait pas été soulevée, ou du moins, elle n'a pas laissé de traces, si jamais les Sophistes l'ont suscitée, au milieu de tant d'autres, paradoxales et erronées ainsi que celle-là. Socrate, dans le Phèdre, ne se trouve pas assez de loisirs pour écouter les subtilités des Mythologues ; et, fidèle au précepte de l'oracle de Delphes, il ne s'occupe que de lui-même, «en cherchant « à démêler si l'homme est, en effet, un monstre plus compliqué et plus furieux que Typhon, ou un être plus doux et plus simple, qui porte l'empreinte d'une nature noble et divine. » Aristote n'a pas eu l'occasion, à ce qu'il semble, de se prononcer dans ce débat, qui l'eût bien surpris. Mais le ler livre de sa Métaphysique nous prouve comment il l'eût résolu, et quel cas l'inestimable il fait du seul être à qui la nature ait inspiré la passion du savoir. Le Stoïcisme a une si magnifique idée du sage, qu'il en fait le coopérateur de l'ordre universel, l'ami, page CCXXII et presque l'égal de Dieu. les poètes, même les plus légers comme Ovide, célèbrent la supériorité de l'homme comparé à toutes les créatures qui rampent sur la terre. Pline, le naturaliste, après avoir déploré la faiblesse de l'homme, Nudum in nuda humo, ne tarit pas sur les œuvres merveilleuses de son intelligence. Sénèque est encore plus éloquent et plus profond, sur ce sujet inépuisable. Au même temps, le Christianisme vient apporter pour jamais dans le monde une telle opinion de la nature de l'homme, qu'il ne croit pas pouvoir le sauver autrement que par le sang d'un Dieu. Mais la science contemporaine répudie tous ces témoignages et l'on dirait que, plus ils sont anciens nombreux, vénérables, plus elle se plaît les braver. La philosophie est essentiellement engagée dans cette question, que, du reste, elle a quelque peine à prendre au sérieux. Si l'homme n'est qu'un animal comme tout autre, sauf peut-être qu'il est un peu plus intelligent, s'il n'est pas l'être raisonnable, moral, et libre, qu'il se croit, et qu'il a tant de page CCXXXIII motifs de se croire, que devient alors la philosophie, elle qui se flatte de ne se fonder que sur la pensée et de ne suivre que la raison? Elle ne fait donc qu'étudier et analyser un être imaginaire ! Mirage, dont elle est dupe depuis qu'elle est née parmi les hommes ! C'est donc un songe et un nuage qu'elle embrasse, et qu'elle peut encore moins saisir aujourd'hui que dans le passé, qui l'a déjà tant déçue ! La philosophie, la Métaphysique n'existe donc pas! Il est temps enfin que l'esprit humain renonce aux hochets, qui ont pu amuser son enfance ignorante, mais qui déshonorent son âge mûr ! Par bonheur, c'est la philosophie qui, étant la plus compromise clans cette menace de déchéance, peut aussi opposer le plus péremptoire de tous les arguments à ces contempteurs de l'humanité, à ces partisans de la brute, flattée par eux à nos dépens. Parmi les plus audacieux et les plus aveugles, qui oserait soutenir que la loi morale, qui régit l'homme, se retrouve dans les animaux, qu'elle est en nous, telle que la philosophie la proclame? Qui oserait se jouer à ce page CCXXIV point, et de la vérité, et de ses semblables, et de lui-même ? La morale, quand elle s'efforce de guider les pas chancelants de l'homme, dans sa carrière d'ici-bas, est plus encore que la Métaphysique, précieuseà la philosophie ; elle est la pratique de la vie, tandis que la Métaphysique n'en est que l'explication. Bien des facultés, communes à l'espèce humaine, subsistent dans l'animalité. Sensation, mémoire, intelligence, passions, la bête a tout cela, comme nous l'avons. Mais prétendre qu'elle a aussi le discernement du juste et de l'injuste, la conscience du bien et du mal, lui prêter les luttes qui nous déchirent, mais qui nous ennoblissent, lui prêter les infinies délicatesses du sentiment, les sublimités de la pensée, les triomphes magnanimes de la vertu, l'héroïsme du sacrifice, c'est un outrage gratuit qu'on s'inflige à soi-même. C'est un don plus gratuit encore qu'on fait à l'animal, à qui la nature l'a si évidemment refusé. Le rival qu'on veut créer à l'homme n'est pas un rival ; c'est un esclave, qui a toujours docilement servi son maître, et qui ne secouera jamais page CCXXV ce joug légitime, en dépit des encouragements qu'on lui prodigue. Trop souvent, la loi morale est obscurcie ou faussée en nous, par nos fautes ou nos passions. Mais, en soi, elle est quelque chose de si auguste et de si sacré que la philosophie elle-même, en la contemplant, se sent troublée et confondue, comme l'homme le serait en présence de Dieu. Lorsque Kant, près avoir tout détruit en psychologie et en logique, veut tout rétablir par la morale, il s'arrête devant l'idée du Devoir ; et, saisi l'un enthousiasme que d'habitude la Critique ne ressent guère, il ne peut retenir ses exclamations : « Devoir, mot grand et sublime, toi qui n'as rien d'agréable, ni de flatteur, et qui commandes la soumission, sans employer, pour mouvoir la volonté, des menaces qui ne pourraient qu'exciter l'aversion et la terreur, mais en te bornant à proposer une loi qui s'introduit dans l'âme et la force au respect, sinon toujours à l'obéissance, et devant laquelle se taisent tous les penchants, quoiqu'ils travaillent sourdement contre elle. De- page CCXXVI voir, quelle origine est digne de toi? Où trouver la racine de ta noble tige? » Puis Kant ajoute : « La majesté du devoir n'a rien à démêler avec les jouissances de la vie ; elle a sa loi propre ; elle a aussi son propre tribunal (26). » Les racines de la loi morale ne sont peut-être pas aussi éloignées, ni aussi cachées que Kant paraît le penser. Ce n'est pas l'homme qui a fait la loi morale, puisqu'il ne peut l'abolir, quelque désir qu'il en ait, quand elle le condamne aux tortures d'une existence pire que la mort. Mais une loi suppose nécessairement un législateur; et, ici, le législateur tout-puissant et souverain ne peut être que Dieu. C'est donc à Dieu, directement, que nous rattache la loi morale, dont nos législations ne sont jamais qu'un pâle reflet et un insuffisant écho. Admettre par une hypothèse invérifiable que les animaux sont, aussi bien que nous, éclairés de ces lumières surhumaines, et qu'ils se conduisent à cette splendeur, c'est un roman qui peut CCXXVII naître dans les imaginations orientales, mais qui, dans notre Occident,. devrait faire rougir les savants, qui se piquent de si bien observer les choses. Est-il un seul fait qui prouve que la loi morale produise dans la bête les effets qu'elle produit chez l'homme? Tous les faits sans exception, ne prouvent-ils pas absolument le contraire? Mais la loi morale n'est pas seulement une barrière insurmontable entre l'homme et la brute; c'est encore elle, et elle seule; qui fait que l'homme a une destinée, tandis que les autres êtres n'en ont point, ou que, s'ils en ont une, noms ne la connaissons pas. Chacun de nous peut s'assurer dans cette vie, et se préparer pour l'autre, un destin, qui dépend de notre libre arbitre. Dans la mesure où la Providence l'a voulu, nous pouvons accomplir la loi morale ou la violer; nous pouvons obéir à la voix de la raison, qui s'adresse à notre conscience, ou y rester sourds. C'estla condition. de l'homme, Pleine de grandeur ou de bassesse, selon qu'il se soumet, ouqu'il se révolte, selon qu'il permet la prédominance à l'un des deux principes dont il page CCXXVIII composé. C'est cette lutte du bien contre le mal en nous, qui nous conquiert la part de mérite moral que nous pouvons avoir. Ce sont les alternatives et les péripéties de ce combat secret qui forment tout le tissu de notre existence vraiment humaine et raisonnable. Mais, que l'homme ait obéi à la loi ou qu'il l'ait enfreinte, ne doit-il pas en rendre compte à celui qui l'a faite, sans lui, et qui est l'infaillible témoin de ce qui se passe dans les profondeurs insondables du cœur humain? Les lois que les nations se donnent, ne punissent que les fautes les plus grossières, les plus nuisibles elles plus apparentes ; les coupables qu'atteignent les lois écrites sont des exceptions dangereuses, auxquelles les sociétés doivent infliger un châtiment immédiat. Mais, nous avons beau être innocents devant un tribunal infiniment plus délicat et plus éclairé que les nôtres, nous n'avons pas moins à y comparaître, pour que le suprême législateur juge, dans son équité, jusqu'à quel point nos âmes ont observé sa loi, ou l'ont méconnue. Pensée et conscience dans l'homme, loi page CCXXIX
morale qui s'impose; nécessité d'un législateur de
qui vient cette loi souveraine, nécessité non moins certaine d'un
jugement, croyance à Dieu et à sa présence en nous, plus encore. que
dans le reste de l'univers; ce sont là les titres de noblesse de
l'homme ; ce sont là autant de phénomènes divins, qui ne se
produisent qu'en lui, et qui sont « attachés et liés entre eux par
ces raisons de fer et de diamant » dont Platon et Socrate parlent
dans le Gorgias (27). Ceux qui
les C'est à expliquer cette énigme que se consacre la Métaphysique. Mais ces problèmes sont d'un tel ordre, ils sont d' fine telle im- page CCXXX portance que nous ne pouvons nous en remettre à personne du soin de les résoudre à notre place. C'est à chacun de nous individuellement qu'il appartient d'en chercher la solution, en se garantissant, le mieux qu'il peut, des égarements de sa raison ou des faiblesses de son cœur. C'est ce sentiment plus ou moins réfléchi, ce besoin de s'entendre avec soi-même et de se connaître, qui a poussé vers la philosophie tant d'esprits admirables, et qui ne cessera d'y pousser à jamais tous ceux qui seront aussi indépendants, et aussi sincèrement amoureux du vrai. On ne sortira pas de ce dilemme : ou la vie de l'homme a un sens, ou elle n'en a pas. Si la vie n'a pas de sens, nous n'avons, en effet, qu'à nous livrer à tous nos instincts, moins sûrs que ceux des brutes; ou, si la vie signifie quelque chose, notre premier devoir est d'étudier ce que nous sommes, et quel destin est le nôtre. Ici , nous rencontrons un redoutable écueil, que la philosophie même n'a pas toujours su éviter, et sur lequel se sont brisées presque toutes les religions : c'est la super- page CCXXXI stition. Entre les deux extrêmes, qui consistent, l'un à ne sentir dans les événements de la vie rien qui les explique, et l'autre à donner aux moindres incidents une signification pieuse, il y a un moyen terme. C'est à la raison de découvrir cette juste mesure, qui est, à ce qu'il semble, bien difficile à garder, puisque les plus sages ne l'ont pas toujours connue. Le plus accompli des modèles à qui l'humanité puisse vouer ses respects et son imitation, Socrate, entend une voix qui lui parle surnaturellement, pour lui prescrire, ou lui défendre, les actes les plus indifférents ou les plus graves. Se croire l'objet préféré d'une sollicitude toute particulière de la Providence, vient de notre égoïsme, si ce mot sévère peut s'appliquer à une âme comme celle du sage Athénien. Dans l'Antiquité, il n'est pas un grand homme qui n'ait été superstitieux, autant que lui et plus que lui. Les faits de tout genre abondent dans l'histoire pour nous montrer jusqu'à quel point les Anciens ont cédé à ce penchant naturel, que n'ont pas même accru les siècles qui ont suivi la dispa- page CCXXXII
Tel est le résultat dernier auquel aboutit tout l'effort de l'esprit humain, depuis ces philosophies incertaines et confuses où l'homme sait à peine se distinguer de tout page CCXXXIII ce qui l'entoure, jusqu'à ces philosophies lumineuses et vraies, où il est en pleine possession de lui-même, et où il analyse, avec admiration et reconnaissance, les étonnantes facultés de son âme. Apprendre à l'individu, non pas précisément ce qu'il est, mais lui apprendre à le savoir par lui-même et pour lui-même, dans une absolue indépendance, voilà le sérieux et perpétuel service que nous rend la philosophie. Chez bien des peuples, pendant de longues périodes de temps, dans des races entières, elle n'a pu que bégayer. Dans toute l'Asie, depuis la Chine jusqu'à l'Inde, à la Perse et au monde musulman, ses essais sont informes; et il est peu probable que, dans ces pays, au sein de ces nations, d'ailleurs très bien douées à quelques égards, la philosophie puisse jamais prendre un développement qu'elle n'a point connu dans le passé, qu'elle est incapable de se donner spontanément chez ces peuples, et qu'elle ne pourra peut-être même pas recevoir, avec tant d'autres bienfaits, de La part d'étrangers plus heureux. Quelles que soient les lacunes trop réelles page CCXXXIV de la philosophie, qui sont aussi les lacunes des religions, en un mot celles de l'esprit humain, les amis de la vérité ne se sont jamais découragés. Tous les siècles ont eu leurs philosophes, plus ou moins profonds, plus ou moins brillants, plus ou moins utiles à l'humanité, dont ils sont les interprètes, toujours divers par les doctrines, toujours semblables par les intentions. A défaut de Pythagore, c'est Xénophane ; à défaut de Socrate, c'est Zénon ; à défaut d'Épictète, c'est Plotin; à défaut de Descartes, Condillac; à défaut de Reid, Kant. La raison humaine ne s'est pas plus arrêtée en philosophie que dans toutes ses autres applications ; elle ne s'arrêtera pas davantage à l'avenir, tant qu'elle n'aura pas consenti, sur la pente où on l'appelle, à abdiquer, devant la partie brutale et inférieure de notre être. Dans cette galerie d'hommes généreux et indépendants, qui compose l'histoire de la philosophie, chacun de nous peut choisir et adopter le guide pour lequel il se sent le plus de sympathie, ou peut-être aussi de ressemblance. Mais le mieux encore est de ne pas page CCXXXV avoir besoin de guide, et de ne s'en fier qu'à soi seul, en marchant, sans crainte, dans fia libre voie qu'ont suivie tant de sages et illustres devanciers. Entre les théories qu'ils ont produites, les historiens ont cherché à établir un ordre de succession régulière et périodique, qui serait la loi de ces évolutions. La philosophie, dit-on, serait inévitablement forcée de se mouvoir dans quatre systèmes principaux, intelligence, ses sources d'information et ses anodes de connaissance : sensibilité, raison, doute, et instinct. Selon que le philosophe accorde plus d'autorité au témoignage des sens, ou à la pensée réfléchie; selon que, désespérant de l'un et de l'autre, il se laisse Daller au doute; ou bien enfin, selon qu'effrayé de l'abîme où le doute le mène, il confie, presque sans examen et sans règle, l'instinct divin, qui est le fond de notre entendement, le système qui sort d'une de ces quatre tendances est, ou le sensualisme, ou l'idéalisme rationnel, ou le scepticisme, qui ne croit à rien, ou enfin, le page CCXXXVI mysticisme, puéril et naïf, qui croit à tout. Ces distinctions sont vraies; mais ce qui ne l'est peut-être pas autant, c'est l'ordre qu'on croit pouvoir instituer entre ces systèmes; c'est l'influence mutuelle qu'ils exerceraient uns sur les autres, pour se susciter à tour, ou pour se détruire. dans la réalité, il n'existe pas entre eux une lutte uniforme et aussi nécessaire. Ils sont souvent mêlés confusément dans un même individu ; ils le sont encore plus dans une même époque. Quelquefois, ils manquent tous ensemble presque entièrement; et par exemple, dans cette longue éclipse de la Métaphysique, qui s'étend de la destruction de l'Empire romain jusqu'à la première Renaissance, au XIIIe siècle, les quatre systèmes font défaut ; et même quand les ténèbres se dissipent peu à peu, on a la plus grande peine à les discerner. Il y a des peuples fort intelligents et des races, comme celles de l'Inde, où un seul des quatre systèmes, le mysticisme, a presque uniquement prévalu, à l'exclusion des trois autres, et où le scepticisme ne s'est jamais montré. Les circons- page CCXXXVII tances extérieures sont aussi pour beaucoup dans l'éclosion, ou dans l'avortement, des systèmes. Quand les esprits sont satisfaits par le dogme religieux, comme il est arrivé pour notre Moyen-âge, ils songent moins à la philosophie. Ce n'est pas qu'elle soit morte; mais elle se tait; et il lui faut bien du temps pour recouvrer la parole. Au contraire, quand la foi religieuse est incapable, comme dans le Paganisme, de répondre aux exigences de la raison, les systèmes de toute sorte se multiplient et florissent. La métal physique supplée une religion insuffisante ; et elle apporte aux esprits le solide aliment qu'ils ne trouvent point ailleurs. Toutes ces alternatives et ces oscillations, tant reprochées à la philosophie, comme si elles n'étaient pas la condition même du savoir de l'homme, se comprennent aisément; si l'on se rappelle le caractère essentiellement individuel des spéculations philosophiques. Précisément parce que l'homme est avant tout un être libre, il ne peut pas y avoir de loi absolue pour la production des systèmes. Ne dépendant que de l'individu, page CCXXXVIII ils naissent à l'aventure; et, pour savoir pleinement quelle en est la secrète origine, il faudrait être dans les conseils de Dieu, qui fait des philosophes, comme il fait des poètes et des artistes, les répartissant aux peuples et aux âges selon des desseins qui nous dépassent. La loi, s'il y en a une, nous échappe. Certainement, il est bon de la chercher ; mais on peut douter qu'elle soit encore comprise. Il n'y a pas non plus de loi dans la succession des poètes, puisque le plus grand de tous en est aussi le premier par la date, comme par le génie. La philosophie y perd-elle quelque chose de son influence et de son utilité? Pas le moins du monde. Quand elle trouve quelque parcelle de vérité, le trésor qu'elle met à découvert n'en a pas moins de prix, parce qu'il vient d'un penseur qui n'a ni aïeux, ni descendants. La philosophie peut se dire que ce qu'il y a de vraiment essentiel et de durable dans les conquêtes de la raison, lui appartient toujours, venant d'elle ou remontant jusqu'à elle. Si les considérations qui précèdent ont page CCXXXIX quelque valeur, si elles sont exactes, appliquons-les à la philosophie de notre temps, sur la fin du XIXe siècle, spécialement dans notre pays. Instruit par les leçons du passé, le philosophe doit être, de nos jours, plus modeste que jamais; et, tout à la fois, il peut être animé de la plus mâle assurance. A cette heure, son droit n'est douteux, ni pour lui-même, ni pour les autres. D'ailleurs, pour peu qu'il interroge sa conscience, il y trouve, sous la conduite de Descartes, une force que nulle puissance au monde ne peut contraindre; et, sans se flatter, il peut se répéter, avec le poète, que la ruine même de l'univers n'ébranlerait pas son cœur invincible, comme Pascal nous l'apprend après Horace : « Quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. » Dans la nature de l'homme, c'est la philosophie surtout qui peut revendiquer cette fière parole, que le Stoïcisme ancien a transmise, et fait accepter, à l'humilité chrétienne. Sous une autre forme, c'est l'axiome Cartésien; et puisque la philosophie, grâce à la méthode, sait qu'elle doit page CCXL s'appuyer désormais sur cette base inébranlable, elle a, quand elle le veut, un levier qui peut soulever le monde de la pensée des choses. Tels sont aujourd'hui, plus que jamais, parmi nous plus que chez aucune autre nation, les motifs de l'imperturbable assurance de la philosophie ; tels sont ses titres à la confiance que l'esprit humain peut placer en elle. Des motifs non moins graves recommandent au philosophe une circonspection et une réserve qui s'allient fort bien avec de fermes croyances, aussi éloignées de l'orgueil que du scepticisme. A ses débuts, la philosophie s'imaginait pouvoir expliquer l'univers ; et c'est une illusion qu'elle se fait encore quelquefois, malgré l'avertissement de tant de fameux naufrages. Elle ne doit plus se la faire. Se connaissant pour ce qu'elle est, elle doit mieux apercevoir quelles sont ses infranchissables limites. C'est bien toujours l'ensemble des êtres, la totalité de l'Être, que le philosophe essaie de comprendre, à commencer par son être propre page CCXLI mais, en face de l'infini et de l'absolu, il ne sent que trop vivement, sinon sa complète impuissance, du moins son infirmité relative et ses justes bornes. C'est pour lui personnellement qu'il s'efforce de pénétrer le mystère ; et comme, nécessairement, il n'en pénètre qu'une faible partie, dans la mesure étroite de son individu, il ne doit plus avoir la prétention de posséder la vérité tout entière, et encore moins d'imposer à ses semblables la solution qu'il a trouvée, après de longues méditations, et qui ne regarde que lui. Le philosophe ne peut plus se croire un révélateur. Cet aveuglement des premiers jours, s'il a jamais été excusable, a cessé de l'être; ce serait, maintenant, une erreur plus impardonnable encore que dangereuse. L'humanité n'en est pas moins prête à écouter le philosophe, quand il lui apporte le tribut de ses pensées ; mais il ne peut pas plus songer à dicter la loi aux autres hommes qu'il n'a, comme le dit Aristote, à la recevoir d'eux. Que si la philosophie, sortant d'elle-même, jette ses regards impartiaux sur ce qui l'en- page CCXLII vironne, elle se voit, dans notre siècle, aussi bien que parle passé, en face d'une religion qui exerce un immense et heureux empire, et en face de la science, qui a pris un prodigieux développement. L'une mérite le respect, l'autre l'admiration; toutes deux exigent l'attention la plus constante du philosophe. Il peut leur demander quelques lumières, tout en jouissant des siennes, que rien ne peut remplacer. Malgré les imperfections inévitables de toute oeuvre humaine, la religion, telle qu'elle se montre dans nos sociétés européennes, est encore la plus grande et la plus vraie de toutes celles qui ont jamais paru; il serait peut-être hasardeux d'ajouter, qui paraîtront jamais. Par ses origines qui remontent, avec la Bible, aux premiers âges de l'histoire, par les emprunts qu'elle a faits à l'Antiquité grecque et romaine, par les labeurs incomparables qui l'ont accrue depuis les Apôtres et les Pères de l'Église, par les Conciles qui ont successivement fixé le dogme et la jurisprudence sacrée, par les docteurs du Moyen-âge, et même par les am- page CCXLIII bitions démesurées de certains Papes, la religion chrétienne, dont le Catholicisme est le véritable héritier, est entourée d'une puissance et d'une majesté dont rien n'approche dans les annales du genre humain. C'est un édifice colossal, qu'ont élevé les mains les habiles et les plus persévérantes, qui a duré bien des siècles déjà parce qu'il est fondé sur la foi la plus sincère, et qui pourra défier, pendant bien des siècles encore, « la fuite des temps ». Comparé à toutes les autres religions, le Christianisme les domine à une hauteur incommensurable, autant que notice civilisation et nos sciences l'emportent sur la civilisation de toutes les autres races, présentes ou éteintes. Cet éclat et cette gloire seraient peu de chose pour la raison et la philosophie, qui se plaît d'ailleurs à les constater, si la religion chrétienne n'avait encore d'autres titres infiniment plus réels et plus solides, que n'apprécie pas le vulgaire, mais dont les penseurs doivent être frappés, si ce n'est convaincus ou éblouis. Sur tous les problèmes qu'agité la Métaphysique, le Chris- page CCXLIV tianisme a des solutions ; il ne laisse ignorer à l'homme rien de ce qui peut l'intéresser sur sa nature, sur son origine, sur sa destinée, sur ses espérances, et sur Dieu. Que ces solutions soient définitives et indiscutables, il n'y a que les fidèles qui puissent le croire. Mais la philosophie se manquerait à elle-même, si elle ne les étudiait pas, et si elle n'en tenait pas le plus grand compte. C'est l'inspiration qui les a dictées; l'inspiration est loin d'être infaillible, puisque la raison elle-même ne l'est pas; mais quand la spontanéité des esprits a de tels précédents, et quand elle a porté de tels fruits, elle est digne de l'examen le plus approfondi, qui peut devenir un enseignement fécond. C'est la Judée, la Grèce et Rome que le Christianisme résume et continue; c'est toute la civilisation moderne qu'il concentre et qu'il représente, en attendant qu'il la fasse régner sur la face entière du globe que nous habitons. Le philosophe serait bien imprudent de ne pas le consulter aussi attentivement, au moins, qu'il consulte le passé philosophique. page CCXLV Sur une foule de points, il se trouvera d'accord avec la religion; et il pourra joindre alors aux égards que conseillent toujours les convenances sociales, cette adhésion, bien autrement intime, d'un cœur qui se rend librement à la vérité partout où il la voit. Il ne saurait désavouer, sous le costume chrétien, les principes et les doctrines qu'il admire dans Platon. Cette conformité, pour n'être pas tout à fait celle de la raison et de la foi, n'en est guère moins précieuse. On est heureux de pouvoir accorder l'approbation avec le respect; et la philosophie, sans avoir besoin de ce concours, y puise néanmoins des forces, qui n'ôtent rien à son indépendance, et qui, s'il le fallait, la rendraient encore plus tolérante qu'elle ne doit toujours l'être. On peut n'être pas chrétien; c'est le droit que réclame la libre pensée; mais c'est une témérité aveugle et injuste que de réprouver le Christianisme, sans chercher d'abord à le bien entendre. Ou il faut proscrire toutes les religions, ce qui est un insupportable mépris de l'humanité; ou il faut écouter celle-là, et la vénérer plus que toutes les autres. page CCXLVI relations de la Métaphysique avec les science contemporaine sont peut-être moins faciles et moins nettes qu'avec la religion. Le malentendu, qui dure depuis assez longtemps déjà, et qui remonte tout au moins à Bacon, s'accroît tous les jours par les progrès incessants que font les sciences. Pour sa part, la Métaphysique n'a guère à espérer des progrès semblables; et, sauf l'apparition de quelque génie extraordinaire, elle ne dépassera pas le niveau qu'elle a atteint avec Socrate et Descartes. Au contraire, les conquêtes scientifiques semblent de plus en plus s'étendre; les découvertes les plus inattendues s'accumulent, dans le champ de l'infini. Elles ont un retentissement universel; et les sciences aujourd'hui remplissent, à peu près seules, le théâtre où se fixent les yeux de la foule. Elles y ont succédé aux lettres, qui naguère y tenaient une place exclusive ; et leur vogue n'est pas près de se tempérer, bien qu'un jour elle doive défaillir à son tour, sous l'ardeur d'une vogue contraire. La philosophie assiste à ces luttes sans les craindre, parce qu'elles doivent tourner au profit de page CCXLVII l'intelligence commune. Ce triomphe des sciences, légitime sous bien des rapports, ne la trouble pas ; elle sait dès longtemps quelles en doivent être les bornes, de même qu'elle sait aussi, non moins sûrement, quels sont ses droits imprescriptibles, que les victoires de la science ne font qu'accroître, loin de les réduire. D'ailleurs, répétons-le aux savants, sans intention de les blesser : la philosophie a moins besoin des sciences que les sciences n'ont besoin de la philosophie. Les maîtres de la sagesse ont apparu dans des temps, et chez des peuples, où les sciences étaient à peine écloses. Les sages n'en ont été, ni moins éclairés, ni moins utiles. Ainsi que le remarque Aristote, l'étonnement et l'admiration ont été pour les hommes le commencement de la science et de la philosophie. A mesure que les sciences analysent les phénomènes et en découvrent de nouveaux, de plus en plus admirables, l'étonnement s'augmente; mais il ne change pas de nature. On pourrait presque croire que, plus on a lieu d'être étonné et plus l'admiration page CCXLVIII
se justifie, moins peut-être on comprend l'infinitude
des choses. Il est à douter que Newton admirât les cieux plus que ne
le faisait David; et personne encore, parmi les astronomes, n'a
surpassé en enthousiasme les psaumes du Roi-prophète. Ce n'est pas
la science qui fait la vivacité, ni la profondeur du sentiment.
Après plus de deux mille ans, la philosophie peut encore objecter
aux Ce qui est vrai de la Métaphysique en France ne l'est pas moins pour le reste de l'Occident. La situation est partout la même vis-à-vis de la religion et de la science ; et la noble famille européenne garde toujours l'unité contractée, dès le Moyen-âge, sous la discipline de la Scholastique, que Paris avait enfantée avec Abélard et ses successeurs. Sans doute, il y a des dissemblances très notables entre la philosophie française, et les autres philosophies contemporaines, page CCXLIX allemande, italienne, anglaise et américaine; mais, dans leurs traits généraux, elles sont de la même race ; elles se sont formées, elles ont grandi sous les mêmes influences ; elles sont soumises à des péripéties analogues. Ce qui s'applique à la nôtre s'applique à peu près aussi bien à ses sœurs. Mais nous pouvons, sans vanité, penser que notre philosophie, réglée par Descartes, depuis de deux siècles, est encore la plus sage et la plus pratique de toutes. Si elle n'a pas les éclats et les conceptions gigantesques de quelques autres, elle n'en a pas non plus les périls et les chutes. Contre toute attente, les esprits ont été, chez nous, beaucoup plus audacieux dans le monde des faits que dans celui de la pensée ; et la furie française, qui s'est donné carrière dans une révolution qui a bouleversé tous les peuples, disparaît en philosophie. Nous y sommes d'une sagesse exemplaire, que d'autres auraient pu imiter, s'ils l'avaient comprise, mais dont ils n'ont fait que se railler, parce qu'ils en étaient incapables. Selon toute apparence, nous resterons fidèles à ces habitudes de modération CCL et nous ne dépasserons pas la mesure, clarté, qui est la première qualité de notre esprit national, et que nous avons reçue de l'Antiquité, nous préserve des écarts extrêmes ; le bon sens est chez nous un frein auquel il est bien difficile de se soustraire. Ailleurs, les obscurités de l'esprit aident beaucoup aux ténèbres des théories, et l'on y paraît quelquefois d'autant plus profond qu'on est plus inintelligible. On le voit donc : considérée dans son état actuel, dans sa gloire du XVIIe siècle, dans ses défaillances même du Moyen-âge, dans ses merveilleux débuts en Grèce; considéré dans ses représentants les plus vrais, ou bien dans ce degré inférieur où elle se montre parmi les peuples de l'Asie, la philosophie a été la même, ou peu s'en faut, à toutes les époques. Sa nature n'a pas essentiellement varié, quoique ses œuvres aient été bien diverses; son procédé est resté identique. Le seul progrès, c'est que la conscience qu'elle en a eue a été plus ou moins complète, jusqu'à ce qu'enfin elle en arrivât à la splendeur Cartésienne, que nulle ; page CCLI autre ne peut surpasser, et qui ne doit plus s'éteindre. Le passé de la philosophie depuis Platon et Aristote nous répond de son avenir; et cette pérennité, que lui souhaitait Leibniz, elle l'a toujours possédée. Quoi qu'il puisse arriver, elle en jouira à jamais, appui le plus solide de la raison humaine, son honneur suprême, et son salut, aujourd'hui comme jadis, dans les siècles futurs aussi bien qu'elle l'a été dans les siècles écoulés. Avril 1879. (01) Fragment de l'Hortensius, cité par Nonius, liv. IV, t. XXXV, p. 262 de la petite édition de Victor Le Clerc. (02) LEIBNITZ., édition Paul Junot, t. II, p. 524. (03) Une bonne partie des critiques d'Aristote contre la théorie des Nombres peut regarder la théorie Platonicienne des Nombres idéaux de Xénocrale et de Speusippe. Mais il serait presque impossible de faire exactement les parts. (04) Voir des passages décisifs dans la République, liv. VI, pp. 2, 5 et 13, traduction de M. Victor Cousin. (05) Voir des arguments tout pareils contre les idéalistes, dans le Traité de métaphysique de Voltaire, t. XXXVII, p. 304, édition Beuchot. (06) Bossuet n'est que l'écho d'Aristote quand il dit : « Dieu se connaît et se contemple; sa vie, c'est de se connaître. » Sermon sur la Mort, p. 393, édition de 1845. (07) Métaphysique d'Aristote, liv. XII, ch. VII, § 8. (08) Voltaire, agitant la question de savoir s'il y a en effet des objets extérieurs, ajoute : « On n'aurait point songé à traiter cette question, si les philosophes n'avaient cherché à douter des choses les plus claires, comme ils se sont flattés de connaître e les plus douteuses. » Traité de Métaphysique, 1731, p. 301, édition Bouchot, t. XXXVII. (09) V. COUSIN, Histoire de la philosophie, leçon VII, pp. 426 et suiv., Édition de 1872. (10) Voir notre traduction, dans le Journal des Savants, cahiers de mars, avril, juillet et septembre 1868. (11) Voir la Critique de la Raison pure, traduction de M. Tissot, p. 43. (12) 1 Voir M. Victor COUSIN, Histoire de la philosophie, leçon Xe, pp. 537 et suiv., Édition de 1872. (13) IAMBLIQDE, Vie de Pythagore, XII, § 58, p. 28, édition Firniin-Didot. (14) PLATON, Apologie de Socrate, traduction de M. Victor Cousin, p. 93. (15) Discours de la Méthode, édition de M. Victor Cousin, p. 124, Œuvres de Descartes. (16) Voir son Traité de Métaphysique à madame du Châlelet; et son ouvrage intitulé : Il faut prendre un parti, édition Beuchot, t. XXXVII et XLVII. (17) M. Thiers, dans son discours de 1844. (18) DESCARTES, Discours de la Méthode, p. 164, edit. V. Cousin. (19) Voir la Métaphysique, liv. I, ch. II. (20) LAPLACE, Exposition du Système du Monde, t. II, pp. 3 et 411, édition de 1821. (21) LAPLACE, Exposition du Système du Monde, t. II, p. 367, Édition de 1824. (22) Exposition du Système du Monde, t. II, p. 393, édition de 1824. (23) Lettre XC, Éloge de la philosophie. (24) Buffon, tout Cartésien, a dit : « Nous ne cherchons qu'à nous répandre au dehors et à exister hors de nous. » De la nature de l'homme, au début. (25) BUFFON, De la nature de l'homme, pp. 309 à 322, édition de 1830. (26) KANT, Critique de la raison pratique. Mobiles de la raison, p. 269, traduction Barni.
(27)
Gorgias de Platon, p.
307 de la traduction de M. Victor Cousin. |