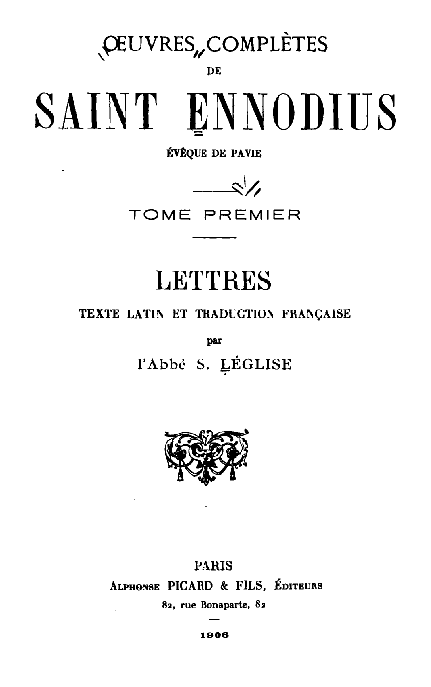|
le fonds d'écran provient de
CATHEDRAL CHURCH ENNODIUS Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LETTRES INTRODUCTION
livre I - livre II - livre III - livre IV - livre V - livre VI - livre VII - livre VIII - livre IX
PREFACELa traduction des Lettres d’Ennodius que nous offrons au public, a pour unique objet de vulgariser des trésors historiques et littéraires, demeurés jusqu’ici presque inconnus. Deux éditions récentes et les travaux qu’elles ont provoqués en France et à l’Etranger, ont tiré de l’oubli les œuvres de l’évêque de Pavie, mais il restait, pour le commun des lecteurs, une grosse difficulté: l’intelligence de sa langue. Une traduction, même très imparfaite, aplanira cette difficulté. C’est donc surtout pour permettre de lire avec facilité le latin d’Ennodius que nous en donnons la traduction française. Car, comme tous les écrivains qui ont une langue personnelle, Ennodius doit être lu dans son texte. Ces billets si délicats, ces épîtres si littéraires, perdent dans la traduction tout ce qu’il y a d’exquis et de savoureux dans l’original. Aussi n’avons-nous pas hésité à reproduire au bas des pages le texte latin, pour le mettre immédiatement sous les yeux du lecteur.[1] L’introduction paraîtra peut-être volumineuse, mais les documents que nous y avons réunis nous ont permis de supprimer presque entièrement les notes dans le corps de l’ouvrage. Du reste nous avons été par là même dispensé de répétitions fastidieuses. Les annotations plus spéciales, qui n’avaient pas leur place dans l’introduction, se trouvent fondues dans le sommaire placé en tête de chaque lettre. Une table analytique où figurent les noms de tous les correspondants, complète, relativement à chaque personnage, les indications nécessaires. Il nous reste à recommander notre œuvre à la bienveillance du lecteur. Nous espérons qu’il tiendra compte des difficultés qu’offrait la traduction du latin d’Ennodius et que s’il trouve matière à nous adresser le reproche d’avoir présumé de nos forces, il voudra bien rendre hommage à notre bonne volonté. Malgré son imperfection, nous avons la confiance que la traduction des Lettres d’Ennodius offrira quelque intérêt. L’époque où nous vivons ne ressemble que trop à celle où écrivait Ennodius. Notre histoire sociale, c’est, à de nombreux points de vue, la reproduction de l’histoire sociale de la fin du Ve siècle. Comme au lendemain de l’invasion des Barbares, des ruines s’accumulent, des institutions séculaires disparaissent, les couches inférieures montent et s’emparent de la suprématie. N’y a-t-il pas pour l’observateur attentif un intérêt souverain à écouter les confidences de ces fiers Romains, devenus les fidèles sujets du Goth Théodoric? Si Dieu nous prête vie et soutient notre courage, à ce premier volume, tout entier consacré à la correspondance d’Ennodius, s’ajoutera un second qui contiendra la traduction du reste de ses œuvres, opuscules, discours et poésies. Bordeaux, 30 août 1904. INTRODUCTIONIUne correspondance à la fin du Ve siècle; non point un recueil de lettres officielles, comme celles de Cassiodore, mais une correspondance intime, expression réelle de la vie journalière dans la haute aristocratie du monde romain d’Occident à cette époque, telle est l’œuvre dont nous donnons au public la traduction française. Toutes les œuvres d’Ennodius, il est vrai, sont précieuses pour l’histoire de cette singulière époque où le vieux monde Romain, survivant à l’empire d’Occident écroulé sous la poussée des Barbares, était en gestation de peuples nouveaux. Ces œuvres écrites selon l’occasion et les circonstances, inspirées par l’amitié, l’amour des lettres, le dévouement à la cause de la religion ou de la patrie romaine, présentent la plus grande variété. Panégyriques et apologies, sermons et biographies, discours académiques, modèles de plaidoyers et de réquisitoires, leçons de littérature et traité des études, formules liturgiques et hymnes sacrées, poésies diverses et épigrammes, tout s’y rencontre et tout présente un intérêt historique très particulier. C’est qu’en effet, s’il est inutile de chercher dans ces écrits ce que l’on trouve d’ordinaire chez les historiens de profession qui donnent des événements un tableau d’ensemble méthodiquement composé, on y trouve des documents vécus, tombés au jour le jour de la plume d’un homme du monde, d’un fin lettré occupant dans l’Eglise une haute situation, dans la noblesse une place distinguée, qui écrit à des contemporains, qui s’entretient avec eux des choses et des hommes de son temps et qui, par cela même, nous fournit des renseignements qu’un historien ou un chroniqueur aurait négligés[2] ». Le rôle qu’il a joué dans les lettres, dans le barreau, dans l’Eglise et dans la politique, l’amitié qui l’unit à de grands personnages, la confiance que lui témoignèrent les évoques Epiphane et Laurent, les papes Symmaque et Hormisdas, les hautes charges occupées par ses correspondants, la parenté qui le liait à beaucoup d’entre eux, toutes ces raisons donnent à son témoignage et à ses écrits une valeur exceptionnelle. L’histoire n’a donc rien à négliger dans ce qui nous a été conservé des écrits d’Ennodius, mais sa correspondance est sans contredit, à ce point de vue, la part la plus intéressante. Rien ne peut la remplacer. Cassiodore, il est vrai, nous donne le tableau administratif très complet du règne de Théodoric, mais il laisse dans l’ombre la réalité de choses, c’est dans la correspondance d’Ennodius qu’il faut la chercher. Nous disons qu’il faut la chercher, car en effet elle n’y apparaît pas de prime abord. Ce n’est d’ordinaire qu’après le Vale et dans une sorte de post-scriptum qu’Ennodius énonce en peu de mots l’objet principal de sa lettre. Il s’est longue abandonné à des considérations philosophiques sur les douceurs du commerce épistolaire ; il y a mêlé des éloges à l’adresse de son correspondant ou de ses amis; vous croyez à une simple lettre d’amitié, charmante mais banale, où l’on n’a rien à dire, mais voici la fin: « Tout en vous saluant écrit Ennodius, je vous recommande ce porteur qui n’a pas voulu se présenter à vous sans une lettre de moi... » ; ou bien il traite de quelque affaire. Malheureusement nous ne possédons relativement qu’un petit nombre des lettres qu’écrivit Ennodius. Nous y trouvons plusieurs allusions à un bien plus grand nombre qui n’ont pas été conservées (V, 27 ; VI, 22 ; III, 32); et encore celles qui furent recueillies sont-elles toutes relatives à une courte période de sa vie, antérieure à son élévation à l’épiscopat. Nul doute cependant que, devenu évêque, indépendamment des lettres d’affaires que sa charge l’obligeait à écrire, Ennodius n’ait continué à correspondre avec ses illustres amis, car il avait la passion du commerce épistolaire, passion qui s’inspirait d’un double motif cultiver les lettres et cultiver l’amitié. L’amitié est un thème sur lequel Ennodius revient sans cesse, que chaque jour il traite d’une façon neuve sinon nouvelle. Il a pour répéter cette même chose mille délicatesses, mille subtilités de langage. On peut dire que, prise dans son ensemble, sa correspondance est par excellence un charmant traité de Amicitia, dicté par le besoin d’aimer et de se savoir aimé. Que Faustus laissât quelqu’un de sa maison ou de ses connaissances partir pour la Ligurie sans le charger de lettres, Ennodius en était inconsolable. Il ne se contentait pas des nouvelles portées de vive voix; il lui fallait une lettre. Il entre en effet dans le commerce épistolaire régulier, quelque chose d’intime, de profond, que la parole ne saurait remplacer. La lettre, telle qu’elle s’échange entre vrais amis, est la photographie de l’âme dans sa réalité présente. Même après de longs siècles, malgré le vague des allusions dont l’intelligence nous échappe, ces lettres d’Ennodius restent la fidèle image de son âme. Elle y apparaît comme en un miroir, tantôt heureuse, rendant grâces au ciel du succès d’un jeune disciple, du retour d’un ami, tantôt et plus souvent, triste, inquiète, mélancolique, toujours aimante, toujours désireuse d’obliger ses amis et de se sentir aimée. Voilà bien, à n’en pas douter, ce qui faisait le charme des lettres d’Ennodius et ce qui le fait encore. Et pourtant le style de ces lettres manque presque toujours de la qualité maîtresse du genre épistolaire: le naturel. Il est vrai, Ennodius qui savait ses lettres lues d’un certain public, croyait devoir à l’honneur de sa plume et aussi à l’honneur de ses illustres correspondants, d’apporter à la rédaction même des simples lettres d’affaire (VI, 13) le souci d’une composition littéraire. De là ce bagage de sentences, un laconisme parfois exagéré, des inversions forcées sacrifiées à l’euphonie. Mais il était une chose qu’Ennodius ne fardait pas et qui passait au naturel dans ses lettres : cette chose s’était son cœur. D’où vient donc qu’une part si importante de cette précieuse correspondance ne nous soit pas parvenue? On a supposé que ses lettres d’affaire, négligées par ses premiers éditeurs, ne furent pas toutes conservées ; ses lettres purement administratives durent être dédaignées; on n’aurait recherché que celles où le brillant du style s’alliait avec cette pompe oratoire qui passait alors pour la plus haute expression de l’art. La postérité immédiate aurait traité Ennodius plus en homme de lettres qu’en historien et laissé se perdre tout ce qui ne pouvait justifier sa réputation d’écrivain. Sans contredire à ces hypothèses, nous croyons qu’il y eut à ces regrettables lacunes d’autres causes. On peut supposer en effet que certains cahiers se sont perdus. N’est-il pas invraisemblable que, devenu évêque, Ennodius n’ait pas continué à correspondre avec ses illustres amis et à donner des lettres et même des poésies dignes de figurer à côté de leurs ainées? Or nous ne possédons de lui aucune œuvre relative à son épiscopat. Ne doit-on pas en conclure que les premiers collecteurs de ses œuvres auront réuni à part ce qu’il écrivit étant évêque, en un volume qui se sera perdu. Peut-être quelque heureux chercheur le découvrira-t-il un jour.[3] Un indice que les premiers collecteurs des lettres d’Ennodius étaient loin de les considérer comme de précieux documents historiques c’est le peu de souci qu’ils apportèrent à les classer par ordre de date. Ils les transcrivirent pêle-mêle avec les autres œuvres d’Ennodius. selon qu’elles se trouvaient déjà insérées dans les divers recueils partiels formés par ses amis ou ses admirateurs. Ces divers recueils furent transcrits à la file sans que les copistes, éditeurs des manuscrits où l’on trouve les œuvres complètes, prissent la peine de remanier le classement des pièces variées qui les composaient. Ils ne se préoccupèrent même pas de ranger les collections partielles par ordre de date de leur composition, et les insérèrent comme elles leur tombaient sous la main. L’ordre chronologique se trouve donc très souvent interverti. Sirmond établit dans son édition un certain ordre et classa les diverses pièces selon leur genre littéraire, lettres, opuscules, dictions, poèmes, en divers livres qu’il enrichit de notes précieuses, mais il laissa forcément subsister l’incertitude de la chronologie. Il l’aggrava même, au dire de Vogel (praef. p. liii-liv) qui prétend, non sans quelque raison, que les recueils primitifs n’avaient point été faits tout à fait au hasard ; que les pièces dont ils se composaient avaient entre elles un certain lien, soit qu’elles se rapportassent à un moine événement, soit qu’elles fussent d’une même époque. Il en conclut que ces diverses pièces rapprochées s’éclairent les unes les autres et qu’en les dispersant pour un classement nouveau, Sirmond en a rendu l’intelligence plus difficile. Bref Vogel a rétabli dans son édition l’ordre des anciens manuscrits et ainsi son édition offre un intérêt particulier et ne fait pas double emploi avec celle publiée à Vienne par Hartel presque en même temps. Magnus Felix Ennodius, né à Arles en 473, d’une noble famille gallo-romaine, perdit fort jeune ses parents et fut recueilli à Milan par une riche tante qui lui fit donner une brillante éducation littéraire. Doué d’un génie merveilleux, passionné pour l’éloquence et la poésie, le jeune étudiant ne tarda pas à être recherché de ce qu’il y avait de plus distingué dans l’aristocratie ligurienne. Il avait seize ans lorsque, par suite de la mort de sa tante et de l’invasion en Italie de Théodoric (489), il se trouva presque réduit à la misère. Mais une noble héritière qu’il épousa, lui apporta une fortune considérable. Saint Epiphane, alors évêque de Pavie, distingua le jeune Ennodius, gagna son affection, se l’attacha, et l’emmena en qualité de secrétaire dans le voyage qu’il fit en Gaule, par ordre de Théodoric, pour racheter les captifs de Ligurie tombés aux mains des Burgondes. Cependant Ennodius, quoique très vertueux, menait le trahi de vie d’un grand seigneur. Passionné pour la poésie, il consacrait au culte des muses les loisirs que lui laissaient ses occupations de maître de littérature et sa profession d’avocat. Une très grave maladie dont il guérit miraculeusement par intercession de saint Victor, fut pour lui l’occasion de quitter le monde. Du plein consentement de sa sainte épouse qui, de son côté, prit le voile des veuves consacrées à Dieu, il se laissa ordonner diacre. Il resta dans cet ordre, servant l’Eglise et les pauvres, tantôt de sa plume comme écrivain, tantôt de sa parole comme avocat, jusqu’en 511 qu’il fut élevé sur le siège épiscopal de Pavie. Le pape saint Hormisdas, son ami, l’envoya par deux fois, en qualité de légat (515 et 517), auprès de l’empereur Anastase, avec mission de rétablir la paix et la communion entre les Orientaux et l’Eglise romaine. Ces légations n’eurent d’autre résultat que d’ajouter à la gloire littéraire d’Ennodius, celle de confesseur de la foi. L’empereur, après avoir vainement essayé de le tromper et de le corrompre par argent, le renvoya sur un vaisseau tout fracassé, avec défense d’aborder à aucun port de la Grèce et d’entrer dans aucune ville. Toutefois, il arriva heureusement à Pavie. Il y mourut le 17 juillet 521, âgé de quarante-huit ans. Il subsiste une difficulté relativement à la date de son ordination au diaconat. La plupart des auteurs le font ordonner à l’âge de vingt et un ans, vers 494. Ils se fondent sur ce fait que dès lors il fut attaché à la personne de l’évêque de Pavie, saint Epiphane. Pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici, nous nous rattachons à l’opinion de Vogel[4] qui retarde cette ordination jusques vers 502, alors qu’Ennodius était à Milan, auprès de l’évêque Laurent, son parent. IILorsque, à l’aurore du VIe siècle, Théodoric le Grand, maître de l’Italie et arbitre de l’Occident, eut donné la paix à la péninsule, Ennodius ne vit d’espoir de conserver à l’élément romain submergé par l’invasion, un reste de vie et d’influence, que dans la culture des lettres et le salut des arts. Les Ostrogoths vainqueurs régnaient en maîtres. Mais ces vainqueurs de Rome n’aspiraient plus qu’à devenir eux-mêmes romains. Fascinés par l’éclat de cette civilisation, ils en convoitaient ardemment les jouissances. Il leur paraissait qu’en se revêtant des dépouilles de Rome ils héritaient de sa gloire. Désireux, du reste, de mettre à profit les ressources intellectuelles et morales qu’il trouvait chez les vaincus, Théodoric conserva tous les rouages de l’ancienne administration et, ne craignit pas d’appeler aux Premières charges de sa cour des Romains tels que les Boèce, les Symmaque, les Cassiodore, les Faustus, les Libérius, etc. Ces fiers patriciens, ces illustres consulaires, eurent le patriotisme de ne pas se refuser à ces royales avances. Ennodius comprit l’importance de ce mouvement et s’y porta de toutes les forces de son influence, de toute la vigueur de son génie. Il fallait à tout prix sauver Rome,[5] sauver sa langue, ses arts, ses lois, son antique civilisation, et pour cela il fallait que l’élément nouveau, implanté par la barbarie, se fondit dans l’élément romain. Un tel résultat ne pouvait s’obtenir qu’à la condition, pour l’aristocratie romaine, de ne pas se tenir à l’écart. Boèce avait harangué et fêté Théodoric à son entrée à Rome en 501 ; quelques années plus tard, Ennodius prononça le panégyrique du prince. Loin de conseiller l’abstention, il poussait à la cour, de tout son crédit, les fils de grandes familles, et les félicitait vivement d’y avoir trouvé place. Pour les tirer de leurs forêts, les détacher de leurs chiens et de leurs chevaux, et les ramener au culte des muses et du barreau, il n’épargna ni son temps ni sa peine. Trois moyens furent mis en œuvre : il donna de sa personne et se fit maître d’école ; il mit à faire fleurir l’Auditorium (école d’éloquence) de Milan, toutes les ressources de son merveilleux talent oratoire ; enfin par ses lettres et ses traités, il continua auprès de ses anciens élèves et de ses jeunes amis, cette œuvre de relèvement national. Malgré sa charge de diacre et le soin des pauvres de Milan,[6] malgré le travail énorme nécessité par ses fonctions d’avocat des plus consultés et des plus chargés d’affaires,[7] tant civiles qu’ecclésiastiques,[8] tant par les pauvres[9] que par les riches,[10] Ennodius ouvrit une école et se fit maître de belles-lettres. Nul, alors, n’était plus propre à grouper autour d’une chaire les nobles fils de la haute aristocratie romaine pour leur donner le goût des lettres. Issu d’une famille consulaire gallo-romaine, uni par les liens du sang ou de l’amitié aux Faustus, aux Boèce, aux Symmaque, en relation avec tous les hommes éminents d’Italie ou de Gaule, Ennodius aimait les lettres avec passion et les cultivait avec un éclatant succès. Le barreau d’Italie n’avait pas d’orateur plus en renom,[11] les monastères, le pape, les conciles empruntaient sa plume. Ses lettres défrayaient les salons littéraires, et .ses poésies, dignes de figurer en ligne des modèles de l’art antique, faisaient les délices des esprits les plus cultivés. Ce n’est certes pas que ces écrits si appréciés fussent d’un goût parfait; mais ces défauts de bon goût étaient alors tenus, dans le monde des lettres, pour de brillantes qualités.[12] On devine quelle dut être la vogue d’une école dirigée par un tel maître. La correspondance d’Ennodius, malheureusement trop discrète sur ce sujet, nous révèle cependant les noms de quelques-uns de ses élèves, devenus dans la suite, pour la plupart, d’illustres personnages. C’est l’orphelin Arator, né en Ligurie, d’un père fort habile dans les lettres[13] et que l’évoque de Milan, Laurent, avait pris en tutelle dans son palais. Parthénius était fils d’une sœur d’Ennodius, et partant élève de ce dernier. Son autre sœur, sa chère Euprépie, restée veuve à Arles, avait aussi confié à Ennodius l’éducation de son jeune fils Lupicin. Enfin le plus aimé de tous, Aviénus, fils ainé de Faustus et de Cynégie cousine de notre saint, quitta Rome pour venir en Ligurie recevoir les leçons d’Ennodius, et ne se sépara plus de son maître que lorsque, son éducation terminée, il revint à Rome se marier.[14] On pourrait croire qu’Ennodius n’accordait la faveur de ses leçons qu’à quelques privilégiés que les liens de la parenté ou de l’amitié lui rendaient chers. Mais la lettre à Victor (IX, 8) nous révèle une œuvre plus large. Nous croyons y lire qu’Ennodius était à la tête d’une véritable école, peut-être créée par lui, peut-être existant déjà et dépendant de l’évêché de Milan. C’était comme un prélude aux écoles épiscopales du moyen âge. La lettre à Victor traite de l’admission d’un enfant à cette école. Il est certain qu’Ennodius gardait près de lui les jeunes élèves venus de loin, comme celui dont il est ici question; ses deux neveux, Lupicin et Parthénius, le fils de sa cousine des Gaules, Camilla, qui lui fut également envoyé (IX, 9), Aviénus, dont les parents habitaient Rome ou Ravenne, vivaient, selon toute apparence, sous le toit d’Ennodius. Il n’est pas moins évident qu’ils s’y trouvaient réunis plusieurs à la fois. La lettre à Victor nous laisserait même deviner qu’Ennodius avait sous sa direction des collaborateurs : « Il n’est nul besoin, écrit-il, d’aller chercher au loin des maîtres lorsque celui qui présente un élève est déjà lui-même parfaitement instruit ». Ennodius, il est vrai, emploie souvent le pluriel pour le singulier. Mais si notre version n’est pas absolument concluante, rien non plus n’y contredit. Quel pouvait être le nombre des élèves de cette école, et par suite, dans l’hypothèse d’une école épiscopale, celui des maîtres? Ce nombre ne peut guère se préciser. La correspondance Ennodius ne nous en fait connaître que quelques-uns des plus distingués et dont les parents résidaient au loin. S’il venait de si loin des élèves au diacre de Milan, ne sommes-nous pas en droit de conclure qu’il lui en venait d’auprès un nombre plus grand encore. Les pères de famille de Ligurie auraient-ils dédaigné des leçons que les étrangers venaient chercher à si grands frais ? Nous aimons à croire qu’ils étaient, au contraire, des premiers à confier leurs fils à l’habile maître, et que les Ambroise, les Beatus, et ces autres jeunes Liguriens, Fidèle, Marcellus, Georges, Solatius, Simplicianus (VII, 28), qui, dans la suite, venaient à Rome étudier le droit et s’initier aux charges publiques, munis de lettres de recommandation d’Ennodius, avaient d’abord suivi ses leçons à Milan. Ce n’est pas que nous prétendions assimiler l’école d’Ennodius à nos collèges publics modernes où l’on admet indistinctement à peu près tout le monde. La lettre à Victor prouverait le contraire. Ennodius avait de l’éducation une trop haute idée pour ne pas faire un choix sévère de ses élèves. S’il admettait les uns c’est une preuve qu’il en excluait d’autres. Il avait pour ses chers élèves une affection de père; il les aimait comme ses propres enfants, ainsi qu’il le manifeste pour Aviénus et Arator, et le régime de son école n’était qu’une extension de la vie de famille. C’est dire avec quel soin jaloux il devait écarter tout sujet vicieux ou indigne. En résumé, la lettre à Victor suppose une école fonctionnant régulièrement à Milan sous la direction d’Ennodius. Cette école comprenait des internes venus du loin, et des externes de la ville et des environs. Frédéric Vogel, après avoir invoqué les principaux textes des lettres et des dictions d’Ennodius, desquels il ressort qu’il dirigea l’éducation d’un certain nombre de jeunes étudiants, tire cette conclusion assez inattendue : « N’allez pas croire cependant que, dans ma pensée, Ennodius fut jamais à la tête d’une école. A mon avis, il eut simplement la charge d’administrer et de faire prospérer l’Auditorium de Milan, où Deutérius dirigeait les études. S’il enseigna la rhétorique à quelques jeunes gens, ce fut d’une manière privée, selon la coutume antique de suivre les orateurs de talent pour se former à leur école. Ennodius avait ainsi avec lui quelques jeunes gens qu’il initiait à l’art oratoire.[15] » L’abbé François Magani, dans son grand ouvrage sur Ennodius,[16] réfute longuement l’opinion du critique allemand; il établit « comme un des points d’histoire les mieux éclaircis » qu’Ennodius enseigna en qualité de maître dans une école. Le premier argument se tire de l’examen général de ses Dictions que Sirmond appelle Controverses, (Dict., xiv et seq.). « Ces exercices oratoires ne se comprendraient pas si Ennodius n’eût été précepteur » (t. I, p. 285) ; ce sont, en effet, des corrigés de devoirs donnés à ses élèves de littérature qu’il initiait aux compositions oratoires, pour les préparer à passer à l’école d’éloquence proprement dite du rhéteur Deutérius.[17] Plusieurs de ces corrigés portent le nom de l’élève à qui le devoir avait été donné.[18] Ces épaves de l’enseignement d’Ennodius, parvenues jusques à nous, prouvent assez clairement, ce nous semble, qu’il ne fut pas seulement un précepteur d’occasion, comme le supposerait Vogel, mais un maître de littérature dans toute la ligueur du terme. Ce que les « Controverses » et les « Ethopées[19] » conservées dans les œuvres d’Ennodius, nous donnent le droit de supposer, se trouve énoncé d’une façon très claire dans ses autres dictions dites scolaires (Scholasticae).[20] Ces discours académiques prononcés aux fêtes littéraires, contiennent de manifestes allusions à la qualité de professeur de l’orateur, et parfois lui-même se l’attribue en propres termes. Dans la diction prononcée à l’occasion de la translation au Forum de l’Auditorium, il se dit de semblable profession que le rhéteur de cette école, Deutérius : « Si par crainte de parler sans art, je garde un timide silence, vous ne me reconnaîtrez plus pour un homme de profession semblable à la vôtre ». Il termine cette même diction par ces mots adressés aux étudiants: « Que Dieu favorise mes vœux et me fasse recueillir les fruits des soins que, précepteur, je donne à vos jeunes intelligences ». Il dit d’Arator : « Il a reçu de nous tout ce que, avec l’aide de Dieu, il montre de savoir ». Au sujet du même Arator, il invente un mot pour dire qu’il lui a fait la classe et l’appelle son classique: ergo classico meo... mihi classicus.... Or, l’idée de classe suppose évidemment, non seulement une collection d’élèves, mais plusieurs collections distinctes appartenant à la même école, selon l’ancienne méthode romaine : « Chaque école était divisée en sections (classes) (Quint. I, 2, 23) assez nombreuses pour que la lutte y fut vive et ardente.[21] » Ennodius fut orateur et même orateur très applaudi. Il occupait au barreau une place distinguée, néanmoins nous ne croyons pas que les illustres jeunes gens dont il s’entourait recherchassent surtout en lui un maître et un modèle dans l’art oratoire. Ennodius fut par dessus tout littérateur et son enseignement fut surtout littéraire. Il excelle à aiguiser le trait, à limer la phrase, à trouver des mots heureux, sa langue harmonieuse et musicale ne supporte pas le moindre choc; recherchée à l’excès, elle n’admet que des termes soigneusement choisis. Il paraît s’appliquer à prendre le contre-pied du précepte de Montaigne: « Je veulx que les choses surmontent, et qu’elles remplissent de façon l’imagination de celuy qui escoute, qu’il n’aye aulcune souvenance des mots[22] ». Une allure aussi étudiée ne saurait s’allier à l’entraînement de la grande éloquence. Au reste et ce qui est un argument décisif qu’Ennodius ne fut jamais qu’un professeur de littérature, lorsque ses élèves avaient terminé le cours régulier des études littéraires, il les envoyait se former à l’art oratoire, soit à Milan même, à l’Auditorium du rhéteur Deutérius, soit à Rome, où, de son temps comme au temps de Cicéron, les jeunes gens venaient de tous les points du monde romain, apprendre l’éloquence.[23] L’abbé Magani[24] croit qu’Ennodius enseigna d’abord à Pavie, puis à Milan, puis encore à Pavie. Vers l’âge de dix-huit ans, saint Epiphane, évêque de Pavie, l’aurait appelé à professer dans son école épiscopale. Il est du moins certain qu’Ennodius enseigna la littérature à Milan tandis que Laurent en était évêque. Le professeur était lui-même alors diacre. Au début de la diction prononcée lorsque le fils d’Eusèbe, jeune orphelin dont Ennodius avait la tutelle, fut présenté à l’école d’éloquence (Dict. xi), notre professeur fait une allusion très marquée à une longue interruption dans ses discours publics. Puis, une allusion à sa qualité de religieux laisse assez entendre qu’il parle pour la première fois depuis son ordination au diaconat. Cette interruption momentanée de ses exercices oratoires fut donc la conséquence de la longue et grave maladie qui précéda et détermina son ordination, et par conséquent il est établi que dès avant son ordination au diaconat Ennodius s’occupa des écoles et des écoliers, prit part aux fêtes oratoires, et se fit maître de littérature. Il continua d’enseigner et de s’occuper d’enseignement jusqu’au jour où le choix de l’Eglise de Pavie l’arracha à sa chaire de professeur pour l’élever sur le siège épiscopal (511). Vers 505 ou 506 il résuma, dans un traité des études PARŒNESIS DIDASCALICA (opusc. vi), destiné à Ambroise et Beatus, sa doctrine pédagogique. Nous avons donné ailleurs de cet opuscule une analyse détaillée.[25] Ennodius garde le vieux cadre romain des études de grammaire et de littérature, mais il y fait entrer l’éducation morale et la formation de ses jeunes élèves aux vertus chrétiennes. Il renonce à la férule si fort en honneur dans les écoles romaines et prétend faire épouser avec amour la science. Dans ce but il s’ingénie à la présenter sous les charmes les plus séduisants. Mais tout d’abord il s’efforce d’inspirer à ses jeunes élèves l’amour de la vertu. La vertu est la source du talent. Les vertus et les muses sont sœurs, et ne doivent pas être séparées. Les vertus sans les muses manqueront de cette grâce, de cet attrait qui les fait aimer ; les muses sans les vertus perdront toute décence et toute dignité. Les arts doivent relever la beauté de la vertu ; ils doivent aussi relever l’éclat de la noblesse. Dans ses lettres, dans ses discours, Ennodius ne tarit pas sur ce sujet; il ne cesse de rappeler aux jeunes héritiers des grands noms romains que, sans l’ornement des arts, sans la culture littéraire, la noblesse de leur race restera abîmée dans les misérables bas-fonds du vulgaire (Dict. vii, viii). Ce culte des belles-lettres, Ennodius le poussait jusqu’à l’enthousiasme. Il va jusqu’à écrire : « C’est une sainte chose que l’étude des lettres. On y apprend à fuir le vice avant d’en avoir l’expérience » (V, 10). C’est le contre-pied de la thèse de Rousseau que les arts ont corrompu les mœurs et fait le malheur de l’humanité. Ennodius, au contraire, attribue aux arts la civilisation du monde (Dict. xii). Il avoue lui-même ingénument que dès sa plus tendre enfance il professa pour les belles lettres un amour passionné (Opusc. v). Dès lors il avait conquis la faveur du public lettré. Il sentait vivement le prix de cette estime et se montra constamment préoccupé de la mériter. Il veillait à ce que rien de négligé ne tombât de sa plume, ou du moins ne circulât dans le public (Epis. V, 17 ; VI, 13). Poussé par cette passion de la forme littéraire, il s’efforçait d’en inspirer le souci à tous ceux qui le touchaient de près. Il reproche à sa sœur Euprépie de n’écrire que des billets d’un style insignifiant (VII, 8); il adresse également des remarques au sujet de son style, à la noble dame Stéphanie, sœur de Faustus (IX, 18). Il y a tout lieu de penser que, lors de son voyage en Gaule (494), comme secrétaire de saint Epiphane, son évêque, Ennodius n’avait pas manqué d’entrer en relations avec le célèbre grammairien Julien Pomère. Venu d’Afrique dans les Gaules, Pomère s’était fixé à Arles. Il y fut ordonné prêtre et y devint abbé. Sa réputation, comme grammairien, fut si grande, que les esprits les plus éminents, tels que les Césaire et les Rurice, se faisaient gloire de suivre ses leçons.[26] Ennodius écrivait assez fréquemment à Arles, où il comptait encore des parents et où résida longtemps sa sœur Euprépie. Une de ces lettres, écrite, parait-il, sans trop de soin, tomba sous les yeux de Pomère qui émit à son sujet une appréciation peu avantageuse. Ennodius en fut instruit et, blessé dans son amour-propre de Romain, il voulut justifier la vieille Italie. Il adresse au grammairien africain émigré sur les bords du Rhône les plus vifs éloges et reconnaît que l’Italie doit maintenant recevoir de la Gaule les trésors de la science. Puis il arrive au point essentiel : Pomère a recherché dans une lettre dictée sans soin ce que vaut la littérature d’Italie; scrutateur attentif, il a trouvé matière à limer, n’ayant sous les yeux qu’une ébauche; mais Claudien n’a-t-il pas écrit qu’Homère lui-même, père des poètes, a reçu les traits d’une sévère critique? Ennodius ne veut pas entrer en discussion sur leur mérite littéraire respectif, car il suffit à sa profession (de diacre) de s’appliquer à la doctrine. Il avoue toutefois ingénument que si lorsque, jeune encore, il était épris de beautés littéraires, quelqu’un l’eût blessé d’un pareil coup de dent, il n’eut pas manqué de fournir la réplique. « Maintenant, conclut-il, mon cher seigneur, portez- vous bien, et songez plutôt à me favoriser de vos enseignements sur les matières ecclésiastiques... Laissons les sujets profanes, semblables par leur frivolité à la trame de Pénélope (II, 6). Les derniers mots de la lettre à Pomère nous révèlent une immense révolution dans la république des lettres : le triomphe de l’esprit chrétien sur le paganisme littéraire. Malgré que depuis Constantin la religion chrétienne fut le culte officiel de l’empire, le paganisme restait vivace dans les mœurs romaines. A la fin du Ve siècle le pape Gélase eut toutes les peines du monde à abolir les Lupercales, fêtes païennes que, depuis la fondation de Rome, l’on célébrait dans la ville, le 15 février, en l’honneur de Pan. Il se trouva des Sénateurs chrétiens, entre autres Andromachus, frère de Faustus Maître des Offices, qui en firent des plaintes, et publièrent que les maux du jour venaient de ce que l’on ne célébrait plus ces fêtes païennes. Le pape dut écrire une apologie de son décret, et interdire aux chrétiens de célébrer ces fêtes. Le sénat se rendit aux avis de Gélase et abolit les Lupercales. Il dut interdire aussi, au moins pour un temps, les spectacles sanguinaires en usage à l’avènement des consuls. Ennodius nous apprend comme une chose nouvelle que l’argent autrefois dépensé par les nouveaux consuls à donner des jeux païens au cirque, était employé à vêtir les pauvres.[27] Cependant peu d’années plus tard, en 523, le sénateur Maxime, cet illustre chrétien pour le mariage duquel Ennodius, son ami, écrivit un si charmant épithalame (Carmin. I, 4), ne put se dispenser, à l’occasion de son élection au consulat, de donner au peuple, dans l’amphithéâtre de Titus, les jeux traditionnels où l’on faisait combattre en l’honneur de Diane les Gladiateurs contre des bêtes féroces. Cassiodore considère ces jeux païens et inhumains comme une nécessité[28] et n’y trouve d’autre remède que de payer largement les Gladiateurs. Mais le paganisme restait surtout cantonné dans la littérature. « La mythologie, a dit Ozanam, c’est le paganisme se perpétuant dans les lettres.[29] Claudien, le poète du Ve siècle, affecta d’être aussi païen qu’Homère et Virgile. Ces vieilles fables mythologiques, auxquelles personne ne croyait plus, restaient le thème préféré, sinon exclusif, des compositions littéraires. Ennodius se laissa d’abord entraîner par le courant; sous le charme des grands modèles classiques de l’antiquité, lui aussi adopta la mythologie comme sujet de ses vers. Les applaudissements prodigués à ces premiers essais contribuèrent encore à le pousser dans cette voie. Mais un jour vint où le jeune poète se sentit épris d’une science plus solide. Eclairé des lumières de la foi à l’école du grand évêque de Pavie, saint Epiphane, en même temps que son cœur aspira aux sublimes vertus chrétiennes, son esprit, avide de vérité, se porta, sous la conduite de Servilion, à l’étude des divines Ecritures, de la théologie et des saints canons (Epist. V, 14). En ce point, du reste, il ne faisait que suivre l’exemple des grands chrétiens de son temps. Les laïques instruits, surtout ceux qui pratiquaient le barreau ou les affaires publiques, avaient souci d’ajouter, comme complément nécessaire, aux sciences profanes les sciences sacrées. Il suffit de citer Boèce qui, laïque et ministre d’Etat, prêtait au souverain Pontife le concours de ses lumières pour réfuter les hérétiques, et se consolait de sa prison en écrivant sur les dogmes les plus élevés de la foi. Cassiodore nous apprend lui-même que, de concert avec le pape saint Agapet, il eut le projet d’établir à Rome, comme on le pratiquait autrefois à Alexandrie, et de son temps encore à Nisibe en Syrie, une chaire publique d’Ecriture sainte pour les laïques. Mais les guerres et les troubles qui bouleversaient l’Italie ne permirent pas d’y donner suite.[30] Lorsqu’à la suite de sa miraculeuse guérison, Ennodius se fut laissé ordonner diacre, une question capitale se posa pour lui : la question du paganisme littéraire. Le poète chrétien pouvait-il s’attacher aux fables de la mythologie? Pour dépouiller le vieux clinquant de la brillante parure mythologique, il ne fallait pas un mince courage à un poète aimé du public. Ennodius eut ce courage. Son ami, l’avocat Olybrius, lui avait adressé une composition où, sous l’allégorie de la lutte d’Hercule et d’Antée, il célébrait leur commune amitié. Ennodius relève le mérite littéraire de l’œuvre, mais il reproche aimablement à son éloquent ami de prendre dans la mythologie le sujet de ses écrits, et finalement il affirme cette conclusion : « Assez des vieilles fictions des poètes; répudions la fabuleuse antiquité. » Cessent anilium commenta pœtarum: fabulosa repudietur antiquitas (I, 19). Il convient néanmoins qu’on peut rajeunir certains récits de la fable pour en tirer d’utiles leçons. Ainsi Oreste et Pylade, Castor et Pollux, Nisus et Euryale peuvent offrir de beaux modèles d’amitié. De ce qu’Ennodius proscrivait les fables mythologiques de la littérature chrétienne, il ne faudrait pas conclure qu’il proscrivait également les classiques païens de l’enseignement. Nous ne pensons pas que cette question des classiques se soit même posée à son esprit. Les classiques païens d’Athènes et de Rome restaient les maîtres qu’il fallait nuit et jour feuilleter sur les bancs des écoles de poésie et d’éloquence. Il dit en propres termes d’Aviénus, dont lui-même avait dirigé les études : « La langue de l’Attique et celle de Rome n’ont pas eu pour lui de secrets ; il a voulu apprécier l’or de Démosthène et le fer de Cicéron. » (Epist., I, 5). Il voulait que ces modèles fussent lus assidûment. Il y revient constamment dans ses lettres aux jeunes gens (VI, 23 ; VII, 31). Il écrit à Johannis dont les premiers essais promet- talent beaucoup : « Redouble d’assiduité à l’étude, vise à la clarté dans tes discours, applique ton esprit à la lecture, afin que ton éloquence s’épure par le commerce de ces nombreux auteurs. » (I, 10). Enfin les sujets de devoirs écrits pour ses élèves nous fournissent la preuve manifeste qu’Ennodius ne songeait nullement à bannir la mythologie de l’enseignement. Ce sont, pour la plupart, des souvenirs de fables : Paroles de Thétis quand elle vit Achille mort; paroles de Ménélas à la vue de Troie en cendres; paroles de Junon lorsqu’elle vit Antée aussi fort qu’Hercule ; paroles de Didon en voyant Enée s’en aller. La muse convertie d’Ennodius ne sut même jamais se dépouiller complètement des vieux ajustements mythologiques. L’épithalame composé pour le mariage du sénateur Maxime (Carm. I, 4), malgré que ce poème chante en définitive le triomphe du christianisme sur le paganisme, nous en fournit un curieux exemple. Pour réaliser le programme pédagogique tracé par Ennodius il fallait d’autres maîtres que de vils mercenaires, faisant de l’éducation un vulgaire métier; il fallait des hommes comme Deutérius, à la fois vertueux et savants, dont l’exemple instruisit autant que les leçons. Et comme les jeunes étudiants courent grand risque de ne pas trouver ces maîtres dans les écoles, Ennodius leur signale ceux des personnages de Rome les plus distingués par leur naissance, leur talent et leur vertu, dont ils devront assidûment fréquenter les salons. Ce sont les patrices Festus et Symmaque, les patriciens Probinus, Céthègus, Boèce, Agapit; c’est Probus; c’est surtout Faustus. Qui n’admirera ces nobles patriciens, la plupart élevés aux plus hautes charges, ouvrant leurs salons aux jeunes étudiants de province, pour les sauver des mille dangers de la capitale? Les jeunes gens y trouvaient en outre un très grand profit intellectuel. Ces superbes demeures patriciennes étaient comme autant d’Académies où se donnait rendez-vous la société lettrée de Rome. Là se lisaient les poésies encore inédites des auteurs du jour. Là se critiquaient les derniers plaidoyers du Forum là se communiquaient les fines épîtres reçues des amis de province. Plus d’une fois la perspective des rigueurs de ces tribunaux sans appel, où ne manquaient pas de faux délicats « dont l’insupportable dédain méprisait tout et condamnait même ce qu’il y avait de mieux choisi » (I, 5), donna des inquiétudes à Ennodius. Plus d’une fois nous le surprenons suppliant ses correspondants d’épargner à sa lettre, qu’il juge trop peu châtiée, la censure de ce public (II, 20), où l’on avait accueilli si favorablement les œuvres littéraires de sa jeunesse (Opusc. v). Plus d’une fois aussi nous l’entendons menacer de ces mêmes rigueurs ses jeunes correspondants et leur inspirer par cette crainte salutaire, le souci du bon style (I, 10). Dans ces salons Faustus, Symmaque, Boèce et Probus étaient les arbitres du goût. On comprend sans peine quels avantages de jeunes étudiants devaient trouver à être admis dans un pareil milieu. A la fois encouragés et dirigés dans leurs études, ils y récitaient leurs premiers vers, ils y déclamaient leurs premières dictions. L’aiguillon de l’émulation doublait l’activité de leur esprit. Les succès de l’un obligeaient les autres, et l’obligeaient lui-même à se maintenir au niveau atteint. Comment Simplicianus se fût-il négligé après que sa diction eut mérité les éloges des hommes les plus doctes de Rome? (VII, 19). Aviénus pourrait-il déchoir lorsque ses premiers discours ont circulé de main en main et que tout le monde les a voulu lire? (II, 11). Dans ces salons académiques du VIe siècle, la dame romaine, l’antique matrone, devenue chrétienne, occupait un rang éminent. Son esprit cultivé ne se désintéressait point des questions de littérature ou d’enseignement, et sa vigilante sollicitude faisait retrouver aux jeunes étrangers leur mère absente. Sur la fin de la République les dames romaines étaient, en général, assez savantes pour s’intéresser à l’instruction de leurs fils et la surveiller avec intelligence. Quintilien les invitait expressément à remplir ce devoir, il sentait combien leur concours dans l’œuvre de l’éducation était précieux. Ennodius le sentait aussi et n’avait garde de négliger de si précieuses auxiliaires. Les grandes traditions de vertu et de science des Paule et des Stochie du siècle précédent, étaient encore en vigueur chez les dames romaines. Elpidie, fille du patrice Festus, que Boèce épousa en premières noces, écrivait d’élégantes poésies ; l’Eglise lui doit l’hymne des saints apôtres Pierre et Paul. Lorsque le moine africain, saint Fulgence, à son premier voyage à Rome (500), visita la maison du patrice Symmaque, il y trouva trois femmes aussi distinguées par la culture de leur esprit que par l’éminence de leurs vertus : la veuve Galla, la vierge Proba, consacrée à Dieu dès sa jeunesse et à laquelle Fulgence dédia ses deux traités de la Virginité et de la Prière, et Rusticienne que Boèce épousa après la mort d’Elpidie. Parmi ces nobles dames de Rome, Ennodius en désigne deux comme particulièrement dévouées au bien de ses jeunes amis, Barbara et Stéphanie. Ennodius avait connu Barbara dans le voyage qu’il fit à Rome vers 505. Béatus logeait sous son toit. Ces deux âmes se comprirent et s’apprécièrent. Dès lors, le diacre de Milan n’écrit plus à Rome sans penser à Barbara; jamais il ne cite le nom de la matrone, sans en faire le plus grand éloge. Les admirables lettres qu’il lui écrit témoignent de la sainte affection qu’il lui avait vouée, et révèlent une de ces grandes figures de Romaine chrétienne, oubliée à jamais dans la nuit de ces temps barbares si Ennodius n’eût buriné d’elle un portrait impérissable. Il veut que Béatus lui communique l’épitaphe de Cynégie qu’il a composée et il ajoute : « Saluez Fidèle, Marcellus, Georges, Solatius, Simplicianus. Dites-leur : Si vous avez à cœur de suivre la sage direction de la matrone Barbara, fréquentez sa maison, ses parents et ses frères. La chasteté y règne et le luxe en est banni. Celui qui tiendrait une autre conduite ne doit pas espérer revenir vers moi » (VII, 29). La noble veuve Stéphanie qu’Ennodius désigne à Ambroise et Béatus aux mêmes titres que Barbara, était sœur de Faustus. Le magnifique éloge qu’il en fait se trouve par là même pleinement justifié. En adressant l’épitaphe de Cynégie au prêtre Adéodat, Ennodius le prie de saluer pour lui la dame Stéphanie ainsi que la dame Sabiana et la dame Fadilla (VII, 28). Ces deux dernières appartenaient donc aussi à la maison de Faustus. L’œuvre d’éducation commencée sur les bancs de l’école de Grammaire, continuée à l’Auditorium et dans les salons littéraires de Rome, Ennodius la poursuivait avec non moins de zèle dans sa correspondance. On peut lire ses lettres à Béatus, à Arator, à Parthénius, à Messala. Il ne cesse d’adresser à ses jeunes amis d’utiles conseils et parfois de judicieuses critiques de leurs compositions. Un de ses grands soucis était de voir ces jeunes gens se former au style épistolaire. Il estimait que des fils de nobles familles devaient exceller dans ce genre de littérature (I, 11). Lui-même, dans une lettre à son ami Olybrius, trace du genre épistolaire des règles que l’on sera curieux de lire: « Comme le dit un personnage, d’une éloquence remarquable, c’est la règle du genre épistolaire d’être sans apprêt, et le comble du génie consiste dans une habile négligence. En ce genre, ce n’est qu’au détriment de l’agrément que l’on sue et que l’on se torture l’esprit. Qu’est-il besoin de mots forgés à l’enclume pour donner de ses nouvelles et en demander? Dans ces relations le mieux est de nous présenter le front dépouillé de tout ornement : l’intimité de la conversation répudie l’apparat du diadème. Le commerce épistolaire atteint sa perfection dès lors qu’il ne paraît pas y prétendre (II, 13). » Il faut avouer qu’Ennodius n’apporte pas toujours dans ses lettres la simplicité dont il fait ici la loi du style épistolaire les mots et les phrases « péniblement forgés à l’enclume » n’y font pas défaut, mais la règle n’en est pas moins juste et nettement formulée. Sa correspondance, offre néanmoins de beaux modèles de cette charmante simplicité. Citons encore ce qu’il écrit à Aviénus : « Chacun, il est vrai, donne ses lettres une forme subordonnée à son propre génie. Souvent vous y verrez dominer la solennité ; quelquefois vous y découvrirez les indices de la sincère affection qui les aura dictées ; mais le plus souvent, sous l’apparence trompeuse de l’amitié, lorsqu’on perce le voile et qu’on regarde au travers, on ne découvre au fond qu’un habile déguisement. « Pour moi, les pages sont le miroir de la conscience, L’absent ose à peine y rechercher les preuves de l’amitié, mais l’œil y distingue clairement ce que le discours y recèle de simplicité ou d’artifice. L’intelligence interprète de l’écriture, déchire les nuages de la parole : elle fauche dans les mots et s’ouvre un sentier qui la mène promptement au fond du sens. (III, 31). IIIAprès ce coup d’œil rapide jeté sur l’œuvre littéraire d’Ennodius, nous avons à considérer en lui l’avocat, et le rôle du barreau romain au commencement du VIe siècle. Nous l’avons déjà remarqué, Théodoric dépouilla le sanguinaire et grossier attirail de la barbarie pour adopter le raffinement administratif et social de la civilisation romaine. D’ailleurs le spectacle seul de cette civilisation et de ses œuvres exerçait sur l’imagination des Barbares un tel empire que tout en ruinant et foulant aux pieds la société romaine, ils faisaient tous leurs efforts pour l’imiter. Les meilleurs éléments du monde barbare venaient au-devant de l’influence romaine, prêts à se laisser absorber et transformer. Aussi par la force des choses, une fois les barbares établis dans l’Empire détruit, y eut-il un réveil puissant et fécond de la civilisation romaine. Elle domina et métamorphosa les vainqueurs. « Deux causes entre beaucoup d’autres, ont produit ce résultat : La puissance d’une législation civile forte et bien liée; l’ascendant naturel de la civilisation sur la barbarie[31] ». La loi romaine pouvait seule régler les rapports nouveaux qui s’établirent soit entre les nouveaux venus, soit entre eux et les romains. Seule cette loi était en mesure d’y suffire. Les Barbares, tout en conservant leurs coutumes, tout en demeurant les maîtres du pays, se trouvèrent pris, pour ainsi dire, dans les filets de cette législation savante. Ce fut la conséquence nécessaire du partage des terres. Pour fixer les Barbares au sol envahi et leur inspirer l’amour de la paix publique, il fallait les rendre propriétaires. Le partage des terres et des habitations, qui devait être si douloureux pour les romains dépossédés, s’opéra sans trop de difficulté (Cassiod. Var., II, 15, 16). Les conditions en furent empruntées, sans y presque rien changer, à la législation impériale sur les logements militaires. Les Barbares établis empruntaient de ce fait, à titre définitif, la condition de soldats romains logés chez l’habitant. La loi romaine attribuait à l’hôte un tiers du logement et laissait au propriétaire les deux tiers. Ce fut la règle suivie, sauf que parfois le barbare prit pour lui les deux tiers et ne laissa au propriétaire romain qu’un tiers pour sa part.[32] Ainsi le partage des terres fut en réalité non un acte de barbarie basé sur le droit du plus fort, mais une disposition légale basée sur le droit romain. Ce fut un romain, un ami d’Ennodius, le patrice Libérius (IX, 23), que Théodoric chargea d’opérer ce partage en Italie. « Mis en possession de leurs nouveaux domaines, les barbares cessèrent d’être un danger pour la propriété et pour La sécurité publique. Leurs intérêts se confondirent avec ceux du reste de la population. Et ces hommes, qui avaient été les plus cruels ennemis de l’ordre social, se virent amenés, par le jeu de la fortune, à en être les plus énergiques défenseurs ». Malgré le vieux préjugé dont s’inspirait l’aristocratie romaine pour repousser toute alliance avec les barbares, on voit, au temps d’Ennodius, la loi qui interdisait le mariage entre les Romains et les Barbares, n’être plus rigoureusement observée et les deux races fusionner. Parthénius, fils d’une sœur d’Ennodius, a pour père un Germain. Malheureusement, en Italie comme en Gaule, l’arianisme fut chez les Goths un obstacle permanent à la fusion de cette nation avec les Romains catholiques. En définitive les Barbares établis dans l’Empire se mêlaient peu aux Romains et il semble qu’il était naturel aux uns et aux autres de continuer à vivre chacun sous le régime de leur loi nationale. Mais dès lors qu’ils furent fixés au sol comme propriétaires et qu’ils eurent pris une part des terres romaines, les Barbares furent obligés d’adopter pour les conserver, le code qui les régissait. C’était alors le code Théodosien. Théodoric jouait trop à l’empereur romain pour y rien changer. Alaric II à Toulouse en fit publier en 506 une édition spéciale pour ses Wisigoths, et Gondebaud en donna une à ses Bourguignons.[33] Ainsi par la force des choses le droit romain survivait à l’Empire. Or les conquérants avaient beau posséder le sol et disposer même de l’autorité civile, ils n’échappaient pas aux querelles et aux procès ; procès entre eux, procès avec les habitants primitifs. Comment plaider, comment obtenir justice sans le concours des hommes qui possédaient la science du droit romain, en entendaient et en parlaient la langue et se trouvaient par leur éducation ou la pratique qu’ils en avaient déjà, initiés aux secrets de l’éloquence du barreau? En un mot, comment se passer des avocats et des jurisconsultes romains? L’élément barbare avait dominé tant qu’il était sur pied de guerre, mais dès lors que le Goth devenait citoyen, l’élément romain allait reprendre le dessus. Ennodius comprit à merveille la puissance du barreau dans cette société mixte. Par une conséquence nécessaire non seulement les charges judiciaires mais toutes les magistratures du nouvel Etat seraient recrutées, comme par le passé, dans le barreau romain. Ce ne serait plus, il est vrai, comme au temps de la puissance romaine, sous l’inspiration de la politique, puisque les Romains étaient les vaincus, mais par la nécessité où se trouvaient les souverains barbares et leurs peuples de recourir au talent et à la science des membres du barreau. L’homme de la parole, l’orateur demeura donc l’homme d’Etat par excellence de ces temps nouveaux, comme il l’avait été sous la République romaine, et encore longtemps après l’établissement du régime impérial. Pour rendre à l’aristocratie romaine l’influence que l’invasion des barbares lui avait fait perdre, lui remettre en main la direction des affaires publiques et finalement sauver par elle ce qui survivait de la civilisation romaine, il fallait la ramener à l’étude du droit. Cinquante ans auparavant Sidoine Apollinaire, tombé des marches du trône impérial dans l’obscurité de la vie privée et retiré dans sa villa d’Avitacum, avait déjà poussé le cri d’alarme. Il voyait l’aristocratie romaine se diviser en deux courants. Les uns, et c’était le grand nombre, fiers de leur supériorité et dédaigneux des faveurs des nouveaux maîtres barbares, acceptaient d’être exclus des charges publiques, renonçaient à l’espoir d’y parvenir et, retirés dans leurs terres, tombaient dans l’insouciance et s’abandonnaient aux douceurs de l’oisiveté. Une société de choix, le culte des arts et des lettres, charmaient leur luxueuse solitude. Tels Apollinaire, parent de Sidoine, à Voroange, et Tonance Ferréol à Prusianum, dans le voisinage de Nîmes; tel Léonce à Bourg, superbe villa sise sur les collines qui dominent le confluent de la Dordogne et de la Garonne.[34] D’autres, cependant, se plaçaient courageusement en face de la réalité, acceptaient le fait accompli, entraient dans les curies municipales, dans les tribunaux, et briguaient même les hauts emplois à la cour des rois barbares où leur supériorité n’avait pas trop de à se faire jour. Déjà Théodoric II formait sa cour de Toulouse de Gallo-Romains et d’évêques, et éloignait de son trône ses conseillers couverts de peaux.[35] Ennodius reprit énergiquement l’idée de Sidoine Apollinaire. Nous avons vu plus haut comment il s’employa de toutes ses forces à remettre en honneur parmi les fils de famille, le culte des lettres et de l’éloquence. Cet effort aura un brillant résultat. Comme par le passé le barreau sera le séminaire des dignités;[36] Ennodius pourra écrire au jeune Marcianus fils de Stéphanie sœur de Faustus et de l’avocat Astérius, avocat lui-même : « ... Certes la Ligurie n’est pas inféconde en hommes de mérite! elle nourrit pour le Forum des jeunes gens auxquels volontiers la Curie ouvrira ses portes. On sait qu’il n’y a pas loin de l’avocat au sénateur: à ceux qui honorent la toge, la tunique palmée sourit et leur ouvre ses plis » (V, 2). La tunique palmée était réservée aux consuls et autres hauts dignitaires. C’est encore ce que constate le roi Alaric lorsque, par la plume de Cassiodore, il annonce au Sénat qu’il a élu sénateur le questeur Félix: « ... Apprenez, dit-il, à connaître notre questeur et sachez qu’il a commencé à se rendre recommandable par l’exercice de l’éloquence. En plaidant comme avocat il remporta de si nombreuses victoires que son élection aux plus hautes dignités s’imposait d’elle-même... Orateur éloquent, avocat de grande autorité, sa renommée était déjà un gage de succès pour les causes qu’il acceptait de défendre; car on ne pouvait croire, qu’il fut impossible de démontrer le bon droit d’une cause qu’un tel avocat prenait en main. N’eusse point été un dommage public que de laisser de côté un tel homme ?... ».[37] Nous voyons en effet les jeunes amis d’Ennodius s’élever par l’éloquence et la science des lois aux plus hautes charges de la cour. Arator fut avocat renommé avant d’être promu, jeune encore, aux charges de secrétaire du palais et d’intendant des finances. Parthénius que nous trouvons en 544 maître des offices et Patrice,[38] avait charmé de son talent oratoire les peuples du Rhône et du Rhin; la douceur de sa parole avait ravi la cour des rois ; en Espagne et sur Le Danube, la foule accourait pour jouir de son éloquence « abondante comme les flots du Tage ». Citons encore les deux frères Décoratus et Honorat, jeunes Liguriens d’un rang modeste. D’abord avocats, Décoratus à Rome et Honorat à Spolète, ils parvinrent l’un et l’autre à la charge de questeur, c’est-à-dire de grand chancelier.[39] Cette même charge de questeur fut remplie par Ambroise, une première fois sous Théodoric, une seconde fois, en 527, sous son successeur Athalaric. Ainsi se vérifiait encore le mot de Sidoine Apollinaire que les avocats ne cessaient de plaider que pour être élevés aux dignités.[40] Cet effort, sans doute, n’aura qu’un résultat momentané. Malgré ce regain de vitalité, le vieux régime romain devra bientôt disparaitre; mais il y aura une période de transition qui permettra à l’Eglise Romaine de recevoir dans son sein les peuples nouveaux et de Les préparer au nouvel état politique de l’Europe qui sera le moyen-âge. Voilà pourquoi avec la conversion des peuples nouveaux au VIe siècle, l’ère du vieux monde romain se ferme d’une manière définitive. C’est plus qu’un fait d’ordre religieux, c’est le début d’une civilisation nouvelle. Des débris de l’Empire surgissent les nationalités. Mais si l’Eglise, par ses évêques et ses moines, prépara les peuples nouveaux à une civilisation nouvelle, ce ne fut point pour ruiner et abolir la civilisation romaine. Au contraire, le christianisme fut son arche de salut. L’Eglise était essentiellement romaine. Sa langue liturgique, ses basiliques, les arts quelle appelait à donner de l’éclat au culte, en un mot tout ce qu’il y avait d’humain en elle, lui venait de Rome. Aussi l’on peut dire que, l’empire détruit, l’Eglise resta l’héritière de la civilisation romaine christianisée, et la transmit dans la mesure du possible aux peuples nouveaux. Les évêques et les moines n’ont pas seulement sauvé les bibliothèques en transcrivant les manuscrits; c’est une de leurs gloires, mais il en est une autre, celle d’avoir sauvé, en les faisant adopter des barbares convertis, la civilisation et les arts de Rome. Ennodius constitue un des principaux anneaux de cette chaîne littéraire qui par Cassiodore, Isidore de Séville et Bède le Vénérable, se rattache à Alcuin pour transmettre aux écoles de Charlemagne et au Moyen-âge, les secrets de l’Antiquité. L’influence du barreau romain dans le monde nouveau issu de l’invasion des Barbares était accrue encore, par suite des immunités juridiques accordées à l’Eglise. A la barre des tribunaux ecclésiastiques aussi bien qu’à celle des tribunaux civils, l’élément romain comme la loi romaine dominaient exclusivement. Or au temps où le diacre Ennodius plaidait à leur barre, les tribunaux épiscopaux avaient acquis dans le monde romain une importance considérable. Leur juridiction était très large et comprenait non seulement les affaires ecclésiastiques proprement dites qui étaient exclusivement de leur ressort, mais aussi les affaires civiles. La première épître de saint Paul aux Corinthiens est la charte fondamentale des tribunaux épiscopaux. L’apôtre veut que les chrétiens ne prennent pour juges que des chrétiens et qu’ils désignent eux-mêmes quelqu’un pour remplir cette parmi eux (I, Cor. vi). Saint Clément commente le texte de saint Paul: Les chrétiens ne doivent pas recourir à des juges païens. Il règle la procédure d’après les constitutions des Apôtres: Les audiences auront lieu le lundi et pourront se poursuivre, si c’est nécessaire, jusques au samedi. Les diacres et les prêtres siègeront et jugeront, comme des hommes de Dieu, en toute justice. Les deux plaideurs s’étant présentés, comme la loi l’ordonne, comparaitront ensemble devant le tribunal. Ils seront entendus, après quoi te jugement sera prononcé en toute conscience. Mais auparavant les juges auront fait tous leurs efforts pour les amener, par l’intervention de l’évêque, à un arrangement à l’amiable.[41] Nous trouvons sous le règne de Constantin les évêques en pleine possession d’exercer les fonctions de juges. Le préfet du prétoire Ablavius demanda au prince quel cas il devait faire des jugements ainsi rendus par les évêques. Constantin lui répondit par un rescrit où il fait allusion à des dispositions antérieures prises par lui dans Le même sens, les résume et les remet en vigueur. Il y décide deux points essentiels : D’une part les sentences des évêques, sous quelque forme qu’elles soient rendues et quelle que soit la nature de la cause, doivent être tenues pour décisives, sans appel et absolument exécutoires. D’autre part quelle que soit l’affaire en litige, qu’elle soit à son origine ou déjà engagée devant un tribunal civil, que l’on en soit aux plaidoiries ou que même le tribunal ait déjà commencé à prononcer la sentence, dès l’instant que l’une des parties choisit d’être jugée par l’évêque, lors même que la partie adverse s’y refuserait, le tribunal est dessaisi et, sur le champ, sans hésitation, l’affaire est dévolue à l’évêque dont le jugement restera sans appel. Constantin ajoute pour le cas où l’évêque est cité comme témoin, que le témoignage d’un seul évêque suffit et qu’après ce témoignage il n’y a pas lieu d’entendre d’autres témoins.[42] Des faits nombreux prouvent qu’en réalité les évêques, dès les premiers temps de l’Eglise et dans la suite, exercèrent parmi leurs chrétiens, la fonction de juge, même en ce qui concerne les affaires civiles. Saint Grégoire le Thaumaturge rendait la justice à Néocésarée.[43] Saint Ambroise était si accablé par la multitude d’affaires qu’il avait à juger, qu’à peine lui laissait-on le temps de respirer.[44] Comme l’indique le rescrit de Constantin, tantôt les parties en litige prenaient tout d’abord l’évêque pour juge; tantôt elles en appelaient à l’évêque de la sentence rendue par les juges séculiers, pour la faire casser ou réformer. On trouve dans saint Ambroise des exemples de ces deux cas. Sur le premier il écrit qu’en vertu du précepte de l’Apôtre et de l’autorité dont il est revêtu, il a rendu la justice, et ce sont les parties qui l’ont exigé de lui.[45] Ailleurs, il affirme qu’il a cassé d’injustes sentences des magistrats et même des jugements confirmés par rescrit des empereurs contraires à la justice.[46] Ainsi même les sentences impériales n’étaient pas au dessus du jugement de l’évêque et l’on pouvait en appeler à son tribunal.[47] Les évêques se plaignirent souvent de l’inconvénient qu’il y avait pour eux d’avoir à se consacrer à ces fonctions judiciaires. Synésius, évêque de Ptolémaïde en Egypte, s’en trouvait si accablé, l’obligation de juger les causes séculières lui inspirait une telle répugnance qu’il supplia pour ce motif l’assemblée des évêques de le de charger de l’épiscopat, mais il ne put l’obtenir. Du reste, lorsque le devoir de sa charge l’exigeait. Synésius ne reculait pas devant l’obligation de rendre la justice. Le préfet de la province Andronicus et le magistrat Tonans abusaient de leur autorité pour commettre des injustices. Synésius les jugea et prononça contre eux la sentence d’excommunication. Par un rescrit daté de Milan et adressé au préfet du Prétoire Eutychianus, Honorius, en 398, remit en vigueur la loi de Constantin sur le pouvoir judiciaire des évêques, en la mitigeant dans une certaine mesure. Il faut que les deux parties soient d’accord d’en référer au jugement de l’évêque. Nul ne peut être cité malgré lui devant ce juge. D’autre part l’évêque lui-même ne remplit cet office que parce qu’il le veut bien et ne siège que de son plein gré.[48] Il est vrai que les évêques considéraient la fonction de juge comme une obligation de leur ministère dont ils ne pouvaient se dispenser. Saint Augustin se plaint que les plaideurs l’assiègent et ne lui laissent aucun loisir pour vaquer à l’oraison et à l’étude. Il a beau s’efforcer de les éloigner par de pressantes exhortations sur le mépris des biens de la terre, il n’y gagne rien. Bien loin de se retirer, ils insistent, ils pressent, ils supplient, ils font du tumulte, finalement ils s’imposent et l’obligent à juger.[49] Son historien Possidius raconte que sollicité non seulement par les chrétiens mais encore par les partisans de n’importe quelle secte, le saint évêque écoulait les causes avec une attention pleine de bonté. Il prolongeait l’audience jusques à l’heure des repas et même parfois, à jeun, jusques à la fin du jour. Il ne négligeait point de donner à ses clients des conseils salutaires à leur âme et ne leur demandait pas autre chose que d’être dociles à sa voix et de pratiquer fidèlement les vertus chrétiennes. Souvent on le consultait sur les affaires et il donnait par lettres des conseils.[50] Un pouvoir judiciaire si absolu exercé par les évêques, leur donnait au milieu des peuples un prestige considérable, et saint Augustin remarque malicieusement que les plaideurs le saluent chapeau bas. Quoique les évêques jugeassent les affaires des laïques, les proconsuls et les préfets des provinces ne se mêlaient nullement des affaires des clercs. Tout au plus écrivaient-ils parfois sur ces affaires à l’évêque, mais l’évêque en restait le juge absolu et unique. Au concile de Chalcédoine, Dioscore, évêque d’Alexandrie, fut jugé par les seuls évêques. Or l’accusation relevait contre lui plusieurs griefs de droit commun. Gratien prescrivit que l’on observât pour les affaires ecclésiastiques la procédure en usage dans les causes civiles. D’après ce rescrit daté de Trèves, 1er juin 376, les causes criminelles, surtout celles qui peuvent entraîner la peine capitale, restent dévolues aux juges séculiers. Par un rescrit adressé à Optat, préfet d’Egypte (385), Théodose indique d’une manière formelle que les affaires des clercs doivent êtres jugées par les évêques.[51] C’était la pratique constante; les empereurs y tenaient la main et s’il y eut des tentatives de dérogation, elles vinrent des ecclésiastiques en cause qui fuyaient le jugement de leurs pairs. Une conséquence immédiate de l’autorité judiciaire reconnue aux évêques par les pouvoirs publics, fut de les faire « entrer en partage du genre d’autorité exercé dans la société romaine par les jurisconsultes; ils participèrent comme eux à la législation et les lois nouvelles reçurent l’empreinte manifeste et inévitable du christianisme)[52] ». Alaric II ne promulgua son édition du code Théodosien révisé, abrégé, annoté à l’usage de ses sujets, et n’en rendit par décret les lois exécutoires qu’après en avoir soumis le texte rédigé par une commission de jurisconsultes et de prêtres, à l’approbation des évêques. Ainsi l’autorité juridique des évêques s’imposait même aux princes ariens comme était Alaric II. C’est qu’en effet l’évêque du Ve siècle, n’est pas seulement le pasteur des âmes, le docteur des intelligences, le guide dans la foi; l’évêque est le gardien vigilant, le défenseur, le père de la cité. Valentinien I avait créé la fonction de défenseur de la cité defensor civitatis ou defensor populi. Cette magistrature élective alla naturellement aux évêques, tout désignés pour l’exercer et dans la suite ils en furent titulaires de droit.[53] Cyr et son territoire, par le fait de l’animosité d’un haut personnage, n’avait pas bénéficié d’une remise générale d’impôts et restait lourdement grevée. L’évêque, Théodoret, prit en main la cause de son peuple. Il écrivit à Proclus, patriarche de Constantinople, et le pria de plaider la cause de sa ville auprès du préfet du Prétoire et de celui de la province. Il en écrivit à l’impératrice Pulchérie elle-même. Il lui dépeint la misère extrême où sont réduits ses diocésains, les champs non cultivés, d’autres abandonnés; les citoyens obligés de payer les impôts pour ceux qui ont déserté: les uns réduits à la mendicité, les autres à la fuite. Une lettre au consul Momus nous apprends que Théodoret a édifié, à l’entrée des églises, des portiques ouverts au public; il a construit deux grands ponts; il s’est préoccupé de doter sa ville de bains publics et, comme il l’avait trouvée dépourvue d’eau de source, il a établi un aqueduc et cette cité qui manquait d’eau, en est maintenant inondée. En administrateur soucieux de la prospérité de sa ville, son premier soin fut d’y amener des hommes expérimentés en tous les arts nécessaires. Il y attira d’habiles médecins et les détermina à s’y fixer. Au nombre de ces derniers il cite comme un homme qui honore son art et l’exerce avec succès le prêtre Pierre.[54] Si les prêtres étaient admis, sous le patronage de l’évêque, à pratiquer l’art de la médecine, à plus forte raison les clercs pouvaient-ils exercer la profession d’avocat. Du reste dès lors qu’il y avait des tribunaux épiscopaux où se jugeaient non seulement les causes des clercs mais aussi celles des laïques qui en appelaient à l’évêque, ou choisissaient de préférence sa juridiction pour le règlement de leurs affaires, ces tribunaux eurent non seulement leurs juges ecclésiastiques mais aussi leurs avocats, selon le mode du barreau romain. Il en résulta l’institution d’un barreau d’Eglise. Il arriva sans doute aussi que les mêmes avocats plaidaient tantôt devant les tribunaux civils, tantôt devant le tribunal de l’évêque. Ou bien encore un avocat civil, qui entrait dans le clergé, comme Ennodius, ajoutait à ses premières fonctions qu’il continuait à exercer, celles d’avocat ecclésiastique. La correspondance d’Ennodius montre l’avocat en exercice dans ce vieux monde romain tombé aux mains des Barbares. Ses lettres révèlent les mœurs juridiques au VIe siècle comme au siècle d’Auguste les discours de Cicéron. Ennodius, romain dans l’âme, a suivi la vieille tradition qui voulait que toute l’éducation convergeât vers l’éloquence, que tout romain fut orateur, que tout citoyen fut avocat. Son talent est très apprécié et il déclare avec modestie que sans avoir le mérite de la science et de l’érudition, il a souvent à soutenir, dans les causes qu’il plaide, la réputation de parfait avocat (II, 27). Il est très soucieux de la mériter. Citoyens et clercs lui confient leurs causes et il se prête à tous (VII, 12), preuve qu’il plaide aussi bien à la barre des tribunaux civils qu’à celle des tribunaux ecclésiastiques. D’autres passages de ses lettres précisent ce fait et le rendent évident. Il va plaider s Ravenne à la demande de Senarius, un des dignitaires de la Cour (VI, 27); chargé par l’abbé Etienne d’une affaire où ses moines avaient à plaider contre un misérable clerc devant l’évêque de Milan, il se défie de la vénalité trop connue des juges milanais, qui sûrement étaient des laïques, car il conseille à l’abbé d’envoyer à Ravenne solliciter l’appui de Faustus. En sa qualité de Préfet du Prétoire ou de Questeur, Faustus avait tout pouvoir sur les juges civils. Il lui appartenait de les instituer, de les révoquer, de châtier les juges provinciaux prévaricateurs (III, 4). Lorsqu’il plaidait cette affaire Ennodius avait renoncé à la vie mondaine. Très lié avec l’illustre avocat Olybrius dont il célèbre l’éloquence et que Cassiodore appelle le Grand Olybrius[55] il se recommande à lui comme avocat des causes ecclésiastiques et le prie, s’il a quelque affaire avec l’Eglise, de la lui confier de préférence, invoquant du reste le dévouement qu’il a mis dans diverses causes auxquelles Olybrius s’était particulièrement intéressé (II, 13). C’est bien en qualité d’avocat ecclésiastique qu’il doit plaider une cause où l’évêque (de Milan) se trouve engagé, et qui est soumise à l’arbitrage d’Agapit (V, 26). Au contraire, c’est comme avocat civil qu’il recommande à Faustus un de ses clients évincé de son héritage et auquel il le prie de rendre bonne justice en réformant le jugement qui l’a condamné. Ce client en appelait donc des juges ordinaires au questeur du palais qui connaissait des appels et Ennodius, son avocat, appuyait son appel (IV, 15). Il est consulté par ses clients et c’est encore comme avocat qu’il dicte pour une personne dont le nom reste inconnu, la formule d’une lettre testamentaire (IV, 4). Ce texte offre un très grand intérêt pour l’histoire du droit. Sous le Droit Romain on pouvait tester même par une simple lettre. (Cod. Théod., iv, tit. iv). Ces testaments par lettres (epistolœ) comme le testament olographe proprement dit, devaient être signés de sept ou cinq témoins. Le texte latin de cette formule est remarquable ... Dono, in fraternitatem tuam confero et juri tuo perpetua libertate transfundo mancipium juris mei illud et cœtera. Le terme mancipium doit être pris ici comme l’expression la plus absolue de la propriété. Il y a cette différence entre dominium et mancipium, que dominium signifie le droit de propriétaire (dominus) sur la chose, et mancipium l’objet même possédé en tant que propriété du possesseur. Ce sens est précisé dans un vers de Lucrèce: Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu. La vie n’est donnée à personne en propriété, mais à tous en usage. Dans trois lettres (V, 25, VI, 13 et 14) qu’il écrit au juge Avitus, comme avocat du fils de Sabinus, Ennodius donne un curieux spécimen des démarches officieuses qu’un avocat devait faire en secret auprès du juge pour assurer le succès d’une cause même bonne. On y voit aussi une allusion aux moyens dilatoires employés pour échapper à un arrêt. N’est-ce point aussi comme avocat qu’il écrit à Faustus (VIII, 18) pour appuyer la demande d’un plaideur, lequel pour s’assurer de son bon droit, veut soumettre sa cause à l’examen d’un jurisconsulte aussi renommé. Il fait allusion à son devoir professionnel d’avocat (III, 33). En cette qualité il déclare juste la cause de Dalmatius qu’il recommande à Faustus (IV, 5). C’est bien en homme d’affaire qu’au sujet d’une entrée en possession qui l’intéresse personnellement, il écrit à Faustus (IX, 22). Au même titre il est chargé par Opilion de négocier une affaire dont la solution dépend d’Agnellus, fonctionnaire d’une cupidité insatiable et qui attend qu’on lui offre un bon prix (V, 3). Orateur du barreau par profession, Ennodius se retrouve avocat dans plusieurs de ses écrits auxquels il a donné la forme de véritables plaidoyers. Le plus important et le plus connu est son Apologie en faveur du IVe concile tenu à Rome sous le pape Symmaque.[56] Nous avons donné ailleurs une analyse détaillée de cet opuscule.[57] Qu’on nous permette d’en reproduire ces quelques lignes : « Quelques jours suffirent au jeune avocat, ami particulier du pape Symmaque, pour rédiger de son style d’acier ce magnifique plaidoyer. Rapide et puissant comme le torrent qui tombe des montagnes, Ennodius renverse et « pulvérise » l’une après l’autre les objections des schismatiques. Il parle plutôt qu’il n’écrit. Il sent qu’il ne s’adresse pas seulement à quelques esprits d’élite, comme dans une plaidoirie vulgaire. C’est la cause de l’Eglise Romaine qu’il plaide, et Rome toute entière l’écoute, Rome qui, depuis cinq ans, souffre du schisme et des schismatiques. Aussi, dans cet écrit, unique en son genre, trouvons-nous réunis, à la rigueur du plaidoyer la noble grandeur de la harangue, à la causticité du pamphlet les tendres élans de l’homélie. Au point de vue littéraire, on peut dire que les talents d’Ennodius brillent de tout leur éclat dans l’Apologie, comme aussi ses défauts. Malgré ces derniers, l’Apologie pour le IVe concile reste un chef-d’œuvre d’éloquence digne de figurer à côté de ce que l’antiquité nous a laissé de plus beau » (p. 53). C’est encore sous forme de plaidoyer et dans le style du barreau qu’il écrivit à l’avocat Constantius la belle lettre où il expose la doctrine du libre-arbitre (II, 19). Le théologien y argumente comme s’il plaidait une cause. Il n’omet même pas cette précaution oratoire classique de l’avocat : « La seule chose que je demande c’est que mon écrit soit apprécié à ma mesure, et que l’on ne considère pas comme une lacune de la loi ou un vice de la cause que j’entreprends de défendre, ce qui doit être attribué à mon ignorance ». Nous ne signalons que pour mémoire les dictions, ou corrigés de devoirs qu’Ennodius donnait à ses jeunes élèves pour les initier aux secrets de l’éloquence judiciaire et qui par conséquent ne sont autre chose que des modèles de plaidoyers. Nous en avons longuement parlé ailleurs.[58] Dans les autres écrits, surtout dans ses lettres, Ennodius emploie fréquemment la langue du barreau et l’on ne peut avoir l’intelligence de ces métaphores qu’en ne perdant pas de vue que c’est un avocat qui écrit. Eu voici quelques exemples A l’abbé Etienne (III, 4). « Aidez-moi donc de vos prières. Car à ce que je vois par vos lettres, ce n’est pas en vain que vous prêtez assistance. D’ailleurs ne furent-ils pas vos clients (nam et isti suscepti sunt...) ceux qui m’ont obtenu les biens dont je suis si heureux? » VII, 3. Qui amantem de his, quœ recens sunt acta, convenerit... en langue du barreau ce dernier verbe signifie accuser en justice quelqu’un, et ici, par conséquent, adresser à un ami des reproches... Dans la suite de la même phrase opponit a le sens juridique d’objecter comme chef d’accusation dans un plaidoyer. VII, 18. Cum defero... signifie proprement dénoncer en justice en remplissant l’office d’avocat général qui accuse avec un dossier de preuves. VII, 26. . . .Felicissirna defensionis sorte adsumus innocentibus... « La défense nous est bien facile dès lors que nous plaidons pour l’innocence. » Cette phrase dénonce bien l’avocat de profession. III, 24. . . .Hoc ad defensionem integram quod prœtuli compulabo. « J’estime que ce que j’ai dit suffit à ma complète défense » IV, 16. .. .Adsum partibus meis... « Je plaide la cause de mes clients. » I, 23. . . . Ne de amoris, credo, testimonio, animorum indices, epistulas convenirem. « Pour que je ne puisse tenir sous la main, comme témoignage de votre amitié, des lettres révélatrices de vos sentiments. » Il compare ces lettres à des témoins que l’on réunit, que l’on amène et que l’on produit pour appuyer sa cause. III, 11. ... Hunc tantum fructum de caritate possedi, quem incognitus provisione subtraxi. « De votre amitié je n’ai possédé d’autre fruit que ce que j’ai pu, encore inconnu, soustraire par provision. » IX, 2. Et causa et persona, cum Dei solacio, vestro disponatur studio. « Avec la grâce de Dieu, prenez en main et la cause et la personne. » Par ces mots qui semblent adressés à un avocat que l’on charge d’une cause, Ennodius prie Faustus de se constituer le patron du jeune Ambroise à Rome et de le gouverner dans sa vie d’étudiant. VI, 2. Refundo ergo depositum officii lege constrictus. « Je restitue donc le dépôt, lié par le devoir professionnel... » Ce porteur qu’il renvoie à Faustus, il le compare à un dossier que lui, avocat, après en avoir pris connaissance, remet à un autre avocat. Si Ennodius payait ce tribut à la langue du droit, ce n’était point qu’elle eut pour lui des charmes; ses goûts de fin lettré n’y trouvaient point leur compte, au contraire, comme le prouve cette boutade adressée au jeune avocat Honorat: « Appliquez plutôt votre talent à l’étude des rudes textes du droit, bien propres à fournir aux exigences de la langue la plus barbare (II, 27). Bornons-là ces citations. Elles suffisent à indiquer que pour entendre la langue d’Ennodius il ne faut pas que le poète, le professeur ou le diacre fassent perdre de vue l’avocat. Pour le surplus nous renvoyons le lecteur au magistral ouvrage de M. Augustin Dubois sur La Latinité d’Ennodius,[59] livre infiniment précieux pour quiconque voudra pénétrer les arcanes de cette latinité. Dans le système si complexe de l’administration romaine, des emplois publics correspondaient à toutes les institutions. Hadrien établit que la vingtième partie des héritages reviendrait au fisc. Pour assurer l’exécution de cette prescription, il institua la charge d’Avocat du Fisc. Le fisc romain avait des ramifications très étendues ; il comprenait le Trésor public de l’Empire, le Trésor privé du Prince et la caisse du Préfet. En outre des droits de succession fixés par Hadrien, le fisc se saisissait des biens vacants et tombés en déshérence. L’avocat du fisc était chargé de défendre les intérêts du fisc, à Rome, soit au conseil du Prince, soit auprès du Préfet du Prétoire, du Préfet de la ville, du Maître des Offices, du comte des Largesses Sacrées, du Préfet du Trésor. En province, il intervenait auprès de l’intendant impérial, du Proconsul ou du Gouverneur. Il n’accusait point de lui-même les détenteurs des biens du fisc, mais il devait produire un accusateur dont il appuyait la délation. En province, il présidait aux inventaires, et le Proconsul ou le Gouverneur ne pouvaient sans son concours faire une enquête sur les biens vacants. La loi prononçait des peines contre les délateurs qui dénonçaient, sans l’intervention de l’avocat du fisc, des biens vacants, caducs, soustraits, détenus par personnes interposées et fidéicommis, des esclaves vagabonds, la découverte d’un trésor. L’avocat du fisc ne gardait d’ordinaire cette charge que deux ans. Au bout de ce temps, il ne revenait point au barreau, mais recevait quelque charge plus élevée. D’après la règle du droit les avocats du fisc étaient pris dans le corps des avocats selon l’ordre de leur inscription au tableau; mais Ennodius (I, 26) et Cassiodore (I Var., 22) nous font connaître que le Prince s’en réservait le choix. De là les brigues, signalées par Ennodius (ibid.) pour obtenir une charge qui, en outre des avantages légaux, offrait un vaste champ aux exactions de la cupidité. Les deux avocats du fisc attachés à la Préfecture du Prétoire étaient admis, le jour des Calendes de Janvier, parmi les Honorables Comtes du Conseil Sacré, à recevoir la gratification marquée de la main du Prince. En outre six cents aurei leur étaient payés aux Calendes d’Octobre et la Préfecture du Prétoire leur comptait chaque année soixante livres d’or, à se partager entre eux deux. Aux avantages pécuniaires s’ajoutaient divers privilèges pour eux et leurs enfants. Un mot de la lettre de Cassiodore au Sénateur Marcellus nommé à cette charge, laisse deviner comment l’avocat du fisc pouvait être la terreur d’une Province: « ... Marche dans le sentier de la justice, de manière à ne pas rendre les innocents victimes de la calomnie, et à ne pas laisser les détenteurs au-dessus des justes réclamations. Il est préférable que le fisc perde une cause que de la gagner contrairement à la justice... Ce n’est pas la puissance impériale mais le droit qui doit le faire triompher... » (I Var., 22). On voit, par ces recommandations, combien la charge d’avocat du fisc offrait de prise à la critique et soulevait l’animadversion publique. D’ailleurs l’avocat du fisc n’était-il pas le pourvoyeur attitré de la rapacité proverbiale des Intendants impériaux? L’Empereur lui-même en était réduit à fermer les yeux et n’avait d’autre moyen de mettre un terme à ces exactions professionnelles que d’élever les Intendants enrichis à un autre emploi. La profession d’avocat fut toujours considérée à Rome comme très honorable et, sous la République, les plus grands personnages, les Crassus, les Antoine, les Cicéron, après avoir rempli les premières charges de l’Etat, et même reçu le suprême honneur du triomphe, ne dédaignaient point de reparaître au Forum comme simples avocats, et d’y plaider. Le nombre des avocats en exercice n’était pas illimité. Le barreau de chaque tribunal comprenait un nombre fixe d’avocats inscrits au tableau. Le barreau du Prétoire comptait cent cinquante avocats. Ces avocats réguliers se distinguaient des surnuméraires qui pouvaient plaider devant le Proconsul ou le Comte d’Orient, ou devant les Gouverneurs de provinces. Et encore le nombre de ces derniers était-il déterminé; Le barreau d’Alexandrie comptait cinquante avocats; le Proconsul et le Comes Privatarum en avaient le même nombre. Le tribunal du Gouverneur de Syrie en avait trente; celui du Comte d’Orient, quarante ; celui du Préfet de la Ville, quatre-vingt. Tous les avocats inscrits n’avaient pas les mêmes privilèges. Les soixante-quatre premiers au tableau du Préfet du Prétoire, et les quinze premiers à celui du Préfet de la Ville, jouissaient des faveurs impériales accordées aux avocats du fisc et à leurs enfants. La charge d’avocat n’était pas perpétuelle, et les anciens, au bout du temps marqué, devaient faire place aux nouveaux. Mais, selon le mot de Sidoine Apollinaire, ils ne quittaient le barreau que pour être élevés aux dignités (I, ep. 11). Comme pour le service militaire, la durée de la charge d’avocat était de vingt ans. Mais souvent il arrivait qu’avant l’expiration de ce terme, l’Empereur prenait parmi les membres les plus distingués du barreau ses avocats du fisc et ses divers ministres. Ces faveurs étaient attribuées aux avocats en considération de l’Ordre.[60] Les avocats attachés aux barreaux de province eurent à l’expiration de leurs fonctions, d’autres privilèges encore. Ils demeuraient dispensés du soin de pourvoir à l’approvisionnement de froment et d’huile, d’inspecter les travaux publics, d’en faire le compte, de pourvoir à la défense de la cité, etc. Ils n’étaient pas appelés d’office à faire partie de la Curie ou des collèges administratifs, toutes charges très onéreuses et qu’il fallait imposer. Ennodius était avocat en province. En principe l’office d’avocat était gratuit. Le défenseur était censé plaider par amitié et dévouement à une bonne cause, non pour de l’argent. Mais les avocats, sans exiger de leurs clients des honoraires proprement dits, trouvaient mille moyens de les exploiter, et l’on en voyait accumuler ainsi des fortunes scandaleuses. Par les dons qu’ils se faisaient attribuer, ils dépouillaient impitoyablement les malheureux qui recouraient à leur office. Constantin adressa sur ce sujet à Bassus un rescrit où il flétrit la rapacité des avocats et déclare que ceux qui se livrent à de telles exactions doivent être bannis de la société des honnêtes gens et exclus des tribunaux.[61] Ce rescrit de Constantin suffit à nous révéler pourquoi l’Empereur ne suivait pas toujours l’ordre d’inscription au tableau lorsqu’il prenait parmi les membres du barreau les Avocats du fisc, les Sénateurs, les maîtres des Secrétariats, les maîtres des Offices, les Questeurs du Sacré Palais et les autres dignitaires. Les secrétariats occupaient dans l’administration du Sacré Palais une place très importante. La bureaucratie florissait à Rome et notre bureaucratie moderne n’est que le prolongement de la bureaucratie romaine. Il y avait à Rome quatre secrétariats Le secrétariat de la Mémoire; Celui des Lettres Celui des Libelles; Celui des Dispositions. Le maître de la Mémoire était un comte de premier ordre, que le Prince élevait presque toujours aux plus illustres dignités. Il dictait au Prince les annotations qu’il apposait de sa main aux suppliques, soit en marge, soit au revers de la page. Les lettres des empereurs furent une source du Droit. Il importait donc de les conserver avec soin. Les premiers empereurs eurent des affranchis pour secrétaires. Mais depuis Hadrien, les lettres et discours des empereurs furent dictés par le maître du secrétariat des lettres. Il y avait deux bureaux, celui des lettres grecques et celui des lettres latines. Le particulier ou la ville qui désirait obtenir quelque chose de l’Empereur, adressait au prince un Libelle où étaient exposés les motifs de la supplique. Le Maître des Libelles rédigeait les réponses ou rescrits. Ces rescrits conservés au secrétariat, constituaient une des principales sources du droit civil et de son interprétation. Le fameux Narcisse, sous Claude, exerça cet emploi. On appelait Dispositions tout ce que le Prince réglait en dehors des prescriptions légales les constitutions, les édits, les promotions aux honneurs, les ordonnances, les coutumes, etc. Ces ordonnances étaient durables et générales. Le Maître ou Comte des Dispositions avait sous sa surveillance le secrétariat où ces pièces étaient conservées avec les livres de l’Empire. Il faisait fonction d’archiviste. Chaque bureau du secrétariat était desservi par des secrétaires adjoints dont le nombre était fixé : soixante-deux à la Mémoire, trente-quatre aux Lettres et trente-quatre aux Libelles. A ces employés s’ajoutaient les copistes, désignés sous le nom d’Antiquarii, pour transcrire les manuscrits de la bibliothèque impériale, les gardiens des registres, les expéditionnaires, les rédacteurs et transcripteurs. Tous ces employés avaient besoin de connaître le droit et par suite devaient se recruter de préférence dans le monde du barreau. Au secrétariat de la Mémoire était gardé le Grand Registre ou Laterculum que le Primicier des notaires avait en main. Dans ce registre était consignée l’énumération des dignités et des charges tant civiles que militaires, Notitia imperii, les ordonnances du Prince, les promotions et les coutumes. Les services du Grand Registre comprenaient quatre bureaux que dirigeait le Primicier des notaires. Le premier bureau était affecté aux dignités civiles ; le second aux dignités militaires; le troisième aux ordonnances et promotions; le quatrième aux coutumes. Le Primicier des notaires avait sous lui dix tribuns ou comtes des notaires. C’était une dignité considérable. Les notaires du Prince furent souvent élevés aux dignités illustres telles que la Préfecture, le Consulat, la Maîtrise des Offices; d’autres furent envoyés avec pleins pouvoirs dans les provinces, ou bien en ambassade auprès des souverains. En outre des notaires du Prince il y avait des notaires d’un rang inférieur, dont la principale fonction était de rédiger l’état des impôts où figurait le nom des contribuables et la somme due par chacun d’eux. Il est question dans la correspondance d’Ennodius d’un de ces notaires ou chartiers (VII, 1.) IVThéodoric ne changea rien à la constitution de l’Empire. Il avait la prétention de soutenir le parallèle avec l’empereur romain de Constantinople. Pour le romain, Dieu communiquait au Prince sa majesté souveraine et le Prince en faisait part à tous ceux qu’il appelait à collaborer avec lui au gouvernement. De là le qualificatif de divin donné aux empereurs et à tout ce qui les touche ou émane d’eux. Leur personne est sacrée, comme aussi leur palais et tout ce qu’il renferme, même les écuries (sacrum stabulum). Aussi toute charge dans le palais comporte-t-elle une dignité éminente. L’Empire est administré comme une seule maison par un pouvoir unique et absolu qui est la volonté du Prince. En cette volonté suprême et toute puissante le Prince centralise tout. La loi n’en est que l’expression; les magistratures diverses, les charges civiles ou militaires, les emplois du Palais et les dignités en sont les organes. La plupart des correspondants d’Ennodius furent pourvus de ces charges et de ces emplois, ennoblis de ces titres honorifiques. Il importe donc d’en donner ici un exposé succinct.[62] Sous la République on ne connaissait que deux titres honorifiques: Majesta.s Populi, Amplitudo Senatus. On donnait le titre de clarissimus aux sénateurs et à ceux de leur maison. Sous l’empire les titres se multiplient et se précisent. Les principaux sont ceux de Clarissime, Spectable, Illustre. Les Clarissimes (V. C.) sont les gouverneurs de provinces, les consulaires, les correcteurs ou administrateurs de l’Italie. Le titre de Spectable (V. S.) est attaché aux charges des Proconsuls, du Comte d’Orient, des Vicaires qui gouvernent les diocèses. On honorait du titre d’Illustres (V. I.) ceux qui exerçaient leur autorité sur plusieurs diocèses. Il appartenait au Préfet du Prétoire, au Préfet de la Ville, au Maître de la Milice, trois dignités équivalentes. Honorius et Théodose y ajoutèrent le Préfet de la chambre sacrée. Plus tard on y joignit le Maître des Offices, les Comtes du Trésor, et d’autres.[63] Valentinien établit une échelle précise des dignités. Au Sénat le Préfet de la Ville tenait le premier rang; puis venaient les Patriciens, les Consuls, les Consulaires, les Préfets du Prétoire, les Maîtres de la Milice et les autres Illustres. Outre le Préfet du Prétoire proprement dit préposé à l’Italie, il y eut des Préfets du Prétoire d’Orient, des Gaules, d’Illyrie et d’Afrique. Signalons encore les titres moins pompeux de Perfectissime et Nobilissime. Les Patriciens ou Patrices composaient le Sénat (Cassiod. viii Var., 10).Tels qu’ils étaient au temps d’Ennodius, les patriciens furent une création de Constantin qui en fit les conseillers de l’empereur. En cette qualité l’honneur du Patriciat l’emportait sur tous les autres. Nul n’y pouvait être élevé s’il n’avait auparavant rempli quelque charge éminente telle que le Consulat; s’il n’avait été Préfet du Prétoire, d’Illyrie ou de la Ville, Mettre de la milice ou des Offices. Le Patriciat comprenait trois ordres : les Patriciens de naissance, ceux que le Prince élevait à cette dignité et les Patrices militaires. La dignité de ces derniers, attachée à leurs fonctions de gouverneurs militaires, n’était pas à vie. Ils pouvaient être destitués au gré du Prince. Le Consulat primait toutes les dignités, à tel point que les empereurs en briguèrent le titre. L’empereur avait coutume d’aller au devant des consuls. Le consul présidait le Sénat, même le Prince étant présent, si le Prince lui-même n’était consul. Les consuls ordinaires entraient en charge aux calendes de Janvier et donnaient leur nom à l’année. Mais depuis qu’ils furent nommés par les empereurs, ils ne restèrent pas en charge l’année entière. Après un temps plus ou moins long d’autres consuls leur étaient substitués. La durée ordinaire de cette charge fut de deux mois. En outre des Ordinaires et des Substitués, il y eut les Consuls honoraires qui ne reçurent de l’empereur que le titre sans remplir la charge. Au point de vue honorifique le Consulat et le Patriciat étaient les premières dignités de l’empire, mais, à la cour, la plus grande puissance était aux mains du Préfet du Prétoire. Il disposait d’un pouvoir si absolu qu’on peut le considérer réellement comme un vice-empereur. Dans l’ancienne Rome on appelait Préteur tout magistrat mis à la tête de l’armée; d’où le nom de Prétoire donné à la tente du général, et celui de Porte Prétorienne, à la principale porte du camp; d’où le nom de Préfet du Prétoire, ou des préteurs, donné au chef suprême de l’armée. Les pouvoirs du Préfet du Prétoire furent successivement étendus à tel point qu’il concentra dans ses mains tous les pouvoirs civils et militaires, en un mot toute la puissance impériale. Il donnait des ordres aux gouverneurs des provinces, les confirmait dans leur charge, pourvoyait à les suppléer en cas de décès jusques à la nomination d’un titulaire. Il instituait les juges, les révoquait; il châtiait les juges provinciaux prévaricateurs, jugeait sans appel et verbalement, partout au nom de l’empereur (vice sacra), et le poignard qu’il recevait du souverain indiquait qu’il avait le pouvoir de condamner à la peine capitale (Cassiod. VI Var., 3). A la cour, le Préfet du Prétoire présidait aux jugements du Prince et connaissait des appels. Tout appel d’un juge ordinaire quelconque était de son ressort. La plupart du temps les Proconsuls et les autres juges lui renvoyaient les causes capitales, par exemple les causes des chrétiens. Malgré que la sentence du Préfet du Prétoire fut sans appel, on pouvait en réclamer la rétractation en s’adressant soit à son successeur, soit même à celui qui l’avait portée. Les Préfets du Prétoire avaient pour assesseurs des jurisconsultes qui les aidaient de leurs lumières. Tels ces Paulus, ces Ulpien, ces Papinien si célèbres, qui, d’assesseurs, devinrent à leur tour Préfets du Prétoire. Cent cinquante avocats étaient attachés à leur tribunal. Pour alléger la charge du Préfet du Prétoire, Théodose et Valentinien lui donnèrent comme collègue, dans ses fonctions juridiques, le Questeur du Palais. D’autre part, depuis que Constantin eut créé la charge de maître de la milice, le Préfet du Prétoire n’eut plus à s’occuper de l’armée. Auguste créa d’abord un seul Préfet du Prétoire, puis deux sur le conseil de Mécène. Les autres empereurs en eurent jusqu’à trois, mais les gardèrent à leur cour. Constantin divisa l’empire en quatre sections, (tractus), et préposa à chacune un Préfet du Prétoire. Il y eut ainsi un Préfet d’Orient, un autre d’Illyrie, un troisième d’Italie et un quatrième des Gaules. Plus tard, après avoir reconquis l’Afrique sur les Vandales, Justinien institua pour elle un cinquième Préfet. Chaque tractus administré par un Préfet comprenait plusieurs diocèses, et chaque diocèse plusieurs provinces. L’administration romaine centralisait tous les services, mais surtout celui du fisc. Les tableaux de répartition des impôts partaient du Prince, étaient enregistrés par le Préfet du Prétoire qui les distribuait comme il l’entendait, et envoyés à chaque province. Des délégués les y portaient. Après avoir été affichés dans les cités par le soin des juges respectifs, ces tableaux étaient conservés dans les archives par les chartiers. Pour assurer aux principales villes de bons maitres des langues grecque et latine, le Préfet attribuait aux grammairiens et aux rhéteurs qui tenaient école publique, des subventions fixes et, à ce titre, il exerçait sur ces écoles un certain droit d’inspection. Enfin le Préfet du Prétoire disposait des feuilles (evectiones) qui donnaient le droit de voyager aux frais de l’Etat par la poste publique dont nous parlerons plus bas. Il avait sa garde du corps comme l’empereur. Le Questeur du Palais suppléait le Préfet du Prétoire dans l’administration de la justice. Cette charge était auparavant remplie par le Préteur. Les Préteurs avaient pour fonction de décider sur les points de droit controversés, de donner la possession des biens, d’admettre les héritiers à succéder, de formuler le droit, de constituer les juges. Le Préteur marchait presque l’égal des Consuls, sauf qu’on ne portait devant lui que six faisceaux tandis que le Consul avait droit à douze. Sous les empereurs la charge législative des Préteurs passa en grande partie aux Questeurs, qui devinrent comme les grands chanceliers du Prince. Primitivement il y eut deux sortes de questure: un questeur attaché à la personne du Prince et un questeur militaire qui commandait l’armée aux cinq provinces de Scythie, Mysie, Carie, Chypre et les Cyclades dont Rhodes était la capitale. Bien qu’il n’eut pas le titre de Préfet du Prétoire, Le questeur militaire en avait les pouvoirs et tous les honneurs ainsi que tout le personnel administratif. Le Questeur du Palais était comme juge l’égal du Préfet du Prétoire. Il jugeait les appels au Prince et au nom du Prince. Il lisait au Sénat les mémoires et les Lettres du Prince. Ce fut là sa première fonction. Depuis Constantin les attributions du questeur du Palais furent augmentées. On le trouve, au temps d’Ausone, conseiller du Prince, arbitre des demandes qui lui sont adressées, rédacteur des lois. Il est le gardien de la Justice; Cassiodore l’appelle Ursenal des lois (VI Var., 5), la voix des lois (VIII Var., 13). Les ordonnances du Prince devaient être contresignées du Questeur et ne faisaient loi qu’à cette condition. A côté du Questeur du Palais siégeait comme juge le Maître des Offices. Ce haut dignitaire était préposé à la surveillance et à la direction de tous les services du Palais. Soit par délégation du Prince, soit en vertu de sa charge, le Maître des Offices avait à rendre des jugements de diverses sortes. Il assistait le Questeur et la discipline des mœurs dans le Palais relevait de lui, Il était le juge ordinaire des valets de chambre de l’Empereur et de l’impératrice, des Silenciaires, des employés aux divers secrétariats et aux autres charges du Palais, tant au civil qu’au criminel. Les agents de tous ordres, huissiers de diverses sortes, gardes, introducteurs, conservateurs du mobilier, ouvriers des fabriques et des manufactures impériales, relevaient de lui. Les manufactures d’armes distribuées dans l’empire pour la fabrication des arcs, flèches, épées, glaives, cuirasses, lances, épieux, javelots, boucliers, casques, etc., comportaient un personnel considérable. Le Maître des Offices avait à sa charge le service des interprètes, et celui de l’intendance militaire. Il devait pourvoir les frontières du nombre de soldats nécessaires et assurer le matériel des campements et des clôtures. C’est lui qui délivrait aux soldats les congés. Pour assurer ce service étendu jusques aux extrémités de l’Empire, le Maître des Offices disposait d’agents. Remarquons à ce propos que notre Société, issue de la société romaine, a conservé une foule d’usages administratifs qui nous viennent des Romains et dont les dénominations elles-mêmes ne gardent de sens qu’en remontant à la langue latine. Tels les agents, terme si commun dans notre administration. C’est le mot latin agens in rebus. Les appariteurs sont des agents qui apparaissent aux yeux du public pour assurer le fonctionnement d’une magistrature (qui apparent). Aussi ont-ils un uniforme et des insignes pour mieux être vus. Le Maître des Offices avait à ses ordres, pour contrôler ces services, tout un monde d’inspecteurs que l’on appelait curiosi. Chaque bureau avait un chef, Princeps Officii, qu’il ne faut pas confondre avec le Maître des Offices. Il n’y avait que deux maîtres des Offices, l’un pour l’Orient, l’autre pour l’Occident, tandis qu’il y avait autant de chefs que de bureaux. Ce Princeps Officii dont l’insigne de commandement était une verge de vigne, jugeait et châtiait les cas ordinaires qui se produisaient dans son bureau. Les cas graves étaient dévolus au maître des Offices. Une des principales attributions du maître des Offices était la direction de la poste impériale et du service des transports publics. Dans l’introduction à une correspondance aussi importante que celle d’Ennodius, il convient de donner sur la poste romaine quelques détails. Suétone attribue l’institution de la poste à Auguste. Il est certain que Trajan en organisa le service pour être rapidement informé de ce qui se passait sur tous les points de l’empire. La poste romaine fut desservie d’abord par des coureurs échelonnés sur les voies militaires; d’où le nom de Cursus publicus. Plus tard on substitua aux coureurs des cavaliers et des véhicules rapides. Sévère transféra le service des postes des particuliers au fisc. Il fut rattaché au Patrimoine, mais tous les frais du service restèrent à la charge des provinces sillonnées par la poste impériale. Les provinces devaient fournir les chevaux, mules, bœufs, ânes employés à la poste, les véhicules et les ouvriers, les navires dont la poste se servait sur les fleuves et pour passer les lacs, les golfes et les mers, les routes et leur entretien, les terrains et les constructions nécessaires pour les relais et les stations, le fourrage pour les animaux, et nourrir le personnel des postillons et des inspecteurs. On appelait angaria mot que l’on dit venu de la langue Perse cette obligation de fournir au Prince, les moyens de transport. Nul n’était exempt de ces prestations (prœstationes), pas même ceux qui n’avaient pas droit de municipe et n’étaient pas indigènes. Si donc c’était avantageux de se trouver sur le canal de la poste, c’était aussi fort onéreux. Seuls les ecclésiastiques et quelques privilégiés furent dispensés de fournir ces prestations. Les véhicules de poste étaient de diverses sortes: Le cheval veredus portait trente livres. Le cavalier portait les dépêches dans une valise installée derrière lui. Plus tard le Veredus fut chargé davantage et Théodoric dut interdire sous peine d’amende de deux onces d’or, de lui faire porter plus de cent livres (V Var., 5 ; IV Var., 47). La Birote ainsi nommée parce qu’elle était montée sur deux mues, s’attelait de trois mules et portait deux cents livres. Le Carrus portait six cents livres. Le Reda s’attelait de huit mules et portait un maximum de mille livres. L’Angaria portait jusques à quinze cents livres. Des inspecteurs (curiosi cursus publici) contrôlaient les chargements (V Var., 5). Ils contrôlaient également si ceux qui usaient de la poste publique étaient munis du billet impérial qui leur en donnait le droit, et s’ils ne dépassaient pas la teneur de leur billet. La poste romaine était un service exclusivement impérial. Ne pouvaient en user que ceux que l’Empereur envoyait ou qu’il appelait à lui. Par la poste le Trésor recevait les envois du fisc des provinces; elle portait jusqu’aux extrémités de l’empire les ordonnances du Prince et lui rapportait les renseignements fournis par les Gouverneurs (V Var., 5). Une constitution de Gratien et Valentinien réservait à l’Empereur et au Préfet du Prétoire le droit de délivrer des billets de poste. Ces mêmes princes cependant étendirent ce droit au Maître des Offices. Il fut même accordé au Préfet de la Ville pour des intérêts publics. Les Consuls délivrèrent quelquefois des billets de poste, mais au nom du Prince, non de leur propre autorité. Parmi les officiers de la Préfecture du Prétoire, le Régendaire (regendarius) était préposé au service de la poste. Il contresignait les billets délivrés par l’Empereur et les transcrivait sur un registre. On appelait ces billets de Postes évections (evectiones) ou tractories (tractoriae). Ils portaient en détail l’itinéraire à suivre par le voyageur et tout ce à quoi il aurait droit au cours du voyage, soit comme moyens de transport, soit pour son alimentation et celle de son personnel. Constantin chargea Albarius, Préfet du Prétoire, de convoquer au Concile d’Arles Cecilianus évêque de Carthage et les autres évêques d’Afrique, de Byzacène, de Tripolitaine, de Numidie et de Mauritanie. Il régla ainsi leur voyage: data evectione publica per Africam et Mauritaniam, inde ad Hispaniam brevi tractu facias navigare; et inde nihilominus hujusmodi his in singulis episcopis singulas tractorias tribuas, ut ipsi ad supradictum locum intra diem Kalendarum Augustarum possint pervenire.[64] Constantin appelle au même concile d’Arles (314) Chrestus, métropolitain de Syracuse, et l’invite à amener avec lui deux évêques à son choix et trois valets pour les servir en cours de route. Latronianus, gouverneur de Sicile, est chargé de pourvoir aux frais de leur voyage.[65] Au cours du voyage il y avait les relais (inutationes, stationes), où l’on ne s’arrêtait que le temps de changer de chevaux. On en comptait plusieurs dans une journée. Après une journée de course on trouvait l’hôtellerie (Stativa) où l’on faisait un arrêt assez long pour se restaurer et se reposer. En temps ordinaire il est à croire que voyageurs et postillons passaient la nuit à la Stativa et ne repartaient que le lendemain matin. Sur les routes romaines les distances étaient mesurées pour les relais et les hôtelleries de repos. Tout était calculé pour que le service de la poste se fit avec précision, rapidité et sécurité. Au départ, comme en cours de route, les bénéficiaires d’une tractorie, quelle que fut leur dignité, étaient tenus de la produire à toute réquisition des inspecteurs. S’ils s’y refusaient, ils étaient déférés au Préfet du Prétoire. Les Vandales conservèrent en Afrique le service de la poste publique et Théodoric la réorganisa dans ses états (Cassiod. Varwr. I, 29; V, 39; V, 5; VI, 6; VI, 47 ; XI, 9; XI, 14), préoccupé surtout de lui donner une plus grande rapidité et d’alléger les charges qu’il faisait peser sur les provinciaux. Le service de la poste publique romaine était donc admirablement organisé, mais il était, nous l’avons vu, exclusivement réservé au service de l’empereur. Nul particulier, quelle que fut d’ailleurs sa dignité, n’en pouvait user sans une tractorie impériale. Quels moyens avaient donc les particuliers de faire parvenir à destination leur correspondance? Les gens riches comme l’étaient Ennodius et ses principaux correspondants, employaient des porteurs à leurs gages pris parmi le personnel de leurs serviteurs (II, 5 ; III, 14; IV, 20 ; VII, 16 IX, 29). Ces serviteurs étaient des esclaves, mais assez dévoisés à leurs maîtres non seulement pour porter les lettres, mais encore pour être pris comme organes de leurs confidences qu’ils portaient de vive voix (II, 3, 7). Ennodius se plaint à son ami le sénateur Maxime de ce qu’il se contente de répondre à ses Lettres par commission orale « la parole d’un esclave peut-elle être mise sur le même pied que l’écriture d’un homme libre? » (VII, 21). Le plus ordinairement, on confiait les lettres à des voyageurs amis et même à des inconnus, selon que l’occasion s’en présentait (VII, 6; VIII, 24; I, 16). Une lettre de Béatus est portée de Rome à Milan par un enfant et, par suite, arrive en retard (VIII, 21). En outre des lettres, le porteur est presque toujours chargé de commissions à faire de vive voix (III, 14 ; VI, 34; VIII, 40); très souvent il est lui-même l’objet de recommandations auprès du destinataire (I, 17, 20 ; VI, 25 ; VIII, 38, 39; IX, 2, 3, 4). Ennodius se plaint à Florus et à Décoratus que malgré le grand nombre des voyageurs qui passent, pas le moindre billet ne lui arrive d’eux (VII, 6); il considère comme un vol fait à l’affection que de laisser partir des voyageurs sans leur donner des lettres (II, 24) ; quelques fois il s’abstient d’écrire parce qu’il manque de porteurs (III, 3; VI, 24; VIII, 24). Ces porteurs d’occasion étaient d’ordinaire des marchands qui voyageaient pour leur commerce, mais on ne les trouvait pas toujours d’une parfaite délicatesse (III, 14) et, sans pudeur, ils se montraient exigeants (VI, 2). Le port des lettres entrait en ligne de compte dans leur industrie et ajoutait aux profits du négoce. Ennodius fait allusion (II, 8) à la rémunération que les porteurs exigeaient parfois avec insistance. Mais il n’était pas rare qu’ayant touché au départ le prix du message, les porteurs négligeassent de remettre les lettres. Ennodius attribue à leur incurie si les lettres que lui a adressées Firmin son parent, « furent retenues en route ou perdues » (II, 7); il avertit Apollinaire de ne pas le taxer de négligence si ses lettres lui paraissent rares, car il arrive fréquemment, et il vient d’en avoir la preuve, que les lettres sont interceptées (II, 8). Au même il écrit encore sur ce sujet : « Que faire? Qui choisir parmi cette foule confuse de porteurs qui offrent leurs services? Comment y distinguer celui auquel on puisse confier les lettres avec l’assurance qu’elles vous seront remises intactes? La plupart ne sont que de vils mercenaires qui n’envisagent que l’occasion de tirer profit de ce commerce que nous inspire l’affection, et il est vraiment pénible de voir tourner en aliment de la cupidité ces relations qu’impose l’amitié. Aussi me suis-je résolu à m’abstenir d’écrire jusques à ce que j’aie sous la main un porteur de ma maison » (III, 13). Il a écrit à Albinus jusques à quatre fois sans que ses lettres soient parvenues. Il l’attribue à la malveillance du porteur (II, 21). Mais indépendamment de ces porteurs privés et d’occasion, il y avait certainement au temps d’Ennodius des courriers réguliers au service du public. Très souvent il fait allusion au passage de ce courrier (VII, 28). Durant sa courte halte il rédige à la hâte un billet (VII, 11, 29 ; VII, 30, 31). Il lui fait courir après pour corriger son texte qu’une trop grande précipitation ne lui a pas permis de châtier à sa guise (VI, 13). Il écrit à l’abbé Etienne (III, 4) « O l’heureuse nécessité des porteurs qui poussés par l’obligation de se pourvoir eux-mêmes de clientèle, comblent les vœux d’autrui! » Ce texte, dans sa brièveté, jette un jour tout particulier sur ce service privé des correspondances. L’entreprise de ces courriers est aléatoire; leurs bénéfices dépendent de leur clientèle et, pour les augmenter, ils sollicitent des messages. On sait, en effet, que plusieurs cités possédaient des messagers de profession (tabellarii). Suétone parle de voiture de louage stationnant dans les hôtelleries, à la disposition des voyageurs d’occasion (meritoria vehicula). Ulpien indique des loueurs de chevaux, jumentarii, de voitures à deux roues, carucarii, de voitures à deux ou à quatre roues rhedarii. Sous l’Empire les loueurs de moyens de transport s’organisèrent en corporations et formèrent des syndicats, collegia.[66] Le Comte des Sacrées largesses (Comes Sacrarum largitionum) avait la charge d’administrer les trésors de l’Empereur et présidait à l’emploi des deniers publics (VI Var., 7). On l’appelait aussi Comte des rémunérations (Comes remunerationum). Ces termes de largesses, gratifications, n’étaient d’ordinaire, pour les Romains, qu’une façon de sauver les apparences et de donner satisfaction à leur amour propre. Ils appelaient ainsi la solde qu’ils payaient aux chefs des barbares pour obtenir d’eux la paix. Aurum quod pendimus munera vocamus, écrivait Salvien (de Provid. lib. vi). Les gratifications officielles de l’Empereur le jour des Calendes de Janvier étaient distribuées par le Comte des Sacrées Largesses. Il y avait un Comte des Largesses en chaque diocèse, et tous étaient subordonnés au Comte des Largesses attaché à la cour et qui portait le titre d’illustre, ils étaient d’après Cassiodore, primiciers des notaires qui expédiaient les brevets des charges publiques (VI Var., 7). La juridiction du Comte des Largesses Sacrées était très étendue. Il connaissait de tout ce qui intéressait le fisc et les débiteurs publics; les confiscations ou saisies, l’entretien des édifices publics le concernaient. Il jugeait des trésors trouvés dont la moitié, dans certains cas, revenait au fisc, des biens des proscrits. Il avait sous sa juridiction tous les collecteurs d’impôts, qui devaient verser dans ses caisses le produit des taies (VII Var., 21, 22), avant les Calendes de Mars. Le collecteur en était responsable sur ses propres deniers. Cette clause rendait la charge peu enviable, aussi devait-on l’imposer d’office (VII Var., 20), ou par succession, comme une sorte d’hérédité réglée par les lois et l’usage. Parfois le principal collecteur recevait des aides, mais il restait responsable sur ses propres biens, des taxes à encaisser (VII Var., 21, 22). A quelles exactions ne devaient pas se livrer ces collecteurs menacés de solder de leurs deniers les sommes exigées par le fisc? Le Comte des Largesses jugeait vice sacra, c’est-à-dire, au nom de l’empereur. Les droits sur les marchandises, le commerce, les marchands, les pâturages, étaient de son ressort. On appelait à lui dans toutes les causes fiscales. Il avait sous ses ordres ceux qui gardaient le mobilier précieux de l’empereur, le vestiaire, la vaisselle d’or et d’argent, l’or en lingots, les pierreries, les joyaux, etc. Les sources qui alimentaient le trésor impérial étaient très variées et, sous des noms divers, l’impôt atteignait les citoyens de plusieurs façons. Ils payaient au fisc des contributions en nature qui consistaient en comestibles (annonœ) : froment, vin, huile, pain, viande, sel; en d’autres objets tels que l’or, l’argent, l’airain, les chevaux, les habits. Il y avait les impôts du sol et les capitations. Le citoyen était tenu de déclarer au fisc la matière imposable chez lui (professio), telle que la contenance de ses propriétés, le nombre de ses esclaves. De là le nom de profession donné au métier que l’on déclarait pratiquer, pour payer patente. Chaque navire était frappé d’un impôt que payait l’armateur. Depuis que Rome s’était enrichie des dépouilles du monde, ses citoyens étaient exempts de contributions et l’impôt pesait but entier sur les provinces. Elles en étaient écrasées. Aux contributions en nature ou en espèces s’ajoutaient les charges et corvées de toutes sortes que les provinciaux devaient fournir selon les besoins et les circonstances et dont nous avons déjà parlé à propos de la poste. Le comte des Sacrées Largesses avait sous ses ordres six intendants de la Monnaie. La frappe des monnaies relevait de lui (VI Var., 7). Il y avait donc dans l’empire six ateliers pour la frappe de la monnaie. Les pièces portaient la marque de la ville d’où elles sortaient. On en cite de Rome, d’Aquilée, de Lyon, de Trèves, d’Arles. Chaque atelier avait son intendant. Les manufactures d’étoffes que tissaient les femmes, établies dans les villes industrielles (on en comptait dix-sept), relevaient du Comte des Largesses; de même les teintureries de pourpre à l’usage du Prince et dont l’Etat avait le monopole. Neuf intendants les dirigeaient. Enfin, tout ce qui touchait au commerce dans l’empire relevait du Comte des Largesses (VI Var., 7). Il avait le monopole de l’achat de la soie aux barbares; il veillait à proscrire tout commerce non autorisé, soit quant à la nature des marchandises, soit aux lieux où les marchés étaient permis. L’Etat prélevait sur le commerce des droits de trois sortes droit de monopole, exigé de ceux qui obtenaient le monopole de certaines marchandises ; droit de l’or lustral, payé par les commerçants à chaque lustre; le droit dit Siliquaticum perçu par le fisc sur toutes les denrées vendues et qui répondait au droit de place que l’on paie aujourd’hui sur les marchés. Il était payé moitié par le vendeur et moitié par l’acheteur. Comme pendant au Comte des Sacrées Largesses, surintendant du Trésor public, il y avait à Rome, comme lui titré Illustre, le Comte des largesses privées (Comes Privatarum), surintendant du Trésor privé du Prince (VI Var., 8). Ce trésor englobait les biens vacants, les héritages caducs, les confiscations, les héritages taxés de fidéicommis, les esclaves sans maîtres, les trésors trouvés dont la moitié revenait au fisc et l’autre moitié à celui qui avait trouvé le trésor, à la condition qu’il en fit de lui-même la déclaration. Toute contestation, aliénation ou revendication relatives à ces biens, relevait du Comte des Largesses privées. Il connaissait des dettes des colons, des ventes faites par le fisc soit de meubles, soit d’immeubles. Il faisait rendre gorge aux collecteurs des impôts (VI Var., 8). Il avait juridiction sur les manufactures pour empêcher la fraude. Pendant trente jours il expose en un lieu public et très fréquenté les objets apportés comme revenant au trésor, afin que les ayants droit puissent les revendiquer. Si les trente jours s’écoulent sans qu’il se produise de revendication, il met le fisc en possession. Il louait les biens du Prince et avait soin des maisons qui était de son domaine. Il veillait à ce que les palais et édifices sacrés ne fussent en aucune façon livrés à l’usage des particuliers. Le Comte des Largesses privées avait encore la garde des mœurs dont il était l’inquisiteur officiel. Il protégeait les tombeaux contre le vol et le sacrilège (VI Var., 8). Cette dignité faisait du Comte des Largesses privées l’égal du Préfet. La charge de Comte du Patrimoine paraît se confondre avec celle de Comte des Largesses privées; elle en est pourtant distincte. Le Comte du Patrimoine fut institué par l’empereur Anastase pour administrer le patrimoine du Prince. Cassiodore (VI Var., 9) lui attribue le pouvoir judiciaire et la charge d’approvisionner la table du Prince. Il est juge des causes qui intéressent le Patrimoine. Il ne doit pas empiéter sur le bien d’autrui et les biens du Prince doivent rester immeubles, c’est-à-dire ne pas marcher au-delà de leurs bornes pour s’étendre injustement. Cette formule de Cassiodore laisse deviner quelle était à cette époque la vénalité des juges, et que les illustres Comtes du Patrimoine, dans les cas variés et fréquents où les particuliers défendaient leurs biens et leurs héritages contre les prétentions du fisc, n’étaient pas à l’abri de pareil soupçon. Pour gagner sa cause il fallait trop souvent acheter la sentence.[67] On distinguait deux sortes de Patrimoine: Le Patrimoine sacré était le Patrimoine de la couronne, que le Prince transmettait à ses successeurs; Le Patrimoine privé appartenait au Prince en propre et personnellement et revenait à ses héritiers naturels. Le Comte du Patrimoine avait sous ses ordres des intendants chargés d’administrer les biens du Prince. Les biens du sacré Patrimoine étaient inaliénables; on ne pouvait pas les vendre mais seulement les louer à des particuliers. Les contestations soulevées à propos de ces loyers avaient pour juge le Comte du Patrimoine. On en trouve un curieux exemple dans la correspondance d’Ennodius (VII, 1) : Julien Comte du Patrimoine l’avait chargé d’une enquête au sujet d’une contestation élevée entre le fermier de la maison du roi Bauton et le chartier Epiphane, préposé à la nomenclature et à l’inscription des revenus, des hommes ou des récoltes du domaine (cod. Just, lib. xii, tit. 41).[68] Ennodius a rendu son jugement en faveur de Bauton et le soumet à l’approbation du Comte. Guther (de offic. domus Augustae, lib. III, c. 27) infère de cette lettre qu’Ennodius était agent comptable (Rationalis) du Patrimoine, et qu’en cette qualité sa décision entre le fermier et l’employé du Palais impérial, devait être revêtue de l’autorité du Comte du Patrimoine. L’opinion de Guther peut être ingénieuse, mais le cas nous paraît plus simple. Ce n’est point en vertu d’une charge de la hiérarchie administrative qu’Ennodius fait son enquête et porte sa décision, mais en vertu d’une commission spéciale reçue du Comte du Patrimoine. La forme de procéder employée en cette affaire, remonte aux temps les plus reculés de la République romaine. Lorsque la nature d’une affaire, la nécessité de recueillir au loin des éléments de conviction, rendaient l’instruction longue et difficile, le peuple ou le Sénat déléguaient un magistrat ou un simple citoyen pour procéder à une information, pour rechercher les faits du procès. Ce délégué fut appelé quaesitor ou quœstor. L’affaire étant instruite, le quaesitor en faisait le rapport à qui de droit.[69] Dans le cas présent les faits se passaient sans doute en Ligurie où résidait Ennodius, et le comte Julien qui le connaissait intimement (IV, 7 et 20) et l’honorait de son amitié, eut naturellement recours à sa science juridique. C’est donc simplement comme juriste qu’Ennodius fut chargé de décider dans cette affaire. La dignité de Comte du Patrimoine comportait le titre d’illustre. Telles étaient les principales charges publiques ou dignités dont nous trouvons investis les nobles correspondants d’Ennodius.
[1] Le texte latin est celui de l’édition publiée par Guillaume Hartel. in-8, Vienne, 1882. Corpus Script. Eccles. t. vi. [2] Maurice Dumoulin. Le Gouvernement de Théodoric et la domination des Goths en Italie d’après les Œuvres d’Ennodius. — Revue Historique, 1902. t. 78 [3] Les œuvres d’Ennodius (Magni Felicis Ennodii) furent éditées pour la première fois à Bâle, dans les Monumenta S. Patrum Orthodoxographa (in-fol., 1569) de Jean-Jacques Grynaeus, édition très imparfaite; puis en 1611, à Tournai, par le jésuite André Schott, in 8°, et à Paris par le P. Sirmond, également in-8°. Cette dernière édition, très estimée comme texte et à cause des notes précieuses dont elle est enrichie, resta comme définitive et fut réimprimée, dans le premier volume des œuvres de Sirmond, in fol., Paris, 1696, et Venise, 1718; elle fut insérée successivement datas la Biblioth. Patrum, Paris. 1639, t. xv (suppl., t. i);— Lyon, 1677, t. ix; dans la Biblioth. Patr, de Galland, Venise, 1781, t. xi ; dans la Patr. Lat. de Migne, t. LXIII. Mais en ces dernières années, deux nouvelles éditions des œuvres d’Ennodius ont été publiées avec tout le luxe de la critique moderne : la première par Guillaume Hartel, à Vienne, 1881, in 8° de xcii-722 p., vol. vi du CORPUS SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM ; la deuxième par Frédéric Vogel, à Berlin, 1885, in-4° de lxiv-418 p., t. vii des MONUMENTA GERMANIE HISTORICA. Cf. Vogel, p. XLIX et s. Hartel a conservé l’ordre logique établi par Sirmond; Vogel a cru devoir rétablir l’ordre ou plutôt la confusion des anciens manuscrits et de l’édition princeps; voir les motifs qu’il en donne p. LIII. Notre traduction a été faite sur l’édition Hartel avec l’aide de celle de Vogel. [4] Préface de son édition, p. x. [5] Ennod., Epist., I, 3. [6] Ennod., Epist., IX, 20. [7] Ennod., Epist., VI, 27; VIII, 23. [8] Ibid., VII, 12. [9] Ibid., III, 33. [10] Ibid., IV, 5. [11] Ennod., Epist., II, 27. [12] Ibid., I, 1. [13] Cassiod. Var., VIII, 12. [14] Ennod., Epist., IX. 32, 34. [15] Magni Felicis Ennodi Opera, Berlin, 1885, in-4°, p. xi, l. 13 et s. [16] Ennodio, Papia, 1886, 3 vol. in 4°. [17] Emile Jullien, professeur au lycée de Lyon, dans son savant Les professeurs de littérature dans l’Ancienne Rome. Paris, 1885, minutieusement décrit (ch. viii, les devoirs) ces sortes de compositions dont Ennodius nous a conservé de nombreux spécimens. [18] Ennod., Dict., xviii, xvii. xix, xxii. [19] Ethicae, voir E. Jullien, loc. Cit., p. 310. [20] Sirmond. [21] E. Jullien, les Professeurs.... [22] Essais, t. I, c. xxv. [23] Ennod. Epist. VII, 30, 31 ; IX, 2. [24] Ennodius, t. I, p. 289. [25] I. Etudes sur saint Ennodius. II. Saint Ennodius et la haute éducation littéraire dans le monde romain au commencement du VIe siècle. § III et s. in-8°. 1890. Bordeaux, Feret. [26] Ruric., Epist., II, 8. [27] Libel. pro Synodo. Opusc. ii, édit. Hart., p. 328. [28] … Necesse est talia populis exhibere... Variar. V, 42. [29] Ozan., Civil. au Ve siècle, 7e leç., in 8°, p. 245. [30] Cassiod., de Inst. div. litt., praefat. [31] Guizot, Hist. de la civilisation en France, t. Ier. Cf. Dareste, Hist. de France, t. i, p. 181. [32] Cf. Kurth. Les origines de la civilisation moderne. [33] Le Code Théodosien fut rédigé par ordre de l’empereur Théodose le Jeune et publié le 15 février 435. Ce Code fut l’unique règle de la jurisprudence de l’Orient et de l’Occident durant tout le Ve siècle et le premier quart du VIe. Les Ostrogoths en Italie et les Vandales en Afrique acceptèrent son autorité. Même après que Justinien eut donné son Code (528) dans lequel était fondu celui de Théodose le jeune, celui-ci resta en vigueur en Espagne et en Gaule sous les Wisigoths, les Burgondes et les Francs de la première race, et en halle sous les Lombards. (Cod. Théod. Godefroi, proleg., c. vii.) [34] Chaix. Saint Sidoine Apollinaire et son siècle, t. I, livre v. [35] Dareste. Hist. de France, t. I. [36] Novel. Theod. xxxiv. [37] Cassiod. Var. VIII, 19. [38] Arator, Epist. ad Parth. [39] Cassiod., Var. V, 3 et 4. [40] Quorum cum finiuntur actiones, tunc incipiunt dignitates. Sidon. Apollin. Epist. I, 11. [41] Baron. Annales Eccl. ad ann. 57; t. i, p. 432. [42] Id. ad ann. 326, t. iii, p. 346. [43] Greg. Nyss. Panégy. [44] August. Confess. VI, 3. [45] Epist. ad Marcellum. [46] Ambros. de offic. lib. ii, c. 29. [47] Baron. Annal. ad ann. 57, t. i, p. 437. [48] Baron. Annal., ad ann. 398, t. v, p. 61. [49] August., in Psalm. 118. [50] Possid., vita. S. Aug., c. 19. [51] Habent illi judices suos, nec quicquam his publicis commune cum legibus, quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet, quas decet Episcopeli auctoritate decidi. Apud Baron. ad ann. 385, t. iv, p. 514. [52] Dareste, Hist. de France, t. i, p. 141. [53] Dareste, Hisi. de France, t. i, p. 144. [54] Baron, Annal. ad ann. 444, t. vi, p. 27-28. [55] Varia, VIII, 19. [56] Opusc. II. Libellus pro Synodo. [57] Saint Ennodius et la Suprématie pontificale au VIe siècle. Articles parus dans l’Université Catholique, années 1889, 1890, 1891. Lyon, Witte, puis réunis en une brochure, sous ce titre: Etudes sur Saint Ennodius. Bordeaux, Féret. [58] Etudes sur Saint Ennodius. Ennodius et la Haute Education littéraire dans le monde romain au commencement du VIe siècle. § vi. p. 129 et s. [59] Thèse de doctorat ès-lettres, in-8° de 576 p., 1903, Paris, Klincksieck, 11, rue de Lille. [60] Novel. Theod. et Valenti. 49. [61] Baron. ad ann. 326, t. III, p. 345. [62] Une fois pour toutes nous indiquons comme source ou l’on pourra puiser abondamment: Jacobi Gutheri, de officiis domus Augustœ, libri tres, inséré dans la collection de Sallengre, Novus Thesaurus Antiquitatum Romanorum in fol. t. iii. [63] Selon du Cange (Gloss.; In add.) le titre d’illustre passa aux rois des Francs lorsque Clovis reçut de l’empereur Anastase des lettres qui lui conféraient la dignité de Consul. Après Charlemagne l’usage de ce titre tomba en désuétude, sauf à la Chancellerie Romaine où les Souverains Pontifes, Jusqu’à Pie II, continuèrent à le donner à nos rois, Les Maires du Palais, comme dépositaires de l’autorité royale, ne tardèrent pas à s’attribuer le titre d’illustres. Les Comtes suivirent leur exemple. Enfin ce titre qui était jusque là comme séculier, fut donné à certains abbés. Dans la suite, on appela illustrissimes les évêques et les cardinaux; mais sous Urbain VIII, comme ce titre, donné sans discernement, était devenu vulgaire, les cardinaux l’abandonnèrent pour celui d’Eminentissimes, (Mabillon. De re diplomatica lib. ii; c. iii, 2, 3, 4.) [64] Baron. ad ann. 314, t. iii, p. 118. Cet auteur définit ainsi les tractories: fuisse tractorias alibi diximus diplomata quae dabantur missis vel evocatis a Principe, cursu Publico utentibus, adscriptis etiam stativis, id est diversoriis et mansionibus, quibus alerentur sumptibus publicis. ibid. [65] Formule d’une tractorie, citée par Baronius, d’après Cujas : « Tel Prince à tous les agents qui sont en ce lieu: Nous envoyons dans ce pays en légation l’illustre Gaius; en conséquence nous ordonnons que vous le traitiez avec honneur et que vous lui procuriez les moyens de transport, c’est-à-dire tant de chevaux, tant de pains, tant de mesures de vin, tant de mesures de bière, tant de lard, tant de viande, tant de porcs, tant de cochons de lait, tant de moutons, tant d’agneaux, tant d’oies, tant de faisans, tant de poulets, tant d’œufs, tant de livres d’huile, tant de livres de garum (condiment très estimé), tant de miel, tant de vinaigre, tant de cumin, tant de poivre, tant de costus, tant de girofle, tant d’épis, tant de cannelle, tant de grains de lentisque, tant de dattes, tant de pistache, tant d’amandes, tant de cire, tant de sel, d’herbes potagères et de légumes tant de chariots, tant de torches, du fourrage pour les chevaux tant de chariots. Qu’à l’aller comme au retour le susdit trouve à sa disposition toutes ces choses aux lieux accoutumés et cela sans retard. Donnez-y vos soins. » Baron. Annal. eccles. ad annum 314, t. iii, p. 118. [66] Dictionnaire des Antiquités Grecque et Romaine par Daremberg et Saglio. Art. Cursus publicus. [67] Alibi forte judices formidentur injusti; hic ubi remedium praesens petitur, redempta sententia non timetur. Querimonias possessorum sine venali protractione diseinge (VI Var., 9). [68] On voit par cette lettre d’Ennodius (VII, 1) et aussi par la lettre d’Alhalaric au Comte du Patrimoine Bergantinus (Cassiod., Var. VIII, 23) que le Comte du Patrimoine avait dans son administration des Chartiers Chartularios vel Chartarios. Les chartiers étaient adjoints aux comptables, aux scribes, aux aides, aux secrétaires, aux greffiers qui tous manipulaient les livres et les registres publics. Les feuilles du fisc notamment et les tableaux des impôts les concernaient; ils en avaient la garde et le contrôle, ils étaient responsables des écrits et des rôles publics et devaient veiller à ce que la teneur en fut observée. Ils contresignaient les actes publics qui émanaient des secrétariats. Cod. lib. xii, t. 50. [69] Grellet Dumazeau, Le Barreau romain. Introduct., p. xx.
|