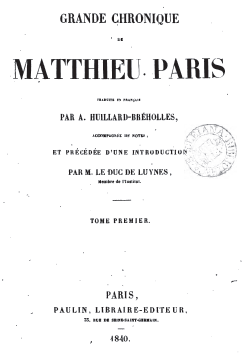
MATTHIEU PARIS
GRANDE CHRONIQUE INTRODUCTION (partie I - partie II - partie III - partie IV - partie V - partie VI - partie VII)
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
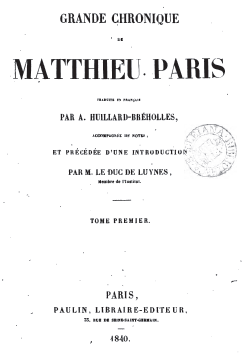
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
TRADUITE EN FRANÇAIS
PAR A. HUILLARD-BRÉHOLLES,
ACCOMPAGNEE DE NOTES,
ET PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION
PAR M. LE DUC DE LUYNES,
Membre de l'Institut.
TOME PREMIER.
PRÉFACE.
Porté par la nature de ses études et de ses goûts vers les recherches historiques, le traducteur de ce livre accepta avec reconnaissance la longue tâche que M. le duc de Luynes avait bien voulu confier à sa jeunesse. Mais à mesure qu'il avança dans son travail, il s'effraya bien souvent des difficultés imprévues qui surgissaient à ses yeux, et s'arrêta devant ce vaste horizon qui s'élargissait en reculant sans cesse. Soutenu cependant par une protection éclairée et libérale, il arriva enfin au terme du voyage, et aujourd'hui que cet ouvrage est présenté au public, il espère qu'à défaut d'autre talent on lui saura gré de sa persévérance.
En effet les devoirs du traducteur sont modestes et simples, surtout quand il n'a point à reproduire les chefs-d'œuvre de la littérature ancienne ou des langues modernes, mais, seulement les récits d'un chroniqueur qui pense dans le vieux français de Joinville, et qui s'exprime dans le latin de la barbarie ; le traducteur s'imposa donc pour règle une fidélité qui lui permit de conserver à Matthieu Paris son caractère original ; mais, tout en s'aidant des glossaires, tout en maintenant; principalement dans les chartes, certaines traductions littérales indispensables, il tâcha de se défendre contre une tendance naturelle vers des termes surannés, qui deviennent étranges à force d'être exacts.
Parmi les fautes qui altèrent souvent le texte du moine de Saint-Albans, quelques-unes proviennent des violations de la grammaire ; mais les plus nombreuses sont dues à l'inhabileté de ceux qui transcrivirent les manuscrits primitifs. Ici la fidélité ne suffisait plus. La critique indiquera à l'inexpérience du traducteur les points où il a manqué de sagacité.
Quant aux notes qu'il a jointes au texte, elles n'avaient d'abord pour but que de justifier, la traduction qu'il adoptait ; mais en voyant que parmi tant de faits, plusieurs étaient ou vagues par la forme, ou contestables dans le fond, il n'a pu résister au désir d'éclaircir ou de rectifier, à l'aide des sources et des historiens les plus estimés, ce qui lui semblait incertain ou erroné. S'il n'a point toujours réussi, il a cherché du moins à être utile ; et cette intention peut être ou son mérite ou son excuse.
Nous avons indiqué par un point de doute quelques abréviations et quelques noms de lieux ou d'individus : les uns, en les traduisant approximativement après comparaison des textes ou des ouvrages spéciaux ; les autres, en conservant l'orthographe du latin, parce qu'autrement nous n'étions amené qu'à des inductions peu sûres. Les mots renfermés entre deux traits indiquent les passages, d'ailleurs assez rares, où nous avons cru devoir compléter, par une légère addition, la pensée de l'auteur.
L'édition suivie pour cette traduction, est celle de 1644. (Parisiis, apud viduam Pelé.) À l'avantage d'être aussi exacte que toutes les autres, elle joint celui d'être plus généralement répandue. Bien qu'elle porte pour titre Historia major Anglorum, nous avons préféré les termes de Grande Chronique, qui nous semblent résumer mieux l'ensemble du livre. D'ailleurs le titre d'Historia major Anglorum vient plutôt des éditeurs anglais que de Matthieu Paris lui-même, puisqu'à la suite d'une révision qu'il avait faite de son œuvre, il l'avait intitulée Chronica majora Sancti Albani.
Au treizième siècle, la race germanique et chrétienne, la race sémitique et musulmane sont en présence des bords du Bosphore au pied des Pyrénées. Depuis cinq cents ans leur lutte est commencée. Propagé avec une incroyable rapidité, soutenu par les armes de tribus belliqueuses sans cesse accrues et renouvelées, l'islamisme s'est assis en Asie sur les ruines de l’empire d'Orient, a conquis l'Afrique, asservi l'Espagne et partagé la Sicile.
Comme la vie se retire des extrémités vers le cœur, le christianisme s'est réfugié dans l'Europe. Sous son influence salutaire, les farouches destructeurs de la civilisation romaine, Huns, Visigoths, Lombards, Francs ou Scandinaves, peuples nombreux et vaillants, sont demeurés barbares, mais reconnaissent le lien sacré qui les unit. C'est leur rudesse même qui fait leur force. Tandis que, dans les murs de Constantinople, les orgueilleux successeurs de Justinien tremblent au milieu de leurs Grecs dégénérés, les Francs ont arrêté Abdérame dans sa marche victorieuse; et quatre siècles plus tard, les nations germaniques ont délivré le saint Sépulcre.
A la voix de Pierre l'Ermite, de saint Bernard et des pontifes romains, les croisades succèdent aux croisades ; une foi ardente, universelle, capable de tous les prodiges, épuise les trésors, les populations et les guerriers de l'Europe, pour accomplir de grandes et sanglantes expiations par une conquête matériellement improfitable, dont le résultat éloigné demeure inconnu, et dont la conséquence immédiate sera l'augmentation du pouvoir apostolique au détriment des princes séculiers. Plusieurs siècles encore doivent s'écouler dans ce conflit redoutable. L'empire de Constantinople, momentanément catholique sous les croisés, ressaisi peu d'années après par Michel Paléologue, est destiné à recevoir les lois des sectateurs du prophète; les rochers de Malte et les murs de Vienne seront les dernières limites de l'invasion musulmane.
Les croisades, commencées par l'enthousiasme populaire, prêchées par l'église, dirigées par elle, changèrent graduellement de nature et d'objet. A mesure que se refroidissaient le zèle et l'espérance de conserver les conquêtes de Syrie, l'influence pontificale appliquait l'activité religieuse et militaire des nations catholiques à des expéditions d'un intérêt moins abstrait, d'abord contre des peuples idolâtres et hérétiques, ensuite contre les ennemis politiques du Saint-Siège. Ce fut à regret que les papes approuvèrent, les deux croisades de Louis IX; le trésor des indulgences était prodigué aux champions de la puissance apostolique contre les souverains coupables de la méconnaître. Cette puissance était en effet arrivée à son apogée. Créée par Grégoire VII, qui réussit à lui donner une réalité formidable, étendue par l'habileté d'Alexandre III, elle avait reçu du génie d'Innocent III un développement inespéré. Ce grand homme, souverain ou protecteur de l'Italie, avait su mettre l'Europe entière à ses pieds, rendre ses vassaux la plupart des rois catholiques, et commander en même temps aux églises d'Orient et d'Occident. Tuteur d'un des princes les plus illustres de son siècle, distributeur de couronnes et du sceptre impérial qu'il donnait ou retirait à son gré, plus riche qu'aucun des princes chrétiens, sans armées, mais puissant par la domination morale qui lui était dévolue, Innocent III, par son étonnante activité, la fermeté de son esprit, la justesse et la sûreté de ses vues, réalisant les projets de Grégoire VII, put se considérer comme le maître spirituel et temporel de l'Europe, le suzerain des suzerains, dernière expression de la constitution idéale du moyen âge et peut-être aussi de la société catholique.
L'esprit profondément religieux des populations à cette époque peut seul expliquer comment furent vaincues tant de rébellions contre l'autorité des papes, inspirées par le sentiment d'un extrême péril, depuis l'empereur Henri IV jusqu'à Louis de Bavière. Appuyés sur un pouvoir supérieur à toutes les lois, élevés par la vénération publique au-dessus de la condition humaine, les papes avaient fondé leur droit canonique sur les fausses Décrétales d'Isidore et sur le recueil de Gratien complété par Grégoire IX. La faculté qu'ils s'étaient graduellement arrogée de lever des taxes sur le clergé et de disposer des bénéfices ecclésiastiques, les dispenses du vœu de croisade, les redevances payées par les rois vassaux de l'église, constituèrent leur trésor et subvinrent à leurs énormes dépenses ; l'Inquisition leur donna dans tous les pays des espions et des délateurs; elle leur fournit auprès des grands et du clergé des agents accrédités de persécution et d'un contrôle inexorable; ils trouvèrent dans les ordres mendiants des émissaires infatigables et gratuits, habiles à s'insinuer dans la confiance des princes. L'excommunication qui frappait les personnes, l'interdit qui atteignait les églises, les villes ou les états, leur donnaient la faculté de maîtriser les rois et de pousser les peuples à la révolte. En déliant les vassaux de leur serment, et en disposant des couronnes, ils ébranlèrent la hiérarchie féodale; mais cette atteinte hardie eut souvent des résultats trop funestes pour ne pas exciter la résistance des rois les plus dévoués à l'église : la sentence de Jean-sans-Terre et celle de Frédéric II produisirent la pragmatique sanction de Louis IX, et peu de temps après, les violences d'Anagni, que le successeur de Boniface VIII dut oublier au lieu de les punir.
La suprématie sacerdotale avait jeté ses racines dans le monde féodal ébauché par les Mérovingiens. Pépin et Charlemagne la reconnurent, Louis le Débonnaire s'humilia et se prosterna devant elle. Depuis Hildebrand, toute cette suprématie fut déposée dans la main des papes. Les églises et les monastères avaient perdu leur indépendance, les conciles provinciaux une partie de leur autorité. L'évêque de Rome grandit jusqu'à devenir une tête impérieuse dont les volontés communiquaient la vie et une force extraordinaire à la caste sacrée dont il était le chef. L'église, essentiellement hiérarchique depuis les apôtres, n'avait pu se préserver de l'organisation féodale; elle trouva la cause de sa grandeur et l'occasion de sa ruine. Les papes s'étaient montrés intrépides et obstinés même dans la fuite et la défaite. Malgré toute leur fermeté, Henri II et Philippe-Auguste n'avaient pas échappé aux censures ; Frédéric II soutint une lutte prolongée où sa popularité, le dévouement des siens, ses talents, son courage, ne purent le garantir d'être déposé dans un concile solennel. Après lui, quelques années suffirent pour précipiter dans la tombe son fils Conrad, Manfred et l'infortuné Conradin. La vengeance apostolique avait frappé jusqu'au dernier rejeton de l'arbre maudit; l'Allemagne, étonnée de tant de catastrophes, resta sans chef véritable jusqu'à l’élection de Rodolphe de Habsbourg.
Les conquérants de l'empire d'Occident avaient mis huit cents ans à effacer les institutions romaines; encore avaient-elles été conservées dans quelques lieux, pour jeter bientôt un nouvel éclat, en modifiant profondément la civilisation nouvelle. A la fin du douzième siècle celle-ci est encore concentrée dans l'Europe occidentale, tandis qu'à l'autre extrémité, des populations féroces et guerrières, idolâtres et barbares, s'entre-détruisent, souffrent ou végètent en attendant des lumières qui pourront les conduire vers un état meilleur. Encore ébranlé par les derniers ravages des Scandinaves et des Maures, l'ancien empire de Charlemagne s'est divisé en trois principales fractions : l'Allemagne, qui depuis Othon le Grand s'est approprié l'Italie, source de tous ses maux; la France, où l'habileté des Capétiens a créé une grande monarchie ; l'Angleterre, qui s'est subitement transformée sous la main tyrannique et conquérante de Guillaume le Bâtard. Autour de ces pays dont la régénération est la plus avancée, les contrées voisines s'éclairent graduellement, en adoptant la foi catholique et la constitution féodale. L'exemple des Normands a entraîné la conversion religieuse et politique de leurs frères les Norvégiens, les Suédois et les Danois. Ceux-ci, à leur tour, entraînés par l'exemple, le prosélytisme, l'ardeur guerrière ou l'intérêt, entreprennent, contre les nations idolâtres des bords de la Baltique, des croisades plus fructueuses que celles de la Terre-Sainte.
Sur les frontières de l'Allemagne, l'ordre militaire des Chevaliers teutoniques appelle une autre croisade pour détruire les païens habitants de la Prusse, et leur substituer de nouvelles colonies. Déjà chrétiens, encore à demi-sauvages, les Polonais, agités par les Irréconciliables dissensions de leurs princes, succombent à l'invasion la plus formidable qui ait menacé l'Europe, depuis le temps d'Attila. Partis des frontières de la Chine sous le commandement de Gengis khan, les Mongols inondent l'Asie de leur cavalerie innombrable. Chrétiens, idolâtres, musulmans, tout cède et fuit à leur approche. Aucune armée ne leur résiste, aucune soumission ne les désarme ; la Russie plie tout entière sous leur joug qu'elle subit pendant plus de deux siècles. L'intrépide et sauvage Hongrie expie, par un désastre épouvantable, la témérité de sa noblesse ; les Mongols ne s'arrêtent enfin qu'après avoir vu leur dernière attaque repoussée, près du Danube, par les Allemands sous les ordres des deux fils de Frédéric II, et retournent en arrière, laissant, depuis les rives de la Dalmatie et de l'Esclavonie, les traces longtemps ineffaçables de leur terrible passage. Pendant que les peuples limitrophes de l'empire germanique amortissent le choc des barbares, au sud des Pyrénées, les vaillants chrétiens de Castille, de Léon, d'Aragon et de Navarre repoussent graduellement les Maures vers le détroit. La bataille de Las Navas de Tolosa décide la ruine des Almohades : depuis cette époque, les chrétiens restent les maîtres en Espagne, excepté dans le royaume de Grenade. Le même succès accompagne les armes de la dynastie française en Portugal ; aidés de leur courage, soutenus par l'autorité des papes, dont ils reconnaissent la suzeraineté, Alphonse Henriquez et ses fils commencent, avec le douzième siècle, leurs conquêtes qu'ils achèvent avant le milieu du treizième.
Ainsi, à travers de nombreux désastres et de cruelles dissensions, l'Europe occidentale, ramenée à une sorte d'unité, d'abord par la prépondérance de l'empire d'Allemagne, et plus tard par les croisades, est garantie contre les invasions des barbares, poursuit l'expulsion des musulmans sur son propre territoire, et les attaque jusqu'en Asie et en Afrique.
A la faveur d'événements si inattendus, un état social, que personne n'avait préparé ni prévu, s'est substitué aux sociétés romaine et germanique. De la combinaison des coutumes barbares avec le reste de la haute civilisation latine, est né un système qui s'est développé lentement et qui tend aussitôt à des transformations nouvelles. Depuis le douzième siècle, ce système embrasse et gouverne par des lois précises tous les individus, du plus grand au plus petit, de l'homme libre à l'esclave. Ce dernier, sous le nom de serf, soit qu'il ait vendu ou perdu sa liberté, soit qu'il descende de race gauloise ou de race germanique, est attaché à la glèbe et aux métiers ; il s'aliène avec le sol auquel il est fixé, et se transmet comme une chose. Au-dessus de lui, et l'exploitant à son profit, l'homme libre est presque toujours le vassal de quelque seigneur auquel il doit fidélité, service de cour et de guerre pour le fief qu'il en a reçu. A son tour, le seigneur doit à son vassal protection et assistance. Leurs obligations sont mutuelles, saintes, garanties par l'honneur et l'intérêt. Si tous les deux doivent à leurs serfs secours et aliments, s'ils peuvent composer avec eux pour leur affranchissement partiel ou définitif, le seigneur, sauf les aides et services fixés par la collation même du fief, ne peut réclamer rien au-delà et devient le tuteur vigilant des enfants de son vassal, le gardien de son épouse et de son manoir. Lui-même est aussi le vassal d'un suzerain encore plus puissant, qui dans l'origine a possédé le sol et l’a d'abord aliéné viagèrement, héréditairement ensuite, aux mêmes conditions. Ces engagements peuvent, dans toute la classe des hommes libres, être dissous par un consentement réciproque ou par forfaiture et félonie. Le fief vacant retourne alors à son seigneur immédiat, qui le conserve ou en investit un nouveau vassal. Car de ce système, il résulte qu'il n'y a nulle terre sans seigneur et nul seigneur sans terre, que le fief régit le fief et impose à quiconque l'occupe les obligations par lesquelles il est régi. Au seigneur appartient la justice, le droit de guerre privée, celui de monnayage; ses revenus consistent dans les produits de ses domaines non inféodés, dans les tailles imposées à ses propres serfs, dans les confiscations et amendes ordonnées par ses tribunaux, dans les péages, droits et exemptions qu'il fait lever à son profit, dans les aides que lui donnent ses vassaux, dans les lods et ventes qu'ils lui doivent pour les mutations de fief et le rachat ou droit de succession qu'il prélève sur leurs héritiers. Les rois eux-mêmes n'ont pas d'autres droits ni d'autres finances, et c'est comme chefs-seigneurs qu'ils possèdent leur couronne.
Cet état de choses découle du principe féodal ; déjà en vigueur, mais viager, sous Charlemagne, il a été complété par la faiblesse des Carolingiens, qui ont irrévocablement aliéné leurs domaines en rendant les fiefs héréditaires. Lorsque le roi n'a plus eu de fiefs à conférer, il s'est trouvé le plus pauvre des seigneurs, et le plus riche a saisi la couronne. Telle est l'origine du pouvoir royal dans la famille d’Hugues Capet. Ses successeurs, instruits par l’expérience, se gardèrent de tomber dans les mêmes fautes que ceux de Charlemagne.
Depuis les faibles et timides efforts de Philippe Ier, on voit ses habiles descendants hâter l'émancipation des communes, abolir les justices seigneuriales, et ajouter au fief de France toutes les réunions que le hasard favorise ou que leur habileté prépare. Au contraire, en Allemagne, où le pouvoir suprême est limité dès l'origine, les états voulant empêcher la ruine de la féodalité, maintiennent l'élection pour le trône impérial, et s'opposent à ce que les grands fiefs restent au-delà d'un temps déterminé, sans être conférés à quelque nouveau vassal. En Angleterre, le partage est fait dès le jour de la conquête, entre le roi et les barons; les réunions au domaine de la couronne ne peuvent avoir lieu, et dans leurs querelles avec les rois, les barons protègent les communes. De ces trois conditions différentes résulte, pour la France, l'abaissement des feudataires et l'agrandissement de l'autorité royale jusqu'à la puissance absolue; en Allemagne, l'égalité du droit de l'empereur avec celui des électeurs ; en Angleterre, la soumission du pouvoir monarchique à la tutelle de l'aristocratie.
Le système féodal, malgré la régularité de son ensemble théorique, n'a jamais été réalisé absolument ou simultanément et sans entraves. Au moment où il dominait le plus généralement en Europe, ses vices radicaux se faisaient déjà sentir; les ennemis de son existence grandissaient auprès de lui ou dans son sein. Auprès de lui, et entourée de ses respects, s'élevait l'église qui, aspirant à s'immiscer dans les affaires temporelles, se faisait charger de dons, investir de fiefs, et qui, pauvre dans l'origine, obtint ensuite de la piété immodérée des empereurs, rois et seigneurs, la plus belle part du territoire européen, avec les plus larges immunités, une juridiction séparée, une hiérarchie relevant seulement du Saint-Siège, et une autorité morale qui ne redoutait aucune censure. Les évêques et les abbés, plus tard les papes, profitèrent très habilement de ces immenses avantages.
Au sein du système féodal croissait un ennemi moins puissant dans l'origine, mais plus durable que le clergé.
Depuis le temps de Louis le Gros, les seigneurs, appauvris par leurs querelles et surtout par les croisades, ont augmenté leurs ressources pécuniaires sans diminuer leurs revenus, en accordant à leurs serfs la faculté d'acheter l'affranchissement. En Italie, quelques villes délibèrent sur cette mesure, la considèrent comme politique et générale, la décrètent, et indemnisent les maîtres dépossédés; en Allemagne, la nécessité de repeupler les contrées désertées par des populations entières, croisées contre les Slaves, amène rétablissement des cultivateurs libres. Un peu plus tard, en France, Louis X supprimera le servage dans les domaines royaux, en proclamant comme un principe la liberté et l'égalité naturelles de tous les hommes. Les grandes communes des pays féodaux ont, au treizième siècle, maintenu, conquis ou acheté leur indépendance. Les villes marchandes des abords de la Baltique ont déjà formé cette confédération qui deviendra puissante sous le nom de ligue hanséatique ; la faveur ou la pénurie des rois, les combinaisons politiques des empereurs, l'affluence des hommes émancipés, ont multiplié les communes affranchies, jusqu'au sein de la plus rigide féodalité. Ce système ainsi ébranlé penche vers sa ruine; elle va s'opérer graduellement, malgré la forte constitution hiérarchique du moyen âge, par l'effet des éléments destructeurs qu'il n'a pu s'empêcher d'associer à sa maturité. L'ère purement guerrière et barbare approche de son terme ; celle du commerce, des sciences et des arts est née dans ces illustres républiques italiennes qui fixent tous les regards de l'Europe attentive, par leur éclat surprenant et leur prospérité trop passagère.
Nées d'elles-mêmes, durant les querelles des empereurs avec leurs vassaux ou avec les papes, ces républiques ont grandi à l'ombre de la protection pontificale. Richesse, population, courage militaire, union, chefs habiles et puissants, rien ne leur a manqué pour conquérir leur liberté. Les deux plus grands empereurs de la maison de Souabe ont vu leurs talents et leurs armées échouer devant la ligue de Lombardie. Depuis Milan jusqu'à Naples, s'élèvent de nombreuses cités fières de leur indépendance, dans toute l'activité et la fécondité de la jeunesse, produisant une foule de grands hommes, jurisconsultes profonds qui ressuscitent le droit romain, braves guerriers, orateurs et politiques intelligents, marins intrépides, poètes immortels, artistes dont les œuvres conservées jusqu'à nos jours attestent le génie comme la grandeur du temps dont ils nous retracent le splendide souvenir.
Mais tandis que Venise, Gênes et Pise atteignent au faite de la prospérité, en transportant les croisés, et en servant les rivalités des empereurs et des rois, tandis que le commerce enrichit Florence et les villes de Lombardie, les factions guelfe et gibeline entretiennent une continuelle guerre civile au sein des plus florissantes républiques. La noblesse y prend une part active ; à Venise se fonde une aristocratie héréditaire, les podestats, capitaines, et routiers des différentes villes, attendent ou préparent les occasions favorables pour s'emparer du pouvoir et le rendre despotique ; on voit apparaître des tyrans dont les cruautés surpassent ce que l'histoire a jusque-là raconté. Ainsi commence la chute de ces mémorables républiques, et se prépare leur transformation en petits états, qui, sous les ducs de Milan, de Toscane ou de Ferrare, auront aussi leur éclat, mêlé de terribles tragédies, auquel succédera la plus triste décadence, funeste précurseur de l'anéantissement politique.
Le treizième siècle nous montre encore d'autres républiques naissantes ; au nord de la France, les riches et puissantes communes de la Flandre, orgueilleuses et faisant sans crainte la guerre aux rois dont elles souffrent impatiemment le joug ; à l’est, la Suisse, aussi pauvre que courageuse, prête à briser la chaîne de la maison d'Autriche; au midi, du pied des Pyrénées à celui des Alpes, on compte encore un grand nombre de villes libres se gouvernant par leurs propres lois, reste brillant et envié de la civilisation antique. Mais depuis que les princes capétiens sont devenus les héritiers des comtes de Toulouse et de Provence, on a vu la tutelle royale s'étendre sur les cités jadis si florissantes; l'indépendance s'est évanouie avec les derniers chants des troubadours. En même temps, toute l'Europe féodale se couvre de villes affranchies, dont le nombre et l'opulence, devenant des obstacles à craindre ou de grandes ressources à mettre en usage, leur assurent un rang dans les assemblées où se votent les impôts, et où s'agitent les questions d'intérêt public. Telle est la première apparition du tiers état en France où il grandira dans une inquiète obéissance pour renverser la monarchie sur les ruines de la noblesse, en Angleterre, où il aidera l'aristocratie à maîtriser la royauté; en Allemagne, où il s'effacera graduellement dans la soumission à un despotisme mitigé.
Ainsi, successivement et par la force des événements, le pouvoir est dévolu à qui peut l'exercer ou le partager; toujours abandonné à regret, quelquefois défendu avec acharnement et réclamé avec violence, il finit nécessairement par tomber entre les mains des forts, clergé, noblesse ou démocratie. Lorsqu'un des ordres l’a conquis, ses chefs, papes, rois, tribuns, veulent tout posséder sans partage et sans contrôle ; le temps, qui leur a donné l'autorité, la leur soustrait par une complication le plus, souvent inattendue de causes et d'événements plus faciles à démêler pour la postérité que pour les contemporains. La féodalité ayant touché sa dernière limite, les rois commencent à s'arroger une puissance plus vaste et plus indépendante. Philippe-Auguste et ses successeurs ont recours aux moyens juridiques pour dépouiller des vassaux dangereux et un ordre militaire trop riche dans leur royaume appauvri. La législation de saint Louis, celle de Frédéric II, la grande charte d'Angleterre, le code d'Alphonse de Castille, commencent à régler l'état social, en assurant une justice plus éclairée, la liberté individuelle, des garanties contre l'arbitraire, le jugement par les pairs, l'abolition des guerres privées, des épreuves, (les combats judiciaires, la nécessité des assemblées délibérantes. Rédigés par des hommes de loi, adversaires naturels de la féodalité, ces pactes, établissements, codes ou constitutions, respirent le même esprit; l’on y reconnaît qu'alors toute l'Europe civilisée était animée simultanément des mêmes pensées politiques de réforme ou d'amélioration. Aux prétentions des papes sur le pouvoir temporel et aux exactions de leurs légats, le clergé d'Angleterre, d'Allemagne, de Norvège, de France, oppose une résistance inusitée, secondée par la noblesse et les princes les plus religieux. En revanche, tous les esprits sont pénétrés de vénération pour les reliques qu'une pieuse fraude dérobe à l'Asie ou achète en s'efforçant d'éviter la simonie. Une haine profonde pour les hérétiques favorise l'établissement des inquisiteurs, allume les bûchers dans tout le monde catholique, et inonde de sang le pays des Vaudois, des Albigeois et des Stadings. Dans ce temps où les rois eux-mêmes aident, comme de simples ouvriers, à la construction des édifices sacrés, le blasphème est puni de peines sévères. Un peu plus tard, l'horreur qu'inspire la magie avec ses cérémonies secrètes, désigne à la haine publique les personnages les plus illustres comme les plus obscurs. D'effroyables accusations de sacrilège et de pratiques infâmes font disparaître les Templiers ; un sombre fanatisme agite les esprits; les croisades des Pastoureaux sont les inquiétants présages de la Jacquerie ; les lépreux et les Juifs expient par des massacres leur isolement physique et religieux, ainsi que leurs riches fondations et leurs trésors accumulés par l'usure.
Dans le même siècle fleurit par toute l'Europe l'institution singulière de la chevalerie, qui, vers le onzième siècle, dut son origine à un profond sentiment d'humanité et des devoirs féodaux chez quelques nobles, lorsque tant d'autres oubliaient leurs obligations de bonne garde et de protection envers leurs vassaux ou les étrangers. La chevalerie fut développée par l'amour des aventures, qui entraînait les Français à la croisade et à la conquête de pays inconnus. Elle fut encouragée par les éclatants succès des Normands dans l’Apulie, des croisés dans l'Asie, des Latins à Constantinople, des Espagnols et des Portugais contre les Maures. L'exemple des ordres militaires excita les confréries d'armes à se former parmi les séculiers ; les chants des poètes et les fables des romanciers illustrèrent ces sociétés. Le culte de l'honneur et celui des dames régnèrent ensemble dans l'esprit des chevaliers et jusque dans leurs cris de bataille ; les tournois devinrent leurs exercices les plus habituels, la défense des faibles était le devoir de toute leur vie.
La France, qui fut le pays le plus féodal de l'Europe, en fut aussi le plus chevaleresque. Dans ses provinces méridionales se tinrent les célèbres cours d'amour dont les sentences attestent la facile chasteté de cette époque. A l'école de Bertrand de Born et des autres troubadours Richard Cœur-de-Lion puisa le goût pour la poésie et les prouesses qui, malgré son caractère farouche, en ont fait un des types héroïques du moyen âge. C'est à la chevalerie que les Français durent des faits d'armes admirables, mais encore plus d'impardonnables témérités et de sanglantes catastrophes, entre la défaite de la Massoure et la bataille de Pavie.
L'éclat particulier dont brille le treizième siècle dans l'histoire du moyen âge est dû aux grands hommes qui l’ont honoré autant qu'aux tristes périodes dont il fut suivi.
Dans l'église paraissent des fondateurs d'ordres célèbres : saint François d'Assise, qui personnifia l'exaltation et l'humilité chrétiennes ; saint Dominique, dont le zèle inexorable fit trembler le Midi devant le nouveau tribunal de l'inquisition. Parmi les théologiens, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, Etienne Langton, Jean Scot, Raymond Lulle et le philosophe alchimiste Roger Bacon. Trois conciles généraux furent réunis : celui de Latran contre les Albigeois et pour la défense de la Terre-Sainte ; le premier concile de Lyon, en présence duquel Innocent IV déposa Frédéric II son ennemi ; le second, où Grégoire X et l'empereur Paléologue s'efforcèrent de réunir dans une seule foi les églises d'Orient et d'Occident, si longtemps divisées.
En France, règnent successivement l'habile et heureux politique Philippe-Auguste, Louis VIII qui porta la couronne d'Angleterre malgré le pape, et mourut en servant l'église contre les Albigeois ; Louis IX, le plus parfait des hommes et des rois, dont les vertus furent à lui, et dont les fautes furent causées par l'esprit religieux de son temps ou par son ardent amour pour l'équité. Ses croisades infructueuses, les dernières qui furent entreprises, le montrent aussi grand dans la captivité que dans les combats ou sur le trône. Roi généreux, équitable et fidèle, âme noble, ferme et candide, il ne cessa de songer à ses devoirs qu'en expirant sur les sables de l'Afrique. Quel homme aurait pu mériter de lui succéder?
L'Italie nous présente en même temps l’heureuse jeunesse et la vie agitée de Frédéric II, avec la grande et touchante catastrophe de sa maison. Depuis longtemps entreprise par les papes, on la voit accomplie par Charles d'Anjou, l'homme noir et sans sommeil, vassal redouté du pontife devant lequel il fléchissait le genou. En Sicile, l'intrépide don Pèdre d'Aragon, bravant la colère apostolique, vient, avec ses almogavares et son bon amiral Roger de Luria, arracher à Charles d'Anjou le pays inondé du sang français à l'instigation de Jean de Procida. Les mêmes événements ébranlent l'Allemagne, y affaiblissent le pouvoir impérial, jettent la perturbation et la haine parmi les familles dominantes, créent des empereurs rivaux, et transmettent le sceptre de Frédéric anathématisé à Henri Raspe, à Guillaume de Hollande, à Richard de Cornouailles, enfin à Rodolphe de Habsbourg, qui commence une ère nouvelle.
L'empire d'Orient subit aussi les vicissitudes les plus imprévues. Une armée de croisés, conduite par le doge de Venise, s'interpose d'abord pour pacifier les troubles civils de Constantinople, puis s'en empare et établit sur le trône de Justinien des empereurs français promptement renversés par l'habile et courageux Michel Paléologue.
Richard Ier, Jean et Henri III, héritiers d’Henri Plantagenet, apportent successivement sur le trône d'Angleterre la vaillance imprévoyante, une lâche démence et la faiblesse avec le parjure. Mais la nation anglaise n'a pas été plutôt conquise, qu'elle a reçu une vie nouvelle ; l'intelligence normande la pénètre, la fortifie et la prépare à devancer toute l'Europe dans la carrière des institutions qui succéderont à celles du moyen âge.
À cette époque, les connaissances pratiques d'économie politique paraissent avoir reçu leurs premiers développements chez les nations du Midi. En Espagne, les Maures introduisent un système d'agriculture savamment combiné et malheureusement oublié par leurs vainqueurs; en Italie, les Lombards, les Toscans, les Apuliens se livrent aux mêmes travaux. Les Siciliens continuent de s'y adonner, et, par l'ordre de Frédéric II, essayent de planter et d'exploiter la canne à sucre. L'Angleterre élève de nombreux troupeaux dont elle envoie la laine à tisser aux Flamands ; la France et l'Allemagne, encore couvertes de forêts, poursuivent des défrichements, des plantations de vignes et des exploitations rurales dans les régions les mieux partagées, soit pour le climat, soit pour la fertilité. L'industrie s'associe à leurs efforts. Les fabriques de drap et les corps de métiers de Flandre élèvent cette province à une prospérité immense et prématurée. Les plus riches étoffes sont importées d'Orient ou imitées avec succès. Le commerce des pelleteries, du fer, des cuirs, du verre, l'orfèvrerie, l'immense activité occasionnée par les magnifiques monuments religieux et civils élevés à l'envi dans tout le monde chrétien et par les grands événements militaires des croisades, toutes ces causes produisent, surtout dans les républiques italiennes, une prospérité qui va s'éteindre devant les guerres funestes et les fléaux exterminateurs du quatorzième siècle. C'est encore dans ces pays méridionaux que la navigation est le plus encouragée ; le commerce avec l'Orient n'est pas interrompu par les guerres des chrétiens contre les musulmans; Gênes et Venise rivalisent d'efforts pour se supplanter et se nuire; la cupidité de leurs marchands va jusqu'à vendre aux infidèles des armes et des vaisseaux, et la rivalité de leurs marins jusqu'à se livrer des batailles acharnées; mais l'influence de Venise l'emporte, et cette république cédera la dernière aux conquérants de l'empire grec.
L'administration des finances paraît aussi mieux combinée dans les républiques commerçantes que dans les pays monarchiques. L'ignorance des véritables causes de la richesse, un mauvais système d'impôts, une dilapidation effrénée des deniers publics, et les excessives immunités de l'église, mettent les rois d'Angleterre à la merci de leurs barons, les empereurs d'Allemagne dans l'impuissance de tenir tête à leurs ennemis, et font disparaître en France les dernières traces des économies de Philippe-Auguste. Les successeurs de saint Louis ont recours à l'expédient aussi honteux que funeste d'altérer le titre de leurs monnaies ; les emprunts deviennent difficiles et si dangereux pour les préteurs, que les Juifs, les Lombards et les Caursins peuvent seuls se résoudre à devenir les créanciers des hommes puissants ou des princes ; l'usure, justifiée par le péril et par la déloyauté des emprunteurs, irrite tous les esprits; l'église la flétrit ; l'abolition des dettes est virtuellement prononcée par la persécution, l'expulsion ou le massacre; les survivants recommencent, cependant, quelques années après, n'ignorant pas le sort qui leur est réservé ; tellement, dans les pays mal administrés, leur intervention est devenue nécessaire et lucrative.
Nous avons déjà pu observer que les finances des papes mettant à contribution le clergé de toute l'Europe, et levant des impôts sur tous les rois leurs vassaux, étaient les plus intarissables du monde chrétien. La politique pontificale est aussi la mieux conduite ; on y reconnaît les lumières et la vigoureuse persistance qui, seules, peuvent accomplir de grands desseins. Aucune race royale, pas même celle de Souabe, ne peut se comparer, sous ce rapport, à cette série de princes spirituels et temporels à la fois, tous couronnés dans l'âge mûr, choisis dans le sein d'un collège d'hommes habiles et exercés, par les fonctions de légat, à traiter avec les chrétiens et les barbares, avec les monarques comme avec les républiques. Parmi ces dernières, Venise et son aristocratie récente déploient leur supériorité dans l'art de négocier des traités et de les tourner à leur agrandissement. Charles d'Anjou montre aussi qu'il a conservé quelques traditions de son aïeul ; la mort seule l'empêche, peut-être, de réaliser ses projets d'invasion dans la Grèce, à l'exemple de Robert Guiscard.
La jurisprudence antique, tirée de l'oubli par Irnerius, refleurit dans les écoles de Portius Azo et d’Accurse. Pierre de Cugnières, Nogaret, Taddeo de Sessa, Pierre des Vignes sont remarqués parmi les légistes français et dans la chancellerie impériale. Un seul poète domine le siècle et lui imprime toute sa gloire. Dante, élève de Brunetto Latini, apparaît sans rivaux, sans imitateurs, mais suivi de bien près par Pétrarque. De célèbres voyageurs furent ses contemporains ; Jean de Plancarpin, Rubruquis et Marco Polo révélèrent les premiers à l'Europe le chemin de la Tartarie et du Japon ; l'Italie et la France s'honorèrent de grands artistes, tels que Marchione et Margaritone d'Arezzo, Robert de Luzarches, Pierre de Montereau, Nicolas de Pise, Arnolfo di Lapo, Cimabué et Giotto.
D'innombrables historiens ecclésiastiques ou séculiers se consacrèrent alors à perpétuer le souvenir des événements dont ils avaient été les témoins. La plupart écrivirent en latin, quelques-uns dans la langue alors usitée. Cette innovation, déjà introduite dans la législation, eut pour résultat de commencer à supprimer la langue savante et générale ; mais elle mit l'étude à la portée d'une classe plus nombreuse, et créa dans chaque pays une littérature avec son caractère et ses qualités particulières.
Villani conçut le projet de ses chroniques, en se rendant à Rome au jubilé célébré l’an 1500; avec lui peuvent se ranger Barthélémy de Neocastro, Jamsilla, Ricobaldo de Ferrare, l'exact et naïf Catalan Ramon Muntaner, le Grec Georges Pachymeres, et les historiens français Geoffroy de Villehardouin, Joinville, Guillaume de Nangis.
Le goût des études historiques s'était rapidement propagé dans le Nord. L'Islande, si éloignée des régions oui la science était perfectionnée, se distingue de bonne heure par une sorte de culte pour les lettres. Dès le onzième siècle, Sämund Sigfasson, prêtre chrétien, y recueille avec un heureux respect les traditions mythologiques des Scandinaves : cent ans plus tard, Snorre Sturleson écrit l’Heimskringla, inépuisable trésor pour la poésie et l'histoire. Après eux, au treizième siècle, Sturla Thordson, neveu de Snorre Sturleson, a laissé des chants et différentes chroniques, spécialement celle du roi Hakon Hakonson, où brillent le mérite et l'exactitude de l'historien.
L'Irlande présente un phénomène intellectuel de même nature. Convertie au christianisme par saint Patrice, changeant de religion sans troubles et sans fanatisme, elle ne tarde pas à envoyer au dehors ses missionnaires zélés, mais charitables, dont les rapports avec Rome sont assidus, et dont les prédications se font entendre au septième siècle, en France, en Brabant et sur les bords du Rhin. En Irlande, la philosophie scolastique prend son essor ; la théologie et la physique y sont cultivées; Feargal, évêque et mis au rang des saints, avance sur la cosmographie des opinions aussi hardies qu'ingénieuses, après lui brillent Clément et Dungal, estimés de Charlemagne ; ils sont effacés par Jean Scot, dit Erigène, dont la science fut en si haut renom dans l’église, auprès des princes carolingiens et d'Alfred, le plus lettré des rois anglo-saxons.
Au onzième siècle, Tigernach et Marianus Scot se distinguent comme annalistes souvent exacts. Le premier eut soin de consigner dans ses écrits les dates des éclipses ; les documents qu'il a conservés sont considérés comme d'une grande valeur historique.
L'Angleterre, devenue chrétienne, s'adonna d'abord comme l'Irlande aux études théologiques ; le clergé et les moines s'y livrèrent avec ardeur, et, dans les premiers âges de la civilisation anglo-saxonne, on compte une foule d'auteurs ecclésiastiques, parmi lesquels Bède le Vénérable, son élève Alcuin et saint Boniface occupent le premier rang.
De longues calamités succédèrent en Europe au règne brillant de Charlemagne ; elles frappèrent aussi rudement l'Angleterre. Envahie par les pirates danois, elle était condamnée alternativement à combattre, à négocier ou à subir l'intolérable oppression de ses vainqueurs. Les lettres n'étaient plus cultivées que dans les monastères; leur asile sacré fut incendié ou détruit : une terreur profonde suspendait les études ; aucun écrivain marquant ne paraît alors dans ce pays en proie à toutes les calamités.
A peine Guillaume, duc de Normandie, s'est-il approprié, par les armes, la succession d'Edouard le Confesseur, que l'Angleterre, abattue par ses malheurs, comprimée, mais régularisée par une volonté inexorable, voit ses nouveaux conquérants lui apporter, avec leur despotisme, une organisation nouvelle, et la législation normande jeter sur son sol des racines profondes qui lui donneront un jour la stabilité, la liberté et la plus grande puissance politique qui ait existé depuis celle des Romains.
Sous la domination normande, les études se raniment au fond des cloîtres, et sont protégées par l'heureuse influence des savants italiens Lanfranc et Anselme, l'un toujours favorisé, l'autre souvent molesté par les rois d'Angleterre. Des moines érudits et laborieux, embrassant toute l'histoire depuis les temps les plus reculés, en rédigent des abrégés où se trouvent entremêlés des récits empruntés aux principaux auteurs de l'antiquité et des traditions populaires, fabuleuses ou pédantesques. Mais la partie véritablement inestimable de leur travail est celle où, animés d'un esprit différent selon les races auxquelles ils appartiennent, plus souvent encore selon leurs intérêts personnels, ils rapportent les faits accomplis sous leurs yeux. On y trouve retracés avec une douloureuse simplicité ou avec une sombre énergie, les souffrances et le désespoir de la nation saxonne, trop faible pour défendre son indépendance, trop fière pour se résoudre à l'asservissement. Les déprédations méthodiques exercées par les Normands, leur division systématique des hommes et des choses, leurs mesures politiques et militaires que n'arrêtent ni la famine, ni l'agonie, ni les révoltes de tout un peuple, sont exposées avec un profond caractère de vérité. Parmi les auteurs qui ont raconté ces mémorables événements, Guillaume de Malmesbury est remarqué pour la maturité de son jugement autant que pour son érudition et son évidente sincérité.
Guillaume, moine de Newborough, Raoul de Diceto, doyen de Saint-Paul, Roger de Hoveden, chapelain d’Henri II, tous trois bien instruits des faits qu'ils rapportent et d'une fidélité reconnue, imitent l'exemple de Guillaume de Malmesbury, et ont laissé de précieux documents pour l'histoire d'Angleterre : celle d'Irlande en doit de très importants à Gyraldus le Cambrien, malgré les défauts littéraires qui lui sont justement reprochés.
A ces écrivains succède, sous le roi Jean et son fils, une nouvelle génération de docteurs, de savants et de chroniqueurs. Pendant que, dans la théologie, s'illustrent Etienne Langton, Alexandre Hales et Robert Grosse-Teste, le célèbre Roger Bacon, par ses études encyclopédiques, devance l'aurore des sciences dont un autre Bacon doit, longtemps après, indiquer la classification avec toute la puissance d'une intelligence admirable. Des légistes, tels que Raoul de Glanville et Bracton, fleurissent avec les mathématiciens Jean Godard, Jean de Holywood et le Juif Profacius.
La médecine, la topographie commencent de rudes essais. Mais le nombre des historiens s'accroît sensiblement, et, pour le treizième siècle, on compte plus de quarante annalistes ou biographes, dont les livres sont en partie publiés, en partie perdus ou inédits. Les noms de Jean de Fordun, de Raoul Le Noir se rattachent aux faits et gestes des rois tant anglo-saxons que de race normande. Quelques-uns, tels que Benoit de Peterborough, Alain de Tewkesbury, Richard d'Ely, Roger de Croyland, Jocelin Brackland, se sont proposé de traiter spécialement ce qui concernait le clergé et les monastères ; d'autres, enfin, ont embrassé l'histoire de l'Europe avec un succès mesuré à leur instruction et à leur talent.
Parmi ces derniers se distingue une succession de moines bénédictins du couvent de Saint-Albans, qui se transmirent la tâche difficile de consigner fidèlement, et sans autre passion que celle de la vérité, tous les événements notables arrivés de leurs jours. C'est ainsi que, pendant plusieurs siècles, leur monastère produisit les premiers historiens de l'Angleterre.[1]
La célèbre chronique connue sous le nom d’Historia major est l'ouvrage de plusieurs moines de Saint-Albans. Le premier qui mit la main à ce travail fut, dit-on, Roger de Wendover, religieux de noble extraction, probablement Normand comme son nom semble l'attester.[2] Il fut nommé prieur de Bealvair dans le voisinage de Lincoln, à la place de Raoul le Simple, dont il eut la faiblesse d'imiter les dangereux exemples. Par ses prodigalités et ses dilapidations, il justifia les accusations portées à l'oreille de l'abbé Guillaume, qui faisait, en 1216, l'inspection des prieurés dépendants de Saint-Albans. Sévèrement repris par l'abbé, Wendover promit en vain de se corriger ; il fut, peu de temps après, remplacé par le cellérier Martin de Bodersham, et mourut en 1235, comme le prouve l'Obit des religieux de Saint-Albans, inséré par Matthieu Paris dans ses Additamenta.
Roger de Wendover est l'auteur présumé de la Grande Chronique jusqu'à l’an 1234; cette opinion a été accréditée par l'autorité d'une note annexée à un des manuscrits de l’Historia major, par l'opinion d'Handbury, et surtout par une note marginale introduite dans le texte de Matthieu de Westminster; on y fit, à la fin de l'an 1235, hucusque Rogerus de Wendower cronica sua digessit. A ce témoignage se joint celui du manuscrit windowérien de l’Historia major; à la fin de l'année 1235, on trouve au texte ce supplément : Hucusque scripsit chronica Rogerus de Wendover, et le distique suivant :
Cernis completas hic vestro (nostro) tempore metas,
Si plus forte petas, tibi postera nunciet aetas.
D'un autre côté, un manuscrit de Saint-Albans atteste que la chronique de Wendover, remontant à l'origine du monde, et serait étendue jusqu'au temps d’Henri II. Sur le seul manuscrit de Wendover maintenant existant, une note marginale nous apprend qu'à partir de l'an 1190, un nouveau chroniqueur continua ce travail. D'ailleurs Boston de Bury, savant bibliographe du quinzième siècle, fixe à l’an 1189 le commencement de la chronique rédigée par Matthieu Paris, et il résulte des notes de Wats, qu'à la fin de l’an 1189 les manuscrits de l’Historia major s'interrompent ou sont écrits d'une autre main. Tous ces documents laissent planer le doute sur l'auteur qui a continué l'histoire de Wendover depuis 1189 jusqu'en 1235. On peut conjecturer que Roger de Wendover, tombé en 1216 dans la disgrâce de son abbé, fut suspendu en même temps de ses fonctions d'historiographe de Saint-Albans, et, dans ce cas, celui qui en fut investi ne pouvait être Matthieu Paris, qui ne prit l'habit qu'en 1217; mais si ces fonctions restèrent vacantes jusqu'en 1235, Matthieu Paris aurait comblé la lacune laissée par son devancier, ce qui s'accorderait avec le catalogue de Boston de Bury. Il est même vraisemblable que Wendover introduisit dans sa chronique des fragments entiers de Marianus Scot, de Sigisbert de Gemblach et de Hugues de Saint-Victor, comme trois passages de l’Historia major l'indiquent assez clairement.
C'est donc seulement entre les années 1128 et 1186 que l'on peut limiter avec une espèce de certitude la rédaction historique appartenant en propre à Roger de Wendover. La chronique sous son nom embrasse les événements arrivés en Europe, et particulièrement en Angleterre, depuis là mort d'Edouard le Confesseur. On y trouve exposés succinctement tous les faits principaux relatifs à l'invasion et à l'occupation de l'Angleterre par les Normands ; elle rapporte comment, après les jours tranquilles du roi Edouard, la nation anglo-saxonne, rapidement déchue, subit la loi du plus fort ; les généreuses et inutiles résistances de quelques hommes, comme Waltheof, les conspirations tardives et les rébellions désespérées des opprimés impuissantes contre l'activité et là prévoyante tyrannie de Guillaume. On voit, en même temps, s'établir en Italie les aventuriers normands, dont la postérité régnera sur la Sicile, et, sous leur protection, grandit déjà cette puissance pontificale qui s'assujettira toutes les nations catholiques.
L'histoire de Guillaume le Roux est diversifiée par d'intéressants détails sur la première croisade. Tout n'est pas exact dans ce récit ; on y trouve, pourtant, des faits curieux propres à compléter ce que nous apprennent Guillaume de Tyr et les autres historiens des croisades.
A Guillaume le Roux succède l'astucieux politique Henri Ier qui, par une charte bientôt désavouée, s'assure l'appui des barons contre son frère, le brave et aventureux Robert, pour le dépouiller de son héritage, et le laisser mourir dans la captivité.
Henri lui-même, possesseur de la couronne acquise par tant d'adresse et de fraude, lutte tout son règne contre une noblesse indocile, et voit s'anéantir dans un fatal naufrage l'objet de toutes ses espérances, les jeunes héritiers de sa royauté; il la lègue à sa fille, veuve d'un empereur, épouse d'un comte d'Anjou, et tige de ces Plantagenets que doivent illustrer plus tard les calamités de la France.
En donnant aux affaires de l'Angleterre leur principale attention, les auteurs de la Grande Chronique ne négligent pas d'entremêler à leurs annales tous les faits importants qui concernent l'église, les croisades, et l'état de l'Europe. C'est ainsi que Wendover nous montre Etienne de Blois, ce prince vaillant et malheureux, élu d'abord par les barons, approuvé par l'église, puis abandonné par ses partisans et par le pape; soutenant contre Mathilde et les Plantagenets une guerre durant laquelle les rivaux, tour à tour vainqueurs ou prisonniers, délivrés ou fugitifs, tiennent dix-sept ans la fortune incertaine, et désolent un pays déjà ravagé par la conquête. Le chroniqueur interrompt son récit pour donner de curieux détails sur les conciles célébrés en France et en Angleterre, et sur la détresse du royaume de Jérusalem, que les croisades de l'empereur Conrad et de Louis VII ne peuvent préserver d'un menaçant avenir. Il introduit même, vers la fin du règne d'Etienne, une fable religieuse, dont la caverne de Saint-Patrice est le théâtre, et dont le héros est un chevalier irlandais, admis, dans une pénitence et une félicité anticipées, à visiter le purgatoire et le paradis. Cette espèce d'épopée en prose est remarquable par l'imagination du narrateur, la variété des scènes et l'analogie de sa composition avec deux autres visions de même nature, décrites dans l’Historia major. Toutes ensemble rappellent l'histoire du puits de Saint-Patrice dans le roman provençal intitulé Guérin le Malheureux,[3] le Songe, par Raoul de Houdan, et le poème allégorique de Brunetto Latini, sources où, probablement, se sera inspiré le Dante en composant sa Divine Comédie.
Les mêmes traditions sur les peines matérielles subies dans l'éternité ont dirigé le, pinceau des Orcagna dans leur grande peinture du Campo-Santo de Pise, représentant la mort, le jugement et l'enfer[4] ; elles durent exercer une influence semblable sur les sculpteurs du treizième siècle, lorsqu'ils représentaient sur de grands édifices religieux les supplices variés, mais étranges, que les démons infligent aux pécheurs frappés de la réprobation divine. D'ailleurs, dans ces jours de foi fervente et absolue, tous les esprits, depuis le plus humble jusqu'au plus élevé, étaient pénétrés des mêmes convictions et frappés des mêmes terreurs. Les châtiments de l'autre vie, les révélations faites par des morts à leurs amis et à leurs proches, les apparitions divines, l'intervention des saints, des anges, des démons, dans les actes des hommes, surtout des religieux et des prêtres, toutes ces choses étaient admises avec un respect qui ne souffrait pas d'examen, et dont la Grande Chronique offre des exemples aussi intéressants que multipliés. Quelles étaient les limites du pouvoir spirituel sur des intelligences ainsi disposées à le reconnaître et à l'implorer comme le seul protecteur efficace, l’unique refuge de la faiblesse humaine! On en put apprécier retendue sous le règne d’Henri Plantagenet, dont l'avènement avait été considéré comme une félicité publique. Ce prince, fixant toutes ses pensées sur l'agrandissement de ses états et les améliorations poli: tiques, avait, par son mariage avec Éléonore de Guyenne, réuni à son héritage le duché d'Aquitaine et le comté de Poitou, que laissait échapper le roi de France par le plus imprudent divorce. À peine couronné, Henri se faisait accorder par le pape l'autorisation de conquérir l'Irlande, et, pour s'en préparer les moyens, soumettait le pays de Galles, y arrachait les forêts, perçait des routes, fortifiait des châteaux. Il songeait en même temps à réformer la législation anglaise. Celle de Guillaume le Conquérant sur les immunités du clergé offrait depuis cent ans des inconvénients toujours plus grèves, et occasionnait de tels abus, qu'il était devenu nécessaire de la modifier ou de l'annuler en partie. Henri, voulant préparer et assurer le succès de son entreprise, crut agir sagement en appelant à l'archevêché de Cantorbéry Thomas Becket, son chancelier et le plus favorisé de tous ses courtisans. La mesure qu'il se proposait de réaliser était sage, prudente et dictée par l'expérience ; il voulait assujettir le clergé à la justice des tribunaux séculiers pour les crimes civils, empêcher les évêques de passer la mer pour assister à des conciles où les rois d'Angleterre pourraient être déposés comme le furent quelques empereurs ; enfin soumettre au droit féodal les ecclésiastiques devenus barons vassaux de la couronne, et assurer au fisc royal les revenus des sièges vacants. Henri anticipait peut-être sur le temps où ces changements deviendraient faciles et d'une évidente nécessité. Si cependant, les seize articles des constitutions de Clarendon étaient manifestement proposés dans l'intérêt du pouvoir royal, cet essai de gouvernement régulier parut assez utile à l'assemblée chargée d'en délibérer, pour que le clergé y donnât son adhésion en même temps que les barons et les grands du royaume.
L'archevêque de Cantorbéry fut le seul qui se rétracta, et s'érigea en champion de l'église contre l’auteur de sa fortune. L'autorité de graves historiens ne peut suffire pour faire reconnaître une querelle de la race anglo-saxonne contre la race normande, dans les hostilités de neuf années entre Henri II et Thomas Becket. Durant tout le cours de cette lutte, l'archevêque manifesta le sombre enthousiasme d'une âme exaltée par sa rapide conversion la résolution prise d'avance de combattre jusqu'à la fin pour un principe, l’obstination orgueilleuse qui repoussait les prières et les décisions du clergé anglais, des légats, du pape lui-même, l'empressement passionné d'un esprit indomptable pour répandre sur ses adversaires les anathèmes sans limite et sans mesure, enfin le fanatisme avide de souffrances qui l'irritent, et résolu de finir par une mort sanglante une vie que sa violence a sans cesse troublée.
Si la résistance de Thomas Becket excita la vengeance tyrannique et meurtrière d’Henri II, elle apporta aux combinaisons du roi des obstacles si grands, qu'ils firent échouer en partie l'expédition d'Irlande, favorisèrent les hostilités du roi de France, et entravèrent jusqu'au couronnement du jeune Henri Court-Mantel. La mort violente de l'archevêque, les miracles opérés au tombeau de ce martyr des immunités ecclésiastiques canonisé un an après sa mort, forcèrent Henri à une justification ainsi qu'à une expiation avilissantes. Il avait accepté l'humiliation pour rappeler la fortune ; mais il en fut abandonné sans retour. Consumant ses dernières années à réprimer les rébellions de ses vassaux et de ses fils dénaturés ligués avec le roi de France, il vit le honteux traité de Saumur terminer son règne et ses chagrins.
Les écrivains anglais appartenant au clergé peignirent des plus sinistres couleurs le prince auteur d'un meurtre sacrilège. Mais l'histoire d’Henri II, entachée trop souvent de rapt et de violence, n'en atteste pas moins une politique active et prévoyante, constamment déjouée, malgré sa persévérance, par l'existence d'un homme dont l'inimitié pouvait paraître une sorte de félonie. Dans les circonstances difficiles où il gouverna, Henri II ne se montra pas sans habileté, mais il ne put atteindre la gloire. Un destin tout opposé attendait son fils Richard, qui ceignit la couronne pour étonner le monde par ses prouesses autant que par ses prodigalités insensées.
La moitié du règne de ce prince fut occupée par sa croisade ; il y dissipa le trésor paternel, ainsi que le fruit de rapines et d'exactions inouïes. Ce fut à son détriment que Richard entreprit le voyage de Palestine avec Philippe-Auguste. Celui-ci, toujours attentif à réparer les fautes de son prédécesseur avait, durant la vie d’Henri II, soutenu la rébellion de Richard, dont il connaissait le caractère et la bravoure irréfléchie. Richard éprouvait pour la chevalerie une passion que les Anglais partagèrent peu. Après lui, le comte de Cornouailles et le prince Edouard furent les seuls qui abandonnèrent l'Angleterre pour aller combattre en Orient. A sa piété excessive, qui lui fit acheter toutes les reliques de la Terre-Sainte, le successeur d’Henri II joignait une violence et un orgueil qui lui aliénèrent l'esprit de tous les princes croisés. Les outrages dont il les accabla lui attirèrent d'implacables inimitiés. Pendant qu'au retour de son expédition brillante, mais inutile, Richard reste prisonnier de l'empereur Henri VI, par la vengeance du duc d'Autriche, Philippe-Auguste, depuis longtemps revenu dans ses états, poursuit ses projets, prolonge la captivité de son rival, et tente de conquérir la Normandie.
La fin du règne de Richard nous le montre réduit ara plus vils expédients pour subvenir à la pénurie de ses finances, et causant, par des impôts arbitraires, la dernière des révoltés du peuple anglais contre les Normands. Philippe-Auguste, inférieur sur le champ de bataille, mais supérieur dans l’art de négocier et d'acquérir; se joue de la valeur de son ennemi dont il sait éviter les attaques, pour le surprendre par des traités. La mort de Richard devant le château de Chaluz laisse au roi de France la faculté de réaliser les plans qu'il a conçus, depuis le temps où Henri II vivait encore. Jean-sans-Terre, dépourvu des talents de son père et des qualités militaires de son prédécesseur, unissait à la bassesse du cœur, et à la pusillanimité, tous les vices qui pouvaient l'exposer à l'aversion des siens. Aucun moyen d'oppression ne lui répugnait; pour satisfaire ses passions ou ses vengeances, il ne craignait pas de flétrir l'honneur de ses plus fidèles serviteurs, ni de livrer des innocents à la mort ou aux plus cruelles tortures. Sa déloyauté et sa dissimulation étaient trop connues pour qu'il pût en tirer quelque avantage ; il ne savait se soustraire à l'adversité que par de lâches soumissions ; la prospérité lui inspirait les mesures les plus tyranniques. Il serait cependant injuste de ne pas ajouter que la situation où il se trouvait engagé était trop délicate pour un homme si peu adroit, et trop décourageante pour un caractère si peu énergique. Héritant de la couronne fraternelle par la faveur des barons, au préjudice de son neveu Arthur, que soutenaient le roi de France et de nombreux partisans, Jean crut assurer ses droits par le meurtre de son rival. Il ne fit que hâter le moment décisif auquel aspirait Philippe-Auguste. La sentence des pairs de France sépara de l'Angleterre, le duché de Normandie, l'Anjou et le Maine, que Jean ne songea pas à défendre. Celui-ci, réfugié en Angleterre y trouva les barons devenus insoumis depuis les longs pèlerinages de Richard, et traitant avec une hauteur nouvelle le prince dont la royauté était leur ouvrage.
L’esprit indépendant du clergé anglais engagea promptement le roi dans des querelles où l'église s'empressa d'intervenir ; elles prirent un caractère si grave, et poussèrent Jean-sans-Terre à de telles sévices, que l'interdit, l’excommunication et la déposition le frappèrent successivement. Innocent III ne se laissait pas intimider par des menaces, et les actes désespérés d'un prince ne pouvaient alors entraîner personne à imiter sa révolte contre la puissance spirituelle. D'un autre côté, l'occupation des trois fiefs par Philippe-Auguste avait définitivement établi la nationalité française, qui se déclara bientôt par les armes, à la bataille de Bouvines. La même séparation avait donné une sorte d'unité à la nationalité anglaise ; les intérêts des barons cessèrent d'être divisés entre leur pays et le continent. Ce fut au roi qu'ils le firent éprouver d'abord. Jean ne trouva plus qu'une seule ressource; il y recourut, et son excuse fut autant dans le péril que dans l’exemple d'autres souverains plus intrépides et plus heureux que lui. En faisant hommage à saint Pierre, il se conciliait le plus puissant de tous les protecteurs; il échappait à la rude tutelle des barons, pour se soumettre à celle de l'église ; il arrêtait, par la seule parole d'un légat, l'expédition française prête à passer le détroit pour accomplir la conquête entreprise par les ordres du pontife lui-même. Mais en écartant ce qui allait amener sa ruine immédiate, Jean ne put échapper à celle qui devait être lente et graduelle. Convaincus de son indignité, irrités par ses crimes, les barons et le clergé n'accédèrent pas sans conditions à la réhabilitation prononcée par le Saint-Siège ; ils exigèrent la réforme des lois injustes, le rétablissement de celles d'Edouard le Confesseur, puis la reconnaissance des libertés accordées par Henri Ier. L'intervention du pape et ses réprimandes n'eurent aucune influence sur l'esprit des barons confédérés ; malgré les menaces d'excommunication proférées par le légat et les tergiversations du roi, ils reprirent les armes de concert avec les habitants de Londres, et ne les déposèrent qu'après avoir rédigé la grande Charte à l'assemblée de Runnymead. Cet acte mémorable, dont les principaux auteurs furent Etienne Langton, archevêque de Cantorbéry, el Guillaume, comte de Pembroke, fut bien moins une institution nouvelle que la restauration et la consécration solennelle de droits auxquels la rapacité et l'arbitraire des rois normands avaient porté les plus dangereuses atteintes. La plupart des barons, lorsqu'ils imposèrent la grande charte, ne croyaient pas altérer l'état social de leur pays, encore moins préparer dans un avenir lointain la réforme politique de l'Europe ; ils voulaient seulement tirer du droit féodal tout ce qu'il pouvait donner de libertés et de garanties, et y joindre ce que les lois saxonnes avaient laissé de dispositions utiles, qu'il convenait alors de faire revivre. Ils stipulèrent pour l'église, parce que sa participation était leur sauvegarde; pour les villes, parce que celles d'Angleterre jouissaient, dès avant la conquête, de franchises qui les rendaient puissantes et anoblissaient la bourgeoisie ; ils stipulèrent aussi pour les arrière-vassaux, parce que leur fidélité et leur adhésion étaient alors plus que jamais nécessaires.
Mais avant tout, les barons songèrent à leurs intérêts, profondément lésés par le despotisme des successeurs de Guillaume ; en effet, ce qui fut rétabli par la charte de Runnymead n'avait été supprimé que par d'intolérables abus. Des améliorations furent introduites et assurées en ce qui concernait la liberté individuelle, le vote de l'impôt extraordinaire, la distribution de la justice, la fixation des amendes, la sécurité du commerce. Le véritable mérite de la grande charte fut de rendre permanent et durable ce qui avait été jusque-là précaire et facile à transgresser ; elle définit ce qui était resté incertain, et exigea comme un droit ce que l'on n'obtenait plus que comme une grâce. En limitant de bonne heure le pouvoir royal, elle eut l'avantage d'améliorer la situation présente et d'assurer l'avenir. On ne pouvait attendre davantage de la prudence humaine, presque toujours surprise et déconcertée par les événements.
La lâcheté du roi avait accepté le pacte de Runnymead ; sa déloyauté s'efforça de le rompre. Les barons, résolus de soutenir leur ouvrage, appelèrent pour régner sur l'Angleterre un prince français, le fils de Philippe-Auguste. Malgré les censures apostoliques, Louis accepta cette couronne ; mais la mort du prince dépossédé éteignit la colère des barons, et les rallia promptement autour de son fils. Ils aidèrent Henri III à éloigner son rival; toutefois l'autorité qu'ils lui remirent avait changé de nature, et il ne pouvait l'exercer, à l'avenir, sans la partager avec eux. Vers la fin du règne de Jean-sans-Terre, un jeune novice, nommé Matthieu Paris, Parisien, ou de Paris, fut admis au monastère de Saint-Albans. On ignore si sa famille était anglaise, normande ou française; car le nom qu'il portait laisse dans l'incertitude à ce sujet. Peut-être les études que, suivant l'usage de son temps, il avait dû faire à Paris, lui avaient-elles valu le surnom qui lui est resté, de même que le moine anglais Richard reçut l'épithète de Syracusain, pour avoir accompagné en Sicile la fille d’Henri II, fiancée au roi Guillaume, qui lui accorda l'évêché de Syracuse.
Durant son noviciat, vers l’année 1210, le jeune Paris, adonné aux recherches historiques, et attentif à tout ce qui pouvait l'instruite, écoutait curieusement les relations des faits contemporains, et inspirait assez de confiance pour que Robert de Londres, gardien de Saint-Albans pendant l'interdit, lui racontât les détails de son étrange ambassade auprès de l'Emir-al-Moumenim Mohammed al-Nassir dont le roi Jean sollicitait l'alliance au prix d'une apostasie aussi abjecte qu'inutile.
En 1217, le 21 janvier, Matt. Paris prit l'habit de religieux, et comme les constitutions papales fixaient à vingt ans, au plus tôt, l'âge de profession, on peut en inférer qu'il vécut au moins soixante-deux ans, la date de sa mort étant bien connue.
L'érudition et les talents du jeune moine, soit comme littérateur, soit comme peintre et calligraphe, ne tardèrent pas à le faire remarquer ; le chroniqueur du monastère, Roger de Wendover, étant mort en 1235, Matthieu Paris fut chargé de le remplacer, et de continuer son travail; il remplit constamment ces fonctions, et, malgré son mérite, la faveur dont il jouissait ne put le préserver des chagrins réservés à tout historien impartial.
Matthieu Paris, avec une foule de prêtres et de moines, assistait, au mois d'octobre 1247, à la fête religieuse célébrée par ordre d’Henri III, lorsque ce prince déposa, dans l'église de Westminster, le vase contenant le sang de Jésus-Christ, que lui avait apporté un Templier, de la part du patriarche de Jérusalem. A la fin de la cérémonie, le roi ayant aperçu le moine historien, l'appela près de lui, le fit asseoir au pied de son trône, et lui recommanda de transmettre à la postérité la plus reculée tous les détails de ce qu'il avait vu dans ce jour mémorable; il l'invita ensuite au festin royal, avec trois de ses compagnons. L'écrivain obéit avec fidélité; car, dans son récit, il consigna en même temps l'attendrissement du plus grand nombre, la piété du roi, et les doutes qui s’élevèrent dans rassemblée sur l'authenticité de la relique à laquelle Henri III attachait tant de prix. En effet, depuis la première croisade où fut reconnue l'imposture de la sainte lance dont la découverte avait sauvé l'armée chrétienne, la dévotion publique hésitait quelquefois, et, dans cette occasion, une controverse fut nécessaire pour rassurer certains esprits. Cette tâche fut entreprise par le savant Robert Grosse-Teste, évêque de Lincoln, dont notre historien écouta les discours qu'il a fidèlement enregistrés dans ses Additamenta.
Au commencement de la même année,[5] Matthieu Paris avait été invité, par une lettre du roi Hakon V, à réparer le désordre des finances du monastère de Saint-Benoît de Holm,[6] dans le diocèse de Nidaros en Norvège. Pour une somme de trois cents marcs, il réussit à libérer cette communauté envers les usuriers caursins de Londres, et congédia le prieur, après avoir acquitté toutes les dettes dont le monastère était grevé. Cependant les moines de Holm, délivrés des embarras pécuniaires où les avaient jetés les malversations de leur abbé, étaient restés dans une telle ignorance de leurs devoirs, et dans un si grand oubli de leur règle, que l'archevêque de Nidaros menaçait de les expulser et d'ajouter à ses possessions tout ce qui dépendait du monastère. Les moines s'adressèrent au légat envoyé par le pape pour couronner le roi Hakon, cérémonie qui eut lieu le 26 août 1247. Le cardinal leur conseilla de solliciter à la cour romaine un réformateur et un instructeur de leur ordre. Sur leur demande, le pape Innocent IV désigna le frère Matthieu, moine de Saint-Albans, et leur délivra un bref inséré dans la Grande Chronique. Durant ces négociations, qui se prolongèrent vraisemblablement jusque dans les premiers mois de 1248, Matthieu Paris était lui même en France, à Saint-Germain-en-Laye, auprès du roi Louis IX. Celui-ci préparait alors son expédition contre l'Egypte, et chargea le moine de Saint-Albans d'une lettre où il invitait Hakon à se joindre à loi, puisqu'il avait aussi pris la croix, lui offrant le commandement de la flotte française, comme au chef le plus expérimenté qu'elle pût avoir dans cette traversée.
Chargé de cette mission, et investi des pouvoirs ecclésiastiques pour réformer le monastère de Holm, Matthieu Paris s'embarqua sur un gros navire qui partait d'Angleterre pour Bergen ; il atteignit ce port le 10 juillet 1248, jour où la ville et le château furent réduits en cendres par un épouvantable incendie. Le lendemain, l'envoyé du pape et du roi de France était, de bonne heure, descendu à terre pour célébrer la messe, lorsqu'un violent orage éclata, et la foudre brisa le mât du navire anglais, tuant un matelot, blessant ou meurtrissant les autres.
Le roi Hakon se trouvait alors à Bergen, où il s'était vainement efforcé de combattre les ravages des flammes : Matthieu Paris put lui remettre, sans retard, les lettres de saint Louis. Ils ignoraient tous deux que ce prince était parti le mois précédent pour l'Egypte, ayant renoncé au projet de naviguer avec les Norvégiens. Hakon, homme instruit et justement vénéré de ses sujets, remercia l'envoyé de saint Louis, mais éluda modestement d'accepter une offre dont il prévoyait avec sagacité les inévitables inconvénients. Il rappela seulement que, voulant assurer sa propre traversée dans le cas où il accomplirait sa croisade, il avait sollicité de Louis des lettres patentes destinées à lui garantir une réception amicale dans les ports du royaume de France. Aussitôt, le moine courtisan lui remit les lettres qu'il avait apportées et où le souhait du roi de Norvège était réalisé dans les termes les plus honorables. Transporté de joie, Hakon remercia le porteur de ces lettres et le combla de dons magnifiques, faisant, en outre, réparer le vaisseau sur lequel il avait navigué et qui venait d'être endommagé par la foudre.
Après avoir quitté le roi, Matthieu Paris se rendit dans le nord, à Hobn, pour y accomplir un travail plus grave et plus pénible. Il réussit néanmoins à rétablir l'ordre et l'instruction parmi les moines sur lesquels il avait toute l'autorité de son caractère et de la faveur royale.[7] En effet, Hakon lui accordait une si grande part dans son estime, que, durant ses entretiens, il lui confia les conditions mises par le pape à son couronnement, et comment il les avait repoussées en déclarant qu'il aurait pour ennemis tous ceux de l'église, mais non pas tous ceux du pontife.
De retour en Angleterre, l'historien fut accueilli avec une nouvelle bienveillance par Henri III, dont il censurait avec une incroyable liberté les actes politiques et la faiblesse à l'égard de la cour romaine. Il lui reprocha sans crainte l'acte despotique par lequel il violait les droits de propriété du monastère de Saint-Albans pour complaire à un de ses favoris ; le roi parut avoir égard à ses remontrances, mais ne tarda pas à les oublier.
A la fin de l’an 1250, Matthieu Paris, s’arrêtant au temps même où il écrivait, suspendit son travail historique,[8] après avoir augmenté et remanié les chroniques de son monastère. Il se réservait, sans doute, de continuer la sienne, lorsque de nouveaux événements et un laps de temps suffisant lui permettraient d'en reprendre la rédaction. En effet, à partir de l’an 1251 jusqu'en 1259, la Grande Chronique lui est unanimement attribuée. Lui-même nous raconte, comme témoin, la dédicace de l'église de Hales, fondée et bâtie par le comte Richard de Cornouailles, dont il obtint des renseignements précis sur les frais que coula la construction de cet édifice religieux. Matthieu Paris rapporte avec complaisance tout ce qui peut montrer ses relations familières avec les principaux personnages de son temps, surtout avec la famille qui régnait alors en Angleterre. Il avait souvent occasion de converser avec le roi lorsque celui-ci venait à Saint-Albans se promener dans le verger, suivi de son frère, de quelques seigneurs et d'un chapelain poitevin, lequel remplissait le rôle de bouffon. D'autres fois le roi venait au monastère prier au tombeau du saint et l'enrichir de somptueuses offrandes, comme il le fit au mois de mars 1257, Alors il appelait Matthieu Paris, le retenait continuellement auprès de lui, dans son appartement et à sa table, dirigeant sa plume avec attention et amitié. Leur entretien avait souvent pour objet le comte Richard, frère du roi, qui venait d'obtenir la couronne impériale, et Henri nommait à l'historiographe tous les princes allemands qui avaient pris part à l'élection ; tantôt il énumérait tous les rois anglais canonisés, depuis Albert jusqu'à Edouard le Confesseur; tantôt il rappelait à sa mémoire la liste des baronnies anglaises, jusqu'au nombre de deux cent cinquante.
Il permettait à Matthieu Paris d'assister, dans la chapelle de Saint-Oswin, aux audiences sollicitées par les maîtres de l'université d'Oxford; il écoutait avec bienveillance ses remontrances en faveur de cette école célèbre, qui comptait, sous le roi Jean, plus de quatre mille étudiants, et dont les libertés paraissaient compromises par les empiétements de l'évêque de Lincoln.
Cette situation privilégiée ainsi que l'estime particulière accordée à la science et aux vertus du moine de Saint-Albans, lui facilitèrent les moyens de puiser aux sources les plus certaines les matériaux dont il composait sa chronique. Il fut l'ami de l'abbé de Ramesey, de Nicolas de Fernham, évêque de Durham; de Jean de Crachale, clerc spécial de Robert Grosse-Teste ; de maître Jean de Basingestokes, archidiacre de Leicester, l'un des hommes les plus savants du treizième siècle. Nous le voyons dans les mêmes rapports avec Richard, évêque de Bangor, Roger de Thurkeby, chevalier très lettré. Il apprend du Juif Aaron d'York les persécutions et les exactions dont il avait été accablé; il consulte Ranulphe Besace, ancien médecin de Richard Cœur-de-Lion, et qui avait vu Saladin ; les lettres écrites de la Terre-Sainte par Guillaume de Châteauneuf, maître de l'hôpital de Jérusalem, lui sont communiquées; enfin, Thomas Shirburne l'instruit des faits relatifs à la sanglante tragédie des Pastoureaux.
La piété du savant moine égalait son crédit et son mérite. Il offrit à l'église de Saint-Albans une chape d'étoffe précieuse ornée d'aigles brodées en or. L'étoffe lui avait été donnée par la reine Éléonore, et la frange d'or par le roi Hakon. Les présents qu'il avait reçus d’Henri III lui servirent à faire hommage à la chapelle de Saint-Matthieu, dans la même église, d'une chasuble avec son aube, son étole et son manipule, garnis d'une bordure en or, selon
On ignore dans quel mois de l’an 1259 mourut le chroniqueur de Saint-Albans ; il paraît qu'il cessa d'écrire au commencement de juin, atteint peut-être de l'épidémie qui venait d'enlever l'évêque de Londres. Une miniature tracée sur le manuscrit de son histoire, conservé à Saint-Albans, le montrait couché mourant sur son lit; au-dessus de sa tête était écrit : Ici meurt Matthieu Paris; son coude était appuyé sur son ouvrage, et de sa bouche sortaient ces paroles de l'Écriture : Je remets mon esprit entre vos mains : vous m'avez racheté, Dieu de vérité.
Nous possédons encore la plus grande partie des ouvrages de Matthieu Péris; ceux qui ont été publiés sont:
1. L'Histoire depuis l'origine du monde, maintenant placée à la tête de celle de Matthieu de Westminster ; cette transposition a été signalée par Parker, qui soutient son opinion par des raisons très plausibles.
2. L'Histoire depuis la conquête ; compilée de plusieurs chroniques, comme nous l'avons exposé, continuée par Matthieu Paris, depuis l’an 1255 jusqu'à l’an 1259, et ter minée par Guillaume de Rishanger, à la dernière année du règne d’Henri III, 1275. La préface de cette chronique est de Matthieu Paris, et les vingt-trois premières lignes paraissent avoir dû servir d'introduction à l'Histoire depuis l'origine du monde, par le même auteur. Le commence ment de cette préface a été littéralement copié par Matthieu de Westminster.
3. Le livre des Additamenta, servant d'éclaircissements et de pièces justificatives à la Grande Chronique, et où deux additions, seulement, sont des historiographes antérieurs.
4. La Biographie des deux Offa, rois de Mercie, fondateurs du monastère de Saint-Albans.
5. La Biographie des vingt trois abbés de Saint-Albans.
Les ouvrages inédits et encore existants de Matthieu Paris sont :
1. La Description du monde; série de cartes géographiques grossièrement tracées et peintes sur des feuillets placés en tête du manuscrit de la Grande Chronique. La première de ces cartes représente, à ce qu'il paraît, le sud de l’Angleterre; on y voit le château de Douvres, avec cette légende : Le chastel de Doure, l'entrée et la clef de la riche isle de Engleterre. Les autres légendes sont, la plupart, écrites en français. D'après les détails fournis par Selden, on peut conjecturer que la Description du inonde était simplement un recueil géographique destiné à éclaircir le texte de la Grande Chronique, où se trouvait comprise l'histoire universelle jusqu'au temps de Guillaume le Conquérant.
2. L’Historia minor, révision de la Grande Chronique : Matthieu Paris en retrancha plusieurs détails, ajouta et compléta différents faits, et intitula cette nouvelle rédaction, Chronica majora Sancti-Albani. Longtemps après lui, Guillaume Lambard, secrétaire de Matthieu Parker, abrégea les Chronica majora, et leur donna le nouveau titre d'Historia minor. Cette différence de titre a fait supposer, à tort, trois différentes histoires composées par Matthieu Paris.
Cet auteur écrivit, en outre, la Vie de saint Edmond comme il le dit expressément dans la Grande Chronique.
On lui attribue encore :
La Vie de saint Guthlace, celle de saint Wulstan, les Actes des martyres de saint Albans et saint Amphibale ; les Histoires d'Irlande; mais ces trois derniers ouvrages, comme l'observent Wats et Oudin, sont évidemment extraits de la Grande Chronique et auront été copiés à part ce que prouve l’incipit de l'Histoire d'Irlande; quant à la Vie de saint Ulstan, nous avons déjà reconnu qu'elle est l'ouvrage d'un auteur antérieur à Matthieu Paris. Celui-ci fait mention de la Vie de saint Guthlace, mais ne s'en déclare pas l'auteur.
L'importance de la Grande Chronique est tellement manifeste, que, depuis l’année 1571 où Matthieu Parker, archevêque de Cantorbéry, la publia pour la première fois, elle fut réimprimée à Zurich en 1606, puis à Londres en 1640, à Paris en 1644, et à Londres en 1684, avec les notes de Wats et de Selden.
L'indépendance, même la causticité, que respire cette chronique à l'égard des rois, des évêques, des abbés de Saint-Albans, et surtout des papes, ont paru si étranges aux catholiques, que Baronius, entre autres, et, après lui, Bellarmin, ont cru reconnaître dans les passages les plus virulents des interpolations qu'ils attribuent aux éditeurs hérétiques d'Angleterre ou de Zurich. Les auteurs protestants et ceux du dix-huitième siècle profitèrent avec tant d'empressement des faits détaillés dans la Grande Chronique, ils la consultèrent si exclusivement pour ce qui concernait l'histoire de l'église, que, faute de confrontation et d'impartialité, ils se sont laissé entraîner à de graves erreurs. Un des plus notables historiens que l'Angleterre ait produits, Lingard, porte sur Matthieu Paris un jugement d'une excessive sévérité sur lequel, malgré son amour de l'équité, l'esprit catholique de l'auteur ne peut avoir été sans influence. Baronius, tout en blâmant avec passion ce qu'il regarde comme coupable dans tes révélations hardies du chroniqueur de Saint-Albans, n'en est pas moins obligé d'avouer que, sans ces graves défauts, ces blasphèmes comme il les appelle, son ouvrage serait un livre d'or, riche par les documents publics dont il est comme tissu et construit. Mais Lingard après avoir fait constamment de la Grande Chronique un usage souvent nécessaire et toujours utile, s'exprime enfin en ces termes :
« De tous ces écrivains, le plus plaintif est Matthieu Paris, moine de Saint-Albans, en partie auteur, en partie compilateur du pesant volume qui, avec la continuation de Rishanger, a été publié sous son nom. Cet ouvrage contient beaucoup de documents originaux, dont quelques-uns sont importants. Mais l'écrivain, accoutumé à déchirer les grands, soit ecclésiastiques, soit séculiers, semble avoir rassemblé et conservé toutes les anecdotes malignes ou scandaleuses qui pouvaient satisfaire son goût pour la censure. Il paraîtra peut-être malveillant de parler rudement de cet historien favori ; mais je suis en mesure d'affirmer que, dans les circonstances où j'ai pu comparer ses pages avec les pièces authentiques ou avec des écrivains contemporains, j'ai le plus souvent trouvé leur désaccord si grand, que sa narration prenait l'apparence d'un roman plutôt que celle de l'histoire ».
Le même auteur accuse l'historiographe de Saint-Albans d'avoir, en cette qualité, dénigré un personnage éminent, Robert, évêque de Lincoln, qui visitait avec sévérité les monastères de son diocèse.
On reproche encore à Matthieu Paris une crédulité extrême, qui lui fait rapporter des faits merveilleux avec de longs détails et une naïveté puérile; enfin il est taxé d'ingratitude pour avoir emprunté à Roger de Wendover une partie de sa chronique, et ensuite outragé la mémoire de celui auquel il enlevait le fruit de son travail.
Il ne nous semble pas difficile, de justifier les auteurs de la Grande Chronique, et Matthieu Paris en particulier. Wats a déjà écarté de celui-ci l'inculpation d'une opposition malveillante aux actes diplomatiques des légats et aux décisions politiques des papes. Comme il l’observe avec raison, tous les historiens anglais qui précédèrent et suivirent Matthieu Paris, Edmer, Malmesbury, Newborough, Wendover, Matthieu de Westminster et Walsingham sont unanimes dans leur censure des exactions et des déprédations commises en Angleterre par les légats, au nom et avec l'autorité du Saint-Siège. Jusque dans Joinville, on trouve des plaintes exhalées, par un légat même, contre la corruption de la cour pontificale. Les exemples fameux de Jean de Salisbury et de Robert Grosse-Teste, dont les rudes avertissements et la résistance furent humblement accueillis par les papes, les véhémentes remontrances du clergé anglais dans les conciles de Londres et de Lyon, sont d'accord, sur ce point, avec la Grande Chronique. Seulement, elle nous apprend, de plus, les manœuvres par lesquelles les Italiens réalisèrent en Angleterre les grandes levées d'argent, si nécessaires à une puissance universelle dont le trésor n'était pas à Rome, mais chez toutes les nattons catholiques.
Considérons encore que Matthieu Paris fut investi de missions honorables par Innocent IV, et par les rois Louis IX et Hakon V ; qu'il fut admis avec faveur et amitié dans l'intimité des princes anglais, eut des relations constantes avec les hommes les plus religieux comme les plus distingués de son temps, et que, s'il apporte dans sa chronique un esprit de censure hardie envers les grands qu'il avait vus de près, on ne peut que lui savoir gré d'une impartialité trop rare chez les historiens, surtout à l'égard de l'ordre auquel ils ont appartenu. Robert Grosse-Teste a été rigoureusement traité par Matthieu Paris, lorsque celui-ci voyait dans l'évêque de Lincoln le visitateur violent de son monastère, indifférent aux privilèges dont chaque couvent était alors doté, et que tout moine était jaloux de défendre; mais aussi quelle justice éclatante ne rend pas le chroniqueur aux vertus de Robert, à son courage, à sa lutte constante pour les libertés de l'église anglicane, opinion qu'il partage avec ardeur, et qu'il couronne enfin dans la personne de l'évêque mourant par une espèce d'apothéose?
Ce serait s'imposer une tâche impossible à remplir que de prétendre disculper un historien du moyen âge de toute inexactitude historique; il faut même reconnaître que les fautes de ce genre sont fréquentes dans la Grande Chronique, surtout en ce qui concerne les croisades, spécialement la première de saint Louis. Cependant Matthieu Paris, aussi bien informé qu'on pouvait l'être alors par ses relations tant avec la cour qu'avec Rome et avec le clergé de France, est resté le seul historien à consulter pour le temps de Jean-sans-Terre, dont le règne fut sans gloire, mais décida l'avenir de la nation anglaise. La Grande Chronique avec les Additamenta contient, d'ailleurs, les plus précieuses données historiques, puisqu'on y trouve plus de deux cent cinquante pièces diplomatiques, lettres authentiques et documents semblables, dont une grande partie n'existe pas ailleurs. De ce nombre sont les actes du concile de Lyon et les fragments des actes de plusieurs autres conciles. On croira difficilement que le texte, parfois si piquant et si animé, destiné à servir de lien à des morceaux historiques de cette importance, n'ait pas été rédigé avec une complète bonne foi : partout éclate le désir du chroniqueur de ne consacrer sa plume qu'à la narration sincère des événements; on le voit s'en enquérir avec soin, et souvent revenir sur ce qu'il a déjà raconté pour y ajouter des rectifications et des détails. S'il se trompe parfois, que d'erreurs ne trouverait-on pas dans les écrivains, même postérieurs, lorsqu'ils ont, comme lui, voulu traiter l'histoire de toute l'Europe? Personne ne lira, d'ailleurs, la Grande Chronique sans y puiser une ample connaissance des mœurs et des grands événements du moyen âge ; on y remarque, sans doute, cet amour du merveilleux commun à tous les écrivains du même siècle, tels que Rigord, Richer, et par-dessus tous les autres l'hagiographe Jacques de Voragine, évêque de Gênes. Mais doit-on être surpris, doit-on regretter de rencontrer chez un historien les préjugés de son époque, ou chez un moine profondément pieux la croyance dans les reliques, les miracles et les visions, que partageaient alors les hommes les plus éclairés? Ce serait demander à Montluc d'être un cathodique tolérant, à Voltaire de n'être point railleur et incrédule.
L'ingratitude dont Matthieu Paris aurait fait preuve à regard de Wendover n'est qu'une injuste imputation ; à cette époque, tous les chroniqueurs anglais, continuant l'œuvre de ceux qui les avaient précédés, ne se faisaient aucun scrupule de leur emprunter la totalité ou de grands lambeaux de leurs travaux historiques; Matthieu de Westminster a copié Matthieu Paris, comme celui-ci transcrivit Wendover, comme probablement Wendover copie les écrivains dont il mentionne les ouvrages. Encore est-il bon d'observer que le travail de Wendover fut modifié pour être admis dans la Grande Chronique; il subit des retranchements et des additions.[9] L'ingratitude personnelle de l’auteur envers son prédécesseur ne reposerait, d'ailleurs, que sur le récit de la disgrâce de Wendover inséré, non dans la Grande Chronique, mais dans la Biographie des vingt-trois abbés ; et si, comme il y a lieu de le croire, Roger de Wendover perdit en même temps les bonnes grâces de l'abbé Guillaume et ses fonctions d’historiographe, il aurait cessé de remplir ces dernières, l’année qui précéda la prise d'habit de son heureux rival.
L'attention et l'exactitude avec lesquelles Matthieu Paris indique les éclipses, même celles qui paraissaient contre les lois de la nature, étaient inspirées par l'excellente tradition des chroniqueurs du douzième siècle. A leur exemple, le moine de Saint-Albans nota tous les phénomènes les plus singuliers, et le relevé des faits de ce genre qu'il a sauvés de l'oubli, les porte à un nombre considérable. Leur étude mérite l'examen des physiciens modernes qui trouveraient dans toute l'histoire du moyen âge, mais surtout dans ta Grande Chronique, une foule de renseignements curieux sur les observations astronomiques et météorologiques faites, pour l'époque, avec un soin tout particulier.
Nous terminerons cette apologie en faisant remarquer que si Matthieu Paris a contre lui Baronius, Coiffetean, Bellarmin et Lingard, ces critiques n'ont pu s'empêcher de lui accorder une part d'éloges ; il a reçu ceux de Casaubon, Voss, Selden, Daunou, Berington, Wachsmuth. Nous ne parlons pas des louanges que lui prodiguent Bale, Pits et Leland ; les deux premiers ont trop peu de critique et le dernier trop peu de modération dans ses affections littéraires, pour que leur opinion jouisse à nos yeux d'une suffisante autorité.
Nous ayons déjà dit que la partie de la Grande Chronique appartenant exclusivement à Matthieu Paris n'embrassait qu'une période de vingt-quatre années : mais les faits politiques qui signalèrent cet espace de temps méritaient par leur importance d’être exposés avec détail. Il est à regretter que Rishanger, autre moine de Saint-Albans, écrivain bien inférieur à celui dont il a continué les travaux, n'ait pas jugé convenable de donner à sa relation tous les développements qu'elle exigeait ; en quelques pages il nous fait parcourir quatorze années durant lesquelles se passèrent les graves événements dont Matthieu Paris avait commencé le récit Heureusement d'autres annales et de nombreuses pièces diplomatiques remédient, pour ceux qui étudient l'histoire, à l'insuffisance des pages de Rishanger, formant la dernière partie de la Grande Chronique. Le règne d’Henri III dura cinquante-sept ans. Commencé sous les plus tristes auspices, au milieu de la fuite et dans l'abandon, il se continua triste et sans honneur dans les guerres civiles, les intrigues, la captivité, et sous la pesante surveillance dies barons. Cependant l'Angleterre, qui doit au règne ignominieux de Jean-sans-Terre le commencement de sa liberté, en attribue la confirmation au règne d’Henri III, sans que ni ce prince ni son père puissent revendiquer l'honneur d'un généreux sacrifice, ou celui d'une adhésion loyale à des conditions imposées par leur mauvaise fortune. Henri III était faible, imprévoyant et pusillanime comme son père ; il avait besoin de donner, sa confiance à des favoris, et ne savait pas choisir ses conseillers ; lorsque des princes de ce caractère viennent à régner, si la pénurie de leur trésor les paralyse dans les périls, on les voit subitement tomber à la merci des corps délibérants, et ceux-ci mettre, sans hésiter, leur assistance à un prix tellement élevé, qu'il équivaut ou aboutit à l'annulation du pouvoir monarchique. Henri III ne manquait pas de vertus privées; il était chaste, tempérant, patient, prodigue d'aumônes ; d'une piété exemplaire et quelquefois aveugle, il rivalisait avec saint Louis dans sa vénération pour les reliques et pour les ordres mendiants. L'exemple de son père lui avait inspiré un respect mêlé de terreur pour l'église dont il s'était reconnu vassal en prenant la couronne ; son incapacité politique et militaire était notoire; sa bravoure resta toujours douteuse ; son ostentation, l’affection immodérée qu'il portait à ses proches, et sa partialité pour les étrangers le poussèrent à des profusions d'autant plus préjudiciables qu'elles épuisaient toutes ses ressources et le livraient désarmé aux parlements, toujours disposés à se prévaloir de leurs avantages. Moins heureusement partagé que le roi de France, dont le riche domaine faisait un puissant équilibre à celui de tous les grands vassaux, Henri, réduit à des concessions sans cesse renouvelées, avant d'obtenir des barons une aide ou une escuage, était obligé de mendier l'autorisation du pape pour extorquer des dîmes au clergé; il vendait jusqu'à sa vaisselle aux habitants de Londres, afin de subvenir aux besoins insatiables de ses créatures, et n'ayant en revenus que le neuvième de ceux de Guillaume le Conquérant, il ne savait remédier à cette disette financière que par les tergiversations les plus déloyales; passant hardiment de la promesse au serment, du serment à l'invocation de l'anathème ; puis, faussant avec la même audace ce que l'honneur et la religion avaient offert de plus sacré comme garantie de sa bonne foi. Henri prétendait justifier ses parjures par l'autorité des papes ses suzerains qui s'étaient arrogé la faculté de délier les serments et ne craignaient pas de violer leurs propres engagements au moyen de cette célèbre formule du nonobstant, qu'à leur exemple le roi ne se fit aucun scrupule de mettre en usage.
La situation de ce prince fut encore aggravée par ses campagnes de Bretagne et de Poitou, Qui tournèrent à sa confusion, lui laissant pour unique résultat des provinces amoindries, un trésor épuisé, et, pour consolation, les espérances d'une riche conquête, dépouille de Frédéric II en Italie, offerte par le pontife romain à son aveugle cupidité.
Depuis 1240, les impôts sollicités par le roi et les légats paraissaient intolérables, et vers 1244, les barons songèrent à déposer Henri ; mais il écarta Forage par des promesses : la colère des barons se tourna contre les agents de pape; un légat fut expulsé. Une députation, envoyée au concile de Lyon, réclama vainement la suppression des provisions papales, et celle des exactions immenses, opérées en Angleterre, au nom et avec l'autorité du siège apostolique. En 1248 les barons adressèrent au roi des plaintes plus hardies, il les éluda par sa dissimulation ; en 1250, il prit la croix afin d'obtenir des subsides; mais lorsqu'il eut accepté, pour son second fils Edmond, l'investiture du royaume de Sicile, les nouvelles levées d'argent qu'il sollicita révoltèrent l’esprit public, et firent éclater en même temps le mécontentement de la noblesse et du clergé. Quatre ans plus tard, nous voyons les barons se rendre tout armés au parlement de Westminster, et exiger leur convocation à Oxford. À ce moment commence la lutte ouverte où le roi trouve, à la tête de ses ennemis, Simon de Montfort, comte de Leicester, un des hommes les plus entreprenants et les plus habiles du treizième siècle.
Les décisions hardies prises dans l'assemblée d'Oxford, pour l'honneur de Dieu, le service du roi et le bien du peuple, produisirent, il est vrai, l'humiliation du roi, l'expulsion de ses frères et de ses conseillers ; mais elfes assuraient une constante protection atout homme libre, soumettaient les grands shérifs à l'élection, l'administration royale à un perpétuel contrôle; elles obligeaient le trésorier, le chancelier, le justicier à rendre des comptes annuels au parlement dont les sessions étaient en quelque façon permanentes, puisqu'il était réuni trois fois dans chaque année.
Malgré l'injurieuse épithète appliquée au parlement qui promulgua les provisions d'Oxford, on ne peut méconnaître que les efforts de l'intelligente aristocratie anglaise tendirent constamment, depuis, vers le but que Simon de Montfort s'était proposé, sans pouvoir cependant réaliser, dans toute son étendue, l'organisation conçue et tracée d'avance par cet esprit aussi ferme que supérieur.
La dépendance où vivait Henri III aurait été insupportable pour tout souverain; il résolut de s'y soustraire. Relevé de son serment par une bulle d'Alexandre IV, il osa rompre avec les, barons qui s'étaient constitués administrateurs du royaume; mais assistés du clergé dont l'indépendance et l'esprit national étaient stimulés par son appauvrissement imminent, soutenus par les villes dont un grand nombre prit part à la rébellion, les barons, dans leur vigoureuse résistance, déployèrent contre Henri les ressources les plus efficaces. Après l'inutile interposition de saint Louis, nommé arbitre de cette grande querelle, la bataille de Lewes, suivie de la captivité du roi, plaça le gouvernement, comme l'avenir de l'état, entre les mains de Leicester; il en profita pour introduire dans la constitution d'importantes modifications dont la plus marquante fut d'admettre au parlement les députés des bourgs et cités du royaume.
Ainsi fut achevée, sous l'influence de l'esprit public, par la force et le discernement de quelques chefs, cette transition salutaire du régime féodal au régime constitutionnel, source des prospérités et de la grandeur de l'Angleterre, état plus approprié au génie de la nation britannique, et à son système d'aristocratie, qu'à toute autre nation européenne, où les éléments de pouvoir et d'action ne se contrebalancent pas avec la même régularité.
La bravoure du prince Edouard, avec la défection de Gloucester, purent abattre la ligue et le chef des barons sur le champ de bataille d'Evesham; mais l'œuvre de Pembroke et de Leicester subsiste encore aujourd'hui. Elle atteste le génie de ces hommes qui reconnurent la réforme devenue nécessaire, l'accomplirent avec une noble audace, et la léguèrent à la postérité.
[1] Si l’on croit Jean de Fordun, Scoti-chronicon, lib. 46, c. 59, les monastères fondés par les rois anglais étaient tenus d'avoir un annaliste, et, après la mort de chaque roi, tous les chroniqueurs se rassemblant, soumettaient leurs œuvres à des hommes sages chargés de les comparer et d'en extraire ce qui méritait d'être conservé. Cette tradition paraît avoir inspiré peu de confiance à Jean de Fordun lui-même, puisqu'il se sert des expressions : ut audivi; elle a, d'ailleurs, une grande analogie avec celles qui concernent des usages semblables prêtés par les Orientaux aux princes de l'Asie. Il est cependant certain que l'autorité des chroniques de monastères faisait foi, au quatorzième siècle, en matière de droit des gens, puisqu'en 1300 Edouard Ier en fit consulter un grand nombre pour éclaircir la question de ses droits envers les Ecossais. Ce prince inséra dans sa lettre au pape Boniface les recherches de Rishanger (Halliwell, Introd. ad Rishang. p. vi), et recueillit les ouvrages de Raoul de Diceto dans le même but diplomatique. Bale, Script. ill., t. I, p. 256.
[2] C'est l'opinion de Wats fondée sur le nom du chroniqueur tel que le donne un manuscrit de Cotton, et sur l'existence d'un autre Richard de Wendovre, évêque de Rochester. Vandœuvre est une localité de basse Normandie dont le nom et les seigneurs peuvent avoir simultanément passé en Angleterre. Wendower est situé à huit lieues est d'Oxford.
[3] Nous rappellerons bientôt que la légende de la caverne de Saint Patrice est attribuée à Matt. Paris. Celui-ci peut l'avoir ajoutée à la chronique de Wendover où il a fait plusieurs suppressions et une addition certaine.
[4] Tom. ii. Vision miraculeuse d'un moine. Voyage de Thurcill à l'enfer et au paradis. Il est singulier d'observer que trois révélations semblables sont faites dans la personne d'un moine, d'un chevalier et d'un villageois, au clergé, à la noblesse et au peuple.
[5] C'était au commencement de 1247, puisque le prieur de Holm vint trouver Matt. Paris en Angleterre avant l'arrivée du légat Guillaume en Norvège (Grande Chron., t. iv, p. 440, 444), et que l'arrivée du légat à Bergen est fixée au 17 juin par Sturla Thordson, Saga Hakonar Konungs, cap. 249, p. 271, et Praef., p. 29, éd. Hav. 1818.
[6] Wachsmuth pense qu'il s'agit du monastère de Holm, aujourd'hui forteresse de Munkholm près Nidaros, Trondheim. Le traducteur de Matt. Paris est d'une opinion différente, t. VI, p. 440, not. 1.
[7] Gr. Chr., t. vi, p. 442, 445. Le récit de Matt. Paris offre assez de désordre sous le rapport de la chronologie; en le lisant attentivement, on peut le rétablir avec certitude, comme nous venons de le faire. Il n'est pas vraisemblable que la lettre patente de saint Louis puisse être corrigée pour la date, 1248, qui n'est pas écrite en chiffres dans le texte de notre auteur.
[8] C'est ce qu’indiquent les vers qui servent de conclusion à l'année 1250. Ils sont imités, pour le sens, de ceux qui passent pour marquer la fin du texte de Wendover. Gr. Chr., t. vii, p. 448, 449.
[9] Cf. Wats, éd. Matth. Paris, ad calc. Prédiction des astronomes de Tolède supprimée par Matt. Paris qui ajoute les détails de l'ambassade de Jean à l’Emir-al-Moumenim.