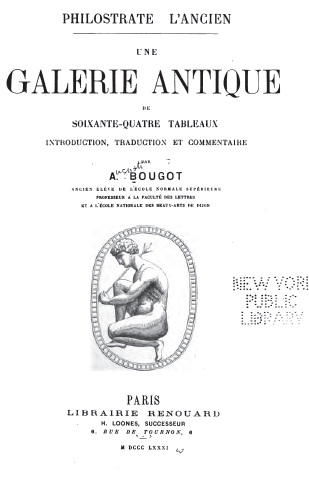
PHILOSTRATE L'ANCIEN
GALERIE ANTIQUE.
INTRODUCTION (pages 108-161)
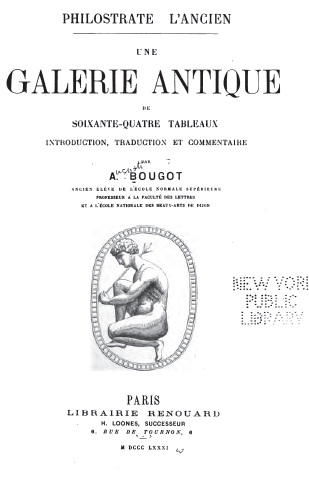
INTRODUCTION (pages 108-161)
INTRODUCTION
Philostrate l'ancien. — La peinture antique et les tableaux de Philostrate.
— La critique
d'art chez les anciens. — L'ecphrasis ou description des œuvres d'art dans
l'antiquité.
pages 1 - 55 - pages 56-107 - 161-fin
108 Ce procédé n'était point étranger à l'art de la miniature, vers le quatrième ou le cinquième siècle, comme l'attestent quelques-unes des cinquante-huit peintures qui accompagnaient le texte d'un manuscrit de l'Iliade et qui sont, aujourd'hui conservées à la bibliothèque Ambroisienne (1). Considérez, par exemple, celle qui représente le retour de Chryséis vers son père (2) ; voici Ulysse, aisément reconnaissable à son bonnet, qui prend la main de Chryséis et la place dans la main du grand prêtre, couronné de laurier ; cependant on aperçoit sur le dernier plan, à demi caché par un repli du terrain ou un rocher, un navire d'où Ulysse et Chryséis ne sont point encore descendus. On dirait, dit Inghirami, que cette seconde scène représente le départ de la fille de Chryséis, et la première son arrivée dans la maison paternelle. En tout cas, ce sont bien les mêmes personnages, engagés dans deux scènes qui se sont suivies de très près. Sur une autre miniature (3), d'un côté de la composition, on aperçoit Ulysse dépouillant Dolon de 109 la peau de loup qu'il avait revêtue, de l'autre Ulysse tenant à la main la tête saignante de Dolon qu'il vient d'égorger. Une autre miniature (4), nous transportant à la fois dans le camp des Grecs et dans celui des Troyens, nous montre ici Ulysse et Diomède égorgeant Rhésus et ses compagnons, là Ulysse et Diomède présentant à Nestor et autres chefs de l'armée grecque les cavales du roi thrace. Les sujets chrétiens ne furent pas traités différemment par la miniature. Dans une peinture de la Topographie de Cosmos, l'aventure de Jonas se divise en trois épisodes, comme sur les murs des Catacombes ; ici Jonas est précipité à la mer ; là il sort de la gueule du monstre ; plus loin il est couché sous un arbuste (5). Une miniature d'un manuscrit syriaque, qui date de la fin du septième siècle, nous présente la crucifixion et la résurrection. Dans ce dernier épisode les saintes femmes figurent deux fois ; à gauche, elles se rendent vers le sépulcre ; à droite, elles tombent à genoux devant le Christ ressuscité (6). Comment penser qu'un artifice d'un emploi si fréquent, à la dernière époque de l'art, dans le bas-relief et les miniatures, ne se soit point introduit dans la peinture mobile ou murale de la même époque (7) ?
L'indépendance est une des marques les plus distinctives de l'art antique. Il n'est guère de règle qui lui soit en tout et partout applicable. Après l'unité de temps et de lieu prenons pour exemple ce que nous appelons en peinture du nom de couleur locale. Entendue de la façon la plus générale, elle consiste à respecter la vérité et la vraisemblance. C'est pécher contre la vérité historique que de donner quatre chevaux au char d'Am- 110 phiaraos (8), lorsque les poésies d'Homère nous apprennent qu'à cette époque tous les chars étaient attelés de deux chevaux ; c'est donner des progrès des arts dans la société homérique une idée peut-être trop avantageuse que de placer, auprès d'Achille jouant de la lyre, deux jeunes filles dont l'une semble lire sur un rouleau des notes de musique, et l'autre lève la main pour marquer la mesure (9). C'est confondre les temps que de représenter la tente d'Achille, qui paraît avoir été une espèce de baraque en planches, comme les tentes des soldats romains sur la colonne Trajane ; que de donner la cuirasse d'une seule pièce à des héros habitués à porter la cuirasse composée de deux parties que Polygnote, dans sa Destruction d'Ilium, avait placée sur un autel, sans oser en revêtir ses personnages, tous empruntés cependant au cycle héroïque. C'est tenir peu de compte de la vraisemblance que de coucher une Ariadne abandonnée sur le sable du rivage, et pourtant de placer sous son corps des étoffes précieuses et un riche coussin ; c'est user largement du droit à l'indulgence que de jeter sur des centaures, non des peaux de bêtes, mais des étoffes, et que de donner des langes à leurs petits. Ce sont pourtant là toutes libertés que l'art antique a prises et que nous ne songeons pas d'ailleurs à blâmer. Le peintre n'est ni un antiquaire, ni un historien, ni un copiste exact de la réalité ; il s'adresse beaucoup plus à notre sensibilité qu'à notre raison et à notre science ; s'il transporte les choses d'un temps et d'un monde dans un autre monde et un autre temps, il compte, avec raison, sur l'acquiescement de notre imagination, à qui plaisent souvent les combinaisons nouvelles d'éléments connus.
Toutefois, il ne serait pas juste de dire que l'artiste ancien n'a aucun souci de la couleur locale ; non, tantôt il y reste fidèle, tantôt il s'en écarte. Suivant quelles lois ? dira-t-on, suivant quels principes ? Cette loi ne paraît pas uniforme ; 111 ce principe n'a pas été formulé par l'antiquité. Il est pourtant aisé de découvrir dans la plupart des cas la raison esthétique qui a déterminé l'artiste, sciemment ou à son insu, à rester dans la vérité historique ou à la sacrifier. Veut-il représenter Priam apportant dans la tente d'Achille la rançon d'Hector ? Il donnera à Priam et aux Troyens qui l'accompagnent le bonnet à la pointe ramenée sur le sommet de la tête, la tunique à manches, les pantalons collants, serrés à la cheville, le manteau large et flottant. C'est là le costume phrygien, réel ou de convention ; il sert ici à caractériser la scène ; une légende n'aurait pas été plus claire ni plus explicite. Dans une peinture décorative, l'artiste conservera à Paris le même costume phrygien et l'enrichira de broderies (10) ; mais veut-il montrer à nos yeux un jeune homme digne par sa beauté d'inspirer de l'amour à la plus belle des déesses, puis à la plus belle des femmes, il ne laissera au berger phrygien que son bonnet et sa chlamyde (11) ; il pourra même le placer, dépouillé de tout vêtement et de tout signe caractéristique, à côté d'Oenone ou d'Hélène (12), et les archéologues, pour le reconnaître, devront comparer cette composition à une toute semblable par l'attitude et la place du personnage, mais où Paris porte le bonnet phrygien et le pedum traditionnel. Sur le bas-relief d'Orope, sur une peinture monochrome d'Herculanum (13), Amphiaraos est traîné par quatre chevaux ; pourquoi cette dérogation à la vérité historique ou, si l'on veut, aux indications de la légende ? C'est sans doute parce que deux chevaux sont moins agréables à voir et plus aisés à représenter (la difficulté étant un attrait pour l'artiste consommé) que quatre chevaux habilement 122 disposés, dont les quatre têtes affectent des attitudes différentes, dont les seize jambes se plient on se tendent sans se gêner ni se masquer. Au contraire, un simple bige porte le héros sur des bas-reliefs, sur des gemmes, où le quadrige n'aurait pas eu sa place, ou en aurait occupé une trop étendue par rapport aux autres objets avec lesquels il est groupé dans la composition. C'est qu'en effet la vérité historique et la vraisemblance sont non pas sacrifiées, mais subordonnées aux nécessités pittoresques. La raison d'art, voilà la principale, sinon la seule que les artistes ont reconnue dans tous les temps.
Toutefois, en fait de costume et de couleur locale, l'art antique paraît avoir suivi à peu près la même loi dans son développement que l'art moderne. Dans le principe , ou il ne se préoccupe nullement de la vérité historique, et représente, avec Polygnote, Orphée non comme un Thrace, mais comme un Grec; ou, s'il s'en préoccupe, il conserve, jusque dans sa fidélité, une certaine indépendance. C'est ainsi, par exemple, comme l'a fait remarquer l'Académie des beaux-arts (14), que les Perses, si connus cependant des Grecs, sont faiblement caractérisés dans les bas-reliefs du temple de la Victoire Aptère à Athènes, surtout si l'on compare ces bas-reliefs à ceux de Persépolis. Au contraire le souci de l'exactitude est porté très loin dans certaines œuvres de date plus récente. Un grand nombre de vases, exécutés sans doute vers l'époque d'Alexandre, les vases à figures rouges d'un dessin hardi et plein de franchise, les vases à ornements dorés, représentent de préférence des scènes qui ont pour acteurs des asiatiques ou des barbares. Ici, comme sur. le vase célèbre de Xénophantos (15), ce sont des Perses à la chasse ; là le grand roi et la reine sa femme (16) ; sur le vase dit de Darius (17), le roi tient conseil avec ses courtisans et reçoit 113 les tributs ; ailleurs un roi asiatique, monté sur un dromadaire, est entouré de personnages qui célèbrent les orgies bachiques (18). Dans toutes ces compositions, l'éclat et la variété du costume nous transportent en Orient. Sur les vases à figures rouges, d'un style sévère, dit M. Helbig, les Amazones sont armées comme des hoplites grecs ; plus tard elles auront la mitre phrygienne, les anaxyrides, les vêtements zébrés ou tachetés. Sur les anciens vases c'est à peine si Priam, Paris, Memnon, Médée offrent, dans leur costume, des traces de leur origine asiatique ; l'art plus récent marque fortement leur nationalité (19). Un exemple frappant de fidélité à la couleur locale nous est donné par la grande mosaïque du Musée de Naples qui représente, dit-on, la bataille d'Arbelles; les Perses se montrent à nous dans tout l'éclat de leur costume national. Leur souverain, Darius, a la tiare droite ; elle se courbe en avant sur la tête des chefs ; elle s'aplatit sur celle des soldats. On distingue la tunique à manches, l'ample manteau, les anaxyrides, les chaussures enveloppant tout le pied ; l'or et l'argent brillent, les pierreries étincellent sur toutes ces parties du costume asiatique : les griffons, ces monstres chimériques que l'on rencontre sur les monuments grecs, mais qui paraissent d'origine orientale, déploient leurs ailes, étalent leurs griffes, allongent leur bec sur les pantalons des guerriers et les selles des chevaux.
La peinture campanienne donne aussi aux personnages et aux divinités locales de l'Asie, à Priam, à Paris, au génie du Mont 114 Ida, par exemple, non seulement des traits et un teint exotiques, mais encore les principales pièces du costume oriental, le bonnet et les pantalons ; toutefois comparés aux peintures de vases ou à la mosaïque de Naples, les tableaux d'Herculanum et de Pompéi se distinguent, à cet égard, par une remarquable discrétion ; conservant les formes des vêtements asiatiques, ils rejettent la broderie et les dessins variés, comme si ce luxe de richesse eût été préjudiciable à la beauté des figures. Dans les scènes placées ailleurs qu'en Asie, la fidélité à la couleur locale admet les mêmes ménagements. Par exemple, une peinture de Pompéi (20) représente la mort de Sophonibe. Scipiona les brodequins militaires et le paludamentum : les archéologues ont cru remarquer sur son visage la cicatrice qui se voit sur ses bustes. Masinissa et Sophonibe ne sont point particulièrement caractérisés par leurs vêtements; une bandelette rose, un collier, un bracelet n'aideraient point à faire reconnaître la fille d'Asdrubal et l'épouse de Syphax ; une bandelette blanche sur la tête, une chlamyde jetée sur le bras ne désigneraient pas clairement le roi des Numides : mais Masinissa a les traits nettement accusés et le teint coloré des races africaines ; des deux servantes de Sophonibe, l'une, très blanche de teint, porte un chiton blanc ; mais l'autre se reconnaît pour une Africaine à son visage brûlé par le soleil, à sa coiffure rayée de blanc et de jaune. La couleur locale, dans ce tableau, n'a point, comme on le voit, fait l'unique préoccupation de l'artiste ; elle l'a préoccupé cependant, et il s'en est habilement servi pour caractériser, sans le surcharger de détails, le sujet de son tableau.
Il serait intéressant de savoir si au temps d'Alexandre, et sous ses successeurs, la peinture de chevalet, dans sa manière de traiter la couleur locale, se rapprochait plus des peintures de vases et des mosaïques, ou des peintures campaniennes. La question est assez délicate à résoudre. Pline nous dit bien 115 qu'Apelle avait représenté la Procession de Mégabyse, le grand prêtre d'Artémis éphésienne ; qu'Aétion avait peint un événement de l'histoire de Sémiramis, peut-être comme on l'a conjecturé (21), le mariage de cette princesse avec Ninos : Néalcès, un combat naval entre les Perses et les Égyptiens (22) ; mais il serait peut-être hardi de prétendre avec M. Helbig, que le principal attrait de ces tableaux devait consister dans la pompe, l'éclat varié et par suite l'exactitude des costumes orientaux. Toutefois la différence que nous remarquons entre la peinture campanienne, d'une part, de l'autre, les peintures de vases et les mosaïques, nous autorise à croire que la peinture de chevalet différait de l'une et des autres ; en outre, il semble qu'en raison même de la richesse de ses moyens, elle ait dû être tentée plus d'une fois de mieux caractériser la nationalité de ses personnages que la peinture décorative et généralement sommaire de Pompéi et d'Herculanum.
Rapprochons maintenant de ces remarques et de ces conjectures les descriptions de Philostrate. Pélops porte la tiare et les autres pièces du vêtement phrygien ; Philostrate regrette même l'exactitude trop scrupuleuse du peintre. « Les flancs, la poitrine de Pélops, toutes les parties dont on aime à juger la beauté, dit le sophiste grec, nous sont dérobées, comme la cuisse elle-même, par le costume. » Dédale a le tribôn ou manteau des artistes et des philosophes ; dans le tableau de Thémistocle, non seulement les Perses portent le costume asiatique, brodé, constellé, chamarré de bêtes fantastiques, mais comme dans les vases cités plus haut, l'or rehausse l'éclat de cette pompe orientale : un bouclier échancré est orné d'un aigle d'or, l'insigne royal ; le trône du roi est en or ; l'or étincelle dans la cour du palais. Rhodogune, dans le tableau de ce nom, n'a ni pierres précieuses, ni colliers, ni ornements d'aucune sorte ; mais en vraie reine orientale, elle est vêtue avec magnificence : 116 elle porte des anaxyrides brodées ; sa tunique est de pourpre ; ses longues manches sont composées de deux parties rattachées sur le bras par une série d'agrafes ; sa monture, une cavale de Nisa, est parée de tous les bijoux qu'elle s'est refusés à elle-même ; l'éclat de la pourpre brille sur les guerriers, morts ou vivants. On pourrait confondre le costume de Rhodogune avec celui des Amazones ; Philostrate a bien soin de nous prévenir que le peintre n'a point commis la faute d'habiller une reine de Perse comme une Hippolyte; en effet le sein n'est pas découvert : toute l'épaule est cachée. Cette fidélité à.la couleur locale était-elle partout soutenue? pour répondre à celte question, il faudrait voir sans doute les tableaux eux-mêmes ; il est à remarquer que Philostrate ne décrit point le costume de Panthée, mourant sur le corps d'Abradate; qu'il donne à Thémistocle le tribôn qui ne semble pas avoir été jamais le costume des grands personnages de la Grèce. Mais de toutes façons nous n'avons pointa nous étonner ; la date des tableaux de Philostrate explique ce qu'ils peuvent avoir de trop minutieux dans l'imitation du costume ; les habitudes de Part antique expliquent les infidélités que l'on pourrait relever à cet égard. Quant à la vraisemblance, elle est en général observée dans les tableaux de Philostrate ; au besoin cependant l'artiste s'en est écarté ; ainsi les petits des centaures sont enveloppés de langes semblables à ceux qui servent aux enfants ; dans le tableau du Cyclope qui représente d'ailleurs un pays favorisé par Dionysos, on fait à la fois la vendange et la moisson ; il n'est pas besoin, pour expliquer des faits semblables, d'alléguer les modifications de l'art ; l'esprit de convention qui règne souverainement dans les arts antiques, mieux que cela les droits du caprice et de la fantaisie, qu'en aucun temps on n'a déniés aux artistes, suffisent, croyons-nous, pour rendre raison de ces très légitimes hardiesses.
Les observations précédentes s'appliquent tout à la fois à la peinture mythologique et à la peinture historique ; aussi avons-nous demandé des exemples tant à l'une qu'à l'autre, 117 Il est nécessaire de considérer séparément la peinture de paysage, la peinture de genre et celle de nature morte.
Dans ses études sur les peintures campaniennes M. Helbig partage en différentes classes les paysages antiques, les uns, servant de cadre à un sujet fabuleux, à des événements imaginés ou racontés par les poètes, ont, pour ainsi dire, un caractère épique ou dramatique, conforme d'ailleurs à la scène représentée ; la nature y est austère, les arbres, les montagnes ont de grandes proportions, des formes nettes et précises ; telles sont, par exemple, les peintures qui représentent la lutte de Persée contre le monstre marin ou la chute d'Icare. D'autres paysages, au contraire, sont conçus dans un style idyllique ; ils offrent à nos regards des arbres sacrés avec leurs bandelettes flottantes et leurs offrandes suspendues au tronc ou aux branches, des sanctuaires, des antres, des statues de Nymphes, d'Hermès, de Priape; les personnages sont des bergers conduisant des troupeaux ou jouant de la flûte, des paysans occupés à la charrue ou offrant des sacrifices. Dans un cadre semblable viennent quelquefois se placer des sujets mythologiques, dont le caractère confine à l'églogue, par exemple Paris sur le mont Ida, Bellérophon et Athénâ cherchant à s'emparer de Pégase qui paît tranquillement au bord d'un ruisseau. Ailleurs la peinture nous transporte sur les rivages de la mer; les mêmes objets, arbres sacrés, autels, donaria se présentent à la vue ; toutefois l'horizon est quelquefois plus vaste, le ciel est déchiré par des rochers et des montagnes découpées en forme de dents ; des barques se balancent sur les flots ; des pêcheurs tiennent leur ligne ou relèvent leurs filets. Mais la plupart des paysages campaniens ressemblent beaucoup à ce que nous appelons des vues ; ce sont des villas mirant dans l'eau leurs superbes façades ou préservées par de puissantes digues contre l'assaut des vagues ; ce sont des ports avec leurs arsenaux et leurs môles richement décorés ; ce sont des villes tout entières s'étageant en amphi- 118 théâtre, étalant leurs portiques aux innombrables colonnes qui s'étendent comme des bras dans la mer ou courent sur le flanc des montagnes. Les jardins et les parcs forment un autre groupe, mal représenté d'ailleurs dans la peinture campanienne, mais que les peintures de la villa ad Gallinas ne permettent pas d'oublier. Les paysages égyptiens tiennent aussi une grande place parmi les peintures de Pompéi ; les fabriques qu'ils nous montrent sont des maisons construites en roseaux, ou des temples et de vastes édifices participant à la fois du style grec et du style égyptien ; la végétation y est représentée par les fleurs de lotus, les roseaux, les palmiers ; des ibis, des crocodiles, des hippopotames, peuplent et animent une contrée marécageuse ; les personnages sont des Pygmées ou des paysans, qui vaquent surtout à des opérations de drainage. On compte quelques marines représentant des vaisseaux qui s'évitent, se poursuivent ou encore manœuvrent de conserve. Les paysages décrits ou indiqués par Philostrate (car en général le sophiste semble plus préoccupé des personnages que du cadre dans lequel ils se meuvent) peuvent se répartir à peu près dans les mêmes classes. Le tableau des îles, par exemple, représentait l'éruption d'un volcan ; au-dessus de la montagne vomissant la flamme et couverte de lave, apparaissait au milieu d'un brouillard, Jupiter qui lançait la foudre contre un géant, Encélade destiné à gémir sous le poids de la terre et à fournir aux poètes une explication des phénomènes volcaniques. Ailleurs les Phlégyens sont campés sur les bords du Céphise et Phorbas leur chef se tient sous un chêne, dont les branches ornées de dépouilles sanglantes paraissaient s'agiter au souffle du vent. Ailleurs le peintre avait représenté les Gyres, dominant les flots, et la mer soulevée par la tempête : « on croit voir, dit Philostrate, les roches blanchissantes, les écueils minés par le travail incessant des flots, le navire d'Ajax enveloppé par la flamme qui semble engouffrer le vent et fait pour ainsi dire l'office d'une voile. » Ce sont là des 119 paysages du premier groupe. Beaucoup plus fréquent et plus marqué surtout semble avoir été le caractère idyllique. Ici ce sont des Amours jouant avec des cygnes sur un bassin où croit l'amarante, là Olympos dort sur une prairie humide de rosée, à côté d'un antre et d'une source. Ailleurs le même disciple de Marsyas se mire dans l'eau limpide d'une fontaine. L'antre d'Achéloos et des nymphes était représenté dans le tableau de Narcisse. « La vraisemblance, dit Philostrate, a été observée : car on y voit des statues grossièrement sculptées dans une pierre qui provient du lieu même : les unes ont été rongées par le temps, les autres ont été mutilées par des enfants, des bouviers ou des pâtres qui, en raison de leur âge, ne sentent pas encore la présence du dieu. » Les statues à peine dégrossies sont représentées fréquemment dans la peinture campanienne par des figures d'un dessin un peu flottant et que l'on prendrait volontiers pour des ombres (23). Ailleurs les Cyclopes font la vendange et la moisson. Dans une île, aux pieds d'une statue de Poséidon, les laboureurs et les pêcheurs apportent sur un marché commun, ceux-ci les produits de leur pêche, ceux-là les fruits de la campagne. Sur un pont jeté contre deux îles passent des allants et venants, paysans et citadins. La mer et les bords de la mer étaient représentés plus d'une fois dans cette galerie de Naples et, comme dans les peintures campaniennes, de manière à rappeler les travaux des populations maritimes. Dans le tableau du Bosphore ou des Pêcheurs, tous les genres de pêche étaient réunis, la pêche à la ligne, au harpon, au filet, la pêche des menus poissons et des gros comme les thons. Le plaisir que prend Philostrate à les décrire fait penser que l'artiste avait mis la même complaisance aies peindre. L'un attache son aviron ; l'autre montre en ramant un bras tout gonflé par l'effort ; celui-ci encourage son voisin ; celui-là frappe un rameur paresseux. Ailleurs dans l'Isthme de Co- 120 rinthe, jeté comme un pont entre deux rivages, s'élève une forêt de pins qui forme l'enceinte sacrée, le téménos de Poséidon. Le tableau des lies semble avoir été conçu tout exprès pour rassembler sous le regard les aspects variés que peuvent offrir les rivages ; des ruisseaux se jettent dans la mer après avoir répandu partout la fraîcheur ; la végétation court sur les pentes qui s'abaissent vers les flots ; la vigne, le lierre et le smilax s'entrelacent, suivant l'usage antique ; des roches escarpées servent d'asile aux oiseaux de mer. Les ruines mêmes avaient trouvé leur peintre. « C'est ici, dit Philostrate, le vestibule d'une maison peu fortunée ; on dirait presque qu'elle n'a point de maître ; à l'intérieur, on aperçoit une cour déserte ; les colonnes qui se sont affaissées et déjetées ne soutiennent plus rien ; les seuls hôtes sont les araignées.... » Les Vues proprement dites étaient rares ; toutefois la galerie élevée près du rivage, les maisons qui surplombent les flots dans le tableau du Bosphore ; les constructions, théâtre et palais, qui couvrent une des îles, dans le tableau de ce nom, semblent des éléments empruntés à cette sorte de paysage. La peinture des Amours nous offre un véritable parc ou un verger ordonné à la mode campanienne : « Plantés en ligne droite, les arbres laissent entre eux de larges avenues pour les promeneurs ; les allées sont bordées d'une herbe délicate. » Le Nil que décrit Philostrate se détachait sans doute sur un fond semblable aux paysages égyptiens de Pompéi : toutefois le rhéteur se tait sur l'aspect de la contrée. Ailleurs, à propos de la Thessalie, inondée par les eaux du Pénée, Philostrate dira : « au premier aspect la peinture égyptise » comme s'il avait voulu rappeler du moins, par cette allusion fugitive, toute une classe de paysages chère aux anciens. Voilà bien des ressemblances avec la peinture campanienne ; mais les différences sont surtout instructives. Il faut remarquer d'abord que certains tableaux de la galerie de Naples représentaient une vaste portion de contrée. Le tableau du Bosphore et ce- 121 lui des Iles sont moins des paysages qu'une vue, à vol d'oiseau, là d'un détroit fort étendu, ici de toute une mer parsemée de nombreux îlots. Ce sont comme des cartes géographiques, d'un caractère plus pittoresque, avec fabriques et personnages. Brunn a comparé ces peintures à la table de Peutinger et à la peinture murale de l'Italie qui est conservée à la galerie géographique du Vatican (24). La comparaison n'est pas, on le comprend, tout à fait juste; toutefois elle prouve que l'idée d'offrir au spectateur comme un panorama d'une contrée n'était point étrangère à l'antiquité (25) ; dès lors, pourquoi le peintre n'aurait-il pas donné, au paysage ainsi conçu, tout le développement et toute la variété que nous rencontrons dans les descriptions de Philostrate ? En second lieu, dans certains paysages de la galerie de Naples, contrairement aux habitudes de l'art antique, les personnages et les fabriques font défaut, si bien que les artistes paraissent avoir représenté la nature pour elle-même. Une des îles décrites par Philostrate n'attirait les yeux que par ses ruisseaux et sa végétation, Mais d'abord la différence avec la peinture campanienne n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire ; cette île n'est pas isolée ; elle fait partie d'un groupe ; sur les autres îles on retrouve et les pêcheurs et les laboureurs, et les bûcherons, elles personnages mythologiques et la statue de Poséidon, et les attributs de Dionysos et les constructions fantastiques, tous éléments que ce tableau possède en commun avec tant de paysages anciens. En outre, il n'est pas impossible que le sentiment de la nature n'eût fait quelques progrès dans l'antiquité, depuis l'exécution des peintures d'Herculanum et de Pompéi, surtout depuis l'exécution des peintures qui paraissent avoir servi de modèle à ces dernières. Quelques faits, recueillis par Friedlander (26) qui d'ailleurs ne distingue pas suffisamment les épo- 122 ques, nous autorisent à penser qu'à cet égard l'antiquité n'a pas toujours ressemblé à elle-même. Sénèque exprime avec émotion l'effroi qu'inspirent les bois sacrés (27); en ce cas, le sentiment de la nature, pour se confondre avec le sentiment religieux, n'est pas moins réel ni moins vif. Pausanias, le voyageur du deuxième siècle, décrit avec une visible complaisance les grottes célèbres et ces arbres vénérés, dont Cicéron parle sur un ton léger. Pline l'Ancien, toujours si pressé, toujours si ennemi des détails oiseux, trouve le temps, à propos de la vallée de Tempé, de vanter le lit de cailloux sur lequel coule le Pénée (28) et le riant gazon, et le chant des oiseaux. L'étude de l'histoire naturelle, qui paraît avoir été très répandue à cette époque, devait s'allier à une certaine admiration aimante de la nature ; nous contemplons avec avidité, dit le même auteur, les herbes et le feuillage silencieux (29). La lettre de Pline le Jeune sur le lac Vadimon, la situation de ses villas, la position de tant d'autres villas romaines qui avaient vue sur la mer et sur la campagne, quelquefois sur les deux à la fois, nous montrent bien le charme que les scènes de la nature avaient pour les anciens de celte époque. Quintilien (30) ne veut pas que l'on travaille en face d'un paysage trop agréable ; exagérant le précepte, Pline le jeune (31), quand il méditait, au lieu d'ouvrir les fenêtres de ses villas d'où l'on apercevait tant et de si beaux points de vue, se renfermait dans l'obscurité la plus complète ; si vif était donc ce sentiment, que les hommes de volonté le combattaient en certaines circonstances ; la nature faisait peur, à force d'être attrayante. Au deuxième siècle, Oppien écrit ses Halieutiques et ses Cynégétiques, dans lesquels le sentiment de la nature se révèle moins encore par le choix du sujet que par la fraîcheur et l'exactitude amoureusement 123 minutieuse des descriptions. Au troisième siècle, à l'époque même de Philostrate, Elien abandonne la rhétorique pour l'histoire naturelle et compose des ouvrages où le sentiment des beautés de la nature est quelquefois faussé, non cependant étouffé par les préoccupations toujours subsistantes du sophiste. La nature exerce alors une séduction si impérieuse sur tous les esprits que les descriptions de paysages se glissent dans la grave histoire, et que Lucien est obligé de rappeler dans les camps et sur la scène de la vie politique les écrivains qui s'attardent dans les grottes et sous les berceaux de verdure (32). Quoi d'étonnant dès lors si l'art obéissant à la même tendance, a emprunté plus fréquemment ses sujets à la nature et s'est même émancipé jusqu'à écarter l'homme de ses paysages. D'ailleurs sur ce point, si nous ne savons pas de peinture antique où la nature soit peinte pour elle-même, où au lieu d'être le cadre ou l'entourage, elle soit l'objet même de la représentation, nous en connaissons du moins qui semblent occuper une place intermédiaire entre les paysages à personnages des villas campaniennes, et les coins de nature, si l'on peut dire, que nous rencontrons dans les descriptions de Philostrate ; ce sont les peintures esquilines qui représentent des scènes tirées de l'Odyssée. Une d'elles (33) nous montre Ulysse fuyant sur son vaisseau la côte des Lestrygons ; les personnages sont peu nombreux et n'occupent point une place principale ; d'un côté, un Lestrygon écrase avec une pierre un Grec attardé ; de l'autre, figurent sur des rochers les Aktai ou femmes personnifiant les rivages, derrière un rocher on aperçoit les trois quarts du navire d'Ulysse. Tout le reste de la composition est occupé par la mer et le développement des côtes qui présentent plusieurs saillies et aux fractuosités. On pensera peut-être que le peintre a suivi Homère ; il est bien question en effet dans le dixième chant de l'Odyssée 124 du « port superbe, autour duquel règne de toutes parts un rocher à pic, et dont l'entrée est resserrée par deux hauts promontoires » ; mais ce n'est point ici le port, que la première de ces peintures nous a d'ailleurs montré ; en outre, dans les vers que ce tableau est destiné à nous rappeler, le poète s'intéresse aux efforts d'Ulysse, non au paysage : si le peintre semble faire le contraire, c'est qu'il a senti que dans son art l'intérêt pouvait être déplacé sans inconvénient et peut-être avec avantage. En outre dans les peintures esquilines, le sentiment de la nature, qui a dirigé le pinceau de l'artiste, ne se révèle pas seulement par la prédominance de paysage ; il se montre encore dans la façon étudiée et consciencieuse dont chaque partie est traitée ; « la partie avancée d'une chaîne de montagne qui s'étend de la deuxième peinture à la troisième, dit Woermann, reproduit assez bien la physionomie du sol. Les rochers couverts d'écume qui forment le premier plan dans plusieurs tableaux, sont assez bien caractérisés; dans la peinture des enfers, des rochers forment une porte qui malgré la nature du sujet ne doit rien à la fantaisie, et se distingue par une telle fidélité dans l'imitation qu'elle me rappelle les portes de Mörmer à Helgoland, avant leur écroulement en l'année 1865 (34) ». Enfin les paysages de la galerie napolitaine, s'il faut en croire Philostrate (qui sur ce point, il faut l'avouer, prête peut-être aux artistes des intentions qu'ils n'ont pas eues), avaient quelquefois comme un caractère scientifique; ils permettaient à un œil observateur d'étudier la nature comme sur place ; ils avaient égard aux résultats de l'histoire naturelle ; ils étaient fidèles aux rapports que la science antique avait découverts ou cru découvrir entre les choses. « Le terrain est humide, dit Philostrate au début de sa description du Marécage; il produit le roseau et le fléole qui croissent naturellement sans semis ni labour dans les lieux marécageux. On distingue aussi dans le tableau le tamaris et le souchet 125 qui sont des plantes aquatiques. Des montagnes formant ceinture autour des marais perdent leur cime dans les airs ; elles ne présentent pas toute la même nature de terrain, le pin qui croît sur celle-ci annonce une terre fine et légère ; celles-là sont couvertes de cyprès qui attestent la présence de l'argile. Quant à ces sapins, ne disent-ils pas que la montagne qui les porte est rocailleuse et battue par les orages ?... » Si un palmier forme comme un pont sur un fleuve, c'est qu'il est du sexe mâle, et qu'il se dirige amoureusement vers le palmier femelle situé sur l'autre rive. Si le portique semi-circulaire qui longe le Bosphore offre un aspect jaunâtre, c'est qu'il a été bâti avec des pierres qui proviennent de certaines carrières de Phrygie et que l'infiltration des eaux a ainsi colorées. Ailleurs les mouettes dorment en cercle sur le sommet d'une île escarpée et le Céyx veille pour elles, ainsi que le voulait, dans l'antiquité, l'histoire de la nature. Il semble à lire de tels passages que Philostrate ou les peintres anciens aient eu de l'art dans le paysage une idée analogue à celle de Ruskin qui prétendait que la peinture révélât les vérités de la science. « Chaque classe de roche, chaque variété de sol, chaque espèce de nuage doit être étudiée et rendue avec une exactitude géologique et météorologique Toute formation géologique a ses traits essentiels qui n'appartiennent qu'à elle, ses lignes déterminées de fracture qui donnent naissance à des formes constantes dans les terrains et les rochers, ses végétaux particuliers.... de ces circonstances modifiantes résulte la multiplicité infinie des ordres de paysages... (35) » C'est le développement de la science moderne qui a inspiré de telles théories à Ruskin ; les progrès de la science dans l'antiquité semblent avoir eu une influence semblable sur les artistes et les rhéteurs. Après Sénèque, après Pline l'Ancien, au temps d'Elien et d'Oppien, si la peinture paraît commenter la science, ou si les sophistes distinguent un intérêt scien- 126 tifique dans les tableaux, nous ne saurions nous en montrer trop surpris : notre temps a connu le même pédantisme.
Examinons maintenant les ressemblances et les différences que peuvent offrir la composition et l'exécution avec les peintures de Campanie.
A Herculanum et à Pompéi, les divinités locales, les êtres qui figurent un
fleuve, une montagne, un pays, sont fréquents; dans la galerie de Naples ces
sortes de personnages se sont multipliés à l'excès ; d'après le calcul le
plus modeste on en compte jusqu'à six, par exemple dans le tableau de
Palémon. De plus, tout est personnifié, un isthme, un port. Cette
différence, tout à l'avantage des peintres campaniens, du moins suivant nos
idées modernes, a pu étonner les commentateurs; toutefois on sent combien
l'allégorie, une fois admise dans un art, tend à l'envahir tout entier,
comme à se compliquer et à se raffiner. En outre les peintures esquilines
témoignent encore de ces progrès, ou si l'on veut de cette tendance à l'abus,
dans l'emploi des personnifications ; un même tableau réunira les Vents, le
Génie de la montagne, la Source et les Rivages ; et les Rivages seront
représentés par un homme poussant sa barque, sans que le peintre se soit
préoccupé ni du genre ni du nombre du mot rivage en grec qu'il inscrit
d'ailleurs au-dessus de son personnage, tant la liberté laissée à l'artiste
était grande sur ce point !
Dans les peintures campaniennes, il y a presque toujours harmonie entre le
paysage et l'action représentée. C'est là du moins une observation de M.
Helbig qu'il n'y a peut-être pas lieu d'accepter sans réserve (36). En
réalité, le sujet principal, pour l'artiste ancien, c'est le drame, c'est la
représentation de l'homme ; s'il ajoute un arbre, un rocher, un portique,
c'est moins pour peindre la nature que pour indiquer le lieu de la scène.
D'ailleurs la présence des personnages allégoriques exclut jusqu'à un
certain point, une étude attentive, une
127
reproduction fidèle de la nature même ; en lui se concentre la vie et
l'intérêt du paysage ; il est la grâce, il est la fraîcheur, il est le
caractère et le génie du lieu ; le paysage ainsi personnifié possède un tel
attrait que par lui-même et comme paysage il cesse de plaire et presque
d'exister. S'il existe encore, c'est pour servir de siège et de piédestal à
l'être qui le représente et pour ainsi dire le remplace. Dans la plupart des
cas, le paysage est si restreint qu'on ne peut même pas dire qu'il y ait
entre lui et la scène une harmonie ; triste et désolé il apparaît, dit-on,
dans la peinture à' l'Hésione délivrée par Héraclès, dans celle de Persée
combattant le monstre marin, dans celle d'Icare tombant sur le rivage ; mais
il n'est pas moins triste ni moins désolé dans telle peinture dont le sujet
est gracieux, par exemple celle qui nous représente Eros et Aphrodite
péchant à la ligne (37). Aphrodite est assise sur un rocher nu, où poussent
çà et là, dans les interstices de la pierre, quelques plantes marines ; Eros
est debout près d'un arbuste isolé et chétif. Le contraste est encore plus
frappant dans une peinture qui groupe autour d'un ruisseau, des jeunes
femmes occupées à baigner ou à retirer du bain un enfant, désigné comme
Achille par les uns, comme Dionysos ou Adonis par les autres (38) ; tout est
d'aspect aimable et souriant dans cette scène, les attitudes, les gestes, le
mouvement des personnages sans excepter l'enfant et la Scopia ailée qui se
penche sur un rocher ; et cependant il ne peut guère y avoir de site plus
sauvage ; les roches qui bordent les deux rives sont absolument nues ; la
terre est dépourvue de toute végétation ; un seul arbre y pousse, mais cet
arbre n'est qu'un tronc qui se bifurque en deux branches dégarnies de toute
feuille. Cependant la règle comporte des exceptions ; telle peinture, par
exemple, qui nous représente Hylas ravi par les Nymphes (39)
128
nous montre un lac aux bords heureusement découpés pour le plaisir des yeux
et couverts d'arbres touffus. Comment avaient procédé à cet égard les
peintres dont Philostrate décrit les œuvres ? Il faudrait sans doute voir
ces œuvres elles-mêmes pour répondre à cette question. Toutefois il est à
remarquer que là où la scène offre quelque intérêt par elle-même,
Philostrate oublie le paysage ; il l'oublie peut-être parce que l'artiste
ne l'avait traité que sommairement. Quand, au contraire, Philostrate décrit
longuement le paysage, il n'y a pas une véritable action. C'est là, ce
semble, le témoignage d'une ressemblance entière avec les habitudes de la
peinture campanienne. D'ailleurs nous ne remarquons aucune disparate ; il a
bien été dit que dans le Marécage la ceinture de montagnes et de forêts qui
forment le fond du tableau offre un aspect trop sévère, comparé avec celui
du bassin où les Amours jouent avec des cygnes ; mais c'est là, ce semble,
un contraste heureux plutôt qu'une disparate, et d'ailleurs le contraste
était sans doute peu marqué, attendu que les jeux des Amours ne devaient
occuper dans le tableau qu'une place fort restreinte.
Le paysage campanien est ordonné le plus souvent d'une façon toute plastique et pour ainsi dire topographique, suivant la remarque de M. Helbig. Il ne paraît pas que les paysages décrits par Philostrate aient été composés autrement ; le rhéteur ne parle point des accidents du terrain, d'arbres, ou de bosquets capricieusement isolés ou groupés ; au contraire, c'est l'ordre, c'est la symétrie qui semble avoir frappé son attention. « Des sources jaillissent en bouillonnant des hauteurs, dit-il, dans le Marécage; elles suivent leurs pentes et confondent leurs eaux, font de la plaine un marais ; il n'y a d'ailleurs ni désordre ni confusion. L'art a dirigé le cours des ruisseaux, comme l'aurait fait la nature, avec sa souveraine habileté. » La nature aime peut-être moins la régularité que ne le dit Philostrate; mais il veut faire entendre sans doute 129 que la régularité, dans le tableau, grâce à la disposition du terrain même, paraissait vraisemblable et naturelle ; et c'est là sans doute un grand mérite. Le tableau du Bosphore, celui des Îles ne sont, comme nous l'avons dit, que des cartes pittoresques, sur lesquelles le terrain ou la mer, vus d'un point très élevé (ce qui est aussi le cas pour beaucoup de peintures campaniennes), se déployait en tous sens sous le regard du spectateur, avec ses divers plans bien distincts, ses constructions ou ses différentes scènes nettement séparées les unes des autres ; en un mot c'est un ensemble où chaque partie garde sa valeur sans nuire à la voisine ni la faire valoir ; c'est un bel ordre, clair, aisé à comprendre ; le désordre plus pittoresque du paysage moderne ne s'y mêle en aucune façon. Welcker avait même cru découvrir dans le tableau des lies une rigoureuse symétrie ; par exemple une des îles, habitée par des pêcheurs et des laboureurs, tout entière en plaines, aurait fait pendant à une autre île montagneuse et boisée, fréquentée par les chasseurs et les bûcherons. A une île escarpée et boisée aurait répondu Vile dorée, remarquable par son luxe de végétation et la magnificence de ses édifices. Nous avons cru devoir, dans le commentaire, combattre cette conjecture ; toujours est-il que, si la symétrie n'était pas aussi rigoureuse, le tableau renfermait les éléments d'un arrangement symétrique ; de plus ces deux îles, unies autrefois et séparées, dit l'auteur, par un tremblement de terre, offraient, chacune, des saillies et des enfoncements qui correspondaient aux enfoncements et aux saillies de l'autre. C'est là sans doute une disposition naturelle, et l'artiste avait pu en observer, dans la réalité, de nombreux exemples ; mais cette régularité même, que romprait peut-être un paysagiste moderne, avait dû plaire tout particulièrement à l'artiste ancien.
A l'étude du paysage se rattache assez étroitement celle des effets de lumière. Dans les peintures anciennes que nous avons conservées, ces sortes d'effets sont excessivement rares ; 130 on cite, par exemple, le rayon qui éclaire la prison de Cimon, dans une célèbre peinture de Pompéi ; dans un des tableaux esquilins qui représente l'enfer homérique, les ombres évoquées apparaissent dans la demi-clarté d'un jour crépusculaire. Les descriptions de Philostrate nous parlent au contraire assez souvent de la manière dont la scène est éclairée : dans le tableau de Phaéton, en plein midi, la Nuit chasse le Jour et derrière le globe du soleil qui descend vers la terre paraissent les astres ; les Heures désertant les postes confiés à leur garde s'élancent en fuyant vers les ténèbres qui viennent au devant d'elles. Ailleurs Cômos tient une torche, dont la lueur mourante éclaire les derniers mouvements d'une ronde exécutée par des convives couronnés de fleurs. Le meurtre de Cassandre a lieu pendant la nuit, à la lueur des flambeaux. Ailleurs la nuit s'illumine de l'éclat que projette l'épaule de Pélops ; c'est à la faveur d'un rayon de la lune qu'Antigone cherche sur le champ de bataille le corps de Polynice pour l'ensevelir. Dans le tableau de Sémélé, l'éclat s'échappant du corps de Dionysos faisait pâlir la flamme qui tombait d'un nuage de feu sur la ville de Cadmos ; ce qui produisait un contraste entre deux effets de lumière. Dans le tableau du Mélès, les ondes soulevées du fleuve formaient au-dessus de Crithéis une voûte qui resplendissait des couleurs de l'arc-en-ciel.
La différence que nous constatons ici avec la peinture campanienne lient sans doute en grande partie à la différence même des procédés techniques entre la fresque et la peinture de chevalet. Nous savons d'ailleurs que la peinture, au moins dès le temps d'Alexandre, savait représenter la lumière, à ses différents degrés d'intensité et dans ses jeux divers. Si l'on interprète bien un texte de Pline, Apelle, dans un de ses tableaux, avait peint avec une vérité saisissante les phénomènes qui accompagnent la tempête (40). Dans une autre de ses 131 peintures, la main d'Alexandre portant la foudre semblait sortir du tableau, effet qui ne semble pouvoir être obtenu que par un habile ménagement des ombres et de la lumière (41). Le peintre Antiphile avait représenté un jeune enfant soufflant le feu : l'éclat du foyer, dit Pline, illuminait la tête de l'enfant et tout le tableau (42). Sur les peintures de vases que l'on fait remonter à l'époque des successeurs d'Alexandre et que l'on suppose copiées d'après des peintures de grands maîtres, on rencontre, non précisément des effets de lumière, mais la représentation, au moyen de simples traits, des rayons qui s'échappent des astres, se répandent dans l'atmosphère, traversent les corps transparents, se réfléchissent dans l'eau. Nous n'en citerons qu'un seul exemple, d'après Helbig (43) ; sur un vase (44) qui représente la pluie envoyée par Jupiter pour sauver Alcmène condamnée à périr par le feu, l'arc-en-ciel et la pluie ont été rendus avec toute la fidélité que l'on peut attendre de ces sortes de peintures. On en conclut, avec quelque vraisemblance, que la peinture à l'encaustique, qui paraît avoir été très riche en moyens d'exécution, ne se maintenait pas, en ce qui concerne la lumière, dans les limites d'un style conventionnel. Les effets de lumière que nous rencontrons dans les descriptions de Philostrate ne sont donc point un fait nouveau dans l'histoire de l'art ni une exception. On peut même croire qu'avec le temps ces sortes d'effets étaient devenus d'un emploi vulgaire, et que la manière de les obtenir n'était un secret pour aucune école ni pour aucun atelier. Des exemples viendraient au besoin confirmer ces raisons et le témoignage de Philostrate ; d'après une épigramme relative à un tableau qui représentait l'adultère d'Arès et d'Aphrodite, 132 Hélios apparaissait entouré d'un éclat lumineux, sur le seuil de la porte (45). Dans un tableau décrit par Achille Tatius cl dont le sujet était Y Enlèvement d'Europe, un rayon de soleil, traversant l'épais feuillage d'un bosquet, venait mourir sur le gazon (46).
Comparées au paysage moderne, les peintures décrites par Philostrate, comme d'ailleurs les peintures campaniennes, s'en distinguent de deux façons ; elles ne paraissent point connaître la perspective aérienne qui donne à la fois la variété et la vérité à la représentation de l'atmosphère et les choses qu'elle enveloppe ; elles n'expriment point en outre ce sentiment du silence et de repos, de fraîcheur ou d'aridité, d'humidité ou de sécheresse, de tristesse ou de gaieté, d'assoupissement ou de réveil à la vie, que nous sommes habitués à demander au paysage ; elles ne cherchent point à nous rendre la nature sympathique ; elles l'emploient comme un décor, non comme un personnage doué d'une vie latente qui sent à peu près comme nous, ou nous amène à sentir comme il paraît le faire ; en un mot, elles sont belles, d'une beauté plastique, non d'une beauté animée : ce qui leur manque, c'est le charme qui se communique. Ces remarques faites ou indiquées par M. Helbig (47) nous paraissent justes ; toutefois,, à ces deux égards, la perspective aérienne et le sentiment, les tableaux décrits par Philostrate nous paraissent avoir une vague tendance à se rapprocher du paysage moderne. Dans le tableau de Cômos, ce génie était debout sur le seuil d'une chambre nuptiale aux portes dorées ; « dorées, elles semblent en effet, dit Philostrate, bien que l'œil soit lent à les discerner dans 133 l'ombre de la nuit». Comme tous les personnages étaient assez distincts pour que Philostrate pût les décrire, il faut supposer que la lumière n'était pas également répartie entre tous les plans du tableau. Dans la peinture du Bosphore l'artiste avait observé ce que l'on pourrait appeler la perspective appliquée à l'eau. « A travers l'éclat verdâtre de la mer, dit le sophiste, on distingue les poissons à leur couleur ; les plus près de la surface paraissent noirs ; ceux qui suivent le sont moins ; le troisième rang en profondeur se dérobe à la vue ; puis ce n'est qu'une ombre ; puis ils se confondent avec l'eau ; puis il faut les deviner, le regard s'affaiblissant et perdant de sa netteté à mesure qu'il descend plus loin sous les flots. » Quant au sentiment, si Philostrate ne cherche point à l'interpréter avec cet enthousiasme et ce luxe d'expressions qui sont propres à la critique moderne, ce n'est peut-être pas qu'il fît tout à fait défaut aux peintures qu'il avait sous les yeux. Sans doute Philostrate est un sophiste, et comme le remarque M. Helbig, il perçoit quelquefois ce que le peintre ne saurait reproduire, comme l'odeur de l'encens ou des roses ; mais on aurait tort de croire, pour cette raison, qu'il a décrit tout ce qui pouvait l'être. C'est une question d'ailleurs que nous nous proposons d'aborder plus loin. Ici nous ne voulons que rappeler certaines expressions de l'auteur grec qui semble révéler, chez le peintre ancien de paysage, des préoccupations analogues à celles de nos artistes. Dans le tableau de Comos, par exemple, Philostrate loue la souplesse des couronnes et la fraîcheur des roses, « toutes choses, ajoute-t-il, qu'on n'obtient pas en juxtaposant des couleurs si bien choisies qu'elles soient en vue de l'imitation ». Cette remarque rappelle celle de Topffer dans les Menus Propos (48) : « Si vous regardiez, dit-il pendant une heure ou deux un peintre peindre... vous ne pourriez vous empêcher de remarquer que ce peintre rend sans cesse ce qu'il voit par un moyen qu'il ne voit pas, mais 134 qu'il invente. Il rend la fluidité par certains secrets de brosse ou de palette ; la distance des objets, par une atténuation de couleur, ou d'éclat, ou de détails ; le mystère par des apparences incertaines et profondes ; la fraîcheur, par des transparences ; la lumière par des oppositions. » Et plus loin : « Voici une montagne dont il peut à son gré compter les dentelures et nombrer les anfractuosités, et il est libre pareillement de les imiter toutes et par leurs formes et par leur couleur propre, et par leurs accidents. Je ne vois pas non plus qu'il le fasse. Bien plus, s'il le faisait, à mesure que son imitation serait plus directe, elle serait moins vraie. De l'eau bleue ou verte, mais plus de fluidité; des ombres nettes et visibles, mais plus de mystère ; du jaune, du rouge, du blanc, mais plus de soleil, plus d'aurore. » On pourrait ajouter, en prenant l'exemple que nous offre la description de Philostrate: des roses d'un dessin irréprochable, du plus vif éclat ; mais plus de fraîcheur, plus de délicatesse. Dans un autre tableau, des jeunes filles formant un chœur foulent de leurs pieds nus une herbe tendre, tout humide d'une fraîche rosée. Comme l'on ne peut guère supposer que le peintre eût représenté les gouttelettes d'eau suspendues aux brins d'herbe, il est probable que le sentiment de fraîcheur, répandu dans toute la peinture, a inspiré ce détail à Philostrate. Ailleurs Persée est couché sur l'herbe tendre et parfumée. Mais, dans ce genre de traits, le plus caractéristique est celui que nous rencontrons au début de la description des Iles : « Le Zéphire promène son haleine sur les flots, dit Philostrate, donne à la mer un riant aspect. La mer n'est ni soulevée ni déchaînée : elle n'est pas non plus unie et dormante ; elle aide la manœuvre des matelots ; elle est comme animée d'un souffle de vie. » Or ce souffle de vie n'est-il pas précisément ce sentiment qui nous paraît, à nous autres modernes, se dégager des paysages peints selon notre goût et nos théories. La peinture de genre, c'est-à-dire la représentation de 135 scènes empruntées à la vie journalière, semble avoir tenu peu de place dans la galerie napolitaine ; elle s'y confond le plus souvent avec le paysage ou avec la peinture mythologique. Ainsi, nous rencontrons plus d'une fois, dans de vastes compositions comme le Bosphore ou les Iles, des pêcheurs, des chasseurs, des bûcherons, des matelots, des voyageurs ; dans le Bosphore, des jeunes gens, parés et couronnés, montés sur des barques à la proue d'or et à la proue d'azur, jouant de la flûte, battant des mains en chantant, assiègent le rivage où s'élève la maison d'une veuve ou d'une courtisane, qui de ses fenêtres, contemple en riant l'expédition galante. Une peinture dans laquelle le paysage, sans être oublié, avait peut-être moins d'importance, représentait une chasse au sanglier. Dédale, dans son atelier, est servi par des Amours ; le sujet du tableau appartient à la fable, puisque Dédale et les Amours travaillent pour Pasiphaé. Le tableau des Amours représentait une vendange ; mais, comme le titre l'indique, les vendangeurs n'étaient autres que les Amours, ce qui ôte un peu à la composition son caractère de tableau de genre. La même observation s'applique au tableau de la Palestra, où des groupes d'Amours se montraient dans les différentes postures ou figures de la lutte. Quand les Pygmées livrent un assaut en règle à Héraclès, la mythologie se réduit aux proportions d'une anecdote : c'est l'aventure d'un géant au milieu de nains présomptueux; toutefois le sujet appartient plus à la fable qu'à la vie réelle. C'est le contraire dans le tableau de Cômos, où les convives attardés exécutent des danses devant la porte de deux jeunes mariés ; mais la présence de l'élément fabuleux n'est pas tout à fait écartée, puisque Cômos en personne préside à la fête. Un tableau de genre véritable est peut-être celui où Arrhichion étouffe, en périssant lui-même, l'adversaire qui l'a terrassé ; encore peut-il rentrer dans la peinture historique. Sur ce point encore, l'analogie avec les peintures campaniennes est assez frappante : dans ces dernières, en effet, à part quelques scènes 138 de toilette et de banquet, à part les cérémonies du culte et quelques sujets empruntés au théâtre comique, les occupations de la vie privée ont pour cadre un paysage, plus ou moins sommaire, et souvent pour acteurs des personnages allégoriques, comme les Génies et les Amours. Celte manière de concevoir les sujets de genre semble indiquer qu'ils étaient traités plutôt dans un style idéal que dans un style réaliste. Aucun détail donné par Philostrate ne s'oppose d'ailleurs à cette conjecture. Pour le tableau même d'Arrhichion, qui faisait exception comme sujet, il n'y a pas lieu de croire que l'artiste ait été beaucoup moins discret dans l'imitation de la réalité que, par exemple, Céphissodote dans son groupe connu de deux athlètes ; si Philostrate parle de la sueur qui n'était point encore refroidie sur le corps d'Arrhichion, il dit aussi que la joie de la victoire illuminait le visage de l'athlète mourant, et ne dit point que les convulsions de la mort fussent peintes, en traits effrayants, sur le visage de l'adversaire qui avait les côtes enfoncées et la cheville du pied déboîtée. Dans le tableau du Bosphore, les pêcheurs avaient le teint hâlé et les bras vigoureux : ce sont là des traits caractéristiques ; toutefois, comme ils peuvent très bien s'allier avec un certain idéal, il nous faudrait voir la peinture elle-même, pour savoir jusqu'à quel point elle s'éloignait de la peinture des villes campaniennes ou se rapprochait de la nôtre.
Les peintures de nature morte sont nombreuses à Herculanum et à Pompéi. Comparées aux peintures mythologiques et aux peintures de genre, elles s'en distinguent par la finesse et la vérité de l'exécution ; toutefois, ajoute M. Helbig, à qui nous empruntons cette observation, la peinture campanienne ignore ces effets de lumière, celte magie du clair-obscur qui donnent un si vif attrait aux « natures mortes » des peintres hollandais, et en général des artistes modernes. Autant que nous le pouvons conjecturer, les tableaux décrits par Philostrate auraient prêté aux mêmes remarques. Les peintures de 137 la galerie de Naples, plus réalistes et plus naturalistes que les peintures d'Herculanum et de Pompéi dans les sujets d'un ordre élevé, avaient poussé ici la recherche de l'illusion, aussi loin que les ressources de l'art le lui permettaient. Philostrate dans ses descriptions, relève complaisamment tous les détails qui étaient de nature à surprendre agréablement le spectateur par les merveilles dune fidélité inattendue. Ce sont des figues qui laissent échapper un suc savoureux ; ce sont des noix qui commencent à se dépouiller de leur enveloppe entr'ouverte ; ce sont des pommes revêtues de cet incarnat si particulier qu'on le croirait inimitable, à le voir dans la réalité, et qui par conséquent, dans la peinture, paraît un effet non du rapprochement des couleurs, mais, comme le fait observer Philostrate, de la maturité elle-même ; c'est un fromage nouvellement caillé et comme tremblant encore, par suite du mouvement intérieur que produit la coagulation. Ailleurs ce sont des fruits mûrs, brillants de rosée, qu'il faut se hâter de prendre et de manger, dit le sophiste ; dans un instant, il serait trop tard ; ils auraient perdu quelque chose de leur fraîcheur ; ils vaudraient moins ; tant le peintre avait bien su leur donner cette apparence fugitive du fruit cueilli à point ! Que manque-t-il à cette peinture pour être tout à fait semblable à la nôtre : probablement cet art de peindre l'atmosphère et la lumière, qui, pour n'avoir pas été tout à fait ignoré des anciens, n'avait pas produit, à en juger par les descriptions antiques, les mêmes merveilles que chez nous.
En résumé, si l'on tient compte de la différence des temps et de la différence des procédés, les tableaux décrits par Philostrate, qu'ils appartiennent à une classe ou à une autre, ne présentent point avec la peinture campanienne, ni dans le choix des sujets, ni dans la manière de les traiter, un de ces contrastes violents qui pourraient faire douter de leur authenticité. Quant aux autres parties de l'art, le dessin, le clair-obscur, le coloris, Philostrate ne nous en donne point une 138 idée supérieure à celle que nous laissent la lecture de Pline l'Ancien et l'étude des monuments conservés. Il fait l'éloge de la symétrie, qui, dans le langage des anciens, n'est autre que la proportion exacte des parties avec le tout et des parties entre elles ; mais, s'il faut en croire Pline (49), Parrhasius avait introduit de bonne heure la symétrie dans la peinture, ce qui signifie, sans doute, que ses figures étaient mieux proportionnées que celles de ses devanciers. Dans la description d'un tableau qui représentait l'Éducation d'Achille, il loue la manière heureuse dont le peintre avait dissimulé chez le Centaure le passage de la nature humaine à celle du cheval ; mais c'est là un talent que Lucien admire déjà chez le peintre Zeuxis. Il parle avec admiration de la perspective du tableau de Ménœcée, mais, outre que la perspective était connue des anciens, sou enthousiasme nous paraît, dans ce cas, excité par un effet des plus simples et des plus aisés à obtenir. Philostrate nous apprend que le peintre de Thémistocle chez les Perses avait représenté fidèlement l'éclat et la souplesse des fils d'or qui entraient dans le tissu des étoffes asiatiques ; que la chlamyde d'Amphion et les armes de Pallas semblaient passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ; mais, d'un côté, nous savons que l'art antique s'étudia souvent, surtout après le règne d'Alexandre, à reproduire le luxe du costume oriental ; de l'autre, nous remarquons dans la peinture campanienne un effort souvent heureux pour rendre l'éclat des étoffes chatoyantes (50). Philostrate nous dit qu'une statue d'Aphrodite était ornée de pierreries dont l'éclat était rendu moins par la couleur que par un effet de lumière ; reconnaissons un artifice bien simple et certainement déjà vulgaire dans l'antiquité, qui consiste, pour peindre la rondeur et la transparence d'un objet, à l'éclairer vivement dans un endroit, et à plonger les autres dans les demi-teintes. Philostrate raconte qu'une statue d'ivoire, représentée dans une de ces pein- 139 tures, ne voulait point paraître peinte, mais que sortant comme du cadre elle semblait s'offrir à la main ; que l'œil, en face d'Atlas pliant sous son fardeau, distinguait nettement les parties saillantes et rentrantes ; mais, sur ce point, tous les témoignages de l'antiquité s'accordent avec celui du rhéteur ; la main d'Alexandre, armée de la foudre, semblait s'avancer vers le spectateur, dans un tableau d'Apelle ; Pausanias avait peint un taureau vu par derrière ; et si nous comprenons bien le passage de Pline, ce qu'on admirait surtout dans ce tableau, c'est que l'artiste, sans opposer l'ombre à une vive lumière, et seulement au moyen de teintes dégradées, avait rendu sensibles les saillies de certaines parties du corps (51). Nous avons parlé plus haut des effets de lumière dans le paysage ; s'ils sont indiqués dans la peinture murale, dans la peinture de vases, il y a tout lieu de croire que dans la peinture mobile ils devaient être rendus avec une très suffisante exactitude. Philostrate appelle quelquefois l'attention de son jeune auditeur, réel ou supposé, sur les reflets : la face intérieure du bouclier de Rhodogune s'empourprait, dit-il, des reflets de sa tunique ; l'étoffe de pourpre, qui flottait au-dessus de Galatée, projetait une lueur sur son front et sur ses joues. Le reflet des étoffes sur la chair est difficile à reconnaître dans les peintures campaniennes, à cause de l'altération que la couleur a subie ; mais elles nous offrent souvent l'image des corps réfléchis dans le métal et l'eau. Par exemple, Thétis se mire dans le bouclier d'Achille que lui tend Héphsestos (52) ; dans une mosaïque, la Bataille d'Alexandre, un bouclier tombé à terre reproduit l'image d'un Perse terrassé. Une peinture nous montre Persée et Andromède contemplant dans l'eau la tête de Méduse qu'ils 140 ne sauraient regarder en face sans danger (53). Gomment penser qu'un art attentif à ces sortes d'effets et capable de les rendre ait négligé le reflet des couleurs vives de la chair ?
Nous ne prétendons point d'ailleurs que les anciens aient connu toutes les ressources de la couleur et du clair-obscur. Il y a lieu toutefois, sur ce point comme sur d'autres semblables, de ne pas trop refusera la peinture antique une partie des qualités modernes. A celle question très controversée du coloris chez les anciens, Tôpffer a cru pouvoir- donner la solution suivante : (54) « Dans la peinture ancienne, dit-il, le relief borné à ce qui fait saisir les saillies principales, à ce qui complète l'énergique représentation des formes, ne va pas jusqu'à exprimer, dans sa perfection, le modelé, c'est-à-dire l'exacte mesure relative des lumières et des ombres, cette dégradation délicate des demi-teintes, au moyen de laquelle on rend chaque forme dans toute sa vérité ; il cherche l'expression, mais point l'effet, c'est-à-dire une combinaison de lumières et d'ombres qui soit agréable à l'œil ; il néglige les ressources et les beautés propres du clair-obscur. Quant au troisième moyen, la couleur, la distance est encore plus grande... Une étoffe verte est verte partout sans tenir compte de mille accidents qui à l'œil modifient cette couleur et la font passer par toutes sortes de degrés que la peinture de nos jours doit rendre, sous peine de passer pour complètement inhabile dans son art. » Ce jugement sans doute est trop absolu surtout en ce qui concerne la couleur. Töpffer, dans cette discussion, a un premier tort, celui de juger les peintures anciennes, comme si elles avaient été exécutées toutes à la détrempe ; en outre, même dans les peintures campaniennes, qui sont des fresques pour la plupart, si la couleur ne passe pas par toutes les nuances que lui donnerait l'art moderne, elle n'est pas non plus grossièrement uniforme ; enfin il est bon 141 de rappeler un passage de Pline, suivant lequel les anciens connaissaient dans la couleur ce que d'habiles coloristes et des amateurs éclairés appellent la valeur, et ce que les Grecs nommaient le ton (τόνος). C'est quelque chose, dit Pline, d'intermédiaire entre la lumière et l'ombre (55) ; autrement dit, c'est l'éclat propre de la couleur, indépendamment de la nuance elle-même ; c'est la façon dont elle brille, dont elle reflète la lumière, abstraction faite de sa nature qui est d'être jaune, bleue ou rouge. Cette observation si fine et si vraie nous semble indiquer que les anciens savaient employer la couleur avec une science voisine de la nôtre. La magie du clair-obscur consiste en effet dans l'usage judicieux des couleurs, considérées plutôt comme des valeurs que comme des taches. D'un autre côté, nous ne pouvons savoir jusqu'où les anciens avaient poussé l'harmonie des couleurs ; mais Pline nous apprend du moins qu'ils la connaissaient, qu'ils en faisaient grand cas et qu'ils l'appelaient du nom particulier d'harmogé. Quoiqu'il en soit, ce n'est point Philostrate, comme on le voit, qui nous donne de la couleur et du clair-obscur chez les anciens, l'idée la plus avantageuse ; il reste en deçà du témoignage de Pline ; il n'y a donc pas lieu de l'accuser d'exagération, ni de croire qu'il ait prêté à la peinture ancienne des qualités chimériques.
Nous avons étudié l'esprit et les caractères de l'art antique en général ; mais Philostrate ne décrit pas seulement les peintures de la galerie de Naples ; il mêle à ses descriptions des jugements et des impressions ; il convient donc, pour le juger sainement à notre tour, de nous demander avec quels yeux les anciens regardaient les œuvres d'art, ce qu'ils leur demandaient, ce qu'ils sentaient en les voyant, si sur ce point ils ressemblent aux modernes, ou diffèrent d'eux.
142 Nous devons d'abord distinguer à cet égard trois classes d'hommes parmi les anciens. Cette distinction, nous ne l'inventons point ; nous l'empruntons à Lucien qui paraît avoir assez bien connu les hommes et les choses de son temps pour ne point nous égarer. On se rappelle la fameuse description qu'il a faite de la Famille du Centaure, un tableau de Zeuxis. Le peintre, mécontent du jugement de la multitude, avait ordonné à Micion, son élève, de rouler et de remporter la toile. La multitude pourtant n'avait point critiqué le tableau, ne s'était point moquée du peintre; au contraire, elle avait témoigné une sincère et naïve admiration ; mais cette admiration n'était point du goût de l'artiste. La multitude en effet n'avait trouvé à louer que la singularité du motif. Or c'était là, selon Zeuxis, la boue du métier. Qu'aurait-il donc fallu admirer, suivant le peintre ? le talent d'exécution, cette qualité qui fait que Pétrone appelle la peinture de Zeuxis, Zeuxidis manus. Lucien profite de la leçon renfermée dans l'anecdote ; il ne fait point consister tout le mérite de l'art dans la beauté de l'exécution, et dans le tableau de Zeuxis voit autre chose à louer que ce que louait Zeuxis. « Toutes les autres beautés de ce tableau, dit-il, qui échappent en partie à l'œil d'un ignorant tel que moi, je veux dire la correction exquise du dessin, l'heureuse combinaison des couleurs, les effets de saillies et d'ombre ménagés avec art, le rapport exact des parties avec l'ensemble, je les laisse à louer aux fils des peintres qui ont mission de les comprendre. Pour moi j'ai surtout loué Zeuxis pour avoir déployé dans un pareil sujet les trésors variés de son génie, en donnant au centaure un air terrible et sauvage, une crinière rejetée avec fierté, un corps hérissé de poils, non seulement dans la partie chevaline, mais dans celle qui est humaine. A ses larges épaules, à son regard tout à la fois riant et farouche, on reconnaît un être sauvage, nourri dans la montagne et qu'on ne saurait apprivoiser. Tel est le Centaure. La femelle ressemble à ces superbes cavales de Thessalie qui n'ont point 143 encore été domptées et qui n'ont pas fléchi sous l'écuyer. La moitié supérieure est d'une belle femme, à l'exception des oreilles qui se terminent en pointe comme celles des Satyres ; mais le mélange, la fusion des deux natures, à ce point délicat où celle du cheval se perd dans celle de la femme, est ménagé par une transition si fine qu'elle échappe à l'œil et qu'on ne saurait y voir d'intersection. Quant aux deux petits, on remarque dans leur physionomie, malgré leur jeune âge, je ne sais quoi de sauvage mêlé à la douceur ; et ce qu'il y a d'admirable, selon moi, c'est que leurs regards d'enfant se tournent vers le berceau, sans qu'ils abandonnent la mamelle et sans qu'ils cessent de s'attacher à leur mère (56). » Ainsi trois sortes de personnes jugent différemment des œuvres d'art ; la multitude se laisse séduire par la nouveauté ; le peintre ne connaît que la belle exécution de la main, suivant l'expression de Voltaire ; l'homme de lettres, comme Lucien, demande aux œuvres d'art, outre les qualités techniques, le caractère et l'expression.
Dans l'histoire de l'art antique et de la critique nous retrouverons aisément la trace de cette triple manière de sentir et de comprendre le talent. Pour la plupart des hommes, dans l'antiquité comme de nos jours, le principal attrait d'une œuvre d'art consistait dans le sujet lui-même, autrement dit dans l'invention. Pausanias, décrivant les peintures qu'il rencontre dans les temples et les portiques de la Grèce, se préoccupe rarement de la beauté des figures, loue quelquefois l'expression et, dans la plupart des cas, se borne à expliquer le sujet qui l'intéresse plus vivement que toutes les autres parties de l'art. De leur côté les artistes comptent bien évidemment sur ce genre d'intérêt, autant au moins que sur leur habileté de main. Polygnote représentant dans la Lesché de Delphes la prise de Troie et la descente d'Ulysse aux enfers (57), réunissant dans 144 une vaste composition toutes les inventions des poètes et les siennes propres, plaçant une scène gracieuse à côté d'une scène terrible ou pathétique, la toilette d'Hélène non loin de Néoptolème qui menace les Troyens, les filles de Pandaros jouant aux dés à côté du supplice de Tityos, Polygnote savait bien que, pour plaire aux Grecs, il fallait captiver leur esprit et leur imagination, autant au moins que leurs yeux. Quelquefois même, pour réveiller plus sûrement l'attention, il ne dédaigna pas la singularité du motif. Ainsi dans la descente d'Ulysse aux enfers, on voyait près des compagnons du héros qui offrait des victimes, un homme assis du nom d'Ocnos, qui tressait une corde de jonc et un âne rongeant cette corde à mesure qu'elle était tressée (58). Ocnos, disait-on, était un homme actif et laborieux ; sa femme dépensait tout ce qu'il amassait. Polygnote ou ses interprètes ne manquaient pas d'esprit ; mais cette représentation allégorique devait être d'un effet assez surprenant en peinture. Ailleurs nous rencontrons une attitude bizarre, que Pausanias n'explique pas et qui paraît assez inexplicable ; Callisto assise ou couchée sur une peau d'ours, avait les pieds sur les genoux de Nomia (59). Quand les sujets principaux empruntés à la légende ou à l'histoire eurent été épuisés, il fallut bien les renouveler, par la manière de les présenter : c'est alors que les artistes cherchèrent des circonstances, auxquelles leurs devanciers n'avaient point songé. De là, parmi les peintures campaniennes, tant de motifs charmants, tant de détails gracieux, semés comme à profusion ; par exemple, dans l'Éducation de Dionysos (60), l'action du jeune dieu, soulevé par les mains de Silène et s'élançant vers une grappe de raisin que lui tend le plus haut possible, en raidissant le bras, une figure de femme ; dans le Thésée vainqueur du minotaure, le baiser déposé par des jeunes filles sur 145 la main du héros (61 ) ou dans la Lutte de Pan et de l'Amour, la présence du pédotribe qui prend le petit Pan par les cornes pour l'empêcher de blesser son adversaire (62) ; de là tant de compositions ingénieuses, par exemple Persée et Andromède contemplant dans l'eau qui coule à leurs pieds la tête de Méduse (63) ou l'Amour apportant une lettre à Polyphème de la part de Galatée (64) ; de là ces scènes allégoriques que chacun connaît et qui ont surpris même le dix-huitième siècle, par la grâce un peu précieuse de l'idée ; par exemple le tableau où une femme, tenant par les ailes un amour qu'elle vient de tirer de sa cage, semble vouloir le vendre à des jeunes filles qui le regardent, moitié avec défiance, moitié avec une curiosité pleine de désirs (65) ; ou cette autre peinture dans laquelle un jeune homme et une jeune fille contemplent dans leur nid des amours naissants, symbole de l'amour qui naît sans doute dans leur cœur (66) ; de là enfin toutes ces personnifications et ces rôles d'amours qui jettent dans ces peintures tant de variété et d'agrément ; de là aussi une certaine complexité d'incidents et des bizarreries qui obscurcissent pour nous le véritable sujet et nous laissent dans l'incertitude sur les intentions du peintre. Zeuxis lui-même, en peignant sa famille de centaures, ne comptait-il pas plaire aux spectateurs par l'action de ce centaure qui, tenant un lionceau au-dessus de sa tête, s'amusait à faire peur aux deux enfants ? et 146 si l'attention trop exclusive de la foule pour le sujet du tableau le blessa, ne serait-ce point là un trait de la bizarrerie orgueilleuse qu'on lui a reprochée ? D'un autre côté, parmi les éloges que l'antiquité a faits des œuvres d'art, quelques-uns paraissent s'adresser uniquement à la singularité ou à la nouveauté du sujet. L'auteur de l'épigramme sur la statue de l'Occasion par Lysippe (67) ne paraît pas songer un seul instant à louer les mérites techniques de la statue : ce qu'il admire, c'est l'esprit du sculpteur, certainement ce qu'il y avait dans l'œuvre de moins digne d'admiration. Lucien, qui cite le mot de Zeuxis, et qui, sans l'accepter entièrement, devait comprendre au moins ce qu'il contient de vérité, Lucien lui-même montre un goût surprenant pour des compositions allégoriques d'une complexité singulière et d'une étonnante subtilité. Il décrit ainsi, par exemple, un tableau qui aurait représenté les tribulations de l'homme épris des richesses (68); l'Espérance le fait entrer ; la Ruse et la Servitude le livrent au Travail ; déjà malade et privé de ses couleurs, il passe à la vieillesse ; vient en dernier lieu l'Outrage qui l'entraîne vers le Désespoir. L'Espérance s'envole, et l'on chasse l'infortuné par une porte détournée et secrète. Nous ne nous demanderons pas si Lucien est l'auteur de cette composition ou s'il a vu réellement un tableau ainsi composé ; mais, après avoir lu cette description, on ne peut douter de l'importance que Lucien attache au sujet, ni de la singularité de goût dont il aurait lait preuve dans le choix de ses personnages et de l'action, s'il avait été peintre. De même, en face de cet Hercule gaulois (69), personnification de l'éloquence, qu'une chaîne d'or et d'ambre, fixée à la langue du dieu, reliait avec ses auditeurs, tous attachés par les oreilles, Lucien semble n'éprouver aucune surprise ; la complaisance même avec la- 147 quelle il décrit ce groupe trop ingénieux semble prouver qu'il n'a pour la conception de l'artiste que de l'admiration. Lucien, en cette occasion, aurait mérité d'être confondu par Zeuxis avec cette multitude que l'artiste traitait si dédaigneusement.
D'un autre côté, il n'est point douteux que les anciens, dans l'appréciation des œuvres d'art, n'aient tenu un grand compte de l'exécution. Outre les fils des peintres, auxquels Lucien, parlant de Zeuxis, laisse le soin de vanter l'harmonie des couleurs et la correction des lignes, il y avait, pour sentir tout le prix de ces qualités, tout un groupe très nombreux d'amateurs éclairés. Que de choses invisibles pour nous, s'écrie Cicéron, les peintres ne voient-ils pas dans les ombres et les saillies (70)? Mais ces choses que Cicéron avouait ne pas reconnaître, ceux-là, sans doute, les distinguaient qui, bien que ne sachant pas peindre, étaient réputés, comme il le dit lui-même, bons juges des peintures, en raison de leurs connaissances spéciales. Plutarque aussi sépare ces spectateurs vulgaires qui, admis dans une galerie, promènent sur tous les objets une admiration banale et font comme ceux qui saluent tout le monde à la fois, de ces connaisseurs formés par l'étude et un long usage, qui n'accordent leurs éloges, et pour ainsi dire leur salut, qu'à bon escient (71). D'ailleurs, parmi les observations générales sur l'art ou les jugements particuliers sur les œuvres que nous ont laissés les grands écrivains, que de preuves trouvons-nous de cette attention donnée par l'antiquité aux qualités du dessin, de la couleur, du clair-obscur, du faire même des artistes ? Cicéron, qui ne paraît point avoir été un connaisseur très exercé, remarque que, si l'art de la peinture est un, les peintres comme Zeuxis, Aglaophon, Apelle, diffèrent beaucoup entre eux, sans qu'on puisse dire qu'ils ne soient pas parfaits chacun en son genre : or, c'est là distinguer, dans la peinture, les 148 temps, les écoles et les manières ; c'est considérer non les sujets ni la faculté d'invention, mais bien le talent du peintre lui-même (72). Dans le discours sur les statues et œuvres d'art, enlevées par Verres, Cicéron décrit peu, parle çà et là de l'effet que telle œuvre produisait sur le spectateur, mais ne cite pas une seule statue, un seul bas-relief, un seul vase ciselé, un seul ornement, sans en vanter la délicatesse et le fini de l'exécution. La plupart des jugements de Pline, soit qu'il émette une opinion personnelle, soit qu'il parle d'après les artistes, comme Praxitèle, ou ceux qu'il appelle les gens habiles dans l'art, peritiores artis, ont presque tous rapport à cette qualité maîtresse. De Piréicus, qui n'avait peint que des boutiques de barbier et de cordonnier, des ânes, des provisions de cuisine, il dira, par exemple : « par l'art lui-même il n'est inférieur à aucun peintre ; peut-être s'est-il fait tort par le choix de ses sujets (73). » Voyez l'éloge qu'il fait de Parrhasius (74) : il loue non seulement la beauté et l'expression de ses personnages, mais encore sa remarquable entente de la proportion et son habileté à dessiner les contours ; c'est là, ajoute-t-il assez singulièrement, le dernier mol de la peinture ; Falconet. qui s'est attaché à relever les invraisemblances et les contradictions du trente-cinquième livre, qui critique en particulier cette dernière observation, ne peut s'empêcher de remarquer que l'auteur a toutefois raison de priser si fort la science du dessin et de la faire consister surtout dans la délicatesse et la pureté des lignes enveloppantes. C'est Pline qui nous a laissé sur les artistes anciens et leur œuvre le plus de détails techniques : c'est lui, par exemple, qui nous apprend que le coloris d'Aristide était un peu dur (75), que celui d'Antidotos était sévère (76), que, pour être austère, celui d'Athénion n'en était que plus 149 agréable aux yeux des connaisseurs (77) ; que Nicias donnait tous ses soins à la partie du clair-obscur (78) ; que Pausias (79), dans le clair-obscur et les raccourcis, avait un talent remarquable. On sait que les amateurs les plus raffinés trouvent surtout leur plaisir dans l'étude du faire même de l'artiste, c'est-à-dire de la manière originale dont il tient le pinceau ou manie le crayon ; or, c'est dans les esquisses que les qualités du faire sont, pour ainsi dire, plus à nu, ou du moins apparaissent plus naïvement, par cela même que l'artiste n'a pas eu le temps ou ne s'est pas donné la peine de corriger ou de compléter son travail. Ce goût pour les ébauches était répandu à Rome, comme l'atteste ce passage de Pline : « Mais ce qui est surtout curieux et digne de remarque, dit-il, c'est qu'on admire plus que les productions terminées les derniers morceaux des artistes, ceux même qu'ils ont laissés imparfaits, comme Y Iris d'Aristide, le Tyndaridès de Nicomaque, la Médée de Timomaque, et ce tableau d'Apelle, dont nous avons parlé, la Vénus. En effet, on y considère l'esquisse laissée et les pensées même de ΐ artiste ; une certaine douleur intervient pour faire priser davantage le travail, et on regrette la main arrêtée dans l'exécution (80). » Cette dernière considération semble plus d'un écrivain moraliste, comme Pline l'est presque toujours, que d'un artiste ou d'un connaisseur ; mais la définition de l'esquisse, qui est comme la pensée du peintre, est telle que pourrait la donner un connaisseur ou un artiste. Une des preuves les plus frappantes de cette disposition des anciens à regarder l'exécution comme supérieure à l'invention nous est donnée par cette liste très longue des œuvres que Pline désigne, non point par le nom, mais par l'action, l'attitude, ou un caractère quelconque des personnages représentés, comme si l'admiration pour l'art lui-même avait fait 150 oubliera Pline ou plutôt aux historiens de l'art qu'il compile le sujet véritable (81) : nous rencontrons, par exemple, un diadu-mène, un doryphore, un phylarque, un navarque en cuirasse, un blessé mourant, un prêtre en prières, un acteur tragique, un enfant, des matrones en pleurs, des femmes adorant et sacrifiant, d'autres à leur toilette, un homme comptant sur ses doigts ; mais Pline ne dit point qui étaient ces femmes, qui étaient ces hommes ; peu lui importait à lui, ou à ses autorités, ou même à l'opinion des amateurs ; ce qu'on admirait, c'était le talent de peindre ; la désignation était vague, mais elle suffisait entre connaisseurs et gens du métier, pour savoir de quelle œuvre il était question ; le sujet était indifférent. Pline, après avoir dit qu'on voyait dans le sénat un tableau de Philocharès, représentant Glaucion et Aristippe son fils, s'écrie : « merveilleuse puissance de l'art, à en juger seulement par ce tableau, puisque, grâce à Philocharès, le sénat et le peuple romain contemplent depuis tant de siècles deux personnages du reste tout à fait obscurs (82) ! » On ne peut mieux dire ni mieux reconnaître combien dans une œuvre d'art le choix du sujet a peu d'importance, combien du moins les qualités de l'exécution peuvent suppléer au défaut d'attrait et d'intérêt dans le sujet lui-même. Pline nous apprend il est vrai, à propos de ce tableau, que ce qu'on admirait surtout, c'était la ressemblance d'un fils adolescent avec son vieux père, malgré la différence de l'âge qui avait été observée ; on peut trouver que ce n'est point là une merveille; qu'un peintre de quelque talent peignant d'après nature un père et un fils, devait nécessairement mettre dans son œuvre les ressemblances et les différences que lui présentait le modèle; l'observation est juste, mais, pour que ces ressemblances et ces différences eussent plu si vivement aux amateurs, il fallait qu'elles fussent frappantes, c'est-à-dire qu'elles eussent été exécutées de main de maître. L'éloge par lui-même vaut 151 peu ; mais il vaut par la supériorité d'exécution qu'il suppose et que la réflexion de Pline, sur la puissance de l'art, nous paraît pleinement attester (83).
Quintilien n'a guère parlé des artistes que pour les comparer aux orateurs; mais ce qu'il loue en eux, ce qui les distingue à ses yeux les uns des autres, ce qu'il regarde, par conséquent, comme leur mérite propre, c'est presque toujours l'exécution : Zeuxis inventa la distribution des lumières et des ombres, Parrhasius excella dans les proportions; Protogène brilla par le fini, Pamphile et Mélanthe par la science du dessin, Antiphile par la facilité, Apelle par la grâce (84).
152 Quintilien, il est vrai, préfère les œuvres achevées aux simples ébauches, la perfection à la naïveté. « Les couleurs simples de Polygnote et d'Aglaophon, dit-il, ont aujourd'hui encore des admirateurs si passionnés qu'ils mettent ces ouvrages presque grossiers et qui sont comme l'enfance de l'art au-dessus des productions des artistes les plus illustres qui les ont suivis ; c'est là, à mon sens, un goût particulier, une prétention. » Mais ce passage prouve quelle importance les amateurs et Quintilien lui-même attachaient à l'exécution; seulement les amateurs par une certaine lassitude assez fréquente du beau, peut-être aussi par un excès de délicatesse et, comme le pense Quintilien, pour se distinguer de la foule, recherchaient l'exécution incomplète; Quintilien, épris de la perfection oratoire, veut retrouver dans les arts une exécution achevée et de tout point irréprochable. On a cru que les plaintes de Pétrone sur la décadence de la peinture étaient inspirées par le défaut d'originalité qu'il remarquait dans le choix des sujets et des motifs (85) : mais c'est là une opinion peu vraisemblable. Ce sont les méthodes expéditives, inventées par l'Egypte, qui ont perdu la peinture, nous dit-il; que peuvent être ces méthodes expéditives sinon un ensemble de procédés permettant à l'artiste de peindre plus vite et comme de pratique, au lieu de l'astreindre, comme les procédés anciens, à une étude patiente du modèle, aux lenteurs souvent heureuses d'une exécution attentive? Des détails techniques sur les effets de la lumière se retrouvent dans Plutarque, dans l'auteur de l'écrit Sur le Sublime. Lucien lui-même, bien que faisant profession de réserve à l'endroit de la technique de l'art, empiète hardiment sur le domaine des artistes; il aime à louer, par exemple, dans les statues, l'heureuse proportion 153 du corps, les doigts ronds et effilés, le contour du visage, la délicatesse des joues, le beau dessin du nez, l'ouverture gracieuse de la bouche et la rondeur du cou ; dans les peintures, les teintes chaudes qui relèvent la blancheur, l'harmonie des couleurs, la grâce et la pureté du dessin (86).
En général, cependant, les écrivains, philosophes, orateurs, sophistes, regardent surtout au visage les statues et les personnages représentés par la peinture : ce qu'ils leur demandent, c'est d'exprimer avec sincérité, avec éloquence, soit par le jeu de la physionomie, soit par le geste, des sentiments conformes à leur nature et à leur situation ; l'âme, en un mot, voilà l'objet de leur préoccupation presque unique, de leur curiosité légèrement exclusive ; un trait pour eux ne vaut que comme un signe, et ce signe ils l'estiment à proportion de sa justesse, de sa clarté et de sa force. Aussi haut que nous remontions, la critique ancienne offre ce caractère. Que demande Socrate à Parrha-sius, dans le fameux dialogue rapporté par Xénophon ? de faire du visage le miroir de l'âme. Pourquoi Aristote préférait-il Polygnote à Zeuxis? Parce que, selon lui, Polygnote avait bien représenté les mœurs, tandis que la peinture de Zeuxis était dépourvue de toute expression morale (87). Nous avons vu comment Lucien décrit les centaures de Zeuxis; de parti pris, il s'interdit toute observation qui n'a pas l'expression pour objet (88). S'il passe devant un tableau qui représente Persée et Andromède (89), il est surtout frappé par l'air de crainte et de pudeur répandu sur le visage de la jeune fille; s'il a devant les yeux un Ulysse contrefaisant l'insensé, il n'oublie pas, entre autres détails, de faire remarquer que le visage du héros est bien tel qu'il doit être : car on semble y lire l'ignorance de tout 154 ce qui se passe autour de lui. De son côté, Pline l'Ancien est riche en détails de ce genre; de Zeuxis, il nous dira qu'il semble avoir peint les mœurs de Pénélope (90) ; de Silanion, que sa statue ou son buste en bronze d'Apollodore le sculpteur, fameux par ses fureurs contre ses propres œuvres, représentait moins un homme que la colère elle-même (91). Le Philiscus de Protogène paraissait absorbé dans ses méditations (92) ; la Phryné de Praxitèle exprimait la joie (93) ; une femme mourante, dans un tableau d'Aristide, laissait encore lire, sur son visage contracté par l'agonie, toute la vivacité des préoccupations maternelles (94).
Mais l'expression, si importante qu'elle soit dans les œuvres d'art, ne doit être pourtant considérée que comme un des moyens les plus efficaces dont le talent dispose pour donner aux figures l'air de vivre et d'agir. Ce but souverain des arts, les anciens écrivains ne l'ont pas plus méconnu que les modernes, et même l'on peut dire d'eux ce que l'on ne peut dire des modernes, c'est qu'ils semblent tous d'accord sur ce point. La fiction de Pygmalion, animant la statue qui est l'œuvre de ses mains, est acceptée par l'antiquité comme le symbole de la puissance même de l'art. Aucun ancien n'aurait, comme Gœthe, blâmé Pygmalion « d'avoir détruit par un acte de sensibilité vulgaire ce qu'un acte purement intellectuel avait produit de plus sublime (95). » Ecoutez Socrate conversant avec Parrhasius; ce que le philosophe estime dans une œuvre d'art, c'est non seulement l'expression, mais le principe de vie, τὸ ζωτικόν (96). Parcourez les jugements de Pline l'Ancien : le héros nu de tel artiste est une espèce de provocation à l'adresse de la nature; 155 Hercule, vêtu de la tunique de Nessus, paraît souffrir tous les tourments de l'agonie (97); tel personnage supplie si bien qu'on entend presque sa voix (98). Le mourant blessé de Crésilas laissait deviner au spectateur ce qui lui restait de vie (99). Valère Maxime, parlant d'un tableau qui représentait le dévouement de Péro, s'exprime ainsi : «les yeux restent saisis et immobiles ; dans ces muets contours qui reproduisent des formes humaines, ils croient voir des personnes vivantes et animées (100). Un des personnages du roman de Pétrone, entrant dans la galerie de Trimalcion, vante les esquisses de Protogène, qui, dit-il, le disputaient de vérité avec la nature elle-même (101). Unissant dans un même éloge les tableaux de Zeuxis, d'Apelle et de Protogène, il ajoute ; « les contours, par leur finesse, imitent la nature avec une telle exactitude qu'on pourrait croire qu'il y a aussi une peinture pour le principe de la vie. »
Les écrivains, surtout les poètes de l'antiquité, vont plus loin ; ils éprouvent ou feignent d'éprouver, devant les œuvres d'art animées d'une vie intense, une espèce d'illusion. Stace décrivant l'Héraclès épitrapézios de Lysippe, s'écrie : « Voilà le dieu, le dieu lui-même; il a bien voulu se montrer à toi, Lysippe; petit il apparaît, mais on sent qu'il est énorme ; il n'a qu'un pied de haut, mais la justesse des proportions est si merveilleuse, qu'en le parcourant des yeux, il est permis de s'exclamer: Voilà la poitrine qui a étouffé le lion de Némée, voilà les bras qui portaient la massue fatale et brisaient les rames du navire Argo (102)... » La vache de Myron était prise pour une génisse véritable par les animaux et les hommes, disent de toutes manières, plus ou moins ingénieusement, les épigrammes de l'Anthologie (103). « Elle pourrait mugir, suivant Au- 156 sone (104), mais elle craint de faire tort à l'artiste, car pour un homme, donner les apparences de la vie, c'est plus que, pour un dieu, donner la vie elle-même. » Diodore avait ciselé en argent un satyre endormi ; il dort en effet, dit l'épigramme : tu peux le piquer, il s'éveillera (105). Qu'elle est ravissante cette image d'Hélène, dit une autre épigramme ! L'airain même accuse sa grâce et ses charmes. Celte belle statue exhale tous les feux de l'amour, comme si l'œuvre était vivante (106). Telle statue d'un coureur s'élancerait pour saisir la couronne, si le piédestal ne le retenait pas (107). « Que si même la pierre jalouse me le permet d'un signe, dit Galéné, la divinité des souffles favorables, dans une épigramme d'Addée sur un béryl, je suis toute prête à m'élancer, et tu connaîtras ma vitesse à la nage (108). » Pythagoras parlerait, si l'artiste n'avait voulu le représenter méditant en silence (109). Les dieux ont changé Niobé en pierre; mais Praxitèle lui a rendu la vie (110). Dans une statue de marbre, un poète croit apercevoir les teintes de la chair; « elle est là, la fille d'Eétion, Andromède, debout sur ses pieds qui empruntent à la rose ses couleurs. » Quelquefois le poète flotte entre l'illusion et la réalité : « sur les joues d'Hercule, les larmes s'épanchent à flots : mais l'art les a séchées pour montrer l'ardeur fiévreuse de ses incurables douleurs (111). »
Faut-il conclure de ces citations que l'illusion était pour les artistes et les écrivains de l'antiquité le triomphe de l'art ? Cette théorie, soutenue quelquefois dans les temps modernes, est aujourd'hui, comme on le sait, entièrement abandonnée. Les arguments, qui servent à la réfuter, paraissent en effet péremp- 157 toires. L'illusion, a-t-on dit, ne pouvant jamais être complète, il y a quelque puérilité à en faire le but de ses efforts ; d'excellentes peintures, de véritables chefs-d'œuvre ne produisent sur le spectateur aucune espèce d'illusion ; enfin, si l'illusion était l'idéal, le véritable chef-d'œuvre serait le trompe-l'œil, qui emploie cependant les artifices les plus grossiers. L'esthétique des anciens, telle qu'elle se dégage des jugements de Pline et des épigrammes de l'Anthologie, est-elle donc tout entière fondée sur une erreur?
Remarquons d'abord combien il serait étrange qu'une théorie vaine et fausse sur les arts d'imitation fût née précisément sur la terre classique des beaux-arts; les artistes ne se seraient pas mépris sur le véritable objet de l'art, et tous les écrivains sans exception les auraient admirés pour des qualités équivoques ou des défauts réels ! D'un autre côté, la convention, comme nous l'avons vu, occupe une si grande place dans l'art antique qu'il est impossible de ne pas s'y heurter à chaque instant, et qu'elle doit constamment dérouter l'illusion. Enfin, si le peintre dispose de ressources spéciales qui favorisent l'illusion, l'illusion est-elle possible devant des statues de marbre et de bronze, surtout quand elles sont conçues dans le style antique? Qu'ont donc pensé nos poètes de l'Anthologie, et qu'ont-ils voulu réellement dire ?
On peut supposer d'abord, non sans vraisemblance, qu'ils ont perdu quelquefois de vue l'œuvre d'art pour contempler en imagination le héros ou le dieu qu'elle représentait : d'elle-même, la poésie crée des personnages vivants ; comment ne donnerait-elle pas une vie pleine et entière à celui qui a déjà reçu d'un autre art un commencement de vie ? En outre n'y avait-il point, pour tous ces poètes raffinés de l'époque alexandrine, un jeu agréable dans cette opposition entre la pierre et la vie, entre la vie et un assemblage de lignes et de couleurs ? Mais il y a, croyons-nous, une autre raison qui explique mieux, qui justifie même le langage des poètes de l'Anthologie. L'illu- 158 sion est bien, dans un certain sens, le but de l'art : non pas cette illusion vulgaire qui est celle du trompe-l'œil, qui est produite par une confusion habilement ménagée entre l'image d'un objet et des objets réels, placés à proximité, éclairés d'une façon particulière : non l'illusion complète, mais cette demi-illusion, à laquelle l'imagination se prête volontiers, devant une reproduction fidèle de la réalité. Que fait l'artiste, quand il se propose de peindre ou de sculpter un personnage historique ? il s'efforce de se le représenter en esprit, de le replacer au milieu des hommes et des choses de son temps ; il le voit, et plus celte vue est nette, plus l'image qu'il exécutera aura de relief et d'éclat; de même, suivant une remarque de Philostrate, un critique doit avoir contemplé en imagination Ajax furieux pour apprécier le tableau de Timomaque. Or quand, entre l'idée et la chose représentée, entre la conception de la pure imagination et l'œuvre du pinceau ou du ciseau, il y a identité; quand, ce qui arrive souvent, l'œuvre d'art dépasse ce que nous pouvons imaginer par nous-mêmes, mais nous montre ce que nous imaginons aisément, avec l'aide d'autrui, n'y-a-t-il pas lieu de s'écrier : Deus ille, Deus ! le personnage est pris sur le vif, il est ce qu'il doit être, il respire, il agit. Sans doute l'œuvre ne possède ni toutes les conditions ni même toutes les apparences d'une vie entière et complète ; mais par cela même qu'elle jouit de toute la vie qu'elle a pu recevoir d'une main mortelle, elle mérite de paraître vivante, et nous le paraît en effet. C'est là une illusion, si l'on veut, mais une illusion restreinte ; de plus, consentie, acceptée par notre imagination et dont nous ne cessons pas un seul instant d'avoir conscience. Le spectateur n'est point dupe ; car c'est volontairement qu'il se plaît à confondre la nature et l'image, rendant ainsi hommage à la perfection de l'imitation.
Les poètes ou les rhéteurs qui ont décrit les œuvres d'art se complaisent parfois dans cette illusion et l'exagèrent de parti pris. D'une statue de suppliant Pline a dit qu'elle avait presque la 159 voix ; cette voix, les poètes l'entendent ; ils recueillent les paroles du personnage représenté; ils conversent avec lui. Que de fois dans l'Anthologie des yeux sans prunelle s'allument d'un éclair, des visages de marbre ou de bronze se colorent d'une vive rougeur, des membres rigides comme le métal ou la pierre dont ils sont formés changent d'attitude, exécutent le mouvement commencé, en commencent un autre, suite du premier ! L'Apollon de Daphné près d'Antioche semblait chanter, selon Libanius, et même, ajoute le rhéteur, on l'a entendu, vers l'heure de midi, moduler les louanges de la terre en s'accompagnant de la cithare (112). Doit-on blâmer une semblable méthode? Observons d'abord qu'elle a été employée par plus d'un critique moderne qui n'écrivait pas en vers et à qui le nom de sophiste eût paru un outrage. Aux yeux de Winckelmann, l'Apollon du Belvédère n'est-il point un dieu descendu du ciel sur la terre? ne le voit-il pas marcher et même tendre l'arc qu'il n'a plus et qu'il n'a peut-être jamais eu (113) ? Devant Diderot les personnages de Greuze, de Vernel, s'animent, se meuvent, pensent, parlent entre eux, parlent avec lui ; c'est lui qui a dit : « De deux lettres, par exemple, d'une mère à sa fille ; l'une pleine de beaux et grands traits d'éloquence et de pathétique, sur lesquels on ne cesse de récrier, mais qui ne font illusion à personne ; l'autre simple, naturelle, et si naturelle et si simple que tout le monde s'y trompe, et la prend pour une lettre réellement écrite par une mère à sa fille : quelle est la bonne et même quelle est la plus difficile (114) ? » La seconde sans nul doute, selon Diderot ; et ce principe il l'applique au tableau ; plus l'illusion est complète, meilleure est la peinture ; il a vu les personnages de Greuze ; il a vu ceux de Fragonard, mais seulement comme en rêve (115); Greuze est donc supérieur à Fragonard ; il ne voit point ceux de Lépicié ; ce sont 160 des fantômes de fantômes. Un philosophe moderne décrit ainsi un tableau du Poussin qui a pour sujet Y Inspiration du poète. Le poète à genoux porte à ses lèvres la coupe sacrée que lui tend le dieu de la poésie, Apollon ; à mesure qu'il boit, l'improvisation s'empare de lui, son visage se transfigure et la sainte ivresse se fait sentir dans le mouvement de ses mains et dans tout son corps » (116). Comment la peinture qui ne peut fixer sur la toile qu'un seul instant a-t-elle pu représenter ces degrés de l'inspiration? Elle ne les a pas représentés; mais le critique s'abandonne à l'illusion. Un de nos écrivains les plus autorisés en pareille matière (117) a écrit, à propos des Chanteurs de Luca délia Robbia conservés aux Offices : « l'artiste a réussi à figurer l'émission de la voix et la qualité même de chaque organe par la posture plus ou moins souple des personnages, par la contraction inégale des traits, parle mouvement différent des têtes, les unes à demi renversées comme pour lancer vers le ciel les sons aigus du soprano, les autres droites, immobiles, s'aidant en quelque sorte de la ligne verticale pour tirer plus énergiquement de la poitrine les notes profondes qui serviront de basse au concert. » Nous nous garderons bien de contester la justesse de ces observations, mais on reconnaîtra sans doute avec nous qu'un critique doué d'un esprit moins délié et d'une imagination moins vive, n'aurait pas découvert dans l'œuvre de Luca délia Robbia tant de qualités si peu conformes, en apparence du moins, au génie de la plastique (118). Personne n'accusera cependant les modernes de croire que l'illusion est le but de l'art; mais ils subissent, comme les anciens, le prestige d'une imitation parfaite; dans cette illusion, même incomplète, ils trouvent un certain charme, ils la prolongent ; ils cherchent à la compléter autant qu'il est en eux pour accroître leur plaisir. Le procédé est poétique et ne saurait être condamné d'une façon absolue, 161 il répond certainement à une tendance de notre nature ; mais il est aisé, en l'appliquant, d'excéder la mesure, de manquer de goût ; c'est un défaut qu'on relèverait sans peine chez les modernes comme chez les anciens ; nous le reprocherons plus d'une fois à Philostrate ; ni Diderot, ni Winckelmann n'en sont exempts. Il est moins fréquent de nos jours ; ce n'est pas sans doute faute d'enthousiasme ou d'imagination, mais par un sentiment plus juste des lois esthétiques ; nous savons en effet que si celui-là ne sent pas assez qui ne se prête pas à une certaine illusion, celui-là sent trop vivement pour juger sur qui l'illusion a une prise trop forte et trop soudaine. De plus, nous sommes plus attentifs au mérite de l'exécution ; nous sommes trop occupés à comparer le modèle et l'imitation, pour les confondre tous les deux ; nous maintenons sous notre regard le monde réel, et le monde fictif créé par l'art, sans leur permettre de se superposer l'un à l'autre ; nous regardons moins en poètes et plus en dilettantes.
(1) A. Mai : Iliados fragmenta antiq. Mediol., 1819; Homeri lliados picturae, R., 1835.
(2) Inghirami, Galleria Omerica, pi. XVII. (
(3) Ibid., CVIII.
(4) Inghirami, Galleria Omerica, CXII.
(5) Cf. Bayet, Recherches, etc., p. 24. (
(6) Labarte, Hist. des arts industr., pi. LXXX; Bayet, ouvr. cit., p. 73.
(7) A plus forte raison, on trouve réunies dans ces mêmes miniatures, sans répétition des mêmes personnages, des scènes qui n'ont pu se passer en même temps ni dans le même lieu. Voir, par ex. Inghirami, lav. 87 ; d'un côlé Hector adresse des reproches à Paris, en présence d'Hélène; de l'autre les femmes troyennes, Hécube en tête, viennent offrir un riche péplos à la déesse
(8) Overb., Die Bildw., Alt., VI, 6 et 7.
(9) Helbig, W., n° 1315.
(10) Vase de Ruvo à Carlsruhe; Overb., Die Bildw., p. 333 ; Atl., XI, 1.
(11) Peint, de Pompéi ; Overb., D.Bi., p. 245; Atl., XI, 11 ; Camée de la galer. de Florence, Ibid., p. 249 ; Atl., XI, 6.
(12) Bas-relief du palais Spada; Overb., Die Bildw., p. 257, n° 3 et 4; Alt., XII, 5. Ce bas-relief n'a pu être expliqué que par la comparaison avec le bas-relief analogue de la villa Ludovisi.
(13) Voir le commentaire sur la description de Philostrate intitulée Amphiaraos, I, 26.
(14) Dict. de l'Académie des beaux-arts, p. 227, art. Barbares (par Vinet).
(15) Arch. Zeit, 1856. Taf. 86.
(16) Mus. Grég., 11,4,2, 2°.
(17) Arch Zeit., 1857. Taf. 103.
(18)I Müller-Wies., Il,447.
(19) Sur toute cette question voir Helbig (Untersuch,, p. 169) que préoccupe moins d'ailleurs la fidélité à la couleur locale que l'influence orientale sur la peinture antique. La remarque faite plus haut est toutefois applicable à tous ces exemples : ce n'est pas par souci de l'exactitude que les artistes sont exacts en fait de costume, mais bien par souci de l'effet pittoresque. Sur bien des vases le costume asiatique est donné à des personnages comme Orphée, Thamyris, Phineus, Borée, Rhésos qui sont des barbares, mais non des barbares d'Orient. Dans les arts, où reflet pittores-que est sans importance, dans la sculpture, par exemple, la fidélité à la couleur locale semble avoir été plus tardive; les belles statues d'amazones ont la tunique et la petite chlamyde qui laissent le sein, les bras, les jambes et les pieds nus (Voir Vinet, art. Amazones dans le Dict. de Saglio et Daremherg).
(20)) Helbig, W., n° 1385.
(21) Bruno, G. d. gr. K., II, p. 245.
(22) Pline, XXXV, 93 ; 78 ; 142.
(23) Helbig, Untersuch., p. 296.
(24) Bruno, Die Ph. G., p. 297.
(25) Tel vase en verre d'origine romaine représente les côtes de Puteoli (Arch. Zeit., 1868, p. 91. Taf., 11). De tels sujets devaient convenir encore mieux à la peinture.
(26) Friedl., Mœurs romaines, etc., II, p. 472 de la traduct. franc.
(27) Sen., Lettre, 41.
(28) H. Ν., IV, 31.
(29) H. N., 37, 62 « Herbas quoque silentes frondesque avide spectare solemus ».
(30) X, 3, 24.
(31) Plin., iii. viii, 36.
(32) Lucien, Quum. hist. conscrib., 19.
(33) Woermann, Die Odysseel. viertes Laistrygonenbild.
(34) Ibid., p. 17
(35) Milsand, l'Esthétique anglaise, p. 110.
(36) Voir le commentaire du Marécage, Phil., 1,9.
(37) Roux et Barré, Herculamm et Pompéi (Didot), III, 121 ; Mus. Borb., IV, 4.
(38) ) Roux et Barré, H. et P., III, 141 ; Pompeiana, 2e partie, p. 75; Helbig, Wandg., n° 1390.
(39) Helbig, W.t 1260; P. d'E., IV, 6, p. 31.
(40) Pline, H. N., 35,90 « pingit et quœ pingi non possunt, tonitrua, fulgetra, fulgura quœ Bronten, Astrapen, Ceraunobolian appellent. » Malgré l'avis de Bruno (G. d. gr. Κ., II, 207) et celui d'Urlichs (Chrest. Plin.,, p. 361) il est difficile de songer ici à des personnifications.
(41) Pl. Ν. H., 35, 92.
(42) Ibid., 35, 138.
(43) Helbig, Unters., p. 212. Voir tout le passage.
(44) Voir Ann dell. lnst., 1837 ; Mon., pl. X. Vase analogue, Ann. dell. Inst., 1872, Tav. d'Agg.. A.
(45) Anth. Pat.,lV, 391.
(46) I, 4. Dans Marcus Eugenicus (Kays., 140) l'enfant Jésus resplendit d'une lumière qui rayonne dans toutes les directions; ailleurs le soleil fait étinceler l'or et les pierreries des couronnes (ib., p. 158). En supposant les descriptions de M. Eugenicus faites d'imagination, aurait-il imaginé des effets de lumière, si l'art de son temps ne les eût pas recherchés? Un sophiste n'est pas un témoin quand il est seul; mais l'unanimité des sophistes semble être une preuve très forte.
(47) Unters., p. 364.
(48) IV, chap. xviii.
(49) Plin., H. N. 35,67 : « primus symmetriam picturœ dedit... »
(50) Cf. Helbig, Wandg, n° 52, 101, 102 et passim.
(51) Pl., H. N., XXXV, 127 « cum omnes quae volunt eminentia videri caudicanti faciunt colore, quae condunt nigro, hic totum bovem atri coloris fecit umbraeque corpus ex ipsa dédit magna prorsus arte in aequo exstantia ostendente et in confracto solida omnia. »
(52) Belbig, W., 1318, c.
(53) Ibid., n° 1192. Voir Helbig, Unters., p. 214.
(54) Menus propos, III, 6, p. 80,
(55) Pl., H. N., 35, 5, 11. Cf. Fromentin, Les Maîtres d'autrefois, 1875, p. 236, 237. D'après cet artiste, bien colorer, c'est surtout habilement rapprocher les couleurs des tons. Des écoles entières, observe-t-il, ne se sont pas doutées de celte loi. Le passage de Pline autorise peut-être à penser que ce ne fut pas le cas de l'école grecque.
(56) Zeuxis ou Antiochus, traduct. Talbot, I, p. 339.
(57) Paus., X, 25-31.
(58) Paus., X, 29, 1.
(59) X,31,10.
(60) Roux et Barré, P. d'Herc. et Pompéi, lf, 5.
(61) Roux et Barré, II, 2.
(62) ld., ibid., II, 6.
(63) Id., II, 43.
(64) (4) Id.,II, 45.
(65) Pitt. d'Er., III, 7,41 ; Helbig, W., 824.
(66) Roux, III, 140; Helbig, W., 821. L'explication de ce tableau ne saurait être douteuse. Comparez ce passage de Nicetès Eugenianus (V. 127.) Chariclès, regardant des nids d'hirondelle, répondit à Drosilla : « Pour toi, belle hirondelle, étant venue aux jours du printemps, tu te construis un seul nid pour deux petits, avec de joyeux gazouillements ; quand l'hiver revient, tu fuis; mais l'amour ailé, l'amour qui tire de l'arc tresse sans cesse un nid dans mon cœur. Un désir se couvre d'une plume abondante; un autre annonce déjà son éclosion; un troisième s'élève hors de l'œuf ; et mon cœur malheureux bondit au dedans de moi, effrayé par les cris de tous ces petits oiseaux, qui toujours ouvrent le bec. »
(67) Anth. Gr. t II, 49,13.
(68) Sur ceux qui sont aux gages des Grands, c. xvii (Voir trad. Talbot, I, 273).
(69) Préface ou Hercule, I, 4.
(70) Acad., II, 7.
(71) Plut., De Genio Socratis.
(72) Cic, Or. 11 ; de Orat., III, 7.
(73)) Plin., ibid. n., 35, 37.
(74) Id., ibid., 35, 67.
(75) Id., ibid., 35, 98.
(76) Id., ibid., 35, 130.
(77) )Plin., H. n.,35, 134.
(78) Id.,ibid., 35, 130.
(79) Id., ibid., 35,127.
(80) Id., ibid. 35,145 ; traduct. Littré.
(81) Cf. Furtwängler, Plin. u. seine Quellen, p. 47.
(82) (lin., H. n., 35, 28.
(83) M. Helbig, dans ses recherches sur la peinture campanienne, prétend que Pline Taisait plus de cas de l'invention que de l'exécution ; la raison serait que Pline parle de la peinture comme un art qui se meurt, jugement contredit par les peintures d'Herculaoum et de Pompéi. Nous ne saurions être de l'avis de M. Helbig sur ce point. Sans doute les jugements de Pline ne semblent pas inspirés par des prin* cipes 1res constants; tantôt il parle comme un artiste pourrait le faire ; tantôt il se laisse prendre aux éloges que la foule ou des amateurs peu éclairés donnent aux œuvres d'art; tantôt il semble consulter ses impressions. Pline est toujours compilateur ; il reproduit la science et les opinious d'autrui, sans trop s'inquiéter de mettre l'unité dans cet assemblage de pièces et de morceaux. Cependant presque toujours, en parlant d'oeuvres d'art, son appréciation est fondée sur des qualités techniques. Comment aurait-il pu ne songer qu'à l'invention en disant que l'art était à son déclin? L'argument tiré des peintures campaniennes ne nous paraît point sérieux ; ces peintures laissent plutôt deviner la perfection des modèles qu'elles ne donnent le sentiment de la perfection. On peut voir sur ce point le jugement des premiers artistes qui les virent, comme Cochin et Bellicard. Cochin est trop sévère; mais,au point de vue technique, n'auraiUoη pas été trop indulgent après lui? Si la peinture mobile ne différait point de la peinture campanienne, au premier siècle, Pline, qui avait sous les yeux les chefs-d'œuvre des maîtres de la Grèce, pouvait dire que la peinture se mourait, sans pour cela songer plus particulièrement à l'invention. Il est vrai qu'on peut distinguer (et c'est là une distinction trop souvent oubliée selon nous par la critique d'art) deux inventions: l'une consiste dans le choix du sujet; l'autre dans l'originalité même du talent. Celle dernière peut affecter toutes les parties de l'art, le dessin, la couleur, le clair-obscur, le faire même. La grâce de Raphaël, qui est inséparable de sa manière de dessiner, relève de l'invention. En ce sens, l'invention paraît avoir été très grandement estimée par Pline; mais ce n'est pas ce sens que M. Helbig donne a ce mot d'invention. M. Boissier, dans ses Promenades archéologiques, d'une érudition si alerte et si charmante, nous parait avoir accordé un peu trop de confiance au jugement de M. Helbig sur Pline et Pétrone (Voir Pr. arch., p. 328).
(84 Quintilien, Inst, orat., XII, 10. Toutefois Quintilien attribue comme traits dis-tinctifs à Théon de Samos l'imagination (φαντασίας), à Apelle le génie (ingenium) outre la grâce; à Zeuxis, outre la science du clair-obscur, le caractère auguste des figures.
(85) Helbig [Untersuch.) entend par compendiaria ars cette pratique des peintres campaniens qui consiste à imiter sur un mur, en reproduisant à la fois le cadre et le sujet, un tableau de grand maître. Nous pensons que le mot s'applique plutôt à des procédés nouveaux, plus aisés à acquérir, d'une application plus commode, qui d'ailleurs devaient convenir parfaitement à une peinture du genre décoratif, comme celles des villes de Campante.
(86) Cf. Lucien, Les Portraits, initio.
(87) Arist., Poét., VI, 2 ; expressions empruntées à la traduct. de M. Egger.
(88) Les Centaures de Zeuxis, sa Pénélope, devaient être, au point de vue de l'expression, une exception dans l'œuvre du maître; tous les textes relatifs à ce peintre parlent plutôt de ses qualités d'exécution, et aussi d'un certain air de grandeur dû à la taille de ses figures.
(89) De Domo, 22.
(90) ) Plin., H. n., 35, 63.
(91)) Id., ibid.,34, 81.
(92) Id., ibid., 35,106.
(93) ld., ibid., 34, 70.
(94) Id., ibid., 35, 90.
(95) Gœthe, Mémoires et voyages, ch. xi.
(96) Xénoph., Mém. Socr., III, 10,6.
(97) Pline, H n., 34, 93.
(98) Id., obid.,35, 99.
(99) Id., ibid., 34, 75.
(100) Id., ibid., V, 4
(101) Satyric., 84.
(102) Stace, Silv., IV, 6, 36 et suiv.
(103) Overb., Die Sehr. Quell., n° 550 et suiv.
(104) Ausone, Epigr., 64.
(105) Ep. de Platon, Anall., I, p. 172, n° 16.
(106) Statues du Zeuxippe, trad. F. D. (Hachette), p. 5.
(107) Anth., IV, 185, n° 313.
(108) Anth. Pal., IX, 544; Iraduct. de H. Rossignol (Des Services, etc., p. 237). Voir le même ouvrage, p. 234 et suiv. sur le véritable rôle de cette divinité marine.
(109) Anth., III, 202, n° 34.
(110) Ibid., III p. 201, η• 28.
(111) Ibid., trad. F. D., I, p. 5.
(112) Liban., Orat., 61.
(113) Cf. Wieseler, der Apollo Stroganoff, et l'article Apollo dans le Dict. de Daremberg et Saglio.
(114) Diderot, Greuze, Salon de 1765.
(115) Tableau de Corésus et de Callirrhoé, Salon de 1765, Fragonard.
(116) Cousin, le Vrai, le Beau, et le Bien, éd., 1872, p. 491.
(117) M. Delaborde, Sculpture florentine (Rev. des Deux Mondes, 1er oct. 65, p. 615).
(118) Gaz. des Beaux-Arts, 1er janv. 76, p. 144, art. d'Eug. Guillaume.