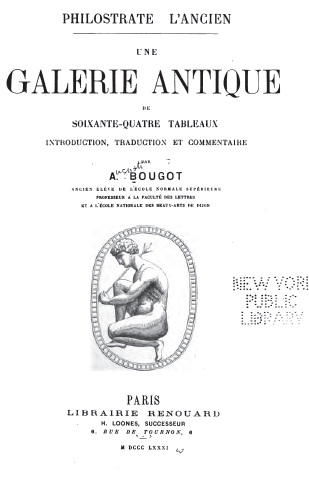
PHILOSTRATE L'ANCIEN
GALERIE ANTIQUE.
INTRODUCTION (pages 1 à 55)
pages 58-107
1
INTRODUCTION
Philostrate l'ancien. — La peinture antique et les tableaux de Philostrate.
— La critique
d'art chez les anciens. — L'ecphrasis ou description des œuvres d'art dans
l'antiquité.
Suidas compte trois sophistes du nom de Philostrate, le premier père du second, et le troisième fils d'un certain Nervianus qui aurait été à la fois le neveu et le gendre du second Philostrate. Décès trois personnages, le plus célèbre dans l'antiquité paraît avoir été le second Philostrate, celui que nous désignons sous le nom de Philostrate l'ancien. Il a laissé entre autres ouvrages une Vie d'Apollonius de Tyane, riche en documents sur la philosophie et l'état moral des premiers siècles après Jésus-Christ, de nombreuses biographies de sophistes, fort instructives pour l'histoire littéraire de cette époque, enfin l'ouvrage dont nous offrons une traduction au public lettré; c'est un recueil de descriptions de tableaux, très curieux à étudier au double point de vue de l'art et du sentiment de l'art chez les anciens, en particulier chez les sophistes.
Nous voudrions pouvoir raconter la vie de Philostrate, comme il a raconté celle des sophistes ses prédécesseurs ou ses contemporains; malheureusement il a peu parlé de lui. Eunape, qui a écrit les Vies des philosophes et des sophistes, ne cite Philostrate que pour dire qu'il l'imitera. Suidas est d'une sécheresse désespérante et d'une exactitude suspecte.
2 Essayons toutefois de réunir les rares documents que nous a laissés l'antiquité.
Philostrate est né à Lemnos ; le nom de cette île revient plusieurs fois dans ses ouvrages; raconte-t-il, par exemple, comment Apollonius, le fameux thaumaturge, délivra une bourgade de la présence d'un satyre qui outrageait les femmes : « J'ai connu à Lemnos, dit-il, un de mes compagnons d'âge dont la mère voyait venir à elle un satyre vêtu d'une nébride (1). » Ailleurs il décrit avec soin les cérémonies célébrées tous les ans pour purifier l'île de Lemnos, souillée au temps des Argonautes par le crime des Lemniennes qui avaient égorgé leurs époux (2). Ailleurs encore il parle de paysans de Lemnos qui s'étaient réfugiés sous un arbre pendant un orage et qui périrent frappés de la foudre (3). On a cru découvrir dans ces passages une certaine complaisance de l'écrivain à nommer le pays où il était né. D'ailleurs, sur ce point, son propre témoignage vient confirmer celui de Suidas; écrivant à deux de ses amis qui étaient de l'île d'Imbros, il leur dit : « Des désirs que vous m'exprimez, les uns sont accomplis, les autres le seront bientôt; car, étant de Lemnos, j'estime qu'Imbros est aussi ma patrie. J'unis par la bienveillance que je leur porte les deux îles ensemble et moi-même avec elles (4). » De quel service s'agit-il dans cette lettre; nous ne savons; mais Philostrate en rendit un plus méritoire à sa patrie ; il l'illustra ; les anciens qui parlent de lui l'appellent le Sophiste lemnien. Quelle est la date de sa naissance? on l'ignore; toutefois il est probable qu'il naquit vers les dernières années du règne de Marc-Aurèle, vers 182 après Jésus-Christ.
Le père de Philostrate, nous dit Suidas, professa la sophistique à Athènes. A quelle époque faut-il placer cet enseignement?
Philostrate fut-il l'élève de son père? Ce sont 3 autant de questions auxquelles nous ne saurions répondre.
L'éducation de Philostrate fut sans doute celle de tous les sophistes. Philostrate appelle les premières études des exercices critiques (5), sans doute, parce qu'ils étaient destinés à corriger les vices de prononciation et de langage, à enseigner l'usage classique des mots et des tournures, à former des atticistes consommés. Ce sont les exercices que Quintilien paraît comprendre tous sous le nom de grammaire, c'est-à-dire, outre la grammaire proprement dite, la lecture et l'explication des poètes, cette discussion même des textes à laquelle nous donnons aujourd'hui plus spécialement le nom de critique, enfin la science des mesures et des rythmes. « Sans la grammaire, dit le rhéteur latin, une éducation oratoire manque d'un fondement solide ; tout ce qu'on essaiera de construire s'écroulera (6). » C'était aussi l'avis des Grecs : Lucien, dans un dialogue où il oppose la véritable éducation à celle des sophistes pressés d'exercer leur art, nous fait pénétrer dans l'école d'un de ces maîtres qui enseignaient consciencieusement la grammaire, ou, si l'on veut, la critique. « Ce bonhomme, dit Lucien feignant de vanter les méthodes nouvelles plus aisées et plus expéditives, après t'avoir débité je ne sais quelles sornettes, t'engagera à le suivre, te montrera les traces de Démosthène, de Platon et de quelques autres Il te dira que tu parviendras au bonheur et que tu épouseras la Rhétorique, si tu suis ces traces avec la précision d'un danseur de corde ; car, pour peu que tu poses le pied à côté; que tu inclines à droite ou à gauche, que tu ne suives pas la direction, te voilà hors de la ligne droite qui mène au mariage. Ensuite il t'ordonnera de te former sur les anciens ; il te proposera pour modèles des discours vieillis, difficiles à imiter, semblables aux statues sorties de l'antique atelier d'Hégias, de Critias et de Nesiotès, œuvres précises, nerveuses, un peu raides, d'un dessin correct 4 et sévère. Mais ce qu'il y a de plus désolant, c'est que ce guide vous fera dépenser à ce voyage un temps considérable, des années entières. Il ne sait compter ni par jours ni par lunaisons ; il ne procède que par olympiades (7). » Tels étaient sans doute, moins l'exagération de ce portrait satirique, les maîtres comme Théagène de Cnide, Munatius de Tralles, Taurus de Tyr, avec lesquels un Hérode Atticus avait commencé son éducation de sophiste. Sans doute, comme le prouve ce même dialogue de Lucien, tous ne se soumettaient pas aux ennuis d'un apprentissage aussi long et aussi difficile; beaucoup se contentaient d'apprendre une vingtaine de mots attiques qu'ils mêlaient à des expressions étrangères pour étonner leur auditoire; mais ce n'était pas le cas d'un Hérode ni d'un Philostrate; le véritable sophiste avait pris, dès l'école, l'habitude d'un purisme exagéré. Un jour Philager, dans une discussion avec un élève d'Hérode Atticus, laissa échapper un mot suspect. — Dans quel auteur se trouve ce mot? demanda le jeune homme. — Dans Philager, répondit le sophiste, et la réponse passa en proverbe (8) ; mais un sophiste qui aurait eu besoin de répondre souvent comme Philager eût trahi l'insuffisance de son éducation première.
Des mains du grammairien, l'enfant passait entre celles du rhéteur. Quintilien nous a donné la liste des exercices savamment gradués, en usage dans les écoles préparatoires au barreau. L'élève était chargé de raconter un fait historique; puis il examinait le degré de confiance que méritaient certaines traditions ; puis venaient des éloges d'hommes illustres, des parallèles entre deux personnages historiques, des amplifications sur des lieux communs, des thèses ayant pour objet de comparer une chose à une autre, par exemple la vie de la 5 campagne à celle de la ville; les chries où il s'agissait de rechercher la raison d'un usage, par exemple, d'un attribut donné par les poètes ou les artistes à un dieu; puis l'éloge ou la censure des lois; enfin, la déclamation, véritable harangue de toutes pièces, qui roulait sur un sujet de pure invention ou qui, suivant le conseil de Quintilien, se rapprochait par le fond comme par la forme des plaidoyers réels. La lecture des historiens et des orateurs, faite à haute voix par un des élèves, sous la direction du maître qui expliquait le sujet et appelait l'attention de la classe sur les mérites de composition et de style, complétait cet enseignement, cette « institution oratoire ». Il y avait souvent des différences d'école à école et de maître à maître; ainsi, suivant le précepte de Théon (9), des rhéteurs écrivaient eux-mêmes des développements oratoires que les élèves apprenaient par cœur et qui devaient leur servir de modèles; mais on peut penser que le cercle des exercices était à peu près partout le même, à Rome et dans Athènes, dans l'école de Quintilien et dans celle de Proclus qui fut un des maîtres de Philostrate.
Ce Proclus était de Naucratis (10); pour échapper aux discordes qui déchiraient cette petite ville d'Égypte, il vint se fixer à Athènes, où il ouvrit école. C'était un personnage riche et faisant de sa richesse un bon usage; Philostrate raconte qu'à son arrivée en Grèce il demanda des nouvelles d'un Athénien, son ancien condisciple, avec lequel il avait suivi les leçons du sophiste Adrien ; on lui répondit que la maison de cet homme allait être vendue, parce qu'il ne pouvait acquitter une dette de dix mille drachmes ; Proclus envoya la somme avec ces mots : « Sauve ta maison ; je ne veux pas te retrouver dans la tristesse. » Il possédait quatre maisons, deux dans la ville elle-même, l'autre au Pirée, la quatrième à Éleusis; d'Égypte il recevait de l'ivoire, de l'encens, des parfums, des papyrus, 6 des livres qu'il vendait aux marchands d'Athènes à un prix raisonnable, ne pressant point ses débiteurs, se contentant d'un intérêt modeste. Son école n'était pas gratuite ; les honoraires du professeur étaient de cent drachmes par élève ; mais cette somme une fois payée, dit Philostrate, on avait le droit d'assister à ses leçons pour un temps sans limite, ce qui signifie sans doute pendant toute la durée des études, jusqu'à l'âge où l'on se sentait assez exercé pour n'avoir plus besoin de déclamer dans une école. Voici d'ailleurs quelles étaient la règle et les habitudes du maître. « Nous étions introduits ensemble, jeunes gens et enfant;, dit Philostrate ; les enfants s'asseyaient d'un côté avec leurs pédagogues; les jeunes gens de l'autre. » C'était là une mesure de discipline; il paraît en effet que dans ces écoles de sophistes, quand ces pédagogues n'étaient pas présents, il s'élevait de véritables querelles entre les élèves, les plus âgés se moquant sans doute de l'inexpérience des débutants. Proclus prenait rarement la parole; quand il le faisait, il reproduisait l'éloquence d'Hippias et de Gorgias. Habituellement il faisait lire ou réciter au milieu des élèves réunis la déclamation, l'exercice oratoire qui avait été préparé la veille, dit le texte de Philostrate. Les maîtres de rhétorique suivaient en effet deux méthodes en ce genre d'exercice : ou ils donnaient un cadre et, quand l'élève l'avait rempli, ils reprenaient eux-mêmes le sujet, comblaient les lacunes, traitaient certains points avec tout le soin qu'ils apportaient à leurs propres discours; ou bien, en donnant la matière, ils ne se contentaient pas d'en marquer les principales divisions; ils entraient dans quelques développements, indiquaient les arguments et même la place des mouvements oratoires. La manière dont Philostrate parle de l'enseignement de Proclus donne à penser qu'il employait l'une et l'autre méthode, mais plus souvent la seconde que la première. Proclus semble avoir tenu beaucoup à orner de connaissances variées l'esprit de ses élèves : sa bibliothèque leur était ouverte, et c'était 7 là, dit Philostrate, comme un complément de la leçon.
Parmi les premiers maîtres de Philostrate, il faut aussi compter Antipater (11). Ce sophiste avait écrit l'histoire de l'empereur Sévère qui le choisit d'abord comme précepteur de ses fils, puis comme secrétaire. « Beaucoup, dit Philostrate, ont écrit l'histoire, ont déclamé mieux que lui, mais personne ne l'a surpassé dans l'art d'écrire une lettre : comme un acteur de tragédies tout rempli de l'esprit de son rôle, il prêtait à l'empereur un langage digne du rang suprême ; il avait toutes les qualités du style qu'exigé le genre, la clarté, la gravité des pensées, une élocution sans recherche et comme née du sujet, une négligence aimable. » Antipater fut donné comme gouverneur à la Bithynie; mais il perdit ses fonctions pour avoir été trop prompt à se servir du glaive, selon l'expression de Philostrate (12). Peut-être Antipater dépassa-t-il, pour faire respecter l'autorité romaine, les bornes d'une juste sévérité; il est peu probable cependant qu'on ait eu à lui reprocher les cruautés d'un Vérus. Dans ces temps de servilité et d'abaissement, il donna un rare exemple de courage : lorsque Caracalla eut fait tuer son frère Géta qu'il accusait de projets fratricides, Antipater écrivit au meurtrier triomphant une lettre désolée, espèce d'élégie et de plainte funèbre où il se plaignait que de deux yeux, que de deux mains il ne lui restait qu'une main et qu'un œil, où il s'affligeait de voir deux frères tourner l'un contre l'autre des armes dont il leur avait appris à se servir pour leur défense mutuelle. Cette lettre, comme on le pense, déplut vivement à l'empereur. Antipater, qui avait déjà soixante-huit ans, ne survécut pas au chagrin d'avoir perdu Géta, ou à la disgrâce qu'il avait si noblement encourue; il se laissa mourir de faim.
A quelle époque Philostrate fréquenta-t-il l'école d'Antipater ? Avant l'année 197, lorsque le sophiste n'était pas encore 8 secrétaire et qu'il avait déjà pour élèves Caracalla et Géta ; en couvrant ses paroles d'applaudissements, nous l'appelions, dit Philostrate, le précepteur des dieux. Philostrate, si nous adoptons pour sa naissance la date de 182, avait donc environ quinze ans à cette époque. Concluons qu'Antipater fut pour lui, comme l'avait été Proclus, un maître de rhétorique ; il dut demander à d'autres maîtres ce supplément d'éducation oratoire, ces raffinements de méthode et de discipline qui faisaient les sophistes.
Il faut en effet distinguer entre l'éloquence ordinaire d'un avocat et l'art consommé du sophiste. Philostrate raconte à cet égard une anecdote caractéristique (13). Apollonius de Tyane rencontra dans ses voyages un jeune homme illettré qui apprenait à des oiseaux à parler comme des hommes et à moduler les sons comme les flûtes. Le philosophe lui représenta qu'il faisait là un sot métier : apprendre aux oiseaux qui ont reçu de la nature un langage harmonieux à parler un mauvais grec, c'est les gâter deux fois ; en outre c'est se ruiner soi-même, car il lui faut nourrir toute une volière qui s'accroît tous les jours. Que ne va-t-il trouver plutôt ces hommes qu'on appelle des maîtres et qui se trouvent dans toutes les villes ; moyennant une somme légère, il n'aura rien à craindre pour le reste de ses biens ; ces maîtres lui apprendront en effet la rhétorique, celle du barreau ; c'est là un art facile. Si notre oiseleur était encore enfant, Apollonius lui conseillerait de fréquenter les philosophes et les sophistes, et de protéger sa maison avec tout l'appareil de la science ; mais parce qu'il a passé l'âge de ces sortes d'études, il doit apprendre à parler pour lui-même ; avec une éducation plus complète, il eût été semblable à un redoutable hoplite ; la rhétorique fera de lui un soldat armé à la légère, un frondeur ; il exterminera les sycophantes comme des chiens. Le jeune homme suivit le conseil, dit Philostrate ; il alla trouver des maîtres, et sous leur 9 direction, il aiguisa sa langue et son esprit. Il est curieux de voir que pour le philosophe de Tyane, comme sans doute pour tous les anciens, le mérite d'un avocat consistait moins à défendre les faibles qu'à se rendre soi-même redoutable aux autres ; mais il n'est pas moins curieux d'apprendre quelle distance un sophiste mettait entre lui et un rhéteur, entre son éloquence et celle d'un avocat.
Quelle était donc cette éloquence des sophistes et par quels exercices pouvait-on espérer l'acquérir ? Chez nous, il n'y a d'acteurs que sur la scène du théâtre, et c'est un poète, un écrivain qui compose le rôle destiné à être joué par l'acteur. Le sophiste est à la fois l'acteur et le poète dans un rôle qui ne fait point partie d'une pièce et qui n'est qu'un long monologue. Le sophiste n'a point de cause réelle à plaider, ni pour lui ni pour le compte d'un client ; il n'a point un auditoire à convaincre ou à persuader ; mais il supposera qu'il est Lysias, qu'il est Démosthène, qu'il est Eschine; que, comme tel, il a une défense à présenter ou une accusation à intenter, ou un avis à proposer ; il essaiera alors de parler, comme aurait fait, dans les circonstances imaginées par lui, un décès orateurs ; son triomphe sera de faire dire aux auditeurs : voilà le style de Lysias ; voilà la période de Démosthène, le geste et la prononciation d'Eschine. Quelquefois, le sophiste, abandonnant l'imitation des orateurs, s'inspirait des poètes illustres ; il prenait le ton de la tragédie ou de la comédie : il déclamait de manière à produire cette illusion qu'on entendait un morceau inédit d'Euripide ou d'Aristophane : émouvoir, provoquer la pitié ou la gaieté, dans une cause fictive, par les seuls artifices du langage et de l'action, tel était l'objet de cet art étrange qui tenait à la fois du théâtre et de la tribune, de l'éloquence et du genre dramatique. Dans d'autres occasions, les sophistes de ce temps prenaient pour modèles les sophistes anciens, Hippias par exemple, ou Gorgias ; alors son discours ressemblait à une prédication morale ou à une thèse philoso- 10 phique ; mais ce qui en faisait surtout le mérite aux yeux des Grecs, ce n'était pas tant le fond du discours, que l'exactitude de l'imitation. Des compliments à l'adresse des villes que les sophistes honoraient de leur présence, des éloges de sophistes célèbres, complétaient la liste des sujets sur lesquels s'exerçait cette éloquence de parade, cet art aussi raffiné que dévoyé. Quelle que fût [d'ailleurs la matière, les qualités que l'auditoire exigeait du sophiste étaient à peu près les mêmes : c'était une douceur de voix telle qu'elle pût charmer même ceux qui n'entendaient pas le grec, comme beaucoup de romains ; c'était une telle variété, une telle richesse d'intonations que rien n'y pût être comparé, si ce n'est le gosier du rossignol, la lyre ou les flûtes (toutes ces comparaisons sont de Philostrate) ; un débit d'une souveraine aisance, comme celui de Polémon qui prononçait en souriant le dernier membre d'une longue période ; c'était une action conforme à toutes les règles des rhéteurs, aux traditions du théâtre, noble, digne, au besoin passionnée et savamment violente ; c'étaient, dans le discours, l'image nette et frappante, les pensées ingénieuses, les traits brillants, les expressions poétiques, enfin tous les raffinements du rythme oratoire.
Comment les Grecs étaient-ils arrivés à donner cette attention puérile à la forme extérieure de l'éloquence, au vêtement de l'idée ? Il serait peut-être trop long de l'expliquer. Il faut toutefois accuser de cette véritable maladie les trop grands loisirs faits par la domination romaine à la Grèce captive, l'absence de vie politique. Là où le goût des lettres a brillé d'un vif éclat, il ne peut s'éteindre brusquement ; forcée d'abandonner le grand jour, la place publique, l'éloquence ou, si l'on veut, la rhétorique se réfugia dans l'école ; puis l'école, fréquentée par l'élite de la société, sortit de ses limites, déborda, avec ses rhéteurs et leurs disciples, sur le monde oisif, charma, s'imposa, et pour soutenir cette admiration, inventa de nouveaux procédés, imagina des perfections inattendues. 11 Qu'on se représente les exercices de nos élèves de rhétorique devenant un genre littéraire, nos écrivains les plus distingués ne connaissant point de plus noble occupation que de faire parler Bossuet ou Mirabeau, dans telle circonstance de leur vie ; nous arriverions bientôt au même point que les sophistes. Ils ne connaissaient que le dialecte attique ; la langue classique que nous étudions aujourd'hui pour comprendre nos grands écrivains, nous voudrions la parler et ne parler qu'elle. Les sophistes mettaient souvent leur gloire à se distinguer les uns des autres et à se confondre avec les orateurs de la belle époque; le pastiche, cher à quelques lettrés, deviendrait aussi notre manie, et nous bornerions notre originalité à ne point ressemblera nos rivaux du jour. D'ailleurs cet effort pour faire revivre l'éloquence d'un temps et d'un homme est resté et restera toujours sans résultat ; l'imitation ne saisit que la forme ; la manière de penser ne se dérobe pas ; si le passé est grand, c'est parce qu'il a osé penser par lui-même, selon le tour d'esprit qui lui était propre et qu'il tenait des circonstances elles-mêmes. Les sophistes nous donnent la preuve éclatante de cette vérité. Philostrate en nomme beaucoup qui rappelaient ou Gorgias, ou Critias,ou Eschine, ou Démosthène ; quel est celui d'entre eux qui ait égalé son modèle ? Nul, assurément : c'est l'âme qui fait l'éloquence, a dit Quintilien ; si l'on peut emprunter jusqu'à un certain point le vocabulaire, les tours, les rythmes d'un orateur, l'âme, qui les a comme produits, reste inaliénable. Il y a mieux : cet appareil étranger paraît étouffer l'âme elle-même chez celui qui s'en empare ; si bien qu'il n'est plus lui ni un autre, qu'il n'est plus rien.
Toutefois ces qualités de la parole, du débit et de l'action, si précieuses quand elles ne se substituent pas à d'autres plus essentielles, mais presque vaines quand elles sont seules, ne s'acquièrent ni dans un cas ni dans l'autre sans de laborieuses études. Il semble même que la difficulté d'atteindre à une forme parfaite doive augmenter avec la pauvreté du fond. Quelle 12 musique vouliez-vous qu'il fit sur un pareil libretto, disons-nous quelquefois du musicien, à propos d'un opéra ? Comment, dirions-nous volontiers, les sophistes pouvaient-ils être éloquents, étaler du moins les qualités extérieures de l'éloquence dans des causes fictives où, s'il s'agissait de la fortune, de la vie, de l'honneur d'un accusé, cet accusé, un personnage illustre d'ailleurs, était mort depuis des siècles ? Nous devons cependant nous garder d'une prévention : de même que les pires des librettos, à les considérer comme des pièces de théâtre, peuvent être riches en situations qui inspirent le musicien, de même le sophiste, qui était lui-même le librettiste et le musicien, choisissait les sujets les plus conformes au genre de talent qu'il avait et qu'il ambitionnait de montrer ; les causes réelles sont souvent basses et vulgaires ; les causes fictives peuvent rouler sur les intérêts les plus nobles ; dans les premières, c'est un point de droit ou un point de fait qu'il faut éclaircir ; de là tout un appareil très compliqué de raisons, de preuves, de conjectures qui sent la chicane ; dans les secondes, si le sujet est bien choisi, la situation sera nette par elle-même ou n'aura besoin que de quelques mots pour être exposée ; de la tâche de l'avocat, l'orateur ne conservera que la partie la plus brillante, la plus pathétique. Grâce à cet artifice l'éloquence, de science et art qu'elle était tout à la fois, n'est plus qu'un art : c'est déchoir pour elle ; mais il est évident que dans de pareilles conditions, alors que l'orateur est délivré des préoccupations qui pèsent sur le talent dans la vie réelle, il lui sera plus facile d'être constamment pur, élégant, harmonieux.
Cette facilité toutefois est relative. Car du jour où l'orateur n'est plus qu'un artiste, nous sentons croître à son égard notre sévérité. Les hommes ne sont jamais plus dédaigneux que dans la comparaison qu'ils font d'un artiste à un autre ; si cette comparaison est facilitée encore par la ressemblance des sujets, on ne peut bientôt plus supporter que ce qui est excel - 13 lent. Le sophiste était donc condamné à se surpasser lui-même et à surpasser ses rivaux. De là ces longues études préparatoires à la profession de sophiste , ces exercices multipliés et sans cesse renouvelés auxquels se livraient non seulement les jeunes gens, mais les hommes les plus renommés par leur talent de parole ; de là ces écoles publiques où le maître donnait à la fois le précepte et l'exemple, déclamant et faisant déclamer : de là ces chaires officielles fondées par les empereurs, l'une à Athènes, l'autre à Rome, non pas seulement pour donner un théâtre et un auditoire de curieux aux sophistes, mais pour leur préparer des successeurs ; de là ces conférences tenues à domicile par les sophistes, et dont la plus célèbre paraît avoir été le Clepsydrion d'Hérode Atticus : réunion ainsi nommée, dit Philostrate (14), de la clepsydre qui mesurait le temps pendant lequel Hérode Atticus débitait, sans s'arrêter, la valeur d'une centaine de vers ; de là enfin ces journées tout entières, sans en excepter les heures de repas (15), consacrées à cette gymnastique de la parole.
Après Proclus, après Antipater, quels furent les maîtres de Philostrate ? S'attacha-t-il de préférence à un sophiste ? Fit-il partie d'un clepsydrion quelconque ? nous ne savons. On a nommé parmi ses maîtres le sophiste Hippodromes ; mais le passage, cité à l'appui de cette assertion, n'a peut-être pas été bien entendu. Philostrate raconte que Proclus de Naucratis avait maltraité dans une déclamation Hippodromes et tous ceux qui enseignaient à Athènes (16) ; « nous nous attendions, ajoute-t-il, à entendre une réplique qui fût comme un écho de l'outrage reçu ; Hippodromes, évitant toute parole indigne de lui, parla d'abord du paon qui, sensible à la louange, déploie sa queue par fierté, et pendant tout son discours fit l'éloge de la modestie. » Cette anecdote prouve que Philostrate entendit, 14 au moins une fois, Hippodromes, non qu'il ait fréquenté assidûment son école ; peut-être le fait qu'il raconte s'est-il passé au moment où Philostrate était l'élève de Proclus. Il était naturel qu'ayant entendu l'attaque il eût voulu écouter la défense ; cette joute d'éloquence entre deux rivaux devait d'ailleurs intéresser vivement des jeunes gens, leurs élèves. Il nous semble peu probable que Philostrate ait été au nombre des familiers d'un sophiste ; son silence sur ce point est un argument ; s'il eut choisi de préférence un sophiste pour maître, s'il eut vécu dans son intimité, l'aurait-il oublié dans sa galerie de sophistes contemporains et, le nommant, n'eût-il pas dit aussi qu'il avait été son élève.
Parmi les sophistes dont Philostrate nous a laissé la biographie, quels furent ceux qu'il entendit ? Nous avons déjà parlé d'Antipater et d'Hippodromes. Peut-être faut-il joindre à ces deux noms celui d'Héraclide (17). Ce sophiste occupa un moment la chaire d'Athènes, mais ne put s'y maintenir; une cabale formée parles disciples d'un sophiste rival, Apollonius de Naucratis, le força à se retirer à Smyrne qui avait pour la rhétorique et la déclamation un goût aussi vif qu'Athènes. Avait-il déjà quitté la Grèce quand Philostrate vint à Athènes pour étudier la sophistique ? On ne saurait sur ce point se prononcer avec certitude. Hippodromos, que Philostrate entendit, et Héraclide étaient, il est vrai, contemporains et compagnons d'âge, mais Hippodromos déclamait encore à Athènes quand Héraclide avait déjà formé des élèves en Ionie ; il y prononça l'éloge d'Héraclide , et dans le jugement que Philostrate porte sur ce sophiste peut-être s'inspire-t-il du discours d'Hipodromos (18). Philostrate entendit sans doute le sophiste Ptlolémée qui parcourait les villes grecques, porté, dit notre auteur, sur le char magnifique de sa renommée, au moins connaissait-il ses écrits; 15 car il défend vivement une de ses déclamations contre la critique.
Il paraît difficile qu'il n'ait point assisté aux leçons d'Apollonius l'Athénien (19). Ce sophiste qui vécut soixante-quinze ans enseignait à Athènes au temps d'Héraclide ; il avait alors « la chaire politique » à laquelle était attaché un traitement d'un talent. Il fut archonte, préteur, hiérophante, et dans plusieurs circonstances, ambassadeur de la ville d'Athènes. Envoyé comme tel auprès de Septime Sévère, l'empereur lui accorda l'exemption des charges qu'il retira au sophiste Héraclide. Philostrate cite de lui quelques passages et parle de son éloquence en homme qui a eu l'occasion de la juger; il. lui reproche un souci trop grand du rythme et de la mesure ; il reconnaît toutefois qu'il savait quelquefois s'affranchir de ce défaut, et qu'alors il ne manquait ni de force ni de gravité.
Damianos (20), sophiste célèbre par sa naissance, par ses richesses, par son talent de parole, attirait vers le même temps une foule déjeunes gens à Éphèse. Philostrate, nous ne savons à quel moment, se rendit dans cette ville, et fut admis jusqu'à trois fois à l'honneur d'entendre le sophiste. «Je vis, dit-il, un homme semblable au cheval de Sophocle (21) ; bien qu'il fût appesanti par l'âge, il apportait dans la discussion une impétuosité toute juvénile. » D'après Philostrate, son éloquence tenait trop du plaidoyer dans la déclamation et trop de la déclamation dans le plaidoyer. Il était l'élève d'Aristide et d'Adrien, dont l'un avait professé à Éphèse, l'autre à Smyrne, et c'est de lui que Philostrate tenait tous les détails qu'il nous a laissés sur ces deux sophistes.
D'autres sophistes, également mentionnés par Philostrate, paraissent avoir été plutôt ses contemporains que ses maîtres ; c'est Hermocrate, qui fut le gendre d'Antipater, un des maî- 16 très de Philostrate, et qui mourut à vingt-cinq ou vingt-huit ans (22). Philostrate fait de lui cet éloge; nul ne l'aurait surpassé, s'il avait vécu; c'est Philiscus (23), qui conserva pendant sept ans la chaire d'Athènes, grâce à la protection de Julia Domna; c'est un Philostrate lemnien, élève d'Hippodromes et ami de notre Philostrate, qui avait vingt-quatre ans en 215, la quatrième année du règne de Caracalla et par conséquent était de dix ans plus jeune que l'auteur des Vies des Sophistes; c'est Héliodore (24), que Philostrate entendit plaider en Gaule dans sa propre cause, puis déclamer dans une cause fictive devant Caracalla, que l'empereur nomma avocat du fisc, qui fut relégué dans une île, après la mort de ce prince, accusé de meurtre, puis absous, et passa à Rome une vieillesse ni méprisée ni honorée ; c'est Élien (25) qui après la mort d'Elagabale composa un discours contre l'Efféminé, et à qui Philostrate de Lemnos disait : « pour mériter l'admiration, il eût fallu accuser le prince de son vivant ; » c'est Aspasius de Ravenne (26), le secrétaire d'Alexandre Sévère, le professeur en titre de la Sophistique à Rome, le détenteur obstiné de cette chaire qu'il ne voulait céder, dit Philostrate, à aucun sophiste plus jeune ; c'est enfin Apsinès de Gadara (27), qui fut l'ami de Philostrate, et qui, selon Suidas, florissait sous le règne de Maximin.
Philostrate, suivant le témoignage de Suidas, enseigna d'abord à Athènes, puis à Rome sous Septime Sévère. A la mort de cet empereur, il devait avoir vingt-neuf ans (28). L'enseignement de Philostrate à Athènes dut avoir un certain éclat ; 17 car Hiéroclès et Eusèbe (29) ne connaissent notre sophiste que sous le nom de Philostrate l'Athénien, comme s'il eût mérité d'être désigné non par le lieu de sa naissance, mais par celui qui avait vu son talent éclore et se développer. C'est sans doute aussi cette gloire précoce qui le signala à l'attention de Septime Sévère ou plutôt de Julia Domna. Il entra en effet dans cette espèce d'Académie que l'impératrice avait formée, qu'elle consultait, qu'elle emmenait dans ses voyages. Dans ce cercle de beaux esprits, il n'y avait pas que des sophistes et les sophistes eux-mêmes semblent s'y être convertis quelquefois à des études plus sérieuses. Julia Domna aimait la philosophie ; elle avait une vive curiosité pour les croyances religieuses des différents peuples ; son héros était le fameux Apollonius de Tyane qui avait été à la fois un sage, un dévot et un faiseur de miracles. Elle chargea Philostrate de raconter la vie du thaumaturge ; pour un sophiste, il semble qu'il ne pouvait y avoir de tâche plus agréable. Apollonius haranguait les villes, donnait des conseils aux peuples, aux rois, aux particuliers : quelle admirable occasion pour composer des discours remplis d'ingénieuses pensées, écrits dans le style attique le plus pur ! Apollonius avait parcouru l'Égypte, la Perse ; c'était le lieu de reprendre ce parallèle si fréquent chez les auteurs anciens, mais toujours lu, paraît-il, avec un nouveau plaisir, entre la civilisation grecque et les mœurs des peuples barbares. Apollonius avait pénétré jusque dans l'Inde : or l'Inde était alors un pays inconnu où la Grèce, toujours éprise de merveilleux, plaçait des hommes étranges et le théâtre de faits extraordinaires. Apollonius était un érudit : que de maximes, que d'allusions aux poètes de la Grèce, que de citations il était permis de lui mettre dans la bouche, en un pareil ouvrage ! Apollonius enfin avait interprété les cérémonies de la religion, les attributs des divinités, les pieuses coutumes ; or cette exégèse était aussi du domaine des sophistes ; elle était de plus dans le 18 goût des contemporains et dans celui de Julia Domna. Les anciens, sentant que toutes leurs traditions étaient menacées par l'avènement d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle philosophie, semblent s'être divisés en deux camps : les uns qui comme Lucien hâtent l'œuvre de destruction ; les autres qui, comme Philostrate, cherchent à régénérer les croyances par des explications nouvelles. C'était là, il faut l'avouer, une ample et belle matière offerte à un talent de sophiste. Un des sujets que les sophistes choisissent le plus volontiers quand ils écrivent, c'est le récit d'un banquet entre sophistes : chacun des convives, en effet, apporte son écot d'histoires, d'anecdotes; toute la science de l'époque peut être ainsi passée en revue ; l'écrit devient une petite encyclopédie où les plus petits détails de l'érudition ont leur place, comme les plus grandes questions de morale et de philosophie. La vie d'Apollonius présentait à l'écrivain les mêmes facilités de discourir un peu sur tout, de plus elle avait l'avantage de permettre une unité moins factice. Julia Domna, en chargeant Philostrate de cette biographie, lui avait remis sur Apollonius les mémoires d'un certain Damis qui avait accompagné le philosophe dans ses voyages en Asie. Ces mémoires qui étaient restés inconnus jusque là, elle les tenait elle-même d'un parent de Damis. Philostrate parle en outre d'un livre d'un certain Maxime d'Égée qui contenait le récit du séjour d'Apollonius dans cette dernière ville. De plus, il existait, à cette époque, un testament attribué à Apollonius. En6n un auteur du nom de Mœragènes avait écrit quatre livres sur le thaumaturge ; mais Philostrate critique cet ouvrage, comme incomplet (30). On a contesté l'existence de ce Damis (31) et de ces mémoires qui auraient servi à Philostrate, sous prétexte que le récit du sophiste est rempli de fables, de contradictions, d'inexactitudes historiques et géographiques. Cet argument ne nous paraît pas concluant : d'abord Damis, compagnon d'un homme illustre 19 qui semble avoir fait plus d'une fois un métier de charlatan, a bien pu, lui aussi, ajouter ses propres imaginations aux faits dont il avait été témoin ; puis ces mémoires, remis à Julia Domna par un parent de Damis, étaient peut-être bien une œuvre de seconde main, composée non par Damis, mais d'après ses récits ; on pense bien que Philostrate, n'a pas eu recours, pour constater l'authenticité des manuscrits, aux règles d'une véritable critique. Enfin, pourquoi Philostrate, s'il inventait Damis, ne dirait-il pas qu'il a trouvé ses manuscrits, comme il le dit du livre de Maxime d'Égée, au lieu de prétendre qu'il les tient de Julia Domna? Remarquons qu'à cette époque un auteur n'était point obligé de fournir ses preuves ; l'antiquité n'a point demandé sans doute à voir le manuscrit de Maxime d'Égée ; elle n'aurait pas demandé davantage à voir celui de Damis. Nous ne prétendons pas d'ailleurs que, pour avoir existé, les mémoires de Damis aient dû être le récit fidèle d'un témoin oculaire : le mensonge grandit sans doute en passant de bouche en bouche ; mais il peut aussi bien sortir de la première bouche que de la seconde.
Commencée peut-être en 214, la Vie d'Apollonius n'était pas achevée en 217 à la mort de Julia Domna (32) Quand fut-elle publiée? aucun détail dans l'ouvrage ne nous permet de fixer cette date même par conjecture.
Philostrate dut jouir de la plus grande faveur sous les règnes
de Septime Sévère et de Caracalla. Il suivit ce dernier prince
en Gaule (33), moins peut-être comme le compagnon du prince
que parce qu'il faisait partie de la cour de Julia Domna. Il
assista à la plaidoirie qu'Héliodore prononça pour lui-même
devant Caracalla, et joua, dans cette entrevue, le rôle d'un
courtisan attentif à épier la volonté du maître, mais trop
prompt quelquefois à deviner ses intentions. Caracalla en effet
20 eut à peine entendu Héliodore qu'il s'écria,
en se levant de son
siège: « Voilà un homme tel que je n'en ai jamais vu ; j'ai découvert
la gloire de mon temps. » En même temps il levait les bras
et rejetait le pan de sa chlamyde sur son épaule. Croyant à de
l'ironie, les courtisans et Philostrate lui-même (c'est Philostrate
qui nous
l'apprend) éclatèrent de rire, mais l'admiration de l'empereur était sincère
; il fit entrer dans l'ordre équestre
Héliodore et ses enfants; il voulut l'entendre déclamer, lui
donna le sujet de sa déclamation, l'écouta avec bienveillance et
tourna un visage irrité contre ceux qui ne paraissaient pas goûter
son éloquence et qui ne devaient pas être nombreux. Plus tard
il le nomma avocat du fisc. Compromis par tant d'honneurs,
Héliodore, après la mort de Caracalla, fut déporté dans une île ;
il en revint pour répondre à une accusation de meurtre, prouva
son innocence et put alors passer à Rome sa vieillesse. Quel fut
le sort de notre Philostrate, après la mort de Julia Domna et de
Caracalla? Fut-il atteint par la proscription qui frappa dans
Héliodore un ami du prince? s'exila-t-il de lui-même? saisit-il
cette occasion favorable pour voyager en Grèce et en Asie, et
recueillir les documents nécessaires à sa Vie d'Apollonius et à
son histoire des Sophistes? A toutes ces questions nous ne pouvons
répondre que par la phrase trop sèche de Suidas : « il
enseigna la sophistique à Rome sous Sévère et cela jusqu'au
règne de Philippe. » Suidas ne parle point d'une interruption
dans cet enseignement ; mais son texte n'est pas de nature à
écarter toute supposition de ce genre.
Quoi qu'il en soit, Philostrate, à une époque ou à une autre, pendant ou après le règne de Caracalla, visita la ville d'Antioche (34). Là, dans le temple de Daphné, temple charmant, solitaire, situé près d'un ruisseau qui ne fait pas entendre le moindre murmure el qui par cela même est favorable aux doctes entretiens, il eut avec Antoine Gordien, le père de l'empereur Gordien Ier, une conversation sur les sophistes. Là peut-être 21 lui vint l'idée de composer les Vies des Sophistes qu'il dédia en 229 (ou 230) à ce même Gordien, alors proconsul d'Afrique (35).
Cet écrit est fort intéressant et mériterait, à plus d'un titre, d'être traduit en français. La sophistique, il est vrai, n'a pas notre sympathie que nous réservons, avec raison, pour une littérature plus saine et plus virile; toutefois il ne faut pas oublier que si c'est une maladie, cette maladie a duré plusieurs siècles, qu'elle a eu sur les mœurs une influence profonde; qu'elle s'est immiscée dans tous les genres littéraires ; que les représentants de cette littérature sont, à beaucoup d'égards, des grammairiens, des érudits, des historiens, des philosophes ; que dans ces sciences qu'ils cultivent comme accessoires, ils ont souvent un mérite supérieur à celui qu'ils recherchent et dont ils se vantent, comme sophistes ; qu'enfin leurs prétentions, leur vanité, leurs rivalités, ont enrichi l'histoire littéraire d'une foule d'anecdotes propres à peindre l'homme dans certaines conditions particulières qui se sont rencontrées une fois et ne se reverront peut-être plus; la critique est mal venue à dédaigner un temps ou un autre ; elle n'a jamais plus utile et meilleure besogne à faire que lorsque le bien et le mal, le mauvais et le bon, se mêlent, se confondent et produisent un genre bizarre, hétéroclite, brillante erreur de l'esprit humain en quête de la nouveauté et du succès.
Nous sommes portés aujourd'hui à confondre tous les sophistes dans une même réprobation. Il y a pourtant entre eux de notables différences; et ce sont ces différences que Philostrate, en connaisseur émérite, a voulu marquer avec précision. Par cette étude sur les sophistes, il nous permet de le juger lui-même comme sophiste et comme homme de goût, si l'on veut bien nous accorder qu'il puisse être question de bon et de mauvais goût, même à propos d'un genre faux.
22 Les termes dont Philostrate se sert pour juger les sophistes nous étonnent quelquefois. Ainsi il louera Gorgias et Antiphon (36) d'avoir fleuri leur langage d'expressions poétiques; il trouve avec Nicagoras que la tragédie est la mère des sophistes, et avec Hippodromos qu'Homère en est le père (37) ; il admire Nicélès de Smyrne (38) pour avoir déclamé comme plaidaient les avocats et plaidé comme déclamaient les sophistes ; pour avoir eu dans le style quelque chose de bachique et s'être élevé au ton du dithyrambe. Le sophiste Scopelianus (39), quand il faisait parler, quand il jouait, pour mieux dire, Darius et Xerxès, se livrait à des gestes désordonnés, au point qu'un des disciples de Polémon le comparait à ces prêtres de Cybèle qui s'agitaient en frappant leur tambour : « Je joue du tambour, répondait le sophiste, mais c'est sur le bouclier d'Ajax. » Philostrate non seulement admire cette réponse, mais il trouve qu'aucun sophiste n'a égalé Scopelianus dans les sujets médiques de déclamation. D'autres éloges nous surprennent, non pas qu'ils paraissent donnés comme les précédents à de brillants défauts, mais parce qu'il semble que de tous les orateurs ce sont les sophistes qui ont dû le moins les mériter. Par exemple, Philostrate vante la gravité de plusieurs sophistes (40) et se sert du même mot que Pline le Jeune emploie pour caractériser l'éloquence de Tacite (41). Nous avons peine à croire que la gravité d'un Polémon ou d'un Critias ressemblât à la gravité romaine, surtout à celle du plus austère des historiens. Ce que Philostrate désigne ainsi, c'est sans doute le ton solennel que les sophistes savaient prendre, quand ils faisaient parler un Démosthène ou un Phocion ; c'était une gravité de circonstance, une gravité d'acteur pénétré de son rôle. Comme 23 tout sentiment joué, celui-ci dépassait bien un peu la mesure quelquefois ; car suivant Philostrate, qui pourtant veut par ces mots louer Polémon, la gravité de ce sophiste était celle d'une prêtresse sur son trépied.
Si dans ces jugements Philostrate semble admirer ce qu'il faudrait blâmer, ailleurs il loue de véritables qualités et critique de véritables défauts. Nous lui savons gré, par exemple, de condamner l'excès du purisme : raffiner dans l'atticisme, dit-il quelque part, c'est être barbare (42). Nous ne lui reprocherons pas d'aimer les pensées inattendues (43), s'il entend par là, comme il y a lieu de le croire, l'originalité de l'esprit et de l'imagination. 11 est de l'avis de Platon et du nôtre quand il se moque des orateurs qui, comme Polus, recherchent dans leurs phrases de puériles consonances, une symétrie et des oppositions factices; il a raison quand il s'élève contre la diction cadencée d'un Favorinus, contre les savantes modulations d'un Varus, contre les rythmes poétiques d'un Apollonius (44). Est-ce bien un sophiste qui parle, est-ce bien un sophiste dont nous entendons l'éloge, quand il est dit que la douceur de Dionysios n'avait rien d'excessif ni d'affadissant ; que dans les déclamations d'Hérode Atticus, il y avait un art qui s'insinuait plutôt qu'il ne s'imposait; que ses discours étaient comme une eau limpide courant sur des parcelles d'or ? Une des grandes vanités des sophistes, c'est l'improvisation. Ils se faisaient gloire, comme on sait, de parler sans préparation ou après une courte méditation qui avait lieu le plus souvent en public, sur un sujet que les auditeurs leur proposaient. Que pensait Philostrate de ce genre d'éloquence? Il approuve Aristide qui, invité à déclamer sur-le-champ par l'empereur Marc-Aurèle, promit de le faire le lendemain, en ajoutant : « Nous sommes de ceux qui préparent les discours avec soin, non de ceux qui les 24 vomissent » (45); mais il ne peut s'empêcher d'admirer à cet égard et Eschine qui le premier, dit-il, inventa cette manière de parler qu'il appelle toute divine, probablement parce que la méditation trahit la faiblesse de l'humanité, et Scopelianus qui ne réfléchissait que le temps nécessaire pour monter à sa chaire, et Polémon qui à cette question d'Hérode Atticus : « quand pourrons-nous t'entendre? » répondit : « aujourd'hui, à l'instant même », et Hérode Atticus qui mettait la réputation d'improvisateur au-dessus des titres de consul et de fils de consul (46). Enfin il prétend qu'Aristide lui-même, malgré son dédain apparent pour cette sorte d'éloquence, s'enfermait dans sa chambre pour se livrer à des exercices d'improvisation. Philostrate en effet, bien que sévère quelquefois à l'endroit des sophistes qui outrent les défauts d'une éloquence artificielle, aime cette éloquence elle-même. Les hommes de son temps, depuis les empereurs les plus graves comme Marc-Aurèle jusqu'aux monstres les plus illettrés, comme Caracalla, depuis les Grecs, aux oreilles avides de beau langage, jusqu'aux Romains peu familiers avec le grec (47), étaient de son avis : c'est là son excuse. Cependant les sophistes avaient aussi leurs adversaires, et parmi ces derniers il faut compter un certain Plutarque (48), « le plus audacieux de tous les Grecs», qui semble avoir fait partie, lui aussi, de l'Académie de Julia Domna. Quelle parole irrévérencieuse ce Plutarque avait-il laissé échapper contre les sophistes? Nous ne savons ; toujours est-il que Philostrate, invoquant l'autorité au secours de sa doctrine littéraire, crut devoir aviser Julia Domna de ce manque de goût. La lettre de Philostrate à l'impératrice est curieuse; ou ne se douterait pas du témoignage qu'il invoque en faveur des sophistes; c'est celui de Platon, leur ennemi. En effet, dit-il, Platon les imitait; Platon, reprochait à Gorgias, 25 n'était point inférieur à Gorgias; puisqu'il parle souvent comme Hippias et Protagoras, il est leur émule, non leur ennemi. Philostrate oublie que Platon n'a emprunté le langage des sophistes que pour en montrer la vanité et l'impuissance, que pour l'opposer au langage de la véritable et sincère philosophie. Le plus hardi des Grecs, en cette occasion, ce n'est point Plutarque, c'est Philostrate qui dénature ainsi la pensée de Platon ; ou plutôt il parle comme les hommes infatués d'eux-mêmes ou de leur art qui prennent pour des éloges l'épigramme déguisée et la raillerie discrète.
Un sophiste, comme nous l'avons vu, était à la fois un historien, un moraliste, un orateur, un critique; bien variés aussi étaient les talents de Philostrate. Suivant Suidas, il avait composé des mélétai ou déclamations que nous n'avons plus, mais dont le discours d'Apollonius de Tyane devant Domitien peut nous donner une idée (49), des dissertations ou des controverses dans lesquelles il traitait des questions de ce genre : « s'il paraît difficile de se connaître soi-même, il est plus difficile encore, à mon sens, que le sage reste toujours semblable à lui-même; et il ne peut amener au bien ceux qui ont une mauvaise nature qu'à la condition de ne pas changer lui-même » (50) ; deux ouvrages entièrement perdus et dont le caractère même ne nous est pas connu, l'un intitulé Les Chèvres ou Sur la flûte (51), l'autre La Place publique (52) ; deux écrits, l'un Sur la Gymnastique, retrouvé depuis peu, l'autre Sur Néron que Suidas attribue au premier Philostrate et que des indices à peu près sûrs ont permis de rendre au fils ; des Lettres amoureuses, le plus faible de tous ces ouvrages, le plus maniéré, le plus vide, le plus marqué de l'empreinte de la sophistique ; les Héroïques, espèce de dialogue entre un vigneron et un 26 Phénicien où Philostrate semble avoir voulu fixer, sans doute dans une intention morale, l'image des héros de la guerre de Troie, non telle qu'elle se dégage des poèmes homériques, mais telle que l'auraient faite la poésie et les traditions postérieures à Homère ; où Ulysse cède à Palamède, le père des sophistes, sa réputation de sagesse et d'habileté; enfin les Images ou descriptions des tableaux que le sophiste prétend avoir vus dans une galerie de Naples.
Nous donnons une traduction de ce dernier ouvrage qui, par son rapport avec l'art et la mythologie antique, par la grâce piquante de certains détails, la justesse ou même le caractère paradoxal de certaines observations, mérite, croyons-nous, d'intéresser le public lettré. Toutefois nous invitons le lecteur à ne pas oublier qu'il a sous les yeux, non un compte rendu de salon, semblable à ceux qu'il peut lire aujourd'hui, mais des descriptions que les habitudes de l'art antique, le sentiment propre aux anciens dans leur critique d'art, enfin l'intervention de la sophistique rendent très fort étrangères à notre goût. Dans le commentaire qui accompagne chaque tableau, nous avons essayé de suppléer aux lacunes, de dissiper les obscurités que présentent les analyses de Philostrate; nous nous sommes efforcé, en nous aidant des monuments figurés qui sont parvenus jusqu'à nous, d'expliquer et de compléter l'auteur, de manière à offrir à l'imagination un tableau d'une netteté parfaite et d'une exactitude vraisemblable en toutes ses parties. Le lecteur jugera si nous avons réussi ; mais, avant d'entreprendre cette tâche, nous croyons devoir répondre à une question que la critique s'est souvent posée et qu'elle a tranchée de diverses façons. Philostrate a-t-il décrit de véritables tableaux, ou bien nous promène-t-il à travers une galerie imaginaire qu'il aurait peuplée de ses rêves? Différentes méthodes ont été suivies pour résoudre le problème: tantôt on s'est demandé si les limites qui doivent exister entre la poésie et la peinture sont suffisamment observées dans 27 ces peintures (53); tantôt on a comparé les descriptions de Philostrate avec les monuments figurés, et de l'absence ou de la présence de tel détail, souvent peu important, on a cru pouvoir conclure pour ou contre l'authenticité des tableaux (54) ; tantôt on a fait observer que les Images ont avec la littérature contemporaine beaucoup de traits communs, et celle ressemblance a paru suspecte (55). Nous croyons devoir adopter une méthode plus large : Philostrate prétend décrire de véritables peintures; en quoi ces peinτures ressemblent-elles aux peintures anciennes, telles que nous les connaissons par les textes et les monuments; en quoi en diffèrent-elles, et ces différences, si elles existent, s'expliquent-elles aisémenτ par le progrès ou la décadence de l'art, par les changements naturels du goût et les influences de tout genre qui les amènent. Philostrate ne se borne pas toujours à décrire; il loue, il observe, il juge ; en quoi sa critique se distingue-t-elle de la critique d'art chez les anciens? Enfin, avanτ tout, il est un sophiste ; quelles étaient les préoccupations des sophistes, et dans quelle mesure peuvent-elles expliquer certaines singularités, certaines audaces ou même les inexactitudes évidentes de ses descriptions ? Après cet examen, nous serons peut-être assez éclairé pour nous prononcer sur l'authenticité des tableaux ; peut-être aussi trouverons-nous que la question n'a pas toute l'importance qu'on lui suppose et qu'on lui a donnée ; et qu'au point de vue de l'histoire de l'art, les descriptions de Philostrate, qu'elles aient été faites d'imagination ou d'après des peintures réelles, peuvent être considérées comme de précieux documents.
Les tableaux décrits par Philostrate appartiennent aux différents genres cultivés par les anciens. Les uns sont mythologi- 28 ques, et représentent soit les aventures d'un dieu, soit les exploits d'un héros : ici Poséidon poursuit Amymone ; là Héraclès étouffe Antée. Les autres empruntent leur sujet à l'histoire, c'est Panthée mourante, c'est Rhodogune rendant grâce aux dieux de la victoire. Les tableaux de ce genre proprement dit sont peu nombreux ; toutefois certaines compositions plus importantes, certains sujets mythologiques rentrent dans cette catégorie, les uns par la manière dont ils sont traités, les autres par tel détail : ainsi dans le Bosphore qui est un paysage ou pour mieux dire une vue de toute une contrée, des jeunes gens poussent leur barque sous les fenêtres d'une femme. Les animaux ne sont pas représentés seuls ni pour eux-mêmes; mais ils ne sont point exclus pour cela de ces peintures; tantôt ils jouent un rôle auprès des hommes, comme dans les Fables où les animaux entourent Ésope ; tantôt ils animent la contrée que le peintre a représentée. Les paysages ne manquent pas non plus : là, c'est un marais, là une chasse, ailleurs des îles ou désertes et arides, ou peuplées et boisées. Philostrate nous décrit aussi deux tableaux de nature morte. Rien de plus naturel que cette variété; rien de plus conforme jusqu'ici à l'histoire de la peinture antique ; rien de plus analogue aux grandes divisions qu'offre la peinture dans les villes de Campanie.
On a comparé aux différentes sortes de poésie les manières diverses dont les anciens ont conçu les mythes divins ou héroïques (56). Tantôt en effet le peintre semble avoir pour objet de nous rappeler ce qu'il y a de plus extraordinaire ou de plus mystérieux dans la vie des dieux et des héros : elle s'élève alors au plus haut style; ses personnages sont d'une 29 espèce supérieure à l'humanité; les événements ont une grande importance historique ou religieuse ; l'analogie avec le poème épique est frappante. Cette conception de la fable et de l'histoire ne se rencontre guère que dans les œuvres des plus anciens peintres; les tableaux de Polygnote en sont les exemples les plus connus. Parmi les peintures des villes campaniennes, quelques-unes rappellent, mais de loin seulement, un semblable style; ce sont, par exemple, des combats d'Amazones et de Centaures ; ce sont les monochromes d'Herculanum qui représentent Thésée combattant contre les Centaures, un guerrier sur un char; ce sont les peintures consacrées aux exploits d'Héraclès. Tantôt, au contraire, le sujet semble avoir été choisi et traité par le poète, de manière à exciter plus particulièrement la compassion ou la terreur, à éveiller dans notre esprit l'idée d'un conflit entre deux passions contraires, soit dans le même personnage, soit entre personnages différents; c'est Médée méditant la mort de ses enfants ; c'est Oreste en présence d'Iphigénie ; c'est Admète et Alceste, apprenant la réponse de l'oracle. On a remarqué que la plupart de ces scènes, empruntées à la tragédie ou composées dans le même esprit que le drame littéraire, ont pour fond, dans les peintures campaniennes, une décoration architecturale, soit qu'il y ait eu de la part du peintre une intention d'imiter les décors mêmes de la scène tragique, soit que le sens esthétique des Grecs se soit plu à opposer le calme des lignes monumentales à la violence des passions représentées. Quelquefois cependant la scène est placée en plein air et le paysage prend plus ou moins d'extension; c'est, par exemple, Phèdre et Hippolyte, dans un tableau d'Herculanum conçu d'ailleurs dans un style plus sentimental que dramatique ; c'est le châtiment de Dircé au milieu des bois. Tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, le sentiment dont s'est inspiré l'artiste est tout voisin de celui qui règne dans les Idylles ; le héros ou le dieu nous est montré dans une 30 action qui n'a aucun rapport avec le développement de la légende ou du mythe ; aucun rapport non plus avec une situation dramatique; la scène représentée offre un caractère anecdotique, et le sentiment qu'elle éveille chez le spectateur rentre dans l'ordre des affections tendres de l'âme ; ce sera, par exemple, Narcisse contemplant son image et dépérissant d'amour à cette vue ; ce sera Polyphème cherchant à séduire Galatée par les sons de la syrinx, Marsyas enseignant Olympos, Persée et Andromède, appuyés l'un sur l'autre et considérant dans un ruisseau qui coule à leurs pieds l'image de la tête de Méduse ; ce seront encore des jeunes gens amoureux, les yeux fixés sur un nid d'amours. Dans ces sortes de compositions le paysage joue un grand rôle; il est en harmonie avec le sentiment général du tableau ; et le rapport étroit qui l'unit à la scène est souvent marqué par la personnification des objets naturels, par des êtres allégoriques qui représentent des rivages ou des rochers. Un élément voluptueux ou humoristique se mêle souvent dans ces sortes de compositions à la sentimentalité : les jeunes gens ont un air efféminé ; les vêtements sont transparents, ou sont disposés de manière à faire valoir habilement les nus; les satyres mettent la main sur la poitrine des bacchantes ou écartent pendant leur sommeil le voile qui les couvre ; Apollon poursuit Daphné, qui n'est plus, comme dans le mythe primitif, une rustique chasseresse, mais une belle jeune fille, entièrement nue ou vêtue d'un voile flottant ; Apollon ne fait plus paître les bœufs d'Admète pour gagner sa vie sur la terre d'exil, mais bien parce qu'il est amoureux d'Admète, dont il cherche à se faire aimer, en jouant devant lui de la cithare ; ailleurs, Jupiter est sur le point de lancer la foudre quand Éros attire son attention sur une femme et désarme ainsi le dieu plus enclin encore à l'amour que ferme et terrible dans sa colère ; ailleurs les amours jouent avec la massue d'Héraclès endormi, ou Héraclès, la quenouille d'Omphale entre les mains, file docilement la laine.
31 Nous retrouvons la plupart de ces caractères dans la galerie de Naples, décrite par Philostrate. Au style épique, par exemple, pouvait appartenir ce tableau du Scamandre qui représentait Héphaistos poussant la flamme contre le fleuve et celui-ci cherchant à fléchir le dieu par ses supplications : remarquons en effet que d'après la description de Philostrate le paysage devait être conçu avec simplicité et largeur : « Le feu couvre la plaine comme un torrent débordé; il rampe et s'étale sur les rives du fleuve où l'on ne voit déjà plus aucune végétation. » En outre aucun trait d'importance médiocre ne vient affaiblir l'effet général. « Héphaistos ne boite pas, dit Philostrate ; c'est à cause de la vitesse de sa course, ajoute-t-il. » Mais s'il avait boité, l'œil se serait attaché sur ce défaut physique; la colère du dieu en aurait paru moins terrible. Si l'exécution répondait à la conception, le tableau d'Amphiaraos semble avoir dû faire sur l'esprit du spectateur une impression profonde et d'un ordre élevé : « L'attelage est blanc; les roues du char semblent se mouvoir avec rapidité ; les chevaux soufflent à pleins naseaux, ils humectent la terre de leur écume Amphiaraos est couvert de toutes ses armes; il ne lui manque que le casque, sa tête étant consacrée à Apollon ; il a le regard d'un homme divin, d'un prophète. Le tableau d'Ajax ou des Gyres est du même genre. « Le héros parcourt des yeux la mer sans apercevoir la terre ni un vaisseau ; il ne s'effraie même pas à la vue de Poséidon qui s'approche et semble encore se raidir contre la divinité ; ses bras ont conservé toute leur force; il porte fièrement la tête comme autrefois en face d'Hector et des Troyens. » La scène est en harmonie par sa simplicité et sa grandeur avec l'action représentée; d'un côté se dresse la crête d'un rocher qui sert de refuge et comme de piédestal au héros ; de l'autre, sur une mer soulevée, le navire d'Ajax est consumé par les flammes. Dans cette catégorie il faut placer le tableau qui représentait Apollon aux prises avec Phorbas : « Les yeux d'Apollon lancent 32 des éclairs, un sourire menaçant erre sur ses lèvres; Phorbas, renversé sur le sol et baigné dans son sang, conserve un aspect farouche ; la foudre tombe sur le chêne aux branches duquel sont suspendus des crânes et des dépouilles sanglantes. » Quelques tableaux ont pour sujet les exploits d'Héraclès, et par cela même semblent faire partie d'un cycle héroïque; si l'on excepte le tableau d''Héraclès au milieu des Pygmées, celui de Théodamas, celui des Funérailles d'Abdère, sur lesquels nous reviendrons, les autres ont bien un caractère en rapport avec la plus haute idée que l'on puisse se faire d'Héraclès et de ses travaux : par exemple, dans l'un d'eux, en regard d'Atlas dont les bras tremblent, dont le corps affaissé sur lui-même ruisselle de sueur, voici Héraclès qui, la massue jetée à terre, étend ses mains comme pour réclamer le fardeau du ciel, marquant ainsi un désir impatient d'éprouver la force de ses épaules. Combien cette manière de concevoir le mythe est-elle plus héroïque que la légende d'après laquelle Héraclès, ayant pris un moment la place d'Atlas, feignit, pour remettre le fardeau au Titan peu empressé de le reprendre, d'aller chercher un coussin pour ses épaules fatiguées ! Dans la Lutte d'Antée et d'Héraclès, nous avons le spectacle de la force prodigieuse mise au service de la justice. Héraclès est bien le héros des vieux âges, le redresseur des torts et le vengeur des opprimés.
Dans tous ces tableaux, ce qui domine, c'est la grandeur de l'action ; dans d'autres l'action sera plus particulièrement émouvante. Ainsi, par exemple, Menœcée; le fils de Créon, condamné par l'oracle à mourir pour sauver sa patrie, se perce de son épée ; il est jeune, il a toutes les grâces et toute la beauté de son âge, il est plein de vie, dit Philostrate, et cependant il meurt résolument, avec un visage calme et souriant. L'héroïsme dans ce tableau ne frappe pas seulement l'imagination ; il touche encore le cœur. Ailleurs, sur le Cithéron, Panthée est déchiré par sa mère et ses tantes qui le prennent pour un lion, et afin de bien marquer le caractère 33 pathétique du sujet, le peintre avait représenté, au pied de la montagne, Agave revenue de son délire et plongée dans une morne tristesse, à l'aspect des restes ensanglantés de son malheureux fils. Le tableau d'Hippolyte réunit tous les détails les plus propres à nous apitoyer sur le sort du héros; ses membres sont déchirés ou broyés; ses cheveux sont souillés; sa poitrine respire encore comme si la vie ne l'abandonnait qu'avec peine, et son regard semble errer sur ses blessures; il conserve dans la mort une certaine fleur de grâce et de beauté. Le sentiment général est bien saisi par Philostrate qui ajoute aces traits : « La peinture gémit sur toi, elle aussi; elle est comme une espèce de lamentation poétique, de plainte funèbre composée en ton honneur; les hauteurs escarpées sur lesquelles tu chassais en compagnie d'Artémis nous apparaissent sous les traits de femmes qui se déchirent les joues ; ces jeunes gens représentent les prés purs de toute profanation, comme tu les nommais; par compassion pour toi, leurs fleurs se flétrissent ; tes nourrices, les nymphes de ces sources, soulèvent au-dessus de l'eau leur poitrine ruisselante et s'arrachent les cheveux. » Les tableaux de Cassandre, d'Antigone, d'Evadné' rentrent dans la même classe. Après avoir décrit les convives égorgés, Agamemnon étendu mort sur le sol, Philostrate ajoute : « Mais c'est Cassandre qui nous inspire la pitié la plus vive. Clytemnestre, la fureur dans les yeux, les cheveux en désordre, le bras raidi, lient la hache suspendue sur sa victime; celle-ci, dans un transport de tendresse et d'enthousiasme, veut s'élancer vers Agamemnon ; elle jette loin d'elle ses bandelettes et l'enveloppe, pour ainsi dire, des insignes de son art ; mais elle lève les yeux vers la hache suspendue sur elle et pousse un cri si lamentable que le héros qui l'entend emploie ce qui lui reste de vie à la pleurer; il se souviendra en effet de cette scène dans les enfers et la racontera à Ulysse au milieu des âmes rassemblées. » Antigone à genoux devant son frère, émue au milieu de tous ces cadavres 34 épars sur le champ de bataille et qu'éclairé la lumière douteuse de la lune, retenant son souffle pour ne pas réveiller l'attention des gardiens, nous fait songer à tous les malheurs qui ont frappé la maison des Labdacides et aux dangers qu'elle court elle-même, elle, la plus généreuse et la plus vaillante de cette maison. Évadné a revêtu ses plus beaux ornements pour se jeter sur le bûcher de son mari; ses regards, dit Philostrate, ne sollicitent point la pitié; mais ils l'excitent d'autant plus sûrement qu'elle semble heureuse et contente de son sacrifice. Un groupe très considérable est formé par les tableaux qui introduisent dans le mythe la sentimentalité, l'attrait sensuel ou la gaieté piquante de l'anecdote. Nous citerons, par exemple, le tableau de Poséidon et Amymone, où le flot s'arrondit en forme de voûte, pour recevoir, comme dans une chambre nuptiale, le dieu qui paraît ému d'une violente passion et la jeune fille qui, dans son effroi, laisse échapper de sa main sa cruche d'or; le tableau d'Ariadne, où Dionysos, sans thyrse, sans couronne ni nébride, contemple amoureusement la jeune femme endormie et vêtue d'une draperie qui laisse voir la poitrine à découvert ; celui où les Satyres, réunis autour d'Olympos qui dort, manifestent par l'expression de leur visage, par leurs gestes et leur attitude, l'amour dont ils sont épris pour le disciple de Marsyas : celui où Olympos, dans un lieu désert, joue de la flûte pour les rochers et les ruisseaux, peut-être pour son image qui se reflète dans l'eau, certainement pour lui-même et pour son propre plaisir ; le tableau de Narcisse semblable ou peu s'en faut à toutes les descriptions et à toutes les œuvres consacrées à ce mythe ; le tableau où Apollon qui vient de tuer Hyacinthe, « jeune Lacédémonien aux jambes bien droites, aux bras déjà robustes, aux formes élégantes, » demeure immobile et comme frappé de stupeur, détourne les yeux et les tient fixés sur la terre; celui où Poséidon, amenant à Pélops le char sur lequel il doit remporter la victoire, touche et presse tendrement la main du jeune homme, dont la chevelure 35 s'échappe en ondes dorées d'une mitre phrygienne et retombe avec grâce sur ses épaules. Crithéis, la beauté ionienne, « aux doigts effilés, au regard aimable et naïf, » aux seins qui soulèvent une draperie transparente, Crithéis amoureuse du Mêlés représenté sur un lit de safran, de lotus et d'hyacinthe, avec toutes les grâces tendres de l'adolescence, c'est encore là une œuvre du même genre; il faut en dire autant de la peinture qui nous montre Polyphème chantant Galatée, et Galatée traînée sur les flots par quatre dauphins au milieu d'un cortège de Néréides. Les sujets de nature à provoquer le rire n'ont pas été oubliés : voici Hermès qui dérobe les flèches d'Apollon déjà courroucé pour un premier vol, celui de ses génisses; voici Héraclès qui fait rôtir le bœuf de Théodamas et sourit malignement aux imprécations que le laboureur profère contre lui ; voici Héraclès à qui les Pygmées livrent un assaut en règle, et voici le dieu qui, se redressant, emporte dans sa peau de lion ses trop faibles ennemis. Dans un certain nombre de tableaux qu'on peut revendiquer pour ce groupe à cause de leur caractère anecdotique, ce qui frappe, c'est la prédominance de l'élément merveilleux; aux accents de la lyre d'Amphion, les pierres s'ébranlent et s'appareillent pour construire les murs de Thèbes; les cygnes pleurant Phaëton étendent leurs ailes qui frémissent mélodieusement au souffle du Zéphyre, sympathique à leur douleur et docile à leur désir ; les Héliades à demi transformées en peupliers répandent des larmes d'or que l'Éridan doit transformer en ambre ; pendant que les Bacchantes célèbrent les orgies sur le Cithéron, le vin s'échappe à flots des rochers entr'ouverls; le lait ruisselle sur la terre; le miel coule goutte à goutte des arbres et des thyrses; Dionysos, s'élançant du sein de sa mère, est reçu dans une grotte merveilleuse, faite tout à la fois de flamme et de verdure. Au moment de la métamorphose des Tyrrhéniens en dauphins, le navire de Dionysos, dont la poupe disparaît sous les cymbales, dont la proue 36 offre l'image d'une panthère dorée, déploie une voile de pourpre ornée de figures sur laquelle courent la vigne et le lierre : « c'est là une merveille, dit Philostrate, mais rien n'est plus merveilleux que la source devin qui jaillit delà cavité du navire et pour ainsi dire de la sentine. » Le tableau de Midas représentait un satyre endormi, ce qui n'a rien de surprenant pour l'imagination, mais rappelait la légende singulière d'après laquelle le roi Midas aurait enivré le satyre, en mêlant du vin au ruisseau où il venait boire. Ailleurs un fleuve de vin traverse l'île d'Andros ; des abeilles se posent sur les lèvres de Pindare enfant; Glaukos, l'antique pêcheur d'Anthédon métamorphosé en dieu marin, sort des flots et se montre aux yeux des Argonautes effrayés d'un tel prodige; dans une île consacrée à Dionysos, les vignes sont tout à la fois chargées de grappes mûres, de grappes qui commencent à mûrir et de grappes qui ne sont qu'en fleur.
Quelques-uns des tableaux décrits par Philostrate ont un caractère mixte. Tel est, par exemple, celui qui représentait Pélops et Hippodamie. « C'est ici, dit Philostrate une scène de surprise et de terreur; en effet, autour du char brisé d'Oenomaos et du vieux roi étendu sans vie sut le sol se pressent les Arcadiens ; pendant ce temps, Pélops et Hippodamie, debout sur leur char, ne songent qu'à leur amour ; peu s'en faut, dit l'auteur grec, que l'ardeur mutuelle qui les dompte ne les jette dans les bras l'un de l'autre. » De là deux impressions différentes, l'une d'effroi et de compassion, l'autre de joie et de bonheur qui d'ailleurs se renforcent mutuellement par le contraste. Dans le tableau de Persée, le héros qui vient de combattre le monstre est épuisé de fatigue, son attitude témoigne du prix que lui a coûté sa victoire ; sa chlamyde est encore parsemée de gouttelettes de sang : voilà le poème épique ; il contemple Andromède, et celle-ci attache sur son libérateur un regard animé déjà par un sourire : voilà le roman et l'idylle. Dans les Funérailles d'Abdère, nous n'avons 37 pas seulement devant les yeux un héros qui vient d'accomplir un exploit mémorable : Héraclès pleure Abdère qu'il aimait ; la pitié se joint ici à l'admiration. Ailleurs, de légères disparates ou une allégorie trop spirituelle viennent amoindrir l'effet de compositions qui auraient, par elles-mêmes, une signification des plus bautes. On peut citer, par exemple, le tableau qui représentait la naissance d'Athéna; les dieux et les déesses, dit Philostrate, paraissent frappés de stupeur; Jupiter contemple sa fille avec fierté : ces circonstances n'ont rien que de conforme au sens élevé et religieux du mythe ; mais Philostrate ajoute : Héphaistos a l'air de se demander avec inquiétude comment il gagnera les bonnes grâces de la déesse ; Jupiter respire avec plaisir comme font ceux qui au prix d'un pénible travail ont obtenu un grand résultat. Si Philostrate a bien interprété les expressions, on peut dire que l'artiste n'avait point été à la hauteur du sujet qu'il avait choisi. De même le tableau de l'Oracle de Dodone offrait une composition simple et grave ; des prêtres, des prêtresses , des députés de Thèbes entouraient l'arbre fatidique ; mais l'artiste trop ingénieux avait cru devoir rappeler par une statue en bronze de la nymphe Écho portant la main sur sa bouche qu'en ce lieu il y avait des bassins de bronze qui se communiquaient leurs vibrations et ne cessaient de retentir que lorsque la main avait touché l'un d'entre eux.
Si nous comparons maintenant, pour les sujets, les tableaux
décrits par Philostrate à la peinture campanienne, nous serons
frappés d'une ressemblance et de plusieurs différences.
La ressemblance consiste surtout dans le caractère sentimental,
voluptueux même, souvent anecdotique de quelques tableaux.
Les différences principales sont d'un côté le nombre plus
considérable, toute proportion gardée, des sujets épiques
ou tragiques, et, d'un autre côté, l'extension plus grande donnée
à l'élément merveilleux. Ces différences, on le sent assez,
n'ont rien de contraire aux tendances de l'art en général, et
38 en particulier à l'esprit de l'art grec.
Toutefois on peut se demander
pourquoi il y a lieu de constater, à une époque de
décadence, un retour vers les sujets les plus nobles et les plus
pathétiques, qui, à ne considérer que la peinture campanienne,
paraissent avoir été presque abandonnés au premier siècle de
notre ère. D'abord ce retour est peut-être plus apparent que
réel ; l'art que nous admirons dans les maisons de Pompéi et
d'Herculanum est surtout décoratif; il l'est lorsqu'il couvre
tout un mur de peintures qui semblent le supprimer et agrandir
l'espace ; lorsque, séparant ses sujets par des pilastres, il conserve
cependant un lien entre eux ; lorsqu'il suspend aux
colonnes, aux frontons, aux cimaises de la décoration architecturale
de petits tableaux qui représentent des mers, des
paysages, des natures mortes ; il l'est dans l'emploi de ces
figures isolées qui se penchent sur des balustrades, ou se balancent
au sommet d'une tige, ou apparaissent comme suspendues
au milieu des airs; il l'est enfin même lorsque au milieu
d'un mur peint d'une seule couleur il entoure d'un cadre une
composition qui veut être prise pour un tableau mobile et
qui est souvent en effet la copie d'un tableau de cette sorte.
Tel n'était point l'art dont Philostrate nous décrit les œuvres :
la galerie de Naples est une pinacothèque, un musée, non
une habitation que la peinture s'est efforcée d'égayer ; les murs
n'y sont pas peints à la fresque, mais les tableaux sont incrustés
dans des murs revêtus de marbre ; peut-être même s'y
trouvait-il des tableaux sur marbre, comme ceux qui ont été
découverts à Herculanum et à Pompéi, et dont deux surtout représentent
des scènes d'un haut intérêt, le combat de Thésée
contre les Centaures et le châtiment de Niobé. En outre,
presque tous les motifs de la peinture campanienne étant empruntés
à la peinture d'une autre époque, celle d'Alexandre et
de ses successeurs, les artistes avaient dû les modifier de façon
à les faire rentrer dans le système de la décoration générale ;
dans la galerie de Naples, un maître intelligent avait
39 réuni les œuvres d'un grand nombre de peintres
qui sans
doute avaient conservé leur génie propre et leur originalité. A
quelle époque appartenaient-ils ? on ne le sait ; mais, en les
supposant contemporains de Philostrate, il n'y a pas lieu de s'étonner
qu'ils aient choisi des sujets émouvants ou sérieux ; la peinture antique
n'y avait pas sans doute tout à fait renoncé pour avoir décoré de ses plus
gracieuses fantaisies les maisons campaniennes. D'un autre côté, bien qu'on
ne puisse guère citer, à cette époque, un nom illustre de poète, bien que la
seule littérature, du moins la plus répandue, paraisse avoir été celle que
représentent les sophistes, les grands poètes de la Grèce étaient encore
étudiés dans les écoles, sans doute aussi dans les ateliers d'artistes, et
les sophistes eux-mêmes les savaient par cœur, comme le prouvent, non
seulement leurs citations nombreuses, mais leur style demi-poétique, nourri
des expressions d'Homère, d'Euripide et de Pindare. Quant à l'élément
merveilleux, il est comme la marque distinclive de celte époque singulière
entre toutes ; dans aucun temps, la foi aux miracles et aux prodiges n'a été
plus répandue ; s'il y avait des sceptiques, comme Lucien, il y avait encore
plus d'imposteurs comme Alexandre d'Abonotichos, de voyageurs courant le monde non pour observer, mais pour recueillir des traditions
légendaires, de gens crédules même parmi les lettrés et les philosophes. La
Vie d Apollonius de Tyane n'est qu'un recueil de fables, entremêlé
d'ailleurs de fort belles pages de philosophie religieuse et morale ; on y
rencontre précisément une légende analogue au sujet d'un des tableaux
décrits par Philostrate ; dans la galerie de Naples, le satyre qu'interrogé
Midas était représenté endormi auprès de la source mêlée de vin où il
s'était enivré ; Philostrate nous raconte dans
la vie d'Apollonius que le philosophe avait employé le même artifice que le
roi phrygien
pour délivrer les femmes d'une contrée des obsessions d'un satyre effronté.
Les (57). fleuves de lait et de vin sont un ornement
habituel des fables
milésiennes et des voyages imaginaires : « A peine avons-nous
fait quelques pas, dit Lucien, que nous rencontrons un fleuve
qui roulait une sorte de vin semblable à celui de Chio ; le courant
était large, profond et navigable en plusieurs endroits
L'idée m'étant venue de savoir d'où partait ce fleuve, j'en remonte
le courant et je ne trouve aucune source, mais de nombreuses
et grandes vignes pleines de raisin. Du pied de chacune
d'elles coulait goutte à goutte un vin limpide qui servait de
source à la rivière (58). » On voit quel rapport étroit existe entre
cette description et le fleuve de Philostrate, couché sur un
lit de grappes et de pampres. De même nous ne serons plus
étonnés de voir les vignes, dans Philostrate, prendre en même
temps tous les aspects répartis d'ordinaire entre les différentes
saisons, quand nous lisons dans l'Histoire véritable de Lucien
qu'en certain pays du monde les vignes sont fécondes douze
fois l'an et s'y chargent chaque mois de leurs fruits. Dans
Homère, une vague azurée du fleuve Ënipée se dresse comme
une montagne, se courbe et enveloppe Poséidon et Tyro ;
cette espèce de lit nuptial, ce thalamos sous-marin, est devenu
un lieu commun chez les sophistes ; un grammairien, du nom
de Ménander, recommande l'histoire de Poséidon et de Tyro
comme une ressource précieuse pour les faiseurs d'épithalames
dans l'embarras (59) ; dans Himérius, c'est le Céphise qui soulève
ses eaux, et les deux amants sont Pélops et Hippodamie (60).
Sans doute on a pu conclure de ces rapprochements et autres
semblables que les tableaux de la galerie de Naples ont été
conçus par un sophiste, non par un peintre ; mais on aurait
pu en conclure aussi bien, ce semble, que les artistes du
deuxième siècle s'étaient inspirés de la littérature contemporaine,
représentée surtout par les sophistes.
41 Outre ce rapport général avec la poésie, considérée dans ses différentes espèces, les tableaux de Philostrate en offrent un plus particulier. Non seulement, entre l'artiste et le poète, le sujet est commun, mais la peinture semble avoir été composée sous l'influence immédiate de l'œuvre poétique, tant l'une et l'autre se ressemblent jusque dans les moindres détails. Par exemple, le tableau de Cassandre reproduit fidèlement le récit d'Agamemnon au onzième livre de l'Odyssée. « Égisthe m'invite, et au milieu du festin il m'immole comme un bœuf à l'étable.... Pêle-mêle avec les urnes, les tables couvertes de mets, au milieu des flots de sang, nous gisons dans la salle du festin. Alors j'entends les cris affreux de la fille de Priam, de Cassandre, que la perfide Clytemnestre immole auprès de moi (61). » Ailleurs les Bacchantes déchirent Penthée; ce sont bien les Bacchantes et le Penthée d'Euripide. Si les Éthiopiens apportent du lait et du vin à Persée épuisé par sa lutte contre le monstre, si Persée invoque l'Amour et si l'Amour répond à sa prière, ce sont là des circonstances empruntées à Euripide. Le tableau intitulé les Fureurs d'Héraclès est une scène de l'Héraclès furieux. Hippolyte traîné par ses chevaux, Antigone ensevelissant son frère, Évadné se précipitant dans les flammes qui consument le corps de son mari, ce sont encore là trois tableaux que l'artiste paraît avoir exécutés, un Euripide à la main. L'imagination de Pindare semble aussi être souvent venue à l'aide du peintre, dans cette galerie de Naples ; le génie qui dans les Coudées pose un pied, un pied de géant, sur les sources du Nil, l'épaule d'ivoire de Pélops qui brille au milieu de la nuit, ce sont là des motifs dont l'artiste est redevable au poète thébain ; de lui aussi vient la pensée de représenter dans un tableau , divisé en deux parties, le ciel où Athéna s'élance de la tête de Jupiter, et les deux acropoles d'Athènes et de Rhodes, chères toutes deux, mais différemment, à la même déesse.
42 Surpris de cette ressemblance, des commentateurs ont mieux aimé l'attribuer à l'érudition d'un sophiste qu'à celle des peintres. Il y a lieu d'abord, en signalant les ressemblances, de tenir compte des différences, qui sont assez nombreuses et assez importantes ; nous les relevons avec soin dans le commentaire qui accompagne chaque tableau ; qu'il nous suffise d'observer ici, par exemple, que Menœcée, dans le tableau de ce nom, ne se jette pas du haut du rempart, comme dans Euripide, mais se perce lui-même de son épée, près de l'antre du dragon ; que dans le tableau des Bacchantes, Dionysos, contrairement au récit d'Euripide, est présent à la scène où Penthée est déchiré, que les attitudes et les mouvements des Bacchantes ne sont pas les mêmes ; que, dans le tableau d'Héraclès furieux, les enfants ne tombent pas frappés de la même manière que dans Euripide. Ce que nous voudrions faire remarquer, c'est que, à aucune époque, la peinture ancienne n'a dédaigné de consulter les poètes, et que cette tendance, bien loin de s'être affaiblie avec le temps, a dû être plus marquée que jamais au second siècle de notre ère.
Pausanias nous donne sur ce point de précieux renseignements. Cet auteur nous a laissé, comme on sait, des descriptions, tantôt sommaires, plus rarement développées d'un grand nombre d'objets d'art ; presque toujours, quand il se trouve en face d'un détail qui ne lui semble pas emprunté à la tradition ordinaire ou aux poètes les plus connus, il s'ingénie pour découvrir l'autorité de l'artiste. Rien n'est plus curieux à étudier, à ce point de vue, que sa description des peintures de Polygnote, dans la Lesché de Delphes (62). L'une représentait l'embarquement des Grecs après la prise de Troie, l'autre, la descente d'Ulysse aux enfers. Pausanias aperçoit-il près d'Hélénos un guerrier, Mégès, blessé au bras ; un autre, Lyconide, blessé au poignet; il nous apprend que le poète Leschéos, dans sa Ruine de Troie, avait parlé de ces blessures ; et, ajoute- 43 t-il naïvement, je ne crois pas que l'idée de les représenter fût venue à l'esprit de Polygnote, s'il n'avait lu les poèmes de Leschéos. Hélène était groupée avec plusieurs figures parmi lesquelles se remarquaient Aithra, la mère de Thésée, et Eurybate, un héraut d'Agamemnon : encore un épisode emprunté à Leschéos ; suivant le poète, Aithra, qui était devenue l'esclave d'Hélène, se serait enfuie, pendant le sac de la ville, dans le camp des Grecs ; les fils de Thésée, l'ayant reconnue, la réclamèrent auprès d'Agamemnon qui ne voulut pas la remettre enlre leurs mains avant d'avoir obtenu d'Hélène la liberté d'Aithra. Si Clymené, si Aristomaché sont placées parmi les captives, c'est que le peintre s'est rappelé les Nostoi de Stesichore; s'il leur a donné pour compagnes Deinomé, Médusa et Laodicé, c'est qu'il connaissait et la Petite Iliade, et les chants du poète d'Himère et Euphorion de Chalcis, qui d'ailleurs a cru à tort, ajoute Pausanias, que Laodicé, la belle-fille d'Anténor, ait pu être emmenée en servitude par les Grecs. Dans la seconde peinture, la Descente d'Ulysse aux enfers, Charon, déjà vieux, la main sur la rame de sa barque, attendait les ombres des morts : or ce personnage, appelé depuis à une célébrité poétique, n'était alors connu, paraît-il, que par les vers du poète Mynias. Au contraire, le démon Eurynome, qui mange les chairs des morts , n'est mentionné ni par Mynias, ni par Homère ni par Stésichore ; mais Polygnote ne l'a point inventé : ce sont les prêtres de Delphes qui lui ont dit son nom, son aspect hideux, ses fonctions repoussantes. Le groupe d'Ulysse, de Tirésias, d'Anticlée est peint d'après Homère. Thésée et Pirithoos, contrairement à la tradition qui les représentait enchaînés, étaient simplement assis ; mais en cela Polygnote n'avait fait que suivre Panyasis, d'après lequel la pierre s'était attachée au corps des deux héros et les avait retenus prisonniers, sans l'aide de chaînes. Orphée, se penchant sur un tronc d'arbre, tenait la cithare de la main gauche, de l'autre il touchait le feuillage d'un saule ; on peut, dit Pausanias, prendre 44 ce bois sacré (représenté par un saule et un tronc d'arbre) pour celui de Proserpine, dans lequel, suivant Homère, croissent les peupliers et les saules. Tantale subissait le supplice décrit par Homère ; de plus, une pierre comme prête à tomber était suspendue sur sa tète ; ce détail, Polygnote, selon Pausanias, l'avait emprunté an poète Archiloque. Ailleurs (63), Pausanias décrivant les Propylées d'Athènes fait remarquer que l'artiste, en peignant Ulysse et Nausicaa, s'était conformé au texte d'Homère.
Dans l'intervalle qui sépare Polygnote du règne d'Alexandre, beaucoup de peintres illustres demandèrent leurs sujets de tableaux aux grands poètes de la Grèce ; toutefois, comme nous n'avons guère conservé que le titre de leurs tableaux, comme les auteurs anciens qui les citent ont rarement pris la peine de les décrire, nous ne savons pas jusqu'à quel point les artistes, dans la composition et le choix des détails, s'étaient montrés fidèles au récit poétique. Quelques indices nous permettent cependant de croire que l'art, loin de faire consister son originalité à différer d'Homère et d'Euripide, se plaisait à offrir au regard une image à peu près exacte des scènes avec lesquelles une lecture assidue ou les représentations du théâtre avaient familiarisé les Grecs. Si Timante, par exemple, avait voilé le visage d'Agamemnon, assistant au sacrifice de sa fille, ce n'était pas, sans doute, comme l'ont pensé les anciens, par impuissance d'exprimer la douleur paternelle, ni, comme voulait Lessing, pour éviter l'expression déplaisante d'une douleur trop forte, mais uniquement pour reproduire un trait d'Euripide (64). « Ce tableau est de Nicias, dit une épigramme de l'Anthologie. Je représente l'immortelle descente d'Ulysse aux 45 enfers, chef-d'œuvre et monument de tous les âges. Homère ayant pénétré jusque dans les demeures de Pluton, sa description a servi de modèle à l'artiste qui m'a peint (65). »
Sous les successeurs d'Alexandre, le rapport entre la poésie et la peinture semble être devenu encore plus étroit ; les peintures trouvées dans les villes de Campanie et du Latium, et qui, comme on sait, sont des imitations plus ou moins exactes de la peinture alexandrine, nous offrent à cet égard de précieux renseignements. Quand nous voyons, par exemple, sur une peinture de Pompéi, un amour, porté par un dauphin, remettre une lettre à Polyphème, n'avons-nous pas lieu de croire que l'artiste s'est rappelé le passage de Philoxène (66) où le Cyclope charge le dauphin d'être son messager entre lui et Galatée, et aussi ces vers de Théocrite : « Peut-être Galatée, voyant ces preuves d'indifférence, m'enverra-t-elle quelque message (67). » Un autre tableau représente l'aventure d'Hylas; ne le dirait-on point inspiré par Théocrite ? Le paysage, plus riche et plus accidenté qu'il ne l'est d'ordinaire dans la peinture antique, rappelle les vers : « Bientôt l'enfant découvrit une source au fond d'un vallon resserré ; tout autour de lui poussaient en abondance les plantes aquatiques et la chélidoine bleuâtre, et la verte adiante, et le persil à la végétation vigoureuse et le rampant agrostis. » Les Nymphes, qui sur d'autres monuments ne sont que deux, sont ici trois comme dans le poète, Eunicé, Malis et Niché « qui a le printemps dans les yeux. » Héraclès est là tout près, derrière un rocher : n'y-a-l-il pas dans cette circonstance un souvenir des vers : « Trois fois il appelle Hylas par son nom, d'une voix qui ressemblait à un mugissement ; trois fois l'enfant entendit, et, quoiqu'il fût tout près, il paraissait être bien loin (68). » Ici Pâris grave 46 le nom d'Oenoné sur un arbre du mont Ida ; c'est une circonstance qu'Oenoné rappellera à Paris infidèle dans Ovide, qui imitait sans doute un poète de l'époque alexandrine (69). Là Ariadne se réveille en pleurs sur le rivage de Naxos : on croirait voir la tapisserie décrite par Catulle, qui lui-même traduisait sans doute Callimaque ou un autre poète de la même époque. Une peinture découverte à la villa Hadriani représente l'entrevue de Glaukos et de Scylla ; paysage, attitudes, expressions, tout peut être décrit avec ces vers d'Ovide : « Glaukos arrive; il voit Scylla et, dans une muette surprise, il la contemple avec amour.... Scylla, parvenue au sommet d'un immense rocher dont la cime unique est dépouillée d'ombrage, se penche au-dessus des eaux. Elle s'arrête et de cet asile inaccessible, ignorant si elle voit un monstre ou un dieu, elle regarde avec étonnement son étrange couleur, la longue chevelure qui couvre ses épaules et son dos, son corps terminé par la queue flexible d'un poisson. Glaukos s'en aperçoit, et, appuyé sur un rocher voisin, il dit....» Ce trait est le seul que le peintre ait négligé; mais l'altitude du monstre marin qui, plaçant la main droite sur sa poitrine, fait avec la gauche un geste de soumission, répond aux paroles suppliantes, à l'accent de tendresse que le poète lui prête (70). Que manque-t-il à la peinture murale de Pompéi (71), connue sous le nom iï Achille et de Briséis, pour être semblable au récit d'Homère ? Voici les deux envoyés d'Agamemnon ; voici Patrocle qui, sur l'ordre d'Achille, remet aux envoyés Briséis en pleurs ; voici le héros qui accueille sans colère les messagers inquiets et qui, sûr de faire expier son sacrifice à ses ennemis, le consomme avec une tranquillité menaçante. L'Achille à Scyros que nous montre une autre 47 peinture de Pompéi (72) est bien le héros que décrit Ulysse dans Ovide; il porte la main sur un bouclier ; il tient dans l'autre une épée ; il n'a pas encore dépouillé ses vêtements de femme, Ulysse le saisit par le bras « injecique manum (73). » Le sentiment est le même dans. le tableau et les vers du poète : on comprend qu'Achille est comme complice de la violence qui lui est faite ; Ulysse exhorte, mais Achille est déjà convaincu. Europe enlevée par le taureau est une scène souvent reproduite par les artistes sur les mosaïques, sur les vases, dans les peintures murales (74); la plupart des motifs qui entrent isolés ou réunis, dans ces diverses compositions, se retrouvent dans les vers de Moschos (75) : Europe, par exemple, saisira d'une main la corne du taureau, de l'autre, retiendra son vêtement qui flotte comme un voile au-dessus de sa tête. Sans doute il est difficile de dire si c'est le poème qui a précédé le tableau ou le tableau qui a précédé le poème ; si Moschos, par exemple, a fait comme André Chénier qui décrit le même sujet d'après un groupe en bronze, ou si c'est au contraire l'artiste qui s'est inspiré de Moschos ; mais, quelque avis qu'on ait sur ce point, il faut admettre, ce semble, que dans un temps où la peinture et la poésie avaient tant de ressemblances, les emprunts entre artistes et poètes devaient être fréquents. D'eux-mêmes d'ailleurs, les artistes de Pompéi, quand ils ont osé aborder des sujets qui n'avaient point été traités par les peintres alexandrins, ont suivi quelquefois la même méthode ; il est tel tableau, par exemple, dont Virgile a fourni le sujet et les détails (76) : Énée blessé est soigné par le médecin lapis ; il est armé de toutes pièces ; le casque seul lui manque ;
Nudato capite;
il s'appuie sur une lance :
Ingentem nixus in hastam ;
48 Ascagne pleure et sèche ses larmes avec un pan de son pallium ; trois guerriers, représentant l'armée entière, se tiennent à quelque distance :
Magnoe juvenum et mœrentis luli
Concursu, lacrimis immobilis ;
le médecin est à genou ; il approche les pinces de la blessure :
Prensatque lenaci forcipe ferrum.
Vénus, planant au-dessus de la scène, tient dans sa main le dictame. Le peintre n'a changé qu'un léger détail de costume ; dans Virgile, lapis a retroussé sa robe, à la manière de Péon :
Pœonium in morem succinctus amictu;
dans le tableau, il porte une longue tunique. Il est aisé en effet de concevoir que cette imitation de la poésie par l'art, loin de se montrer plus discrète avec le temps, ne devint que plus hardie et plus complète, à mesure que la puissance d'invention faiblissait chez les artistes. Si l'art se copiait lui-même, au premier siècle de notre ère, il serait étrange que les artistes se fussent fait un scrupule de suivre à la lettre les indications des poètes. Ces deux servitudes, ou si l'on aime mieux, ces deux servilités sont naturellement contemporaines ; l'une et l'autre procède de la même cause, la stérilité, l'habitude et presque la manie de marcher sur les traces d'autrui. Ce caractère de l'art est surtout manifeste dans les bas-reliefs de sarcophages dont la plupart, pour l'exécution du moins et, sans doute, en grande partie pour la composition, appartiennent à l'époque gréco-romaine. Un bas-relief de la villa Albani (77) peut servir, pour ainsi dire, de commentaire à l'Alcestis d'Euripide. Alcestis s'est jetée sur le lit où elle doit mourir; ses enfants 49 sont près d'elle, et pleurent, l'un la tête dans ses mains, l'autre les yeux et les mains levés vers le ciel ; ces deux attitudes ne sont point, il est vrai, indiquées par Euripide, qui nous montre les enfants suspendus à la robe de leur mère; mais, dans une autre partie du bas-relief, Admète, soutenant et comme retenant Alcestis qui lui échappe, semble prononcer les vers du poète : « Emmène-moi avec toi, au nom des dieux ! emmène-moi aux enfers. » Ailleurs nous voyons Admèle et Phérès en présence ; c'est la scène d'Euripide dans laquelle Admète reproche à son père de n'avoir pas consenti, lui vieillard, à mourir pour son fils, à la place d'Alcestis. Cette scène, dit Feuerbach (78), ne peut avoir appartenu en propre qu'à Euripide, et comme elle n'a rien en soi, n'étant qu'un simple dialogue, qui pût tenter l'imagination d'un artiste, il faut bien croire qu'il n'a été guidé que par le seul désir de se conformer au texte du poète. Dans un tableau de Pompéi, qui représente le sacrifice d'Iphigénie, la jeune fille est portée sur l'autel comme dans Eschyle par deux serviteurs (79) ; Agamemnon se voile la figure comme dans Euripide et le tableau de Timante ; mais Achille ne se tient pas près de l'autel, avec la corbeille qui renferme le couteau du sacrifice, mais Iphigénie n'est point couronnée ni voilée : ces derniers détails se retrouvent sur un bas-relief de Cléomène à Florence (80), qui nous rend ainsi complètement la scène telle qu'Euripide l'avait conçue. Rien n'y manque, pas même le bois sacré (représenté par un arbre), dans lequel doit s'accomplir le sacrifice sanglant. Les bas-reliefs consacrés à l'histoire d'Iphigénie en Tauride reproduisent, avec de très légers changements, les scènes les plus importantes de la tragédie d'Euripide (81) : Oreste épuisé par un récent accès 50 du délire qui le possède ; Pylade se précipitant à son secours ; Oreste et Pylade entraînés vers le temple de Diane ; Iphigénie tenant la lettre qui doit amener la reconnaissance entre le frère et la sœur ; Iphigénie emportant la statue d'Artémis et se justifiant auprès de Thoas qui semble accueillir ses raisons avec la même crédulité que dans Euripide. Si quelques détails ont été imaginés par les artistes, d'autres sont bien dus au poète : ici Iphigénie tiendra le couteau avec lequel elle doit couper les cheveux des victimes humaines, avant le sacrifice (82); là les jeunes gens seront débarrassés de leurs chaînes, suivant l'ordre que donne Iphigénie dans le poète : « étant maintenant consacrés, qu'ils soient libres de tout lien (83). » Quelques fragments de la tragédie perdue d'Euripide, Protésilas, ont tant de rapport avec un bas-relief du musée du Vatican, qu'on a pu, sans trop d'invraisemblance, retrouver la suite des scènes et reconstituer la pièce, à l'aide de l'œuvre d'art (84). Jason priant sa nouvelle épouse Glaucé, d'apaiser ses ressentiments et de recevoir les présents de Médée, Glaucé enveloppée parles flammes, secouant sa chevelure, portant encore le bandeau qu'elle a vainement essayé d'arracher; Médée délibérant sur la mort de ses enfants qui jouent devant elle avec une balle, Médée s'envolant sur un char attelé de dragons, toutes ces circonstances imaginées par le poète pour rendre plus atroce la vengeance de l'épouse délaissée, sont fidèlement reproduites sur un bas-relief de Mantoue (85). Rien ne saurait être plus conforme à la tragédie d'Hippolyte qu'un bas-relief décrit par Zoëga (86) : la nourrice de Phèdre révèle à Hippolyte le secret de sa maîtresse, et l'une des femmes qui se tient auprès de Phèdre se penche, comme dans Euripide, pour surprendre cet entretien ; plus loin à côté d'Hippolyte, entouré de serviteurs, à cheval et chassant, 51 on aperçoit Artémis, qui « ne le quittait pas, dit Euripide, dans ses courses à travers les vertes campagnes (87). »
Ce qu'on reproche, il est vrai, aux tableaux décrits par Philostrate,
c'est moins d'être une reproduction exacte, quelquefois
minutieuse, de scènes empruntées à des poètes que de méconnaître
à tout instant les limites qui, en bonne esthétique, doivent
séparer la poésie et la peinture. Nous aurons à étudier dans le
commentaire si cette critique est toujours bien fondée. Mais, en
supposant même que les tableaux de Philostrate attestent à cet
égard un manque de goût, serait-ce une raison pour en contester
l'authenticité? On n'a rien fait quand on a prouvé que les
sophistes auraient rendu un très mauvais service à l'art, s'ils
avaient été à la fois sophistes et peintres ; il n'est pas sûr que les
artistes n'aient été à cette époque des sophistes en leur genre et
qu'ils aient mieux compris la véritable grandeur el la véritable
beauté dans les beaux-arts que les sophistes dans l'éloquence et
la poésie. Un des caractères de l'art, aux époques de décadence,
est précisément de mêler les genres, de chercher la nouveauté,
d'unir des beautés d'ordre différent, au risque de les compromettre
par cette alliance toujours piquante, mais quelquefois
peu naturelle, enfin d'être maladroitement éclectique et souvent
mal à propos. Dans les bas-reliefs cités plus haut, on relèverait
plus d'une tendance contraire au véritable esprit de la plastique.
Nous avons déjà parlé de la scène entre Admète et son vieux
père : c'est là un entretien que la poésie peut raconter, mais
que la sculpture ne peut que rappeler, en plaçant l'un devant
l'autre les deux personnages : choisir un tel sujet, c'est dans
l'art trahir son impuissance et se condamner volontairement à
l'infériorité. Dans le bas-relief qui représente la double vengeance
de Médée, rien n'est plus singulier et plus choquant
que les bonds désordonnés de Glaucé, consumée par les flammes ;
rien de plus étrange que ces sillons creusés dans la pierre pour représenter
les flammes elles-mêmes. Cette confusion de
52 principes divers, cet échange périlleux de
procédés entre arts
voisins, mais différents, se montrent déjà d'une façon bien manifeste
dans le bas-relief d'Archélaos de Priène, qui a pour sujet
l'Apothéose d'Homère et qui, comme on sait, appartient à l'école
asiatique de l'art ancien (88). Les trois bandes supérieures du
monument représentent les Muses, qui apparaissent au spectateur
comme des statues complètes et libres: rien de mieux jusqu'ici ;
rien de plus conforme à la théorie du bas-relief ; mais derrière
ces statues, toutes de même taille, au lieu d'un fond idéal, s'élève
une montagne sur laquelle elles sont posées à des hauteurs
diverses. Voilà un élément emprunté à la peinture : si l'artiste
avait été conséquent avec lui-même, il aurait dû pécher davantage
contre la loi de son art, en observant la perspective. Dans
la bande inférieure, les personnages se détachent sur un rideau ;
ils n'ont qu'un demi-relief, au lieu d'avoir comme les Muses un
relief plein ; celte différence est singulière, elle détruit l'unité
d'impression ; l'ouvrage semble composé de deux parties distinctes,
exécutées séparément et réunies mal à propos; on cherche
soit dans la nature du sujet, soit dans le choix de la matière ,
la raison de cette différence, et l'on est surpris de ne pas la
trouver : l'œuvre est à la fois pittoresque et plastique, à la fois de
haut et de bas-relief; elle a quelque chose de singulier et de bâtard.
Un coup d'œil jeté sur les bas-reliefs antiques, conservés
dans nos musées, permet de les répartir en deux classes, ceux qui
sont composés selon les principes du véritable bas-relief et ceux
qui semblent reproduire quelque tableau : sans doute les anciens
n'ont pas comme les modernes cherché à donner au spectateur
du bas-relief l'illusion d'une peinture, en creusant la
pierre et en multipliant le nombre des plans, en variant l'épaisseur
des figures, selon le degré de l'éloignement ; mais sur
beaucoup de bas-reliefs les personnages d'une même scène se
groupent comme en
demi-cercle, de manière à produire l'effet de deux ou trois plans bien
distincts, quoique fort rapprochés; 53 souvent ils se superposent les uns aux autres
ou s'échelonnent,
sans pour cela qu'ils différent de taille. Dans le bas-relief du
Louvre qui représente la mort d'Adonis (89), derrière l'antre
d'où se précipite le sanglier, on aperçoit deux chasseurs; ils
sont sur le plan le plus reculé. Adonis est en face de l'antre,
dont l'ouverture est un peu de côté par rapport au spectateur,
c'est le premier plan ; sur un second, un autre personnage,
un troisième chasseur, se tient entre Adonis et les deux chasseurs
les plus éloignés. Ce n'est pas là sans doute une conformité
absolue aux lois de la perspective ; mais la tendance à s'y
conformer est manifeste. Quand la composition est un peu plus
compliquée, comme dans le bas-relief (90) qui représente Dionysos
découvrant Ariadne dans l'île de Naxos, les personnages
du premier plan, des figures allégoriques, une centauresse,
Ariadne sont à demi couchées ; au-dessus apparaissent les personnages
du thiase : ce sont bien là deux plans distincts. On
pourrait aisément en distinguer trois sur d'autres monuments,
par exemple celui qui nous montre Achille vainqueur de Penthésilée (91) : des morts et des mourants, des chevaux blessés gisent
sur le sol ; Achille enlevant Penthésilée est vu de côté, si bien
qu'il a une jambe sur le plan le plus avancé et que Penthésilée,
soutenue dans ses bras, est légèrement en arrière ; sur cette
même dernière ligne se tiennent des Amazones et des combattants ; derrière,
l'œil aperçoit des têtes de chevaux, des
figures de femmes. Et non seulement il y a plusieurs plans,
mais certaines figures sont moitié dans un plan, moitié dans
l'autre. Si, au lieu de prendre pour exemple les sarcophages,
nous considérons la colonne Trajane ou des monuments postérieurs,
cette disposition du bas-relief à se rapprocher de la
peinture est encore plus frappante. Sans doute, suivant les expressions
de M. Ch. Blanc (92), Apollodore de
Damas, qui éleva la 54 colonne Trajane, «a montré sur le fond de son
relief des édifices
qui ne s'enfoncent point selon les lois rigoureuses de la perspective
mathématique, » mais il est aisé d'y reconnaître une perspective
de convention. D'abord les plans y sont assez nombreux, et
l'on pourrait, comme Michel Anguier, parlant en général des
bas-reliefs antiques, distinguer (93) quatre lignes de dégradation
d'ailleurs fort voisines les unes des autres ; puis, les personnages
n'ont pas tous la même taille. Le sarcophage d'Amendola (94) qui
représente une bataille entre Asiatiques et Gaulois offre une
composition toute pittoresque et un grand nombre de raccourcis
que le bas-relief évite d'ordinaire, faute de pouvoir les rendre
assez heureusement; aussi a-t-on pu, avec une grande vraisemblance, autant à
cause du sujet que pour cette ressemblance avec le style de la peinture,
regarder ce bas-relief comme une imitation d'un tableau exécuté dans l'école
de Pergame. D'un autre côté, la colonne Trajane a emprunté à ce sarcophage
un grand nombre de motifs : ainsi se confondent les limites respectives des
arts, autant par une imitation directe que par une imitation d'œuvres qui
ont elles-mêmes le caractère d'une copie, ou pour mieux dire d'une
transposition. Dans d'autres cas le bas-relief se rapproche du tableau moins
par la disposition des lignes générales de la composition que par une
tendance très manifeste
à exprimer les passions dans toute l'énergie qui est propre à chacune ou
dans la violence de leur conflit entre elles; c'est ainsi par exemple qu'un
sarcophage de Weimar (95), représentant une scène d'Iphigénie en Tauride, n'a
pas de meilleur commentaire qu'une épigramme grecque, dans laquelle le poète nous décrit une peinture de Timomachos : c'est bien la même
Iphigénie : « elle est furieuse ; mais la vue d'Oreste la ramène
55 au doux souvenir de son frère. Dans les yeux
de la prêtresse
en proie au ressentiment et d'une sœur devant un frère, se
confondent la colère et la pitié (96). » Nous aurons lieu de revenir
sur l'étude des bas-reliefs, avec lesquels la peinture de
décadence a dû avoir beaucoup d'analogie ; nous ne voulons pour
le moment que constater la tendance des arts voisins à empiéter
les uns sur les autres, quand ils ont épuisé ou croient avoir
épuisé leurs propres ressources ; quoi d'étonnant dès lors si le
bas-relief imitant la peinture et quelquefois la composition
poétique, la peinture elle-même a demandé à la poésie non
seulement ses sujets, mais encore les détails de la représentation
et toute son ordonnance ?
Un des caractères les plus frappants de l'art antique est sa tendance à tout personnifier. Il a représenté toutes les classes d'êtres allégoriques que l'imagination peut rêver. Le peintre Nicias avait assis Némée (97) sur un lion et lui avait mis une palme à la main, en souvenir des jeux Néméens qu'elle était censée présider ou du moins contempler. Alcibiade, revenant d'Olympie, apporta à Athènes deux tableaux d'Aglaophon, où il était représenté, dans l'un, assis sur les genoux de Némée (98), couronné dans l'autre par Pythias et Olympias. Voilà pour les contrées ; mais la mer et la terre, les montagnes, les fleuves, les parties de contrées sont également personnifiés. Dans un groupe de divinités et de personnages allégoriques, offert par le sophiste Hérode Atticus au sanctuaire de l'isthme de Corinthe, Thalassa, la mer, soutenait Amphitrite, une déesse de la mer (99). Si nous considérons les monuments, peintures ou bas-reliefs, ici le génie de l'Olympe assiste à la chute de Phaéton (100) ; les amours d'Endymion et 56 de Séléné ont pour théâtre le mont Latmos, pour témoin, le génie du mont Latmos (101); ailleurs le génie du mont Ida se soulève sur un bras et s'appuie sur un pedum pour avoir sa part inattendue du spectacle que les trois déesses offrent aux regards du berger Paris (102).
(1) V. Ap., 7, 17, éd. Kaiser, p. 124, 1. 18.
(2) Heroic. ; Op., 740, 3; K., 325, 8.
(3) Vit. soph.,i, 11; K., 219, 14.
(4) Epist., 70 ;K., 363, 12.
(5) Οἱ κριτικοὶ τῶν λόγων, V. S., 11, 1 ; K., 243, 32 et ibid., 12 ; K., 257, 29.
(6) Quint., Inst. or., I, iv.
(7) (1) Lucien, Le Maître de rhétor., 9, traduct. Talbot. — Nous avons cru devoir substituer le nom de Nésiolès à celui de Nestoclès qu'on lit dans cette traduct. Cf. Brunn, Gesch. d. Griech. Kunstler, i, p. 102.
(8) Ph., V. S., 2, 8; K., 251, 8.
(9) Théo, 1, 168, éd. Walz.
(10) V. S., 2,21; K., 262, 26.
(11) )V. S., 2, 24 ; K., 263.
(12) K., 265, 14.
(13) V. A. ,6, 36; K., 126,36
(14) V. S., 2, 10; K., 254, 18; ibid , 2, 13 ; K., 258, 25.
(15) V.S., 2, 10; K., 254, 21.
(16) V.S., 2, 27; K., 269, 17
(17) V. S., 2,26; K., 567, 11.
(18) V. S., 2, 15; K., 269, 11.
(19) V. S., 2,20; K., 261, 31.
(20) V. S., 2, 23 ;K., 264, 3.
(21) Soph., Elect., 25. « Semblable à un coursier généreux dont les années n'ont point ralenti l'ardeur dans les périls et qui dresse encore l'oreille... »
(22) V. S., 2, 23; K., 261,8.
(23) V. S., 2,30; K.,272, 8.
(24) 2, 32 ; K., 273
(25) 2, 31;K.,273.
(26) 2, 33; K.,274.
(27) K., 275, 13.
(28) On ne doit pas s'étonner de voir un sophiste occuper à cet âge une chaire importante : Hermocrate, qui mourut à 25 ou 28 ans, avait déjà fait preuve d'un talent qui le mettait au-dessus de tous les autres sophistes grecs; à 24 ans Caracalla distinguait Philoslrale de Lemnos, l'ami de notre Philostrate.
(29) P. 430, éd. Ol
(30) V. Ap. Préface.
(31) Letronne, Statue de Memnon.
(32) Ce renseignement ne se trouve nulle part ; mais ou a pensé que si Julia Domna eût vécu, Philostrate lui aurait dédié un ouvrage commencé d'après ses ordres. C'est peut-être là une conjecture hasardée.
(33) V. S.. 2, 30; K.,273, 4.
(34) V. S., préf.;K., 201.
(35) Voir sur ce point Keil, p. 25 et suiv. de la préface de l'édit. particul. qu'il a donnée des Vies des Sophistes (1838). — La grande édition de 1846 ne reproduit pas la discussion et les preuves.
(36) V.S. 1, 9 et 15.
(37) V. S. 2, 27 ;K., 271,9.
(38) V. S. I, 19; K., 216, 29.
(39) V. S. 1, 21; K., 221, 23.
(40) V.S. 1, 16 et 25.
(41) Pl. m. II, 2, 17, édit. Keil.
(42) V. S.,1, 16 ;K., 213, 19.
(43).A propos de Gorgias (l, 9), de Critias (i1 16),de Nicétès (1, 19), d'Hérode Atticus, ἔννοια οἷαι μὴ ἑτέρῳ ἐνθυμηθῆναι (2, 1, 34). (
(44) V. S., ad cujusque nomen.
(45) V. S., 2, 9, 4.
(46) V. S., ad cujusque nomen.
(47) V. S., 2, 10, 8.
(48) Ep., 73 (édit. Didot, p. 336).
(49) V. Ap., vii, 7; K., 153, 909.
(50) V. A., vi, 35,traduct. Chassang, p. 278.
(51) Αἶγαι ἢ περὶ αὐλου (Suidas).
(52) Ἀγορά (id.).
(53) Friederichs, Die Philostratischen Bilder, Erlang., 1860.
(54) Welcker, dans l'édit. de Jacobs. Lipsiœ, 1825 et Brunn, Die Philostratischen Gemâlde, Leipz., 1861 (Besond. Abdruck nus dem vierten Supplementbande der Jarbücher fur class. Phil.)
(55) Malz, De Philostratorum in describendis imaginibus fide, Bonn, 1867.
(56) Helbig, Untersuchungen über die campanische Wandmalerd. Nous emprunterons beaucoup à ce livre, si riche en aperçus sur la société grecque, sur la poésie et la peinture hellénique, et tout pénétré de cet esprit de la critique moderne qui s'attache à distinguer entre elles les époques. Dans ses Promenades archéologiques, M. Boissier a résumé cet ouvrage avec sa compétence habituelle et cette vivacité piquante qui ne paraissait pas compatible, avant lui, avec les choses de l'érudition.
(57) V. Ap., VII, 17.
(58) Lucien, Hist. vérit., 1, 7 (traduct. Talbot).
(59) Menander de enc. Rh. Gr.,éd. W., p. 268 (cité par Matz).
(60) Him. Or., i, 11; Or., xvi, 4
(61) Hom.,Od.,ïi, 408-425.
(62) Pausanias, x, 25-31.
(63) 1, 22, 6.
(64) Eurip., Iph. in Aul., v. 1547-1550. Voir le sang de ses enfants, c'était contracter une espèce de souillure; « patrios fœdasti funere vullus, » dit Priam à Néoptolème dans Virgile. Sur une mosaïque d'Ampurias (Arch. Z, 1869, pl. XIV) qui représente le sacrifice d'Iphigénie, Agamemnon se dérobe la vue du sacrifice avec sa main, mais son visage reste à découvert pour le spectateur.
(65) Anth. Gr., il, 2l, 53 (Pal. IX, 792) ; traduct. F. D. (Hachette), 1, 368.
(66) Sch. Théocr. ad XI, 1.
(67) Théocr., VI, 31. Cf. Jahn, Arch. Beitr., p. 417.
(68) Théocr., W.,XIII. Helbig, Wandg., n° 1200; Millin, Gal. myth., 106, 420 ; la peau de lion qui caractérise Héraclès manque dans la planche de Millin
(69) Helb. W., n° 1280; Ovide, ép. V. Helbig, Unters., p. 112 et suiv. donne d'autres exemples.
(70) Voir la peinture dans Mus. Worsleyanum, n, pl. I, et Mon. d. Inst., III, t. LIII, n° 6, avec l'article de Vinet Annali, XV, 189. Cf. Gaedecheus, Glaukos der Meergott, 1860, p. 104. Pour les vers d'Ovide, Metam., XIII, 912, sq.
(71).Helbig, 1309.
(72) Helbig, 1296, 1297.'
(73) Ov., Met., XIII, 170.(
(74) Overbeck, Kunstmyth. Atlas, Taf. VI et VII.
(75) Moscbos, id. Cf. Helbig, Untersuckungen, etc., p. 224 et suiv.
(76) Helbig, 1383. Cf. Virg., Aen., XII, 312, sq.
(77) Vinckelm., Alte Denkm., 86 ; Millin, G. myth. CVIII, 428.
(78) Feuerbach, Vaticamsche Apoll., p. 329.
(79) Helbig, Wg., 1304.
(80) Uhden, Iph. in A. in den Abhandl. der hist. philolog. Cl. der Berl. Akad., 1816, p. 74; Overbeck, Die Bildw., p. 318; Atl., XIV, 7.
(81) Overb.,Die Bildw., 724, sq., n° 71 (sarcoph. Accoramboni),77 (sarcoph. Grimani), 78 (sarcoph. de Berlin), 81 (autre sarcoph. Grimani).
(82) Overb., n° 71; Eur., Iph. Taur., 619sq.
(83) Overb., n° 11; Eur., v., 469.
(84 Feuerb., Der vatic. Apoll., p. 330.
(85) Millin, Gai. myth. , CVIII, 486 ; cf. Feurb., D. v. A., 332.
(86) Zoëga, Bass., 1, 49. Cf. Feuerb., 335.
(87) Eurip.,Hipp., v, 17
(88) Cf. Müller-Wieseler, n, 742. Overb., Gesch. d. Griech. Plastik, IV, p. 263.
(89) Clarac.pl. 116, n° 85.
(90) Clarac .pl. 127, n° 148.
(91) Clarac, pl. 112, n° 245.
(92) Ch. Blanc., Gramm. des arts du dessin, p. 455.
(93) Mémoires inédits de l'Ac. roy. de peint, et sculpt., 1, 465. Regnaudin, qui fit aussi une conférence sur les bas-reliefs antiques, ne reconnaît sur la colonne Trajane ni les dégradations, ni les différences de taille entre les personnages (ibid., p. 473); mais cet artiste paraît n'avoir fait qu'une étude assez superficielle de la colonne Trajane.
(94) Mon. dell' Inst., i, 30, de Helbig, Untersuchungen, p. 54.
(95) Overb., Die Bildw. Taf. 30, n° 2, p. 731 et 735.
(96) Anth. Pal., li, p. 664, 128, trad. F. D (Hachette), II, 153. — Cf. Helbig., Unters., p. 149.
(97) Pline, H. N., 35, 131 (Cf. Brunn., G. d. G. K., H, 194).
(98) Athéné, XII, 634 D. Cf. Plut. Alc., 16, sur le nom du peintre; Cf. Brunn, II, 54.
(99) Pausanias, II, 1, 7.
(100) Fröhner, Catal, du Louvre, n° 425.
(101) Fröhner, Catal. du Louvre, n°426;
(102) Overb., Die Bildw. Taf. XI, n° 12.
(103)