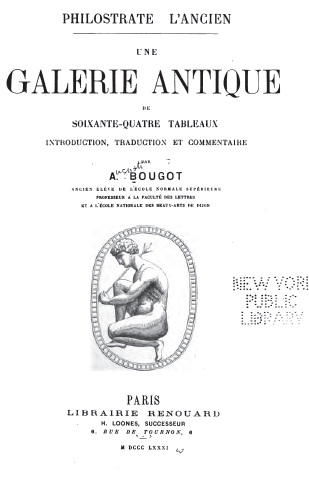
PHILOSTRATE L'ANCIEN
GALERIE ANTIQUE.
INTRODUCTION (page 56-107)
1
INTRODUCTION
Philostrate l'ancien. — La peinture antique et les tableaux de Philostrate.
— La critique
d'art chez les anciens. — L'ecphrasis ou description des œuvres d'art dans
l'antiquité.
56 Dans les fresques esquilines, une inscription, placée à côté ou au-dessus des personnages, prévient toute erreur d'interprétation; cet homme qui, une rame à la main, manœuvre une barque tout près de la côte du pays des Lestrygons, c'est le Rivage (1) ; cette femme qui tient dans sa main gauche une urne et un roseau, qui de sa main droite s'appuie sur la terre, et tournant le dos au spectateur regarde couler un ruisseau, c'est Créné, la source Artakia mentionnée par Homère; deux figures, l'une nonchalamment couchée et regardant paître les troupeaux, l'autre assise, la main appuyée sur une houlette, personnifient les pâturages (2). Ailleurs trois femmes, groupées à souhait, animent discrètement les rivages qu'elles représentent. Les inscriptions manquent presque toujours sur les peintures de Pompéi ; toutefois les êtres allégoriques y sont aisés à reconnaître, quelquefois même à nommer. Ces figures, assises sur un rocher, dans un tableau de Persée et d'Andromède (3), semblent bien être des Aktai ou rivages : à ces trois jeunes gens couronnés de laurier et de primevères, assis sur le gazon, dans la peinture du mariage sacré de Jupiter ou de sa rencontre avec Junon sur le mont Ida (4), quel nom donner, si ce n'est celui de Leimonés, les prairies? Enfin toutes ces figures dont la pré- 57 sence ne semble point nécessitée par le sujet, que l'on voit assises ou couchées sur des hauteurs solitaires, ne sont-ce point des Scopiai, c'est-à-dire les divinités des rochers?
Le rôle de ces divinités locales semble varier. Tantôt elles restent isolées, immobiles, passives; elles ne se dégagent pas entièrement de la nature qu'elles représentent; sous leur figure humaine, elles semblent conserver quelque chose de la matière inerte ; tout au plus témoignent- elles pour les personnages qui sont les acteurs du drame l'intérêt compatible avec la sérénité d'un être supérieur; elles regardent, mais ne paraissent pas vouloir quitter leur poste d'observation ; elles sont attentives, mais ce qu'elles pensent, elles ne le laissent point deviner ni par leur attitude ni par l'expression de leur physionomie. Tantôt, au contraire, ces divinités fictives, si l'on peut dire, participent à la vie de véritables divinités; elles ont un rôle actif; elles laissent percer leurs véritables sentiments ; visibles ou non pour les personnages de la scène, elles se mêlent à eux; comme nous l'avons vu, elles peuvent couronner un vainqueur (5) ; manier un aviron et conduire une barque; elles peuvent, comme les Aktai du quatrième tableau des Leslrygons, se montrer l'une à l'autre la haute mer sur laquelle fuit sans doute le navire d'Ulysse; elles peuvent, comme une Thalassa d'une peinture campanienne, tendre les mains, en signe d'étonnement ou d'épouvanté, au-devant du bélier qui porte Phryxos à travers les flots (6).
On conçoit mal d'ailleurs qu'il en pût être autrement. L'action est la marque la plus certaine de la vie, et la vie est la principale qualité que nous demandons aux créations de l'art. Que l'artiste ait emprunté ses personnages au monde réel ou à la légende, qu'il les ait fait sortir de sa propre imagination, il a le même devoir envers eux, c'est de les animer; le même devoir envers nous, c'est de nous faire croire qu'ils 58 sont vivants. A quoi lui aurait-il servi de personnifier des abstractions, si elles devaient encore paraître des abstractions aux yeux des spectateurs ? Des critiques trop raisonnables (7) ont cru que les divinités locales, nées d'un caprice d'artiste, devaient se souvenir de leur humble origine, se montrer discrètes, réservées, se tenir à leur place, se contenter de remplacer un écriteau : c'est vouloir que, dans les fables, les animaux élevés à la dignité de personnages parlants ne parlent point comme les hommes; c'est méconnaître l'objet de l'art, qui est comme voué à la représentation de l'homme, et qui ne saurait tout à fait oublier ce personnage essentiel, même lorsqu'il parait l'abandonner pour d'autres inférieurs ou plus nobles.
Cette classe d'êtres allégoriques est largement représentée dans les tableaux de Philostrate; tantôt ce sont des dieux intervenant eux-mêmes dans l'action, comme le Scamandre, le Nil, le Mêlés, l'Achéloüs; tantôt ils prennent part au drame, sans en être les acteurs principaux : l'Éridan, dans le tableau de Phaéton, étend le pli de sa robe pour recevoir le fils du Soleil; la Terre embrasée lève les mains au ciel, en signe de désespoir ; l'Alphée dans le tableau d'Hippodamie, sort de ses eaux tourbillonnantes, pour offrir à Pélops, vainqueur d'Oenomaos, une couronne d'olivier ; tantôt, au contraire, comme Olympos dans la Naissance d'Hermès, comme le Pénée et le Titarésios dans la Thessalie, l'Isthme, dans le tableau de Palémon, les Thalattai et Oropé dans celui d'Amphiaraos , ils désignent simplement le lieu de la scène.
Une autre classe d'êtres allégoriques est formée par ceux qui représentent les moments de la durée ou l'état de l'atmosphère : ce sont, par exemple, les Saisons, les Heures, le Jour et la Nuit, les Vents, les Tempêtes. Toutes ces divinités que l'art crée eu se jouant, ils les prend au sérieux; il leur communique la même vie qu'aux dieux mêmes de la 59 mythologie païenne. Les vents qui amoncellent les nuages souffleront avec fureur dans leurs conques, comme feraient des Triions ; le Zéphyre est un beau jeune homme ailé, aussi alerte, aussi souriant qu'Éros. Remarquons aussi que la personnification de la chose n'exclut pas, pour cette classe comme pour la classe précédente, la représentation exacte de la chose signifiée. Sur une peinture de Pompéi, Séléné, la tête entourée d'un nimbe, se laisse glisser à travers les airs jusqu'auprès de son amant endormi ; la déesse, représentée ainsi sous la figure d'une femme, l'est encore une seconde fois sous la forme d'un croissant posé au-dessus de la tête d'Endymion (8).
Il faut ranger dans un autre groupe ces figures qui personnifient les actions de l'homme, ses vertus, ses faiblesses, ses joies, ses chagrins, un état physique comme le sommeil, un art comme la palestra. Les archéologues (9) distinguent ici deux personnifications différentes : tantôt l'être allégorique est la chose elle-même personnifiée ; tantôt il est le génie de cette chose. Ainsi la Méthé qui dans un tableau de Pausias (10) vidait une coupe était l'ivresse elle-même ; au contraire la Méthé d'Olympie qui tendait la coupe à Silène était le génie de l'ivresse (11). Hypnos endormi est le sommeil; tenant une corne, c'est le dieu du sommeil. Nous avons bien de la peine à croire que les artistes anciens aient fait une distinction semblable : tous les personnages mythologiques, quels qu'ils soient, dieux ou abstractions personnifiées, vivent d'une vie complète ; ils sont à la fois actifs et passifs ; Dionysos enivre et s'enivre ; Éros aime, et inspire l'amour. Pourquoi les êtres allégoriques, tels que le sommeil, n'auraient-ils pas subi eux-mêmes l'influence qu'ils exercent sur les autres (12)? Pour- 60 quoi supposer que l'Envie qui est pâle n'est pas l'Envie qui fait pâlir; que la Repentance que l'on représente « vêtue d'une robe noire et déchirée, détournant la tête, versant des larmes. » n'est pas la Repentance qui inspire les regrets ! Toutefois, si l'on tient à cette distinction, il sera aisé de la retrouver dans Philostrate, soit que l'artiste y ait songé, soit qu'il n'en ait pas eu conscience. Par exemple, Palestra qui fait lutter entre eux des génies, qui tient à la main une branche d'olivier pour la donner en prix au vainqueur, est la déesse de la palestre; au contraire, Côrnos qui succombe au sommeil, qui laisse sa torche pencher et comme tomber à terre, n'est pas le dieu infatigable des folles réjouissances, des joyeux banquets; c'est le génie des cômazontes, des gais convives, de la turbulente jeunesse, génie qui finit par se lasser, par s'épuiser lui-même, par s'endormir de fatigue.
De tous les êtres allégoriques, il n'en est point dont l'art ait fait un plus fréquent usage que les Érotés et les Génies ; les Génies personnifient un art, un métier, un usage ; Éros et les Ërotés personnifient l'amour et toutes les formes que prend l'amour. Tantôt ces dieux de petite taille se livrent seuls à leurs joyeux ébats ou à leurs graves occupations comme ces Génies qui, dans les peintures campaniennes, tressent des fleurs ou travaillent le bois, ou lancent l'épieu contre des animaux, ou conduisent des chars, ou font les vendanges, ou s'amusent entre eux, se poussant, courant les uns après les autres, cherchant à s'effrayer mutuellement. Tantôt ils sont groupés avec des dieux ou des hommes : Éros conduira par la main Séléné vers Endymion, et sa présence, nous fera mieux comprendre 61 quelle force attire la déesse du ciel sur la terre ; ailleurs les Érotés, après avoir amené Aphrodite vers Arès, joueront avec l'arme du dieu ; ou, après avoir égaré Héraclès en Lydie, réuniront leurs efforts pour rouler sa massue : ils indiquent alors d'une façon gracieuse l'étendue de leur pouvoir et leur genre d'influence sur l'homme. Tantôt leur signification est plus vague ; leur rôle est moins conforme à leur nature ; on dirait qu'ils dédoublent le personnage principal, qu'ils personnifient son âme, en tant qu'éprise ou digne d'inspirer l'amour; ainsi, dans un tableau de Pompéi (13), Éros dormira près de Ganymède, aimé de Jupiter; dans un autre, placé près d'Adonis, il portera comme lui les épieux du chasseur (14). Les peintures décrites par Philostrate nous présentent aussi les Érotés dans ces rôles divers : ici entourant la Palestra, ils personnifient les différentes positions et figures de la lutte ; là, ils manient la scie et le vilebrequin dans l'atelier de Dédale ; ailleurs, plus émancipés pour ainsi dire, oubliant presque leur origine et leur nature, ils s'amusent entre eux, comme des enfants, dans un verger consacré à Aphrodite; ils voltigent sur les arbres, recueillent des pommes, les entassent dans des corbeilles ; ailleurs Eros, tout en favorisant l'amour, ce qui est tout à fait dans son rôle, compatira aux suites fâcheuses de l'amour qu'il inspire, ce qui semble rentrer moins dans ses attributions : ainsi il brisera l'essieu du char qui porte le père d'Hippodamie pour permettre à celle-ci d'épouser Pélops, mais il le brisera en pleurant.
Il est difficile d'indiquer par quelles phases dut passer l'allégorie
antique avant d'arriver à son entier développement, à
un raffinement extrême. Toutefois la plupart des œuvres que
nous avons citées pour exemple ou les œuvres originales dont
elles ne sont que les copies appartiennent à la période alexandrine. A cette
époque, l'allégorie paraît avoir été aussi en
62 honneur que chez nous au dix-septième et au
dix-huitième
siècle ; et comme il arrive, les beaux-arts n'étaient point seuls à
en faire usage, la littérature se complaisait aussi dans les abstractions
personnifiées. Un des prologues les plus fameux de
Ménandre était récité par le génie Elenchos qui, dit Lucien (15),
aime la vérité et la franchise, et n'est autre que l'esprit de
critique, armé de ses preuves. L'allégorie n'était point absente
des fêtes ; elle y jouait un rôle prépondérant, comme sous
Louis XIV, dans les cérémonies publiques et les divertissements
de toute sorte. Dans le cortège qui sous Ptolémée
Philadelphe traversa les rues d'Alexandrie, l'année était personnifiée
par un homme costumé et masqué tenant une corne
d'abondance ; une période de cinq années, une pentatéris, par
une femme richement vêtue, une couronne dans une main,
une branche de palmier dans l'autre. Antiochus Épiphane
fit entrer dans la pompe dont il donna le spectacle à la ville
d'Antioche, la Nuit, le Jour, le Ciel, l'Aurore et jusqu'à l' Heure de midi (16). L'art qui réunissait dans un même tableau
la Délation, l'Innocence, la Suspicion, l'Envie, la Fourberie,
la Perfidie, la Repentance et la Vérité (17), qui représentait
Kairos, l'occasion, chauve par derrière, les cheveux sur le front,
des ailes aux pieds, un rasoir à la main (18) ; qui, pour rappeler
l'expédition d'Antiochus Ëpiphane contre les brigands du
Tauros, montrait le roi domptant un taureau (19), était sans
doute déjà bien hardi et bien raffiné. Aucun monument n'est
plus riche en personnification que le bas-relief d'Archélaos de
Priène; non seulement l'Iliade et l'Odyssée se blottissent sous
le fauteuil d'Homère, non seulement la Terre (ἡ
οἰκουμένη) et le
Temps se tiennent derrière le poète, mais le Mythe sous les traits d'un
enfant, l'Histoire, la Poésie, la Tragédie, la Co-
63 médie, la Nature, la Vertu, la Mémoire, la
Foi, la Sagesse,
composent le cortège qui vient offrir un sacrifice au poète
divinisé. L'artiste a eu soin d'écrire le nom de ses personnages ;
les commentateurs, auxquels les conjectures ne coûtent
pas, les auraient sans doutes nommés, mais il est douteux
qu'ils eussent rencontré juste, attendu que beaucoup de ces
personnages n'ont aucun caractère ou attribut qui indique avec précision
leur nature ou leur rôle. Dans la peinture campanienne il est souvent plus facile de reconnaître l'emploi de
l'allégorie que de trouver un nom pour les êtres allégoriques ;
toutefois il en est beaucoup dont la signification semble manifeste;
nous avons déjà cité les personnifications des contrées,
des montagnes, des rivages ou des rochers. Les abstractions
sont-elles aussi personnifiées ? Cela est fort probable ; des interprètes
très autorisés ont cru reconnaître ici Techné, l'art,
dans une jeune fille ailée qui montre à Thétis le bouclier fabriqué
par Héphaistos ; là, Mêtanoia ou Répentance, auprès d'Ariadne abandonnée ; ailleurs
Didascalie, l'art de l'acteur, près
d'un comédien (20). Ce genre d'allégorie n'avait rien de surprenant
pour tous les anciens, habitués à rencontrer, sur les
vases peints , les noms et les personnages d'Oistros ou la Fureur (21), d'Apaté
ou la Fourberie (22), de Mania ou la
Folie (23),
de Paidia ou la Gaieté de la jeunesse, d'Eudaimonia ou la
Félicité; d'Eumomia, la Règle; d'Euthymia, la
Confiance ; de Pannychis, l'Emploi joyeux de toute la nuit; de
Pandaisia, l'Allégresse des festins (24). Dans les tableaux de Philostrate l'allégorie
est peut-être plus compliquée, plus subtile et plus envahissante
que dans les œuvres de la peinture campanienne et les bas-reliefs ; mais
cette différence est bien légère et ne 64
saurait justifier des soupçons contre
l'authenticité des peintures ;
l'antiquité n'ayant pas eu, comme nous, sa réaction contre
l'allégorie, les peintres du deuxième siècle durent chercher
de nouvelles combinaisons allégoriques et multiplier les personnifications
pour renchérir sur leurs
devanciers. Une miniature d'un manuscrit de Dioscoride (25), qui date du
commencement
du sixième siècle, nous montre la princesse Juliana
Anicia, nièce de Valentinien III, assise entre les figures de la
Prudence (Φρόνησις;) et de la Magnanimité (Μεγαλοψυχία) ; un génie
qui porte le nom singulier de Désir de la science du constructeur (Πόθος
τῆς σοφίας κτίσου) lui tend un livre, pendant qu'à ses pieds une femme agenouillée et voilée
représente la
Reconnaissance
des arts (Εὐχαριστία τεχνῶν). Sur une autre miniature du
même manuscrit l'Invention (Εὕρεσις;) en tunique dorée et en
manteau rouge offre à Dioscoride la racine de mandragore,
espèce de poupée humaine avec une étoile de cinq feuilles autour
de la tête. Les tableaux de Philostrate, antérieurs à ces
miniatures, postérieurs sans doute aux peintures campaniennes,
nous paraissent bien représenter aussi, par la manière dont
l'allégorie y est traitée, une phase intermédiaire entre les deux
époques auxquelles ces compositions appartiennent. L'allégorie
y est moins compliquée que dans celles-là; elle est moins
discrète que dans celles-ci ; l'exemple de réunir les êtres allégoriques
et les êtres empruntés à la réalité avait été déjà
donné ; la peinture, d'après les descriptions de Philostyate,
avait mis, à le suivre, une complaisance et une hardiesse qui
furent certainement dépassées un peu plus tard (26).
Le costume et les attributs sont deux moyens que l'art an-
65 tique, comme l'art moderne, emploie pour
caractériser ses
personnages, qu'ils appartiennent d'ailleurs au monde réel ou
au monde allégorique. Les archéologues, depuis Winckelmann,
ont fait une étude spéciale et minutieuse de celte langue figurée
qui pour les anciens devait suppléer souvent à l'absence d'une
inscription ou d'une légende explicative. On sait, par exemple,
qu'Ulysse porte un bonnet d'une forme particulière, que Castor
et Pollux se reconnaissent au pilos, qu'Orphée est représenté
sous le costume d'un Thrace, que Némésis a le bras replié pour
indiquer que la coudée est une mesure, et que la mesure en
toutes! une vertu. Mais ces règles ou ces usages ne se sont
point imposés aux artistes avec une force telle qu'ils n'aient
jamais cru devoir s'en écarter. Avant tout, ils semblent avoir
tenu compte des convenances pittoresques de leur sujet, de la
beauté des attitudes, de la clarté de l'ordonnance ; d'après ces
principes, quelquefois même d'après leur caprice, ils ont varié
les attributs et le costume. Dans tel bas-relief, Ulysse assis
sur une pierre, contemplant une ombre, celle de Tirésias qui
sort de terre, est nu-tête (27). Si sur la Cista mystica
de Prœneste (28) Castor a le pilos, son frère Polydeucès ne le porte pas.
Sur le même monument, les critiques reconnaissent un Héraclès
dans une figure que ne distinguent ni la massue ni la
peau de lion traditionnelle. Orphée, dans les peintures de
Polygnote à Delphes, était vêtu en Athénien, non en Thrace.
Entre la Némésis de Rhamnunte et la figure ailée, casquée,
tenant le serpent et la patère sur telle intaille antique (29), il y a
une grande différence de costume et d'attitude. Les attributs
des Muses sont à peu près constants ; cependant dans le bas-relief d'Archélaos, qui représente l'apothéose d'Homère, plusieurs
Muses sont sans attributs, et, pour cette raison même,
66 il n'est pas aisé de les nommer avec sûreté
(30).Calliope, qui tient
ordinairement un coffret ou un rouleau, manquera dans telle
peinture de tout caractère distinctif (31). Clio a quelquefois les
deux flûtes, comme Euterpe. Melpomène au masque joint
quelquefois l'épée. Thalie, accoutumée au masque et au pedum,
n'aura parfois qu'une branche de myrte. Ici les vents ouïes tempêtes
soufflent dans des conques ou de longs instruments garnis
à leur extrémité d'un large pavillon ; (quelquefois aussi ils
se contentent d'enfler les joues, et cette contraction seule des
muscles buccinateurs suffit pour amonceler les nuages et
pousser les navires sur les écueils (32). Que de fois des
Érotés
apparaissent sans ailes sur les mêmes monuments à côté d'Érotés ailés, sans que la science la plus subtile et la plus exercée
puisse donner de cette différence une autre raison que la convenance
pittoresque (33). Persée délivrant Andromède est armé
le plus souvent d'un glaive en forme de faux auquel les mythologues
donnent le nom de harpé ; quelquefois aussi il n'a,
comme un simple héros, que l'épée courte (34). Mais l'art antique
ne se distingue pas seulement par cette facilité à varier
les attributs ; parfois il les accumule. Sur les murs de Pompéi,
que de figures ont en chaque main un objet
caractéristique ! c'est la Fortune avec son gouvernail et sa corne
d'abondance,
c'est la Bonne Déesse avec son flambeau et son épi de blé ! Une Diane
porte dans une main un épieu, dans l'autre un
arc, non que ces armes puissent lui servir en même temps,
67 mais pour montrer sans doute qu'elle les
prenait tour à tour.
Éros est conçu tantôt comme le dieu qui brûle, tantôt comme
le dieu qui perce les cœurs ; ce qui ne l'empêche pas dans
certaines représentations, par exemple sur le vase de Portland,
d'être armé tout à la fois du flambeau et des flèches. Le fameux
Kairos de Lysippe présentait un assemblage curieux d'attributs.
Dans une main, il tenait une balance, symbole de la
justesse de ses appréciations sur le moment favorable ; dans l'autre un trait, symbole de la rapidité de ses décisions ; il
se désignait ainsi comme le dieu qui poursuit un but; mais
sa nuque était dégarnie de cheveux, pour bien montrer qu'une
fois passé, il ne donnait plus de prise à la main tardivement
impatiente de le saisir ; par cette particularité, il s'annonçait
comme l'occasion elle-même, qui de sa nature est fugitive,
non plus comme le génie épiant l'occasion (35). L'art antique
ne reculait même pas quelquefois, du moins à certaines époques,
devant la hardiesse et la singularité de certains symboles :
Milon l'athlète, debout sur un disque, les pieds joints, tenait
une grenade de ses doigts crispés, soit comme prêtre de Jupiter,
suivant l'explication d'Apollonius, soit pour montrer qu'aucun
objet ne pouvait être arraché à l'étreinte de sa main vigoureuse ;
il portait une bandelette, symbole de modestie suivant
les uns, indice, selon le même Apollonius, de sa dignité
sacerdotale (36).
Des caractères analogues se retrouvent dans les tableaux décrits par Philostrate. La tradition a fourni au peintre certains détails de costume, certains attributs; mais il n'a demandé les autres, semble-t-il, qu'à sa fantaisie. Si Poséidon est armé du trident quand il sort des eaux pour châtier l'orgueil d'Ajax, ailleurs, dans le tableau des Iles, il est monté sur une charrue terminée en proue de navire, attribut que l'on chercherait vainement sur les monuments parvenus jusqu'à nous. 68 Dionysos porte ordinairement un thyrse, est couronné de pampres et de lierre ; mais, quand il s'offre aux yeux d'Ariadne, il a dépouillé toutes ces marques accessoires de sa divinité ; le spectateur refusera-t-il de le reconnaître, et ne lui saura-t-il pas plutôt gré, comme le veut Philostrate, de n'avoir compté que sur l'éclat juvénile de sa beauté pour consoler et séduire la jeune femme abandonnée? Les artistes d'Herculanum et de Pompéi donnent à Polyphème une lyre, grossièrement travaillée, comme pour indiquer à la fois et la rusticité du chanteur et le caractère lyrique de ses chants; dans un des tableaux de Philostrate, le pâtre monstrueux tient, au lieu d'une lyre, une syrinx sous son bras ; dirons-nous, pour cela, que toutes les traditions sont violées, et que le peintre ou Philostrate, au lieu de rester fidèle aux habitudes de la peinture, a suivi maladroitement Ovide ou Théocrite? Apollon, qui tient ordinairement l'arc et les flèches, a les poings et les bras armés du ceste, dans un des tableaux ; est-ce là une innovation qui devra nous paraître, par elle-même, et sans tenir compte de la circonstance, invraisemblable et presque barbare? Ailleurs ce n'est point la Victoire qui descend du ciel pour couronner Héraclès; la couronne est déposée sur la tête du vainqueur d'Antée par Hermès. Y a-t-il là une confusion sans exemple d'attributs ou d'attributions? Philostrate ne dit point que les Nymphes des sources et les Fleuves se penchent sur une urne, que Pan est armé du pedum ou bâton de chevrier : en supposant que de son silence il soit permis de conclure à l'absence de ces attributs dans le tableau, est-ce une raison pour tenir son dieu Pan, ses Nymphes et ses Fleuves pour des divinités équivoques et sans aveu? Amphiaraos, sur plusieurs monuments, monte un char à quatre chevaux, n'a pour toute armure qu'un bouclier et un casque, pour tout vêtement qu'une chlamyde; l'Amphiaraos de Philostrate qui, au contraire, est armé de toutes pièces et qui a la tète nue, qui conduit un char à deux chevaux, doit-il nous sembler, à cause de ces différences, une 69 création de sophiste, non de peintre? Que Marsyas jouât de la flûte simple ou de la double flûte ; qu'Olympos eût ou n'eût pas le bonnet phrygien ; que Pélops fût représenté avec ou sans barbe, qu'importait au spectateur antique? S'il se fût trouvé, dans l'antiquité, une école pour essayer d'imposer aux artistes le joug d'une pareille contrainte, croit-on que les artistes s'y seraient assujettis ? et si quelques-uns avaient méconnu à ce point les franchises essentielles de l'art, croit-on qu'elles n'eussent pas été revendiquées par une foule d'autres, et peut-être par les plus considérables d'entre eux? Nous avons vu que l'art antique accumulait les attributs ; ils sont accumulés aussi quelquefois dans les descriptions de Philostrate. Son Cômos a un épieu et une torche : pourquoi l'épieu? pour s'appuyer; pourquoi la torche ? parce qu'il est le dieu des réjouissances nocturnes ; il semble qu'il n'y ait pas besoin d'une explication plus subtile. Amphiaraos a la tête ceinte de lauriers et de bandelettes ; devons-nous reprocher à l'artiste d'avoir ainsi réuni deux signes du don de prophétie? Eros tient dans une main un arc, une torche dans l'autre : est-ce là une faute, et, s'il y a faute, l'art grec n'en a-t-il jamais commis une semblable? Quelques attributs, quelques détails de costume, quelques attitudes distinctives paraissent avoir été inspirés par une assez grande subtilité d'esprit : l'Écho de Dodone porte le doigt à sa bouche, soit pour dire qu'elle est une divinité dont le seul rôle est de parler, soit, comme le veut Philostrate, parce que l'écho de Dodone, produit par la résonance de bassins de cuivre, ne se taisait que lorsque l'on venait à toucher du doigt un de ces bassins ; quelle que soit l'explication qu'on adopte, dira-t-on que le peintre n'a pu penser avec un excès de finesse? Si le Pénée personnifié soutient le Titarésios, son affluent, pour montrer, dit Philostrate, que les eaux de ce dernier, sans se confondre avec les flots du Pénée, roulent sur ceux-ci comme sur un lit véritable, c'est peut-être là une bizarrerie ; mais la bizarrerie n'a pas été toujours étrangère à 70 l'art antique, nous l'avons vu. Et ce fleuve Mêlés, qui, au lieu d'être caractérisé par l'urne des fleuves classiques, se contente, n'étant qu'un ruisseau, d'égratigner la terre du bout de ses doigts et de recueillir dans le creux de sa main le même filet d'eau qui jaillit du sol, dirons-nous qu'il s'annonce avec trop d'esprit, qu'il révèle trop ingénieusement sa pauvreté et son humilité pour être autre chose que la conception d'un rhéteur en quête d'un symbolisme raffiné? Ainsi, dans le choix des attributs, nous ne remarquons pas, entre les descriptions de Philostrate et les habitudes de l'art antique, surtout à son déclin, une différence profonde. Ici encore, comme dans les autres parties de l'art, il faut tenir compte de la loi suivant laquelle ont lieu les changements ; à la simplicité a succédé la variété; à l'unité la fantaisie ; à la clarté lumineuse l'ingénieuse obscurité de l'énigme.
Dans le choix du sujet et surtout du moment, l'art antique témoigne-t-il d'une préférence marquée? Évite-t-il, par exemple, les scènes violentes et pathétiques? Recherche-t-il celles qui précèdent ou suivent ces dernières, de manière à mettre en jeu notre imagination sans l'ébranler trop fortement? On connaît la Médée de Timomaque. Médée ne tuait pas ses enfants ; le poignard à la main, elle les contemplait d'un air farouche, elle laissait voir sur son visage la lutte entre l'ardeur de la vengeance et les sentiments maternels. Cet exemple est-il isolé, ou n'est-il que l'application à l'histoire de Médée d'une règle invariablement suivie par tous les artistes?
On peut répondre avec certitude qu'à cet égard comme à
tant d'autres, l'art antique semble avoir joui d'une liberté entière.
Les archéologues, qui de nos jours recherchent toute
œuvre inspirée aux artistes par un mythe ou par l'histoire d'un
homme, trouvent presque un monument pour chaque phase de
l'épisode. On dirait que le sujet ait été divisé en ses principales
scènes, et que les artistes se soient fait un devoir de les reproduire
toutes, ceux-ci les violentes et les pathétiques, ceux-là
71 les moins émouvantes et les plus tranquilles.
Rien n'égale la
variété de cet art que l'on s'imagine parfois astreint à une
tradition immuable. Si les bas-reliefs, même ceux de la belle
époque, sont, comme on sait, pleins de mouvement et de vie, la
peinture, qui suppose plus de rapidité dans l'exécution, n'a
point dû être de parti pris froide et languissante. Dans le combat
de Marathon, que Polygnote avait peint pour le Pœcile d'Athènes (37), on luttait de part et d'autre avec un égal acharnement ;
ici les Barbares en désordre se jetaient dans un marais ;
là les Grecs massacraient les fuyards sur leurs vaisseaux.
Pausanias nous décrit froidement ce tableau comme il parle de
tout ; sa curiosité d'érudit et de dévot ne s'élève jamais au ton
d'une admiration chaleureuse, mais les détails qu'il donne ne
laissent-il pas deviner qu'il avait sous les yeux une ardente
mêlée, une véritable bataille, non un simulacre de combat ?
Dans la Lesché de Delphes on voyait les Grecs s'embarquant
après le siège de Troie (38) ; la ville venait d'être ravagée ; les
captives étaient réunies sur le rivage ; Hélène s'occupait de sa
toilette. Cependant le peintre avait trouvé moyen, en une semblable
situation, de peindre une scène de meurtre : Néoptolème,
dit Pausanias, ne cessait de massacrer les Troyens. Les anciens
redoutaient-ils au moins de contempler, en peinture,
ces actions impies, ces meurtres horribles, auxquels la fatalité
poussait leurs héros tragiques? Lucien (39), décrivant un tableau
qui représentait la mort d'Égisthe, félicite l'artiste d'avoir
montré Oreste et Pylade, non pas armés contre Clytemnestre
qui a déjà reçu le coup mortel et gît étendue sur le sol, mais
tournant leur fureur contre l'amant adultère : c'est là un éloge
qu'à tort ou à raison les artistes anciens ne paraissent pas
s'être souciés de toujours mériter. Sur un bas-relief du palais
Circi à Rome (40), Oreste a renversé sa mère, il s'apprête à lui
72 enfoncer le glaive dans la poitrine ; sur la
plupart des monuments
antiques (41), Clytemnestre, au moment du meurtre
d'Égisthe, n'est pas encore tuée ; par un excès de courage, qui
la rend en quelque sorte plus odieuse, elle essaye de défendre
son amant ; elle retient l'épée prête à frapper et brandit une
hache sur la tête de son fils. Le titre que Plutarque donne au
tableau de Théon, Oreste meurtrier de sa mère (42), ne semble
laisser aucun doute sur le moment de l'action choisie par l'artiste.
Si Timomaque n'avait point représenté Médée égorgeant
ses enfants, c'était moins sans doute pour ménager la sensibilité
du spectateur que pour ne point émousser, comme le veut une
épigramme grecque, l'effroi par la pitié (43). Des remarques
semblables s'appliqueraient aux peintures d'Herculanum et de
Pompéi, bien que le genre décoratif, auquel elles appartiennent,
ait toujours une tendance à n'être que souriant et gracieux.
Une de ces peintures nous montre Achille à Scyros ; avec
quelle précipitation le héros, excité par la vue des armes, par
le sonde la trompette, par les paroles d'Ulysse, s'élance hors du
palais de Lycomède ! La célèbre mosaïque de Pompéi nous présente
l'image d'une bataille, sinon confuse et furieuse, comme
celles qu'a peintes Salvator Rosa, du moins tumultueuse et sanglante.
Les scènes d'un caractère absolument opposé ne sont
point rares dans l'art antique. Combien de fois s'est-on moqué
chez nous de sujets de tableau comme celui-ci, qui avait
été imposé à un artiste (44) : Catherine de Médicis répondant
au duc de Guise : « Jésus ! mon cousin, que parlez-vous
d'adieux ? Doutez-vous du plaisir que le roi et moi aurions à vous
entendre ? » Si l'art grec n'a point cherché à rendre par
73 des gestes et l'expression une parole aussi
précise, du moins
semble-t-il n'avoir souvent mis les personnages en présence
que pour montrer qu'ils s'entretiennent ensemble. Nous avons
parlé plus haut d'un bas-relief représentant cette scène d'Euripide,
dans laquelle Admète reproche à son vieux père de
laisser mourir Alcestis, quand il aurait pu, en se dévouant lui-même, rendre inutile le dévouement de cette dernière. Que de
fois rencontrons-nous sur les monuments anciens des scènes semblables,
c'est-à-dire, sans action, sans mouvement ! Timomaque, selon Pline (45), avait peint des hommes en manteau,
se disposant à parler ; ces personnages levaient sans doute une
main, geste que la sculpture emploie quelquefois pour caractériser
un orateur. A Pompéi, voici, par exemple, Hélène et
Paris en présence : Hélène, les mains jointes sur sa poitrine,
détourne la tête (46); Paris, appuyé sur un pilier, écoute un
Éros qui apparaît au-dessus de son épaule et lui prend le
menton en souriant. Plusieurs peintures représentent la déclaration
de Paris à Hélène (47); l'expression, l'attitude des personnages,
tout respire le plus grand calme ; sans la présence
d'Éros, se douterait-on qu'il s'agit d'une conversation amoureuse ;
et, malgré la présence d'Éros, s'imagine-t-on bien avoir
sous les yeux les premiers mouvements de cet amour fatal et
violent qui doit mettre aux prises l'Asie et l'Europe ? Ailleurs,
un guerrier debout, la main droite levée comme pour accompagner
son discours du geste, consulte une jeune prêtresse
assise qui tient dans la main gauche une branche de laurier, une
couronne de laurier dans sa main droite (48). Ici, devant
un jeune
homme assis, se tient debout, appuyé sur un bâton, un autre
jeune homme qui paraît s'entretenir avec le premier. La scène est
si vague, la nature même de l'entretien est si peu caractérisée
que les archéologues ne savent pas à quel sujet, à quels per-
74 sonnages ils ont affaire. C'est aussi bien
Antiloque, annonçant
à Achille la mort de Patrocle, que Patrocle priant Achille de
secourir les Achéens. Mais la conversation est encore une
action ; dans certains cas, cette action même, pourtant si
froide, si peu saisissante en peinture, est supprimée ; nous
nous trouvons alors, comme devant une peinture d'U/ysse et
de Pénélope (49), en présence de deux personnages qui se considèrent
l'un l'autre, qui semblent s'abîmer dans leurs réflexions,
et, au lieu de parler, attendre que l'un d'eux rompe
le silence. Il serait aisé de multiplier les exemples ; nous
croyons que ceux-ci suffisent pour montrer que la peinture antique ne
s'effraye point des sujets qui nous paraissent anti-pittoresques ; que, dans le choix du moment, elle ne recherche
pas toujours le plus dramatique ; que, si elle aime les situations
violentes, elle ne dédaigne pas les plus calmes, semblable en
cela à la comédie antique, qui, à côté de ses pièces d'un caractère
agité et remuant, avait ses pièces paisibles que les acteurs
jouaient presque sans changer de place.
La galerie décrite par Philostrate nous offre la même variété. Ici, dans le tableau de Penthée, dans celui d'Héraclès furieux, dans celui de Cassandre, le mouvement, l'horreur et la pitié sont portés au comble. Ailleurs, dans l'entretien de Pénélope et Poséidon, dans le Chœur des femmes chantant la naissance d'Athéné, dans l'Entrevue de Thémistocle et du grand roi, ce qui frappe, c'est l'absence d'action. Mais ni les uns ni les autres de ces tableaux, ni, à plus forte raison, ceux qui pour le mouvement semblent tenir le milieu, ne sauraient nous étonner : l'art antique n'a point circonscrit son domaine ; il renferme tous les degrés de la passion, du sentiment et de l'action ; il peut même se passer d'action ; s'il semble faire quelquefois un choix entre les phases d'une même histoire, il ne s'y tient pas; on dirait qu'aux moments les plus défavorables et les plus ingrats il compte donner un intérêt qui, n'étant pas 75 dans les choses elles-mêmes, devra lui être attribué et n'en manifestera que mieux sa puissance.
Dans le choix du moment, comme dans celui des attributs,
nous avons donc à constater entre les tableaux de Philostrate
et les œuvres connues de l'art antique plutôt des ressemblances
que des différences. Le même accord se retrouve-t-il dans le
choix des détails ? On a fait observer que, contrairement aux
habitudes de l'art grec, la nature et la réalité paraissent avoir
été quelquefois copiées, dans les tableaux de Philostrate, avec
une fidélité excessive qui s'allie mal avec l'idée d'une beauté
irréprochable ou qui affecte désagréablement notre sensibilité.
Ainsi Polyphème ne ressemble point au Cyclope aimable,
presque transformé en petit maître galant, que nous montrent
les peintures de la Campanie ; il est aussi laid que le décrit
Théocrite : « son unique sourcil dessine un arc au-dessus de
son œil unique ; son nez aplati descend sur sa lèvre ; il secoue
une chevelure épaisse et droite comme un pin ; ses mâchoires
voraces découvrent ses dents aiguës ; sa poitrine, son ventre,
ses bras jusqu'aux ongles, tout est velu. » Memnon et les
Éthiopiens du tableau de Persée ont, non pas peut-être le
type, mais la couleur des races africaines. Le monstre tué par
l'épée de Persée rougit la mer de son sang : des gouttelettes
de sang ont rejailli sur la chlamyde du héros. Phorbas est
blessé à la tête, et de sa blessure le sang s'échappe à flots ;
les têtes des voyageurs massacrés par ce brigand se balancent
aux branches d'un arbre ; les unes sont desséchées ; les autres,
récemment détachées du tronc, sont encore recouvertes par
la peau du crâne et des joues; d'autres, entièrement dépouillées,
étalent à nu leur double rangée de dents. Les crèches des
chevaux de Diomède sont remplies de débris humains ; Héraclès
emporte dans sa peau
de lion les dépouilles sanglantes d'Abdère. Hippolyte balaye le sol de sa
chevelure ensanglantée ;
ses membres sont les uns déchirés, les autres broyés.
Dans le tableau des Bacchantes, Agave traîne par les cheveux
76 le malheureux Penthée à qui ses tantes coupent
les mains ;
ici on réunit ses membres dispersés; là, sa tête roule sur le sol.
Le vin et le sang mêlés ensemble ruissellent dans la salle du
festin, où Clytemnestre lève contre Cassandre la hache qui a
déjà frappé Agamemnon ; les convives sont ivres ; l'un est
égorgé ; l'autre a la tête séparée du tronc. Dans d'autres
tableaux, le peintre, pour rester fidèle à la légende, ne craint
pas d'offrir aux regards
des objets de dégoût ; étendu auprès de la source capiteuse qui l'a enivré,
le satyre qu'interrogera
le roi Midas vomit des flots de vin pendant son sommeil.
Il y a lieu d'abord, croyons-nous, de ne pas exagérer les tendances réalistes des tableaux de Philostrate. Nous ne pouvons en effet savoir, n'ayant pas devant les yeux les peintures décrites par le sophiste, jusqu'à quel point l'exécution, l'harmonie de la composition atténuaient l'effet de certains détails choquants en eux-mêmes pour la vue ou pour la pensée. La réalité, si laide qu'on la suppose, n'est guère déplaisante que lorsqu'elle est seule, lorsque rien ne vient distraire d'elle le regard et l'esprit ; lorsqu'elle est l'objet même de la représentation, et non un accident dans cette représentation. L'idéal d'ailleurs est chose subtile, qui peut se mêler à tout, au geste, à l'attitude, aux lignes, aux couleurs ; une description, si bien faite qu'on la suppose, ne donne pas toujours une idée juste de la mesure dans laquelle le tableau participe à cet idéal ; l'écrivain raconte bien en effet ce qu'il voit, mais comment faire sentir cette pureté, cette élégance, cette fleur d'exécution qui peut, jusqu'à un certain point, racheter ce qu'il y a de désagréable ou d'épouvantable dans l'objet imité ? Il semble même qu'en certains cas la réalité soit comme un condiment qui relève ce qu'un idéal trop soutenu, trop uniformément répandu, pourrait avoir de fade et d'inerte. C'est un véritable talent que de savoir et de sentir les services que ces deux forces, si l'on peut ainsi parler, du réalisme et de l'idéalisme, doivent se prêter. Un des dessins que Raphaël exécuta pour les tapisseries du 77 Vatican offre de cette union un exemple remarquable : c'est celui qu'on appelle la Guérison du paralytique : « Les nobles et belles figures de saint Jean, de saint Pierre, des hommes, des femmes, des enfants réunis à l'entrée du temple, dit Passavant, contrastent avec la laideur du paralytique et d'un autre mendiant également estropié qui se traîne vers les disciples du Christ. Grand exemple de la puissance du style dans les arts ; on ne saurait imaginer des créatures humaines plus contradictoires à la beauté que ces deux mendiants, et cependant leur laideur n'est point l'horrible ni le trivial. Ces figures démontrent victorieusement un principe immuable, à savoir : quand le laid est nécessaire dans une œuvre d'art, il n'est acceptable qu'avec le style le plus élevé, et s'il remplit cette condition, il rentre même plus dans l'art que la beauté vulgaire, accidentelle et sans style. » Passavant a raison ; toutefois il n'explique qu'imparfaitement ce qu'il entend par le style. Il y a dans le tableau de Raphaël deux causes qui empêchent la laideur d'être choquante : d'abord elle est à sa place ; ensuite, même dans ces mendiants, à côté de la laideur repoussante du visage, il y a une certaine beauté de mouvements et de lignes qui les met en harmonie avec l'ensemble de la composition : ajoutez, s'il est possible de la séparer du reste par la pensée, cette grâce infinie de l'exécution qui donne un prix à toutes choses, même aux plus insignifiantes et aux plus rebutantes par elles-mêmes.
Certains indices nous permettent de croire que cet heureux mélange delà réalité et de l'idéal distinguait les tableaux de Philostrate. Nulle part le souci de la grâce et de la beauté ne paraît avoir abandonné tout à fait les artistes anonymes de celte galerie. Par exemple, la tête de Penthée, dit le rhéteur, aurait fait pitié à Dionysos lui-même , tant elle conservait un air de jeunesse et de fraîcheur. Les membres d'Abdère, mal dissimulés par la peau de lion qui les renfermait, attestaient encore la beauté du favori d'Héraclès. Hippolyte, renversé, 78 foulé aux pieds de ses chevaux, déchiré par les pierres de la route, n'avait point perdu tout l'éclat de la jeunesse ; ses blessures mêmes ne faisaient point horreur. De même dans le tableau de Persée et d'Andromède, la beauté du héros et de l'héroïne empêchait sans doute le regard de s'arrêter trop longtemps sur des détails vulgaires ou peu agréables, comme la sueur, les gouttelettes de sang, les figures noires des Éthiopiens. Philostrate, non plus que tous les anciens, ne connaît point les doctrines exclusives qui imposent aux artistes ou la culture de la réalité ou celle de l'idéal ; il ne se soucie point de faire remarquer que l'artiste a été fidèle à l'un ou l'autre système, ou qu'il en a adopté un troisième, plus vrai et plus sûr; mais, en homme de goût, il a bien senti que c'est un mérite pour le peintre de respecter la beauté là même où il est forcé de s'en écarter, et, tout en choquant la vue à certains égards, de ne pas cesser de plaire par quelque endroit.
D'un autre côté, il n'est pas juste de comparer à ce point de vue, non plus qu'à un autre, la peinture des villes de Campanie aux tableaux de Philostrate. La première, entièrement décorative, est faite pour égayer les habitations, non pour produire sur l'esprit des spectateurs une impression sérieuse et profonde ; elle est, pour ainsi dire, à la peinture ce qu'est à la littérature la poésie légère ; la fantaisie beaucoup plus que la réalité est son domaine; aussi, là même où il semble qu'elle dût être pathétique, elle ne cesse d'être aimable et gracieuse. Dans presque toutes les peintures qui représentent Aphrodite et Adonis (50), le jeune homme est blessé à la cuisse, et la blessure saigne encore, mais la présence des Amours qui soutiennent le bras d'Adonis ou tiennent leurs épieux renversés, ou essuient leurs larmes, l'attitude charmante des deux personnages penchés l'un vers l'autre, la sérénité de la douleur chez Aphrodite, la tranquillité de l'agonie chez Adonis, tout montre que l'artiste a plutôt voulu réveiller chez 79 le spectateur l'idée d'un amour partagé entre une déesse et un bel adolescent que celle d'un accident tragique. Une peinture, que nous avons déjà eu l'occasion de citer, représente Énée blessé (51) ; le médecin, dont la figure d'ailleurs n'a rien d'idéal, approche ses pinces de la blessure entr'ouverte ; mais Énée, semblable à Héraclès jeune, est debout et ne laisse voir sur son visage aucun signe de douleur ou de découragement ; mais Vénus paraît dans les airs apportant le dictame qui doit guérir son fils; si bien qu'en présence de cette composition nous pensons plus au courage d'Énée et à sa guérison miraculeuse que nous n'arrêtons notre vue sur la plaie saignante. De toutes les peintures des villes campaniennes, celle-ci est cependant une des plus réalistes. De même la laideur ou la difformité ne déparait point, n'assombrissait nulle part les murs d'Herculanum et de Pompéi. Quand les artistes ont eu à représenter un être disgracié, ils n'ont pu se résoudre à suivre exactement le récit des poètes ou la tradition. Polyphème, par exemple, n'est jamais un monstre : il ne conserve rien du lourd et brutal Cyclope que l'imagination se figure d'après Homère; s'il a un œil au milieu du front, cet œil n'est marqué que par un léger trait, et il fixe sur Galatée deux yeux très ouverts et très semblables à ceux des autres hommes ; ailleurs même il nous étonnera par l'élégance et la noblesse de ses formes juvéniles; il sera le digne amant de Galatée, la plus belle des Néréides, qui en raison même de cette transformation ne paraîtra pas insensible à son amour. De toutes les figures que nous montre la peinture campanienne, la plus disgracieuse, la plus effrayante, est peut-être celle d'une Scylla (52); elle a le regard sauvage, les cheveux hérissés, la bouche entr'ouverte ; toutes ses formes sont maigres et comme tendineuses : ce n'est point la Scylla de Virgile, qui est une 80 belle jeune fille jusqu'à la ceinture (53). Mais, outre que cette figure est peinte sur une corniche et que par là même elle rentre dans la classe des peintures architecturales, c'est-à-dire plus décoratives encore que toutes les autres, sa laideur répond à la tâche que lui attribuent les poètes, et par l'énergie de son mouvement, par la fierté de sa pose, en un mot par la beauté du style, elle se fait aisément pardonner ce qui lui manque en beauté véritable.
Suivant une opinion qui semble très accréditée ou qui du moins l'a été, l'art antique aurait toujours eu pour les sens et l'esprit du spectateur les plus grands ménagements. C'est là, croyons-nous, un jugement beaucoup trop absolu, uniquement fondé sur le caractère des peintures campaniennes, des statues antiques de nos musées et de quelques bas-reliefs ; mais ces échantillons de l'art antique sont loin de le représenter à toutes les phases de son développement ni dans toutes ses manifestations. Que de figures terribles et même hideuses à voir étaient sculptées sur le bouclier d'Héraclès, si la description d'Hésiode a été faite d'après une œuvre d'art ! « Au milieu était la terreur inénarrable d'un Dragon qui regardait en arrière avec des yeux flamboyants et dont la gueule était pleine de dents blanches, féroces et implacables. Au-devant de lui volait la détestable Éris, horrible et troublant l'esprit des guerriers qui osaient offrir le combat au fils de Zeus ; et les âmes de ces guerriers descendaient sous terre dans le Hadès et, sur la terre noire et sous l'ardent Scirios, leurs ossements pourrissaient dépouillés de chair. Là étaient figurés la Poursuite et le Retour, le Tumulte et la Terreur, et le Carnage furieux ; ici s'agitaient Ëris et Désordre ; et la Ker terrible saisissait ou un vivant récemment blessé ou un autre encore sain et sauf, ou un cadavre qu'elle traînait par les pieds à travers la mêlée. Sa robe tachée de sang humain flottait autour de ses épaules ; elle regardait avec des yeux effrayants 81 et poussait des clameurs. Là se dressaient les douze têtes affreuses des serpents inénarrables qui terrifiaient sur la terre les races de guerriers qui osaient offrir le combat au fils de Zeus ; et leurs dents grinçaient, tandis que l'Amphylrionade combattait. Et toutes ces figures merveilleuses resplendissaient, et il y avait des taches sur le dos bleu de ces dragons horribles, et leurs mâchoires étaient noires (54). »
On peut prétendre, il est vrai, que ce sont là les conceptions
d'un poète, non d'un artiste ; mais qu'y a-t-il de plus affreux que ce démon
Eurynomos, qui, selon Pausanias, passait pour ronger les cadavres et qui,
dans la Descente d''Ulysse aux enfers par Polygnote (55), était assis sur une
peau de vautour, découvrait les dents, et ressemblait par sa couleur
intermédiaire entre le bleu et le noir « aux mouches à viande ». Le peintre
Calliphon (56), de Samos, avait représenté dans le sanctuaire d'Artémis à
Éphèse une furie horrible à voir, semblable à celle qui, sur le coffre de
Cypsélos, assistait au combat entre Ajax et Plector. Ce sont là, il est
vrai, des œuvres qui appartiennent plus ou moins à la période archaïque de
l'art ; les artistes de la belle époque paraissent avoir évité avec soin
ces sortes de représentations, et il est peu probable que l'art les ait
admises, même au temps de son déclin, alors que l'archaïsme était en
honneur, et que sur un même vase Sosibios, par exemple, sculptait un Hermès
et une Artémis suivant le type ancien, et en un style plus moderne toutes
les autres figures de sa composition. Mais rien aussi dans les tableaux de
Philostrate n'est à comparer avec le démon Eurynomos ou la furie de
Calliphon. Mais si le réalisme, très relatif d'ailleurs, de nos peintures,
82 n'a rien de commun avec le réalisme primitif,
il se rapproche
beaucoup de celui que durent présenter les œuvres d'art, dans
la seconde école attique et les écoles postérieures. Le sculpteur
Ctésilaos avait représenté une amazone blessée (57) ; et sur les
statues antiques, qui paraissent être des copies de cette œuvre,
le flanc de l'amazone est sillonné d'une blessure béante.
Dans le groupe connu sous le nom d'Arria et Pœtus (58) et
qui sans doute représente un Gaulois tuant sa femme après
la défaite, des gouttes de sang au bras droit marquent la place
où le poignard a déjà frappé. Le célèbre Gladiateur mourant,
qui n'est autre qu'un Gaulois tombé à terre, perd son sang
par une large blessure (59). Pour mieux rendre la pâleur de
Jocaste, Silanion avait mêlé l'argent au bronze, dit Plutarque (60) ; son visage devait exprimer avec une vérité frappante
toutes les angoisses de la mort et de la douleur morale, car
Plutarque, parlant ailleurs (61) des effets de l'imitation, oppose le
plaisir que l'on éprouvait à voir la Jocaste expirante de Silanion ou le Philoctète d'Aristophon
(62) à l'horreur que nous
ressentons à la vue d'un malade couvert d'ulcères. La peinture
ne dut point être plus délicate ni plus timorée que la sculpture;
le marbre et le bronze se refusent encore à une
imitation trop exacte d'un modèle vulgaire et hideux; ils
n'ont point en soi de quoi se plier à tous les accidents de
la réalité ; la peinture, qui plus que tout autre art se joue avec
les apparences, a par cela même plus de souplesse ; elle a le
droit de tout imiter, parce qu'elle imite tout avec une vraisemblance
suffisante, et cette confiance très fondée en ses
moyens d'expression l'invite naturellement à se rapprocher
83 le plus possible de la vérité. On n'a jamais
vu et on ne verra
jamais, sans doute, exister en même temps une école réaliste
de sculpture et une école idéale de peinture ; ce que la
sculpture ne craint pas de montrer, la peinture l'étalé avec
complaisance; ce que le ciseau indique, le pinceau le reproduit
fidèlement; là où les statues représentent des personnages
blessés ou mourants, les tableaux offrent aux regards le
sang qui coule et les convulsions de l'agonie. Apelle avait
peint des mourants, dit Pline (63), qui ne nous donne pas
d'ailleurs d'autres renseignements sur cette œuvre de l'artiste;
mais rien que le titre du tableau indique de la part du peintre
l'intention de frapper fortement l'imagination : on ne représente
pas isolément des figures mourantes quand les effets
de la mort ne sont pas le but principal de l'imitation, et si
ces figures mourantes avaient servi à nommer une composition
importante, dont elles auraient fait partie, cela seul prouverait
qu'elles étaient d'une vérité saisissante ; c'est ainsi qu'un
épisode d'un dessin de Michel-Ange l'a fait désigner sous le titre
des Grimpeurs. Aristide avait peint le sac d'une ville (64) :
un enfant se glissait sur le sein de sa mère blessée et mourante,
qui l'écartait et laissait voir sur son visage, dit Pline, la crainte
que son fils, au lieu de lait, ne bût le sang qui s'échappait
de sa blessure. Le fameux vase de Vicenzio (65), par la grandeur
du style, le caractère épique de la représentation, le
développement sculptural de l'action, semble reproduire une
peinture d'une époque antérieure; toutefois, comme il témoigne
dans l'exécution aussi bien que dans la composition d'un
art remarquable, il ne saurait être attribué à une période
archaïque; or, sur les genoux de Priam ou du personnage
qui passe pour Priam aux yeux des archéologues, un peu sans
vraisemblance, est couché le cadavre nu d'Astyanax, percé de
84 coups, et tacheté de ruisseaux de sang ;
Politès gisant aux
pieds de Priam est aussi tout ensanglanté (66). Une coupe sur
laquelle l'expression est sacrifiée à la grâce des détails, et qui
par cela même nous semble l'œuvre d'une époque raffinée,
tus montre Diomède plongeant le couteau dans la gorge de Dolon; le sang ruisselle sur la poitrine du malheureux Troyen.
La collection Gampana renferme, dit Brunn, une coupe d'un bon style qui représente les Bacchantes tenant entre leurs mains les membres déchirés de Penthée (67). Sur des gemmes (68) Diomède ou tout autre guerrier contemple la tête d'un cadavre décapité sur lequel il pose le pied. Sur une autre gemme (69), Tydée tient par les cheveux la tête coupée de Mélanippe et se penche sur elle, un poignard à la main, comme pour la frapper encore et assouvir par ce luxe de cruauté une haine qui survit à la mort de son ennemi. Nous n'insisterons pas d'ailleurs sur ce genre de preuves ; les œuvres que nous avons citées en dernier lieu ne sont pas des peintures, et de plus la date peut en être contestée. Mais ce qu'on ne saurait contester, c'est le témoignage des écrivains de l'antiquité. Aristote aurait-il remarqué que nous contemplons avec plaisir la représentation la plus exacte des objets que dans la réalité nous verrions avec peine, par exemple des bêtes les plus hideuses, des cadavres (70), si l'art et la peinture de son temps n'avaient représenté que des Thésée nourris de rose (71) ou des Vénus anadyomènes (72)? Cette observation, Plutarque l'applique d'une façon plus expresse à la peinture. « II faut apprendre aux enfants, dit-il, que, lorsque nous voyons dans un tableau l'image d'un lézard 85 et d'un singe, ouïe visage d'un Thersite, le plaisir ou même l'admiration que cette vue nous cause ne vient pas de la beauté des objets, mais de leur ressemblance (73). » Plutarque ne semble même pas concevoir que l'artiste puisse en certains cas ménager la sensibilité du spectateur. « Si la peinture, ajoute-t-il, représentait un objet hideux sous des traits aimables, elle pécherait contre la convenance et cesserait d'être vraisemblable... Timomaque, par exemple, a peint Médée égorgeant ses enfants, Théon Oreste qui poignarde sa mère. » Plutarque ne décrit pas autrement ces peintures ; mais, puisque la vérité y était si fidèlement observée, il est difficile, pour l'esprit qui cherche à se les représenter, de ne pas évoquer les images les plus lugubres et les plus effrayantes.
Il est peu probable que l'art, à son déclin, ait connu des scrupules auxquels il était resté étranger pendant sa maturité. Sur un bas-relief de l'époque romaine (74), nous voyons, attachées aux branches d'un arbre qui abrite l'image d'Artémis, des tètes humaines, symbole et témoignage des sacrifices sanglants qui s'accomplissaient en Tauride. Un bas-relief de la colonne Trajane nous montre, portées sur des pieux qui dominent les murailles d'une ville assiégée, des têtes coupées, aux pommettes saillantes, à la peau flétrie et desséchée. A cette image ajoutez, par la pensée, les traits d'un réalisme plus saisissant que la peinture seule peut rendre, et vous croirez voir ce tableau de Philostrate où les têtes coupées par le brigand Phorbas se balancent aux branches d'un chêne et distillent la pourriture. Un peintre, Kvanlhès, dont nous ne connaissons pas l'époque, mais dont Achille Tatius (75), un auteur 86 du troisième siècle, a décrit deux tableaux, avait représenté dans l'un d'eux le supplice de Prométhée ; un aigle, chargé de la vengeance de Jupiter, déchirait la poitrine du Titan ; bien qu'il y eût fait une large plaie, il ne cessait de l'élargir; à travers la blessure béante, on apercevait une partie du foie. L'aigle avait enfoncé ses serres dans les flancs de sa victime ; Prométhée repliait une jambe convulsivement, étendait l'autre qui, par la contraction des muscles et l'écartement des doigts de pied attestait la violence de la douleur. Nous ne parlons pas des sourcils qui se rapprochaient et s'élevaient, des lèvres qui, en se contractant, laissaient voir les dents à nu. Un art qui poussait si loin l'étude et la reproduction des signes de la douleur physique peut-il être soupçonné d'avoir redouté ses propres effets sur l'imagination, et par cet excès de scrupule d'avoir hésité à être aussi vrai que ses ressources le lui permettaient ? A ces preuves vient s'ajouter, au moins pour cette époque, le témoignage de saint Jean Chrysostôme (76) : « Les peintres, dit-il, représentent toute la nature, les hommes, les animaux, les arbres, la guerre, les combats, les flots de sang.... » Aurait-il tenu un tel langage, si les artistes de son temps avaient craint de représenter les massacres d'un champ de bataille, ou si, en les représentant, ils avaient eu pour habitude d'atténuer, autant que faire se pouvait, l'horreur d'un tel spectacle? « Le peintre de ce tableau, dit Marcus Eugenicus, a voulu plaire aux regards ; il laisse à d'autres le soin de représenter ces effusions de sang, ces torches embrasées qu'on approche des cadavres, ces combattants qui expirent dans les tortures. » Si les anciens avaient leurs Albane, ils avaient donc aussi leurs Salvator Rosa ! A côté des peintres d'idylles, appelés pour décorer les appartements, il y avait donc des peintres de scènes sévères ou terribles ! Il y eut des peintres pour les supplices quand la persécution contre le christianisme renouvela le fonds usé des sujets tragiques. Saint 87 Asterius d'Apamée décrit ainsi une scène d'une peinture sur toile qui représentait le martyre de sainte Euphémie : « Les bourreaux vêtus seulement d'une tunique accomplissent leur tâche ; l'un d'eux a saisi la tête de la vierge et la renverse en arrière; il la maintient ainsi immobile, exposée aux tortures; l'autre lui arrache les dents. On voit les instruments de supplice, un maillet et un fouet. Mais ici je fonds en larmes et la douleur me coupe la parole. Car le peintre a si distinctement rendu les gouttes de sang qu'on les voit réellement couler et qu'on s'éloigne en sanglotant (77). » C'est un martyre que décrit Marcus Eugenicus dans sa première ecphrasis (78); le rhéteur nous montre les bourreaux occupés à déchirer « avec toute la force de leurs mains et toute la violence de leur zèle » les flancs et la poitrine de Démétrios. A cette férocité il oppose, il est vrai, la sérénité de la victime, sérénité qu'il décrit en termes qui font songer au martyre des saints Gervais et Protais par Le Sueur ; mais le réalisme de Philostrate n'est point non plus, comme nous l'avons vu, pur de tout mélange d'idéal ; cela seul suffit, d'abord pour que nous ne le regardions pas comme inventé par le sophiste, ensuite pour que nous ne soyons pas tentés de le confondre avec le réalisme outré et mal accommodant des écoles modernes.
Dans un autre ordre d'idées on aurait tort de croire que les artistes anciens eussent toujours épargné au spectateur la vue d'un visage hideux, de difformités physiques, ou de quelques particularités, plus propres à caractériser les personnages qu'à relever leur beauté. Qu'on nous permette ici de confondre un peu les époques, vu la difficulté de distinguer les diverses phases du réalisme antique et aussi de demander des exemples aux différents arts qui naturellement ont une grande influence l'un sur l'autre. Les centaures d'Aristéas et Papias ont la poitrine couverte de poils; le Silène, appelé Si- 88 léno-pappos est toujours entièrement velu comme le Polyphème de Philostrate. C'est aussi l'aspect que présente Marsyas, sur tel vase de Ruvo (79). Si le monstre est un jeune et beau pasteur, aux traits réguliers, dans les peintures idylliques des villes campaniennes, sur tel masque (80), sur telle gemme (81), il reste le cyclope effrayant, à l'œil unique et farouche, des poèmes homériques et de la tradition. Une peinture récemment découverte dans les fouilles du Palatin (82) nous montre un Polyphème intermédiaire entre le cyclope ennobli et adonisé des peintures campaniennes et le géant velu de Philostrate. Il a des formes et une carrure rustiques ; tout grand qu'il est, il paraît trapu ; ses cheveux en désordre retombent sur son front et lui donnent l'aspect le plus vulgaire ; c'est un jeune et vigoureux paysan des environs de Rome. Nous ne déciderons pas si ces peintures sont antérieures ou postérieures à celles de Pompéi ; mais elles prouvent bien évidemment que l'art antique n'a pas toujours recherché l'idéal le plus pur, et qu'il ne s'est pas maintenu non plus au même point, entre l'idéal et le réalisme. La laideur sans doute ne se rencontre guère sur les beaux monuments de l'art antique ; mais ce serait une erreur de croire que les anciens n'ont jamais sacrifié la beauté à l'expression et à la vérité, surtout à l'époque de décadence. Déjà Plutarque nous a dit que les peintres représentaient des singes, et Thersite, ce type de la laideur dans l'antiquité. « Avez-vous remarqué près du jet d'eau, dit Eucrate dans Lucien (83), un personnage qui a le ventre saillant et la tête chauve ? Il est à moitié nu ; 89 le vent semble agiter quelques poils de sa barbe ; il a les veines fortement accusées ; on dirait d'un homme, tant la ressemblance est parfaite; c'est de lui que je parle et je crois que c'est Pélichos, général des Corinthiens. » L'auteur de cette statue était Demétrios, dont le talent paraît avoir fleuri entre la 80e et la 100e Olympiade, c'est-à-dire entre 460 et 364 avant Jésus-Christ. Le même sculpteur avait fait la statue d'une prêtresse d'Athéna, âgée de soixante-quatre ans. Demétrios, disent les critiques (84), n'est point un disciple ni un fondateur d'école ; il est isolé ; il est naturaliste à outrance au milieu d'artistes qui conservent le culte de l'idéal. La remarque peut être juste; toutefois si le naturalisme grec débute ainsi, presque par l'excès, on peut croire que la modération ne lui viendra pas avec les années. Le personnage de Philoctète peut nous servir d'exemple. Pythagoras de Rhégium, un sculpteur qui florissait environ vers 488 avant Jésus-Christ, l'avait représenté boitant; aie voir, dit Pline on croyait souffrir de sa blessure (85). Dans une épigramme de l'Anthologie (86) qui est peut-être relative à cette même statue, Philoctète se plaint de l'artiste qui a éternisé sa douleur en bronze. Comme le fait remarquer Brunn, l'artiste avait dû rendre sensible les souffrances de Philoctète par l'attitude de tout le corps, par une violation de l'harmonie et de l'eurythmie naturelle. L'infirmité de Philoctète frappait-elle les yeux dans le tableau de Parrhasios, un contemporain de Socrate ? nous ne savons : toujours est-il que son visage et ses yeux exprimaient une douleur atroce, comme l'atteste une épigramme grecque (87) : « II avait vu, sans doute, le héros de Trachine en proie à ses souffrances, Parrhasios qui a peint Philoctète. Car de ses yeux desséchés s'échappe une larme, et, au dedans, la douleur le dévore. 90 Ô le plus habile des peintres, tu es maître dans ton art; mais ta puissance, il fallait l'employer à calmer les douleurs du héros infortuné. » Une autre épigramme, relative peut-être à une œuvre d'une époque postérieure, entre dans plus de détails (88) : « Je crois reconnaître Philoctète ; il laisse voir ses souffrances même à ceux qui le contemplent de loin ; il a une chevelure épaisse, hérissée ; des mèches arides, aux âpres couleurs, descendent sur ses joues. Sa peau est desséchée, rude à voir, rude au toucher. Ses paupières arides cachent des larmes figées, signe d'une souffrance toujours éveillée. » II y a peu de différence entre ce Philoctète et celui que décrit Philostrate le jeune (89). « II est représenté avec un visage flétri par la maladie, des yeux sans regard profondément enfoncés sous l'orbite et voilés par les sourcils appesantis ; une chevelure en désordre, une barbe inculte, hérissée ; le corps tout couvert de haillons et le pied enveloppé. » En supposant contemporaines ces deux compositions, l'une explique l'autre; si l'on pense avec Brunn que l'épigramme de Julien a été faite d'après le tableau de Parrhasios, c'est à une époque très reculée qu'il faut faire remonter l'origine du réalisme grec, et nous serons d'autant moins surpris de le rencontrer à une époque de décadence. Un raisonnement analogue s'appliquerait à une statue de Mômos décrite dans l'Anthologie (90) : « Ô Mômos qui ronges tout jusqu'à tes malheureux ongles, sèche d'envie, consume toi en grinçant tes dents venimeuses. On te reconnaît bien à tes nerfs tendus, à tes membres défaillants, à tes cheveux qui frémissent sur tes tempes rugueuses.... Quel est donc l'artiste qui t'a donné cette vie, cette perfection, à toi l'ennemi des hommes, en ne laissant aucune place à tes morsures ? » Une autre épigramme parle de sa double rangée de dents que fait grincer la prospérité des au- 91 tres, de son front chauve qu'il appuie sur une main décharnée ; mais le poète anonyme a tort de dire que Mômos est représenté avec un art qui ne craint pas Mômos, c'est-à-dire la critique : on reprocherait aujourd'hui à l'artiste, comme aux tableaux de Philostrate, d'avoir poussé trop loin l'imitation de la nature imparfaite et choquante. Toujours est-il que l'art antique, à certaines phases de son développement (et si la statue de Mômos n'a pas été exécutée à l'époque romaine ou byzantine, la subtilité de la personnification ne permet guère de l'attribuera un âge antérieur au règne d'Alexandre), ne s'embarrassait pas de ces sortes de reproches et qu'on ne songeait pas à les lui adresser. Un goût sûr a préservé en général les artistes anciens d'un réalisme outré ; on aurait tort de croire cependant qu'ils n'ont jamais été entraînés un peu au delà de ce que nous regardons comme la juste mesure de la fantaisie individuelle, par le désir de la nouveauté, quelquefois même par les nécessités impérieuses de la Fable.
Parmi les sujets mythologiques, il n'en est peut-être point qui mettent autant à l'épreuve le goût d'un artiste que les métamorphoses. Si nous considérons les peintures campaniennes, nous voyons que les métamorphoses ont été plutôt indiquées que représentées. Dans la Casa dei capilelli colorati, Cyparissos, assis à côté d'Apollon, s'appuie sur le bras droit et tient dans la main gauche deux épieux ; il va se changer en cyprès, comme le montrent des branches qui s'élèvent au-dessus de sa tête ; mais ni sa tête, ni ses pieds ni ses mains n'ont subi d'altération (91). Dans la plupart des représentations de Daphné et d'Apollon, la métamorphose n'est pas même commencée ; un laurier, placé dans le fond du tableau, rappelle seulement à l'esprit du spectateur le dénouement merveilleux de celte aventure amoureuse. Toutefois dans deux peintures les branches de laurier, au lieu d'appartenir à un tronc distinct, apparaissent au-dessus de Daphné, 92 comme si elles avaient poussé de sa tête et de ses épaules (92). Sur la plupart des monuments, peintures, bas-reliefs ou statues qui représentent Actéon, la métamorphose du chasseur n'est indiquée que par de très petites cornes de cerf qui sortent de son front (93). Les artistes de la galerie de Naples, s'il faut en croire Philostrate, auraient adopté un parti beaucoup plus hardi : « les Héliades, dans le tableau de la Chute de Phaéthon, se transforment en peupliers ; les unes sont arbres jusqu'au milieu du corps ; les autres, envahies par les fibres végétales qui les enveloppent, n'ont déjà plus ni bras ni mains ; la chevelure de l'une d'elles ressemble déjà à la cime d'un peuplier noir. Dans le tableau des Bacchantes, Harmonie et Cadmos subissent leur métamorphose en serpents : depuis les pieds jusqu'aux hanches le corps disparaît sous les écailles. Que faut-il penser de cette différence ? Remarquons d'abord que la timidité de la peinture campanienne ne paraît pas avoir été partagée en général par l'art antique. Sur une pierre gravée, qui représente Apollon et Daphné, les branches de laurier naissent non seulement de la tête de la jeune fille, mais de ses mains qu'elles semblent continuer; sur une autre, c'est la chevelure qui se confond avec les pousses de l'arbuste, et les pieds de Daphné pénètrent dans le sol comme des racines ; sur une médaille, les deux bras étendus se terminent par deux branches de laurier. Dans le fameux groupe de Dionysos et d'Ampélos, un buste de jeune garçon se dégage d'une gaine de pampre et de grappes ; ce n'est pas là une métamorphose, il est vrai; c'est une personnification de la vigne ; mais au point de vue de l'art, qui dans les deux cas a deux natures différentes à réunir et à concilier, la distinction est sans importance. Enfin nous croirions volontiers que dans ces sortes de représentations l'art antique a poussé quelquefois la hardiesse aussi loin que possible, et plus loin même que le 93 peintre des Héliades dans le tableau de Philostrate. Un bas-relief du palais Rondanini représente trois scènes du séjour d'Ulysse dans la demeure de Circé ; dans l'une d'elles, la magicienne fait sortir de l'étable, pour les rendre à leur première forme, les compagnons du héros qui apparaissent, deux avec des tètes de porc, un avec une tête de bélier, un quatrième avec une tête de taureau (94). Comme le fait remarquer Jahn (95), on rencontre quelques exemples analogues sur les monuments antiques. Une gemme représente une figure d'homme à genoux avec une tête d'aigle, c'est Périphas. Sur une monnaie de Jotapé, il semble avoir une tête de génisse. Ailleurs une tête de cerf est posée sur les épaules d'Actéon. Mais, en fait de changement de cette nature, l'exemple le plus osé peut-être nous est donné par un des bas-reliefs de la colonne de Marc-Aurèle; Jupiter Pluvius, représenté par une tête et deux ailes, étend deux bras qui se fondent en eau et ressemblent à la nappe d'une cascade ; rien de plus bizarre que ce personnage transformé en pluie ou que cette pluie transformée en personnage. C'est là sans doute un monument de décadence, comme quelques-uns de ceux que nous avons cités plus haut ; mais les tableaux décrits par Philostrate ne paraissent pas appartenir non plus à la meilleure époque de l'art. Ici encore les peintres delà galerie de Naples nous semblent tenir un certain milieu entre les œuvres d'un goût pur et correct, et les compositions plus aventureuses de la dernière période gréco-romaine. D'ailleurs en cette question une considération importante ne doit pas nous échapper, c'est que l'exécution peut sauver la bizarrerie du motif (96) ; en outre, en ce qui concerne les Hé- 94 liades de Philostrate, si l'on est surpris que l'une d'elles fut presque entièrement recouverte par l'écorce du peuplier, il ne faut pas oublier qu'elles étaient trois et que l'artiste devait être tenté, dans l'intérêt même de la variété, de les représenter chacune en un degré différent de transformation.
Nous avons vu l'art antique se rapprocher aussi près que possible de la réalité et de la vérité ; dans d'autres circonstances, au contraire, il s'en écarte, et fait à la fantaisie et à la convention une part des plus larges. Nous ne parlons pas seulement des personnages et des scènes qu'il nous montre ; c'est là un monde créé avant la sculpture et la peinture par la poésie et la Fable, et qui, par une suite naturelle de cette origine, se meut toujours dans une sphère fictive ; mais l'art antique ajoute, pour ainsi dire, la fiction à la fiction, en ne tenant compte ni de l'unité de temps ni de l'unité de lieu, ni de ce que nous appelons la couleur locale, en réunissant, contre toute vraisemblance, des éléments qui dans la nature sont toujours séparés, en se jouant, en un mot, de toutes les conditions du possible. Voici par exemple un monument qui représente la naissance de Dionysos (97) : le thyrse, le tambour, la peau de panthère, toutes choses que le dieu doit inventer plus tard, servent déjà d'emblèmes ou d'ornements aux personnages qui le reçoivent. Sur un miroir étrusque, le petit dieu, sortant de la cuisse de Jupiter, tient déjà le pédum symbole de la vie qu'il passera au milieu des divinités agrestes, les Satyres, les Silènes et les Pans (98). Aill-95 leurs il reposera sur des pampres ou tiendra à la main une grappe de raisin, bien que la vigne qu'il doit planter plus tard soit encore inconnue. Brunn s'est complu à accumuler les exemples de ce procédé qui consiste à rapprocher l'avenir du présent, et qu'il nomme une prolepse. Sur un vase (99), Hermès tient la palme de la victoire pour Pélops qui est encore occupé des préparatifs de sa lutte avec OEnomaos; ailleurs, Memnon n'est pas encore enseveli, et l'oiseau passant dans le champ de la peinture indique la métamorphose qui attend les compagnons du héros (100). Zeus, pendant la naissance d'Athéna a déjà sur le bras la chouette, attribut que la déesse doit choisir (101). Sur une métope de Sélinonte, Méduse, dont le sang doit donner naissance à Pégase, presse déjà sur sa poitrine le cheval ailé, avant d'avoir été décapitée par Persée. Dans une statue du Vatican (102), une branche de palmier annonce déjà la victoire à la course d'une jeune femme qui attend encore le signal du départ. Sur une coupe de bronze, un guerrier troyen combattant contre Héraclès élève un bouclier sur lequel est représentée la lionne avec ses petits, comme pour unir l'histoire de Troie aux origines de Rome (103). Sur une gemme du cabinet Stosch (104), qui représente l'enlèvement de Ganymède, une urne indique que le favori de Jupiter changé en oiseau sera placé parmi les constellations. Une hydrie du Musée britannique nous montre Persée assistant aux préparatifs que font des Éthiopiens pour exposer Andromède, comme si son premier soin n'eût pas été, en pareille occasion, d'arracher la jeune fille à ses bourreaux (105).
A quelle époque cet usage s'introduisit-il dans l'art? En l'état actuel de nos connaissances, il serait malaisé de le dire? Quels sont, parmi les arts, ceux qui l'adoptèrent de préférence? La 96 plupart des exemples cités plus haut appartiennent surtout à la peinture de vases, à la toreutique, arts un peu bornés dans leurs moyens d'expression et qui cherchent à racheter ce défaut par une liberté plus grande dans la fantaisie. Il est évident que là où l'illusion est pour l'artiste hors de toute prise, il peut plus aisément confondre les temps. Que lui reprocherait-on? de détruire l'illusion ; mais son art même le dispense de la rechercher. La peinture, conçue dans le style décoratif, ne saurait non plus repousser la prolepse ; nous en retrouvons l'emploi, discret d'ailleurs, dans les peintures campaniennes ; Apollon poursuivant Daphné, par exemple, est déjà couronné de laurier, comme si le laurier existait avant la métamorphose de Daphné. Le bas-relief n'est pas sans analogie avec le style décoratif ; et la preuve, c'est qu'on lui fait un reproche d'imiter trop quelquefois la peinture non décorative ; la prolepse ne devait donc pas lui rester étrangère. Sur un bas-relief de Mégare (106), une biche placée aux pieds d'Héraclès, qui est assis pendant qu'Augé est debout à ses côtés, offre une allusion anticipée à la naissance de Télèphe ; c'est du moins l'interprétation de Raoul Rochelle qui a publié le monument. Sur un sarcophage décrit par Millingen (107), les Muses, pendant leur lutte avec les Sirènes, sont déjà ornées des plumes qu'elles doivent leur arracher pour les punir d'une téméraire rivalité. Mais l'exemple le plus frappant de ce procédé nous est peut-être donné par le bas-relief du Louvre (108) qui représente la chute de Phaéton : Cycnos, qui fut changé en cygne par Apollon, s'y montre sous ses deux formes, celle qui précède et celle qui suit la métamorphose : derrière un cygne véritable apparaît en effet, la tête appuyée sur le bras, la poitrine nue, un vieillard, 97 dont l'attitude éplorée ne convient qu'à Cycnos, le proche parent de Phaéton. Il y a lieu de croire que la peinture antique, la peinture de chevalet, tout en recherchant dans une active mesure l'illusion, ne fut jamais fermée tout à fait aux hardiesses du style conventionnel ; mais si elle dut leur faire une large place, ce fut surtout dans un temps de décadence, alors que les arts s'empruntent mutuellement leurs procédés et que l'imitation du bas-relief semble avoir été en honneur dans les ateliers de peintres. Aussi, de toutes façons et pour plusieurs raisons, nous ne devons point être surpris à cet égard des descriptions de Philostrate. Midas, dans sa rencontre avec le satyre, peut avoir déjà de longues oreilles, bien que d'après Ovide la sentence maladroite de Midas juge entre Pan et Apollon, et le châtiment qui la suivit, soient postérieurs à cette aventure. Phaéton, précipité du ciel, n'a pas encore touché la terre, et déjà ses sœurs sont changées en peupliers, Cycnos en cygne. Au moment où naît Dionysos, le Cithéron s'afflige ; Mégéra sur la montagne plante un sapin et fait jaillir une source; allusion, dit Philostrate, d'abord à l'aventure de Penthée qui devait contempler les mystères des Bacchantes du haut d'un sapin, et tomber à terre avec l'arbre déraciné ; ensuite à celle d'Actéon qui sur le Cithéron devait surprendre Artémis se baignant à cette source même.
Cet esprit de convention affecte toutes les parties de l'art antique. Le lieu de la scène par exemple, sera souvent à peine caractérisé ; des personnages qui ne peuvent être conçus que dans l'éloignement apparaîtront tout près de ceux qui sont bien réellement voisins des spectateurs ; ils seront séparés les uns des autres par un arbre, par un pan de mur; quelquefois ils ne le seront par rien. Regardons, par exemple, les Noces aldobrandines (109); la peinture se compose de trois scènes; dans celle du milieu, Aphrodite ou Peitho presse la jeune femme de recevoir l'époux qui attend sur le seuil ; à gauche, des femmes préparent le bain nuptial : à droite se font les pré- 98 paratifs de l'épilhalamium. Comment ces différentes scènes sont-elles séparées? Par les piliers qui divisent le mur du fond, de manière à faire deviner qu'à gauche se trouvent des chambres, et qu'à droite, le mur finissant, s'étend la cour de la maison. Une peinture du mont Esquilin (110) représente l'intérieur du palais de Circé ; à droite, est une cour à colonnade, à gauche le vestibule ; un pilier, se détachant sur les murs du fond, indique seul la séparation entre ces deux parties différentes du palais; la chose est d'autant plus singulière que les personnages de gauche sont les mêmes que ceux de droite, c'est-à-dire toujours Ulysse et Circé. Dans des peintures également découvertes sur le mont Esquilin (111) et qui représentent les mythes de Lavinium et de Rome, les différentes scènes, par exemple le Mariage d'Énée avec Lavinia, Turnus s'éloignant du palais de Laurente, la Construction de Lavinium, la Bataille sur les bords du Numicius, l'Apothéose ou la Disparition d'Enée, Mézence chassé de Lavinium, ne sont séparées les unes des autres que par une colonne avec son chapiteau. Une peinture de Pompéi (112), dont tous les détails ne nous paraissent pas d'ailleurs avoir reçu une explication suffisante, nous montre Pylade remettant à Oreste la lettre d'Iphigénie ; Apollon et Artémis, les divinités qui s'intéressent aux deux héros grecs, assistent à la scène; ils apparaissent, non dans l'éloignement, mais derrière un simple mur, à hauteur d'appui. Ailleurs, sur des bas-reliefs (113), Apollon et Diane, exterminant la famille de Niobé, sont tout près de leurs victimes : ce n'est là, on le sent, qu'une simple convention; car des divinités qui manient l'arc avec une infaillible sûreté, dont les flèches atteignent de loin, n'ont pu descendre sur la terre pour exécuter leurs vengeances. Une part semblable est faite à la convention dans les tableaux de Philostrate : si dans le 99 tableau d'Héraclès furieux on apercevait et le héros et Mégara qui s'était réfugiée dans une chambre voisine, c'est que sans doute, comme dans les Noces aldobrandines, un simple pilier séparait les deux scènes; une disposition analogue permettait au regard de voir Dédale dans son atelier et Pasiphaé dans la campagne. Sur ce point donc nulle différence entre l'art antique et la galerie de Naples. Usité avant Philostrate, le procédé se conservera après lui, nous ne saurions en douter. A défaut de documents relatifs à la peinture murale, aux tableaux mobiles, les miniatures de manuscrits peuvent être appelées en témoignage. Par exemple, une peinture du manuscrit de Virgile conservée au Vatican nous montre Didon, sur son trône, à Carthage, avec l'Amour qui a pris la figure et le costume d'Ascagne ; tout près d'elle, et séparé seulement par une ligne conventionnelle, Ascagne, que Vénus a transporté dans les bocages d'Idalie, dort dans l'île sacrée, devant le temple de la déesse (114).
De là à représenter dans un même tableau deux scènes différentes ayant mêmes acteurs, il n'y a qu'un pas, et ce pas fut aisément franchi. L'unité de lieu est souvent violée de cette manière dans les tableaux de Philostrate. Il nous suffira ici de citer quelques exemples. La peinture décrite sous le titre « Les Bacchantes » contient deux scènes : la première se passe sur le Cilhéron : Penthée est déchiré par sa mère et ses tantes ; la seconde a lieu au pied de la montagne, dans la ville de Thèbes, dans le palais de Cadmus : les parents de Penthée recueillent ses restes informes ; les Bacchantes pleurent la victime de leur fureur. Dans le tableau de la Naissance d'Hermès, le dieu enfant pousse devant lui les bœufs d'Apollon, au pied de l'Olympe, et au sommet du même mont dépouille Apollon de son carquois. Un même tableau nous montre d'un côté Chiron agenouillé sur ses jambes de devant, et accueillant Achille qui revient de la 100 chasse ; de l'autre Achille monté sur le centaure qui lui donne ainsi une leçon d'équitation.
Ce procédé, qui peut nous paraître singulier, semble aussi, par nature, appartenir au style décoratif. Voyons quel usage en faisaient les différents arts dans l'antiquité. Sur les vases, un même personnage est souvent représenté dans différentes attitudes et dans des actions diverses. Deux coupes à figures rouges (115) représenteront par exemple, de chaque côté, deux scènes tirées de la légende de Thésée, si bien que Thésée sera reproduit quatre fois sur le même vase. Une hydrie à figures noires (116) nous montre dans sa partie supérieure des scènes de combat, et dans chacune Athéna jouant le rôle principal. A ces exemples donnés par Friederichs (117) comme les seuls qui soient connus des archéologues, Brunn en ajoute plusieurs autres. A l'intérieur d'une coupe (118), autour de la figure du Minotaure, Thésée est représenté six fois, dans des scènes différentes, et les mêmes motifs se répètent sur les côtés extérieurs de la coupe. Sur une autre coupe, du musée Campana (119), deux des exploits de Thésée ne sont séparés que par la lutte d'Héraclès contre le lion de Némée (120). Deux vases de l'Italie inférieure réunissent en une seule et même image la dispute des déesses éprises d'Adonis et la mort de ce personnage (121).
Des exemples tels que ce dernier montrent bien, comme le fait remarquer Brunn, que le procédé consistant à diviser une surface unique en plusieurs scènes, avec répétition du même 101 personnage, n'est point particulier aux coupes et aux vases analogues, mais se retrouve aussi sur la panse de vases considérables par leur dimension. Les peintures de vases sont, sans doute, tout particulièrement décoratives ; même en supposant, comme c'est aussi la vérité, que dans beaucoup de cas elles ont dû reproduire des peintures murales ou sur bois, on pourrait prétendre qu'elles ont ajouté les éléments contraires à l'unité de lieu, ou qu'elles se sont plu à réunir, sur une même surface, des compositions primitivement isolées. Dans les bas-reliefs, ce procédé a pris une extension considérable ; il en est peu où il ne soit employé (122). Au dix-huitième siècle, où le bas-relief était traité comme un tableau, les bas-reliefs antiques passaient, du moins aux yeux de certains artistes, pour très bizarres. Falconet n'a point assez de railleries pour cette manière de composer qui multiplie, comme à plaisir, les impossibilités et les invraisemblances. « Je n'indiquerai, dit-il, que deux ou trois de ces bas-reliefs ridicules. Dans l'un Cérés, le flambeau à la main, court les champs pour chercher Proserpine que Pluton enlève à deux pas de Cérès, et qu'il va placer dans son très petit char conduit par Mercure. Les chevaux sont déjà au grand galop, quoique personne encore ne soit dans cette voiture commode, et ils mènent l'équipage dans les enfers à Pluton qui, assis sur son trône infernal, à quelques pouces de là, se plaint, dit-on, à Mercure, d'être le seul des dieux qui ne soit pas marié. Le morceau est à Rome, au palais Mazarin. Dans un autre bas-relief vous verrez Minerve qui dit à Persée d'aller délivrer Andromède, que lui Persée délivre à l'autre bout du tableau. L'ouvrage est au palais Mattéi. — Dans un autre, vous verrez Mercure qui invite une ombre descendue de 102 la barque à faire à pied le reste du trajet, et tout à côté de Mercure vous verrez encore Mercure qui conduit une autre ombre. Le morceau est au palais Barberini. Notez bien toujours, ajoute Falconet, que je ne parle pas de l'exécution, qui parfois est très bonne dans ces misérables compositions. Cependant si un sculpteur en produisait aujourd'hui de pareilles, on louerait le travail et on donnerait à l'artiste un atelier aux Petites-Maisons (123). » Nous avons tenu à reproduire entièrement cette spirituelle mais peu judicieuse critique, parce qu'elle ressemble beaucoup aux reproches que certains commentateurs ont adressés aux tableaux de Philostrate, et aussi parce qu'il est évident, d'après les paroles de Falconet, que si cet artiste, au lieu des bas-reliefs eux-mêmes, n'en avait eu sous les yeux que la description, il aurait été tenté, comme on l'a fait pour Philostrate, de les déclarer purement imaginaires. Les gemmes elles-mêmes, malgré l'exiguïté du champ, répètent quelquefois le même personnage. Nous n'en connaissons pas de plus curieux exemple que la pierre gravée reproduite par Inghirami, dans sa Galerie homérique. Achille, debout sur son char, traîne autour de Troie le cadavre d'Hector : à une des portes de la ville se tient une femme portant un enfant dans ses bras, et qui ne saurait être autre qu'Andromaque; Hector se sépare d'elle, pour aller combattre Achille, et se détourne pour jeter un dernier regard sur sa femme et son fils (124).
Aucune description, aucun texte, aucun monument ne nous autorise à croire que ce mode de composition fût en usage dans la peinture au temps des Apelle et des Protogène, ou dans l'école qui les suivit. S'il avait été très répandu, il semble que la peinture campanienne, qui paraît avoir fait tant d'emprunts à la peinture hellénique, se serait emparée aussi d'une convention tout à fait conforme d'ailleurs à l'esprit du genre décoratif. Toutefois les archéologues citent deux peintures murales 103 qui semblent s'écarter en ceci de la règle générale : toutes les deux représentent l'aventure d'Actéon. M. Helbig décrit ainsi la première : « au pied d'un rocher qui forme grotte, Artémis se baigne ; elle est agenouillée; d'une main, elle protège sa pudeur, elle lève l'autre vers Acléon comme pour jeter sur lui quelques gouttes d'eau. Actéon se tient à droite de la grotte ; sur sa tête poussent déjà deux cornes de cerf ; il est assailli par deux chiens dont l'un le mord à la cuisse gauche, l'autre s'élance sur son flanc droit. Contre celui-ci il manie le pedum ; de la main gauche il saisit la tête du premier. Autour du bras gauche s'enroule une peau de léopard... Dans le fond du tableau, au-dessus des rochers , s'élève une figure de jeune homme qui a tous les caractères d'Actéon. Une peau de léopard enveloppe également son bras gauche ; la main gauche tient le pedum ; enfin il élève la main droite à la hauteur de son front et regarde Artémis ; » ce n'est donc pas, comme le fait remarquer M. Helbig, un dieu de la montagne; c'est Actéon lui-même, et il est représenté dans le moment où il aperçoit la déesse (125). La seconde peinture est plus décisive encore (126) : Actéon la main droite posée sur la bouche, un pedum dans la main gauche, contemple par-dessus un mur la déesse qui s'agenouille au bord d'une cascade ; ses vêtements, sa couronne, ses brodequins, son épieu sont déposés sur le sol à quelque distance. Artémis, apercevant le chasseur téméraire, lève la main vers lui, sans doute pour le menacer du châtiment. Un peu plus loin, à droite, la déesse, qui a repris son épieu et ses brodequins de chasseresse, qui est entièrement vêtue et laisse flotter son voile au vent, s'élance en courant vers un personnage qui ne peut être qu' Actéon, une seconde fois représenté ; car il est assailli par un chien, et Artémis semble exciter contre lui un autre chien dont elle est accompagnée. Nous avons donc bien devant les yeux deux moments divers d'une même aven- 104 ture ; et remarquons que ces deux scènes ne sont point juxtaposées, comme il arrive en pareil cas sur les bas-reliefs, mais sont engagées l'une dans l'autre. Artémis vêtue est placée directement au-dessous d'Actéon qui regarde la déesse au bain; si bien que la composition paraît ainsi s'équilibrer : Actéon châtié fait pendant du côté droit à la déesse qui se baigne du côté gauche ; Artémis armée pour sa vengeance sur le premier plan répond à Actéon qui, au second plan, regarde la déesse entièrement nue. Dans une autre peinture de Pompéi plus récemment découverte, l'artiste a réuni deux épisodes successifs de l'histoire de Médée et des filles de Pélias ; et, pour éviter toute méprise au spectateur, il a donné aux personnages répétés les mêmes vêtements ; à droite et à gauche de la composition, Médée porte le chiton violet serré à la taille, et la bandelette dorée ; une des sœurs a dans la seconde scène le chiton jaune et l'ampéchonion rouge dont elle est velue dans la première. L'enfant qui accompagne ici Médée est là debout auprès de l'une des trois sœurs (127). On nous permettra aussi de placer à côté de ces trois exemples une peinture (128) qui, pour ne pas représenter un mythe ou une scène historique, n'en montre pas moins quelle était à l'égard de la composition la liberté des artistes anciens. Le champ de la peinture est divisé en deux par une île avec un sacellum, au-devant duquel s'élève une statue de Poséidon ; à droite manœuvrent deux vaisseaux dont l'un semble poursuivre l'autre ; à gauche, un des navires, entr'ouvert sans doute par l'éperon de son adversaire, sombre, et ne laisse plus voir au-dessus des flots que la partie supérieure de son aplustrum pendant que l'autre continue sa route. Ce sont bien 105 là les deux mêmes navires ; car le navire qui poursuit à droite et celui qui s'éloigne à gauche de toute la vitesse de ses rames, est percé à la proue de deux yeux, tandis que le navire qui a sombré était dépourvu de cet ornement. Les peintures découvertes en 1848 dans les fouilles du mont Esquilin nous offrent un exemple, sinon plus frappant, du moins plus incontestable, de ce procédé ; l'artiste en effet, pour éviter toute méprise sur ses intentions, a écrit les noms au-dessus de ses personnages. Le sujet d'une de ces peintures est la réception d'Ulysse par Circé (129). L'œil pénètre dans l'intérieur du palais de Circé : nous apercevons à droite une espèce de cour circulaire, décorée dans le fond de colonnes doriques, et fermée par des colonnes qui supportent un entablement ; devant ce portique a lieu la scène principale. Circé s'est jetée aux pieds d'Ulysse qui a tiré l'épée ; une servante, de petite taille, prend la fuite. A gauche, entre le mur épais qui ferme la cour circulaire, et un pilier, élevé sur le bord même de la mer, on voit une porte ouverte : Circé est là avec sa servante ; elle reçoit Ulysse qui demande l'hospitalité. Ainsi deux scènes se trouvent presque sur le même plan, l'une à côté de l'autre, dans le même local, séparées par un pan de mur qui est oblique et n'empêcherait pas les personnages placés près de la porte de voir ceux de la cour, s'ils n'étaient les mêmes. Il serait intéressant de savoir si les peintures esquilines sont antérieures ou postérieures aux peintures campaniennes ; dans le second cas, elles pourraient servir à prouver que ce mode de composition, discrètement employé par les peintres de Potnpéi, fut copié ou plus franchement adopté, et on pourrait les considérer comme formant un anneau intermédiaire entre la peinture du premier siècle et celle du troisième, telle du moins que celle dernière se montre à nous dans les descriptions de Philostrate. Nous devons reconnaître toutefois que les archéologues, se fondant sur la forme des lettres qui entrent dans les inscriptions, et sur le style de la dé- 106 coration architecturale, font remonter à l'époque d'Auguste l'exécution de ces peintures. Cette date n'est peut-être pas très certaine; mais nous n'avons pas précisément besoin de la contester; il est clair en effet qu'en supposant les peintures esquilines exécutées un peu avant les peintures campaniennes, il n'y a pas lieu de s'étonner d'un degré de plus ou de moins dans la hardiesse de la composition. Le développement d'un art ou d'un procédé n'est jamais si régulier qu'on puisse avec certitude classer ses différentes phases par ordre chronologique, surtout quand il s'agit d'un temps peu considérable.
Les peintures esquilines sont décoratives, il est vrai, comme les peintures campaniennes ; les peintures décrites par Philostrate semblent, au contraire, avoir été de véritables tableaux, mais, comme nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer, cet échange de procédés entre les peintures d'ordre différent n'a rien qui puisse surprendre, à une époque de décadence où l'imitation à tous les degrés et sous toutes les formes est précisément le caractère de l'art. Quelques indices confirment d'ailleurs sur ce point le témoignage que nous donne Philostrate sur la peinture du troisième siècle. Un tableau décrit par Achille Tatius (130) se composait de deux scènes empruntées à l'histoire de Térée : dans l'une Philomèle montrait à sa sœur Procnè le tissu qu'elle venait de broder ; dans l'autre, Térée, à la vue des restes sanglants d'Ithis, se préparait à poursuivre les deux sœurs. Qu'il nous soit permis de citer ici les peintures des catacombes ; si, comme l'a démontré M. Rossi (131), elles se distinguent de l'art païen, si elles ne lui ont pas emprunté leurs principaux motifs, si elles ont apporté dans la représentation de scènes nouvelles un sentiment nouveau, il n'en est pas moins vrai qu'à certains égards, dans le choix des ornements, dans la manière de grouper ou de disposer les personnages, elles se rapprochent souvent des habi- 107 tudes de l'art antique. On retrouverait dans quelques-unes de ces peintures le même mode de composition que dans les descriptions de Philostrate. Par exemple, une planche de l'ouvrage de M. Rossi (132) représente l'aventure de Jonas ; à droite on voit le navire d'où Jonas se précipite dans les flots ; au milieu de la composition, Jonas est rejeté par le monstre, dans l'estomac duquel il a passé trois jours et trois nuits ; à gauche Jonas, sain et sauf, repose sous un berceau. Une autre peinture nous montre Moïse dans des actions et des attitudes différentes (133) : à gauche, le pied sur un rocher, il rattache sa chaussure, comme pour indiquer qu'il va gravir la montagne ; à droite il frappe le rocher de sa baguette. Selon M. Rossi la première de ces peintures serait du deuxième siècle; la seconde serait postérieure ; ces dates, comme on le voit, se rapportent assez bien à celles des tableaux décrits par le rhéteur grec. Une peinture du quatrième siècle, décrite par saint Astère d'Amasée, offrait aussi le même caractère. « L'artiste, dit M. le Riant (134), qui la cite dans son étude sur les Actes des martyrs et leurs sources, l'artiste groupant dans un même tableau, suivant un usage familier aux anciens, les épisodes différents d'un fait célèbre, avait représenté sur la toile (ἐν σινδόνι) la comparution de sainte Euphémie, son interrogatoire, ses tortures, sa détention et son supplice (135). »
(1) Ἀκταί, le mot est au pluriel, quoiqu'il n'y ait dans la peinture qu'un seul personnage. L'artiste ou l'auteur de l'inscription aura moins pensé à l'être allégorique lui-même qu'au développement des côtes.
(2) Il est à remarquer que le mot de l'inscription νόμαι, est du féminin, et que les personnages ont des figures d'hommes ; celle anomalie ne paraît pas avoir choqué les anciens ; toute convention leur déplaisait moins qu'à nous. Voir pour ces peintures Woermann, Die antiken Odysseelandschaften.
(3) Helbig, n_ 1187.
(4) Id.,n° 114.
(5) Dans un des portraits d'Alcibiade par Aglaophon.
(6) Helbig, n° 1258.
(7) Friedrichs, Die Phil. Bilder.
(8) Ant. d'Hère., III, 17 ; Roux et Barré, II, 37; Helbig, Wandg., 955.
(9) Friedrichs, Die Ph. B., p. 153; Bruun, Die Phil. Gem.
(10) Pausanias, II, 27, 3.
(11) Id., VI, 24, 8.
(12) Le rhéteur Choricios, décrivant le Sommeil qui était représenté près de Thées endormi, remarque ce double caractère de la divinité allégorique : « Pour montrer la rapidité du Sommeil à tromper nos sens, à engourdir notre esprit, à fermer nos paupières, le peintre en a fait une espèce d'ombre ailée ; sa tête est entourée d'un bandeau blanc, car il triomphe de tous les hommes. Le visage penché sur ses deux mains qu'il a posées l'une sur l'autre, il dort avec délices, subissant sa propre influence, manifestant sa nature à la fois par son action et par son attitude; il se cache le visage ; car personne ne voit venir le Sommeil (Nous lisons ὅπερ ἐστί παθὼν, se ipsum, qualis est, passus et non παθὼν, comme Boissonn. Choric., p. 150.)
(13) ) Zahn, II, 32; Helbig, W., n° 155 ; Cf. Jahn, Arch. Beitr., p. 16.
(14) Zahn, II, 30; Helbig, n° 340. Cf. Jahn., Arch.Beiträg., p. 47.
(15) Lucien, Pseud., 4. Cf. Meineke, Comicor. fragm., IV, p. 307.
(16) Athen., V, 194, 190.
(17) Tableau d'Apelle (Luc. d. Calumn., 5).
(18) Anth. gr., II, 49, 13; Pal. App.,66.(
(19) Libanius, Ἀντιοχικός, I, p. 311. Reiske.
(20) Cf. Helbig, Unters., p. 219, et les ouvrages auxquels il renvoie.
(21) Près de Médée, sur un vase de Canosa (Arch. Zeit., 1847. Taf. 3).
(22) Près de Tellus, sur un vase de Ruvo ; jointe à l'Asie sur le vase de Darius (Ann. dell' Inst., 1873).
(23) Sur un vase de Pestum (Mons. de Inst., VIII, trad. 10; Cf. Arch. Zeit., 1874, p. 82 et suiv.).
(24) Helbig, Unters., p. 216.
(25) Labarte, Htst. des arts industr. au moyen âge, pl. II, 78. Cf. Woltmann, G. der Malerei, 1879, p. 185 et suiv.
(26) Ou trouve aussi de très hardies personnifications dans la description du rhéteur Marcus Eugeuicus. Une vieille femme ridée, amaigrie, une ombre véritable, représente la Solitude, dans un tableau de la Naissance du Christ (Kays., p. 137). Mais l'authenticité de ces descriptions est au moins aussi contestable que celle des descriptions de Philostrate; elle l'est même plus ; car Marcus Eugenicus imite évidemment notre sophiste. Voir l'édit. de Kayser et les notes.
(27) Overb., Die Bildw. Taf. XXXIII n° 12; texte, p. 789; Bouillon, III, 58 (c'est un bas-relief du Louvre).
(28) Müller-Wiesel, I, 39.
(29) Millin, Gal. myth., 79, 430.
(30) Le cas est assez fréquent, voir dans l'Arch. Zeit., 1869, pi. XVIII, la reproduct. d'une peinture de vase qui représente le supplice de Marsyas ; les Muses n'ont aucun attribut : Athéné et Aphrodite sont aussi représentées assez souvent sans insignes. Voir l'art, de M. Fr. Lenormand dans la Gaz. arch. de 1875, p. 34, à propos d'un bas-relief découvert sur l'Acropole d'Athènes et représentant une victoire ou Athéna Nicopolis qui couronne un athlète.
(31) Müller-Wiesel., 488.
(32) Cf. Woermann, Die Odysseenlandsch., 1er tableau; Virgile du Vatican, Bartoli, p. 29; les Vents sur la tour d'Andronicus Cyrrhestès ( O. Müller, trad. Niçard, pi. XXXVII).
(33) Sur cette question voir Jahn, Arch. Beitr., 247; Ungeflügelte Eroten.
(34) Helbig, Wandg., n° 1183 et suiv.
(35) Voir les textes réunis dans Overb., Die Antik. Schriftq., n° 1463 et suiv.
(36) Ph. V. Ap., IV, 28.
(37) Paus.. I, 15, 3.
(38) Paus., X, 2S-31. (
(39) Lucien, Sur un apporterm, 23.
(40) Over., Die Bildw., pi. XXVIII, 9,
(41) Over., Bildw., p. 695, n° 28 et suiv.
(42) Plut., De audiendis poetis, 18; Ὁρέστω μητροκτονία. Cf. Brunn, G. d. g. K., II. 255 ; Brunu conjecture que son tableau de Cassandre avait beaucoup de rapports avec celui que décrit Philostrate soua le même nom.
(43) Anth. G. ,II, 159, 20.
(44) Bürger, Salons, II, 119.
(45) PI..H. n.,35, 136.
(46)) Helbig, W., n° 1287. O. Jahn, Arch. Beitr., p. 348.
(47) Helbig, W., 1288-1290.
(48) Id., ibid., 1391.
(49) Helb., 1331-1332.
(50) Helbig, W.,329 et suiv.
(51) Ibid., 1381 ; Untersuchung., p. 4.
(52) Helbig, 1063.
(53) En,, III, 426 : et pulchro pectore virgo Pube tenus.
(54) Hésiode, Scutum Hercul., 144-168; traduct. de M. Leconte de Lisle.
(55) Paus.,X,28, 7.
(56) Cf. Brunn, II, 56 ; Calliphon est antérieur à Polygnote. Sur l'époque de Polygnote voir Bruno, II, 15; Polygnote florissait avant la 2e ann. de la 78e Olymp (467 av. J.-Ch.), peut-être avant la 4e de la 75e (477 av. J.-Ch.). M. Rossignol (des Services..., etc., p. 317), adopte 480 pour la date approximative du tableau de Calliphon.
(57) Le véritable nom serait Crésilas (Cf. Brunn, G. d. g. K., I, 260). Voir la statue dans Müller-Wies., A. D., 1, 137, dans Mus. Capit., III, 46. Voir Momtmenti ined., VIII, tav. XX des sculpt. de l'école de Pergarae, surtout le n° 3 ; le sang coule à flots sur le marbre; la rigidité cadavérique est très bien marquée.
(58) Müller-Wieseler, A. D., I, 218.(
(59) ld.,ibid., n° 217.
(60) Plut. Qu. conviv., V, 1, 2.
(61) Plut., De aud. poetis, 3, 3.
(62) Frère de Polygnote
(63) Pline, H. n., 35, 90.
(64) PI., 35, 1 10 et Anth. anall., II, 275.
(65) Overb., Die Büdw. Atl., XXV, 24; Millin, P. d. V., l, 25; G. M., 106, 608.
(66) Overb., Die Bildw., XVII, 3; Gerh., Trinksch. u. Gef., I, Taf. C. 7
(67) Cat. Camp., IV, VII, 638 ; Brunn, de Ph. G., p. 219.
(68) Overb., Die Bildw. Atl., V, 8 et 9. (
(69) Id., ibid., n° 10.
(70) Poet., IV, trad. Egger.
(71) Le Thésée de Parrhasius; le mot est d'Euphranor. PI., H. n., 35, 129.
(72) L'Aphr. anad. d'Apelle, 11, 35, 01, Cic., de Natura deor., I, 27, 75 : « Corpus illud non est, sed simile corporis, etc. »
(73) Plut., De aud. poetis.
(74) Sarc. Accoramboni, auj. à Munich; Over., Die Bildw., A, XXX, 1; p. 724. Cf. le sarc. Grimani-Spago, Overb., ibid., XXX, 2.
(75) Ach. Tat., Erot., III, 6; Parrhasius avait peint également un Prométhée; dans quel style, nous ne savons: mais on prétendait que l'artiste avait fait torturer devant lui un captif olympien, aûn de peindre d'après nature les souffrances de Promélhée (Sen., Rh. contr., V, 10). Vraie ou fausse, cette anecdote permet de supposer que Parrhasius avait poussé très loin l'imitation de la réalité.
(76) Hom. in PS. iv.
(77) ) J'emprunte cette traduct. à\ M. Bayet, Recherches, etc., p. 64.
(78) M. Eugen., 4, édit. Kaiser, p. 155
(79) Musée de Naples, Arch. Zeit., 1868, p. 41.
(80) Millin.G. M., 174,631.
(81)Tölken, IV, 385.
(82) Voir sur les peintures du Palatin, Perrot, Revue archéol., nouv. série, l. XXI et XXII, et Mélanges d'archéolog., p. 74 et suiv. Ces quelques pages montrent bien à notre sens, comment, dans ces sortes d'études, le sentiment des choses de l'art peut s'unir à l'esprit critique et à la science archéologique. Nous n'avons rien à envier à Otto Jaiin, si vanté en Allemagne pour ces qualités, et qui mérite de l'être en effet.
(83) Le Menteur d'inclination, 18 (trad. Tulbot).
(84 Brunn, G. d. g. K.,I, 131.
(85) 2) PI., H, n. XXXIV, 150 : « Syracusis autem claudicantem cujus ulceris dolorem sentire etiam spectanles videntur. » Cf. Lessing, Laocoon, c. n.
(86) Anth. anall., III, 213. (
(87) Anall., II, 348, 5, trad. F. D (Hachelle), II, p.. 152
(88) Ep. de Julien d'Egypte, Ant. Gr., III, 200, 27.
(89) Ph. j.,17.
(90) Trad. F. D (Hachette), II, 177.
(91))Helbig, W.,n° 218
(92) Helbig, W.,206 sq.
(93) Cl. Clarac, pi. CXIII, n° 65 et 69 ; pi. CXIV, n° 67 et 68 ; Fröhner, Notice de la se. ant., n° 103. Une statue du musée Britann; Müller-Wies., II, 186; une des peintures de la Campanie; Helbig, W., n° 249.
(94) Overb., Die Bildw., p. 782, Atl., 32, 3.
(95) Jahn, Arch. Beitr., 409 ; Jahn cite encore la métamorphose des Tyrrhéniens en dauphins sur le monument de Lysicrale ; mais la hardiesse de l'artiste peut sembler moins grande, en ce cas, le dauphin ayant déjà par lui-même quelque chose de la forme humaine; d'ailleurs la hardiesse est atténuée par l'habileté de transition entre les deux natures ainsi réunies.
(96) Deux œuvres modernes nous paraissent confirmer surtout celle vérité. Le Bernin a sculplé un groupe d'Apollon et Daphné ; la nymphe étend les mains, dont doigts s'allongent et se bifurquent en véritables rameaux, de manière à figurer une branche de laurier ; rien de plus disgracieux que cet éventail interminable, que cette greffe multiple de parties végétales sur autant de parties humaines. Au contraire, la statue de Phaéluse par Théodon ne mérite que des éloges ; les pieds poussent dans le sol des racines imperceptibles ; une des jambes est engagée dans l'écorce naissante qui d'un côté suit, sans la dérober, la rondeur de la hanche, de l'autre s'élève en serpentant jusqu'à la poitrine, en passant sous les mains croisées de la jeune l'emme. Le problème qui consiste à unir deux natures différentes est donc susceptible d'une heureuse solution ; et cette solution a été connue des anciens comme des modernes.
(97) Gerh., Neap. ant. Bildw. ; Mülller- Wies., II, 396.
(98) Müler-Wies., II, 394 ; Gerh., Etr. Sp., I, Taf. 82.
(99) Monun. dell' Inst.,IV, 30.
(100) Mus. Greg., II, 49.
(101) Ib., II, 42. (
(102) P. CL, 111,27. (
(103) Jahrb. d. rhein. Al. fr., I, 1. Cf. Brunn, Die Ph, Gem., p. 269.
(104) Wink.,St., n° 127; Tolken.121.
(105) Annali dell' Inst., 1872, p. 111.
(106) Raoul Rochelle (Choix de peint, de Pompéi, p. 89) voit une prolepse semblable sur une médaille des Laodicéens dePhrygie ; Jupiter y est représenté avec Bacchus mi l'uni, sur les genoux ; le chevreau, placé aux pieds de Jupiter, faisait allusion à la métamorphose de Bacchus eu bouc. Cf. le même ouvr., p. 132, 204 et 206.
(107) Anc. uned. Monum.,11, 15.
(108) Fröhner, Notice de la sculpt. antiq., n" 425.
(109) Müll.-Wies., 205.
(110) Woermann, Die Odyss. Landsch.
(111) Cf. Brizio, Pitture e Sepolcri scoperti sull' Esquilino nell' anno 1875; Roma, 1876.
(112)) Overb., Die Bildw., p. 739; AIt, XXX, n° 14.(
(113) Bas-relief Casali ; M. P.. Cl. IV, 17 ; Millin., Gal. M., 141, 516
(114) V. Bartoli, Virg. cod. Vatic. Picturae; Millin., G. M., 176 bis, 648.
(115) 1) Gerh., Auser. Vas. V., III, 232-234.
(116) ) Et. des mon. céramogr., I, 90 ; Mus. Greg., II, 7.
(117) Die Ph. Gem., p. 103.
(118)) Bull, dell' lnst., 1846, p. 106.
(119) Cat. Camp., IV, 647.
(120) Nous ne parlons point ici des vases dont l'avers et le revers présentent deux épisodes de la même action. Ces vases sont nombreux, et dans ce cas la répétition du même personnage est fréquente. Par exemple l'avers d'une amphore de Munich (Overb., Die Bildw., 501, n° 11) représente le combat d'Achille et de Penthésilée ; sur le revers, Achille et Memnon sont aux prises. Sur une coupe de Voici, connue sous le nom de coupe de Hiéron, le Jugement de Paris et l'Enlèvement d'Hélène par Paris se partagent les deux faces (Overb., Die Bildw., 219, n° 50).
(121) Bull, dell' lnst., 1583, p. 166.
(122) Voir, par exemple, dans Inghirami, Galleria Omerica, lav. XII, la margelle d'un puits de marbre sur laquelle l'artiste a sculpté les divers événements de la vie d'Achille, Achille an moment de sa naissance, Achille baigné dans les eaux du Styx, Achille rerais à Chiron, Achille assis sur le dos du centaure, etc., etc. Quelques-unes des scènes sont séparées de la voisine par une espèce de colonne; d'autres par un arbre, par une porte
(123) Falconet, traduct. du XXXVIe livre de Pline, note 26.
(124) Ingh., G. O., CCV.
(125) Helbig, Wandg., 249 bis.
(126) Ibid., n° 252. Taf. 8.
(127) Cf. Arch. Zeit., 1875, p. 134 et suiv. Taf. 13. D'après l'auteur de l'article (M. Cari Robert), il faudrait donner le nom d'Héraclès à un personnage qui se trouve auprès d'Hésione dans une peinture campanienne et que M. Helbig (n° 1130 aurait pris à tort pour Télamon ; il est du moins certain que le personnage en question, au lieu de délivrer Hésione de ses chaînes, comme le veut M. Helbig, se tient debout et tranquille et s'appuie sur une massue ; dans ce cas Héraclès, qui figure aussi au milieu du tableau, serait représenté deux fois.
(128) Helbig, Wandg., n° 1580; Pitt. d'Erc., I, 45. Cf. Helbig, Unters., p. 102.
(129) Woermann, Die Odysseelandsch.
(130) Ach. Tat., V, 3.
(131) Voir surtout Roma sottereanea, II, p. 231.
(132) II, PI. XIV.
(133) II, Tav. d'Agg.,B.
(134) Acad. des inscr. et belles-lettres, comptes rendus, t. VII, bull. juillet, août, sept., p. 211.
(135) De la peinture classique et de la peinture chrétienne des premiers siècles, ce procédé de composition passa dans la peinture byzantine. Les descriptions ou plutôt les projets de tableaux que renferme le Guide de la peinture du moine Denys (Manuel d'Iconographie chrétienne grecque et latine, Didron et P. Durand), la répétition du même personnage est fréquente. Nous n'en citerons qu'un exemple. Le moine indique ainsi la manière de représenter le Christ qui « commande aux vents et à la mer. » Une mer furieuse, et au milieu un petit navire naviguant. Le Christ endormi sur la proue. Pierre et Jean, pleins de crainte, étendent les mains vers lui. André tient le gouvernail ; Philippe et Thomas attachent les voiles. On voit une seconde fois le Christ au milieu du navire, « étendant les mains contre les vents et les réprimandant, » A quelle époque ce Guide de la peinture a-t-il été écrit? peut èlre au Xe siècle; peut être au xve; mais il est probable qu'il résume les enseignements les plus anciens et les traditions les plus lointaines de l'école. En Orient, le xve siècle est plus près du iie ou du ive qu'en Occident nous ne le sommes aujourd'hui du xve. On peul objecter qu'il s'agit dans le Guide de peintures murales, où les sujets se suivent, sans être limités et séparés par un cadre ; mais les tableaux de Philostrate avaient-ils un cadre? On sait d'ailleurs que, dans les monuments anciens, un objet quelconque, un pilier, un arbre, constitue une séparation suffisante entre deux compositions. C'est ainsi sans doute qu'il faut entendre un passage de saint Cyrille, traduit par M. Bayet, dans ses Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétienne en Orient (p. 22) : « Si quelqu'un aujourd'hui désirait voir figurée sur un tableau l'histoire d'Abraham, quels traits le peintre donnerait-il à son personnage ? Le montrerait-il en un seul tableau (ἐν ἑνί) accomplissant toutes les actions que l'on raconte, ou bien successivement dans chacune de ces actions et chaque fois différent de lui-même, ou bien encore toujours le même, mais dans plusieurs altitudes? Ainsi ferait-il à mon sens. » Saint Cyrille conseille de représenter l'histoire en une série de compositions distinctes l'une de l'autre ; mais, par sa première supposition, il montre qu'un artiste de son temps pouvait avoir l'idée de représenter tous les épisodes d'une même histoire, avec répétition du personnage principal, dans un même tableau. Les peintures, à sujets chrétiens ou mythologiques, décrites par Choricios de Gaza, dans ses diverses déclamations, se composaient aussi de différentes scènes et reproduisaient plusieurs fois les mêmes personnages; mais il semble qu'il devait y avoir une séparation quelconque entre les épisodes (Cf. Brunn,IBull. dell' Inst., 1849, p. 60; Matz, De Philostrat. fide, p. 18; Bayet, ouvr. cité, p. 60).
(136)