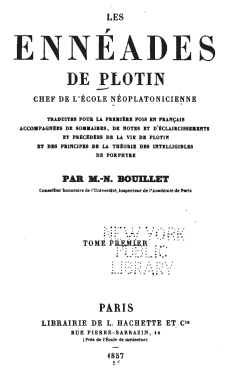
PLOTIN
PREMIÈRE ENNÉADE.
LIVRE QUATRIÈME. DU BONHEUR
Tome premier
Traduction française : M.-N. BOUILLET.
ENNÉADE I, LIVRE III - ENNÉADE I, LIVRE V
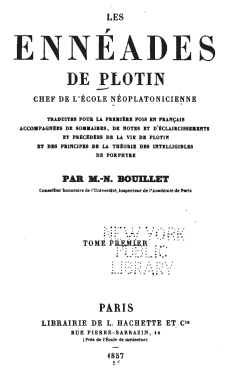
ENNÉADE I, LIVRE III - ENNÉADE I, LIVRE V
|
[1] Τὸ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ αὐτῷ τιθέμενοι καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἆρα τούτων μεταδώσομεν; Εἰ γὰρ ἔστιν αὐτοῖς ᾗ πεφύκασιν ἀνεμποδίστως διεξάγειν, κἀκεῖνα τί κωλύει ἐν εὐζωίᾳ λέγειν εἶναι; Καὶ γὰρ εἴτε ἐν εὐπαθείᾳ τὴν εὐζωίαν τις θήσεται, εἴτε ἐν ἔργῳ οἰκείῳ τελειουμένῳ, κατ´ ἄμφω καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρξει. Καὶ γὰρ εὐπαθεῖν ἐνδέχοιτο ἂν καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔργῳ εἶναι· οἷον καὶ τὰ μουσικὰ τῶν ζῴων ὅσα τοῖς τε ἄλλοις εὐπαθεῖ καὶ δὴ καὶ ᾄδοντα ᾗ πέφυκε καὶ ταύτῃ αἱρετὴν αὐτοῖς τὴν ζωὴν ἔχει. Καὶ τοίνυν καὶ εἰ τέλος τι τὸ εὐδαιμονεῖν τιθέμεθα, ὅπερ ἐστὶν ἔσχατον τῆς ἐν φύσει ὀρέξεως, καὶ ταύτῃ ἂν αὐτοῖς μεταδοίημεν τοῦ εὐδαιμονεῖν εἰς ἔσχατον ἀφικνουμένων, εἰς ὃ ἐλθοῦσιν ἵσταται ἡ ἐν αὐτοῖς φύσις πᾶσαν ζωὴν αὐτοῖς διεξελθοῦσα καὶ πληρώσασα ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος. Εἰ δέ τις δυσχεραίνει τὸ τῆς εὐδαιμονίας καταφέρειν εἰς τὰ ζῷα τὰ ἄλλα - οὕτω γὰρ ἂν καὶ τοῖς ἀτιμοτάτοις αὐτῶν μεταδώσειν· μεταδώσειν δὲ καὶ τοῖς φυτοῖς ζῶσι καὶ αὐτοῖς καὶ ζωὴν ἐξελιττομένην εἰς τέλος ἔχουσι - πρῶτον μὲν ἄτοπος διὰ τί εἶναι οὐ δόξει μὴ ζῆν εὖ τὰ ἄλλα ζῷα λέγων, ὅτι μὴ πολλοῦ ἄξια αὐτῷ δοκεῖ εἶναι; Τοῖς δὲ φυτοῖς οὐκ ἀναγκάζοιτο ἂν διδόναι ὃ τοῖς ἅπασι ζῴοις δίδωσιν, ὅτι μὴ αἴσθησις πάρεστιν αὐτοῖς. Εἴη δ´ ἄν τις ἴσως καὶ ὁ διδοὺς τοῖς φυτοῖς, εἴπερ καὶ τὸ ζῆν· ζωὴ δὲ ἡ μὲν εὖ ἂν εἴη, ἡ δὲ τοὐναντίον· οἷον ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν εὐπαθεῖν καὶ μή, καρπὸν αὖ φέρειν καὶ μὴ φέρειν. Εἰ μὲν οὖν ἡδονὴ τὸ τέλος καὶ ἐν τούτῳ τὸ εὖ ζῆν, ἄτοπος ὁ ἀφαιρούμενος τὰ ἄλλα ζῷα τὸ εὖ ζῆν· καὶ εἰ ἀταραξία δὲ εἴη, ὡσαύτως· καὶ εἰ τὸ κατὰ φύσιν ζῆν δὲ λέγοιτο τὸ εὖ ζῆν εἶναι. [2] Τοῖς μέντοι φυτοῖς διὰ τὸ μὴ αἰσθάνεσθαι οὐ διδόντες κινδυνεύσουσιν οὐδὲ τοῖς ζῴοις ἤδη ἅπασι διδόναι. Εἰ μὲν γὰρ τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦτο λέγουσι, τὸ τὸ πάθος μὴ λανθάνειν, δεῖ αὐτὸ ἀγαθὸν εἶναι τὸ πάθος πρὸ τοῦ μὴ λανθάνειν, οἷον τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν, κἂν λανθάνῃ, καὶ οἰκεῖον εἶναι, κἂν μήπω γινώσκῃ ὅτι οἰκεῖον καὶ ὅτι ἡδύ· δεῖ γὰρ ἡδὺ εἶναι. Ὥστε ἀγαθοῦ τούτου ὄντος καὶ παρόντος ἤδη ἐστὶν ἐν τῷ εὖ τὸ ἔχον. Ὥστε τί δεῖ τὴν αἴσθησιν προσλαμβάνειν; Εἰ μὴ ἄρα οὐκέτι τῷ γινομένῳ πάθει ἢ καταστάσει τὸ ἀγαθὸν διδόασιν, ἀλλὰ τῇ γνώσει καὶ αἰσθήσει. Ἀλλ´ οὕτω γε τὴν αἴσθησιν αὐτὴν τὸ ἀγαθὸν ἐροῦσι καὶ ἐνέργειαν ζωῆς αἰσθητικῆς· ὥστε καὶ ὁτουοῦν ἀντιλαμβανομένοις. Εἰ δὲ ἐξ ἀμφοῖν τὸ ἀγαθὸν λέγουσιν, οἷον αἰσθήσεως τοιούτου, πῶς ἑκατέρου ἀδιαφόρου ὄντος τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἀγαθὸν εἶναι λέγουσιν; Εἰ δὲ ἀγαθὸν μὲν τὸ πάθος, καὶ τὴν τοιάνδε κατάστασιν τὸ εὖ ζῆν, ὅταν γνῷ τις τὸ ἀγαθὸν αὐτῷ παρόν, ἐρωτητέον αὐτούς, εἰ γνοὺς τὸ παρὸν δὴ τοῦτο ὅτι πάρεστιν εὖ ζῇ, ἢ δεῖ γνῶναι οὐ μόνον ὅτι ἡδύ, ἀλλ´ ὅτι τοῦτο τὸ ἀγαθόν. Ἀλλ´ εἰ ὅτι τοῦτο τὸ ἀγαθόν, οὐκ αἰσθήσεως τοῦτο ἔργον ἤδη, ἀλλ´ ἑτέρας μείζονος ἢ κατ´ αἴσθησιν δυνάμεως. Οὐ τοίνυν τοῖς ἡδομένοις τὸ εὖ ζῆν ὑπάρξει, ἀλλὰ τῷ γινώσκειν δυναμένῳ, ὅτι ἡδονὴ τὸ ἀγαθόν. Αἴτιον δὴ τοῦ εὖ ζῆν οὐχ ἡδονὴ ἔσται, ἀλλὰ τὸ κρίνειν δυνάμενον, ὅτι ἡδονὴ ἀγαθόν. Καὶ τὸ μὲν κρῖνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος· λόγος γὰρ ἢ νοῦς· ἡδονὴ δὲ πάθος· οὐδαμοῦ δὲ κρεῖττον ἄλογον λόγου. Πῶς ἂν οὖν ὁ λόγος αὑτὸν ἀφεὶς ἄλλο θήσεται ἐν τῷ ἐναντίῳ γένει κείμενον κρεῖττον εἶναι ἑαυτοῦ; Ἀλλὰ γὰρ ἐοίκασιν, ὅσοι τε τοῖς φυτοῖς οὐ διδόασι καὶ ὅσοι αἰσθήσει τοιᾷδε τὸ εὖ, λανθάνειν ἑαυτοὺς μεῖζόν τι τὸ εὖ ζῆν ζητοῦντες καὶ ἐν τρανοτέρᾳ ζωῇ τὸ ἄμεινον τιθέντες. Καὶ ὅσοι δὲ ἐν λογικῇ ζωῇ εἶναι λέγουσιν, ἀλλ´ οὐχ ἁπλῶς ζωῇ, οὐδὲ εἰ αἰσθητικὴ εἴη, καλῶς μὲν ἴσως ἂν λέγοιεν. Διὰ τί δὲ οὕτω καὶ περὶ τὸ λογικὸν ζῷον μόνον τὸ εὐδαιμονεῖν τίθενται, ἐρωτᾶν αὐτοὺς προσήκει. Ἆρά γε τὸ λογικὸν προσλαμβάνεται, ὅτι εὐμήχανον μᾶλλον ὁ λόγος καὶ ῥᾳδίως ἀνιχνεύειν καὶ περιποιεῖν τὰ πρῶτα κατὰ φύσιν δύναται, ἢ κἂν μὴ δυνατὸς ᾖ ἀνιχνεύειν μηδὲ τυγχάνειν; Ἀλλ´ εἰ μὲν διὰ τὸ ἀνευρίσκειν μᾶλλον δύνασθαι, ἔσται καὶ τοῖς μὴ λόγον ἔχουσιν, εἰ ἄνευ λόγου φύσει τυγχάνοιεν τῶν πρώτων κατὰ φύσιν, τὸ εὐδαιμονεῖν· καὶ ὑπουργὸς ἂν ὁ λόγος καὶ οὐ δι´ αὑτὸν αἱρετὸς γίγνοιτο οὐδ´ αὖ ἡ τελείωσις αὐτοῦ, ἥν φαμεν ἀρετὴν εἶναι. Εἰ δὲ φήσετε μὴ διὰ τὰ κατὰ φύσιν πρῶτα ἔχειν τὸ τίμιον, ἀλλὰ δι´ αὑτὸν ἀσπαστὸν εἶναι, λεκτέον τί τε ἄλλο ἔργον αὐτοῦ καὶ τίς ἡ φύσις αὐτοῦ καὶ τί τέλειον αὐτὸν ποιεῖ. Ποιεῖν γὰρ δεῖ αὐτὸν τέλειον οὐ τὴν θεωρίαν τὴν περὶ ταῦτα, ἀλλὰ ἄλλο τι τὸ τέλειον αὐτῷ εἶναι καὶ φύσιν ἄλλην εἶναι αὐτῷ καὶ μὴ εἶναι αὐτὸν τούτων τῶν πρώτων κατὰ φύσιν μηδὲ ἐξ ὧν τὰ πρῶτα κατὰ φύσιν μηδ´ ὅλως τούτου τοῦ γένους εἶναι, ἀλλὰ κρείττονα τούτων ἁπάντων· ἢ πῶς τὸ τίμιον αὐτῷ οὐκ οἶμαι ἕξειν αὐτοὺς λέγειν. Ἀλλ´ οὗτοι μέν, ἕως ἂν κρείττονα εὕρωσι φύσιν τῶν περὶ ἃ νῦν ἵστανται, ἐατέοι ἐνταυθοῖ εἶναι, οὗπερ μένειν ἐθέλουσιν, ἀπόρως ἔχοντες ὅπῃ τὸ εὖ ζῆν, οἷς δυνατόν ἐστι τούτων. [3] Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ἐξ ἀρχῆς τί ποτε τὸ εὐδαιμονεῖν ὑπολαμβάνομεν εἶναι. Τιθέμενοι δὴ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν ζωῇ, εἰ μὲν συνώνυμον τὸ ζῆν ἐποιούμεθα, πᾶσι μὲν ἂν τοῖς ζῶσιν ἀπέδομεν δεκτικοῖς εὐδαιμονίας εἶναι, εὖ δὲ ζῆν ἐνεργείᾳ ἐκεῖνα, οἷς παρῆν ἕν τι καὶ ταὐτόν, οὗ ἐπεφύκει δεκτικὰ πάντα τὰ ζῷα εἶναι, καὶ οὐκ ἂν τῷ μὲν λογικῷ ἔδομεν δύνασθαι τοῦτο, τῷ δὲ ἀλόγῳ οὐκέτι· ζωὴ γὰρ ἦν τὸ κοινόν, ὃ δεκτικὸν τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν ἔμελλεν εἶναι, εἴπερ ἐν ζωῇ τινι τὸ εὐδαιμονεῖν ὑπῆρχεν. Ὅθεν, οἶμαι, καὶ οἱ ἐν λογικῇ ζωῇ λέγοντες τὸ εὐδαιμονεῖν γίνεσθαι οὐκ ἐν τῇ κοινῇ ζωῇ τιθέντες ἠγνόησαν τὸ εὐδαιμονεῖν οὐδὲ ζωὴν ὑποτιθέμενοι. Ποιότητα δὲ τὴν λογικὴν δύναμιν, περὶ ἣν ἡ εὐδαιμονία συνίσταται, ἀναγκάζοιντο ἂν λέγειν. Ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς λογική ἐστι ζωή· περὶ γὰρ τὸ ὅλον τοῦτο ἡ εὐδαιμονία συνίσταται· ὥστε περὶ ἄλλο εἶδος ζωῆς. Λέγω δὲ οὐχ ὡς ἀντιδιῃρημένον τῷ λόγῳ, ἀλλ´ ὡς ἡμεῖς φαμεν πρότερον, τὸ δὲ ὕστερον εἶναι. Πολλαχῶς τοίνυν τῆς ζωῆς λεγομένης καὶ τὴν διαφορὰν ἐχούσης κατὰ τὰ πρῶτα καὶ δεύτερα καὶ ἐφεξῆς καὶ ὁμωνύμως τοῦ ζῆν λεγομένου ἄλλως μὲν τοῦ φυτοῦ, ἄλλως δὲ τοῦ ἀλόγου καὶ τρανότητι καὶ ἀμυδρότητι τὴν διαφορὰν ἐχόντων, ἀνάλογον δηλονότι καὶ τὸ εὖ. Καὶ εἰ εἴδωλον ἄλλο ἄλλου, δηλονότι καὶ τὸ εὖ ὡς εἴδωλον αὖ τοῦ εὖ. Εἰ δὲ ὅτῳ ἄγαν ὑπάρχει τὸ ζῆν - τοῦτο δέ ἐστιν ὃ μηδενὶ τοῦ ζῆν ἐλλείπει - τὸ εὐδαιμονεῖν, μόνῳ ἂν τῷ ἄγαν ζῶντι τὸ εὐδαιμονεῖν ὑπάρχοι· τούτῳ γὰρ καὶ τὸ ἄριστον, εἴπερ ἐν τοῖς οὖσι τὸ ἄριστον τὸ ὄντως ἐν ζωῇ καὶ ἡ τέλειος ζωή· οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲ ἐπακτὸν τὸ ἀγαθὸν ὑπάρχοι, οὐδ´ ἄλλο τὸ ὑποκείμενον ἀλλαχόθεν γενόμενον παρέξει αὐτὸ ἐν ἀγαθῷ εἶναι. Τί γὰρ τῇ τελείᾳ ζωῇ ἂν προσγένοιτο εἰς τὸ ἀρίστῃ εἶναι; Εἰ δέ τις τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν ἐρεῖ, οἰκεῖος μὲν ὁ λόγος ἡμῖν, οὐ μὴν τὸ αἴτιον, ἀλλὰ τὸ ἐνυπάρχον ζητοῦμεν. Ὅτι δ´ ἡ τελεία ζωὴ καὶ ἡ ἀληθινὴ καὶ ὄντως ἐν ἐκείνῃ τῇ νοερᾷ φύσει, καὶ ὅτι αἱ ἄλλαι ἀτελεῖς καὶ ἰνδάλματα ζωῆς καὶ οὐ τελείως οὐδὲ καθαρῶς καὶ οὐ μᾶλλον ζωαὶ ἢ τοὐναντίον, πολλάκις μὲν εἴρηται· καὶ νῦν δὲ λελέχθω συντόμως ὡς, ἕως ἂν πάντα τὰ ζῶντα ἐκ μιᾶς ἀρχῆς ᾖ, μὴ ἐπίσης δὲ τὰ ἄλλα ζῇ, ἀνάγκη τὴν ἀρχὴν τὴν πρώτην ζωὴν καὶ τὴν τελειοτάτην εἶναι. [4] Εἰ μὲν οὖν τὴν τελείαν ζωὴν ἔχειν οἷός τε ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ὁ ταύτην ἔχων τὴν ζωὴν εὐδαίμων. Εἰ δὲ μή, ἐν θεοῖς ἄν τις τὸ εὐδαιμονεῖν θεῖτο, εἰ ἐν ἐκείνοις μόνοις ἡ τοιαύτη ζωή. Ἐπειδὴ τοίνυν φαμὲν εἶναι καὶ ἐν ἀνθρώποις τὸ εὐδαιμονεῖν τοῦτο, σκεπτέον πῶς ἐστι τοῦτο. Λέγω δὲ ὧδε· ὅτι μὲν οὖν ἔχει τελείαν ζωὴν ἄνθρωπος οὐ τὴν αἰσθητικὴν μόνον ἔχων, ἀλλὰ καὶ λογισμὸν καὶ νοῦν ἀληθινόν, δῆλον καὶ ἐξ ἄλλων. Ἀλλ´ ἆρά γε ὡς ἄλλος ὢν ἄλλο τοῦτο ἔχει; Ἢ οὐδ´ ἔστιν ὅλως ἄνθρωπος μὴ οὐ καὶ τοῦτο ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ ἔχων, ὃν δὴ καί φαμεν εὐδαίμονα εἶναι. Ἀλλ´ ὡς μέρος αὐτοῦ τοῦτο φήσομεν ἐν αὐτῷ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς τὸ τέλειον εἶναι; Ἢ τὸν μὲν ἄλλον ἄνθρωπον μέρος τι τοῦτο ἔχειν δυνάμει ἔχοντα, τὸν δὲ εὐδαίμονα ἤδη, ὃς δὴ καὶ ἐνεργείᾳ ἐστὶ τοῦτο καὶ μεταβέβηκε πρὸς τὸ αὐτό, εἶναι τοῦτο· περικεῖσθαι δ´ αὐτῷ τὰ ἄλλα ἤδη, ἃ δὴ οὐδὲ μέρη αὐτοῦ ἄν τις θεῖτο οὐκ ἐθέλοντι περικείμενα· ἦν δ´ ἂν αὐτοῦ κατὰ βούλησιν συνηρτημένα. Τούτῳ τοίνυν τί ποτ´ ἐστὶ τὸ ἀγαθόν; Ἢ αὐτὸς αὑτῷ ὅπερ ἔχει· τὸ δὲ ἐπέκεινα αἴτιον τοῦ ἐν αὐτῷ καὶ ἄλλως ἀγαθόν, αὐτῷ παρὸν ἄλλως. Μαρτύριον δὲ τοῦ τοῦτο εἶναι τὸ μὴ ἄλλο ζητεῖν τὸν οὕτως ἔχοντα. Τί γὰρ ἂν καὶ ζητήσειε; Τῶν μὲν γὰρ χειρόνων οὐδέν, τῷ δὲ ἀρίστῳ σύνεστιν. Αὐτάρκης οὖν ὁ βίος τῷ οὕτως ζωὴν ἔχοντι· καὶ σπουδαῖος ᾗ, αὐτάρκης εἰς εὐδαιμονίαν καὶ εἰς κτῆσιν ἀγαθοῦ· οὐδὲν γάρ ἐστιν ἀγαθὸν ὃ μὴ ἔχει. Ἀλλ´ ὃ ζητεῖ ὡς ἀναγκαῖον ζητεῖ, καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλά τινι τῶν αὐτοῦ. Σώματι γὰρ προσηρτημένῳ ζητεῖ· κἂν ζῶντι δὲ σώματι, τὰ αὑτοῦ ζῶντι τούτῳ, οὐχ ἃ τοιούτου τοῦ ἀνθρώπου ἐστί. : Καὶ γινώσκει ταῦτα καὶ δίδωσιν ἃ δίδωσιν οὐδὲν τῆς αὑτοῦ παραιρούμενος ζωῆς. Οὐδ´ ἐν τύχαις τοίνυν ἐναντίαις ἐλαττώσεται εἰς τὸ εὐδαιμονεῖν· μένει γὰρ καὶ ὣς ἡ τοιαύτη ζωή· ἀποθνῃσκόντων τε οἰκείων καὶ φίλων οἶδε τὸν θάνατον ὅ τι ἐστίν, ἴσασι δὲ καὶ οἱ πάσχοντες σπουδαῖοι ὄντες. Οἰκεῖοι δὲ καὶ προσήκοντες τοῦτο πάσχοντες κἂν λυπῶσιν, οὐκ αὐτόν, τὸ δ´ ἐν αὐτῷ νοῦν οὐκ ἔχον, οὗ τὰς λύπας οὐ δέξεται. [5] Ἀλγηδόνες δὲ τί καὶ νόσοι καὶ τὰ ὅλως κωλύοντα ἐνεργεῖν; Εἰ δὲ δὴ μηδ´ ἑαυτῷ παρακολουθοῖ; Γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἐκ φαρμάκων καί τινων νόσων. Πῶς δὴ ἐν τούτοις ἅπασι τὸ ζῆν εὖ καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν ἂν ἔχοι; Πενίας γὰρ καὶ ἀδοξίας ἐατέον. Καίτοι καὶ πρὸς ταῦτα ἄν τις ἀποβλέψας ἐπιστήσειε καὶ πρὸς τὰς πολυθρυλλήτους αὖ μάλιστα Πριαμικὰς τύχας· ταῦτα γὰρ εἰ καὶ φέροι καὶ ῥᾳδίως φέροι, ἀλλ´ οὐ βουλητά γε ἦν αὐτῷ· δεῖ δὲ βουλητὸν τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι· ἐπεὶ οὐδὲ τοῦτον εἶναι τὸν σπουδαῖον ψυχὴν τοιάνδε, μὴ συναριθμεῖσθαι δ´ αὐτοῦ τῇ οὐσίᾳ τὴν σώματος φύσιν. Ἑτοίμως γὰρ τοῦτο φαῖεν ἂν λαμβάνειν, ἕως ἂν αἱ τοῦ σώματος πείσεις πρὸς αὐτὸν ἀναφέρωνται καὶ αὖ καὶ αἱ αἱρέσεις καὶ φυγαὶ διὰ τοῦτο γίγνωνται αὐτῷ. Ἡδονῆς δὲ συναριθμουμένης τῷ εὐδαίμονι βίῳ, πῶς ἂν λυπηρὸν διὰ τύχας καὶ ὀδύνας ἔχων εὐδαίμων εἴη, ὅτῳ ταῦτα σπουδαίῳ ὄντι γίγνοιτο; Ἀλλὰ θεοῖς μὲν ἡ τοιαύτη διάθεσις εὐδαίμων καὶ αὐτάρκης, ἀνθρώποις δὲ προσθήκην τοῦ χείρονος λαβοῦσι περὶ ὅλον χρὴ τὸ γενόμενον τὸ εὔδαιμον ζητεῖν, ἀλλὰ μὴ περὶ μέρος, ὃ ἐκ θατέρου κακῶς ἔχοντος ἀναγκάζοιτο ἂν καὶ θάτερον τὸ κρεῖττον ἐμποδίζεσθαι πρὸς τὰ αὐτοῦ, ὅτι μὴ καὶ τὰ τοῦ ἑτέρου καλῶς ἔχει. Ἢ ἀπορρήξαντα δεῖ σῶμα ἢ καὶ αἴσθησιν τὴν σώματος οὕτω τὸ αὔταρκες ζητεῖν πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν ἔχειν. [6] Ἀλλ´ εἰ μὲν τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ μὴ ἀλγεῖν μηδὲ νοσεῖν μηδὲ δυστυχεῖν μηδὲ συμφοραῖς μεγάλαις περιπίπτειν ἐδίδου ὁ λόγος, οὐκ ἦν τῶν ἐναντίων παρόντων εἶναι ὁντινοῦν εὐδαίμονα· εἰ δ´ ἐν τῇ τοῦ ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ κτήσει τοῦτό ἐστι κείμενον, τί δεῖ παρέντας τοῦτο καὶ τὸ πρὸς τοῦτο βλέποντας κρίνειν τὸν εὐδαίμονα τὰ ἄλλα ζητεῖν, ἃ μὴ ἐν τῷ εὐδαιμονεῖν ἠρίθμηται; Εἰ μὲν γὰρ συμφόρησις ἦν ἀγαθῶν καὶ ἀναγκαίων ἢ καὶ οὐκ ἀναγκαίων, ἀλλ´ ἀγαθῶν καὶ τούτων λεγομένων, ἐχρῆν καὶ ταῦτα παρεῖναι ζητεῖν· εἰ δὲ τὸ τέλος ἕν τι εἶναι ἀλλ´ οὐ πολλὰ δεῖ - οὕτω γὰρ ἂν οὐ τέλος, ἀλλὰ τέλη ἂν ζητοῖ - ἐκεῖνο χρὴ λαμβάνειν μόνον, ὃ ἔσχατόν τέ ἐστι καὶ τιμιώτατον καὶ ὃ ἡ ψυχὴ ζητεῖ ἐν αὑτῇ ἐγκολπίσασθαι. Ἡ δὲ ζήτησις αὕτη καὶ ἡ βούλησις οὐχὶ τὸ μὴ ἐν τούτῳ εἶναι· ταῦτα γὰρ οὐκ αὐτῇ φύσει, ἀλλὰ παρόντα μόνον φεύγει ὁ λογισμὸς ἀποικονομούμενος ἢ καὶ προσλαμβάνων ζητεῖ· αὐτὴ δὲ ἡ ἔφεσις πρὸς τὸ κρεῖττον αὐτῆς, οὗ ἐγγενομένου ἀποπεπλήρωται καὶ ἔστη, καὶ οὗτος ὁ βουλητὸς ὄντως βίος. Τῶν δ´ ἀναγκαίων τι παρεῖναι οὐ βούλησις ἂν εἴη, εἰ κυρίως τὴν βούλησιν ὑπολαμβάνοι, ἀλλὰ μὴ καταχρώμενος ἄν τις λέγοι, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα παρεῖναι ἀξιοῦμεν. Ἐπεὶ καὶ ὅλως τὰ κακὰ ἐκκλίνομεν, καὶ οὐ δήπου βουλητὸν τὸ τῆς ἐκκλίσεως τῆς τοιαύτης· μᾶλλον γὰρ βουλητὸν τὸ μηδὲ δεηθῆναι τῆς ἐκκλίσεως τῆς τοιαύτης. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὐτά, ὅταν παρῇ· οἷον ὑγίεια καὶ ἀνωδυνία. Τί γὰρ τούτων ἐπαγωγόν ἐστι; Καταφρονεῖται γοῦν ὑγίεια παροῦσα καὶ τὸ μὴ ἀλγεῖν. Ἃ δὲ παρόντα μὲν οὐδὲν ἐπαγωγὸν ἔχει οὐδὲ προστίθησί τι πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν, ἀπόντα δὲ διὰ τὴν τῶν λυπούντων παρουσίαν ζητεῖ〈ται〉, εὔλογον ἀναγκαῖα, ἀλλ´ οὐκ ἀγαθὰ φάσκειν εἶναι. Οὐδὲ συναριθμητέα τοίνυν τῷ τέλει, ἀλλὰ καὶ ἀπόντων αὐτῶν καὶ τῶν ἐναντίων παρόντων ἀκέραιον τὸ τέλος τηρητέον. [7] Διὰ τί οὖν ὁ εὐδαιμονῶν ταῦτα ἐθέλει παρεῖναι καὶ τὰ ἐναντία ἀπωθεῖται; Ἢ φήσομεν οὐχ ὅτι πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν εἰσφέρεταί τινα μοῖραν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὸ εἶναι· τὰ δ´ ἐναντία τούτων ἢ πρὸς τὸ μὴ εἶναι ἢ ὅτι ἐνοχλεῖ τῷ τέλει παρόντα, οὐχ ὡς ἀφαιρούμενα αὐτό, ἀλλ´ ὅτι ὁ ἔχων τὸ ἄριστον αὐτὸ μόνον βούλεται ἔχειν, οὐκ ἄλλο τι μετ´ αὐτοῦ, ὃ ὅταν παρῇ, οὐκ ἀφῄρηται μὲν ἐκεῖνο, ἔστι δ´ ὅμως κἀκείνου ὄντος. Ὅλως δὲ οὐκ, εἴ τι ὁ εὐδαίμων μὴ ἐθέλοι, παρείη δὲ τοῦτο, ἤδη παραιρεῖταί τι τῆς εὐδαιμονίας· ἢ οὕτω γε καθ´ ἑκάστην τὴν ἡμέραν μεταπίπτοι ἂν καὶ ἐκπίπτοι τῆς εὐδαιμονίας· οἷον εἰ καὶ παῖδα ἀποβάλλοι ἢ καὶ ὁτιοῦν τῶν κτημάτων. Καὶ μυρία ἂν εἴη ἃ οὐ κατὰ γνώμην ἐκβάντα οὐδέν τι παρακινεῖ τοῦ παρόντος τέλους αὐτῷ. Ἀλλὰ τὰ μεγάλα, φασί, καὶ οὐ τὰ τυχόντα. Τί δ´ ἂν εἴη τῶν ἀνθρωπίνων μέγα, ὥστ´ ἂν μὴ καταφρονηθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀναβεβηκότος πρὸς τὸ ἀνωτέρω ἁπάντων τούτων καὶ οὐδενὸς ἔτι τῶν κάτω ἐξηρτημένου; Διὰ τί γὰρ τὰς μὲν εὐτυχίας, ἡλίκαι οὖν ἐὰν ὦσιν, οὐ μεγάλας ἡγεῖται, οἷον βασιλείας καὶ πόλεων καὶ ἐθνῶν ἀρχάς, οὐδὲ οἰκίσεις καὶ κτίσεις πόλεων, οὐδ´ εἰ ὑπ´ αὐτοῦ γίγνοιντο, ἐκπτώσεις δὲ ἀρχῶν καὶ πόλεως αὐτοῦ κατασκαφὴν ἡγήσεταί τι εἶναι μέγα; Εἰ δὲ δὴ καὶ κακὸν μέγα ἢ ὅλως κακόν, γελοῖος ἂν εἴη τοῦ δόγματος καὶ οὐκ ἂν ἔτι σπουδαῖος εἴη ξύλα καὶ λίθους καὶ νὴ Δία θανάτους θνητῶν μέγα ἡγούμενος, ᾧ φαμεν δεῖν δόγμα παρεῖναι περὶ θανάτου τὸ ἄμεινον ζωῆς τῆς μετὰ σώματος εἶναι. Αὐτὸς δὲ εἰ τυθείη, κακὸν οἰήσεται αὐτῷ τὸν θάνατον, ὅτι παρὰ βωμοῖς τέθνηκεν; Ἀλλ´ εἰ μὴ ταφείη, πάντως που καὶ ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γῆν τεθὲν τὸ σῶμα σαπείη. Εἰ δ´ ὅτι μὴ πολυδαπάνως, ἀλλ´ ἀνωνύμως τέθαπται οὐκ ἀξιωθεὶς ὑψηλοῦ μνήματος, τῆς μικρολογίας. Ἀλλ´ εἰ αἰχμάλωτος ἄγοιτο, « πάρ τοί » ἐστιν « ὁδὸς » ἐξιέναι, εἰ μὴ εἴη εὐδαιμονεῖν. Εἰ δὲ οἰκεῖοι αὐτῷ αἰχμάλωτοι, οἷον « ἑλκόμεναι νυοὶ καὶ θυγατέρες » - τί οὖν, φήσομεν, εἰ ἀποθνῄσκοι μηδὲν τοιοῦτον ἑωρακώς; Ἆρ´ ἂν οὕτω δόξης ἔχοι ἀπιών, ὡς μὴ ἂν τούτων ἐνδεχομένων γενέσθαι; Ἀλλ´ ἄτοπος ἂν εἴη. Οὐκ ἂν οὖν δοξάσειεν, ὡς ἐνδέχεται τοιαύταις τύχαις τοὺς οἰκείους περιπεσεῖν; Ἆρ´ οὖν διὰ τὸ οὕτως ἂν δόξαι ὡς καὶ γενησομένου ἂν οὐκ εὐδαίμων; Ἢ καὶ δοξάζων οὕτως εὐδαίμων· ὥστε καὶ γινομένου. Ἐνθυμοῖτο γὰρ ἄν, ὡς ἡ τοῦδε τοῦ παντὸς φύσις τοιαύτη, οἵα καὶ τὰ τοιαῦτα φέρειν, καὶ ἕπεσθαι χρή. Καὶ πολλοὶ δὴ καὶ ἄμεινον αἰχμάλωτοι γενόμενοι πράξουσι. Καὶ ἐπ´ αὐτοῖς δὲ βαρυνομένοις ἀπελθεῖν· ἢ μένοντες ἢ εὐλόγως μένουσι καὶ οὐδὲν δεινόν, ἢ ἀλόγως μένοντες, δέον μή, αὑτοῖς αἴτιοι. Οὐ γὰρ δὴ διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄνοιαν οἰκείων ὄντων αὐτὸς ἐν κακῷ ἔσται καὶ εἰς ἄλλων εὐτυχίας καὶ δυστυχίας ἀναρτήσεται. [8] Τὸ δὲ τῶν ἀλγηδόνων αὐτοῦ, ὅταν σφοδραὶ ὦσιν, ἕως δύναται φέρειν, οἴσει· εἰ δὲ ὑπερβάλλουσιν, ἐξοίσουσι. Καὶ οὐκ ἐλεεινὸς ἔσται ἐν τῷ ἀλγεῖν, ἀλλὰ τὸ αὐτοῦ καίει [τῷ] ἔνδον φέγγος, οἷον ἐν λαμπτῆρι φῶς πολλοῦ ἔξωθεν πνέοντος ἐν πολλῇ ζάλῃ ἀνέμων καὶ χειμῶνι. Ἀλλ´ εἰ μὴ παρακολουθοῖ, ἢ παρατείνοι τὸ ἀλγεῖν ἐπὶ τοσοῦτον αἰρόμενον, ὥστε ἐν τῷ σφοδρῷ ὅμως μὴ ἀποκτιννύναι; Ἀλλ´ εἰ μὲν παρατείνοι, τί χρὴ ποιεῖν βουλεύσεται· οὐ γὰρ ἀφῄρηται τὸ αὐτεξούσιον ἐν τούτοις. Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς οὐχ, οἷα τοῖς ἄλλοις φαίνεται, τοιαῦτα καὶ τῷ σπουδαίῳ φανεῖται ἕκαστα, καὶ οὐ μέχρι τοῦ εἴσω ἕκαστα οὔτε τὰ ἄλλα [οὔτε ἀλγεινὰ] οὔτε τὰ λυπηρά. Καὶ ὅταν περὶ ἄλλους τὰ ἀλγεινά; ἀσθένεια γὰρ εἴη ψυχῆς ἡμετέρας. Καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ, ὅταν λανθάνειν ἡμᾶς κέρδος ἡγώμεθα καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν, εἰ γίγνοιτο, κέρδος εἶναι τιθεμένων καὶ οὐ τὸ ἐκείνων ἔτι σκοπουμένων, ἀλλὰ τὸ αὐτῶν, ὅπως μὴ λυποίμεθα. Τοῦτο δὲ ἡμετέρα ἤδη ἀσθένεια, ἣν δεῖ περιαιρεῖν, ἀλλὰ μὴ ἐῶντας φοβεῖσθαι μὴ γένηται. Εἰ δέ τις λέγοι οὕτως ἡμᾶς πεφυκέναι, ὥστε ἀλγεῖν ἐπὶ ταῖς τῶν οἰκείων συμφοραῖς, γιγνωσκέτω, ὅτι οὐ πάντες οὕτω, καὶ ὅτι τῆς ἀρετῆς τὸ κοινὸν τῆς φύσεως πρὸς τὸ ἄμεινον ἄγειν καὶ πρὸς τὸ κάλλιον παρὰ τοὺς πολλούς· κάλλιον δὲ τὸ μὴ ἐνδιδόναι τοῖς νομιζομένοις τῇ κοινῇ φύσει δεινοῖς εἶναι. Οὐ γὰρ ἰδιωτικῶς δεῖ, ἀλλ´ οἷον ἀθλητὴν μέγαν διακεῖσθαι τὰς τῆς τύχης πληγὰς ἀμυνόμενον, γινώσκοντα μὲν ὅτι τινὶ φύσει ταῦτα οὐκ ἀρεστά, τῇ δὲ αὑτοῦ φύσει οἰστά, οὐχ ὡς δεινά, ἀλλ´ ὡς παισὶ φοβερά. Ταῦτ´ οὖν ἤθελεν; Ἢ καὶ πρὸς τὰ μὴ θελητά, ὅταν παρῇ, ἀρετὴν καὶ πρὸς ταῦτα ἔχει δυσκίνητον καὶ δυσπαθῆ τὴν ψυχὴν παρέχουσαν. [9] Ἀλλ´ ὅταν μὴ παρακολουθῇ βαπτισθεὶς ἢ νόσοις ἢ μάγων τέχναις; Ἀλλ´ εἰ μὲν φυλάξουσιν αὐτὸν σπουδαῖον εἶναι οὕτως ἔχοντα καὶ οἷα ἐν ὕπνῳ κοιμώμενον, τί κωλύει εὐδαίμονα αὐτὸν εἶναι; Ἐπεὶ οὐδὲ ἐν τοῖς ὕπνοις ἀφαιροῦνται τῆς εὐδαιμονίας αὐτόν, οὐδ´ ὑπὸ λόγον ποιοῦνται τὸν χρόνον τοῦτον, ὡς μὴ πάντα τὸν βίον εὐδαιμονεῖν λέγειν· εἰ δὲ μὴ σπουδαῖον φήσουσιν, οὐ περὶ τοῦ σπουδαίου ἔτι τὸν λόγον ποιοῦνται. Ἡμεῖς δὲ ὑποθέμενοι σπουδαῖον, εἰ εὐδαιμονεῖ, ἕως ἂν εἴη σπουδαῖος, ζητοῦμεν. Ἀλλ´ ἔστω σπουδαῖος, φασί· μὴ αἰσθανόμενος μηδ´ ἐνεργῶν κατ´ ἀρετήν, πῶς ἂν εὐδαίμων εἴη; Ἀλλ´ εἰ μὲν μὴ αἰσθάνοιτο ὅτι ὑγιαίνοι, ὑγιαίνει οὐδὲν ἧττον, καὶ εἰ μὴ ὅτι καλός, οὐδὲν ἧττον καλός· εἰ δὲ ὅτι σοφὸς μὴ αἰσθάνοιτο, ἧττον σοφὸς ἂν εἴη; Εἰ μή πού τις λέγοι ὡς ἐν τῇ σοφίᾳ γὰρ δεῖ τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ παρακολουθεῖν αὐτῷ παρεῖναι· ἐν γὰρ τῇ κατ´ ἐνέργειαν σοφίᾳ καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν παρεῖναι. Ἐπακτοῦ μὲν οὖν ὄντος τοῦ φρονεῖν καὶ τῆς σοφίας λέγοι ἄν τι ἴσως ὁ λόγος οὗτος· εἰ δ´ ἡ τῆς σοφίας ὑπόστασις ἐν οὐσίᾳ τινί, μᾶλλον δὲ ἐν τῇ οὐσίᾳ, οὐκ ἀπόλωλε δὲ αὕτη ἡ οὐσία ἔν τε τῷ κοιμωμένῳ καὶ ὅλως ἐν τῷ λεγομένῳ μὴ παρακολουθεῖν ἑαυτῷ, καὶ ἔστιν ἡ τῆς οὐσίας αὐτὴ ἐνέργεια ἐν αὐτῷ καὶ ἡ τοιαύτη ἄυπνος ἐνέργεια, ἐνεργοῖ μὲν ἂν καὶ τότε ὁ σπουδαῖος ᾗ τοιοῦτος· λανθάνοι δ´ ἂν αὕτη ἡ ἐνέργεια οὐκ αὐτὸν πάντα, ἀλλά τι μέρος αὐτοῦ· οἷον καὶ τῆς φυτικῆς ἐνεργείας ἐνεργούσης οὐκ ἔρχεται εἰς τὸν ἄλλον ἄνθρωπον ἡ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἀντίληψις τῷ αἰσθητικῷ, καί, εἴπερ ἦμεν τὸ φυτικὸν ἡμῶν ἡμεῖς, ἡμεῖς ἂν ἐνεργοῦντες ἦμεν· νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐσμέν, ἡ δὲ τοῦ νοοῦντος ἐνέργεια· ὥστε ἐνεργοῦντος ἐκείνου ἐνεργοῖμεν ἂν ἡμεῖς. [10] Λανθάνει δὲ ἴσως τῷ μὴ περὶ ὁτιοῦν τῶν αἰσθητῶν· διὰ γὰρ τῆς αἰσθήσεως ὥσπερ μέσης περὶ ταῦτα ἐνεργεῖν δοκεῖ καὶ περὶ τούτων. Αὐτὸς δὲ ὁ νοῦς διὰ τί οὐκ ἐνεργήσει καὶ ἡ ψυχὴ περὶ αὐτὸν ἡ πρὸ αἰσθήσεως καὶ ὅλως ἀντιλήψεως; Δεῖ γὰρ τὸ πρὸ ἀντιλήψεως ἐνέργημα εἶναι, εἴπερ « τὸ αὐτὸ τὸ νοεῖν καὶ εἶναι ». Καὶ ἔοικεν ἡ ἀντίληψις εἶναι καὶ γίνεσθαι ἀνακάμπτοντος τοῦ νοήματος καὶ τοῦ ἐνεργοῦντος τοῦ κατὰ τὸ ζῆν τῆς ψυχῆς οἷον ἀπωσθέντος πάλιν, ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ περὶ τὸ λεῖον καὶ λαμπρὸν ἡσυχάζον. Ὡς οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις παρόντος μὲν τοῦ κατόπτρου ἐγένετο τὸ εἴδωλον, μὴ παρόντος δὲ ἢ μὴ οὕτως ἔχοντος ἐνεργείᾳ πάρεστιν οὗ τὸ εἴδωλον ἦν ἄν, οὕτω καὶ περὶ ψυχὴν ἡσυχίαν μὲν ἄγοντος τοῦ ἐν ἡμῖν τοιούτου, ᾧ ἐμφαίνεται τὰ τῆς διανοίας καὶ τοῦ νοῦ εἰκονίσματα, ἐνορᾶται ταῦτα καὶ οἷον αἰσθητῶς γινώσκεται μετὰ τῆς προτέρας γνώσεως, ὅτι ὁ νοῦς καὶ ἡ διάνοια ἐνεργεῖ. Συγκλασθέντος δὲ τούτου διὰ τὴν τοῦ σώματος ταραττομένην ἁρμονίαν ἄνευ εἰδώλου ἡ διάνοια καὶ ὁ νοῦς νοεῖ καὶ ἄνευ φαντασίας ἡ νόησις τότε· ὥστε καὶ τοιοῦτον ἄν τι νοοῖτο μετὰ φαντασίας τὴν νόησιν γίνεσθαι οὐκ οὔσης τῆς νοήσεως φαντασίας. Πολλὰς δ´ ἄν τις εὕροι καὶ ἐγρηγορότων καλὰς ἐνεργείας καὶ θεωρίας καὶ πράξεις, ὅτε θεωροῦμεν καὶ ὅτε πράττομεν, τὸ παρακολουθεῖν ἡμᾶς αὐταῖς οὐκ ἐχούσας. Οὐ γὰρ τὸν ἀναγινώσκοντα ἀνάγκη παρακολουθεῖν ὅτι ἀναγινώσκει καὶ τότε μάλιστα, ὅτε μετὰ τοῦ συντόνου ἀναγινώσκοι· οὐδὲ ὁ ἀνδριζόμενος ὅτι ἀνδρίζεται καὶ κατὰ τὴν ἀνδρίαν ἐνεργεῖ ὅσῳ ἐνεργεῖ· καὶ ἄλλα μυρία· ὥστε τὰς παρακολουθήσεις κινδυνεύειν ἀμυδροτέρας αὐτὰς τὰς ἐνεργείας αἷς παρακολουθοῦσι ποιεῖν, μόνας δὲ αὐτὰς οὔσας καθαρὰς τότε εἶναι καὶ μᾶλλον ἐνεργεῖν καὶ μᾶλλον ζῆν καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ πάθει τῶν σπουδαίων γενομένων μᾶλλον τὸ ζῆν εἶναι, οὐ κεχυμένον εἰς αἴσθησιν, ἀλλ´ ἐν τῷ αὐτῷ ἐν ἑαυτῷ συνηγμένον. [11] Εἰ δέ τινες μηδὲ ζῆν λέγοιεν τὸν τοιοῦτον, ζῆν μὲν αὐτὸν φήσομεν, λανθάνειν δ´ αὐτοὺς τὴν εὐδαιμονίαν τοῦ τοιούτου, ὥσπερ καὶ τὸ ζῆν. Εἰ δὲ μὴ πείθοιντο, ἀξιώσομεν αὐτοὺς ὑποθεμένους τὸν ζῶντα καὶ τὸν σπουδαῖον οὕτω ζητεῖν εἰ εὐδαίμων, μηδὲ τὸ ζῆν αὐτοῦ ἐλαττώσαντας τὸ εὖ ζῆν ζητεῖν εἰ πάρεστι μηδὲ ἀνελόντας τὸν ἄνθρωπον περὶ εὐδαιμονίας ἀνθρώπου ζητεῖν μηδὲ τὸν σπουδαῖον συγχωρήσαντας εἰς τὸ εἴσω ἐπεστράφθαι ἐν ταῖς ἔξωθεν ἐνεργείαις αὐτὸν ζητεῖν μηδὲ ὅλως τὸ βουλητὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔξω. Οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲ ὑπόστασις εὐδαιμονίας εἴη, εἰ τὰ ἔξω βουλητὰ λέγοι καὶ τὸν σπουδαῖον βούλεσθαι ταῦτα. Ἐθέλοι γὰρ ἂν καὶ πάντας ἀνθρώπους εὖ πράττειν καὶ μηδὲν τῶν κακῶν περὶ μηδένα εἶναι· ἀλλὰ μὴ γινομένων ὅμως εὐδαίμων. Εἰ δέ τις παράλογον ἂν αὐτὸν ποιήσειν φήσει, εἰ ταῦτα ἐθελήσει - μὴ γὰρ οἷόν τε τὰ κακὰ μὴ εἶναι - δῆλον ὅτι συγχωρήσει ἡμῖν ἐπιστρέφουσιν αὐτοῦ : τὴν βούλησιν εἰς τὸ εἴσω. [12] Τὸ δὲ ἡδὺ τῷ βίῳ τῷ τοιούτῳ ὅταν ἀπαιτῶσιν, οὐ τὰς τῶν ἀκολάστων οὐδὲ τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς ἀξιώσουσι παρεῖναι - αὗται γὰρ ἀδύνατοι παρεῖναι καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν ἀφανιοῦσιν - οὐδὲ μὴν τὰς περιχαρίας - διὰ τί γάρ; - ἀλλὰ τὰς συνούσας παρουσίᾳ ἀγαθῶν οὐκ ἐν κινήσεσιν οὔσας, οὐδὲ γινομένας τοίνυν· ἤδη γὰρ τὰ ἀγαθὰ πάρεστι, καὶ αὐτὸς αὑτῷ πάρεστι· καὶ ἕστηκε τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἵλεων τοῦτο· ἵλεως δὲ ὁ σπουδαῖος ἀεὶ καὶ κατάστασις ἥσυχος καὶ ἀγαπητὴ ἡ διάθεσις ἣν οὐδὲν τῶν λεγομένων κακῶν παρακινεῖ, εἴπερ σπουδαῖος. Εἰ δέ τις ἄλλο εἶδος ἡδονῆς περὶ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ, οὐ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ. [13] Οὐδ´ αἱ ἐνέργειαι δὲ διὰ τὰς τύχας ἐμποδίζοιντο ἄν, ἀλλὰ ἄλλαι ἂν κατ´ ἄλλας γίγνοιντο τύχας, πᾶσαι δὲ ὅμως καλαὶ καὶ καλλίους ἴσως ὅσῳ περιστατικαί. Αἱ δὲ κατὰ τὰς θεωρίας ἐνέργειαι αἱ μὲν καθ´ ἕκαστα τάχα ἄν, οἷον ἃς ἂν καὶ σκεψάμενος προφέροι· τὸ δὲ « μέγιστον μάθημα » πρόχειρον ἀεὶ καὶ μετ´ αὐτοῦ καὶ τοῦτο μᾶλλον, κἂν ἐν τῷ Φαλάριδος ταύρῳ λεγομένῳ ᾖ, ὃ μάτην λέγεται ἡδὺ δὶς ἢ καὶ πολλάκις λεγόμενον. Ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ φθεγξάμενον τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἐν τῷ ἀλγεῖν ὑπάρχον, ἐνταῦθα δὲ τὸ μὲν ἀλγοῦν ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο, ὃ συνὸν αὐτῷ, ἕως ἂν ἐξ ἀνάγκης συνῇ, οὐκ ἀπολελείψεται τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὅλου θέας. [14] Τὸ δὲ μὴ συναμφότερον εἶναι τὸν ἄνθρωπον καὶ μάλιστα τὸν σπουδαῖον μαρτυρεῖ καὶ ὁ χωρισμὸς ὁ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ἡ τῶν λεγομένων ἀγαθῶν τοῦ σώματος καταφρόνησις. Τὸ δὲ καθόσον ἀξιοῦν τὸ ζῷον τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι γελοῖον εὐζωίας τῆς εὐδαιμονίας οὔσης, ἣ περὶ ψυχὴν συνίσταται, ἐνεργείας ταύτης οὔσης καὶ ψυχῆς οὐ πάσης - οὐ γὰρ δὴ τῆς φυτικῆς, ἵν´ ἂν καὶ ἐφήψατο σώματος· οὐ γὰρ δὴ τὸ εὐδαιμονεῖν τοῦτο ἦν σώματος μέγεθος καὶ εὐεξία - οὐδ´ αὖ ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι εὖ, ἐπεὶ καὶ κινδυνεύσουσιν αἱ τούτων πλεονεξίαι βαρύνασαι πρὸς αὑτὰς φέρειν τὸν ἄνθρωπον. Ἀντισηκώσεως δὲ οἷον ἐπὶ θάτερα πρὸς τὰ ἄριστα γενομένης μινύθειν καὶ χείρω τὰ σωματικὰ ποιεῖν, ἵνα δεικνύοιτο οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἄλλος ὢν ἢ τὰ ἔξω. Ὁ δὲ τῶν τῇδε ἄνθρωπος ἔστω καὶ καλὸς καὶ μέγας καὶ πλούσιος καὶ πάντων ἀνθρώπων ἄρχων ὡς ἂν ὢν τοῦδε τοῦ τόπου, καὶ οὐ φθονητέον αὐτῷ τῶν τοιούτων ἠπατημένῳ. Περὶ δὲ σοφὸν ταῦτα ἴσως μὲν ἂν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν γένοιτο, γενομένων δὲ ἐλαττώσει αὐτός, εἴπερ αὑτοῦ κήδεται. Καὶ ἐλαττώσει μὲν καὶ μαρανεῖ ἀμελείᾳ τὰς τοῦ σώματος πλεονεξίας, ἀρχὰς δὲ ἀποθήσεται. Σώματος δὲ ὑγίειαν φυλάττων οὐκ ἄπειρος νόσων εἶναι παντάπασι βουλήσεται· οὐδὲ μὴν οὐδὲ ἄπειρον εἶναι ἀλγηδόνων· ἀλλὰ καὶ μὴ γινομένων νέος ὢν μαθεῖν βουλήσεται, ἤδη δὲ ἐν γήρᾳ ὢν οὔτε ταύτας οὔτε ἡδονὰς ἐνοχλεῖν οὐδέ τι τῶν τῇδε οὔτε προσηνὲς οὔτε ἐναντίον, ἵνα μὴ πρὸς τὸ σῶμα βλέπῃ. Γινόμενος δ´ ἐν ἀλγηδόσι τὴν πρὸς ταύτας αὐτῷ πεπορισμένην δύναμιν ἀντιτάξει οὔτε προσθήκην ἐν ταῖς ἡδοναῖς καὶ ὑγιείαις καὶ ἀπονίαις πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν λαμβάνων οὔτε ἀφαίρεσιν ἢ ἐλάττωσιν ταύτης ἐν τοῖς ἐναντίοις τούτων. Τοῦ γὰρ ἐναντίου μὴ προστιθέντος τῷ αὐτῷ πῶς ἂν τὸ ἐναντίον ἀφαιροῖ; [15] Ἀλλ´ εἰ δύο εἶεν σοφοί, τῷ δὲ ἑτέρῳ παρείη ὅσα κατὰ φύσιν λέγεται, τῷ δὲ τὰ ἐναντία, ἴσον φήσομεν τὸ εὐδαιμονεῖν αὐτοῖς παρεῖναι; Φήσομεν, εἴπερ ἐπίσης σοφοί. Εἰ δὲ καλὸς τὸ σῶμα ὁ ἕτερος καὶ πάντα τὰ ἄλλα ὅσα μὴ πρὸς σοφίαν μηδὲ ὅλως πρὸς ἀρετὴν καὶ τοῦ ἀρίστου θέαν καὶ τὸ ἄριστον εἶναι, τί τοῦτο ἂν εἴη; Ἐπεὶ οὐδὲ αὐτὸς ὁ ταῦτα ἔχων σεμνυνεῖται ὡς μᾶλλον εὐδαίμων τοῦ μὴ ἔχοντος· οὐδὲ γὰρ ἂν πρὸς αὐλητικὸν τέλος ἡ τούτων πλεονεξία συμβάλλοιτο. Ἀλλὰ γὰρ θεωροῦμεν τὸν εὐδαίμονα μετὰ τῆς ἡμετέρας ἀσθενείας φρικτὰ καὶ δεινὰ νομίζοντες, ἃ μὴ ἂν ὁ εὐδαίμων νομίσειεν· ἢ οὔπω οὔτε σοφὸς οὔτε εὐδαίμων εἴη μὴ τὰς περὶ τούτων φαντασίας ἁπάσας ἀλλαξάμενος καὶ οἷον ἄλλος παντάπασι γενόμενος πιστεύσας ἑαυτῷ, ὅτι μηδέν ποτε κακὸν ἕξει· οὕτω γὰρ καὶ ἀδεὴς ἔσται περὶ πάντα. Ἢ δειλαίνων περί τινα οὐ τέλεος πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ ἥμισύς τις ἔσται. Ἐπεὶ καὶ τὸ ἀπροαίρετον αὐτῷ καὶ τὸ γινόμενον πρὸ κρίσεως δέος κἄν ποτε πρὸς ἄλλοις ἔχοντι γένηται, προσελθὼν ὁ σοφὸς ἀπώσεται καὶ τὸν ἐν αὐτῷ κινηθέντα οἷον πρὸς λύπας παῖδα καταπαύσει ἢ ἀπειλῇ ἢ λόγῳ· ἀπειλῇ δὲ ἀπαθεῖ, οἷον εἰ ἐμβλέψαντος σεμνὸν μόνον παῖς ἐκπλαγείη. Οὐ μὴν διὰ ταῦτα ἄφιλος οὐδὲ ἀγνώμων ὁ τοιοῦτος· τοιοῦτος γὰρ καὶ περὶ αὑτὸν καὶ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ. Ἀποδιδοὺς οὖν ὅσα αὐτῷ καὶ τοῖς φίλοις φίλος ἂν εἴη μάλιστα μετὰ τοῦ νοῦν ἔχειν.
[16] Εἰ δέ τις μὴ ἐνταῦθα ἐν τῷ νῷ
τούτῳ ἄρας θήσει τὸν σπουδαῖον, κατάγοι δὲ πρὸς τύχας καὶ ταύτας
φοβήσεται περὶ αὐτὸν γενέσθαι, οὔτε σπουδαῖον τηρήσει, οἷον ἀξιοῦμεν
εἶναι, ἀλλ´ ἐπιεικῆ ἄνθρωπον, καὶ μικτὸν ἐξ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ διδοὺς
μικτὸν βίον ἔκ τινος ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ ἀποδώσει τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐ
ῥᾴδιον γενέσθαι. Ὃς εἰ καὶ γένοιτο, οὐκ ἂν ὀνομάζεσθαι εὐδαίμων εἴη
ἄξιος οὐκ ἔχων τὸ μέγα οὔτε ἐν ἀξίᾳ σοφίας οὔτε ἐν καθαρότητι
ἀγαθοῦ. Οὐκ ἔστιν οὖν ἐν τῷ κοινῷ εὐδαιμόνως ζῆν. Ὀρθῶς γὰρ καὶ
Πλάτων ἐκεῖθεν ἄνωθεν τὸ ἀγαθὸν ἀξιοῖ λαμβάνειν καὶ πρὸς ἐκεῖνο
βλέπειν τὸν μέλλοντα σοφὸν καὶ εὐδαίμονα ἔσεσθαι καὶ ἐκείνῳ
ὁμοιοῦσθαι καὶ κατ´ ἐκεῖνο ζῆν. Τοῦτο οὖν δεῖ ἔχειν μόνον πρὸς τὸ
τέλος, τὰ δ´ ἄλλα ὡς ἂν καὶ τόπους μεταβάλλοι οὐκ ἐκ τῶν τόπων
προσθήκην πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν ἔχων, ἀλλ´ ὡς στοχαζόμενος καὶ τῶν
ἄλλων περικεχυμένων αὐτόν, οἷον εἰ ὡδὶ κατακείσεται ἢ ὡδί, διδοὺς
μὲν τούτῳ ὅσα πρὸς τὴν χρείαν καὶ δύναται, αὐτὸς δὲ ὢν ἄλλος οὐ
κωλυόμενος καὶ τοῦτον ἀφεῖναι, καὶ ἀφήσων δὲ ἐν καιρῷ φύσεως, κύριος
δὲ καὶ αὐτὸς ὢν τοῦ βουλεύσασθαι περὶ τούτου. Ὥστε αὐτῷ τὰ ἔργα τὰ
μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν συντείνοντα ἔσται, τὰ δ´ οὐ τοῦ τέλους χάριν
καὶ ὅλως οὐκ αὐτοῦ ἀλλὰ τοῦ προσεζευγμένου, οὗ φροντιεῖ καὶ
ἀνέξεται, ἕως δυνατόν, οἱονεὶ μουσικὸς λύρας, ἕως οἷόν τε χρῆσθαι·
εἰ δὲ μή, ἄλλην ἀλλάξεται, ἢ ἀφήσει τὰς λύρας χρήσεις καὶ τοῦ εἰς
λύραν ἐνεργεῖν ἀφέξεται ἄλλο ἔργον ἄνευ λύρας ἔχων καὶ κειμένην
πλησίον περιόψεται ᾄδων ἄνευ ὀργάνων. Καὶ οὐ μάτην αὐτῷ ἐξ ἀρχῆς τὸ
ὄργανον ἐδόθη· ἐχρήσατο γὰρ αὐτῷ ἤδη πολλάκις. |
[1] Si bien vivre (τὸ εὖ ζῇν) et être heureux (τὸ εὐδαιμονεῖν) nous semblent choses identiques, devons-nous pour cela accorder aux animaux le privilège d'arriver au bonheur? S'il leur est donné de suivre sans obstacle dans leur vie le cours de la nature, qu'est-ce qui empêche de dire qu'ils peuvent bien vivre? Car, si bien vivre consiste soit à posséder le bien-être, soit à accomplir sa fin propre (02), dans l'une et l'autre hypothèse les animaux sont capables d'y arriver : ils peuvent en effet posséder le bien-être et accomplir leur fin naturelle. Dans ce cas, les oiseaux chanteurs, par exemple, s'ils possèdent le bien-être et qu'ils chantent conformément à leur nature, mènent une vie désirable pour eux. Si nous supposons enfin que le bonheur est d'atteindre le but suprême auquel aspire la nature, nous devons encore dans ce cas admettre que les animaux ont part au bonheur quand ils atteignent ce but suprême : alors la nature n'excite plus en eux de désirs, parce que toute leur carrière est parcourue et que leur vie est remplie du commencement à la fin. On verra peut–être avec peine accorder le bonheur aux êtres vivants autres que l'homme, et l'on objectera sans doute qu'on est ainsi conduit à l'accorder aux êtres les plus vils, aux plantes mêmes : car elles vivent aussi, et leur vie a aussi une fin, qu'elles aspirent à atteindre par leur développement. Mais, d'abord, il semblerait peu raisonnable (03) de dire que les êtres vivants autres que l'homme ne peuvent posséder le bonheur par cette seule raison qu'ils nous paraissent des êtres vils; et d'ailleurs, on peut fort bien refuser aux plantes ce qu'on accorde aux autres êtres vivants, en donnant pour motif à cette exclusion que les plantes ne sont pas douées de sentiment. Il y aura peut-être des hommes qui accorderont aux plantes le bonheur, en se fondant sur ce qu'on Ieur accorde la vie : car du moment qu'un être vit, il peut vivre bien ou mal; c'est ainsi qu'il arrivera aux plantes de posséder ou de ne pas posséder le bien-être, de porter ou de ne pas porter de fruits. Si la volupté est la fin de l'homme (04), si bien vivre consiste à en jouir, il serait absurde de prétendre que les êtres vivants autres que l'homme ne sauraient bien vivre: Il en est de même si l'on réduit le bonheur à l'ataraxie [c'est–à-dire à un état de tranquillité imperturbable] (05), ou si on de fait consister à vivre conformément à la nature (06). [2] Ceux qui refusent aux végétaux le privilège de bien vivre, parce qu'ils ne sentent pas, ne sont pas pour cela obligés de l'accorder à tous les animaux. S'ils font consister le sentiment dans la connaissance de l'affection éprouvée, il faut que cette affection soit déjà un bien avant que la connaissance en ait lieu : il faut, par exemple, que l'être soit dans un état conforme à la nature, lors même qu'il l'ignore, qu'il remplisse sa fonction propre, lors même qu'il ne le sait pas, qu'il possède la volupté avant de la percevoir. Ainsi, comme, en possédant cette volupté, l'être possède déjà le bien, il possède par là même le bien-être. Pourquoi donc y joindre le sentiment? à moins qu'au lieu de faire consister le bien dans une affection, dans un état de l'âme, on ne, le place plutôt dans le sentiment et dans la connaissance [de cette affection, de cet état].
On ramène ainsi le bien à n'être que le sentiment,
l'acte de la vie sensitive, et, dans ce cas, pour le posséder, il suffit de
percevoir, quel que soit l'objet de notre perception. Dira-t-on que le bien
résulte de la réunion de ces deux choses, de l'état de l'âme et de la
connaissance qu'elle en a : s'iI consiste dans le sentiment de tel ou tel état,
nous demanderons comment des éléments qui par eux-mêmes sont indifférents
peuvent par leur réunion constituer le bien. Veut-on que le bien soit tel ou tel
état, que bien vivre consiste à posséder telle ou telle disposition et à
connaître qu'on jouit de la présence du bien, voici la question que nous
poserons alors : suffit-il pour bien vivre que l'être sache qu'il possède cet
état, ou bien faut-il qu'il sache non seulement que cet état est agréable, mais
encore que c'est le bien? S'il faut connaître que c'est le bien, ce n'est plus
la fonction du sentiment, mais d'une faculté supérieure aux sens : ainsi, pour
bien vivre, il ne suffira plus de posséder la volupté, il faudra encore savoir
que la volupté est le bien ; la cause du bonheur ne sera donc pas la présence de
la volupté même, mais le pouvoir de juger que la volupté est un bien. Or, ce qui
juge est supérieur à l'affection : c'est la raison ou l'intelligence, tandis que
la volupté n'est qu'une affection, et ce qui est irraisonnable ne saurait être
supérieur à la raison. Comment donc la raison s'oublierait-elle elle-même pour
reconnaître comme supérieur ce qui est placé dans un genre opposé à elle? Ces
hommes qui n'accordent pas (07)
aux plantes le bonheur, qui le font consister dans telle ou telle espèce de
sentiment, nous semblent à leur insu rechercher un bonheur d'une nature
supérieure et le regarder comme ce meilleur (τὸ ἄμεινον)
qu'on ne trouve que dans une vie plus complète. [3] Pour nous, reprenons la question à son principe et disons en quoi le bonheur nous semble consister. Si nous l'attribuons à un être vivant, nous ne faisons pas pour cela vie synonyme de bonheur: sinon, nous admettrions que tous les êtres vivants peuvent y arriver, et nous regarderions comme en jouissant réellement tous ceux qui auraient cette unité et cette identité que tous les êtres vivants sont naturellement capables de posséder. Enfin, nous ne saurions accorder ce privilège à l'être raisonnable et le refuser à la brute : car l'un et l'autre possèdent également la vie; ils devraient donc être capables d'arriver au bonheur, puisque, dans cette hypothèse, le bonheur ne serait qu'une espèce de vie. Par conséquent les philosophes qui le font consister dans la vie rationnelle, et non dans la vie commune à tous les êtres, ne s'aperçoivent pas qu'ils supposent implicitement que le bonheur est quelque chose de différent de la vie. Ils se voient alors obligés à dire que c'est dans une pure qualité, dans la faculté rationnelle, que réside le bonheur. Mais le sujet [auquel ils devraient rapporter, le bonheur], c'est la vie rationnelle, puisque c'est au tout seulement [à la vie jointe à la raison] que le bonheur peut appartenir. Ils font donc de cette vie une espèce de la vie : non qu'on ait le droit de regarder ces deux sortes de vie [la vie en général et la vie rationnelle] comme étant placées sur le même rang, ainsi que le seraient les deux membres d'une division, mais on peut établir entre elles un autre genre de distinction, comme quand nous disons qu'une chose est antérieure, une autre postérieure. Puisque la vie peut s'entendre en plusieurs sens, qu'elle a des degrés divers, que par homonymie elle s'affirme en un sens du végétal, en un autre de la brute, que ses différences consistent en ce qu'elle est plus ou moins complète; l'analogie exige qu'il en soit de même de bien vivre. Si un être est par sa vie l'image de la vie d'un autre être, il sera aussi par son bonheur l'image du bonheur de cet être. Si le bonheur est le privilège de la vie complète, l'être qui possède une vie complète possédera seul aussi le bonheur: car il possède ce qu'il y a de meilleur, puisque, dans l'ordre des existences, ce qu'il y a de meilleur, c'est de posséder l'essence et la perfection de la vie. Par conséquent, le bien n'est pas une chose adventice ; nul sujet ne peut le devoir à une qualité qui lui viendrait d'ailleurs. Qu'ajouterait-on en effet à la vie complète pour la rendre excellente? Si quelqu'un demande quelle est la nature du bien, nous répondrons (car nous avons à en déterminer l'essence et non la cause) : la vie parfaite, véritable et réelle consiste dans l'intelligence: Les autres espèces de vie sont imparfaites; elles n'offrent que l'image de la vie; elles ne sont pas la vie dans sa plénitude et dans sa pureté ; elles ne sont pas la vie plutôt que son contraire, comme nous l'avons souvent dit. En un mot, puisque tous les êtres vivants dérivent d'un même principe, et que cependant ils ne possèdent pas un égal degré de vie; ce principe doit nécessairement être la vie première et la perfection (τὴν πρώτην ζώην καὶ τὴν τελειότητα). [4] Si l'homme est capable de posséder la vie parfaite, il est heureux dès qu'il la possède; s'il en était autrement, si aux dieux seuls appartenait la vie parfaite, à eux seuls aussi appartiendrait le bonheur. Mais puisque nous attribuons le bonheur aux hommes, nous avons à montrer en quoi consiste cette vie qui le procure. Or, je le répète : l'homme a la vie parfaite quand il possède, outre la vie sensitive, la raison et la véritable intelligence; cela est évident d'après les démonstrations que nous en avons données. Mais l'homme est-il par lui-même étranger à la vie parfaite et la possède-t-il comme une chose étrangère [à son essence]? Non, il n'y a pas d'homme qui ne possède soit en acte, soit en puissance, ce que nous appelons le bonheur. Mais regarderons-nous le bonheur comme une partie de l'homme et dirons-nous qu'il est en lui la forme parfaite de la vie? ou ne penserons-nous pas plutôt que celui qui est étranger à la vie parfaite ne possède qu'une partie du bonheur puisqu'il ne le possède qu'en puissance, mais que celui-là seul est vraiment heureux qui possède en acte la vie parfaite et qui en est arrivé à s'identifier avec elle? Toutes les autres choses ne font plus que l'envelopper (08) et ne sauraient être regardées comme parties de lui-même, puisqu'elles l'enveloppent malgré lui. Elles lui appartiendraient comme parties de lui-même si elles lui étaient jointes par l'effet de sa volonté. Qu'est-ce que le bien pour l'homme qui se trouve dans cet état? Il est son bien à lui-même par la vie parfaite qu'il possède. Le principe [le Bien en soi] qui est supérieur [à la vie parfaite] est la cause du bien qui est en lui : car autre chose est le Bien en soi et le bien dans l'homme. Ce qui prouve que l'homme parvenu à la vie parfaite possède le bonheur, c'est que dans cet état il ne désire plus rien. Que pourrait-il désirer? Il ne saurait désirer rien d'inférieur : il est uni à ce qu'il y a de meilleur; il a donc la plénitude de la vie. S'il est vertueux, il est pleinement heureux, il possède pleinement le bien : car il n'est pas de bien qu'il ne possède. Ce qu'il cherche, il le cherche par nécessité, moins pour lui que pour quelqu'une des choses qui lui appartiennent : il le cherche pour le corps qui lui est uni ; et quoique ce corps soit doué de vie, ce qui se rapporte à ses besoins n'est pas propre à l'homme véritable. Celui-ci le sait, et ce qu'il accorde à son corps, il l'accorde sans s'écarter en rien de la vie qui lui est propre. Son bonheur ne diminuera donc pas dans l'adversité, parce qu'il continue à posséder la vie véritable. S'il perd des parents, des amis, il sait ce que c'est que la mort, et d'ailleurs, ceux qu'elle frappe le savent aussi s'ils sont vertueux. Si le sort de ces parents, de ces amis l'afflige, l'affliction n'atteindra pas la partie intime de son être; elle ne se fera sentir qu'à cette partie de l'âme qui est privée de raison et dont il ne partagera pas les souffrances. [5] Mais, dira-t-on, ne faut-il pas tenir compte des douleurs du corps, des maladies, des obstacles qui peuvent entraver l'action, du cas où l'homme perdrait la conscience de lui-même, ce qui peut arriver par l'effet de certains philtres, de certaines maladies (09)? Comment le sage pourra-t-il, dans tous ces cas, bien vivre et être heureux? Et encore ne parlons-nous pas de la pauvreté, de l'obscurité de condition. En considérant tous ces maux, et surtout en y ajoutant les infortunes si fameuses de Priam (10), on pourra faire de bien graves objections. En effet, le sage supportât-il tous ces maux (et il les supporterait facilement), ils n'en seraient pas moins contraires à sa volonté : or la vie heureuse doit être une vie conforme à notre volonté. Le sage n'est pas seulement une âme douée de certaines dispositions; il faut aussi comprendre le corps dans sa personne (11). Il semble naturel d'admettre cette assertion en tant que les passions du corps sont ressenties par l'homme même, et qu'elles lui suggèrent des désirs et des aversions. Si donc le plaisir est un élément du bonheur, comment l'homme affligé par les coups du sort et par les douleurs pourra-t-il encore être heureux, lors même qu'il serait vertueux? Les dieux n'ont besoin pour être bienheureux que de jouir de la vie parfaite ; mais les hommes, avant leur âme unie à une partie inférieure, doivent chercher leur bonheur dans la vie de chacune des deux parties qui les composent, et non dans celle de l'une des deux exclusivement, quoiqu'elle soit supérieure à l'autre. En effet, dès que l'une d'elles souffre, nécessairement l'autre se trouve, malgré sa supériorité., entravée dans ses actes. Autrement, il faut ne tenir compte ni du corps, ni des sensations qui en proviennent, et ne rechercher que ce qui peut, indépendamment du corps, suffire par soi-même pour procurer le bonheur. [6] Si la raison faisait consister le bonheur à être exempt de douleur, de maladie, à ne pas éprouver de revers ni de grandes infortunes, il nous serait impossible de goûter le bonheur quand nous serions exposés à quelqu'un de ces maux. Mais si le bonheur est la possession du véritable bien, pourquoi oublier ce bien pour regarder ses accessoires? Pourquoi, dans l'appréciation de ce bien, chercher des choses qui ne sont pas comptées au nombre de ses éléments? S'il consistait à réunir, avec les biens véritables, des choses qui sont seulement nécessaires à nos besoins, ou qui sans l'être sont cependant nommées biens, il faudrait travailler à posséder aussi ces deniers. Mais comme l'homme doit avoir une fin unique et non multiple (autrement on ne dirait pas qu'il tend à sa fin, mais à ses fins), il faut rechercher seulement ce qu'il y a de plus élevé et de plus précieux, ce que l'âme désire enfermer en quelque sorte dans son sein. Son inclination, sa volonté ne peuvent aspirer à rien qui ne soit le souverain bien (12). Si la raison évite certains maux et recherche certains avantages, c'est qu'elle y est provoquée par leur présence, mais elle n'y est pas portée par sa nature. La tendance principale de l'âme est dirigée vers ce qu'il y a de meilleur; quand elle le possède, elle est rassasiée et elle s'arrête; elle jouit alors d'une vie véritablement conforme à sa volonté. En effet, la volonté n'a pas pour but de posséder les choses nécessaires à nos besoins, si l'on prend le terme de volonté (13) dans son sens propre et non dans un sens abusif. Sans doute nous jugeons convenable de nous procurer les choses nécessaires, comme en général nous évitons les maux. Mais les éviter n'est pas l'objet de notre volonté : ce serait plutôt de ne pas avoir besoin de les éviter. C'est ce qui a lieu, par exemple, quand on possède la santé et quand on est exempt de souffrance. Lequel de ces avantages nous attire vers lui? Tant qu'on jouit de la santé, tant qu'on ne souffre pas, on y attache peu de prix. Or, des avantages qui, présents, n'ont nul attrait pour l'âme et n'ajoutent rien à son bonheur, qui, absents, sont recherchés à cause de la souffrance qui naît de la présence de leurs contraires, doivent raisonnablement être appelés des choses nécessaires plutôt que des biens et ne pas être comptés au nombre des éléments de notre fin. Lorsqu'ils sont absents et remplacés par leurs contraires, notre fin n'en reste pas moins tout à fait la même. [7] Pourquoi donc l'homme heureux désire-t-il jouir de la présence de ces avantages et de l'absence de leurs contraires? Nous répondrons que c'est parce qu'ils contribuent, non à son bonheur, mais à son existence; que leurs contraires tendent à lui faire perdre l'existence, qu'ils entravent la jouissance du bien, sans l'enlever cependant; en outre, que celui qui possède ce qu'il y a de meilleur veut le posséder uniquement, sans aucun mélange. Toutefois, quand un obstacle étranger survient, le bien existe encore même en présence de cet obstacle. En un mot, s'il arrive à l'homme heureux quelque accident contre sa volonté, son bonheur n'en est en rien altéré. Autrement, chaque jour il changerait et perdrait son bonheur, si, par exemple, il avait à regretter un fils, s'il perdait quelques-unes de ses possessions. Il est mille événements qui peuvent survenir contre son désir sans le troubler dans la jouissance du bien qu'il a atteint. Mais, dit-on, ce sont les grands malheurs , et non les accidents vulgaires [qui peuvent troubler le bonheur du sage]. Cependant, dans les choses humaines, en est-il une assez grande pour n'être pas méprisée de celui qui s'est élevé à un principe supérieur à tout, et qui ne dépend plus des choses inférieures? Un tel homme ne pourra rien voir de grand dans les faveurs de la fortune, quelles qu'elles soient, comme d'être roi, de commander à des villes, à des peuples, de fonder et de bâtir des villes, lors même que ce serait lui-même qui aurait cette gloire; il n'ira pas attacher de l'importance à la perte de son pouvoir ou même à la ruine de sa patrie. S'il regarde tout cela comme un grand mal, ou seulement comme un mal, il aura une opinion ridicule; ce ne sera plus un homme vertueux : car, par Jupiter, il regardera comme une grande chose du bois, des pierres, la mort d'êtres nés mortels; tandis qu'il devrait admettre comme une vérité incontestable que la mort est meilleure que la vie corporelle (14). S'il était immolé lui-même, regarderait-il comme un mal de mourir, parce que c'est au pied des autels qu'il mourrait? Que lui importe d'être enterré? son corps pourrira sur la terre aussi bien que dessous (15). Que lui importe d'être enseveli sans luxe et avec un appareil vulgaire, de ne pas paraître digne d'être placé dans un tombeau magnifique? Ce serait là de la petitesse d'esprit. S'il était emmené captif, il aurait toujours une route ouverte pour sortir de la vie dans le cas où il ne lui serait plus permis d'être heureux. Mais si les personnes de sa famille, par exemple, ses filles, ses brus (16), étaient emmenées en captivité? Que dirions-nous donc s'il était arrivé au terme de la vie sans avoir rien vu de pareil? Est-ce qu'il, sortirait de ce monde en croyant que ces choses ne peuvent arriver? Une pareille opinion serait absurde. Ne pensera-t-il pas que les siens sont exposés à de pareils malheurs? Et s'il a l'opinion que cela puisse arriver, en sera-t-il moins heureux? Non, il sera heureux même avec cette croyance. Il le sera donc encore lors même que cela se réaliserait : il réfléchira en effet que telle est la nature de ce monde qu'il faut souffrir ces accidents et s'y soumettre. Souvent peut-être des hommes traînés en captivité vivront mieux [qu'en liberté]; et d'ailleurs, si la captivité leur est insupportable, il est en leur pouvoir de s'en affranchir; s'ils restent, c'est ou par raison, et alors leur sort n'est pas trop dur; ou contre la raison, et alors ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le sage ne sera donc pas malheureux à cause de la folie des siens; il ne fera pas dépendre son sort dis bonheur ou du malheur d'autrui. [8] Quant aux douleurs qu'il éprouve lui-même; si elles sont fortes, Il les supportera autant qu'il le pourra; si elles sont au-dessus de ses forces; elles l'emporteront (17). Dans tous les cas, il n'excitera pas la pitié au milieu de ses souffrances ; [toujours maître de sa raison]; il ne laissera pas éteindre en lui la lumière qui lui est propre : c'est ainsi que la flamme continue à briller dans le fanal malgré la tempête déchaînée, malgré le souffle violent des vents. Que dire cependant s'il n'a plus la conscience de lui-même; ou si la douleur devient tellement forte que sa violence puisse presque l'anéantir? Si l'intensité de la douleur s'accroît; il décidera ce qu'il doit faire : car; dans ces circonstances, on ne perd point son libre arbitre (18). Il faut d'ailleurs savoir que cas ces souffrances ne se présentent pas au sage sous les mêmes apparences qu'au vulgaire; que toutes ne pénètrent pas jusqu'à la partie la plus intime de l'homme : c'est ce qui a lieu pour la plupart des douleurs; des chagrins, pour les maux que nous voyons éprouver aux autres; les ressentir, c'est une preuve de faiblesse. Une marque de faiblesse non moins manifeste, c'est de regarder comme un avantage d'ignorer tous ces maux, de nous estimer heureux de ce qu'ils arrivent seulement après notre mort (19), sans nous inquiéter du sort des autres et en ne pensant qu'à nous épargner un chagrin. Il y aurait là de notre part une faiblesse qu'il importe d'éloigner de nous, en ne nous laissant pas effrayer par la crainte de ce qui pourra arriver. Si l'on venait à objecter qu'il nous est naturel d'être affligés des malheurs de ceux qui nous entourent , nous répondrions d'abord qu'il n'en est pas ainsi de tous les hommes, ensuite qu'il est du devoir de la vertu d'améliorer la condition commune de la nature humaine et de la conduire à ce qu'il y a de plus beau, en s'élevant au-dessus de l'opinion du vulgaire. Or, il est beau de ne pas céder à ce que le vulgaire regarde ordinairement comme des maux. Pour lutter contre les coups de la fortune; il ne faut pas se poser comme un ignorant, mais comme un habile athlète qui sait que les dangers qu'il brave sont redoutés de certaines natures, mais qu'une nature telle que la sienne les supporte facilement, n'y voyant rien de terrible ou du moins ne les trouvant redoutables que pour des enfants. Mais, dira-t-on, est-ce que le sage avait souhaité ces maux? Non, sans doute; cependant, quand il en est frappé, il leur oppose la vertu qui rend l'âme inébranlable et impassible. [9] Mais, quand le sage n'a plus sa raison, quand il est accablé par la maladie, par les maléfices de la magie, continue-t-il d'être heureux? Si l'on admet que dans cet état il continue d'être vertueux, qu'il est seulement assoupi comme dans le sommeil, pourquoi ne serait-il pas heureux, puisqu'on ne prétend pas que dans le sommeil il perde son bonheur, qu'on ne tient nul compte du temps qu'il passe dans cet état, et qu'on ne l'en regarde pas moins comme heureux toute sa vie? Si l'on nie qu'il continue d'être vertueux, on sort de la question, puisque, supposant qu'il continue d'être vertueux, ce que nous cherchons c'est s'il reste heureux tant qu'il reste vertueux. Mais, objectera-t-on, s'il reste vertueux sans le sentir, sans agir conformément à la vertu, comment sera-t-il heureux? Voici notre réponse: s'il se portait bien, s'il était beau, mais sans le sentir, en serait-il moins bien portant, moins beau? De même, s'il était sage sans le sentir, il n'en serait pas moins sage. Mais, dira-t-on encore, il est essentiel à la sagesse d'avoir le sentiment et la conscience d'elle-même : car c'est dans la sagesse en acte que réside le bonheur. Si la raison et la sagesse étaient choses adventices, cette objection serait fondée. Mais si la substance de la sagesse consiste dans une essence ou plutôt dans l'essence, si de plus l'essence ne périt ni dans celui qui dort, ni dans celui qui n'a pas conscience de lui-même, si par conséquent L'activité de l'essence continue à subsister en lui, si par sa nature même elle veille sans cesse, il en résulte que l'homme vertueux doit, même dans cet état [de sommeil et d'absence de conscience], continuer d'exercer son activité. Du reste, cette activité n'est ignorée que d'une partie de lui-même et non de lui. tout entier. C'est ainsi que, quand la force végétative (20) s'exerce, la perception de son activité n'est pas transmise par la sensibilité au reste de l'homme. Si c'était la force végétative qui constituât notre personne, nous agirions dès qu'elle agit; mais ce n'est pas elle qui nous constitue : nous sommes l'acte du principe intellectuel, et c'est peur cela que nous agissons quand ce principe agit. [10] Si l'activité de l'intelligence nous reste cachée, c'est sans doute parce qu'elle n'est pas sentie : car ce n'est que par l'intermédiaire du sentiment que cette activité peut se manifester ; mais pourquoi [même sans être sentie], l'intelligence cesserait-elle d'agir? Pourquoi de son côté l'âme ne pourrait-elle tourner vers elle son activité avant de l'avoir sentie on perçue? Il faut bien qu'il y ait quelque acte antérieur à la perception, puisque [pour l'intelligence] penser et exister sont identiques. La perception paraît ne pouvoir naître que lorsque la pensée se replie sur elle-même; et que le principe dont l'activité constitue la vie de l'âme retourne pour ainsi dire en arrière et se réfléchit, comme l'image d'un objet placé devant un miroir se reflète dans sa surface polie et brillante. De même que, si le miroir est placé en face de l'objet, il se forme une image, et que, si le miroir est éloigné ou qu'il soit mal disposé, il n'y a plus d'image bien que l'objet lumineux continue d'agir; de même, quand la faculté de l'âme qui nous représente les images de la raison discursive et de l'intelligence est dans un état convenable de calme, nous en avons l'intuition, la connaissance en quelque sorte sensible, avec la connaissance antérieure de l'activité de l'intelligence et de la raison discursive; mais quand ce principe est agité par un trouble survenu dans l'harmonie des organes, la raison discursive et l'intelligence continuent d'agir sans qu'il y ait d'image, et la pensée ne se réfléchit pas dans l'imagination. Aussi faut-il admettre que la pensée est accompagnée d'une image sans cependant en être une elle-même. Il nous arrive souvent, pendant que nous sommes éveillés, de faire des choses louables, de méditer et d'agir, sans avoir conscience de ces opérations au moment où nous les produisons. Quand, par exemple, on fait une lecture, on n'a pas nécessairement conscience de l'action de lire, surtout si l'on est fort attentif à ce qu'on lit. Celui qui exécute un acte de courage ne pense pas non plus, pendant qu'il agit, qu'il agit avec courage. Il en est de même dans une foule d'autres cas; de sorte qu'il semble que la conscience qu'on a d'un acte en affaiblisse l'énergie, et que, quand l'acte est seul [sans conscience], il soit dans son état de pureté et ait plus de force et de vie. Quand des hommes vertueux sont dans cet état [où il y a absence de conscience, leur vie est plus intense parce qu'au lieu de se mêler au sentiment elle se concentre en elle-même. [11] Peut-être quelques-uns nous objecteront-ils que l'homme placé dans l'état dont nous parlons ne vit pas véritablement. Nous leur répondrons qu'il vit, mais qu'eux, ils sont incapables de comprendre son bonheur ainsi que sa vie. Refuseront-ils de nous croire? Dans ce cas, nous leur demanderons à notre tour s'il n'est pas convenable qu'après avoir accordé que cet homme vit et est vertueux, ils examinent si dans de pareilles conditions il n'est pas heureux. Nous leur demanderons aussi de ne pas commencer par le supposer anéanti pour considérer ensuite s'il est heureux, de ne pas s'arrêter uniquement à le chercher dans ses actes extérieurs après avoir admis qu'il tourne toute son attention sur les choses qu'il porte en lui-même, en un mot de ne pas croire que le but de sa volonté soit dans les objets extérieurs. En effet, ce serait nier l'essence même du bonheur que de regarder les objets extérieurs comme des buts de la volonté de l'homme vertueux, que de prétendre que ce sont là les objets qu'il désire. Sans doute il voudrait que tous les hommes fussent heureux et qu'aucun d'eux n'éprouvât aucun mal; cependant, quand cela n'arrive pas, il n'en est pas moins heureux. Dira-t-on enfin que pour l'homme vertueux il serait déraisonnable de former un pareil voeu (parce qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de maux ici bas (21)? C'est évidemment reconnaître avec nous que la volonté de l'homme vertueux a pour seul but la conversion de l'âme vers elle-même (22). [12] Si l'on réclame des plaisirs pour l'homme vertueux, ce ne sont pas sans doute ceux que recherchent les débauchés ni ceux qu'éprouve le corps. Ces plaisirs ne pourraient lui être accordés sans souiller sa félicité. On ne demande pas non plus sans doute pour lui des excès de de foie : à quoi bon en effet? Sans doute on veut seulement que l'homme vertueux goûte les plaisirs attachés à la présence des biens, plaisirs qui ne doivent ni consister dans le mouvement, ni être accidentels : or il jouit de la présence de ces biens, puisqu'il est présent à lui-même; est dès lors dans un état de douce sérénité. L'homme vertueux est donc toujours serein, calme, satisfait; s'il est vraiment vertueux, son état ne peut être troublé par aucune de ces choses que nous appelons des maux. Si l'on cherche une autre espèce de plaisirs dans la vie vertueuse, c'est qu'un cherche autre chose que la vie vertueuse. [13] Les actions de l'homme vertueux ne sauraient être entravées par la fortune, mais elles pourront varier avec les vicissitudes de la fortune. Toutes seront également belles, et d'autant plus belles peut-être que l'homme vertueux se trouvera placé dans des circonstances plus critiques. Quant aux actes qui concernent la contemplation, s'il en est qui se rapportent à des choses particulières, ils seront tels que le sage pourra les produire après avoir bien cherché: et considéré ce qu'il doit faire. Il trouve en lui-même la plus infaillible des règles de conduite, une règle, qui ne lui fera jamais défaut, fût-il enfermé dans ce taureau de Phalaris dont on a tant parlé. En vain l'homme vulgaire affecte à dire qu'un tel sort est doux, et le répète deux ou trois fois (23): dans un pareil homme, ce qui prononce ces mots, c'est cette partie même qui subit les. tortures [la partie animale]. Dans l'homme vertueux, au contraire, la partie qui souffre est autre que celle qui habite avec elle seule, et qui, en tant qu'elle habite ainsi nécessairement en elle-même, n'est jamais privée de la contemplation du Bien universel. [14] Ce qui constitue l'homme, l'homme vertueux sur tout, ce n'est pas le composé de l'âme et du corps [l'animal] (24), comme le prouve la puissance qu'a l'âme de se séparer du corps (25) et de mépriser ce qu'on nomme des biens. Il serait ridicule de prétendre que le bonheur se rapporte à cette partie animale de l'homme, puisqu'il consiste à bien vivre, et que bien vivre; étant un acte, n'appartient qu'à l'âme; et encore n'est-ce pas à l'âme entière : car le bonheur ne s'étend pas à la partie végétative, n'ayant rien de commun avec le corps; ni la grandeur du corps, ni le bon état dans lequel il peut se trouver n'y contribuent en rien. Il ne dépend pas davantage de la perfection des sens, parce que leur développement, aussi bien que celui des organes, rend l'homme pesant et le courbe vers la terre. Il faut plutôt, pour rendre plus facile l'accomplissement du bien, établir une sorte de contrepoids, affaiblir le corps et en dompter la force afin de montrer combien l'homme véritable diffère des choses étrangères qui l'enveloppent. Que l'homme vulgaire soit beau, grand, riche, qu'il commande à tous les hommes, jouissant ainsi de tous les biens terrestres : il ne faut pas lui envier le plaisir trompeur qu'il trouve dans ces avantages. Quant au sage, peut-être ne les possédera-t-il pas d'abord; mais, s'il les possède, il les diminuera de son plein gré s'il a de lui-même le soin qu'il doit avoir; il affaiblira et flétrira par une négligence volontaire les avantages du corps; il abdiquera les dignités; tout en conservant la santé de son corps, il ne désirera pas d'être entièrement exempt de maladies et de souffrances ; s'il ne connaît pas ces maux, il voudra en faire l'épreuve dans sa jeunesse; mais, arrivé à la vieillesse, il ne voudra plus être troublé ni par les douleurs, ni par les plaisirs, ni par rien de triste ou d'agréable qui soit relatif au corps, pour ne pas être obligé de lui accorder son attention. Aux souffrances qu'il éprouvera, il opposera une fermeté qu'il aura toujours en lui-même. Il ne croira pas son bonheur augmenté par les plaisirs, la santé, le repos, ni détruit ou diminué par leurs contraires : puisque les premiers avantages n'augmentent pas sa félicité, comment leur perte pourrait-elle la diminuer? [15] Mais supposons deux sages dont l'un ait tout ce qui est conforme au voeu de la nature, et dont l'autre soit dans la position contraire, devrons-nous dire qu'ils sont également heureux? Oui, s'ils sont également sages. Car lors même que l'un posséderait la beauté corporelle et tous les autres avantages qui ne se rapportent ni à la sagesse, ni à la vertu, ni à la contemplation du bien, ni à la vie parfaite, à quoi tout cela lui servirait-il, puisque celui, qui possède tous ces avantages n'est pas considéré comme étant plus réellement heureux que celui qui en est privé? Leur affluence ne saurait même suffire au joueur de flûte pour lui faire atteindre sa fin (26). Mais nous n'envisageons l'homme heureux qu'avec la faiblesse de notre esprit, regardant comme grave et horrible ce que l'homme vraiment heureux juge indifférent. Car I'homme ne saurait être sage, ni par conséquent heureux, tant qu'il n'a pas réussi a se débarrasser de toutes ces vaines idées, tant qu'il ne s'est pas entièrement transformé, tant qu'il n'a pas en lui-même la confiance d'être à l'abri de tout mal. Ce n'est qu'alors qu'il vivra sans être agité d'aucune crainte. Si quelque chose l'effraie encore, c'est qu'il n'est pas un sage accompli, qu'il est seulement à moitié sage. Quant aux craintes qui surviendraient à l'improviste et qui pourraient s'emparer de lui avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, au moment où il serait attentif à autre chose, le sage s'empressera de les écarter; traitant ce qui s'agite en lui-même comme un enfant égaré par la douleur, il l'apaisera, soit par la raison, soit par la menace, mais toutefois sans passion: c'est ainsi que la seule vue d'une personne respectable suffit pour calmer un enfant. Du reste, le sage ne sera pas étranger à l'amitié ni à la reconnaissance; il traitera les siens comme il se traite lui-même; donnant autant à ses amis qu'à sa propre personne, il se livrera à l'amitié, mais sans cesser d'être avec l'intelligence. [16] Si l'on ne plaçait pas l'homme vertueux dans cette vie élevée de l'intelligence, si on le supposait au contraire soumis aux coups du sort, et qu'on les redoutât pour lui, on n'aurait plus l'homme vertueux tel que nous l'entendons, mais seulement un homme du vulgaire, mêlé de bien et de mal, auquel on attribuerait une vie également mêlée de bien et de mal. Un tel homme ne se rencontrerait peut-être pas encore facilement, et, d'ailleurs, si on le rencontrait, il ne mériterait pas d'être appelé sage : car il n'aurait rien de grand, ni la dignité de la sagesse, ni la pureté du bien. Le bonheur n'est donc pas placé dans la vie du vulgaire. Platon a raison de dire qu'il faut quitter la terre pour s'élever au Bien, qu'il faut, pour devenir sage et heureux, tourner ses regards vers le Bien seul, tâcher de lui devenir semblable et de mener une vie conforme à la sienne (27). C'est là en effet ce qui doit suffire au sage pour atteindre sa fin. Aussi ne doit-il pas attacher plus de prix au reste qu'à des changements de lieu, dont aucun ne peut ajouter au bonheur. S'il donne quelque attention aux choses extérieures qui sont jetées çà et là autour de lui, c'est pour satisfaire, selon son pouvoir, les besoins du corps. Mais comme il est tout autre chose que le corps, il n'est jamais embarrassé de le quitter; or, il le quittera quand la nature en aura marqué le moment. Il conserve d'ailleurs toujours la liberté de délibérer à cet égard (28). Atteindre le bonheur sera son principal but; toutefois, il accomplira aussi des actions qui n'auront pas directement pour objet sa fin, ni lui-même, mais le corps qui lui est uni : il soignera ce corps et il le soutiendra aussi longtemps qu'il lui sera possible. C'est ainsi qu'un musicien se sert de sa lyre aussi longtemps qu'il le peut; dès qu'elle est hors d'usage, il la change, ou renonce à employer la lyre et à en jouer, parce qu'il peut désormais se passer de cet instrument; le laissant à terre, il le regardera presque avec mépris, et chantera sans s'en accompagner. Cependant ce n'est pas en vain que cette lyre lui aura été donnée dans l'origine ; car il s'en sera souvent servi avec avantage.
|
|
412 LIVRE QUATRIÈME. DU BONHEUR.
Ce livre est le quarante-sixième dans l'ordre chronologique. Il a
été traduit en anglais par Taylor: Five Books of Plotinus, p. 3. § 1. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE D'ARISTOTE. Dans la plus grande partie de ce livre, Plotin discute la théorie qu'Aristote a exposée sur la question du Bonheur dans les livres I et X de l'Éthique à Nicomaque. Il est facile de le reconnaître en lisant les extraits de ce traité que nous donnons ici : « Dans toute action, dans toute détermination raisonnée, le bien, c'est la fin... Le bien parfait. ou absolu, est celui qu'on préfère toujours pour lui-même et jamais en vue d'aucun autre. Or le bonheur (εὐδαιμονία) paraît surtout être dans ce cas: car nous le désirons constamment pour lui-même et jamais pour aucune autre fin... On peut donc dire que le bonheur est quelque chose de parfait et qui se suffit à soi-même (τελειόν τι καὶ αὔταρκες), puisqu'il est la fin de tous nos actes. Pour connaître clairement ce qu'est le bonheur, il faut connaître quelle est l'oeuvre propre de l'homme. Et d'abord, la vie semble lui être commune avec les plantes (29) : or nous cherchons ce qu'il y a de propre à l'homme; il faut donc mettre de côté la vie de nutrition et d'accroissement (θρεπτικὴ καὶ αὐξητικὴ ζωή). Vient ensuite la vie sensitive (αἰσθητικὴ ζωή) ; mais celle-ci encore est commune à tous les animaux (30). Reste enfin la vie active de l'être qui a la raison et partage (πρακτική τις λόγον ἔχοντος), en tant 413 qu'il obéit à la raison, ou qu'il la possède et qu'il en fait usage. Or cette vie étant susceptible d'être considérée sous deux points de vue [la puissance et l'acte], admettons qu'elle soit en acte; car c'est principalement à ce point de vue qu'elle doit son nom. Si donc l'oeuvre de l'homme est une activité de l'âme conforme à la raison (ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον) (31); et si l'on peut affirmer qu'outre qu'elle est l'oeuvre de l'homme en général, elle peut encore être celle de l'homme de bien, comme il y a l'oeuvre du musicien et celle du musicien habile; et si cette distinction s'applique aux oeuvres de toute espèce, en ajoutant ainsi à l'oeuvre elle-même la différence qui résulte d'une supériorité absolue en mérite ; s'il en est ainsi, et si l'oeuvre de l'homme est un certain genre de vie qui consiste dans l'activité de l'âme et dans les opérations accmpagnées de raison. (ψυχῆς ἐνέργεια καὶ πράξεις μετὰ λόγου), qu'il appartient à l'homme vertueux d'exécuter convenablement, et dont chacune ne peut être accomplie qu'autant qu'elle a la vertu qui lui est propre : il résulte de là que le bien de l'homme est l'activité de l'âme dirigée par la vertu (τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια κατ’ ἀρετήν), et, s'il y a plusieurs vertus, par celle qui est la plus parfaite.
Examinons maintenant le principe du bonheur, non seulement
d'après ses conséquences et par la définition qu'on en donne, mais aussi d'après
ce qu'on dit communément sur ce sujet. Or, comme nous avons fait trois classes
de biens, les biens extérieurs, les biens de l'âme et les biens
du corps, nous plaçons au premier rang ceux de l'âme, et ce sont eux que
nous appelons proprement des biens, attribuant à l'âme les actes et les
opérations; en sorte que notre langage est tout à fait conforme à l'opinion qui
a été anciennement et universellement admise par tous les philosophes, que la
fin de notre vie consiste dans ces actes et dans ces opérations: car, de cette
manière, on voit qu'elle comprend les biens de l'âme et non pas les biens
extérieurs. Cette définition se trouve confirmée par les expressions de bien
vivre (τὸ εὖ ζῇν) et de bien agir (τὸ εὖ πράττειν), dont on se sert
ordinairement en parlant d'un homme heureux, puisque bonne vie (εὐζωία) et bonne
conduite (εὐπραξία) sont des expressions à peu près synonymes de bonheur (32). 414 Leur vie est par elle-même remplie de délices (ὁ βίος καθ’ αὑτὸν ἡδύς) : car le sentiment du plaisir ( τὸ ἥδεσθαι) appartient à l'âme (33), et dire qu'un homme aime quelque chose, c'est dire que cette chose lui cause du plaisir; ainsi, quiconque aime la justice, ou, en général, la vertu, y trouve de véritables jouissances. Il suit de là que les actions vertueuses sont des plaisirs, qu'elles sont à la fois bonnes et honorables, et qu'elles réunissent chacune de ces qualités au plus haut degré, si l'homme de bien sait les apprécier comme il faut: et c'est ainsi qu'il en juge en effet. Le bonheur est donc ce qu'il y a de plus excellent, de plus beau et de plus agréable; car tout cela se trouve dans les actions les plus parfaites; or, le bonheur est, à notre avis, ou la réunion de toutes ces choses, ou celle d'entre elles qui est la plus excellente. Néanmoins, il semble qu'il faut y joindre encore les biens extérieurs (34) car il est impossible, ou au moins fort difficile, de bien faire (καλὰ πράττειν), quand on est entièrement dépourvu de ressources; il y a même beaucoup de choses pour l'exécution desquelles des amis, des richesses, une autorité politique, sont comme des instruments nécessaires. La privation absolue de quelqu'un de ces avantages, comme de la naissance, le manque d'enfants, de beauté, gâte et dégrade en quelque sorte le bonheur. Car ce n'est pas un homme tort à fait heureux que celui qui est d'une excessive laideur, ou d'une naissance vile, ou entièrement isolé et sans enfants. Celui qui a des amis ou des enfants tout à fait vicieux, ou qui en avait de vertueux que la mort lui a enlevés, est peut être moins heureux encore. La jouissance de ces sortes de biens semble donc être un accessoire indispensable.... Le bonheur est, avons-nous dit, un emploi de l'activité de l'âme, conforme à la vertu; et quant aux autres biens, les uns sont nécessaires pour le rendre complet, elles autres y servent naturellement comme auxiliaires, ou comme d'utiles instruments.... Les conditions du bonheur sont une vertu parfaite et une vie accomplie. En effet, la vie est sujette à bien des vicissitudes, à bien des chances diverses; et il peut arriver que celui qui est au comble de la prospérité, tombe, en vieillissant, dans de grandes infortunes, comme les poètes épiques le racontent de Priam. Or, personne ne vantera sans doute le bonheur de celui qui, après avoir éprouvé de tels revers, serait mort ensuite misérablement (35). Si l'on s'attache à observer les vicissitudes de la fortune, on pourra souvent dire d'un même individu qu'il est heureux, et en- 415 suite qu'il est malheureux, et. ce sera. faire du bonheur une condition fort équivoque et fort peu stable (36). Ne pourrait-on pas dire plutôt qu'il n'y a aucune raison d'attacher tant d'importance à ces vicissitudes? car, enfin, ce ne sont pas elles qui constituent le bien et le mal en soi; mais la vie humaine a besoin d'en tenir compte, au moins jusqu'à un certain point; au lieu que ce sont les actions conformes à la vertu, qui décident du bonheur, comme les actions contraires décident de l'état opposé. Il n'y a rien dans les choses humaines où la constance se manifeste autant que dans les actions conformes à la vertu ; elles sont ce qu'il y a de plus honorable à la fois et de moins sujet à l'instabilité.
Ainsi donc le caractère de constance que nous cherchons se
trouvera dans l'homme heureux, et il le conservera toute sa vie. Car Ies actions
conformes à la vertu seront toujours, ou du moins la plupart du temps, ce qu'il
fera et te qu'il considérera avant tout; et quant aux revers de la fortune, il
saura les supporter, quels qu'ils soient, avec dignité et avec calme: car il
sera l'homme véritablement vertueux et dont toute la conduite n'offre rien à
reprendre. Plotin combat Aristote en soutenant contre lui, avec les Stoïciens, que la possession des biens extérieurs et des biens du corps n'est pas nécessaire pour le bonheur (§ 5-16, p. 77-91). Il se rapproche de lui dans la définition qu'il donne de la vie parfaite (38). En effet, Aristote, après avoir distingué trois vies, la vie animale qui n'offre que des jouissances, la vie politique ou active, la vie contemplative, donne la prééminence à la vie contemplative (39) et la regarde comme la condition du bonheur parfait : « SI le bonheur est une manière d'agir toujours conforme à la vertu, il est naturel de penser que ce doit être à la vertu la plus 416 parfaite, c'est-à-dire, à celle de l'homme le plus excellent [la sagesse]. Que ce soit donc l'intellect (νοῦς) ou quelque autre principe auquel appartient naturellement l'empire et la prééminence, et qui semble comprendre en soi la conception de tout ce qu'il y a de sublime et de divin, ou au moins ce qu'il y a en nous de plus divin, le parfait bonheur (ἡ τέλεια εὐδαιμονία) ne saurait être que l'action de ce principe dirigée par la vertu qui lui est propre et qui est purement contemplative [la sagesse] (40). Cette action est la plus puissante, puisque l'entendement est en nous ce qu'il y a de plus merveilleux, et qu'entre les choses qui peuvent être connues, celles qu'il peut connaître sont les plus importantes. Son action est aussi la plus continue: car il nous est plus possible de nous livrer, sans interruption, à la contemplation, que de faire sans cesse quelque chose que ce soit. Nous pensons aussi qu'il faut que le bonheur soit accompagné et pour ainsi dire mêlé de quelque plaisir: or, entre les actes conformes à la vertu, ceux qui sont dirigés parla sagesse sont incontestablement ceux qui nous causent le plus de joie; et, par conséquent la sagesse semble comprendre en soi les plaisirs les plus ravissants par leur pureté et par la sécurité qui les accompagne (41). D'un autre côté, la condition de se suffire à soi-même se trouve surtout dans la vie contemplative; le sage, même dans l'isolement le plus absolu, peut encore se livrer à la contemplation, et il le peut d'autant plus qu'il a plus de sagesse. » (Éthique d Nicomaque, X, 7; p. 475-476 de la trad. de M. Thurot.) L'analogie que présentent les opinions d'Aristote et de Plotin au sujet de la prééminence qu'ils accordent à. la vie contemplative a donné à Gennade, plus connu sous le nom de George Scholarius, l'idée de les concilier, et, dans ce but, il a composé un ouvrage encore inédit, sous ce titre: Περὶ ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας Ἀριστοτέλους καὶ Πλωτίνου συμβιβαστικόν. (Voy. Bandini, Catalogue des Manuscrits grecs, latins et italiens de la Bibliothèque Laurentine, t. III, p. 363, 370, 403). La doctrine qui fait consister le bonheur suprême de l'âme dans la vie contemplative, comme l'ont entendu Aristote et Plotin, se trouve reproduite dans le traité de Bossuet que nous avons déjà cité plusieurs fois précédemment (De la Connaissance de Dieu et de soi-même, chap. V, § 14): « La stature de l'âme est d'être formée à l'image de son auteur; et cette conformité nous y fait entendre un principe divin et immortel. Car s'il y a quelque chose, parmi les créatures, qui mérite de durer éternellement, c'est sans doute la connaissance et l'amour de Dieu, et ce qui est né pour exercer ces divines opérations. Quiconque les exerce les voit si justes et si parfaites; qu'il voudrait les exercer à jamais; et nous avons dans cet exercice l'idée d'une vie éternelle et bienheureuse... Là nous goûtons un plaisir si pur que tout autre plaisir ne nous paraît rien en comparaison. C'est ce plaisir qui a transporté les philosophes, et qui leur a fait souhaiter que la nature n'eût donné aux hommes aucunes voluptés sensuelles, parce que ces voluptés troublent en nous le plaisir de goûter la vérité toute pure. Qui voit Platon célébrer la félicité de ceux qui contemplent le beau et le bon, premièrement dans les arts, secondement dans la nature, et enfin dans leur source et dans leur principe, qui est Dieu; qui voit Aristote touer ces heureux moments où l'âme n'est possédée que de l'intelligence de la vérité, et juger une telle vie seule digne d'être éternelle et d'être la vie de Dieu (42); qui voit les saints tellement ravis de ce divin exercice de connaître, d'aimer et de louer Dieu, qu'ils ne le quittent jamais, et qu'ils éteignent, pour le continuer durant tout le cours de leur vie, tous les désirs sensuels; qui voit, dis-je, toutes ces choses, reconnaît dans les opérations intellectuelles un principe et un exercice de vie éternellement heureuse. Et le désir d'une telle vie s'élève et se fortifie d'autant 417 plus en nous que nous méprisons davantage la vie sensuelle et que nous cultivons avec plus de soin la vie de l'intelligence. El l'âme qui entend cette vie, et qui la désire, ne peut comprendre que Dieu, qui lui a donné cette idée et lui a inspiré ce désir, l'ail faite pour une autre fin. » § II. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE DES STOÏCIENS. Sans adopter la doctrine des Stoïciens, Plotin, en soutenant avec eux contre Aristote que la possession des biens extérieurs et des biens du corps n'est pas nécessaire pour le bonheur (§ 5-16, p. 77-91), expose des idées conformes à quelques-unes de leurs maximes les plus célèbres. Nous nous bornerons ici à les indiquer en nous servant des termes mêmes employés par Juste Lipse dans le traité intitulé : Manuductio ad Stoïcam philosophiam (43). Voici ces maximes :
Solam Virtutem sufficere ad Beatitatem, nec Externa aut
Fortuita requiri. (44)
(Manuductio, II, 20) ;
(01) Pour les Remarques générales, Voyez la Note sur ce livre à la fin du volume. (02) Plotin discute ici à la fois les doctrines des Péripatéticiens, des Épicuriens et des Stoïciens. Les expressions dont il se sert : εὖ ζῇν, εὐζωία, ἔργον οἰκείον τελειουμένον, sont celles mêmes qui étaient propres à chacune de ces écoles. Son début rappelle particulièrement ce passage de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote; (1, 8, 4 ) : συνᾴδει τῷ λόγῳ καὶ τὸ εὖ ζῇν καὶ τὸ πτάττειν τὸν εὐδαίμονια· σχεδὸν γὰρ εὐζωία τις εἴρηται καὶ εὐπταξία. (03) Les Mss. portent, Ies uns δόξει, les autres οὐ δόξει, Creuzer préfére οὐ δόξει ; Taylor, dans sa traduction, supprime la négation. II ne nous a pas non plus paru nécessaire de l'introduire. (04) C'était, on le sait, la doctrine d'Aristippe, etc. (05) C'était le bien suprême selon Épicure. Voy. Diogène Laërce, liv. X, p. 128, 131, 136; et Cicéron, De Finibus, liv. I, § 14, 46. (06) C'était la formule des Stoïciens. Voy. Cicéron, De Finibus, liv. IV, 11, 26 : « Naturæ congruenter vivere.» (07) Nous lisons avec Creuzer οὐ διδόασιν. Ficin, dans sa traduction, a omis la négation, qui cependant semble nécessaire au sens de la phrase. (08) Περικεῖσθαι, expression des Stoïciens. (09) Plotin a surtout en vue ici la doctrine des Péripatéticiens : c'est à leurs objections qu'il répond. Voy. Aristote, Éthiq. à Nicomaque, liv. VII, 13; Sextus Empiricus, Hypotyp. pyrrhon., liv. III, 180; Stobée, Eclog., liv. II, 7. (10) Voy. Aristote, Ethiq. à Nicom., liv. I, 10, 14. (11) Ce passage est une allusion non seulement à, la doctrine des Péripatéticiens, mais encore à celle des Pythagoriciens, comme le prouvent ces mots d'Archytas, cités par Stobée, Florileg., tit, I, § 76, p, 43, éd. Gaisford : ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐχ ἁ ψυχὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα· τὸ γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων ζῶον, καὶ τὸ ἐκ τοιούτων ἄνθρωπος. (12) Creuser déclare que le texte de cette phrase est inintelligible; nous donnons le sens probable. (13) Voy. Enn. VI, liv. VIII. (14) Allusion à une maxime dès longtemps admise chez les anciens, comme le témoigne ce passage d'Hérodote : διέδεξε ὁ θεὸς ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. (15) Allusion à ce mot de Théodore de Cyrène cité par Plutarque, De la Méchanceté, p. 499: Καὶ τί Θεοδώρῳ μέλει πότερον ὑπὲρ γῆς ἢ ὑπὸ γῆς σήπεται. Sénèque a dit de même dans le De Tranquill. animi, 14: O te ineptum, si putas interesse, supra terram an infra putrescam! (16) Le texte porte νυοί. Quelques manuscrits donnent ὑίοι, fils, qui semblerait préférable. (17) Sénèque a exprimé la même pensée, qui sans doute faisait partie de la doctrine stoïcienne : Contemnite dolorem aut solvetur, aut solvet. De Providentia, 3. Taylor a compris qu'il s'agissait ici de la perte de la raison : When they are excessive, they may cause him to be delirious; ce qui ne peut être, puisque Plotin fait cette supposition même deux lignes plus bas et au commencement. du § 9 : εἰ μὴ παρακολουθοῖ. (18) Voy. sur ce sujet le liv. IX de cette même Ennéade. Il est facile de reconnaître que toutes ces idées sont empruntées aux Stoïciens: Plotin fait ici allusion au suicide, que ces philosophes permettent au sage. Sénèque a dit de même, dans le De Providentia, 5 : Ante omnia cavi ne quis vos teneret invitos : patet exitus. (19) Allusion aux vers de certains poètes qui vantaient le bonheur des hommes auxquels la mort a épargné le spectacle de grandes calamités. Voy. Eschyle, les Sept chefs devant Thèbes, vers 327. (20) Φυτικὴ ἐνεργία : c'est la puissance qui préside à la nutrition et à l'accroissement du corps. Voy. Enn. IV, liv. III, § 23. (21) Voy. Enn. I, liv, VIII. (22) Voy. Enn 1, liv. II § 4. (23) Cicéron, Tusculanes, liv. Il, § 17 : In Phalaridis tauro si positus erit [Epicurus], dicet: « Quam suave est, quam hoc curo ! » (24) Voy. Enn. I, liv. I, § 10. (25) Ὁ χωρισμὸς ὁ ἀπὸ τοῦ σώματος. Sur cette puissance qu'a l'âme de se séparer du corps, Voy. plus haut, Enn. I, liv. I, § 3 et 10. (26) Expression proverbiale cher les Grecs et dont l'application ici n'est pas bien claire pour nous. Du reste, la comparaison tire sa force du peu d'estime que les anciens avaient pour ceux qui exerçaient la profession de joueur de flûte. (27) Théétète, p. 170; Phédon, p. 42; République, VI, p. 509, et liv. X, p. 618; Lois, liv. IV, p. 716. Voy. aussi ci-dessus, Enn, I, liv. II, § 1. (28) Il a déjà exprimé la même pensée ci-dessus, § 8. Pour la doctrine sur le suicide, Voy. le livre IX de cette même Ennéade. (29) Voy. Enn. I, liv. IV, § 1, p. 71. (30) Ibid., § 2, p. 72. (31) Ibid., § 2, p. 73. (32) Ibid., § 1, p. 70, note 2. (33) Ibid., § 2, p. 72. (34) Ibid., § 5-16, p. 77-91. (35) Ibid., § 5, p 77. (36) Ibid., § 7, p.80. Voy. aussi la Note sur le livre V. (37) Voy. liv. IV, § 5, p.78. (38) Plotin dit § 3, p.75: « La vie parfaite, véritable et réelle consiste dans I'intelligence. » (39) Voy. Enn I, liv. I, § 2, p. 50. (40) Voy. p. 50, 352, 390-401. (41) Voy. liv. IV, § 12, p. 86. (42) Voici le passage célèbre d'Aristote auquel Bossuet fait allusion: « Ce n'est que pendant quelque temps que nous pouvons jouir de la félicité parfaite. Dieu la possède éternellement, ce qui nous est impossible. La jouissance, pour lui, c'est son action même. C'est parce qu'elles sont des actions, que la veille, la sensation, la pensée, sont nos plus grandes jouissances; l'espoir et le souvenir ne sont des jouissances que par rapport à celles-là. Or la pensée en soi est la pensée de ce qui est en soi le meilleur, et la pensée par excellence est la pensée de ce qui est le bien par excellence. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible; car elle devient elle-même intelligible à ce contact, à ce penser. Il y a donc identité entre l'intelligence et l'intelligible: car la faculté de percevoir l'intelligible et l'essence, voilà l'intelligence; et l'actualité de l'intelligence, c'est la possession de l'intelligible. Ce caractère divin, ce semble, de l'intelligence se trouve donc au plus haut degré dans l'intelligence divine; et la contemplation est la Jouissance suprême et le souverain bonheur. Si Dieu jouit éternellement de cette félicité que nous ne connaissons que par instants, il est digne de notre admiration ; il en est plus digne encore si son bonheur est plus grand. Or, son bonheur est plus grand en effet. La vie est en lui: car l'action de l'intelligence est une vie, et Dieu est l'actualité même de l'intelligence; cette actualité prise en soi, telle est sa vie parfaite et éternelle. » (Métaphysique, XII, 7; t. II, p. 223 de la trad. de MM. Pierron et Zévort,) (43) On trouvera ce traité au commencement du tome I de l'édition de Sénèque que nous avons donnée dans la Collection des Auteurs classiques latins, publiée par M. Lemaire. (44) Voy,. Enn. I, liv. IV, § 4, p. 76 de ce volume. (45) Voy. ibid., § 6, 14; p.79, 88. (46) Voy. § 12, p. 86. (47) Voy. § 13, p. 87. (48) Voy. § 7, 8; p. 80.83, 89. (49) Voy. § 7, 15; p. 81, 89. (50) Voy. § 4, 5,11 ; p. 76, 77, 86. (51) Voy. § 8, 16; p. 82, 91.
|
|