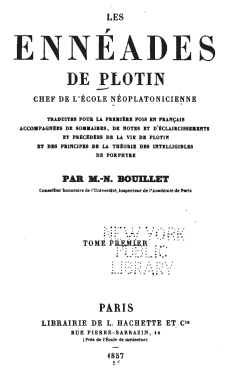
PLOTIN
PREMIÈRE ENNÉADE.
LIVRE DEUXIÈME. DES VERTUS.
Tome premier
Traduction française : M.-N. BOUILLET.
ENNÉADE I, LIVRE I - ENNÉADE I, LIVRE III
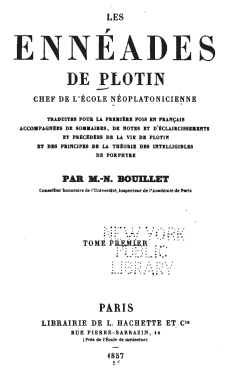
ENNÉADE I, LIVRE I - ENNÉADE I, LIVRE III
|
[1] Ἐπειδὴ « τὰ κακὰ » ἐνταῦθα καὶ « τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης », βούλεται δὲ ἡ ψυχὴ φυγεῖν τὰ κακά, « φευκτέον ἐντεῦθεν ». Τίς οὖν ἡ φυγή; « θεῷ », φησιν, « ὁμοιωθῆναι ». Τοῦτο δέ, εἰ « δίκαιοι καὶ ὅσιοι μετὰ φρονήσεως γενοίμεθα » καὶ ὅλως ἐν ἀρετῇ. Εἰ οὖν ἀρετῇ ὁμοιούμεθα, ἆρα ἀρετὴν ἔχοντι; Καὶ δὴ καὶ τίνι θεῷ; Ἆρ´ οὖν τῷ μᾶλλον δοκοῦντι ταῦτα ἔχειν καὶ δὴ τῇ τοῦ κόσμου ψυχῇ καὶ τῷ ἐν ταύτῃ ἡγουμένῳ ᾧ φρόνησις θαυμαστὴ ὑπάρχει; Καὶ γὰρ εὔλογον ἐνταῦθα ὄντας τούτῳ ὁμοιοῦσθαι. Ἢ πρῶτον μὲν ἀμφισβητήσιμον, εἰ καὶ τούτῳ ὑπάρχουσι πᾶσαι· οἷον σώφρονι ἀνδρείῳ εἶναι, ᾧ μήτε τι δεινόν ἐστιν· οὐδὲν γὰρ ἔξωθεν· μήτε προσιὸν ἡδὺ οὗ καὶ ἐπιθυμία ἂν γένοιτο μὴ παρόντος, ἵν´ ἔχῃ ἢ ἕλῃ. Εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἐν ὀρέξει ἐστὶ τῶν νοητῶν ὧν καὶ αἱ ἡμέτεραι, δῆλον ὅτι καὶ ἡμῖν ἐκεῖθεν ὁ κόσμος καὶ αἱ ἀρεταί. Ἆρ´ οὖν ἐκεῖνο ταύτας ἔχει; Ἢ οὐκ εὔλογον τάς γε πολιτικὰς λεγομένας ἀρετὰς ἔχειν, φρόνησιν μὲν περὶ τὸ λογιζόμενον, ἀνδρίαν δὲ περὶ τὸ θυμούμενον, σωφροσύνην δὲ ἐν ὁμολογίᾳ τινὶ καὶ συμφωνίᾳ ἐπιθυμητικοῦ πρὸς λογισμόν, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἑκάστου τούτων ὁμοῦ « οἰκειοπραγίαν ἀρχῆς πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι ». Ἆρ´ οὖν οὐ κατὰ τὰς πολιτικὰς ὁμοιούμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὰς μείζους τῷ αὐτῷ ὀνόματι χρωμένας; Ἀλλ´ εἰ κατ´ ἄλλας, κατὰ τὰς πολιτικὰς ὅλως οὔ; Ἢ ἄλογον μηδ´ ὁπωσοῦν ὁμοιοῦσθαι κατὰ ταύτας - τούτους γοῦν καὶ θείους ἡ φήμη λέγει καὶ λεκτέον ἀμῃγέπῃ ὡμοιῶσθαι - κατὰ δὲ τὰς μείζους τὴν ὁμοίωσιν εἶναι. Ἀλλ´ ἑκατέρως γε συμβαίνει ἀρετὰς ἔχειν κἂν εἰ μὴ τοιαύτας. Εἰ οὖν τις συγχωρεῖ, [κἂν εἰ μὴ τοιαύτας] ὁμοιοῦσθαι δύνασθαι, ἄλλως ἡμῶν ἐχόντων πρὸς ἄλλας, οὐδὲν κωλύει, καὶ μὴ πρὸς ἀρετὰς ὁμοιουμένων, ἡμᾶς ταῖς αὑτῶν ἀρεταῖς ὁμοιοῦσθαι τῷ μὴ ἀρετὴν κεκτημένῳ. Καὶ πῶς; Ὧδε· εἴ τι θερμότητος παρουσίᾳ θερμαίνεται, ἀνάγκη καὶ ὅθεν ἡ θερμότης ἐλήλυθε θερμαίνεσθαι; Καὶ εἴ τι πυρὸς παρουσίᾳ θερμόν ἐστιν, ἀνάγκη καὶ τὸ πῦρ αὐτὸ πυρὸς παρουσίᾳ θερμαίνεσθαι; Ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ πρότερον εἴποι ἄν τις καὶ ἐν τῷ πῦρ εἶναι θερμότητα, ἀλλὰ σύμφυτον, ὥστε τὸν λόγον ποιεῖν τῇ ἀναλογίᾳ ἑπόμενον ἐπακτὸν μὲν τῇ ψυχῇ τὴν ἀρετὴν, ἐκείνῳ δέ, ὅθεν μιμησαμένη ἔχει, σύμφυτον· πρὸς δὲ τὸν ἐκ τοῦ πυρὸς λόγον τὸ ἐκεῖνον ἀρετὴν εἶναι· ἀρετῆς δὲ ἀξιοῦμεν εἶναι μείζονα. Ἀλλ´ εἰ μὲν οὗ μεταλαμβάνει ψυχὴ τὸ αὐτὸ ἦν τῷ ἀφ´ οὗ, οὕτως ἔδει λέγειν· νῦν δὲ ἕτερον μὲν ἐκεῖνο, ἕτερον δὲ τοῦτο. Οὐδὲ γὰρ οἰκία ἡ αἰσθητὴ τὸ αὐτὸ τῇ νοητῇ, καίτοι ὡμοίωται· καὶ τάξεως δὲ καὶ κόσμου μεταλαμβάνει ἡ οἰκία ἡ αἰσθητὴ κἀκεῖ ἐν τῷ λόγῳ οὐκ ἔστι τάξις οὐδὲ κόσμος οὐδὲ συμμετρία. Οὕτως οὖν κόσμου καὶ τάξεως καὶ ὁμολογίας μεταλαμβάνοντες ἐκεῖθεν καὶ τούτων ὄντων τῆς ἀρετῆς ἐνθάδε, οὐ δεομένων δὲ τῶν ἐκεῖ ὁμολογίας οὐδὲ κόσμου οὐδὲ τάξεως, οὐδ´ ἂν ἀρετῆς εἴη χρεία, καὶ ὁμοιούμεθα οὐδὲν ἧττον τοῖς ἐκεῖ δι´ ἀρετῆς παρουσίαν. Πρὸς μὲν οὖν τὸ μὴ ἀναγκαῖον κἀκεῖ ἀρετὴν εἶναι, ἐπείπερ ἡμεῖς ἀρετῇ ὁμοιούμεθα, ταυτί· δεῖ δὲ πειθὼ ἐπάγειν τῷ λόγῳ μὴ μένοντας ἐπὶ τῆς βίας. [2] Πρῶτον τοίνυν τὰς ἀρετὰς ληπτέον καθ´ ἅς φαμεν ὁμοιοῦσθαι, ἵν´ αὖ τὸ αὐτὸ εὕρωμεν ὃ παρ´ ἡμῖν μὲν μίμημα ὂν ἀρετή ἐστιν, ἐκεῖ δὲ οἷον ἀρχέτυπον ὂν οὐκ ἀρετή, ἐπισημηνάμενοι ὡς ἡ ὁμοίωσις διττή· καὶ ἡ μέν τις ταὐτὸν ἐν τοῖς ὁμοίοις ἀπαιτεῖ, ὅσα ἐπίσης ὡμοίωται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ· ἐν οἷς δὲ τὸ μὲν ὡμοίωται πρὸς ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἐστι πρῶτον, οὐκ ἀντιστρέφον πρὸς ἐκεῖνο οὐδὲ ὅμοιον αὐτοῦ λεγόμενον, ἐνταῦθα τὴν ὁμοίωσιν ἄλλον τρόπον ληπτέον οὐ ταὐτὸν εἶδος ἀπαιτοῦντας, ἀλλὰ μᾶλλον ἕτερον, εἴπερ κατὰ τὸν ἕτερον τρόπον ὡμοίωται. Τί ποτε οὖν ἐστιν ἡ ἀρετὴ ἥ τε σύμπασα καὶ ἑκάστη; Σαφέστερος δὲ ὁ λόγος ἔσται ἐφ´ ἑκάστης· οὕτω γὰρ καὶ ὅ τι κοινόν, καθ´ ὃ ἀρεταὶ πᾶσαι, δῆλον ῥᾳδίως ἔσται. Αἱ μὲν τοίνυν πολιτικαὶ ἀρεταί, ἃς ἄνω που εἴπομεν, κατακοσμοῦσι μὲν ὄντως καὶ ἀμείνους ποιοῦσιν ὁρίζουσαι καὶ μετροῦσαι τὰς ἐπιθυμίας καὶ ὅλως τὰ πάθη μετροῦσαι καὶ ψευδεῖς δόξας ἀφαιροῦσαι τῷ ὅλως ἀμείνονι καὶ τῷ ὡρίσθαι καὶ τῶν ἀμέτρων καὶ ἀορίστων ἔξω εἶναι κατὰ τὸ μεμετρημένον· καὶ αὐταὶ ὁρισθεῖσαι, ᾗ μέτρα γε ἐν ὕλῃ τῇ ψυχῇ, ὡμοίωνται τῷ ἐκεῖ μέτρῳ καὶ ἔχουσιν ἴχνος τοῦ ἐκεῖ ἀρίστου. Τὸ μὲν γὰρ πάντη ἄμετρον ὕλη ὂν πάντη ἀνωμοίωται· καθ´ ὅσον δὲ μεταλαμβάνει εἴδους, κατὰ τοσοῦτον ὁμοιοῦται ἀνειδέῳ ἐκείνῳ ὄντι. Μᾶλλον δὲ τὰ ἐγγὺς μεταλαμβάνει· ψυχὴ δὲ ἐγγυτέρω σώματος καὶ συγγενέστερον· ταύτῃ καὶ πλέον μεταλαμβάνει, ὥστε καὶ ἐξαπατᾶν θεὸς φαντασθεῖσα, μὴ τὸ πᾶν θεοῦ τοῦτο ᾖ. Οὕτω μὲν οὖν οὗτοι ὁμοιοῦνται. [3] Ἀλλ´ ἐπεὶ τὴν ὁμοίωσιν ἄλλην ὑποφαίνει ὡς τῆς μείζονος ἀρετῆς οὖσαν, περὶ ἐκείνης λεκτέον· ἐν ᾧ καὶ σαφέστερον ἔσται μᾶλλον καὶ τῆς πολιτικῆς ἡ οὐσία, καὶ ἥτις ἡ μείζων κατὰ τὴν οὐσίαν, καὶ ὅλως, ὅτι ἔστι παρὰ τὴν πολιτικὴν ἑτέρα. Λέγων δὴ ὁ Πλάτων τὴν « ὁμοίωσιν » τὴν πρὸς τὸν « θεὸν φυγὴν » τῶν ἐντεῦθεν εἶναι, καὶ ταῖς ἀρεταῖς ταῖς ἐν πολιτείᾳ οὐ τὸ ἁπλῶς διδούς, ἀλλὰ προστιθεὶς « πολιτικάς γε », καὶ ἀλλαχοῦ « καθάρσεις » λέγων ἁπάσας δῆλός τέ ἐστι διττὰς τιθεὶς καὶ τὴν ὁμοίωσιν οὐ κατὰ τὴν πολιτικὴν τιθείς. Πῶς οὖν λέγομεν ταύτας καθάρσεις καὶ πῶς καθαρθέντες μάλιστα ὁμοιούμεθα; Ἢ ἐπειδὴ κακὴ μέν ἐστιν ἡ ψυχὴ « συμπεφυρμένη » τῷ σώματι καὶ ὁμοπαθὴς γινομένη αὐτῷ καὶ πάντα συνδοξάζουσα, εἴη ἂν ἀγαθὴ καὶ ἀρετὴν ἔχουσα, εἰ μήτε συνδοξάζοι, ἀλλὰ μόνη ἐνεργοῖ - ὅπερ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ φρονεῖν - μήτε ὁμοπαθὴς εἴη - ὅπερ ἐστὶ σωφρονεῖν - μήτε φοβοῖτο ἀφισταμένη τοῦ σώματος - ὅπερ ἐστὶν ἀνδρίζεσθαι - ἡγοῖτο δὲ λόγος καὶ νοῦς, τὰ δὲ μὴ ἀντιτείνοι - δικαιοσύνη δ´ ἂν εἴη τοῦτο. Τὴν δὴ τοιαύτην διάθεσιν τῆς ψυχῆς καθ´ ἣν νοεῖ τε καὶ ἀπαθὴς οὕτως ἐστίν, εἴ τις ὁμοίωσιν λέγοι πρὸς θεόν, οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι· καθαρὸν γὰρ καὶ τὸ θεῖον καὶ ἡ ἐνέργεια τοιαύτη, ὡς τὸ μιμούμενον ἔχειν φρόνησιν. Τί οὖν οὐ κἀκεῖνο οὕτω διάκειται; Ἢ οὐδὲ διάκειται, ψυχῆς δὲ ἡ διάθεσις. Νοεῖ τε ἡ ψυχὴ ἄλλως· τῶν δὲ ἐκεῖ τὸ μὲν ἑτέρως, τὸ δὲ οὐδὲ ὅλως. Πάλιν οὖν τὸ νοεῖν ὁμώνυμον; Οὐδαμῶς· ἀλλὰ τὸ μὲν πρώτως, τὸ δὲ παρ´ ἐκείνου ἑτέρως. Ὡς γὰρ ὁ ἐν φωνῇ λόγος μίμημα τοῦ ἐν ψυχῇ, οὕτω καὶ ὁ ἐν ψυχῇ μίμημα τοῦ ἐν ἑτέρῳ. Ὡς οὖν μεμερισμένος ὁ ἐν προφορᾷ πρὸς τὸν ἐν ψυχῇ, οὕτω καὶ ὁ ἐν ψυχῇ ἑρμηνεὺς ὢν ἐκείνου πρὸς τὸ πρὸ αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀρετὴ ψυχῆς· νοῦ δὲ οὐκ ἔστιν οὐδὲ τοῦ ἐπέκεινα. [4] Ζητητέον δέ, εἰ ἡ κάθαρσις ταὐτὸν τῇ τοιαύτῃ ἀρετῇ, ἢ προηγεῖται μὲν ἡ κάθαρσις, ἕπεται δὲ ἡ ἀρετή, καὶ πότερον ἐν τῷ καθαίρεσθαι ἡ ἀρετὴ ἢ ἐν τῷ κεκαθάρθαι. Ἀτελεστέρα τῆς ἐν τῷ κεκαθάρθαι 〈ἡ ἐν τῷ καθαίρεσθαι· τὸ γὰρ κεκαθάρθαι〉 οἷον τέλος ἤδη. Ἀλλὰ τὸ κεκαθάρθαι ἀφαίρεσις ἀλλοτρίου παντός, τὸ δὲ ἀγαθὸν ἕτερον αὐτοῦ. Ἤ, εἰ πρὸ τῆς ἀκαθαρσίας ἀγαθὸν ἦν, ἡ κάθαρσις ἀρκεῖ· ἀλλ´ ἀρκέσει μὲν ἡ κάθαρσις, τὸ δὲ καταλειπόμενον ἔσται τὸ ἀγαθόν, οὐχ ἡ κάθαρσις. Καὶ τί τὸ καταλειπόμενόν ἐστι, ζητητέον· ἴσως γὰρ οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν ἦν ἡ φύσις ἡ καταλειπομένη· οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο ἐν κακῷ. Ἆρ´ οὖν ἀγαθοειδῆ λεκτέον; Ἢ οὐχ ἱκανὴν πρὸς τὸ μένειν ἐν τῷ ὄντως ἀγαθῷ· πέφυκε γὰρ ἐπ´ ἄμφω. Τὸ οὖν ἀγαθὸν αὐτῆς τὸ συνεῖναι τῷ συγγενεῖ, τὸ δὲ κακὸν τὸ τοῖς ἐναντίοις. Δεῖ οὖν καθηραμένην συνεῖναι. Συνέσται δὲ ἐπιστραφεῖσα. Ἆρ´ οὖν μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐπιστρέφεται; Ἢ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐπέστραπται. Τοῦτ´ οὖν ἡ ἀρετὴ αὐτῆς; Ἢ τὸ γινόμενον αὐτῇ ἐκ τῆς ἐπιστροφῆς. Τί οὖν τοῦτο; Θέα καὶ τύπος τοῦ ὀφθέντος ἐντεθεὶς καὶ ἐνεργῶν, ὡς ἡ ὄψις περὶ τὸ ὁρώμενον. Οὐκ ἄρα εἶχεν αὐτὰ οὐδ´ ἀναμιμνήσκεται; Ἢ εἶχεν οὐκ ἐνεργοῦντα, ἀλλὰ ἀποκείμενα ἀφώτιστα· ἵνα δὲ φωτισθῇ καὶ τότε γνῷ αὐτὰ ἐνόντα, δεῖ προσβαλεῖν τῷ φωτίζοντι. Εἶχε δὲ οὐκ αὐτά, ἀλλὰ τύπους· δεῖ οὖν τὸν τύπον τοῖς ἀληθινοῖς, ὧν καὶ οἱ τύποι, ἐφαρμόσαι. Τάχα δὲ καὶ οὕτω λέγεται ἔχειν, ὅτι ὁ νοῦς οὐκ ἀλλότριος καὶ μάλιστα δὲ οὐκ ἀλλότριος, ὅταν πρὸς αὐτὸν βλέπῃ· εἰ δὲ μή, καὶ παρὼν ἀλλότριος. Ἐπεὶ κἀν † ταῖς ἐπιστήμαις· ἐὰν μηδ´ ὅλως ἐνεργῶμεν κατ´ αὐτάς, ἀλλότριαι. [5] Ἀλλ´ ἐπὶ πόσον ἡ κάθαρσις λεκτέον· οὕτω γὰρ καὶ ἡ ὁμοίωσις τίνι 〈θεῷ〉 φανερὰ καὶ ἡ ταυτότης [τίνι θεῷ]. Τοῦτο δέ ἐστι μάλιστα ζητεῖν θυμὸν πῶς καὶ ἐπιθυμίαν καὶ τἆλλα πάντα, λύπην καὶ τὰ συγγενῆ, καὶ τὸ χωρίζειν ἀπὸ σώματος ἐπὶ πόσον δυνατόν. Ἀπὸ μὲν δὴ σώματος ἴσως μὲν καὶ τοῖς οἷον τόποις συνάγουσαν πρὸς ἑαυτήν, πάντως μὴν ἀπαθῶς ἔχουσαν καὶ τὰς ἀναγκαίας τῶν ἡδονῶν αἰσθήσεις μόνον ποιουμένην καὶ ἰατρεύσεις καὶ ἀπαλλαγὰς πόνων, ἵνα μὴ ἐνοχλοῖτο, τὰς δὲ ἀλγηδόνας ἀφαιροῦσαν καί, εἰ μὴ οἷόν τε, πράως φέρουσαν καὶ ἐλάττους τιθεῖσαν τῷ μὴ συμπάσχειν· τὸν δὲ θυμὸν ὅσον οἷόν τε ἀφαιροῦσαν καί, εἰ δυνατόν, πάντη, εἰ δὲ μή, μὴ γοῦν αὐτὴν συνοργιζομένην, ἀλλ´ ἄλλου εἶναι τὸ ἀπροαίρετον, τὸ δὲ ἀπροαίρετον ὀλίγον εἶναι καὶ ἀσθενές· τὸν δὲ φόβον πάντη· περὶ οὐδενὸς γὰρ φοβήσεται - τὸ δὲ ἀπροαίρετον καὶ ἐνταῦθα - πλήν γ´ ἐν νουθετήσει. Ἐπιθυμίαν δέ; Ὅτι μὲν μηδενὸς φαύλου, δῆλον· σίτων δὲ καὶ ποτῶν πρὸς ἄνεσιν οὐκ αὐτὴ ἕξει· οὐδὲ τῶν ἀφροδισίων δέ· εἰ δ´ ἄρα, φυσικῶν, οἶμαι, καὶ οὐδὲ τὸ ἀπροαίρετον ἔχουσαν· εἰ δ´ ἄρα, ὅσον μετὰ φαντασίας προτυποῦς καὶ ταύτης. Ὅλως δὲ αὕτη μὲν πάντων τούτων καθαρὰ ἔσται καὶ τὸ ἄλογον δὲ βουλήσεται καὶ αὐτὸ καθαρὸν ποιῆσαι, ὥστε μηδὲ πλήττεσθαι· εἰ δ´ ἄρα, μὴ σφόδρα, ἀλλ´ ὀλίγας τὰς πληγὰς αὐτοῦ εἶναι καὶ εὐθὺς λυομένας τῇ γειτονήσει. ὥσπερ εἴ τις σοφῷ γειτονῶν ἀπολαύοι τῆς τοῦ σοφοῦ γειτνιάσεως ἢ ὅμοιος γενόμενος ἢ αἰδούμενος, ὡς μηδὲν τολμᾶν ποιεῖν ὧν ὁ ἀγαθὸς οὐ θέλει. Οὔκουν ἔσται μάχη· ἀρκεῖ γὰρ παρὼν ὁ λόγος, ὃν τὸ χεῖρον αἰδέσεται, ὥστε καὶ αὐτὸ τὸ χεῖρον δυσχερᾶναι, ἐάν τι ὅλως κινηθῇ, ὅτι μὴ ἡσυχίαν ἦγε παρόντος τοῦ δεσπότου, καὶ ἀσθένειαν αὑτῷ ἐπιτιμῆσαι. [6] Ἔστι μὲν οὖν οὐδὲν τῶν τοιούτων ἁμαρτία, ἀλλὰ κατόρθωσις ἀνθρώπῳ· ἀλλ´ ἡ σπουδὴ οὐκ ἔξω ἁμαρτίας εἶναι, ἀλλὰ θεὸν εἶναι. Εἰ μὲν οὖν τι τῶν τοιούτων ἀπροαίρετον γίνοιτο, θεὸς ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος καὶ δαίμων διπλοῦς ὤν, μᾶλλον δὲ ἔχων σὺν αὐτῷ ἄλλον ἄλλην ἀρετὴν ἔχοντα· εἰ δὲ μηδέν, θεὸς μόνον· θεὸς δὲ τῶν ἑπομένων τῷ πρώτῳ. Αὐτὸς μὲν γάρ ἐστιν ὃς ἦλθεν ἐκεῖθεν καὶ τὸ καθ´ αὑτόν, εἰ γένοιτο οἷος ἦλθεν, ἐκεῖ ἐστιν· ᾧ δὲ συνῳκίσθη ἐνθάδε ἥκων, καὶ τοῦτον αὐτῷ ὁμοιώσει κατὰ δύναμιν τὴν ἐκείνου, ὥστε, εἰ δυνατόν, ἄπληκτον εἶναι ἢ ἄπρακτόν γε τῶν μὴ δοκούντων τῷ δεσπότῃ. Τίς οὖν ἑκάστη ἀρετὴ τῷ τοιούτῳ; Ἢ σοφία μὲν καὶ φρόνησις ἐν θεωρίᾳ ὧν νοῦς ἔχει· νοῦς δὲ τῇ ἐπαφῇ. Διττὴ δὲ ἑκατέρα, ἡ μὲν ἐν νῷ οὖσα, ἡ δὲ ἐν ψυχῇ. Κἀκεῖ μὲν οὐκ ἀρετή, ἐν δὲ ψυχῇ ἀρετή. Ἐκεῖ οὖν τί; Ἐνέργεια αὐτοῦ καὶ ὅ ἐστιν· ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν ἄλλῳ ἐκεῖθεν ἀρετή. Οὐδὲ γὰρ αὐτοδικαιοσύνη καὶ ἑκάστη ἀρετή, ἀλλ´ οἷον παράδειγμα· τὸ δὲ ἀπ´ αὐτῆς ἐν ψυχῇ ἀρετή. Τινὸς γὰρ ἡ ἀρετή· αὐτὸ δὲ ἕκαστον αὑτοῦ, οὐχὶ δὲ ἄλλου τινός. Δικαιοσύνη δὲ εἴπερ οἰκειοπραγία, ἆρα αἰεὶ ἐν πλήθει μερῶν; Ἢ ἡ μὲν ἐν πλήθει, ὅταν πολλὰ ᾖ τὰ μέρη, ἡ δὲ ὅλως οἰκειοπραγία, κἂν ἑνὸς ᾖ. Ἡ γοῦν ἀληθὴς αὐτοδικαιοσύνη ἑνὸς πρὸς αὐτό, ἐν ᾧ οὐκ ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο· ὥστε καὶ τῇ ψυχῇ δικαιοσύνη ἡ μείζων τὸ πρὸς νοῦν ἐνεργεῖν, τὸ δὲ σωφρονεῖν ἡ εἴσω πρὸς νοῦν στροφή, ἡ δὲ ἀνδρία ἀπάθεια καθ´ ὁμοίωσιν τοῦ πρὸς ὃ βλέπει ἀπαθὲς ὂν τὴν φύσιν, αὐτὴ δὲ ἐξ ἀρετῆς, ἵνα μὴ συμπαθῇ τῷ χείρονι συνοίκῳ.
[7] Ἀντακολουθοῦσι τοίνυν ἀλλήλαις καὶ
αὗται αἱ ἀρεταὶ ἐν ψυχῇ, ὥσπερ κἀκεῖ τὰ πρὸ τῆς ἀρετῆς [αἱ] ἐν νῷ
ὥσπερ παραδείγματα. Καὶ γὰρ ἡ νόησις ἐκεῖ ἐπιστήμη καὶ σοφία, τὸ δὲ
πρὸς αὐτὸν ἡ σωφροσύνη, τὸ δὲ οἰκεῖον ἔργον ἡ οἰκειοπραγία, τὸ δὲ
οἷον ἀνδρία ἡ ἀυλότης καὶ τὸ ἐφ´ αὑτοῦ μένειν καθαρόν. Ἐν ψυχῇ
τοίνυν πρὸς νοῦν ἡ ὅρασις σοφία καὶ φρόνησις, ἀρεταὶ αὐτῆς· οὐ γὰρ
αὐτὴ ταῦτα, ὥσπερ ἐκεῖ. Καὶ τὰ ἄλλα ὡσαύτως ἀκολουθεῖ· καὶ τῇ
καθάρσει δέ, εἴπερ πᾶσαι καθάρσεις κατὰ τὸ κεκαθάρθαι, ἀνάγκη πάσας·
ἢ οὐδεμία τελεία. Καὶ ὁ μὲν ἔχων τὰς μείζους καὶ τὰς ἐλάττους ἐξ
ἀνάγκης δυνάμει, ὁ δὲ τὰς ἐλάττους οὐκ ἀναγκαίως ἔχει ἐκείνας. Ὁ μὲν
δὴ προηγούμενος τοῦ σπουδαίου βίος οὗτος. Πότερα δὲ ἐνεργείᾳ ἔχει
καὶ τὰς ἐλάττους ὁ τὰς μείζους ἢ ἄλλον τρόπον, σκεπτέον καθ´
ἑκάστην· οἷον φρόνησιν· εἰ γὰρ ἄλλαις ἀρχαῖς χρήσεται, πῶς ἔτι
ἐκείνη μένει κἂν εἰ μὴ ἐνεργοῦσα; Καὶ εἰ ἡ μὲν φύσει τοσόνδε, ἡ δὲ
τοσόνδε, καὶ ἡ σωφροσύνη ἐκείνη μετροῦσα, ἡ δὲ ὅλως ἀναιροῦσα;
Ταὐτὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅλως τῆς φρονήσεως κινηθείσης. Ἢ εἰδήσει
γε αὐτὰς καὶ ὅσον παρ´ αὐτῶν ἕξει; τάχα δέ ποτε περιστατικῶς
ἐνεργήσει κατά τινας αὐτῶν. Ἐπὶ μείζους δὲ ἀρχὰς ἥκων καὶ ἄλλα μέτρα
κατ´ ἐκεῖνα πράξει· οἷον τὸ σωφρονεῖν οὐκ ἐν μέτρῳ ἐκείνῳ τιθείς,
ἀλλ´ ὅλως κατὰ τὸ δυνατὸν χωρίζων καὶ ὅλως ζῶν οὐχὶ τὸν ἀνθρώπου
βίον τὸν τοῦ ἀγαθοῦ, ὃν ἀξιοῖ ἡ πολιτικὴ ἀρετή, ἀλλὰ τοῦτον μὲν
καταλιπών, ἄλλον δὲ ἑλόμενος τὸν τῶν θεῶν· πρὸς γὰρ τούτους, οὐ πρὸς
ἀνθρώπους ἀγαθοὺς ἡ ὁμοίωσις. Ὁμοίωσις δὲ ἡ μὲν πρὸς τούτους, ὡς
εἰκὼν εἰκόνι ὡμοίωται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἑκατέρα. Ἡ δὲ πρὸς ἄλλον ὡς πρὸς
παράδειγμα. |
[1] Puisque le mal règne ici-bas et domine inévitablement en ce monde, et puisque l'âme veut fuir le mal, il faut fuir d'ici-bas. Mais quel en est le moyen? C'est, dit Platon, de nous rendre semblables à Dieu. Or nous y réussirons en nous formant à la justice, à la sainteté, à la sagesse, et en général à la vertu (02). Si c'est par la vertu qu'a lieu cette assimilation, le Dieu à qui nous voulons nous rendre semblables possède–t–il lui–même la vertu? Mais quel est ce Dieu? Sans doute c'est celui qui semble devoir posséder la vertu au plus haut degré, c'est l'Âme du monde, avec le principe qui gouverne en elle et qui a une sagesse admirable [l'Intelligence suprême]. Habitant ce monde, c'est à ce Dieu que nous devons chercher à ressembler. Et cependant, on peut douter à la première vue que toutes les vertus puissent convenir à ce Dieu, qu'on puisse par exemple lui attribuer 52 la modération dans les désirs ou le courage : le courage, puisqu'il n'a aucun danger à craindre, étant à l'abri de toute atteinte; la modération, puisqu'il ne peut exister aucun objet agréable dont la présence excite ses désirs, dont l'absence excite ses regrets. Mais si Dieu aspire comme nous-mêmes aux choses intelligibles, c'est évidemment de là que nous recevons l'ordre et les vertus. Dieu possède-t-il donc ces vertus? Il n'est pas convenable de lui attribuer les vertus qu'on nomme civiles (πολιτικαί) : la prudence, qui se rapporte à la partie raisonnable de notre être, le courage, qui se rapporte à la partie irascible, la tempérance, qui consiste dans l'accord et l'harmonie de la partie concupiscible et de la raison, la justice enfin, qui consiste dans l'accomplissement par toutes ces facultés de la fonction propre à chacune d'elles, soit pour commander, soit pour obéir (03). Mais si ce n'est pas par les vertus civiles que nous pouvons nous rendre semblables à Dieu, n'est-ce pas par des vertus qui sont d'un ordre supérieur et qui portent le même nom? Dans ce cas, les vertus civiles sont-elles complètement inutiles pour atteindre notre but? Non : on ne peut pas dire qu'en les pratiquant on ne ressemble en aucune manière à Dieu: car la renommée proclame divins ceux qui les possèdent. Elles nous donnent donc quelque ressemblance avec Dieu, mais c'est par les vertus d'un ordre supérieur que nous lui devenons complètement semblables. Il semble que de l'une ou de l'autre façon on est conduit à attribuer à Dieu des vertus, quoique ce ne soient pas des vertus civiles. Si l'on accorde que, bien que Dieu ne possède pas les vertus civiles, nous pouvons lui devenir semblables par d'autres vertus (car il peut en être autrement pour des 53 vertus d'un autre ordre), rien n'empêche que, sans nous assimiler à Dieu par les vertus civiles, nous devenions, par des vertus qui cependant sont nôtres, semblables à l'être qui ne possède pas la vertu. Comment cela peut-il avoir lieu? Le voici : quand un corps est échauffé par la présence de la chaleur, est-il nécessaire que le corps d'où provient la chaleur soit échauffé lui-même par un autre? Si un corps est chaud par l'effet de la présence du feu, faut-il que le feu soit lui-même échauffé par la présence d'un autre feu? On dira peut-être d'abord : il y a de la chaleur dans le feu. mais une chaleur innée; d'où l'on doit conclure par voie d'analogie que la vertu, qui n'est qu'adventice dans l'âme, est innée dans Celui de qui l'âme la tient par imitation [dans Dieu]. A l'argument tiré du feu, on répondra peut-être encore que Dieu possède la vertu, mais une vertu d'une nature supérieure (04). Cette réponse serait juste, si la vertu à laquelle l'âme participe était identique au principe dont elle la tient ; mais il y a tout au contraire opposition complète : quand nous voyons une maison, la maison sensible n'est pas identique à la maison intelligible, quoiqu'elle lui soit semblable. En effet la maison sensible participe à l'ordre et à la proportion, tandis que l'on ne saurait attribuer à l'idée de cette maison ni ordre, ni proportion, ni symétrie. De même nous tenons de Dieu l'ordre, la proportion, l'harmonie, conditions de la vertu ici-bas, sans que l'Intelligence suprême ait besoin de posséder elle-même ni ordre, ni proportion, ni harmonie. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle possède la vertu, quoique ce soit par la vertu que nous lui 54 devenons semblables. Voilà ce que nous avions à dire afin de montrer qu'il n'est pas nécessaire que l'Intelligence divine possède la vertu pour que nous lui devenions semblables par la vertu. Mais il faut persuader cette vérité, sans se contenter de contraindre l'esprit à l'admettre. [2]. Examinons d'abord les vertus par lesquelles nous devenons semblables à Dieu, et cherchons quel genre d'identité il y a entre l'image qui dans notre âme constitue la vertu et le principe qui dans l'Intelligence suprême est l'archétype de la vertu sans être la vertu. Il y a deux espèces de ressemblance : l'une exige l'identité de nature entre les choses qui sont semblables entre elles, comme le sont celles qui procèdent d'un même principe; l'autre dérive de ce qu'une chose ressemble à une autre qui lui est antérieure et lui sert de principe. Dans ce second cas, il n'y a pas réciprocité, et le principe n'est pas semblable à ce qui lui est inférieur; ou du moins la ressemblance doit être conçue ici tout autrement : elle n'implique pas que les êtres où elle se trouve soient de même espèce, mais plutôt d'espèces différentes, puisqu'ils se ressemblent d'une autre manière. Qu'est-ce donc que la vertu, soit en général, soit en particulier? Pour plus de clarté, considérons une espèce particulière de vertu : c'est le moyen de déterminer facilement ce qui constitue l'essence commune de toutes les vertus. Si les vertus civiles, dont nous venons de parler, ornent réellement notre âme et la rendent meilleure, c'est parce qu'elles règlent et modèrent nos appétits, qu'elles tempèrent nos passions, qu'elles nous délivrent des fausses opinions, qu'elles nous renferment dans de justes limites, et qu'elles sont elles-mêmes déterminées par une sorte de mesure. Cette mesure, qu'elles donnent à notre âme comme une forme à une matière, ressemble à la mesure des choses intelligibles (05) ; c'est comme un vestige de ce qu'il y a là-55 haut de plus parfait. Ce qui n'a aucune mesure, n'étant que matière informe, ne peut aucunement ressembler à la divinité : car on s'assimile d'autant plus à l'être qui n'a pas de forme qu'on participe plus de la forme ; et on participe d'autant plus de la forme qu'on en est plus proche. C'est ainsi que notre âme, qui par sa nature en est plus proche que le corps, par cela même participe davantage de l'essence divine, et pousse assez loin la ressemblance qu'elle a avec elle pour faire croire que Dieu est tout ce qu'elle est elle-même. C'est de cette manière que les hommes qui possèdent les vertus civiles s'assimilent à Dieu. [3] Platon indiquant un autre mode d'assimilation comme le privilège d'une vertu supérieure (06), nous parlerons de cet autre mode. Par là on comprendra mieux quelle est l'essence de la vertu civile, et ce qu'est cette autre vertu d'une nature supérieure, et en quoi elle diffère de la précédente. Quand Platon dit qu'on s'assimile à Dieu en fuyant d'ici-bas, et qu'au lieu d'appeler simplement du nom de vertus les vertus qui ont rapport à la vie sociale, il y ajoute l'épithète de civiles, enfin lorsque dans un autre endroit il dit que toutes les vertus sont des procédés de purification (07), il distingue évidemment deux sortes de vertus, et ce n'est pas aux vertus civiles qu'il attribue le pouvoir de nous assimiler à Dieu. A quel titre donc peut-on dire que les vertus purifient, et comment en nous purifiant nous rapprochent–elles le plus possible de la divinité? L'âme est mauvaise tant qu'elle est mêlée au corps, qu'elle partage ses passions, ses opinions; elle ne devient meilleure et n'entre en possession de la vertu, que lorsqu'au lieu d'opiner avec le corps, elle pense par elle-même (ce qui est la vraie pensée et constitue la prudence), lorsqu'elle cesse de partager ses passions (ce qui est la tempérance), qu'elle ne craint pas d'être séparée 56 du corps (ce qui est le courage), lorsqu'enfin la raison et l'intelligence commandent et sont obéies (ce qui est la justice). On peut, sans crainte de se tromper, affirmer que la disposition d'une âme ainsi réglée, d'une âme qui pense les choses intelligibles et qui reste impassible, est ce qui constitue la ressemblance avec Dieu : car ce qui est pur est divin, et telle est la nature de l'action divine que ce qui l'imite possède par cela même la sagesse. Mais Dieu a-t-il une pareille disposition? Non : c'est à l'âme seule qu'il appartient d'avoir une disposition. D'ailleurs l'âme ne pense pas les objets intelligibles de la même manière que Dieu: ce qui est en Dieu ne se trouve en nous que d'une manière toute différente ou même ne s'y trouve pas du tout. Ainsi la pensée de Dieu n'est pas identique avec la nôtre. La pensée de Dieu est un premier principe dont la nôtre dérive et diffère. Comme la parole extérieure n'est que l'image de la parole intérieure de l'âme, la parole de l'âme n'est elle-même que l'image de la parole d'un principe supérieur; et comme la parole extérieure parait divisée quand on la compare à la parole intérieure de l'âme, celle de l'âme, qui n'est que l'interprète de la parole intelligible, est divisée par rapport à celle-ci. C'est ainsi que la vertu appartient à l'âme sans appartenir ni à l'Intelligence absolue, ni au principe supérieur à l'Intelligence. [4] La purification (κάθαρσις) est-elle la même chose que la vertu telle que nous venons de la définir? Ou bien la vertu est-elle la conséquence de la purification? Dans ce cas, consiste-t-elle à se purifier actuellement ou à être déjà purifié? voilà ce que nous avons à examiner. Se purifier est inférieur à être déjà purifié : car la pureté est le but que l'âme a besoin d'atteindre. Être pur, c'est s'être séparé de toute chose étrangère ; ce n'est pas encore posséder le bien. Si l'âme eût possédé le bien avant de perdre sa pureté, il lui suffirait de se purifier; dans ce cas 57 même, ce qui lui resterait après s'être purifiée, ce serait le bien, et non la purification. Que reste-t-il donc? Ce n'est pas le bien ; sinon, l'âme ne serait pas tombée dans le mal. Elle a donc la forme du bien, sans être cependant capable de rester solidement attachée au bien, parce que sa nature lui permet d'incliner également au bien et au mal. Le bien de l'âme, c'est de rester unie à l'intelligence dont elle est sœur; son mal, de s'abandonner aux choses contraires. Il faut donc, après avoir purifié l'âme, l'unir à Dieu; or, pour l'unir à Dieu, il faut la tourner vers lui. Cette conversion (08) ne commence pas à s'opérer après la purification ; elle en est le résultat même. La vertu de l'âme ne consiste pas alors dans sa conversion, mais dans ce qu'elle obtient par sa conversion. Or qu'obtient-elle? l'intuition de l'objet intelligible, son image produite et réalisée en elle, image semblable à celle que l'œil a des choses qu'il voit. Faut-il en conclure que l'âme ne possédait pas cette image, qu'elle n'en avait pas de réminiscence? Elle la possédait sans doute, mais inactive, latente, obscure. Pour la rendre claire, pour connaître ce qu'elle possède, l'âme a besoin de s'approcher de la source de toute clarté. Or, comme elle ne possède que les images des intelligibles sans posséder les intelligibles mêmes, il est nécessaire qu'elle compare avec eux les images qu'elle en a. Il est facile à l'âme de contempler les intelligibles, parce que l'intelligence ne lui est pas étrangère; il suffit à l'âme, pour entrer en commerce avec elle, de tourner vers elle ses regards. Sinon, l'intelligence reste étrangère à l'âme, quoiqu'elle soit présente en elle. C'est ainsi que toutes nos connaissances sont pour nous comme si elles n'existaient pas quand nous ne nous en occupons pas. [5] Jusqu'où conduit la purification? telle est la ques- 58 tion que nous avons à résoudre pour savoir à quel Dieu (09) l'âme peut se rendre semblable et s'identifier. La résoudre, c'est examiner jusqu'à quel point l'âme peut réprimer la colère, les appétits et les passions de toute espèce, triompher de la douleur et des autres sentiments semblables, enfin se séparer du corps. Elle se sépare du corps lorsque, abandonnant les divers lieux où elle s'était en quelque sorte répandue, elle se retire en elle-même, lorsqu'elle devient entièrement étrangère aux passions, qu'elle ne permet au corps que les plaisirs nécessaires ou propres à le guérir de ses douleurs, à le délasser de ses fatigues, à l'empêcher d'être importun; lorsqu'elle devient insensible aux souffrances, ou que, si cela n'est pas en son pouvoir, elle les supporte patiemment et les diminue en ne consentant pas à les partager ; lorsqu'elle apaise la colère autant que possible, et même, si elle le peut, la supprime entièrement, ou que du moins, si cela ne se peut pas, elle n'y participe en rien, laissant à la nature animale l'emportement irréfléchi, et encore réduisant et affaiblissant le plus possible les mouvements irréfléchis ; lorsqu'elle est absolument inaccessible à la crainte, n'ayant plus rien à redouter; lorsqu'elle comprime tout brusque mouvement, à moins que ce ne soit un avertissement de la nature à l'approche d'un danger. L'âme purifiée ne devra évidemment désirer rien de honteux : dans le boire et le manger, elle ne recherchera que la satisfaction d'un besoin, tout en y restant étrangère ; elle ne recherchera pas davantage les plaisirs de l'amour, ou, si elle les désire, elle n'ira pas au delà de ce qu'exige la nature, résistant à tout emportement irréfléchi, ou même ne dépassant pas les élans involon- 59 taires de l'imagination (10). En un mot, l'âme sera pure de toutes ces passions et voudra même purifier la partie irrationnelle de notre être de manière à la préserver des émotions, ou du moins à diminuer le nombre et l'intensité de ces émotions et à les apaiser promptement par sa présence. C'est ainsi qu'un homme placé auprès d'un sage profite de ce voisinage, soit en lui devenant semblable, soit en craignant de rien faire que ce sage puisse désapprouver. Cette influence de la raison s'exercera sans lutte et sans contrainte : il suffit en effet qu'elle soit présente ; le principe inférieur la respectera au point de se fâcher contre lui-même et de se reprocher sa propre faiblesse, s'il éprouve quelque agitation qui puisse troubler le repos de son maître. [6] L'homme parvenu à l'état que nous venons de décrire ne commet plus de fautes pareilles : il en est corrigé. Mais le but auquel il aspire, ce n'est point de ne pas faillir, c'est d'être dieu. S'il laisse encore se produire en lui quelqu'un des mouvements irréfléchis dont nous avons parlé, il sera à la fois dieu et démon (11); il sera un être double, ou plutôt il aura en lui un principe d'une autre nature (12), dont la vertu différera également de la sienne. Si, au contraire, il n'est plus troublé par aucun de ces mouvements, il sera uniquement dieu; il sera un de ces dieux qui forment le cortège du Premier (13). C'est un dieu de cette nature qui est venu d'en haut habiter en nous. Redevenir ce qu'il était originairement, c'est vivre dans ce monde supérieur. Celui qui s'est élevé jusque-là habite avec l'intelligence pure et s'y assimile autant que possible. Aussi n'éprouve-t-il plus aucune de ces émotions, ne fait-il aucune 60 de ces actions que désapprouverait le principe supérieur, qui désormais est son seul maître. Que devient chaque vertu pour un tel être? Pour lui, la sagesse consiste à contempler les essences que l'intelligence possède, essences avec lesquelles l'intelligence est en quelque sorte en contact. Il y a deux espèces de sagesse, dont l'une est propre à l'intelligence, l'autre à l'âme : c'est dans la dernière seule qu'il y a vertu. Qu'y a-t-il donc dans l'intelligence? L'acte [de la pensée] et l'essence. L'image de cette essence, qu'on voit ici-bas dans un être d'une autre nature, c'est la vertu qui en émane. II n'y a en effet dans l'intelligence ni la justice absolue, ni aucune des vertus proprement dites; il n'y eu a que le type. Ce qui en dérive dans l'âme est la vertu : car la vertu est l'attribut. d'un être particulier. L'intelligible, au contraire, n'appartient qu'à lui-même, n'est l'attribut d'aucun être particulier. Si la justice consiste à remplir sa fonction propre, implique-t-elle toujours multiplicité? Assurément, si elle est dans un principe qui a plusieurs parties [l'âme humaine, dans laquelle on distingue plusieurs facultés] ; mais son essence est dans l'accomplissement de la fonction propre à chaque être, lors même qu'elle se trouve dans un principe qui est un [l'Intelligence]. La justice absolue et véritable consiste dans l'action que dirige sur lui-même le principe qui est un, dans lequel on ne peut distinguer de parties. A ce degré supérieur, la justice consiste à diriger l'action de l'âme vers l'intelligence; la tempérance est la conversion intime de l'âme vers l'intelligence ; le courage est l'impassibilité, par laquelle l'âme devient semblable à ce qu'elle contemple, puisque l'intelligence est impassible par sa nature. Or cette impassibilité, l'âme la tient de la vertu qui l'empêche de partager les passions du principe inférieur auquel elle est associée. [7] Les vertus ont dans l'âme le même enchaînement qu'ont entre eux dans l'intelligence les types supérieurs à la 61 vertu. Pour l'intelligence, la pensée est ce qui constitue la sagesse et la prudence; la conversion vers soi-même est la tempérance; l'accomplissement de sa fonction propre est la justice; ce qui est l'analogue du courage, c'est la persévérance de l'intelligence à rester en soi-même, à se maintenir pure et séparée de la matière. Donc contempler l'intelligence constituera pour l'âme la sagesse, la prudence, qui sont alors des vertus et non plus des types. Car l'âme n'est pas comme l'intelligence identique aux essences qu'elle pense. Les autres vertus de l'âme correspondront de la même manière aux types supérieurs. Nous en dirons autant de la purification. Puisque toute vertu est purification, la vertu exige qu'on se soit purifié; sans cela, elle ne serait point parfaite. Quiconque possède les vertus de l'ordre supérieur possède nécessairement en puissance les vertus inférieures. Mais celui qui possède les inférieures ne possède pas nécessairement les supérieures. Tels sont les principaux caractères de la vie de l'homme vertueux. Il nous resterait à considérer s'il possède en acte ou d'une autre façon les vertus, soit supérieures, soit inférieures. Pour le savoir, il faudrait examiner séparément chacune d'elles, la prudence, par exemple (14). Comment cette vertu subsiste-t-elle si elle emprunte d'ailleurs ses principes, si elle n'est pas en acte? Qu'arrivera-t-il si une vertu s'avance naturellement jusqu'à un certain degré, et une autre vertu jusqu'à un autre degré? Que dire de la tempérance qui modère certaines choses et en supprime certaines autres? On peut élever les mêmes questions au sujet des autres vertus, en consultant la prudence, qui jugera à quel degré les vertus sont parvenues (15). 62 Peut-être aussi, en certaines circonstances, l'homme vertueux se servira-t-il dans ses actions de quelques–unes des vertus inférieures [des vertus civiles]; mais [alors même], s'élevant à des vertus d'un ordre supérieur, il se créera d'après elles d'autres règles. Par exemple, il ne fera pas consister la tempérance seulement à être modéré, mais il cherchera à se séparer de plus en plus de la matière; il ne se contentera pas de mener la vie de l'homme de bien, telle que l'exige la vertu civile: il aspirera plus haut encore, il aspirera à la vie des dieux. C'est à eux, et non pas seulement aux hommes de bien, qu'il faut devenir semblable. Chercher seulement à devenir semblable aux hommes de bien, ce serait faire une image en se bornant à la rendre semblable à une autre image qui aurait été faite d'après le même modèle. L'assimilation que nous prescrivons ici consiste à prendre pour modèle un être supérieur.
|
|
397 LIVRE DEUXIÈME. DES VERTUS.
Ce livre est le
dix-neuvième dans l'ordre chronologique. § I. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE DE PLATON. Pour composer ce livre, Plotin a puisé principalement dans le, dialogues de Platon. Le début est emprunté au Théétète comme nous l'avons indiqué, p. 51, note 2. L'idée que la vertu est une purification (§ 3, p. 55) est tirée du Phédon (Voy. le passage de ce dialogue qui a été cité plus haut, p. 381-384.) Enfin les définitions que Plotin donne nos quatre vertus, justice, prudence, courage, tempérance (§ 1, 3, p. 52, 55), reproduisent celles qui se trouvent dans le livre IV de la République (t. IX, p. 210-243 de la traduction de M. Cousin). Nous citons ici ce morceau entier pour ne pas en altérer le sens par des retranchements : « Nous n'avons pas oublié que l'État est juste lorsque chacun des trois ordres qui le composent remplit le devoir qui lui est propre. - Je ne crois pas que nous l'ayons oublié. - Souvenons-nous donc que, lorsque chacune des parties de nous-mêmes remplira le devoir qui lui est propre, alors nous serons justes et nous remplirons notre devoir. - Il faut nous en bien souvenir. - N'appartient-il pas à la raison de commander, puisque c'est en elle que réside la sagesse, et qu'elle est chargée de veiller sur l'âme tout entière? Et n'est-ce pas à la colère d'obéir et de la seconder? - Oui. - Et n'est-ce pas le mélange de la musique et de la gymnastique, dont nous parlions plus haut, qui mettra un parfait accord entre ces deux parties, nourrissant et fortifiant la raison par de beaux discours et par l'étude des sciences, relâchant, apaisant, adoucissant la colère par le charme de l'harmonie et du nombre ? -assurément. - Ces deux parties de l'âme ayant été ainsi élevées, 398 instruites et exercées à remplir leurs devoirs, gouverneront la partie où siège le désir, qui occupe la plus grande partie de notre âme et qui est insatiable de sa nature; elles prendront garde que celle-ci, après s'être accrue et fortifiée par la jouissance des plaisirs du corps, ne sorte de son domaine et ne prétende se donner sur elles une autorité qui ne lui appartient pas, et qui troublerait l'économie générale. Assurément. - En présence des ennemis du dehors, elles prendront les meilleures mesures pour la sûreté de l'âme et du corps: l'une délibérera, l'autre, soumise à son commandement, combattra, et, secondée du courage, exécutera ce que la raison aura résolu. - Oui. - Et nous appelons l'homme courageux, lorsque cette partie de l'âme où réside la colère suit constamment, au milieu des peines et des plaisirs, les ordres de la raison sur ce qui est à craindre ou ne l'est pas. - Bien. - Nous l'appelons prudent à cause de cette partie de son âme qui a exercé le commandement et donné ces ordres; qui possède en elle-même la science de ce qui convient à chacune des trois parties et à toutes ensemble. - Sans contredit. - Et tempérant, par l'amitié et l'harmonie qui règnent entre la partie qui commande et celles qui obéissent, lorsque ces deux dernières demeurent d'accord que c'est à la raison de commander et ne lui disputent pas l'autorité? - La tempérance, dans l'État comme dans l'individu, n'est pas autre chose. - Enfin il sera juste, par la raison et de la manière que nous avons plusieurs fois exposées. - La cause de tout cela, n'est-ce pas que chacune des parties de son âme remplit son devoir, qu'il s'agisse de commander ou d'obéir? - Il n'y en a pas d'autre. » Quant à la conversion dont il est question dans le livre II, § 4, p. 57, Voy. ce qui en a été déjà dit plus haut, p. 348-349. § II. RAPPROCHEMENTS ENTRE LA DOCTRINE DE PLOTIN ET CELLE D'ARISTOTE. Quoique Plotin développe généralement dans ce livre la doctrine de Platon, cependant il a aussi emprunté à Aristote plusieurs des idées qu'il exprime à la fin du § 7, p. 61. Voici d'abord le passage de Plotin : « Il nous resterait à considérer si l'homme vertueux possède en acte ou d'une autre façon les vertus, soit supérieures, soit inférieures; pour le savoir, il faudrait examiner séparément chacune d'elles, la prudence, par exemple. Comment cette vertu subsiste-t-elle si elle emprunte d'ailleurs ses principes, si elle n'est pas en acte? Qu'arrivera-t-il si une vertu s'avance naturellement jusqu'à 399 un certain degré, et une autre vertu jusqu'à autre degré? Que dire de la tempérance qui modère certaines choses et en supprime certaines autres ? On peut élever les mêmes questions au sujet des autres vertus, en consultant la prudence, qui jugera à quel degré les vertus sont parvenues. » Les idées que Plotin se borne ici à énoncer, avec une concision qui tombe dans l'obscurité, sont reprises et développées par lui dans le § 6 du livre III, p. 68-69. Voici ce passage qu'il est absolument nécessaire de rapprocher du précédent : « La philosophie traite des mœurs : ici encore, c'est la Dialectique qui pose les principes; la Morale n'a plus qu'à en faire naitre les bonnes habitudes et à conseiller les exercices qui les engendrent. Il en est de même des vertus rationnelles, λογικαὶ ἕξεις : c'est à la Dialectique qu'elles doivent les principes qui semblent leur appartenir en propre: car le plus souvent elles s'occupent des choses matérielles [parce qu'elles modèrent les passions]. Les autres vertus impliquent aussi l'application de la raison aux passions et aux actions qui sont propres à chacune d'elles; seulement la prudence y applique la raison d'une manière supérieure: elle s'occupe plus de l'universel; elle considère si les vertus s'enchaînent les unes aux autres, s'il faut faire présentement une action, ou la différer, ou en choisir une autre. Or, c'est la Dialectique, c'est la science qu'elle donne, la sagesse, qui fournit à la prudence, sous une forure générale et immatérielle, tous les principes dont celle-ci a besoin... Pour les vertus, on peut posséder d'abord les vertus naturelles, puis s'élever, avec le secours de la sagesse, aux vertus parfaites. La sagesse ne vient donc qu'après les vertus naturelles; alors elle perfectionne les mœurs; ou plutôt, lorsque les vertus naturelles existent déjà, elles s'accroissent et se perfectionnent avec elle. Du reste, celle de ces deux choses qui précède donne à l'autre son complément. En général, avec les vertus naturelles, on n'a qu'une vue [une science imparfaite et des mœurs également imparfaites, et ce qu'il y a de plus important pour les perfectionner, c'est la connaissance philosophique des principes d'où elles dépendent. » Ce que Plotin dit de la prudence dans ces deux passages est parfaitement conforme au rôle qu'Aristote assigne à cette vertu dans l'Ethique à Nicomaque (VI, 5): « Quant à la prudence, on peut s'en faire une idée en considérant quels sont ceux que l'on appelle prudents: or, il semble que ce qui caractérise l'homme prudent, c'est la faculté de délibérer avec succès sur les choses qui lui sont bonnes et avantageuses, non pas sous quelques rapports particuliers, comme celui de la santé ou 400 de la force, mais qui peuvent contribuer, en général, au bonheur de sa vie. Ce qui le prouve, c'est qu'on appelle prudents ou avisés, dans tel ou tel genre, ceux qu'un raisonnement exact conduit à quelque fin estimable, dans les choses où l'art ne saurait s'appliquer, en sorte que l'homme prudent serait, en général, celui qui est capable de délibérer... Il suit nécessairement de là que la prudence est une véritable habitude de contemplation, dirigée par la raison, dans les biens propres à la nature humaine. » (Trad. de M. Thurot, p. 256, 258.) En subordonnant la prudence à la sagesse, en les appelant toutes deux des vertus rationnelles ou habitudes intellectuelles, et en les regardant comme supérieures aux vertus morales (liv. I, § 10, p. 47), Plotin s'est encore inspiré d'Aristote, qui s'exprime ainsi à ce sujet: « Il faut que le sage, non seulement connaisse les conséquences qui dérivent des principes, mais aussi qu'il sache la vérité des principes. En sorte que la sagesse serait l'intelligence et la science, et que sa partie fondamentale serait la connaissance de ce qu'il y a de plus noble et de plus sublime. » (Éthique à Nicomaque, VI, 7; p. 261 de la trad. de M. Thurot.) « La distinction [de deux parties dans l'âme, de la partie irraisonnable et de la partie raisonnable] sert de fondement à une division ou classification des vertus: car nous disons que les unes sont intellectuelles, διανοητικαί, et les autres morales, ἠθικαί; nous appelons vertus intellectuelles, la sagesse, la prudence; vertus morales, la tempérance, la libéralité. En effet, quand nous parlons des mœurs d'un homme, nous ne disons pas qu'il est habile ou spirituel, mais qu'il est doux ou sobre; nous louons aussi, dans l'homme savant et habile, ses habitudes et sa manière d'être; or, entre les habitudes, on appelle vertus celles qui sont dignes de louange. » (Éthique à Nicomaque, I, 13; p. 50 de la trad.) Enfin, la distinction établie par Plotin entre les vertus naturelles et les vertus parfaites se trouve développée dans les lignes suivantes du même ouvrage d'Aristote : « La nature semble avoir mis dans chacun des individus le germe des vertus morales : car nous apportons, pour ainsi dire, en naissant, quelque disposition à la justice, à la prudence, à la tempérance, et aux autres qualités de l'âme. Mais nous cherchons ici quelque chose de plus, c'est la bonté et la vertu proprement dites, c'est une autre manière d'être juste, courageux, tempérant, et le reste. Ces dispositions naturelles, φυσικαὶ ἕξεις, existent en effet dans les enfants et dans les animaux; mais elles semblent plutôt être nuisibles qu'utiles, sans l'intelligence. C'est ce qu'on peut recon- 401 naître en considérant que les mouvements du corps, de quelque vigueur qu'il soit doué, ne peuvent que l'exposer à des chocs très funestes quand il est privé de la vue. Or, il en est de même ici : notre manière d'agir est tout autre quand elle est dirigée par l'intelligence. Et c'est précisément dans une habitude ou disposition semblable que consiste la vertu proprement dite. Concluons de là que la partie morale de l'âme comprend deux sortes de vertus, la vertu naturelle, φυσικὴ ἀρετή , et la vertu en soi ou proprement dite, κυρία ἀρετή; et celle-ci, qui est principale et directrice, ne saurait exister sans la prudence. » (Éthique à Nicomaque, VI, 13; p. 280 de la trad. de M. Thurot.) § III. MENTIONS ET CITATIONS QUI ONT ÉTÉ FAITES DE CE LIVRE. Porphyre a commenté ce livre dans ses Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητά, § 54. Ce morceau de Porphyre a été cité lui-même par Stobée, Florilegium (Tit. I, p. 54, éd. Gaisford), et par Michel Psellus (Omnifaria doctrina, § 55, p. 110). George Gémiste lui a aussi fait des emprunts dans son ouvrage intitulé Libellus de Virtute ejusque partibus, publié en grec et en latin par Angelo Maï, Milan, 1816. Enfin, Macrobe a analysé et commenté le livre de Plotin dans son Commentaire sur le Songe de Scipion (I, 8) : «Solae faciunt virtutes beatum, nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur : unde, qui existimant nullis nisi philosophantibus inesse virtutes, nullos praeter philosophos beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, eos tantummodo dicunt esse sapientes qui superna acie mentis requirunt, et, quantum vivendi perspicuitas praestat, imitantur (16); et in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum, quarum officia sic dispensant : prudentiae esse, mundum istum et omnia quit in mundo insunt, divinorum contemplatione despicere, omnemque anime cogitationem in sola divina dirigere; temperantiae, omnia relinquere, in quantum natura patitur, quae corporis usus requirit; furtitudinis, non terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiae recedentem, nec allitudinem perfectae ad superna ascensionis horrere; justitiae, ad unam sibi hujus propositi consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium (17). Atque ita fit ut, secundum hoc tam rigidae definitionis abruptum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint. Sed Plotinus, inter philosophiae 402 professores cum Platone princeps, libro De virtutibus, gradus earum, vera et naturali divisionis ratione compositos, per ordinem digerit: Quatuor sunt, inquit, quaternerum genera virtutum. Ex his primae politicae vocantur; secundae, purgatoriae; tertiae, animi jam purgati; quartae, exemplares. Et sunt politicae (18) hominis, qua sociale animal est : bis boni viri reipublicae consulunt, urbes tuentur; his parentes venerantur, liberos amant, proximos diligunt; his civium salutem gubernant; his socios circumspecta providentia protegunt, justa liberalitate devinciunt : Hisque sui memores alios fecere merendo. (VIRG, Aen., lib. VII, v. 684.) Et est politici prudentia, ad rationis normam quae cogitat quaeque agit universa dirigere; ac nihil praeter rectum velte vel facere, humanisque actibus, tanquam divinis arbitris, providere. Prudentiae insunt ratio, Intellectus, circumspectio, providentia, dociliitas, cautio. Fortitudinis est, animum supra periculi metum agere, nihilque turpia timere; tolerare fortiter vel adversa vel prospera. Fortitudo praestat magnanimitatem, fiduciam, securitatem, magnificentiam, constantiam, tolerantiam, firmitatem. Temperantiae, nihil appetere paenitendum, in nullo Iegem moderationis excedere, sub jugum rationis cupiditatem domare. Temperantiam sequuntur modestia, verecundia, abstinentia, castitas, moderatio, parcitas, sobrietas, pudicitia. Justitiae, servare unicuique quod suum est. De justitia veniunt innocentia, amicitia, concordia, pietas, religio, affectas, humanitas. His virtutibus vir bonus primum sui atque inde reipublicae rector effecitur, juste ac provide gubernans humana, divina non deserens. Secundae, quas purgatorias (19) vocant, hominis sunt qui divini capax est; solumque animum ejus expediunt qui decrevit se a corporis contagione purgare, et quadam humanorum fuga solis se inserere divinis. Hae sunt otiosorum, qui a rerumpublicarum actibus se sequestrant. Harum quid singulae velint, superius expressimus, quum de virtutibus philosophantium diceremus; quas solas quidam existimaverunt esse virtutes. Tertiae sunt purgati jam defaecatique animi (20) et ab omni mundi hujus aspergine presse pureque detersi. lllic prudentiae est divina non quasi in electione praeferre, sed sola nosse, et haec, tanquam nihil sit aliud, intueri. Temperantiae, terrenas cupiditates non re- 403 primere, sed penitus oblivisci : fortitudinis, passiones ignorare, non vincere, ut « nesciat irassci, cupiat nihil ; » justitiae, ita cum supera et divina mente sociari ut servet perpetuum cum ea foedus imitando. Quartae exemplares (21) sunt, quae in ipsa divina Mente consistunt, quam diximus νοῦν vocari, a quarum exemplo reliquae omnes per ordinem defluunt : nam si rerum aliarum, multo magis virtutum ideas esse in mente credendum est. Illic prudentia est Mens ipsa divina ; temperantia, quod in se perpetua intentione conversum est; fortitudo, quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justitia, quod perenni lege a sempiterna operis sui continuatione non flectitur. Haec sunt quaternarum quatuor genera virtutum, quae, praeter cetera, maximam in passionibus habent differentiam sui; passiones autem, ut scimus, vocantur, quod homines .......... Metuunt, cupiunt, gaudentque, dolentque; (VIRG., .lib. VI, v 738.) Has primae molliunt, secundae auferunt, tertiae obliviscuntur : in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est officium et effectus virtutum, beare, constat autem et politicas esse virtutes, igitur ex politicis efficiuntur beati. »
Ce passage de Macrobe a
été mentionné lui-même par Vincent de Beauvais, Speculum historiale, V,
9. τὰ γὰρ πάθη, ὥς φησιν ὁ Πλωτῖνος, αἱ αἰσθήσεις εἰσίν ἣ οὐκ ἄνευ αἰσθήσεων· εἰπων δὲ πρότερον κοινῶς περί τῶν ψυχικῶν ἕξεων, ὅτι καὶ αὖται τελειώσεις εἰσὶ καὶ ἐν τῷ πρός τι συμμετρίαι τινές οὖσαι καὶ ἀσυμμετρίαι, καὶ ὅτι γίνονται ἀλλοιουμένου τοῦ αἰσθητικοῦ, διαιρεῖ λοιπὸν τὰς ψυχικάς ἀρετὰς, εἴστε τάς ἠθικὰς καὶ διανοητικὰς, καὶ ἐφ’ ἑκατέρων δείκνυσι πῶς ἐν τῷ πρός τι εἰσι, κ. τ. λ. Pour l'exposition et la critique des idées morales de Plotin, on peut consulter Brucker, Histoire critique de la philosophie, II, p. 460 ; Tennemann, Histoire de la philosophie, VI, p, 47; M. Bavaisson, Essai sur la Métaphysique d'Aristote, t. II, pages 449-450; M. Vacherot, Histoire critique de l'École d'Alexandre, t. I, p. 564-668, t. II, p. 427-431 ;
M. J. Denis, Histoire
des théories et des idées morales de l'antiquité, t. Il, p. 336-343.
(01) Pour les Remarques générales, Voyez, à la fin du volume, la Note sur ce livre. (02) Théétète, p. 176 de l'éd. de H. Étienne, p. 247 de l'éd. de Bekker; t. II, p.132 de la trad. de M. Cousin : « Il n'est pas possible que le mal soit détruit parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au bien... c'est donc une nécessité qu'il circule sur cette terre et autour de notre nature mortelle. C'est pourquoi nous devons tâcher de fuir au plus vite de ce séjour à l'autre. Or, cette fuite, c'est la ressemblance avec Dieu, autant qu'il dépend de nous, et on ressemble à Dieu par la justice, la sainteté et la sagesse.» (03) Ces définitions sont empruntées à Platon, République, liv. IV, p. 434 de l'édition de H. Étienne. (04) Tout ce passage est assez obscur. Nous suivons l'interprétation de Ficin qui, dans sa traduction, donne la forme interrogative à toute cette phrase: Εἴ τε θερμότητος παρουσίᾳ… θερμαίνεσθαι, quoique le texte porte la forme affirmative, et qui justifie ce changement dans son Commentaire. - Du reste, le but de l'auteur ne peut être douteux : c'est d'établir que la cause ne possède pas nécessairement les mêmes qualités que l'effet. Voy. Enn. II, liv. VI, § 3. (05) Voy. Enn. I, liv. III, § 1. (06) Théétète, p. 178. (07) Voy. Platon, Phédon, p. 89. (08) Ἐπιστροφή . Voy. Enn. V, liv. I, § 1. (09) Ce qui motive cette question de Plotin, c'est qu'il distingue en Dieu trois hypostases : le Bien, l'Intelligence, l'Âme universelle. Dans ce livre il examine principalement la ressemblance que l'âme humaine peut avoir avec l'Intelligence divine. (10) Tout ce passage se trouve reproduit presque littéralement et éclairci par Porphyre dans ses Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητά, § 34. (11) Sur la différence des dieux et des démons, Voy. Plotin, Enn. III, liv. IV, et Proclus, Comment. sur l'Alcib., p. 31, 67, 90, 123. (12) L'Intelligence. (13) Allusion à un passage de Platon, Phèdre, p. 246. (14) Dans ce passage, que nous traduisons aussi littéralement que possible, l'auteur pose une série de questions qui paraissent avoir peu de lien entre elles et dont il ne donne pas ici la solution. (15) Sur le rôle que Plotin assigne à la prudence vis-à-vis des autres vertus, Voy. le livre suivant, § 6. (16) Voy. Enn. I, liv. II, § 1, p. 51. (17) Ibidem, § 3, p. 65. (18) Ibidem, § 1, p. 52. (19) Ibidem, § 3, p. 55. (20) Ibidem, § 6, p. 60.
|
|