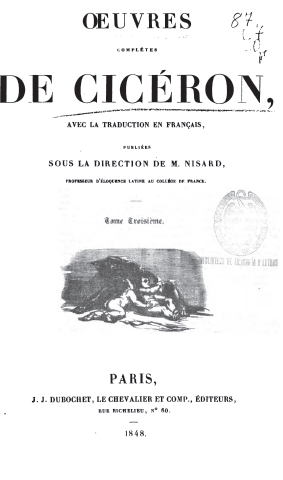|
MARCI TVLLI CICERONIS DE FINIBVS BONORVM ET
MALORVM LIBER PRIMVS
I. Non eram nescius, Brute, cum, quae summis
ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone tractavissent, ea
Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones
incurreret. Nam quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, totum hoc
displicet philosophari. Quidam autem non tam id reprehendunt, si remissius
agatur, sed tantum studium tamque multam operam ponendam in eo non arbitrantur.
Erunt etiam, et ii quidem eruditi Graecis litteris, contemnentes Latinas, qui se
dicant in Graecis legendis operam malle consumere. Postremo aliquos futuros
suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans,
personae tamen et dignitatis esse negent. Contra quos omnis dicendum breviter
existimo. Quamquam philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo
libro, quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum esset accusata et
vituperata ab Hortensio. Qui liber cum et tibi probatus videretur et iis, quos
ego posse iudicare arbitrarer, plura suscepi veritus ne movere hominum studia
viderer, retinere non posse. Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen
id volunt fieri, difficilem quandam temperantiam postulant in eo, quod semel
admissum coerceri reprimique non potest, ut propemodum iustioribus utamur illis,
qui omnino avocent a philosophia, quam his, qui rebus infinitis modum
constituant in reque eo meliore, quo maior sit, mediocritatem desiderent. Sive
enim ad sapientiam perveniri potest, non paranda nobis solum ea, sed fruenda
etiam (sapientia) est; sive hoc difficile est, tamen nec modus est ullus
investigandi veri, nisi inveneris, et quaerendi defetigatio turpis est, cum id,
quod quaeritur, sit pulcherrimum. Etenim si delectamur, cum scribimus, quis est
tam invidus, qui ab eo nos abducat? sin laboramus, quis est, qui alienae modum
statuat industriae? nam ut Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum
non vult
Fodere aut arare aut aliquid ferre denique :
non enim illum ab industria, sed ab
illiberali labore deterret --, sic isti curiosi, quos offendit noster minime
nobis iniucundus labor.
II. His igitur est difficilius satis facere, qui
se Latina scripta dicunt contemnere. In quibus hoc primum est in quo admirer,
cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas
Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus
paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut
reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras
oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam
utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime
scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de
quo
Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit.
Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut
fastidii delicatissimi. Mihi quidem nulli satis eruditi videntur, quibus nostra
ignota sunt. An
Utinam ne in nemore
. . .
nihilominus legimus quam hoc idem Graecum, quae
autem de bene beateque vivendo a Platone disputata sunt, haec explicari non
placebit Latine? Quid? si nos non interpretum fungimur munere, sed tuemur ea,
quae dicta sunt ab iis quos probamus, eisque nostrum iudicium et nostrum
scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae et
splendide dicta sint neque sint conversa de Graecis? nam si dicent ab illis has
res esse tractatas, ne ipsos quidem Graecos est cur tam multos legant, quam
legendi sunt. Quid enim est a Chrysippo praetermissum in Stoicis? legimus tamen
Diogenem, Antipatrum, Mnesarchum, Panaetium, multos alios in primisque
familiarem nostrum Posidonium. Quid? Theophrastus mediocriterne delectat, cum
tractat locos ab Aristotele ante tractatos? quid? Epicurei num desistunt de
isdem, de quibus et ab Epicuro scriptum est et ab antiquis, ad arbitrium suum
scribere? quodsi Graeci leguntur a Graecis isdem de rebus alia ratione
compositis, quid est, cur nostri a nostris non legantur?
III. Quamquam, si plane sic verterem Platonem aut
Aristotelem, ut verterunt nostri poetae fabulas, male, credo, mererer de meis
civibus, si ad eorum cognitionem divina illa ingenia transferrem. Sed id neque
feci adhuc nec mihi tamen, ne faciam, interdictum puto. Locos quidem quosdam, si
videbitur, transferam, et maxime ab iis, quos modo nominavi, cum inciderit, ut
id apte fieri possit, ut ab Homero Ennius, Afranius a Menandro solet. Nec vero,
ut noster Lucilius, recusabo, quo minus omnes mea legant.
Utinam esset ille
Persius, Scipio vero et Rutilius multo etiam magis, quorum ille iudicium
reformidans Tarentinis ait se et Consentinis et Siculis scribere. Facete is
quidem, sicut alia; sed neque tam docti tum erant, ad quorum iudicium elaboraret,
et sunt illius scripta leviora, ut urbanitas summa appareat, doctrina mediocris.
Ego autem quem timeam lectorem, cum ad te ne Graecis quidem cedentem in
philosophia audeam scribere? quamquam a te ipso id quidem facio provocatus
gratissimo mihi libro, quem ad me de virtute misisti. Sed ex eo credo quibusdam
usu venire; ut abhorreant a Latinis, quod inciderint in inculta quaedam et
horrida, de malis Graecis Latine scripta deterius. Quibus ego assentior, dum
modo de isdem rebus ne Graecos quidem legendos putent. Res vero bonas verbis
electis graviter ornateque dictas quis non legat? nisi qui se plane Graecum dici
velit, ut a Scaevola est praetore salutatus Athenis Albucius. Quem quidem locum
comit multa venustate et omni sale idem Lucilius, apud quem praeclare Scaevola:
Graecum te, Albuci, quam Romanum atque Sabinum,
municipem Ponti, Tritanni, centurionum,
praeclarorum hominum ac primorum signiferumque,
maluisti dici. Graece ergo praetor Athenis,
id quod maluisti, te, cum ad me accedis, saluto:
χαῖρε, inquam, Tite! : lictores, turma omnis chorusque:
χαῖρε, Tite ! Hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus.
Sed iure Mucius. Ego autem mirari [satis] non queo
unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic
docendi locus; sed ita sentio et saepe disserui, Latinam linguam non modo non
inopem, ut vulgo putarent, sed locupletiorem etiam esse quam Graecam. Quando
enim nobis, vel dicam aut oratoribus bonis aut poetis, postea quidem quam fuit
quem imitarentur, ullus orationis vel copiosae vel elegantis ornatus defuit?
IV. Ego vero, quoniam forensibus operis, laboribus,
periculis non deseruisse mihi videor praesidium, in quo a populo Romano locatus
sum, debeo profecto, quantumcumque possum, in eo quoque elaborare, ut sint opera,
studio, labore meo doctiores cives mei, nec cum istis tantopere pugnare, qui
Graeca legere malint, modo legant illa ipsa, ne simulent, et iis servire, qui
vel utrisque litteris uti velint vel, si suas habent, illas non magnopere
desiderent. Qui autem alia malunt scribi a nobis, aequi esse debent, quod et
scripta multa sunt, sic ut plura nemini e nostris, et scribentur fortasse plura,
si vita suppetet; et tamen, qui diligenter haec, quae de philosophia litteris
mandamus, legere assueverit, iudicabit nulla ad legendum his esse potiora. Quid
est enim in vita tantopere quaerendum quam cum omnia in philosophia, tum id,
quod his libris quaeritur, qui sit finis, quid extremum, quid ultimum, quo sint
omnia bene vivendi recteque faciendi consilia referenda, quid sequatur natura ut
summum ex rebus expetendis, quid fugiat ut extremum malorum? qua de re cum sit
inter doctissimos summa dissensio, quis alienum putet eius esse dignitatis, quam
mihi quisque tribuat, quid in omni munere vitae optimum et verissimum sit,
exquirere? An, partus ancillae sitne in fructu habendus, disseretur inter
principes civitatis, P. Scaevolam M'.que Manilium, ab iisque M. Brutus
dissentiet -- quod et acutum genus est et ad usus civium non inutile, nosque ea
scripta reliquaque eiusdem generis et legimus libenter et legemus --, haec, quae
vitam omnem continent, neglegentur? nam, ut sint illa vendibiliora, haec
uberiora certe sunt. Quamquam id quidem licebit iis existimare, qui legerint.
Nos autem hanc omnem quaestionem de finibus bonorum et malorum fere a nobis
explicatam esse his litteris arbitramur, in quibus, quantum potuimus, non modo
quid nobis probaretur, sed etiam quid a singulis philosophiae disciplinis
diceretur, persecuti sumus.
V. Ut autem a facillimis ordiamur, prima veniat in
medium Epicuri ratio, quae plerisque notissima est. Quam a nobis sic intelleges
expositam, ut ab ipsis, qui eam disciplinam probant, non soleat accuratius
explicari; verum enim invenire volumus, non tamquam adversarium aliquem
convincere. Accurate autem quondam a L. Torquato, homine omni doctrina erudito,
defensa est Epicuri sententia de voluptate, a meque ei responsum, cum C.
Triarius, in primis gravis et doctus adolescens, ei disputationi interesset. Nam
cum ad me in Cumanum salutandi causa uterque venisset, pauca primo inter nos de
litteris, quarum summum erat in utroque studium, deinde Torquatus: Quoniam nacti
te, inquit, sumus aliquando otiosum, certe audiam, quid sit, quod Epicurum
nostrum non tu quidem oderis, ut fere faciunt, qui ab eo dissentiunt, sed certe
non probes, eum quem ego arbitror unum vidisse verum maximisque erroribus animos
hominum liberavisse et omnia tradidisse, quae pertinerent ad bene beateque
vivendum. Sed existimo te, sicut nostrum Triarium, minus ab eo delectari, quod
ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud
quidem adduci vix possum, ut ea, quae senserit ille, tibi non vera videantur.
Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. Oratio me istius philosophi non
offendit; nam et complectitur verbis, quod vult, et dicit plane, quod intellegam;
et tamen ego a philosopho, si afferat eloquentiam, non asperner, si non habeat,
non admodum flagitem. Re mihi non aeque satisfacit, et quidem locis pluribus.
Sed quot homines, tot sententiae; falli igitur possumus. Quam ob rem tandem,
inquit, non satisfacit? te enim iudicem aequum puto, modo quae dicat ille bene
noris. Nisi mihi Phaedrum, inquam, tu mentitum aut Zenonem putas, quorum
utrumque audivi, cum mihi nihil sane praeter sedulitatem probarent, omnes mihi
Epicuri sententiae satis notae sunt. Atque eos, quos nominavi, cum Attico nostro
frequenter audivi, cum miraretur ille quidem utrumque, Phaedrum autem etiam
amaret, cotidieque inter nos ea, quae audiebamus, conferebamus, neque erat
umquam controversia, quid ego intellegerem, sed quid probarem.
VI. Quid igitur est? inquit; audire enim cupio,
quid non probes. Principio, inquam, in physicis, quibus maxime gloriatur, primum
totus est alienus. Democritea dicit perpauca mutans, sed ita, ut ea, quae
corrigere vult, mihi quidem depravare videatur. Ille atomos quas appellat, id
est corpora individua propter soliditatem, censet in infinito inani, in quo
nihil nec summum nec infimum nec medium nec ultimum nec extremum sit, ita ferri,
ut concursionibus inter se cohaerescant, ex quo efficiantur ea, quae sint
quaeque cernantur, omnia, eumque motum atomorum nullo a principio, sed ex
aeterno tempore intellegi convenire. Epicurus autem, in quibus sequitur
Democritum, non fere labitur. Quamquam utriusque cum multa non probo, tum illud
in primis, quod, cum in rerum natura duo quaerenda sint, unum, quae materia sit,
ex qua quaeque res efficiatur, alterum, quae vis sit, quae quidque efficiat, de
materia disseruerunt, vim et causam efficiendi reliquerunt. Sed hoc commune
vitium, illae Epicuri propriae ruinae: censet enim eadem illa individua et
solida corpora ferri deorsum suo pondere ad lineam, hunc naturalem esse omnium
corporum motum. Deinde ibidem homo acutus, cum illud occurreret, si omnia
deorsus e regione ferrentur et, ut dixi, ad lineam, numquam fore ut atomus
altera alteram posset attingere, attulit rem commenticiam; * itaque declinare
dixit atomum perpaulum, quo nihil posset fieri minus; ita effici complexiones et
copulationes et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus
omnesque partes mundi, quaeque in eo essent. Quae cum tota res (est) ficta
pueriliter, tum ne efficit quidem, quod vult. Nam et ipsa declinatio ad
libidinem fingitur (ait enim declinare atomum sine causa; quo nihil turpius
physico, quam fieri quicquam sine causa dicere), et illum motum naturalem omnium
ponderum, ut ipse constituit, e regione inferiorem locum petentium sine causa
eripuit atomis nec tamen id, cuius causa haec finxerat, assecutus est. Nam si
omnes atomi declinabunt, nullae umquam cohaerescent, sive aliae declinabunt,
aliae suo nutu recte ferentur, primum erit hoc quasi, provincias atomis dare,
quae recte, quae oblique ferantur, deinde eadem illa atomorum, in quo etiam
Democritus haeret, turbulenta concursio hunc mundi ornatum efficere non poterit.
Ne illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam
putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam
illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito
in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse censet,
quantus videtur, vel paulo aut maiorem aut minorem. Ita, quae mutat, ea
corrumpit, quae sequitur sunt tota Democriti, atomi, inane, imagines, quae
εἴδωλα nominant, quorum incursione non solum videamus, sed etiam cogitemus;
infinitio ipsa, quam ἀπειρίαν vocant, tota ab illo est, tum innumerabiles mundi,
qui et oriantur et intereant cotidie. Quae etsi mihi nullo modo probantur, tamen
Democritum laudatum a ceteris ab hoc, qui eum unum secutus esset, nollem
vituperatum.
VII. Iam in altera philosophiae parte. Quae est
quaerendi ac disserendi, quae λογική dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem
videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac
partiendo docet, non quo modo efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua
via captiosa solvantur ambigua distinguantur ostendit; iudicia rerum in sensibus
ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero probatum sit, sublatum esse
omne
iudicium veri et falsi putat. Confirmat autem illud vel maxime, quod ipsa natura, ut ait ille, sciscat et
probet, id est voluptatem et dolorem. Ad haec et quae sequamur et quae fugiamus
refert omnia. Quod quamquam Aristippi est a Cyrenaicisque melius liberiusque
defenditur, tamen eius modi esse iudico, ut nihil homine videatur indignius. Ad
maiora enim quaedam nos natura genuit et conformavit, ut mihi quidem videtur. Ac
fieri potest, ut errem, sed ita prorsus existimo,
neque eum Torquatum, qui hoc
primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo
perciperet corpore voluptatem, aut cum Latinis tertio consulatu conflixisse apud
Veserim propter voluptatem; quod vero securi percussit filium, privavisse se
etiam videtur multis voluptatibus, cum ipsi naturae patrioque amori praetulerit
ius maiestatis atque imperii. Quid? T. Torquatus, is qui consul cum Cn. Octavio fuit, cum illam
severitatem in eo filio adhibuit, quem in adoptionem D. Silano emancipaverat, ut
eum Macedonum legatis accusantibus, quod pecunias praetorem in provincia cepisse
arguerent, causam apud se dicere iuberet reque ex utraque parte audita
pronuntiaret eum non talem videri fuisse in imperio, quales eius maiores
fuissent, et in conspectum suum venire vetuit, numquid tibi videtur de
voluptatibus suis cogitavisse?
Sed ut omittam pericula, labores, dolorem etiam, quem optimus quisque pro patria
et pro suis suscipit, ut non modo nullam captet, sed etiam praetereat omnes
voluptates, dolores denique quosvis suscipere malit quam deserere ullam officii
partem, ad ea, quae hoc non minus declarant, sed videntur leviora, veniamus. Quid tibi, Torquate, quid huic Triario litterae, quid historiae cognitioque
rerum, quid poetarum evolutio, quid tanta tot versuum memoria voluptatis affert?
nec mihi illud dixeris: Haec enim ipsa mihi sunt voluptati, et erant illa
Torquatis. Numquam hoc ita defendit Epicurus neque Metrodorus aut quisquam
eorum, qui aut saperet aliquid aut ista didicisset. Et quod quaeritur saepe, cur
tam multi sint Epicurei, sunt aliae quoque causae, sed multitudinem haec maxime
allicit, quod ita putant dici ab illo, recta et honesta quae sint, ea facere
ipsa per se laetitiam, id est voluptatem. Homines optimi non intellegunt totam
rationem everti, si ita res se habeat. Nam si concederetur, etiamsi ad corpus
nihil referatur, ista sua sponte et per se esse iucunda, per se esset et virtus
et cognitio rerum, quod minime ille vult expetenda. Haec igitur Epicuri non probo, inquam. De cetero vellem equidem aut ipse
doctrinis fuisset instructior -- est enim, quod tibi ita videri necesse est, non
satis politus iis artibus, quas qui tenent, eruditi appellantur -- aut ne
deterruisset alios a studiis. Quamquam te quidem video minime esse deterritum.
VIII.
Quae cum dixissem, magis ut illum provocarem quam ut ipse loquerer, tum Triarius
leniter arridens: Tu quidem, inquit, totum Epicurum paene e philosophorum choro
sustulisti. Quid ei reliquisti, nisi te, quoquo modo loqueretur, intellegere,
quid diceret? Aliena dixit in physicis nec ea ipsa, quae tibi probarentur; si
qua in iis corrigere voluit, deteriora fecit. Disserendi artem nullam habuit.
Voluptatem cum summum bonum diceret, primum in eo ipso parum vidit, deinde hoc
quoque alienum; nam ante Aristippus, et ille melius. Addidisti ad extremum etiam
indoctum fuisse. Fieri, inquam, Triari, nullo pacto potest, ut non dicas, quid non probes
eius, a quo dissentias. Quid enim me prohiberet Epicureum esse, si probarem,
quae ille diceret? cum praesertim illa perdiscere ludus esset. Quam ob rem
dissentientium inter se reprehensiones non sunt vituperandae, maledicta,
contumeliae, tum iracundiae, contentiones concertationesque in disputando
pertinaces indignae philosophia mihi videri solent. um Torquatus: Prorsus, inquit, assentior; neque enim disputari sine
reprehensione nec cum iracundia aut pertinacia recte disputari potest. Sed ad
haec, nisi molestum est, habeo quae velim. An me, inquam, nisi te audire vellem,
censes haec dicturum fuisse? Utrum igitur percurri omnem Epicuri disciplinam
placet an de una voluptate quaeri, de qua omne certamen est? Tuo vero id quidem,
inquam, arbitratu. Sic faciam igitur, inquit: unam rem explicabo, eamque
maximam, de physicis alias, et quidem tibi et declinationem istam atomorum et
magnitudinem solis probabo et Democriti errata ab Epicuro reprehensa et correcta
permulta. Nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum
probaturum esse confidam. Certe, inquam, pertinax non ero tibique, si mihi probabis ea, quae dices,
libenter assentiar. Probabo, inquit, modo ista sis aequitate, quam ostendis. Sed
uti oratione perpetua malo quam interrogare aut interrogari. Ut placet, inquam.
Tum dicere exorsus est.
IX. Primum igitur, inquit, sic agam, ut ipsi auctori huius
disciplinae placet: constituam, quid et quale sit id, de quo quaerimus, non quo
ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur,
quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale
debet esse, ut ad id omnia referri oporteat, ipsum autem nusquam. Hoc Epicurus
in voluptate ponit, quod summum bonum esse vult, summumque malum dolorem, idque
instituit docere sic: Omne animal, simul atque natum sit, voluptatem appetere eaque gaudere ut
summo bono, dolorem aspernari ut summum malum et, quantum possit, a se
repellere, idque facere nondum depravatum ipsa natura incorrupte atque integre
iudicante. Itaque negat opus esse ratione neque disputatione, quam ob rem
voluptas expetenda, fugiendus dolor sit. Sentiri haec putat, ut calere ignem,
nivem esse albam, dulce mel. Quorum nihil oportere exquisitis rationibus
confirmare, tantum satis esse admonere. Interesse enim inter argumentum
conclusionemque rationis et inter mediocrem animadversionem atque admonitionem.
Altera occulta quaedam et quasi involuta aperiri, altera prompta et aperta
iudicari. Etenim quoniam detractis de homine sensibus reliqui nihil est, necesse
est, quid aut ad naturam aut contra sit, a natura ipsa iudicari. Ea quid
percipit aut quid iudicat, quo aut petat aut fugiat aliquid, praeter voluptatem
et dolorem? Sunt autem quidam e nostris, qui haec subtilius velint tradere et negent
satis esse, quid bonum sit aut quid malum, sensu iudicari, sed animo etiam ac
ratione intellegi posse et voluptatem ipsam per se esse expetendam et dolorem
ipsum per se esse fugiendum. Itaque aiunt hanc quasi naturalem atque insitam in
animis nostris inesse notionem, ut alterum esse appetendum, alterum aspernandum
sentiamus. Alii autem, quibus ego assentior, cum a philosophis compluribus
permulta dicantur, cur nec voluptas in bonis sit numeranda nec in malis dolor,
non existimant oportere nimium nos causae confidere, sed et argumentandum et
accurate disserendum et rationibus conquisitis de voluptate et dolore
disputandum putant.
X. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim
ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque
porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur,
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur? quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit
esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo
voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias
excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem
rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis
est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat,
facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus
saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis
voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores
repellat. Hanc ego cum teneam sententiam, quid est cur verear, ne ad eam non possim
accommodare Torquatos nostros? quos tu paulo ante cum memoriter, tum etiam erga
nos amice et benivole collegisti, nec me tamen laudandis maioribus meis
corrupisti nec segniorem ad respondendum reddidisti. Quorum facta quem ad modum,
quaeso, interpretaris? Sicine eos censes aut in armatum hostem impetum fecisse
aut in liberos atque in sanguinem suum tam crudelis fuisse, nihil ut de
utilitatibus, nihil ut de commodis suis cogitarent? at id ne ferae quidem
faciunt, ut ita ruant itaque turbent, ut earum motus et impetus quo pertineant
non intellegamus, tu tam egregios viros censes tantas res gessisse sine causa? Quae fuerit causa, mox videro; interea hoc tenebo, si ob aliquam causam
ista, quae sine dubio praeclara sunt, fecerint, virtutem iis per se ipsam causam
non fuisse. -- Torquem detraxit hosti. -- Et quidem se texit, ne interiret. --
At magnum periculum adiit. -- In oculis quidem exercitus. -- Quid ex eo est
consecutus? -- Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia
firmissima. -- Filium morte multavit. -- Si sine causa, nollem me ab eo ortum,
tam importuno tamque crudeli; sin, ut dolore suo sanciret militaris imperii
disciplinam exercitumque in gravissimo bello animadversionis metu contineret,
saluti prospexit civium, qua intellegebat contineri suam. Atque haec ratio late
patet. In quo enim maxime consuevit iactare vestra se oratio, tua praesertim, qui
studiose antiqua persequeris, claris et fortibus viris commemorandis eorumque
factis non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore laudandis, id totum
evertitur eo delectu rerum, quem modo dixi, constituto, ut aut voluptates
omittantur maiorum voluptatum adipiscendarum causa aut dolores suscipiantur
maiorum dolorum effugiendorum gratia.
XI. Sed de clarorum hominum factis illustribus et gloriosis satis hoc loco
dictum sit. Erit enim iam de omnium virtutum cursu ad voluptatem proprius
disserendi locus. Nunc autem explicabo, voluptas ipsa quae qualisque sit, ut
tollatur error omnis imperitorum intellegaturque ea, quae voluptaria, delicata,
mollis habeatur disciplina, quam gravis, quam continens, quam severa sit. Non
enim hanc solam sequimur, quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et cum
iucunditate quadam percipitur sensibus, sed maximam voluptatem illam habemus,
quae percipitur omni dolore detracto, nam quoniam, cum privamur dolore, ipsa
liberatione et vacuitate omnis molestiae gaudemus, omne autem id, quo gaudemus,
voluptas est, ut omne, quo offendimur, dolor, doloris omnis privatio recte
nominata est voluptas. Ut enim, cum cibo et potione fames sitisque depulsa est,
ipsa detractio molestiae consecutionem affert voluptatis, sic in omni re doloris
amotio successionem efficit voluptatis. Itaque non placuit Epicuro medium esse se quiddam inter dolorem et
voluptatem; illud enim ipsum, quod quibusdam medium videretur, cum omni dolore
careret, non modo voluptatem esse, verum etiam summam voluptatem. Quisquis enim
sentit, quem ad modum sit affectus, eum necesse est aut in voluptate esse aut in
dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam
voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri
amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente,
statua est in Ceramico Chrysippi sedentis porrecta manu, quae manus significet
illum in hae esse rogatiuncula delectatum: 'Numquidnam manus tua sic affecta,
quem ad modum affecta nunc est, desiderat?' -- Nihil sane. -- 'At, si voluptas
esset bonum, desideraret.' -- Ita credo. -- 'Non est igitur voluptas bonum.' Hoc
ne statuam quidem dicturam pater aiebat, si loqui posset. Conclusum est enim
contra Cyrenaicos acute, nihil ad Epicurum. Nam si ea sola voluptas esset, quae
quasi titillaret sensus, ut ita dicam, et ad eos cum suavitate afflueret et
illaberetur, nec manus esse contenta posset nec ulla pars vacuitate doloris sine
iucundo motu voluptatis. Sin autem summa voluptas est, ut Epicuro placet, nihil
dolere, primum tibi recte, Chrysippe, concessum est nihil desiderare manum, cum
ita esset affecta, secundum non recte, si voluptas esset bonum, fuisse
desideraturam. Idcirco enim non desideraret, quia, quod dolore caret, id in
voluptate est.
XII. Extremum autem esse bonorum voluptatem ex hoc facillime perspici potest:
Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et corpore
voluptatibus nullo dolore nec impediente nec impendente, quem tandem hoc statu
praestabiliorem aut magis expetendum possimus dicere? inesse enim necesse est in
eo, qui ita sit affectus, et firmitatem animi nec mortem nec dolorem timentis,
quod mors sensu careat, dolor in longinquitate levis, in gravitate brevis soleat
esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas
voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est,
quod huc possit, quod melius sit, accedere? Statue contra aliquem confectum
tantis animi corporisque doloribus, quanti in hominem maximi cadere possunt,
nulla spe proposita fore levius aliquando, nulla praeterea neque praesenti nec
expectata voluptate, quid eo miserius dici aut fingi potest? quodsi vita
doloribus referta maxime fugienda est, summum profecto malum est vivere cum
dolore, cui sententiae consentaneum est ultimum esse bonorum eum voluptate
vivere. Nec enim habet nostra mens quicquam, ubi consistat tamquam in extremo,
omnesque et metus et aegritudines ad dolorem referuntur, nec praeterea est res
ulla, quae sua natura aut sollicitare possit aut angere. Praeterea et appetendi et refugiendi et omnino rerum gerendarum initia
proficiscuntur aut a voluptate aut a dolore. Quod cum ita sit, perspicuum est
omnis rectas res atque laudabilis eo referri, ut cum voluptate vivatur. quoniam
autem id est vel summum bonorum vel ultimum vel extremum ( quod Graeci τέλος
nominant , quod ipsum nullam ad aliam rem, ad id autem res referuntur omnes,
fatendum est summum esse bonum iucunde vivere.
XIII.
Id qui in una virtute ponunt et splendore nominis capti quid natura postulet non
intellegunt, errore maximo, si Epicurum audire voluerint, liberabuntur: istae
enim vestrae eximiae pulchraeque virtutes nisi voluptatem efficerent, quis eas
aut laudabilis aut expetendas arbitraretur? ut enim medicorum scientiam non
ipsius artis, sed bonae valetudinis causa probamus, et gubernatoris ars, quia
bene navigandi rationem habet, utilitate, non arte laudatur, sic sapientia, quae
ars vivendi putanda est, non expeteretur, si nihil efficeret; nunc expetitur,
quod est tamquam artifex conquirendae et comparandae voluptatis (Quam autem ego dicam voluptatem, iam videtis, ne invidia verbi
labefactetur oratio mea). Nam cum ignoratione rerum bonarum et malarum maxime
hominum vita vexetur, ob eumque errorem et voluptatibus maximis saepe priventur
et durissimis animi doloribus torqueantur, sapientia est adhibenda, quae et
terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate
derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem. Sapientia enim est
una, quae maestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescere metu non sinat. Qua
praeceptrice in tranquillitate vivi potest omnium cupiditatum ardore restincto.
Cupiditates enim sunt insatiabiles, quae non modo singulos homines, sed
universas familias evertunt, totam etiam labefactant saepe rem publicam. Ex cupiditatibus odia, discidia, discordiae, seditiones, bella nascuntur,
nec eae se foris solum iactant nec tantum in alios caeco impetu incurrunt, sed
intus etiam in animis inclusae inter se dissident atque discordant, ex quo vitam
amarissimam necesse est effici, ut sapiens solum amputata circumcisaque
inanitate omni et errore naturae finibus contentus sine aegritudine possit et
sine metu vivere. Quae est enim aut utilior aut ad bene vivendum aptior partitio quam illa,
qua est usus Epicurus? qui unum genus posuit earum cupiditatum, quae essent et
naturales et necessariae, alterum, quae naturales essent nec tamen necessariae,
tertium, quae nec naturales nec necessariae. Quarum ea ratio est, ut necessariae
nec opera multa nec impensa expleantur; ne naturales quidem multa desiderant,
propterea quod ipsa natura divitias, quibus contenta sit, et parabiles et
terminatas habet; inanium autem cupiditatum nec modus ullus nec finis inveniri
potest.
XIV. Quodsi vitam omnem perturbari videmus errore et inscientia, sapientiamque
esse solam, quae nos a libidinum impetu et a formidinum terrore vindicet et
ipsius fortunae modice ferre doceat iniurias et omnis monstret vias, quae ad
quietem et ad tranquillitatem ferant, quid est cur dubitemus dicere et
sapientiam propter voluptates expetendam et insipientiam propter molestias esse
fugiendam? Eademque ratione ne temperantiam quidem propter se expetendam esse dicemus,
sed quia pacem animis afferat et eos quasi concordia quadam placet ac leniat.
Temperantia est enim, quae in rebus aut expetendis aut fugiendis ut rationem
sequamur monet. Nec enim satis est iudicare quid faciendum non faciendumve sit,
sed stare etiam oportet in eo, quod sit iudicatum. Plerique autem, quod tenere
atque servare id, quod ipsi statuerunt, non possunt, victi et debilitati obiecta
specie voluptatis tradunt se libidinibus constringendos nec quid eventurum sit
provident ob eamque causam propter voluptatem et parvam et non necessariam et
quae vel aliter pararetur et qua etiam carere possent sine dolore tum in morbos
gravis, tum in damna, tum in dedecora incurrunt, saepe etiam legum iudiciorumque
poenis obligantur. Qui autem ita frui volunt voluptatibus, ut nulli propter eas consequantur
dolores, et qui suum iudicium retinent, ne voluptate victi faciant id, quod
sentiant non esse faciendum, ii voluptatem maximam adipiscuntur praetermittenda
voluptate. Idem etiam dolorem saepe perpetiuntur, ne, si id non faciant,
incidant in maiorem. Ex quo intellegitur nec intemperantiam propter se esse
fugiendam temperantiamque expetendam, non quia voluptates fugiat, sed quia
maiores consequatur.
XV. Eadem fortitudinis ratio reperietur. Nam neque laborum perfunctio neque
perpessio dolorum per se ipsa allicit nec patientia nec assiduitates nec
vigiliae nec ea ipsa, quae laudatur, industria, ne fortitudo quidem, sed ista
sequimur, ut sine cura metuque vivamus animumque et corpus, quantum efficere
possimus, molestia liberemus. Ut enim mortis metu omnis quietae vitae status
perturbatur, et ut succumbere doloribus eosque humili animo imbecilloque ferre
miserum est, ob eamque debilitatem animi multi parentes, multi amicos, non nulli
patriam, plerique autem se ipsos penitus perdiderunt, sic robustus animus et
excelsus omni est liber cura et angore, cum et mortem contemnit, qua qui affecti
sunt in eadem causa sunt, qua ante quam nati, et ad dolores ita paratus est, ut
meminerit maximos morte finiri, parvos multa habere intervalla requietis,
mediocrium nos esse dominos, ut, si tolerabiles sint, feramus, si minus, animo
aequo e vita, cum ea non placeat, tamquam e theatro exeamus. Quibus rebus
intellegitur nec timiditatem ignaviamque vituperari nec fortitudinem
patientiamque laudari suo nomine, sed illas reici, quia dolorem pariant, has
optari, quia voluptatem.
XVI. Iustitia restat, ut de omni virtute sit dictum. Sed similia fere dici
possunt. Ut enim sapientiam, temperantiam, fortitudinem copulatas esse docui cum
voluptate, ut ab ea nullo modo nec divelli nec distrahi possint, sic de iustitia
iudicandum est, quae non modo numquam nocet cuiquam, sed contra semper afficit
cum vi sua atque natura, quod tranquillet animos, tum spe nihil earum rerum
defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad modum temeritas et
libido et ignavia semper animum excruciant et semper sollicitant turbulentaeque
sunt, sic improbitas si cuius in mente consedit, hoc ipso, quod adest,
turbulenta est; si vero molita quippiam est, quamvis occulte fecerit, numquam
tamen id confidet fore semper occultum. Plerumque improborum facta primo
suspicio insequitur, dein sermo atque fama, tum accusator, tum iudex; Multi etiam, ut te consule, ipsi se indicaverunt. Quodsi qui satis sibi
contra hominum conscientiam saepti esse et muniti videntur, deorum tamen horrent
easque ipsas sollicitudines, quibus eorum animi noctesque diesque exeduntur, a
diis inmortalibus supplicii causa importari putant. Quae autem tanta ex improbis
factis ad minuendas vitae molestias accessio potest fieri, quanta ad augendas,
cum conscientia factorum, tum poena legum odioque civium? et tamen in quibusdam
neque pecuniae modus est neque honoris neque imperii nec libidinum nec epularum
nec reliquarum cupiditatum, quas nulla praeda umquam improbe parta minuit, *
inflammat potius , ut coercendi magis quam dedocendi esse videantur. Invitat igitur vera ratio bene sanos ad iustitiam, aequitatem, fidem, neque
homini infanti aut impotenti iniuste facta conducunt, qui nec facile efficere
possit, quod conetur, nec optinere, si effecerit, et opes vel fortunae vel
ingenii liberalitati magis conveniunt, qua qui utuntur, benivolentiam sibi
conciliant et, quod aptissimum est ad quiete vivendum, caritatem, praesertim cum
omnino nulla sit causa peccandi. Quae enim cupiditates a natura proficiscuntur, facile explentur sine ulla
iniuria, quae autem inanes sunt, iis parendum non est. Nihil enim desiderabile
concupiscunt, plusque in ipsa iniuria detrimenti est quam in iis rebus
emolumenti, quae pariuntur iniuria. Itaque ne iustitiam quidem recte quis
dixerit per se ipsam optabilem, sed quia iucunditatis vel plurimum afferat. Nam
diligi et carum esse iucundum est propterea, quia tutiorem vitam et voluptatem
pleniorem efficit. Itaque non ob ea solum incommoda, quae eveniunt improbis,
fugiendam improbitatem putamus, sed multo etiam magis, quod, cuius in animo
versatur, numquam sinit eum respirare, numquam adquiescere. Quodsi ne ipsarum quidem virtutum laus, in qua maxime ceterorum
philosophorum exultat oratio, reperire exitum potest, nisi derigatur ad
voluptatem, voluptas autem est sola, quae nos vocet ad se et alliciat suapte
natura, non potest esse dubium, quin id sit summum atque extremum bonorum
omnium, beateque vivere nihil aliud sit nisi cum voluptate vivere.
XVII. Huic certae stabilique sententiae quae sint coniuncta explicabo brevi.
Nullus in ipsis error est finibus bonorum et malorum, id est in voluptate aut in
dolore, sed in his rebus peccant, cum e quibus haec efficiantur ignorant. Animi
autem voluptates et dolores nasci fatemur e corporis voluptatibus et doloribus
-- itaque concedo, quod modo dicebas, cadere causa, si qui e nostris aliter
existimant, quos quidem video esse multos, sed imperitos --, quamquam autem et
laetitiam nobis voluptas animi et molestiam dolor afferat, eorum tamen utrumque
et ortum esse e corpore et ad corpus referri, nec ob eam causam non multo
maiores esse et voluptates et dolores animi quam corporis. Nam corpore nihil
nisi praesens et quod adest sentire possumus, animo autem et praeterita et
futura. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna
accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis
opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut ea maior sit, si nihil
tale metuamus. Iam illud quidem perspicuum est, maximam animi aut voluptatem aut molestiam
plus aut ad beatam aut ad miseram vitam afferre momenti quam eorum utrumvis, si
aeque diu sit in corpore. Non placet autem detracta voluptate aegritudinem
statim consequi, nisi in voluptatis locum dolor forte successerit, at contra
gaudere nosmet omittendis doloribus, etiamsi voluptas ea, quae sensum moveat,
nulla successerit, eoque intellegi potest quanta voluptas sit non dolere. Sed ut iis bonis erigimur, quae expectamus, sic laetamur iis, quae
recordamur. Stulti autem malorum memoria torquentur, sapientes bona praeterita
grata recordatione renovata delectant. Est autem situm in nobis ut et adversa
quasi perpetua oblivione obruamus et secunda iucunde ac suaviter meminerimus.
sed cum ea, quae praeterierunt, acri animo et attento intuemur, tum fit ut
aegritudo sequatur, si illa mala sint, laetitia, si bona.
XVIII.
O praeclaram beate vivendi et apertam et simplicem et directam viam! eum enim
certe nihil homini possit melius esse quam vacare omni dolore et molestia
perfruique maximis et animi et corporis voluptatibus, videtisne quam nihil
praetermittatur quod vitam adiuvet, quo facilius id, quod propositum est, summum
bonum consequamur? clamat Epicurus, is quem vos nimis voluptatibus esse deditum
dicitis; non posse iucunde vivi, nisi sapienter, honeste iusteque vivatur, nec
sapienter, honeste, iuste, nisi iucunde. Neque enim civitas in seditione beata esse potest nec in discordia
dominorum domus; quo minus animus a se ipse dissidens secumque discordans
gustare partem ullam liquidae voluptatis et liberae potest. Atqui pugnantibus et
contrariis studiis consiliisque semper utens nihil quieti videre, nihil
tranquilli potest. Quodsi corporis gravioribus morbis vitae iucunditas impeditur, quanto magis
animi morbis impediri necesse est! animi autem morbi sunt cupiditates inmensae
et inanes divitiarum, gloriae, dominationis, libidinosarum etiam voluptatum.
Accedunt aegritudines, molestiae, maerores, qui exedunt animos conficiuntque
curis hominum non intellegentium nihil dolendum esse animo, quod sit a dolore
corporis praesenti futurove seiunctum. Nec vero quisquam stultus non horum
morborum aliquo laborat, nemo igitur est non miser. Accedit etiam mors, quae quasi saxum Tantalo semper impendet, tum
superstitio, qua qui est imbutus quietus esse numquam potest. Praeterea bona
praeterita non meminerunt, praesentibus non fruuntur, futura modo expectant,
quae quia certa esse non possunt, conficiuntur et angore et metu maximeque
cruciantur, cum sero sentiunt frustra se aut pecuniae studuisse aut imperiis aut
opibus aut gloriae. Nullas enim consequuntur voluptates, quarum potiendi spe
inflammati multos labores magnosque susceperant. Ecce autem alii minuti et angusti aut omnia semper desperantes aut
malevoli, invidi, difficiles, lucifugi, maledici, monstruosi, alii autem etiam
amatoriis levitatibus dediti, alii petulantes, alii audaces, protervi, idem
intemperantes et ignavi, numquam in sententia permanentes, quas ob causas in
eorum vita nulla est intercapedo molestiae. Igitur neque stultorum quisquam
beatus neque sapientium non beatus. Multoque hoc melius nos veriusque quam
Stoici. Illi enim negant esse bonum quicquam nisi nescio quam illam umbram, quod
appellant honestum non tam solido quam splendido nomine, virtutem autem nixam
hoc honesto nullam requirere voluptatem atque ad beate vivendum se ipsa esse
contentam.
XIX. Sed possunt haec quadam ratione dici non modo non repugnantibus, verum
etiam approbantibus nobis. Sic enim ab Epicuro sapiens semper beatus inducitur:
finitas habet cupiditates, neglegit mortem, de diis inmortalibus sine ullo metu
vera sentit, non dubitat, si ita melius sit, migrare de vita. His rebus
instructus semper est in voluptate. Neque enim tempus est ullum, quo non plus
voluptatum habeat quam dolorum. Nam et praeterita grate meminit et praesentibus
ita potitur, ut animadvertat quanta sint ea quamque iucunda, neque pendet ex
futuris, sed expectat illa, fruitur praesentibus ab iisque vitiis, quae paulo
ante collegi, abest plurimum et, cum stultorum vitam cum sua comparat, magna
afficitur voluptate. Dolores autem si qui incurrunt, numquam vim tantam habent,
ut non plus habeat sapiens, quod gaudeat, quam quod angatur. Optime vero Epicurus, quod exiguam dixit fortunam intervenire sapienti
maximasque ab eo et gravissimas res consilio ipsius et ratione administrari
neque maiorem voluptatem ex infinito tempore aetatis percipi posse, quam ex hoc
percipiatur, quod videamus esse finitum. In dialectica autem vestra nullam
existimavit esse nec ad melius vivendum nec ad commodius disserendum viam. In
physicis plurimum posuit. Ea scientia et verborum vis et natura orationis et
consequentium repugnantiumve ratio potest perspici. Omnium autem rerum natura
cognita levamur superstitione, liberamur mortis metu, non conturbamur
ignoratione rerum, e qua ipsa horribiles existunt saepe formidines. Denique
etiam morati melius erimus, cum didicerimus quid natura desideret. Tum vero, si
stabilem scientiam rerum tenebimus, servata illa, quae quasi delapsa de caelo
est ad cognitionem omnium, regula, ad quam omnia iudicia rerum dirigentur,
numquam ullius oratione victi sententia desistemus. Nisi autem rerum natura perspecta erit, nullo modo poterimus sensuum
iudicia defendere. Quicquid porro animo cernimus, id omne oritur a sensibus; qui
si omnes veri erunt, ut Epicuri ratio docet, tum denique poterit aliquid
cognosci et percipi. Quos qui tollunt et nihil posse percipi dicunt, ii remotis
sensibus ne id ipsum quidem expedire possunt, quod disserunt. Praeterea sublata
cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum
gerendarum. Sic e physicis et fortitudo sumitur contra mortis timorem et
constantia contra metum religionis et sedatio animi omnium rerum occultarum
ignoratione sublata et moderatio natura cupiditatum generibusque earum
explicatis, et, ut modo docui, cognitionis regula et iudicio ab eadem illa
constituto veri a falso distinctio traditur.
XX. Restat locus huic disputationi vel maxime necessarius de amicitia, quam, si
voluptas summum sit bonum, affirmatis nullam omnino fore.
De qua Epicurus quidem
ita dicit, omnium rerum, quas ad beate vivendum sapientia comparaverit, nihil
esse maius amicitia, nihil uberius, nihil iucundius. Nec vero hoc oratione
solum, sed multo magis vita et factis et moribus comprobavit. Quod quam magnum
sit fictae veterum fabulae declarant, in quibus tam multis tamque variis ab
ultima antiquitate repetitis tria vix amicorum paria reperiuntur, ut ad Orestem
pervenias profectus a Theseo. At vero Epicurus una in domo, et ea quidem
angusta, quam magnos quantaque amoris conspiratione consentientis tenuit
amicorum greges! quod fit etiam nunc ab Epicureis. Sed ad rem redeamus; de
hominibus dici non necesse est.
(66) Tribus igitur modis video esse a nostris de amicitia disputatum. Alii cum
eas voluptates, quae ad amicos pertinerent, negarent esse per se ipsas tam
expetendas, quam nostras expeteremus, quo loco videtur quibusdam stabilitas
amicitiae vacillare, tuentur tamen eum locum seque facile, ut mihi videtur,
expediunt. Ut enim virtutes, de quibus ante dictum est, sic amicitiam negant
posse a voluptate discedere. Nam cum solitudo et vita sine amicis insidiarum et
metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare, quibus partis confirmatur
animus et a spe pariendarum voluptatum seiungi non potest.
(67) Atque ut odia, invidiae, despicationes adversantur voluptatibus, sic
amicitiae non modo fautrices fidelissimae, sed etiam effectrices sunt voluptatum
tam amicis quam sibi, quibus non solum praesentibus fruuntur, sed etiam spe
eriguntur consequentis ac posteri temporis. Quod quia nullo modo sine amicitia
firmam et perpetuam iucunditatem vitae tenere possumus neque vero ipsam
amicitiam tueri, nisi aeque amicos et nosmet ipsos diligamus, idcirco et hoc
ipsum efficitur in amicitia, et amicitia cum voluptate conectitur. Nam et
laetamur amicorum laetitia aeque atque nostra et pariter dolemus angoribus.
(68) Quocirca eodem modo sapiens erit affectus erga amicum, quo in se ipsum,
quosque labores propter suam voluptatem susciperet, eosdem suscipiet propter
amici voluptatem. Quaeque de virtutibus dicta sunt, quem ad modum eae semper
voluptatibus inhaererent, eadem de amicitia dicenda sunt. Praeclare enim
Epicurus his paene verbis: 'Eadem', inquit, 'scientia confirmavit animum, ne
quod aut sempiternum aut diuturnum timeret malum, quae perspexit in hoc ipso
vitae spatio amicitiae praesidium esse firmissimum.' Sunt autem quidam Epicurei timidiores paulo contra vestra convicia, sed
tamen satis acuti, qui verentur ne, si amicitiam propter nostram voluptatem
expetendam putemus, tota amicitia quasi claudicare videatur. Itaque primos
congressus copulationesque et consuetudinum instituendarum voluntates fieri
propter voluptatem; cum autem usus progrediens familiaritatem effecerit, tum
amorem efflorescere tantum, ut, etiamsi nulla sit utilitas ex amicitia, tamen
ipsi amici propter se ipsos amentur. Etenim si loca, si fana, si urbes, si
gymnasia, si campum, si canes, si equos, si ludicra exercendi aut venandi
consuetudine adamare solemus, quanto id in hominum consuetudine facilius fieri
poterit et iustius? Sunt autem, qui dicant foedus esse quoddam sapientium, ut ne minus amicos
quam se ipsos diligant. Quod et posse fieri intellegimus et saepe etiam videmus,
et perspicuum est nihil ad iucunde vivendum reperiri posse, quod coniunctione
tali sit aptius. Quibus ex omnibus iudicari potest non modo non impediri
rationem amicitiae, si summum bonum in voluptate ponatur, sed sine hoc
institutionem omnino amicitiae non posse reperiri.
XXI. Quapropter si ea, quae dixi, sole ipso illustriora et clariora sunt, si
omnia dixi hausta e fonte naturae, si tota oratio nostra omnem sibi fidem
sensibus confirmat, id est incorruptis atque integris testibus, si infantes
pueri, mutae etiam bestiae paene loquuntur magistra ac duce natura nihil esse
prosperum nisi voluptatem, nihil asperum nisi dolorem, de quibus neque depravate
iudicant neque corrupte, nonne ei maximam gratiam habere debemus, qui hac
exaudita quasi voce naturae sic eam firme graviterque comprehenderit, ut omnes
bene sanos in viam placatae, tranquillae, quietae, beatae vitae deduceret? Qui
quod tibi parum videtur eruditus, ea causa est, quod nullam eruditionem esse
duxit, nisi quae beatae vitae disciplinam iuvaret. An ille tempus aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore
facimus, consumeret, in quibus nulla solida utilitas omnisque puerilis est
delectatio, aut se, ut Plato, in musicis, geometria, numeris, astris contereret,
quae et a falsis initiis profecta vera esse non possunt et, si essent vera,
nihil afferrent, quo iucundius, id est quo melius viveremus, eas ergo artes
persequeretur, vivendi artem tantam tamque et operosam et perinde fructuosam
relinqueret? non ergo Epicurus ineruditus, sed ii indocti, qui, quae pueros non
didicisse turpe est, ea putant usque ad senectutem esse discenda.
Quae cum dixisset, Explicavi, inquit, sententiam meam, et eo quidem consilio,
tuum iudicium ut cognoscerem, quoniam mihi ea facultas, ut id meo arbitratu
facerem, ante hoc tempus numquam est data.
|
LIVRE PREMIER
I. Je n'ignorais pas, Brutus, que si nous voulions traiter en latin
les mêmes matières que des philosophes d'un rare savoir et d'un
excellent esprit ont traitées en grec, bien des gens trouveraient à
redire à notre entreprise, les uns d'une façon, les autres d'une
autre. Car il y a des personnes, et même assez éclairées, qui ne
peuvent souffrir qu'on s'applique à la philosophie; et il y en a
d'autres qui véritablement ne désapprouvent pas qu'on s'y adonne,
pourvu qu'on y garde quelque mesure, mais qui tiennent qu'on ne doit
pas s'y livrer avec tant de zèle et y consacrer tant d'efforts. Il y
en a aussi qui, versées dans les lettres grecques, et méprisant
notre littérature, diront qu'elles aiment mieux lire les écrivains
originaux. Enfin il s'en trouvera quelques-unes, à ce que je
soupçonne, qui m'engageront à cultiver de préférence tout autre
genre d'écrire, prétendant que celui-ci, malgré son mérite, ne
convient ni à la gravité de mon caractère ni à la dignité de mon
rang. Je leur répondrai à tous en peu de mots, quoiqu'à l'égard de
ceux qui dédaignent la philosophie, je leur aie déjà assez répondu
dans le livre où j'ai présenté la défense et l'éloge de cette belle
étude, injurieusement attaquée par Hortensius. Ce livre ayant eu
votre approbation et celle des hommes que j'en regardais comme les
juges, je me suis enhardi à continuer, de peur qu'il ne parût que
j'eusse excité chez les esprits un goût que je ne pouvais nourrir.
Quant à ceux qui trouvent bon que l'on s'adonne à la philosophie,
mais sobrement, ils demandent une espèce de retenue très-difficile,
et dont on n'est plus le maître du moment qu'on s'est embarqué;
aussi ceux qui condamnent ouvertement la philosophie sont-ils en
quelque façon plus équitables que ceux qui veulent donner des
limites à une matière infinie, et demandent de la modération dans
une étude qui a d'autant plus de prix qu'elle est poussée plus loin.
En effet, ou l'on peut parvenir à la sagesse, et alors il ne suffit
pas de l'avoir acquise, mais il faut en jouir; ou l'acquisition en
est longue et pénible, et cependant on ne doit
488
pas cesser de chercher la
vérité qu'on ne l'ait trouvée; car il serait honteux de se rebuter
dans la poursuite de ce qu'il y a de plus excellent au monde.
D'ailleurs, si c'est une jouissance pour moi que de traiter de tels
sujets, pourquoi me l'envier et me l'interdire? si c'est une tâche
que je me suis imposée, pourquoi vouloir régler les travaux
d'autrui? C'est par esprit d'humanité que Chrémès dans Térence ne
veut pas que son nouveau voisin
Bêche la terre, ou laboure, ou porte quelque fardeau;
Ce n'est pas le travail
qu'il lui déconseille, mais ce sont ces occupations d'esclave; quant
à mes censeurs, c'est par pure indiscrétion qu'ils se mettent en
peine d'un travail où je trouve tans de charmes.
II. Il n'est peut-être pas si aisé de répondre à ceux qui disent ne
faire nul cas des ouvrages écrits en latin; quoiqu'on ait sujet de
s'étonner que des gens qui ne laissent pas de prendre plaisir à des
tragédies latines traduites du grec mot pour mot, ne puissent
souffrir que l'on traite en leur langue les sujets les plus graves.
Car y a-t-il quelqu'un assez ennemi du nom romain pour dédaigner ou
rejeter superbement la Médée d'Ennius ou l'Antiope de
Pacuvius, et pour oser dire que dans Euripide ces pièces le
charment, mais que, traduites en latin, elles choquent son goût? Il
faudra donc, dira-t-il, que je lise les Synéphèbes de
Cécilius, ou l'Andrienne de Térence, plutôt que les deux
comédies de Ménandre? Pour moi, je suis dans des sentiments si
différents qu'encore que l'Electre soit admirable dans
Sophocle et qu'Attilius l'ait fort mal rendue, je ne laisse pas
pourtant de la lire dans Attilius, que, Licinius appelle un écrivain
de fer, avec assez de raison, mais qui cependant est un écrivain, et
mérite d'être lu. C'est après tout trop de
nonchalance ou de vaine délicatesse que de ne
vouloir pas jeter les yeux sur nos poètes.
Pour moi, je ne saurais regarder comme des gens instruits ceux qui
n'ont pas la moindre connaissance de nos auteurs. Eh quoi! nous
lisons tout aussi volontiers dans Ennius que dans le grec:
”Plût au ciel que jamais dans les bois du Pélion.”
et nous ne voudrons pas
que l'on explique en latin les théories de Platon sur le bien et le
bonheur? De plus, si je n'écris point en simple traducteur, mais si
je soutiens les opinions des philosophes que j'approuve, si je mêle
mes propres pensées et que je donne un autre tour, un autre ordre
aux doctrines que je reproduis, pourquoi préférera-t-on les ouvrages
grecs à des traités latins écrits élégamment et sans servilité? Que
si l'on prétend que toutes ces matières ont été épuisées par les
Grecs, il n'y a plus de raison alors pour lire parmi les Grecs
eux-mêmes tous les écrivains qui méritent d'être lus. La doctrine
des stoïciens n'est-elle pas tout entière dans Chrysippe? nous
lisons cependant Diogène, Antipater, Mnésarques Panétius, bien
d'autres encore, et, en première ligne, notre ami Posidonius. Est-ce
que Théophraste ne nous fait pas grand plaisir, alors même qu'il
traite les mêmes sujets qu'Aristote? Et les épicuriens
n'écrivent-ils pas tous les jours avec la plus parfaite liberté sur
les matières traitées par Épicure et leurs anciens auteurs? Que si
les Grecs sont lus par les Grecs sur les mêmes sujets
489
développés d'une manière
différente, pourquoi les Latins ne liraient-ils pas leurs écrivains?
III. Toutefois, si je me bornais à traduire Platon ou Aristote,
comme nos poètes traduisent le théâtre grec, ce serait rendre, sans
doute, un mauvais service à mes concitoyens que de leur faire
connaitre ces divins génies. Mais c'est ce que je n'ai point encore
fait, et je ne crois nullement qu'il me soit interdit de le faire;
aussi lorsque l'occasion se présentera de traduire quelques
passages, surtout des deux grands hommes que je viens de nommer, je
me sens fort disposé à suivre l'exemple d'Ennius qui traduit souvent
Homère, et d'Afranius qui reproduit Ménandre. Du reste, je
n'appréhenderais point, comme notre Lucilius, d'écrire pour tout le
monde. Eh! que ne puis-je avoir pour lecteurs Persius et plutôt
encore Scipion et Rutilius dont il craignait tant le jugement, qu'il
disait que ce n'était que pour les Tarentins, pour ceux de Consente
et pour les Siciliens qu'il écrivait. C'est là une de ses nombreuses
plaisanteries, mais, à la vérité, il n'y avait pas alors beaucoup de
savants personnages, de l'approbation desquels il dût se mettre fort
en peine; et dans tous ses écrits, d'un genre fort léger, on trouve
de la politesse et de l'agrément, mais peu de savoir. Pour moi, quel
lecteur aurais-je à redouter, puisque c'est à vous, qui ne le cédez
pas même aux Grecs, que j'ose adresser mon ouvrage? Il est vrai que
vous m'y avez en quelque sorte provoqué par votre livre de la
Vertu, dont l'envoi m'a été si délicieusement agréable. Mais ce
qui fait, je pense, que certaines personnes ont si peu de goût pour
les lettres latines c'est qu'elles seront tombées sur quelques
méchants livres, déjà mauvais en grec, et pitoyables en latin. Si
cela est, je suis de leur avis, pourvu qu'elles reconnaissent que de
tels ouvrages ne méritent pas même en grec l'honneur d'être lus.
Mais si l'on exprime de bonnes idées en termes choisis, avec goût et
dignité, qui pourrait dédaigner cette lecture, à moins de vouloir
passer tout à fait pour Grec, comme cet Albucius, que le préteur
Scévola salua en grec à Athènes! C'est un endroit que Lucilius a
traité avec beaucoup d'élégance et de sel, en faisant dire à
Scévola: “Vous avez préféré, Albucius, d'être appelé Grec, que
Romain et Sabin, compatriote de Pontius, de Tritannus, centurions,
hommes célèbres, les premiers de la cité, et dont la main a porté
les aigles. Un préteur de Rome vous salue donc en grec à Athènes,
lorsque vous l'abordez; χαῖρε, Titus! Les licteurs,
toute la compagnie, la cohorte entière répètent en chœur: χαῖρε, Titus! C'est de là que date la haine d'Albucius
contre moi.”
Mucius avait bien raison, et je ne saurais assez m'étonner de voir
l'insolent dédain de certaines gens pour tout ce qui est romain. Ce
n'est pas ici le lieu de traiter un pareil sujet; mais j'ai toujours
cru, et je m'en suis souvent expliqué, que non-seulement notre
langue n'est point pauvre,comme on le croit vulgairement, mais
qu'elle est même plus riche que la langue grecque. Car, a-t-on
jamais vu, pour ne pas citer mon propre exemple, nos bons orateurs
et nos bons poètes, dès qu'ils eurent un vrai modèle, manquer de
termes pour exprimer leurs idées ou donner des grâces à leur
langage?
IV. Pour moi, qui au milieu des labeurs, des soucis et des périls du
forum, crois n'avoir jamais abandonné le poste que le peuple romain
490 m'avait confié, je dois
aussi essayer, selon la mesure de mes forces, d'éclairer mes
concitoyens par mes travaux, mes études et mes veilles. Mon
intention n'est point tant de m'opposer au goût de ceux qui aiment
mieux lire les Grecs, pourvu qu'effectivement ils les lisent, et
qu'ils ne se contentent pas d'en faire semblant, que de travailler
pour ceux qui savent mêler les lettres latines aux grecques et pour
ceux qui sont peu disposés à demander aux étrangers ce qu'ils
trouvent à Rome. Quant à ceux qui voudraient que j'écrivisse sur
toute autre chose que sur la philosophie, ils devraient être plus
équitables, et songer que j'ai déjà beaucoup écrit sur divers
sujets, et autant qu'aucun autre Romain ait jamais fait; je ne
renonce pas cependant à traiter d'autres matières encore, si ma vie
se prolonge; mais quiconque voudra s'appliquer à lire mes ouvrages
de philosophie, trouvera qu'il n'y a point de lecture dont on puisse
retirer plus de fruit. Qu'y a-t-il en effet de plus digne de nos
recherches que tout ce que la philosophie enseigne, et ce qui fait
en particulier le sujet des présents livres; savoir, quelle est la
fin principale et dernière à laquelle il faut rapporter toutes les
règles du bien vivre et les motifs éclairés des actions, et ce que
la nature doit rechercher comme le plus grand des biens, ou fuir
comme le plus grand des maux. Or les sentiments des plus savants
hommes étant partagés là-dessus, puis-je croire que la recherche de
la vérité la plus importante pour la conduite de toute la vie, soit
une occupation qui ne réponde pas à l'opinion qu'on veut bien avoir
de moi? Quoi! deux grands personnages de la république, L. Scévola
et M. Manilius, auront consulté ensemble pour décider “si l'enfant
d'une esclave doit être regardé comme un fruit qui appartient au
maître;” Marcus Brutus aura été là-dessus d'un avis différent du
leur; et comme ce sont là des questions de droit assez subtiles et
de quelque usage dans la société, on lira leurs écrits et d'autres
du même genre avec plaisir, et on négligera ce qui regarde le cours
entier de la vie? De pareils livres peuvent certainement avoir plus
de débit, mais les sujets que je traite sont assurément d'une
utilité plus féconde; au reste, il faut en laisser le jugement aux
lecteurs. Je crois avoir développé ici complètement toute la
question des biens et des maux; je n'ai rien négligé dans cet écrit
non-seulement pour expliquer mon opinion, mais pour faire entendre
tout ce qui a été dit sur la matière par chacune des écoles
philosophiques.
V. Pour commencer par le plus aisé, je vais examiner la doctrine
d'Épicure, si connue de tout le monde, et vous verrez que je
l'expose avec tant de soin, que ceux mêmes qui la soutiennent ne
sauraient l'expliquer mieux; car je ne songe qu'à chercher la
vérité, et nullement à combattre, ni à vaincre un adversaire. L.
Torquatus, homme d'un profond savoir, défendit un jour devant moi
avec beaucoup de talent l'opinion d'Épicure sur la volupté; et je
lui répondis, en présence de G. Triarius, jeune homme fort instruit
et d'un esprit très-mûr, qui assista à notre discussion. Car l'un et
l'autre m'étant venus voir dans ma campagne de Cumes, la
conversation tomba d'abord sur les lettres, qu'ils aimaient
passionnément tous deux. Bientôt Torquatus me dit: Puisque nous vous
trouvons de loisir, il faut que je sache de vous, je ne dirai pas
pourquoi vous haïssez Épicure, comme font d'ordinaire
491 ceux qui ne sont pas de son
sentiment; mais au moins pourquoi vous n'approuvez pas un homme, le
seul selon moi qui ait connu la vérité; un homme qui a délivré nos
esprits des plus graves erreurs, et nous a donné tous les préceptes
nécessaires pour pouvoir vivre sages et heureux. Pour moi, j'imagine
que ce qui fait que vous ne le goûtez pas, vous et Triarius, c'est
qu'il a négligé ces ornements du discours, si familiers à Platon,
Aristote et Théophraste; car d'ailleurs je ne saurais me persuader
que vous ne soyez pas de son sentiment. Voyez, lui répondis-je,
combien vous vous trompez, Torquatus. Le style de ce philosophe ne
me choque point; il dit ce qu'il veut dire, et il le fait fort bien
entendre. Je ne suis pas fâché de trouver de l'éloquence dans un
philosophe, mais ce n'est pas ce que j'y cherche. C'est uniquement
sur les choses mêmes qu'Épicure ne me satisfait pas en plusieurs
endroits. Mais, autant de têtes, autant d'opinions, et je puis bien
me tromper. En quoi donc ne vous satisfait-il pas, reprit-il? Car,
pourvu que vous ayez bien compris ce qu'il dit, je ne doute point
que vous ne soyez un juge très-équitable. A moins que vous ne
pensiez, lui répondis-je, que Phèdre et Zénon m'en ont imposé (car
je les ai entendus tous deux et n'ai pu approuver en eux que leur
zèle), vous devez croire que je possède assez bien la doctrine
d'Épicure. Je les ai même entendus souvent avec mon cher Atticus qui
les admirait tous deux et qui aimait particulièrement Phèdre; tous
les jours nous nous entretenions sur ce que nous avions entendu, et
jamais nous n'avions de dispute sur le sens des paroles, mais sur le
fond même des opinions.
VI. Encore une fois, ajouta-t-il, sur quoi Épicure ne vous
contente-t-il pas? En premier lieu, lui répondis-je, il n'entend
rien à la physique dans laquelle il se vante d'exceller. Il fait
quelques changements et ajoute quelques traits au système de
Démocrite, mais il me semble fort qu'il n'y touche que pour le
gâter. Les atomes, selon lui (car c'est ainsi qu'il appelle de
petits corpuscules indivisibles à cause de leur solidité), sont
incessamment portés de telle sorte dans le vide infini, où il ne
peut y avoir ni haut, ni bas, ni milieu, ni commencement, ni fin,
que venant à s'attacher ensemble par leur concours, ils forment tout
ce qui existe et ce que nous voyons. Il veut aussi que leur
mouvement ne leur ait été imprimé par aucun principe étranger, mais
qu'il leur ait été propre de toute éternité. Épicure se trompe moins
dans les endroits où il suit Démocrite. Parmi tous les reproches que
je puis adresser à leur commune doctrine, il en est un d'une extrême
importance; c'est que tandis qu'il y a dans la nature deux principes
à considérer, la matière dont tout est fait, et la force qui donne
la forme à chaque chose, ils n'ont parlé que de la matière, et n'ont
pas dit un mot de la force et de la cause efficace. Voici en quoi
ils ont manqué l'un et l'autre, mais voici où Épicure a failli
particulièrement. Il prétend que les atomes se portent d'eux-mêmes
directement en bas, et que c'est là le mouvement naturel de tous les
corps. Ensuite venant à songer que si tous les atomes se portaient
toujours en bas et en ligne directe, il n'arriverait jamais qu'un
atome pût toucher l'autre, notre habile homme se met en frais d'une
proposition tout à fait chimérique et nous parle
492
d'un mouvement de déclinaison
le plus léger possible, par le moyen duquel les atomes venant à se
rencontrer, s'accrochent ensemble, et composent l'univers et toutes
ses parties. Et cependant avec cette fiction puérile, il n'atteint
nullement le but qu'il se propose, car il introduit tout à fait
arbitrairement cette déclinaison, dont il n'allègue aucune cause; et
rien n'est plus honteux pour un physicien que de recevoir des effets
sans cause; d'un autre côté, il ôte aux atomes, également sans
cause, le mouvement naturel et direct de haut en bas, qu'il avait
établi dans tous les corps; et cependant avec toutes les
suppositions qu'il invente, il ne peut venir à bout de ce qu'il
prétend. Car si tous les atomes ont le même mouvement de
déclinaison, jamais ils ne s'attachent ensemble; que si les uns ont
ce mouvement, et les autres suivent la ligne droite, d'abord c'est
leur donner de différents emplois à crédit, que d'assigner un
mouvement direct aux uns et un oblique aux autres, outre qu'avec
tout cela il ne laissera pas d'être impossible que cette rencontre
tumultueuse des atomes, qui est la pierre d'achoppement de Démocrite
lui-même, produise jamais l'ordre et la beauté de l'univers. Il est
d'ailleurs indigne d'un physicien de croire qu'il existe des
particules indivisibles; jamais Épicure n'aurait eu cette vision
s'il eût mieux aimé apprendre la géométrie de Polyène, son ami, que
de la lui faire désapprendre. Démocrite, qui était instruit et
habile en géométrie, croit que le soleil est d'une grandeur immense;
Épicure lui donne environ deux pieds, et pense que sa véritable
grandeur est telle qu'elle nous parait, ou peut-être un peu plus ou
un peu moins considérable. Ainsi donc, toutes les nouveautés qu'il
apporte sont insoutenables; le reste de son système est du Démocrite
pur; c'est de lui qu'il a pris les atomes, le vide, les images ou
espèces sensibles qui, nous venant frapper, causent non-seulement
nos perceptions, mais toutes nos pensées; c'est de lui aussi qu'il a
reçu cette infinité qu'ils nomment εἴδωλα cette
innombrable multitude de mondes qui naissent et périssent à toute
heure. Et quoique je n'approuve nullement ces imaginations-là dans
Démocrite, je ne puis souffrir qu'un homme qui les a toutes prises
de lui se fasse le censeur d'un si beau génie que tout le monde
admire.
VII. Quant à la logique, qui est la seconde partie de la philosophie
et nous apprend l'art des recherches et la conduite du raisonnement,
votre Épicure, ce me semble, est extrêmement vide et faible. Il
supprime les définitions, il n'enseigne ni à distinguer, ni à
diviser, ni à tirer une conclusion, ni à résoudre un argument
captieux, ni à lever les ambiguïtés des termes; enfin, il fait les
sens juges de tout, et tient que si seulement une fois ils prenaient
l'erreur pour la vérité, il n'y aurait plus aucun moyen de
distinguer le vrai du faux. Il soutient avec beaucoup de force que
la nature ne recherche que la volupté et ne craint que la douleur,
et c'est à ces deux mobiles qu'il rapporte tout ce que nous devons
poursuivre et fuir. Cette doctrine est d'Aristippe, et elle a été
bien mieux soutenue et avec plus de vraisemblance par les
cyrénaïques que par Épicure. Cependant rien ne me parait plus
indigne d'un homme qu'une pareille opinion, et la nature à ce qu'il
me semble, nous a créés et formés pour quelque chose de plus grand;
mais au fond il se peut faire que je me trompe. Je ne puis croire
pourtant que celui qui mérita le premier le nom
493 de Torquatus, ait arraché ce
fameux collier à l'ennemi par sentiment de volupté; je ne puis
croire que par volupté il ait combattu les Latins près du Vésère
dans son troisième consulat. Et quand il fit frapper son fils de la
hache, ne se priva-t-il pas de bien des jouissances, en étouffant le
cri de la nature et l'amour paternel sous l'impérieux sentiment des
droits du souverain commandement déposé dans ses mains? Quoi!
lorsque T. Torquatus, celui qui fut consul avec Cn. Octavius, voulut
que son fils qu'il avait émancipé pour être adopté par D. Silanus,
plaidât lui-même sa cause devant lui contre les ambassadeurs
macédonien qui l'accusaient de concussion pendant sa préture, et
qu'après avoir entendu les deux parties, il prononça qu'il ne lui
paraissait pas que son fils se fût comporté dans le commandement
comme ses ancêtres, et lui défendit de se présenter davantage devant
son père, croyez-vous que ce fût alors un sentiment de volupté qui
le fit agir? Mais laissant à part ce que tout bon citoyen supporte
pour son pays, et non-seulement les plaisirs dont il se prive, mais
les périls où il s'expose, les fatigues et les maux qu'il endure en
préférant de souffrir plutôt tous les supplices que de manquer au
moindre de ses devoirs; je viens à ce qui est moins considérable,
mais qui ne prouve pas moins. Quelle volupté, vous Torquatus, et
vous Triarius, trouvez-vous dans la culture des lettres, dans
l'étude de l'histoire et des poètes, dans le souvenir de tous ces
vers qui ornent votre mémoire? Et ne m'allez pas dire tous deux que
c'est pour vous une grande volupté; et que vos ancêtres, Torquatus,
trouvaient une certaine jouissance dans leur héroïsme. Ce n'est pas
ce qu'Épicure répond à une semblable objection; ce n'est pas non
plus ce que vous y devez répondre, ni vous ni tout homme de bon
sens, qui sera un peu instruit de ces matières. On demande souvent
ce qui fait qu'il y a tant d'Épicuriens; à cette question je vois
plus d'une réponse à faire; mais ce qui attire surtout la multitude,
c'est qu'elle s'imagine qu'au dire d'Épicure, tout ce qui est juste
et honnête donne de soi-même du plaisir et de la volupté. Mais ces
excellentes gens ne prennent pas garde que tout le système serait
renversé, s'il en était ainsi. Car si l'on accordait que les choses
louables et honnêtes fussent agréables naturellement et par leur
propre charme, sans aucun rapport aux voluptés physiques, il s'en
suivrait que la vertu et la science seraient désirables pour
elles-mêmes, ce dont Épicure est loin de tomber d'accord. Je ne puis
donc pas l'approuver dans tout ce que je viens de vous dire.
D'ailleurs je voudrais, ou qu'il eût été plus versé dans les
sciences (car vous serez bien forcé d'avouer qu'il n'a presque
aucune teinture de ce qui fait que les hommes sont appelés savants);
ou qu'il n'eût pas détourné les autres de l'étude, quoiqu'il me
semble que pour vous il n'ait pas eu le crédit de vous en détourner.
VIII. Après que j'eus parlé de la sorte, plutôt encore pour
provoquer Torquatus que pour exprimer mon opinion, Triarius me dit
en souriant: Il ne s'en faut guère que vous n'ayez effacé Épicure du
rang des philosophes. Car tout le mérite que vous lui laissez, c'est
que, de quelque façon qu'il s'énonce, vous ne laissez pas de
l'entendre. Sur la physique, il a pris des autres tout ce qu'il a
dit, encore ses principes ne sont-ils pas de votre goût; et tout ce
qu'il a voulu corriger, il l'a gâté. Il n'a eu aucune connaissance
de la dialec- 494 tique. Et en
mettant le souverain bien dans la volupté, premièrement il s'est
fort trompé; en second lieu, il n'a rien dit qui lui fût propre, car
Aristippe avait soutenu cette doctrine avant lui, et mieux que lui.
Enfin vous avez ajouté que c'était un ignorant. — II est impossible,
repris-je, Triarius, que lorsqu'on diffère de sentiment avec
quelqu'un, on ne marque ce qu'on ne peut approuver chez lui; car qui
m'empêcherait d'être épicurien, si j'adoptais toutes les opinions du
maître, qu'il est si facile d'apprendre en se jouant? Il ne faut
donc pas trouver mauvais que ceux qui discutent ensemble, parlent
l'un contre l'autre pour se réfuter. Ce sont les injures, les
invectives, les emportements, la trop grande vivacité et
l'opiniâtreté sans frein qu'il faut bannir de la dispute et qui me
semblent indignes de la philosophie. — Vous avez raison, dit
Torquatus; il n'y a pas de discussion sans critique; tout comme il
n'y a pas de bonne discussion, lorsque l'emportement et
l'opiniâtreté s'y mêlent. Mais, si vous le trouvez bon, j'aurais
quelque chose à répondre à ce que vous avez dit. — Croyez-vous donc,
lui répliquai-je, que j'eusse parlé comme j'ai fait, si je n'avais
eu envie de vous entendre? — Eh bien, dit-il, voulez-vous que nous
parcourions toute la doctrine d'Épicure, ou que nous parlions
seulement de la volupté qui est le principal sujet de la
controverse? — A votre choix, lui répondis-je. — Je le veux bien: je
ne développerai alors qu'une seule partie de la doctrine, mais la
plus importante de toutes; nous remettrons à une autre fois ce qui
regarde la physique, et je me fais fort de vous prouver la
déclinaison des atomes, et la grandeur du soleil, telle qu'Épicure
la suppose, et de vous faire voir qu'il a repris et réformé
très-sagement beaucoup de choses dans Démocrite. Quant à présent, je
ne parlerai que de la volupté, et sans rien dire de fort nouveau, je
ne laisse pas d'espérer que vous finirez par être de mon sentiment.
— Je vous assure, lui répondis-je, que je ne serai point opiniâtre,
et que je me rendrai volontiers, si vous pouvez me persuader. — Je
le ferai, ajouta-t-il, pourvu que vous demeuriez dans l'équitable
disposition que vous témoignez. Mais j'aimerais mieux parler de
suite que de faire des questions ou d'y répondre. — Comme il vous
plaira.— Il entra alors ainsi en matière.
IX. Je commencerai par me conformer à la méthode d'Épicure, dont je
vais expliquer la doctrine: j'établirai d'abord en quoi consiste
précisément le sujet de nos recherches, non pas que je pense que
vous ne le sachiez très-bien, mais afin de procéder avec ordre. Nous
cherchons donc quel est le dernier et le plus parfait des biens; et
du consentement de tous les philosophes, il faut que ce soit celui
auquel tous les autres biens doivent se rapporter et qui ne se
rapporte à aucun autre. A ces traits Épicure reconnait la volupté
qu'il prétend être le souverain bien, ajoutant que la douleur est le
plus grand des maux; et voici comment il s'y prend pour le prouver.
Tout animal, dès qu'il est né, recherche la volupté dont il jouit
comme d'un bien excellent, redoute la douleur comme le plus grand
des maux et la fuit autant qu'il le peut; et tout cela il le fait
lorsque la nature n'a pas encore été corrompue en lui et qu'il peut
juger le plus sainement. On n'a donc pas besoin de raisonnement ni
de preuves pour démontrer que la volupté est à rechercher et la
douleur à fuir. Cela se sent comme on sent que le feu est chaud, que
la neige est blanche et que le miel est doux; il
495 est inutile d'employer une
habile dialectique pour démontrer ce qui se prouve assez de
soi-même. Car il y a différence, dit Épicure, entre ce qu'on ne peut
démontrer que par raisonnement et syllogisme, et ce qui ne demande
qu'un simple avertissement et comme un unique regard; les choses
abstruses et enveloppées de ténèbres ont besoin d'étude pour être
bien démêlées, les choses faciles à comprendre et évidentes se
saisissent au premier coup d'œil. Otez les sens à l'homme, il ne lui
reste plus rien; c'est donc aux sens, c'est-à-dire à la nature
elle-même à juger de ce qui est conforme à la nature ou de ce qui
lui est contraire. Et, je vous le demande, à quel signe pouvons-nous
démêler et reconnaitre ce qu'il faut rechercher ou fuir, si ce n'est
à cette marque sensible de la volupté ou de la douleur? Il y a dans
notre école plusieurs esprits qui veulent établir avec plus d'art et
d'appareil ce premier principe et qui disent que ce n'est pas assez
de juger par les sens de ce qui est bon et mauvais, mais que l'on
peut connaitre par l'esprit et par la raison que l'on doit
rechercher la volupté pour elle-même et que la douleur inspire une
aversion légitime, et qu'ainsi la recherche de l'une et la fuite de
l'autre se déduisent d'une notion naturelle, gravée dans tous les
esprits. D'autres, de l'avis desquels je suis, voyant que tant de
philosophes soutiennent qu'il ne faut mettre ni la volupté au rang
des biens, ni la douleur au rang des maux, disent que nous devons ne
pas trop nous reposer sur la bonté de notre cause, mais soutenir la
discussion, rechercher avec soin ce que l'on peut démontrer sur la
volupté et la douleur, et établir notre doctrine par une habile
argumentation.
X. Mais pour vous faire bien connaitre d'où vient l'erreur de ceux
qui accusent la volupté et se font les partisans de la douleur, je
vais aller tout droit au fond du sujet, et vous expliquer ce qui a
été dit à cet égard par l'inventeur de la vérité que l'on pourrait
appeler l'architecte du bonheur. Personne certainement ne craint ni
ne fuit la volupté parce que c'est la volupté, mais parce qu'elle
attire de grandes douleurs à ceux qui ne savent pas en faire un
usage raisonnable; et d'un autre côté, personne n'aime, ne recherche
et n'ambitionne la douleur pour elle-même, mais parce qu'il se
présente quelquefois des conjonctures où le travail et la douleur
nous conduisent à quelque grande jouissance. Car pour descendre
jusqu'aux petites choses, qui de nous se livre jamais à un exercice
pénible, si ce n'est pour en retirer quelque avantage? Et qui
pourrait justement blâmer ou celui qui rechercherait une volupté de
laquelle ne pourrait résulter aucune suite fâcheuse, ou celui qui
éviterait une douleur dont il ne pourrait espérer aucun plaisir?
Tout au contraire nous blâmons avec raison, et nous croyons dignes
de mépris et de haine ceux qui, se laissant séduire et corrompre par
les attraits d'une volupté présente, ne prévoient pas à combien de
maux et de chagrins une passion aveugle les peut exposer. J'en dis
autant de ceux qui trahissent leurs devoirs par faiblesse d'âme,
redoutant lâchement le travail et la douleur. Il est bien facile de
justifier cette apparente diversité de vues. Car lorsque nous sommes
tout à fait libres, et entièrement maîtres de nos actions, lorsque
rien ne nous empêche de faire ce qui peut nous donner le plus de
plaisir, nous pouvons nous livrer sans
496 réserve à la volupté et fuir hardiment toute espèce
de douleur; mais dans de certaines circonstances nos devoirs ou la
nécessité des temps nous obligent à répudier la volupté et â ne
point nous refuser à la peine. La règle que tient en cela un homme
sage, c'est de renoncer à de légers plaisirs pour s'en préparer de
plus grands, et de savoir supporter des douleurs légères, pour en
éviter de plus fâcheuses. Qui m'empêchera donc d'expliquer suivant
l'opinion que je professe les belles actions des Torquatus mes
ancêtres? et ne croyez pas qu'en les louant comme vous l'avez fait
avec tant d'amitié pour moi, vous m'ayez corrompu ou rendu moins
délibéré à vous réfuter. De quelle manière, je vous prie,
interprétez-vous ce qu'ils ont fait? pouvez-vous croire qu'ils se
soient jetés au travers des ennemis ou qu'ils aient sévi contre leur
propre sang, sans songer à leur plaisir ni à leur intérêt? Les bêtes
féroces elles-mêmes dans leur plus grande impétuosité ne font rien
sans qu'on puisse connaitre le motif de leurs bonds et de leur
emportement; et vous penserez que des hommes d'un mérite si
excellent ont fait de si grandes choses sans sujet! Nous examinerons
bientôt quel peut avoir été leur mobile; en attendant, je tiendrai
que s'ils en ont eu un dans ces actions incontestablement fort
dignes d'éloges, ce ne fut point la vertu seule par son unique
attrait. Le premier Torquatus alla hardiment arracher le collier à
l'ennemi, mais il se couvrit en même temps de son bouclier pour
n'être point tué. Il s'exposa à un grand péril, mais à la vue de
toute l'armée. Et quel fut le fruit d'un tel courage? l'estime et
l'amour de tout le monde, qui sont les gages et les soutiens les
plus assurés d'une vie tranquille. Il condamna son fils à la mort;
si ce fut sans raison, je voudrais certes n'être pas descendu d'un
homme si dur et si cruel. Si ce fut pour sanctionner par un
sacrifice personnel aussi terrible la discipline militaire, et pour
contenir les troupes par le frein d'une terreur salutaire dans cette
guerre difficile, il pourvut par là au salut de ses concitoyens,
d'où il savait que le sien devait dépendre. On peut appliquer à bien
des exemples le même raisonnement. Car ce qui donne un beau champ à
l'éloquence de votre école, et surtout à la vôtre, Tullius, lorsque
dans votre zèle ardent pour les anciens âges vous rapportez les
belles actions de nos grands hommes et faites entendre qu'ils n'y
ont été engagés par aucune vue d'intérêt, mais par le seul attrait
de la vertu, tout cela se trouve entièrement renversé par ce
principe d'action si simple que je viens de mettre en lumière, qu'on
ne se dérobe à aucune volupté que pour se ménager une volupté plus
grande, ou qu'on ne s'expose à aucune douleur que pour éviter une
douleur plus fâcheuse.
XI. Mais c'est assez parlé ici des glorieuses actions des grands
personnages. Nous aurons plus tard à montrer expressément que toutes
les vertus tendent à la volupté. Nous avons à montrer maintenant en
quoi consiste précisément la volupté afin d'ôter aux ignorants tout
sujet d'erreur, et de prouver combien une secte qui passe pour toute
voluptueuse, et pour l'asile de la délicatesse et de la sensualité,
est en effet grave, sévère et retenue. Car nous ne nous attachons
pas à la seule volupté qui nous chatouille agréablement et fait
naitre dans notre esprit des sensations délicieuses; mais pour nous,
la première de toutes les voluptés, c'est l'absence de la douleur.
497 En effet, puisque du
moment que nous ne sentons aucune douleur, cette trêve et ce
soulagement nous donnent de la joie; puisque tout ce qui nous donne
de la joie est volupté, comme tout ce qui nous blesse est douleur;
c'est avec raison que l'absence de toute espèce de douleur est
appelée volupté. Et de même que lorsqu'on a chassé la soif et la
faim par le boire et le manger, c'est une volupté que de ne plus
sentir le besoin; c'en est une aussi en toutes choses que de faire
évanouir la douleur. C'est pourquoi Épicure n'a voulu admettre aucun
milieu entre la douleur et la volupté; et ce que quelques uns ont
regardé comme un milieu entre l'une et l'autre, je veux dire
l'absence de toute douleur, il déclare, lui, que c'est non-seulement
une volupté, mais encore la plus grande de toutes. En effet, avoir
conscience des impressions que l'on éprouve, c'est nécessairement
jouir ou souffrir; et Épicure pense que l'absence de la douleur est
le dernier terme de la volupté, qui peut bien ensuite être
diversifiée de plusieurs manières, mais qui ne peut jamais aller
plus loin. Je me souviens d'avoir ouï dire à mon père, qui se
moquait avec urbanité et finesse des Stoïciens, qu'il y a dans le
Céramique à Athènes une statue de Chrysippe, assis et avançant la
main; ce geste signifie qu'il se plaisait beaucoup à faire ce petit
raisonnement subtil: “Votre main dans l'état où la voilà, désire
t-elle quelque chose? – Non sans doute. – Mais si la volupté était
le bien, ne la désirerait elle pas? – Je le crois. – La volupté
n'est donc pas le bien.” Si la statue pouvait parler, disait mon
père, elle ne tiendrait certes pas ce langage. D'ailleurs cet
argument ne conclut que contre Aristippe et les cyrénaïques et
nullement contre Épicure. Car s'il n'y avait de volupté que celle
qui chatouille agréablement les sens et qui fait courir dans nos
membres un frémissement délicieux, la main re se contenterait pas de
ne point sentir de douleur et désirerait encore une vive impression
de plaisir. Si au contraire la suprême volupté, comme l'entend
Épicure, est l'absence de la douleur, en premier lieu, Chrysippc, on
a eu raison de vous accorder que la main dans l'état où elle se
trouve là, ne désire rien; mais ensuite on a eu tort de répondre
que, si la volupté était le bien, la main la désirerait; car,
comment pourrait-elle désirer ce qu'elle a, puisqu'étant sans
douleur, elle jouit de la volupté?
XII. Voici ce qui peut faire entendre facilement que la volupté est
le souverain bien. Imaginons un homme qui jouisse continuellement de
toutes sortes d'excellents plaisirs, tant du corps que de l'esprit,
sans qu'aucune douleur vienne le frapper ou le menacer;
pouvons-nous, je vous le demande, concevoir un état plus heureux et
plus digne d'envie? Un tel homme a nécessairement l'âme forte; il ne
craint ni la douleur ni la mort, parce que la mort, c'est la
privation de tout sentiment; parce que la douleur, si elle dure, est
légère, si elle est poignante, n'a pas de durée; de telle sorte que
l'excès en est contre-balancé par le prompt évanouissement, et la
longueur par le peu de force. Ajoutez aux traits de notre modèle
qu'il ne soit point sous le coup des terreurs religieuses, et que
même il sache jouir des voluptés passées en les fixant par le charme
du souvenir; encore une fois, que pourrait-on ajouter à un état si
heureux? Supposons au contraire un 498 homme accablé de toutes sortes de douleurs d'esprit et de
corps les plus violentes qui puissent jamais fondre sur nous, sans
aucun espoir de soulagement, sans goûter aucun plaisir et sans
s'attendre à en goûter jamais; peut-on trouver ou imaginer un état
plus misérable? Que si une vie remplie de douleurs est ce qu'il y a
de plus à craindre, sans doute le plus grand des maux est de passer
sa vie dans la souffrance; et par la même raison, le plus grand des
biens est de vivre dans la volupté. Car notre esprit n'a rien autre
chose où il puisse s'arrêter comme à sa fin que la volupté; et
toutes nos craintes, tous nos chagrins, se rapportent à la douleur
sans que nous puissions être sollicités à rien que par la volupté ou
détournés de rien que par la douleur. En outre, la source
universelle de nos désirs et de nos craintes, et le mobile de toutes
nos actions est dans la douleur et la volupté. En conséquence il est
clair que toutes les bonnes et louables actions n'ont d'autre terme
que la volupté. Mais comme le souverain bien, ou la fin et
l'accomplissement de tous les biens, ce que les Grecs nomment
TÉXoç, est celui qui ne se rapporte à rien et auquel tout se
rapporte, il faut avouer que le souverain bien est de vivre dans la
jouissance.
XIII. Ceux qui le font consister dans la vertu et qui, séduits par
le seul éclat de ce beau nom, ne comprennent pas les besoins de la
nature, se trouveraient délivrés d'une grande erreur, s'ils
voulaient en croire Épicure. Car, pour vos vertus, si excellentes et
magnifiques, qui pourrait les trouver dignes d'éloge ou d'envie, si
elles ne vous donnaient des jouissances? Et de même que ce n'est
point pour elle-même qu'on estime la science du médecin, mais à
cause de la santé qu'elle procure; et que dans un pilote, ce n'est
point l'art de naviguer dont on fait cas, mais l'utilité qu'on en
retire; de même, si la sagesse qui est l'art de la vie n'était bonne
à rien, on n'en voudrait pas; on n'en veut que parce qu'elle est
comme l'artisan et la ménagère des voluptés. Mais vous voyez de
quelle nature est la volupté dont j'entends ici parler; car il ne
faudrait pas qu'un mot qui souvent est pris en mauvaise part
discréditât tout mon sentiment. En effet, l'ignorance de ce qui est
bon et mauvais est le principal écueil de la vie; et comme l'erreur
où l'on est là-dessus prive souvent les hommes des jouissances les
plus exquises, et les livre souvent aux plus terribles tourments de
l'esprit, il n'y a que la sagesse qui, nous dépouillant de nos
folles passions et de nos terreurs, et nous arrachant le bandeau des
préjugés, puisse nous conduire sûrement à la volupté. Il n'y a que
la sagesse qui bannisse le chagrin de notre esprit, qui nous défende
des vaines frayeurs, et qui, éteignant en nous par ses préceptes
l'ardeur des passions, nous fasse mener une vie tranquille. Car les
passions sont insatiables, et non-seulement elles perdent les
particuliers, mais souvent elles ruinent des familles entières, et
portent même aux États des coups mortels. Des passions naissent les
haines, les dissensions, les discordes, les séditions, les guerres.
Et ce n'est pas seulement au dehors qu'elles se jettent avec une
impétuosité aveugle; au sein de notre âme elles se combattent et
nous déchirent. C'est ainsi que la vie est empoisonnée:
499 le sage seul, retranchant en
lui et coupant au vif toute sorte de crainte frivole et d'erreur, et
se renfermant dans les bornes de la nature, peut mener une vie
exempte de crainte et de chagrin. Il serait impossible de trouver
une division des passions plus utile et plus en rapport avec la
félicité de la vie, que celle reçue par Épicure; il en reconnait
trois espèces, les unes naturelles, et nécessaires, les secondes
naturelles, mais non pas nécessaires, les troisièmes enfin qui n'ont
ni l'un ni l'autre caractère. On satisfait les nécessaires sans
beaucoup de peine et sans beaucoup de dépense; les naturelles n'en
demandent pas beaucoup plus, parce que les richesses dont la nature
se contente sont aisées à acquérir et ont leurs bornes; mais les
vaines passions n'ont ni borne ni mesure.
XIV. Si donc toute la vie des hommes est troublée par l'erreur et
par l'ignorance, et si la sagesse seule peut nous affranchir de la
guerre des passions, nous délivrer du fantôme de la terreur, nous
apprendre à supporter doucement les injures de la fortune et nous
enseigner tous les chemins qui vont à la tranquillité et au repos,
pourquoi ferions-nous difficulté d'avouer qu'il faut rechercher la
sagesse en vue de la volupté, et fuir l'ignorance et la folie à
cause des maux qu'elles entrainent avec elles? Je dirai dans le même
esprit que ce n'est point pour elle-même qu'il faut rechercher la
tempérance, mais pour le calme qu'elle répand dans les âmes, en les
mettant dans une assiette douce et tranquille. Car c'est la
tempérance qui nous avertit de suivre toujours la raison dans la
recherche des biens et la fuite des maux. Ce n'est pas assez en
effet de savoir juger ce que l'on doit faire ou ne faire pas; il
faut encore savoir se tenir ferme dans le parti que la raison a
approuvé. Mais combien y a-t-il de gens qui, ne pouvant demeurer
fermes dans aucune résolution et séduits par quelque apparence de
volupté, se livrent de telle sorte à leurs passions qu'ils s'y
laissent emporter, sans songer aux conséquences; et de là vient que
pour une volupté médiocre, peu nécessaire, qu'ils auraient pu
remplacer facilement, et dont la privation ne leur eût causé aucune
douleur, ils tombent dans des maladies graves, dans l'infortune et
l'opprobre, et souvent même ils encourent l'animadversion et la
rigueur des lois. Mais ceux qui entendent assez bien la volupté pour
ne point vouloir l'acheter au prix des souffrances, et qui sont
assez fermes dans leurs résolutions pour ne point se laisser vaincre
par l'attrait des plaisirs, et donner par leur conduite un démenti à
leurs sentiments, ceux-là trouvent une grande volupté dans le mépris
même de la volupté. Ils savent aussi quelquefois souffrir une
douleur médiocre pour en éviter une plus forte. On voit par là que
ce n'est point pour elle-même qu'il faut fuir l'intempérance; et
qu'il faut prendre le parti de la tempérance, non parce qu'elle est
l'ennemie des voluptés, mais parce qu'elle nous ménage les plus
solides de toutes les jouissances.
XV. J'en dirai autant de la force d'âme; car la fatigue du travail
et la souffrance des douleurs n'ont par elles-mêmes aucun attrait
qui nous sollicite; je n'en vois pas davantage dans la patience,
l'assiduité, les veilles, dans cette industrieuse activité qu'on
loue tant, dans l'énergie elle-même; mais il n'est rien qu'on ne
souffre 500 pour vivre après
sans souci et sans crainte, et pour affranchir autant qu'on le peut,
son esprit et son corps de toute peine. En effet, de même que la
crainte de la mort trouble entièrement le repos de la vie, de même
que c'est un misérable état de succomber à la douleur, ou de la
supporter avec une indigne faiblesse, et que par une telle lâcheté
souvent l'homme a trahi ses parents, ses amis, sa patrie, et enfin a
été jusqu'à s'immoler lui-même; ainsi un esprit ferme et élevé se
trouve affranchi de toute espèce d'inquiétude et d'angoisse, parce
qu'il méprise la mort qui remet tous les hommes dans l'état où ils
étaient avant de naitre, et se trouve armé contre la douleur en se
rappelant que les extrêmes souffrances finissent bientôt par la
mort, que les légères sont entremêlées de plusieurs intervalles de
relâche, et que pour les autres, suivant que nous les trouvons
tolérables ou non, nous sommes maîtres ou de les supporter ou de
nous en délivrer, et de sortir tranquillement de la vie comme d'un
théâtre. Vous voyez par là que ce n'est point pour elles-mêmes que
nous trouvons blâmables la timidité et la lâcheté, et louables la
patience et la force, mais que l'on réprouve les unes parce qu'elles
trainent les douleurs à leur suite, et qu'on estime les autres parce
qu'elles sont mères de la volupté.
XVI. Il me reste à parler de la justice pour avoir épuisé le cercle
des vertus; et nous pouvons facilement la ramener aux mêmes
principes, et ce que j'ai démontré de la sagesse, de la tempérance
et de la force qui sont tellement identifiées avec la volupté qu'on
ne les en peut ni séparer ni distraire, il faut l'appliquer à la
justice qui, non-seulement n'entraine de douleur pour personne, mais
fait éprouver un charme particulier par le doux effet de sa nature
qui donne la tranquillité à l'esprit, et par l'espérance dont elle
nous remplit que nous ne manquerons jamais d'aucun des biens que
peut désirer une nature où la corruption n'a point pénétré. La
témérité, la licence et la lâcheté déchirent l'âme où elles règnent;
elles y nourrissent continuellement l'agitation et le trouble; tout
pareillement? l'injustice répand le trouble dans l'esprit qu'elle
possède; au milieu de ses entreprises perfides, de quelques ténèbres
qu'on s'enveloppe, on ne peut avoir la confiance qu'on ne sera
jamais dévoilé. Tel est le sort des actions des méchants; d'abord le
soupçon, le bruit qui court, la renommée publique les découvre;
bientôt l'accusateur les poursuit, le juge les frappe; quelquefois
aussi les coupables se découvrent d'eux-mêmes, comme il arriva sous
votre consulat. S'il en est qui croient leur conduite impénétrable
aux regards humains, ils ne laissent pas cependant de redouter ceux
des dieux; et les soins qui les dévorent, les tourments qui les
déchirent nuit et jour, il les regardent comme un supplice que les
dieux immortels leur envoient. Ce qu'on pourrait donc retirer
d'utilité ou de plaisir d'une mauvaise action, peut-il se comparer
aux maux et aux peines que nous infligent le remords, ou le glaive
des lois, ou la réprobation de nos concitoyens? Il est vrai qu'il y
a des gens au comble des biens, des honneurs et de la puissance, et
gorgés de toutes sortes de plaisirs, qui, loin de pouvoir assouvir
leurs passions par une proie injustement ravie, les sentent au
contraire tous les jours s'allumer davantage; mais de tels hommes
ont plutôt besoin d'être enchainés 501
que d'être instruits. La droite raison invite donc à la
justice, à l'équité, à la bonne foi ceux qui ont un esprit sain;
quant aux hommes sans esprit et sans ressources, l'injustice ne les
peut servir, car ou ils manqueront des moyens d'atteindre leur but,
ou leurs succès seront bientôt évanouis; pour ceux à qui les trésors
de l'esprit ou de la fortune sont échus, la libéralité leur convient
mieux, car avec elle ils se concilient l'estime et l'amour de leurs
semblables, qui est le plus solide fondement du repos de la vie;
d'ailleurs, quel sujet pourrait-on avoir d'être injuste, quand on
est puissant? Les besoins qui ont une source tout à fait naturelle,
sont aisés à contenter, sans faire tort à personne; quant aux
passions factices, il ne faut point les satisfaire; elles ne portent
à rien qui justifie nos désirs, et on ne saurait commettre
d'injustice sans y perdre plus qu'on n'y gagne. De sorte qu'on ne
peut pas dire que la justice soit à rechercher pour elle-même, mais
seulement pour les nombreux avantages qu'on en retire. Car s'il est
doux d'être aimé et cbéri, c'est parce que l'amour de nos semblables
fait un rempart à notre tranquillité et double ainsi nos
jouissances. Aussi ce n'est pas seulement pour éviter les
inconvénients du dehors que nous croyons qu'il faut s'empêcher
d'être injuste, mais principalement parce que l'injustice ne laisse
jamais respirer ceux dans l'âme de qui elle pénètre, et ne leur
donne jamais de trêve. Ainsi donc si les vertus, dont les autres
philosophes ont accoutumé de faire sonner la louange si haut, ne
peuvent avoir pour dernière fin que la volupté, et si la volupté
seule a le don de nous appeler et de nous attirer naturellement à
elle, il n'y a point de doute qu'elle ne soit le plus grand et le
dernier des biens, et que par conséquent ce ne soit vivre heureux
que de vivre dans la volupté.
XVII. J'expliquerai en peu de mots les principales conséquences de
cette maxime certaine et indubitable. Il est évident que ce n'est
point en établissant la volupté pour le plus grand des biens et la
douleur pour le plus grand des maux que l'on se trompe, mais en
ignorant quelles sont les choses qui peuvent véritablement procurer
la volupté ou causer la douleur. Nous avouons que les plaisirs et
les peines de l'esprit viennent des plaisirs et des peines du corps;
et je demeure d'accord de ce que vous disiez tantôt que ceux d'entre
nous qui pensent autrement, et que je vois aussi nombreux
qu'inhabiles, ne peuvent jamais soutenir leur opinion. Mais quoique
les plaisirs et les chagrins de l'esprit causent de la joie et de la
douleur; cependant les uns et les autres ont leur source dans les
impressions du corps, et c'est au corps qu'ils se rapportent; ce qui
n'empêche pas pourtant que les voluptés et les peines de l'esprit ne
soient en effet plus grandes que celles du corps. Car nous ne
pouvons sentir par le corps que ce qui est présent et ce qui nous
touche; mais par l'esprit, notre sentiment s'étend au passé et à
l'avenir; et supposant les douleurs de l'esprit égales à celles du
corps, c'est toujours un grand surcroit de douleur que de s'imaginer
que le mal qu'on ressent n'aura point de fin. Et ce que je dis de la
douleur on peut l'appliquer au plaisir, qui est d'autant plus grand
qu'on en jouit sans crainte. Il est manifeste qu'une extrême volupté
ou une extrême douleur d'esprit contribue encore plus à rendre la
vie heureuse ou misérable, que les mêmes impressions se rencon-
502 trant avec une égale durée
dans le corps. Nous ne prétendons pas au reste que, dès qu'on n'a
plus de volupté, on se trouve dans un état malheureux, à moins que
la douleur n'ait pris la place de la volupté; au contraire nous
tenons que c'est une joie que l'absence de la douleur, quand même
cette absence ne serait accompagnée d'aucune volupté sensible. Et
par là on peut juger quelle grande volupté c'est que de ne sentir
aucune douleur. De plus, comme l'attente des biens que nous espérons
nous donne de la joie, le souvenir de ceux dont nous avons joui est
encore du bonheur; et tandis que les insensés se font un tourment
des maux qu'ils n'ont plus, les sages trouvent une source de délices
dans le souvenir charmant des biens qui sont passés. Il ne dépend
que de nous d'ensevelir nos adversités dans un perpétuel oubli, et
d'éterniser dans notre mémoire bienfaisante nos prospérités
écoulées. Lorsqu'on jette un regard vif sur le passé dont le
souvenir nous absorbe, si ce sont des maux que nous nous rappelons,
nous éprouvons de la peine; et de la joie, si ce sont des biens.
XVIII. N'est-ce pas là, je vous le demande, une voie courte et
directe et en même temps brillante et commode pour arriver au
bonheur? Car puisqu'il n'y a rien de meilleur que de vivre sans
douleur ni chagrin, et de jouir des plus grandes voluptés de
l'esprit et du corps; ne voyez-vous pas que nous n'avons rien oublié
de tout ce qui peut rendre la vie agréable et conduire plus sûrement
au souverain bien dont il s'agit? Épicure, que vous accusez d'être
trop abandonné à la volupté, vous crie qu'on ne peut vivre
agréablement à moins de vivre sagement, honnêtement et justement;
niais aussi que l'on ne peut vivre sage, honnête et juste, si l'on
est privé de tout agrément. Car, s'il ne peut y avoir de bonheur
dans une ville livrée à la sédition et dans une maison dont les
maîtres sont en dissentiment, comment un homme qui est en lutte avec
lui-même pourrait-il porter ses lèvres à la coupe de la vraie et
pure volupté? Tant qu'il sera agité de désirs et de sentiments
contraires, il est impossible qu'il goûte la paix et qu'il juge de
rien avec calme. Si de graves maladies du corps sont un obstacle à
l'agrément de la vie, à combien plus forte raison les maladies de
l'esprit n'en seront-elles pas un? Les maladies de l'esprit, ce sont
les excessives et vaines convoitises des richesses, de la gloire, de
la domination, des voluptés sensuelles; ajoutez-y les chagrins, les
tourments et les ennuis dont se laissent continuellement ronger ceux
qui ne veulent pas comprendre qu'il ne faut jamais s'affliger de ce
qui n'est point une douleur du corps actuelle, ou ne traine point
infailliblement une douleur à sa suite. Tous ceux qui n'ont pas la
vraie sagesse sont attaqués de quelqu'une de ces maladies, et tous
sans exception sont malheureux. Ajoutez à cela la frayeur de la
mort, ce rocher de Tantale, toujours suspendu sur leur tête;
joignez-y encore la superstition qui ne laisse jamais de relâche à
ceux qui en sont imbus. Voyez-les; ils ne savent ni se ressouvenir
des biens passés ni goûter les biens présents; ils sont toujours
tendus vers l'avenir, dont l'incertitude les tient dans de
continuelles angoisses; et c'est alors surtout qu'ils sont
cruellement déchirés, lorsqu'ils s'aperçoivent enfin de la vanité de
leurs efforts pour acquérir des richesses, des honneurs, de
l'autorité et de la gloire. Tous ces plaisirs dont l'espérance les
avait enflammés et pour la conquête desquels ils s'étaient
503 donné tant de peines et de
tourments, leur échappent sans retour. On en voit d'autres d'un
esprit faible et bas ou qui désespèrent de tout, on qui sont
malintentionnés, envieux, difficiles à vivre, médisants,
misanthropes, de véritables bêtes furieuses et malignes; d'autres,
les hommes les plus légers du monde, qui font sans cesse des
chapitres de roman; ceux-ci sont emportés, ceux-là téméraires,
effrontés, sans frein, et en même temps sans caractère, et leur
esprit n'est jamais dans la même assiette. Or tous les esprits
tournés de la sorte souffrent d'une plaie qui ne leur laisse jamais
de repos. Mais comme il n'y a aucun de tous ces insensés qui soit
heureux, il n'y a aussi aucun sage qui ne le soit; et nous sommes
beaucoup mieux fondés que les Stoïciens à le soutenir. Ils disent
eux qu'il n'y a d'autre bien que cette je ne sais quelle ombre
qu'ils appellent l'honnête, expression pompeuse qui ne sonne que le
vide; et ils prétendent que la vertu reposant sur ce bien, ne
recherche aucune volupté et se suffit à elle-même pour le bonheur.
XIX. Cependant tout n'est pas déraisonnable dans leurs propositions,
et il en est que loin de combattre, nous adoptons nous-mêmes. C'est
ainsi que, pour Épicure, le sage est toujours heureux. Il est borné
dans ses désirs; il méprise la mort; il pense des dieux immortels ce
qu'il en faut croire, mais sans aucune terreur; et si la vie lui
devient insupportable, il ne fait aucune difficulté d'en sortir.
Ainsi préparé, il est toujours dans la volupté; car en tout instant,
il éprouve toujours plus de jouissances que de douleurs. Il se
ressouvient du passé avec joie, il jouit du présent qu'il sait
apprécier et prendre par le beau côté; il attend doucement l'avenir
sans en être l'esclave; et comme il est très-éloigné de tous les
défauts et des erreurs dont nous venons de parler, il sent une
volupté inconcevable quand il compare sa vie avec celle du vulgaire
insensé. Lorsque les douleurs surviennent, elles ne sont jamais
assez fortes pour que le sage ne puisse en faire une juste estime et
trouver qu'il a toujours plus de sujets de se réjouir que de
s'attrister. Épicure dit encore très-bien que la fortune a
infiniment peu de prise sur le sage, mais qu'il n'y a point
d'affaires si importantes qu'il ne puisse heureusement manier par la
force de sa raison, et qu'on ne peut pas recevoir de plus grande
volupté dans toute l'éternité des temps, qu'il en reçoit dans les
courtes limites où sa vie est renfermée. Quant à votre dialectique,
il l'a regardée comme ne pouvant en aucune façon nous servir ni à
vivre plus heureusement ni à mieux raisonner. Il attachait au
contraire beaucoup de prix à la physique; cette science selon lui
peut nous faire connaitre la force des mots, la nature et les règles
du discours, les lois de la conséquence et de la contradiction dans
les propositions; d'un autre coté lorsque l'on connait bien la
nature des choses, on est délivré de la superstition, affranchi de
la crainte de la mort, soustrait au trouble qu'inspiré l'ignorance
d'où naissent souvent de si terribles fantômes; enfin, quand on est
parvenu à savoir bien ce que la nature désire, on est beaucoup plus
réglé dans tout le cours de sa vie. De plus si nous possédons une
solide et vraie connaissance des choses, et si nous suivons celle
règle qui est comme descendue du ciel pour diriger et éclairer nos
jugements, nous demeure- 504
rons toujours inébranlables dans nos sentiments, sans qu'aucune
force d'éloquence puisse nous en faire dévier. Mais si nous ne
connaissons à fond la nature des choses, il nous sera impossible de
défendre l'autorité de nos sens. Or, toutes les conceptions de notre
esprit ont leur source dans les impressions des sens, dont le
témoignage, s'il est fidèle, comme renseigne Épicure, peut nous
conduire ainsi à de légitimes connaissances. Mais ceux qui le
ruinent et disent qu'on ne peut être certain d'aucune perception,
récusant l'autorité des sens, se rendent par là même incapables et
de mettre au jour et d'établir l'opinion qu'ils soutiennent. En
outre, si vous supprimez la connaissance et la science, il n'est
plus rien sur quoi on puisse fonder la conduite de la vie et la
règle des actions. C'est ainsi que, dans l'étude de la physique, on
puise la fermeté de l'esprit contre la crainte de la mort, la force
de caractère contre les vaines frayeurs de la superstition; le repos
de l'intelligence, qui a levé le voile dont les principes des choses
sont naturellement couverts; la modération des désirs, qui vient
toujours d'une connaissance approfondie des diverses sortes de
passions; et enfin, comme je l'ai déjà dit, les lois de la
connaissance elle-même, et, par la règle de nos jugements qu'on en
déduit naturellement, l'art infaillible de distinguer le faux et le
vrai.
XX. Il me reste à parler d'un sujet qui appartient essentiellement à
cette discussion, je veux dire l'amitié, que vous déclarez anéantie
si la volupté est le souverain bien, et dont Épicure disait que, de
tous les biens que la sagesse peut acquérir pour rendre la vie
heureuse, il n'en est point de plus excellent, de plus fécond et de
plus doux que l'amitié. Et ce n'est point seulement dans ses
discours qu'il a fait paraitre ce sentiment; sa vie, ses actions,
ses mœurs en sont une démonstration bien plus éloquente encore, et
dont on ne peut comprendre tout le prix qu'en recourant aux
anciennes fables, si riches et si variées, et où l'on trouve à peine
trois couples d'amis, en descendant de Thésée jusqu'à Oreste. Mais
quelle nombreuse troupe d'amis parfaits, et tous unis par la plus
vive tendresse, Épicure n'avait-il point rassemblée dans une seule
et étroite maison! Tous les Épicuriens ne suivent-ils pas encore son
exemple? Mais revenons à notre sujet. C'est de l'amitié et non de
ses héros que nous devons parler. Je vois dans notre école trois
opinions différentes sur l'amitié. Les uns nient que le bien de nos
amis doive être recherché par nous avec tout autant de zèle que le
nôtre; en cela il semble que l'amitié soit un peu ébranlée;
néanmoins ils soutiennent assez bien leur opinion et résolvent
toutes les difficultés, à mon avis. Ils disent qu'il en est de
l'amitié comme des vertus, dont nous avons parlé déjà, qu'elle est
inséparable de la volupté. La vie d'un homme seul et sans amis est
en effet exposée à de si grands dangers, que la raison même nous
porte à nous faire des amis, dont l'attachement pour nous puisse
mettre notre esprit en repos, et il est impossible que l'on forme
ces belles liaisons sans songer aux avantages que l'on en retirera.
De même que les haines, les jalousies et les marques de, mépris sont
entièrement contraires à nos plaisirs bien entendus; de même il
n'est pas pour nos voluptés d'appui plus solide ni de source plus
féconde qu'une amitié réciproque, qui non-seulement est d'un
commerce délicieux dans le temps même, mais qui nous donne encore
l'espoir d'un riant et 505
paisible avenir. Comme donc il est impossible de mener une vie
véritablement et continuellement heureuse sans l'amitié, et
d'entretenir longtemps l'amitié si nous n'aimons nos amis comme nous
même, alors il arrive qu'on aime ses amis de cette sorte, et que
l'amitié se joignant ainsi à la volupté, on ne sent pas moins de
joie ou de peine que son ami de tout ce qui lui arrive d'agréable ou
de fâcheux. C'est pourquoi le sage aura toujours les mêmes
sentiments pour les intérêts de ses amis que pour les siens, et
toutes les peines qu'il se donnerait pour se procurer des voluptés,
il n'hésitera pas à les souffrir pour en procurer à son ami. Voilà
de quelle sorte ce que nous avons dit des vertus, qu'elles sont
inséparables de la volupté, doit s'entendre aussi de l'amitié. A ce
propos, je puis rappeler les excellentes paroles d'Épicure, qui dit
à peu près en ces termes que la même doctrine qui nous a rendus
fermes contre l'appréhension d'un malheur perpétuel, ou même d'une
longue durée, nous a aussi fait voir que l'amitié est le secours le
plus assuré qu'on puisse avoir dans toute la vie. Il y a d'autres
Épicuriens qui, s'effrayant un peu trop de vos reproches, et ne
manquant pas toutefois de finesse d'esprit, semblent craindre que ce
ne soit faire boiter l'amitié que de ne lui donner d'autre prix que
celui des plaisirs qu'elle nous procure. Ils demeurent bien d'accord
que c'est l'intérêt qui forme les premiers liens et ébauche d'abord
toutes les amitiés; mais ils disent que quand l'usage les a rendues
plus étroites et plus intimes, alors la pure tendresse prend un tel
essor, qu'indépendamment de toute utilité, nous venons à aimer nos
amis uniquement pour eux-mêmes. Car si le temps et l'habitude nous
donnent de l'attachement pour les maisons, les temples, les villes,
les gymnases, et tous les lieux d'exercices, les chiens, les
chevaux, les jeux et la chasse, à combien plus forte et plus juste
raison l'habitude produira-t-elle le même effet à l'égard des
hommes! Enfin le troisième sentiment de quelques-uns des nôtres sur
l'amitié est qu'il y a une espèce de traité entre les sages, par
lequel ils s'obligent à n'aimer pas moins leurs amis qu'eux-mêmes;
ce que nous comprenons aisément qu'on peut faire et dont nous voyons
des exemples fréquents; joint à cela, qu'évidemment rien n'est plus
propre qu'une telle alliance à répandre le bonheur dans tout le
cours de la vie. Par toutes ces raisons on peut donc juger que bien
loin que ce soit détruire l'amitié, que de mettre le souverain bien
dans la volupté, il serait impossible sans la volupté qu'aucune
liaison d'amitié se formât parmi les hommes.
XXI. Ainsi donc, si ce que je viens de dire est plus clair que le
jour, si tout mon discours est puisé aux sources de la nature, s'il
est confirmé par l'autorité des sens, ces témoins sincères et
incorruptibles; si les enfants, si les animaux eux-mêmes prennent
une voix pour nous dire, sous l'inspiration de la nature, qu'il n'y
a de bonheur que dans la volupté et de misère que dans la douleur,
toutes choses dont ils jugent avec le sens le plus droit et le plus
inattaquable, quelles grâces ne devons-nous pas rendre à celui qui,
ayant entendu ce cri universel de la nature, a si bien et si
profondément compris tout ce qu'il veut dire, qu'il a ouvert à tous
les hommes d'un esprit sain le chemin d'une vie paisible,
tranquille, douce et heureuse? Épicure vous parait peu sa-
506 vant; c'est qu'il a cru qu'il
n'y avait d'autre science utile, que celle qui apprend à pouvoir
vivre heureusement. Aurait-il voulu passer le temps, comme nous
avons fait, Triarius et moi, sur votre conseil, à feuilleter les
poètes où l'on ne trouve que des amusements d'enfant et rien de
solide? Ou se serait-il épuisé comme Platon, à étudier la musique,
la géométrie, les nombres et le cours des astres, toutes sciences
qui, étant fondées sur des principes faux, ne peuvent jamais nous
conduire à la vérité, et qui, lors même qu'elles nous y
conduiraient, ne contribueraient jamais à notre bonheur, et partant
ne nous apprendraient pas à mieux vivre? Croyez-vous qu'il eût voulu
s'embarrasser de tous ces astres, et négliger l'art de la vie le
plus grand, le plus difficile, le plus fructueux de tous? Épicure
n'était donc pas ignorant, mais ceux-là le sont véritablement qui
croient que les études dont il serait honteux aux enfants de n'avoir
pas de teinture doivent faire leur unique occupation jusqu'à
l'extrême vieillesse. Vous voyez par là, ajouta-t-il, quel est mon
sentiment, et je ne m'en suis ouvert qu'afin de savoir quel est le
vôtre. Je n'avais pas encore jusqu'ici trouvé l'occasion de
m'expliquer à mon aise sur cette grande question. |