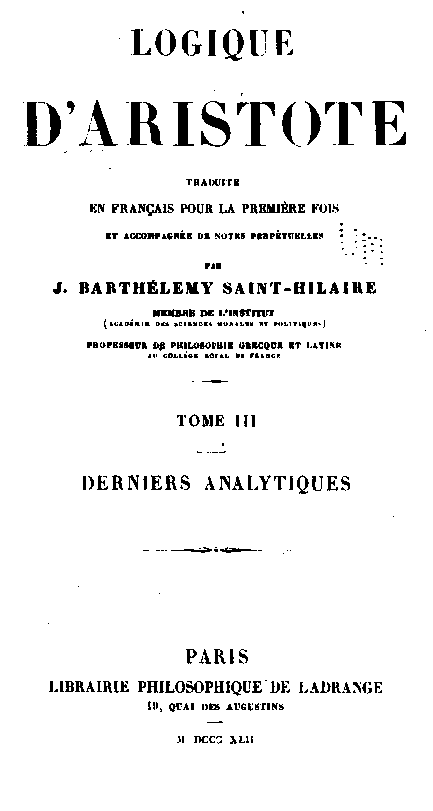
ARISTOTE
DERNIERS ANALYTIQUES.
PLAN GÉNÉRAL DES DERNIERS ANALYTIQUES.
premiers analytiques chapitre XXVII - Derniers analytiques : livre I
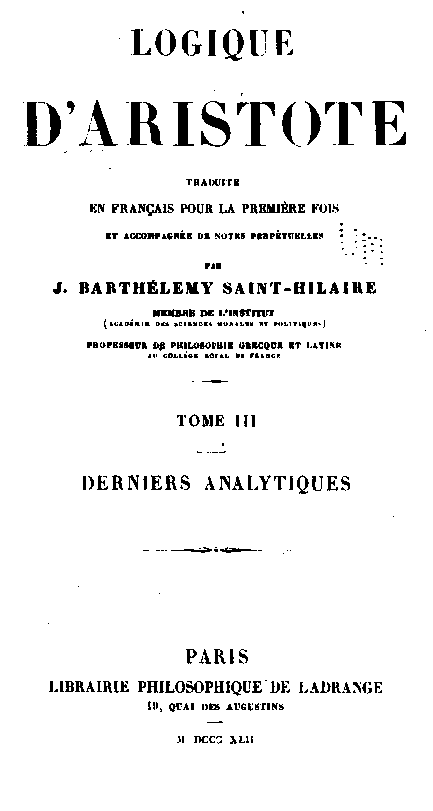
premiers analytiques chapitre XXVII - Derniers analytiques : livre I
DERNIERS ANALYTIQUES
|
I. PLAN GÉNÉRAL DES DERNIERS ANALYTIQUES.
LIVRE PREMIER.
SECTION PREMIÈRE.
POSSIBILITÉ DE LA DÉMONSTRATION.
Toute connaissance, acquise par un acte plus ou moins parfait de raisonnement, dérive toujours de connaissances antérieures à elle : toute conclusion, quelle qu'en soit d'ailleurs la vérité ou l'erreur, vient toujours de principes antérieurement connus. L'exemple de toutes les sciences sans exception est là pour l'attester. Les plus régulières de toutes, les mathématiques, n'ont pas d'autre procédé. La dialectique, tout éloignée II qu'elle semble des mathématiques, emploie aussi cette méthode : car elle ne fait que des syllogismes ou des inductions ; or le syllogisme suppose connues, soit comme évidentes, soit comme accordées, les prémisses dont il tire la conclusion : et l'induction suppose connu, comme de toute évidence, le particulier dont elle tire l'universel. La rhétorique elle-même suit la voie de la dialectique, la voie des mathématiques : car la rhétorique ne se sert que d'exemples et d'enthymèmes : et l'exemple n'est qu'une induction tout comme l'enthymême n'est qu'un syllogisme. Ces connaissances antérieures, principe de toutes celles que le raisonnement peut nous donner, ne sont que de deux espèces. C'est le sens du mot ou des mots qui expriment la chose à connaître, c'est en second lieu l'existence même de cette chose. Il faut nécessairement, quel que soit le sujet qu'on étudie, supposer ces données initiales ; et c'est en partant de celles-là qu'on peut essayer de connaître quelque attribut d'abord ignoré de ce sujet. C'est la conclusion du syllogisme qui donne cet attribut : mais la conclusion est déjà comprise implicitement dans l'universalité de la majeure ; et elle est parfaitement connue dès que la mineure vient à l'être. La majeure est, relativement à la conclusion, une connaissance antérieure, et III la mineure une connaissance en quelque sorte simultanée. C'est que l'universel contient en puissance tous les cas particuliers ; et que, du moment qu'on connaît l'universel, on connaît, du moins dans une certaine mesure, tous les cas particuliers qu'il renferme. Ainsi, quand on sait d'une manière universelle que tout triangle a la somme de ses angles égale à deux droits, on sait implicitement aussi que cette figure triangulaire qu'on voit tracée dans une demi-circonférence à la somme de ses angles égale à deux droits. C'est en vain que les sophistes le nient : Savez-vous, vous demandent-ils, que tout triangle a ses angles égaux à deux droits? Oui, répondez-vous: et alors, pour établir leur prétendue réfutation, ils vous montrent un triangle qu'ils tenaient caché, dont vous ignoriez jusque-là l'existence, et dont par suite vous ne pouviez affirmer qu'il eût ses angles égaux à deux droits. Mais on peut leur répondre: Oui, j'ignore la conclusion de science particulière, mais en même temps je la sais de science universelle : je la sais par la majeure universelle que je connais ; je l'ignore par la mineure particulière que vous me cachez. On peut donc tout à la fois savoir une chose et l'ignorer, la savoir dans un sens, l'ignorer dans un autre. Si l'on n'admet point cette solution qui est IV la vraie, il ne reste plus qu'à recourir à celle de Platon; et à croire avec Ménon que nous n'apprenons vraiment pas, et que nous ne faisons que nous ressouvenir. Platon ne nie pas absolument la science ; mais la manière dont il la conçoit ne résout rien, et surtout n'explique point comment la démonstration nous fait connaître ce que d'abord nous ne connaissions pas. Non, nous ne savons pas, dans la conclusion, uniquement ce que nous savions dans la majeure, comme l'exigerait la réminiscence : nous savons plus, et nous savons autrement. Nous savons l'un des cas particuliers renfermés sous l'universel; et nous le savons d'une façon claire et distincte, au lieu de ne savoir que l'universel, au lieu de ne savoir que confusément. Ainsi la démonstration est possible, malgré ce qu'en disent les sophistes, malgré ce que Platon a pensé du principe de la science. Il n'y aurait absurdité que si l'on prétendait que l'on sait ce que l'on apprend précisément de la façon même qu'on l'apprend.
SECTION SECONDE.
DÉFINITION
ET ÉLÉMENTS DE LA DÉMONSTRATION.
Qu'est-ce donc que la science ? Qu'est-ce donc que la démonstration? Savoir une chose, c'est en connaître la cause ; c'est connaître la cause qui fait que la chose ne peut être autrement qu'elle n'est. C'est même là l'idée commune qu'on se fait de la science : entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il n'y a point d'autre différence, si ce n'est que les uns savent cette cause, et que les autres croient seulement la savoir. Telle est la science proprement dite, la science fournie par la démonstration. Nous connaissons certaines choses autrement que par la démonstration; mais [c'est la démonstration seule qui nous donne la science. La démonstration est donc le syllogisme qui produit la science, le syllogisme qui nous fait vraiment savoir. Il s'ensuit que le syllogisme démonstratif doit partir de principes vrais, primitifs, immédiats, plus notoires que la conclusion, antérieurs, et qui sont, par rapport à elle, comme la cause est à l'effet. C'est ainsi et seulement ainsi que les principes VI seront les principes propres du démontré, et qu'il y aura démonstration. Sans ces conditions, il peut bien y avoir syllogisme, mais il n'y a pas syllogisme démonstratif. Les principes doivent être vrais, car il n'est pas possible de savoir ce qui n'est pas ; et, par exemple, on ne peut pas savoir que la diagonale est commensurable au côté. Ils doivent être primitifs et immédiats, c'est-à-dire indémontrables : car s'ils avaient un moyen terme, ils pourraient être démontrés ; et si on les démontrait, c'est qu'ils ne seraient pas des principes. Ils doivent être causes de la conclusion parce qu'on ne sait réellement que quand on connaît la cause. Ils doivent être antérieurs à la conclusion puisqu'ils en sont causes, précisément en ce qu'ils sont plus universels : l'universel qui s'adresse à l'entendement est en nature antérieur au particulier qui ne s'adresse qu'à nos sens, et qui n'est plus notoire que relativement à eux et non point en soi. Enfin si les principes sont causes de la conclusion, ils en doivent être la cause non point éloignée et médiate, mais la cause la plus prochaine, la cause propre, c'est-à-dire, la cause qui n'a pas plus d'extension que le sujet donné, et qui en est, par conséquent, la définition parfaitement adéquate. La forme de ces principes, c'est la proposition immédiate, qui n'a point au-dessus VII d'elle, en son genre, d'autre proposition ni plus évidente ni plus étendue. La proposition immédiate, qui doit servir à la démonstration, ne reste point, comme la proposition immédiate de la dialectique, indécise entre les deux termes d'une opposition qu'elle admet également. Elle se prononce pour l'un des deux termes, qu'elle nie ou qu'elle affirme en excluant toujours l'autre. La proposition immédiate du syllogisme démonstratif est un axiome quand elle est d'une telle évidence pour tous, que le maître n'a pas plus besoin de l'enseigner que l'élève n'a besoin de l'apprendre. Elle est une simple thèse, lorsque, tout en restant indémontrable, elle doit cependant être énoncée formellement, pour que la démonstration soit possible. La thèse prend le nom d'hypothèse quand elle affirme ou nie : et le nom de définition, quand, ne faisant ni l'un ni l'autre, elle explique seulement l'essence du défini, sans dire d'ailleurs que ce défini est ou n'est pas. — De tout ceci l'on peut tirer ces deux conséquences nécessaires : d'abord, que les principes, antérieurs à la conclusion dont ils sont causes, sont aussi mieux connus qu'elle, précisément parce que ce sont ceux qui nous la font connaître ; car nous croyons plus aux principes que nous ne croyons à la conclusion : en second lieu, que VIII la fausseté ou l'erreur des principes contraires est tout aussi évidente, tout aussi certaine pour nous que la vérité des principes que nous adoptons : et cette connaissance de la fausseté du syllogisme contraire, loin de détruire la science donnée par la conclusion vraie, ne fait que la rendre inébranlable. Mais, avant d'aller plus loin, il est bon de réfuter deux objections trop souvent répétées contre la science et la démonstration. On prétend d'une part qu'il n'y a point de science possible ; et d'autre part, l'on prétend que tout peut être démontré. Égale erreur, quoique erreur contraire, de l'un et de l'autre côté. Les uns accordent trop à la démonstration, les autres ne lui accordent point assez ; les uns- nient la science, les autres étendent la science bien au-delà de ses véritables limites. Répondons d'abord à nos premiers adversaires : puisque pour savoir la conclusion, disent-ils, il faut savoir les principes, ces principes ne peuvent être sus que par démonstration : il faudra donc de ces principes remonter à des principes antérieurs, et de ceux-là à d'autres ensuite, puis à d'autres encore. Alors de deux choses l'une : ou il faudrait, chose impossible, parcourir l'infini et poursuivre la vérité et la science qui recule sans cesse, sans IX qu'on la puisse jamais saisir : ou bien, si l'on atteint des principes vraiment premiers, ils sont inconnus puisqu'ils sont indémontrés ; et ces principes étant ignorés, comment pourraient-ils donner à la conclusion la clarté qu'ils n'ont pas, et y produire pour nous la science que nous ne trouvons point en eux? Donc la science est impossible soit dans la conclusion, soit dans les principes. A cette première objection, on peut répondre que toute connaissance ne vient pas de démonstration, que la science de la conclusion est bien une science démontrée : mais que la connaissance des principes est une connaissance indémontrable, et qui nous vient par un procédé tout différent de celui de la démonstration. C'est ce que nos adversaires auraient dû conclure de leur propre argument. Ils admettent, en effet, qu'on doit arriver à des principes au-delà desquels il ne soit plus possible de remonter : ils admettent en outre qu'il faut savoir ces principes pour parvenir à savoir la conclusion : donc, devraient-ils dire, la connaissance de ces principes est acquise sans démonstration. Même réponse à la seconde objection qui tombe dans l'excès opposé. Les principes, dit-on, peuvent être démontrés ; et ils le sont par la conclusion, tout comme la conclusion est démontrée par eux. X Ainsi la démonstration est circulaire : et il y a science non seulement pour la conclusion, mais aussi pour les principes. Seconde erreur non moins grave que l'autre. D'abord les principes sont indémontrables : puis à quelles conséquences absurdes n'est-on pas conduit par cette démonstration circulaire ? Si les principes se démontrent par la conclusion, comme la conclusion par les principes, il s'ensuit qu'une même chose peut être à une autre même chose, et sous un même rapport, antérieure et postérieure tout à la fois, ce qui est évidemment impossible : qu'elle est tout à la fois plus connue et moins connue qu'elle, si la définition donnée par nous de la démonstration est vraie. Il s'ensuit en outre qu'on fait une pétition de principe, et qu'on démontre alors d'une manière parfaitement vaine et stérile le même par le même ; ce qui n'est plus une démonstration. Il s'ensuit enfin qu'on méconnaît ce qu'est réellement la démonstration circulaire : on l'étend beaucoup plus qu'il ne le faut, puisque d'abord elle n'est possible que dans un seul mode d'une seule figure, ainsi qu'on l'a prouvé dans le Traité du syllogisme, et que de plus, elle n'est même possible dans ce mode unique que si le sujet et l'attribut sont réciproques, c'est-à-dire, d'extension égale ; or ce sont XI là des cas exceptionnels ; et l'on ne peut en arguer pour soutenir que la démonstration circulaire est toujours applicable. Loin de là elle ne l'est presque jamais ; et si la possibilité de la démonstration ne reposait que sur la possibilité de ce cercle, la démonstration serait, on peut dire, tout à fait détruite. Ainsi donc on peut soutenir, d'une part contre la première objection, que la démonstration existe, et contre la seconde d'autre part, qu'elle ne s'étend pas à tout : on peut soutenir contre toutes deux que la démonstration s'applique à un ordre de choses limité. Ces deux objections réfutées, continuons la théorie : Ce que l'on sait par démonstration, avons-nous dit, ne peut être autrement qu'on ne le sait : donc toute conclusion démontrée est nécessaire : car une chose est dite nécessaire quand elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est, c'est-à dire qu'elle ne peut pas ne pas être. Or si la conclusion démontrée est nécessaire, il s'ensuit évidemment que les propositions dont on la tire sont nécessaires comme elle : donc la démonstration est le syllogisme formé de prémisses nécessaires. Il n'y a démonstration vraie qu'à ce prix. Quelles sont les conditions indispensables pour qu'une proposition porte en elle le caractère de nécessité que la démonstration exige? XII Ces conditions sont au nombre de trois. Pour que l'attribut soit uni au sujet d'un lien perpétuel et indissoluble, il faut qu'il soit dit de tout le sujet : il faut qu'il soit essentiel au sujet : il faut enfin qu'il soit universel au sujet, c'est-à-dire, aussi étendu que lui, ni plus ni moins. Pour que la première condition soit remplie, il ne suffit pas que l'attribut soit dit de toutes les parties du sujet, et s'étende au sujet tout entier, à tous les individus sans exception qui composent le genre ; il faut encore qu'il leur soit attribué à tous dans tous les moments de la durée. Ainsi cette proposition est nécessaire : Tout homme est animal, non pas seulement parce que tous les hommes sont animaux, mais encore parce qu'ils le sont en tout temps, aujourd'hui comme ils l'étaient hier, comme ils le seront demain. Ainsi universalité du sujet et perpétuité de l'attribut dans le sujet, voilà ce qui constitue la première condition. La seconde condition qui rapproche l'attribut du sujet encore davantage, c'est qu'il lui soit essentiel. Essentiel à quatre sens différents dont il faut se bien rendre compte. Un attribut est essentiel quand il existe réellement dans son sujet, par l'acte même de la nature et non point par l'acte seul de notre esprit; et alors cet attribut est compris dans la définition même du XIII sujet. Ainsi quand on dit : L'homme est un animal, animal est un attribut essentiel de l'homme : car l'animal est naturellement dans l'homme ; mais quand on dit au contraire : L'animal est homme, l'attribut homme n'est point essentiel : car animal peut exister sans homme : l'homme n'est point naturellement dans l'animal, et n'est point compris dans sa définition. En second lieu, un attribut est essentiel encore, lorsque le sujet est compris dans la définition de cet attribut, au lieu que cet attribut le soit dans la définition du sujet, bien entendu toujours que l'attribut existe réellement dans le sujet. Ainsi quand on dit : Cette ligne est droite, ce nombre est impair; droite, impair, sont des attributs essentiels, d'abord parce qu'en réalité droit, impair, sont dans la ligne, dans le nombre ; et ensuite parce que si l'on veut définir droit et impair, il faut faire entrer dans la définition, ligne d'une part et nombre de l'autre. Quant aux attributs qui n'entrent point dans la définition de leurs sujets, et dans la définition desquels leurs sujets n'entrent point, ce sont des attributs accidentels et non plus essentiels. Ainsi, quand on dit : Cet animal est blanc, blanc n'est point un attribut essentiel : car il ne fait point partie de la définition d'animal, non plus qu'animal ne fait partie de la définition de blanc. En troisième XIV lieu, on dit d'une chose qu'elle est essentielle quand elle existe par elle-même et non par une autre qu'elle : elle est accidentelle, elle est un accident, quand elle n'est qu'à la condition d'une autre existence sans laquelle elle ne serait pas. Ainsi l'homme, l'arbre, le cheval sont des choses essentielles, des substances, parce qu'ils existent par eux-mêmes : blanc, vert, se promenant, sont des choses accidentelles, des accidents, parce que ces choses n'existent point par elles-mêmes, et qu'elles ne seraient point sans les êtres dans lesquels elles sont. Enfin, en quatrième lieu, un attribut peut être essentiel à son sujet tout en n'étant point réellement en lui, tout en n'entrant point dans sa définition, tout en étant séparé de lui dans la nature, s'ils ont entre eux le rapport de cause à effet. Si ce rapport n'existe point, l'attribut n'est qu'un accident. Ainsi cette proposition est accidentelle : II a tonné pendant que nous marchions ; car ce n'est pas parce que nous marchions qu'il a tonné, c'est un pur accident. Mais celle-ci est essentielle : Cet homme ayant été étranglé en est mort ; car c'est précisément parce qu'il a été étranglé qu'il est mort. Dans un cas le tonnerre est un accident à la marche ; car il aurait fort bien pu ne pas tonner : dans le second, la mort est une suite nécessaire de la XV strangulation, qui en est la cause essentielle. De ces quatre façons d'entendre le mot essentiel, les deux premières lient nécessairement le sujet à l'attribut : c'est qu'en effet les attributs qui entrent dans la définition de leurs sujets, ou dans la définition desquels entrent leurs sujets, ne peuvent pas ne pas être à ces sujets, et leur sont par conséquent nécessaires. Après ces deux premières conditions que l'attribut soit à tout le sujet et qu'il lui soit essentiel, en vient une troisième et dernière qui donne à la proposition le caractère absolu de nécessité que les deux autres ne lui donnent qu'à un moindre degré : c'est que l'attribut soit tout entier dans le sujet, qu'il y soit compris universellement, c'est-à-dire qu'il n'existe point dans des sujets autres que celui auquel il est joint. Ainsi la faculté de pouvoir rire est un attribut universel relativement à l'homme, la raison est pour lui un attribut universel : car la faculté de pouvoir rire, et la raison, non seulement sont des attributs qui appartiennent à tous les hommes et en tout temps, et qui sont essentiels à l'homme, mais ce sont en outre des attributs qui ne se trouvent point dans d'autres êtres que l'homme : il est le seul être doué de ces facultés. L'attribut universel est donc à tout le sujet, il est essentiel au sujet, et il est au sujet XVI en tant que ce sujet est ce qu'il est. La sensibilité est bien un attribut qui appartient à tous les hommes et en tout temps : c'est bien un attribut essentiel de l'homme : mais ce n'est pas un attribut universel : car elle ne lui appartient pas en tant qu'il est homme : elle lui appartient seulement en tant qu'il est animal : ce n'est pas en tant qu'homme que l'homme est sensible : c'est en tant qu'être animé : car la sensibilité se trouve dans d'autres êtres que lui. Au contraire avoir ses angles égaux à deux droits est un attribut universel relativement au triangle : car c'est en tant que triangle qu'il a la somme de ses angles égale à cette quantité, et il est la seule figure qui l'ait. D'où il suit qu'un attribut démontré est un attribut universel, quand il est à tout le sujet, et en outre au sujet qui possède immédiatement cet attribut. Ainsi avoir ses angles égaux à deux droits n'est pas un attribut universel de la figure puisqu'il y a des figures, le carré par exemple, qui n'ont pas la somme de leurs angles égale à deux droits : ce n'est pas un attribut universel du triangle équilatéral, puisque le triangle équilatéral n'est pas le premier sujet qui ait immédiatement cet attribut : avant lui et au-dessus de lui, il y a le triangle qui jouit de cette propriété : et c'est par le triangle seul que cet attribut est XVII universel. La démonstration ne s'applique réellement qu'aux attributs de ce genre : pour tous les autres, c'est une démonstration incomplète et bâtarde, parce que le sujet et l'attribut ne sont pas exactement de même dimension. Ici, il arrive souvent qu'on se trompe et qu'on prenne pour universelle une conclusion qui au fond ne l'est pas, ou qu'on ne croie pas universelle une conclusion qui l'est bien cependant. Ainsi l'on croit quelquefois que la démonstration n'est pas universelle parce qu'elle s'applique à un seul individu : elle l'est pourtant, si l'attribut démontré est joint au sujet par les rapports énumérés plus haut. La démonstration alors est universelle en tant qu'elle s'applique, non pas à ce sujet unique, mais à la nature qui est en lui et qui pourrait appartenir à tout autre individu de cette même espèce. Au contraire, la démonstration n'est pas universelle, bien qu'elle le paraisse, quand on a démontré l'attribut pour toutes les espèces et qu'on ne l'a point démontré pour le genre, qui parfois, il est vrai, n'est pas désigné par un nom spécial et qui pour ce motif échappe à la démonstration. Enfin la démonstration n'est pas davantage universelle, lorsque l'attribut est démontré de l'espèce au lieu de l'être du genre. Par exemple, ce n'est pas faire une dé- XVIII monstration universelle que de prouver que des lignes sont parallèles, parce que les angles que forme la sécante sont droits tous les deux : car elles ne sont pas parallèles parce que les angles sont droits l'un et l'autre : elles le sont d'une manière plus générale, parce que les angles formés par la sécante, quels qu'ils soient, pris séparément, équivalent, l'un et l'autre pris ensemble, à deux angles droits. Si le triangle équilatéral était la seule espèce de triangle, la démonstration qui prouverait que les angles de l' équilatéral sont égaux à deux droits n'en serait pas moins universelle, bien que le genre ne comprît ici qu'un seul individu : car cette démonstration s'appliquerait à l' équilatéral, non pas en tant qu' équilatéral, mais en tant que triangle. Enfin la démonstration n'est point universelle, si l'on démontre que des nombres, des lignes, des solides, des temps peuvent être en proportion géométrique et permutante, et si l'on ne remonte pas jusqu'au genre qui comprend toutes ces espèces, et qui est le terme supérieur auquel appartient l'attribut qu'on démontre. Même erreur, si l'on démontrait que l'équilatéral, le scalène, l'isocèle, ont la somme de leurs angles égale à deux droits, et qu'on ne le démontrât pas du triangle. Bien qu'il n'y ait pas d'autres espèces de triangles que XIX les trois dont on a démontré, la démonstration n'est point universelle parce qu'elle ne s'est point adressée au primitif. C'est qu'il faudrait pour qu'elle le fût que le triangle se confondît avec l'une de ses espèces, s'il n'en avait qu'une, ou se confondît avec toutes : or le triangle est distinct de l'une de ses espèces, comme il l'est de toutes prises ensemble ; et voilà pourquoi on n'a point démontré universellement, si l'on n'est point remonté jusqu'au triangle qui est ici le sujet primitif. Comment donc peut-on parvenir à discerner ce primitif auquel seul s'adresse la démonstration universelle ? La règle est fort simple : le primitif est, parmi tous les termes donnés, celui sans lequel la démonstration ne serait plus possible : les termes qui peuvent être retranchés sans que la démonstration soit rendue impossible, ne sont pas le primitif cherché. Soit, par exemple, une figure en airain, limitée, triangulaire, équilatérale, dont il s'agit de démontrer qu'elle a ses angles égaux à deux droits. Au milieu de tous ces termes, quel est le primitif? Ce n'est ni d'être d'airain, ni d'être équilatéral ; car on peut enlever ces deux termes et la démonstration n'en reste pas moins possible. Il est vrai qu'elle ne l'est plus si on ôte la figure, et la limite qui la constitue : mais la figure et la limite ne sont point le primitif universel: XX car toute figure n'a point ses angles égaux à deux droits. Le primitif ici, c'est le triangle, puisque c'est le seul terme qui, si on l'ôte, détruit toute démonstration. C'est à lui, et à lui seul, que s'adresse la démonstration universelle. Puis donc que la conclusion démontrée porte en elle-même un caractère d'absolue nécessité, car ce qu'on sait ne peut pas ne pas être tel qu'on le sait, il s'ensuit que les principes dont on tire cette conclusion nécessaire sont nécessaires comme elle, que les prémisses sont essentielles et universelles tout comme la conclusion. Il ne suffit pas de partir de propositions vraies : la dialectique qui ne vise qu'à la probabilité admet aussi des propositions vraies : mais il faut partir, si l'on veut démontrer, de propositions nécessaires. C'est là, parmi tous les syllogismes, la condition spéciale du syllogisme démonstratif. Voyez en effet le cours des discussions ordinaires : quand on veut réfuter une argumentation qui paraît fausse, que dit- on? que la conclusion prétendue n'est pas nécessaire. On croit donc en général, et l'on a raison malgré les assertions erronées des sophistes, qu'il ne suffit pas que les principes soient probables, ni même simplement vrais : il faut en outre qu'ils soient nécessaires. Tout attribut vrai n'est pas un attribut propre du sujet, un attribut XXI universel de même extension que lui : et sans cette condition indispensable, la démonstration n'est pas possible. Veut- on de nouvelles preuves que les principes de la démonstration doivent être nécessaires? En voici deux qui sont décisives. La conclusion a beau être nécessaire, quand on ne la sait pas par un moyen terme nécessaire comme elle, on ne la sait point par sa cause : on ne la sait point de cette science qui est le résultat de la vraie démonstration : donc cette démonstration n'en est point une au fond, puisqu'elle n'a point donné la véritable science, la connaissance de l'attribut par la cause même de cet attribut. Le moyen terme dont on s'est servi n'étant point nécessaire peut ne pas être : la conclusion au contraire étant nécessaire, c'est-à-dire étant toujours, et l'effet ne pouvant exister sans la cause qui le produit, il s'ensuit que le terme moyen n'est pas la cause de la conclusion, et que par conséquent il ne fait point savoir dans le sens propre où l'on entend ici ce mot. Ce n'est pas à dire que de principes non nécessaires, on ne puisse tirer aussi une conclusion nécessaire, comme de principes faux on tire une conclusion vraie : mais ce n'est point une démonstration. En second lieu, on doit accorder que la science subsiste tant que subsistent à la fois, et l'esprit qui XXII sait, et la chose qui est sue, et la raison par laquelle elle est sue : or puisque le moyen n'est pas nécessaire, on peut supposer qu'il n'est pas : et du moment qu'il n'est pas, la science qu'il donne disparaît avec lui. Pourtant les trois conditions essentielles de la science sont demeurées intactes, l'esprit, la chose, la raison. Si donc on ne sait pas après que le moyen terme a cessé d'être, c'est qu'on ne savait pas davantage lorsqu'il était : ce moyen terme n'était point le véritable, car il n'était pas nécessaire. — On peut donc établir comme principes certains : 1° que la conclusion peut être nécessaire sans que le moyen terme le soit, si l'on ne regarde qu'à la forme même du syllogisme : que quand les prémisses sont nécessaires la conclusion l'est toujours, de même que de prémisses vraies on ne peut tirer jamais qu'une conclusion vraie : que quand la conclusion n'est pas nécessaire, les prémisses ne le sont pas plus qu'elle ; mais qu'au point de vue de la démonstration, il faut toujours que le moyen terme soit nécessaire. 2° Qu'il n'y a point de démonstration pour les accidents proprement dits, puisque pouvant être ou ne pas être indifféremment, ils sont impuissants à fournir jamais une conclusion nécessaire. Aussi les syllogismes qui emploient ces attributs accidentels sont-ils abandonnés à la XXIII vaine subtilité de la dialectique. Le dialecticien ne recherche pas le vrai : il recherche seulement la victoire : il s'attache uniquement à cette nécessité apparente qui, de propositions d'abord admises, contraint l'interlocuteur à admettre la conclusion qui en sort : il ne s'inquiète en rien de cette nécessité des choses, de cette nécessité de nature, de matière et non plus de forme, que poursuit celui qui démontre. Le dialecticien ne prétend pas du tout prouver qu'en réalité le moyen terme dont il se sert soit la cause de l'attribut qu'il force son adversaire à conclure : il veut l'amener seulement à conclure cet attribut, vrai ou faux, des prémisses antérieurement établies. — En résumé, on doit tirer de la discussion qui précède ces deux conséquences : d'abord que la démonstration ne peut employer que des attributs nécessaires, c'est-à-dire, essentiels et universels, et qu'elle laisse de 'côté les attributs accidentels précisément parce qu'ils ne sont pas nécessaires : ensuite, qu'elle ne se contente pas d'une seule prémisse essentielle et nécessaire, mais qu'elle exige que toutes les deux le soient, et que le majeur soit au moyen essentiellement et universellement de même que le moyen est, à ces deux titres également, l'attribut du mineur. Telles sont donc les conditions sans lesquelles XXIV la démonstration ne saurait exister : telles sont les formes de toute véritable démonstration. Voyons maintenant quelles propriétés sont la suite nécessaire de ces conditions. L'une des premières et des plus remarquables, c'est que la conclusion et les principes dont on la tire doivent être du même genre, de la même espèce de science : il n'est pas possible, par exemple, de démontrer une conclusion d'arithmétique par des principes de géométrie. Toute démonstration en effet se compose, comme tout syllogisme, de trois termes ni plus ni moins : d'abord l'attribut que l'on démontre, puis les axiomes, principes ou termes moyens par lesquels on le démontre, puis enfin le sujet spécial dont on le démontre; le sujet, le moyen et l'attribut étant d'ailleurs liés les uns aux autres par ces rapports intimes que nous venons d'indiquer. De ces trois termes, quels sont ceux qui peuvent passer indifféremment d'une science à une autre? ou quels sont ceux qui demeurent invariablement dans la science à laquelle ils appartiennent, sans pouvoir jamais servir à une autre science ? Il est évident, en premier lieu, que le sujet ne peut en aucune façon passer à une science différente de celle dans laquelle il est. Le sujet est précisément ce qui constitue la science ; sans lui, elle n'est rien : sans XXV lui, elle n'existe pas : le sujet reste donc à la science spéciale qu'il fait : et ne peut en être isolé même par la pensée : le nombre reste invariablement à l'arithmétique, l'étendue à la géométrie. Il n'y a donc que le moyen terme et l'attribut pour lesquels cette transition ne serait pas impossible. Il est vrai que parfois le moyen terme peut être le même dans deux sciences différentes : mais c'est dans un cas tout spécial ; c'est celui où les sciences sont subordonnées l'une à l'autre, et où elles ont par conséquent un sujet identique : la science supérieure relevant directement de ce sujet ; la science inférieure s'y rattachant médiatement. Dans toutes les sciences qui n'ont point ce rapport entre elles, il n'est pas possible que les termes moyens, les principes de l'une deviennent les principes de l'autre, attendu que le sujet de l'une est tout à fait différent du sujet de l'autre. S'il semble parfois que l'on traite des questions de géométrie par des principes d'arithmétique, c'est qu'alors les grandeurs cessent d'être considérées comme grandeurs, et qu'elles sont considérées comme nombres : mais au fond, la géométrie ne peut pas plus résoudre des questions d'arithmétique qu'elle ne résout des questions de métaphysique. La géométrie peut résoudre des questions de perspective parce que la perspective est une XXVI science inférieure qui emprunte son sujet et par suite ses principes à la géométrie. De même la musique emprunte ses principes à l'arithmétique et lui emprunte en partie son sujet, puisque le sujet de la musique est le nombre considéré dans les sons : on peut résoudre des problèmes de musique par l'arithmétique. Ainsi, ni le sujet, ni même le moyen, ne peuvent passer d'un genre à un autre. L'attribut ne le peut pas davantage : car l'attribut étant essentiel au sujet, y étant contenu tout entier, lui est propre et ne peut être attribué à un sujet différent dans une science différente. Voilà pourquoi ce n'est point au géomètre de démontrer certains attributs des lignes, quand ces attributs ne sont point aux lignes en tant que lignes, seul aspect sous lequel le géomètre puisse les étudier. La ligne droite est-elle la plus belle des lignes? La ligne droite est-elle contraire à la circonférence? Ce sont là des questions qui ne regardent point la géométrie : car la beauté, la contrariété, n'appartiennent point à la ligne en tant que ligne. Ce sont des attributs communs de l'être : et c'est à la science qui étudie l'être, à la métaphysique, et non point à la géométrie, qu'il appartient de les démontrer. Donc en résumé, sujet, moyen et attribut sont toujours tous les trois d'un seul et même XXVII genre, toujours dans une seule et même science. Une autre propriété non moins importante de la démonstration, c'est qu'elle s'applique à des choses éternelles et qu'elle ne s'applique qu'à celles-là. Du moment que le syllogisme est formé de propositions marquées du caractère de nécessité que nous avons dit, il s'ensuit que la conclusion est nécessaire, qu'elle ne peut pas ne pas être, qu'elle est éternelle. L'attribut qu'elle démontre appartient au sujet dans tous les moments de la durée. Par suite, on doit dire que pour les choses périssables, qui naissent et qui meurent suivant le cours ordinaire de la nature, il n'y a point de démonstration, il n'y a point de science proprement dite. Pour ces choses-là, il n'y a qu'une science d'accident, particulière, transitoire. C'est que jamais pour elles l'attribut n'est démontré dans son universalité : il est démontré pour une partie de son sujet et non pour le sujet tout entier : il est démontré pour un certain moment de la durée, non pour la totalité du temps. Quand la conclusion démontrée n'est point éternelle, c'est que l'une des prémisses tout au moins ne l'est pas non plus. La caducité de l'une des propositions est passée jusqu'à elle. Si la conclusion n'est point universelle, c'est que l'une des prémisses est particulière. On peut ajouter que cette XXVIII marque d'éternité n'appartient pas seulement à la démonstration, et que les définitions la possèdent aussi. Toute définition en effet est ou un principe de démonstration, ou une démonstration complète dont les termes parfaitement identiques ne diffèrent que par la position, ou enfin une conclusion de démonstration. Donc la définition est éternelle comme la démonstration : donc elle ne concerne pas plus qu'elle les choses périssables. Mais, dira-t-on, est-ce que la démonstration ne s'applique pas aussi à des choses qui tantôt sont et tantôt ne sont point, à des phénomènes qui se répètent souvent, mais qui ne sont pas de durée éternelle, les éclipses par exemple? A cela on peut répondre : la démonstration s'adresse non à telle éclipse en particulier, non pas même à toutes les éclipses observées, mais à l'éclipse prise d'une manière universelle : et en ce sens on peut dire que l'éclipse est d'essence éternelle, puisqu'elle est toujours la privation de lumière pour le corps éclairé par l'interposition d'un corps opaque entre lui et le corps éclairant. Donc la démonstration ne s'applique réellement qu'aux choses éternelles. Voici encore une propriété nouvelle de la démonstration : si l'attribut appartient essentiellement au sujet, en tant que le sujet est ce qu'il XXIX est, il s'ensuit que les principes par lesquels l'attribut est démontré, sont ses principes propres, et qu'ils ne peuvent pas plus être des principes communs qu'ils ne peuvent être des principes étrangers. Les principes dont on se sert ont beau être vrais, immédiats, indémontrables, ils ne donnent pas la science s'ils ne sont pas spéciaux. Avec des principes communs, on arrive à des démonstrations aussi vaines que celle par laquelle Bryson prétendait prouver la quadrature du cercle. Le moyen terme qu'on emploie alors peut tout aussi bien démontrer l'attribut pour tout autre sujet : or ce n'est pas là savoir : car on ne sait vraiment l'attribut que quand on le sait relativement au sujet auquel il est essentiel, et par la cause propre qui fait que cet attribut est à ce sujet. Quand deux ou plusieurs sciences sont subordonnées, les principes peuvent bien être communs entre elles ; mais ils ne démontrent pas tout à fait de même dans l'une et dans l'autre. Dans la science inférieure, ils démontrent le simple fait : dans la science supérieure, ils démontrent la cause, parce que ce n'est que dans la science supérieure que l'attribut est vraiment essentiel au sujet. De ce que les principes par lesquels on démontre, ne peuvent être des principes communs ou étrangers, de ce qu'ils doivent XXX être des principes propres, il résulte que les principes de chaque science ne peuvent être démontrés dans cette science même. La métaphysique elle-même ne peut s'introduire dans les sciences particulières pour leur donner l'explication des principes qu'elles emploient : elle est bien la science par excellence, .la science souveraine et mère de toutes les autres : c'est bien elle qui peut rendre compte de tous les principes des sciences spéciales, parce qu'elle est la seule qui étudie vraiment les premiers principes. Mais la métaphysique elle-même ne peut abaisser cette barrière infranchissable qui sépare une science d'une autre science . Les explications qu'elle donne des principes, elle doit les garder pour elle; elle ne doit point les faire descendre dans les autres sciences, qui ne sont qu'à la condition d'accepter leurs principes comme indémontrables. Si donc la métaphysique démontre les principes de la géométrie, ce n'est pas en géométrie, c'est en métaphysique. Du reste, c'est toujours un point fort difficile de savoir si l'on a fait une véritable démonstration, parce qu'il est toujours fort difficile de savoir si l'on est bien remonté aux principes propres de la question. Le seul moyen de s'assurer qu'on les a atteints, c'est de voir si l'attribut et le moyen terme sont du même genre que le sujet. XXXI Puisque les principes sont indémontrables dans la science même qui les emploie, il s'ensuit qu'on doit les admettre comme antérieurement connus. On sait d'abord le sens des mots qui les expriment; et de plus, on suppose sans démonstration qu'ils existent. Pour les conclusions au contraire, leur vérité peut et doit être démontrée : la seule connaissance préalable pour elles est celle du sens des mots, qu'il faut comprendre pour les conclusions comme pour les principes. Les principes se partagent en deux espèces, principes propres et principes communs. Mais les principes communs dont il s'agit ici ne le sont que dans la mesure même où le sujet en question en a besoin. Les principes communs, pour être de quelque valeur, doivent se restreindre; il faut qu'ils perdent leur généralité, et s'ajustent en quelque sorte à l'étendue du sujet qu'on traite. Ainsi l'arithmétique et la géométrie font usage l'une et l'autre de ce principe commun, que si, à des quantités égales, on ôte ou on ajoute une quantité égale, ces quantités restent encore égales ; mais la première emploie ce principe en le restreignant au nombre, et la seconde l'emploie en le restreignant à l'étendue. Les principes propres sont les termes, dont la définition et l'existence étant admises tout d'abord, on cherche les XXXII attributs essentiels. Le nombre en arithmétique, la ligne en géométrie, voilà des principes propres et indémontrables : pair et impair, droit ou courbe, commensurable ou incommensurable, voilà des attributs essentiels dont on suppose la définition primitivement connue, mais qu'il faut démontrer pour les sujets auxquels ils appartiennent. Enfin, pour démontrer ces attributs de ces sujets, on a recours à des principes communs qu'on renferme dans les limites mêmes de la science spéciale dont on s'occupe. Il y a donc dans toute science obtenue par démonstration trois éléments : le sujet dont on cherche les attributs, les principes communs au moyen desquels on démontre les attributs, puis enfin les attributs qu'on démontre. Il n'est pas d'ailleurs toujours nécessaire d'exprimer formellement les hypothèses que l'on est obligé de faire. Quand l'existence et la définition du sujet sont parfaitement connues, quand la définition de l'attribut l'est également, quand le sens du principe commun qui sert de moyen terme est de toute évidence, il n'est pas besoin de les rappeler ou de les expliquer. C'est qu'en effet, il serait fort inutile de présenter comme hypothèse ou comme postulat, ce qui de soi est nécessaire et doit paraître tel à tous. La démonstration s'adresse bien XXXIII plus encore à la parole intérieure qu'à la parole du dehors. L'adversaire, quand il n'est pas de bonne foi, peut toujours opposer quelques objections aux démonstrations même les plus claires et les plus certaines. Mais dans son for intérieur, il est contraint de les admettre, de les subir. C'est sur ces concessions tacites, irrésistibles, que s'appuie surtout la démonstration. Parfois on peut aussi se dispenser de démontrer des choses qui seraient cependant fort démontrables, quand l'interlocuteur ou l'élève les admet sans aucune résistance : c'est alors une hypothèse. Mais quand il y a quelque opposition de la part de l'interlocuteur, c'est un postulat qu'on est obligé de faire, c'est une concession qu'on lui demande et qu'il accorde seulement à titre provisoire. Il ne faut pas confondre la définition avec l'hypothèse ; car, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, la définition n'est point comme l'hypothèse une proposition en forme, puisqu'elle ne nie point, n'affirme point. De la définition on ne peut tirer une conclusion, tandis qu'on en tire une de l'hypothèse. On aurait tort d'ailleurs de contester au géomètre ses hypothèses et de les accuser de fausseté. Il sait bien que la ligne qu'il trace n'est pas droite, quoiqu'il l'appelle droite ; qu'elle n'a point un pied de long, bien XXXIV qu'il lui suppose cette longueur : aussi ne conclut-il rien de la forme ou de la dimension réelles de ces figures; il ne conclut que par les vérités incontestables que ces figures représentent et révèlent. Les principes communs ne sont point des idées platoniciennes, en dehors et indépendantes des individus, antérieures et supérieures aux individus, qui, sans elles, seraient incompréhensibles et indémontrables. L'universel qui fournit le moyen terme, c'est-à-dire la démonstration même, n'est point une unité isolée et par conséquent sans réalité. C'est un terme applicable à chacun des individus, qui se retrouve tout entier dans tous, mais qui ne serait rien sans eux. C'est en ce sens que les principes communs entrent dans toutes les sciences, se pliant aux besoins et aux limites de chacune, mais n'existant point indépendamment d'elles. Du reste, les sciences n'ont que faire, en général, d'exprimer formellement ces principes communs, ces axiomes sur lesquels se fondent les démonstrations. Prenons pour exemples les deux principes de contradiction ; l'un négatif : On ne peut nier et affirmer à la fois une même chose; l'autre affirmatif : De toute chose, il faut nier ou affirmer. Quelle est la démonstration qui pose jamais cet axiome, et XXXV qui s'inquiète de l'exprimer? Aucune; ou du moins on ne fait entrer dans la démonstration les deux parties de la contradiction, que lorsqu'on veut donner à la conclusion cette forme même, et qu'on doit conclure, par exemple, que telle chose a tel attribut, et qu'elle n'a pas l'attribut contraire. Il suffit alors de placer la contradiction au grand extrême, puisqu'il doit se retrouver sous cette forme dans la conclusion : il serait fort inutile de la placer, soit au petit extrême, soit au moyen terme. Ainsi, par exemple, si j'ai à démontrer que Callias est un être animé et non un être inanimé, je ne mettrai la contradiction qu'au majeur. L'homme est un être animé et non un être inanimé ; or Callias est homme ; donc Callias est un être animé et non un être inanimé. La contradiction accompagne le majeur, comme on le voit ; elle serait inutile au mineur ou au terme moyen. Quant au principe affirmatif de contradiction, il n'y a que la démonstration par réduction à l'absurde qui en fasse usage ; et, le plus souvent, cette démonstration même ne l'emploie qu'en le restreignant au sujet en question, c'est-à-dire, en lui ôtant sa généralité. Ces principes communs sont donc, on peut dire, le lien de toutes les sciences entre elles : chacune les emprunte dans la mesure qui lui est propre, et XXXVI par là elles communiquent toutes les unes avec les autres. Les sujets, les attributs de chacune restent distincts, séparés ; mais les moyens termes sont en quelque sorte à toutes. Ce dont on démontre et ce qu'on démontre est spécial : ce par quoi l'on démontre devient commun. Mais ces moyens termes de nouvelle espèce n'entrent pas dans la démonstration ; ils restent en dehors, bien que ce soit en eux qu'elle puise toute sa force. C'est là ce qui fait que la dialectique qui accepte ces principes communs dans toute leur étendue,et que cette autre science supérieure, la métaphysique, qui les étudie et en rend compte, s'appliquent à toutes les sciences particulières sans exception. La dialectique est utile à toutes, précisément parce qu'elle ne se borne point comme elles à un genre, à un sujet spécial. Les deux faces de la question lui sont également indifférentes; aussi procède-t-elle par interrogations, adoptant, comme on l'a vu dans le Traité du syllogisme, l'une ou l'autre réponse au gré de l'interlocuteur : bien éloignée en cela de la démonstration qui, elle, adopte une seule des deux parties de la contradiction, s'y attache, et ne la quitte qu'après en avoir prouvé l'erreur ou la vérité. D'ailleurs, la dialectique n'est pas seule à faire usage de l'interrogation : la démonstration peut XXXVII procéder aussi par cette méthode, et les questions qu'elle fait peuvent produire la science tout aussi bien que les propositions syllogistiques. Chaque science particulière a des questions qui lui sont propres, tout comme elle a des principes qui ne sont qu'à elle. Toute question indistinctement n'est pas géométrique, n'est pas médicale. Les seules questions géométriques sont celles dont on peut tirer une conclusion géométrique : il n'y a de questions médicales que celles dont on peut tirer une conclusion médicale. Et de même pour toutes les autres sciences. Ces questions posées ainsi dans chaque science peuvent être ou des principes, et alors il n'y a point à en rendre compte, il n'y a qu'à obtenir l'assentiment de celui qu'on interroge ; ou bien des conséquences de démonstrations antérieures, et alors il faut au besoin les expliquer et les éclaircir par ces démonstrations mêmes. Ainsi donc toute question n'est pas permise dans une science quelconque, et l'on ne doit répondre qu'aux questions vraiment spéciales. Les autres étant en dehors du sujet même que l'on discute, il faut s'abstenir de les faire ; ou si elles sont faites par l'interlocuteur, il faut s'abstenir d'y répondre. Il y a donc, en géométrie par exemple, des questions qui sont géométriques, et d'autres qui ne le sont pas. Mais XXXVIII ces questions erronées peuvent être de deux espèces, ou fausses dans la science dont on s'occupe, ou complètement étrangères à cette science, qui ne peut alors les admettre à aucun titre et qui les renvoie à une science différente. Ainsi une question de musique n'est pas une question géométrique parce qu'elle est tout à fait en dehors de la géométrie. Mais demander si les parallèles se rencontrent, c'est une question qui en un sens n'est pas géométrique, et qui en un sens l'est bien aussi cependant ; car elle pose un principe de géométrie, faux si l'on veut, mais qui n'appartient qu'à cette science, et non point à une autre. L'ignorance peut donc être double. Dans le premier cas, l'ignorance ne nie point le genre en question : elle ne le connaît pas : elle s'adresse seulement à un autre ; dans le second cas, elle admet le genre : mais elle le contredit : elle soutient dans ce genre le faux au lieu de s'adresser au vrai. C'est en partant de principes erronés et contraires aux principes vrais, que l'ignorance arrive à la conclusion fausse qu'elle soutient. Le syllogisme de l'erreur peut pécher par le fond, ou pécher par la forme : par le fond, lorsque le moyen terme qui est répété deux fois dans les prémisses est pris ici dans un sens et là dans un autre : par la forme, lorsque XXXIX les propositions ne sont pas établies d'après les règles ordinaires du syllogisme. C'est donc à l'aide de termes équivoques que la première espèce d'erreur est le plus souvent commise. Les sciences mathématiques y tombent rarement : mais la dialectique, moins précise qu'elles, et qui d'ailleurs n'a point le secours du dessin et des figures, admet souvent l'équivoque sans même s'en rendre compte. Les vices de forme les plus fréquents sont de faire des syllogismes, ou avec deux propositions particulières, ce qui est interdit dans toutes les figures, ou avec deux affirmatives dans la seconde, ce qui est également impossible. Il faut remarquer cependant que ces derniers syllogismes, s'ils ne concluent pas sous le rapport de la forme, peuvent conclure quelquefois sous le rapport de la matière : et c'est lorsque les termes sont réciproques ; car alors on peut passer de la seconde figure à la première par la conversion simple de la majeure ; et l'on sait que, dans la première figure, on peut obtenir une conclusion régulière avec deux prémisses affirmatives. Les paralogismes concluants dans la seconde figure donnent donc une conclusion vraie tout en partant de principes faux. C'est qu'en effet de la vérité de la conclusion on ne peut pas affirmer la vérité des prémisses, comme de la vérité des pré- XL misses on affirme la vérité de la conclusion. Ce qui donne tant de certitude aux mathématiques, c'est que n'admettant que des définitions et non point des accidents pour moyens termes, elles peuvent remonter de la conclusion aux principes avec presque autant de sûreté qu'elles descendent des principes à la conclusion. La dialectique ne fait rien de pareil : pour prouver un seul et même attribut, elle a recours à plusieurs termes moyens qu'elle prend entre cet attribut et le sujet : la démonstration, au contraire, prend la première conclusion qu'elle obtient pour en faire une prémisse dans un nouveau syllogisme, et enchaîne ainsi d'une manière continue les syllogismes les uns aux autres. La dernière conclusion dépend alors de toutes les conclusions précédentes. La démonstration, quand elle remplit toutes les conditions requises, donne donc la connaissance, non point du simple fait, mais de la cause : elle n'apprend pas seulement que la chose est ; elle apprend aussi pourquoi elle est. Mais il suffit qu'une seule des conditions vienne à manquer, pour que la démonstration n'apprenne que le simple fait et non plus la cause. Si, par exemple, la majeure n'est pas immédiate, la conclusion fait bien connaître l'existence de la chose, mais elle n'en fait pas connaître le pourquoi. Il en est en- XLI core de même si, au lieu de la cause, on a pris l'effet pour moyen terme ; et c'est ce qui a lieu ordinairement quand l'effet est plus notoire, plus facile à connaître que la cause qui le produit. Soit, par exemple, cette démonstration astronomique : Un corps lumineux qui ne scintille pas est proche ; or les planètes ne scintillent pas ; donc les planètes sont proches. Que nous apprend cette démonstration? Un simple fait, à savoir : que les planètes sont proches ; mais elle ne nous dit pas la cause de ce fait : car ce n'est pas l'absence de scintillation qui fait que les planètes sont proches ; c'est, au contraire, parce qu'elles sont proches qu'elles ne scintillent pas. Mais avec les mêmes termes, et seulement en convertissant la majeure, on peut obtenir une véritable démonstration, dont la conclusion dira non pas seulement que la chose est, mais pourquoi elle est : Tout corps lumineux' qui est proche ne scintille pas ; or les planètes sont proches ; donc les planètes ne scintillent pas. Et pourquoi ne scintillent-elles pas? C'est qu'elles sont proches. Ici donc on a la science de la cause, et non pas, comme tout à l'heure, la science du simple fait. On savait tout à l'heure que les planètes étaient proches sans savoir pourquoi : ici l'on sait qu'elles ne scintillent pas, et pourquoi elles ne scintillent XLII pas : c'est qu'on a pris pour moyen terme la cause vraie du phénomène, la cause adéquate, et que la conclusion à la suite de telles prémisses a donné la science vraie, complète, absolue, la science par la cause. Mêmes remarques sur les démonstrations relatives à la rondeur et aux phases de la lune. Si l'on dit: Tout astre qui reçoit sa lumière par phases successives est rond ; or la lune reçoit successivement sa lumière du soleil ; donc la lune est ronde, on sait seulement que la lune est ronde : c'est un simple fait ; car ce n'est pas parce qu'elle reçoit successivement sa lumière du soleil qu'elle est ronde. Mais si l'on dit au contraire : Tout corps rond reçoit successivement sa lumière d'un autre corps lumineux ; or la lune est ronde ; donc la lune reçoit sa lumière du soleil par phases successives, on sait alors la cause de ces phases de la lune : car c'est parce qu'elle est ronde qu'elle reçoit ainsi la lumière ; et ce n'est pas du tout parce qu'elle reçoit ainsi sa lumière qu'elle est ronde. Ainsi donc, quand on prend pour moyen terme l'effet, qui est plus connu que sa cause, on sait l'existence de la chose et non point la cause de la chose. On sait que la chose est, on ne sait pourquoi elle est. On n'a point fait une véritable démonstration. On n'en fait point davantage, lorsque la XLIII cause prise pour moyen terme est une cause éloignée, au lieu d'être la cause immédiate, la cause adéquate. Si l'on dit, par exemple : Ce qui n'est point animal ne respire pas ; or un mur n'est point animal ; donc un mur ne respire pas, on sait par cette conclusion un simple fait, on ne sait point par la cause ; car la .cause qu'on a choisie n'est pas la cause immédiate : c'est une cause fort éloignée. Si en effet n'être point animal était la cause vraie qui fait qu'on ne respire pas, il s'ensuivrait qu'il suffit d'être animal pour respirer : or cela n'est pas, puisqu'il y a des animaux qui ne respirent pas : donc n'être point animal n'est point la cause de l'absence de respiration. Du reste ces démonstrations bâtardes ont lieu dans la seconde figure et non plus dans la première : Tout ce qui respire est animal : or aucun mur n'est animal : donc aucun mur ne respire. La cause est dans ce cas beaucoup plus étendue que l'effet qu'elle démontre : on est allé chercher le moyen terme beaucoup trop loin, et cela ressemble à ce mot d'Anacharsis, à qui l'on demandait s'il y avait des joueuses de flûte en Scythie : Non, répondit-il, parce qu'il n'y a point de vignes. Il est bien vrai que sans vignes il n'y aurait point devin, sans vin point d'ivresse, sans ivresse point d'orgies, où les joueuses de flûte font retentir XLIV les sons corrupteurs de leurs instruments: mais la cause indiquée par Anacharsis n'est pas la vraie; car on peut fort bien avoir du vin sans ivresse et sans orgies. — On voit donc maintenant quelles sont les différences dans une seule et même science, de la démonstration du simple fait, et de la démonstration par la cause. Mais il arrive aussi que ces deux démonstrations, au lieu d'être dans une même science, sont dans des sciences distinctes; et que telle science donne le simple fait, tandis qu'une autre donne l'explication et la cause. C'est la science supérieure qui donne la cause : la science subordonnée et inférieure se contente de recueillir le simple fait. Tel est le rapport de l'optique à la géométrie, de la mécanique à la stéréométrie, de la météorologie à l'astronomie. La science supérieure peut ignorer les faits ; elle n'en donne pas moins la cause; car on peut savoir l'universel, et ne savoir pas tous les cas particuliers. La science inférieure sait les faits que la sensibilité lui révèle ; mais elle ne s'élève pas à l'abstraction qui est le seul aliment de l'autre. Les mathématiques ne s'attachent en effet qu'à des abstractions, à des formes pures : leur objet n'est point réel, n'est point sensible. Souvent aussi les deux sciences qui donnent, l'une le fait et l'autre la cause, n'ont entre elles aucun XLV rapport de subordination et de supériorité. Le médecin observe, par exemple, que les plaies circulaires sont les plus lentes à guérir; mais c'est au géomètre de lui dire pourquoi elles se guérissent moins vite que les plaies allongées. Le médecin aussi peut bien le savoir : mais ce n'est point en tant que médecin : c'est en tant que géomètre. La médecine n'est point cependant subordonnée à la géométrie ; mais il est dans la nature des choses qu'un fait observé par l'une ne soit explicable que par l'autre. Il suit de tout ce qui précède que, parmi les figures du syllogisme, c'est la première, dans son premier mode, qui est la plus propre à la démonstration. C'est la plus scientifique de toutes, et il est facile de s'en convaincre. D'abord on peut remarquer que les sciences mathématiques, et en général toutes les sciences qui recherchent et démontrent les causes, se servent de cette figure presque exclusivement : de plus, c'est dans cette figure, ainsi qu'on vient de le voir, que se forme le syllogisme de la cause proprement dite : puis, c'est par cette figure, et cette figure seulement, qu'on peut chercher la définition dont la démonstration ne saurait se passer : or toute définition est affirmative et universelle, en tant qu'on la rapporte au défini : et la seconde figure XLVI n'est jamais affirmative, la troisième jamais universelle ; enfin, la première figure se suffit à elle-même : les deux autres, au contraire, ont besoin d'elle pour remonter de leurs propositions médiates aux vraies propositions immédiates, aux vrais principes. A tous ces titres, la première figure du syllogisme est donc la figure principale de la démonstration, de la science. Il ne faut point aller cependant jusqu'à croire qu'elle soit la seule. On vient de voir en effet que, certaines démonstrations ont lieu dans la seconde figure. Et cela se comprend sans peine; c'est que de même qu'il y a des propositions affirmatives immédiates, il y aussi des propositions négatives immédiates; et alors la démonstration peut se former avec des propositions universelles et négatives dans la seconde figure, qui n'a point, comme on sait, de conclusion affirmative. Mais à quelle condition une proposition négative peut-elle être immédiate ? D'abord, quand on dit qu'une proposition de qualité quelconque est immédiate, cela signifie qu'il n'y a pas d'intermédiaire possible entre les deux termes qui la composent ; car s'il y a un intermédiaire entre eux, cet intermédiaire peut servir à démontrer l'un des termes de l'autre, soit affirmativement, soit négativement; et dans ce cas, il n'y a plus de XLVII proposition immédiate, il n'y a qu'une proposition démontrable. Or cet intermédiaire, quand il existe, est toujours un genre sous lequel est compris, soit l'attribut, soit le sujet ; ou même l'un et l'autre à la fois peuvent être compris chacun sous un genre séparé ; et alors c'est ce genre qui sert de moyen terme pour démontrer négativement que l'attribut n'est pas au sujet. Il s'ensuit que, du moment que l'attribut ou le sujet est compris sous un genre, il n'y a plus de proposition immédiate possible. Il se forme alors un syllogisme régulier, complet, avec une conclusion démontrée, dans le premier ou le second mode de la seconde figure, toujours convertibles, comme on s'en souvient, dans le second mode de la première. Même remarque, si le sujet et l'attribut sont tous deux à la fois des espèces sans qu'aucun des deux soit un genre. Mais alors il faut que les deux genres dont ils relèvent ne puissent jamais se confondre : et c'est ce qui arrive précisément aux catégories. Elles forment entre elles des séries parallèles dont les degrés se suivent, mais ne se mêlent jamais. Aucun des termes de l'une ne peut entrer dans l'autre : la qualité ne peut jamais devenir substance, non plus que la quantité ne peut devenir relation. La proposition négative ne pouvant être immédiate quand l'un XLVIII des deux termes est une espèce, ou quand ils le sont tous deux, il faut, pour qu'elle le devienne, que ni l'un ni l'autre ne le soit. Il faut donc que tous deux soient des genres : car alors la proposition qu'ils forment ne peut être démontrée, puisque, entre le sujet et l'attribut, il n'y a pas de moyen terme possible.
SECTION TROISIÈME.
DE L'IGNORANCE
OPPOSÉE A LA SCIENCE DÉMONSTRATIVE.
Le but que poursuit la démonstration, aussi bien que la base sur laquelle elle repose, c'est la vérité, c'est la science. Vérité dans les conclusions, vérité dans les principes, voilà ce qu'elle cherche, voilà ce qui la constitue ; mais elle ne l'obtient pas toujours. L'erreur, malgré les efforts de l'entendement, se glisse dans le domaine de la science, et en attaque l'origine aussi bien que le terme. Les principes et les conclusions peuvent être fausses. Les propositions immédiates peuvent être erronées : les propositions démontrables peuvent l'être comme elles. Quant XLIX aux principes, l'erreur peut être de deux sortes : ou elle se borne à nier le vrai, à affirmer le faux, sans employer le syllogisme : alors elle se contente d'opposer principe à principe, proposition immédiate à proposition immédiate ; mais elle ne raisonne pas : ou bien elle fait usage du raisonnement, et s'égare par la route même qui devrait la mener au vrai. Quand l'erreur s'abstient du syllogisme, elle est simple ; sa forme est toujours la même : la proposition qu'elle adopte est fausse, et ne peut l'être que d'une seule façon, soit d'ailleurs qu'elle affirme, soit qu'elle nie. Au contraire, quand l'erreur a recours au syllogisme, la forme qu'elle revêt peut être multiple. En effet, quand la conclusion est fausse, il faut nécessairement que l'une ou l'autre des prémisses le soit d'abord ; il se peut même que toutes les deux le soient à la fois. Soit donc en premier lieu une proposition immédiate vraie et de forme négative : la conclusion erronée qui lui est opposée sera par conséquent de forme affirmative, puisqu'elle est supposée fausse. Dans cette première hypothèse, les prémisses peuvent être toutes les les deux fausses, majeure et mineure; et la conclusion l'est alors comme elles. La mineure ne peut être qu'erronée, puisqu'elle subordonne affirmativement au moyen terme le sujet de la con- L clusion qui, dans la proposition immédiate vraie, ne peut être subordonné à aucun terme, la forme de cette proposition étant négative. Quant à la majeure, elle peut être vraie ou fausse indifféremment ; mais la mineure ne peut jamais être vraie. Ainsi donc le syllogisme de l'erreur peut se former dans ce premier cas, avec une majeure et une mineure fausses, ou avec une majeure vraie et une mineure fausse. Soit, en second lieu, une proposition immédiate, vraie et de forme affirmative : la conclusion erronée qui lui est opposée sera par conséquent de forme négative ; et alors elle peut être soit dans la première, soit dans la seconde figure. Dans la première, les deux prémisses peuvent être fausses, ou seulement l'une des deux, soit majeure, soit mineure indifféremment, ce qui donne trois nuances pour le syllogisme de l'erreur. Dans la seconde, les deux prémisses peuvent être fausses, non point en totalité, mais en partie : ou bien l'une des deux fausse en partie, soit majeure, soit mineure indifféremment, dans le premier ou le second mode de cette figure. Ainsi, pour les propositions immédiates, pour les principes, voilà toutes les formes sous lesquelles l'erreur peut se produire. Pour les propositions médiates ou conclusions, l'erreur peut être encore plus complète. Il se LI peut, en effet, que le syllogisme erroné se serve du même moyen dont se sert le syllogisme vrai, ou bien qu'il se serve d'un moyen terme différent, alternative qui ne se présentait point pour les principes puisqu'ils n'ont pas de moyens. De plus le syllogisme de l'erreur, la conclusion erronée, peut, ici comme plus haut, être de forme négative, ou de forme affirmative. Supposons d'abord que le syllogisme de l'erreur emploie le moyen propre. S'il est négatif et dans la première figure, la majeure seule pourra être fausse, et la mineure restera nécessairement vraie : car elle doit être la même que dans le syllogisme légitime. Même remarque, si le moyen terme que prend le syllogisme de l'erreur, sans être le moyen propre, s'en rapproche cependant et peut servir aussi à démontrer une conclusion vraie. Mais si le moyen terme, choisi par le syllogisme de l'erreur, est tout à fait étranger, les deux prémisses peuvent être fausses à la fois ; ou si c'est l'une des deux seulement qui est fausse, c'est toujours la mineure. Dans la seconde figure, le syllogisme négatif de l'erreur ne pourra, comme plus haut pour les propositions immédiates, avoir ses deux prémisses fausses en totalité : mais l'une des deux indifféremment pourra être vraie et l'autre fausse, soit dans le premier, soit dans le second mode. LII Passons à la seconde hypothèse, celle où l'erreur prend la forme affirmative, et s'oppose par conséquent à une proposition médiate, vraie, de forme négative. Le syllogisme alors ne peut se produire que dans le premier mode de la première figure : mais le moyen qu'il emploie peut être ou le moyen propre, ou un moyen analogue au moyen propre, ou un moyen étranger. Dans le premier cas, la majeure seule peut être fausse, puisque la mineure qui reste affirmative ne peut changer : même remarque pour le second : mais dans le troisième, les deux prémisses peuvent être fausses ; ou s'il n'y en a qu'une qui le soit, c'est toujours la mineure. — Telles sont donc toutes1 les formes que l'erreur peut revêtir, pour arriver par le syllogisme à la conclusion que la vérité repousse. Il est à peine besoin de dire que l'erreur peut venir aussi d'un défaut dans nos sens eux-mêmes. Une organisation incomplète mutile la science, parce qu'elle n'en peut réunir les éléments. L'aveugle de naissance ne peut avoir la science des couleurs, ni le sourd celle des sons. Les universaux, dont la science ne saurait se passer, ne s'acquièrent que par l'induction : et l'induction n'a lieu qu'à la suite de la sensation. Là où la sensibilité manque, la science n'est pas seule- LIII ment imparfaite, elle est impossible. L'exemple des mathématiques, qui ne semblent vivre que d'abstractions, est concluant. Pour faire comprendre les principes abstraits sur lesquels elles s'appuient, il faut qu'elles recourent aux sens, qu'elles leur parlent, et qu'elles les convainquent avant de convaincre l'entendement. Si les mathématiques sont soumises à cette nécessité, à bien plus forte raison toutes les sciences le sont-elles.
SECTION QUATRIÈME.
MÉTHODE
POUR REMONTER DES PROPOSITIONS MÉDIATES AUX PROPOSITIONS IMMÉDIATES, ET DÉGAGER LES ÉLÉMENTS DE LA DÉMONSTRATION.
C'est surtout dans les propositions médiates que se produit l'erreur. L'évidence des propositions immédiates, des principes, les défend mieux contre l'ignorance: ils sont si clairs qu'il est presque impossible de les méconnaître. Ce serait donc une méthode à peu près certaine d'éviter l'erreur que de savoir remonter des propositions médiates aux propositions immédiates, des con- LIV clusions aux principes. Mais ici se présente une question supérieure qu'il faut préalablement résoudre. Déjà nous l'avons indiquée plus haut. Existe-t-il réellement des propositions immédiates, ou bien au-dessus de l'attribut y a-t-il toujours un attribut plus large que lui, au-dessous du sujet, un sujet moins étendu ; et entre ces deux termes, un nombre infini de moyens termes possibles? Rencontre-t-on l'infini soit en remontant d'attribut en attribut, soit en descendant de sujet en sujet, soit en se renfermant entre les deux extrêmes? Si l'on répond affirmativement, c'en est fait, comme on l'a vu, de toute démonstration: c'en est fait aussi de cette méthode que nous cherchons ici, et par laquelle il serait possible de ramener les propositions médiates aux propositions immédiates. Mais au fond, il n'est pas vrai que les attributs soient infinis, ni que les sujets et les moyens le soient davantage ; ils sont tous limités : la démonstration est possible, et avec elle, la méthode dont nous avons besoin. Remarquons d'abord que dans tout syllogisme, soit affirmatif, soit privatif, il y a trois termes qui forment deux propositions, lesquelles doivent être immédiates, selon nous, dans le syllogisme vraiment démonstratif. Ainsi, dans chacune d'elles, l'attribut doit tenir au sujet si étroite- LV ment qu'il ne soit pas possible d'insérer entre eux de terme moyen. Ce lien doit être réel, parfaitement vrai, et non point de simple apparence. La dialectique se contente de l'opinion, de la probabilité : la science démonstrative exige davantage : elle prétend atteindre ce qui est, et ne s'arrête point à ce qui semble être. Elle veut ce qui est en soi, et ne se borne point aux vaines attributions qui ne reposent que sur des accidents. Elle ne veut que des attributions essentielles. Ainsi quand on dit : Cet objet blanc est un homme, c'est là une attribution accidentelle et purement logique : car l'homme n'est point réellement dans l'objet blanc ; mais quand on dit : L'homme est blanc, c'est là une attribution parfaitement réelle, qui est bien dans la nature des choses. Il y a donc des attributs qui n'appartiennent au sujet que par une vue de l'esprit, un rapport que crée notre raison : il en est d'autres au contraire qui en soi sont au sujet ; et ce sont ceux-là seuls dont il doit être ici question. Cette distinction bien comprise, on demande : 1° dans une proposition dont le sujet n'a point au-dessous de lui de terme moins large que lui, peut- on, en partant de l'attribut, trouver une série infinie d'attributs toujours de plus en plus larges? 2° Dans une proposition dont l'attribut n'a point au-dessus de lui de terme LVI qui soit plus large que lui, peut-on, en partant du sujet, trouver une série infinie de sujets toujours de moins en moins larges? 3" Dans une proposition où le sujet et l'attribut sont les termes extrêmes d'une série limitée haut et bas à l'un et à l'autre, peut-on insérer un nombre infini de moyens termes? Ces trois questions, qui sont faites ici pour le syllogisme affirmatif, sont également applicables au syllogisme négatif; c'est-à-dire qu'on peut aussi se demander, si dans les propositions immédiates négatives, le progrès à l'infini peut avoir lieu comme pour les affirmatives. Du reste, il faut faire exception pour les propositions réciproques dans lesquelles le sujet et l'attribut sont d'extension parfaitement égale. L'attribut peut y servir de sujet, tout comme le sujet peut y servir d'attribut : c'est un cercle que l'on parcourt, et on peut le parcourir indéfiniment. Seulement, même dans ce cas, et parmi ces attributions alternatives, on peut distinguer encore les attributions naturelles et vraies des attributions accidentelles et simplement logiques. D'abord, que le nombre des moyens termes soit infini, quand les extrêmes eux-mêmes sont limités, la chose est évidemment impossible : car, si les moyens sont infinis, on aura, soit en remontant, soit en descendant, une série sans fin : les LVII attributs et les sujets ne seront plus limités, ce qui est contre l'hypothèse. Ce ne serait point d'ailleurs échapper à cette difficulté que de prétendre que c'est seulement à partir d'un certain terme intermédiaire que les moyens deviennent infinis. L'impossibilité reste la même à quelque degré que commence l'infinité des termes moyens. On prouvera plus loin que les moyens ne peuvent être infinis dans la proposition affirmative. Mais nous admettons ici que cette hypothèse soit déjà prouvée, et nous prétendons que, du moment que la série à l'infini n'est pas possible dans la proposition affirmative, elle ne l'est pas davantage dans la proposition négative. En effet, dans la première figure, c'est la majeure qui peut être négative : la mineure affirme toujours. Si donc la majeure n'est point immédiate, et qu'on puisse entre ses deux termes insérer des moyens à l'infini, il faudra prouver cette majeure négative par une autre proposition négative et par une affirmative : car les deux prémisses ne peuvent jamais êtres négatives à la fois. Un moyen terme dans la négative en appellera un dans l'affirmative : et si la série des premiers est infinie, celle des seconds le serait également ; ce qui est contre l'hypothèse, puisque nous avons supposé que la série des moyens termes est limitée dans les pro- LVIII positions affirmatives. Même remarque pour la seconde figure. Si l'on prétend que la proposition négative, soit mineure, soit majeure, peut avoir des moyens termes à l'infini, on est forcé de remonter encore à l'infini d'attributs en attributs pour la proposition affirmative, sans laquelle le syllogisme ne serait pas possible. Enfin, dans la troisième figure, qu'on peut aussi, jusqu'à certain point, employer pour démontrer, si l'on prétend que pour la proposition négative les moyens sont infinis, on arrive à cette conséquence absurde qu'ils le sont aussi pour la proposition affirmative en descendant de sujets en sujets. C'est en vain qu'on objecterait ici, qu'au lieu de démontrer dans une seule et même figure le syllogisme de l'une des trois figures, on pourrait le démontrer tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Mais le nombre de ces combinaisons serait lui-même limité : car des éléments finis, en nombre fini, ne peuvent donner une série infinie de combinaisons. Si donc le progrès à l'infini n'est pas possible dans les propositions affirmatives, il ne l'est pas non plus dans les propositions négatives. Prouvons maintenant qu'il ne l'est pas dans les premières. Et d'abord, si les attributs pouvaient être infinis, la définition deviendrait par cela même impossible : car la définition doit con- LIX tenir tous les attributs essentiels de la chose, pour en faire connaître l'essence : si ces attributs sont en nombre infini, on ne peut ni les parcourir, ni les assembler tous; et, par conséquent, on ne peut définir quoi que ce soit. Or la définition est possible : elle existe de l'aveu de tous ; donc les attributs essentiels, loin d'être infinis, sont, au contraire, limités. Ceci ne s'applique pas seulement aux attributs essentiels : on peut le dire tout aussi bien des autres attributs, en admettant toutefois que ces attributs sont réels, et qu'ils ne sont pas de pur accident ou simplement logiques. Les attributions dont on se sert dans la démonstration sont toujours naturelles, parce que la vérité est le but que la démonstration se propose. Et voilà pourquoi les idées platoniciennes n'ont que faire ici, puisqu'elles ne sont point des réalités. Elles tendraient à donner aux accidents autant d'être qu'aux sujets eux-mêmes, dans lesquels les accidents sont toujours de toute nécessité, et sans lesquels ils ne sont rien. Les attributs vrais dont s'occupe la démonstration sont réciproques au sujet, ou font tout au moins partie de son essence. Quant aux attributs d'accident, ils peuvent être vrais, mais ils ne sont jamais réciproques à leur sujet. Le sujet ne peut jamais devenir réellement attribut LX de son propre accident ; car alors l'espèce deviendrait genre de son propre genre, différence de sa propre différence. Mais même encore dans ce cas, le nombre des attributs, pas plus que celui des sujets, ne serait infini. En remontant d'homme à bipède, de bipède à animal, d'animal à tel autre genre, on arriverait toujours à un genre supérieur qu'on ne pourrait dépasser; de même qu'en allant d'animal à homme, d'homme à Callias, on arriverait aussi à un sujet au-delà duquel on ne pourrait descendre. Et ce qu'on dit ici de la substance s'applique également aux autres catégories. D'abord le nombre même des catégories est limité ; et, de plus, elles sont toutes des accidents de la substance; et nous venons de voir que les attributions de la substance sont nécessairement limitées en haut et en bas. Ainsi donc, tant pour la première catégorie que par les autres, il faut toujours qu'on atteigne, en remontant, un attribut supérieur, au-delà duquel il n'y a plus d'attribution possible ; et en descendant un sujet inférieur, passé lequel il n'y a plus d'autre sujet. Il faut ajouter que si le nombre des moyens était infini dans la proposition affirmative, la démonstration deviendrait impossible tout aussi bien que la définition. En effet, qu'est-ce qu'un terme démontrable? C'est un terme subordonné à un autre LXI terme plus large que lui, qui sert à le démontrer. De plus, toute proposition démontrable ne peut être sue que par la démonstration : et les propositions qui servent à faire savoir la conclusion, doivent être nécessairement connues avant elle. Si donc les moyens sont infinis, c'est-à-dire, si toute proposition est démontrable, il n'y a plus de premiers principes, et partant plus de science, ni de démonstration. Or nous sommes assurés que la science et la démonstration existent : donc il y a des principes, donc les moyens ne sont pas infinis. Telles sont les raisons purement logiques, qui peuvent servir à prouver que, dans les propositions de forme affirmative, le nombre des moyens termes ne saurait être infini. Il est d'autres raisons plus profondes, plus spéciales et vraiment analytiques. Les voici, et elles seront plus concises que celles qui précèdent. La démonstration ne s'occupe que des attributs essentiels. Or les attributs essentiels sont ceux qui entrent dans la définition du sujet, ou dans la définition desquels entre le sujet. De l'une et de l'autre façon, en effet, le sujet et l'attribut sont liés par des rapports également étroits: ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ainsi l'impair est un attribut essentiel de nombre ; car on ne peut définir l'impair qu'en faisant figurer le nombre dans sa dé- LXII finition. De quelque manière que l'on considère les attributs essentiels, ils ne peuvent être infinis : car alors la définition ne serait plus possible. L'ensemble de tous les attributs du nombre s'applique au nombre : le nombre lui-même entre dans la définition de chacun de ses attributs : leur totalité est égale au terme qu'ils déterminent: mais elle ne le dépasse pas. Le défini et la définition sont d'extension égale, et par conséquent sont deux termes réciproques. Les attributions ne seront donc pas plus infinies que ne le sont les attributs : il y aura des propositions immédiates, et la démonstration sera possible. — De toute la discussion antérieure, on peut conclure que les extrêmes, attributs ou sujets, sont limités : que les moyens termes destinés à unir les extrêmes le sont comme eux : que, par conséquent, il y a nécessairement des premiers principes, des propositions immédiates, et que toutes les propositions ne sont pas démontrables, comme l'ont prétendu quelques philosophes, et qu'en résumé le nombre des moyens termes ne peut être infini. Nous n'avons considéré jusqu'ici que le cas où l'attribut est unique comme le sujet : mais l'on doit ajouter qu'un attribut unique peut être immédiat à plusieurs sujets, pourvu que ces sujets LXIII soient tous du même genre ; car on se rappelle que la démonstration ne peut passer d'un genre à un autre. De plus, il est évident qu'autant il y a de moyens entre deux termes, autant il y a de démonstrations possibles. Il y a toujours autant de majeures indémontrables qu'il y a de moyens ; et les majeures indémontrables sont les éléments même de toute démonstration. Peu importe d'ailleurs que ces majeures soient affirmatives ou négatives ; car nous avons vu qu'il y a des propositions immédiates négatives tout comme il y en a d'affirmatives ; et les unes et les autres servent également de principes. — Après tout ce qui précède, il est facile de voir comment on pourra, des propositions médiates, remonter jusqu'aux propositions immédiates, jusqu'aux principes. Soit en effet une proposition médiate affirmative : il suffira de prendre au-dessus du sujet un terme qui lui soit attribué essentiellement, et qui soit compris lui-même sous l'attribut de la proposition initiale. Au-dessus de ce premier terme, devenu lui-même sujet d'une seconde proposition, on prendra un nouvel attribut qui se rapprochera encore d'un degré de l'attribut initial : puis un troisième, un quatrième, etc., de sorte que l'intervalle diminue de plus en plus, et que de proche en proche on arrive à le combler tout LXVI entier. On formera de cette façon une suite de propositions dont la totalité unira sans lacune le premier sujet au premier attribut. Toutes les propositions intermédiaires seront immédiates, c'est-à-dire qu'elles ne relèveront que de l'entendement seul, qui, dans la démonstration et la science, peut être regardé comme l'unité, aussi bien que le dièse l'est en musique, et que la mine l'est en fait de poids. Par cette méthode, aucun des termes qu'on insère n'est pris en dehors des extrêmes; les moyens et les extrêmes sont dans la même catégorie : on ne fait que restituer tous les degrés qu'avait omis la première proposition, qui, à cause de cette omission même, n'était qu'une proposition médiate. Cette méthode resterait la même si la proposition primitive était négative au lieu d'être affirmative : et on pourrait l'appliquer indifféremment à l'une des trois figures. Seulement, les propositions intermédiaires seraient négatives au lieu d'être affirmatives.
LXV SECTION CINQUIÈME.
DES DIVERSES ESPÈCES DE LA DÉMONSTRATION
ET DE LA SCIENCE.
On a vu plus haut qu'on entendait par démonstration universelle la démonstration où l'attribut s'applique au sujet primitif, au genre entier ; et par démonstration particulière, celle où le sujet n'est qu'une espèce : car alors l'attribut n'est démontré que d'une partie du sujet total. Nous venons de voir en outre que la forme de la démonstration peut être négative tout aussi bien qu'affirmative : enfin, la démonstration peut être directe, ostensive, ou bien indirecte, c'est-à-dire, prouvant par réduction à l'absurde. De ces espèces diverses de la démonstration, quelle est la meilleure ; en d'autres termes quelle est celle qui fait le plus et le mieux savoir ? Comparons d'abord la démonstration particulière avec la démonstration universelle : nous comparerons ensuite l'affirmative et la négative ; et nous terminerons par l'ostensive et celle qui a recours à l'absurde. — On peut, en faveur de la démonstration particulière comparée à l'universelle, alléguer trois arguments principaux. Les voici : LVI d'abord comme l'objet propre de la démonstration est de faire savoir, celle qui fait le mieux savoir est la préférable. Cela ne peut être contesté. Or nous savons une chose beaucoup mieux, quand nous la savons elle-même directement, que quand nous la savons indirectement par l'intermédiaire d'une autre. Ainsi nous savons mieux que Coriscus est musicien, quand nous savons que Coriscus est musicien, que lorsque nous savons que l'homme est musicien. La démonstration universelle ne nous fait connaître la chose que par le moyen d'une autre : elle nous apprend par exemple que l'équilatéral a la somme de ses angles égale à deux droits, non pas en tant qu'équilatéral, mais en tant que triangle. La démonstration particulière nous montre au contraire que l'équilatéral lui-même a cette propriété. Donc, la démonstration qui prouve la chose même et non une autre chose, est supérieure à celle qui prouve une chose autre que celle qu'on étudie : donc, la démonstration particulière est supérieure à l'universelle. C'est là le premier argument. En voici un second non moins fort, du moins à l'apparence. L'universel n'est rien sans les individus : il n'est point une chose réelle et distincte. Or la démonstration universelle nous donne à croire que ce qu'elle démontre a une existence bien po- LXVII sitive : elle nous donne à croire que le triangle est quelque chose de réel indépendamment de tous les triangles particuliers, le nombre indépendamment de tous les nombres particuliers, la figure indépendamment de toutes les figures particulières. Elle s'occupe de ce qui n'est pas en s'occupant de l'universel, tandis que la démonstration particulière ne s'occupe que de ce qui est. Enfin, par suite, la démonstration universelle nous trompe, tandis que la particulière ne nous trompe pas. Ainsi, en résumé, la démonstration particulière est plus directe, plus réelle et plus sûre que l'universelle. A ces trois titres, elle lui doit être préférée. Mais à ces arguments on peut répondre. D'abord le premier argument vaut tout autant pour la démonstration universelle que pour la démonstration particulière. Oui sans doute, la démonstration qui fait le plus savoir est la meilleure, je l'accorde ; mais n'est-ce pas la démonstration universelle qui donne cette science plus complète et plus certaine? Si cette propriété d'avoir la somme de ses angles égale à deux droits est à l'équilatéral, non pas en tant qu'équilatéral, mais en tant que triangle, celui qui la connaît par rapport à l'équilatéral, sait moins que celui qui la connaît par rapport au triangle. Rappelons-nous qu'on ne ferait plus une dé- LXVIII monstration universelle, si l'on démontrait du triangle une propriété qui ne lui appartînt pas en tant que triangle ; or pour savoir si l'on fait bien une démonstration universelle, il suffit de s'assurer si le terme dont on démontre est le plus large ; et ici, par exemple, si le triangle est un terme plus étendu que l'équilatéral ; si, de plus, l'attribut qu'on démontre est bien au terme tout entier ; et enfin si ce terme ne peut faire équivoque. Ces trois conditions remplies, c'est-à-dire, la démonstration étant vraiment universelle, on sait beaucoup plus par elle que par la particulière ; car ce n'est pas en tant qu'équilatéral que le triangle a ses trois angles égaux à deux droits : c'est au contraire en tant que triangle que l'équilatéral les a. Donc, la démonstration universelle vaut mieux que la démonstration particulière. En second lieu, nous convenons encore que la démonstration de l'être vaut mieux que celle du non-être : mais y a-t-il moins d'être dans l'universel que dans le particulier? Ou, pour mieux dire, l'universel n'a-t-il pas plus d'être encore que les individus? N'est-il pas éternel tandis que les individus, du moins la plupart, sont périssables ? En troisième lieu, et pour répondre au troisième argument, nous dirons que la démonstration universelle ne nous LXIX trompe pas, comme on le prétend. Elle ne veut pas nous faire croire que l'universel soit un être distinct et indépendant des individus, pas plus que la démonstration particulière ne nous fait croire que les accidents sont distincts et indépendants du sujet. Si l'on prend ici le change, ce n'est pas la démonstration qu'il faut blâmer : c'est l'auditeur même qui la comprend mal. — Ces objections réfutées, voici ce que l'on peut dire en faveur de la démonstration universelle : elle est bien plus la démonstration de la cause que la démonstration particulière : car l'universel, qui par lui seul et toujours a un attribut essentiel, est cause de cet attribut, que le sujet particulier ne possède que par l'intermédiaire même de l'universel. Cette notion de cause a une telle importance, que sans elle la science n'existe pas. Tant que nous ne sommes pas arrivés à la cause, nous ne croyons pas réellement savoir ; et nous cherchons toujours. Une fois la cause atteinte, nous cessons de chercher à remonter plus haut : Pourquoi un tel est-il venu? pour recevoir de l'argent : et pourquoi vient-il recevoir de l'argent? pour payer ses dettes : et pourquoi paye-t-il ses dettes? pour accomplir un devoir. Et remontant toujours ainsi de terme en terme, une fois que nous en avons atteint un qui est par lui- LXX même et non plus à cause de quelqu'autre, nous le considérons comme la cause finale ; et nous disons que c'est par cette cause qu'un tel est venu. Et de même pour l'universel : car il a l'attribut démontré, n'on plus par le moyen d'un autre terme, mais par lui seul : et à ce titre, il en est la cause. En second lieu, les cas particuliers, les individus, tendent à devenir infinis .- l'universel, au contraire, tend à la limite, à l'unité. Par conséquent, il est bien plus démontrable que le particulier : et la démonstration qui s'applique à des choses plus démontrables, est bien plus démonstration que celle qui s'applique à des choses moins démontrables. Donc, la démonstration universelle est supérieure à la démonstration particulière. Ajoutons que la démonstration universelle est préférable, en ce qu'elle suppose la connaissance de plus de choses ; car lorsqu'on sait l'universel, c'est qu'on sait aussi quelque cas particulier, tandis que la réciproque n'est point vraie. Ajoutons encore que l'on sait plus l'universel, parce qu'on le sait par un moyen terme qui est plus rapproché du principe, et que la démonstration qui part du principe est au-dessus de celle qui n'en part point. Enfin un dernier argument qui n'a rien de logique, et qui tient profondément à l'analyse de la question, c'est que LXXI quand on sait l'universel, on sait aussi, du moins en puissance, tous les cas particuliers que l'universel renferme; tandis qu'on peut connaître la proposition particulière, sans connaître l'universelle, ni en acte, ni en puissance. Disons pour terminer qu'il y a d'ailleurs une grande différence entre les facultés de l'âme auxquelles s'adressent l'une et l'autre démonstration : que la démonstration universelle ne parle qu'à l'entendement, tandis que la particulière parle aux sens ; et que de l'une à l'autre, il y a tout l'intervalle, toute la distance qui sépare l'entendement de la sensibilité. Donc, en résumé, la démonstration universelle l'emporte sur la démonstration particulière : et c'est l'universelle que, pour tous ces motifs, la science doit exclusivement employer. Il ne sera pas plus difficile de prouver, que la démonstration affirmative est au-dessus de la négative. D'abord, la démonstration qui se contente d'un moindre nombre de propositions, hypothèses ou postulats, doit être préférée à celle qui en exige davantage : de même qu'une conclusion qu'on prouve par deux moyens, vaut mieux que celle qu'on doit prouver par trois ou par quatre : car la connaissance y est plus rapide, en supposant d'ailleurs qu'elle y est aussi certaine. Or, si la démonstration négative n'emploie, comme l'af- LXXII firmative, que trois termes et deux propositions, elle emploie l'affirmation et la négation, tandis que l'affirmative se borne à l'affirmation, dans les deux prémisses comme dans la conclusion : donc, il faut plus d'espèces d'éléments à la démonstration négative ; donc elle est inférieure. Il suit de là que la négative dépend de l'affirmative : car on a vu qu'il était impossible de former un syllogisme avec deux propositions négatives. Si donc la démonstration négative n'existait pas, la négative ne pourrait avoir lieu, tandis que l'affirmative peut se passer fort bien de la négative. Ce par quoi l'on démontre est plus notoire, est plus croyable que ce qu'on démontre; et par conséquent la démonstration affirmative, par laquelle on démontre la négative, est plus notoire, plus croyable qu'elle, et lui est supérieure. Il faut ajouter que cette dépendance de la démonstration négative à l'affirmative, est d'autant plus remarquable que le nombre des moyens s'accroît davantage. Supposons, en effet, que dans un syllogisme dont les deux prémisses sont médiates, il s'agisse de prouver l'une et l'autre par des prosyllogismes. La proposition affirmative sera prouvée par deux affirmatives : la négative par une affirmative et une négative : ainsi l'on aura trois affirmatives contre une négative ; et si l'on pour- LXXIII suit, six contre deux, neuf contre trois, etc. Enfin le principe de la démonstration affirmative est supérieur à celui de la négative. En effet, dans le syllogisme démonstratif, le principe c'est la proposition universelle. Cette proposition universelle est affirmative dans la démonstration affirmative ; négative, dans la négative. Or l'affirmation est plus notoire que la négation : car la négation ne se comprend que par l'affirmation : de plus, l'affirmation est antérieure comme l'être l'est au non-être. Donc, en résumé, la démonstration affirmative, composée d'éléments moins divers, se suffisant à elle-même, partant de principes meilleurs, est préférable à la démonstration négative. Une conséquence de ce théorème, c'est que la démonstration affirmative, ou pour mieux dire ostensive, est également préférable à la démonstration par l'absurde : pour le prouver, il suffira de prouver que la négative inférieure à l'affirmative, vaut mieux encore que celle qui procède par réduction à l'absurde. D'abord, rappelons comment se forment la démonstration négative et la démonstration par l'absurde. La démonstration négative est composée d'une majeure universelle négative et d'une mineure universelle affirmative; et de ces prémisses, elle tire une LXXIV conclusion universelle négative. Or c'est précisément cette conclusion que nie l'adversaire. Pour lui prouver qu'elle est vraie, voici la méthode par l'absurde. On suppose que cette conclusion attaquée est fausse en effet : et l'on admet par conséquent que la contradictoire est vraie. Cette contradictoire, qui est universelle affirmative, devient la majeure d'un nouveau syllogisme : on conserve du premier la mineure qu'on n'a point contestée : et de ces deux prémisses affirmatives universelles, on obtient une conclusion dont la fausseté est de toute évidence. Or comme de prémisses vraies on ne peut tirer que le vrai, il est clair que si la conclusion est fausse, c'est que l'une des prémisses ou toutes les deux le sont aussi. Or ce n'est pas la mineure qui est erronée, puisqu'elle n'a point été contestée. Ce ne peut donc être que la majeure. Mais cette majeure est contradictoire à la conclusion du premier syllogisme ; et comme deux contradictoires ne peuvent être fausses à la fois, il s'ensuit que la première conclusion est vraie. Même remarque, si au lieu de démontrer par l'absurde au moyen d'une conclusion nouvelle, on prenait la contradictoire de la majeure du premier syllogisme. Ainsi donc, la démonstration négative part des prémisses pour atteindre la conclusion : la dé- LXXV monstration par l'absurde commence, au contraire, par la conclusion, pour aboutir à l'une des propositions. Les propositions sont naturellement antérieures à la conclusion qui vient d'elles : donc le principe de la démonstration négative est supérieur : donc cette démonstration aussi, est supérieure à la démonstration par l'absurde, qui, à plus forte raison, le cède à la démonstration affirmative. Après avoir traité des diverses espèces de la démonstration, il nous reste à parler des diverses espèces de la science : et ici nous entendons par science, soit une connaissance spéciale que donne la démonstration, soit un ensemble systématique de doctrine. Une science peut être plus exacte et plus élevée qu'une autre de trois laçons : 1° quand elle réunit la notion du fait et la notion de la cause de ce fait, sans séparer le fait de la cause : 2° quand elle a un sujet abstrait au lieu d'un sujet matériel; 3° quand son sujet est plus simple. Ainsi l'arithmétique est supérieure à la musique, parce que le sujet de la musique, le son, est concret, tandis que le sujet de l'arithmétique est purement abstrait : l'arithmétique est également supérieure à la géométrie, en ce que son sujet est moins complexe; car l'unité, sujet de l'arithmétique, est une substance sans position, tandis que LXXVI le point, sujet de la géométrie, doit nécessairement en avoir une. La science aussi peut être une ou multiple : elle est une, quand, se bornant à un seul et même sujet, elle étudie les composés ou les parties de ce sujet, et les modifications essentielles qui affectent ces composés et ces parties. Au contraire, une science est différente d'une autre science, quand elle tire ses principes d'une origine différente, ou que les principes de l'une ne sont pas subordonnés aux principes de l'autre. Pour s'assurer de l'identité ou de la diversité de deux sciences, il suffit de remonter aux principes indémontrables. Si ces principes sont les mêmes pour les choses que l'on compare, les choses, toutes diverses qu'elles semblent, appartiennent à une seule et même science ; et réciproquement, si des principes en apparence dissemblables aboutissent cependant à des conclusions pareilles, c'est que ces principes forment une seule et même science. Du reste, si l'unité de la science repose sur l'unité du sujet, elle n'a pas du tout besoin de l'unité de démonstration. Une seule conclusion peut fort bien être démontrée par plusieurs termes moyens. Il se peut même que les moyens soient pris dans des séries différentes, ou dans la même LXXVII série à de grandes distances les uns des autres. Il est vrai que toutes ces démonstrations ne sont pas également bonnes : mais elles sont toutes régulières: et l'on peut encore les faire varier par la variété même des figures du syllogisme. Soit en effet à démontrer que tout être qui ressent du plaisir, éprouve aussi quelque changement, on pourra prouver cette conclusion unique par des moyens termes différents ; et entre autres par les deux moyens les plus opposés : le mouvement d'une part et le repos de "l'autre. Ainsi l'on peut dire d'une part : Tout être qui est mu éprouve un changement: or tout être qui ressent du plaisir est mu : donc tout être qui ressent du plaisir éprouve un changement : et l'on peut dire encore avec autant de vérité : Tout être qui se repose éprouve un changement : or tout être qui ressent du plaisir se repose : donc tout être qui ressent du plaisir éprouve un changement. La conclusion est pareille : les termes moyens sont contraires. De plus, nous nous sommes servis ici de la première figure : nous aurions pu nous servir d'une autre, si la forme de la proposition n'eût point été universelle affirmative : et par là même, nous eussions multiplié les démonstrations. Après avoir établi les points principaux de la théorie de la démonstration, il nous reste encore LXXVIII à parcourir quelques questions, qui, sans en faire directement partie, s'y rattachent cependant et la complètent. — D'abord de ce qui a été dit plus haut, sur le caractère de nécessité que doivent toujours avoir les éléments de la démonstration, il suit qu'il n'y a point de démonstration pour le fortuit, pour ce qui ne dépend que du hasard. Dans tout syllogisme démonstratif, les propositions sont nécessaires ; ou tout au moins sont-elles vraies pour la plus grande partie des cas. Or le fortuit n'est pas vrai de cette façon, encore moins est-il nécessaire : donc n'étant ni nécessaire, ni même ordinaire, il ne peut être démontré. D'autre part, de ce que les propositions de la démonstration sont universelles, il suit que la science proprement dite ne peut être acquise par la sensation. La sensation se borne à un seul objet, dans un seul moment, dans un seul lieu : elle est limitée dans son objet, dans le temps et dans l'espace. L'universel, au contraire, est dans la totalité des objets auxquels il s'applique : il est partout, il est toujours : il échappe donc à la sensation. S'il était borné comme elle, il ne serait plus l'universel. Or la science, la démonstration ne s'appuient que sur l'universel, et ne valent que par lui. La sensation ne peut donc donner la LXXIX science. Nos sens pourraient même nous faire connaître que les trois angles de tel triangle sont égaux à deux droits, que nous chercherions la démonstration de cette vérité géométrique ; car les sens ne donnent que la notion de tel objet particulier : la science ne vit que de l'universel : elle n'est pas sans lui, et les sens ne peuvent le fournir. Il en est absolument de même pour les phénomènes naturels. Supposons que nous soyons placés près de la lune au moment même où elle s'éclipse. Nous verrions la lune couverte d'ombre et la terre qui vient s'interposer : ainsi l'éclipse, la lune et la terre, les trois éléments du phénomène, nous seraient connus; mais la sensation, toute complète qu'elle serait, ne nous donnerait pas la science de l'éclipse ; nous verrions bien telle éclipse particulière, mais nous ne saurions point ce que c'est que l'éclipse ; car nous n'en saurions point la cause universelle. Seulement, les sensations répétées peuvent, ainsi que nous l'avons déjà dit, nous mettre sur la trace de l'universel: car l'universel ressort de la multiplicité des cas particuliers : et une fois l'universel obtenu, nous pouvons procéder à la démonstration. Ce qui donne tant d'importance à l'universel, c'est qu'il suppose nécessairement la connaissance de la cause : les sens, l'entendement LXXX lui-même ne la supposent pas. Aussi dans les choses qui en ont une autre pour cause, c'est-à-dire, dans les choses démontrables, la connaissance universelle est-elle fort supérieure et à la connaissance sensible, et même à l'entendement dont l'objet est tout différent, comme on le verra plus tard. Ainsi la sensation ne peut du tout faire savoir rien de ce qui est démontrable, à moins qu'on ne veuille confondre, par un abus de mots, sentir et savoir par démonstration. On a pu dire plus haut qu'une lacune dans la sensibilité, une erreur dans la sensation, en amenaient une aussi dans la science, et que si nous voyions certaines choses, nous ne chercherions plus à nous les démontrer. Ceci ne veut pas dire que c'est la sensation qui nous fait savoir : cela veut dire seulement que par la sensation nous arrivons à l'universel, source unique de la science. Par exemple, si nous pouvions voir distinctement la lumière traverser la vitre, nous saurions pourquoi elle nous éclaire ; mais ce ne serait pas par la sensation successive de chaque cas particulier ; ce serait parce qu'en voyant chacun des phénomènes, nous comprendrions qu'il en doit être de même dans tous les cas possibles, atteignant ainsi la notion de l'universel, qui n'est point cependant dans les faits particuliers. LXXXI On a dit antérieurement qu'il y avait pour toutes les démonstrations des principes communs, des axiomes qui leur appartiennent à toutes sans exception. On aurait tort d'en conclure que les principes de tous les syllogismes démonstratifs sont identiques : et pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que parmi les syllogismes, les uns sont faux, les autres sont vrais; et que leurs principes varient de l'erreur à la vérité, tout comme leurs conclusions. Il est certain, d'autre part, que de prémisses fausses on peut tirer une conclusion vraie : mais ce n'est là qu'une exception ; et la preuve c'est qu'on n'a jamais que des propositions fausses, lorsqu'on veut démontrer par des prosyllogismes les deux prémisses fausses, dont on a tiré la conclusion vraie. Ainsi, habituellement le faux conclut le faux; et ce n'est qu'accidentellement qu'il conclut le vrai. Bien plus, les syllogismes vrais ne diffèrent pas seulement des syllogismes faux par leurs principes : les syllogismes faux diffèrent encore entre eux. Il y a des propositions fausses qui sont contraires entre elles, qui ne peuvent coexister, et qui par conséquent ne se rattachent point à des principes identiques. Ainsi, ces propositions sont fausses et de plus elles sont contraires entre elles : La justice est injustice : La justice est faiblesse: LXXXII L'égal est plus grand : L'égal est plus petit. Les principes de ces propositions ne sauraient être les mêmes. A ces raisons purement logiques, ajoutons-en de plus décisives, pour prouver que les principes de tous les syllogismes ne peuvent être semblables. D'abord les principes propres sont divers pour les diverses sciences; et par exemple, le point et l'unité ne peuvent être confondus. En outre, les principes communs, les axiomes, tel que le principe de contradiction, ne font jamais partie de la démonstration, bien que sans eux il n'y ait point de démonstration possible : les éléments de toute démonstration sont les principes propres variant avec la variété même des sujets, ici quantité, là qualité, etc. En troisième lieu, si les principes étaient les mêmes pour toutes les démonstrations, le nombre en serait limité et parfaitement connu ; loin de là, les principes sont à peu près aussi nombreux que les conclusions ; on pourrait même dire qu'ils sont plus nombreux, puisque les propositions sont les principes, et qu'il y a toujours deux propositions dans le syllogisme contre une conclusion ; or les propositions sont infinies : et il serait impossible de prétendre que les principes, qui d'ailleurs sont contingents, tout aussi bien que nécessaires, sont limités quand les conclusions ne le sont pas. On LXXXIII ne saurait entendre que tous les principes sont les mêmes, en ce sens qu'ils ne varient point dans chaque science ; car on convient par là qu'ils sont divers dans des sciences diverses : et, de plus, toutes choses sont en ce sens identiques à elles-mêmes ; et ce n'est pas de ce point de vue ridicule que nous nous occupons ici. Soutenir que d'un principe quelconque on peut tirer une conclusion quelconque, ce n'est pas du tout la même question que de prétendre que tous les principes sont identiques; mais les mathématiques prouvent bien que d'un principe pris au hasard on n'obtient pas la conclusion cherchée : certaines conclusions répondent à certains théorèmes ; et il en est de même dans toutes les sciences. L'analyse ne fait point exception. Chaque conclusion découle d'une majeure indémontrable qui lui est propre : et si l'on change cette majeure, la conclusion change avec elle. On ne peut pas dire davantage que ce sont les propositions immédiates qui sont les principes identiques : car il y a au moins une proposition immédiate dans chaque genre ; et ces propositions ne sont pas du tout pareilles. Enfin, on ne saurait dire que les principes sont tous du même genre, et que différant seulement en espèce, ceux-ci démontrent telle conclusion, tandis que ceux-là LXXXIV en démontrent telle autre. Les principes diffèrent en genre pour les choses de genre différent ; et ils sont doubles : communs, quand ce sont ceux sur lesquels s'appuie la démonstration; propres, quand ce sont ceux dont on démontre. Donc, en résumé, les principes de tous les syllogismes ne sauraient être identiques. Il ne faut pas confondre la science et l'opinion, ce qui est su de simple opinion, avec ce qui est su de science certaine et démontrée. La science est universelle, et se forme d'éléments nécessaires. Or le nécessaire ne peut être autrement qu'il n'est, tandis qu'il est des choses vraies d'ailleurs, réelles, et qui peuvent être autrement qu'elles ne sont. Ce n'est point à ces choses-là que s'applique la science, non plus que l'entendement, principe de la science, qui, sans démonstration, connaît les propositions immédiates : ces choses sont le domaine de l'opinion. L'opinion n'est donc point essentiellement fausse ; elle n'est point non plus essentiellement vraie comme la science et l'entendement : elle se borne à connaître le contingent, c'est-à-dire, ce qui peut-être autrement qu'il n'est. Elle remonte bien à la proposition immédiate : mais la proposition immédiate qu'elle admet n'est point nécessaire. Tel est si bien le caractère de l'opinion que le LXXXV mot seul emporte l'idée de quelque chose d'imparfait et d'incertain. Quand on pense d'une chose qu'elle ne peut être autrement qu'elle n'est, on ne dit point qu'on en a une simple opinion, on dit qu'on en a la science. C'est que la science, je le répète, ne concerne que le nécessaire ; l'opinion ne concerne que le contingent. Cependant il est possible que la science et l'opinion s'appliquent à un seul et même objet. Seulement, d'une part, on croit cet objet nécessaire, et d'autre part, on le croit contingent. Et remarquez en outre que la cause tout aussi bien que l'effet, est du domaine de l'opinion, comme elle est du domaine de la science. Comment donc l'opinion et la science ne se confondent-elles pas et ne sont-elles pas identiques? C'est que pour l'une et pour l'autre, la disposition de l'esprit est toute différente. Quand on sait, c'est qu'on est persuadé que la chose ne peut être autrement qu'elle n'est : c'est qu'on en possède la définition qui doit donner la démonstration. Au contraire, quand on ignore que les attributs de la chose sont essentiels, et qu'elle ne peut pas être sans eux, ces attributs qu'on connaît ont beau être vrais, on ne s'élève point au-dessus de la simple opinion, soit qu'on sache que la chose est, si l'on n'a employé que des propositions médiates, soit qu'on LXXXVI sache pourquoi elle est, si l'on est remonté jusqu'à des propositions immédiates. D'un autre côté, il n'est pas parfaitement exact de dire que l'objet de la science soit le même que celui de l'opinion. L'opinion vraie et l'opinion fausse n'ont pas non plus le même objet : il s'agit bien d'une seule chose pour l'une et pour l'autre: mais l'attribut donné à cette chose n'est pas identique; loin de là, il est contraire. Ainsi l'opinion vraie croit le diamètre incommensurable au côté ; l'opinion fausse le croit commensurable : c'est bien toujours d'un même objet, du diamètre qu'il s'agit : mais c'est en ce sens seulement que l'objet de l'opinion vraie et celui de l'opinion fausse sont identiques. De même pour la science et pour l'opinion. L'une tout comme l'autre croit bien, par exemple, que l'homme est animal : mais la science croit fermement qu'il l'est essentiellement, qu'il ne peut pas ne pas l'être : l'opinion au contraire, tout en croyant qu'il l'est, ne sait pas qu'il l'est nécessairement : et elle pense qu'il pourrait aussi ne pas l'être. Ainsi l'objet de toutes deux est identique : mais elles ne le considèrent pas du même point de vue. De là, il suit qu'il est impossible d'avoir en un même temps, sur un même objet, la science et l'opinion ; car alors on penserait, chose contradic- LXXXVII toire et impossible, que la chose peut et ne peut pas être autrement qu'elle n'est. — Nous pourrions pousser plus loin la distinction faite ici entre la science et l'opinion, et nous demander quelles sont les différences du raisonnement et de l'entendement, de la science et de l'art, de la prudence et de la sagesse. Mais ce sont là des matières qui appartiennent plutôt à la psychologie et à la morale. Bornons-nous à remarquer, car ce sujet tient de plus près à la démonstration, que ce qu'on appelle sagacité n'est pas autre chose que la conception juste et rapide du terme moyen, c'est-à-dire, de la cause adéquate de la chose. Ainsi, par exemple, si, observant que la lune a toujours sa partie lumineuse tournée vers le soleil, on conjecture sur-le-champ que c'est parce qu'elle tire sa lumière du soleil, on fait acte de sagacité. On se montre également sagace, si, voyant un homme pauvre parler à un riche, on conjecture sur-le-champ qu'il ne l'aborde que pour lui emprunter de l'argent. Enfin, l'on n'est pas moins sagace, si, voyant deux hommes jadis ennemis se rapprocher, on conjecture sur-le-champ que c'est qu'ils ont tous deux un ennemi commun à combattre. Or qu'a-t-on fait dans ces trois circonstances diverses? Des extrêmes étant LXXXVIII donnés, on n'a fait que découvrir promptement le terme moyen qui les unit, c'est-à-dire, la cause par laquelle tel attribut est à tel sujet : on n'a fait que résoudre promptement la conclusion dans ses principes.
LIVRE SECOND.
SECTION PREMIÈRE.
DU CHANGEMENT
DE LA DÉMONSTRATION EN DÉFINITION.
Jusqu'ici nous n'avons considéré la démonstration qu'en elle-même, et nous avons vu qu'elle avait pour objet de faire savoir l'attribut de la chose en faisant connaître la cause de cet attribut. Mais nous ne cherchons pas seulement à savoir pourquoi la chose a tel attribut; nous cherchons en outre à savoir ce qu'est la chose en elle-même : c'est-à-dire, nous en voulons avoir la définition et savoir quelle est son essence. La démonstration peut-elle nous donner cette nouvelle espèce de science, qui est la plus haute, la LXXXIX plus précieuse de toutes? En d'autres termes, quels sont les rapports de la démonstration à la définition? Et si la démonstration ne peut nous donner l'essence directement, comment contribue-t-elle du moins à nous la fournir? D'abord, voyons quel est le nombre des questions que nous pouvons nous poser ; et quelle est la nature de ces questions. Un sujet étant donné avec son attribut, il n'y a que quatre questions possibles : le sujet a-t-il cet attribut? Pourquoi l'a-t-il? Ce sujet existe-t-il? et enfin qu'est-il essentiellement? Ces questions sont précisément aussi nombreuses que les espèces de connaissances même que nous pouvons avoir des choses : d'un sujet seul en effet nous ne pouvons savoir que l'existence et l'essence, de même que d'un sujet joint à l'attribut, nous ne pouvons savoir que l'existence et la cause de cet attribut. Prenons un exemple : s'agit-il de savoir si le soleil s'éclipse ou ne s'éclipse pas? Nous cherchons si l'attribut de l'éclipse est dans le sujet; et la preuve, c'est qu'une fois que nous savons que le soleil s'éclipse, nous nous tenons pour satisfaits et n'allons pas au-delà. Une fois que nous savons qu'il s'éclipse, nous pouvons nous demander pourquoi il s'éclipse. Et de même pour le sujet considéré en lui seul et sans attribut : le centaure existe- XC t-il? Dieu existe-t-il? Voilà la question de l'existence simple du sujet. Une fois que nous savons que Dieu existe, nous nous demandons : qu'est-ce que Dieu? Voilà la question de l'essence. Telles sont les quatre questions qu'on peut se poser, et les quatre ordres de connaissance qu'on peut acquérir. On peut encore les diviser autrement. Lorsque nous cherchons à savoir l'attribut qu'a le sujet, et lorsque nous cherchons simplement l'existence du sujet, cela revient à chercher s'il y a un moyen terme ou s'il n'y en a pas. Et lorsque sachant que le sujet a tel attribut, ou qu'il existe, nous nous demandons la cause de cet attribut, l'essence de ce sujet, cela revient à chercher quel est ce moyen-terme d'abord trouvé. Ainsi donc les quatre questions transportées au moyen se réduisant à deux: y a-t-il un moyen terme? quel est ce moyen terme? Or le moyen terme, c'est la cause, ici de l'attribut, là de l'essence; et les deux questions ainsi réduites peuvent se transformer en celles-ci : y a-t-il une cause? quelle est cette cause ? soit de l'attribut, soit de l'essence du sujet. En définitive, les quatre questions se réduisent donc à une seule, la question de la cause, soit qu'il s'agisse de savoir simplement si la chose est ou n'est pas, soit qu'il XCI s'agisse de savoir si elle a ou n'a pas tel attribut. Évidemment dans tous ces cas, l'essence du sujet et la cause de l'attribut se confondent. Ainsi, par exemple : qu'est-ce que l'éclipse? C'est l'obscurcissement de la lumière de la lune par suite de l'interposition de la terre. Et pourquoi la lune s'éclipse-t-elle? quelle est la cause de l'éclipse? C'est que la lumière s'obscurcit par l'interposition de la terre. Qu'est-ce que l'harmonie musicale? C'est un rapport numérique d'un son grave et d'un son aigu? Pourquoi le grave et l'aigu s'accordent-ils? C'est qu'ils ont entre eux un rapport numérique. Ce qui prouve bien que la recherche entière ne porte que sur le moyen terme, c'est la solution même des questions où le moyen terme est accessible aux sens et peut être connu directement par eux. Si nous pouvions nous placer dans la lune, nous n'aurions rien à nous demander sur l'éclipse, ni si elle a lieu, ni si elle atteint la lune, ni pourquoi elle a lieu, ni enfin ce qu'elle est. Tout cela nous serait évident par la sensation seule ; et la sensation nous amenant à connaître l'universel, nous verrions nettement que la terre est interposée, que la lumière de la lune disparaît, que c'est l'interposition de la terre qui en est la cause, et que l'éclipse en un mot n'est pas autre chose que XCII l'interposition de la terre entre le soleil qui donne la lumière et la lune qui la reçoit. Ainsi donc, la question de l'essence se confond avec la question de la cause pour les accidents, pour les attributs, tout aussi bien que pour les substances, pour les sujets; et toute question se réduit au fond à la recherche d'un terme moyen. Mais comment l'essence peut-elle être connue? Comment la définition peut-elle être ramenée à la démonstration? Qu'est-ce que la définition? et quelles sont les choses auxquelles elle s'applique? Voilà des questions qu'il nous faut résoudre. Mais avant d'en donner la solution vraie, il est un certain nombre de points qu'il convient d'éclaircir préalablement. Voici le premier : la démonstration et la définition se confondent-elles? Peut-on savoir par démonstration et par définition une même chose considérée sous un même rapport? ou bien cela est-il impossible, et la définition est-elle complètement isolée de la démonstration ? Ce qui semble prouver que toute démonstration ne peut pas se convertir en définition, c'est que la forme de l'une n'est pas identique à celle de l'autre. La définition de l'essence n'est jamais qu'universelle et affirmative, tandis que parmi les syllogismes démonstratifs, il en est qui sont privatifs, d'autres qui XCIII ne sont pas universels : et par exemple, il n'y a que des privatifs dans la seconde figure, et il n'y en a pas un seul universel dans la troisième. En second lieu, on ne peut pas même dire que tous les syllogismes démonstratifs, universels et affirmatifs, puissent se changer en définition. Ainsi cette conclusion démontrée, universelle et affirmative : Tout triangle a la somme de ses angles égale à deux angles droits, ne saurait devenir une définition. En effet, si l'on pouvait savoir par définition, une proposition démontrable, il s'ensuivrait qu'on saurait un démontrable sans démonstration : or savoir une chose démontrable, c'est en avoir la démonstration et non point la définition. En troisième lieu, on peut se convaincre que c'est par démonstration et non par définition qu'on arrive à connaître les attributs essentiels ou accidentels d'un sujet. Enfin, ces attributs n'étant point des substances, il est évident que la définition ne peut les faire connaître, puisqu'elle ne s'applique qu'aux substances. Ainsi donc, par les quatre motifs qui précèdent, on doit dire qu'il n'y a pas définition pour tout ce dont il y a démonstration. Mais l'on peut demander encore : S'il n'y a point définition pour tout ce dont il y a démonstration, y a-t-il du moins démonstration pour tout ce dont XCIV il y a définition? Pas davantage : et par un motif tout à fait pareil à l'un de ceux qu'on vient d'énumérer. Si tout ce qui peut être défini pouvait aussi être démontré, il s'ensuivrait comme plus haut cette absurdité, qu'une chose démontrable pourrait être sue sans démonstration. C'est qu'en effet une chose une en tant qu'une ne peut être sue que d'une seule façon. Ajoutons cet argument plus grave encore, que les principes des démonstrations elles-mêmes sont des définitions; et les principes, comme on l'a dit, ne peuvent être démontrés. De deux choses l'une, ou les principes seront démontrables, et alors il faudra démontrer aussi les principes des principes, et cela à l'infini : ou bien les primitifs mêmes seront des définitions indémontrables. Ainsi, toute définition n'est pas plus une démonstration que toute démonstration n'est une définition. Il ne faut pas croire davantage qu'en limitant cette assertion, on la rendra plus vraie : et que si toutes les démonstrations ne sont pas des définitions, il en est du moins quelques-unes qui le sont. Il n'en est rien ; et l'on peut dire d'une manière générale qu'aucune démonstration n'est une définition ; et le motif c'est que la démonstration ne s'applique pas du tout au même objet que la définition. La définition ne recherche XCV que l'essence; la démonstration, au contraire, cherche si peu l'essence, qu'elle la suppose toujours ou l'admet toute faite. Ainsi les mathématiques posent, comme l'une de leurs premières hypothèses, l'essence de l'unité, l'essence de l'impair, etc. De plus, la démonstration attribue toujours une chose à une autre chose, puisqu'elle a pour but de prouver que le sujet a tel ou tel attribut. Rien de pareil dans la définition. La définition n'attribue jamais à une chose une chose autre qu'elle-même ; la définition est bien attribuée tout entière au défini : mais jamais dans la définition une partie n'est attribuée à une partie; et, par exemple, dans la définition de l'homme : animal bipède etc., bipède n'est pas plus attribué à animal qu'animal ne l'est à bipède : et de même dans la définition du cercle, figure plane, etc., figure n'est pas plus attribué à plane que plane n'est attribué à figure. Enfin la définition fait connaître l'essence du sujet : la démonstration n'en donne que l'attribut : or, pour deux choses différentes, le mode de connaissance est absolument différent, si ce n'est quand l'une n'est qu'une partie de l'autre : ainsi, c'est par une démonstration identique au fond qu'on sait que l'équilatéral a ses angles égaux à deux droits, quand il a été démontré que tout triangle jouit XCVI de cette propriété : mais l'attribut et l'essence ne sont pas dans ce rapport que l'un soit une partie de l'autre. En résumé, on vient de prouver qu'il n'y a point démonstration pour ce dont il y a définition, ni définition pour ce dont il y a démonstration ; il s'ensuit qu'on ne peut avoir à la fois la définition et la démonstration d'une même chose, que la démonstration et la définition n'ont pas du tout la même valeur, et que l'une n'est pas comprise dans l'autre, pas plus que le sujet de l'une n'est compris dans le sujet de l'autre.
Mais voyons à quelles conditions on
pourrait faire le syllogisme et la démonstration de l'essence? Voici
la seule forme que ce syllogisme pourrait recevoir. Le grand extrême
devant être la définition du petit extrême dans la conclusion, et la
définition étant propre au défini et de même étendue que lui, il
faudrait nécessairement que le moyen terme destiné à les unir fût
égal au grand extrême dans la majeure, égal au petit extrême dans la
mineure, puisque l'un et l'autre extrême sont égaux dans la
conclusion. Ainsi donc, les trois termes indispensables du
syllogisme seraient de même extension. Pour que le grand extrême
soit dans la conclusion la définition du petit, il faut qu'il soit
attribué essentiellement au
XCVII
moyen, comme le moyen est attribué essentiellement au petit extrême
dans la mineure. S'il en était autrement, si l'on ne redoublait pas
dans les prémisses la définition, elle ne pourrait plus être
conclue; car si le grand extrême était la définition du moyen dans
la majeure, et que le moyen ne le fût pas à son tour du petit
extrême dans la mineure, il serait impossible de mettre dans la
conclusion que le grand extrême est la définition du petit. Ainsi
donc, si les deux prémisses ont la définition, la définition
cherchée sera dans la mineure avant d'être dans la conclusion,
c'est-à-dire qu'on fera une pétition de principe ; car on ne saurait
prétendre qu'une même chose puisse avoir plusieurs définitions ; et
le petit extrême, étant déjà défini dans la mineure, doit l'y être
absolument de même que dans la conclusion. C'est ce que n'ont pas vu
certains philosophes qui prétendaient démontrer une définition de
l'âme en disant : Tout ce qui est cause de vie pour soi-même est un
nombre qui se meut lui-même : or l'âme est pour elle-même cause de
vie ; donc l'âme est un nombre qui se meut lui-même. Ce -n'est point
là une définition réelle ; ce n'est au fond qu'une pétition de
principe. En effet, la définition de l'âme est déjà dans la mineure,
puisque cette définition est la propriété
XCVIII
d'être cause de sa propre vie, et que cette propriété même est, dans
la majeure, donnée pour identique à la définition conclue. Il ne
suffit donc pas, pour démontrer la définition, que l'attribut soit
dans la majeure essentiel au moyen, comme le moyen est dans la
mineure essentiel au sujet : il faut que le grand extrême soit la
définition du moyen terme et que le moyen terme soit celle du sujet.
Par exemple, si dans la majeure on dit : Tout animal est corps, et
dans la mineure : Tout homme est animal, les deux attributs, celui
d'animal comme celui d'homme, sont bien essentiels, mais on conclut
seulement que tout homme est corps. Est-ce là la définition de
l'homme? pas du tout : corps est un attribut essentiel de l'homme;
mais ce n'est pas sa définition : car ce n'est pas là tout l'homme.
Donc, en résumé, ou l'on ne démontrera pas l'essence ; ou, si on la
démontre, ce sera comme nous venons de le dire, en faisant une
pétition de principe. Le syllogisme étant reconnu impuissant pour
démontrer l'essence, s'adressera-t-on à la méthode de division? Mais
déjà nous l'avons vu en traitant des figures du syllogisme, la
méthode de division n'arrive même pas à conclure nécessairement.
Elle n'avance que de concessions en concessions : elle interroge et
fait dépendre ses
XCIX
solutions des réponses qu'elle obtient. Le syllogisme au contraire
conclut de toute nécessité, que l'interlocuteur le veuille ou ne le
veuille pas. Les prémisses posées, on ne peut repousser la
conclusion. Voyez la méthode de division : si elle cherche à définir
l'homme, elle demande d'abord : L'homme est-il un être animé ou
inanimé? Elle suppose qu'il est animé, mais elle ne le prouve pas.
Puis, divisant les animaux comme elle a divisé tout à l'heure les
êtres, elle demande encore : L'homme est-il un animal terrestre ou
aquatique? Elle admet par supposition qu'il est terrestre; mais elle
ne le prouve pas davantage. Sa conclusion n'a rien de nécessaire,
que d'ailleurs les termes soient au nombre de deux comme dans
l'exemple cité, ou qu'ils soient plus nombreux. Par la méthode de
division, on n'arrive point à conclure syllogistiquement, même dans
le cas où la démonstration régulière serait cependant possible. En
admettant même que toute cette collection de différences que réunit
la division, soit vraie, il resterait encore à démontrer que c'est
bien là la définition du sujet. L'homme est bien, si l'on veut, un
animal terrestre, etc., mais qu'est-ce qui démontre que ce soit là
sa vraie définition? Qui prouve qu'on n'a point ajouté quelques
différences mutiles, qu'on n'en a point
C
omis d'essentielles, qu'on n'a point méconnu la substance? Ce sont
là des erreurs dans lesquelles La division et le syllogisme ne pouvant donner la définition de l'essence, on a pensé qu'on pourrait l'obtenir en plaçant la définition même de la définition dans la majeure du syllogisme. Par exemple, on dirait, en supposant qu'on acceptât cette définition de la définition : La proposition composée de tous les attributs propres et essentiels d'une chose est la définition de cette chose ; or telle proposition, qu'on énoncerait, est la réunion de tous les attributs propres et essentiels de telle chose : donc cette proposition est la définition de cette même chose. Mais, on le voit, la définition qu'on croirait démontrer ainsi ne serait qu'une pétition de principe; car la définition est posée hypothétiquement dans la mineure. De plus, est-ce qu'on a jamais besoin dans le syllogisme, pour former la conclusion, de donner la définition du syllogisme? Pourquoi donc pour la définition qu'on prétend conclure, devrait-on donner la définition de la définition? Dans le syllogisme, on ne pose que deux propositions dont l'une est un tout relativement à l'autre qui n'en est qu'une partie, et l'on conclut. Si l'adversaire prétend qu'on n'a point fait un CII syllogisme, on lui prouve qu'on en a fait un, en lui donnant la définition du syllogisme : mais cette définition ne fait point partie du syllogisme initial. De même aussi, l'adversaire contestant qu'on a fait une définition véritable, on le réfute en définissant la définition elle-même ; mais cette définition de la définition n'a que faire dans la définition qu'on cherchait d'abord; elle n'y doit point figurer. Pourra-t-on davantage, au lieu de la définition de l'objet qu'on étudie, poser la définition de son contraire ? Et par exemple, en admettant que la définition du mal soit d'être divisible, pourra-t-on en conclure que la définition du bien, contraire du mal, soit d'être indivisible, contraire de divisible? Non sans doute; car ici la pétition de principe est encore évidente. On pose l'essence pour démontrer l'essence. Il est vrai que l'essence est différente de part et d'autre ; mais elle est également inconnue : l'une est réciproque à l'autre, et l'on peut démontrer tout aussi bien la définition du mal par celle du bien que celle du bien par celle du mal : or, c'est ce qui ne doit jamais avoir lieu dans les démonstrations régulières, où l'on procède toujours du connu à l'inconnu. De plus, cette méthode de la définition du contraire a le même inconvénient que la méthode de division. Pourquoi l'homme CIII est-il animal bipède terrestre, et non pas animal et bipède et terrestre? Qui nous prouve que la totalité des attributs forme une unité et non point une simple agrégation? Qui nous le prouve également dans la définition du contraire? Il y a plus ; ce n'est pas seulement le syllogisme, et la méthode de division, et la définition de la définition, et la définition des contraires, qui ne peuvent démontrer l'essence; il faut ajouter que la définition elle-même n'y est pas moins impuissante. Voilà ce qu'il nous reste à prouver. En premier lieu, la définition ne démontre, ni comme le syllogisme qui, partant de certains principes accordés, conclut nécessairement que, telle chose étant, telle autre aussi doit être; ni comme l'induction qui, procédant du particulier à l'universel, conclut que tous les sujets sont ainsi, attendu qu'aucun n'est autrement. Or, si la définition ne procède ni comme le syllogisme ni comme l'induction, quelle marche suit-elle donc? Ce n'est pas certainement en la faisant toucher aux sens, au doigt et à l'œil, qu'elle nous fait connaître l'essence. En second lieu, pour connaître l'essence, ne faut-il pas connaître aussi l'existence? Pour savoir ce qu'est une chose, ne faut-il pas savoir aussi qu'elle est? Car il faut le remarquer, pour une chose qui n'est pas on peut CIV bien savoir la définition, le sens du mot qui la désigne, on ne peut pas savoir ce qu'elle est, et par exemple il serait impossible de savoir ce que c'est qu'un bouc-cerf. Or la définition, non plus que la démonstration, n'indique pas plusieurs choses à la fois : elle ne fournit qu'une seule notion. Comment donc pourrait-elle nous dire à la fois ce qu'est l'homme et que l'homme est? questions tout à fait distinctes. C'est la démonstration seule, et non point la définition, qui nous apprend que la chose est ; mais l'être n'est l'essence de quoi que ce soit, parce que l'être n'est jamais le genre. L'exemple des sciences prouve que la démonstration ne dit jamais ce qu'est la chose et qu'elle dit uniquement que la chose est telle chose. Ainsi la géométrie suppose la définition du triangle ; et elle démontre ensuite que le triangle a telle propriété. Que démontrera donc la définition de l'essence? ou bien pourra-t-on dire qu'elle démontre l'essence sans démontrer l'existence? ce qui est absurde. Mais il est évident que la définition ne prouve jamais que la chose est : elle ne prouve même pas qu'elle soit possible; et l'on peut toujours pour toutes les définitions données, suivant les méthodes ordinaires, demander par exemple : Pourquoi la définition du cercle s'applique-t-elle au cercle et CV non point à tout autre objet? Pourquoi le cercle existe-t-il? Si donc la définition ne démontre pas l'essence de la chose, il reste qu'elle explique la signification du mot qui désigne cette chose. Mais c'est en quelque sorte réduire la définition à rien que de la restreindre dans ces limites. D'abord c'est l'appliquer à des choses qui ne sont pas ; car les mots peuvent exprimer aussi des choses qui n'ont aucune réalité, et par conséquent aucune essence. Il s'ensuivrait que tout mot, tout discours serait une définition : nous ne ferions que des définitions en parlant; le mot d'Iliade serait à lui seul toute une définition du grand poème qu'il représente. Enfin, il n'est pas de science qui démontre le sens des mots; et la définition, base des sciences, ne le démontre pas plus qu'elles. — Il semble donc résulter de toutes les discussions qui précèdent, que le syllogisme et la définition sont fort distincts l'un de l'autre ; que le syllogisme et la définition ne peuvent s'appliquer au même objet; que la définition ne démontre pas, et que la définition, pas plus que le syllogisme, ne peut nous faire connaître l'essence. Qu'y a-t-il de vrai, qu'y a-t-il de faux dans ces théories? Qu'est-ce que la définition? Peut-on démontrer ou définir l'essence de quelque manière? ou ne le peut-on en aucune façon? Re- CVI marquons d'abord que la question de l'essence, se confondant, ainsi que nous l'avons vu, avec la question de la cause de l'existence, il semblerait qu'il est possible de mettre la définition dans la conclusion, en prenant pour moyen terme la cause. Le syllogisme se formerait dans la première figure, puisqu'il est affirmatif et universel. C'est bien là, si l'on veut, une définition démontrée : mais il y a toujours au fond une pétition de principe, attendu que le moyen terme, pour conclure l'essence, doit être une essence aussi : il y aura donc, dans ce syllogisme, deux définitions de la chose, l'une qu'on démontrera, l'autre qu'on prendra pour indémontrable. Mais ce n'est là qu'une démonstration apparente, acceptable seulement à la dialectique qui s'en contente ; elle ne suffit pas à la science, laquelle exige plus qu'une démonstration purement logique. Quelle est donc la démonstration vraie de l'essence, et comment est-elle possible? Pour donner à cette question une réponse qui échappe à toutes les objections antérieures, reprenons-la dès le principe. De même que parfois, sachant qu'une chose est, nous cherchons pourquoi elle est, de même aussi il arrive que nous connaissons simultanément l'existence et la cause de la chose. Mais il est certain que nous ne pouvons jamais connaître pourquoi CVII une chose est avant de savoir qu'elle est. Évidemment encore, nous ne pouvons jamais savoir l'essence d'une chose sans savoir aussi son existence : car il est de toute impossibilité de connaître ce qu'une chose est, quand nous ne connaissons pas qu'elle est. Or nous connaissons qu'une chose est tantôt par son accident, tantôt par sa cause. Ainsi, quand nous disons que le tonnerre est du bruit dans les nuages, que l'éclipse est une privation de lumière, que l'homme est un animal, que l'âme se meut elle-même, nous connaissons ces choses non point par la cause, mais seulement d'une façon accidentelle et incomplète. Quand nous ne savons les choses que de cette manière, nous ne pouvons en atteindre l'essence, puisque nous ne savons même pas, en réalité, si elles sont : et chercher ce qu'est une chose sans savoir qu'elle est, c'est précisément ne rien chercher. Au contraire, quand nous savons les choses par leur cause, nous pouvons plus aisément arriver à l'essence : car, autant nous savons de l'existence, autant nous savons de l'essence. Prenons d'abord le cas où nous connaissons la cause; et, par exemple, supposons que nous sachions que l'interposition de la terre est la cause de l'éclipse de la lune : la lune étant le petit extrême ou le sujet, l'éclipse étant le grand CVIII extrême ou l'attribut, et l'interposition étant la cause ou moyen terme. Demander si la lune s'éclipse ou non, c'est demander si l'interposition a lieu ou n'a pas lieu; en d'autres termes, c'est demander si la cause de l'éclipse se produit, et si elle se produit, nous disons que l'éclipse a lieu aussi. Ou bien soit encore à savoir, si le triangle a ou n'a pas la somme de ses angles égale à deux angles droits, et quelle est, des deux parties de cette contradiction, la partie vraie et la partie fausse? Si c'est par la cause propre qu'on sait cette propriété du triangle, on sait alors non seulement qu'il la possède, mais pourquoi il la possède. Si au lieu de savoir par la cause, comme dans les deux cas qui précèdent, on ne sait la chose que par un de ses effets, on sait seulement alors que la chose est ; mais on ignore pourquoi elle est. Reprenons l'exemple de l'éclipse, et au lieu de l'interposition de la terre qui est la vraie cause, prenons un effet qui suit l'éclipse ; et cet effet, c'est, si l'on veut, que la lune, toute pleine qu'elle est, ne peut plus projeter l'ombre des objets, comme elle le fait ordinairement quand il n'y a point de corps interposé entre elle et nous. Prenons cet effet pour moyen terme ; que démontrerons-nous ? Nous démontrerons que, la lune ne projetant plus l'ombre des objets, c'est CIX qu'elle est éclipsée : mais nous n'aurons pas démontrée pourquoi elle l'est. Nous savons bien que l'éclipse est : nous ne savons pas ce qu'elle est. Il nous reste donc à chercher la cause, c'est-à-dire à savoir ce qu'est cet effet observé; à savoir que la lune ne projette plus l'ombre des objets. Est-ce une interposition de la terre? est-ce une mutation de la lune elle-même? est-ce une intermittence de sa lumière? Or la nature de cet effet, la cause qu'on cherche, est la définition même du grand extrême; et, par exemple, la définition de l'éclipse se tire de l'interposition même de la terre. Ainsi, la démonstration qui fait connaître! pourquoi la chose est, fait connaître aussi ce qu'elle est ; en d'autres termes, la même démonstration donne la cause et l'essence. Autre exemple:. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est du feu qui s'éteint dans les nuages. Pourquoi tonne-t-il? parce que le feu s'éteint dans les nuages. Le syllogisme qui apprendra la cause du tonnerre, en apprendra aussi l'essence. Si, du reste, le moyen terme avait besoin lui-même d'être démontré, c'est-à-dire, si la cause, qui doit donner la définition, avait elle-même une cause, il faudrait remonter de moyens termes en moyens termes, de causes en causes, de définitions en définitions, jusqu'au terme immédiat duquel vien- CX draient tous les autres. Telle est la véritable méthode pour obtenir la définition, pour connaître l'essence. Comme on le voit, il n'est pas possible de dire qu'il y ait syllogisme non plus que démonstration de l'essence ; et c'est cependant par syllogisme et par démonstration que l'essence est connue. Ainsi donc, on peut dire tout à la fois, comme nous l'avons indiqué, en exposant les deux systèmes opposés, qu'on ne saurait connaître l'essence sans la démonstration, pour les choses qui ont une cause, et que pourtant il n'y a pas démonstration de l'essence. La définition se forme des éléments mêmes du syllogisme démonstratif, mais elle n'est jamais conclue. Nous venons de dire que cette théorie de la définition tirée d'une démonstration, ne s'applique qu'aux choses qui en ont une autre pour cause. Il s'ensuit qu'entre les définitions, qu'entre les essences, il y a les mêmes distinctions à faire qu'entre les choses. Ainsi, certaines définitions sont immédiates et doivent être considérées comme principes qu'on pose par hypothèse, comme l'arithmétique suppose la définition et l'existence de l'unité ; et que d'autres définitions, au contraire, sont obtenues par la démonstration, comme nous l'avons indiqué. Ainsi, les définitions des substances, qui sont par elles-mêmes, CXI qui n'ont d'autres causes qu'elles-mêmes, sont de la première espèce : les définitions des accidents, des attributs, qui n'ont d'être que par une cause étrangère à eux, sont de la seconde. Seulement ce n'est pas l'essence qu'on démontre ; ce n'est pas l'essence qu'on obtient dans la conclusion : mais sans le syllogisme démonstratif cependant, l'essence ne serait pas connue. Maintenant, et instruits par tout ce qui précède, nous pouvons nous poser cette question et la résoudre. Qu'est-ce que la définition? D'abord, il y a une définition commune qui, sous apparence d'expliquer l'essence de la chose, ne fait qu'expliquer le mot qui la désigne. C'est la définition nominale : et, par exemple, c'est la définition du triangle en tant que triangle. Cette espèce de définition ne nous fait point connaître l'essence : car elle ne nous apprend ni la cause ni même l'existence de la chose. Or, il nous est très difficile de savoir pourquoi une chose est, quand nous ne savons même pas qu'elle est; et nous avons vu que la difficulté tient ici, à ce que nous ne savons alors qu'accidentellement si la chose est ou n'est pas. Du reste, la définition forme bien une unité comme la démonstration ; car l'unité peut résulter, d'une part, de l'enchaînement des parties : et telle est l'unité de l'Iliade ; CXII et d'autre part, de l'identité des deux parties mises en rapport, dont l'une s'applique essentiellement à l'autre. Ainsi, il y a une première espèce de définition, la définition nominale, qui ne donne pas l'essence. Une seconde espèce est celle qui indique la cause de la chose, et qui par là en fait vraiment connaître l'essence. La première définition exprime bien quelque chose, mais elle ne le démontre pas. La seconde, au contraire, est évidemment, d'après ce que nous avons dit, comme une démonstration de l'essence, ne différant de la démonstration véritable que par la position des termes, qui, du reste, sont les mêmes. Il y a bien quelque différence à dire pourquoi le tonnerre a lieu, et à dire ce que c'est que le tonnerre ; car, d'un côté, on dit que le tonnerre a lieu parce que le feu s'éteint avec bruit dans les nuages : et de l'autre, que le tonnerre est le bruit du feu qui s'éteint dans les nuages ; mais au fond la proposition est la même, la forme seule diffère. Ici c'est une démonstration continue qui se poursuit dans les deux prémisses et dans la conclusion qui la composent ; là, c'est une définition proprement dite. Remarquons en outre que cette définition du tonnerre : Le tonnerre est un bruit dans les nuages, est la conclusion même de la démonstration dont on CXIII pourrait tirer l'essence du tonnerre. Au contraire, pour les termes immédiats, pour les substances, où il n'y a pas de moyen terme possible, la définition est la thèse indémontrable de l'essence. Donc, en résumé, voilà trois espèces de définitions bien distinctes : l'une, qui est cette thèse indémontrable de l'essence : l'autre, qui est ce qu'on peut appeler le syllogisme de l'essence, et qui ne diffère du syllogisme que par l'arrangement des termes : la troisième enfin, qui est la conclusion de la démonstration de l'essence. De ces trois définitions, la première est le principe d'une démonstration, la seconde est une démonstration sous forme différente, et la dernière est une conclusion de démonstration. — En récapitulant cette longue discussion sur la démonstration et la définition de l'essence, nous pouvons dire que nous avons fait voir : 1° comment il y a démonstration de l'essence et comment cette démonstration n'est pas possible ; 2° quels sont les objets auxquels cette démonstration peut s'appliquer, et ceux auxquels elle n'est point applicable, les accidents d'une part et les substances de l'autre ; 3° que la définition est de plusieurs espèces ; 4° comment la définition fait connaître et comment elle laisse ignorer l'essence ; 5" à quels termes s'applique la définition tirée de la démons- CXIV tration et à quels termes elle ne s'applique pas, médiats dans la première hypothèse, immédiats dans la seconde ; 6° enfin, nous avons fait voir quels sont les rapports de la définition et de la démonstration, et jusqu'à quel point elles peuvent être obtenues toutes deux à la fois pour un seul et même objet.
SECTION SECONDE.
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CAUSES EMPLOYÉES
COMME MOYENS TERMES DANS LA DÉMONSTRATION.
En parlant d'abord de la science, puis ensuite de la démonstration et de la définition, nous avons vu de quelle importance était l'idée de la cause pour les unes et pour les autres. Or la cause peut être de quatre espèces qu'il s'agit de bien distinguer entre elles. C'est, en premier lieu, la cause essentielle, celle qui fait que la chose est ce qu'elle est, et qui entre dans la définition ; c'est en second lieu, la cause matérielle, qui, étant posée, entraîne nécessairement à sa suite l'exis- CXV tence de certains effets : troisièmement, c'est la cause motrice, qui renferme l'origine première du mouvement : c'est enfin la cause finale, celle en vue de laquelle l'acte se produit. Chacune de ces causes, quelque différentes qu'elles soient toutes les quatre, peut servir de moyen terme également. Voyons pour la cause matérielle. D'abord on peut dire que, dans le syllogisme, le moyen est comme la matière de la conclusion : car une fois le moyen posé, la conclusion s'ensuit nécessairement : ce qui n'empêche pas que le moyen seul soit insuffisant, et qu'il faille toujours au moins deux propositions, pour que la conclusion soit possible. Prenons un exemple géométrique. Pourquoi l'angle tracé dans la demi-circonférence est-il un angle droit? en d'autres termes, quelle est la condition qui, étant posée, fait que nécessairement cet angle est droit? Supposons qu'on prenne ici pour moyen terme la moitié de deux angles droits : du moment qu'il est prouvé que l'angle de la demi-circonférence est la moitié de deux droits, il s'ensuit nécessairement qu'il est droit. Ainsi, ce moyen terme : la moitié des deux angles droits, est la cause matérielle qui fait que l'attribut-droit est nécessairement appliqué au sujet , à l'angle de la demi-circonférence. Or la moitié de deux angles droits CXVI est précisément la définition de l'angle droit, c'est-à-dire du grand extrême ; et le terme moyen est ici encore la cause de l'essence. Passons à la cause motrice, à la cause efficiente. Pourquoi les Mèdes ont-ils fait la guerre aux Athéniens? Quelle est la cause de la guerre médique? La cause efficiente , l'origine de cette guerre, fut l'attaque de Sardes par les Athéniens unis aux habitants d'Érétrie ; car c'est là ce qui provoqua l'invasion de la Grèce. Prenons pour moyen terme : attaquer les premiers : Ceux qui attaquent les premiers s' exposent à la guerre; or, les Athéniens ont les premiers attaqué les Perses ; donc les Athéniens se sont exposés à la guerre. On le voit, le terme moyen est ici la cause efficiente, la cause motrice ; car c'est la provocation des Athéniens qui a motivé la guerre médique. Ainsi la cause motrice, tout comme la cause matérielle, peut servir de terme moyen. Même observation pour la cause finale. Pourquoi se promène-t-on après dîner? c'est pour se bien porter. Pourquoi construit-on une maison? pour y abriter les meubles et les habitants. La santé d'une part, la conservation des meubles de l'autre, voilà des causes finales. On peut les faire servir de moyens termes; et, par exemple, l'on dira : On se porte bien quand les aliments ne flottent pas à l'entrée CXVII de l'estomac ; or, la promenade, après dîner, fait qu'on se porte bien ; donc la promenade, après dîner, fait que les aliments ne flottent pas à l'entrée de l'estomac. On peut remarquer que si la santé est la cause finale, en vue de laquelle on se promène après dîner, la bonne digestion des aliments descendus au fond de l'estomac est la cause efficiente de la santé. Or, cette cause efficiente peut être prise aussi pour moyen terme, et l'on aurait alors : Une digestion régulière donne la santé ; or, se promener après dîner procure une digestion régulière ; donc se promener après dîner procure la santé. Mais la digestion régulière est la définition de la santé, de même que la santé est la définition de la digestion régulière : seulement la santé est la cause finale, en vue de laquelle on cherche à bien digérer les aliments dont on se nourrit , tandis que la digestion régulière est la cause efficiente de la santé. Ainsi, la seconde démonstration s'est faite par un simple déplacement des définitions de l'un et l'autre terme. Il y a cependant cette différence entre ces deux genres de causes, que l'ordre de la génération des termes n'est pas le même. Dans la démonstration par la cause finale, le sujet est le premier, l'attribut le second, et le terme moyen le dernier ; tandis que, pour la cause efficiente, CXVIII le sujet est le premier, le moyen terme le second, et l'attribut le dernier ; car il faut se promener après dîner pour que la digestion soit régulière ; et la digestion doit être régulière pour que le corps soit en santé. Il peut d'ailleurs fort bien se faire qu'un seul et même effet ait plusieurs causes qui serviraient au besoin à le démontrer ; et, par exemple, une cause finale et une cause matérielle ou nécessaire. Pourquoi la lumière traverse-t-elle la lanterne ? On peut répondre en premier lieu, en considérant la cause matérielle, que ce qui a les parties plus ténues passe au travers de pores plus larges : et en second lieu, si l'on considère la cause finale, on peut répondre que la lumière traverse la lanterne pour éclairer et assurer notre marche dans l'obscurité. Ceci s'applique aux effets purement accidentels et passagers aussi bien qu'aux effets permanents et éternels. Ainsi le tonnerre paraît nécessaire , si on le regarde comme le bruit causé par l'extinction du feu dans les nuages: ou bien ce n'est qu'un effet produit en vue d'une cause finale , si, comme le veulent les disciples de Pythagore, il est une menace adressée par les dieux aux âmes perverses qui habitent le Tartare. C'est surtout dans les phénomènes naturels, qu'on peut reconnaître l'existence simultanée de ces deux espèces de CIX causes ; car tantôt la nature fait les choses en vue d'un certain but , tantôt elle les fait par nécessité. C'est qu'en effet la nécessité est double : l'une selon la nature, selon la tendance naturelle des choses; l'autre, au contraire, violente et opposée à cette tendance. La pierre, par exemple, obéit à la nécessité, soit qu'elle monte en l'air , soit qu'elle tombe : mais la nécessité n'est pas la même dans l'un et l'autre cas. Pour les actes produits par la volonté de l'homme, la nécessité ne saurait intervenir comme pour certains faits naturels; mais le hasard peut y exercer de l'influence, bien qu'il n'en soit pas primitivement la cause. Ainsi, le succès, la santé, la vie même dépendent souvent du hasard, malgré tous nos désirs, tous nos efforts ; mais il est des actes humains qui lui échappent tout à fait ; et, par exemple, la maison que construit l'architecte, la statue que modèle l'artiste, ne sont des effets ni du hasard ni de la nécessité ; elles ont un but, et sont faites en vue d'une certaine fin. Loin de là, le hasard n'a jamais un but. La fin de l'art ou de la nature est toujours bonne, en ce sens que c'est pour cette fin que l'un et l'autre agissent. La cause, qui sert de moyen terme pour la démonstration , ne varie point avec les divers moments du temps : elle reste la même, soit que CXX l'effet soit passé, présent ou à venir. Seulement, pour un effet actuel la cause est actuelle ; elle est passée pour un effet passé ; elle est à venir pour un effet à venir. Ainsi, pourquoi l'éclipse a-t-elle lieu? c'est que la terre s'interpose. Pourquoi a-t-elle eu lieu? c'est que la terre s'est interposée. Pourquoi aura-t-elle lieu? c'est que la terre s'interposera. La cause , moyen terme de la démonstration , reste toujours , comme on le voit, l'interposition de la terre. Autre exemple : La congélation de l'eau cause la disparition entière de la chaleur. La glace se produit quand la chaleur disparaît totalement : elle se produira quand la chaleur disparaîtra ; elle s'est produite quand la chaleur a disparu. Ainsi la cause et l'effet sont toujours dans le même moment, si on les considère relativement à la démonstration. Mais il y a des effets qui ne se produisent pas simultanément à leurs causes. Les causes peuvent-elles servir aussi de moyens termes dans la démonstration, en supposant que l'effet et la cause , sans être simultanés , se suivent du moins immédiatement, c'est-à-dire, sans qu'il soit possible d'admettre aucun intervalle de temps entre l'un et l'autre? On supposerait alors pour un effet passé que la cause passée également , lui a été immédiatement antérieure; pour un effet à venir, CXXI que la cause le précédera immédiatement ; et pour un effet actuel, que la cause vient de le précéder immédiatement. Ce qu'il y a de certain ici , c'est qu'on peut toujours former le syllogisme en partant du terme qui est postérieur, c'est-à-dire, de l'effet ; car le principe du terme postérieur est toujours un terme antérieur à lui , soit pour le présent, soit pour le passé, soit pour l'avenir: mais on ne peut pas faire de syllogisme en partant du terme antérieur ; car de ce que la cause a été , il ne s'ensuit pas que l'effet ait eu lieu après elle, tandis qu'au contraire l'effet ne peut jamais avoir lieu sans que la cause ait eu lieu avant lui. Du moment qu'on admet entre la cause et l'effet un intervalle quelconque de temps, soit défini, soit indéterminé, il y a toujours un instant où la cause existe sans l'effet, et où l'on ne peut point par conséquent affirmer l'existence de cet effet, par cela seul que la cause existe. Ainsi la cause antérieure à son effet dans le passé, ne peut servir de moyen terme dans la démonstration : elle le peut encore bien moins dans l'avenir, et il est impossible de prouver par syllogisme démonstratif qu'une chose sera parce qu'une autre a été. Le moyen terme doit toujours être contemporain du grand extrême ; or , la cause passée et l'effet à venir appartiennent à des CXXII temps différents. Il n'y a donc point de continuité entre un fait actuel et un fait passé , de même qu'il n'y en a pas entre deux faits passés. Les faits passés sont des indivisibles, isolés les uns des autres, et qui ne se continuent pas plus que les points géométriques ne sont continus entre eux. Le fait actuel est divisible, le fait passé est indivisible ; et leur rapport est celui de la ligne au point : de même que dans la ligne il y a une infinité de points, de même on peut dire que dans le fait actuel et présent il y a une infinité de faits passés. Mais s'il n'y a point continuité entre la cause et l'effet non simultanés, il y a du moins succession de l'effet à la cause, et l'effet peut être pris pour moyen terme dans la démonstration, où il joue alors le rôle de cause purement syllogistique. L'existence de l'effet démontre l'existence antérieure de la cause, et comme principe de démonstration , l'effet devient alors cause de sa propre cause, en ce sens que sans lui elle ne pourrait pas être démontrée. Il ne faut pas croire du reste, qu'ici, entre la cause et l'effet non simultanés, il puisse y avoir une infinité de moyens termes, de même qu'entre deux points non continus, il peut y avoir une infinité de points. Il suffit qu'après la cause, on prenne, à quelque distance que ce soit dans le temps , le premier effet CXXIII par lequel elle s'est manifestée , pour que la proposition formée de l'effet comme sujet et de la cause comme attribut, soit une proposition immédiate. Entre la cause et l'effet par lequel on la démontre, il n'est point intervenu d'autre effet. Le raisonnement est du reste tout à fait semblable s'il s'agit de l'avenir au lieu du passé; et si la cause et l'effet doivent se produire au lieu de s'être déjà produits. Appliquons ceci à des exemples réels. Soit à démontrer cette conclusion : Si la maison a été construite, il faut nécessairement que les pierres aient été entièrement taillées. Entre les deux extrêmes , prenons pour moyen terme , les fondements ; et nous aurons alors ce syllogisme : Si les fondements de la maison ont été posés, c'est que les pierres ont été antérieurement taillées ; or, si la maison a été faite, c'est que les fondements ont été antérieurement posés ; donc, si la maison a été faite, c'est que les pierres ont été antérieurement taillées. On pourrait tout aussi bien démontrer par le même moyen terme, que, si la maison doit être faite, il faudra nécessairement que les fondements soient d'abord posés , etc. Ainsi, au passé comme au présent, on peut prendre l'effet postérieur à la cause pour démontrer cette cause; mais on ne peut jamais prendre la cause pour CXXIV démontrer l'effet, que lorsque l'un et l'autre sont simultanés. Reste enfin un troisième et dernier cas, c'est celui où la cause et l'effet se suivent de telle sorte que l'un engendre l'autre circulairement ; et pour citer un phénomène naturel , la pluie mouille la terre ; l'humidité de la terre forme les vapeurs ; les vapeurs forment les nuages, les nuages à leur tour produisent la pluie. C'est une sorte de génération circulaire ; mais ici encore, bien que tour à tour les effets puissent devenir causes, et les causes devenir effets, lorsqu'on démontre, c'est toujours l'effet qui sert à démontrer la cause, et jamais la cause qui sert à démontrer l'effet. Seulement ce qu'on prend comme cause peut tout à l'heure, dans une autre démonstration, être pris pour effet, et réciproquement. — Remarquons , pour terminer cette théorie sur les causes dans la démonstration, qu'il y a des sujets qui ont toujours leurs attributs, et qu'il y en a d'autres au contraire, qui, sans les avoir toujours, les ont cependant le plus ordinairement. Pour ces derniers sujets, la cause par laquelle on démontrera l'attribut, sera, comme lui, non d'existence perpétuelle, mais d'existence habituelle. Ainsi, l'homme arrivé à l'âge mûr a ordinairement de la barbe, mais non pas toujours ; la cause, quelle qu'elle soit , dont on se servira CXXV pour démontrer cet attribut sera comme lui le plus habituellement, mais elle ne sera pas plus que lui d'existence perpétuelle. Elle sera soumise à exception dans le sujet comme l'attribut lui-même. En effet, si la cause était perpétuelle , universelle, sans aucune limite de temps ni de sujet, l'attribut serait aussi de même; mais l'attribut n'est pas toujours, il n'est que le plus ordinairement ; donc la cause est comme lui simplement ordinaire, ce qui n'empêche pas que ces démonstrations n'aient comme les autres des principes immédiats et indémontrables. En résumé, voilà ce que nous avions à dire sur l'idée de la cause en tant qu'elle est employée dans la démonstration : traiter ce sujet avec plus de détail et dans toute son étendue , appartient à la théorie générale du mouvement , c'est-à-dire , à la Physique.
SECTION TROISIÈME.
THÉORIE DE LA DÉFINITION.
Nous devons encore, pour compléter les théories précédentes, nous occuper de quelques points relatifs à la définition et à la cause. Nous avons vu CXXVI plus haut qu'une espèce de définition se rapportait à la démonstration, et nous avons dit quels étaient les rapports de la définition de ce genre et de la démonstration ; mais nous avons dit aussi qu'il y avait des définitions qui ne tombaient point sous la démonstration , et qui , s'adressant soit à des sujets, soit à des attributs, étaient au contraire des principes de démonstration. Ces définitions sont ce que nous avons appelé la thèse indémontrable de l'essence. Y a-t-il en dehors de la démonstration une méthode régulière pour atteindre ces définitions, et quelle est cette méthode? voilà ce qu'il nous reste à chercher. Soit donc un sujet quelconque à définir. Nous remarquerons d'abord que, parmi les attributs qui peuvent appartenir à ce sujet, les uns sont plus étendus que lui, sans cependant dépasser le genre auquel appartient ce sujet. D'autres attributs au contraire dépassent le sujet et le genre tout à la fois; par exemple l'être est, si l'on veut, un attribut de la triade ; mais l'être appartient aussi à bien d'autres termes que le nombre, genre de la triade, et par conséquent il est hors du genre. Impair est bien également plus étendu que la triade ; car impair est l'attribut de bien des nombres autres que trois ; mais impair ne sort pas du genre, car il n'y a que le nombre qui soit CXXVII impair. Donc, pour définir la triade, il faudra prendre tous les termes , tous les attributs , dont la totalité sera d'extension égale au défini, bien que chacun d'eux, pris à part , puisse être plus étendu que lui. Ce sera là en effet l'essence de la triade. Ainsi la triade sera un nombre impair et premier, dans ce double sens que ce nombre ne sera ni le multiple d'autres nombres, ni formé d'autres nombres ; car trois n'a pas de diviseurs, et de plus il n'est formé que par le seul nombre deux, plus l'unité, qui n'est point un nombre. Nombre impair, premier dans les deux sens, telle sera la définition de la triade. L'attribut de nombre impair appartient à tous les nombres impairs et non pas seulement au nombre trois : l'attribut de premier dans les deux sens appartient à la dyade aussi bien qu'à la triade ; mais la réunion de ces attributs n'appartient qu'à la triade seule dont ils constituent la définition essentielle. Or les attributs essentiels et universels d'une chose sont nécessaires à cette chose, ainsi que nous l'avons vu plus haut : les attributs que nous venons d'énumérer sont essentiels et universels à la triade; ils lui sont donc nécessairement. J'ajoute qu'ils en constituent bien l'essence ou la définition. Si en effet ils n'en forment pas la définition, ils en sont un genre, que ce genre ait d'ailleurs ou CXXVIII n'ait pas un nom spécial. Ce genre, précisément parce qu'il est genre et qu'à ce titre il doit renfermer plusieurs espèces, sera donc plus étendu que la triade, et s'adressera, non pas seulement à la triade , mais encore à d'autres termes. Mais la collection d'attributs indiquée ne s'applique qu'à la triade en général ou si l'on veut à toutes les triades particulières. Cette collection d'attributs ne sera donc pas le genre de la triade, elle en sera uniquement la définition , l'essence; car l'essence est précisément pour chaque chose cette attribution dernière qui s'applique aux individus. Si, au lieu d'avoir à définir une espèce, comme dans l'exemple précédent, il s'agissait de définir un genre, le procédé serait tout à fait analogue. Il faudrait diviser ce genre en ses espèces les plus voisines, puis faire la définition de ces espèces suivant la méthode qu'on vient d'indiquer. On prendrait ensuite tous les attributs qui seraient communs aux espèces; et la collection de ces attributs communs formerait la définition du genre. Les attributs du genre seront donc évidents par les définitions spécifiques ; car ce sont ces définitions qui sont l'élément simple et le principe de tout le reste, puisque les attributs ne sont, directement et en soi, qu'aux individus dont se composent les espèces, et que c'est seulement CXXIX par les individus que ces attributs passent à l'espèce, et remontent enfin jusqu'au genre lui-même. La méthode de division, bien qu'elle soit impuissante à donner la définition, parce qu'elle ne conclut pas nécessairement, peut être ici de quelque utilité , pour arriver aux définitions du genre et des espèces suivant la méthode que nous indiquons. Il est vrai qu'elle fait toujours une pétition de principe, et qu'elle pose la totalité des attributs, sans plus de certitude que si on les admettait tout d'abord sans aucune division ; mais il faut dire aussi qu'elle a le mérite de mettre un ordre régulier dans la succession des attributs qu'elle fournit. Cette régularité a bien son importance ; et par exemple, il n'est pas indifférent, pour définir l'homme, de dire : animal bipède, ou bien bipède animal. La définition se compose toujours de deux parties dans l'unité totale qu'elle forme, le genre et la différence ; et il importe que le genre ne devienne pas la différence ni la différence le le genre. Un second mérite de la division, issu du premier, c'est qu'elle prémunit contre les omissions. Si en effet, le genre une fois donné, on prend des divisions inférieures au lieu des divisions mêmes de ce genre, on en sera sur-le-champ averti ; car le genre ne se partagera pas tout entier dans les deux différences contraires. CXXX. Qu'on ait à définir l'animal, par exemple. Si l'on dit : Tout animal a les ailes pleines ou divisées, on pourra s'apercevoir aisément qu'on se trompe, car tout animal n'est pas ailé; ailé n'est donc pas la première différence d'animal. La première différence d'animal est celle dans laquelle rentre tout animal. L'erreur est d'ailleurs manifeste, soit qu'on sorte du genre, soit qu'on reste dans le genre. La méthode de division a donc cet avantage qu'elle nous avertit de cette erreur , tandis que, si on ne la suit pas , on se trompe presque nécessairement sans que rien puisse nous en faire apercevoir. Du reste, il n'est pas du tout besoin, comme on l'a prétendu, pour définir ou diviser une chose, de connaître toutes les autres choses. Il est impossible, dit-on , de connaître une chose sans les différences qui la séparent des autres ; et il n'est pas plus possible de connaître les différences, si l'on ne connaît pas toutes les choses ; car, ajoute-t-on, la définition sera ce qui ne diffère en rien de la chose, et tout ce qui en diffère ne sera point la définition. Il y a ici bien des erreurs. D'abord toute différence ne suffit pas pour rendre une chose différente d'une autre. Ainsi des choses identiques en espèce ont entre elles des différences qui ne sont point essentielles. De plus, quand on divise un CXXXI genre dans ses différences opposées, et qu'on attribue l'une de ces différences au sujet qu'on prétend définir, il n'y a aucune utilité à connaître tous les sujets quelconques auxquels ces différences peuvent encore être attribuées. Ce dont il importe uniquement de s'assurer, c'est, si l'on est parvenu à une différence, qui elle-même ne peut plus être divisée ; car alors évidemment cette différence indivisible, jointe à toutes celles qu'on aura obtenues antérieurement par la division, formera la définition cherchée. Nous avons reproché à la méthode de division de faire une pétition de principe ; mais cette pétition de principe ne consiste pas à admettre que le genre entier se divise dans les deux différences opposées qui n'ont point d'intermédiaire entre elles ; car cela est parfaitement évident. La pétition de principe consiste à prendre arbitrairement l'une de ces différences à l'exclusion de l'autre. Ainsi la pétition de principe que fait la méthode de division, ne nuit pas, du moins en ce sens, à l'exactitude des divisions qu'elle fait. On peut donc employer utilement cette méthode pour construire des définitions. Il faut seulement faire bien attention à ces trois choses : 1° que tous les attributs soient des attributs essentiels ; 2° qu'ils soient bien régulièrement classés ; 3° qu'ils soient pris CXXXII tous sans en omettre un seul. Pour s'assurer que les attributs admis sont bien réellement essentiels, on ne peut employer que des raisonnements dialectiques ; car syllogistiquement l'essence ne peut se démontrer. Quant à l'ordre régulier de ces attributs, voici le moyen simple de l'obtenir : le premier attribut sera celui dont les autres ne sont pas des conséquences, et qui est lui-même la conséquence de tous les autres sans exception. Le premier attribut sera donc le plus large de tous. Le second, sera le plus large après le premier ; le troisième, le plus large après le second ; et ainsi de suite. Enfin, on peut être certain que l'on a bien tous les attributs essentiels sans exception ; car on a pris d'abord le premier genre que l'on a partagé dans les deux différences opposées qui le comprennent tout entier ; puis , l'une de ces différences étant admise, on a encore partagé de même cette différence ; et l'on est arrivé ainsi à une dernière différence, qui ne peut plus être partagée parce qu'elle ne s'applique qu'au défini, et que, jointe aux différences antérieurement obtenues, elle forme une définition parfaitement égale au sujet à définir. Évidemment cette définition n'a rien de trop, puisqu'on n'y a fait entrer que des attributs essentiels; elle n'a rien de moins, rien ne lui manque ; car ce qui lui man- CXXXIII querait serait ou un genre ou une différence. Ce ne peut être un genre ; car, en divisant le premier genre dans les différences qui le comprennent tout entier, et en divisant successivement les différences mêmes qu'on admet, on n'a pu omettre de genre intermédiaire : ce ne peut être davantage une différence ; car s'il manquait une différence, la définition ne serait pas égale au défini, ce qui est contre l'hypothèse. On voit donc comment la méthode de division peut avoir quelque utilité pour former la définition. Mais je reviens à l'autre méthode , et je rappelle que pour avoir la définition d'un genre , il faut étudier d'abord les espèces, voir ce que dans chacune d'elles les individus ont de commun , tout attribut commun aux individus devant être celui de l'espèce , puis ensuite ce que ces espèces elles-mêmes ont de commun entre elles, tout attribut commun aux espèces étant un attribut du genre. On doit parvenir ainsi à une seule expression , qui sera la définition même de la chose. Si, au contraire, les attributs d'une espèce étaient différents des attributs d'une autre espèce , et que ces attributs n'eussent rien de commun, il en faudrait conclure que le genre à définir a plusieurs sens divers et non point un seul , et que par conséquent, on peut en donner plusieurs définitions au lieu CXXXIV d'une seule. Soit, par exemple, à définir la magnanimité. D'après les règles tracées plus haut, nous étudions un certain nombre d'individus magnanimes, et nous nous demandons ce qu'ils ont de commun : Alcibiade, Achille, Ajax. Ce qu'ils ont de commun tous les trois, c'est de n'avoir pu supporter une insulte. L'un fit la guerre à sa patrie , l'autre eut son illustre courroux, l'autre se tua de sa propre main pour ne point endurer un affront. Après ces premiers exemples, prenons-en d'autres, Lysandre et Socrate, personnages non moins magnanimes que les premiers. Qu'ont-ils donc de commun entre eux? C'est une indifférence profonde à la bonne comme à la mauvaise fortune. Je compare maintenant ces deux qualités que nous trouvons dans les hommes magnanimes ; et je cherche si la susceptibilité aux affronts et l'impassibilité envers la fortune, ont entre elles quelque chose de commun ; et comme je les trouve profondément différentes, j'en conclus que la magnanimité a deux espèces qui ne peuvent se confondre l'une avec l'autre. Aussi la définition de chacune de ces espèces, ne peut-elle être prise pour la définition de la magnanimité; car toute définition doit être universelle, c'est-à-dire, s'appliquer à tout le défini. C'est comme le médecin qui ne cherche CXXXV point par exemple ce qui est bon à tel œil pris en particulier, mais ce qui est bon à tout œil en général, ou du moins à tout œil affecté du mal spécial qu'il convient de guérir. Ce qui fait du reste qu'il faut toujours procéder de la définition des espèces à la définition du genre, c'est qu'il est plus facile de définir les cas particuliers que l'universel. L'universel peut renfermer des équivoques qu'il est beaucoup moins aisé d'y découvrir, que dans les individus, ou dans les espèces, qui doivent être toutes semblables entre elles. C'est qu'en effet le principal mérite d'une définition , c'est d'être claire. La clarté est aussi nécessaire à la définition que la force de conclusion l'est au syllogisme ; et pour obtenir la clarté , on doit procéder par la définition des espèces particulières contenues sous chaque genre , les étudier chacune à part, pour remonter ensuite à ce qu'elles ont de commun, en ayant soin d'éviter toute ambiguïté de termes. C'est aussi en vue de la clarté qu'il faudra se défendre de toute métaphore dans la définition. La métaphore doit être bannie même des simples discussions dialectiques ; à plus forte raison , doit-elle l'être des définitions qui n'ont pour but que de faire mieux comprendre les choses. La définition, quand la méthode en est bien CXXXVI comprise, peut être fort utile aussi pour se bien rendre compte des questions qu'on se pose à démontrer, et pour trouver les moyens termes par lesquels on peut les résoudre démonstrativement. Soit, par exemple, une question dans laquelle on affirme que tel attribut appartient à tel sujet, question qu'il faudra plus tard démontrer, et qui alors deviendra une conclusion. Du sujet donné, il faut remonter de proche en proche jusqu'au genre auquel appartient primitivement l'attribut donné. Ainsi, en supposant que le sujet soit un animal, il faut remonter jusqu'au genre animal lui-même, et voir quels sont les attributs essentiels, compris dans la définition d'animal. Si parmi ces attributs se trouve celui qu'il s'agit de démontrer, on saura, dès lors, pourquoi il est au sujet ; car il est au sujet en tant que ce sujet est tel animal particulier. Parfois il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'au genre le plus élevé, et, selon la nature de l'attribut, on peut s'arrêter à l'une des espèces, laquelle est la première à posséder cet attribut. D'autres fois, le genre n'a point de nom spécial ; et alors il faut s'en tenir à quelque propriété commune à tous les individus compris dans ce genre. On sait que certains animaux ont plusieurs estomacs, et qu'ils ont en outre le système dentaire conformé d'une cer- CXXXVII taine façon. Or les animaux ainsi constitués n'ont point été réunis dans un genre dont le nom les comprenne tous ; mais on remarque que tous ces animaux ont plusieurs estomacs, en tant qu'ils sont des animaux à cornes. Parfois ce n'est pas une propriété commune qui peut aider ainsi à réunir plusieurs êtres sous une seule idée : c'est une analogie, une simple ressemblance dans la conformation. Ainsi l'os dans l'animal soutient la chair; l'arête dans le poisson joue le même rôle ; l'épine dans la seiche remplit le même office; et l'on dirait que l'os, l'arête et l'épine, bien qu'ils ne soient pas communs à l'animal, au poisson, à la seiche, forment pourtant comme une seule propriété qui a certains attributs, lesquels peuvent être démontrés de ces différents êtres. Du reste, les questions, quelque diverses qu'en soient les termes, sujet et attribut, peuvent être regardées comme identiques , quand le moyen terme, par lequel on les démontre, est le même. Ainsi, pourquoi l'eau des puits est-elle plus chaude en hiver? Pourquoi digère-t-on mieux en hiver qu'en été? Pourquoi respire-t-on plus vite dans la veille que dans le sommeil? Toutes questions identiques, si l'on admet pour cause et pour moyen terme, dans tous ces phénomènes, l'influence de la température ambiante. Il peut se CXXXVIII faire encore que ce moyen terme identique en genre soit pris dans ses espèces seulement , suivant les questions, suivant les sujets. Pourquoi le bruit fait-il un écho? Pourquoi l'image lumineuse est-elle visible? Pourquoi l'arc-en-ciel se forme-t-il? Génériquement ces questions sont identiques; car, dans toutes, le moyen terme est la réfraction; mais elles diffèrent en espèces, selon la nature même des phénomènes. Les questions ne cessent pas d'être identiques, quand le moyen de l'une est compris sous le moyen terme de l'autre, c'est-à-dire, quand le moyen de la première est un effet du moyen terme de la seconde. Pourquoi le cours du Nil est-il plus plein à la fin du mois? c'est que la fin du mois est plus humide. Et pourquoi la fin du mois est-elle plus humide? c'est que la lumière de la lune, à cette époque, est moins considérable. Ainsi, la diminution de la lumière solaire est cause de l'humidité et de la pluie à la fin du mois, comme cette pluie est cause du gonflement du Nil. Mais ces questions ne sont diverses, qu'en ce sens que le moyen terme de celle-ci est subordonné au moyen terme de celle-là.
CXXXIX SECTION QUATRIÈME.
RAPPORTS
DE LA CAUSE ET DE L'EFFET DANS LES DÉMONSTRATIONS.
Il nous reste encore, pour terminer la théorie de la démonstration, à éclaircir quelques doutes que pourrait soulever le rapport établi par nous entre la cause et l'effet. Nous avons dit que l'effet pouvait syllogistiquement servir à démontrer la cause, comme la cause sert à démontrer l'effet, lorsque la cause et l'effet sont contemporains. Mais on peut se demander, si réellement l'existence de la cause peut être déduite de l'existence de l'effet. Par exemple, on voit tomber les feuilles de certains arbres; on voit la lune s'éclipser, voilà des effets ; on demande si l'on peut en conclure la cause qui les produit, la largeur des feuilles dans un cas, l'interposition de la terre dans l'autre. Il paraît d'abord que la cause et l'effet sont réciproques; car si la cause indiquée n'existait pas quand l'effet existe, c'est qu'elle ne serait pas la vraie cause ; et il y en aurait une autre qui serait, du moment que serait aussi l'effet lui-même, puisque tout effet a nécessaire- CXL ment une cause. Mais si la cause et l'effet sont réciproques, il s'ensuit qu'on peut indifféremment les démontrer l'un par l'autre. Ainsi la la vigne perd ses feuilles, parce que c'est un arbre à feuilles larges ; c'est en prenant la largeur des feuilles pour moyen terme, qu'on démontre dans la vigne le phénomène de la perte de ses feuilles. Voilà l'effet démontré par la cause. Réciproquement, on peut démontrer que la vigne a les feuilles larges : Tout arbre qui perd ses feuilles a les feuilles larges; or la vigne perd ses feuilles; donc la vigne a les feuilles larges. Voilà la cause démontrée par l'effet. Il semble donc que la démonstration peut être circulaire; il n'en est rien pourtant. La cause est bien la cause de l'effet ; mais l'effet n'est pas la cause de sa cause; la cause est toujours antérieure à son effet. C'est bien parce que la terre s'interpose que l'éclipse a lieu ; et ce n'est pas du tout parce que l'éclipse a lieu que la terre s'interpose. Il y a donc entre ces deux démonstrations cette profonde différence, que, quand on prouve l'effet par la cause, on sait la cause de cet effet, et que, quand on prouve la cause par l'effet, on ne sait que l'existence de la cause , sans savoir la cause de la cause. Ainsi, la démonstration par la cause apprend pourquoi la chose est ; la démonstration, CXLI. par l'effet, apprend seulement que la chose est. On sait que la terre s'interpose, mais on ne sait pas pourquoi elle s'interpose ; et ce qui le montre bien, c'est que l'idée de l'interposition de la terre est indispensable à la définition essentielle de l'éclipse, tandis que l'idée de l'éclipse n'a que faire dans la définition de l'interposition. L'interposition de la terre fait donc comprendre l'éclipse, tandis que l'éclipse ne fait pas du tout comprendre l'interposition de la terre. On fait encore une autre objection contre cette réciprocité syllogistique de la cause et de l'effet ; et l'on dit : Un même effet peut avoir plusieurs causes ; on pourra donc prouver cet effet par l'une quelconque de ces causes ; mais, en partant de l'effet, laquelle de ces causes prouvera-t-on de préférence aux autres? En descendant des causes à l'effet, on arrive toujours à ce seul effet ; mais, en remontant de cet effet unique aux causes qui le produisent, on peut arriver à l'une aussi bien qu'à l'autre ; il faut bien toujours atteindre une cause, mais non pas toute cause ; donc, peut-on conclure, l'effet n'est pas réciproque à sa cause. Nous soutenons, au contraire, que dans la démonstration il doit toujours l'être. En effet, il faut toujours, dans la démonstration, que la conclusion soit universelle, c'est-à-dire, que l'attribut CXLII soit d'extension égale au sujet; et, par exemple, que l'attribut de perdre ses feuilles soit appliqué au sujet même pour lequel il est universel, c'est-à-dire, à la plante prise avec certaines conditions, et non plus à la vigne. Il faut donc que le moyen terme , qui unit les extrêmes , soit aussi d'égale extension; et par conséquent la cause est égale au sujet dans la mineure, comme l'effet doit être égal à cette cause dans la majeure. Les propositions sont universelles comme la conclusion qui en vient. L'effet et la cause sont alors réciproques. Pourquoi la plante perd-elle ses feuilles? c'est que la sève se coagule ; et l'on peut alors conclure que, si les feuilles tombent, c'est que la coagulation a lieu, tout aussi bien que, si la coagulation a lieu, les feuilles tombent. Du reste, il n'est pas possible qu'un môme effet ait plusieurs causes, ainsi qu'on le prétend. Oui, sans doute, un seul effet peut avoir plusieurs causes accidentelles et partielles ; mais il n'en peut jamais avoir qu'une seule qui lui soit adéquate, qui soit de même extension que lui, comme l'exige la démonstration. Dans la démonstration, la cause ou le moyen terme est la définition de l'effet ou du grand extrême : et une chose n'a jamais et ne peut jamais avoir qu'une seule définition. Il est bien vrai que les questions qu'on se CXLIII pose ne sont pas toujours universelles , c'est-à-dire qu'on ne joint pas toujours dans la conclusion l'attribut universel au sujet primitif, et qu'on pose quelquefois des questions purement accidentelles; mais il faut dire que, dans ce cas, le moyen terme ou la cause suit la nature même de l'attribut. Si l'attribut est un terme équivoque, à plusieurs sens, la cause sera équivoque et aura plusieurs sens comme lui. Si l'attribut ne s'adresse qu'à une espèce au lieu de s'adresser au genre, la cause aussi sera spécifique au lieu d'être générique. Si, par exemple, on demande pourquoi les nombres peuvent être mis en proportion, pourquoi les lignes peuvent être mises en proportion, ce sont là des questions d'espèces : car la cause est différente pour les lignes et différente pour les nombres, entant qu'elle s'applique ici aux nombres et là aux lignes ; mais elles sont identiques, si l'on admet que la proportionnalité des lignes et des nombres, résulte d'un certain accroissement tout pareil dans les unes et dans les autres. Voici des exemples de questions équivoques : Pourquoi une couleur est-elle semblable à une autre couleur? Pourquoi une figure est-elle semblable à une autre figure? Ici l'attribut de semblable a un double sens ; car la similitude des couleurs n'est pas du tout la même chose que la similitude des CXLIV figures. Les figures sont semblables, quand elles ont les côtés proportionnels et les angles égaux ; les couleurs sont semblables, quand elles produisent sur nos yeux une sensation pareille. La cause de la similitude pour les couleurs d'une part, et pour les figures de l'autre, ne pourrait être qu'un mot équivoque comme la similitude elle-même. Quand les questions sont identiques par simple analogie, comme dans l'exemple cité plus haut, de l'os, de l'arête et de l'épine, le moyen terme ou la cause n'est identique aussi que par simple analogie. Au contraire, quand la démonstration est vraiment universelle, les trois termes sont tous réciproques; le sujet, l'attribut, le moyen, sont d'extension égale. Lorsque le sujet n'est pas le sujet primitif, et que ce n'est qu'une espèce au lieu d'être le genre , l'attribut est plus étendu que chacune des espèces prises à part ; mais il n'est pas plus étendu que toutes les espèces prises en masse. Par exemple, avoir la somme des angles formés par deux des lignes qui se rencontrent, égale à quatre droits, est un attribut plus large que le triangle ou le quarré, qui sont des espèces particulières de figures rectilignes; mais c'est un attribut parfaitement égal à toutes les figures rectilignes, c'est-à-dire, au genre qui est la figure rectiligne. Il en serait de CXLV même du moyen terme par lequel on démontrerait cet attribut ; car le moyen terme est la définition de l'attribut ou grand extrême ; et c'est là ce qui fait que toute science obtenue dans une conclusion démontrée, est une science de définition. De même encore perdre ses feuilles est un attribut plus large que la vigne , que le figuier , ou tel autre arbre qui perd ses feuilles, et qui n'est pas le seul à les perdre ; mais c'est un attribut égal à tous les arbres qui perdent leurs feuilles, c'est-à-dire, qui ont des feuilles larges. Si on remonte au moyen terme primitif, à la cause primitive , ce moyen terme sera la définition de l'attribut: perdre ses feuilles. Si l'on dit que la vigne, le figuier, etc., perdent leurs feuilles parce qu'ils ont des feuilles larges, le moyen terme sera primitif relativement à toutes ces espèces ; mais il ne le sera pas relativement au genre. Le genre, c'est l'arbre à feuilles larges; et le moyen primitif, par rapport au genre, sera la coagulation de la sève. Et en effet, en admettant toujours que ce soit là véritablement la cause, quelle définition donnera-t-on de la chute des feuilles? La chute des feuilles , dira-t-on , est la coagulation de la sève à la commissure des feuilles avec les branches. Il serait facile de démontrer par des exemples purement littéraux , c'est-à-dire , d'une CXLVI manière toute générale, que, quand un même attribut est à plusieurs sujets par plusieurs causes, cet attribut ne peut être réciproque à aucune de ces causes en particulier, non plus qu'à aucun de ces sujets. Tous ces sujets pris ensemble sont de même extension que cet attribut, mais chacun pris à part le dépasse. Il faut, de plus, que ces sujets soient différents en espèce ; car s'ils étaient d'espèce identique, l'attribut identique pour tous ne pourrait avoir non plus qu'une seule et même cause. Il se peut faire d'ailleurs que ces causes diverses d'un attribut unique soient subordonnées les unes aux autres ; et alors , pour démontrer l'attribut relativement à une espèce, on prendra la cause la moins étendue ; et pour le démontrer relativement au genre , on se servira de la cause la plus large. En remontant ainsi de cause en cause, on arrive à une cause supérieure qui ne relève plus que d'elle seule, et qui n'est plus subordonnée à aucune autre. Pour résumer toute la doctrine contenue dans les Premiers et les Derniers Analytiques, nous pouvons dire que nous savons maintenant ce que c'est que le syllogisme et la démonstration , et comment l'un et l'autre se forment; et nous savons aussi, par conséquent, ce que c'est que la CXLVII science démontrée, laquelle se confond avec la démonstration même.
SECTION CINQUIÈME.
DE L'ACQUISITION DES PRINCIPES.
Il ne reste plus, pour achever la théorie tout entière , qu'à dire comment nous acquérons la connaissance des principes, et quelle est en nous la faculté qui est en rapport avec eux. Rappelons-nous d'abord qu'il n'est pas possible de connaître la conclusion, si l'on ne connaît pas antérieurement les principes. Mais cette connaissance des principes est-elle bien la même que la connaissance de la conclusion , ou est-elle différente? y a-t-il science proprement dite pour les principes, comme il y a science pour la conclusion? ou bien la connaissance des principes est-elle tout autre chose que la science? enfin , les principes sont-ils innés en nous, et nous restent-ils d'abord cachés? ou bien, n'étant point innés en nous, ne nous sont-ils connus que postérieurement? CXLVIII nous possédons les principes dès notre naissance, et à soutenir que nous acquérons plus tard la faculté de les connaître. Comment est-il possible que, possédant une connaissance supérieure à la science même que donne la démonstration, cette science nous échappe? Et d'autre part, si nous ne connaissons que postérieurement les principes, par quelle voie arrivons-nous donc à les connaître, si, comme nous l'avons dit, toute connaissance rationnelle procède toujours d'une connaissance antérieure? Évidemment donc, les principes ne sont pas innés ; et ils ne peuvent pas nous devenir connus par le développement d'une faculté que nous n'aurions pas antérieurement. Par conséquent, il est nécessaire que nous ayons une certaine faculté qui nous les fasse acquérir ; mais qui cependant nous donne une connaissance moins exacte que la connaissance même des principes, et qui[soit inférieure en certitude. Or, c'est là précisément ce que nous retrouvons dans tous les animaux. Il n'en est pas un qui n'apporte en naissant cette faculté de judiciaire qu'on appelle la sensibilité. Mais ici se présente une différence considérable : chez les uns la sensation persiste ; chez les autres elle disparaît aussitôt qu'elle a été perçue. Dans les animaux où la sensation s'évanouit ainsi , il n'y a point connaissance au-delà CXLIX de la sensation même , ou du moins il n'y a point connaissance pour les choses dont la sensation s'efface si rapidement. Parmi ceux au contraire qui conservent quelque chose après la sensation, les uns arrivent jusqu'à la raison par suite de la permanence des effets de la sensation ; les autres ne peuvent atteindre jusqu'à elle. Ainsi la sensation engendre la mémoire , et la mémoire engendre l'expérience qui s'applique à l'identité des cas particuliers, et qui est une, bien qu'elle résulte de cas multiples. C'est de l'expérience , ou pour mieux dire de la totalité de l'idée universelle, qui, distincte des idées particulières , toujours une et la même dans toutes, s'arrête dans notre entendement, que l'art et la science tirent leur principe : l'art, s'il s'agit de choses que nous pouvons créer : la science, s'il s'agit uniquement de connaître ce qui est et non pas ce que nous pouvons faire. Ainsi donc les principes ne sont pas innés en nous ; ils n'y sont pas tout déterminés à l'avance ; ils ne dérivent pas non plus de connaissances qui leur seraient supérieures ; ils dérivent de la sensibilité. Notre âme est comme une armée mise en déroute : si dans la fuite un soldat s'arrête , un autre s'arrête après lui , puis un autre, et les rangs se reforment comme ils étaient d'abord formés. Tout de même, dès qu'une sensa- CL tion particulière, et toutes les sensations particulières sont semblables entre elles relativement à l'universel qu'elles forment, s'est arrêtée dans notre intelligence , il y a dès lors aussi de l'universel. C'est bien un être particulier qui a été senti ; mais la faculté de sentir est elle-même en rapport avec l'universel, elle est faite pour sentir l'être en général, et non point tel être particulier : pour sentir l'homme par exemple, et non point tel homme en particulier, Callias, si l'on veut. De ces notions particulières qui demeurent dans l'âme, elle remonte de notions en notions à des notions totales, indivises, universelles, et de celles-là à de plus universelles encore; de tel animal particulier, elle remonte à l'animal pris universellement, et d'animal à un terme plus étendu encore. C'est donc, comme on voit, par l'induction que nous parvenons à connaître les primitifs, et c'est la sensation qui produit même l'universel. Or, de tous les procédés rationnels par lesquels nous arrivons à la vérité, les uns sont toujours exclusivement vrais, les autres peuvent aussi être faux. L'opinion et le raisonnement peuvent quelquefois nous mener à l'erreur ; la science et l'entendement ne nous conduisent jamais qu'à la vérité. Au-dessus de la science, il n'y a que l'entendement. Mais les principes de la CCI démonstration doivent être plus notoires que la conclusion qu'on en tire, et la science n'est que le résultat d'un raisonnement. Donc, il n'y a pas science des principes , à proprement parler ; et comme il ne peut y avoir rien de plus vrai que la science, si ce n'est l'entendement lui-même, il faut en conclure que c'est l'entendement, l'entendement seul, qui s'applique aux principes. Ce qui le prouve encore , c'est que , de même qu'il ne peut y avoir, sans tomber dans la série à l'infini, démonstration de la démonstration, de même non plus il ne peut y avoir science de la science. Si donc, après la science, il n'y a plus que l'entendement qui nous donne le vrai, il faut en conclure que l'entendement est le principe de la science ; et que, comme principe, il ne s'adresse qu'aux principes, d'où sort la science de la conclusion, de même que la science ne s'adresse jamais qu'aux conclusions mêmes dont on la tire.
|