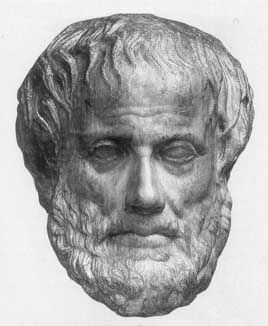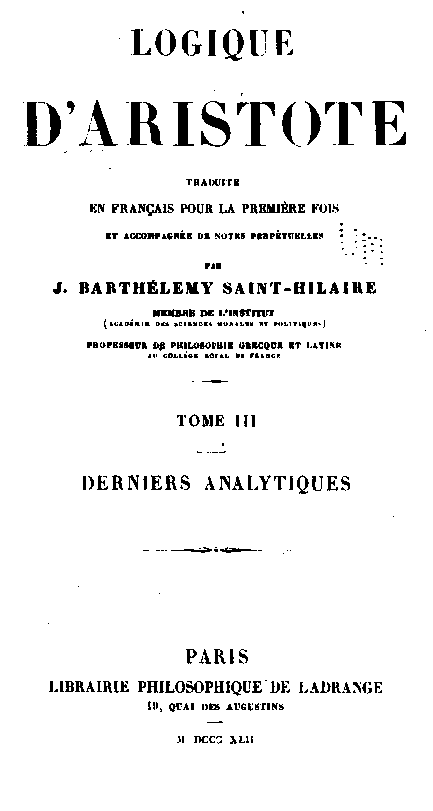|
Table des matières des seconds anaLytiques
table des matières de l'œuvre d'Aristote
ARISTOTE
DERNIERS ANALYTIQUES.
LIVRE PREMIER.
PLAN GÉNÉRAL DES DERNIERS ANALYTIQUES - livre II
Si vous voulez avoir le texte grec d'un paragraphe, cliquer sur le paragraphe
SECTION PREMIÈRE.
Principe général de toute connaissance rationnelle : application à toutes les sciences. - Les notions antérieures sont de deux espèces, selon qu'elles se rapportent à l'existence de la chose, ou au mot qui exprime la chose. - Notions immédiates et simultanées : la notion de l'universel contient implicitement la notion de tous les cas particuliers. - Théorie du Ménon sur la réminiscence. - Objection sophistique et réfutation de cette objection ; solution vraie de la question. |
|
|
71a § 1. Toute connaissance rationnelle, soit enseignée soit acquise, dérive toujours de notions antérieures. § 2. L'observation démontre que ceci est vrai de toutes les sciences; car c'est le procédé des sciences mathématiques, et de tous les autres arts sans exception. § 3. C'est encore le procédé de tous les raisonnements de la dialectique, aussi bien de ceux qui sont formés par syllogisme que de ceux qui sont formés par induction. Les uns et les autres, en effet, tirent toujours l'instruction qu'ils donnent de notions antérieures; les premiers, en supposant ces notions comprises et accordées; les autres, en démontrant l'universel par l'évidence même du particulier. C'est également par cette méthode que les raisonnements de rhétorique produisent la persuasion; car ils y arrivent, soit par des exemples, ce qui n'est que l'induction; soit par des enthymèmes, ce qui n'est que le syllogisme. § 4. Les notions antérieures ne peuvent être nécessairement que de deux espèces : ou bien, c'est l'existence même de la chose qu'il faut préalablement connaître: ou bien, c'est le nom seul de la chose qu'il faut comprendre; parfois aussi, il faut savoir tout ensemble et l'existence de la chose et le nom qu'elle porte. Ainsi pour cette proposition : De toute chose quelle qu'elle soit, il doit être vrai soit de l'affirmer, soit de la nier, ce qu'on sait nécessairement tout d'abord, c'est que cette proposition est vraie. Pour le triangle, il faut savoir, au contraire, que le mot de triangle signifie telle chose spéciale. Enfin pour l'unité, il faut savoir à la fois, et la chose qu'exprime ce mot, et l'existence de cette chose. On voit que dans chacun de ces cas, le mode de la connaissance n'est pas du tout le même pour nous. § 5. Du reste on peut connaître les choses, tantôt en en connaissant d'autres antérieurement à celles-là, tantôt en les apprenant simultanément avec d'autres, comme par exemple on sait tous les cas particuliers compris sous l'universel dont on possède la notion. Ainsi, l'on sait préalablement que la somme des angles de tout triangle est égale à deux droits, et l'on sait, que cette figure comprise dans une demi-circonférence est un triangle, à l'instant même qu'on la voit. C'est qu'en effet il est des choses dont on acquiert la connaissance de cette façon. L'extrême est alors connu sans le secours d'un terme moyen; et ce sont précisément les choses individuelles, qui ne peuvent jamais être attribuées à un sujet. § 6. Mais avant même que ce triangle n'ait été produit ou que le syllogisme en forme n'ait eu lieu, la propriété de cette figure, on peut dire, est connue en un sens, et en un autre sens, elle n'est pas connue. En effet, d'une chose dont on ne sait pas absolument qu'elle existe, comment pourrait-on savoir absolument qu'elle a ses angles égaux à deux angles droits? Pourtant il est certain qu'on le sait en ce sens qu'on la connaît d'une manière générale, mais il est certain aussi qu'on ne la connaît pas d'une manière absolue. § 7. Autrement, la théorie du Ménon serait juste; et alors, ou l'on n'apprendrait rien, ou l'on ne ferait qu'apprendre ce que l'on sait déjà. § 8. On ne peut d'ailleurs du tout admettre la solution proposée par quelques-uns: « Savez vous, disaient-ils, que tout nombre binaire est pair ou ne le savez vous pas? » Si l'on répondait : oui, je le sais, ils vous montraient une dualité que 72 vous ne connaissiez pas, et dont, par conséquent, vous ne saviez pas non plus qu'elle fût paire. C'est qu'en effet ils affirment qu'on ne sait pas que toute dualité est paire, mais qu'on ne le sait que de la dualité qu'on connaît comme telle. Toutefois l'on sait ce dont on possède la démonstration, ou ce qu'on accepte pour démontré. Or, l'on n'a pas admis la démonstration seulement pour tout ce dont on sait que c'est un triangle ou que c'est un nombre. L'on a entendu parler absolument de tout nombre et de tout triangle; car jamais la proposition n'a eu cette forme: « Le nombre que vous connaissez, la figure rectiligne, que vous connaissez, etc. ; » la proposition s'est toujours appliquée à tout triangle, à toute figure rectiligne. § 9. A mon avis, rien ne s'oppose à ce qu'on sache d'une façon et qu'on ignore d'une autre, ce qu'on apprend. L'absurde est de dire, non pas qu'on sait de quelque façon ce qu'on apprend, mais qu'on le sait de la façon même et dans les termes où on l'apprend. |
§ 1. Toute connaissance rationnelle, il s'agit uniquement ici de la science acquise soit par syllogisme, soit par démonstration. la connaissance intuitive qui résulte de la sensibilité ou d'un acte immédiat de l'entendement, est donc implicitement exclue. Voir un peu plus bas § 5. et dans le second livre, ch. 19, § 6, où la connaissance des principes eux-mêmes est dérivée de la sensation, antérieure par conséquents aux principes qu'elle aide à faire connaître. Dans le livre 6 de la Morale à Nicomaque, ch. 3, p. 1139, b, Aristote revient sur cette distinction de la connaissance, et rappelant le début du premier livre des Derniers Analytiques et la fin du second, il établit de nouveau que toute connaissance qui n'est point intuitive, et celle même des principes, procède toujours de notions antérieures. - Dérive toujours de notions antérieures. Voilà le principe général de toute la théorie qui remplit les deux livres des Derniers Analytiques. C'est un axiome, et il est de toute évidence que la conclusion ne peut être connue qu'après les prémisses. § 2. Des sciences mathématiques, Philopon a cru, mais à tort, qu'il s'agissait ici des sciences logiques ou rationnelles, et non des mathématiques proprement dites. - De tous les autres arts, il faut entendre arts dans le sens où l'on dit l'art de la rhétorique, l'art poétique, etc. § 3. De tous les raisonnements de la dialectique, le texte dit seulement : discours; mais il s'agit évidemment après la science, de la dialectique, comme après la dialectique il s'agira de la rhétorique. - Les premiers, le syllogisme suppose toujours que les prémisses sont accordées. - Les autres, c'est l'induction qui procède des cas particuliers qui sont évidents. - Pour le syllogisme, voir les deux livres des Premiers Analytiques et spécialement la définition du syllogisme, liv. 1, ch. 1, § 8; pour l'enthymème, liv. 2, ch. 27; pour l'induction, liv. 2, ch. 23; pour l'exemple, liv. 2, ch. 24. § 4. De deux espèces, il faut connaître : 1° que la chose est, 2° ce qu'elle est : d'une part, c'est l'affirmation ou la négation de son existence; de l'autre c'est sa définition. Après avoir distingué les notions antérieures en deux espèces, Aristote semble ensuite en reconnaître trois; mais le réunion de la notion d'existence et de la définition ne forme pas à vrai dire ne espèce à part. Les exemples cités dans le texte ne sont pas très clairement exposés. Le principe de contradiction est évident par soi-même; il suffit de renoncer pour qu'on sache qu'il est vrai, c'est ce qu'Aristote appelle savoir l'existence de la chose. Pour le triangle, il faut savoir, non pas que le triangle existe, mais que le mot de triangle signifie une figure formée de trois lignes droites, ou qui a trois agies; il faut donc savoir la définition nominale du triangle. Enfin pou l'unité comme la conçoivent les mathématiciens, Il faut savoir à la fois, et la définition de ce mot et l'existence abstraite de la chose qu'il désigne. Le mode de connaissance est en effet différent dans ces trois cas. § 5. En en connaissant d'autres antérieurement à celle-là, ainsi on ne connaît. la conclusion que parce qu'on connaît antérieurement la majeure. - Simultanément avec d'autres, ainsi on connaît la conclusion, du moment même qu'on connaît la mineure. - L'on sait préalablement que la somme des angles de tout triangle, etc., c'est la la majeure du syllogisme dont la mineure est : Cette figure comprise dans une demi-circonférence est un triangle; donc, etc. La connaissance des cas particuliers, des termes individuels est immédiate, c'est-à-dire que le sujet et l'attribut sont connus sans moyens termes et par le fait seul de la sensation. - Ne peuvent jamais être attribués à un sujet. Voir Catégories, ch. 2, § 2. § 6. On connaît la conclusion en puissance, d'une manière générale, confuse, du moment qu'on connaît la majeure, parce que la conclusion est un cas particulier de l'universel qu'on sait. On ne sait la conclusion d'une manière spéciale et distincte qu'au moment même où l'on sait la mineure, et dans l'exemple particulier que cite Aristote, la mineure est cette proposition : La figure comprise dans ce demi-cercle, est un triangle. § 7. Si l'on n'admet point ce rapport de la conclusion à la majeure, il faut alors reconnaître pour vraie la théorie du Ménon dont il a été déjà question dans le 2e liv. des Premiers Analytiques, ch. 21, § 7. Socrate soutient que toute la science n'est que réminiscence, et que l'âme ne fait rien dans cette vie que se rappeler ce qu'elle a su dans une rie antérieure avant d'être unie au corps. Aristote combat cette doctrine par la distinction des deux espèces de connaissances, l'une générale, l'autre particulière, théorie développée dans le passage indiqué plus haut. § 8. Par quelques-uns, il s'agit ici des sophistes. Ils posaient cette question : Savez-vous que tout nombre binaire est pair? On répondait oui ; et montrant alors deux objets qu'ils avaient tenus jusque là cachés, ils ajoutaient : vous ne connaissiez pas ces deux choses dont le nombre est pair, donc vous ne saviez pas que tout nombre binaire est pair. On avait cru réfuter les sophistes en disant qu'on savait, non point absolument que tout nombre binaire est pair, mais qu'on le savait seulement du nombre qu'on connaissait pour binaire. Aristote rejette cette réfutation, et il affirme ce qui est évident, que la démonstration est universelle et qu'elle n'est point restreinte comme un semble le croire. La démonstration s'applique, en général, à tout nombre binaire, à tout triangle, et puisque l'on sait ce qui est démontré, on sait d'une manière universelle que le triangle a ses angles égaux à deux droits, et que tout nombre binaire est pair. § 9. On sait la conclusion en puissance dès qu'on connaît la majeure. On peut donc dire, sans absurdité, qu'on sait et qu'on ne sait pas à la fois une seule et même chose; on la sait d'une manière universelle, on ne la sait pas d'une manière particulière. Ainsi donc la science est le passage d'une connaissance confuse à une connaissance claire et distincte; ce n'est point une réminiscence, comme l'a dit Platon dans le dialogue du Ménon. |
|
SECTION DEUXIÈME. DÉFINITION ET ÉLÉMENTS DE LA DÉMONSTRATION.
CHAPITRE II. |
|
|
§ 1. Nous pensons savoir les choses d'une manière absolue et non point d'une manière sophistique, purement accidentelle, quand nous pensons savoir que la cause par laquelle la chose existe, est bien la cause de cette chose, et que par suite nous pensons que la chose ne saurait être autrement que nous la savons. § 2. Ce qui prouve bien que savoir est à peu près cela, c'est qu'entre ceux qui ne savent pas et ceux qui savent, il n'y a que cette différence, que les premiers pensent être et que ceux qui savent sont réellement dans ce cas, § 3, que la chose dont ils ont la connaissance absolue ne peut point du tout être autrement qu'ils la savent. § 4. Qu'il y ait encore une autre manière de savoir, c'est ce que nous dirons plus tard; mais ici, nous disons qu'on peut savoir aussi par démonstration. § 5. Or j'appelle démonstration le syllogisme qui produit la science; et j'entends par syllogisme qui produit la science, celui qui par cela seul que nous le possédons, nous fait savoir quelque chose. § 6. Si donc savoir est bien ce que nous avons dit, il s'ensuit nécessairement que la science démonstrative procède de principes vrais, de principes primitifs, de principes immédiats, plus notoires que la conclusion dont ils sont cause et qu'ils précèdent. C'est à ces conditions, en effet, qu'ils seront aussi les principes propres du démontré. § 7. Car il pourra bien y avoir syllogisme sans ces conditions, mais il n'y aura pas démonstration sans elles; parce qu'alors le syllogisme ne produira pas la science. § 8. Il faut donc que les principes soient vrais, parce qu'on ne peut point savoir ce qui n'est pas; par exemple que le diamètre est commensurable. § 9. Il faut ensuite que les primitifs dont on part soient indémontrables; car on ne les saurait pas puisqu'on n'en posséderait pas la démonstration, et que savoir autrement que d'une façon accidentelle les choses dont la démonstration est possible, c'est en posséder la démonstration. § 10. II faut de plus que les principes soient causes de la conclusion, qu'ils soient plus notoires qu'elle et antérieurs à elle : causes, parce que nous ne savons une chose qu'après en avoir connu la cause : antérieurs, puisqu'ils sont causes : et préalablement connus, non pas seulement en tant qu'on connaît le mot qui les exprime, mais en outre parce qu'on sait qu'ils sont. § 11. Antérieurs et plus notoires peut s'entendre en deux sens; car il ne faut pas confondre l'antérieur par nature et l'antérieur pour nous, 72a pas plus que le plus notoire par nature, et le plus notoire pour nous. Je nomme antérieur et plus notoire pour nous, ce qui est le plus rapproché de la sensation; mais d'une manière absolue, le primitif le plus notoire est ce qui s'en éloigne le plus; car le plus éloigné de la sensation est précisément le plus général, le plus rapproché est le particulier; et toutes ces choses sont opposées entre elles. § 12. Partir des principes propres à la chose, c'est partir des primitifs de cette chose; car je confonds primitif et principe. § 13. Le principe de la démonstration, c'est la proposition immédiate; et la proposition immédiate est celle qui n'a point d'autre proposition avant elle. La proposition est d'ailleurs l'une des deux faces de l'énonciation, exprimant une seule chose d'une seule autre chose: dialectique, quand elle prend indifféremment l'une ou l'autre; démonstrative, quand elle n'en prend spécialement qu'une seule pour vraie. L'énonciation est l'une ou l'autre des deux parties de la contradiction; la contradiction est l'opposition qui par elle-même n'a pas de moyen terme possible. L'une des parties de la contradiction est l'affirmation qui attribue une chose à une autre; et l'autre partie, c'est la négation qui nie une chose d'une autre chose. § 14. J'appelle thèse d'un principe syllogistique immédiat, la proposition qui ne peut pas être démontrée, et qu'il n'est pas indispensable de connaître pour apprendre quelque chose; celle au contraire que l'on doit nécessairement connaître pour apprendre la chose quelle qu'elle soit, je la nomme axiome; car il y a certaines propositions de ce genre; et c'est à celles-là que nous réservons habituellement ce nom. § 15. La thèse qui prend l'une quelconque des deux parties de l'énonciation, c'est-à-dire, qui affirme ou qui nie l'existence de l'objet, reçoit le nom d'hypothèse. La thèse qui est dénuée de ces conditions, est une définition. La définition, en effet, est une sorte de thèse, et c'est ainsi que l'arithméticien pose par exemple cette thèse : Que l'unité est ce qui, sous le rapport de la quantité, est indivisible. Mais elle n'est pas du tout une hypothèse; car dire ce qu'est l'unité et dire que l'unité est, ce n'est pas la même chose. § 16. Puis donc que pour croire et savoir une chose, il faut posséder ce syllogisme que nous appelons démonstration, lequel syllogisme n'existe que parce que les choses dont il est le syllogisme existent aussi, il y a nécessité, non seulement de connaître antérieurement les primitifs, soit en totalité soit en partie, mais encore on les connaît nécessairement plus que tout le reste. Car ce par quoi une chose existe existe aussi plus qu'elle; et par exemple ce par quoi nous aimons est encore plus aimé que l'objet que nous aimons : et de même si nous savons et croyons les choses au moyen des primitifs, nous savons et croyons ces primitifs bien plus encore que les choses : car ce n'est que par eux que nous savons et croyons tout le reste. § 17. Or, il n'est pas possible de croire moins les choses qu'on sait que les choses qu'on ne sait pas, et à l'égard desquelles on n'est pas dans une position meilleure qu'on ne serait si on les savait ; et pourtant c'est ce qui aura lieu si, se fiant à la démonstration, on n'avait point de notions antérieures à elle; car on ajoute nécessairement plus de foi aux principes, soit tous, soit quelques-uns, qu'on n'en ajoute à la conclusion qu'ils donnent. § 18. En outre, celui qui doit acquérir la science tirée de la démonstration, doit, non seulement plus connaître les principes, et les croire plus que le démontré, 73 mais encore, il n'y a rien de plus croyable ni de plus notoire pour lui, que les opposés de ces principes, d'où l'on tirerait le syllogisme de l'erreur contraire à la démonstration, attendu que celui qui sait réellement ne peut faillir. |
§ 1. Nous pensons savoir, après avoir indiqué le principe et l'origine de toute connaissance rationnelle, il convient de définir d'une manière plus précise ce que c'est que la science obtenue par démonstration, ce que c'est que la science elle-même. Il y a deux conditions à la science démonstrative. La première c'est de connaître la cause de la chose qu'on sait, et en second lieu, de croire que la chose en question ne peut être autrement qu'on ne la sait. § 2. Ce qui prouve bien, confirmation du principe antérieur par le témoignage unanime des hommes, c'est-à-dire par l'autorité du sens commun. § 4. C'est ce que nous dirons plus tard. Voir la fin de ce chapitre ; les chapitres 3, 13 et 33 de ce premier livre, et les chapitres 3 et 19 du second. Cet autre mode de la science est la science des principes dérivant de l'induction, qui vient elle-même de la sensation. § 5. J'appelle démonstration le syllogisme qui produit la science. Le syllogisme est donc plus étendu que la démonstration. Ch. 4, § 1, du premier livre des Premiers Analytiques. Le syllogisme qui produit la science est, d'après la définition même de la science, celui qui donne la connaissance de la cause. § 6. Ce que nous avons dit. Voir plus haut, § 1. - La science démontrée, c'est-à-dire la science que donne une conclusion démontrée. Après avoir défini la démonstration par le but qu'elle atteint. Aristote la définit ici par les éléments mêmes dont elle se compose. Les conditions nécessaires de la démonstration sont donc au nombre de six. D'abord les prémisses du syllogisme démonstratif doivent être vraies. 2° Elles doivent être des propositions primitives ou immédiates. 3° Elles doivent être plus notoires que la conclusion qui en sort. 4° Elles sont causes de la conclusion, c'est-à-dire que le moyen est en réalité cause de l'attribut ou grand extrême. 5° Les prémisses doivent être antérieures à la conclusion. 6° Elles sont des propositions propres et spéciales au démontré. Cette dernière condition n'est, au reste, que la réunion de toutes les autres dont elle résulte. § 7. Ce qui distingue le syllogisme de la démonstration, c'est que ces conditions sont nécessaires à la démonstration, tandis que le syllogisme peut s'en passer; mais lorsqu'il les a pas, il ne produit point véritablement de science. - Aristote reprend ensuite une à une toutes les conditions qu'il vient d'indiquer, et il explique ce qu'on doit entendre par chacune d'elles. § 8. Il faut donc que les principes soient vrais, car s'ils n'étaient pas vrais, la conclusion serait fausse comme eux et ce ne serait point alors de la science : il a cependant été démontré liv. 2 des Premiers Analytiques, ch. 2, 3 et 4, qu'on pouvait obtenir une conclusion vraie de prémisses fausses; mais dans les Premiers Analytiques, Aristote ne considérait que la forme de la conclusion, tandis qu'ici il eu considère la matière. De prémisses fausses on ne peut jamais tirer qu'une vérité de simple accident; mais en soi, on ne tire réellement que le faux de prémisses fausses. Voir Averroès - On ne peut pas savoir ce qui n'est pas, c'est-à-dire, savoir de science vraie et certaine; c'est une opinion, si l'on veut; ce n'est point de la science. § 9. Indémontrable a ici le même sens que plus haut primitif et immédiat. Si les principes n'étaient pas indémontrables, on les saurait par démonstration, et alors remontant de principe en principe on aurait à parcourir l'infini, ce qui est absurde et destructif de toute science; donc les principes sont indémontrables. - Les choses dont la démonstration est possible, c'est-à-dire les choses qui peuvent être connues par leur cause ou un moyen terme; mais il est des choses comme les principes qui sont connues immédiatement et sans cause. § 10. Aristote intervertit dans cette nouvelle énumération, l'ordre qu'il avait assigné dans la précédente, § 6. - En tant qu'on connaît le mot qui les exprime. Voir plus haut, ch. 1, § 4. §11. L'antérieur par nature et l'antérieur pour nous. Il s'agit toujours ici de la connaissance humaine, car il n'y a que l'homme qui connaît, et la nature ne connaît pas. Seulement la connaissance peut avoir deux ordres distincts. L'ordre même dans lequel elle se produit, et l'ordre naturel dans lequel les choses se produisent. Ainsi, dans l'ordre propre de la connaissance, l'effet vient avant la cause, et dans l'ordre de la nature, de la réalité, la cause est nécessairement avant l'effet qu'elle produit. Ainsi l'effet, c'est-à-dire le particulier, est le plus près de la sensation ; la cause, c'est-à-dire le général, en est le plus éloigné. § 12. Principes propres, principe et primitif se confondent, c'est-à-dire qu'il faut dans chaque chose, chercher les premiers principes qui lui appartiennent spécialement, et ne point tes principes généraux ou axiomes qui appartiennent à toute chose en général. § 13. Le principe de la démonstration. Après avoir indiqué les conditions essentielles des principes, Aristote définit ici ce que c'est qu'un principe dans la démonstration. Toute cette théorie de la proposition immédiate a déjà été présentée dans l'Herménéia, ch. 5 et 6, et plus particulièrement liv. 1 des Premiers Analytiques, ch. 1, § 6, qui Aristote ne fait guère que répéter ici. § 14. J'appelle thèse, Aristote distingue ici les propositions immédiates en deux espèces : d'abord la thèse, puis l'axiome. La thèse se subdivise elle-même en hypothèse et en définition. La thèse n'a pas besoin d'être démontrée non plus que l'axiome; mais elle doit être énoncée et elle est aussitôt accordée. Si l'on affirme ou si l'on nie l'existence de la chose, la thèse devient une hypothèse. Si l'on ne fait qu'indiquer l'essence de la chose, c'est une définition; car la définition n'affirme ni ne nie, elle pose seulement ce qu'est la chose. L'hypothèse et la définition sont donc toutes deux des thèses, seulement l'une dit que la chose est ou n'est pas, et l'autre ce qu'est la chose. § 16. Les principes, précisément parce qu'ils sont indémontrables, sont plus connus que la conclusion qu'ils produisent. - Soit en totalité, soit en partie, c'est-à-dire, soit qu'on connaisse la majeure, soit qu'en connaisse la mineure, séparément ou toutes les deux ensemble. Voir § 17, un peu plus bas. § 17. C'est ce qui aura lieu, Aristote veut dire ici que les principes doivent être connus ou par la science démontrée ou par un mode de connaissance supérieure à la science elle-même. Il vient de démontrer que les principes sont plus connus que la conclusion; mais on pourrait croire que les principes sont connus par démonstration comme la conclusion elle-même. Or comme on ne sait pas les principes précisément parce qu'on les connaît d'une manière supérieure à la science, il s'ensuivrait qu'on croirait plus à ce qu'on ne sait pas, qu'a ce qu'on sait par démonstration. Donc on ne sait pas les principes, on les connaît d'une autre manière comme il sera dit au chapitre dernier du second livre. - Soit tous, soit quelques-uns, voir plus haut, § 16. § 18. De l'évidence et de la certitude des principes vrais résulte de toute nécessité la fausseté évidente et incontestable des principes opposés. L'erreur est alors aussi claire que la vérité. |
|
Deux objections contre la science démonstrative : 1° la science démonstrative est impossible; car il n'y a point de principes et il y a progrès à l'infini ; ou s'il y a des principes, on ne les sait pas puisqu'on ne peut les démontrer. - Réponse : toute science ne vient pas de la démonstration; et par exemple, celle des propositions immédiates est indémontrable; les principes de la science sont les termes, les définitions. - 2° La science démonstrative est possible, mais la démonstration est circulaire et réciproque. - Réponse : la démonstration circulaire mène à cette contradiction évidente qu'une même chose est à la fois antérieure et postérieure à une autre ; la démonstration circulaire prouve le même par le même; la démonstration circulaire n'est possible que dans le premier mode de la première figure, et seulement encore pour les termes réciproques; fausseté de cette théorie. |
|
|
§ 1. De ce qu'il faut savoir les primitifs, quelques-uns en concluent qu'il n'y a pas de science possible; et d'autres, tout en admettant la possibilité de la science, croient cependant que tout peut se démontrer; deux opinions qui ne sont ni vraies ni nécessaires. § 2. Quand on admet que la science est impossible, c'est qu'on croit qu'il y a progrès à l'infini; et l'on dit alors avec raison qu'on ne peut pas savoir des choses postérieures par des antérieures qui n'en sont pas les primitifs; et en effet il est bien impossible de parcourir l'infini. Mais, ajoute-t-on, si l'on s'arrête et qu'il y ait des principes, ces principes mêmes sont inconnus, puisqu'il n'y a pas de démonstration pour eux, et que la démonstration est, à ce qu'on suppose, le seul moyen de connaître. Que, s'il est interdit de connaître les primitifs, ajoute-t-on encore, il n'est pas davantage possible de connaître absolument et proprement ce qui en dérive, et l'on ne peut le connaître qu'en posant hypothétiquement l'existence des primitifs. § 3. D'autre part, on admet bien la possibilité du savoir; car on dit que c'est par la démonstration seule qu'on sait, mais on prétend aussi qu'il n'y a aucun obstacle à ce que tout se démontre, attendu que la démonstration peut être circulaire; et que les choses se prouvent les unes par les autres. § 4. Pour nous, nous soutenons, d'abord, que toute science n'est pas de démonstration, et que les propositions immédiates sont connues sans démonstration. Et que cela soit de toute nécessité, c'est ce qu'on voit sans peine; car s'il est nécessaire de savoir les choses antérieures et celles dont se forme la démonstration, et que de plus on puisse trouver un point d'arrêt dans les propositions immédiates, il s'ensuit, bien certainement, que celles-là sont indémontrables. Nous soutenons donc qu'il en est ainsi, et que non seulement la science existe, mais qu'il y a pour la science un principe, en tant que nous connaissons les termes même dont la science se sert. § 5. Quant à la démonstration circulaire, l'impossibilité absolue en est frappante, s'il est vrai que la démonstration doit toujours partir de choses antérieures et plus notoires. En effet, il est impossible que les mêmes choses soient à l'égard des mêmes choses antérieures et postérieures tout à la fois, si ce n'est sous un point de vue différent : par exemple, en les prenant tantôt par rapport à nous, tantôt dans leur existence absolue; et l'induction nous donne la science sous le premier rapport. Mais, s'il en est ainsi, la science n'est pas unique et nous l'avons mal définie; il faut alors reconnaître qu'elle est double; ou bien il faudrait repousser absolument cette autre démonstration qui se tire de choses plus notoires par rapport à nous. § 6. Non seulement les partisans de la démonstration circulaire commettent la faute que nous indiquons ici, mais au fond ils se bornent à dire qu'une chose est si elle est. De cette façon-là, rien n'est plus facile que de démontrer tout. Pour prouver la vérité de ceci, il suffit de poser trois termes; car peu importe que la démonstration revienne sur elle-même par un plus grand nombre ou un moins grand nombre de termes; par plus de deux termes ou par deux termes seulement. En admettant donc que A existant, il y a nécessité que B existe, et que B existant, il y a nécessité que C existe aussi; A existant, C existera. Mais si A étant, il y a nécessité que B soit, et que celui-ci étant A soit réciproquement 73a, car c'est là précisément la démonstration circulaire, on peut supposer A à la place de C. Ainsi dire que B étant A est aussi, c'est dire que C est également; et cela revient encore à dire que A existant, C existe; car C se confond avec A. On voit donc que, quand on soutient que la démonstration est circulaire, on arrive simplement à dire que A existant, A existe. A ce compte, on peut aisément tout démontrer. § 7. Mais la démonstration circulaire n'est même possible que pour les termes qui se suivent réciproquement comme les attributs propres. En effet, il a été démontré que, quand on ne suppose qu'une seule chose, on n'en peut jamais conclure nécessairement qu'une autre soit; et j'entends qu'une seule chose ne suffit pas, soit terme unique, soit proposition isolée. Il faut primitivement, tout au moins, deux propositions pour pouvoir conclure, si toutefois l'on veut faire un syllogisme. Si donc A est conséquent de B et de C, et que ces deux derniers termes soient conséquents l'un de l'autre ainsi que de A, on pourra démontrer, les uns par les autres, tous les termes admis, dans la première figure, comme on l'a fait voir dans le Traité du syllogisme. Il a été démontré, en outre, que dans les autres figures, il n'y a pas de syllogisme circulaire, ou que, du moins, il n'y en a pas pour les propositions données.
Quant aux termes qui ne sont pas susceptibles d'être attribués
réciproquement les uns aux autres, on ne peut pas du tout les
démontrer circulairement. Or, comme il y a dans les démonstrations
fort peu de termes de ce genre, c'est évidemment soutenir quelque
chose de vide de sens et d'impossible, que de dire que la
démonstration est réciproque, et qu'il peut y avoir démonstration de
ce genre dans tous les cas. |
§1. Quelques-uns... et d'autres. Il y a donc deux objections contre la possibilité de la science. 1° La science n'est pas possible ; 2° la science n'est possible que par la démonstration. § 2. Quand on admet que la science est impossible, développement de la première objection. La science est impossible, car il faut avoir les principes pour savoir tes conclusions; et comme on ne peut avoir que par démonstration, il s'ensuit que les principes eux-mêmes doivent être démontrés; et remontant ainsi de principes en principes, il est impossible d'atteindre la science qui recule dans l'infini. Que si l'on croit arriver à des principes, comme ces principes sont inconnus, attendu qu'ils sont indémontrables, on ne peut s'en servir pour connaitre antre chose. Ainsi les conclusions sont inconnues comme les principes eux-mêmes; et si on les connaît, ce n'est jamais que d'une manière hypothétique, c'est-à-dire en supposant toujours que les principes sont vrais. § 3. D'autre part, développement de l'autre objection. On peut savoir les principes par démonstration, et on les démontre au moyen des conclusions, de même qu'on démontre les conclusions par les principes. Donc la démonstration peut s'appliquer à tout parce qu'elle est circulaire. § 4. Pour nous, réponse d'Aristote aux deux objections. II faut distinguer deux espèces de sciences, l'une qui est obtenue par démonstration, l'autre sans démonstration. Les conclusions sont bien, en effet, connues par les principes; mais les principes sont connus par eux-mêmes, et les propositions immédiates sont indémontrables. - La science existe, la science des conclusions dérivée des principes. - Il y a pour la science un principe, c'est-à-dire des principes indémontrables. - Nous connaissons les termes mêmes. Les termes signifient ici les propositions immédiates. § 5. Quant à la démonstration circulaire. La démonstration circulaire est impossible par trois motifs: 1° elle mènerait à cette absurdité, que les mêmes choses seraient à la fois antérieures et postérieures à d'autres mêmes choses, puisque on doit admettre ce principe évident, que les principes dont part la démonstration sont plus notoires que la conclusion qui en sort, et lui sont antérieurs. Il n'y aurait qu'un moyen de défendre cette absurdité, ce serait de distinguer entre les choses celles qui sont antérieures ou postérieures par nature et celles qui le sont par rapport à nous. On pourrait donc prouver une chose antérieure relativement à nous par une chose antérieure en nature; et réciproquement; ce qui donnerait bien une démonstration circulaire, mais alors la définition de la science donnée plus haut, chap. 2, §§ 1 et suivants, est fausse; ce qui est impossible. La conclusion qui produit la science vient toujours du principe plus notoire relativement à nous. § 6. Non seulement... 2° La démonstration circulaire mène à cette absurdité, qu'une même chose est prouvée par elle-même, c'est-à-dire que la démonstration circulaire n'est qu'une pétition de principes, comme le prouve l'exemple donné sur les trois termes généraux A, B, C, et qu'on aurait pu donner sur les deux premiers seulement en désignant les prémisses par A. § 7. La démonstration circulaire n'est même possible. 3° Le troisième défaut de la démonstration circulaire, c'est qu'elle ne s'applique qu'aux choses qui peuvent se convertir réciproquement les unes dans les autres; et par conséquent, elle ne s'applique point à tout, comme on l'a dit. - Qui se suivent réciproquement, c'est-à-dire qui sont d'égale étendue et qui peuvent se convertir les uns dans les autres. - Comme les attributs propres, c'est-à-dire qui n'appartiennent qu'à la chose seule, et qui peuvent, par conséquent, être pris pour elle. - Il a été démontré, Premiers Analytiq., liv. 1, chap. 24. - Comme on l'a fait voir dans le Traité du syllogisme, Premiers Analyt., liv. Il, chap. 3 et suivants; il a été démontré, en effet, que le cercle complet, c'est-à-dire, la démonstration circulaire des prémisses et de la conclusion avec des propositions qui peuvent se convertir les unes dans les autres, n'avait lieu qu'en Barbara, et qu'elle était impossible dans les autres modes et dans les autres figures. - Il a été démontré en outre, Premiers Analyt., liv. II, chap. 5, 6, 7. - Pour les propositions données, c'est-dire que tantôt on ne peut prouver circulairement aucune des propositions, et que tantôt on peut n'en prouver qu'une seule. De plus, il n'y a qu'un très petit nombre de termes qui puissent ainsi se convertir les uns dans les autres. C'est donc se tromper étrangement que de soutenir que la démonstration circulaire est générale et peut s'appliquer à tout, puisque les faits attestent que l'emploi n'en est que très rarement possible. |
|
Principe général : Toute conclusion démontrée est nécessaire, parce que les principes dont elle sort sont nécessaires; définition de la démonstration. Conditions de la nécessité dans les propositions. 1° II faut que le sujet soit pris dans toute son extension. 2° Il faut que l'attribution soit essentielle. 3° Il faut que l'attribut soit universel, c'est-à-dire, aussi étendu que le sujet. Définitions de ces trois expressions : être attribué à tout, essentiel, universel. - Pour être attribué à tout le sujet, il faut que l'attribut soit à toutes les parties du sujet et dans tous les temps ; pour que l'attribution soit essentielle, il faut que l'attribut soit compris dans la définition du sujet, ou le sujet dans la définition de l'attribut, que le sujet existe par lui-même et que l'un des deux termes soit cause de l'autre; pour que l'attribut ne soit pas plus étendu que le sujet, il faut qu'il se rapporte à un primitif. - Démonstration universelle et essentielle. |
|
|
§ 1. Puisqu'une chose qu'on sait absolument ne peut point être autrement qu'on ne la sait, il en résulte que ce qui est su de science démontrée est nécessaire, la science démontrée étant celle que nous possédons, par cela même que nous en avons la démonstration. Donc la démonstration est le syllogisme tiré de propositions nécessaires. § 2. Voyons donc de quelle espèce de propositions se composent les démonstrations et à quoi elles s'appliquent; et d'abord définissons ce que nous entendons par ces expressions: attribué à tout, essentiel et universel. § 3. Je dis d'une chose qu'elle est attribuée à toute une autre chose, quand elle ne petit pas être attribuée à telle partie, et n'être pas attribuée à telle autre partie de cette chose; quand elle ne peut pas lui être attribuée dans tel moment, et ne le lui être point dans tel autre moment. Ainsi, par exemple, animal étant attribué à tout homme, s'il est vrai de dire que tel être est un homme, il est vrai aussi de dire qu'il est animal; et si l'un des deux est actuellement, l'autre est à titre égal. Ou bien encore, si l'on dit que le point est dans toute ligne, le raisonnement est tout pareil. La preuve de ceci, c'est que pour les objections, nous regardant comme interrogés sur la totalité de la chose, nous les faisons toujours, en soutenant ou qu'elle n'est pas à telle partie, ou qu'elle n'est pas en tel temps. § 4. Essentiel se dit des choses qui sont dans la chose en tant qu'elle est ce qu'elle est, comme la ligne dans le triangle, et le point dans la ligne. En effet, l'essence du triangle et de la ligne se compose de ces éléments; et ces éléments entrent dans la proposition qui exprime ce que sont le triangle et la ligne. On appelle encore essentielles toutes les choses dont la définition essentielle ne peut être donnée qu'au moyen des choses mêmes dont elles sont essentiellement les attributs. Par exemple, droit et courbe s'applique essentiellement à la ligne: pair et impair s'appliquent au nombre aussi bien que premier et multiple, carré 74 et scalène; et pour toutes ces choses, dans la proposition qui exprime ce qu'elles sont, se retrouvent, ici la ligne, là le nombre. Je pourrais citer bien d'autres exemples analogues, et dans chaque cas, j'appelle essentielles les choses de ce genre. Au contraire, j'appelle accident les choses qui ne sont ni de l'une ni de l'autre façon. Ainsi musicien ou blanc, ne sont que des accidents par rapport à l'animal. § 5. Une chose est encore dite essentielle, quand elle ne peut être attribuée à aucun sujet. Par exemple marchant, suppose toujours un être distinct dont on dit : Il est marchant et il est blanc. La substance, au contraire, et tout ce qui exprime un objet individuel n'étant pas autre chose que ce qu'ils sont, sont uniquement ce qu'ils sont. J'appelle donc essentielles, les choses qui ne se rapportent pas à un sujet, et accidents celles qui s'y rapportent. § 6. Enfin, en un autre sens, essentiel se dit de tout ce qui, par la chose même, est à cette chose; et accidentel, de ce qui n'y est pas par elle seule. Si, par exemple, il a fait un éclair pendant qu'on marchait, ce n'est là qu'un accident; car cet éclair n'a pas eu lieu parce qu'on marchait; il n'a eu lieu, comme on dit, qu'accidentellement. Au contraire de ce qui a lieu à cause de la chose même, on dit que c'est essentiel. Si par exemple quelqu'un est mort étranglé, c'est de la strangulation qu'il est essentiellement mort; car il est mort parce qu'il a été étranglé, et ce n'est pas du tout un accident qu'étant étranglé il en soit mort. § 7. Ainsi donc, pour tout ce qu'on sait d'une manière absolue, les choses dites essentielles en ce sens qu'elles sont essentiellement dans leurs attributs ou que leurs attributs sont essentiellement en elles, sont à la fois par elles seules et de toute nécessité; car il est impossible ou qu'elles ne soient pas elles-mêmes à l'objet d'une manière absolue, ou que leurs opposés n'y soient pas. Ainsi pour la ligne, droit ou courbe; pour le nombre, pair ou impair; car le contraire est toujours ou la privation, ou la contradiction dans le même genre; et par exemple, dans les nombres, le pair est ce qui n'est pas impair; car c'est là ce qu'exigent la manière dont l'un et l'autre se suivent. Si donc il faut nécessairement pour toute chose ou la nier ou l'affirmer, il faut aussi que les choses essentielles soient nécessairement dans les objets auxquels elles se rapportent. § 8. Telles sont les définitions de ces expressions : être attribué à tout, et essentiel. § 9. J'appelle universel ce qui à la fois est attribué à tout l'objet, lui est essentiel, et est à l'objet en tant que l'objet est ce qu'il est. § 10. Il en résulte évidemment que ce qui dans les choses est universel, y est aussi nécessaire. § 11. Essentiel, et en tant que l'objet est ce qu'il est, ce sont là des expressions équivalentes. Par exemple : le point et le droit sont essentiellement à la ligne; car ils y sont en tant qu'elle est ligne. Deux angles droits sont la valeur du triangle en tant que triangle; car essentiellement le triangle a ses angles égaux à deux droits. § 12. L'universel n'existe qu'à cette condition d'être démontré d'un objet quelconque dans le genre dont il s'agit, et primitif dans ce genre; ainsi, valoir deux angles droits n'est pas universel à la figure, bien qu'on puisse démontrer d'une figure qu'elle vaut deux angles droits, mais ce n'est pas d'une figure quelconque; et de plus, quand on démontre, on ne prend pas non plus une figure quelconque, attendu que le quadrilatère, qui est bien aussi une figure, n'a pourtant pas la somme de ses angles égale à deux angles droits. Au contraire, un isocèle quelconque a bien ses angles égaux à deux droits, mais l'isocèle n'est pas un primitif; car le triangle lui est antérieur. Donc ce qui sans exception et primitivement, est démontré avoir ses angles égaux à deux droits ou telle autre propriété 74a, ce primitif-là a l'universel, et il y a démonstration essentielle de cet universel. Pour tout le reste, au contraire, la démonstration a bien lieu, dans une certaine mesure, mais elle l'est pas essentielle. Ainsi pour l'isocèle, la démonstration n'est pas universelle, attendu qu'elle est plus large que lui. |
§ 1. Absolument... ne peut point être autrement qu'on ne la sait.... Voir plus haut, chap. 2, § 1, ce principe déjà posé. - La démonstration est le syllogisme tiré de propositions nécessaires. Syllogisme est pris ici, comme il l'a déjà été si souvent, pour conclusion. - Reste à savoir quelles sont les conditions qui rendent une proposition nécessaire, et par suite démonstrative. § 2. Trois conditions sont indispensables dans une proposition pour qu'elle soit nécessaire. Il faut, 1°que l'attribut soit attribué à tout le sujet dans tous les temps, dans toutes les circonstances possibles, 2° qu'il soit essentiel, 3° qu'il soit universel, c'est-à-dire, qu'étant à la fois attribué à tout l'objet, et lui étant essentiel, il s'applique en outre au primitif, dans le genre dont ils agit C'est la réunion de ces trois condition ; qui constitue la proposition réellement nécessaire. § 3. Attribuées à toute une autre. Voilà la première condition qui se partage elle-même en deux espèces. pour que l'attribut soit général, il faut, à la fois, qu'il comprenne tout le sujet, et qu'il comprenne tout le temps. Les scholastiques ont appelé la première attribution qui n'est générale que par rapport au sujet, attributio prioristica, et celle qui se rapporte à tout le sujet et à tout le temps, attributio posterioristica. - La preuve de ceci, c'est que pour les objections, preuves tirées du témoignage commun de tous les hommes. L'attribution générale est si bien ce que dit Aristote, que lorsqu'on prétend réfuter, on objecte également, ou que l'attribut ne s'applique pas à une partie du sujet, ou qu'il ne lui appartient pas dans tel moment donné. § 4. Essentiel se dit des choses, voilà la seconde condition qui contribue à rendre une proposition nécessaire ; toute attribution essentielle est générale, mais la réciproque n'est pas vraie, et toute attribution générale n'est pas essentielle, c'est-à-dire, que cette seconde condition contient la première et n'est pas contenue par elle. - Aristote distingue quatre sens différents du mot essentiel; et par conséquent il en distinguera tout autant pour le mot accidentel qui lui est opposé. - Se dit des choses qui sont dans la chose. Premier sens du mot essentiel; un attribut essentiel d'une chose est celui qui naturellement, en réalité, est dans cette chose, et qui par conséquent se retrouve aussi dans la définition essentielle de cette chose. - On appelle encore essentielles... dont elles sont essentiellement les attributs. Deuxième sens du mot essentiel; ici, encore, l'attribut est naturellement placé dans le sujet, mais il faut en outre que le sujet lui-même entre dans la définition de l'attribut, tandis que dans le premier sens c'était l'attribut qui entrait dans la définition du sujet. - Droit et courbe t'appliquent essentiellement à la ligne, car il faut nécessairement qu'une ligne soit l'un ou l'autre. - Nombre scalène, c'est-à-dire, nombre qui est multiplié par un autre que lui-même. - J'appelle accident les choses qui ne sont ai de rune ni de l'autre façon, c'est-à-dire, qui ne sont essentielles ni dans le premier ni dans le second sens; ce sont des attributs qui n'entrent point dans la définition du sujet, et dans la définition desquels le sujet non plus n'entre point. § 5. Une chose est encore dite essentielle, troisième sens du mot essentiel. C'est ici le principe général des Catégories qui divise les choses en deux grandes classes, les substances et les accidents. Les premières, qui sont en elles-mêmes et ne peuvent être attribuées; les secondes qui sont toujours dans un sujet digèrent d'elles et qui peuvent servir d'attributs. Voir les Catégories, ch. 2, § 2. - Ici encore Aristote donne la définition de l'accident opposé à la substance, comme II l'a fait pour les deux premiers sens d'essentiel. § 6. Quatrième et dernier sens du mot essentiel. Dans les trois premiers sens, l'attribut était toujours dans le sujet, ici au contraire, l'attribut est séparé du sujet. Pour que l'attribution soit vraie, il faut cependant qu'il y ait entre les deux termes un rapport. Quand ce rapport est tel que l'un soit la cause de l'autre, l'attribution est essentielle; elle est accidentelle quand ce rapport est autre que celui de la cause à l'effet. § 7. En ce sens qu'elles sont essentiellement dans leurs attributs, second sens du mot essentiel : voir plus haut, § 4. - Ou que leurs attributs sont essentiellement en elles, premier sens du mot essentiel, ibid. - Ainsi toutes les choses essentielles dans les deux premiers sens, sont nécessairement dans les choses auxquelles elles se rapportent, soit le sujet à l'attribut, soit l'attribut au sujet. - Ou que leurs opposés n'y soient pas, restriction et extension de ce principe : la chose ou son opposé. Ainsi d'une manière générale la ligne n'est pas droite; elle est ou droite ou courbe, parce que droit et courbe sont des attributs essentiels et nécessaires à la ligne qui doit avoir l'un ou l'autre. - Que les choses essentielles soient nécessairement dans les objets auxquels elles se rapportent, il faut entendre ici les choses essentielles dans les deux premiers sens seulement. Quant au troisième sens du mot essentiel, il est évident que la substance individuelle n'est jamais nécessaire; et de plus elle est pour elle seule, et n'est jamais dans un sujet autre qu'elle même. Enfin, quant au quatrième sens, il ne porte pas non plus en lui un caractère de nécessité; ainsi dans l'exemple choisi par Aristote, il n'y a pas de nécessité que l'homme meure par strangulation; car il 'y a une foule d'autres causes de mort toutes différentes. § 8. De ces expression : être attribué à tout et essentiel, voilà l'explication des deux premiers termes indiqués au § 2. Aristote passe ensuite à l'explication du troisième universel. § 9. J'appelle universel, il faut bien remarquer qu'ici le terme d'universel a un tout autre sens que dans les Premiers Analytiques, ou dans l'Herméneia. Universel s'entend ici d'un attribut égal en extension au sujet, de telle sorte que l'un peut être pris pour l'autre. L'attribut est alors dans tout le sujet, et il ne se trouve point dans un autre sujet; il est non seulement de omni, il est encore de solo. II y a trois conditions pour l'universel: les deux premières ont été déjà expliquées; quant à la troisième, est à l'objet en tant que l'objet est ce qu'il est, signifie que le sujet est primitif dans le genre. Ainsi, l'homme est doué de la faculté de rire en tant qu'il est homme, et cet attribut lui appartient en tant qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire en tant qu'il est homme; la sensibilité, au contraire, lui appartient en tant qu'il est animal; car la sensibilité appartient à un genre supérieur à celui de l'homme, et plus étendu que lui; donc la sensibilité n'est pas un attribut universel de l'homme dans le sens où Aristote entend ici universel. § 10. Y est aussi nécessaire, l'universel porte le plus haut caractère de nécessité; l'essentiel et l'attribution générale ont ce caractère à de moindres degrés. L'universel, qui est la troisième condition, réunit les deux premières, et voilà pourquoi ils donnent aux propositions une force absolue de nécessité que les deux premières conditions ne peuvent leur communiquer. § 11. Ce sont là des expressions équivalentes, il est alors difficile de comprendre pourquoi la seconde est ajoutée comme une condition nécessaire à l'idée de l'universel. Pour expliquer cette contradiction apparente, les commentateurs ont distingué deux nuances dans le sens du mot essentiel. D'abord essentiel est opposé à accidentel, comme on l'a vu plus haut § 4, et alors il ne peut se confondre avec cette autre expression : en tant que l'objet est ce qu'il est car alors il est plus étendu qu'elle ; en second lieu, essentiel est opposé à ce qui est par soi seul et n'est point par une chose autre que soi, et alors il peut se confondre avec cette expression : en tant que l'objet est ce qu'il est. C'est dans ce dernier sens qu'Aristote le prend ici. Par exemple, la sensibilité est bien essentielle à l'homme et non point accidentelle, en ce sens que l'homme n'est point sans la sensibilité; mais ce n'est point en tant qu'homme qu'il est sensible, c'est en tant qu'animal; ce n'est pas en tant qu'il est ce qu'il est que l'homme est sensible; il ne l'est pas par soi, il l'est par un autre que soi. § 12. L'universel n'existe, on ne peut obtenir une conclusion universelle démontrée que si le sujet dont on démontre un attribut est primitif dans le genre dont il s'agit. Ainsi, prenant pour exemple cette propriété géométrique d'avoir ses trois angles égaux à deux droits, pour que la démonstration soit universelle, il faut que le sujet remplisse ces deux conditions, que tout entier il reçoive l'attribut, et qu'il soit, en outre, le premier à le recevoir. On peut démontrer de trois objets que les trois angles sont égaux à deux droits : d'abord de la figure; mais la démonstration ne serait pas universelle, puisque tonte figure n'a pas la somme de ses angles égale à deux droits, bien que ce soit d'une figure qu'on doive démontrer cette propriété En second lieu, du triangle équilatéral; mais la démonstration ne serait pas non plus universelle : puisque ce n'est pas en tant qu'équilatéral que le triangle équilatéral a ses trois angles égaux à deux droits, c'est en tant que triangle; l'équilatéral n'est donc pas primitif dans son genre. Après avoir exclu un sujet plus étendu que l'attribut et ensuite un sujet plus étroit, reste un sujet égal en étendue à son attribut, et voilà pourquoi c'est du triangle qu'on démontre cette propriété universelle qu'il a ses trois angles égaux à deux droits; car tout triangle la possède; et de plus le triangle est primitif dans son genre, puisqu'on ne peut remonter au delà. - Il y a démonstration essentielle de cet universel, les démonstrations de toutes les sciences sont de ce genre; elles s'adressent toujours aux primitifs, et démontrent toujours un attribut d'étendue parfaitement égale à celle du sujet. - Mais elle n'est pas essentielle, elle a lieu pour l'objet non point en soi, mais par un autre que soi comme on vient de le dire. |
|
Quatre sortes d'erreurs possibles dans la démonstration universelle. - 1° Quand la démonstration s'arrête à l'individuel et ne va pas jusqu'à l'universel auquel l'individu se rattache. - 2° Ou les individus se rattachent. - 3° Quand il n'y a pas de mot spécial pour l'universel et qu'on se borne à démontrer les espèces. - 4° Quand on confond la démonstration de toutes les espèces avec celle de l'universel. - Exemples: 1° de la quatrième erreur, 2° de la première, 3° de la troisième, 4° de la seconde. Règle générale : il n'y a démonstration universelle que quand on est parvenu au primitif universel; le primitif universel est le terme dont le retranchement détruit la démonstration, et dont l'admission la rend possible. |
|
|
§ 1. Il faut remarquer que souvent ici on se trompe, et que le démontré n'est pas primitif universel dans le sens même où il a été démontré, à ce qu'il semble, primitif universel. On commet cette erreur, lorsqu'on ne peut point remonter à un terme plus haut que l'individu ou des individus; ou bien quand en allant même au-delà de l'individuel, l'universel n'est pas représenté par un mot qui réunisse les choses spécialement différentes ; ou bien enfin lorsque l'objet auquel la démonstration s'applique, renferme seulement l'universel comme le tout dans la partie; car la démonstration alors aura lieu pour les cas particuliers, elle s'appliquera à tout l'objet, et cependant elle ne s'appliquera point au primitif universel. Or je dis qu'il n'y a démonstration du primitif en tant que primitif, que quand il y a démonstration du primitif universel. § 2. Quand, par exemple, on démontre que deux droites sont parallèles, on pourrait croire qu'on donne une démonstration proprement dite, parce qu'elle vaut pour toutes les lignes coupées à angles droits; pourtant il n'en est rien, puisque les lignes sont parallèles, non pas parce que les angles sont d'une certaine façon égaux à deux droits, mais parce qu'ils sont toujours égaux à deux droits, quelle que soit d'ailleurs leur forme. § 3. On se tromperait encore de même si, supposant qu'il n'y a pas d'autre triangle que le triangle isocèle, les propriétés du triangle semblaient lui appartenir, en tant qu'isocèle. § 4. On se trompe aussi quand on croit que la proportion est permutable seulement, en tant que les termes sont ou des lignes, ou des nombres, ou des solides, ou des temps, comme on pourrait le démontrer pour chacune de ces espèces séparément, bien qu'il soit également possible de le démontrer par une seule démonstration pour toute espèce de termes. Mais comme toutes ces espèces ne sont pas comprises sous un nom unique qui les renferme toutes, nombre, surface, solide, temps; et comme de plus, en tant qu'espèces, elles différent les unes des autres, on pouvait les considérer chacune isolément. Ici, au contraire, on parle de démonstration universelle; car ce n'est pas en tant que ces espèces sont des lignes, en tant qu'elles sont des nombres, que la proportion existe pour elles ; mais c'est en tant qu'elles sont l'objet même qu'on suppose universel. § 5. Voilà encore pourquoi, si l'on a démontré pour toutes les espèces de triangle, soit par une démonstration commune, soit par une démonstration spéciale, que chacun de ces triangles a ses angles égaux à deux droits, l'équilatéral aussi bien que le scalène et l'isocèle, l'on ne peut pas dire encore qu'on sache, si ce n'est d'une manière sophistique, que le triangle a ses angles égaux à deux droits. On ne connaît pas universellement le triangle, bien qu'il n'y ait pas de triangle autre que ceux-là; car on ne sait pas que le triangle a cette propriété en tant que triangle. On ne sait même pas non plus que c'est la propriété de tout triangle, ou du moins on ne le sait que numériquement. Formellement, on ignore que tout triangle est dans ce cas, bien qu'il n'y ait pas de triangle outre ceux qu'on connaît. § 6. Quand donc est-on privé de la science universelle, et quand possède-t-on la science d'une manière absolue ? Il est clair qu'on ne la posséderait ainsi que si l'on pouvait supposer que l'essence du triangle se confond avec l'équilatéral, ou avec tel autre des triangles pris à part, ou avec tous ensemble. Mais si, loin d'être la même chose, c'est une chose toute différente, et que la propriété n'appartienne au triangle qu'en tant que triangle, on ne possède certainement pas la science universelle. § 7. Mais la propriété est-elle au triangle en tant que triangle ou en tant qu'isocèle? Quand la propriété existe-t-elle relativement au primitif? et quand est-on arrivé à la démonstration universelle? Évidemment c'est lorsque après avoir retranché toutes les circonstances, on a atteint le terme auquel la propriété appartient en premier. Ainsi deux angles droits sont la valeur des angles d'un triangle isocèle d'airain 75; mais c'est encore la valeur de ses angles en retranchant ces deux conditions qu'il soit d'airain et qu'il soit isocèle. Cette propriété cesse bien de subsister si on lui ôte et la figure qu'il a, et les lignes qui le limitent; mais cette figure et ces lignes ne sont pas les primitifs; et quel est donc ici le primitif qu'il faudrait ôter? Évidemment c'est le triangle; car c'est par lui que la propriété appartient aussi aux autres termes, et c'est pour lui seul qu'il y a démonstration universelle. |
§ 1. Souvent ici l'on se trompe, il s'agit de la conclusion et des erreurs qu'on peut y commettre en croyant avoir démontré l'universel, bien qu'en réalité on n'ait point démontré l'universel proprement dit, et qu'on ait pris un terme moins étendu que l'universel pour l'universel même; et, par exemple, l'espèce pour le genre ou l'individu pour l'espèce. - On commet cette erreur, quatre espèces distinctes de la même erreur : 1° Il n'y a qu'un seul individu dans l'espèce : la démonstration s'appliquant à lui seul ne paraît point universelle, et elle l'est cependant parce qu'elle s'applique à l'individu, non point en tant qu'individu, mais en tant qu'il a quelque qualité naturelle indépendante du temps et du lieu. - 2° Ou des individus, seconde espèce d'erreur. Zabarella, d'après Thèmistius et Averroès, veut rejeter ces trois mots, qui manquent en effet dans plusieurs manuscrits grecs et latins. Pacius au contraire les adopte, et il y trouve une seconde espèce d'erreur de sorte qu'il en reconnaît quatre au lieu de trois. Je n'ai pas cru devoir les supprimer, parce qu'ils ne contredisent point, à mon sens, ce qui précède. Ils veulent dire que, soit que la démonstration s'applique à un seul individu, soit qu'elle s'applique à plusieurs, elle s'en est pas moins universelle, bien qu'elle ne remonte pas directement jusqu'à l'espèce. De plus, comme plus bas, au § 5, Aristote donne un exemple de cette erreur aussi bien que des trois autres, il est évident qu'il a voulu la distinguer et en faire une espèce à part. Je m'éloigne donc, avec Pacius, du sentiment de Zabarella, quelque grave que soit son autorité: mais Zabarella ne paraît pas avoir remarqué le caractère particulier de l'exemple cité au § 5. - L'universel n'est pas représenté par un mot. 3° Troisième espèce d'erreur. Il ne suffit pas que démonstration s'applique à toutes les espèces pour être universelle. Quand le genre n'a point de nom spécial, on ne remonte pas jusqu'à lui, et l'on croit, mais à tort, avoir démontré universellement, parce qu'on a démontré de toutes les espèces que le genre contient; mais cela ne suffit pas. - Comme le tout dans la partie. 4° Quatrième espèce d'erreur. La démonstration peut être générale, c'est-à-dire s'appliquer à tout l'objet, mais si l'objet lui-même n'est pas le primitif universel, la démonstration n'est pas universelle. C'est qu'il faut se rappeler ici le sens nouveau qu'Aristote donne à universel dans le chapitre précédent, § 9. La proposition a bien la forme universelle: tout homme est doué de sensation; mais la démonstration n'est point pour cela universelle, car ce n'est pas l'homme qui, sous le rapport de la sensation, est primitif universel; c'est l'animal. - Comme le tout dans la partie, c'est-à-dire qu'on prend l'espèce pour le genre; comme ici l'homme pour l'animal. Averroès croit, à tort, contre Thémistius et Philopon, que cette quatrième erreur est relative aux prémisses et au moyen terme en particulier: elle s'adresse comme les trois premières à la conclusion. - Que quand il y a démonstration du primitif universel. Voir chapitre précédent, § 12. § 2. Quand par exemple, dans les §§ 2, 3, 4, 5. Exemples des diverses espèces de l'erreur générale qu'on vient d'indiquer, et d'abord exemple de la quatrième espèce. - Une démonstration proprement dite, une démonstration universelle. - D'une certaine façon, c'est-à-dire quand les deux angles sont droits chacun pris à part. Dans cette démonstration en effet on ne remonte point jusqu'au primitif universel. Ce n'est point parce que la sécante est perpendiculaire aux deux lignes, et forme, par conséquent, deux angles droits de l'un et de l'autre côté dont la somme est égale à deux droits, que les lignes sont parallèles; mais elles sont parallèles parce que la ligne qui les coupe, perpendiculaire ou non, forme toujours deux angles dont la somme est égale à deux angles droits. § 3. En supposant qu'a n'y a pas d'autre triangle que le triangle isocèle, exemple de la première espèce d'erreur. Aristote suppose, ce qui n'est pas, qu'il n'y ait qu'une seule espèce de triangle, l'équilatéral; et il raisonne ainsi : SI l'on démontre que le triangle équilatéral a ses angles égaux à deux droits, on pourra croire que l'on fait une démonstration universelle, et pourtant on n'en fera point une; car ce n'est point en tant qu'équilatéral que l'équilatéral a ses angles égaux à deux droits, c'est en tant que triangle. § 4. On se trompe encore, exemple de la troisième espèce d'erreur. - La proportion est permutable, c'est ce que nous appelons aujourd'hui proportion par équiquotient et par équidifférence. Ces deux espèces de proportions ont cette propriété qu'on peut y changer de place les moyens ou les extrêmes sans que la proportion soit détruite; le rapport qui constitue la proportion subsiste toujours. - On parle de démonstration universelle, ou pourrait croire qu'on a fait une démonstration universelle, parce qu'on a démontré la propriété en question de toutes les espèces auxquelles elle appartient; mais la démonstration ne serait vraiment universelle que si elle s'appliquait au genre, ici sans nom spécial, qui renfermerait, lignes, nombres, solides et temps, à la fois; ce genre pourrait être, par exemple, la quantité, c'est-à-dire, l'objet même qu'on suppose universel. § 5. Pour toutes les espèces de triangle, exemple de la seconde espèce d'erreur. Au lieu d'une seule espèce de triangle, comme au § 3, il s'agit ici de toutes les espèces de triangle; au lieu d'un seul individu, de tous les individus. La démonstration n'est pas universelle, bien qu'on l'ait appliquée, soit par un syllogisme collectif, soit par des syllogismes particuliers, à toutes les espèces de triangles. Cette démonstration, ou ces démonstrations ne font pas savoir que le triangle a ses angles égaux à deux droits; ou, du moins, elles ne le font savoir que d'une manière sophistique, voir plus haut ch. 2, § 1. - Numériquement, parce qu'on le sait pour tous les triangles, pour le nombre total des triangles possibles. - Formellement, c'est-à-dire, pour le triangle en général, la forme générale du triangle, quelle que soit d'ailleurs la forme particulière de chaque triangle, scalène, équilatéral, ou rectangle. § 6. Quand donc est-on privé de la science universelle. Après avoir indique les espèces de l'erreur, Aristote trace les règles pour l'éviter; et d'abord il remarque que la démonstration qui s'applique à un terme inférieur peut bien être universelle quand l'essence du terme inférieur est identique à celle du terme supérieur, comme l'essence de l'Individu est identique à celle de l'espèce; mais que cette démonstration relative à un terme inférieur n'est pas universelle, quand l'essence du terme inférieur n'est pas identique à celle du supérieur, comme, par exemple, l'essence de l'espèce qui n'est pas du tout identique à celle du genre. Ainsi, la démonstration qui s'applique à une espèce particulière de triangle, ou à toutes les espèces, n'est pas universelle, parce qu'en effet l'essence du triangle est différente de celle d'une espèce, ou de celle de toutes les espèces. On voit que l'erreur repose ici sur une homonymie, puisqu'on a pris le triangle équilatéral ou tout autre pour le triangle. § 7. Mais la propriété, règle pour reconnaître le primitif universel, et, par conséquent, la démonstration universelle. Le primitif universel, le terme auquel s'applique la démonstration universelle est celui qui, par cela seul qu'il est posé, pose l'attribut; qui par cela seul qu'il est détruit, détruit l'attribut, c'est-à-dire le sujet qui est de même étendue que l'attribut, de sorte que l'un de ces deux termes peut être pris pour l'autre. C'est ce qui Aristote exprime en disant: C'est évidemment lorsque, après avoir retranché toutes les circonstances, etc. Soit en effet cet attribut à démontrer universellement: avoir la somme de ses angles égale à deux angles droits; et soit le sujet un triangle isocèle d'airain qui est une figure limitée par des lignes. Quel est ici le primitif? quel est le terme auquel doit s'attacher la démonstration universelle? Évidemment l'attribut n'appartient point à l'isocèle comme primitif; car, l'isocèle détruit, l'attribut n'en subsiste pas moins; il n'appartient pas non plus à l'airain; car l'airain détruit, l'attribut subsiste encore ; ce n'est pas non plus à la figure, car, s'il est vrai que, la figure détruite, l'égalité des angles à deux droits est détruite aussi, ce n'est pas seulement parce que la figure est détruite que l'attribut est détruit, niais c'est parce qu'avec la figure le triangle est détruit aussi : la figure n'est donc pas le primitif. Reste donc le triangle qui est bien ici le primitif universel; car, si on le détruit, l'attribut est détruit, et c'est de tous les termes indiqués celui auquel se rattache immédiatement l'attribut. Au-dessous de lui l'isocèle, au-dessus la figure, l'un plus large, l'autre moins étendue; le triangle seul est de même extension que l'attribut; et voila pourquoi il est l'attribut universel, et ce n'est qu'à lui que peut s'appliquer la démonstration universelle. - Les scholastiques expriment cette règle avec une concision que nous ne pouvons rendre en français : lllud quo primo aufertur affectio, est subjectum ejus primum cui illa inest quatenus ipsum, ou mieux encore: Illud quo ablato aufertur, et quo posito ponitur, est subjectum primum. Zabarella rappelle cette formule. |
|
Développement du principe général que la démonstration est formée de propositions nécessaires. 1° La conclusion démontrée est nécessaire; les prémisses doivent donc l'être aussi. - 2" Avec des prémisses nécessaires, on arrive toujours à une conclusion démontrée. - 3° La nature même des objections contre les conclusions non démontrées prouve que la conclusion démontrée doit venir de prémisses nécessaires; les sophistes ont tort de croire qu'il suffit pour démontrer de propositions probables et vraies. - 4° Des prémisses non nécessaires ne peuvent donner une conclusion nécessaire; il faut que le moyen soit nécessaire comme les deux autres termes. II n'y a pas de démonstration pour l'accident; il faut que les prémisses soient essentielles, de même qu'il faut qu'elles soient nécessaires. |
|
|
§ 1. Si donc la science obtenue par démonstration dérive de principes qui sont nécessaires, ce qu'on sait ne pouvant être autrement qu'on ne le sait ; si de plus, ce qui est essentiel dans les choses est nécessaire pour ces choses, essentiel se disant d'une part de l'attribut compris dans la définition essentielle de l'objet, et d'autre part, se disant aussi de l'objet compris dans la définition essentielle de ses propres attributs, toutes les fois que l'un des deux attributs contraires doit nécessairement être au sujet, il en résulte évidemment que ce doit être d'éléments de ce genre que se tire le syllogisme démonstratif; car tout attribut est, ou nécessaire, ou accidentel; et ce qui est accidentel n'est pas nécessaire. § 2. Ou il faut confondre ainsi l'accident et le nécessaire; ou bien, admettant comme principe que la démonstration porte un caractère de nécessité, et que, dès qu'on a démontré une chose, il n'est pas possible qu'elle soit autrement, il faut convenir que le syllogisme démonstratif doit se tirer de propositions nécessaires. § 3. En partant de principes vrais, on peut faire un syllogisme sans pour cela démontrer; mais en partant de principes nécessaires, on ne peut faire de syllogisme qu'en démontrant; car c'est là précisément le propre de la démonstration. § 4. Une preuve que la démonstration se forme bien d'éléments nécessaires, c'est que quand nous devons des objections contre un raisonnement que l'adversaire croit avoir démontré, nous disons que la conclusion n'est pas nécessaire, soutenant d'ailleurs que la chose peut être autrement, soit d'une manière absolue, soit seulement pour le besoin de la discussion. § 5. Ceci fait bien voir aussi toute l'erreur de ceux qui croient avoir atteint réellement les principes, par cela seul que la proposition qu'ils soutiennent est probable et vraie, comme les sophistes quand ils prétendent que savoir c'est avoir la science. Mais un principe n'est pas du tout ce qui est ou n'est pas seulement probable; c'est uniquement le primitif du genre même dont on doit démontrer, et toute proposition, par cela seul qu'elle est vraie, n'est pas propre à ce genre. § 6. Voici encore ce qui prouve bien que le syllogisme démonstratif doit être tiré d'éléments nécessaires; c'est que, tant que l'on ignore la cause d'une chose, on a beau en avoir une démonstration, on ne peut pas dire qu'on la sache. Soit par exemple A attribué nécessairement à C, et que B, moyen par lequel on a démontré, ne soit pas nécessaire; certes on ne sait pas la cause de la chose; car la conclusion n'est point à cause du moyen, puisque ce moyen peut ne pas être, tandis qu'au contraire la chose conclue est nécessaire. § 7. De plus, si l'on ne peut pas dire qu'on sache actuellement une chose, tout en admettant d'ailleurs et que l'on conserve sa raison, et que l'on vive, et que la chose elle-même reste bien telle qu'on la comprend, sans en rien oublier, c'est qu'on ne la savait pas non plus auparavant. Car le moyen pourrait s'anéantir, puisqu'il n'est pas nécessaire, et alors on conservera sa raison, on sera vivant, la chose elle-même subsistera, et pourtant on ne la sait pas; c'est qu'on ne la savait pas non plus antérieurement. Que si le moyen n'est pas anéanti, mais qu'il puisse seulement l'être, la conséquence que j'indique serait possible et contingente; mais il est impossible qu'avec ces conditions on puisse réellement savoir. § 8. 75a Mais peut-on dire, lorsque la conclusion est nécessaire, rien n'empêche du moins que le moyen terme par lequel on la démontre ne le soit pas, et qu'on puisse tirer une conclusion nécessaire même de propositions qui ne sont pas nécessaires, comme on peut tirer aussi une conclusion vraie de propositions qui ne sont pas vraies. Bien entendu d'ailleurs que, quand le moyen terme est nécessaire, la conclusion est également nécessaire, de même que de propositions vraies on tire toujours des conclusions vraies. Soit en effet A à B nécessairement, et B à C nécessairement, la conclusion est que A est nécessairement aussi à C. Au contraire, quand la conclusion n'est pas nécessaire, il n'est pas possible que le moyen le soit non plus. Soit, par exemple, A à C, sans y être nécessairement, mais à B nécessairement, et B nécessairement aussi à C; donc A aussi sera nécessairement à C. Or on avait supposé le contraire. § 9. A ceci on peut répondre : Ce que l'on sait par démonstration devant être de nécessité, il en résulte évidemment que la démonstration doit se faire aussi par un moyen terme nécessaire comme elle. Autrement, ou bien on ne saura ni pourquoi la conclusion est nécessaire, ni même qu'elle soit nécessaire; mais l'on croira savoir sans savoir réellement, si l'on admet comme nécessaire ce qui ne l'est pas; ou bien l'on ne croira même pas savoir de cette façon, soit d'ailleurs qu'on sache l'existence de la chose par des propositions médiates, soit même qu'on en sache la cause par des propositions immédiates. § 10. Il est impossible de savoir par démonstration les accidents qui ne sont pas essentiels dans le sens même de la définition que nous avons donnée de ce mot : c'est qu'en effet on ne peut jamais pour les accidents démontrer que la conclusion est nécessaire, puisqu'un accident est ce qui peut ne pas être, seule espèce d'accident dont je veuille ici parler. § 11. Mais on peut se demander : A quoi bon alors poser des questions d'accidents pour les démonstrations, s'il n'y a pas pour eux de conclusions nécessaires; car il n'y a aucun intérêt à faire des questions au hasard pour qu'on y réponde par une conclusion quelconque ? § 12. A cela je réponds : quand on interroge, on doit poser ces questions, non pas comme si la chose était nécessaire à cause des propositions mêmes, mais seulement en supposant que celui qui admet les questions doit aussi admettre nécessairement la conclusion qui en dérive, et conclure vrai si les questions elles-mêmes sont vraies. § 13. D'autre part, puisque pour chaque genre de choses il n'y a de nécessaire que ce qui est essentiel à ce genre, et lui appartient en tant que ce genre est ce qu'il est, il est clair que c'est aux choses essentielles que s'appliquent les démonstrations qui procurent la science, et que c'est de ces choses-là seules que se peuvent tirer ces démonstrations, attendu que les accidents ne sont pas nécessaires.
§ 14. Et qu'ainsi, on ne sait pas nécessairement la cause de la
conclusion, en admettant même que cette conclusion soit éternelle,
mais sans être essentielle, comme il arrive dans le syllogisme tiré
de simples signes ; car la conclusion aura beau être essentielle, on
ne saura ni qu'elle est essentielle, ni pourquoi elle l'est. Or,
savoir pourquoi une chose est, c'est la savoir par l'objet même qui
la cause. |
§ 1. Dérive de principes qui sont nécessaires, voir plus haut, ch. 4, § 1. - Ce qui est essentiel, id. 9, 4 et suiv. Les deux sens du mot essentiel indiqués ici sont les deux premiers. - D'éléments de ce genre, c'est-à-dire de propositions nécessaires. § 2. Les propositions étant nécessaires, il faut aussi que la conclusion soit nécessaire, non pas seulement sous le rapport de la forme, mais aussi sous le rapport de la matière, de la réalité. - La démonstration porte un caractère de nécessité, voir plus haut, ch. 2, §§ 1, 5 et 6, la définition de la science et de la démonstration. § 3. Il ne suffit pas que les prémisses soient vraies : car en partant de principes vrais, on peut arriver à une conclusion vraie : mais on n'arrive pas toujours à une conclusion nécessaire ; et alors ce n'est point une véritable démonstration qu'on a faite. Le syllogisme dialectique peut, lui aussi, partir de prémisses vraies; mais le syllogisme démonstratif doit partir de prémisses qui soient non seulement vraies, mais qui en outre soient nécessaires. C'est là ce qui distingue le syllogisme démonstratif de tous les autres. § 4. Une preuve, preuve tirée du sens commun. Quand on réfute une démonstration, on dit ordinairement, soit qu'on le pense en réalité, soit qu'on veuille seulement soutenir la discussion, que la prétendue démonstration ne repose pas sur des propositions nécessaires. On croit donc par conséquent que la démonstration, pour être valable, doit procéder de propositions nécessaires. - Soit seulement pour le besoin de la discussion, c'est ainsi que tous les commentateurs ont entendu ce passage : mais il serait possible de le comprendre encore ainsi : soit que l'on dise d'une manière absolue, soit qu'on dise d'après le raisonnement lui-même, tel qu'il a été proposé, que la chose n'est pas nécessairement ainsi qu'on l'a dit. § 5. Comme les sophistes, il s'agit probablement ici de Protagoras. - Savoir, c'est avoir la science, il est assez difficile de voir clairement quelle est la pensée d'Aristote. Philopon atteste qu'il y avait de son temps des explications diverses de ce passage, et il les trouve toutes sophistiques, c'est-à-dire peu satisfaisantes. Voici celle qui me paraît la plus probable : les sophistes soutenaient que savoir la science d'une chose quelconque, c'est savoir aussi ce qu'est la science : or savoir, c'est avoir la science : donc savoir quelque chose, c'est savoir ce qu'est la science. Aristote n'exprime ici que la mineure ; et à son avis, comme cette proposition n'est que probable et non point nécessaires, elle ne mène point à une véritable démonstration. - Primitif du genre dont on doit démontrer, voir plus haut, ch. 2, § 12. - N'est pas propre à ce genre, ibid. §§ 6 et 12. Ainsi, il ne suffit pas que les propositions soient vraies ou probables, il faut encore qu'elles soient propres au genre, c'est-à-dire immédiates, et qu'elles soient nécessaires, c'est-à-dire que l'attribut et le sujet soient de même extension. § 6. Voici encore ce qui prouve bien, preuve tirée de la nature même de la démonstration. On ne sait point une chose quand on ne la connaît point par sa cause : or quand on connaît une conclusion nécessaire par un moyen qui ne l'est pas, on ne la connaît point par sa vraie cause : donc on ne sait pas, et la démonstration qu'on a, toute nécessaire qu'elle est, ne donne pas la science. Il faut donc, pour qu'il y ait démonstration véritable, que le moyen soit nécessaire aussi. § 7. De plus si l'on ne peut pas dire, la pensée de ce parag. est un peu obscurément exposée; la voici : Si l'on admet que le moyen peut ne pas être nécessaire, il peut alors périr : s'il périt, on ne peut plus dire qu'on sache la conclusion, bien que la conclusion demeure nécessaire comme elle l'était, et que l'esprit qui conçoit cette conclusion demeure lui-même avec toutes ses facultés. Si donc on ne sait plus alors la conclusion, c'est qu'on ne la savait pas davantage auparavant. On a bien la conclusion, mais on ne la sait point à proprement parler. A ceci l'on peut objecter: Il est vrai qu'on ne sait pas la conclusion quand le moyen périt; mais on la sait tant qu'il subsiste. Aristote répond : Non, on ne la sait pas davantage ; car du moment qu'on admet que le moyen peut périr et qu'il peut n'être pas nécessaire, il est possible que le moyen périsse; alors on retombe dans la première absurdité. - Actuellement, c'est-à-dire quand le moyen existe. - Car le moyen pourrait s'anéantir, parce qu'il n'est pas nécessaire. - Que si le moyen n'est pas anéanti, voilà l'objection à laquelle répond Aristote. - La conséquence que j'indique, c'est-à-dire que, le moyen périssant, on puisse croire qu'il est encore possible de savoir la conclusion. - Serait possible et contingente, sinon réelle et positive, comme dans l'hypothèse même d'Aristote. - Avec ces condition, c'est-à-dire le moyen disparaissant ou pouvant disparaître, en d'autres termes n'étant pas nécessaire. - Donc il faut que le moyen soit nécessaire comme la conclusion qu'il produit. § 8. Mais peut-on dire, autre objection. De même que de propositions fausses on peut tirer une conclusion vraie, de même aussi de propositions non nécessaires, ne peut-on pas tirer une conclusion nécessaire? - Comme on peut tirer aussi une conclusion vraie, voir Premiers Analytiques, liv. 2, ch. 2, 3, 4. - Soit en effet A et B nécessairement, exemple où de propositions nécessaires on tire nécessairement une conclusion nécessaire. - Soit par exemple A à C sans y être nécessairement, exemple d'une conclusion supposée non nécessaire. Si l'on fait les propositions nécessaires, il faut par la formule précédente que la conclusion le soit aussi; ce qui est contraire à l'hypothèse ici formée qui suppose la conclusion non nécessaire. - Or on avait supposé le contraire, c'est à-dire que A était à C sans y être nécessairement dans la conclusion supposée. § 9. Ce que l'on sait par démonstration, confirmation de ce qui a été dit au § 6. Si le moyen n'est pas nécessaire, on ne saura pas pourquoi la conclusion est nécessaire; on ne saura même pas qu'elle l'est. - Si l'on admet comme nécessaire ce qui ne l'est pas, si l'on admet comme conclusion nécessaire une conclusion qui ne l'est pas, on croira savoir, mais on ne saura pas réellement. Ou bien l'on ne croira même pas savoir de cette façon, c'est-à dire on croira que la conclusion n'est pas nécessaire, bien que d'ailleurs on sache soit l'existence de la chose par des propositions qui ont besoin d'être démontrées elles-mêmes, soit qu'on sache la cause de la chose par des propositions indémontrables et immédiates. Ainsi, soit qu'on prenne pour nécessaire une conclusion qui ne l'est pas, soit qu'on sache que la conclusion obtenue n'est pas nécessaire, de l'une et l'autre façon on ne sait pas réellement la chose au sens propre du mot : savoir. §10. De ce que la conclusion de la démonstration doit être nécessaire, il en résulte que l'accident ne peut jamais être démontré, puisque l'accident est le contraire du nécessaire. Les seuls accidents démontrables sont les accidents essentiels. - Dans le sens même de la définition que nous avons donnée, plus haut, ch. 4, § 6. - Seule espèce d'accident dont je veuille parler ici, pour les distinguer des accidents essentiels; voir, pour la définition de l'accident, Topiques, liv. I, ch. 5, § 8. § 11. A quoi bon, si l'accident est indémontrable, si la conclusion qui le donne ne peut jamais être nécessaire, toutes les recherches de la dialectique sont vaines; les réponses à ces interrogations sont aussi futiles que les interrogations mêmes. On interroge au hasard et l'on répond de même; le sujet empêche les interlocuteurs d'atteindre jamais une conclusion nécessaire. § 12. A cela je réponds, dans les questions de dialectique, on ne s'inquiète pas de la nécessité réelle de la conclusion. Il importe peu qu'en fait la chose soit ou ne soit pas nécessaire. Ce qu'on veut seulement, c'est que, certaines questions étant posées, l'adversaire soit contraint d'admettre lui-même en répondant la conclusion qu'elles préparent. La conclusion est nécessaire en ce sens qu'elle suit nécessairement des prémisses ; elle n'est pas du tout nécessaire en ce sens que la chose qu'elle exprime soit nécessaire. Ainsi il faut distinguer la nécessité de la forme et la nécessité de la matière; ou, comme disent les scholastiques, necessitas illationis, et necessitas materiae. La dialectique se contente de la première; mais la démonstration a essentiellement besoin des deux. §13. D'autre part, Zabarella fait ici un chapitre nouveau; je crois qu'il a tort. Aristote répète, dans ce §, ce qu'il a dit au début même de ce chapitre, § 1, et il résume la discussion entière en reprenant son point de départ comme il fait souvent, et comme Zabarella lui-même le reconnaît. - Il n'y a de nécessaire que ce qui est essentiel, puisque la conclusion est nécessaire, et qu'il n'y a de nécessaire en réalité que les attributs essentiels, il s'ensuit évidemment que la démonstration ne s'applique qu'à des attributs essentiels, puisque ce sont les seuls attributs nécessaires. La démonstration ne peut s'appliquer aux accidents parce qu'ils ne sont pas nécessaires. § 14. Et qu'ainsi, ajoutez: si les propositions ne sont pas essentielles. Les propositions peuvent être de vérité éternelle; mais pour cela, elles ne fourniront pas la science démonstrative, parce qu'elles ne feront pas connaître la chose par sa cause. - Comme il arrive dans les syllogismes tirés de simples signes, voir les Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 37, §§ 3, 4, 5, 6, 7, sur les signes employés comme moyens dans l'enthymème. Ainsi la conclusion obtenue par un signe de la chose a beau être de vérité constante, elle n'est pas démontrée. Toute femme grosse est pile, exemple cité par Aristote au passage qui vient d'être indiqué, mais il n'est pas du tout démontré qu'une femme est grosse parce qu'elle est pâle, parce que toute femme pâle n'est pas essentiellement enceinte ; et comme la pâleur n'est pas la cause de la grossesse, on ne peut pas dire qu'une femme soit enceinte par cela seul qu'elle est pâle. - En résumé, il faut donc que les propositions soient essentielles et nécessaires pour que la démonstration aussi soit nécessaire. - Le moyen terme doit dire au troisième, c'est-à-dire au mineur dans la mineure; - et le premier au moyen, c'est-à-dire le majeur doit être l'attribut essentiel du moyen dans la majeure. |
|
CHAPITRE VII. Exception : la démonstration peut passer d'un genre à un autre, quand l'un des genres est subordonné à l'autre comme l'optique l'est à la géométrie. Distinction des questions qui tiennent aux principes propres des choses ou qui ne tiennent aux choses que relativement à des principes différents. |
|
|
§ 1. C'est là ce qui fait que l'on ne peut démontrer en passant d'un genre à un autre; et que, par exemple, on ne peut démontrer par l'arithmétique une question de géométrie. § 2. En effet, il y a trois choses à considérer dans les démonstrations. D'abord, la conclusion démontrée, c'est-à-dire l'attribut essentiel du genre dont il s'agit : en second lieu, les axiomes; et les axiomes, ce sont les déments dont on tire la démonstration; troisièmement enfin, le genre lui-même qui est en question, et dont la démonstration prouve les attributs et les accidents essentiels. § 3. Les éléments dont on tire la démonstration peuvent être quelquefois pareils; mais alors il faut que les choses auxquelles la démonstration s'applique ne soient pas de genres entièrement différents, comme l'arithmétique et la géométrie ; car il est impossible de traiter par une démonstration arithmétique les accidents des grandeurs, à moins que les grandeurs ne deviennent des nombres. Du reste, on dira plus tard comment cela petit avoir lieu dans certains cas. § 4. Mais la démonstration arithmétique se borne toujours au genre qui fait son objet, et toutes les autres démonstrations font comme elle; ainsi le genre doit être, ou absolument le même, ou le même au moins à quelques égards, pour que la démonstration puisse passer de l'un à l'autre. Et il est clair que sans cette condition la chose serait tout à fait impossible; car il faut nécessairement que les extrêmes et les moyens soient d'un même genre, puisque s'ils ne sont pas essentiels, ils ne sont que des accidents. § 5. Voilà comment il n'appartient pas à la géométrie de démontrer que la notion des contraires est unique, ni même que deux cubes forment un cube. Voilà comment en général une science ne peut jamais démontrer ce qui appartient à une autre, à moins que ces deux sciences ne soient entre elles dans ce rapport, que l'une soit subordonnée à l'autre, comme l'optique est à l'égard de la géométrie, et l'harmonie à l'égard de l'arithmétique. § 6. On peut ajouter que la géométrie n'a rien à voir, même aux lignes, si l'on étudie une de leurs qualités qui ne leur appartient pas en tant que lignes, et qui ne tient pas aux principes propres des lignes. C'est ainsi que la géométrie n'a point à rechercher si la ligne droite est la plus belle de toutes les lignes, ou bien si la ligne droite est le contraire de la circonférence; car ces qualités appartiennent aux lignes, non pas relativement à leur genre propre, mais relativement à un principe commun qui, à certains égards, appartient aussi aux lignes. |
§ 1. C'est là ce qui fait que l'on ne... on a démontré que la conclusion ainsi que les prémisses devaient être nécessaires et essentielles; il s'ensuit évidemment qu'elles doivent être du même genre, et qu'on ne peut prendre les propositions dans un genre, et la conclusion dans un autre; par exemple, on ne peut tirer une conclusion géométrique de propositions arithmétiques. § 2. Il y a trois choses, ces trois choses sont, en d'autres termes: l'attribut, le moyen et le sujet. - L'attribut, c'est la conclusion démontrée; le moyen, c'est l'axiome ou les axiomes par lesquels on démontre, dont on tire la démonstration; le sujet, c'est le genre lui-même qui est en question. - Prouve les attributs, il pirata qu'Averroès a eu dans son manuscrit: les signes, au lieu de : les attributs. - Et les accidents essentiels, ainsi, la démonstration ne s'applique pas aux substances, comme on le verra au liv. 2. § 3. Les éléments dont on tire la démonstration, c'est-à-dire les mêmes d'après le § précédent. Les axiomes peuvent donc être communs, à ce qu'il semble, théorie exposée plus loin, ch. II, § 5; et c'est ainsi que la plupart des commentateurs ont entendu ce passage. - Et n'en sont pas entièrement différents. C'est ce qu'il veut indiquer en promettant de dire plus tard comment cela peut avoir lieu dans certains cas; voir, plus loin, ch. 9, § 4. C'est ce qu'il développe aussi dans les deux § suivants de ce chapitre. §. 4. La démonstration arithmétique se borne toujours, confirmation de l'explication précédente. - Font comme elles, toutes les sciences gardent leur sujet propre. - Le même au moins à quelques égards, c'est-à-dire, il faut que les sciences soient subalternes; et que le sujet de l'une soit en ce sens le sujet de l'autre. - Les extrêmes, c'est-à-dire, comme l'explique Thémistius, les attributs. - Ils ne sont que des accidents, et alors ils ne sont pas nécessaires, condition tout à fait indispensable pour la démonstration d'après la théorie du chapitre 6. § 5. Il n'appartient pas à la géométrie, exemples divers, dans ce § et le suivant, pour prouver que le moyen ne peut peint passer d'un genre à un autre, soit qu'on le prenne seul comme Ici, soit qu'on le prenne avec l'attribut, c'est-à-dire la majeure tout entière comme au § suivant. - Que la notion du contraires est unique, c'est une question de métaphysique que la géométrie ne peut démontrer. - Que deux cubes forment un cube, c'est-à-dire que deux nombres cubes, multipliés l'un par l'autre, donnent un cube pour produit. La plupart des commentateurs out compris qu'il s'agit de nombres et non point de solides. Philopon seul a été de ce dernier avis; mais il se trompe, parce qu'il faut ici une question arithmétique, et non une question de stéréométrie, science subordonnée à la géométrie, et à laquelle la géométrie pourrait, par conséquent, fournir des démonstrations. - Que l'une soit subordonnée à l'autre, voilà l'exception pour les sciences subalternes. § 6. Si l'on étudie une de leurs qualités, nouveaux exemples où il ne s'agit plus du moyen tout seul, mais du moyen accompagné d'un attribut; la ligne droite, la plus belle de toutes les lignes; la ligne droite, le contraire de la circonférence. - Relativement à un principe commun, l'être, par exemple, auquel on peut attribuer, en général, les idées de beau et de contraire, idées qui ne sont pas spéciales à la géométrie et essentielles à la ligne. |
|
Toute conclusion démontrée est éternelle : il n'y a donc pas de démonstration pour les choses périssables, de même qu'il n'y a pour elles que science d'accident. - Les définitions sont éternelles comme les démonstrations, dont elles ne sont qu'une forme. - La démonstration peut s'appliquer à certaines choses passagères, mais dont l'essence est éternelle, par exemple certains phénomènes naturels. |
|
|
§ 1. Il n'est pas moins évident encore que si les propositions dont on tire le syllogisme démonstratif sont universelle, il y a nécessité que la conclusion de cette espèce de démonstration, ou, pour mieux dire, de toute démonstration, soit éternelle. Il n'y a donc pas de démonstration pour les choses périssables. Pour elles, il n'y a pas non plus de science à proprement parler; ou du moins il n'y en a que de l'accident, parce qu'il n'y a pas de science universelle de cet objet, et que la science n'existe alors que dans certains cas et de certaine façon. Quand la conclusion démontrée est de cette espèce, il faut nécessairement que l'une des deux propositions soit non universelle, et périssable : périssable, puisque la conclusion l'est aussi, quand l'une des propositions l'est: non universelle, car parmi les choses auxquelles la conclusion s'applique, l'une sera tandis que l'autre ne sera pas. Donc on ne peut conclure universellement; on conclut simplement que, dans le cas actuel, la chose est ainsi qu'on la démontre. § 2. Ceci n'est pas moins vrai pour les définitions; car la définition est, ou un principe de démonstration, ou une démonstration, qui ne diffère que par la position des termes, ou enfin une conclusion de démonstration. § 3. Quant à la démonstration et à la science des choses qui arrivent fréquemment, les phases de la lune, par exemple, évidemment elles sont éternelles dans l'essence de ces choses, et elles ne sont particulières qu'en tant que ces choses ne sont pas toujours. Il va sans dire que ce qui s'applique ici à l'éclipse peut s'appliquer également à tout autre phénomène. |
§ 1. Thémistius a déplacé ce chapitre, et l'a mis après le suivant. Il n'a point d'ailleurs donné les motifs particuliers de cette interversion; il s'est contenté d'annoncer dans son préambule que l'ouvrage d'Aristote lui paraissant en désordre, il se permettrait, quand il le jugerait utile, de rétablir l'ordre, et il l'a fait ici sans autre explication. Zabarella trouve, comme Thémistius, que ce chapitre n'est point à sa place; mais, au lieu de le reporter après le suivant, il le rejetait d'abord jusqu'au chap. 11, où il admettait avec Thémistius un autre changement, dont il sera parlé à ce chap. 11 et au chap. 9, qui suit celui-ci. Zabarella modifia ensuite cette première opinion; il laissa le chap. 8 à sa place ordinaire; et il essaya de montrer qu'Il se fiait à ce qui précède : aliquem connexum quisquis ille sit. II me semble que Zabarella se trompe même en ceci. Le sujet traité dans le chap. 8 se lie intimement aux théories antérieures. Après avoir démontré que les principes de la démonstration sont nécessaires, et que la conclusion l'est comme eux, Aristote ajoute cette première conséquence évidente que la conclusion démontrée est éternelle, puisque ce qui est nécessaire ne peut pas être autrement qu'il n'est ; et cette seconde, qui n'est pas moins évidente, qu'il n'y a point de démonstration pour les choses périssables. - De celte espèce de démonstration, de celle dont les prémisses sont universelles. Voir ch. 8. - Ou pour mieux dire, de toute démonstration, c'est qu'en effet il n'y a vraiment démonstration qu'à cette condition. - Il n'y a donc pas de démonstration pour les choses périssables, parce que pour elles il ne peut pas y avoir de conclusion nécessaire. - Il n'y a pas non plus de science à proprement parler, parce que savoir implique l'immutabilité de la chose qu'on sait. Voir chap. 2, § 1. - Il n'y en a que de l'accident, science sophistique ou d'accident. Voir id., ibid. - Dans certains cas, et de certaine façon, deux conditions contraires aux deux conditions de l'attribution générale, qui s'applique à tout le sujet et en tout temps. Voir ch. 4, § 3. - De cette espèce, relative à l'accident. - Universellement, ibid., §§ 4 et suiv. § 2. Thimistius et avec lui Zabarella, placent ici le § 1 du ch. Il, où Aristote combat le système des idées de Platon. Ce changement, bien qu'autorisé par deux autorités aussi graves, n'a point été généralement adopté; et il paraît en effet qu'il ne doit pas l'être ; le § 1 du chap. 11 ne semble pas parfaitement placé où il l'est; mais ce serait, je crois, augmenter encore la difficulté que de le transposer ici. - Car la définition est ou... Voir liv. II, ch. 10, la théorie de la définition, et spécialement § 7, où les termes mêmes dont se sert ici Aristote sont presque littéralement répétés. C'est qu'en effet, comme le remarque Averroès, toute définition complète d'un attribut se compose de trois éléments; le genre, c'est-à-dire l'attribut, le sujet, c'est-à-dire le défini, et la cause, c'est-à-dire le moyen. Or, ce sont là précisément les éléments de tonte démonstration; et ce qui s'applique à la démonstration peut s'appliquer aussi à la définition, qui n'en est qu'une autre forme. § 3. A la théorie qui précède on peut faire cette objection : si la conclusion de la démonstration ne s'applique qu'à des choses nécessaires et éternelles, il n'y a donc pas démonstration pour les phénomènes naturels; que deviennent alors les démonstrations de l'astronomie et de toutes les sciences physiques? Ce que dit ici Aristote a pour objet de répondre à cette objection. Il y a démonstration pour les phénomènes naturels, non pas en tant que spéciaux et passagers, mais en tant que la cause qui les produit, leur essence, est éternelle. Ainsi quand on démontre la cause de l'éclipse, ce n'est pas la cause de l'éclipse qui a eu lieu à tel jour, en tel lieu, c'est la cause de l'éclipse en général, et la démonstration s'applique à l'éclipse d'une manière universelle et éternelle. On définira toujours l'éclipse de la même façon, qu'elle ait eu lieu ou non dans le moment dont on parle. |
|
La démonstration d'une chose ne résulte jamais que des principes propres à cette chose, et non point de principes communs à d'autres choses et à celle-là ; la démonstration donnée par des principes communs n'est jamais qu'accidentelle; elle n'est point essentielle. Exception pour les sciences subordonnées les unes aux autres, où les démonstrations peuvent se faire par des principes communs. Les principes propres sont indémontrables; la science de ces principes propres, source de toutes les démonstrations, est la science suprême dans chaque genre; difficulté de reconnaître les caractères de la science véritable. |
|
|
§ 1. Puisque évidemment on ne peut démontrer une chose que par les principes qui lui sont propres, c'est-à-dire si le démontré est à l'objet en tant que cet objet est ce qu'il est, il ne suffit pas, pour savoir cette chose, de la démontrer en partant de propositions vraies, indémontrables et immédiates; ce n'est là démontrer que comme Bryson démontrait la quadrature du cercle. § 2. Les raisonnements de ce genre ne démontrent jamais que d'après un principe commun qui s'applique aussi à un autre objet; et voilà comment ils conviennent également à des objets 76a qui ne sont pas de même genre. Ce n'est donc pas en tant que la chose est ce qu'elle est qu'on la sait, c'est seulement dans son accident; autrement la démonstration ne pourrait pas convenir tout aussi bien à un autre genre. § 3. Nous ne savons un attribut quelconque réellement et autrement que par l'accident, que lorsque nous le connaissons par ce qui le fait être, d'après les principes qui sont propres à la chose, en tant qu'elle est ce qu'elle est. Nous savons, par exemple, ce que c'est qu'avoir ses angles égaux à deux droits, quand nous savons à quoi appartient essentiellement cette propriété, d'après les principes propres à la chose qui la possède. Il suit de là que si la propriété appartient essentiellement à la chose à laquelle elle est, il y a nécessité que le moyen se trouve aussi dans le même genre. § 4. S'il n'y est pas, c'est qu'alors le rapport est le même que celui des questions d'harmonie à l'arithmétique; et quand les choses sont dans cette relation, on peut les démontrer par des principes identiques. Il y a pourtant encore la différence que voici : l'existence même de la chose relève d'une science différente, puisque le genre en question est différent; mais la cause de la chose relève de la science supérieure à laquelle les propriétés dont il s'agit appartiennent essentiellement. Ceci est une preuve nouvelle qu'on ne peut jamais démontrer une chose absolument que par les principes qui lui sont propres; seulement, dans les sciences dont nous venons de parler, les principes ont la propriété commune qu'on étudie. § 5. Que si cela est évident, il est évident aussi que les principes propres de chaque chose sont indémontrables; ces principes deviendront les principes de tout le reste, et la science de ces principes sera la souveraine de tout ce qui suivra. En effet, celui-là sait davantage, qui sait par les causes supérieures; et savoir par les termes antérieurs, c'est savoir, non pas par les effets produits, mais par les causes qui produisent. En outre, si c'est là savoir davantage, c'est là savoir aussi le plus possible; et dès que cette science existe, c'est à la fois et une science supérieure et la science suprême. § 6. Mais la démonstration ne passe pas d'un genre à un autre, si ce n'est, comme on l'a déjà dit, que les démonstrations de géométrie passent en optique ou en mécanique, et les démonstrations d'arithmétique en harmonie. § 7. Du reste il est difficile de reconnaître si l'on sait ou si l'on ne sait pas, parce qu'il est difficile de reconnaître si notre science provient ou non des principes propres de chaque chose, ce qui est précisément savoir. Nous croyons savoir par cela seul que nous tirons notre syllogisme de certains principes vrais et primitifs. Mais ce n'est point là savoir, puisqu'il faut en outre que la conclusion soit homogène aux principes. |
§ 1. Il ne suffit pas, il a été prouvé plus haut que la conclusion a les principes étaient nécessaires et essentiels, ch. 6; qu'ils devaient être du même genre, ch. 7 ; qu'enfin, la conclusion démontrée était éternelle, ch. 8; il reste à indiquer la dernière relation des principes et de la conclusion: c'est qu'il faut que les principes soient propres à la chose qu'on prétend démontrer, et qu'il est impossible de démontrer par des principes communs à plusieurs choses. Ceci résulte évidemment des théories développées dans le ch. 6; et, du moment que l'attribut démontré est essentiel à la chose, il lui est propre aussi et n'appartient qu'à elle. - De propositions vraies, indémontrables, immédiates, voir plus haut, ch. 2, § 6. - Comme Bryson démontrait la quadrature du cercle, voici, d'après Thémistius et Philopon, la méthode de Bryson. Pour arriver à la quadrature du cercle, il traçait un carré inscrit et un carré circonscrit. La valeur du cercle comprenant l'un et compris dans l'autre, était évidemment entre les deux. Restait donc à trouver, suivant les règles les plus simples de la géométrie, un carré qui fût entre les deux, et qui devait, suivant Bryson, être égal au cercle, en vertu de ce principe Les choses qui sont plus grandes et plus petites que d'autres mêmes choses sont égales entre elles. Donc le carré intermédiaire et le cercle qui sont l'un et l'autre plus petits que le plus grand carré, et plus grands que le plus petit, sont égaux : donc, etc. Aristote rejette cette démonstration parce qu'elle s'appuie sur un principe qui est commun, et qui n'a rien de spécial ni de propre à la nature du cercle. § 2. Les raisonnements de ce genre, sont vicieux en ce qu'ils ne démontrent jamais que d'après un principe commun; et en effet, le principe de Bryson peut s'appliquer à toute autre chose que le cercle, ou des figures de géométrie. - Thémistius élève ici un doute, et se demande si Aristote ne se contredit pas lui-même en proscrivant l'usage des principes communs dans la démonstration, et en reconnaissant cependant, ch. 11, qu'il est des principes communs à toutes les sciences, des axiomes. Thémistius répond que les axiomes ne sont employés dans les démonstrations qu'en perdant leur généralité, et en se restreignant au sujet même dont il est question. Zabarella remarque avec raison que ce n'est pas résoudre la difficulté, et que les axiomes, à ce compte, n'en restent pas moins des principes communs; mais il ajoute, et je suis tout à fait de son avis, qu'il ne faut pas confondre les axiomes et les principes. Les axiomes sont la base nécessaire de toute démonstration ; mais ils n'entrent jamais dans les démonstrations, ils n'en font jamais partie, parce qu'ils ne sont jamais cause de la conclusion. II n'y a que les principes de la chose à démontrer qui puissent être des prémisses; et il faut alors, comme le dit Aristote, que les principes soient propres à la chose. L'erreur de Thémistius vient de ce qu'il a confondu les axiomes et les principes. Bryson posait un principe contestable et faux à bien des égards, il ne posait pas un axiome. - Aristote a établi plus haut, ch. 2, § 6, que les principes sont propres au démontré quand ils sont vrais et immédiats; et ici il semble le nier; mais il faut remarquer avec Zabarella qu'il demandait en outre que les principes fussent causes de la conclusion; et qu'ici il omet cette condition. Aristote ne se contredit donc point; car il ne suffit pas que les principes soient vrais et immédiats pour être propres au démontré. § 3. Nous ne savons... réellement, c'est-à-dire d'une manière parfaitement démontrée. - Par ce qui le fait être, par sa cause. - Ainsi donc, pour savoir par démonstration il faut deux conditions : 1° Il faut que l'attribut soit essentiel au sujet, qu'il soit au sujet en tant que le sujet est ce qu'il est; 2° il faut qu'il y soit par un moyen qui en soit la cause spéciale. Par suite, si la conclusion est essentielle, il faut que le moyen par lequel on la démontre soit essentiel aussi, de la même nature, du même genre. § 4. Le rapport est le même que celui des questions d'harmonie à l'arithmétique, exception pour les sciences subordonnées. On peut démontrer de l'une à l'autre par des principes qui leur sont communs. - Sont dans cette relation, appartenant à des sciences subordonnées. - Par des principes identiques, ou communs; voir plus haut, ch. 7, § 3. - L'existence même de la chose, le fait dépend de la science inférieure ; l'explication du fait par sa cause appartient à la science supérieure. Voir plus loin, ch. 27, § 1. § 5. Thémistius fait encore ici un déplacement, et il intercale tout le chap. 8. Zabarella blâme avec raison ce changement, qu'il rejette. Mais il ne faut peut-être pas accorder à ces déplacements que se permet Thémistius, sans même les expliquer, une aussi grande importance. Il faut toujours se rappeler que Thémistius ne commente pas, et qu'il fait seulement une paraphrase très libre qui tient compte des idées seulement, et fort peu du texte. - La souveraine de tout ce qui suivra, la plupart des commentateurs, Thémistius, Philopon, Zabarella, etc., ont cru qu'il s'agissait de la métaphysique. Pacius croit, au contraire, que la pensée d'Aristote est beaucoup moins étendue, et qu'il s'agit uniquement de la science des principes dans chaque genre. Je suis complètement de son avis, malgré les autorités fort graves qui le contredisent ; c'est en ce sens que j'ai traduit; et il me semble que tout le contexte justifie cette interprétation, quoique l'autre soit celle qui se présente tout d'abord, et qui paraisse la plus simple. - Et la science suprême, c'est-à-dire qu'au-dessus des principes il n'y a rien; et qu'au-dessus de la cause il n'y a point de cause ; car alors il y aurait cause de cause, et principe de principe; en d'autres termes, il n'y aurait ni causes ni principes. § 6. Comme on l'a déjà dit, ch. 7, §§ 3 et 4. Les principes d'une science ne peuvent être démontrés par les principes d'une autre science ; il a été démontré en outre qu'ils ne pouvaient l'être par des principes communs, par des axiomes; voir, plus haut, dans ce chapitre, § 1. Reste donc qu'ils soient indémontrables. § 7. Il faut que la conclusion soit homogène aux principes, voir ch. 7, cette théorie exposée tout au long. |
|
Définition des principes : les principes sont ce dont on ne peut démontrer l'existence. - Division des principes en principes propres et principes communs; exemples des uns et des autres ; éléments essentiels de toute démonstration au nombre de trois. Définition et différence de l'hypothèse et du postulat ; différence de la définition comparée à l'hypothèse et au postulat. |
|
|
§ 1. Ce que j'appelle principes dans chaque genre, ce sont les termes dont on ne peut pas démontrer qu'ils sont. § 2. On admet donc sans démonstration le sens des mots qui expriment et les primitifs et la conclusion qui en dérive; et pour les principes, il faut de toute nécessité admettre qu'ils sont sans les démontrer; mais c'est pour le reste seulement qu'il faut démontrer qu'il est. On doit par exemple admettre sans démonstration ce que signifient et l'unité, et la ligne droite, et le triangle; il faut admettre également sans le démontrer que l'unité et la grandeur existent; et c'est seulement pour le reste qu'il doit y avoir démonstration. § 3. Parmi les principes dont on se sert dans les sciences démonstratives, les uns sont spéciaux à chaque science, les autres sont communs. J'entends qu'ils sont communs par analogie; car le principe commun est employé dans la mesure même où il se rapporte au genre de science en question. Des principes spéciaux, c'est, par exemple, la définition de la ligne, de la droite; au contraire, un principe commun c'est, par exemple, celui-ci : Si de choses égales on ôte des quantités égales, le reste de part et d'autre est encore égal. Chacun de ces principes est applicable en tant qu'il entre dans le genre en question. La valeur du principe commun que je viens de citer sera toujours la même, bien qu'on ne le pose pas pour tous les objets auxquels il pourrait convenir 77, et qu'on le prenne, comme le géomètre, seulement pour les grandeurs, et comme l'arithméticien, seulement pour les nombres. § 4. On appelle encore principes propres dont on admet aussi l'existence sans démonstration, les choses dans lesquelles la science trouve les propriétés essentielles qu'elle étudie. Ainsi l'arithmétique admet sans démonstration les unités, et la géométrie les points et les lignes : car elles admettent sans démonstration et l'existence et la définition de ces choses. De plus, pour les modifications essentielles de ces choses, l'on admet également sans démonstration les noms de chacune d'elles. Par exemple : l'arithmétique admet ainsi le sens des mots d'impair ou de pair, de carré, de cube, etc. ; et la géométrie ceux d'incommensurable, de brisé, d'oblique, etc. Mais quant à l'existence de ces propriétés, on la démontre au moyen et de principes communs et de propositions déjà démontrées. La méthode est la même en astronomie. § 5. En effet, toute science acquise par démonstration se rapporte à trois choses; d'abord tout ce dont on admet l'existence sans démonstration, c'est-à-dire le genre même dont la science étudie les modifications essentielles; en second lieu, ces principes communs que nous appelons axiomes, dont on tire primitivement les démonstrations; et enfin, en troisième lieu, les modifications de ce même genre pour lesquelles il faut admettre aussi sans démonstration le nom de chacune. § 6. Du reste, il se peut fort bien que de ces trois choses, certaines sciences en négligent quelques-unes. Ainsi telle science peut s'abstenir de poser l'existence du genre, s'il est de toute évidence que ce genre existe; car il n'est pas évident de la même manière que le nombre existe, qu'il est évident qu'il fait chaud ou froid. On peut aussi s'abstenir de poser les définitions des modifications du genre, si elles sont parfaitement claires. Enfin même on peut s'abstenir de poser ce que signifient les principes communs; par exemple ce que veut dire : Enlever des quantités égales à des quantités égales, attendu que ce principe est parfaitement bien connu. Néanmoins on peut toujours dire que naturellement il y a trois choses ici : ce dont on démontre, ce qu'on démontre, et enfin ce par quoi l'on démontre. § 7. On ne peut jamais considérer comme hypothèse ou postulat ce qui est nécessairement par soi-même, et ce qu'on doit nécessairement croire. C'est qu'en effet, ce n'est pas à la parole extérieure, c'est à la parole intérieure de l'âme que s'adresse la démonstration, tout aussi bien que le syllogisme. Contre la parole extérieure on peut bien trouver toujours des objections; mais on ne le peut pas toujours contre la parole du dedans. § 8. Toutes les fois donc qu'on pose sans les avoir soi-même démontrées, des choses qui pourraient l'être, et qu'on les admet avec l'assentiment de celui à qui on les apprend, c'est une hypothèse que l'on fait. Ce n'est pas d'ailleurs une hypothèse absolue, c'est une hypothèse relative uniquement à celui à qui l'on parle. Si l'interlocuteur n'ayant aucune idée de la chose, ou même en ayant une idée contraire, on pose pourtant cette chose, c'est un postulat que l'on fait pour la même chose qui tout à l'heure donnait lieu à une hypothèse. Et voilà en quoi diffèrent l'hypothèse et le postulat. Le postulat est en partie contraire à l'opinion de celui qui apprend la chose; ou bien c'est ce qu'on pose sans démonstration, quoi qu'on puisse le démontrer, et dont on se sert sans en avoir donné la démonstration § 9. Les définitions ne sont donc pas des hypothèses; car elles ne disent pas que les choses définies existent ou qu'elles n'existent pas. Au contraire, les hypothèses sont classées dans les propositions. Pour les définitions, il suffit qu'on les comprenne; mais il n'en peut être ainsi d'une hypothèse à moins qu'on ne prétende qu'un simple mot, entendre par exemple, soit aussi toute une hypothèse. Les hypothèses sont précisément toutes les choses qui étant, et par cela seul qu'elles sont, produisent la conclusion. § 10. Le géomètre ne fait pas non plus hypothèse de choses fausses, ainsi qu'on le prétend quelquefois. On dit en effet que bien qu'il ne faille jamais employer le faux, le géomètre pourtant en fait usage, en supposant qu'une ligne qui n'a pas un pied de long en a réellement un, et qu'une ligne tracée est droite 77a quand pourtant elle n'est pas droite. Mais on peut répondre que le géomètre ne conclut rien de ce que cette ligne qu'il a tracée est de telle ou telle façon; il conclut seulement les choses dont ce sont là les représentations. § 11. On doit ajouter en outre que tout postulat, comme toute hypothèse, peut être ou universelle ou particulière, et que les définitions ne sont ni l'un ni l'autre. |
§ 1. Les termes dont on ne peut pas démontrer qu'ils sont, les principes sont donc les termes indémontrables. § 2. Le sens des mots, c'est l'une des premières conditions exigées ch. 1, § 4. - Les primitifs et la conclusion qui en dérive, ainsi, pour les principes, aussi bien que pour la conclusion, la connaissance des mots et du sens qu'on y attache est la première notion antérieure, praecognitio qu'il faut avoir. - Mais pour les principes, ici il y a cette différence entre les principes et la conclusion, qu'il faut, pour les premiers, en admettre l'existence, la vérité, sans démonstration, et que pour la seconde, au contraire, il faut en démontrer l'existence, la vérité. - Ce que signifient, c'est-à-dire le sens des trois mots qui suivent. - Que l'unité et la grandeur existent, l'unité et la grandeur, genre du nombre, et du triangle, sont des principes propres à l'arithmétique et à la géométrie ; ils sont donc indémontrables. On ne peut en démontrer que les attributs, les modifications. § 3. Dans les sciences démonstratives ou mieux, dans les démonstrations qui produisent la science; c'est-à-dire toutes les fois que la science est obtenue par démonstration. - Les autres communs. Plus haut, ch. 9, Aristote a proscrit l'usage des principes communs, et ici il les admet; mais il les admet avec une restriction; les principes communs deviennent spéciaux, en se restreignant au genre en question. C'est là ce qu'il vent dire quand il ajoute: J'entends qu'ils sont communs par analogie. - Chacun de ces principes, soit spécial, soit commun. Les uns et les autres peuvent entrer dans la démonstration qu'on établit, le premier parce qu'il lui est propre, le second parce qu'il se restreint à l'étendue même du genre dont il s'agit. § 4. On appelle encore principes propres, autre division des principes. - Dont on admet aussi l'existence, comme on l'a dit plus haut pour les principes spéciaux et les principes communs. - Les choses dans lesquelles la science..., c'est-à-dire le sujet propre de chaque genre. - Les propriétés essentielles, c'est-à-dire les attributs essentiels. - Les unités, les points, les lignes, sujets de la science en arithmétique et en géométrie. - L'existence et la définition, voir, plus haut, § 2. - Pour les modifications essentielles de ces choses, pour les attributs essentiels des unités, des points, des lignes, il faut encore en admettre sans démonstration la définition; mais il faut en démontrer l'existence. - Les noms de chacune d'elles, c'est-à-dire la définition. - L'existence de ces propriétés, on la démontre, on démontre les attributs, dont on admet la définition sans démonstration, comme on a admis celle des sujets; mais pour les sujets on en a de plus admis l'existence sans démonstration. - Et de principes communs, à toute la science dont il s'agit. § 5. Se rapporte à trois choses, division indiquée déjà plus haut, ch 7, § 2. Ces trois choses sont le sujet, l'axiome et l'attribut. - Tout ce dont on admet l'existence sans démonstration, hypothèse et définition du sujet. - C'est-à-dire le genre même, en d'autres termes, le sujet dont on doit démontrer un attribut. - Primitivement, parce qu'on peut tirer aussi les démonstrations de conclusions antérieurement démontrées ; mais alors la démonstrations ne part point de primitifs. - Les modifications de ce même genre, l'attribut du sujet. - Le nom de chacune, on admet sans démonstration la définition de l'attribut, comme on a admis celle du sujet. § 6. Du reste... Aristote va ici au-devant d'une objection qu'on pourrait lui faire. Ces trois objets, indispensables à toute démonstration, n'y sont pu toujours exprimés avec les conditions qu'Aristote exige, et cependant la démonstration n'en produit pas moins la science. - Sans doute, mais si l'on sous-entend l'existence et la définition du sujet, l'explication des axiomes, et la définition de l'attribut, c'est que tous ces termes sont d'une évidence entière que tout développement ne ferait qu'obscurcir. Il y a consentement tacite et parfaitement intelligible de part et d'autre ; il est inutile de l'exprimer. - Le nombre existe, il faut que l'arithmétique pose l'existence du sujet dont elle s'occupe; car nous ne savons pas qu'il y a des nombres aussi clairement que nous savons, avertis par nos sens, qu'il fait chaud ou froid. - Des modifications du genre, c'est-à-dire, les définitions des attributs, quand le sens d'ailleurs en est parfaitement intelligible. - Ce que signifient les principes communs, il ne faut définir les axiomes que s'ils présentent quelque obscurité. - Naturellement, en regardant à l'essence de cette question, et non point à ses conditions extérieures qui ne sont pas toujours celles que la science découvre. Zabarella compare, avec raison, la science de la démonstration, tout intellectuelle qu'elle est, au mouvement physique; et de même que dans tout mouvement, il y a trois choses, le point d'où part le corps, le point où il arrive, et le corps lui-même qui subit le changement; de même dans toutes les démonstrations, il y a le terme inconnu qu'on cherche à démontrer, l'attribut : le sujet, dont on part, et l'axiome ou moyen terme par lequel on passe du sujet à l'attribut. § 7. On ne peut jamais... les axiomes indémontrables, et de croyance irrésistible, ne doivent pas être confondus avec les hypothèses et les postulats. - Hypothèse, c'est la thèse qu'on pose et qui est admise dès qu'elle est posée. - Postulat, c'est l'hypothèse dont on demande la concession, qui ne porte pas avec elle l'évidence, et qui a besoin d'un assentiment formel, qu'elle soit fausse ou juste. - Nécessairement par soi-même, ce qui est, par conséquent, indémontrable; ce qui n'est point par un autre que soi, qui ne peut être démontré par un terme supérieur. - Et ce qu'on doit nécessairement croire, tous les principes, axiomes, hypothèses, postulats, sont indémontrables; mais on peut ne pas croire aux hypothèses, et surtout aux postulats, tandis qu'on ne peut s'empêcher de croire aux axiomes; c'est là le caractère spécial qui les distingue : La parole extérieure peut les nier; la parole intérieure, du dedans, à laquelle s'adresse la démonstration, les admet toujours et y croit sans objections possibles. § 8. Zabarella met ici, d'après Themistius. le § 10. Certainement ce déplacement peut très bien se justifier; et Thémistius a peut-être bien fait de l'admettre dans sa paraphrase pour rendre la suite des idées plus claire et plus simple; mis rien n'autorise à intervertir ainsi l'ordre du texte, puisque rien s'indique qu'il y ait eu ici interpolation par une main étrangère Thémestius et Zabarella refont Aristote; c'est exagérer le droit des commentateurs. - C'est une hypothèse, le caractère spécial de l'hypothèse, c'est l'assentiment que l'interlocuteur y donne. - C'est un postulat que l'on fait, le caractère spécial du postulat, c'est d'être concédé par l'interlocuteur qui pense d'ailleurs d'une façon contraire, mais qui, pour le besoin de la discussion, accorde un principe qu'il ne partage pas. § 9. Les définitions ne sont donc pas des hypothèses, l'hypothèse est toujours une proposition; et, par conséquent, elle affirme ou elle nie. La définition ne fait ni l'un ni l'autre. II ne faut donc pas la confondre avec l'hypothèse. - il suffit qu'on les comprenne, pour l'hypothèse, il faut en outre qu'on l'admette; autrement il pourrait arriver qu'un mot isolé, que chaque mot, fût une hypothèse; mais un mot tout seul ne nie et n'affirme pas plus que la définition qui n'est elle-même que l'équivalent d'un mot isolé.
§ 11. Ce § semble isolé de ce qui précède par l'intercalation du § 10; et c'est là la seule justification sérieuse du changement proposé. - Les définitions ne sont ni l'un ni l'autre, les définitions n'ont aucun signe, ni d'universalité, ni de particularité; et quand on définit l'homme, par exemple, on ne dit pas plus : Tout homme que Quelque homme; on dit simplement: L'homme. Pour l'hypothèse et le postulat, an contraire, on met le signe, soit de l'universalité, soit de la particularité, parce que ce sont des propositions. Voir plus haut, § 9, et Herméneia, ch. 7.
- Averroès, comme le remarque Zabarella
semble avoir eu ici une leçon différente, où ces mots, ni l'un ni
l'autre, sont supprimés. Averroès en conclut que la définition est
toujours universelle ; il n'insiste pas du reste sur ce point, bien
qu'il contredise la pensée générale du texte, comme on peut le voir. |
|
La démonstration ne suppose pas la théorie des idées platoniciennes ; elle n'a besoin que de l'universel résidant dans la pluralité des individus, et non pas distinct des individus. La démonstration n'exprime pas ordinairement le principe de contradiction sur lequel repose toute démonstration ; exception. - C'est surtout la démonstration par l'absurde qui fait usage de ce principe; et elle le restreint toujours au genre en question. Les sciences communiquent entre elles par les principes communs ; la dialectique et la science des principes sont communes à toutes les autres sciences ; mais la dialectique ne démontre pas. |
|
|
§ 1. Il n'y a donc aucune nécessité pour rendre la démonstration possible, qu'il existe des idées, ni qu'il y ait des unités distinctes et séparées de la pluralité. Il y a seulement nécessité qu'une seule et même chose puisse avec vérité être attribuée à plusieurs êtres; car, sans cette condition, il n'y a pas d'universel; sans universel, il n'y a pas de moyen terme; et partant, il n'y aura pas non plus de démonstration. Il faut donc uniquement qu'il soit possible qu'une seule et même chose se retrouve dans plusieurs êtres, bien entendu toujours que cette chose n'est pas homonyme. § 2. Qu'il soit impossible d'affirmer et de nier à la fois une même chose, c'est là un principe que n'exprime aucune démonstration, à moins qu'on ne veuille démontrer aussi la conclusion sous cette même forme. L'on démontrerait en effet de cette façon, en posant que le premier terme est attribué au moyen avec vérité, et qu'il ne peut avec vérité en être nié. Il serait du reste parfaitement inutile de poser à la fois pour le moyen terme l'affirmation et la négation, ou bien d'en faire autant pour le troisième terme. En effet, si l'on a concédé le terme dont on peut dire homme avec vérité, quoiqu'il puisse être vrai d'ailleurs d'en nier aussi non homme, du moment qu'on a seulement admis que l'homme est animal, et qu'il n'est pas non animal, il sera toujours vrai de dire : Callias, et si l'on veut aussi, non Callias, est animal et n'est pas non pas animal. La cause de ceci c'est que le premier terme n'est pas attribué seulement au moyen; il est attribué aussi à un autre terme, parce qu'il peut s'étendre à plusieurs termes; et voilà comment il n'importe pas pour la conclusion, que le terme moyen soit à la fois telle chose et non telle chose. § 3. C'est la démonstration par l'absurde qui emploie toujours ce principe qu'il faut de toute chose l'affirmer ou la nier. § 4. Cet axiome même n'est pas toujours pris par elle dans son universalité; il est pris seulement dans la mesure suffisante, c'est-à-dire, dans la limite où il s'applique au genre en question; et j'entends par le genre en question le genre relativement auquel on donne les démonstrations, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut. § 5. Toutes les sciences communiquent les unes aux autres par les principes qui leur sont communs; et j'appelle communs les principes qu'on emploie comme devant démontrer par eux, et non pas ce dont on démontre ni ce qu'on démontre. § 6. On peut dire aussi que la dialectique est commune à toutes les sciences; § 7. ainsi que le serait encore la science qui se proposerait de démontrer en général les principes communs de toutes les autres, et par exemple, les principes suivants : De toute chose il faut ou l'affirmer ou la nier : Les quantités égales restent égales, etc., ou quelques autres principes du même genre. § 8. La dialectique ne s'occupe donc pas comme les autres sciences de certains objets spéciaux et déterminés; elle ne se borne pas à un seul et unique genre; autrement, elle ne ferait pas dépendre ses solutions des réponses qu'on fait aux questions qu'elle pose. Au contraire, quand on démontre, on n'est pas libre d'interroger ainsi, parce qu'on ne saurait démontrer une seule et même chose en partant de principes opposés; et c'est ce qui a été prouvé dans le Traité du syllogisme. |
§ 1. Zabarella, d'après Thémistius, a transpose encore ce §, et l'a placé au ch. 8, § 2. Voir plus haut. II est certain que la réfutation de la théorie des idées platoniciennes ne paraît point ici se lier à ce qui précède, ni à ce qui suit, d'une manière fort directe; mais ce n'est pas là, en l'absence de toute autre preuve, un motif suffisant pour changer l'ordre du texte, et je crois devoir le conserver. Aristote a établi plus haut que la démonstration s'appliquait aux choses éternelles; on pourrait en conclure que le principe de toute démonstration réside dans les Idées éternelles, immuables, indépendantes, selon Platon. Il va au-devant de cette conclusion ; et il déclare que, pour lui, l'universel n'est point, comme il l'était pour son maître, séparé et distinct des individus; que le principe de la démonstration est l'éternité seule du genre qui s'applique, sans perdre son unité, à la pluralité des individus; et que, par conséquent, l'universel n'est ni en dehors ni indépendant des individus. - Qu'une seule et même chose puisse avec vérité être attribuée, l'attribution universelle est ce qui constitue l'universel, indispensable à la démonstration, comme au syllogisme. Voir Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 24, § 1. - Cette chose n'est pas homonyme, en d'autres termes, il faut que l'attribution soit réelle et non point apparente. Si le mot était homonyme, c'est-à-dire, s'il avait la même forme tout en désignant un être différent, la démonstration serait factice, comme l'attribution elle-même. Voir, pour la définition d'homonyme, Catég., ch. 1, § 1. § 2. Qu'il soit impossible d'affirmer et de nier à la fois une même chose, le principe de contradiction, bien qu'il soit au fond de toutes les démonstrations, n'entre jamais formellement dans aucune. Il y a cependant une exception, et c'est lorsqu'on veut donner à la conclusion la forme même de ce principe. Pour conclure sous cette forme, il suffit de poser la contradiction à l'attribut, sans la poser ni au sujet, ni au moyen, où elle serait inutile. Soit, par exemple, ces trois termes: Callias, homme, animal; le premier, sujet, le second, moyen, et le troisième, attribut. Il suffit de mettre dans la majeure : Tout homme est animal et n'est pas non animal, pour que la conclusion soit, avec une forme analogue: Callias est animal et n'est pas non animal. II serait superflu de mettre à la mineure: Callias et non Callias (on qui n'est pas Callias), est homme, en menant la contradiction au petit extrême; ou de dire: Callias est homme et n'est pas non homme, en mettant la contradiction au moyen. Ces propositions, toutes bizarres qu'elles seraient, sont vraies cependant; mais elles ont en outre ici l'inconvénient d'être parfaitement inutiles à la démonstration II suffit de la contradiction à la majeure et à l'attribut. Elle se retrouve alors dans la conclusion. - En posant que le premier terme... contradiction dans la majeure seulement. - Le premier terme, l'attribut, le grand extrême. - Le troisième terme, le sujet, le petit extrême. - Le terme dont ou peut dire homme avec vérité, Zabarella semble croire, d'après le commentaire de Philopon, qu'Aristote s'est Ici trompé, du moins dans l'expression ; et, s'appuyant aussi de l'autorité d'Alexandre d'Aphrodise, il pense qu'il faut retourner la phrase et dire: Le terme qu'on peut attribuer à homme avec vérité. Il lui semble indispensable que homme soit ici sujet et non point attribut, comme Aristote le dit. Je ne suis pas de son avis. D'abord le passage de Philopon n'est pas aussi formel qu'il le suppose, et ce n'est pas précisément sur ce point qu'il cite Alexandre. La phrase d'Aristote se justifie parfaitement par elle seule; il suffit de l'appliquer à la mineure et au sujet, et non point à la majeure et au moyen, comme le fait Zabarella. - Le terme dont on peut dire homme avec vérité, c'est Callias, le sujet. - Du moment qu'on a seulement admis, il suffit de poser la contradiction dans la majeure. - Et si l'on veut aussi, non Callias, Callias en effet n'est pas le seul homme. - La cause de ceci, l'attribut est plus large que le moyen, plus large que le sujet. Peu importe alors que l'on contredise l'un et l'autre, l'attribut les dépassera toujours. Ainsi, L'homme et le non homme, est animal; car l'homme n'est pas le seul animal, de même que Callias n'est pas le seul homme. La forme du moyen, comme celle du sujet, est donc indifférente à la conclusion. La forme seule de l'attribut a de l'importance. § 3. Il faut de toute chose l'affirmer ou la nier, le principe de contradiction sa compose de deux parties, l'une négative, dont Aristote a parlé dans le § qui précède, et dont la forme est : Il est Impossible d'une même chose de l'affirmer et de la nier; et l'autre positive, dont la formule est ici donnée. C'est cette seconde formule qu'emploie la démonstration par réduction à l'absurde. Voir Premiers Analytiques, liv. II, ch.11 et suiv. § 4. Ainsi qu'il a été dit plus haut, ch. 10, § 3. § 5. Ces principes qui leur sont communs, les deux parties du principe de contradiction forment deux principes communs à toutes les sciences sans exception, parce qu'ils s'appliquent à l'être en général, et qu'il n'y a pas de science qui n'étudie l'être ; seulement chaque science restreint l'étendue de ces principes au sujet spécial dont elle s'occupe. - Comme devant démontrer par eux, le principe de contradiction n'entre jamais, ou du moins fort rarement, dans la démonstration ; mais au fond c'est lui qui en fait la force, et il est toujours sous-entendu. - Et non pas ce dont on démontre, le sujet de chaque science lui est spécial, ainsi que l'attribut de ce sujet, puisque l'attribut est essentiel. § 6. La dialectique est commune à toutes les sciences, voir Top., liv. I, ch. 2, § 2 et suiv. La dialectique se contente du probable et ne pousse pas jusqu'au vrai. § 7. La science qui se proposerait, il s'agit de la métaphysique. - De démontrer en général les principes communs, il semble que l'expression de démontrer ne soit pas ici fort juste : d'abord parce que les principes ne sont pas démontrables, et en second lieu parce que, au quatrième livre de la Métaphysique, Aristote établit que le principe de contradiction en particulier ne peut être démontré. Il faudrait donc exposer plutôt que démontrer; et c'est bien là le rôle de la métaphysique, puisqu'elle s'occupe de l'être et de ses principes. § 8. La dialectique..., différence de la dialectique et de la métaphysique: la première n'a pas de sujet spécial; la seconde traite de l'être en tant qu'être, et c'est là ce qui la distingue de toutes les autres sciences qui ne traitent l'être qu'à un point de vue particulier, et non général. - Défendre ses solutions, le dialecticien, en interrogeant, est forcé d'adopter la réponse qu'on lui fait dans l'un ou l'autre sens, et d'en tirer des conséquences, au lieu de partir de principes qui lui soient propres. - En partant de principes opposés, c'est-à-dire avec l'affirmation dans la majeure, et la négation dans la mineure, et réciproquement. - Dans le Traité du Syllogisme, il s'agit ici des Premiers Analytiques, où cette théorie est exposée tout au long, liv. II, ch. 15. - Le Traité du Syllogisme, est le nom donné par l'auteur aux Premiers Analytiques, comme l'atteste Galien. Voir le Mémoire sur la Logique d'Aristote, tom. I, p. 42. |
|
La dialectique n'est pas la seule à employer l'interrogation ; l'interrogation peut conduire aussi à la science : conditions des interrogations propres à la démonstration et à la science. Interrogations contraires à la science; conditions du paralogisme; il doit être tiré des mêmes principes, et être pris dans le même genre que le syllogisme; le paralogisme peut tenir à l'homonymie; des irrégularités dans la forme du syllogisme ne produisent pas toujours un paralogisme. - Si le paralogisme est possible, c'est parce qu'on peut tirer une conclusion vraie de prémisses fausses. |
|
|
§ 1. Comme l'interrogation syllogistique se confond avec la proposition qui exprime l'une des deux parties de la contradiction, et comme il y a dans chaque science des propositions d'où se tire le syllogisme spécial à chacune; il s'ensuit qu'il y a une sorte d'interrogation qui produit la science, et donne les éléments dont est tiré pour chaque science le syllogisme qui lui est propre. § 2. II est donc clair que toute interrogation n'est pas également géométrique, ou médicale, ou relative à telle autre science; il n'y a d'interrogation vraiment géométrique que celle dont on se sert pour démontrer, soit l'un des objets de la géométrie, soit l'un des objets démontrés par les mêmes principes, que ceux de la géométrie, ceux de l'optique par exemple; et de même pour tout le reste. § 3. Il faut dans ce cas ne faire porter la discussion que sur des principes, et des conclusions géométriques. Mais le géomètre en tant que géomètre n'a point à discuter les principes; et cette remarque s'applique aussi bien à toutes les autres sciences. § 4. Ainsi donc, quand on sait ce dont on traite, on ne doit pas plus, dans chaque sujet, poser toute question quelconque, qu'on ne doit répondre à toute question ainsi faite. Il faut borner les questions comme les réponses aux choses spéciales de la science dont on s'occupe. § 5. Si donc dans ces limites l'on raisonne en tant que géomètre avec un géomètre, il est clair que raisonner bien ce sera de démontrer quelque chose en partant de principes géométriques; et que si l'on ne part pas de principes géométriques, ce sera raisonner mal; § 6, et il n'est pas moins clair que si dans ce dernier cas on réfute le géomètre, ce n'est que par accident. § 7. Il suit de là qu'il ne faut pas discuter géométrie avec des gens qui ne sont pas géomètres; car on ne s'apercevra pas qu'on raisonne de travers; et cette recommandation n'est pas moins applicable à toutes les autres sciences. § 8. Puisqu'il y a des interrogations géométriques, y en a-t-il donc aussi qui ne sont pas géométriques? et pour chaque science, n'y a-t-il pas des interrogations fondées sur la même ignorance qui sépare les questions géométriques des questions non géométriques? et le syllogisme de l'ignorance est-il le syllogisme formé des propositions opposées aux propositions vraies ou paralogisme, qui toutefois ici ne sort pas de la géométrie? § 9 ou bien, le paralogisme tiré de toute autre science? comme par exemple relativement à la géométrie une interrogation musicale n'est pas géométrique. Mais croire que les parallèles se rencontrent, c'est une idée qui à la fois est géométrique dans un sens, et dans un autre sens, n'est pas géométrique. N'être pas géométrique a deux sens aussi bien que n'être pas rythmique; en premier lieu, une chose est non géométrique comme elle est non rythmique, parce qu'elle n'a aucun rapport à la géométrie; et en second lieu, parce qu'en géométrie elle est fausse; et l'ignorance qui part ainsi de principes pareils est précisément contraire à la science. § 10. Dans les mathématiques, le paralogisme n'est pas aussi aisé. On sait que le moyen terme est toujours double, et qu'un autre terme est attribué à ce moyen tout entier, qui à son tour est attribué à un autre terme tout entier, l'attribut seul n'étant jamais pris universellement; or, en mathématiques, on peut en quelque sorte voir tout cela par la pensée; dans la discussion, au contraire, tout cela peut échapper. Si l'on demande, par exemple : tout cercle est-il une figure? il n'y a qu'à tracer le cercle pour que la réponse soit évidente; et si l'on ajoute : des vers sont-ils donc un cercle? il est clair par le tracé même de la figure qu'ils n'en sont pas un. § 11. Il ne faut pas objecter contre le procédé du mathématicien que la proposition dont il se sert est inductive. De même en effet qu'il n'y a de proposition démonstrative que celle qui s'applique à plusieurs objets, car si elle ne s'applique pas à plusieurs objets, elle ne pourra pas non plus s'appliquer à tous, tandis qu'au contraire le syllogisme ne se forme que de propositions universelles; de même, il est clair qu'il n'y a pas non plus d'objection véritable qui ne soit universelle. C'est qu'au fond les propositions et les objections sont de même nature; et quelle que soit l'objection qu'on fasse, elle pourrait devenir au besoin proposition démonstrative ou dialectique. § 12. Il arrive quelquefois que l'on manque aux règles du syllogisme, parce qu'on prend affirmativement les conséquents des deux extrêmes. C'est par exemple ce que fait Coenée quand il conclut que le feu s'accroît dans une proportion multipliée; car le feu, comme il dit, s'engendre promptement, et cette proportion s'engendre promptement aussi. Mais avec cette manière de procéder il n'y a pas de syllogisme régulier. Pour qu'il y en ait un, il faut que la proportion multipliée soit prise pour le conséquent de proportion la plus rapide, et que proportion la plus rapide dans son accroissement, soit pris pour conséquent de feu. Il arrive donc que parfois on ne peut pas tirer une conclusion de termes ainsi disposés ; et que parfois ou le peut, mais qu'on ne le voit pas. § 13. Si du reste, il était toujours impossible de démontrer le vrai en partant de propositions fausses, il serait facile de résoudre la conclusion dans ses principes, parce qu'alors la réciprocité serait nécessaire. En effet, soit A représentant la conclusion; du moment que A est vrai, j'en puis conclure la vérité des choses dont je connais l'existence et qui sont représentées par B; et par suite je pourrai démontrer, en partant de ces dernières, la vérité de A. Mais cette réciprocité a surtout lieu pour les mathématiques, parce qu'elles n'admettent rien d'accidentel, différence qui les distingue encore de tout ce qui n'est que dialectique et parce qu'elles n'admettent que des définitions. § 14. Ce qui s'accroît dans les mathématiques, ce n'est pas le nombre des moyens termes pour une seule conclusion, c'est seulement le nombre des conclusions qu'on ajoute; par exemple A attribué à B, celui-ci à C, ce dernier à D, et ainsi de suite à l'infini; § 15 ou bien en prenant l'ordre indirect, A attribué à C et à E. Soit par exemple nombre déterminé ou indéterminé qui est représenté ici par A. Le nombre déterminé impair est représenté par B, et le nombre impair par C, on peut conclure que A est attribué à C. Ou bien encore, le nombre déterminé pair est représenté par D, et le nombre pair par E, on en peut conclure que A est attribué à E. |
§ 1. Comme l'interrogation syllogistique, il faut distinguer l'interrogation syllogistique, qui donne les principes d'un syllogisme, de l'interrogation dialectique. La première provoque une réponse certaine et vraie, du moins dans l'esprit de celui qui démontre ; la seconde laisse à celui qui répond le choix de la réponse qui lui convient le mieux et que son interlocuteur admet quelle qu'elle soit. Ce dernier genre d'interrogation peut ne pas mener au syllogisme et à la démonstration. Quant au premier, il est évident qu'Il se confond avec la proposition démonstrative elle-même, et qu'il n'en diffère que par la forme; et, comme il y a dans chaque science des propositions syllogistiques ou démonstratives, il s'ensuit qu'il y a aussi, pour chacune d'elles, des interrogations syllogistiques ou démonstratives. § 2. Toute interrogation n'est pas également géométrique, l'interrogation syllogistique se confondant arec la proposition, il suit que l'interrogation doit être, comme la proposition, propre à la science dont il s'agit. Voyez plus haut, ch. 9, § 4. Il n'y a d'exception, comme on l'a vu, ibid., que pour les sciences subalternes, dont les principes ou les interrogations peuvent être empruntées à la science supérieure. Ainsi, l'optique emprunte ses principes ou ses interrogations à la géométrie dont elle dépend. § 3. Dans ce cas, c'est-à-dire, quand on interroge pour avoir une réponse syllogistique dans une discussion de géométrie. - Le géomètre, en tant que géomètre, n'a point à discuter les principes, les principes de la géométrie sont pour lui indémontrables, du moins en géométrie, précisément parce qu'ils sont des principes; ce qui n'empêche pas qu'il puisse les démontrer comme métaphysicien ou comme dialecticien. Voir, chapitre précédent, §§ 6 et 7. § 4. Ainsi donc, ceci est une conséquence du § 2. L'interrogation devant être propre à la science dont il s'agit, il est interdit, par cela même, de faire ou d'accepter une interrogation quelconque. II ne faut poser et recevoir que des interrogatives spéciales. § 5. Dans ces limites, en ne faisant que des interrogations spéciales. - En tant que géomètre, sans le faire sortir du domaine de la géométrie. § 6. Dans ce dernier cas, en partant de principes qui ne sont pas géométriques. - L'on réfute, voir pour la définition de la réfutation, Réfutations des sophistes, ch. 1, § 4. - Ce n'est que par accident, ce n'est point en tant que géomètre qu'on le réfute, c'est en tant que physicien, ou métaphysicien, etc., ou de toute antre manière qui ne se rapporte pas à la géométrie. § 7. Avec des gens qui ne sont pas géomètres, le texte peut signifier aussi : avec des principes qui ne sont pat géométriques. Zabarella adopte ce dernier sens; j'ai préfère le premier qui me semble se lier mieux à tout ce qui précède, et à la phrase même qui suit, comme on peut le voir. § 8. Puisqu'il y a des interrogations géométriques, la géométrie est prise pour exemple, à la place de toute autre science. - II y a ici trois questions: 1° Y a-t-il des interrogations non géométriques, comme il y en a de géométriques? 2° Dans chaque science, y a-t-il des interrogations qui produisent la science, et d'autres qui ne la produisent pas? 3° Enfin, quelle est la forme du syllogisme qui mène à l'ignorance? et, par exemple, ce syllogisme est-il formé des propositions opposées à celles qui donneraient une conclusion vraie, c'est-à-dire sans sortir du genre en discussion? Les deux premières questions pourraient se réunir en une seule, puisque la première n'est qu'un cas particulier de la seconde qui est plus générale. - Des propositions opposées aux propositions vraies, le texte dit seulement des opposés; j'ai cru devoir ajouter la suite pour être parfaitement clair. § 9. Tiré de toute autre science, voici la réponse aux deux premières questions: Oui, il y a des interrogations non scientifiques, et elles peuvent être de deux genres, selon l'ignorance même qui les produit. Ou l'ignorance est absolue, ou elle n'est que relative; dans le premier cas, on ne sait en aucune manière la chose en question; dans le second, on la sait mal; dans le premier, on est en dehors du genre; dans le second, on reste dans le genre, mais ou ne le comprend pas comme il faut. La première ignorance est, comme dit la scholastique, purae negationis, la seconde est pravæ dispositionis. C'est celle-là qui, pour Aristote, est la véritable ignorance, l'ignorance contraire à la science, qui part de principes pareils à ceux qu'emploie la science elle-même, et qui aboutit cependant au faux. Cette théorie de l'erreur, ou ignorance, est développée tout au long, plus loin, ch. 16, 17 et 18. § 10. La paralogisme n'est pas aussi aisé, réponse à la troisième question du § 8, comment se forment les paralogismes? Aristote signale ici un premier genre de paralogisme; c'est le paralogisme par homonymie; et il remarque qu'en mathématiques, c'est-à-dire surtout en géométrie, ce genre d'erreur est plus difficile, parce qu'on parle aux yeux, et que la représentation matérielle des choses empêche les méprises. Zabarella semble douter qu'il s'agisse spécialement des mathématiques, et il croit que le mot du texte pourrait être pris dans toute sa généralité de science et non de science mathématique en particulier; je crois qu'il se trompe, et à la fin du § me semble le prouver. - On sait que le moyen terme, dans le premier mode de la première figure, le majeur est attribué au moyen universellement, et le moyen l'est universellement aussi au mineur. Ce mode est presque toujours employé dans les mathématiques qui ont besoin de conclusions universelles affirmatives. Voir Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 1, § 1. - L'attribut seul n'étant jamais pris universellement, l'attribut n'a jamais la marque de l'universalité; voir Herméneia, ch. 7, § 4; et Prem. Analytiques, ch. 27, § 9. - Dans la discussion, dans la dialectique; on ne peut pas toujours se représenter les choses dont on parle, comme on le peut en mathématiques. - Des vers sont-ils donc un cercle? l'homonymie porte sur le mot cercle, qui peut s'appliquer à la fois à la figure de géométrie qu'on connaît, et à une certaine espèce de vers. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur cette sorte de poésie. Ce sont ou des vers qui commencent et finissent par le même mot, ou des vers qui peuvent être lus également dans un sens ou dans l'autre, ou enfin des vers qui peuvent être mis indifféremment les uns avant les autres, sans que l'ensemble de la pensée soit changé. Peut-être s'agit-il de poésie cyclique. § 11. Zabarella, d'après Thémistius, rejette ce § à la fin du ch. 17. Je n'adopte pas ce changement plus que les précédents, tout en reconnaissant que ce § semble ici interrompre quelque peu la suite des pensées. - Que la proposition dont il se sert est inductive, c'est-à-dire particulière, comme tirée de la figure spéciale qu'il vient de tracer, voir plus haut, ch. 10, § 10, et Prem. Analytiques, liv. 1, ch. 41, § 6. - Le syllogisme, ajoutez: démonstratif; voir plus haut, ch. 6, § 13. - Qui ne soit universelle, donc toute objection particulière est fausse par cela même, du moment qu'il s'agit de démonstration, comme toute proposition particulière. Voir, pour la définition de l'Objection, Premiers Analytiques, liv. II, ch. 26. Elle est divisée en universelle et particulière comme la proposition; mais c'est qu'il se s'agit point, dans ce passage, des objections et des propositions démonstratives, dont il est question ici. § 12. On prend affirmativement les les conséquences des deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on fait un syllogisme de la seconde figure avec deux propositions affirmatives, ce qui est contre les règles. Voir Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 5, §§ 11, 22, 24 et 26, et ch. 27, § 5. - Ce que fait Coenée, ce philosophe n'est pas connu autrement que par cet unique passage. Voici, du reste, le syllogisme, vicieux dans la forme, qu'il faisait :Ce qui s'accroît en proportion multipliée s'accroit rapidement, or le feu s'accroît rapidement; donc il s'accroît en proportion multipliée. Pour rendre ce syllogisme régulier, il n'y a qu'à convertir la majeure, et alors il est dans la première figure, comme l'indique le texte: Ce qui s'accroît le plus rapidement, s'accroît en proportion multipliée ; or le feu, etc. - Soit pris pour conséquent, ou attribut. - Proportion multipliée, proportion par équiquotient, 2, 4, 8, 16, etc. C'est là le sens donné par les commentateurs grecs, et suivi par Zabarella. Pacius croit qu'il s'agit d'une proportion, dont la raison même procède de puissance en puissance, 2, 4, 16, etc. Les mots grecs se prêtent également à cette explication. Philopon relève avec raison une erreur d'Alexandre d'Aphrodise sur ce passage. - On ne peut pas tirer une conclusion, quand la majeure ne peut être convertie. - Et que parfois on le peut, quand elle est réciproque. § 13. Démontrer le vrai en partant de propositions fausses, on peut tirer une conclusion vraie de principes faux, dans les trois figures, Premiers Analytiques, liv. II, ch. 2, 3 et 4. Si cela était Impossible, du moment que la conclusion est vraie, on pourrait toujours affirmer la vérité des principes; car la réciprocité serait nécessaire, la conclusion étant vraie, les principes le seraient; de même que quand les principes sont vrais, la conclusion l'est toujours. - Et qui sont représentées par B, B représente ici les deux prémisses. - Pour les mathématiques, ou pour les sciences en général comme le veut Zabarella. - Rien d'accidentel, elles n'étudient pas les choses par leurs modifications accidentelles, mais dans leur essence, dans leurs définitions. § 14. Ce qui s'accroît dans les mathématiques, Aristote va ici au-devant d'une objection qu'on peut lui faire: si les mathématiques démontrent par la définition et non par l'accident, comment les conclusions y sont-elles si nombreuses? Chaque chose peut avoir un nombre presque infini d'accidents; elle n'a qu'une seule définition. A cela, Aristote répond : dans les mathématiques, le nombre des moyens termes, c'est-dire des causes et des définitions, ne s'accroît pas; mais c'est seulement celui des conclusions, soit dans l'ordre direct, en subordonnant les démonstrations les unes aux autres, soit dans l'ordre indirect, ou, pour parler comme le texte, dans l'ordre latéral, c'est-à-dire en démontrant le même attribut de plusieurs sujets. - Et ainsi de suite à l'infini, c'est-à-dire en procédant toujours ainsi; mais il y a toujours un terme dans chaque genre. § 15. Soit par exemple, il y a ici deux syllogismes, bien qu'on ne démontre qu'un seul attribut; mais il y a deux sujets, et, par conséquent, deux conclusions: 1° Tout nombre impair est déterminé ou indéterminé; or tout nombre ternaire est impair ; donc tout nombre ternaire est ou déterminé ou indéterminé; 2° Tout nombre pair est déterminé ou indéterminé: or tout nombre binaire est pair ; donc tout nombre binaire est déterminé ou indéterminé. Zabarella dit, en parlant de l'exemple donné ici par Aristote: sumit exemplum satis rude: mais il reconnaît aussi que cet exemple est suffisant, et je crains que Zabarella n'ait pas bien compris le développement des deux syllogismes. |
|
Différence entre la démonstration du fait et la démonstration de la cause : pour la première, le moyen terme n'est qu'un effet immédiat ; pour la seconde, il est la cause immédiate.
1° Dans une même science : exemples d'une démonstration du fait; si l'effet et
la cause sont d'extension égale, en renversant les termes, on obtient la
démonstration de la cause : scintillation des planètes, sphéricité de la lune. -
Si le moyen terme au lieu d'être un effet immédiat ou la cause immédiate n'est
qu'une cause éloignée, on ne démontre que le fait et non la cause du fait;
exemple : le syllogisme est alors dans la seconde figure. |
|
|
§ 1. Entre savoir qu'une chose est, et savoir pourquoi elle est, il y a une grande différence. D'abord cette différence peut avoir lieu dans une seule et même science, et cela de deux manières. La première, c'est quand le syllogisme n'est pas formé de termes immédiats; car alors on n'est pas remonté jusqu'au primitif qui est cause; or, la science du pourquoi ne vient réellement que du primitif qui est cause. La seconde manière, c'est quand le syllogisme, formé d'ailleurs de termes immédiats, n'est pas remonté jusqu'à la cause, et s'est arrêté à celui des termes réciproques qui était plus notoire; car il est fort possible, que parmi les termes qui peuvent être attribués mutuellement l'un à l'autre, le terme qui n'est pas cause, soit cependant plus notoire, et qu'à ce titre on l'emploie pour la démonstration. § 2. Par exemple, on démontre que les planètes sont proches de la terre parce qu'elles ne scintillent pas. Soit C les planètes, B ne pas scintiller, A être proche. Il est vrai de dire B de C, car les planètes ne scintillent pas; mais il est vrai aussi de dire A de B, car lorsqu'un corps ne scintille pas, c'est qu'il est proche. On peut supposer d'ailleurs que cette dernière proposition est fournie par induction ou par expérience sensible ; on en conclut nécessairement que A est à C, et de cette façon il a été démontré que les planètes sont proches. Mais sous cette forme, le syllogisme ne dit pas pourquoi la chose est, il dit seulement qu'elle est ; car les planètes ne sont pas proches de la terre parce qu'elles ne scintillent pas, mais au contraire elles ne scintillent pas parce qu'elles sont proches. § 3. Du reste, on peut encore démontrer à l'inverse l'effet par la cause, et alors la démonstration donnera le pourquoi de la chose. Soit, par exemple, C les planètes, B être proche, A ne pas scintiller ; B est bien aussi à C, et. A ne pas scintiller est également à B, d'où l'on conclut que A est aussi à C; et ce syllogisme donne le pourquoi de la chose, parce qu'on est remonté jusqu'à la cause primitive. § 4. De même encore lorsqu'on démontre la sphéricité de la lune par les accroissements de sa lumière; en disant : Si le corps qui accroît sa lumière ainsi est sphérique, et que la lune accroisse ainsi sa lumière, il est clair que la lune est sphérique ; on forme simplement le syllogisme qui démontre par l'effet. § 5. Mais en déplaçant le terme moyen et le prenant à son tour pour grand extrême, le syllogisme donnera le pourquoi de la chose; car ce n'est pas à cause de ses accroissements de lumière que la lune est sphérique; c'est au contraire parce qu'elle est sphérique qu'elle prend des accroissements de ce genre. Pour démontrer ceci, soit la lune C, sphérique B, et accroissement de lumière A. § 6. Dans le cas où les moyens ne sont pas réciproques, et où c'est le terme qui n'est pas cause qui est le plus notoire, on démontre bien que la chose est, mais on ne démontre pas pourquoi elle est. § 7. Et de même dans les cas où le terme moyen est placé en dehors des extrêmes ; car alors la démonstration donne l'existence de la chose, mais non la cause de cette chose, attendu que la cause n'y est pas exprimée. § 8. Par exemple, pourquoi un mur ne respire-t-il pas? On répond : Parce qu'il n'est pas animal. Si c'était là réellement la cause de l'absence de respiration, il faudrait qu'animal fût cause de la respiration. En effet, du moment que la négation est cause qu'une chose n'est pas, l'affirmation doit être cause que cette chose est; et par exemple, si le défaut d'équilibre entre le chaud et le froid est cause qu'on ne se porte pas bien, l'équilibre de température est cause qu'on se porte bien. Réciproquement, si c'est l'affirmation qui est cause que la chose est, la négation sera cause que cette chose n'est pas. Mais dans l'exemple cité plus haut, ce rapport qu'on vient d'indiquer n'aura pas lieu, puisqu'il n'est pas vrai que tout animal respire. § 9. Or, le syllogisme qui emploie cette sorte de cause, se forme dans la figure moyenne; par exemple, soit A animal, B respirer, C le mur; A est à tout B, car tout ce qui respire est animal; mais il n'est à aucun C, d'où l'on conclut que B n'est non plus à aucun C, c'est-à-dire, que le mur ne respire pas. § 10. Les causes de cette espèce sont, on peut dire, comme des expressions hyperboliques; en d'autres termes, on va chercher le moyen beaucoup trop loin. § 11. C'est tout à fait comme ce mot d'Anacharsis qui disait qu'il n'y a pas de joueuses de flûte parmi les Scythes, parce qu'il n'y a pas de vignes en Scythie. § 12. Telles sont, relativement à une même science, et en ce qui concerne la position des moyens termes, les différences entre le syllogisme qui prouve que la chose est, et le syllogisme qui prouve pourquoi elle est. § 13. Entre le syllogisme du fait et celui de la cause, il y a cette seconde différence, que l'un et l'autre peuvent être empruntés à des sciences diverses. Ceci a lieu pour toutes les sciences qui sont entre elles dans ce rapport que l'une est subordonnée à l'autre: par exemple, l'optique relativement à la géométrie, la mécanique à la stéréométrie, l'harmonie à l'arithmétique, et les phénomènes météorologiques à l'astronomie. § 14. Du reste, quelques-unes de ces sciences sont presque synonymes. L'astronomie signifie à la fois et l'astronomie mathématique et l'astronomie nautique. L'harmonie signifie tout aussi bien et l'harmonie mathématique, et l'harmonie qu'on entend. § 15. C'est qu'ici, en effet, la connaissance du fait appartient à la science qui relève uniquement de sens, et la connaissance de la cause appartient aux sciences mathématiques. Ce sont elles qui, seules, possèdent les démonstrations des causes, ignorant d'ailleurs souvent si la chose existe, de même que ceux qui connaissent l'universel ignorent souvent certain cas particulier, parce qu'ils n'y regardent pas. Telles sont toutes les sciences, qui, bien que différentes en essence, ne s'occupent que des formes. Or, les mathématiques ne s'occupent que des formes et ne s'appliquent pas à un sujet spécial et matériel; car, si la géométrie peut s'appliquer à tel objet spécial, ce n'est certes pas en tant que géométrie qu'elle s'y applique. § 16. Il se peut d'ailleurs qu'une autre science soit à l'optique dans le même rapport que l'optique est à la géométrie. Par exemple, la science qui traite de l'arc-en-ciel. En effet, savoir que l'arc-en-ciel a lieu, appartient au physicien; mais savoir pourquoi il a lieu, appartient à l'opticien, soit d''une manière absolue, soit relativement à la science mathématique. § 17. Ce rapport a lieu même entre beaucoup de sciences qui ne sont pas subordonnées entre elles, la médecine, par exemple, relativement à la géométrie. Ainsi, savoir que les plaies circulaires guérissent plus lentement que les autres, c'est l'affaire du médecin; mais savoir pourquoi, c'est l'affaire du géomètre. |
§ 1. Zabarella remarque avec raison, que le lien de ce chapitre à ce qui précède n'est pas très apparent, mais qu'au fond il est très réel. Après avoir indiqué plus haut toutes les conditions de la démonstration, Aristote en étudie ici le résultat. La démonstration, quand les éléments qui la forment ont toutes les qualités requises, donne la science de la cause, et non celle du simple fait. - D'abord, cette différence peut avoir lieu, voici le premier cas; le second n'est traité qu'au § 13. Le premier s'applique à une seule et même science; le second à des sciences diverses. - Et cela de deux manières, dans une même science on peut arriver à ne démontrer que l'effet au lieu de démontrer la cause en se trompant de deux façons dans les propositions. - Le syllogisme n'est pas formé de termes immédiats, en d'autres termes quand le moyen n'est pas la cause première et immédiate. - Le syllogisme formé d'ailleurs de termes immédiats, c'est-à-dire dont le moyen est bien immédiat, mais est en effet immédiat au lieu d'être la cause immédiate. - Des termes réciproques, l'effet est de même étendue que la cause et peut être pris pour elle, comme elle peut réciproquement être prise pour lui, soir plus loin, liv. II, ch. 16. - Plus notoire, que lacune. - Attribués mutuellement l'un à l'autre, la majeure pouvant se convertir. § 2. Par exemple, exemple relatif à la seconde manière de se méprendre dans la même science. La démonstration de l'effet a lieu par les mêmes termes que la démonstration de la cause : seulement ces termes sont autrement disposés. Aristote prend d'abord un effet immédiat : voici le syllogisme : Ce qui ne scintille pas est proche : les planètes ne scintillent pas; donc elles sont proches. La démonstration ne s'applique qu'au simple fait, et non point a la cause. En effet ce n'est pas l'absence de scintillation qui fait que les planètes sont proches ; c'est au contraire parce qu'elles sont proches qu'elles ne scintillent pas. - Cette dernière proposition, la majeure est indémontrable. - Ou par expérience sensible, Philopon fait remarquer avec raison que la conjonction ou, est ici explicative, plutôt que disjonctive, l'induction résultant de la sensation. § 3. On peut encore démontrer à l'inverse, on peut avec les mêmes termes donner la démonstration de la cause et non plus seulement de l'effet. En convertissant la majeure, le majeur devient moyen et le moyen, majeur : Ce qui est proche ne scintille pas; les planètes sont proches; donc les planètes ne scintillent pas. On a pris pour moyen la cause première et immédiate de la non scintillation, c'est-à-dire, la proximité. § 4. De même encore, autre exemple analogue au premier, et démontrant comme lui d'abord l'effet, puis ensuite la cause. Voici le premier syllogisme où l'on ne démontre que le fait: Ce qui reçoit des accroissements successifs de lumière par le soleil est rond; or la lune reçoit des accroissements de ce genre; donc elle est ronde. § 5. Voici le second syllogisme qui démontre par la cause : Ce qui est rond reçoit des accroissements successifs de lumière par le soleil : or la lune et ronde; donc elle reçoit des accroissements de ce genre. Du premier syllogisme au second, on n'a fait que convertir la majeure, et le grand extrême du premier est devenu le moyen de second. Dans le premier, le moyen n'est qu'un effet; et dans l'autre, il est la cause elle-même. C'est que la cause et l'effet sont réciproques, et peuvent être pris l'un pour l'autre. § 6. Dans les cas où les moyens ne sont pas réciproques, Aristote appelle la cause et l'effet moyens parce que la cause et l'effet sont pris tour à tour pour pour moyens termes, comme on le voit dans les syllogismes précédents. - Le terme qui n'est pas cause, c'est-à-dire l'effet. - Mais on ne démontre pas pourquoi elle est, il s'agit ici d'un effet qui n'est plus immédiat, mais qui est éloigné : la cause a plus d'extension que son effet, et la majeure ne peut plus être convertie. § 7. Le moyen terme est placé en dehors des extrêmes, c'est-à-dire la seconde figure. Il est vrai que, dans la troisième aussi, le moyen est en dehors des extrêmes; mais comme il n'y a dans cette figure que des conclusions particulières, il ne peut y avoir de démonstration, puisque la démonstration doit toujours être universelle. Alexandre d'Aphrodise et Averroès adoptent ce sens: Philopon croit qu'il s'agit de la cause éloigné et qui n'est pas immédiate. Ces deux sens ne s'excluent pas. La cause éloignée, non immédiate, donne un syllogisme de la seconde figure. - La cause n'y est pas exprimée, Aristote aurait dû dire pour plus d'exactitude, la cause immédiate; il est vrai qu'il n'appelle cause que la cause immédiate, et que la cause éloignée n'est pas pour lui une véritable cause. § 8. Exemple où le terme moyen est une cause éloignée et non une cause immédiate. - La cause de l'absence de respiration, la cause immédiate véritable. - Il faudrait qu'animal fût cause de la respiration, or cela n'est pas, puisqu'il y a des animaux qui ne respirent pas; donc la première assertion est fausse aussi, et si un mur ne respire pas, ce n'est pas parce qu'il n'est point animal. - L'affirmation doit être cause que cette chose est, la vraie cause d'un effet étant réciproque à cet effet, tous les deux existant et étant détruits ensemble, il s'ensuit que si l'affirmation est cause de l'affirmation, la négation est cause de la négation; et réciproquement, si la négation est cause de la négation, l'affirmation est cause de l'affirmation. § 9. Se forme dans la figure moyenne, en effet, il s'agit de démontrer une conclusion négative : un mur ne respire pas : or le moyen qui est animal ne peut être attribué à mur que négativement : la mineure ne peut être négative dans la première figure : elle ne l'est que dans la seconde : Tout ce qui respire est animal; or aucun mur n'est animal ; donc aucun mur ne respire. Themistius et Philopon prétendent qu'une cause éloignée peut quelquefois être de même étendue que son effet, et que le syllogisme alors peut avoir lieu dans la première figure comme avec une cause immédiate. Aristote soutient au § suivant que la cause éloignée est toujours plus large que son effet. § 10. Comme des expression hyperboliques, elles dépassent la mesure nécessaire : il n'y a pas besoin de n'être point animal pour ne point respirer, il suffit de n'avoir point de poumon. Le second terme est moins large que le premier ; et c'est le vrai, puisqu'il y a des animaux qui ne respirent point, tandis qu'il n'y a point d'être sans poumon qui respire. § 11. Parce qu'il n'y a point de vignes en Scythie, la cause donnée par Anacharsis est trop éloignée : Là où il n'y a pas de vignes il n'y a pas de vin : là où il n'y a pas de vin, on ne s'enivre pas : là où on ne s'enivre pas, il n'y a pas de joueuses de flûte. Avoir des vignes est en effet une cause plus étendue que l'ivresse : il n'y a point d'ivresse sans vignes; mais il peut y avoir da vignes sans ivresse. § 12. Récapitulation de ce qui précède, relativement à une même science, voir plus haut § 2, et plus bas le § suivant. - La position des moyens termes, voir plus haut, §§ 3 et 5. § 13. Celle seconde différence, voir le § 2, plus haut. L'une est subordonnée à l'autre, et même quand elles ne le sont pas, voir plus loin. § 17. - La géométrie, c'est, comme au sens de Platon (Rép. liv. 7, pag. 95, trad. de M. Cousin ) la science des lignes et des surfaces. - La stéréométrie, c'est la science des solides. La géométrie comprend pour nous la stéréométrie. Si Thémistius s'était reporté au temps de Platon et d'Aristote, il aurait vu que pour eux la géométrie et la stéréométrie étaient deux sciences différentes. § 14. Presque synonymes, ayant le même nom et presque la même définition. § 15. Souvent si la chose existe, ainsi plus bas § 17, le géomètre sait pourquoi les plaies circulaires sont plus lentes à guérir; et de fait, il peut ignorer si les plaies circulaires guérissent plus lentement. - Différentes en essence, des sciences qui leur sont subordonnées. - Ne s'occupent que des formes, en d'autres termes d'abstractions, sans inquiéter de la matière qui les leur fournit. § 16. Il se peut d'ailleurs, il peut y avoir dans la subordination des sciences trois degrés au lieu de deux, et même davantage. - La science qui traite de l'arc-en-ciel, Proclus, au rapport de Philopon, croyait qu'il s'agissait ici de la catoptrique : mais l'expression d'Aristote ne se prête pas à ce sens, comme le remarque Philopon. - Soit relativement à la science mathématique, c'est la leçon vulgaire. Sylburge et Zabarella en adoptent une autre dont ils ne donnent pas l'origine, et qui n'est point préférable: à l'opticien ou à celui qui est mathématicien ; l'édition de Berlin ne donne pas de variante : j'aime mieux le sens que j'ai laissé dans te texte : La théorie de l'arc-en-ciel appartient à l'opticien, soit d'une manière absolue, en tant qu'il est opticien seulement, soit relativement à la science mathématique, en tant qu'il est mathématicien. § 17. C'est l'affaire du géomètre, la démonstration ne passe pas pour cela d'un genre à un autre contre les règles posées plus haut ch. 7, comme l'ont cru quelques commentateurs. Le géomètre ne donne donc qu'une démonstration mathématique et toute générale sur les propriétés du cercle. Le médecin restreint ensuite ces théorèmes à son usage. |
|
La première figure du syllogisme est celle qui est la plus propre à donner la science ; c'est dans cette figure que se forme ordinairement le syllogisme de la cause; elle est la seule qui puisse donner les éléments de la définition essentielle des choses; elle se suffit à elle-même, tandis que les autres figures ont besoin d'elle. |
|
|
§ 1. Des trois figures, c'est la première qui est la plus scientifique. § 2. C'est par elle, en effet, que les sciences mathématiques donnent leurs démonstrations, l'arithmétique, la géométrie, l'optique, et l'on peut dire presque toutes les sciences qui étudient le pourquoi des choses; car c'est dans cette figure, uniquement, ou du moins pour le plus grand nombre des cas et pour la majorité des sciences, que se forme le syllogisme de la cause. § 3. C'est là, du reste, ce qui rend cette figure la plus scientifique de toutes, puisque savoir le pourquoi des choses est le plus haut degré de la science. § 4. Ensuite, cette figure est la seule au moyen de laquelle on puisse chercher à connaître l'essence des choses; car, dans la seconde, il n'y a pas de syllogisme affirmatif; or ce n'est que par l'affirmation qu'on sait ce qu'est une chose; et clans la dernière, il y a bien syllogisme affirmatif, mais il n'y a pas de syllogisme universel; or, la définition essentielle d'une chose, est nécessairement un universel ; et par exemple, c'est sans aucune limite que l'homme est un animal bipède. § 5. Enfin, ou peut ajouter que cette figure n'a pas besoin des deux autres, et que ces dernières, au contraire, ont besoin d'elle, pour condenser et accroître les propositions jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux propositions immédiates. § 6. Donc, en résumé, la première figure est évidemment la plus propre de toutes à donner la science. |
§ 1. Après avoir expose la matière et le but de la démonstration, il reste à indiquer quelle est sa forme. La démonstration n'est qu'un syllogisme dont les propositions remplissent certaines conditions, et dont la conclusion est d'une nature spéciale. A quelle figure du syllogisme, à quel mode, la démonstration a-t-elle recours pour être parfaite? C'est au premier mode de la première figure, Barbara, parce que dans ce mode les propositions, comme la conclusion, sont universelles et affirmatives. - C'est la première, plus exactement, le premier mode de la première. Dans le chapitre précédent, § 9, il a été prouvé que la démonstration pouvait avoir lieu aussi dans la seconde figure: mais d'abord la forme même du syllogisme était alors irrégulière ; et de plus, la démonstration n'était point complète puisqu'elle n'avait lieu que par l'effet et non par la cause. § 2. C'est par elle en effet que les sciences, ce qui fait la supériorité démonstrative de la première figure, c'est que la cause ne peut être jointe à son effet qu'affirmativement; et que, de plus, l'effet étant démontré d'un sujet ne peut être joint à ce sujet qu'affirmativement aussi. La majeure et la conclusion doivent donc toujours, par l'essence même de la science, être affirmatives ; la mineure l'est, par conséquent, comme elles, et le mode est en Barbara. - Ou du moins pour le plus grand nombre des cas, il y a une exception, et elle a lieu lorsqu'on veut démontrer un effet par la cause immédiate, non de son sujet propre, mais d'un sujet différent dont cet effet est nié. Le syllogisme se forme alors, comme le remarque Zabarella, en Camestres de la seconde figure ; Il y en a eu un exemple au chapitre précédent, § 8 - Le syllogisme de la cause, c'est-à-dire, la véritable démonstration où l'attribut est prouvé du sujet par sa cause immédiate. § 3. Savoir le pourquoi des choses, voir plus haut, ch. 2, § 1, second motif qui assure à la première figure la supériorité sur toutes les autres. § 4. L'essence des choses, troisième motif: la première figure, dans son premier mode, est la seule qui puisse conduire la la définition. Toute définition, en effet, est universelle et affirmative. Or, il sera prouvé plus loin, liv. II, ch. 8, § 13, que toute vraie définition vient d'un syllogisme démonstratif où l'ordre des termes seul est changé ; et ce syllogisme démonstratif est toujours dans le premier mode de la première figure. La seconde est exclue parce qu'elle n'a que des conclusions négatives; la troisième, parce qu'elle n'en a que de particulières. - C'est sans aucune limite, le défini est toujours pris dans toute son extension. § 5. Enfin, on peut ajouter..., quatrième motif. - N'a pas besoin des deux autres, voir Premiers Analytiques, liv. I, ch. 7. § 7 et suivants. - Pour condenser et accroître les propositions, si en effet il y a, dans un syllogisme de la seconde figure, une proposition qui ne soit pas immédiate et évidente par elle-même, il faudra recourir, pour la démontrer, à d'autres propositions: et, si la première propositions est affirmative, on ne pourra la prouver que par la première figure, et non par la seconde. De même pour la troisième ligure par laquelle il serait impossible de démontrer une proposition universelle. La première figure, au contraire, n'a pas besoin de recourir à une autre pour démontrer les propositions qu'elle emploie, elle les démontre par elle-même. Voir la théorie de la démonstration circulaire, Premiers Analytiques, liv. II, ch. 5, 6 et 7. Les propositions se condensent lorsque de médiates elles deviennent immédiates. II y a, en effet, dans les propositions médiates, comme un intervalle, un vide, entre le sujet et l'attribut. On comble cet intervalle en insérant entre les deux extrêmes tous les moyens qui les séparent, et l'on arrive ainsi à obtenir le rapport immédiat du sujet à l'attribut où il n'y a plus de moyen terme: c'est qu'alors l'attribut est essentiel. A mesure qu'on avance ainsi, le nombre des propositions médiates s'accroît; et il ne s'arrête que quand on est arrive aux propositions immédiates. § 6. La plus propre de toutes, il ne dit pas que ce soit la seule. Voir plus haut, § 1, où la pensée est la même. |
|
Les propositions immédiates peuvent être négatives aussi bien qu'elles sont affirmatives. Quand les deux termes de la proposition négative sont chacun dans un genre, ou même quand ils sont tous deux dans un même genre, la proposition ne peut jamais être immédiate ; il y a toujours quelque terme moyen qui démontre l'attribut du sujet. Pour que la proposition négative soit immédiate, il faut que les deux termes soient chacun des genres, et des genres différents; le syllogisme alors n'est possible ni dans la première ni dans la seconde figure. |
|
|
§ 1. De même que A peut, comme on l'a vu, être affirmé immédiatement de B, de même il se peut qu'il en soit nié ainsi. § 2. Je dis qu'une chose est, soit affirmativement, soit négativement, immédiate à une autre, lorsque entre ces deux choses, il n'y a pas de terme moyen ; car alors il n'est pas possible que la première chose soit attribuée affirmativement ou négativement à la seconde, par l'intermédiaire de quelque autre chose. § 3. Lors donc que A ou B est dans quelque totalité, ou bien même lorsqu'ils y sont tous les deux à la fois, A ne peut pas être nié immédiatement de B. § 4. En effet, soit A dans la totalité de C; si B n'est pas aussi dans la totalité de C, car il se peut que A soit dans quelque totalité sans que B y soit, il y aura syllogisme concluant que A n'est pas à B; 80 car si C est à tout A et qu'il ne soit à aucun B, A non plus n'est à aucun B. § 5. De même, si B est dans quelque totalité, par exemple en D, alors D est à tout B et il n'est à aucun A; donc on aura pour conclusion que A n'est à aucun B. § 6. C'est encore de la même manière qu'on démontrera, si les deux termes sont chacun dans la totalité d'un genre. § 7. Du reste, que B puisse ne pas appartenir au genre dans la totalité duquel est A, ou réciproquement, que A puisse ne pas appartenir au genre dans la totalité duquel est B, c'est ce que prouvent évidemment les séries parallèles qui ne se confondent jamais entre elles; car si aucun des termes compris dans la série A, C, D, ne peut être attribué à aucun des termes de la série B, E, F, et que A soit dans la totalité de H qui est dans la même série que lui, il est évident que B ne sera pas dans H ; car alors les séries se confondraient. Même raisonnement, si c'est B qui est dans la totalité du genre. § 8. Mais si aucun des deux termes n'est dans la totalité d'un genre, et que A ne soit pas à B, il est nécessaire que ce soit immédiatement qu'il en soit nié. En effet, s'il y avait entre eux un moyen terme, il serait nécessaire que l'un ou l'autre fût dans la totalité d'un genre; et le syllogisme alors se formerait, soit dans la première figure, soit dans la figure moyenne. Si c'est dans la première, B sera dans la totalité de quelque genre, puisqu'il faut que la proposition relative à B soit affirmative. Et si c'est dans la figure moyenne, ce sera indifféremment l'un ou l'autre des deux ternies qui sera dans une totalité de genre; car il y a toujours syllogisme dans cette figure, quelle que soit d'ailleurs la proposition qu'on fasse privative; ce n'est que dans le cas où on les ferait toutes deux négatives qu'il n'y aurait pas de syllogisme.
§ 9. Il est donc évident qu'il est possible qu'un terme soit nié
d'un autre immédiatement ; et nous venons de dire quand et comment
cela peut être. |
§ 1. Comme on l'a vu, dans tout ce qui précède. on a toujours considéré la proposition immédiate comme affirmative; elle peut cependant être négative aussi, et il faut rechercher à quelles conditions. § 2. Je dis qu'un chose est..., définition de la proposition immédiate; c'est celle où il n'est plus possible d'insérer de moyen terme entre le sujet et l'attribut : ils sent liés essentiellement l'un à l'autre, soit affirmativement, soit négativement, sans qu'on puisse faire de démonstration. § 3. Lorsque A ou B est dans quelque totalité, c'est-à-dire compris dans un genre, ou en d'autres termes, lorsque A et B ne sont pas genres eux-mêmes, l'un ne peut pas être nié immédiatement de l'autre. Si en effet l'un ou l'autre est dans un genre, comme le genre est toujours affirmé de l'espèce, il s'ensuivra que le genre de l'un des termes servira de moyen pour démontrer qu'il n'est pas à l'autre: la proposition négative ne sera donc pas immédiate, puisqu'elle pourra être démontrée par un moyen terme placé entre le sujet et l'attribut. - Lorsqu'ils y sont tous les deux à la fois, quand les deux termes sont compris chacun dans un genre, et sont tous les deux des espèces a lieu d'être des genres. § 4. Soit A, dans la totalité de C, la proposition négative qu'on étudie ici est, par exemple: A n'est à aucun B. A quelles conditions cette proposition négative peut-elle être immédiate? 1° En supposant que A est dans un genre C, et que B, le sujet, n'y soit pas. Le genre C servira de moyen pour démontrer que A n'est à aucun B : donc cet proposition ne sera point immédiate. On aura en effet dans la seconde figure en Camestres : C est à tout A; or C n'est à aucun B; donc A n'est à aucun B; car si C est à tout A et qu'il ne soit à aucun B, etc. § 5. De même, si B... 2° En supposant que B, le sujet, est dans un genre, et que A, l'attribut, n'y est pas, la proposition négative ne sera point immédiate; car on pourra la démontrer par le genre D, dans lequel est B. Le syllogisme est en Cesare dans la seconde figure, ou en Celarent dans la première: D n'est à aucun A ; or D est à tout B; donc A n'est à aucun B; ou bien, en convertissant la majeure, qui est convertible simplement: A n'est à aucun D, etc. § 6. C'est encore de la même manière... 3° En supposant que B, le sujet, et A, l'attribut, sont tous deux dans un genre, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'est genre, on démontrera à plus forte raison que la proposition négative, A n'est à aucun B, ne peut être immédiate; car on aurait pour la démontrer, soit dans la première figure, soit dans la seconde, le genre de A et celui de B, c'est-à-dire, deux moyens termes au lieu d'un seul. Il faut du reste supposer ici que A et B sont dans des genres différents, et non point dans un seul et même genre; car alors on ne pourrait démontrer par ce genre unique la proposition négative, puisque le genre est toujours affirmé de ses espèces. C'est ce qui est expliqué dans le § suivant. Pour voir que A et B doivent ne pas être dans le même genre, il suffit de se rappeler que les catégories ne communiquent pas entre elles, c'est-à-dire qu'aucune des espèces de l'une ne peut être attribuée aux espèces de l'autre essentiellement ; car il ne s'agit toujours ici que de l'attribution essentielle. § 7. Du reste, que B puisse..., il peut fort bien se faire que les deux termes A et B ne se réunissent point dans un genre commun, et il suffit pour cela qu'ils soient dans des séries parallèles, c'est-à-dire, dans des catègories différentes, l'un dans la substance, par exemple, l'autre dans la qualité. - Aucun des termes..., aucune des espèces. - Etre attribué, ajoutez : Essentiellement. - Dans la totalité de H, dans le genre H. - Et qui est dans la même série que lui, comme genre suprême, par exemple. - Même raisonnement, peu importe en effet qu'on suppose A ou qu'on suppose B dans un genre; les catégories, les séries, ne peuvent pas davantage se confondre. § 8. Mais si aucun des deux termes..., règle de la proposition négative immédiate. Si les deux termes A et B sont tous les deux genres, et non plus espèces, et qu'ils soient niés l'un de l'autre, ils le seront immédiatement, c'est-à-dire sans moyen terme. - Il serait nécessaire que l'un ou l'autre..., l'un des deux termes serait une espèce : ce qui est contre l'hypothèse. - Soit dans la première figure, en Celarent, en supposant que B est une espèce dont le genre est affirmé, ce qui donne une mineure affirmative. - Soit dans la figure moyenne, en supposant indifféremment que A ou B est une espèce, au lieu d'être un genre; car, dans cette figure, le syllogisme se forme, soit avec une majeure négative en Cesare, soit avec une mineure négative en Camestres. - Qu'il n'y aurait pas de syllogisme. Voir Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 24, § 1. § 9. Quand et comment, quand les deux termes sont tous les deux des genres et non des espèces; et l'un des deux termes ne peut alors être démontré de l'autre; Il en est nié sans moyen terme, et immédiatement ou primitivement, sans démonstration possible. |
|
SECTION TROISIÈME. DE L'IGNORANCE OPPOSÉE A LA SCIENCE DÉMONSTRATIVE. De l'ignorance positive dans les propositions immédiates: cette ignorance peut être produite par syllogisme.
Dans la première figure. - Conclusion affirmative et erronée: les deux
propositions étant fausses ; l'une des deux seulement étant fausse. - Conclusion
négative et erronée : les deux propositions étant fausses ; l'une des deux
seulement étant fausse, soit la mineure, soit la majeure. |
|
|
§ 1. L'ignorance qui repose non sur une négation, mais sur l'admission positive de certains termes, est l'erreur commise par raisonnement. § 2. Elle se produit de deux façons, dans les propositions immédiates, soit affirmatives, soit négatives. C'est d'abord quand on suppose simplement que la chose est ou n'est pas; et en second lieu, c'est quand on fait cette supposition par suite d'un syllogisme. § 3. Quand la supposition est simple, l'erreur est simple aussi ; mais quand la supposition se fait par syllogisme, l'erreur peut être multiple. § 4. Par exemple, supposé que A ne soit immédiatement à aucun B, si l'on établit par syllogisme que A est à B en prenant C pour moyen, on se sera trompé par syllogisme. § 5. Or, il se peut que les deux propositions soient fausses, et il se peut aussi que l'une des deux seulement le soit. § 6. Car si A n'est à aucun C ni C à aucun B, et qu'on admette l'une et l'autre proposition à l'inverse, toutes les deux alors seront fausses. Il se peut en effet que C soit à A et à B dans un tel rapport, qu'il ne soit ni sujet de A ni attribut universel de B; car d'abord il est impossible que B soit dans la totalité de quelque genre, puisqu'on a supposé que A était nié immédiatement de B; et ensuite, il n'est pas nécessaire que A soit attribut universel de toutes choses. Donc, par conséquent, les deux propositions seront fausses. § 7. Mais l'on peut supposer l'une des deux vraie, non pas toutefois l'une ou l'autre indifféremment, mais seulement la proposition 80a A C; car la proposition C B sera toujours fausse, puisque B n'est dans aucun autre terme. Mais la proposition A C peut être vraie, par exemple quand A est à C et à B immédiatement; car lorsqu'une même chose est attribuée primitivement à plusieurs termes, aucun de ces termes ne pourra être immédiatement à aucun autre. § 8. II n'importe pas, du reste, que A ne soit pas immédiatement à C. § 9. Ainsi donc, l'erreur qui affirme que la chose est, se produit à ces conditions et de cette façon seulement; car on a vu qu'il n'y a pas de syllogisme affirmatif dans une figure autre que la première. § 10. Mais l'erreur qui nie que la chose est peut se produire dans la première et dans la moyenne figure. Voyons d'abord de combien de manières elle se produit dans la première figure, et quelle est alors la nature des propositions. § 11. L'erreur est possible lorsque les deux propositions sont fausses. Par exemple, si A est à C et à B immédiatement, en supposant que A n'est à aucun C et que C est à tout B, les deux propositions sont fausses. § 12. L'erreur peut avoir également lieu, une seule des deux indifféremment étant fausse. § 13. En effet, il se peut que A C soit vraie et C B fausse; A C est vraie, parce que A n'est pas attribut de toutes choses; et C B fausse, parce que C, auquel A n'est en aucune façon, ne peut être à B; autrement la proposition A C cesserait d'être vraie; et en outre, si les deux propositions étaient vraies, la conclusion le serait comme elles. § 14. Enfin, il se peut encore que C B soit vraie, l'autre proposition étant fausse, par exemple si B est compris dans C et dans A; car alors il est nécessaire que A et C soient sujets l'un de l'autre; et c'est là ce qui fait que, si l'on suppose que A n'est à aucun C, cette proposition sera fausse. § 15. Donc évidemment, soit que l'une des deux propositions soit fausse, soit qu'elles le soient toutes le deux à la fois, la conclusion sera également fausse. § 16. Dans la figure moyenne, il est impossible que les deux propositions soient fausses tout entières. En effet, quand A est à tout B, on ne peut pas prendre un troisième terme qui soit à l'un tout entier et qui ne soit pas du tout à l'autre. Or, pour qu'il y ait syllogisme, le propositions doivent avoir cette forme, que le moyen soit à l'un des extrêmes et qu'il ne soit pas à l'autre. Si les propositions sous cette forme sont fausses, il s'ensuit évidemment qu'avec une forme contraire elles seront l'opposé du faux; or, c'est là ce qui est impossible. § 17. Mais rien n'empêche que les deux propositions ne soient fausses en partie. Par exemple, lorsque C est à la fois à quelque A et à quelque B, en supposant qu'il est à tout A et qu'il n'est à aucun B, les deux propositions seront fausses, non pas pourtant en totalité, mais seulement en partie. § 18. Et de même aussi, en faisant changer de place la proposition privative. § 19. Il se peut encore que l'une des deux seulement soit fausse, et indifféremment; car, ce qui est à tout A, sera aussi à B. Si donc l'on suppose que 81 C est à A tout entier, et qu'il n'est à aucun B, la proposition C A sera vraie, et C B sera fausse. § 20. De plus, ce qui n'est à aucun B ne sera pas non plus à tout A; car s'il était à A, il serait aussi à B, et l'on a supposé qu'il n'y était pas. Si donc l'on suppose que C est à A tout entier, et qu'il n'est à aucun B, la proposition C B sera vraie, et l'autre sera fausse. § 21. Il en est encore de même en déplaçant la proposition privative ; car ce qui n'est à aucun A ne sera non plus à aucun B. Si donc l'on a supposé que C n'est à aucun A, mais qu'il est à B tout entier, la proposition A C sera vraie et l'autre sera fausse. § 22. A l'inverse, il sera faux de supposer que ce qui est à tout B n'est à aucun A ; car, s'il est à tout B, il faut nécessairement aussi qu'il soit à quelque A. Si donc on a supposé que C est à tout B et qu'il n'est à aucun A, la proposition C B sera vraie, mais C A sera fausse. § 23. Il est donc clair qu'avec les deux propositions fausses ou avec l'une des deux seulement fausse, il pourra y avoir conclusion erronée pour les propositions immédiates. |
§ 1. L'ignorance qui repose... Cette théorie a déjà été indiquée plus haut, ch. 18, § 8 et 9; mais elle n'avait point été developpée. Elle l'est complètement dans ce chapitre et les deux suivants. Après la théorie de la science, vient celle de son contraire, l'ignorance; et, dès le ch. 2, § 18, Aristote avait montré comment l'une tient à l'autre, en vertu de ce principe, que la notion des contraires est unique. Aristote distingue, ici comme plus haut, deux espèces d'ignorances : l'une de négation, qui n'a rien de scientifique, et qui doit par suite tenir fort peu de place, voir plus haut, ch. 18; l'autre qui est positive, en ce qu'elle admet des propositions contraires à la vérité et à la science. L'ignorance positive peut être, ou dans les principes, propositions immédiates, soit affirmatives, soit négatives, ou dans les conclusions. Elle peut, en outre, être simple ou composée: simple lorsque, sans syllogisme régulier, elle nie ce que la science affirme, ou affirme ce que la science nie; composée, quand elle arrive à sn affirmation et à sa négation erronée par un syllogisme en forme. C'est de celle-là surtout qu'il faut s'occuper, en l'étudiant d'abord dans les principes, puis dans les conclusions. - L'erreur commise par raisonnement, le mot de raisonnement a un sens plus large que celui de syllogisme: il indique toute opération de l'entendement général. § 2. De deux façons, c'est-à-dire, elle est simple ou composée. - Dans les propositions immédiates, c'est là l'objet du présent chapitre. Le suivant traitera des propositions médiates, ou conclusions. - Quand on suppose, sans raisonnement en forme. § 3. Quand la supposition est simple, faite sans syllogisme régulier. - L'erreur peut être multiple, Aristote va en décrire ici toutes les espèces. II faut remarquer qu'il ne s'occupe que des modes universels dans la première figure et dans la seconde, au nombre de quatre, parce que, la démonstration étant toujours universelle, les propositions qui expriment l'erreur opposée doivent l'être comme elle. Ainsi ce sont les propositions contraires, et non les contradictoires, dont il sera question ici. Voir Premiers Analytiques, liv. II, ch. 15, § 2, et ch. 8, § 2; ainsi que l'Hermeneia, ch. 7, 10 et 11. C'est qu'en effet dans un sujet nécessaire, in materia necessaria, comme dirait la scholastique, la proposition contraire a force de contradictoire, puisqu'elle est fausse du moment même que l'autre est vraie. § 4. Supposé que A ne soit immédiatement à aucun B, en supposant que cette proposition immédiate négative: A n'est à aucun B, soit vraie, la proposition fausse contraire à celle-là sera: A est à tout B; si l'on démontre cette dernière proposition, le mode sera en Barbara, le seul qui donne une conclusion affirmative universelle, et l'on se sera trompé par syllogisme. L'erreur peut se commettre de plusieurs façons, suivant la nature diverse des propositions. § 5. Or, il se peut..., cette nature diverse des propositions consiste en ce que toutes deux peuvent être fausses, ou l'une des deux seulement. § 6. Car si A n'est à aucun C, première hypothèse : toutes les deux fausses. Si A n'est en réalité à aucun C, et que C ne soit non plus en réalité à aucun B, en admettant les propositions contraires: A est à tout C; C est à tout B, les deux prémisses seront fausses, et l'on conclura : A est à tout B, conclusion opposée à la proposition vraie: A n'est à aucun B, et fausse par conséquent. - Il se peut en effet que C, le moyen C peut en effet n'être ni sujet de A, et alors la majeure est fausse; ni attribut universel de B, et alors la mineure est fausse également. - Que B soit dans la totalité de quelque genre, B lui-même est genre, puisque autrement il ne pourrait être nié immédiatement de A. Voir chapitre précédent, §§ 3 et 8. - Il n'est pas nécessaire que A soit attribut universel de toutes choses, A est un genre comme B; mais il n'est pas attribut de tout, et il y a des choses dont il peut être nié ; et C, le moyen, peut être une de ces choses, quelles qu'elles soient. § 7. L'une du deux vraie, seconde hypothèse. L'une des deux propositions étant vraie, on peut encore obtenir une conclusion affirmative fausse, opposée à la négative immédiate vraie. - Mais seulement la proposition AC, il n'y a que la majeure qui puisse être vraie. A peut bien être attribut de C, mais B se peut jamais être sujet de C; et la mineure C B est toujours fausse, parce que B ne peut être dans aucun autre terme, c'est-à-dire, dans aucun autre genre, puisqu'il est genre lui-même. - Quand A est à C et à B immédiatement, ajoutez: soit affirmativement, soit négativement. - Ne pourra être immédiatement à aucun autre, être attribué affirmativement. Voici donc la règle : quand un terme est attribué à plusieurs autres, de manière à être nié immédiatement de l'un (A n'est à aucun B), et à être affirmé de l'autre soit immédiatement, soit médiatement (A est à tout C), il est impossible que l'un des termes sujets soit affirmé d'un autre terme sujet comme lui ; et voilà pourquoi ici la mineure, C est à tout B, est toujours fausse. A étant nié immédiatement de B, aucun des termes sujets de A ne peut être affirmé de B; car alors B ne serait plus genre, comme le veut l'hypothèse. § 8. Que A ne soit pas immédiatement à C, que A, le grand extrême, soit affirmé de C médiatement ou immédiatement. § 9. Qui affirme que la chose est, l'erreur sous forme affirmative: A est à tout B, opposée à la proposition immédiate et négative, vraie: A n'est à aucun B. - On a vu, Premiers Analytiques, liv. I, ch. 5, § 29, et ch. 6, § 24. - De syllogisme affirmatif, ajoutez: et universel, les propositions universelles étant les seules qui conviennent à la démonstration. § 10. Mais l'erreur qui nie que la chose est, l'erreur qui se produit sous forme négative; ainsi, en supposant que cette proposition immédiate affirmative : A est à tout B, soit vraie, l'erreur négative sera : A n'est à aucun B. Or, cette conclusion peut s'obtenir dans les deux premières figures, qui donnent toutes deux des conclusions universelles négatives. - Quelle est la nature des propositions, qui sont fausses ou vraies. § 11. Lorsque les deux propositions sont fausses, première hypothèse, le syllogisme de l'erreur étant d'ailleurs toujours en Celarent. - Si A est à C et à B immédiatement, en supposant vraie cette proposition immédiate affirmative: A est à tout B, la conclusion contraire négative sera: A n'est à aucun B. Dans le premier cas, on a: A est à tout C immédiatement et sans syllogisme ; dans le second, on essaie de conclure le contraire. Si A est à C immédiatement comme il est à B, la majeure : A n'est à aucun C, sera fausse; car on ne peut nier le genre de ses espèces; et la mineure: C est à tout B, le sera également par la règle du § 7. Les deux propositions seront donc fausses dans ce syllogisme: A n'est à aucun C; or, C est à tout B; donc A n'est à aucun B. Le syllogisme est en Celarent. § 12 Une seule des deux indifféremment, soit la majeure, soit la mineure; seconde et troisième hypothèse. § 13. Que AC soit vraie, que la majeure: A n'est à aucun C, soit vraie. - A n'est pas attribut de toutes choses, il peut y avoir des choses dont A ne soit pas attribut, et le moyen C est une de ces choses. - Et CB fausse, la mineure : C est à tout B, peut être fausse. La seconde hypothèse est donc : majeure vraie, mineure fausse. - Parce que C auquel A s'est en aucune façon, le genre A étant nié de C, il faut nécessairement que l'espèce B de A en soit niée aussi ; et, par conséquent, la mineure affirmative :C est à tout B, est Fausse; car B n'étant àaucun C, réciproquement aussi C est à aucun B. - Si les deux propositions étaient vraies, en admettant que la majeure est vraie, ll faut nécessairement que la mineure soit fausse; car si elle était vraie aussi, la conclusion serait vraie comme les prémisses. Premiers Analytiques, liv. ll, ch. 2, § 2; ce qui est contre l'hypothèse, puisqu'on suppose la conclusion erronée. § 14. Enfin il se peut encore, troisième et dernière hypothèse: majeure fausse, mineure vraie. - CB soit vraie, la mineure: C est à tout B. - L'autre proposition, la majeure: A n'est à aucun C. - Si B est compris dans C et dans A, Si B est sujet de C et de A, A et C étant affirmés de B, il faudra nécessairement qu'ils le soient l'un de l'autre ; et la proposition : A n'est aucun C, sera fausse par conséquent, puisque : A est à tout C, est vraie. § 15. La conclusion sera également fausse, toujours dans la première figure. § 16. Soient fausses tout entières, une proposition universelle est fausse tout entière quand la particulière qu'elle comprend est fausse comme elle. Ainsi, cette proposition universelle négative : Aucun homme n'est animal, est fausse tout entière, parce que la particulière qu'elle comprend : Quelque homme n'est pas animal, est fausse également. Voir Prem. Analytiques, liv. II, ch. 9, § 9 et 8. - Quand A est à tout B, conclusion supposée vraie, et dont la contraire : A n'est à aucun B, est, par conséquent, fausse. - Un troisième terme, la conclusion étant : A est à tout B, on no saurait trouver un moyen qui soit attribut de A, et qui ne soit pas attribut de B. En effet, B étant une espèce du genre A, il faut que ce qui est affirmé universellement du genre soit affirmé aussi de l'espèce, et que ce qui est affirmé universellement de l'espèce le soit au moins particulièrement du genre. - Or, pour qu'il y ait lsyllogisme, concluant en Cesare que A n'est à aucun B, il faudrait que la mineure fût affirmative avec la majeure négative: C n'est à aucun A ; or, C est à tout B; donc A n'est à aucun B. Si les prémisses, sous cette forme sont fausses en totalité, les propositions de forme contraire: C est à tout A, or C n'est à aucun B, seront vraies, ou l'opposé du faux; mais l'on obtient alors en Camestres la même conclusion : A n'est à aucun B, conclusion qui semble devoir être vraie, puisque les prémisse sont supposées vraies. Or, c'est là ce qui est impossible, car on a supposé d'abord que cette proposition A est à tout B, était vraie. Deux propositions opposées seraient donc vraies à la fois, ce qui ne se peut, Herméneia, ch. 14 § 13. Donc la conclusion : A n'est à aucun B, étant fausse, suppose aussi la fausseté de prémisses; elles ne peuvent donc être d'abord fausses en totalité, comme on l'avait supposé, puisque cette hypothèse, si on l'admet, conduit à l'absurde. § 17. Que les deux propositions ne soient faussa en partie, si les prémisses sont fausses en partie au lieu de l'être en totalité, le syllogisme pourra avoir lieu; et l'on obtiendra régulièrement la conclusion erronée, soit en Camestres: B est à tout A ; or, C n'est à aucun B; donc A n'est à aucun B; soit en Cesare, au § suivant. Le moyen C étant attribué particulièrement au deux termes, si l'on suppose d'abord qu'il est à tout le majeur, et qu'il est nié universellement du mineur, les prémisses seront fausses en partie. § 18. Et de même aussi, en faisant la majeure négative au lieu de la mineure; en prenant le mode Cesare au lieu de Camestres. § 19. L'une des deux seulement soit fausse, soit la majeure, soit la mineure; de là quatre syllogismes, deux en Camestres et deux en Cesare, majeure fausse, mineure vraie, et majeure vraie, mineure fausse. - Car ce qui est à tout A, premier syllogisme en Camestres avec majeure vraie et mineure fausse. Soit la conclusion vraie: A est à tout B, la conclusion contraire : A n'est à aucun B, sera fausse; mais tout ce qui, comme C, est attribué à A, le genre, doit l'être aussi à B, l'espèce ; ainsi, dans ce syllogisme : C est tout A; or, C n'est à aucun B ; donc A n'est à aucun D, la majeure sera vraie, la mineure fausse, et la conclusion fausse aussi. - La proposition CA, la majeure. - La proposition CD, la mineure. § 20. De plus ce qui n'est à aucun B, second syllogisme en Camestres. Si le moyen C n'est réellement à aucun B; ou, en d'autres termes, si la mineure : C n'est à aucun B, est vraie, il s'ensuit que la majeure: C est à tout A, est fausse ; car ce qui n'est à aucune espèce ne peut-être universellement au genre. - Car s'il était à A, si le moyen C était à A, le genre, il faudrait aussi qu'il fût à l'espèce B, ce qui est contre l'hypothèse. - La proposition CB, la mineure, comme plus haut. - Et l'autre, la majeure. Le syllogisme ne change pas; seulement la majeure et la mineure sont tantôt vraies et tantôt fausses. § 21. En déplaçant la proposition primitive, c'est-à-dire, en prenant le mode Cesare au lieu du mode Camestres, troisième syllogisme; la majeure étant négative à la place de la mineure - Ne sera non plus à aucun B, parce que ce qui est nié universellement de genre doit l'être aussi de l'espèce; donc la mineure: C est à tout B, est fausse ; et la majeure: C n'est à aucun A, est vraie. § 22. A l'inverse, c'est-à-dire, en faisant la majeure vraie après l'avoir faite fausse, et de même pour la mineure: quatrième syllogisme. - Il sera faux de supposer, que ce qui est à toute l'espèce n'est pas du tout au genre; car ce qui est affirmé de toute l'espèce doit être ou au genre tout entier, ou à une partie du genre. - A quelque A, c'est-à-dire à une partie du genre. - La proposition CB sera vraie, la mineure. - CA sera fausse, la majeure. §. 23. Il est donc clair, résumé du chapitre sur la nature diverse des propositions. |
|
De l'ignorance positive dans les propositions médiates. Conclusion erronée et négative, obtenue dans la première figure, soit par le terme moyen qui pourrait servir à donner la conclusion vraie, soit par un moyen d'une série voisine, soit par un moyen étranger, sujet et non sujet du majeur. - Dans la seconde figure; vérité et fausseté des propositions. Conclusion erronée et affirmative obtenue dans la première figure soit par le terme moyen propre, soit par un moyen d'une série voisine, soit par un moyen étranger, sujet ou non sujet du majeur; vérité et fausseté des propositions. |
|
|
§ 1. Quant aux propositions qui ne sont pas immédiates, affirmatives ou négatives, lorsque le syllogisme de l'erreur se forme par le moyen propre à la chose, il n'est pas possible que les deux propositions soient fausses; il ne peut y avoir de fausse que celle de l'extrême majeur. § 2. J'appelle moyen propre le moyen par lequel se forme le syllogisme vrai, contradictoire à celui de l'erreur. § 3. Soit, par exemple, A à B par C moyen. Puis donc qu'il est nécessaire, pour que le syllogisme ait lieu, que C B soit affirmative, il est évident que cette proposition sera toujours vraie, attendu qu'elle ne peut pas se convertir; mais A C sera fausse, car c'est en convertissant celle-là qu'on forme le syllogisme contraire au vrai. § 4. Même résultat, quand l'on prend le moyen dans une autre classe, par exemple D, s'il est dans A tout entier et qu'il soit attribué à tout B; en effet, il faut que la proposition D B demeure affirmative, et que l'autre soit convertie, de sorte que l'une est toujours vraie, l'autre toujours fausse; et que l'erreur ici est à peu près la même que celle qui a lieu par le moyen propre. § 5. Mais dans le cas où le syllogisme ne se forme pas par le moyen propre, quand le moyen est sujet de A, et qu'il n'est à aucun B, il faut nécessairement que les deux propositions soient fausses; car alors il faut prendre les propositions en sens contraire de ce qu'elles sont, pour que le syllogisme soit possible. Mais, en les prenant ainsi, elles deviennent fausses toutes les deux : par exemple, si A est à D tout entier, et que D ne soit à aucun B; car, en convertissant les propositions, le syllogisme aura lieu, et les deux propositions seront fausses. § 6. Mais quand le moyen n'est pas sujet de A, par exemple D, la proposition 81a A D sera vraie, et D E sera fausse. En effet, A D est vraie parce que D n'était: pas dans A; et D B est fausse, parce que, si elle était vraie, la conclusion le serait aussi. Or, on l'a supposée fausse. § 7. Quand l'erreur se forme par la figure moyenne il ne se peut pas que les deux propositions soient fausses tout entières ; car lorsque B est sujet de A, il n'y a pas de terme qui puisse être à l'un tout entier et n'être aucunement à l'autre, ainsi qu'on l'a dit plus haut. § 8. Mais l'une des deux, indifféremment, peut être fausse. § 9. Car en supposant que C est à A et à B, l'on admet qu'il est à A et qu'il n'est pas à B, A C sera vraie et l'autre sera fausse. § 10. Et réciproquement, si l'on admet que C est à B et qu'il n'est à aucun A, C B sera vraie et l'autre sera fausse. § 11. Lors donc que le syllogisme de l'erreur est privatif, on sait quand et comment l'erreur peut se former. § 12. S'il est affirmatif et qu'il se forme par le moyen propre, il est impossible que les propositions soient toutes les deux fausses à la fois; car nécessairement la proposition C B doit rester affirmative pour qu'il y ait syllogisme, comme on l'a déjà dit plus haut; et voilà pourquoi la proposition C A sera toujours fausse, car c'est celle qui est convertie. § 13. Et de même, si l'on tire le moyen d'une autre série, ainsi qu'on l'a dit pour le syllogisme de l'erreur négative; car il faut que D B reste affirmative et que A D soit convertie. L'erreur alors est la même que précédemment. § 14. Quand ce n'est pas par le moyen propre que le syllogisme se forme, si D est sujet de A, la majeure sera vraie et l'autre sera fausse; car il se peut que A soit en rapport avec plusieurs termes qui ne sont pas subordonnés entre eux. § 15. Mais si D n'est pas sujet de A, il est évident que la majeure sera toujours fausse, car on la prend affirmative. Mais D B peut également être ou vraie ou fausse, puisqu'il se peut fort bien que A ne soit à aucun D et que D soit à tout B. Ainsi, par exemple, animal n'est point à science et science est à musique. D'autre part, il est également possible que A ne soit non plus à aucun D, ni D à aucun B. Donc il est évident que, si le moyen n'est pas sujet de A, les deux propositions peuvent être fausses, ou l'une des deux indifféremment.
§ 16. On voit maintenant de combien de manières et à quelles conditions sont
possibles les erreurs par syllogisme, soit pour les propositions immédiates,
soit pour les propositions auxquelles la démonstration peut s'appliquer. |
§ 1. Quant aux propositions qui ne sont pas immédiates, après avoir traité des conclusions fausses, opposées aux propositions immédiates affirmatives et négatives, il reste à traiter de ces conclusions reiativement aux propositions médiates, ou démontrables, affirmatives et négatives. - Par le moyen propre à la chose, par le moyen terme qui peut aussi donner la conclusion vraie au lieu de la conclusion erronée. Voir le § suivant. - Que celle de l'extrême majeur, il faut que l'une des prémisses soit fausse pour que la conclusion le soit; or, la mineure dans la première figure étant toujours affirmative, elle doit ici rester sous cette forme; et il n'y a que la majeure qui puisse se changer en négative, pour que la conclusion erronée, opposée à la conclusion vraie affirmative, soit négative comme la majeure. § 2. Contradictoire, ou pour mieux dire, contraire, mais avec force de contradictoire. Voir au chap. précédent, § 3. § 3. Soit donc A à C par B, syllogisme en Barbara, à conclusion vraie : A cet à tout C ; or C est à tout B; donc A est à tout B. - Pour que le syllogisme ait lieu, parce que dans la première figure la mineure doit toujours être affirmative. Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 4. - Que CB soit affirmative, la mineure. - Elle ne peut pas se convertir, comme la majeure en négative. Aristote dit ici : se convertir, comme il l'a dit dans les Premiers Analytiques, ch. 3; mais le sens n'est plus le même; il aurait mieux fait de prendre le terme : changer, qui est plus général que celui de: se convenir. J'ai du reste gardé celui-ci pour être plus fidèle, comme je l'ai déjà dit. Premiers Analytiques, liv. 2, ch. 8. - Mais AC sera fausse, la majeure. - Car c'est en convertissant celle-là, c'est en changeant la majeure affirmative en sa contraire négative qu'on peut obtenir la conclusion erronée négative. § 4. Le moyen dans une autre classe, en d'autres termes, un moyen qui ne soit pas la cause propre qui unit l'attribut au sujet. - La proposition DB, la mineure. - Demeure affirmative, par le même motif que plus haut. - L'autre, la majeure. - L'une est toujours vraie, la mineure. - L'autre toujours fausse, la majeure. - A peu près le même, parce que le moyen, sans être le moyen propre, y ressemble en ce qu'il peut donner aussi une conclusion vraie. § 5. Ne se forme pas par le moyen propre, ni par aucun moyen qui puisse, comme le moyen propre, fournir une conclusion vraie. - Quand il est sujet de A et qu'il n'est à aucun B, quand ce moyen est sujet de A, et qu'il ne peut en réalité être à aucun B, il faut prendre les deux propositions fausses, c'es-à-dire, supposer que A n'est pas au moyen, quoiqu'il y soit; et que ce moyen est à B, bien qu'il n'y soit pas; car il faut toujours que la mineure soit affirmative pour que le syllogisme soit possible, dans la première figure. - Si A est à D tout entier, D est ici le moyen terme. - En convertissant les propositions, c'est-à-dire, en changeant la majeure affirmative en négative, et la mineure négative en affirmative. § 6. Quand le moyen n'est pas sujet de A, c'est-à-dire quand la majeure vraie est négative : A n'est à aucun D - Et DB sera fausse, la mineure. - D n'était pas dans A, A n'est à aucun D. - La conclusion le serait aussi, parce que, la majeure étant vraie, et la mineure aussi, la conclusion ne peut être fausse. Premiers Analytiques, liv. 2, ch. 2, § 2 - Or on l'a supposée fausse, puisque le syllogisme est celui de l'erreur. § 7. Lorsque B est sujet de A, lorsque A est le genre et B l'espèce, il faut que ce qui est universellement à l'un soit à l'autre aussi, au moins particulièrement. - Et n'être aucunement à l'autre, ce qu'il faudrait, soit en Camestres, soit en Cesare, si les deux propositions étaient fausses. - Ainsi qu'on l'a dit plus haut, ch. 16, § 16. § 8. L'une des deux, soit la majeure, soit la mineure. § 9. Car en supposant que C..., le moyen est en réalité à A et à B; si l'on suppose au contraire qu'il n'est qu'au premier et qu'il n'est pas au second, le syllogisme en Camestres donnera une conclusion fausse. - AC sera vraie, la majeure. - Et l'autre sera fausse, la mineure. § 10. Et réciproquement, si le syllogisme est en Cesare au lieu d'être en Camestres, et qu'on change la majeure en négative au lieu de la mineure. - CB sera vraie, la mineure. - Et l'autre sera fausse, la majeure. - Zabarella remarque, avec raison, qu'Aristote. n'a point traité le cas où la proposition affirmative, soit majeure en Camestres, soit mineure en Cesare, est seule fausse. Il serait très facile de suppléer à l'omission : c'est de supposer dans l'hypothèse primitive que le moyen terme affirmé d'abord des deux extrêmes soit nié des deux; la négative alors sera vraie, soit en Cesare, soit en Camestres, et l'affirmative sera fausse. Le raisonnement serait d'ailleurs le même. §11. Le syllogisme de l'erreur est privatif, lorsque la conclusion erronée est négative, et contraire à la conclusion vraie qui est affimative dans la première figure, et par deux dans la seconde. § 12. S'il est affirmatif, seconde partie de la théorie : la conclusion erronée est affirmative au lieu d'être négative. La proposition médiate vraie est dans ce cas négative. La conclusion erronée ne peut être qu'en Barbara. - Par le moyen propre. Voir plus haut, §§ 1, 2, 3. - La proposition CB, la mineure doit rester affirmative, parce que la mineure l'est toujours dans la première figure, en Celarent comme en Barbara. - Comme on l'a déjà dit plus haut. Voir plus haut, § 3. - La proposition CA, la majeure sera toujours fausse, parce que c'est la seule qui puisse être changée, et de négative devenir affirmative. Quant à la mineure, elle reste la même et dans le syllogisme de l'erreur, et dans celui de la science. - Celle qui est convertie. Voir au § 3 la remarque sur cette expression : convertie. § 13. Et de même, c'est-à-dire la mineure reste toujours vraie; la majeure est la seule qui puisse devenir fausse. - Ainsi qu'on l'a dit, § 4. - DB reste affirmative, la mineure. - Et que AD soit convertie, la majeure. - La même que précédemment, c'est-à-dire, que pour le moyen propre. Ici le moyen, sans être le moyen propre, c'est-à-dire la cause, ressemble cependant à ce moyen, et peut comme lui donner une conclusion vraie, si ce n'est démonstrative, ce qu'on ne doit pas confondre. § 14. Si D est sujet de A, si A le majeur est attribué à tout D, la majeure sera vraie; mais la mineure : D est à tout B, sera fausse; car il se peut fort bien que A soit attribué, affirmativement ou négativement, à deux tenues dont l'un ne peut pas être affirmé de l'autre, ou, comme le dit le texte, qui ne sont pas subordonnés entre eux. § 15. Mais si D n'est pas sujet de A, si A ne peut pas être en réalité affirmé de D, la majeure qui l'affirme sera fausse. - Mais DB, la mineure peut être tantôt vraie tantôt fausse. - Que A ne soit à aucun D; que D ne soit pas sujet de A; et que D soit à tout B; que B soit sujet de D. - Ainsi, par exemple, voici le syllogisme en Barbara, avec conclusion erronée: Toute science est animal; or toute musique est science; donc toute musique est animal En effet, la science D n'est pas sujet de A animal, et la majeure est fausse ; mais B, la musique, est sujet de D. - Que A ne soit non pies à aucun D.., en d'autres termes que les deux propositions vraies soient négatives, et que, par conséquent, les prémisses affirmatives soient toutes les deux fausses, comme la conclusion. - Ou l'une des dieux indifféremment, la majeure peut être toute seule fausse, quand le moyen n'est pas sujet de A, et que cette majeure l'affirme; ou bien la mineure peut aussi être fausse toute seule, quand le petit extrême n'est pas sujet du moyen terme. - Averroès, et après lui Zabarella, font remarquer que dans l'exemple cité, la mineure étant vraie, le moyen peut servir à donner la conclusion vraie tout aussi bien que la conclusion fausse; et que, par conséquent, c'est le moyeu propre, ou du moins un moyen semblable au moyen propre, ce qui est contre l'hypothèse même faite dans ce §. Aristote aurait dit ajouter ici que, quand la mineure est vraie, le moyen terme est le moyen propre; et que c'est seulement quand elle est fausse que le moyen n'est pas le moyen propre. § 16. De combien de manières dans quels modes, de quelles figures. - A quelles conditions, les propositions étant fausses ou vraies. - Les propositions auxquelles la démontrantion peut s'appliquer, médiates. - Ce § résume ce chapitre et le précédent. |
|
De l'ignorance négative par quelque défaut naturel dans les sens ; la démonstration s'appuie sur l'universel, qui vient de l'induction comme l'induction vient du particulier; et le particulier n'est perçu que par la sensibilité, sans laquelle il n'y aurait ni induction, ni démonstration possible. |
|
|
§ 1. Il n'est pas moins évident que lorsqu'un sens vient à manquer, il doit nécessairement alors manquer aussi quelque science qu'il est impossible d'acquérir. En effet, nous ne pouvons apprendre que par induction ou par démonstration. Or, la démonstration 82 se tire de principes universels, et l'induction de cas particuliers. Mais il est impossible de connaître les universels autrement que par induction; c'est par l'induction, en effet, que sont connues même les choses abstraites, quand on veut faire comprendre que certaines d'entre elles sont dans chaque genre, choses d'ailleurs dites abstraites bien qu'elles ne soient pas séparées en tant que chacune d'elles formerait un objet distinct. Or, induire est impossible pour qui n'a pas la sensation ; car la sensation s'applique aux objets particuliers; et pour eux, il ne peut y avoir de science, puisqu'on ne peut pas du tout la tirer d'universels sans induction, ni l'obtenir par l'induction sans la sensibilité. |
Thémistius, et Zabarella d'après lui, transportent ici le § 11 du chap. 12; j'ai dit, en cet endroit, pourquoi je ne croyais point devoir accepter le changement qu'ils proposent. § 1. Lorsqu'un sens vient à manquer, après avoir traité de l'ignorance pravae dispositionis, Aristote complète la théorie en disant quelques mots de l'ignorance puræ negationis; et il en indique la cause principale, qui est un défaut même de la sensibilité. - Quelque science, la science qui correspond au sens qui manque : la science des couleurs, par exemple, pour un aveugle de naissance ; des sens pour un sourd-muet, etc. - Que par induction ou démonstration, Voir liv. II, ch. 19 ; et dans les Premiers Analytiques, liv. II, ch. 22. - De principes universels. Voir plus haut, ch. 4 et 6. - Et l'induction de car particuliers. Voir la théorie de l'induction, Premiers Analytiques, liv. II, ch. 22. - De connaître les universels autrement que par induction. Voir, à la fin de second livre des Derniers Analytiques, comment se forment les universaux dans l'entendement. - Même les choses abstraites, les principes mathématiques : si donc c'est par l'induction que des principes de ce genre sont connus, à plus forte raison est-ce l'induction qui fera connaître des principes moins éloignes des choses réelles que ceux-là. - Que certaines d'entre elles sont dans chaque genre, s'il s'agit de faire comprendre cette propriété du cercle, d'avoir tous ses rayons égaux, on se sert de l'induction, en montrant cette propriété sur plusieurs cercles sensibles, et en l'induisant ensuite pour le cercle en général ; de même, si l'on voulait démontrer que les angles d'un triangle sont égaux à deux droits. Dans chaque genre signifie ici : qu'il s'agisse ou de cercle, ou de triangle, ou de carré, ou de parallélogramme rectangle, ou de tel autre genre de figure qu'on voudra. - Or induire est imposible, l'induction sert à donner les principes qui ne sont connus que par elle; mais l'induction ne peut avoir lieu que par la sensibilité : la sensibilité est donc indispensable à la connaissance des principes. C'est cette théorie qui a fait accuser Aristote de sensualisme, et lui a fait prêter si souvent cet axiome, qui ne lui appartient pas : Nihil in est intellectu quod non prius fuerit in sensu. Je l'ai déjà défendu contre cette accusation, Mémoire sur la Logique, tom. II, pag. 15; je reviens sur cette grave question dans la préface à cette traduction de l'Organon. Voir le tome 1er. |
|
SECTION QUATRIÈME. MÉTHODE POUR REMONTER DES PROPOSITIONS MÉDIATES AUX PROPOSITIONS IMMÉDIATES, ET DÉGAGER LES ÉLÉMENTS DE LA DÉMONSTRATION. Les principes de la démonstration sont-ils limités ou infinis? 1° Les attributs sont-ils limités ou infinis? 2° Les sujets sont-ils limités ou infinis? En d'autres termes, peut-on, en partant du sujet. remonter sans fin d'attributs en attributs; en partant de l'attribut, descendre sans fin de sujets en sujets? 3° Les extrêmes étant limités, les moyens peuvent-ils être infinis? Ces questions s'appliquent aux propositions immédiates négatives aussi bien qu'aux propositions immédiates affirmatives. Exception pour les termes réciproques. |
|
|
§ 1. Tout syllogisme se compose de trois termes. § 2. Le syllogisme affirmatif peut démontrer que A est à C parce qu'il est à B, et que celui-ci est à C. Mais le syllogisme privatif, dans l'une de ses propositions, exprime qu'une chose est à une autre chose, et dans l'autre, au contraire qu'elle n'y est pas. § 3. Or, ces propositions évidemment sont ce qu'on appelle les principes et les hypothèses; car avec ces diverses formes de propositions, on arrive nécessairement à démontrer par exemple que A est à par B, ou encore que A est à B par un autre moyen, et que B est à c de la même manière. § 4. Quand donc on ne raisonne que suivant l'apparence et d'une manière purement dialectique, il est évident que tout ce dont on doit s'inquiéter, c'est de savoir si le syllogisme se forme des éléments les plus probables possible. Ainsi, en admettant que réellement il y a un terme moyen entre A et B, mais qu'il semble seulement qu'il n'y en ait pas, celui qui raisonne sur ces données ne fait que raisonner dialectiquement. Quand, au contraire, on prétend atteindre la vérité, il faut avoir soin de partir de termes qui sont bien réellement immédiats. § 5. Il est certain, en effet, qu'il y a des choses de cette sorte, puis qu'il y a dans chaque genre une chose qui est attribuée à une autre chose autrement que par accident. J'entends qu'une chose n'est attribuée que par accident, quand nous disons, par exemple, comme cela nous arrive quelquefois, que cet objet blanc est un homme, ne confondant point d'ailleurs cette expression avec celle-ci : L'homme est blanc. C'est qu'en effet, pour être blanc, l'homme n'est pas du tout autre chose que lui-même, tandis que le blanc n'existe que parce qu'il arrive accidentellement à l'homme d'être blanc. II y a donc certaines choses qui peuvent être attribuées essentiellement à d'autres. § 6. Soit donc un terme C de telle espèce qu'il ne soit lui-même à aucun autre terme, et que B soit immédiatement à ce ternie, sans qu'il y ait entre eux aucun intermédiaire, et que E soit de cette même façon à F et celui-ci à B; faut-il que cette suite ait une limite, ou, au contraire, peut-elle s'étendre à l'infini? § 7. D'un autre côté, si rien ne peut être essentiellement attribué à A, et que A soit à H primitivement, sans être à aucun terme supérieur, et que de plus H soit à G et celui-ci à B, ici encore, je le demande, a-t-il nécessité que cette suite s'arrête, ou bien pourrait-elle continuer à l'infini? § 8. Cette seconde question diffère de la première en ce sens que l'une a pour but de savoir si, en commençant par le terme qui n'est attribué à aucun autre, mais qui en reçoit un autre comme attribut, on peut en remontant aller à l'infini; et que dans l'autre, au contraire, il s'agit de savoir si en commençant par le terme 82a qui est attribué lui-même à un autre, sans qu'aucun autre lui soit attribué, on peut en descendant aller de même à l'infini. § 9. On peut demander encore si les moyens peuvent être infinis quand les extrêmes sont limités. Ainsi, par exemple, si A est à C et que B soit moyen entre les deux, et qu'il y ait d'autres moyens entre A et B, et d'autres encore pour ceux-là, est-il possible ou est-il impossible que ces moyens aussi aillent à l'infini? § 10. Se poser cette question, c'est précisément la même chose que de se demander si les démonstrations vont à l'infini, et s'il y a démonstration de tout, ou s'il y a pour les termes une limite de l'un relativement à l'autre. § 11. J'applique également ceci et aux syllogismes privatifs et aux propositions privatives. Ainsi, quand A n'est à aucun B, on peut rechercher s'il en est nié primitivement, ou bien s'il y a quelque terme intermédiaire dont il soit nié antérieurement; par exemple, si ce terme intermédiaire est G qui est à tout B; et en outre si le terme A est nié d'un autre terme antérieur à ce terme G, tel que H qui est à tout G. C'est qu'en effet, dans ce cas aussi, il faut, ou que les choses dont A est nié primitivement soient infinies, ou bien qu'elles aient une limite. § 12. Ceci ne saurait s'appliquer aux termes réciproques, parce que dans les termes qui peuvent être attribués réciproquement l'un à l'autre, on ne peut pas dire qu'il y ait ni premier ni dernier relativement à l'attribution. Tout alors est à tout dans le même rapport, soit que les attributs de l'objet soient infinis, soit que les deux mouvements dont il vient d'être question soient infinis. Il faut dire toutefois que la réciprocité est différente, et que l'une des attributions est accidentelle, tandis que l'autre au contraire est essentielle. |
§ 1. Tout syllogisme..., il a été démontré plus haut, ch. 3, que le nombre des sujets, ni des attributs, ni des moyens, ne pouvait être infini. En s'appuyant de ce principe, Aristote montre comment on peut toujours, des propositions médiates remonter aux propositions immédiates, qui sont les éléments mais de la démonstration. - Se compose de trois termes. Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 25, § 1. § 2. Le syllogisme affirmatif, universel : A est à tout B ; or B est à tout C; donc A est à tout C. - Mais le syllogisme privatif, exige toujours qu'une des propositions soit affirmative. Premiers Analytiques, liv. 1. ch. 21, § 1. - Qu'une chose est à une autre chose, proposition affirmative. - Qu'elle n'y est pas, proposition négative. § 3. Ce qu'on appelle les principes, les hypothèses. Voir, pour la définition de ces deux mots, plus haut, ch. 1, §§ 13 et 15. - Que A est à C par B, quand les propositions sont toutes deux immédiates. - Ou encore que A est à B par un autre moyen, quand la majeure n'est pas une proposition immédiate, et qu'elle a besoin elle-même d'être démontrée. - Et que B est à C de la même manière, quand la mineure aussi est médiate, et qu'elle doit être démontrée. § 4. D'une manière purement dialectique. Voir Topiques, liv. 1, ch. 10, § 2. Les propositions immédiates peuvent être ou réellement immédiates, ou seulement le paraître; la dialectique se contente de ces dernières propositions; la démonstration, au contraire, veut des propositions qui soient immédiates bien réellement. La science ne peut s'acquérir que par celles-là; les autres ne donnent que l'opinion. § 5. Des choses de cette sorte, c'est-à-dire des propositions immédiates. - Autrement que par accident, qui est attribuée essentiellement. Voir plus haut, ch. 4, § 4. - Cet objet blanc est un homme..., l'homme est blanc ; ces deux propositions diffèrent en ce que, dans la première, homme est attribué à blanc autrement que par le blanc lui-même; le blanc n'est pas homme par lui-même ; mais il n'est en rapport avec l'homme que parce qu'il arrive à l'homme d'être blanc. Dans la seconde, au contraire, blanc est attribué à l'homme par l'homme lui-même. Naturellement, blanc n'est pas sujet de homme, tandis que homme peut être naturellement sujet de blanc. - Attribuées essentiellement, Averroès, d'après Philopon, et avec lui Zarabella, proposeraient de lire : Naturellement au lieu d'Essentiellement, pour distinguer l'attribution essentielle, dont il s'agit ici, de celle dont il a été traité au ch. 4. § 6. Soit donc un terme C, un sujet C qui ne puisse être attribué à aucun terme autre que lui, c'est-à-dire un sujet individuel; et que B soit immédiatement à ce terme, mais que ce sujet ait un attribut immédiat, et que cet attribut m ait d'autres, tels que F qui lui-même a E pour attribut: les moyens et les sujets étant ainsi limités, la série des attributs sera-t-elle infinie? Première question qui sen discutée plus loin. § 7. D'un autre côté, seconde question : les attributs et les moyens état limités, le nombre des sujets peut-il être infini? - Si rien ne peut être attribué essentiellement à A, si A est un genre supérieur qui n'en ait plus au-dessus de lui, et qui ne puisse plus, par conséquent recevoir d'attribut. - Et que A soit à H immédiatement, et que la proposition AH soit immédiate. - Et que de plus H soit à G, et que le sujet H suit attribut d'un autre sujet, et celui-ci d'un autre. etc. - Que cette suite s'arrête, qu'il y ait une borne au nombre des sujets, comme il y en a eu une, plus haut, à celui des attributs. § 8. L'une a pour but, la première qui est relative au sujet, c'est-à-dire au terme qui n'est attribué à aucun autre, mais qui reçoit un attribut. - En remontant, d'attribut en attribut. - Dans l'autre, au contraire, dans la seconde qui est relative à l'attribut, c'est-à-dire au terme qui n'est plus sujet d'un autre, parce qu'il est le plus étendu possible. - En descendant, de sujet en sujet. § 9. On peut demander encore, troisième question: le nombre des attributs et des sujets étant limité, celui des moyens termes peut-il être infini? - Si A est à C, conclusion par B moyen. S'il y a un second moyen entre A et B, puis un troisième entre le second et B, etc., cette série peut-elle être sans fin? § 10. Cette question, c'est-à-dire, cette troisième question seulement, et non point toutes les trois, comme l'ont compris quelques commentateurs, et entre autres Philopon. Zabarella remarque, avec raison, que peu importe ici l'infinité du nombre des extrêmes. A peut avoir au-dessus de lui des attributs infinis, et C, au-dessous, des sujets infinis; la démonstration ne va point à l'infini, puisque les deux propositions AB, BC, n'en sont pas moins immédiates. C'est donc le nombre seul des moyens termes qui importe; et voilà pourquoi la troisième question est la seule à laquelle Aristote s'arrête. - S'il y a démonstration de tout, ces deux erreurs ont été déjà réfutées plus haut, ch. 3. § 11. J'applique également ceci, cette dernière question sur le nombre des moyens. - Aux syllogismes privatifs, tout ce qui précède s'applique aux conclusions affirmatives; c'est qu'en effet il y a des propositions immédiates négatives, comme on l'a vu au ch. 15. - Ou bien s'il y a quelque terme intermédiaire, la proposition négative: A n'est à aucun B, étant supposée n'être point immédiate, elle a un moyen G dont A est nié immédiatement, et qui est attribué à tout B; de sorte qu'on a en Celarent: A n'est à aucun G; or, G est à tout B; donc A n'est à aucun B. - Et, en outre, si ce terme A, si la majeure: A n'est à aucun G, est elle-même médiate au lieu d'être immédiate, on aurait alors: A n'est à aucun H; or, H est à tout G ; donc A n'est à aucun G. - Pour la proposition négative, il n'y a point à se poser les deux questions sur les sujets et les attributs, parce qu'en ajoutant des attributs ou des sujets négatifs, on ferait les deux propositions négatives; ce qui ne peut donner de conclusion. Prem. Analytiques, liv. I, ch. 24 § 1. § 12. Ceci ne saurait s'appliquer, les deux premières questions, la troisième ne pouvant trouver place ici puisque entre des termes réciproques il n'y a pas de moyens termes. - Ni premier, ni dernier, parce que l'attribution est en quelque sorte circulaire. - Tout alors est à tout, chacun des termes est alors dans le même rapport, sujet et attribut tout à la fois. - Les deux mouvements dont il vient d'être question, de descendre de sujet en sujet, et de remonter d'attribut en attribut. Voir plus haut les questions des §§ 6 et 7. |
|
Si les extrêmes sont limités, les moyens ne peuvent pas être infinis, car alors on ne pourrait jamais arriver à unir les extrêmes. Objection : Les moyens ne sont pas infinis à partir de l'un des extrêmes; ils ne le sont qu'après quelques attributions. - Réponse : du moment qu'ils sont infinis, peu importe le point où ils commencent à l'être. |
|
|
§ 1. On voit donc, que si les attributions ont une limite en haut et en bas, les moyens non plus ne sauraient être infinis. J'entends par en haut, les attributions qui remontent à un terme plus universel, et par en bas, celles qui descendent au particulier. En effet, A étant attribué à F, si les moyens représentés par B sont infinis, il est évident qu'il sera possible, en partant de A et en descendant, d'attribuer sans fin un terme à un autre, puisque les moyens sont infinis avant d'arriver à F; et ils le sont également en remontant de F avant d'arriver à A. Or, si cela est impossible, il est impossible aussi que les moyens entre A et F aillent à l'infini. § 2. Si l'on prétend que les termes entre A et B se suivent mutuellement de telle manière qu'il n'y ait point place entre eux pour des intermédiaires, et que ce sont seulement les autres termes qui sont insaisissables, cette objection n'est pas juste; car, quel que soit le terme que je prenne parmi les B, les moyens relativement à A ou relativement à F seront infinis, ou ils ne le seront pas. Le point précis où commencent d'abord les termes infinis, soit sur-le-champ, soit plus tard, n'importe en rien; car les termes qui viennent après ce point sont dès lors infinis. |
§ 1. On voit donc, réponse à la dernière des trois questions : les moyens termes ne peuvent être Infinis; car alors l'attribution, soit en montant d'attribut en attribut, soit en descendant de sujet en sujet, serait sans fin. - En haut et en bas, dans les attributs et dans les sujets. - Un terme plus universel, un attribut plus large. - Au particulier, à l'individuel. - A étant attribué à F, la proposition AF est de telle sorte que A n'a point au-dessus de lui d'attribut plus étendu, ni F, au-dessous de lui, de sujet plus restreint. - Or, si cela est impossible, l'infinité des attributs et celle des sujets est possible, comme il sen démontré plus loin, ch. 22. § 2. Si l'on prétend, Aristote va au-devant d'une objection qu'on pourrait faire, et que voici: les moyens infinis se suivent sans interruption et ils sont toujours attribués immédiatement les uns aux autres. Ainsi, entre chaque moyen, il n'y a point une infinité de termes ; il n'y en a une qu'en les deux extrêmes A et F. - Les autres termes, les extrêmes. - Qui sont insaisissables, qu'on ne peut jamais unir parce qu'il faudrait parcourir l'infini de l'un à l'autre. |
|
S'il y a des limites pour la démonstration affirmative, il y en a également pour la démonstration négative; dans celle-ci non plus que dans la première, les moyens ne peuvent être infinis. - Démonstration négative dans la première figure; démonstration négative dans la seconde; démonstration négative dans la troisième; démonstration négative dans les trois figures à la fois : le nombre des moyens termes est toujours limité. |
|
|
§ 1. Il est donc évident que, s'il faut s'arrêter des deux côtés dans la démonstration affirmative, il y aura également des limites dans la démonstration négative. Supposons, en effet, qu'il ne soit possible, ni de remonter à l'infini en partant du dernier terme, et j'appelle dernier terme 83 celui qui n'est lui-même sujet d'aucun terme mais qui en reçoit un autre pour attribut, comme F par exemple, ni de descendre non plus à l'infini en allant du premier au dernier, et j'appelle premier le terme qui est attribué à un autre, sans qu'aucun autre le soit à celui-là ; je dis que, s'il en est ainsi, il y aura limite pour la négation tout aussi bien que pour l'affirmation. § 2. En effet, on démontre le négatif de trois manières : ou bien B est à tout ce à quoi est C, et A n'est à rien de ce à quoi est B; et il faut alors, pour la proposition B C et toujours aussi pour l'un des intervalles, arriver à des termes immédiats; car cet intervalle est attributif. Quant à l'autre, il est évident que si le terme est nié d'un autre ternie antérieur à B, comme par exemple de D, il faudra que celui-ci soit à tout B ; et si c'est d'un terme antérieur à D lui-même qu'il est nié, il faudra que celui-ci encore soit à tout D. Puis donc que cette série s'arrête en bas, elle s'arrêtera tout aussi bien en haut, et l'on atteindra enfin un primitif dont le ternie est nié. § 3. En outre, si B est à tout A et n'est à aucun C, A n'est à aucun C. Pour démontrer ceci, il est évident qu'on pourra employer, soit la manière qu'on vient de dire, soit la manière qu'on indique maintenant, soit enfin la troisième. On a dit la première, on va expliquer la seconde; c'est par elle qu'on démontrerait, en posant par exemple que D est à tout B et n'est à aucun C, si toutefois l'on pose comme nécessaire que quelque terme soit affirmé de B. D'autre part, si l'on peut encore démontrer que D n'est pas à C, un autre terme qui lui-même n'est pas à C sera à D. Puis donc que l'attribution affirmative à un terme supérieur s'arrête toujours, la négation s'arrêtera également. § 4. On se rappelle que la troisième manière avait en quand A est à tout B et que C n'y est pas; C alors c'est pas à tout ce à quoi est A. Cette proposition sera démontrée, ou par les modes indiqués plus haut, ou dans ce même mode. Si l'on prend le premier moyen, la série s'arrête. Si l'on a recours au second, il faudra supposer de nouveau que B est à E auquel C n'est pas tout entier; or, cette dernière proposition sera encore démontrée dans la même figure; et comme on suppose que la série s'arrête aussi en descendant, il est clair qu'il y aura également une limite pour le négatif appliqué à C. § 5. Il est encore évident que si l'on démontre, non par un seul procédé, mais par tous, en empruntant tantôt la première figure, tantôt la seconde ou la troisième, on atteindra toujours une limite, puisque les routes qu'on suit sont elles-mêmes limitées et qu'il faut que des choses limitées prises avec leur limite soient encore limitées dans leur totalité. § 6. On voit donc, en résumé, qu'il y a une limite pour la négation s'il y en a une pour l'affirmation. |
§ 1. S'il faut s'arrêter des deux côtés, dans la série des attributs et dans celle des sujets. - Dans la démonstration affirmative, c'est ce qui sera prouvé au chapitre suivant; ce principe n'est admis ici qu'hypothétiquement. - J'appelle dernier terme, le sujet individuel qui reçoit un attribut sans pouvoir lui-même servir d'attribut à aucun autre terme. - Comme F, par exemple, voir au chapitre précédent, §1. - J'appelle premier terme, l'attribut supérieur qui n'a plus d'attribut au-dessus de lui, mais qui sert lui-même d'attribut aux termes moins étendus que lui. - S'il en est ainsi, hypothèse qui sera démontrée au chapitre suivant et qu'on emploie provisoirement. § 2. De trois manières, une en Celarent dans la première figure, et deux en Cesare et Camestres dans la seconde. - Ou bien B est a tout ce à quoi est C, première figure; syllogisme en Celarent : A n'est à aucun B; or, B est à tout C ; donc A n'est à aucun C - Pour la proposition BC, la mineure qui est affirmative. - Et toujours aussi pour l'un des intervalles, il faut toujours, c'est-à-dire dans toutes les figures, que l'une des propositions au moins soit affirmative, puisque autrement il n'y aurait pas syllogisme. Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 24, § 1. - Car cet intervalle est attributif, affirmatif : et l'on a suppose que, dans les propositions affirmatives, la série n'allait point à l'infini, et qu'on arrivait, soit en remontant, soit en descendant, à des termes immédiats. - Quant à l'autre, la majeure négative. - Si le terme est nié d'un autre terme antérieur, si, dans la majeure: A n'est à aucun B, l'attribut A peut-être nié d'un autre sujet antérieur à B. J'ai ajoute, dans le texte: à B, pour être plus clair; c'est-à-dire, si la proposition A n'est pas immédiate, et qu'il y ait un moyen D, par exemple, entre A et B, il faudra que celui-ci soit à tout B, de sorte qu'on aurait ce nouveau syllogisme : A n'est à aucun D; or, D est à tout B ; donc A n'est à aucun B. - Et si c'est d'un terme antérieur à D lui-même que A est nié, si la majeure négative: A n'est à aucun D, a elle-même un moyen, il faudra de nouveau que A soit nié de ce moyen, et que ce moyen soit affirmé de D, comme D lui-même l'a été de B ; et ainsi de suite en insérant successivement des moyens. Ainsi, toujours la majeure négative entraîne à sa suite une mineure affirmative ; et, comme la série des propositions affirmatives ne va pas à l'infini, il faut nécessairement que celle des propositions négatives n'y aille pas non plus. - S'arrête en bas, dans la mineure. - Tout aussi bien en haut, dans la majeure. - Un primitif dont le terme est nié, on arrivera nécessairement à une proposition négative immédiate, par exemple: A n'est à aucun H. - Jusqu'ici on a démontré seulement dans la première figure que la série des propositions négatives ne pouvait être infinie. On peut croire encore qu'elle le serait dans une autre figure: on va prouver qu'elle ne t'est pas plus dans la seconde que dans la première. § 3. En outre, dans la seconde figure : B est à tout A; or, B n'est à aucun C; donc A n'est à aucun C, syllogisme en Camestres. - Pour démontrer ceci, que dans la mineure la série ne saurait être infinie; il ne s'agit point de la majeure puisqu'elle est affirmative. - La manière qu'on vient de dire, dans le § précédent. - La manière qu'on indique maintenant, dans ce § même. - Soit enfin la troisième, indiquée au § qui suit. - Que D est à tout B, soit, en effet, à démontrer la mineure: B n'est à aucun C, qui est supposée n'être point immédiate, on aura ce nouveau syllogisme en Camestres: D est à tout H; or, D n'est a aucun C; donc B n'est à aucun C. - Que quelque terme soit affirmé de B, si l'on reconnaît que la proposition mineure est médiate, il faut, pour que le nouveau syllogisme soit possible, que le nouveau moyen soit affirmé de B dans la majeure. - Si l'on peut démontrer que D n'ait pas à C, si cette seconde mineure : D n'est à aucun C, est elle-même médiate, le troisième moyen sera affirmé de D dans la majeure, comme D l'était lui-même de B; et ainsi de suite. - Puis donc que l'affirmation, même raisonnement qu'au § précédent. La mineure négative entraîne toujours à sa suite une majeure affirmative; et, comme les affirmations s'arrêtent, il faut bien que les négations corrélatives s'arrêtent aussi. - Aristote ne parle point ici du mode Cesare pour lequel la démonstration serait à peu près la même que pour Camestres. C'est une omission. § 4. On se rappelle, voir les Premiers Analytiques, liv. 1, ch. 6. - La troisième manière, la troisième figure dont il est question Ici, comme dit Zabarella: ad doctrinae abundantiam; en elle n'a rien de démonstratif, puisqu'elle ne donne pas de conclusion universelle. - Quand A est à tout B; voici le syllogisme en Brocardo: C n'est pas à quelque B; or, A est à tout B; donc C n'est pas a quelque A. - Cette proposition, la majeure négative; il ne peut s'agir de la mineure puisqu'elle est affirmative. - Indiqués plus haut, aux §§ 2 et 3. - Ou dans ce même mode, en Brocardo. - Que B est à E, il faudra, en prenant un moyen entre B et C, dans la majeure, faire ce nouveau syllogisme : C n'est pas à quelque E; or, B est à tout E; donc C n'est pas à quelque B. - Cette dernière proposition, cette seconde majeure qui est supposée médiate comme la première. - En descendant, c'est-à-dire, dans la mineure qui est affirmative. § 5. Il est encore évident, on peut admettre que le nombre des moyens est limité dans une seule et même figure, et croire cependant qu'il est infini en passant d'une figure à l'autre pour les syllogismes qu'on doit faire successivement. Aristote va au-devant de cette objection, et il établit que, pas plus dans les trois figures prises ensemble que dans une seule prise à part, le nombre des moyens ne peut être infini; chaque figure est limitée, l'ensemble des figures le sera donc aussi. - Les routes que l'on suit, les trois figures. § 6. S'il y en a une pour l'affirmation, c'est ce qui sera prouvé dans le chapitre suivant et ce qu'on pose ici par hypothèse. |
|
Dans toute proposition affirmative les sujets sont limités comme les attributs; il y a toujours une limite en descendant aussi bien qu'en remontant. Preuves dialectiques de ce principe ; espèces diverses des attributions; l'attribution vraie est l'attribution essentielle; l'accident est toujours dans un sujet autre que lui ; critique de la théorie des idées; il ne peut y avoir d'accident d'accident, parce que l'accident ne peut jamais être sujet, il faut toujours remonter à un sujet primitif ; si les attributs et les sujets étaient infinis, la démonstration serait impossible. Preuves analytiques de ce principe; la démonstration n'emploie que des attributs essentiels; ces attributs sont limités puisqu'ils servent à définir les choses; ils s'arrêtent à la substance, leur sujet primitif; les moyens sont limités aussi, puisqu'on peut unir les extrêmes dans une proposition. |
|
|
§ 1. Qu'il y ait aussi une limite pour les affirmations, c'est ce dont on peut se convaincre, même en n'étudiant cette question que logiquement; en voici la preuve : § 2. Il y a une limite évidemment pour les attributs essentiels. En effet, si d'une part il est possible de définir, en d'autres termes, de connaître ce qu'est une chose; et si d'autre part il est impossible de parcourir l'infini, il faut bien nécessairement que les attributs qui indiquent ce qu'est essentiellement la chose 83a soient en nombre limité. § 3. Mais généralisons ceci. On peut dire, avec vérité, que cet être blanc marche, ou que ce grand objet est du bois; et réciproquement, que le bois est grand et que l'homme marche. Mais il y a grande différence à s'exprimer de l'une ou de l'autre de ces deux façons. En effet, quand je dis que cet objet blanc est du bois, je dis que l'objet qui accidentellement est blanc, est du bois; mais cet objet blanc n'est pas considéré comme sujet du bois; car ce n'est pas en étant blanc ou en étant quelque espèce de blanc, qu'il est devenu bois. Ainsi cet objet n'est pas essentiellement, il n'est que par accident. Au contraire, quand je dis que le bois est blanc, ce n'est pas du tout parce que quelque autre objet blanc existe et qu'il est arrivé à cet objet d'être du bois, comme par exemple, lorsque je dis que le musicien est blanc, je dis que tel homme est blanc, et qu'il lui est arrivé d'être musicien; loin de là, le bois est le sujet qui en outre est devenu blanc, sans être autre chose que ce qu'est le bois, ou une espèce de bois. § 4. S'il nous est permis ici de forger un mot, appelons attribuer cette dernière façon de parler, et nommons l'autre ne pas attribuer du tout, ou du moins attribuer non pas absolument, mais seulement d'une manière accidentelle. Ainsi donc, que tout objet pris comme l'est ici blanc soit ce qui est attribué, et tout objet pris comme l'est ici bois, soit ce à quoi l'on attribue. § 5. Supposons donc que c'est toujours absolument, et non pas par accident, que l'attribut est attribué à la chose dont il est l'attribut; car c'est uniquement par cette attribution absolue que les démonstrations peuvent démontrer. § 6. En effet, c'est toujours par rapport ou à l'essence, ou à la qualité, ou à la quantité, ou à la relation, ou à l'action, ou à la passion, ou au lieu, ou au temps, qu'une chose seule peut être attribuée à une autre seule. § 7. De plus, les attributs qui expriment la substance expriment précisément la chose ou une partie de la chose à laquelle ils sont attribués ; ceux qui n'expriment pas la substance, mais qui sont attribués à un autre sujet qui n'est ni l'attribut ni une partie de l'attribut, sont des accidents, comme, par exemple, le blanc attribué à l'homme; car l'homme n'est ni le blanc ni quelque espèce du blanc, tandis qu'on peut dire qu'il est animal, parce qu'il est une espèce particulière d'animal. § 8. Or, les choses qui n'expriment pas la substance doivent être attribuées à un sujet, et elles ne peuvent être, par exemple, quelque objet blanc qui, sans être autre chose que ce qu'il est, est blanc. Ici d'ailleurs laissons de côté les Idées qui ne sont guère que de vains préludes, et qui, même en supposant qu'elles existent réellement, n'importent en rien à notre sujet; car ce n'est point à des choses de ce genre que s'appliquent les démonstrations. § 9. En outre, à moins que telle chose ne soit la qualité de telle autre, et celle-ci de telle autre encore, c'est-à-dire, à moins qu'il n'y ait qualité de qualité, il est impossible que les choses puissent être ainsi attribuées mutuellement les unes aux autres. Ou peut bien toujours les dire avec vérité, mais l'on ne peut avec vérité les attribuer entre elles. § 10. En effet, les attribuera-t-on comme substance 84; par exemple, comme étant le genre de l'objet, ou bien une différence du genre attribué? § 11. Mais l'on a démontré que les attributs essentiels n'étaient pas infinis, ni en remontant ni en descendant; ainsi, l'homme est bipède, le bipède est animal et l'animal est telle autre chose. Il n'y a pas davantage de série à l'infini pour animal attribué essentiellement à homme, homme à Callias, et Callias à tel individu. Cela tient à ce que l'on peut toujours définir une substance de telle ou telle façon, tandis qu'il n'est pas possible de parcourir intellectuellement l'infini; par conséquent, les termes ici ne sont infinis ni en haut ni en bas, puisqu'il n'est pas possible de définir une substance dont les attributs seraient infinis. § 12. Comme genres, ces termes ne pourront pas davantage être attribués mutuellement les uns aux autres; car alors la chose ne serait qu'une partie d'elle-même. § 13. Mais ni la qualité, ni aucune autre catégorie, ne peuvent pas non plus être attribuées à la qualité ni à aucune autre des catégories, si ce n'est par accident; car les catégories autres que la substance ne sont que des accidents, et elles sont toutes attribuées à la substance. § 14. Du reste, les attributs ne peuvent pas davantage être infinis en remontant. En effet, les attributs de toute chose quelconque sont ce qui exprime la qualité, ou la quantité, ou telle autre espèce analogue; ou bien, ils sont ce qui est compris dans l'essence même de la chose. Or, ces derniers attributs sont limités tout aussi bien que les genres des catégories; car ces genres sont ou qualité, ou quantité, ou relation, ou action, ou passion, ou lieu, ou temps, § 15, en supposant toujours qu'une seule chose est attribuée à une seule autre. § 16. Mais les choses qui ne sont pas des substances ne peuvent être attribuées les unes aux autres, parce qu'elles ne sont que des accidents. Mais il y a des accidents qui sont essentiels, et d'autres accidents qui sont de nature différente. C'est en parlant de tous les accidents que nous disons qu'ils sont toujours attribués à un sujet; et de plus que l'accident n'est pas du tout un sujet; car nous n'admettons pas qu'aucune de ces choses soit dite ce qu'elle est dite sans être encore quelque autre chose; mais elle est elle-même attribuée à une autre, et ces attributs peuvent être différents avec les différents sujets.
§ 17. Ainsi donc, on ne pourra pas dire qu'une chose soit à l'infini
attribuée à une autre, ni en haut ni en bas; car tous les objets
dont les accidents sont les attributs, et qui forment l'essence de
chaque chose, ne sont pas infinis; et en remontant, les accidents ne
sont pas plus infinis que les objets eux-mêmes. Il faut donc
nécessairement qu'il y ait une certaine chose dont une autre chose
soit l'attribut immédiat, de même qu'une autre chose est l'attribut
de celle-là, et que cette série s'arrête. Il faut également qu'il y
ait une certaine chose qui ne puisse plus être attribuée à une chose
antérieure à la première, ni en avoir aucune autre antérieure à
elle-même pour attribut. § 18. Il en est encore une autre, s'il est vrai qu'on puisse démontrer les choses auxquelles d'autres sont attribuées antérieurement. § 19. Et si, pour les choses qui sont démontrables, nous ne pouvons pas être mieux par rapport à elles, que de les savoir, et qu'on ne puisse les savoir que par démonstration; § 20. si de plus, une chose devant être connue au moyen de certaines autres, quand nous ne savons pas ces dernières ou que par rapport à elles nous ne pouvons pas être mieux que si nous les savions, il n'est pas possible non plus de savoir ce que celles-là doivent faire connaître ; § 21. si, en résumé, il est possible de savoir quelque chose par démonstration d'une manière absolue, et non pas seulement d'une manière particulière et hypothétique, il faut conclure que les 84a attributions intermédiaires ont nécessairement une limite; car en supposant qu'elles ne s'arrêtent pas et qu'il y ait toujours un terme supérieur au terme que l'on prend, il s'ensuit que dès lors il y aura démonstration de tout ; et comme on ne peut parcourir l'infini, les choses même dont la démonstration est possible ne pourront pas nous être connues par démonstration. Si donc nous ne pouvons point par rapport à elles être mieux que de les savoir par démonstration, il en résulte qu'il sera impossible de rien connaître par démonstration d'une manière absolue, et qu'on saura uniquement par hypothèse. § 22. C'est donc ainsi qu'on peut se convaincre logiquement du principe posé par nous. § 23. Mais analytiquement, on peut voir plus brièvement encore par ce qui suit, qu'il ne peut y avoir ni en haut ni en bas d'attributs infinis, dans les sciences démonstratives que l'on étudie ici. § 24. D'abord la démonstration ne s'applique qu'aux attributs qui sont essentiels. § 25. Essentiel peut avoir deux sens différents. En premier lieu, les attributs sont essentiels toutes les fois qu'ils sont compris dans la définition essentielle des sujets; et en second lieu, les attributs sont essentiels quand leur définition essentielle comprend leurs propres sujets. Par exemple, relativement au nombre, impair est attribué à nombre, et le nombre lui-même est compris dans la définition de l'impair; et d'une autre part, la pluralité ou la divisibilité est comprise essentiellement dans la définition du nombre. § 26. Pourtant aucune de ces deux attributions ne peut être infinie; et d'abord celle qui attribue l'impair au nombre ; car il faudrait alors qu'il y eût dans l'impair quelque autre terme auquel serait l'impair, tout en le recevant comme attribut; et si cela était, le nombre serait primitivement à ces attributs qui lui appartiendraient. Si donc il ne peut y avoir des attributs à l'infini pour un objet un et limité, il n'y aura pas non plus de série à l'infini en remontant. Mais il faut nécessairement que tous ces termes se rapportent à un primitif, par exemple au nombre, de même que le nombre se rapporte à eux, de telle sorte qu'il y aura réciprocité et que l'un des côtés ne dépassera point l'étendue de l'autre. Mais il n'en est pas moins certain que les termes qui entrent dans la définition essentielle d'une chose ne sont pas en nombre illimité ; car alors on ne pourrait jamais définir quoi que ce soit. § 27. Si donc tous les attributs doivent être regardés comme essentiels, et si ces attributs essentiels ne sont pas infinis, il s'ensuit que pour les attributs il y aura une limite en haut, tout aussi bien qu'il y en aura une en bas. § 28. Ceci admis, il suit encore que les intermédiaires placés entre les deux termes seront aussi toujours en nombre limité. § 29. Et s'il en est ainsi, il n'est pas moins évident que pour les démonstrations il doit y avoir des principes, et qu'il n'y a pas démonstration de tout, opinion soutenue par quelques-uns pour les principes, ainsi que nous l'avons dit; car, s'il y a des principes, il en résulte que toutes choses ne sont pas démontrables, et de plus qu'on ne saurait aller à l'infini. Soutenir l'une ou l'autre de ces deux assertions revient absolument à dire qu'il n'y a pas de proposition immédiate et indivisible, et que toutes les propositions sont divisibles, attendu que c'est en prenant un terme dans l'intérieur de la proposition et non point en dehors, qu'on démontre ce qui est démontré; et que par conséquent, si cette division peut aller à l'infini, il est possible aussi que les moyens placés entre les deux termes soient infinis. Or, c'est là ce qui est impossible, si les attributions 85 s'arrêtent en haut et en bas, et l'on a prouvé qu'elles s'arrêtent, en procédant d'abord d'une manière purement logique, et ici d'une manière analytique. |
§1. Pour les affirmations, j'ai précisé un peu plus que ne le fait le texte; mais le sens me paraît évident, bien que Zabarella ne rapporte pas très nettement ce passage aux propositions affirmatives. Il comprend que tout ceci se rapporte uniquement aux extrêmes dont le nombre ne saurait être infini, sujets ou attributs; mais, comme il s'agit uniquement ici des attributs essentiels, et que ces attributs sont toujours affirmés, il s'ensuit qu'il est bien question des propositions affirmatives; Zabarella semble croire que cette théorie a été achevée dans le chap.19, où elle a été seulement indiquée. - Logiquement, ou dialectiquement, par des raisons extérieures et toutes superficielles. Voir, pour le sens de ce mot qui se représente assez souvent, le Mémoire sur la Logique, t. 2, p. 59 et suiv. § 2. Il est possible de définir, ce que tout le monde accorde. § 3. Mais généralisons ceci, en l'appliquant aux diverses espèces d'attributs qui ne sont pas essentiels. - Il y a une grande différence, dans un cas, en effet, l'attribution est naturelle; car c'est le bois qui est blanc ; c'est l'homme qui marche dans l'autre, elle ne l'est pas; car blanc n'est pas le sujet de bois, il en est au contraire l'attribut; et ce genre d'attribution est contre nature. Voir plus haut, ch. 19, § 5. - Qu'il est devenu bois, c'est au contraire en étant essentiellement du bois qu'il est devenu blanc. - Cet objet, dont on dit qu'il est du bois. - Que le musicien est blanc, trois espèces d'attribution: c'est un accident qui est sujet; c'est un accident qui est attribut. Ainsi donc, il y a trois sortes d'attributions : l'une qui attribue un accident à son sujet, c'est l'attribution naturelle; la seconde qui attribue le sujet à son accident; et la troisième qui attribue un accident à un accident : les deux dernières ne sont pas naturelles. § 4. De forger un mot. Voir le Mémoire sur la Logique, t. 1, p. 99. - Cette dernière façon de parler, l'attribution naturelle. - Non pas absolument, on ne pourra pas dire purement et simplement que ce soit attribuer: il faudra ajouter que c'est attribuer d'une manière accidentelle. - Ce qui est attribué, l'attribut. - Ce à quoi l'on attribue, le sujet. § 5. C'est toujours absolument, c'est toujours de l'attribution absolue ou naturelle qu'il s'agit dans les démonstrations, puisque par elles un veut arriver à la science et à la vérité: les autres espèces d'attributions en sont exclues. § 6. Ou à l'essence ou à la qualité. Voir les Catégories, ch. 5 et suiv. II n'y en a ici que huit de nommés au lieu de dix. - Une chose seule, un seul attribut pour un seul sujet, afin d'éviter l'homonymie. On parlera plus loin d'un seul attribut pour plusieurs sujets. § 7. Les attributs qui expriment la substance, les attributs essentiels sont, ou la chose même à laquelle ils sont attributs, lorsque le sujet et l'attribut sont de même extension ; ou une partie de cette chose, lorsqu'ils ne sont pas de même extension. Ainsi, dans cette proposition : L'homme est un être raisonnable, l'attribut, être raisonnable, exprime l'homme tout entier; car l'attribution est réciproque. Mais dans celle-ci : L'homme est un animal, bien que l'attribution soit essentielle aussi, l'attribut n'exprime qu'une partie de la chose, et le sujet n'est pas tout l'attribut, puisqu'il y a des animaux autres que l'homme, et que homme et animal ne sont pas de même extension. - A un autre sujet, à un sujet autre qu'eux-mêmes, qui n'est ni l'attribut ni une partie de l'attribut qu'il reçoit. - L'homme n'est en réalité ni le blanc, ni une espèce du blanc, ni une partie du blanc : il ne l'est que par accident, et l'attribution est alors accidentelle. - On peut dire qu'il est animal, et l'attribution est essentielle sans être réciproque. § 8. Doivent être attribuées à un sujet, elles ne peuvent être elles-mêmes des sujets. Voir les Catégories, chap. 2, § 2. - Quelque objet blanc, les accidents n'ont pas d'existence propre; ils n'en ont que par les sujets dans lesquels ils sont. - Les idées, la théorie platonicienne des idées. Platon supposait, en effet, que les accidents eux-mêmes, le blanc, par exemple, avaient des Idées existant par elles-mêmes. - De vains préludes, à une science plus réelle. - Car ce n'est point, quelques manuscrits suppriment la négation, et l'édition de Berlin suit cette dernière leçon; si on l'adopte le sens serait : c'est à des choses du genre de celles dont nous venons de parler que s'appliquent les démonstrations. Le sens que j'ai gardé dans le texte me semble plus naturel. § 9. Puissent être ainsi attribués, quand l'attribution est accidentelle, elle ne peut jamais être réciproque. - Les dire avec vérité, l'énonciation n'est pas fausse quand on dit, par exemple : cet objet blanc est un homme; mais l'attribution en réalité n'est pas vraie; car, naturellement, homme ne peut pas être attribué à blanc. - On ne peut avec vérité les attribuer entre elles, parce que, dans la nature, elles ne sont pas attributs l'une de l'autre. § 10. Les attribuera-t-on comme substance, pourra-t-on considérer ces attributs accidentels comme étant le genre du sujet auquel ils sont attribués contre nature, ou bien comme étant une différence du genre qu'on suppose au sujet? Ni de l'une ni l'autre manière, le nombre de ces attributs ne saurait être infini. § 11. L'on a démontré, plus haut, § 2. - L'homme est bipède, limite en remontant d'attribut en attribut. - Est telle autre chose, un genre supérieur au-delà duquel on ne peut remonter. - Il n'y a pas davantage de série à l'infini, limite en descendant de sujet en sujet, jusqu'à l'individu au-dessous duquel on ne peut descendre. - L'on peut toujours définir, principe évident. Voir plus haut, § 2. Ainsi, en admettant que les attributs accidentels puissent être pris comme différences essentielles du sujet, il y aurait une limite pour eux comme il y en a une pour les attributs essentiels. §12. Comme genres, si l'on dit que ces attributs accidentels sont le genre du sujet, ils ne pourront pas davantage être considérés comme attributs essentiels et réciproques ; car alors la chose ne serait qu'une partie d'elle-même, c'est-à-dire que l'espèce, étant assimilée complètement au genre, ne serait qu'une partie d'elle-même, puisqu'elle n'est qu'une partie du genre. § 13. Ne peuvent pas non plus être attribuées, naturellement ; elles ne peuvent l'être qu'accidentellement. § 14. Sont ou ce qui imprime la qualité, attributs accidentels et naturels. - Ils sont ce qui est compris dans l'essence, attributs essentiels. § 15. Une seule chose est attribuée. Voir plus haut, § 6. § 16 Ne peuvent être attribuées, naturellement; car alors ce sont des accidents d'accidents. - Qu'ils sont toujours attribués a un sujet, c'est le caractère général de tous les accidents d'être dans des sujets autres qu'eux-mêmes, en d'autres termes, de n'exister que dans la substance. Voir les Catégories, ch. 2, § 2. - Soit dite ce qu'elle est dite, le blanc, par exemple, n'existe comme blanc que parce qu'il est dans une substance autre que lui-même. - Elle est même attribuée à une autre, elle n'existe point par elle-même parce qu'elle n'est pas substance. § 17. Les objets dont les accidents sont les attributs, les sujets ne sont pas infinis en descendant. - Et en remontant, les accidents, les attributs ne sont pas davantage infinis en remontant. - Une certaine chose dont une autre soit l'attribut immédiat, un sujet dernier qui ait un attribut immédiat, qui a lui-même un attribut, etc. - Il faut également, qu'il y ait un attribut supérieur attribué au sujet primitif qui n'a point d'autre terme avant lui, et cet attribut supérieur n'a pas de terme plus élevé que lut dont il puisse être le sujet. - Le mot d'antérieur, répété ici deux fois, peut faire quelque confusion : appliqué au sujet, il veut dire que le sujet est le premier terme dont on remonte vers les attributs; et appliqué à l'attribut, il veut dire que l'attribut est le premier terme dont en descend sers les sujets. - Et telle est l'une der manières, logiques. Il donnera plus bas, § 23, les arguments analytiques et non plus simplement probables. § 18. Il est encore une autre, seconde raison dialectique. Cette seconde raison se réduit à ceci : La démonstration est possible, et elle est le seul moyen de savoir les choses démontrables ; or l'infinité des moyens termes, si on l'admettait, ou l'infinité des propositions, rend toute démonstration impossible ; donc le nombre des moyens et celui des propositions n'est pas infini. - D'autres sont antérieurement attribuées, c'est-à-dire, s'il est possible de démontrer ses propositions qui ne sont point immédiates, et qui dépendent de principes antérieurs. Zabarella remarque, avec raison, que l'expression d'attribuées n'est pas ici parfaitement exacte, puisqu'il s'agit de propositions et non plus de termes. § 19. Nous ne pouvons pas être mieux par rapport à elles, il y a les choses qu'on sait autrement qat par démonstration, et mieux que par démonstration ; ce sont les principes, et l'on sait les principes mieux que la conclusion qu'on en tire, parce qu'ils sont plus notoires. Voir plus haut, ch. 2, et dans le second livre, ch. 19. § 20. Une chose devant être connue, la conclusion qui doit être comme au moyen des principes. - Quand nous ne savons pas, par démonstration. - Mieux que si nous le savions, en les sachant d'une manière immédiate et intuitive. - Ce que celles-là doivent faire connaître, conclusion qu'on connaît au moyen des prémisses. § 21. Savoir quelque chose par démonstration. Voir, plus haut, les trois premiers chapitres sur les conditions générales de la science et la possibilité de la science par démonstration. - Et hypothétique, d'après l'hypothèse même qu'on a faite dans les prémisses, ce qui n'impliquerait pas qu'on sût réellement. - Les attributions intermédiaires, l'insertion infinie des moyens qui donnent toujours de nouvelles propositions démontrables. - Il y aura démonstration de tout, principe qui a été réfuté plus haut, ch. 3, § 4 et suivant. - Par rapport à elles, par rapport aux choses qui peuvent être sues par démonstration. - Par hypothèse, en effet, on aura admis dans les prémisses des propositions médiates sans les démontrer, bien qu'on les suppose démontrables : les prémisses ne sont doue pas des principes; elles ne sont que des hypothèses, et la conclusion cet par conséquent hypothétique comme elles. § 22. C'est donc ainsi, par les deux motifs purement logiques qu'on vient d'indiquer. § 23. Mais analytiquement, sur le sens de ce mot opposé à logiquement, voir le Mémoire sur la Logique, tom. 2, pag. 60. - Ni en haut, ni en bas, ni en remontant d'attributs en attributs, ni en descendant de sujets en sujets. - Dans les sciences démonstratives, j'ai laissé le sens un peu équivoque du texte; mais je crois qu'il vaudrait mieux dire : dans tous les cas où la science s'obtient par démonstration. § 24. Qu'aux attributs qui sont essentiels, principe déjà posé plus haut, ch. 4. § 25. Essentiels peut avoir deux sens différents. Voir plus haut, ch. 4, § 4, où essentiel reçoit plus de deux sens; mais Aristote ne considère ici que les deux principaux. - En premier lieu, il y a deux sortes d'attribut essentiel : 1° celui qui est compris dans la définition essentielle du sujet ; 2° celui qui comprend la définition essentielle de son sujet dans sa propre définition. - Impair est attribué à nombre, impair est un attribut de la seconde espèce : car la définition essentielle d'impair comprend l'idée même de nombre. - Et d'une autre part, la pluralité ou la divisibilité sont des attributs de la première espèce, parce qu'elles sont comprises essentiellement dans l'idée même de nombre. § 26. Aucun de ces deux attributions, soit de la première, soit de la seconde espèce. - Celle qui attribue l'impair au nombre, attribution de la seconde espèce. - Quelque autre terme auquel serait l'impair, si la série allait à l'infini, il faudrait qu'impair fût avec un autre terme dans le rapport même où nombre est arec lui : Impair serait donc contenu dans la définition de ce terme, comme nombre est contenu dans celle d'impair qui en est l'attribut. - Le nombre serait primitivement, le nombre serait le sujet primitif auquel se rapporteraient tous ces attributs successifs en nombre infini. Il en résulterait que pour objet un et limité, comme nombre, par exemple, il y aurait une infinité d'attributs à comprendre dans sa définition : ce qui rendrait la définition absolument impossible. - A l'infini en remontant, d'attributs en attributs. - Il faut nécessairement, pour qu'il y ait définitive, que le défini et la définition soient d'égale extension, et qu'ils puissent être pris réciproquement l'un pour l'autre. § 27. Si donc tous tes attributs, qu'on fait entrer dans la démonstration. - Une limite en haut, en allant du sujet à l'attribut. - Une en bas, en allant de l'attribut au sujet. § 28. Les intermédiaires, les moyens termes seront limités aussi; car, s'ils étaient infinis, on ne pourrait jamais unir les deux termes qu'ils sépareraient toujours. § 29. Ainsi que nous l'avons dit, plus haut, ch. 3. - Et indivisible, c'est-à-dire entre les deux termes de laquelle on ne peut pas insérer de moyen. - Dans l'intérieur de la proposition, lorsqu'on veut prouver que l'attribut est au sujet, on prend un moyen terme qui est moins large que le premier et plus large que le second ; et l'on descend alors des prémisses aux conclusions, le syllogisme est en Barbara. - En haut et en bas, dans les attributs et dans les sujets. - D'abord, du § 2 au § 18 |
|
Une même chose peut être attribuée immédiatement, non pas uniquement à une seule, mais à plusieurs; autrement, il faudrait admettre que le nombre des moyens termes pourrait être infini. - Il y a toujours autant de démonstrations qu'il y a de moyens. Principe général pour remonter des propositions médiates aux propositions immédiates, soit affirmatives, soit négatives : insérer entre les deux extrêmes autant de moyens qu'il y en aura, en ayant soin de toujours prendre pour moyens des attributs essentiels ; les propositions deviennent de moins en moins larges, et elles arrivent à l'indivisible, c'est-à-dire, à l'immédiat. - Application de ce principe aux syllogismes affirmatifs de la première figure, aux syllogismes négatifs de cette même figure, aux syllogismes de la seconde, et enfin aux syllogismes de la troisième. |
|
|
§ 1. Ceci démontré, il est clair que si une seule et même chose est attribuée à deux termes, par exemple A à C et à D, quand l'un de ces termes n'est pas attribué à l'autre, soit pas du tout, soit du moins non universellement, la première chose ne sera pas toujours attribuée aux deux autres suivant quelque moyen terme qui leur soit commun. § 2. Ainsi, l'isocèle et le scalène ont cette propriété que les angles en sont égaux à deux droits, relativement à quelque terme commun qui est à l'un et à l'antre; en effet, ils ont cet attribut en tant qu'ils sont rus et l'autre une certaine figure, et non point en tant qu'ils sont autre chose. Mais il n'en est pas toujours ainsi. § 3. Soit par exemple B, suivant lequel A est à C D, qu'il soit évident que B aussi est à C et à D selon quelque autre moyen terme commun aux deux, et celui-ci selon quelque autre terme encore, de sorte qu'entre deux termes il y ait une série infinie de termes intermédiaires. Mais cela est impossible; donc une seule et même chose peut être attribuée à plusieurs, sans qu'il y ait nécessité que ce soit par quelque terme commun, puisque les intervalles doivent être immédiats. § 4. Cependant, si le moyen commun est un attribut essentiel, il faut nécessairement que les termes soient dans un même genre et tiré des mêmes indivisibles; car on se rappelle que les démonstrations ne peuvent passer d'un genre à un autre. § 5. Il est en outre évident que A étant à B, s'il y a quelque moyen terme entre eux, il est alors possible de prouver par démonstration que A est à B; et les éléments de cette démonstration sont précisément les moyens termes et sont aussi nombreux qu'eux. C'est qu'en effet les propositions immédiates sont toutes des éléments de démonstration, ou du moins toutes celles qui sont universelles; sans terme moyen, il n'y a plus de démonstration, parce que dès lors on est parvenu jusqu'aux principes eux-mêmes. § 6. Et de même encore, A n'étant pas à B, s'il y a entre eux un terme moyen, ou bien un terme antérieur à B, auquel A ne soit pas, la démonstration est possible; autrement, elle ne peut pas avoir lieu. § 7. Mais il y a toujours autant de principes et d'éléments de démonstration qu'il y a de termes moyens; car les propositions que forment ces termes sont les principes de la démonstration. § 8. Ainsi, de même qu'il y a certains principes indémontrables qui affirment que telle chose est telle chose, et qu'une chose est attribuée à une autre; tout de même il y a des principes indémontrables qui affirment que telle chose n'est pas telle chose et qu'une chose n'est pas attribuée à une autre. Ainsi donc, parmi les principes, les uns affirmeront que la chose est telle chose, et les autres qu'elle n'est pas telle chose.
§ 9. Quand on veut démontrer quelque chose de B, il faut prendre un
terme qui soit attribué primitivement à B, C par exemple, et auquel
A soit attribué au même titre, et en procédant toujours ainsi, la
proposition non plus que l'attribut, n'est jamais prise en dehors de
A dans les démonstrations; mais l'intervalle se condense de plus en
plus, jusqu'à ce que les propositions soient devenues indivisibles
et qu'elles se réduisent à l'unité. Or, il n'y a unité que lorsqu'on
arrive à l'immédiat, et qu'il n'y a plus qu'une proposition
absolument une, en d'autres termes une proposition immédiate. Et de
même que dans tout le reste, le principe ici est une chose simple,
ce qui n'empêche pas que le principe ne varie pour tous les genres ;
par exemple pour le poids, le principe c'est la mine; c'est le dièze
pour le chant, et telle autre unité dans telle autre espèce de
choses. De même dans le syllogisme, l'unité
85a est la proposition immédiate : dans la démonstration et dans
la science, c'est l'entendement. § 10. Dans les syllogismes privatifs de la première figure, le moyen terme ne tombe jamais en dehors de la proposition qui est affirmée; dans ce syllogisme par exemple où A n'est pas à B par C. Si en effet C est à tout B, A n'est à aucun C; mais s'il faut démontrer en outre que A n'est à aucun C, on doit prendre encore un moyen terme entre A et C, et l'on continuera toujours ainsi. § 11. Mais s'il faut démontrer que D n'est pas à E parce que C est à tout D et qu'il n'est à aucun E, ou du moins qu'il n'est pas à tout E, dans ce cas, le terme moyen ne tombera jamais en dehors de E; et c'est précisément à ce dernier terme que l'attribut doit ne pas être. § 12. Dans la troisième figure, le moyen terme ne peut jamais tomber ni en dehors du terme dont un autre doit être nié, ni en dehors de celui qui doit être nié. |
§ 1. Que si une seule et même chose est attribuée, il a restreint, plus haut, la théorie au cas où l'attribut et le sujet sont uniques, chapitre précédent, § 6; il l'étend ici au cas où, l'attribut étant unique, les sujets dont il est démontré sont deux on plusieurs; et il prouve que, dans ce second cas comme dans l'autre, le nombre des moyens termes ne saurait être infini. - Quand l'un de ces termes n'est pas attribué à l'autre, quand l'un de ces termes n'est pas le genre de l'autre; car si l'un des termes est genre et l'autre espèce, l'attribut ne sera jamais à l'espèce que mediatement, par l'intermédiaire du genre. - Ne sera pas toujours attribuée, elle pourra être quelquefois attribuée à un ou plusieurs ternies immédiatement et sans l'intermédiaire d'un autre moyen terme commun aux sujets. § 2. Ainsi l'isocèle, exemple où l'attribut est aux deux sujets par un terme moyen commun à l'un et à l'autre. - Relativement à quelque terme commun, le terme commun, c'est le triangle. - Ils ont cet attribut, d'avoir les trois angles égaux à deux droits. - Une certaine figure, en triangle. - Il n'en est pas toujours ainsi, c'est-à-dire, l'attribut, au lieu d'être médiat, peut aussi être immédiat. § 3. Soit par exemple B, l'exposition n'est pas ici très nette : il faut comprendre que c'est une objection que se fait Aristote, et qu'il y répond, ce que le texte n'indique pas assez clairement. - Cela est impossible, ainsi qu'on l'a prouvé plus haut, ch. 22. - Les intervalles doivent être immédiats, il faut en effet arriver à des propositions immédiates, puisque la série ne peut être infinie. - Quelques manuscrits ont : infinis, ou médiats, au lieu d'immédiats; ce second sens est moins naturel que le premier, et je l'ai rejeté; ce serait alors une conséquente absurde qu'indiquerait Aristote et qu'il repousserait au nom de ses théories antérieures. § 4. Est un attribut essentiel, comme il doit toujours l'être dans la démonstration qui ne considère que les attributs de ce genre. - Des mêmes indivisibles, c'est-à-dire des mêmes principes immédiats. Pacius a lu : des mêmes classes, des mêmes catégories, sans indiquer d'où il tire cette leçon. - On se rappelle. Voir plus haut, ch. 7. § 5. S'il y a quelque terme entre eux, la proposition est démontrable du moment qu'il y a un terme moyen entre le sujet et l'attribut. - Et les éléments de cette démonstration, les principes, en d'autres termes, les majeures indémontrables d'où sortent le syllogisme et la conclusion. - Des éléments de démonstration, des principes. - Qui sont universelles, il n'y a que les propositions universelles qui puissent servir à la démonstration. Voir plus haut, ch. 4 et 6. - Il n'y a plus de démonstration, la proposition étant immédiate est évidente par elle-même et indémontrable. § 6. Et de même encore, même remarque pour la proposition négative immédiate. - Un terme antérieur à B, c'est-à-dire plus étendu que B, qui soit le genre de B. - Auquel A ne soit pas, majeure indémontrable du syllogisme qui a pour conclusion : A n'est pas à B. - Elle ne peut pas avoir lieu, parce que la proposition est immédiate. § 7. De principes et d'éléments, expressions identiques. § 8. Qui affirment que telle chose n'est pas telle chose, en d'autres termes, il y a des propositions immédiates négatives tout comme il y a des propositions immédiates affirmatives. § 9. Quand on veut démontrer, règle générale pour passer des propositions médiates aux propositions immédiates, et remonter jusqu'aux principes. C'est à cette règle qu'aboutissent toutes tes théories antérieures, depuis le ch. 10 inclusivement. - Attribué primitivement à B, Il tant entendre ici primitivement, dans le sens d'essentiellement, comme le remarque Zabarella, et non dans le sens d'immédiatement. En effet, s'il y a plusieurs moyens au lieu d'un, le premier moyen ne peut être Immédiatement sujet du majeur; de plus, si le moyen n'est pas essentiel, c'est-à-dire, s'il sort du genre des extrêmes, les propositions, loin de se condenser, ne font que s'élargir et s'étendre indéfiniment. Du moment, au contraire, que tous les moyens sont essentiels, on remonte toujours d'espèces en espèces vers le genre supérieur, qui est l'attribut immédiat de la dernière espèce. La proposition s'est resserrée de plus en plus à partir du premier moyen ; et elle est enfin devenue indivisible, c'est-à-dire immédiate. Voilà comment Aristote peut dire que, même dans les figures autres que la première, le moyen ne tombe pas en dehors des extrêmes; il y tombe certainement sous le rapport de la forme, puisqu'il est ou attribut ou sujet des deux ; mais il n'y tombe pas sous le rapport de l'essence. - En procédant toujours ainsi, en prenant toujours le nouveau moyen tel qu'il soit attribut essentiel du terme précédent et sujet essentiel du terme qui suit. - En dehors de A, en dehors du genre supérieur auquel il s'agit de rattacher le premier sujet par une suite de moyens essentiels. - Dans les démonstrations successives que l'on fait pour arriver à la conclusion finale. - Se condense de plus en plus, parce que l'espace qui sépare le premier sujet du dernier attribut se resserre de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne indivisible: ce qui a lieu quand la proposition à laquelle on parvient est immédiate. - C'est le dièze pour le chant, le dièze on le demi-ton est considéré ici comme le plus petit intervalle musical que l'oreille puisse saisir. - Dans le syllogisme, ajoutez: démonstratif. - Dans la démonstration et dans la science, c'est-à-dire dans la science acquise par démonstration. - C'est l'entendement, qui est le principe, l'unité pour la science, qui se multiplie et se répète en quelque sorte à chaque connaissance qu'il acquiert. - Ne tombe jamais en dehors des extrêmes, ratione materiae, comme disait la scholastique; c'est-à-dire que le moyen terme doit toujours être essentiel. § 10. Dans les syllogismes privatifs, après avoir montré comment on peut résoudre la proposition médiate affirmative en ses principes, et remonter jusqu'à la proposition immédiate, il reste à voir comment cette méthode peut être appliquée aussi à la proposition médiate négative. - 1° Première figure, en dehors de la proposition qui est affirmée, c'est ce qu'on vient de prouver pour les proposition affirmatives; et ici c'est la mineure. - Dans ce syllogisme, A n'est à aucun C; or C est à tout B; donc A n'est à aucun B, en Celarent. - S'il faut démontrer en outre que A n'est à aucun C, c'est-à-dire, la majeure qui est négative. - On doit prendre encore, comme on l'a indiqué plus haut, pour les propositions affirmatives. - Un moyen terme entre A et C, qui soit essentiellement cause que A n'est pas à C. Quant à la mineure affirmative, elle serait démontrée comme on l'a indiqué au § précédent. § 11. Mais s'il faut démontrer, 2° seconde figure : voici le syllogisme en Camestres : C est à tout D; or C n'est à aucun E; donc D n'est à aucun E. - Ou du moins qu'il n'est pas à tout E, mode en Festino ou en Baroco, dont Aristote aurait pu ne pas parler, non plus que de la troisième figure, puisqu'il ne s'agit dans la démonstration que de propositions universelles. - Que l'attribut doit ne pas être, c'est-à-dire E est le sujet; ainsi le moyen terme devra être pris ici dans le genre même du sujet ; et il ne devra point tomber en dehors de la proposition mineure. § 12. Dans la troisième figure, 3° troisième figure : le moyen ne devra jamais être ni en dehors du sujet, ni en dehors de l'attribut. Pour la mineure affirmative, il sera démontré par la première figure; pour la mineure négative, par la première ou la seconde. - Du terme dont un autre est nié, le sujet, soit en Ferison, soit en Brocardo. - Celui qui doit être nié, l'attribut. |
|
SECTION CINQUIÈME. DES DIVERSES ESPÈCES DE LA DÉMONSTRATION ET DE LA SCIENCE. La démonstration universelle est supérieure à la démonstration particulière. Position de la question. - Raisons apparentes en faveur de la démonstration particulière; elle fait plus savoir que la démonstration universelle; elle s'applique davantage à la réalité puisque l'universel n'a rien de réel ; elle ne trompe pas puisqu'elle ne fait croire qu'à ce qui est. Réponse à ces différentes raisons. Raisons diverses de la supériorité de la démonstration universelle : l'universel est plus cause que le particulier; la dé monstration universelle s'applique aux choses qui ne relèvent que d'elles-mêmes et n'en ont point une autre pour cause; les cas particuliers étant infinis sont insaisissables; la démonstration universelle fait savoir plus de choses que la démonstration particulière; plus le moyen est universel, plus il est principe; et la démonstration universelle est la plus rapprochée du principe et de l'immédiat ; l'universel renferme le particulier en puissance, et la réciproque n'est pas vraie; l'universel se rapporte à l'entendement, l'individuel ne se rapporte qu'à la sensibilité. Conclusion pour la démonstration universelle. |
|
|
§ 1. Comme la démonstration est d'une part universelle ou particulière, et d'autre part affirmative ou privative, on peut se demander quelle est la meilleure; et l'on peut encore se faire cette même question, soit pour la démonstration qu'on peut appeler ostensive, soit pour celle qui conduit à l'absurde. Examinons d'abord la question pour la démonstration universelle et la démonstration particulière. Ceci une fois expliqué, nous parlerons de la démonstration dite ostensive, et de celle qui conduit à l'absurde. § 2. On pourrait donc croire tout d'abord que la démonstration particulière est meilleure, et voici comment: c'est si la démonstration qui nous fait savoir mieux est une démonstration meilleure, faire savoir étant le vrai mérite d'une démonstration ; et si nous savons mieux une chose quand nous la savons en elle-même que quand nous la savons par une autre qu'elle; comme par exemple nous savons mieux Coriscus musicien, quand nous savons que Coriscus est musicien que quand nous savons que l'homme est musicien, et ainsi du reste. Or, la démonstration universelle nous fait seulement savoir qu'une chose autre que celle dont il s'agit possède la qualité qu'on étudie, et non point que la chose même la possède; et par exemple que l'isocèle a ses trois angles égaux à deux droits, non pas en tant qu'isocèle mais en tant que triangle; tandis qu'au contraire la démonstration particulière démontre la propriété pour la chose elle-même. Si la démonstration appliquée à l'objet même doit être regardée comme meilleure, et que la démonstration particulière s'applique à l'objet même plus que la démonstration universelle, il s'ensuivrait que la démonstration particulière serait préférable. § 3. Ajoutons encore ceci : si l'universel n'existe pas indépendamment du particulier; si la démonstration donne à croire que la chose dont elle démontre existe bien réellement et répond à une certaine nature spéciale parmi les êtres; par exemple, que le triangle existe indépendamment des triangles particuliers, que la figure existe indépendamment des figures particulières, que le nombre existe indépendamment des nombres particuliers; si la démonstration qui s'applique à ce qui est, est meilleure que celle qui s'applique à ce qui n'est pas; si la démonstration qui ne nous trompe pas est meilleure que celle qui nous trompe ; si la démonstration universelle est bien de cette dernière espèce, car on n'y démontre que par la méthode qu'on emploie pour le proportionnel, en prouvant que ce qui est de telle espèce est proportionnel, sans être cependant ni ligne, ni nombre, ni solide, ni surface, mais quelqu'autre objet indépendant de tous ceux-là ; si donc la démonstration universelle est plus de ce genre, et si enfin elle s'applique moins à ce qui est que la particulière et qu'elle donne une idée fausse, il s'ensuivrait que la démonstration universelle serait inférieure à la démonstration particulière. § 4. Mais d'abord, le premier argument s'applique autant à la démonstration universelle qu'à la particulière. Sans aucun doute, si avoir ses angles égaux à deux angles droits appartient à l'objet, non pas en tant qu'isocèle, mais en tant que triangle, celui qui sait simplement que c'est en tant qu'isocèle que l'objet a cette propriété, sait moins la chose en elle-même que celui qui sait que c'est en tant que triangle. Au fond, si l'on n'établit pas que c'est en tant que triangle, et qu'on prétende pourtant démontrer, il n'y a pas de véritable démonstration; il n'y en a que si l'on a établi que c'est en tant que triangle. Celui qui sait une chose en tant qu'elle est ce qu'elle est, en sait toujours davantage; mais si triangle est un terme plus étendu qu'isocèle; si de plus la définition est bien la même, l'objet n'étant pas triangle, par une simple homonymie; et si enfin, avoir la somme de ses angles égale à deux angles droits est une propriété commune à tout triangle, comme le triangle a cette propriété de ses angles non pas en tant qu'isocèle, mais qu'au contraire l'isocèle n'a cette propriété qu'en tant que triangle, il en résulte que celui qui sait universellement sait plus comment la chose est, que celui qui ne sait que le particulier. Par conséquent aussi, la démonstration universelle vaut mieux que la particulière. § 5. En outre, si l'universel est bien réellement une idée une et distincte, et s'il n'est pas une simple homonymie, loin d'exister moins réellement que certaines choses particulières, il existera tout au contraire davantage, d'autant plus que les choses impérissables sont parmi les universaux, et que les choses particulières sont bien plus périssables. § 6. En outre, il n'y a aucune nécessité de supposer que l'universel soit quelque chose indépendamment des choses particulières, parce qu'il exprime une chose distincte; pas plus qu'il ne faut le supposer pour les autres choses qui n'expriment pas une substance, mais qui expriment seulement une qualité, ou une relation, ou une action. Si donc l'on fait une supposition de ce genre, ce n'est pas la démonstration qui en est cause, c'est l'auditeur seul qui la fait. § 7. En outre, si la démonstration est le syllogisme de la cause et du pourquoi de la chose, l'universel est cause plutôt que le particulier; car la chose à laquelle quelque attribut est essentiellement, est pour elle-même cause de cet attribut; or l'universel est le primitif; donc il est cause; donc aussi, la démonstration universelle est supérieure, car elle est bien plus relative à la cause et au pourquoi. § 8. En outre, nous cherchons toujours le pourquoi de la chose, croyant ne pas la savoir jusqu'à ce que nous soyons arrivés à ce point que cette chose se fasse ou existe sans l'intermédiaire d'une autre; et alors nous avons atteint le but et la fin dernière de notre recherche. Par exemple, pourquoi un tel est-il venu? Pour recevoir de l'argent; et pourquoi a-t–il reçu de l'argent? pour rendre ce qu'il devait; et pourquoi a-t-il rendu ce qu'il devait? pour ne pas faire mal. Lorsque de proche en proche, nous sommes ainsi parvenus à une chose qui n'est plus par le moyen d'une autre chose, non plus que pour une autre chose, nous disons que c'est pour cela comme but final qu'un tel est venu; ou bien que la chose se fait ou qu'elle est : et nous pensons alors savoir le mieux possible pourquoi un tel est venu. S'il en est de même de toutes les causes et de tous les pourquoi, et si c'est de cette manière que nous connaissons le mieux les choses, toutes les fois que nous en connaissons la cause finale, il s'ensuit que pour tous les autres cas aussi nous savons le mieux la chose, alors qu'elle n'est plus parce qu'une autre chose est. Lors donc que nous savons que les angles externes sont égaux à quatre droits parce que le triangle est isoscèle, il reste encore à savoir pourquoi l'isocèle a cette propriété. C'est que le triangle la possède; et le triangle la possède parce que la figure rectiligne la possède aussi; et si cette figure ne la possède plus par quelque autre chose, alors nous savons le plus possible. Or alors, nous savons universellement: donc la démonstration universelle est meilleure. § 9. En outre, plus Ies choses sont particulières, plus elles tombent dans l'infini; et plus elles sont universelles, plus elles se rapprochent du simple et de la limite. En tant qu'infinies on ne peut pas les savoir; on ne peut les savoir qu'en tant qu'elles sont limitées . On peut donc les savoir plus quand elles sont universelles que quand elles sont particulières. Donc aussi les choses universelles sont plus démontrables; et plus les choses sont démontrables, plus la démonstration s'y applique, les relatifs s'accroissant toujours simultanément. Donc la démonstration qui est plus universelle est meilleure, puisqu'elle est aussi plus démonstration. § 10. En outre, il faut préférer la démonstration qui fait savoir la chose et une autre chose encore, à celle qui ne fait savoir que la chose uniquement; or, quand on sait l'universel on sait aussi le particulier, tandis qu'on peut savoir le particulier sans savoir pour cela l'universel. Donc, encore à cet égard, la démonstration universelle est préférable. § 11. Enfin on peut ajouter cette autre preuve : Il est possible de savoir davantage l'universel parce qu'on le démontre par un moyen qui est plus rapproché du principe; or, le plus rapproché c'est l'immédiat, et l'immédiat, c'est le principe. § 12. Si donc la démonstration qui vient du principe est supérieure à celle qui n'en vient pas, et si la démonstration qui vient plus du principe l'est plus que celle qui en vient moins; la démonstration universelle venant plus du principe, la démonstration universelle est meilleure. Par exemple, s'il fallait démontrer que A est à D, les moyens étant B C, B est le terme supérieur; donc la démonstration qui a lieu par ce terme est plus universelle. § 13. Parmi les raisons qu'on vient d'énumérer quelques-unes sont purement logiques. § 14. Mais ce qui rend bien évidente la supériorité de la démonstration universelle, c'est que quand de deux propositions on sait la supérieure, on sait aussi en quelque façon la proposition inférieure, et on la possède en puissance. Par exemple, quand l'on sait que tout triangle a ses angles égaux à deux droits, on sait aussi en quelque façon que l'isocèle a ses angles égaux à deux droits; et on le sait en puissance, sans même savoir que l'isocèle est un triangle. Celui, au contraire, qui n'a que cette dernière proposition, ne sait absolument en rien l'universel, ni en puissance ni en réalité. § 15. La proposition universelle est toute d'entendement; la proposition particulière n'aboutit qu'à la sensation. § 16. Tels sont donc tous les motifs qui nous font placer la démonstration universelle au-dessus de la démonstration particulière. |
§ 1. Universelle ou particulière,
il faut se rappeler ce qui a été dit plus haut, ch. 4, § 9, sur le sens
d'universel dans la démonstration. - Qu'on peut appeler ostensive, j'ai pris le terme scholastique, ostensive, comme je l'ai déjà fait dans les Prem. Analytiques. Le texte dit : démonstration démonstrative. Voir la théorie de la réduction à l'absurde, et la comparaison de celle démonstration avec la démonstration ostensive, Prem. Analytiques, liv. II, ch. 11, 12, 13 et 14. - Examinons d'abord, dans ce chapitre même il sera question de la démonstratlon afflrmative, de la négative au ch. 25, et de la démonstration ostensive et de celle par l'absurde, au ch. 26. § 2. Que la démonstration particulière est meilleure, premier argument en faveur de la démonstration particulière : 1°Elle fait mieux savoir, en faisant savoir directement la chose. § 3. Ajoutons encore ceci, deux arguments nouveaux en faveur de la démonstration particulière : 2°elle s'adresse à l'être, au particulier, et non au non-être, à l'universel qui n'est rien en dehors du particulier; 3° elle ne nous trompe point, en nous faisant croire, comme la démonstration universelle, à ce qui n'existe pas.
- Pour le proportionnel, voir plus haut, ch. 5, § 4. § 4. Mais d'abord..., réfutation du premier argument. - Autant à la démonstration universelle, c'est-à-dire, la démonstration universelle fait mieux savoir que la particulière, et, à ce titre, il faut lui donner la préférence. - Il n'y a pas de véritable démonstration, parce qu'elle n'est pas universelle, et que toute véritable démonstration doit l'être. - Mais si triangle est un terme plus étendu, règle pour discerner le primitif, le sujet universel du sujet particulier; trois conditions sont nécessaires: 1° que ce sujet soit plus étendu ; 2° que ce sujet reçoive la même définition réellement, et non par simple homonymie; 3° enfin, que l'attribut dont il s'agit s'applique à ce sujet tout entier. - Comment la chose est, l'essence propre de la chose. § 5. En outre, si l'universel..., réfutation du second argument: l'universel existe plus que le particulier; car certaines choses particulières périssent, et l'universel ne périt pas. § 6. En outre, il n'y a aucune nécessité, réfutation du troisième argument. L'universel ne trompe pas; il n'est pas besoin qu'il soit indépendant réellement du particulier. Cette supposition erronée n'appartient qu'a celui qui la fait. - C'est l'auditeur, pour qui la démonstration est faite. § 7. Si la démonstration est le syllogisme de la cause, premier argument en faveur de la démonstration universelle. - Or, l'universel est le primitif, et, à ce titre, il renferme en lui-même, essentiellement, l'attribut, et il est cause de cet attribut. § 8. Nous cherchons toujours le pourquoi, second arguments en faveur de la démonstration universelle; elle fait connaître la cause des choses. - Les angles externes sont égaux à quatre droits, les angles faits sur un côté quelconque d'une figure rectiligne par les deux côtés adjacents prolongés, sont toujours égaux à quatre droits, parce qu'une ligue droite coupée par une autre ligne droite fait toujours d'un même côté deux angles égaux à deux droits, et quatre si elle est coupée par deux lignes au lieu d'une, etc. - Or, alors nous savons universellement, parce qu'on est remonté jusqu'au sujet primitif de l'attribut. § 9. Plus les choses sont particulières, troisième argument en faveur de la démonstration universelle : le particulier est l'infini qu'on ne peut ni parcourir, ni savoir: l'universel est l'unité même qu'on peut plus aisément savoir. - Les relatifs s'accroissent toujours simultanément, les relatifs ici sont le démontrable et la démonstration. Plus une chose est démontrable, plus la démonstration en est démonstration. Zabarella et tous les commentateurs ont remarqué que cet argument était dialectique, et non plus analytique, tiré de principes généraux, et non des principes propres de la démonstration comme les deux premiers. § 10. Il faut préférer, quatrième argument dialectique, et commun comme le précédent. - On sait aussi le particulier, ou plus exactement: quelque cas particulier, parce que l'universel ne peut pas être connu sans un ou plusieurs cas particuliers. Sur le rapport de l'universel au particulier, voir, plus haut, ch. 1, §§ 6, 7, 8, 9, et, plus bas, dans ce chapitre, § 14. § 11. Enfin, on peut ajouter, cinquième et dernier argument pour la démonstration universelle. Celui-ci est analytique comme les deux premiers. - Le plus rapproché de l'immédiat, l'expression n'est pas très exacte: l'immédiat n'est pas le plus rapproché du principe, c'est le principe même, comme le dit ensuite Aristote. § 12. Qui vient du principe, c'est-à-dire, formée de propositions immédiates. § 13. Purement logiques, ou dialectiques, la troisième et la quatrième. § 14. Ce qui rend bien évidente, cette raison qu'on pourrait regarder comme la sixième en faveur de la démonstration universelle, semble se confondre avec la quatrième ; mais, dans la quatrième, Aristote cherchait à établir qu'on ne pouvait connaîtra l'universel sans connaître antérieurement un ou plusieurs cas particuliers. Ici, il montre que quand on connaît l'universel, on connaît aussi de quelque façon, c'est-à-dire en puissance, tous les cas particuliers. § 15. Toute d'entendement, voir, à la fin du liv. II, ch. 19, quel est le rôle de l'entendement. § 16. Résumé de tout ce chapitre: conclusion en faveur de la démonstration universelle, qui est la seule vraiment scientifique, la seule vraie démonstration. |
|
La démonstration affirmative vaut mieux que la démonstration négative : 1° Parce qu'elle a besoin d'un plus petit nombre d'éléments ; 2 °Parce qu'elle n'a pas besoin de la démonstration négative, tandis que celle-ci ne peut se passer d'elle; car le syllogisme négatif emploie des propositions affirmatives, tandis que l'affirmatif n'emploie pas de propositions négatives; 3° Parce qu'en développant la démonstration affirmative, on prouve la majeure par deux affirmatives, tandis que la preuve de la majeure dans la démonstration négative exige une négative et une affirmative; 4° Parce que le principe de la démonstration affirmative est supérieur ; car la proposition universelle immédiate y est affirmative, tandis que dans la démonstration négative, elle est négative; 5° Parce que la démonstration affirmative joue le rôle de principe à l'égard de la démonstration négative. |
|
|
§ 1. Que la démonstration ostensive soit supérieure à la démonstration privative, voici ce qui le prouve : § 2. Admettons d'abord que toutes conditions restant d'ailleurs égales, la démonstration la meilleure est celle qui se tire d'un moindre nombre, ou de postulats, ou d'hypothèses, ou de propositions. En effet, les propositions étant également connues, c'est par les moins nombreuses qu'on pourra connaître plus vite; et cela est préférable. Or, pour justifier cette assertion que la démonstration qui vient de moins de termes, est meilleure, en entendant ceci d'une manière générale, on peut remarquer que si les moyens sont également connus, les premiers le seront toujours davantage. Soit démontré par B, C, D, cette conclusion que A est à E, et par F G cette même conclusion que A est à E; il y a du reste parité entre ces conclusions que A est à D et que A est à E; mais cette conclusion que A est à D est antérieure à celle-ci que A est à E; et elle est plus connue qu'elle, car c'est par A D qu'on démontre A E; et ce par quoi l'on démontre est encore plus croyable que le démontré. Donc la démonstration qui se fait en moins de termes est aussi préférable, toutes les autres conditions restant d'ailleurs les mêmes. Ainsi les deux démonstrations affirmative et négative démontrent bien également l'une et l'autre par trois termes et par deux propositions: mais la première suppose que certaine chose est, et l'autre que certaine chose est et que certaine chose n'est pas. Donc, cette dernière a besoin de plus de termes; donc elle est moins bonne. § 3. En outre, il a été démontré que quand les deux propositions sont privatives, il ne peut y avoir de syllogisme, et qu'il faut, pour que le syllogisme ait lieu, que l'une soit de cette espèce, et que l'autre soit affirmative. On peut encore ajouter à ceci, qu'à mesure que la démonstration prend du développement, les propositions affirmatives deviennent nécessairement plus nombreuses, tandis qu'il est impossible que dans aucun syllogisme il y ait plus d'une privative. En effet, supposons que A ne soit à aucune des choses auxquelles est B, et que B soit à tout C. Pour accroître le nombre des propositions, il faut intercaler un moyen; soit D moyen de A B, et E de B C. Il est évident qu'alors E est affirmatif, et que D affirmatif relativement à B est privatif relativement à A; car il faut que D soit à tout B, et que A ne soit à aucun D. Ainsi donc il n'y a qu'une seule proposition privative, et c'est A D. Le résultat serait aussi le même pour les autres syllogismes; car toujours le moyen des termes affirmatifs est affirmatif dans ces deux rapports; et pour le privatif, il faut nécessairement que le moyen soit privatif dans l'un des deux, de sorte qu'il n'y a que cette seule proposition qui soit de ce genre tandis que les autres sont affirmatives. § 4. Or, si la chose par laquelle on démontre est plus connue et plus croyable que le démontré, et si la démonstration négative est démontrée par l'affirmative sans que celle-ci le soit par l'autre, il s'ensuit qu'étant antérieure, plus notoire et plus croyable, elle est aussi la meilleure. § 5. De plus, comme le principe du syllogisme est la proposition universelle immédiate, et que la proposition universelle est affirmative dans la démonstration ostensive, et négative clans la démonstration privative; comme en outre l'affirmative est antérieure à la négative, et plus connue qu'elle, attendu que la négation n'est connue que par l'affirmation, et que l'affirmation est antérieure comme l'être l'est au non-être, il en résulte que le principe de la démonstration ostensive est meilleur que celui de la privative ; et celle qui emploie de meilleurs principes est aussi meilleure. § 6. Enfin, on peut dire que la démonstration affirmative est encore celle qui ressemble plus à un principe; car la démonstration négative n'existe pas sans la démonstration ostensive. |
§ 1. Démonstration ostensive, ou plutôt affirmative. § 2. Toutes conditions restant d'ailleurs égales, c'est-à-dire, les propositions étant de part et d'autre également vraies, également connues. - Ou de postulats, ou d'hypothéses, voir, pour la définition de ces mots, ch. 9, § 13 et suiv. - En entendant ceci d'une manière générale, c'est-à-dire en comprenant que les termes sont moins nombreux, soit sous le rapport même du nombre, soit sous le rapport de l'espèce, comme il est indiqué plus bas. - Les premiers, ceux qui sont le plus rapprochés de la proposition immédiate. - Soit démontré, il y a ici deux conclusions, l'une qui s'obtient par trois termes moyens, et l'autre par deux seulement. - Que A est à D, dans la série où les moyens sont B, C, au nombre de deux, comme dans l'autre, où A est à E, les moyens sont F, G. Ainsi, de part et d'autre, il n'y a que deux moyens; mais, dans le premier cas, les deux moyens sont plus près du principe; dans le second, ils en sont plus éloignés. - A celle-ci que A est à E, par les trois moyens B, C, D. - C'est par AD qu'on démontre AE, il faut en effet, dans cette série, passer par AD avant d'arriver à AE; car on démontre d'abord A de C par B, A de D par C, puis enfin A de E par D. - Ce par quoi l'on démontre, la proposition AD. - Que le démontré, la conclusion AE. - A besoin de plus de termes, les termes ne sont pas plus nombreux, comme Aristote l'a entendu un peu plus haut; seulement ils sont d'espèces différentes; cela revient à dire que, dans la démonstration affirmative, l'espèce des propositions est unique, puisque toutes deux sont affirmatives; et que, dans la démonstration négative, il y a deux espèces de propositions, puisque l'une des deux est affirmative, et l'autre négative. Donc la négative exige plus d'éléments. § 3. Il a été démontré, ch. 24, § 1. Second argument en faveur de la démonstration affirmative: elle da pas besoin de la négative, tandis que la négative a besoin d'elle. - On peut encore ajouter, Zabarella distingue, avec raison, ce troisième argument du second, malgré l'avis de Philopon, suivi en cela par Pacius. Cet argument ne doit passe se confondre avec le précédent en ce qu'il s'agit ici non plus d'une démonstration simple mais d'une démonstration composée. - A mesure que la démonstration prend du développement, par des prosyllogismes nécessaires à la démonstration particulière de chacune des propositions du syllogisme initial. - Plus d'une privative nouvelle: ainsi, le nombre des affirmatives s'accroît de deux, et celui des négatives d'une seulement. - Pour accroître le nombre des propositions, et faire les prosyllogismes. Voici le premier syllogisme : A n'est à aucun B ; or B est à tout C ; donc A n'est à aucun C, en Celarent. Si l'on doit démontrer par des prosyllogismes la majeure et la mineure, on aura, pour la majeure négative AB: A n'est à aucun D ; or D est à tout B ; donc A n'est à aucun B ; et, pour la mineure affirmative BC: B est à tout E; or E est à tout C; donc B est à tout C. - Qu'alors E est affirmatif, dans les deux propositions; tandis que D ne l'est que dans une seule, et qu'il est négatif dans l'autre. - Qu'une seule proposition privative, c'est la majeure AD du prosyllogisme. Ainsi, dans l'accroisssement de la démonstration, il y a toujours trois affirmatives contre une négative. - Pour les autres syllogismes, ou mieux prosyllogismes, s'il fallait plusieurs prosyllogismes au lieu d'un seul pour prouver les prémisses du syllogisme initial. - Le moyen des termes afflrmatifs, ou mieux des propositions affirmatives. - Dans ses deux rapports, avec les deux termes de la proposition initiale. - Dans l'un des deux, soit dans la majeure, soit dans la mineure. § 4. Résumé des arguments qui précèdent en faveur de la démonstration affirmative qui est supérieure à la négative. § 5. De plus, quatrième argument: la proposition affirmative part de principes meilleurs, donc elle est meilleure que la négative. - Démonstration ostensive, ou mieux affirmative. - L'affirmative est antérieure à la négative. Voir Herméneia, ch. 14. § 6. Enfin, on peut dire..., cinquième argument pour la démonstration affirmative. - Elle ressemble plus à un principe, relativement à la démonstration négative qui ne peut prouver, sans avoir recours à elle, ses propositions affirmatives. |
|
La démonstration affirmative est meilleure que la démonstration par l'absurde; car la démonstration négative est meilleure que celle-ci, et la démonstration affirmative est meilleure que la négative. La démonstration négative vaut mieux que la démonstration par l'absurde; exemptes et différences de ces deux démonstrations; la démonstration négative part des propositions pour arriver à la conclusion ; la démonstration par l'absurde part au contraire de la conclusion pour arriver à ta proposition. - La démonstration négative est supérieure, parce que les principes dont elle est tirée sont supérieurs. |
|
|
§ 1. Par cela même que la démonstration affirmative est au-dessus de la négative, il est évident qu'elle est supérieure aussi à celle qui conduit à l'absurde. § 2. Mais voyons quelle est la différence de la privative et de celle qui procède par réduction à l'absurde. § 3. Soit donc supposé que A n'est à aucun B, et que B est à tout C, donc nécessairement A n'est à aucun C. Avec des termes ainsi disposés, la démonstration négative que A n'est pas à C est ostensive. Maintenant voici comment est faite celle qui conduit à l'absurde. S'il faut démontrer que A n'est pas à B, elle doit supposer qu'il y est, et que B est à C, de sorte qu'on conclut que A est à C. Mais admettons qu'il soit accordé et bien connu que c'est là une chose absurde. Donc il n'est pas possible que A soit à B: donc, si l'on accorde que B est à C, il est impossible que A soit à B. § 4. Ainsi donc les termes sont disposés dans la démonstration par l'absurde, tout comme ils le sont dans la démonstration ostensive. § 5. L'important c'est de savoir si la proposition privative A n'est pas à B, est plus connue que l'absurdité de cette conclusion : A n'est pas à C. Lorsque c'est la conclusion fausse qui est plus connue, la démonstration par l'absurde se produit; lorsque c'est, au contraire, la proposition négative du syllogisme, c'est la démonstration ostensive qui a lieu. § 6. Mais, en nature, cette négation que A n'est pas à B est antérieure à celle-ci que A n'est pas à C, attendu que ce dont on tire la conclusion est antérieur à la conclusion même. Or, la conclusion, c'est que A n'est pas à C, et cette proposition que A n'est pas à B est ce dont on tire la conclusion. § 7. Car ce n'est pas la proposition qu'on peut détruire qui devient la conclusion, tandis que les autres termes deviennent les propositions par lesquelles on conclut; mais ce dont on tire la conclusion, c'est le syllogisme qui est composé de telle sorte qu'il y ait entre les termes ou le rapport du tout à la partie, ou de la partie au tout; mais les propositions A C et A B ne sont pas dans ce rapport entre elles. § 8. Si donc la démonstration tirée de choses plus notoires et antérieures est préférable, et si les deux démonstrations sont croyables en partant toutes deux d'une négation, comme l'une vient d'un terme antérieur, et l'autre d'un terme postérieur, il s'ensuit que la démonstration privative est d'une manière absolue meilleure que celle qui conduit à l'absurde. § 9. Donc encore, si la démonstration affirmative est meilleure que la négative, évidemment aussi elle est meilleure que la démonstration par l'absurde. |
§ 1. Il est évident, c'est ce qui sera démontré dans ce chapitre. § 2. Mais voyons quelle est la différence. Voir la comparaison des deux démonstrations. Prem. Analytiques, liv. Il, ch. 14. § 3. Soit donc supposé, voici le premier syllogisme : A n'est à aucun B; or B est à tout C; donc A n'est aucun C, en Celarent. Pour prouver cette conclusive par l'absurde, on prend la contraire de cette conclusion pour mineure, et l'on a nécessairement, dans un nouveau syllogisme en Cesare : A n'est à aucun B ; or A est à tout C ; donc B n'est aucun C; mais on avait admis, dans la mineure précédente, que B est à tout C ; donc cette dernière conclusion est absurde ; donc la nouvelle mineure A est à tout C est fausse; donc, enfin, sa contraire: A n'est à aucun C, est vraie; et c'est la première conclusion qui se trouve alors démontrée par l'absurde. - S'il faut démontrer que A n'est pas à B, conclusion à prouver par l'absurde. - Elle doit supposer qu'il y est, dans la majeure ; et alors on a ce syllogisme : A est à tout B; or B est à tout C ; donc A est à tout C. - C'est là une chose absurde, c'est-à-dire que A soit à tout C. - Il n'est pas possible que A soit à B, c'est-à-dire la majeure est fausse. Zabarella dit: que A soit à C; B n'indique pas où il a pris cette leçon, qui pourrait aussi être adoptée. Ni les manuscrits, ni aucune édition, ne la donnent. § 4. Tout comme ils le sont, c'est-à-dire que le syllogisme par l'absurde se forme, tout aussi bien que l'ostensif, d'après les modes et les figures régulières, bien que le mode et la figure varient de l'un à l'autre. Voir premiers Analytiques, liv. II, ch. 2 et suiv. § 5. L'important c'est de savoir, comparaison des deux démonstrations. - Si la proposition privative A. n'est pas à B, voici le syllogisme : A n'est pas à B; or B est à tout C; donc A n'est pas à C. Si c'est la majeure qui est plus connue, on procède par la démonstration ostensive; si l'on connaît, au contraire, davantage l'absurdité de la conclusion, on en prend l'opposée, et on procède par l'absurde. § 6. En nature, d'après la nature même du syllogisme, aussi bien qu'en réalité, la majeure précède toujours la conclusion. - Cette négation que A n'est pas à B, majeure. - Celle-ci que A n'est pas à B, mineure. - Est ce dont on tire la conclusion, puisque c'est la majeure, qui contient en puissance la mineure et la conclusion. § 7. Car ce n'est pas la proposition, réponse à une objection qu'on pourrait faire à la théorie précédente. On peut dire, en effet, que la démonstration par l'absurde procède, comme la démonstration ostensive, des termes antérieurs aux termes postérieurs. Non, répond Aristote, car ce n'est pas la proposition qu'on peut détruire, la majeure : A n'est pas à B, qui devient la conclusion proprement dite; car la majeure ne peut jamais avec vérité devenir la conclusion, tandis que la conclusion même qui en a été tirée deviendrait prémisse relativement à elle. - Mais les propositions AC et AB, dans le nouveau syllogisme par l'absurde: donc le syllogisme par l'absurde part d'un terme postérieur, tandis que le syllogisme ostensif part d'un terme antérieur. § 8. Les deux démonstrations, ostensive négative, et par réduction à l'absurde. § 9. Conclusion des deux chapitres précédents. |
|
Une science est supérieure à une autre science: 1° Quand elle réunit à la fois la démonstration de l'existence du sujet et la démonstration de sa cause; 2° Quand son sujet est plus abstrait; 3° Quand son sujet est plus simple et exige un moindre nombre de notions. |
|
|
§ 1. Une science est plus exacte et plus élevée qu'une autre science, quand elle sait à la fois et l'existence de la chose et la cause de la chose, c'est-à-dire, quand la science qui démontre que la chose est, n'est pas séparée de celle qui connaît pourquoi elle est. § 2. De plus, la science qui n'a pas de sujet sensible est au-dessus de celle qui en a un, comme par exemple l'arithmétique, qui est au-dessus de la musique. § 3. La science qui vient d'un moindre nombre d'éléments est supérieure à celle qui a besoin d'adjonctions, et c'est ainsi que l'arithmétique vaut mieux que la géométrie. Quand je dis adjonction, j'entends, par exemple, que l'unité arithmétique est une substance qui n'a point de position, tandis qu'au contraire, le point en géométrie est une substance qui a une position; et je dis alors que la géométrie a besoin d'une adjonction. |
§ 1. Une science, il faut entendre ici ce mot dans l'acception restreinte, aussi bien qui. dans l'acception complète. Les principes exposés dans ce chapitre sont vrais, soit d'une conclusion spéciale obtenue par démonstration scientifique, soit de la totalité des conclusions qui constituent une science proprement dite: l'arithmétique ou la géométrie. - L'existence de la chose et la cause, Aristote distingue donc deux espèces de démonstrations, ou de sciences : l'une, qui fait connaître l'effet et la cause de, l'effet ; l'autre, qui ne donne que l'effet. C'est à tort que quelques commentateurs, et Averroès entre autres, ont distingué une troisième espèce de démonstration, qui ne fait savoir que la cause ; mais il est impossible qu'on sache pourquoi une chose est sans savoir aussi que cette chose est. § 2. De sujet sensible, j'ai ajouté sensible afin d'être clair : le texte dit seulement de sujet. - Par exemple l'arithmétique, en effet, le sujet de l'arithmétique, qui est le nombre, n'est pas perceptible aux sens; il est seulement connu par l'entendement. § 3. Qui a besoin d'adjonction, c'est-à-dire dont le sujet n'est pas simple. Ainsi, l'unité sujet de l'arithmétique est plus simple que le point, et le nombre plus simple que l'étendue ; car le point suppose l'unité, et l'étendue suppose le nombre ; de plus, le point ne peut être connu qu'avec l'idée de position; l'unité n'a pas besoin de l'adjonction de cette idée. - Est une substance qui n'a point de position, substance en tant qu'elle est le sujet de l'arithmétique, comme le point est substance en tant qu'il est le sujet de la géométrie; en réalité, le nombre et le point sont des quantités, c'est-à-dire des accidents de la substance, et non des substances. Voir les Catégories, chap. 6, §§ 11 et 14. Il est facile de voir comment ce chapitre se rattache à toutes le théories précédentes: après avoir comparé les démonstrations entre elles, Aristote compare les sciences qu'elles fournissent, et il classe les sciences comme il a classé les démonstrations. |
|
Unité de la science; il n'y a qu'une seule et même science pour les objets composés des mêmes principes, et qui sont ou parties ou modifications essentielles de ces principes.
Diversité de la science : il y a sciences distinctes, quand les objets ont des
principes différents qui ne rentrent pas les uns dans les autres. |
|
|
§ 1. Une science une, une science d'un seul genre, est celle qui se forme de primitifs et de tout ce qui en est, soit une partie, soit une modification essentielle. § 2. Une science est distincte d'une autre science toutes les fois que les objets de ces sciences ont des principes qui ne viennent ni des mêmes origines, ni les uns des autres. § 3. La preuve de ceci, c'est que, quand on pousse jusqu'aux éléments indémontrables, il faut que ces éléments soient du même genre que les conclusions qu'ils servent à démontrer. § 4. Et une autre preuve encore, c'est que les conclusions démontrées par les indémontrables sont du même genre qu'eux, et leur sont homogènes. |
§ 1. Une science une, est celle qui comprend un seul genre, en comprenant d'ailleurs dans le genre ses parties, c'est-à-dire, ses espèces et ses attributs essentiels. - Soit une partie, en d'autres termes, une espèce. - Soit une modification essentielle, en d'autres termes, un attribut essentiel. § 2. Une science est distincte, diversité des sciences : les sciences sont diverses quand leurs genres sont différents. - Ni des mêmes origines, quand les principes spéciaux de deux sciences ne se rattachent pas aux principes d'une science supérieure, dont les deux premières ne sont que des espèces. - Ni les uns des autres, quand les sciences ne sont pas subordonnées entre elles. § 3. Du même genre que les conclusions, Voir plus haut, ch. 7. §.4 Les conclusions... Sont du même genre, id., ibid. |
|
Une seule et même conclusion peut être démontrée de plusieurs manières ; et les moyens termes peuvent être dans la même série, sans y être continus, ou dans des séries différentes. Exemple d'une même conclusion démontrée par des termes moyens appartenant à des séries opposées; seulement, il faut toujours que l'un de ces moyens puisse être attribué à l'autre. Cette règle est vraie pour toutes les figures du syllogisme. |
|
|
§ 1. ll peut y avoir plusieurs démonstrations d'une seule et même conclusion, non pas seulement en puisant dans une même classe un moyen qui ne serait pas continu, par exemple, C et D et F, moyens de A B. § 2. Mais aussi en empruntant un moyen à une autre classe. Soit par exemple A changer, D être ému, B avoir du plaisir et G être calmé. Il est vrai d'attribuer D à B, et A à D. En effet, tout homme qui a du plaisir est ému, et ce qui est ému éprouve un certain changement. D'autre part, il est vrai d'attribuer A à C et G à B, car tout homme qui a du plaisir est calmé, et celui qui est calmé éprouve aussi un changement. On voit donc par là que le syllogisme peut avoir lieu par des moyens termes différents et qui ne sont pas d'une même classe, non pas cependant jusqu'à ce point qu'aucun des moyens puisse n'être attribué à aucun autre; car il faut nécessairement que tous deux soient à la fois à quelque terme commun. § 3. Il faudrait encore examiner dans les autres figures de combien de manières l'on peut obtenir une même conclusion par syllogisme. |
§ 1. Il peut y avoir plusieurs démonstrations, par les effets, mais non par la cause, comme on le prouvera plus loin, liv. II, ch. 16 et 17. - Une même classe, une même série où les moyens termes sont subordonnés les uns aux autres. - Un moyen qui ne soit pas continu, c'est-à-dire qui ne soit pas la cause immédiate de l'attribut; auquel cas il serait continu au grand extrême. § 2. En empruntant un moyen à une autre classe, à une série dont les moyens ne soient pas subordonnés à ceux de la première. - Être ému..., être calmé, Aristote choisit, avec intention, des moyens opposés l'un à l'autre, pour mieux indiquer la différence des classes auxquelles ils appartiennent. - En effet tout homme qui a du plaisir, premier syllogisme : Tout ce qui est ému éprouve un changement; or tout ce qui a du plaisir est ému ; donc tout ce qui a da plaisir éprouve un changement. - D'autre part, second syllogisme : Tout es qui est calmé éprouve un changement; or tout ce qui a du plaisir est calmé ; donc tout ce qui a du plaisir éprouve un changement. - Puisse n'être attribué à aucun autre, il faut que l'un soit attribué, au moins particulièrement, à l'autre, puisque tous deux, dans les mineures, sont attribués à un même sujet: ce dernier syllogisme serait alors en Darapti. - Soit à la fois à quelque terme commun, ici le terme commun est: or tout ce qui a du plaisir. § 3. Dans les autres figures, les conclusions seraient multipliées, non plus sous le rapport de la matière, comme dans le § précédent, mais sous le rapport de la forme, dans les divers modes des diverses figures. |
|
Il n'y a pas de démonstration pour les choses qui ne dépendent que du hasard. Le hasard n'est ni nécessaire, ni même habituel; les propositions qui le concernent ne peuvent donc entrer ni dans le syllogisme ni dans la démonstration. |
|
|
§ I. Il n'y a pas de science par démonstration pour ce qui ne dépend que du hasard; car ce qui ne dépend que du hasard ne peut être considéré, ni comme nécessaire ni comme arrivant le plus habituellement. Loin de là, c'est ce qui arrive contrairement à l'un et à l'autre. Or, la démonstration ne peut s'appliquer qu'à l'un ou l'autre de ces deux modes d'existence. Tout syllogisme en effet se forme, soit de propositions nécessaires, soit de propositions qui sont le plus habituellement vraies. Quand les propositions sont nécessaires, la conclusion est nécessaire comme elles; si elles ne sont que le plus habituellement vraies, la conclusion a aussi ce caractère. Il en résulte donc que, si le fortuit n'est ni le plus habituel ni nécessaire, il n'y a pas de démonstration pour lui. |
§ 1. Il n'y a pas de science, il a été prouvé, plus haut, ch. 8, que la démonstration ne s'appliquait qu'aux choses éternelles; les choses fortuites, accidentelles, ne peuvent donc pas être démontrées. - Ne peut s'appliquer qu'à l'un ou l'autre de ces deux modes d'existence, il est difficile de concilier ceci avec les principes du ch. 8; mais la démonstration du plus habituel est celle qui s'applique aux faits naturels qui pourraient ne pas être. Quelques commentateurs ont compris cette phrase du texte en ce sens que la démonstration ne peut s'appliquer qu'à un seul de ces deux modes d'existence, c'est-à-dire au nécessaire ; le texte peut se prêter à cette interprétation, mais je crois devoir la rejeter parce qu'elle est contredite par la fin même de ce chapitre. Il faut donc admettre qu'Aristote étend un peu le sens qu'il a donné au mot démonstration, et qu'il élargit les principes antérieurement posés. Ce chapitre, non plus que le suivant, ne tient pas intimement à ce qui précède; il se rattache seulement à l'ensemble du la théorie de la démonstration. |
|
La science démonstrative ne peut s'acquérir par la sensation ; la sensation est toujours limitée et ne peut donner l'universel, sans lequel il n'y a pas de démonstration possible. - La connaissance sensible ne peut jamais tenir lieu. de la démonstration ; exemples. - La sensation sert à préparer la démonstration parce qu'elle sert à former l'universel. -- La supériorité de l'universel tient à ce qu'il fait connaître; la cause. - C'est l'imperfection des sensations qui souvent nous empoche de savoir ; exemple tiré de la transparence des verres. |
|
|
§ 1. La science ne s'acquiert pas non plus par la sensation ; car, bien que la sensation se rapporte à telle qualité générale et non pas seulement à tel objet particulier, il n'y en a pas moins nécessité de sentir une chose spéciale, et dans tel lieu et dans tel moment. Mais ce qui est universel, ce qui est à tous les objets, ne peut pas absolument être senti, puisque l'universel n'est pas une chose spéciale, et qu'il n'est pas à tel moment;., car alors il ne serait plus l'universel, puisque nous n'appelons universel que ce qui est toujours et partout. § 2. Puis donc que les démonstrations sont universelles et qu'on ne peut sentir l'universel, il est évident qu'on ne peut pas non plus acquérir la science par la sensation. § 3. Bien plus, il est évident que, quand bien même il nous serait possible de sentir que le triangle a ses trois angles égaux à deux droits, nous en chercherions encore une démonstration, et que nous ne saurions pas, ainsi que l'affirment quelques-uns. Ce sont nécessairement des choses particulières qu'atteint la sensation, mais il n'y a de science que quand on connaît l'universel. § 4. Voilà ce qui fait que si nous étions au-dessus de la lune et que nous vissions la terre opposée à ce corps, nous ne saurions pas du tout la cause de l'éclipse; nous sentirions bien qu'actuellement la lune est éclipsée, mais nous ne saurions pas pourquoi elle l'est; car la sensation, avons-nous dit, ne s'applique pas à l'universel. § 5. Ce qui n'empêcherait pas que, voyant ce phénomène se répéter souvent, nous ne pussions, en cherchant l'universel, arriver à la démonstration; car l'universel se forme évidemment de la réunion de plusieurs cas particuliers. § 6. Mais le grand mérite de l'universel, c'est de faire connaître la cause. Aussi, dans les choses qui ont une autre chose pour cause, la notion universelle est fort au-dessus des sensations et de la pensée; mais pour les primitifs, la manière de les connaître est toute différente. § 7. Il est donc évident qu'il est impossible par la sensation de savoir rien de ce qui est démontrable, à moins qu'on ne veuille confondre sentir et avoir la scient par démonstration. § 8. Du reste, parmi les questions, il en est quelques-unes qui ne peuvent être attribuées qu'à l'imperfection même de la sensation. En effet, il suffirait de voir certaines choses pour que nous n'eussions plus rien à chercher, non pas que nous eussions la science par ce seul que nous aurions vu, mais parce qu'il nous aura suffi de voir pour obtenir l'universel. Ainsi, par exemple, si nous voyions le verre troué par la lumière qui passerait à travers, nous saurions évidemment alors pourquoi il y a clarté, parce que, voyant ce phénomène se répéter sur chaque verre en particulier, nous saurions en même temps qu'il en est de même pour tous les autres verres sans exception. |
§ 1. La science, ajoutez démonstrative, car la sensation donne une espèce de science qui est l'origine ou l'occasion de toutes les autres. Voir, plus bas, § 5, et, à la fin du second livre, ch. 19, le rôle de la sensation dans l'acquisition des principes. -- Le sens se rapporte, il faut remarquer ici la différence que met Aristote entre le sens et sentir. Le sens est la faculté de sentir, sentir est l'acte même sinus lequel s'exerce cette faculté : la première est générale, le second est toujours particulier. - Telle qualité générale, j'ai ajouté générale, pour être plus clair. - Tel objet particulier, j'ai ajouté particulier. Ainsi la vue s'applique à la couleur, l'ouïe au son, etc. - Nécessité de sentir, chaque sensation n'en est pas moins particulière, bien que la faculté de sentir soit générale. - L'universel n'est pas une chose spéciale, puisqu'il est dans tous les objets particuliers, individuels. - Et partout, où sont les objets individuels, particuliers. § 2. Acquérir la science, ajoutez: démonstrative. § 3. Nous chercherions encore une démonstration, c'est-à-dire, une conclusion universelle. Nous aurions encore à apprendre que tous les triangles, sans exception, ont ta somme de leurs angles égaux à deux droits; la sensation nous dirait seulement que tel triangle jouit de cette propriété. - Nous ne saurions pas, ajoutez: universellement. - Ainsi que l'affirment quelques-uns, Zabarella et Pacius croient qu'il s'agit ici de l'école d'Héraclite, je ne sais sur quelle autorité. Thémistius, Pbilopon, Averroès n'en disent rien; et dans ce qui nous reste de la doctrine d'Héraclite, rien n'autorise directement cette conjecture. Je penserais plutôt qu'il s'agit des sophistes. § 4. Voilà ce qui fait, autre exemple analogue au premier. La sensation nous indiquerait bien le fait de l'éclipse ; mais nous ne saurions pas la cause universelle de l'éclipse prise d'une manière générale. - La sensation, l'acte même par lequel on sent un objet spécial, individuel, et non la faculté générale de sentir qui s'applique aussi à l'universel. Voir plus haut, § 1, et, plus loin, liv. II, ch. 2, § 4. § 5. L'universel se forme évidemment, voir la fin du second livre. § 6. Le grand mérite de l'universel, de la science démonstrative et universelle, c'est-à-dire, faisant centralise tout le sujet. - La notion universelle, la science par démonstration universelle. - De la pensée, par la pensée, il faut entendre la notion universelle d'une chose sans la notion de la cause de cette chose. - Pour les primitifs, pour les principes. Voir la fin du second livre. § 7. Confondre sentir et avoir la science, comme dans l'exemple du § 3. § 8. Non pas que nous eussions la science démonstrative. - Il suffirait de voir, plusieurs faits particuliers pour en conclure le fait universel, ou la cause. - Si nous voyions le verre troué, ceci se rapporte à l'opinion de quelques philosophes qui ne nous sont pas connus, sur la transparence du verre. La lumière, disaient-ils, composée de particules très ténues, traverse le verre qui est poreux, et de là la transparent Aristote répond : Si nous pouvions voir les pores du verre, et les particules de la lumière les traverse nous saurions évidemment la cause de la clarté pour chaque cas particulier; et, en répétant l'observation, nous arriverions à la notion universelle, à la cause; mais nos sens sont imparfaits, nous ne pouvons apercevoir les pores du verre et c'est là ce qui fait que nous cherchons la cause de la transparence |
|
Diversité des principes. - Les principes ne sont pas les mêmes pour tous les syllogismes ; 1° Les uns sont vrais, les autres sont faux comme les conclusions qu'ils forment ; 2° Tous les principes faux ne sont pas même semblables entre eux ; 3° Les principes vrais ne le sont pas davantage; les principes propres de chaque science ne se ressemblent pas ; 4° Les principes communs ne suffisent pas à la démonstration, il faut en outre les principes propres; 5° Les principes sont à peu près aussi nombreux et aussi différents que les démonstrations, et elles sont infinies; 6° Les principes diffèrent entre eux, car les uns sont contingents et les autres nécessaires. Solutions fausses de la question : on ne peut pas dire que les principes sont identiques en ce sens qu'ils restent identiques à eux-mêmes pour chaque science spéciale; on ne peut pas dire non plus que tout se démontre indistinctement par des principes quelconques, car chaque science a un principe qui lui est propre et qu'exprime une seule proposition immédiate; on ne peut pas dire enfin que tous les principes sont du mente genre, et qu'ils ne diffèrent qu'en espèce. Solution vraie; les principes doivent se distinguer en principes communs à toutes les démonstrations qui ne seraient point sans eux, et en principes propres à chaque démonstration. |
|
|
§ 1. Il est impossible que les principes soient les mêmes pour tous les syllogismes, et cela se voit d'abord rien que logiquement. En effet, parmi les syllogismes, les uns sont vrais et les autres sont faux; et quoiqu'on puisse tirer une conclusion vraie de propositions fausses, toutefois, dans ce cas, il ne peut y avoir que cette seule proposition de vraie. Par exemple, si A est vrai de C, il faut que le moyen B soit faux, car alors ni A n'est à B, ni A n'est à C. Et si l'on prend des moyens pour prouver ces propositions, il faudra que les nouvelles propositions soient fausses aussi, parce que toute conclusion fausse ne peut venir que de propositions fausses. Au contraire, de deux propositions vraies, on ne peut tirer qu'une conclusion vraie; et ainsi les conclusions vraies et les conclusions fausses sont toutes différentes. § 2. En outre, les conclusions fausses ne viennent pas toujours de principes semblables entre eux; car on peut considérer comme fausses, et celles qui sont contraires à elles-mêmes, et celles qui ne peuvent coexister, comme, par exemple, quand on dit que la justice est l'injustice ou la lâcheté; que l'homme est cheval ou boeuf; ou bien que l'homme est plus grand ou plus petit. § 3. Voici comment d'après les règles posées plus haut pour la démonstration, on peut prouver que les principes ne sont pas les mêmes pour tous les syllogismes. D'abord les principes de toutes les conclusions vraies ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de choses dont les principes diffèrent en genre et ne s'accordent point entre eux; ainsi, les unités ne s'accordent pas avec les points, puisque les premières n'ont pas de position tandis que les autres en ont une. Pour que les principes soient identiques, il faut toujours que les propositions s'accordent soit dans les moyens, soit en haut, soit en bas, ou bien que parmi leurs termes elles aient les uns en dedans, et les autres en dehors, des extrêmes. § 4. Mais même parmi les principes communs, il n'est pas possible qu'il y en ait quelques-uns dont on tire la démonstration de tout le reste. J'appelle principes communs des principes tels que celui-ci : Pour toute chose il faut affirmer ou nier. C'est qu'en effet les genres des choses sont différents; les uns ne sont applicables qu'aux quantités, les autres ne le sont qu'aux qualités, et l'on fait les démonstrations à l'aide de ces genres joints aux principes communs. § 5. De plus, les principes sont à peu prés aussi nombreux que les conclusions ; car les principes sont précisément les propositions elles-mêmes, et les propositions se forment, soit en ajoutant un terme, soit en intercalant un moyen. § 6. En outre, les conclusions sont infinies, mais les termes moyens sont limités. § 7. Enfin parmi les principes, les uns sont nécessaires, les autres sont contingents. § 8. En examinant ainsi la question, on voit donc qu'il est impossible que les principes soient les mêmes, puisque les principes seraient limités tandis que les conclusions ne le sont pas. § 9. Si l'on soutient qu'à un autre point de vue les principes sont les mêmes, et que seulement les uns sont de géométrie, les autres d'arithmétique, d'autres de médecine, cela ne revient-il pas précisément à dire qu'il y a des principes spéciaux pour chaque science? Car il serait ridicule de les appeler identiques parce qu'ils seraient identiques à eux-mêmes; dans ce sens-là, toutes choses sont identiques. § 10. D'autre part, soutenir qu'on peut toujours démontrer une chose quelconque avec tous les principes indistinctement, ce n'est plus rechercher si les principes sont identiques pour toutes choses; c'est là une assertion par trop naïve; car cela ne se présente ni dans les sciences proprement dites, ni dans l'analyse, où cela est également impossible. C'est qu'en effet les propositions immédiates sont les principes; et, pour obtenir une conclusion différente, il faut ajouter une autre proposition immédiate. § 11. Si l'on prétend que les premières propositions immédiates sont précisément les principes identiques, on peut répondre qu'il n'y en a qu'une seule dans chaque genre. § 12. Mais, s'il est également impossible, et qu'on démontre par tous les principes indistinctement une conclusion quelconque, comme il le faudrait pourtant et que les principes soient tellement différents qu'ils soient différents pour chaque science, reste uniquement que les principes de toutes les conclusions soient homogènes, et qu'on démontre telle conclusion pour tel principe, et telles autres conclusions par tels autres principes. Mais évidemment cela même n'est pas possible; car il a été démontré que les principes sont différents en genre pour les choses différentes en genre. Mais les principes sont de deux espèces; ce sont d'abord les principes dont on tire la démonstration, et ensuite l'objet auquel elle s'applique. Les principes dont on tire la démonstration sont les principes communs; et les objets auxquels elle s'applique sont les principes propres, tels que le nombre et la grandeur |
§ 1. Rien que logiquement, voir plus haut, ch. 23, §§ 22 et 23. - Une conclusion vraie de propositions fausses, Prem. Analytiques, liv. Il, ch. 2, 3, 4. - Que cette seule proposition de vraie, c'est-à-dire, la conclusion ; et. tous les prosyllogismes qu'on pourrait faire pour prouver les prémisses seraient toujours composés de propositions fausses et de conclusions fausses. - Par exemple, si A est vrai de C, voici le syllogisme : A est à B; or B est à C; donc A est à C. Les deux prémisses sous cette forme sont supposées fausses toutes deux, parce que, en réalité, ni A n'est à B, ni B n'est a C. Il n'y a de vraie que la conclusion: A est à C. - Pour prouver ces propositions, les deux prémisses fausses par des prosyllogismes. - Les nouvelles propositions, des prosyllogismes destinés à prouver les prémisses. - Toute conclusion fausse, Premiers Analytiques, liv. II, ch. 2, § 2. - On ne peut tirer qu'une conclusion vraie id., ibid. § 2. En outre, seconde raison, dialectique comme la première. - Comme par exemple, il y a ici deux propositions : la justice est l'injustice; et puis: la justice est la lâcheté. De ces deux propositions, la première est contradictoire à elle-même la seconde ne peut coexister avec la première: car si la justice est l'injustice, elle ne peut pas être la lâcheté. Même remarque pour les deux exemples suivants qui se décomposent chacun en deux propositions. § 3. D'après les règles posées plus haut, dans tout le cours du premier livre : ce sont des raisons analytiques opposées aux raisons logiques antérieurement données. - Les premières n'ont pas de position, voir plus haut, ch. 27, § 3. - Soit en haut, dans l'attribut ou le majeur. - Soit en bas, dans Ie sujet ou le mineur. - Les uns en dedans, selon la première figure où le moyen est entre les extrêmes. - Et les autres en dehors, selon la seconde ou la troisième figure où le moyen en dehors des extrêmes, est ou attribut des deux ou sujet des deux. § 4. Mais même parmi les principes communs, non seulement les principes propres des choses diffèrent entre eux; mais encore les axiomes, qui sont communs à tontes les démonstrations, ne suffisent pas pour tout démontrer. - A l'aide de ces genres. Voir plus haut, chapitres 9, 10 et 11. § 5. De plus, les principes..., si les principes de toutes les démonstrations étaient identiques, il s'ensuivrait qu'ils seraient en petit nombre : mais il n'en est rien : d'abord les principes sont à peu près aussi nombreux que les conclusions. - Soit en ajoutant un terme, un attribut. Voir plus haut, ch. 12, § 14. On conserve la conclusion du premier syllogisme pour mineure; on ajoute une majeure, c'est-à-dire, un nouvel attribut, et l'on forme ainsi un nouveau syllogisme en n'ajoutant qu'un seul terme. - Soit en intercalant un moyen. Voir plus haut, ch. 22, § 29. § 6. Mais les termes moyens sont limités, c'est ce qui a été prouvé plus haut, ch. 20. § 7. Les autres sont contingents, et le nombre des principes contingents est infini. § 8. Que les principes soient les mêmes, pour toutes les démonstrations. § 9. Si l'on soutient, première objection : les principes restent les mêmes dans chaque science : sans doute, mais ils sont alors différents pour des sciences différentes; et c'est là toute la question. § 10. D'autre part, seconde objective. - Dans les sciences proprement dites, les mathématiques. - Ni dans l'analyse, c'est-à-dire, quand on remonte d'une conclusion à ses principes. - Une autre proportion immédiate, une autre majeure. § 11. Qu'une seule dans chaque genre, c'est la définition essentielle du sujet. § 12. Reste uniquement, troisième objection: les principes de toutes les démonstrations sont identiques en genres, ils ne diffèrent qu'en espèce : mais cela même n'est pas, car il a été souvent prouvé quo des choses différant en genre, ont aussi des principes différant en genre. - Les principes sont de deux espèces : d'une part, les axiomes sur lesquels repose toute démonstration, quelle qu'elle soit; et d'autre part, les principes propres de chaque science, de chaque démonstration spéciale. - Les principes dont on tire la démonstration, les axiomes. - Et l'objet auquel elle s'applique, les principes propres, les sujets différents. - Le nombre et la grandeur, pour l'arithmétique et la géométrie. Voir haut, ch. 10, § 3, et ch. 11, § 5, la théorie des principes communs. |
|
Distinction de la science et de l'opinion ; 1° Les objets de toutes deux sont différents: la science s'applique au nécessaire, l'opinion au contingent; 2° la connaissance fournie par l'une et par l'autre est différente, instable pour l'opinion, inébranlable pour la science; Objection : La science et l'opinion se confondent, car il peut y avoir opinion de tout ce dont il y a science. - Réponse : La science et l'opinion ne peuvent point être une seule et même chose, elles peuvent tout au plus s'appliquer à un seul et même objet, l'une y considérant les attributs essentiels en tant qu'essentiels, l'autre y considérant ces attributs comme contingents. Un même esprit ne peut donc sur une même chose avoir science et opinion tout ensemble, bien que cette distinction puisse exister dans deux esprits différents. |
|
|
§ 1. L'objet connu de science certaine et la science diffèrent de l'objet connu par opinion et de l'opinion, en ce que la science est universelle et qu'elle vient des propositions nécessaires; et ce qui est nécessaire c'est ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Mais il a certaines choses vraies, et qui sont, tout en pouvant être autrement qu'elles ne sont. Il est évident qui ce n'est pas pour ces choses-là qu'il y a science; car il s'ensuivrait que ce qui peut être autrement qu'il n'est ne peut pas être autrement qu'il n'est. Il est encore tout aussi clair que pour ces choses-là, ce n'est pas non plus l'entendement qui agit; car ce que j'appelle entendement, c'est le principe même de la science. Il n'y a pas non plus pour elles science indémontrable, c'est-à-dire intuition de la proposition immédiate. Et cependant, l'entendement, la science et l'opinion sont vraies ainsi que tout ce qu'on dit avec leur aide. Reste dons que l'opinion s'applique à ce qui, étant vrai ou faux, peut en outre être autrement qu'il n'est. Elle est donc l'intuition de la proposition qui est à la fois immédiate et non nécessaire. § 2. Et cela est bien d'accord avec les faits, car l'opinion est chose instable; et telle est précisément sa nature. § 3. En outre, personne, quand il pense que la chose qu'il conçoit ne peut être autrement qu'elle n'est; ne croit avoir une simple opinion ; tout au contraire, il croit savoir. Mais c'est seulement quand il pense que la chose peut être ce qu'elle est, et qu'elle peut en outre être autrement, qu'alors il ne fait qu'avoir une simple opinion. Ainsi donc, il ne peut y avoir qu'opinion pour ce qui est marqué de ce caractère, mais il y a science pour ce qui est nécessaire. § 4. Comment donc n'est-ce pas une seule et même chose qu'avoir une opinion et que savoir? Pourquoi l'opinion n'est-elle pas science, si l'on admet qu'on peut avoir une opinion de tout ce qu'on sait? En effet, l'un en sachant, l'autre en n'ayant qu'une simple opinion; iront également tous les deux, à l'aide des moyens termes, jusqu'aux principes immédiats; de sorte que si, d'une part, l'un possède réellement la science, l'autre, qui ne fait qu'avoir une opinion, la possède tout aussi bien, attendu qu'on peut avoir une opinion, non pas seulement de l'existence de la chose, mais encore de sa cause, et que la cause est précisément le moyen. § 5. Mais quand quelqu'un conçoit des choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, en leur donnant ce caractère, de la même façon qu'il croit posséder aussi les définitions par lesquelles on fait les démonstrations, ne doit-on pas dire qu'il n'a plus alors une simple opinion, mais qu'il sait réellement ? Mais s'il suppose que les choses sont vraies sans pourtant supposer que les attributs qu'il en connaît sont essentiels et spécifiques, ne doit-on pas dire encore que réellement il ne sait pas et qu'il ne possède qu'une simple opinion, soit de l'existence et de la cause, si son opinion s'applique à des principes immédiats, soit de l'existence seulement, si elle s'applique à des principes non immédiats ? § 6. L'opinion et la science ne sont pas absolument applicables à un même objet; mais, de même que sur une seule et même chose il peut y avoir à la fois, en un certain sens, une opinion fausse et une opinion vraie, c'est uniquement dans un rapport analogue que la science et l'opinion s'appliquent à un même objet; car si l'on prétend que l'opinion fausse et l'opinion vraie s'appliquent à un seul et même objet, dans le sens ou quelques-uns le soutiennent, il en résulte qu'on admet entre autres choses absurdes qu'on n'a point une opinion quand on a une opinion fausse. Mais comme cette expression : seul et même, peut avoir plusieurs sens, en un sens, il est possible que les deux opinions fausse et vraie s'appliquent à un même objet, et dans un autre sens, cela ne se peut pas. Prendre pour opinion vraie que le diamètre est commensurable, c'est absurde ; mais, comme le diamètre auquel les deux opinions s'appliquent est une seule et même chose, ces deux opinions sont applicables à un seul et même objet. Cependant l'essence admise dans la définition n'est pas du tout la même dans l'un et l'autre cas. C'est précisément de la même manière que l'opinion et la science s'appliquent à un seul objet. Ainsi la science conçoit d'un être qu'il est animal de telle sorte qu'il ne peut pas ne pas être animal. L'opinion conçoit au contraire qu'il peut ne pas l'être. Et par exemple, si l'une trouve qu'animal est un attribut essentiel, de l'homme, l'autre, tout en s'appliquant aussi à l'homme, ne s'attache pas à ce qui le fait essentiellement homme. Le sujet de part et d'autre est le même, puisque c'est l'homme; mais, par la façon dont on le considère, il n'est pas du tout le même. § 7. Il est évident par là, qu'on ne peut pas à la fois et avoir une simple opinion sur une chose et savoir cette même chose; car alors on penserait tout à la fois qu'une même chose peut être et ne peut pas être autrement qu'elle n'est, ce qui est impossible. La science et l'opinion peuvent s'appliquer, comme on l'a dit, à une seule et même chose, dans des esprits différents, mais cela n'est pas possible dans le même esprit, ni comme on le prétend; car on aurait à la fois, par exemple, et la pensée que l'homme est essentiellement animal, car c'était là ce qu'on entendait en disant qu'il ne peut pas ne pas être animal ; et la pensée qu'il n'est pas essentiellement animal, car c'est là ce que signifierait pouvoir ne pas être animal. § 8. Quant au reste, c'est-à-dire, quant aux distinctions qu'il convient d'établir entre le raisonnement et l'entendement, et la science, et l'art, et la prudence, et la sagesse, ce sont là des questions qu'il est bon de laisser les unes à la Physique et les autres à la Morale. |
§ 1. Science... opinion, cette distinction n'est pas d'Aristote, elle appartient tant entière à Platon, qui a présenté une théorie de la science, de ['opinion, et de l'ignorance, et du rapport de toutes trois à le réalité, République, liv. V, p. 313 et suiv., de la traduction do M. Cousin. Voir aussi le Théétète. Aristote ne fait guère ici que reproduire et résumer les principes de son maître. - Mais il y a certaines choses vraies, première différence de la science et de l'opinion: les objets auxquels rune et l'autre s'appliquent ne sont pas les mêmes. - Ce n'est pas non plus l'entendement, seconde différence: les facultés auxquelles l'une et l'autre s'adressent sont diverses. Voir, pour le rôle de l'entendement, la fin du second livre, ch. 19. - Intuition de la proposition immédiate, le mot d'intuition, quoi qu'un peu moderne, m'a paru bien répondre au mot même du texte. - Et cependant, l'opinion peut être vraie, comme l'entendement et la science d'intuition: c'est en quoi elle leur ressemble; les jugements qu'on appuie sur l'opinion, ce qu'on dit avec son aide, peuvent être aussi vrais que les jugements d'intuition : la différence essentielle consiste donc dans l'objet de l'opinion, très distinct de celui de l'entendement, de la science indémontrable. -- Immédiate et non nécessaire, ceci n'est pas contradictoire : la proposition immédiate, en tant qu'elle se ra porte à la chose, est toujours nécessaire en tant qu'elle se rapporte à l'esprit, elle peut ne pas l'être L'esprit peut juger sans myes terme sur l'apparence, sur le probabilité, comme il juge immédiatement sur la vérité. § 2. Car l'opinion est chose instable, autre différence de l'opinion et de la science : la science ne change pas, précisément parce qu'elle repose sur le nécessaire. § 3. En outre, personne..., autre argument tiré du sens commun. - Ne peut être autrement qu'elle n'est, voir plus haut, ch. 2. -- Pour ce qui est marqué de ce caractère, c'est-à-dire ce qui est contingent. Ainsi, la science s'adresse au nécessaire ; l'opinion ne s'adresse qu'au contingent. C'est la distinction même de Platon : seulement pour lui le nécessaire, ce sont les idées. § 4. Comment donc n'est-ce pas une seule et même chose, objection à laquelle il sera répondu dans le g suivant. Si l'opinion a le même objet que la science, si elle peut être vraie comme elle, alors elle ne se distingue pas de la science, elle se confond avec elle. Il peut y avoir opinion de tout ce dont il y a science. On peut tout aussi bien remonter aux principes immédiats en partant de l'opinion qu'en partant de la science; et l'opinion peut arriver également à la cause, c'est-à-dire à la proposition immédiate et indémontrable. § 5. Mais quand quelqu'un..., réponse à l'objection : 1° L'esprit qui a la science et celui qui n'a que la simple opinion ne sont pas dans la même disposition. -- En leur donnant ce caractère, en les considérant comme essentielles. - Les définitions par lesquelles on fait les démonstrations, voir dans le liv. II, ch. 8 et suiv., la théorie des rapports de la définition à la démonstration. - Mais s'il suppose, caractère de la connaissance que donne la simple opinion. § 6. La science et l'opinion, seconde raison contre l'identité de la science et de l'opinion : elles s'appliquent à des objets qui, au fond, sont différents, parce qu'elles ne les étudient pas d'un même point de vue. De même que sur un seul objet, il peut y avoir opinion vraie et opinion fausse, de même aussi il peut y avoir sur un même objet science et opinion : science, quand on sait que l'attribut essentiel de cet objet lui est essentiel et nécessaire : opinion, quand on croit qu'un attribut nécessaire est continent. -- Dans le sens où quelques uns la soutiennent, sans doute les sophistes, et en particulier Protagoras quand il disait : L'homme est la mesure de tout : les choses sont ce qu'elles paraissent à chacun. - Qu'on n'a point une opinion quand on a une opinion fausse, proposition contradictoire et absurde. En effet, du moment qu'une chose est, l'Opinion qui en affirme l'existence est vraie ; et réciproquement, du moment que l'opinion qui affirme l'existence d'une chose est vraie, la chose est. Une opinion vraie sur une chose ne peut être fausse en même temps : ce qu'il faudrait cependant si l'opinion vraie et l'opinion fausse étaient applicables à un objet absolument identique : ainsi l'opinion fausse n'existerait pas, et cependant elle existe, puisqu'elle est l'opposée de l'opinion vraie. - Les deux opinions s'appliquent, que le diamètre est commensurable à la circonférence et qu'il ne lui est pas commensurable. - L'essence admise.... n'est pas la même puisque d'une part on ajoute à l'idée de diamètre celle d'être commensurable, et que d'autre part on ajoute celle d'être incommensurable. - Qu'il peut ne pas l'être, c'est-à-dire, qu'elle prend l'attribut d'animal comme contingent au lieu de le prendre comme nécessaire. § 7. Il est évident par là, autre différence de la science et de l'opinion: elles ne peuvent coexister sur un même sujet, dans un même esprit, au même moment. - Comme on t'a dit, dans le § précédent. -- Ni comme on le prétend, ibid. - Les unes à la Physique, dans le Traité de l'âme, passim, et surtout liv. III, ch. 3; et dans la Morale à Nicomaque, le liv. VI, qui est consacré à ces distinctions. |
|
La sagacité n'est pas autre chose que la découverte exacte et rapide du terme moyen. - Exemples divers physiques et moraux. |
|
|
§ 1. Ce qu'on nomme sagacité n'est que la découverte exacte du terme moyen dans un temps très rapide. § 2. Par exemple, c'est, en voyant que la lune a toujours sa partie brillante tournée vers le soleil, de comprendre sur-le-champ que la cause de ce phénomène, c'est que la lune tire sa lumière du soleil; c'est, en voyant quelqu'un parler à un homme riche, de deviner sur-le-champ qu'il lui emprunte; c'est encore de deviner que ce qui rend deux personnes amies, c'est qu'elles ont un ennemi commun. En effet, il a suffi dans tous ces cas de connaître les extrêmes, pour connaître aussi les termes moyens qui sont les causes.
§ 3. Supposons
représentée par A cette proposition : La partie brillante de la lune
est tournée vers le soleil ; tirer sa lumière du soleil représenté
par B; la lune par C. A la lune C est B, tirer sa lumière du soleil.
Mais A, c'est-à-dire que la partie brillante est tournée vers ce qui
la fait briller, est à B; on en conclut que A est à C par B. |
§ 1. Ce qu'on nomme sagacité, il n'y a qu'un mot sur la sagacité dans la morale à Nicom., liv. VI, ch. 9. Aristote veut en marquer ici le caractère spécial, et il indique d'une manière fort ingénieuse comment elle se rattache aux principes mêmes du syllogisme. § 2. De connaître les extrêmes, c'est-à-dire la conclusion où le mineur est mis en rapport avec le majeur. § 3. On en conclut que A est à C par B, en y joignant toujours la condition d'abord indiquée, que l'acte de la pensée a été très rapide. |
|
FIN DU PREMIER LIVRE DES DERNIERS ANALYTIQUES. |
|