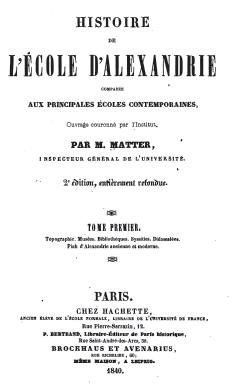
MATTER
HISTOIRE DE L'ECOLE D'ALEXANDRIE
Première Période. (332 —146 avant J.-C. ) chapitres I à VI
Préface + introduction - suite
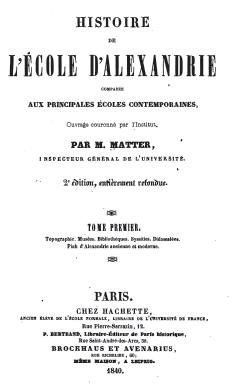
HISTOIRE DE L'ECOLE D'ALEXANDRIE
Première Période. (332 —146 avant J.-C. ) chapitres I à VI
Préface + introduction - suite
HISTOIRE
DE
L'ECOLE D'ALEXANDRIE
COMPAREE
AUX PRINCIPALES ECOLES CONTEMPORAINES,
Ouvrage couronné par l'Institut.
PAR M. MATTER,
INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNIVERSITE.
2e édition, entièrement refondue.
TOME PREMIER
Topographie. Musées. Bibliothèques. Syssities. Didascaléee.
Plan d'Alexandrie ancienne et moderne.
PARIS.
CHEZ HACHETTE,
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ECOLE NORMALE, LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE,
Rue Pierre-Sarrazin, 12. P.
BERTRAND, Libraire-Éditeur 4e Paris historique,
Rue Saint-André-des-Arcs, 38.
BROCKHAUS ET AVENARIUS,
RUE RICHELIEU, 60;
MÊME MAISON, A LEIPZIG
1840.
L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE.
TOPOGRAPHIE, MUSÉES, BIBLIOTHÈQUES, DIDASCALÉES, SYSSITIES,
Première Période. (332 —146 avant J.-C. )
CHAPITRE PREMIER.
L'histoire des musées et des bibliothèques d'Alexandrie , car il ne doit plus être question désormais d'un seul musée et d'une seule bibliothèque , est à tel point liée à celle de cette célèbre cité , qu'on ne saurait la détacher de sa topographie. Afin d'expliquer d'une manière complète les destinées successives de ces établissements , il faudrait même, pour l'époque des premiers Ptolémées , pour celle d'Auguste, pour celle de Constantin et pour celle d'Omar, autant de descriptions différentes. Nous réunirons en un seul tableau les indications essentielles , et nous prendrons pour point de départ le résumé qu'a tracé Strabon dans les premiers temps de la domination romaine (1), c'est-à-dire, trois siècles après la fondation d'Alexandrie, six siècles avant la conquête d'Amrou. Strabon nous laissera quelquefois dans l'incertitude; mais il ne nous est rien resté de plus (44) précis que son résumé ; et les renseignements d'Étienne de Byzance, de Pomponius Méla et de Pline sont loin de le valoir (2). Quant aux modernes, on doit consulter Bonamy, Pococke, Norden, d'An ville, Manso, Mannert, Saint-Genis et Gratien Lepère- Simon de Magistris (ad Daniel, p. 568), Cuper, Clarke et d'autres avaient suivi leur imagination plutôt que les textes, en retraçant le plan ou les édifices d'Alexandrie (3).
C'est donc à Strabon seul que doivent se rattacher les recherches sérieuses sur Alexandrie ancienne. L'état actuel des lieux fournit peu de lumières. Cela se comprend ; la ville moderne occupe un autre emplacement que l'ancienne , dont le sol a été trop souvent bouleversé, l'enceinte et les rues, tout le terrain où elle s'élevait trop profondément modifiés par les alluvions ou les envahissements de la mer, pour qu'on y reconnaisse autre chose que les points les plus généraux. Sous ce rapport, la topographie ancienne d'Alexandrie, loin de s'éclairer de l'état actuel de cette ville, comme celle de Rome ou celle d'Athènes, a toutes les difficultés de celle de Thèbes et de celle de Carthage.
Fondée par Alexandre, la 1ere année de la 113e olympiade (4), au moment où il revenait de Memphis par le Nil, pour recevoir des nouvelles de la Grèce, étudier la population et voir le parti qu'il pourrait tirer d'une côte connue depuis longtemps , Alexandrie recevait sa destinée principale de l'admirable position que présentait une langue de terre touchant d'un côté à la mer et d'un autre au lac Maréotis, qui communiquait par le Nil avec l'Egypte entière. Cette posi- (45) tion avait frappé le conquérant qui venait de renverser Tyr. La sacerdotale Memphis , désolée par les Perses , retirée dans les terres, n'offrant de ressource ni au commerce ni à la navigation, ne pouvait rester la capitale d'une province de Macédoine. Une vieille bourgade, celle de Rhakotis, située entre la Méditerranée et le lac Maréotis, à cent cinquante stades de la bouche Canopique (5), joindrait son sol, sa population et ses temples à la future capitale de l'Egypte, dont le héros traça le plan et l'enceinte, y indiquant lui-même la place du marché, les sanctuaires qu'on devait ériger aux dieux de la Grèce , et celui que devait recevoir Isis, la grande divinité de l'Egypte (6). Depuis longtemps le peuple grec cherchait une position sur ces côtes, où les Milésiens avaient fondé la ville si commerçante de Naucratis (sur la bouche Canopique); désormais il avait, au centre du monde connu, deux vastes ports, et dans le voisinage du fleuve une magnifique station de commerce.
Entraîné par la grande expédition dont la conquête de l'Egypte était un simple épisode , et impatient de reparaître à Memphis avec le caractère sacré qu'il allait demander à l'oracle de Jupiter Ammon, Alexandre avait chargé l'architecte Dinocrate, dont le nom varie chez les anciens, de bâtir la nouvelle cité avec ses collaborateurs Olynthios, Crateus, Héron et Epitherme. Puis , en quittant l'Egypte au printemps de 331, il en avait confié l'administration à l'Egyptien Doloaspis, mais il en avait partagé le commandement militaire entre plusieurs généraux, et leur avait adjoint des intendants pour les surveiller tous. Ce fut à l'un de ces derniers, au gouverneur Cléomène, que les architectes d'Alexandrie eurent à faire (7). Leur ouvrage avança si (46) rapidement, que la bourgade de Rhakotis ne fut bientôt plus qu'un des quartiers d'Alexandrie. (8)
Jetons maintenant un regard sur les points les plus importants que présentent à diverses époques l'histoire et la topographie de cette ville. On admettait autrefois, d'après l'autorité de Philon, que ses différents quartiers, au nombre de cinq, étaient désignés par les cinq premières lettres de l'alphabet (9); et à l'appui de cette désignation, on alléguait un exemple pris dans l'histoire du Musée, où le géographe Eratosthène était désigné par la lettre B. Mais l'indication de PhiIon nous paraît d'autant plus douteuse, que dans le langage ordinaire deux des quartiers d'Alexandrie portaient évidemment d'autres noms. On cite, après le quartier de Rhakotis ou le quartier Nord-Ouest, le Bruchion ouïe quartier Nord-est ; et chacun des faubourgs a son nom spécial. Il est vrai que les trois autres quartiers de la ville ne sont pas nommés par les anciens; mais certainement ce n'est pas là une raison pour croire qu'ils n'avaient que des désignations alphabétiques . Des inscriptions découvertes récemment à Bougie et ingénieusement interprétées, ont paru révéler un des trois noms inconnus (10). En effet, elles mentionnent un certain Sextus Cornélius Dexter, Juridïcus d'Alexandrie , procurator Neaspoleos et Mausolei ; et l'on a pensé que Neapolis pouvait être un des quartiers inconnus; que ce quartier a pu être joint à la ville au IIe siècle de notre ère, ou le nom de Neapolis donné à l'un des anciens quartiers restaurés par l'ordre de quelque empereur. Ces conjectures, appuyées par M. Hase sur des analogies frappantes, ne rencontrent pas d'objections en elles-mêmes ; car on peut concevoir le Juridicus de la ville comme administrateur ou procurator spécial d'un quartier. (47) Seulement, comme le Mausolée dont il s'agit était un monument et non pas un quartier, il semblerait plus naturel de prendre le mot de Neapolis dans un sens analogue, de le considérer comme un vaste ensemble de bâtiments, et de l'appliquer par exemple au Sébastéum , dont il va être question, opinion dont M. Hase n'est nullement éloigné. Il est sans doute étonnant que les noms de trois quartiers d'une ville aussi célèbre soient demeurés tout-à-fait ignorés ; cependant quand on considère que les établissements qui intéressaient le plus la gloire ou le commerce d'Alexandrie se trouvaient dans les deux quartiers du Nord , la surprise s'affaiblit.
Les villes de Pharos et d'Eleusine ceignaient Alexandrie au Nord et au Sud-est ; les faubourgs de Nécropolis et de Nicopolis à l'Est et à l'Ouest. Ils formaient avec elle une vaste agglomération de simples édifices , de temples , de palais et de monuments appartenant à plusieurs peuples, à plusieurs cultes, à plusieurs dynasties. Les villes, les deux faubourgs que nous venons de nommer, et les trois quartiers inconnus ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'histoire d'Alexandrie; et dans la revue topographique que nous allons faire, c'est d'abord sur le Bruchion , quartier séparé de la ville par une enceinte de murailles élevées, contenant à-la-fois les magasins de blé et les palais des rois, et, ensuite, sur celui de Rhakotis, quartier de la vieille population et des principaux sanctuaires , que se portera principalement notre attention. Nous commencerons à l'Heptastade, qui conduisait au Phare et qui séparait les deux ports , pour finir par un coup-d'œil sur les monceaux de ruines qui restent de cette splendide cité.
L'Heptastade ou la ligne de sept stades, à-la-fois chaussée et aqueduc , garni d'un château-fort à chaque extrémité , liait à la ville l'île et la ville du Phare, dont la population était assez considérable pour avoir un marché et des sanctuaires spéciaux. Il livrait passage, sous deux ponts, aux (48) vaisseaux allant du grand port au port d'Eunoste. Les alluvions de la mer ont élargi cette chaussée à l'Est comme à l'Ouest, de telle sorte que c'est elle qui porte les 15,000 habitants de la ville moderne ; et peut-être l'île de Phare, vers laquelle on se presse aujourd'hui, aurait-elle reçu dans l'origine la ville d'Alexandrie, si elle eût offert l'espace nécessaire. Elle était connue des navigateurs ; et pour éclairer l'entrée assez dangereuse du grand port, Ptolémée Ier fit élever sur ses côtes une tour surmontée d'un fanal, construction dirigée par Sostrate, qu'elle illustra, mais qui, selon Pline, y dépensa 800 talents (11), et dont le chef-d'œuvre exista jusqu'au XIII siècle de notre ère. La courbe qui s'étendait de cette tour à l'extrémité de l'Heptastade et à celle du cap Acrolochias, formait l'enceinte du grand port, qui avait trente stades de tour et renfermait trois autres ports, celui des Apostases, celui d'Antirhode et celui des Rois. Sur cette rive où de nombreux débris de colonnes et de chapiteaux s'aperçoivent encore, se trouvaient les principaux établissements, ceux du commerce et de la marine , qui ont attiré sur ce théâtre des événements si funestes pour les institutions littéraires. Près de l'Heptastade, en dehors du môle et de la ville, s'étendait une grande place , qui séparait les Néories (12) des deux ports. De cette place, l'Area d'Hirtius, on rencontrait successivement en suivant la courbe jusqu'à la pointe de l'Acrolochias, les Néories du grand port, les Apostases (13), et un Emporium , qui dans une ville aussi importante a dû être accompagné de comptoirs semblables à nos Bourses. Plus loin les deux obélisques connus sous le nom d'aiguilles de Cléopâtre, et qui sont demeurés sur place, l'un renversé, l'autre debout, couverts d'hiéroglyphes tous deux, indiquent la (49) place qu'occupait un monument considérable, qui fut peut-être le Mausolée. Ensuite la tour dite des Romains paraît montrer le lieu où s'élevait le sanctuaire érigé par Antoine en l'honneur de César. A ce temple succédait autrefois le Posidium ou le sanctuaire de Neptune, qu'on avait placé sur une petite langue de terre; puis le Timonium, ou le palais bâti par Antoine, devenu misanthrope après la catastrophe d'Actium. Le théâtre était situé , suivant Strabon , quand on entrait par le port, au-dessus de l'île d'Antirhode et en arrière du rivage. Cette île, avec son palais et son petit port, avançait légèrement dans le grand bassin , et s'apercevait au-dessous des palais intérieurs, devant le port creusé, qu'on distinguait du port fermé ou caché, réservé aux rois et mis en communication avec les palais. Enfin, on parvenait au promontoire d'Acrolochias, surmonté de palais, auxquels faisaient suite les autres demeures royales, qui se succédaient vers l'intérieur à une grande distance. A celle de ces résidences qu'habitait le prince se liait le Méandre ou le parc, au moyen d'une galerie couverte, le Syrinx.
En suivant la plaine à l'est du Lochias on trouve encore une quantité de ruines qui attestent que la ville ou le faubourg de Nicopolis s'étendait de ce côté. Strabon, qui dit que Nicopolis était située sur la mer, à trente stades d'Alexandrie , n'en mentionne que l'amphithéâtre et le stade, bâtis pour les jeux quinquennaux qu'Auguste avait institués en souvenir de sa victoire sur Antoine (14). Il y avait là beaucoup d'autres édifices, qui faisaient déserter ceux de Rhakotis ; mais le géographe ne s'attache dans son tableau qu'aux choses principales , aux établissements du port et à quelques indications majeures sur le Bruchion ou le quartier des palais ; encore n'y nomme-t-il que le Musée, le Sêma et le Théâtre, ce qui montre que le point de vue qui le domine est celui de la navigation.
(50) En effet, après avoir suivi tout le périmètre du grand port et légèrement, indiqué ce qu'on y voyait de plus remarquable, il passe rapidement au port d'Eunoste, à l'ouest de l'Heptastade. Il y mentionne d'abord le petit port de Kibotos (la Boite) qu'on avait creusé dans cette rade, les Néories qu'on y avait jointes, et le canal navigable qui communiquait de ce point, à travers la ville, avec le lac Maréotis. A l'ouest de ce canal la ville touchait à Nécropolis, faubourg composé surtout de monuments funéraires et de jardins consacrés à l'embaumement. La partie la plus occidentale de l'ancienne Rhakotis, celle qui était comprise entre le canal et la Nécropole, avait peu d'importance. La partie orientale en avait davantage. On y voyait le Sérapéum et d'autres édifices sacrés , qui y fixaient la population égyptienne sous les Lagides, mais qu'on abandonnait, dès l'origine de la domination romaine, pour les nouveaux temples de Nicopolis. Aussi le savant voyageur ne mentionne pas plus la bibliothèque de Rhakotis que celle du Bruchion , et il termine assez brusquement sa topographie, après avoir décrit ce qui se présentait sur les deux ports, ce qui était bien saillant ajoutant toutefois que la ville était pleine d'Anathemata (15) et de temples, mais ne prononçant plus que les noms du Gymnase, du Dicastérion et du Paneton, et sans indiquer la position de ces édifices. De ce qu'il ne les mentionne pas en décrivant le nord, on doit inférer qu'ils se trouvaient dans l'intérieur, dans les quartiers sud-ouest et sud-est de la ville et au midi de la belle rue qui menait de la porte Ganopique à celle de Nécropolis.
Cette rue et celle qui se dirigeait du port de Maréotis vers le Posidium, de la porte du Soleil à celle de la Lune, se coupaient à angles droits. Ornées l'une et l'autre d'immenses colonnades, elles avaient chacune cent plèthres de largeur et formaient au point d'intersection une place dont la gran- (51) deur, relevée par la magnificence des édifices , semblait partager la ville en deux. Les autres rues étaient parallèles à ces deux ligues, mais elles n'étaient pas droites dans le quartier de Rhakotis. Achille Tatius, dit qu'en arrivant sur la grande place, après avoir traversé les portiques qui allaient en ligne droite depuis la porte du Soleil, il croyait passer dans une ville nouvelle (16). Les portiques y présentaient de vastes courbures. La longueur de celle des deux rues qui partait de la .porte de Canopus , était de 30 stades suivant Strabon et. Josèphe , et de 40 suivant Diodore, différence qu'expliquerait celle des stades, mais qui disparaît si Diodpre comprend dans sa mesure une partie de la Nécropolis. Cette ligne marquait la plus grande longueur d'une ville dont la largeur était de 7 à 8 stades suivant Strabon, de 10 suivant Josèphe (17), ce qui donne un périmètre de 80. La tradition prêtait à ce contour la forme de la chlamyde macédonienne , sur laquelle Pline s'explique d'une manière obscure, et que le terrain comportait mal.
Pour mettre d'accord le sol , les géographes et le manteau macédonien ou le col de la chlamyde , Cuper a fait une dissertation et un dessin peu utiles (18) Ce qui offrait plus d'importance que la forme allongée ou échancrée des murs d'enceinte d'une telle cité, c'était son étendue. Quinte-Curce, qui en évalue la superficie à 300 stades, se rapproche du périmètre réel ; et si Pline donne à ce périmètre 15 milles romains , il embrasse dans ses calculs soit les faubourgs , soit la ville de Pharos. Son chiffre égale Alexandrie à Memphis , et à Rome au temps d'Aurélien, c'est-à-dire qu'il la rend plus grande que Londres et Paris.
Alexandrie était réellement grande; on l'appelait la seconde ville du monde, une autre Rome , la ville des villes (19). Magnifique par ses établissements de marine et de com- (52) merce , ses palais et ses édifices sacrés, elle attirait ceux qui cherchaient la fortune ou un séjour agréable. Un ciel pur, un climat tempéré par le voisinage de la mer et les vents du nord, qui rafraîchissaient l'été sans apporter de neige à l'hiver, de belles places dans la ville, quelques bois autour de son enceinte , une végétation riche dans une campagne parsemée de jardins, et au loin des communications faciles : tels étaient les avantages d'Alexandrie. Il faut y joindre les séductions d'une cour opulente, amie des lettres et des arts, passionnée pour le luxe des cités grecques, les théâtres, les musées, les bibliothèques, et pour celui des villes d'Egypte, les palais, les sanctuaires. Tout cela dépassait Memphis, Athènes et Rome au commencement du troisième siècle avant notre ère, et pour un Grec poursuivant la fortune ou cultivant les lettres, il n'y avait pas alors de ville dont le séjour fût préférable à celui d'Alexandrie. Voici ce qu'en dit Achille Tatius , trois siècles après la même ère : « En franchissant la porte dite du Soleil, je m'arrêtai subitement comme étourdi par l'aspect de cette merveilleuse cité. Jamais mes yeux n'avaient eu pareille jouissance. De la porte du Soleil se prolongeait sur les deux côtés, vers la porte de la Lune, une colonnade en ligne droite. Au milieu j'aperçus le marché, une infinité de rues qui se croisaient, et des allées et des venues si fréquentes qu'on eût dit la ville entière en voyage ( l. l.). »
De tous les monuments de cette célèbre cité, il ne reste aujourd'hui sur place que les deux obélisques qui s'élevaient devant le Césarium ; la tour des Romains, qui faisait partie du même édifice ; la colonne de Dioctétien, qui se présente en dehors de la ville moderne, dans les quartiers sud-est de l'ancienne cité; quelques colonnes d'une ancienne basilique chrétienne des premiers siècles, engagées dans une mosquée aujourd'hui ruinée et que la tradition rattache aux septante ; des débris d'un palais ruiné qui bordait le côté sud de la grande rue près d'une autre mosquée abandonnée, (53) qu'une autre tradition rattache à saint Athanase ; un grand nombre d'autres débris de colonnes, de fûts de chapiteaux, et d'ornements d'architecture qui se découvrent le long des ports dans les murs de revêtement ; les ruines d'une arène, qui paraît avoir été le stade dont nous avons parlé ; plusieurs citernes et des aqueducs; et enfin, sur toutes les parties de l'ancienne surface d'Alexandrie, une quantité de collines formées par les décombres de ses plus beaux monuments.
Sur ce même sol d'Egypte où se sont conservés les temples et les palais élevés par les anciens Pharaons, où Cambyse et ses successeurs ont laissé des traces de leur passage (20), Alexandrie n'a pu garder un seul édifice des rois grecs qui étaient venus si longtemps après eux prendre leur place, faire tous leurs efforts pour les éclipser , ériger une quantité de monuments nouveaux et inscrire leurs noms jusque sur ceux de leurs prédécesseurs.
C'est que la belle capitale des Lagides a été plus maltraitée par les Romains et les Arabes que Thèbes et Memphis ne l'avaient été par les Perses et les Grecs. Elle a été incendiée, spoliée, ruinée par ses conquérants et même par ses maîtres. Ptolémée Kakergetès la désola dans ses fureurs, César y mit le feu, Caracalla et Aurélien la ravagèrent, Théodore y fit porter la hache, Omar et ses successeurs, les califes et les soudans, y amassèrent ruine sur ruine. Une foule d'objets d'art furent d'abord enlevés par les empereurs de Rome et de Byzance, puis par les rois de Perse et les califes d'Orient ; dans des temps plus rapprochés, par les gouvernements d'Italie , de France , d'Angleterre , de Naples , de Sardaigne et de Prusse. Si jamais l'Egypte , relevant la ville d'Alexandrie et redevenant conquérante sous un autre Sésostris , y ramenait de l'Orient et de l'Occident ce qu'on lui a ravi; si, du soin de la terre qui les garde, elle retirait ses monuments enfouis pour les joindre aux autres débris sau- (54) vés du naufrage , elle trouverait encore à former un musée imposant : elle y mettrait les ruines les plus éloquentes. Que serait-ce si elle pouvait relever les édifices d'Alexandrie? Elle ferait voir au monde la plus magnifique des cités anciennes. Un coup-d'œil sur les principaux de ses édifices nous fera comprendre son ancienne splendeur.
A une époque où toutes sortes de dévastations s'étaient succédé dans Alexandrie, selon les auteurs arabes Amrou aurait encore trouvé dans cette ville quatre mille palais. Si l'on veut faire quelque attention au chiffre de ces écrivains, il faut supposer qu'ils ont pris pour des palais la plupart des maisons. Le fait est qu'il y eut un grand nombre d'édifices publics. On peut les distinguer en cinq classes. En effet, ils étaient consacrés soit au commerce et à la navigation, soit aux besoins de l'administration et du gouvernement, soit à l'éducation de la jeunesse et aux exercices du corps comme aux travaux de l'esprit, soit au culte des grands hommes, des héros et des dieux, soit enfin aux sciences, aux lettres et aux arts.
Quant à la première classe de ces monuments, j'entends la tour du Phare, les châteaux de l'Heptastade, les néories et les apostases, ainsi que les citernes, les aqueducs et les canaux, ils n'avaient pour objet que la prospérité matérielle de la ville, et ils se rattachent peu aux études; ils ne figureront donc dans nos pages qu'à l'occasion des désastres qu'ils attirèrent sur les musées et les bibliothèques, qu'on avait eu l'imprudence de ne pas en éloigner suffisamment.
La même sagacité avec laquelle on réunit autour des ports les établissements de prospérité matérielle, aurait dû faire exclure de cette région de la ville la majeure partie des édifices de la seconde classe, affectés au gouvernement et à l'administration. Au lieu d'abandonner aux marchands et aux navigateurs la côte tout entière, on en assigna plus de la moitié, l'immense quartier du Bruchion, à la résidence des rois et aux palais qui en dépendaient. On ne renvoya (55) dans les quartiers méridionaux que lé dicastérion ou le palais des tribunaux, édifice important dans une cité dont la population appartenait à trois nations différentes, et dans un pays où les lois étaient nombreuses et compliquées, la science de la législation ancienne et la sagesse des jugements encore plus célèbre que celle des lois. Aussi paraît-il que le dicastérion occupait une place considérable.
Quant aux édifices de la troisième classe, ceux qui étaient affectés à l'éducation de la jeunesse, aux exercices du corps, aux courses et aux jeux gymnastiques, on a dû les mettre naturellement dans les quartiers moins fréquentés et qui offraient de grands espaces. C'est là qu'on les trouve. L'amphithéâtre et le stade furent établis dans le quartier de Rhakotis au sud-ouest; le gymnase dans celui de sud-est, et l'hippodrome hors de la ville, au nord-est de la porte Canopique. De ces divers édifices, un seul intéresse les études : c'est le Gymnase, qui a préoccupé la pensée de quelques géographes et voyageurs modernes à tel point qu'ils l'ont confondu avec le Musée, quoique, contrairement aux usages d'Athènes, il ne paraisse pas avoir eu le moindre rapport avec cette célèbre école. En effet, si dans Athènes, Platon et Aristote eux-mêmes ne dédaignèrent pas d'aller enseigner dans les gymnases de la ville, aucun savant ne paraît avoir professé dans celui d'Alexandrie; fait remarquable et qui nous fournira plus tard quelques inductions curieuses. Cette école elle-même n'est pas nommée une seule fois dans les annales du Musée ou dans celles de la Bibliothèque. Une ligne de démarcation profonde était donc tracée entre ces trois institutions. Il aurait pu arriver néanmoins que des philosophes du musée eussent envie d'enseigner au gymnase, comme leurs maîtres enseignaient dans les écoles publiques d'Athènes. Le silence que les auteurs gardent à cet égard étonne par conséquent d'autant plus que le Gymnase d'Alexandrie était plus important. En effet, sa longueur était d'un stade, et ses colonnades se faisaient remarquer sur la grande et belle rue (56) Canopique par leur magnificence. On conçoit l'étendue de cet édifice. S'il a été le seul Gymnase de la ville, il a dû être immense. Athènes, pour une population libre bien inférieure à celle d'Alexandrie, en avait plusieurs qui, en raison des promenades, des bois, des jardins et des autres dépendances, occupaient hors de la ville et dans son enceinte des espaces très considérables. Quand on se rappelle que les Athéniens, sur quatre Gymnases, en ont construit trois hors des murs, on ne peut se persuader qu'Alexandrie, dont la population fut de trois cent mille âmes, ait pu se contenter d'une seule institution de ce genre, qu'autant qu'on considère la diversité de cette population. En effet, les Egyptiens et les Juifs n'ont pas dû suivre le Gymnase des Grecs et ont dû se donner des écoles spéciales. Pococke a traduit le mot de Gymnase par celui de publick-schools; il ne pouvait toutefois ignorer que toutes les écoles publiques n'étaient pas réunies au Gymnase, et il savait assurément que les Gymnases n'étaient pas des écoles dans le sens moderne. Quoiqu'il en soit, le seul Gymnase d'Alexandrie que citent les anciens était important, et il se liait, sans doute, par les jardins et les bois des promenades publiques au temple de Pan, au Dicastérum, au Stade et à l'Amphithéâtre, constructions dont on croit reconnaître encore quelques ruines (21). Comme il est certain que tous ces bâtiments demandaient une grande surface de terrain, les deux quartiers du sud, privés de commerce et occupés par des promenades, des bois et des édifices publics, ont du renfermer moins de population que les autres. On oppose à cette opinion un passage d'Achille Tatius, qui dit qu'il a surtout admiré la juste proportion entre l'enceinte et la population d'Alexandrie, et qu'il a eu tort de croire un instant que l'enceinte de cette ville était trop grande pour ses habitants ou ses habitants trop nombreux pour son enceinte; (57) Mais ce passage ne dit pas que la population fût la même dans tous les quartiers d'Alexandrie. On a pensé que le lac Maréotis, qui mettait Alexandrie en relation avec Memphis et avec toutes les stations du Nil, a dû faire peupler ce côté de la ville ; et il est très vrai que ce lac, qui s'étendait jusqu'à Taposiris, sur le golfe de Plinthyne, était entouré non-seulement de riches habitations, mais de bourgades considérables, dont la principale, Marca, prétendait à une sorte d'indépendance. Mais il ne s'agit pas ici des bords du lac, qui étaient en dehors d'Alexandrie, nous ne parlons que des quartiers méridionaux de la ville, et ce qui confirme notre opinion sur le peu de population qu'elle a dû renfermer, c'est aussi cette circonstance, que les communications avec le Nil, 'oin de s'arrêter là, aboutissaient parle canal de Rhakotis et par les ponts de l'heptastade, aux deux ports, aux néories, aux apostases et à l'emporium de la région septentrionale.
N'étaient les nécessités politiques et religieuses, on eût placé, sans doute, dans les quartiers méridionaux ceux des édifices de la quatrième classe dont Alexandre n'avait pas désigné lui-même l'emplacement. Mais les bords de la mer formant le point important d'une ville de navigation et de commerce, d'une grande station militaire, tous les édifices consacrés au culte des dieux, à l'exception du Paneion, furent placés dans la région septentrionale et près des ports. Les rois y joignirent ceux qu'ils élevaient aux héros ou à leurs parents; et comme dans Thèbes ou dans Memphis, qu'on imitait, il y eut bientôt dans Alexandrie tout un quartier de palais entremêlés de sanctuaires. En effet, on distinguait parmi les résidences royales du Bruchion et dans la région qui y touchait à l'ouest, à côté du Poseidion et du Sarapion, le Sêma, l'Homérion, l'Arsinoeion, le Mausolion, le Kaisarion, le Sébastian, tous édifices consacrés à la religion, et sur lesquels nous avons à dire quelques mots pour l'intelligence des considérations morales et politiques auxquelles conduit l'école d'Alexandrie.
(58) Le plus ancien de ces édifices, le Sema, érigé par Philapalor (22), pour la sépulture d'Alexandre et celle des Ptolémées (23), touchait probablement à la grande place d'Alexandre, que décrit Achille Tatius. Vénéré après sa mort comme une sorte de divinité (24), le héros qui avait désiré ces honneurs pendant sa vie, eut une sépulture qui devint naturellement une sorte de sanctuaire, et qu'on peut assimiler, autant que le permettent les différences de siècle et de religion, à celui du Ramesséum, sanctuaire ou temple consacré par Ramessès (le Sésostris des Grecs) à Amon-Ra Souther, la principale divinité des Egyptiens, mais où toutefois le prince fondateur paraît avoir été vénéré comme divinité parèdre, σύνναος (25).
Le Sêma, où le corps d'Alexandre était déposé dans un cercueil d'or, que Ptolémée-Aulète pressé par les nécessités de l'état remplaça par un cercueil en verre, subsista longtemps et toujours honoré. Auguste mit sur le corps d'Alexandre une couronne d'or et de fleurs (26). Septime-Sévère, voulant empêcher qu'on ne vît les restes du héros, fit fermer l'enceinte qui les contenait; mais Caracalla y pénétra, s'y dépouilla de son manteau de pourpre, de son anneau, de son balteum et de tout ce qu'il avait de précieux, et le déposa sur le cercueil. Ces témoignages de vénération ne sont pas des indices de culte et ne prouvent pas qu'un sacerdoce spécial ait été attaché à ce sanctuaire; mais ils établissent que la destination primitive du Sema fut respectée sous les Césars comme sous les Lagides.
(59) Sans nul doute il en fut de même de l'homérion qui fut élevé, suivant Elien (27), par Ptolémée-Philopator, et où le prince des poètes était très probablement l'objet d'une sorte de culte à la fois religieux et littéraire. Ce qui porte à le penser, c'est d'abord un passage de Strabon, qui nous apprend qu'à Smyrne il y avait un bomérion ou un portique quadrangulaire avec un temple et une statue d'Homère, et qu'auprès de ce sanctuaire se trouvait une bibliothèque; c'est ensuite la coutume assez générale de la Grèce, de rendre des honneurs divins aux hommes les plus éminents. On sait en effet, qu'Esculape, Mélampe, Lycurgue, Stésichore et Pythagore eurent des temples; que Sophocle eut un hérôon avec un sacrifice annuel (κατ' ἔτος ἕκαστον) ; qu'Aristote érigea un autel à Hermias et fit des sacrifices à la mémoire de sa femme, et que l'on ne prenait pas ces actes pour de vaines cérémonies, puisqu'on accusa ce philosophe d'avoir introduit des dieux nouveaux.
L'Arsinoéion était une sépulture ou un temple élevé par Philadelphe en l'honneur d'Arsinoé, et décoré d'un obélisque de Nectanébis qui était de 80 coudées, mais qui gêna les mouvements sur le port et qui fut transporté par cette raison sur le forum (28).
Le Mausolion, érigé en l'honneur de Cléopâtre, n'eût été qu'un autel ou une sépulture, si l'on s'en rapportait au compilateur Zénobius, qui nous apprend qu'on y plaça les statues de Naëra et de Charmione (29) Une inscription trouvée de nos jours atteste son importance, puisqu'elle mentionne la qualité d'administrateur de ce monument comme un titre de distinction (V. ci-dessus, p. 46 ).
Le Kaisarion, érigé sur les bords de la mer par Antoine et Cléopâtre à la mémoire de César (Dio Cassius, 51, 16), fut aussi un monument considérable; on le voit par la tour qui en reste et par les obélisques qui lui servaient de décoration.
(60) Le Sébastion mérite toutefois une attention plus spéciale, puisque ce fut à-la-fois un sanctuaire et une bibliothèque , et que par là il se rapproche du plus fameux de tous les temples d'Alexandrie , du Sérapéum. Erigé en l'honneur d'Auguste , postérieurement aux deux voyages de Strabon en Egypte, il ne nous est décrit que par Philon, qui le peint comme un des plus magnifiques monuments du monde (30). Il est certain que le culte d'Auguste n'y fut pas célébré plus sérieusement que celui de César ou d'Alexandre au Kaisarion et au Sêma, et que le Sébastéum ne fut pas un temple véritable , un sanctuaire qu'on doive comparer à ceux de Sérapis ou de Neptune. Il fut toutefois le plus important des cinq édifices qui nous occupent en ce moment. Ce qui indique qu'il fut vaste, c'est que l'empereur Claude fit transporter devant sa façade les obélisques de Smarrès et d'Ephrée, qui sont aujourd'hui à Rome, l'un à Sainte-Marie-Majeure, l'autre à Monte-Cavallo. A ce qu'il paraît, le Sébastéum devait non-seulement rivaliser avec le Sérapéum et avec le Musée, mais il entrait dans les vues de son fondateur de faire un grand pas sur les créateurs de ces institutions. En effet, s'il est, comme on le croit, l'édifice décrit par Aphthonius, il se trouvait dans ses portiques des salles de lecture pour les savants, et pour toute la population instruite de la ville : fait nouveau dans l'histoire des lettres anciennes , et qui méritera de notre part une attention spéciale, puisqu'il prouverait que, sous la domination romaine, les maîtres de l'Egypte cherchèrent à populariser la science qui était demeurée une sorte de monopole même sous les Lagides. Si nous en croyons certains auteurs modernes, qui vont plus loin que Philon, Auguste aurait rassemblé au Sébastéum tous les monuments des sciences et des arts (31). Rien ne justifie cette exagération, pas même la description qu'Aphthonius donne de la citadelle d'Alexandrie (32), description qu'on applique au Sébas- (61) téum, et que nous devrons examiner plus tard sous un point de vue nouveau. En effet, plusieurs écrivains, et entre autres Stosch et Norden, confondent le Césaréum avec le Sébastéum; et le dernier de ces savants confond de plus le Césaréum avec le palais de Cléopâtre, confusion qui a trompé beaucoup d'écrivains (33).
De ces monuments consacrés en quelque sorte par l'apothéose, nous arrivons aux sanctuaires véritables, aux principaux temples des divinités. Ce furent le Poseidion, le Paneion et le Sarapion.
Le Poseidion était situé au Bruchium, sur les bords de la mer, à l'endroit qui convenait le plus à un temple de Neptune ; il était pour les Grecs navigateurs ce que le Sérapéum était pour les Egyptiens attachés aux travaux du pays et aux bienfaits du Nil.
Le Paneion était situé dans le quartier sud-ouest, de manière à former une sorte de triangle avec le Poseidion et le Sarapion. Jeté dans un quartier retiré, construit dans ce goût fantastique qu'affectait l'architecte Dinocrate, qui avait offert à Alexandre de tailler le mont Athos en femme agenouillée, et qui avait érigé un Héphestion si capricieux (34), le Paneion était une tour à étages, ornée d'une grotte de Pan (35) et terminée par une plate-forme où conduisaient des escaliers en spirale et d'où la vue embrassait la ville entière (36). Un tel édifice, relégué dans les quartiers secondaires, était loin d'avoir l'importance du Posidium ou du Sébastéum, qui eux-mêmes n'avaient pas toute celle du Sérapéum, dont il nous reste à parler.
Le Sérapéum s'élevait à la place d'une chapelle d'Isis et (62) de Sérapis, sur une colline située dans l'intérieur du quartier de Rhakotis, au nord-est du canal, où il formait pendant au Posidium. Nous l'avons dit : si le culte de Neptune , plus universel, convenait mieux sur le grand port de la Méditerranée et pour la nouvelle population grecque , celui de Sérapis, divinité protectrice du Nil, convenait mieux dans l'ancienne bourgade et à l'ancienne population qui s'y maintenait. Alexandre avait ordonné d'élever un temple à Isis (37). Que cet ordre ait été suivi ou négligé par Dinocrate, Ptolémée Soter crut devoir changer en un temple magnifique la chapelle qui était commune à Isis et à Sérapis , et il fil ériger le Sérapéum. Les Pharaons en avaient élevé d'autres à Memphis et à Canopus , dont on attirait la population dans Alexandrie. II était naturel qu'on voulût surpasser ce qu'elle était obligée de quitter. Le nouveau Sérapéum fut plus beau que tous les autres temples de la ville. « Nos faibles expressions , dit Ammien , ne sauraient peindre la beauté de cet édifice. Il est tellement orné de grands portiques à colonnes, de statues presque animées, et d'une multitude d'autres ouvrages, qu'après le Capitole, qui immortalise la vénérable Rome, l'univers ne voit rien déplus magnifique,. Suivant Ruffin, on y montait par cent degrés. II était comme porté dans les airs , carré, de grandes dimensions. La partie inférieure était voûtée, et le soubassement distribué en vastes corridors et en vestibules carrés, séparés entre eux, pour servir à diverses fonctions et à divers ministères secrets. On y trouvait des salles de conférences, des porches, des maisons élevées pour les gardes de l'édifice et pour les prêtres appelés agneuontes, voués à la chasteté (38).
On sait, par l'histoire du Memnonium, avec quel soin les Egyptiens mettaient les phénomènes de la nature en harmonie avec les idées qui dominaient dans leur culte. Un effet analogue à celui que le soleil produisait sur le colosse de (63) Memnon se remarquait au Sérapéum, à l'égard de la statue de Sérapis. On avait pratiqué dans la partie orientale du temple une petite fenêtre, pour y introduire une sorte de jour, que Ruffin nomme un simulacre du soleil, et qui venait le matin saluer Sérapis. Pour introduire ce simulacre, on observait exactement l'instant où un rayon du soleil pénétrait par la même fenêtre et éclairait la bouche et les lèvres de Sérapis à la vue de tout le peuple, de telle sorte que ce Dieu semblait embrassé par le soleil (39). On ne demandera pas comment un gouvernement grec a pu se plier ainsi aux habitudes de l'Egypte ? Ces habitudes n'étaient pas contraires à celles de la Grèce. D'ailleurs la population égyptienne a continué, sous la domination grecque , à bâtir des temples dans son ancien système (40) ; et celui des Ptolémées qui fit ériger le Sérapéum avait trop à cœur de complaire aux habitants de Canopus et de Rhakotis, pour ne pas flatter leurs goûts.
Dans l'intérieur des dépendances du Sérapéum régnaient des portiques en carré, tout autour du plan. Il est probable que ce-fut là qu'on déposa la seconde bibliothèque d'Alexandrie, celle qu'on appelait la fille , pour la distinguer de la première, appelée la mère. Quoique Strabon ne parle dans sa description ni de l'une ni de l'autre de ces collections , il est évident que la seconde était placée dans les portiques ou dans une dépendance du Sérapéum. Elle s'y maintint longtemps , puisque ce sanctuaire, qui devait accueillir plus tard les débris du Musée lui-même, est cité avec admiration parles auteurs profanes ou ecclésiastiques, jusqu'à la fin du ive siècle, époque de sa destruction par Théophile (41).
Nous arrivons enfin aux édifices de la cinquième classe, à ceux qui étaient consacrés aux sciences, aux lettres et aux arts. C'est le célèbre Musée qui occupe le premier rang (64) dans cette catégorie. Il faut y joindre toutefois la Bibliothèque, le Théâtre, le Claudium et le Didascalée. Nous dirons d'abord un mot sur ces quatre derniers bâtiments.
Le Théâtre, seul édifice qui fût à-la-fois consacré aux lettres et aux arts, occupait une place distinguée dans le quartier du Bruchion, où il se présentait, quand on entrait par le grand port au-dessus de l'île d'Antirhode. Il joua un certain rôle dans l'histoire des lettres comme dans celle des mœurs d'Alexandrie; le peuple y était admis comme au Théâtre d'Athènes, et nous voyons par une concession retirée aux philosophes qu'on y accordait accès aux savants du Musée, par classes ou catégories.
Le Claudium, qui fut un second Musée fondé par l'empereur Claude, se trouvait sûrement dans le quartier de Rhakotis ou dans celui de Bruchion ; car les Césars et leurs gouverneurs ne paraissent pas s'être occupés des autres. Ce fut un édifice spécial, car les anciens n'auraient donné le nom qu'il portait ni à une institution qui n'eût pas eu de local propre, ni à quelque établissement mixte. D'ailleurs, on multipliait les bâtiments d'Alexandrie avec d'autant plus de facilité, que Memphis offrait une plus abondante carrière de pierres et de colonnes toutes taillées (42).
Le Didascaléion ou l'École des chrétiens fut aussi, sans contredit, un bâtiment spécial; et il était naturel que dans une ville où l'on se montrait si tolérant et où tous les autres cultes avaient des édifices si magnifiques, les chrétiens eussent, outre leurs églises, une institution savante, établie dans un local particulier. Leur Didascaléion , qui ne se fit , remarquer qu'à partir du IIe siècle, paraît avoir renfermé une bibliothèque dont nous aurons à parler.
Quant à la grande Bibliothèque, Strabon la passe sous silence ; mais elle était évidemment située dans le Bruchion, puisqu'elle fut atteinte, dans les guerres de César, par l'in- (65) cendie qui dévora la flotte Egyptienne réfugiée dans le grand port. Il en était de même du Musée, qui fut après le Sérapéum, le plus célèbre des édifices d'Alexandrie et qui renferma la plus grande institution littéraire de l'antiquité. Le Musée faisait partie des palais royaux, mais comme ces palais s'étendaient depuis le cap Acrolochias jusqu'à la place d'Alexandre, et occupaient plutôt le tiers que le quart de la ville, ce n'est que par voie d'induction qu'on arrive à en déterminer la position. Cela paraît d'autant plus facile à faire, que le Musée était étendu et qu'il se composait de plusieurs parties qui formaient presque autant d'édifices spéciaux, par exemple, d'une grande salle ou maison à manger qui était sans doute isolée et entourée d'allées (43), d'une galerie ouverte dont on parle quelquefois comme d'un bâtiment indépendant (44), et enfin d'un promenoir qui a dû être considérable (45). Nous savons d'ailleurs que d'un côté le Musée était éloigné des bords de la mer, puisqu'il fut préservé de l'incendie qui dévora la bibliothèque, et que d'un autre il n'était pas assez rapproché dela place d'Alexandre pour qu'Achille Tatius le nommât en parlant de cette place. On peut donc admettre qu'il se trouvait à peu près au centre du Bruchion et au milieu des palais royaux dont il faisait partie. Si Norden le place près du Pharillon, c'est uniquement pour être d'accord avec un détail qui se trouve dans l'histoire des soixante-dix interprètes (46). Les topographes postérieurs à Norden le mettent généralement en regard du Gymnase, ou le confondent avec cet édifice; quelquesuns le passent sous silence, et Saint-Genis lui-même n'en dit presque rien dans son important travail. Mais cet écrivain eût été. plus explicite, sans doute, s'il avait pu donner (66) le plan plusieurs fois annoncé dans son mémoire, sous le titre d'Alexandrie restituée.
La position de la bibliothèque est plus difficile à trouver que celle du Musée. Une première question se présente à cet égard : la bibliothèque et le Musée formaient-ils un seul ou deux établissements différents? Strabon, en indiquant les diverses parties du Musée et jusqu'à la salle à manger, ne nomme pas de bibliothèque. II n'en existait donc pas dans cet édifice, et par conséquent il y avait un bâtiment spécial consacré à la collection, appelée la mère. Mais d'un autre côté, Strabon, en nommant les principaux édifices d'Alexandrie, ne cite pas cette bibliothèque, lui qui a dû la visiter à deux époques de sa vie. Elle n'était donc pas déposée dans un édifice spécial; et dans ce cas, où faut-il la chercher? On nous apprend que la seconde collection, celle qu'on appela la fille, était déposée au Sérapéum; mais on ne nous apprend pas où se trouva.it la première, celle qu'on appelait la mère. Il est évident que ce n'était pas au Musée, non point par la raison que Strabon ne la nomme pas en parlant de cette institution — car les inductions contradictoires que nous venons de tirer du silence de Strabon, montrent que ce silence ne prouve rien du tout et que la question de la réunion ou de la séparation du Musée et de la Bibliothèque doit se décider par d'autres considérations—mais par la raison que le Musée survécut à la bibliothèque réduite en cendres.
Toutefois s'il est vrai que la bibliothèque avait un local spécial, où était situé ce local? Évidemment sur le péri» mètre du port, et assez rapproché des Néories.pour être atteinte par les flammes qui dévorèrent la flotte. Sainte-Croix indique un point pris à l'est du grand port, du côté de la porte de Canope; il n'apporte aucune raison du choix qu'il fait (47), mais l'incendie dont nous venons de parler et les indications de Dio Cassius autorisent cette opinion (48). (67) Elle est préférable à toute autre et nous l'adoptons sur notre carte.
Et maintenant que nous avons reconnu les principaux points topographiques d'Alexandrie, et distingué parmi les édifices publics de cette célèbre cité ceux qui ont joué un rôle spécial dans l'histoire des lettres, les Bibliothèques, les Musées, le Sérapéum, le Sébastéum, le Claudium, nous allons aborder l'histoire des institutions littéraires qu'on y établit successivement, et dont l'ensemble porte le nom d'École d'Alexandrie.
La question fondamentale, celle qui se présentera d'abord , ce sera de savoir quelle a été la pensée des Lagides en créant ces institutions. C'est naturellement cette pensée retrouvée qui devra répandre le plus de jour sur le caractère spécial de ces créations , sur l'organisation primitive de chacune d'elles et sur les rapports de toutes les unes avec les autres. Cette pensée, nous le croyons, ressort d'une manière précise des textes mêmes qui nous sont restés sur la fondation du Musée, la première de ces institutions et celle de toutes qui a produit les autres. Pour saisir la portée de ces textes et comprendre les travaux du Lagide, il faudra toutefois considérer l'état moral de la Grèce, qui l'avait élevé, et celui de l'Egypte, qu'il était appelé à gouverner.
BUT ET ORIGINE DU PREMIER MUSÉE ET DE LA PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE D'ALEXANDRIE.
Avant de nous expliquer sur le but et l'origine des premiers établissements littéraires d'Alexandrie, nous allons maintenant examiner la situation morale de la dynastie qui les fonda et celle de la population sur laquelle ils devaient exercer leur influence.
La population de l'Egypte, jadis la plus unie et la plus exclusive de toutes, avait perdu ce caractère avec son indépendance et sa nationalité. Avant de tomber sous le pouvoir d'Alexandre, elle avait passé sous l'autorité des Perses, sans savoir toutefois s'y soumettre ni s'en affranchir, et le vainqueur de Macédoine l'avait saisie comme une proie plus facile à prendre qu'à conserver. En effet, cette nation qui avait perdu avec ses rois son unité, son importance politique, et même toute capacité de se reconstituer, avait gardé de ses mœurs et de ses institutions antiques des traditions si puissantes, qu'il était difficile de les dédaigner. L'organisation du peuple en castes et la distribution du sol entre elles et la royauté, ces deux pivots de l'ancien ordre social, étaient complètement bouleversées; mais la pensée religieuse et les habitudes morales qui s'y étaient rattachées, se maintenaient. La royauté était anéantie, la caste des guerriers, privée du droit de la représenter et de la soutenir, celle des prêtres, de la gouverner. Entre les autres castes les distinctions étaient à-peu-près effacées; et de nouvelles classes, celle des interprètes par exemple, s'étaient formées au contact avec la Grèce. Mais le fantôme de l'ancien pouvoir sacerdo- (69) tal planait encore sur ces débris, le sacerdoce conservait des revenus propres et une science exclusive, Memphis était toujours la ville sacrée, et l'Egypte, glorieuse des sanctuaires dont elle s'était couverte , présentait encore l'ombre d'une nationalité morale que la religion soutenait par son souffle puissant, comme toutes les autres ruines de l'ancien empire des Pharaons.
Qu'avaient à faire les princes grecs en face de ces puissants débris de religion , de sacerdoce, de législation, de science, d'arts et de monuments ?
Pour Alexandre la question avait été facile. Dans l'immense empire du conquérant, l'Egypte, soumise à quelques gouverneurs qui se contrôlaient mutuellement, formait tout au plus une province d'une physionomie spéciale. Il n'en était pas de même des Lagides ; l'Egypte était tout leur royaume ou du moins le centre de toute leur puissance. Pour y être forts, il fallait la rendre forte; et pour l'avoir telle, faire l'une de ces trois choses : relever ses anciennes lois et ses institutions sacrées; mais c'était s'imposer l'obligation de devenir Egyptiens : lui donner de nouvelles mœurs , de nouvelles idées ; mais c'était s'engager à la rendre grecque : recourir à une transaction; mais c'était faire la moitié du chemin sans être certain que le pays en ferait l'autre moitié. Cependant la transaction est la grande loi des dynasties nouvelles, et les Lagides l'eussent subie s'ils ne l'avaient préférée. Ils la choisirent. A quel autre parti pouvaient-ils s'arrêter? A celui de rétablir les institutions anciennes? Outre que cela était impossible, c'était se condamner au rôle des Pharaons ou restaurer leur dynastie. A celui d'implanter en Egypte les institutions et les mœurs de la Grèce? Outre que cela était impossible aussi, c'était mettre le chaos à la place des ruines. La Grèce, ils le savaient par Démétrius de Phalère et par eux-mêmes, n'offrait plus nulle part d'institutions ni de mœurs à imiter. Les démocraties de Thèbes et d'Athènes étaient usées comme l'oligarchie de Sparte et la grossière (70) monarchie de Macédoine; et dans la transaction à laquelle il fallait s'arrêter, l'Egypte devait même fournir un contingent prépondérant. En effet, s'il se trouvait dans la capitale une minorité de Grecs, l'immense majorité du royaume se composait d'Egyptiens. Ptolémée Soter sentit si bien la nécessité de consulter les lois et les mœurs de cette majorité, qu'à cet égard il chargea son meilleur conseiller d'une mission spéciale. Il préposa à la législation, dit Elien, Démétrius de Phalère, qui s'était réfugié dans ses palais depuis son expulsion de Thèbes et d'Athènes (306 avant J.-C.) (49). Cela ne veut pas dire sans doute, qu'il le pria de faire des lois ; cela veut dire qu'il le chargea de veiller au maintien des lois encore en vigueur, ou d'examiner, en les comparant avec celles du monde grec, quelles seraient celles des lois anciennes ou nouvelles qui conviendraient désormais dans son royaume. Dans tous les cas, les institutions que l'on y trouvait encore durent servir de point de départ; et elles imposèrent nécessairement leur caractère à celles qui venaient s'y agréger. Les plus fortes des institutions encore existantes de l'Egypte, c'étaient incontestablement les sanctuaires d'Héliopolis, de Thèbes et de Memphis. Du côté de la Grèce, celles qui dominaient les esprits, c'étaient assurément les écoles philosophiques d'Athènes. Là, dans les écoles de la Grèce et dans les sanctuaires de l'Egypte , était non-seulement la science, mais la vie, mais le génie des deux pays-, et les sanctuaires menaient les consciences, comme les écoles les intelligences.
Il est toutefois évident que Ptolémée Soter dont la politique avait besoin , dans son système de transaction, de ces écoles et de ces sanctuaires, ne pouvait les accepter tels qu'ils étaient ni les uns ni les autres. Les sanctuaires de l'Egypte avec leur esprit sacerdotal eussent repoussé en lui et dans sa dynastie une civilisation étrangère ; les écoles d'Athènes (71) avec leur génie philosophique eussent combattu, près de lui, à-la-fois la religion et les lois de l'Egypte. Et néanmoins il lui fallait, pour le gouvernement religieux et intellectuel de son royaume, les sanctuaires de l'Egypte et les écoles de la Grèce. Seulement il les désirait modifiés les uns et les autres. Il lui fallait surtout dans sa capitale une institution tenant à la-fois du sanctuaire et de l'école, et qui vînt changer fortement par la science, mais sous la bannière de la religion, les études, les mœurs , les idées ; rallier à sa dynastie les grands corps de l'état, les prêtres , les magistrats, les gouverneurs des provinces, les chefs de l'armée, la jeunesse de plusieurs nations, en un mot tout ce qui commande aux masses ou les entraîne.
La population d'Alexandrie surtout réclamait des institutions spéciales. Elle était très mélangée, composée d'éléments hostiles entre eux, plus propres à troubler le pays qu'à le guider dans les voies de l'ordre et de la soumission. Cette population, c'était d'abord celle de Rhakotis qu'on avait comprise dans l'enceinte d'Alexandrie, et celle de Canobus qu'on invita ou plutôt qu'on força de s'y rendre. C'étaient là des Egyptiens corrompus ou du moins altérés par le contact avec la Grèce, mais qui avaient conservé leur culte et leur langue, et qui ne voyaient dans la nouvelle dynastie qu'une famille étrangère, dont le pays finirait par secouer le joug, comme il avait secoué celui des Ethiopiens, des rois pasteurs, des Perses. A ce fond d'indigènes se joignait une multitude de Juifs qu'Alexandre y avait attirés dès l'origine ou, que Ptolémée y menait à la suite de ses guerres et dans des vues de conquête sur la Judée. Si nous en croyions les auteurs • juifs , Ptolémée aurait conduit dans sa capitale cent mille individus de cette nation, l'an 320 avant J.-C., et un grand nombre d'autres, l'an 312. Enfin , l'Egypte en aurait eu un million au temps de Philon, et une grande partie en aurait habité Alexandrie. Ces récits sont exagérés, saris nul doute; mais il est certain que les Juifs s'étaient portés (72) en foule dans ce vaste bazar de l'industrie ancienne. Or ils formaient une population aussi étrangère aux vieilles institutions de l'Egypte qu'aux mœurs nouvelles d'Alexandrie, et ils n'étaient pas moins corrompus par le contact avec la Perse ou la Grèce que les familles venues de Canobus ou de Rhakotis. Une nuée de Grecs et d'Asiatiques, séduits par Alexandre, parles Ptolémées ou la fortune de la ville fondée par l'un et embellie par les autres, était venue partager les bénéfices d'un immense commerce et les faveurs d'une cour prodigue. C'étaient là pour la plupart des hommes sans principes et sans patrie, dominés les uns par l'amour des richesses, les autres par le désir de visiter la plus fameuse des régions du monde ancien. Une garnison macédonienne très considérable, (car l'armée du fils de Lagus se composait de 200,000 hommes d'infanterie, et de 40,000 de cavalerie), formait le complément d'une population si peu faite pour s'entendre, et c'était là sans doute un élément d'ordre, puisque c'était le principal moyen de gouvernement, mais cette garnison elle-même et les familles qui s'y rattachaient, méritaient de la part du prince une attention extrême. Si la race macédonienne en formait le fond, il s'y trouvait une majorité de mercenaires venus de tous les pays et habitués par tous les genres de séductions à tous les complots et à toutes les révoltes. Sous quelque point de vue qu'on envisage ce mélange de peuples divers, on conçoit que, pour ne pas le laisser un péril pour le gouvernement et pour le fondre en une sorte de syncrétisme social, il fallait de puissants moyens d'influence et d'éducation politique. Distribués dès l'origine par quartiers et distingués les uns des autres non-seulement par leur langue et leur costume, mais par la juridiction à laquelle ils étaient soumis, les habitants d'Alexandrie s'observaient avec des sentiments d'hostilité et de jalousie, qu'il fallait d'autant plus s'efforcer d'anéantir, que toutes les fractions de cette population étaient plus enclines aux nouveautés, et qu'il étaιt moins sage de compter sur (73) des troupes toujours disposées à suivre quiconque pouvait les acheter. Dans ces conjonctures, montrer de la bienveillance à tous, leur assurerà tous des droits égaux, une entière liberté de culte et d'industrie , c'était sans doute les attacher à la cité, au pays, et même à la dynastie; mais ce n'était pas encore satisfaire à tous leurs besoins, en former une nation et se préparer un avenir. Les Lagides, après avoir rempli les devoirs d'une politique vulgaire, et ils les remplirent — car on ne saurait ajouter foi à ce que disent Philon et Josèphe sur l'imprudente prédilection de ces princes pour les Juifs et l'oppression incroyable où ils auraient tenu les Egyptiens (50)—les Lagides, disons-nous, songèrent à l'avenir avec les vues les plus élevées. Pour amener entre les deux principales civilisations qui se trouvaient en présence dans leur royaume, et surtout dans leur capitale, entre les idées, les mœurs et les institutions des Grecs et des Egyptiens, cette transaction qui était la loi suprême de leur gouvernement, ils cherchèrent à confondre la science et les arts de deux nations dont l'une se glorifiait d'avoir tout inventé, dont l'autre avait tout perfectionné, et qui, tout en se rencontrant sur quelques points, différaient sur presque tous les autres. Cette fusion pouvait satisfaire les esprits distingués, et répandre ses lumières sur les individus de toute nation qu'attirerait la fortune d'Alexandrie ou celle de l'Egypte. Si, dans cette transaction, l'Egypte devait avoir d'abord une part prépondérante; si celles de ses lois et de ses mœurs qui étaient encore debout devenaient nécessairement le point de départ, dé profondes modifications devaient néanmoins y être apportes dans la suite des temps et des tendances grecques prévaloir enfin dans toutes les institutions. Les Egyptiers conserveraient ainsi toutes les illusions de leur national té religieuse, mais ils trouveraient dans les créations nouvelles toutes les supériorités et toutes les séductions (74) du génie grec. De là, sous le règne des premiers Lagides, le maintien des anciens collèges de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis ; mais de là aussi la création de ce superbe Gymnase, qui occupait un immense espace sur la principale rue de la cité; de là, cette vaste Bibliothèque, dont les collections embrassaient tous les ouvrages de science et de littérature; delà, enfin, ce royal Musée, où l'on réunissait, sous la présidence d'un prêtre, les savants les plus distingués du monde connu.
Quant au gymnase, qui a dû jouer un rôle important sous tous les rapports, il est inconnu dans les annales littéraires d'Alexandrie ; et il y serait connu, qu'il n'entrerait pas dans notre plan d'en parler. Il n'y aurait d'ailleurs rien à dire sur le but de sa fondation ; un gymnase ne pouvait manquer dans une ville créée par un élève d'Aristote. La première bibliothèque et le premier Musée d'Alexandrie, méritent, au contraire, toute notre attention. Il est vrai que la fondation d'une collection faite dans un but scientifique n'a rien d'étonnant de la part d'une dynastie dont le chef avait coopéré, sans nul doute, sous les ordres d'Alexandre, à enrichir la Bibliothèque d'Aristote, pas plus que la création d'un Musée de la part d'un prince, dont le conseiller intime, Démétrius de Phalère, avait concouru dans Athènes à la fondation du Musée de Théophraste (51). Mais ces deux institutions auraient une tout autre signification, si, dans leur création, des vues politiques s'étaient jointes à des vues scientifiques el littéraires.
Dans ce que l'on a écrit jusqu'ici sur ces grands établissements, on a aussi complètement négligé le point de vue politique que le point de vue moral. Cependant si nous en croyions un écrivain ancien, ce serait une pensée purement politique qui aurait présidé à cette double création. Démétrius de Phalère, dit Plutarque (52), conseilla à Plolémée Soter de s'entourer d'une collection de livres où il pût trouver, (75) sur l'art de régner, des conseils et des maximes de gouvernement que n'oseraient lui donner même ses meilleurs amis. Or, celte indication, prise dans le sens qu'elle doit avoir, nous parait être d'une haute importance ; et après les considérations que nous venons de présenter, il ne saurait plus y avoir le moindre doute que des vues politiques ne soient entrées pour beaucoup dans la création des deux premières institutions littéraires d'Alexandrie. A. celles que déjà nous avons indiquées, il faut joindre surtout, de la part du chef des Lagides, le désir d'entourer la nouvelle dynastie et ses conseillers de toutes les lumières dont ils avaient besoin pour suivre ce système de gouvernement que nous venons de signaler comme le seul qui leur convînt. On voit combien les études politiques étaient suivies en Grèce, à l'école de Socrate, dans l'école de Platon, dans celle d'Aristote, philosophe qui avait réuni dans un ouvrage perdu pour nous des documents sur les institutions sociales de cent-cinquante états différents. Un élève de cette école, Démétrius, ayant à diriger les choix d'un prince grec, devait conseiller ces études et recommander cette littérature au chef de la nouvelle dynastie qui s'élevait en Egypte avec des vues sur la Phénicie, la Palestine, la Cyrénaïque, les îles et le continent de la Grèce. Réunir les chefs-d'œuvre de la littérature grecque et les déposer dans un édifice royal, aux abords même d'un pays aussi célèbre par son antique sagesse et ses puissantes institutions ; y joindre aux ouvrages de politique ceux de morale et de religion qui en étaient inséparables; relever une telle collection par tous les monuments du génie humain et rapprocher ainsi les codes de l'Egypte et de la Judée, les maximes des sages et les inspirations des prophètes de ces pays des lois de Lycurgue et de Solon comme des poésies d'Orphée et d'Homère ou des doctrines de Platon et d'Aristote, c'était là précisément créer ce foyer de civilisation mixte que réclamait la situation des Lagides. Quand, parmi les érudits, on s'est débattu jusqu'ici (76) sur la question de savoir si le fondateur de la première bibliothèque d'Alexandrie a suivi, en la créant, l'exemple des anciens rois d'Egypte, celui de Pisistrate, celui d'Aristote ou celui des rois de Pergame, on s'est mis si complètement en dehors du vrai, qu'on n'a pu faire que de l'érudition sans portée. Que dans l'exécution on a suivi ce qui se trouvait en vue ou ce qui avait précédé, cela est hors de doute; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, c'est de la première pensée d'un prince ou de celle de son conseiller, et quant à celle-là, elle fut politique.
Si, d'après cela, il est à croire qu'une pensée de cet ordre entra pour beaucoup dans la création de la première bibliothèque d'Alexandrie, il est également hors de doute que cette institution fut l'œuvre de Ptolémée Soter, et qu'elle remonte jusqu'aux dernières années du iv* siècle avant notre ère. A cet égard, c'est incontestablement l'opinion de saint Irénée, de saint Clément d'Alexandrie et de Théodore, qu'il faut préférer à celles d'Eusèbe , de Tertullien, de saint Augustin et de saint Epiphane, ainsi qu'aux traditions judaïques sur la version des Septante, traditions qui confondent l'origine de cette version avec celle de la bibliothèque elle-même pour laquelle elle fut ordonnée, et qui donnent Ptolémée II comme fondateur d'une collection qu'il trouva riche en arrivant au pouvoir (53}. En effet, aidé de Zénodote, le premier chef de la bibliothèque, Démétrius, qui en avait conseillé la création , l'avait fait augmenter sous le premier des Lagides à tel point, que le second y trouva 200,000 volumes (54).
Cependant, si importante que devînt cette institution, elle le fui moins qu'une autre qu'elle amena sans doute à sa suite, si elles ne furent pas conçues ensemble , et qui (77) fut essentiellement littéraire encore, mais qui était conçue dans des vues analogues, j'entends le Musée , qui ne fut ni une école sacerdotale d'Egypte, ni une école philosophique de Grèce, mais qui, formée à l'exemple de ces institutions, devait cultiver la science avec une sorte de liberté, à l'instar du Lycée ou de l'Académie, et se soumettre néanmoins à une sorte de direction religieuse, à l'instar des instituts d'Héliopolis et de Memphis. En effet, le Musée fut une institution de transaction. D'abord ce ne fut pas un collège de prêtres, ce ne fut qu'un synode desavants, pour nous servir de la définition de Strabon (55). Ensuite, ce ne fut pas une école de philosophes réunis librement et à leurs frais autour d'un chef indépendant et de leur choix; ce fut une sorte de communauté littéraire élue par un prince, présidée par un prêtre, réunie au même palais et à la même table. Enfin, ce ne fut ni une institution locale, ni une institution nationale, ni grecque, ni égyptienne. Si l'Egypte en était le théâtre, dans le monde grec tout entier on pouvait y aspirer comme en Egypte. Le Musée , dit Philostrate, est •une table égyptienne , qui dans le monde entier appelle à elle les hommes illustres (56). On voit combien une telle insiitution laissait derrière elle, sous le rapport de la grandeur, ou de l'universalité, si l'on veut parler le langage de Philostrate, les établissements locaux de Memphis et d'Athènes. Or quelles qu'aient été réellement ses destinées, on comprend la portée politique qu'elle devait avoir dans la pensée de son auteur. Dans les indications que nous ont laissées des écrivains qui ont vécu longtemps après son fondateur, Strabon, Philostrate, Eustathe, c'est un synode de savants, une table égyptienne , un Prytanée académique. La plupart des modernes n'y ont pas vu davantage (57). Il en est qui n'y ont reconnu (78) qu'une imitation du Musée de Platon ou de Théophraste. Mais il est probable que, si les écrits dont il fut l'objet de la part de Callimaque, d'Aristonicus, d'Apollonius de Rhodes, de Calixène et d'Andron , tous antérieurs à Strabon , nous fussent parvenus , nous en concevrions une idée fort différente et beaucoup plus élevée.
Pour se faire du but primitif de cette institution des notions précises et complètes , abstraction faite des destinées qu'elle eut dans la suite, il faut non-seulement la distinguer de la bibliothèque, mais encore de l'école d'Alexandrie, avec laquelle on l'a souvent confondue.
Pour ce qui est de la bibliothèque, nous verrons bientôt qu'il n'est pas plus possible de confondre en une seule institution la bibliothèque et le Musée, que d'assigner un seul bâtiment à l'une et à l'autre. On ne doit pas confondre davantage le Musée avec l'école d'Alexandrie. Le Musée, composé de membres primitivement élus par le prince et admis dans ses palais à une table commune, fut le noyau de l'école ; il ne, fut pas l'école. Celle-ci se forma librement sous l'influence du Musée, et se rattachant étroitement à ses travaux, mais embrassant tous les savants d'Alexandrie, externes comme internes. En un mot, le Musée d'Alexandrie fut une institution royale, et ce qu'on appelait l'Ecole d'Alexandrie ne fut jamais qu'une agrégation idéale, vague à tel point qu'on y comprenait des écrivains qui n'avaient jamais habité la célèbre cité, mais qui avaient imité ses travaux, ses goûts et son langage. Aujourd'hui on embrasse sous cette dénomination non-seulement tous les savants d'Alexandrie, mais encore (79) toutes les institutions littéraires de cette ville. Demander le but d'une telle école, ce serait faire un non-sens ; on peut et on doit, au contraire, rechercher la pensée qui inspira la fondation du Musée.
D'abord, il faut s'entendre sur la question. Que le but de cette institution ait été littéraire, cela ne souffre pas de doute; et il est certain que le Lagide qui rassembla la première Bibliothèque et ouvrit le premier Musée, aimait les lettres et voulait qu'on les y Cultivât. Cela ne fait pas question. Mais a-t-il voulu essentiellement aussi que, dans sa capitale, les lettres ne fussent cultivées ni avec les mêmes vues et la même liberté qu'en Grèce, ni avec la même dépendance et les mêmes tendances qu'en Egypte? A-t-il voulu, non .pas une école philosophique d'Athènes , ni un collège sacerdotal d'Héliopolis ; mais une institution qui réunît à quelques-uns des avantages du collège égyptien quelques-uns des avantages de l'école grecque? Voilà ce qui fait question. Il a dû vouloir cette fusion; cela était évidemment dans son intérêt de chef de nation et de chef de dynastie; mais formuler sa pensée d'une manière précise et affirmer qu'il désirait se former au Musée des conseillers ou des instruments politiques , qu'il espérait amener par eux les Grecs à quelques habitudes égyptiennes, les Egyptiens à quelques habitudes grecques, tous, dans la suite des temps, à des mœurs et à des croyances communes, ce serait peut-être lui attribuer des vues qu'il n'eut jamais. Toutefois on ne se trompera pas sur ses intentions quand on se persuadera qu'il se flattait de fonder une institution qui jeterait sur sa dynastie un puissant éclat et qui exercerait sur l'Egypte et la Grèce, sous le rapport des doctrines et de la science, une action profonde. Or, c'est là ce que nous appelons le but profondément politique d'une institution essentiellement littéraire, et ces vues entrèrent évidemment dans la création de Ptolémée Soter ; car l'origine du Musée est aussi du règne de ce prince; nous allons le prouver, comme nous l'avons fait pour la Bibliothèque.
(80) Le fondateur du Musée n'étant pas désigné par les anciens, on a émis trois opinions différentes sur l'origine de cette institution . Suivant les uns ce serait Ptolémée Soter, suivant les autres, Ptolémée Philadelphe qui l'aurait créée ; suivant d'autres encore elle serait du règne commun de ces deux princes, c'est-à-dire de l'an 285 à l'an 283 avant notre ère (58). Mais il est hors de doute que le Musée est l'œuvre du premier de ces deux princes. A la vérité cela ne résulte pas de textes positifs, mais cela ressort d'une série de considérations. Il y a des textes qu'on peut invoquer en sens contraire; c'est assez dire qu'ils manquent d'autorité. On peut interpréter en faveur du père, ces mots de Plutarque: Πτολεμαῖος ὁ πρῶτος συναγαγὼν τὸ μουσεῖον (59) ; mais ces mois peuvent se traduire aussi bien par, celui des Ptolémées qui le premier réunit le Musée , que par, Ptolémée premier , qui réunit le Musée ; et dès-lors il faut les abandonner. On peut alléguer en faveur du fils ce passage d'Athénée : Περὶ δὲ βιβλίων πλήθους καὶ βιβλιοθηκῶν κατασκευῆς καὶ τῆς εἰς τὸ μουσεῖον συναγωγῆς τί δεῖ καὶ λέγειν (60) : Que dire de la multitude de livres et du soin qu'il a pris de procurer des bibliothèques et de réunir des savants au Musée ? Ici encore rien de décisif pour le fils , rien d'exclusif pour le père, rien qui fasse connaître le fondateur d'une manière certaine ; et dès-lors il faut abandonner ce texte aussi. Plutarque et Athénée, qui fournissent ces lignes, ont vécu près de cinq siècles après la création du premier Musée, et de leurs textes il résulte une seule chose qui soit bien positive, c'est que, dans l'intervalle qui les séparait de l'origine du Musée , les traditions étaient devenues si incertaines que, dans les unes, on parlait davantage du premier , dans les autres, du second des deux (81) princes. Mais , il est deux sortes de faits qui établissent la création du Musée par Ptolémée Soter : les uns la rendent probable, les autres, certaine.
Voici les premiers. Ptolémée Soter cultivait les lettres avec amour et avec succès, appelait les savants à sa cour, aimait à s'entretenir avec eux et à correspondre avec ceux qu'il n'avait pu attirer dans ses palais (61). A peine proclamé roi, 306 avant J.-C., il avait reçu près de lui Démétrius de Phalère ; et avant d'associer à son empire Ptolémée Philadelphe, il avait fondé, sur le conseil de ce littérateur, la grande bibliothèque. Or , Démétrius avait secondé Théophraste dans la création de son Musée (62): devenu conseiller d'un prince passionné pour les lettres et qui pressait tous les savants les plus distingués de le joindre en Egypte, n'a-t-il pas dû l'engager à leur ouvrir, dans ses palais, un Musée semblable à ceux que les Péripatéticiens et les Platoniciens avaient fondés en Grèce de leurs propres deniers ? Une idée si simple ne pouvait pas ne pas se présenter à la pensée de Démétrius ; et le prince qui construisait des temples , des hippodromes, des gymnases, des théâtres, des résidences et des sépultures royales, ne pouvait pas ne pas la réaliser. En effet, il avait appelé près de sa personne des poêles, des historiens, des philosophes, des mathématiciens, des médecins et des artistes, les uns pour leur remettre le soin de sa grande collection de livres et s'éclairer de leurs lumières [ Démétrius de Phalère, Théodore d'Athènes , Diodore Kronos, Rhinton deCorintbe, Archélaùs, Lycus et Euclide furent de ce nombre] ; les autres pour leur confier l'éducation de son successeur [Philétas, Zénodote et Straton de Cos donnèrent des leçons à Philadelphe] ; d'autres encore pour (82) les charger des constructions qu'il méditait [ ce qui constituait la mission de Dexiphane et de Sostrate], Or il devait nécessairement les rapprocher de ses demeures et les réunir autant qu'il le pouvait : en un mot, il devait les loger dans ses palais, c'est-à-dire fonder le Musée. Cette institution fut établie dans ses palais et le Musée fut fondé.
Voici maintenant les faits qui ne permettent pas de contester la fondation du Musée à Ptolémée Ier. Un ouvrage sur cette institution fui publié par Callimaque sous le règne de Ptolémée lI, Cet écrit n'était pas un tableau de l'avenir , un prospectus ; c'était une notice historique ou panégyrique sur le Musée. Était-il possible de la composer sur une institution qui venait de naître? Cela était-il dans les mœurs des anciens? N'était-il pas, au contraire, dans leurs habitudes d'écrire sur des établissements qui étaient en possession d'une certaine célébrité? Ce qui confirme nos inductions tirées de cette description, ce sont celles que suggère une épigramme dont le Musée fut l'objet à la même époque. L'auteur de cette épigramme , Timon le Phliasien, avait reçu de Ptolémée II un accueil distingué ; mais riche du fruit de ses talents et jaloux de l'indépendance qu'ils lui assuraient, il ne fut nullement tenté de s'agréger au Musée ; dans son humeur caustique le fameux sillographe fit, au contraire, sur cette institution des vers qui prouvent évidemment qu'elle n'était ni de création récente, ni l'œuvre du prince qui venait de l'accueillir. « Beaucoup de gens, dit-il, sont nourris dans la populeuse Egypte, des combattants à coups de livres, qui luttent sans fin dans la cage des Muses , (63). Cela ne pouvait se dire de savants réunis nouvellement; car cela indique des habitudes prises, un état de choses connu. Or , ce n'est pas en un jour que se contractent des mœurs (83) littéraires , que se dessine le caractère d'une institution. Après tous ces faits il nous faudrait les [textes les plus positifs pour contester au premier des Lagides et à son conseiller Démétrius l'honneur de cette fondation.
Je ne réfute pas l'hypothèse de ceux qui ont imaginé, pour concilier toutes les opinions, d'attribuer l'origine du Musée au règne commun des deux premiers Lagides. Cette hypothèse est puérile ; et le second de ces princes portait à Démétrius, qui fut le véritable conseiller de la mesure, des sentiments trop hostiles pour s'associer à ses desseins. On sait qu'à peine élevé sur un trône que Démétrius destinait au fils de la première femme de Soter, il bannit de sa cour le fugitif d'Athènes, qui mourut bientôt dans l'exil.
Ce fut donc sous le règne du premier des Lagides que se forma le Musée; et il est probable que l'origine de cette institution fut à peu-près contemporaine de celle de la Bibliothèque, dont elle devait être le complément et la conséquence. Or quand je considère tout le règne de Ptolémée Ier, je n'y trouve pas d'époque plus favorable à cette création que celle qui suivit l'an 306 , où ce prince fut proclamé roi, ou celle qui suivit l'an 394 , où il commença de jouir d'un état de paix et de prospérité que lui envièrent tous sec émules. Si Ptolémée Soter, pour accomplir ses desseins sur l'Egypte et la Grèce, pays où les collèges sacerdotaux et les écoles philosophiques jouaient un si grand rôle, avait besoin d'une institution qui, unissant les avantages des uns et des autres, exerçât une action profonde sur les mœurs, la langue et la littérature, c'est-à-dire sur la vie morale et politique des peuples qu'il désirait soumettre à sa dynastie, et préparât cette fusion des esprits et des intérêts qu'il était du devoir de son gouvernement d'établir dans sa capitale, pour l'étendre de là sur les provinces , il n'a pas dû tarder à joindre le Musée à la Bibliothèque.
Cependant, pour atteindre les vues morales et politiques qu'il apportait à la création de deux institutions littéraires, (84) il a dû aussi dès l'origine les fonder sur des bases nettement arrêtées. Nous avons vu de quels éléments se composait cette population d'Alexandrie dont il s'agissait de faire le type de la nation ; et l'on conçoit, en l'examinant, que sa tâche n'était pas facile. On le conçoit encore mieux quand on considère les habitudes d'esprit et de conduite de ceux qu'il devait employer comme principaux instruments, de ces philosophes grecs si indépendants, de ces littérateurs d'Athènes si imbus de scepticisme et de démocratie. N'était-il pas téméraire de les appeler au milieu de ces Egyptiens à peine échappés au réseau de leur antique théocratie et façonnés à la révolte par les vexations de leurs derniers maîtres ; deces Juifs, partout marchands avides, citoyens indifférents pour tous les règnes; de ces aventuriers de la Grèce et de l'Asie, qui n'avaient de lois et d'idoles que les faveurs de la fortune ou celles d'une cour quelconque; de ces mercenaires enfin, à qui tant d'ambitieux lieutenants d'Alexandre enseignaient depuis vingt ans le mécontentement et la défection? N'était-il pas à craindre que, libres de leurs travaux et de leurs paroles, les mêmes hommes qu'installait le Lagide dans ses palais pour l'éclairer de leurs lumières et jeter sur son règne l'éclat de leur génie, n'y répandissent le doute des écoles grecques et le désordre de l'agora d'Athènes ; qu'entre les doctrines et les religions diverses, il n'éclatât autant de querelles qu'entre les divers éléments de la population, et qu'ainsi ne se développassent dans Alexandrie, sous le patronage même des rois, tous ces germes de dissolution sociale dont le rapide progrès présageait déjà la chute de la Grèce? Dans ce cas ne valait-il pas mieux maintenir et propager les collèges sacerdotaux de l'Egypte et faire d'Alexandrie la rivale de Memphis?
Sans nul doute. Mais le génie qui créa le premier Musée et la première bibliothèque d'Alexandrie, sut donner dès l'origine à ces institutions une organisation conforme à ses desseins et propre à les préserver de déviations aussi périlleuses.
Organisation Du Premier MusÉe Et De La PremiÈre BiblioThÈque. — Rapports Entre Les Deux Institutions Et EspÉrances Qu'elles Faisaient Concevoir.
Les membres du Musée dressèrent, presqu'au début de leurs travaux, des canons où ils nommaient, par catégories et par ordre de mérite, les meilleurs auteurs de leur époque ou du passé. Puis, pour signaler à la postérité, comme à leurs contemporains, les plus éminents parmi ceux qu'on devait admirer , ils les désignèrent sous le nom de pléiades, et en formèrent une sorte de Musée idéal, qui embrassait tout le monde grec et tous les siècles de sa gloire. Plusieurs membres du Musée d'Alexandrie figurèrent eux-mêmes sur ces tableaux d'honneur. Si l'un d'eux eût daigné descendre à un travail plus humble, et dresser par catégories une simple liste de tous les membres du Musée, que de questions ce document parvenu jusqu'à nous viendrait nous expliquer ! Sans doute il ne nous dirait rien sur le local, l'administration et la direction du Musée, sur son organisation intérieure, ses ressources financières et ses moyens scientifiques ; mais il nous ferait au moins connaître le nombre de ses membres et leurs noms, y compris celui du chef, peut-être aussi leur répartition en classes ou en catégories, et la distinction qu'ils établissaient entre les commensaux de l'institution et les simples savants de la ville. De plus, une foule de questions secondaires se résoudraient au moyen de ces notions fondamentales, et jamais travail plus aisé n'eût été plus utile. Mais personne n'a songé à ce tableau si simple; et les descriptions que plusieurs écrivains d'Alexandrie avaient (86) publiées sur le Musée s'étant perdues, tout ce que nous avons aujourd'hui de renseignements sur son organisation, ce sont quelques lignes de Strabon, qui a vécu trois siècles après son fondateur.
Avant d'examiner ces lignes et d'en tirer les inductions qu'elles fournissent, voyons d'abord quelle confiance elles méritent. Strabon, qui accueille quelquefois des traditions assez suspectes, ne fut pas du Musée; et s'il vit Alexandrie, il ne la vit qu'après l'incendie qui en avait dévoré la Bibliothèque. Il ne fut qu'un étranger dans cette ville dont les institutions littéraires furent pour lui un objet secondaire, nous l'avons vu dans la description qu'il en donne. Cela est incontestable. Cependant Strabon avait fait un séjour prolongé dans Alexandrie ; il y avait recueilli beaucoup de matériaux pour sa géographie, s'y était attaché au philosophe Boéthus et lié avec le poète Elius Gallus, qui, en sa qualité de gouverneur de l'Egypte, remplaçait en quelque sorte les anciens patrons du Musée. Dans l'hypothèse do Malte-Brun, qui admet deux rédactions de l'ouvrage de Strabon, la première aurait été faite à Alexandrie même, vers l'an 24 de notre ère, et dans ce cas un texie rédigé en face du Musée mériterait assurément un haut degré de confiance. Mais cette supposition est peu fondée, et c'est ailleurs qu'il faut chercher le degré d'autorité que peut avoir cet écrivain. Et d'abord , on ne saurait guère admettre qu'un homme tel que lui, qui pouvait si aisément savoir la vérité, et qui voulait, comme il le fait, comparer l'état ancien de l'institution avec sa situation sous les Romains, n'ait pas pris de renseignements exacts sur un établissement qu'il avait visité, et qu'il dépeint en traits pleins d'indications. En effet, il ne se borne pas à le montrer tel qu'il était de son temps, sous Tibère; il regarde au passé, et cite sur son organisation «ne coutume commune aux rois grecs comme aux Césars. Celle de choisir un prêtre pour président, remontait évidemment aux temps primitifs de l'institution, et convenait plus aux projets de (87) Ptolémée Soter qu'à la pensée de ses successeurs, dont aucun n'eût pu l'introduire sans faire une de ces innovations qui marquent une époque dans les annales d'une institution. En général , les indications de Strabon sur le Musée se bornent à ce qui est de coutume ancienne, à ce qui a toujours été tel qu'il l'a vu. Elles méritent donc de notre part une confiance entière, et si concises qu'elles soient, elles fournissent les inductions les plus positives. Les voici : Τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον μέγαν ἐν ᾧ τὸ συσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν. Ἔστι δὲ τῇ συνόδῳ ταύτῃ καὶ χρήματα κοινὰ καὶ ἱερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείῳ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ τῶν βασιλέων νῦν δ´ ὑπὸ Καίσαρος. « Une partie des palais royaux forme aussi le Musée, qui a une promenade, une galerie à sièges, une grande salle où se font les repas communs des hommes savants qui participent au Musée. Cette compagnie a des revenus communs, et pour chef un prêtre autrefois préposé au Musée par les rois, maintenant par César (64).
De ce texte, qui contient un résumé savant, résultent six faits principaux : 1° Le Musée était un bâtiment spécial, exclusivement affecté aux savants ; 2° II était pourvu de ton t ce que demandait leur séjour habituel ; 3° C'était une institution de l'état; 4° Dotée par l'état de revenus spéciaux, elle était sous l'action directe du gouvernement, qui en désignait le chef; 5° Ce chef était un prêtre ; 6° La présidence d'un prêtre, et le nom même du Musée, conféraient à l'établissement une sorte de caractère religieux. Ces résultats généraux méritent quelques développements.
Le Musée était un bâtiment spécial, affecté exclusivement aux savants. Ces derniers étaient les hôtes des rois ; mais ils n'étaient ni leurs commensaux, ni relégués par eux dans quelques coins perdus de leurs palais; au contraire, ils se trouvaient installés dans une demeure royale dont ils (88) étaient les seuls habitants. Dans cette disposition, il y avait, pour le prince, un degré suffisant d'action et d'autorité, pour .eux, un degré suffisant d'indépendance et de dignité. En effet, si le choix d'un palais dans le quartier royal marquait bien la position du Musée vis-à-vis du chef de l'état, il donnait aussi à l'institution naissante, dans un pays où jusqu'ici le sacerdoce seul partageait les demeures des rois, le rang qu'elle devait occuper dans l'intérêt de la dynastie. D'un autre côté , elle avait cette apparence de liberté que réclamait le culte des lettres et qui lui donnait sur l'opinion le crédit dont elle avait besoin.
Dans l'intérêt des lettres, le palais était pourvu de tout ce que demandait le séjour habituel des savants. Comme dans les gymnases grecs on y trouvait un exèdre, c'est-à-dire une galerie ouverte sur le devant, munie de sièges pour les conversations ou les discussions des savants, et quelquefois garnie de tableaux ou de caries pour leurs leçons, comme les portiques eux-mêmes. Ces exèdres s'établissaient sous les portiques, et y prenaient plus ou moins d'espace, suivant l'importance de l'institution. Ce que Vitruve en dit d'une manière générale, trouvait parfaitement son application au Musée d'Alexandrie : Constituuntur in tribus porticis exedrœ spatiosœ, habentes sedes, in quibus philosopha, rhetores, reliquique qui studiis delectantur, sedentes disputare possint. (65)
Pour l'ordinaire les philosophes de la Grèce préféraient à l'exèdre, la promenade. Recherché à l'Académie comme au Lycée, le péripatos, qui était un bois plus ou moins étendu, et qui se composait au moins d'une allée d'arbres, ne pouvait manquer au Musée ; il y ayait un parc près la demeure des roisj on traita les savants à-peu-près comme eux, enjoignit une promenade à leur palais. M. Parthey n'a pas craint d'y ajouter des fontaines jaillissantes. Il faut lui savoir gré de (89) cette attention. Quant à la promenade, Strabon n'en parlerait pas , qu'il faudrait l'admettre. Elle se trouvait au Lycée, où il était si difficile d'en établir (66). Diodore de Sicile, qui a probablement imaginé son Osymandéum d'après le Musée et la Bibliothèque d'Alexandrie, ne manque pas de mettre une promenade dans sa description (67).
En Grèce, le péripatos et l'exèdre étaient les parties d'un gymnase public les plus accessibles aux philosophes. Aux Musées de Platon et de Théophraste, ainsi qu'au jardin d'Épicure, c'étaient là les principaux lieux de réunion. Cependant dans ces institutions particulières, il existait pour les philosophes, d'abord, des droits plus étendus; ensuite, une communauté d'intérêts telle que, probablement, ils se réunissaient comme dans l'Institut de Pythagore aux heures des repas. Non-seulement cette coutume avait été adoptée par le fondateur du Musée, mais il y avait consacré une salle qui se distinguait par son étendue, et qu'on appelait la grande maison. On a conclu de cette dénomination, que la salle à manger du Musée formait un édifice particulier. Rien n'autorise toutefois cette conclusion ; le mot de οἴκος a très souvent le sens de salle à manger, et l'on peut voir dans Vitruve avec quel luxe l'Egypte bâtissait ces salles (68). Strabon parle d'une seule salle. N'y en eut-il qu'une? N'y eut-il pas au moins plusieurs tables? En expliquant un fait qui s'est passé au Musée lors de la présence de Caracalla en Egypte, et en écoutant son imagination plutôt que les textes, un écrivain moderne a supposé que chacune des différentes sectes de philosophes a formé une table à part, une syssitie présidée par le chef de l'école. Il a joint à cette hypothèse celle que les présidents de sections auraient composé avec celui du Musée le conseil d'administration de la maison (69). Mais (90) d'abord, un pareil fractionnement n'entrait pas dans les vues du fondateur. Ensuite, il eût entraîné de grandes difficultés de gestion, puisqu'il eût été également impossible de former ou une seule syssitie pour tous les philosophes, ou des syssities spéciales pour chaque groupe. Enfin, rien n'eût été plus contraire au gouvernement des Lagides que ce conseil d'administration, qu'on adjoint si gratuitement à la présidence. A la vérité, on invoque, pour appuyer l'improvisation de ces présidents, le mot de προστάντες qui se trouve dans un texte ancien (70) ; mais ce mot n'y a pas le sens qu'on lui donne; il indique non pas des présidents de section, mais les membres du Musée eux-mêmes, qu'il nomme avec raison des chefs ou des hommes éminents, puisqu'ils étaient à la tête de l'enseignement et de la littérature. Veut-on de cette interprétation une démonstration frappante? qu'on prenne un instant les προστάντες pour des chefs de sections, et qu'on essaie de traduire dans ce sens le passage en question. On aura ces mots : Eratosthène, que les chefs de sections du Musée appelaient Béta. Or, il est absurde d'imaginer que ce soient les chefs seuls qui aient donné ce nom au savant géographe, et il faut admettre nécessairement que c'étaient les membres eux-mêmes. Y avait-il donc au Musée des chefs de sections au temps d'Ératosthène? Sans doute qu'au temps de Caracalla il y eut dans Alexandrie plusieurs syssities — et nous verrons en son temps ce qu'elles étaient — mais jamais il n'y eut au Musée ni plusieurs tables distinctes dans la même salle à manger, ni plusieurs salles à manger, ni des présidents de section, ni un conseil d'administration.
Nous ajoutons un mot sur la salle à manger. Son existence au Musée indique de la part des littérateurs un séjour plus habituel que les philosophes de la Grèce n'en faisaient au Lycée et à l'Académie d'Athènes. Cependant, dans les textes anciens, rien ne montre que les savants (91) fussent logés au Musée. Les Pythagoriciens habitaient en commun ; les Péripatéticiens demeuraient ensemble au Musée de Théophraste, les Épicuriens, à l'Epicuréum. Je ne doute pas d'après cela que les membres du Musée n'aient eu leurs logements dans ce palais. Strabon , il est vrai, n'en parle pas, et l'on peut tirer une induction négative de son silence ; cependant il se tait aussi, dans sa description d'Alexandrie, sur des choses beaucoup plus importantes, par exemple l'enseignement public des savants, el l'on ne saurait inférer de son silence qu'ils n'enseignaient pas. Il est certain, au contraire, qu'ils faisaient des leçons soit au Musée, soit à la bibliothèque, soit au gymnase, soit enfin dans quelque autre édifice- Or, si Strabon a pu ne pas dire où ils enseignaient, et si de son silence on doit inférer naturellement que c'était au Musée , il a pu très bien aussi ne pas rapporter où ils logeaient, et si l'on doit inférer quelque chose de son silence, c'est qu'ils logeaient au Musée. En effet, puisqu'ils y faisaient leurs cours, leurs repas et leurs promenades , ils y avaient évidemment leur domicile. Mannert veut qu'ils aient demeuré dans le voisinage (71). Il ne pouvait y avoir que deux raisons pour ne pas les admettre dans le palais même, leur nombre et leurs familles. Mais, d'abord pour ce qui est du nombre, qui ne fut pas une difficulté dès le début de l'institution, il ne paraît. pas qu'il ait jamais été très grand, nous le verrons. Si toutefois il le fut, on n'a pas dû en être fort embarrassé. Ce que fit Claude en créant un nouveau Musée sous la domination romaine, était plus facile encore sous la domination grecque. Ensuite, quant aux familles , on sait. que la plupart des philosophes anciens n'étaient point mariés. Ceux mêmes qui l'étaient et qui se rendaient à Alexandrie, n'y amenaient pas sans doute leurs femmes et leurs enfants. Pour les femmes et les enfants , il est évident qu'il n'y en eut pas au Musée. En Grèce, il est vrai; les femmes (92) cultivaient les lettres et la philosophie (72) ; mais même en ce pays, elles ne pouvaient assister aux leçons des philosophes qu'au moyen d'un déguisement. Les mœurs de l'Egypte étaient plus sévères. Une seule femme, la célèbre Hypatie, est nommée parmi les philosophes d'Alexandrie durant l'espace de neuf siècles — car il ne saurait être question de Cléopâtre—'mais ce n'est pas dans les annales du Musée, c'est dans celles de l'école d'Alexandrie qu'elle est citée. Rien ne s'opposait donc au logement des savants dans l'intérieur — car dans mon système je n'y loge ni les établissements de médecine et de chirurgie, ni les copistes et les relieurs, que d'autres y mettent à tort — et comme le Musée formait un bâtiment étendu (73), qu'il y avait l'espace nécessaire pour recevoir les savants appelés en Egypte par Ptolémée Soter, qu'il entrait à-la-fois dans ses vues d'en faire un corps, de les assimiler au sacerdoce du pays et de les rapprocher de sa demeure , il est probable au plus haut degré qu'il les logea. Deux inductions tirées de textes anciens viennent à l'appui de cette opinion. D'abord, dans sa fameuse description de l'Osymandéum, Diodore, qui la traçait d'après le type qu'il avait sous les yeux, dit que le péripatos était plein de toutes sortes d'appartements (74). Or, à quoi des appartements auraient-ils servi, si ce n'est à loger les habitants du palais? Ensuite, dans sa célèbre épigramme sur le Musée, Timon , qui avait vu lui-même cet établissement, le qualifie de cage et en compare les hôtes aux oiseaux de prix qu'on nourrit dans des volières. Or, appliquées à un édifice inhabité ou à des savants disséminés dans la ville et y vivant en toute liberté, ces expressions n'auraient évidemment (93) pas de sens. L'institution elle-même en manquait, si ses membres ne se réunissaient au Musée que pour y manger, discuter et se promener. Cela pouvait être dans les mœurs de la Grèce; cela n'était pas dans celles de l'Egypte.
La dotation spéciale affectée à l'institution est une autre mesure caractéristique. Elle assurait d'un côté le maintien de l'établissement contre les caprices de la cour et les révolutions de l'état; elle la plaçait d'un autre côté sous le contrôle permanent du pouvoir. Il est probable , en effet, qu'elle consistait en domaines ; s'il en eût été autrement, on ne l'aurait pas respectée comme on fit au milieu de tant de bouleversements. Or, constituée de cette manière, elle assimilait le Musée à ces collèges de prêtres qui possédaient encore une partie considérable du pays. Toutefois le Musée ne tenait pas ses terres au même titre que les collèges les leurs; il ne les administrait pas sans l'intervention de l'état, et les Lagides conservaient ainsi sur l'établissement l'action qui entrait dans leurs vues. Cette dotation remontait, sans nul doute, aux temps primitifs de l'institution. A la vérité, aucun texte n'en attribue l'origine à Ptolémée Soter; mais puisqu'elle était ancienne, d'après les mots de Strabon , elle est assurément du règne de Soter. Elle ne saurait être postérieure à Philadelphe, et si elle était réellement l'œuvre de ce prince, celui de tous les Lagides à qui les scoliastes, les compilateurs d'anecdotes et toute la tradition alexandrine prodiguaient le plus de louanges, elle constituait dans son règne un fait trop glorieux pour n'être pas mentionné expressément. Plusieurs fois ces flatteurs ont donné au Musée le surnom de Philadelphion, qui devint plus tard le nom propre du Musée de Constantinople. Certes, Philadelphe étant l'auteur de la dotation, leur adulation eût prévalu. Mais, d'abord, cette mesure entrait dans les vues du fondateur de l'institution, en ce qu'elle conférait au Musée son caractère le plus essentiel ; ensuite, s'il n'en avait pas eu l'idée, Démétrius de Phalère, qui avait contribué de ses de- (94) niers au Musée de Théophraste, la lui aurait bien suggérée. Ce point admis , il s'élève quant à la dotation elle-même , deux questions fondamentales : Fut-elle considérable? Fut-elle laissée à la libre administration des savants? Nous pouvons répondre d'une manière aussi positivé qu'il est désirable à l'une et à l'autre de ces questions, car nous pouvons établir les cinq points suivants. 1° Les revenus du Musée ont suffi aux dépenses d'entretien des bâtiments et aux besoins généraux de la maison. Toutefois il ne faut comprendre dans ces dépenses ni celles de la Bibliothèque, ni celle des établissements de médecine et de chirurgie, ni celles des jardins botaniques ou des dépôts zoologiques que l'on a voulu rattacher au Musée. 2° Ces revenus ont suffi, de plus, pour allouer des indemnités individuelles aux savants. En effet, une anecdote d'Athénée sur le philologue Sosibius, qui s'amusait à transposer dés mots dans le texte d'Homère et à qui Ptolémée Philadelphe, dont il réclamait son traitement, répondit par une plaisanterie fondée sur une de ces transpositions de syllabes, atteste le fait si curieux des indemnités individuelles. Le savant roi, pour prouver au réclamant qu'il était payé, lui montra le registre qui portait les noms de Soter, Sosigène, Bion et Apollonios, et le pria de croire que So-si-bi-os était satisfait (75). 3° Nulle réclamation sérieuse ne s'éleva jamais au sujet de cette dotation et la voix unanime d« plusieurs siècles en célébrait la magnificence. Elle était donc considérable. 4° Elle était assez importante pour que le gouvernement en conservât la surveillance directe , l'anecdote d'Athénée l'atteste. 5° Enfin, l'administration en. était conduite avec une telle exactitude, que les registres mentionnaient nominativement les allocations faites à chaque membre du Musée, comme cela se pratiquait sans doute dans ces collèges sacerdotaux d'Egypte qui avaient des greffiers spéciaux pour leurs trésors et que Ptolémée voulait imiter autant que possible.
(95) Nous voyons une preuve de plus de cette tendance dans le choix qu'il fit pour la présidence du Musée. Ce président, d'après Strabon, fut toujours un prêtre. Or il y avait dans ce choix une pensée de l'ordre le plus élevé. Nommé directement par le prince, ne pouvant être écarté que par lui, un chef sacerdotal donnait par sa dignité personnelle une sorte de caractère religieux à l'institution qu'il présidait. Et plus cela était nouveau dans les mœurs de la Grèce, où les prêtres étaient demeurés jusque-là étrangers aux écoles des philosophes , plus cela mérite attention. Quels motifs ont pu déterminer le Lagide ? Etait-ce le désir d'imprimer une marche plus religieuse à ces débats philosophiques de la Grèce gui alarmaient le sacerdoce ? Ou l'espoir d'établir un ton plus grave dans les rapports entre les savants? Ou l'intention d'attirer plus de considération sur leur compagnie ? Ou celle enfin d'assurer plus de stabilité à l'institution ? Si diverses que paraissent ces pensées, on voit qu'au fond elles se tenaient de près et sortaient toutes ensemble de la situation où le fondateur du Musée trouvait le pays. En effet, quand on envisage l'influence qu'exerçait le sacerdoce sur les mœurs de l'Egypte, l'obligation où étaient les Lagides de donner, d'après l'exemple d'Alexandre, de sincères témoignages d'intérêt aux idées religieuses de la population, et le soin qu'ils devaient prendre de conserver ou de bâtir des sanctuaires, on comprend combien la présidence d'un prêtre était convenable au Musée. Quand on considère de plus le zèle que mettent les premiers Lagides à satisfaire aux besoins religieux de tous leurs sujets, le soin qu'ils prennent de faire traduire en grec un code sacré qui était devenu inintelligible pour les Juifs de leur empire, et d'appeler dans leurs palais des prêtres de tous les cultes (76), on est tenté de croire (96) que le choix d'un prêtre pour la direction du Musée était le seul qui convînt sous tous les rapports.
Il est un de ces rapports qu'il nous faut examiner ici plus particulièrement et qu'indiqué le nom même de Musée. Ce mot jusque là désignait en Grèce, 1° une colline d'Athènes qu'on rattachait à la mémoire du poëte Musée; 2° une sorte de bains décorés avec soin ; 3° des écoles de philosophie accompagnées d'un sanctuaire. Dans l'école de Platon le Musée était peut-être plus sanctuaire ; dans celle de Théophraste, plus école. Démétrius de Phalère, qui avait vu la première et concouru à l'établissement de la seconde, eût peut-être penché pour une simple imitation de celle-ci ; mais j'estime que Ptolémée Soter pencha plus pour une imitation de la première , et qu'élargissant sous plusieurs rapports le Musée de Platon et l'alliance que ce philosophe avait faite entre les lettres et la religion, il institua au Musée un véritable sanctuaire des Muses. Le culte de ces divinités, nous l'avons dit, se rattachait à celui des dieux suprêmes. Platon leur avait dédié un petit temple ; Speusippe y avait fait mettre leurs statues; Théophraste avait songé jusque dans son testament aux déesses à placer dans le sien. Comment Ptolémée Soter, fondant une institution royale et permanente dans le pays le plus sacerdotal du monde , n'aurait-il pas fait un peu plus que ses trois prédécesseurs ? Et à qui plutôt qu'à un prêtre aurait-il confié la présidence du Musée , s'il y établissait les statues et un culte des Muses ? Pour prouver que des serviteurs religieux autres que le prêtre étaient attachés à ce sanctuaire, on a cité une inscription publiée par Falconieri, qui porte ces mots : Asclépiade d'Alexandrie, ministre du grand Sérapis et des philosophes jouissant des immunités , nourris au Musée (77). Mais ce texte ne prouve pas ce qu'on veut (78). Asclépiade n'était pas ministre (νεώκορος) des philosophes, (97) il était un des philosophes, et cette position pouvait' se cumuler avec celle de Néocore du Sérapéum, ainsi que l'atteste une inscription analogue relative à Quintius, Néocore de Sérapis et membre du Musée (79).
Ce qui reste dans une obscurité complète, c'est la nature du service religieux qu'on faisait au Musée. En voyant à la cour des Lagides des prêtres de trois religions différentes, et en considérant, d'abord, les assimilations déjà faites au temps d'Hérodote entre le polythéisme de la Grèce et celui de l'Egypte, puis, les vœux naturels de la nouvelle dynastie, on est tenté de croire qu'elle a désiré cette fusion des cérémonies et des croyances qui s'est opérée un peu plus tard, à la décadence plus complète du polythéisme. On est donc amené à penser qu'elle a fait célébrer une sorte de culte mi-grec mi-égyptien dans le sanctuaire d'une institution qui avait pour but une sorte de fusion dans les idées et dans les mœurs. Mais aucune indication précise ne nous est restée à cet égard, et si l'on peut tirer des inductions, non pas du culte de Sérapis institué pour les habitants de Rhakotis et de Canobus, ni des cérémonies d'intronisation que la nouvelle dynastie faisait célébrer à Memphis d'après les anciens usages, mais d'une grande pompe religieuse dont Ptolémée Philadelphe donna le spectacle pour son avènement, et qui fut d'un caractère entièrement hellénique, on se persuade que ce fut un culte grec que la nouvelle dynastie fit célébrer au Musée. La pompe dont nous parlons eut lieu en l'honneur de Bacchus, dont un grand-prêtre se trouvait à la cour des premiers Lagides, et les Dionysiaques ont joué un rôle notable dans les mœurs d'Alexandrie; cependant jl est à croire que la principale divinité adorée au Musée fut Apollon plutôt que Bacchus, et le président de l'institution fut probablement un prêtre de la première de ces divinités. [Athen. V, c. 6.]
(98) Chargé ainsi de la présidence du culte et de l'administration du Musée, ce prêtre l'était-il aussi de la direction des études? Ceux qui parlent d'un conseil d'administration affirment que la dignité de président fut moins réelle qu'honorifique. Je suis loin de partager cet avis. Je sais que le sacerdoce de la Grèce négligeait les lettres, et montrait de l'indifférence pour les progrès de la philosophie ; mais en Egypte les habitudes étaient tout autres, et les Lagides eussent trouvé facilement dans leurs collèges sacerdotaux un prêtre savant, parlant le grec et pouvant avec honneur figurer à la tête du Musée. Un choix de ce genre, sans blesser les Grecs, flattait les Égyptiens; et rien ne s'y opposait. Je pense toutefois que ce fut un prêtre grec que choisit Ptolémée Soter, et qu'il ne lui fut pas difficile, dans l'Egypte grecque, d'en trouver un assez instruit pour mériter les premiers honneurs du Musée, imprimer à cette institution et aux travaux de ses membres, ainsi qu'à leurs rapports entre eux et avec la oo««, le caractère et la direction convenables, et joindre par là, aux titres que lui donnaient la présidence du coke et celle de l'administration , des titres nouveaux à la considération générale. Faire du président de l'institution un personnage inutile, contrairement au texte de Strabon, qui indique une une autorité réelle, ὁ ἐπὶ μοθσείῳ τεταγμένος, est une inconséquence qui ne compense pas, pour ceux qui la font, le tort de supposer .gratuitement un conseil d'administration composé de présidents de sections.
Désigné par le chef de l'état, le président du Musée en était sans contredit le principal personnage. Cependant son action peu ostensible n'est jamais citée, et le nom d'un seul président est parvenu jusqu'à nous. N'auraient-ils pas eu le loisir d'écrire, et cette circonstance s'expliquerait-elle suffisamment par l'importance des deux fonctions qu'ils cumulaient? On ne s'explique pas de même le silence que garde l'antiquité sur tous les rapports des présidents avec la cour ou avec leurs collègues du Musée même. Le respect (99) dû au caractère sacerdotal et l'intervention prépondérante des princes dans les affaires du Musée ont sans doute fermé la bouche à la chronique; mais il me paraît hors de doute que le président eut à jouer un rôle jusque dans les admissions. et dans les exclusions qui eurent lieu dans l'établissement.
Quant aux admissions il se présente ces trois questions capitales : Quel en fut le mode ? Quelles en furent les conditions, soit de culte et de nationalité, soit de capacité générale? Quelles en furent les limites ? Pour l'époque de première création, nulle difficulté. C'était le prince qui accommodait les honneurs de l'hospitalité aux savants qu'il convoquait de toutes parts. Mais, à cette première presse de philosophes, Πτομεμαῖος ὁ πρῶτος συναγαγὼν τὸ μουσεῖον, succéda un tout autre ordre de choses. Strabon nous dix que, de son temps, le président était nommé par l'empereur , comme il l'était anciennement par le roi. Cela prouve évidemment que, dans la règle, les simples membres n'étaient pas désignés ainsi. Comment et par qui l'étaient-ils ? On ne saurait songer à une élection moderne. Cependant ceux qui dressaient les canons des écrivains classiques et qui, outre ces canons généraux ; .élisaient encore parmi leurs prédécesseurs et leurs contemporains des pléiades honorifiques ou des Musées universels, étaient bien aptes à choisir eux-mêmes leurs collègues ; et il ne faut pas mettre en doute qu'avec leur chef ils n'aient souvent désigné au prince ceux de leurs amis, de leurs compatriotes ou de leurs contemporains qui pouvaient partager leurs travaux. Si étrange que nous nous paraisse une élection faite au Musée., nous verrons bien un prix décerné par un jury d'Alexandrie. Les chefs de l'état conservèrent ou prirent quand ils le voulurent, le droit de nomination ou d'expulsion|; et nous rencontrerons leur action directe sur la composition du Musée, sous la domination romaine comme sous la domination grecque; mais le texte si formel de Strabon fait de ces mesures des exceptions. Si l'on pouvait s'en rapporter à un autre texte assez ancien, mais un peu suspect, il y aurait (100) eu concours. Une lutte, dit l'auteur de la Description de l'Empire, s'étant établie autrefois entre les Egyptiens et les Grecs, pour l'admission au Musée, les Egyptiens ont été reconnus plus subtils et plus parfaits ; ils ont vaincu, et le Musée leur a été adjugé (80). Mais ce résultat n'étant pas confirmé par l'histoire et l'auteur étant dans l'erreur à cet égard, on peut faire de son texte aussi peu de cas que l'on veut. Cependant quand on considère les vieux usages de la Grèce, ces combats si fameux pour toutes sortes de prix, y compris ceux de composition ; ces luttes qu'Alexandre lui-même établit en Egypte entre les artistes grecs et égyptiens (81), et plus spécialement ces jeux d'Apollon célébrés par la dynastie des Lagides (82), on comprend que des faits réels ont pu donner lieu à la tradition que rapporte l'écrivain anonyme. Nous ne hasarderons ici aucune conjecture sur la nature du concours qu'il rappelle; mais, si d'après tout ce qui précède , on peut admettre que le Musée intervenait dans le choix de ses membres ordinaires , il est probable aussi qu'il suivait certaines conditions de culte, de nationalité et de capacité générale. Point de doute à l'égard de la dernière. On avait à demander aux membres du Musée des travaux trop importants, et les Lagides, dans l'intérêt de leur gloire comme de leur politique, avaient trop à cœur de rendre l'institution honorable, pour écouter dans ces choix leur libéralité plutôt que leur raison. Il est certain qu'ils ne mirent pas dans le palais des Muses tous ces parasites du monde grec que la misère ou l'avidité conduisaient en Égypte. On voit, au contraire, qu'ils écrivaient eux-mêmes à ceux qu'ils voulaient attirer, et que c'étaient les hommes les plus éminents, les Théophraste, les Ménandre, les Callimaque et (101) d'autres de ce rang. Aussi Philostrate dit-il formellement qu'ils appelaient du monde entier des hommes éminents : τοὺς ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐλλογίμους (83). D'un autre côté on doit se persuader qu'ils n'affectèrent jamais ni parcimonie ni rigueur. En effet, ni eux, ni les membres du Musée ne furent jamais l'objet d'aucune de ces plaintes que l'amour-propre blessé eût pu arracher à des aspirants déçus dans leurs vœux.
Il en fut de même des considérations de culte et de nationalité. Il n'y eut pas de réclamation , voilà le fait le plus général qu'on puisse établir. Mais ce fait ne préjuge pas la question de savoir quelles furent les religions et les nations admises. Toutes étaient admissibles, sans doute; mais si l'on trouve au tableau un grand nombre de noms grecs, il s'en rencontre peu d'égyptiens ; et l'on doit considérer comme certain que, si les Juifs et les chrétiens suivirent de près les travaux de cette institution, jamais ils ne furent logés dans son enceinte. Malgré toute la faveur que la nouvelle dynastie montra aux premiers et l'attachement qu'ils lui témoignèrent, ni leurs croyances, ni leurs mœurs ne leur eussent permis de vivre, sous la présidence d'un prêtre d'Isis ou d'Apollon, avec les Polythéistes de la Grèce ou de l'Egypte. Il en était de même des chrétiens, qui ne voulurent pas même partager ce sanctuaire du paganisme, quand Constantin fut devenu leur protecteur décidé. Aussi les uns et les autres eurent-ils dans Alexandrie leurs écoles spéciales. Quant aux polythéistes romains, point de difficulté: pendant les trois siècles que dura leur empire sur le Musée, ils y entrèrent aisément, mais ce n'était qu'en qualité d'écrivains grecs qu'ils y figurèrent, et il n'a jamais existé au premier Musée de section latine. Le second Musée, l'institution fondée par Claude, fut lui-même composé de Grecs, puisqu'ils devaient lire des ouvrages grecs (84). Ceux des (102) savants d'Alexandrie qui désiraient écrire dans la langue des maîtres du monde, se rendaient à Rome, nous le verrons dans les Annales du Musée. Quand M. Klippel dit qu'on fit d'abord l'institution pour des Grecs seulement, il émet une hypothèse; mais quand, pour prouver que cela changea et qu'on admit plus tard des savants de tous les pays sans exception (85), il s'appuie sur cette phrase de Philostrate, Μοθσεῖον τράπεζα Αἰγυπτιῳ ξυγκαλοῦσα τοὺσ ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐλλογίσμουςα, il prête aux mots un sens qu'ils n'ont pas ; toute la terre, dans la bouche de Philostrate, signifie simplement le monde grec, Comme plus tard οἰκουμένη, l'empire romain. Il n'y eut jamais ni Parthe, ni indien, ni Éthiopien au Musée.
Ce qu'il y a de plus probable, sous le rapport de toutes les conditions d'admission, c'est qu'elles ne furent jamais bien déterminées. Il en fut sans doute de même des limites de l'admission, et le chiffre des hôtes du Musée a dû varier beaucoup. il est impossible d'en fixer un pour telle époque que ce soit, et je n'oserais pas le moins du monde souscrire à l'opinion de M. Klippel, que le nombre des membres était fixé une fois pour toutes (86). J'ai parlé plus haut d'une moyenne de trente membres, et j'admets au besoin un maximum de cinquante. Un savant étranger a parlé de cent. C'est une exagération qui lient à une double erreur. L'auteur qui la commet part d'une base arbitraire, du nombre de personnes qu'il à fallu pour traduire la bible de l'hébreu en grec. En effet, réduisant à la moitie où au quart le chiffre des Septante, il dit que, s'il a été pourvu proportionnellement aux autres langues et aux autres sciences, on peut bien admettre que le nombre des savants grecs a dû être de près de cent dans cette période de splendeur (87). Mais il faut considérer, 1° que les Septante ne furent jamais membres du Musée, et que le tra (103) vail fait par cette société réduite, au choix, de moitié ou de trois quarts, ne saurait servir de base à aucun calcul pour d'autres; 2° que deux raisons empêchent d'admettre qu'il fallût un grand nombre de Grecs pour les autres langues, la première, c'est qu'il est rarement question dans les annales du Musée de traductions; la seconde, c'est que les savants d'Alexandrie apprirent peu les langues étrangères, même celle de l'Egypte, qu'ils entendaient parler tous les jours; 3° que le Musée ne s'est jamais recruté systématiquement, ni d'après un cadre encyclopédique quelconque, mais qu'il s'est peuplé des hommes un peu éminents qui voulurent bien se rendre et demeurer en Egypte. Sans doute l'institution ayant été royale, on peut grossir les chiffres ; mais l'antiquité n'eût pas conçu, et la Grèce n'eût guère fourni une école de cent littérateurs. Aussi, en réunissant toutes les données qui nous restent sur la population du Musée, nous ne trouvons pas, pour telle époque que ce soit, dix noms que nous puissions inscrire avec certitude dans les annales de cette institution; et, comme la raison l'exige, nous distinguons toujours l'Ecole d'Alexandrie du Musée. Or il faut admettre que les savants du Musée ont eu quelque illustration, qu'ils ont écrit, qu'ils ont fait parler d'eux et qu'il a dû se conserver quelque chose de leur célébrité. Qu'une moitié, que trois quarts d'entre eux aient pu se faire oublier complètement, cela se conçoit; mais avec cette supposition même on n'arrive encore que tout juste à notre moyenne de trente, et on reste bien en deçà du maximum de cinquante. Il y aurait un moyen facile d'aller plus haut, de dépasser même le chiffre de cent : ce serait, d'abord, de prendre pour des savants d'Alexandrie tous ceux qui étaient nés dans cette ville ou qui y avaient fait quelques études; ce serait, ensuite, de prendre pour des membres du Musée tous ces savants d'Alexandrie, Grecs, Egyptiens, Juifs, Chrétiens, Romains et Gnostiques: mais autant vaudrait, dans une future histoire littéraire de Paris, prendre pour des académiciens (104) tous ceux qui s'occupent aujourd'hui, dans nos murs, de science et de littérature.
Au surplus les dernières questions qui surgissent sur l'admission au Musée recevront peut-être quelque jour de ce que nous avons à dire sur les droits assez variés qu'elle conférait et sur les obligations qu'elle imposait. En effet, la position de tous les membres du Musée ne fut pas la même à toutes les époques de cette institution.
D'abord, pour ce qui est des droits, on ne trouve dans les anciens temps que la table, le logement, une indemnité individuelle et de riches moyens d'étude. Sous la domination romaine il y a plus : une exemption formelle de toutes les charges publiques est accordée par l'empereur Adrien à Dionysius qu'il nomme membre du Musée (88), et une inscription du siècle des Antonins prouve qu'à cette époque tous les membres de l'institution jouissaient de la même franchise (89). De plus, Dio Cassius nous apprend que l'empereur Caracalla retira, pendant son séjour à Alexandrie, aux partisans d'Aristote les syssities et les autres avantages, τάς τε λοιπὰς ὠφελείας, dont ils jouissaient, et notamment les spectacles, θεάς (90). Il est probable que ces avantages remontaient à l'origine du Musée, puisque les uns étaient empruntés aux mœurs de la Grèce, les autres à celles de l'Egypte : mais rien ne le prouve. Dans tous les cas, ils constituaient de magnifiques privilèges, s'il est vrai qu'ils furent conférés à vie et à titre de droits. Mais s'il est à croire que, dans la règle, il en était ainsi, on dirait que, dans l'opinion des princes, ces privilèges, loin d'être des droits, n'étaient que des faveurs. En effet, s'ils n'en privent pas ceux qui conservent leur bienveillance, ils les retirent sans façon aux autres. Le chef de l'empire que nous venons de nommer, sans autre (105) motif que son enthousiasme pour Alexandre empoisonné sur les conseils d'Aristote, dépouille de tous leurs avantages une classe entière de philosophes. L'exemple de Caracalla n'est peut-être pas bon à citer dans une question de principes ; mais nous verrons d'autres Césars et quelques-uns des plus éminents se mettre au-dessus de la règle, pour disposer des faveurs du Musée.
En revanche ils tenaient aussi peu aux obligations qu'elles imposaient. La première de toutes, et la seule qui fût rigoureuse dans les anciens temps, c'était celle de la résidence. Sous les Lagides nul ne jouissait de la syssitie du Musée, s'il ne demeurait habituellement dans ce palais. Les empereurs, au contraire, accordèrent à Polémon les honneurs et les avantages du Musée sans la condition de résidence (91).
Si quelques-uns des chefs de l'empire traitèrent avec cette bienveillance des savants qu'ils n'avaient jamais vus dans Alexandrie , on pourrait inférer d'un fait qui se passa sous les Lagides, qu'alors on entendait que ceux qui étaient une fois entrés au Musée n'en sortissent plus sans permission. En effet, Aristophane le philologue y fut retenu malgré lui (92). Mais ce sont là des faits isolés , et dans la règle nous voyons les savants aller se constituer librement les hôtes des Lagides, accepter d'eux pour quelque temps les honneurs du Musée, puis les quitter avec la même aisance, et tout en préférant au séjour d'Alexandrie celui de Pergame ou de Rome , concourir à leur assurer cette renommée de générosité qui distingue leur dynastie.
A l'obligation matérielle de résider se rattachait pour les savants l'obligation morale d'illustrer le Musée ou de servir la science par leurs travaux ; mais assurément nulle espèce de travail ne leur était prescrite. S'il y avait eu des prescriptions de cette nature , la malignité alexandrine nous eût (106) laissé trace dans 8es chroniques de retards et de négligences. Une prescription, il est vrai, fut faite au Claudium; le docte fondateur de cette institution exigea qu'on y fît annuellement la lecture de deux ouvrages d'histoire de sa composition. Mais, d'abord, aucun protecteur du premier Musée n'eut jamais idée semblable. Ensuite, on ne saurait établir aucune comparaison entre deux instituts aussi différents que le Claudium et le Musée. Qui aurait pu prescrire des travaux dans ce dernier? Les princes, les présidents, les chefs d'école. Parmi les princes il s'en trouva plusieurs qui encouragèrent des études spéciales : Ptolémée Ier donna l'exemple de la composition historique et encouragea les études politiques de Démétrius de Phalère ; Ptolémée II provoqua des luttes poétiques, des explorations de géographie et d'histoire naturelle et la traduction du code judaïque; Ptolémée VII favorisa des études de philologie et de zoologie; Cléopâtre, de Médecine et peut-être de philosophie. Mais, de ces prédilections affichées ou de ces impulsions données, à un plan de travaux systématiques, il y avait un abîme qui n'a jamais été franchi par aucun de ces princes. Il est inutile d'examiner la question à l'égard des présidents. Restent les chefs d'école, les Zénodote, les Aristarque, les Erasistrate, les Hérophile, les Ammonius Saccas, les Plotin. Ceux-là, sans doute, ont formé des disciples et associé à leurs travaux de critique, de médecine et de philosophie de nombreux collaborateurs. D'importantes investigations ont donc été poursuivies pendant plusieurs siècles par des générations diverses; mais ces explorations, qui ont passé du maître aux élèves dans vingt écoles différentes , ne formaient pas des travaux systématiquement exécutés par les membres d'un même corps , puisqu'il est évident que tous les disciples de ces chefs n« furent pas leurs confrères au Musée. S'il est tout naturel de penser qu'il y eut des alliances entre les savants, qu'ils se rapprochèrent par catégories et qu'il s'établit une sorte de communauté du travail entre ceux qui cultivaient (107) les mêmes sciences ; s'il est notamment question de discussions élevées et de solutions données entre les grammairiens et les critiques; enfin si la tradition alexandrine attribue certaines découvertes d'astronomie et de médecine, moins à des individus qu'à des écoles, elle ne nomme cependant jamais de chef qui ait tracé une tâche à qui que ce soit. Souvent les membres ou les fractions du Musée , loin de l'entendre par catégories, paraissent s'être combattus systématiquement et par coteries. Nous verrons les querelles dos grammairiens , des critiques et des médecins aussi bien que les divisions des philosophes. Tels étaient les débats de ces derniers , qu'on ne put jamais songer pour eux à un plan d'études.
On le voit, l'idée de travaux systématiques, prescrits et obligatoires, s'évanouit au premier coup-d'œil, et les membres du Musée ont dû jouir d'une grande liberté à est égard. Mais il est très vrai qu'il y avait pour eux, dans un autre sens, des obligations inviolables et une tâche prescrite. Ceux qui avaient la charge de l'observatoire et de ses appareils, ceux qui présidaient à l'amphithéâtre d'anatomie ou dirigeaient les ménageries de la cour , ceux qui instruisaient les jeunes princes (93) ou se trouvaient investis d'un enseignement public, ceux enfin qui partageaient les travaux du chef de la bibliothèque, avaient sinon des devoirs prescrits, du moins obligatoires, quand Alexandrie eut ces établissements.
Nous n'avons rien à dire sur les trois premières ni sur la dernière de ces catégories d'obligations; nous en parierons ailleurs; mais, dès à présent, nous ajouterons quelques mots sur l'enseignement fait par des membres du Musée. Etait-il obligatoire pour tous ? Formait-il un ensemble un peu complet? Etait-il libre comme dans l'ancienne Grèce, ou réservé comme dans la vieille Egypte? Beaucoup de membres du Musée enseignèrent , et la plupart formèrent des disciples dans une ville où affluaient les jeunes gens et (108) les curieux du monde grec; mais tous ne firent pas des cours: et ceux que l'on invitait de temps à autre à professer ou qui se présentaient d'eux-mêmes, cessaient ces fonctions quand ils le trouvaient bon. Leur enseignement ne fut pas plus systématique que leurs autres travaux. Plus libres que les philosophes qui enseignaient à l'académie, au Cynosarge ou au Lycée, ils ne s'astreignirent pas, comme avaient fait Platon, Aristote et Antisthène, à une suite de leçons faites pendant toute une série d'années. Sans jamais se rendre au Gymnase d'Alexandrie, ils se bornèrent à conférer avec ceux qui désiraient les consulter ou les entendre, soit au Musée, soit au théâtre anatomique, soit à l'observatoire, soit à la bibliothèque. Comme il ne s'agit ici que des membres du Musée, nous ne parlons ni des maîtres du Gymnase, ni de ceux des écoles égyptiennes, judaïques, chrétiennes ou gnostiques, ni de ceux des savants d'Alexandrie qu'une fortune indépendante portait à refuser ensemble les honneurs et la gêne de la syssitie royale, pour recevoir chez eux en toute liberté leurs studieux amis. Aussi bien n'est-ce pas de l'enseignement complet d'Alexandrie qu'il s'agit, enseignement que nous verrons en son temps, c'est d'une seule fraction de cet enseignement, et de la fraction la plus incomplète et la plus libre, celle du Musée; mais quand je dis la plus libre, je ne pense pas qu'elle le fût beaucoup.
En effet , ces allures démocratiques qu'affectaient en Grèce ceux même des philosophes qui appartenaient à l'aristocratie par leurs principes, eussent peu convenu aux Lagides. Non-seulement ces princes fermèrent la bouche à Hégésias, surnommé Peisithanatos, qui discutait une question de morale, celle des maux de la vie, comme on traitait en Grèce les questions de religion et de politique, mais ils renvoyèrent le malheureux Zoïle, qui ne prenait de liberté que sur une question de littérature. Cela se comprend. Les Lagides avaient un système politique, et la majorité de leurs peuples, des croyances religieuses, que la (109) population d'Alexandrie, sans mœurs, sans principes, sans patrie, aspirant à tous les genres de licence, ne demandait pas mieux que d'entendre battre en brèche par des doctrines d'émancipation. Mais, si l'on comprend que les Lagides ne purent tolérer un enseignement tout-à-fait libre, on comprend aussi que des hommes tels que Théophraste et Chrysippe ne se soucièrent pas de venir au Musée ; que Timon le Phliasien, qui avait la parole hardie, ne voulut pas y entrer; et que Théocrite, qui aimait les princes, mais dont les goûts étaient ceux d'un poète, n'ait pas prolongé beaucoup son séjour auprès d'une dynastie qu'il avait chantée.
En résumé, si libre qu'on conçoive la position du premier Musée, c'était avant tout un palais égyptien, où présidaient ensemble la royauté et le sacerdoce. Il y régnait donc une sorte de dictature morale ; et sur l'ensemble des travaux et des pensées de ses membres planait une surveillance à-la-fois religieuse et politique, qui se faisait sentir plus ou moins, suivant que le gouvernement appartenait à un Philadelphe ou bien à un Kakergète, mais qui, dans tous les temps, même sous les princes les plus passionnés pour les lettres, enchaînait la parole ou la composition sous certaines convenances.
Y avait-il plus d'indépendance à la première Bibliothèque? Quelle fut l'organisation de cet établissement? Cette question embrasse celles du local, du chef, des employés secondaires et des divers travaux, et elle est également difficile sous tous ces rapports.
Celle du local domine toutes les autres ; car si les volumes acquis par les Lagides ont été déposés au Musée, cette collection, avec tous les soins qu'elle réclamait, se trouva comprise dans l'administration générale du président de ce palais; si, au contraire, elle a eu son local à elle , il lui a fallu une organisation, spéciale. Pour la critique qui s'attache aux faits, la question est résolue par un fait, nous l'avons dit : au fameux incendie de la flotte égyptienne, la première Bibliothèque est devenue la proie des flammes , le (110) Musée est demeuré intact. On peut objecter qu'avant et après la création du Musée d'Alexandrie les livres se déposaient dans les exèdres et dans les portiques des Musées ou des écoles philosophiques , des temples et des palais royaux. A cet égard chacun entasserait exemple sur exemple ; mais que gagnerait-on à ce travail ? On ne changerait pas le fait. Qu'a-t-on dit pour le changer ? Ce sont les livres qui ont brûlé, ce n'est pas la Bibliothèque, c'est-à-dire le Musée (?) qui était construit en pierres , que les flammes n'ont pu dévorer, et qu'on a pu restaurer facilement. Puis, les livres n'étaient peut-être pas à leur place habituelle, quand ils prirent feu. Peut-être César les avait-il fait retirer du Musée tout à la hâte, pour quelque travail de fortification; peut-être les avait-il fait déposer dans les réduits de bois du port, hölzerne Hafenschuppen , pour les étaler lors de son entrée triomphale à Rome. Un texte d'Orose est cité à l'appui de ces peut-être. Ea flamma.... quadringenta mitlia librorum PROXIMIS FORTE AEDIBUS CONDITA exussit, dit Orose (vi, 15). L'on conclut décès expressions, forte condita, que les 400,000 volumes n'étaient déposés là que par cas fortuit (94). Mais d'abord à qui persuader que César eût entrepris une spoliation si odieuse aux yeux de la reine d'Egypte, sans que cet enlèvement fût devenu l'objet d'un cri d'indignation par venu jusqu'à nous? A qui persuader que, pour fortifier le quartier des palais, il ait eu besoin de faire évacuer le Musée ? A qui persuader qu'il ait eu le temps de faire mettre tranquillement les 400,000 rouleaux dans des maisons — car c'est ainsi qu'on traduit aedes — où ils ne s'étaient pas trouvés jusque-là? A qui persuader enfin, que forte condita signifie déposés accidentellement, et que le projet de César eût été traité de simple accident? Les mots d'Orose signifient, au contraire, que les livres étaient établis là par un coup du sort. Or le texte invoqué montre que la flamme gagna le palais même, œdes, où ils étaient disposés , condita ; on veut qu'ils auraient été portés au (111) bord de la mer : il montre que ce n'est pas là, mais plus dans la ville qu'ils furent brûlés. Ea flamma eum partem quoque urbis invasisset, etc. Quand cette flamme eut envahi aussi une partie de la ville, dit Orose, alors elle réduisit en cendres 400,000 volumes qui étaient établis par malheur, par un coup du sort, dans un palais très rapproché.
On le voit, toute cette hypothèse d'une spoliation méditée par César et d'un dépôt provisoire dans des cabanes de bois s'évanouit à la moindre analyse; et le fait, que la collection des livres établie dans la ville, mais dans un local que la flamme put gagner, a été réduite en cendres, tandis que le Musée ne fut pas compris dans cette catastrophe, demeure debout. La Bibliothèque occupait donc un local distinct. Et quand on considère à-la-fois le nombre de palais dont disposaient les Lagides et la quantité de volumes qu'ils y amassèrent, on ne saurait avoir une autre opinion. Ceux qui mettent, au Musée 1° une centaine de savants; 2° des établissements de chirurgie et d'anatomie ; 3° une ménagerie; 4° la bibliothèque avec un établissement de reliure etc., ne considèrent pas qu'il aurait fallu donner tout un quartier de la ville à une agrégation aussi insolite de choses et d'institutions. Loin de là, les anciens distinguent toujours le Musée et la Bibliothèque, ils ne disent pas la Bibliothèque du Musée, ni le Musée de la Bibliothèque, ils parlent de ces institutions comme d'établissements indépendants l'un de l'autre. Dans une de ces notices anonymes dont l'époque est d'ordinaire si incertaine et dont les données sont si suspectes, dans une vie d'Apollonius, on trouve à la vérité ces mots: Appollonius fut jugé digne des bibliothèques du Musée, ὡς καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ μυσείου ἀξιωθῆναι αὐτόν (95). Mais, si ce texte est à tel point corrompu qu'il faut le corriger pour le rendre grec, et ajouter peut-être τῆς προστασίας après βιβλιοθηκῶν, il faut certainement aussi ajouter avant μουσεῖον ou le καὶ qui est tombé à cause de κῶν, (112) qui le précédait. Au surplus, ce texte serait pur et entier, que l'erreur d'un obscur scoliaste obtiendrait peu d'égard en allant contre un fait.
Le fait d'un local spécial admis, restent à vider les autres questions, et d'abord celle du chef et des employés secondaires de la Bibliothèque. Ce chef, cela est certain, ne fut jamais celui du Musée, qui était toujours un prêtre, tandis que de tous les bibliothécaires nul ne paraît avoir été revêtu du sacerdoce. Cela se comprend. Les fonctions du chef de la première bibliothèque étaient essentiellement profanes et très laborieuses. Pour les remplir avec succès, il fallait 1° connaître ou savoir découvrir ce que les lettres grecques offraient de plus précieux dans tous les genres et en procurer des exemplaires par voie d'acquisition ou par voie d'emprunts et de copies ; 2° faire examiner tout ce qui était acquis, prêté ou copié; 3° diriger les soins qu'exigeait la formation et la conservation des rouleaux ou volumes; 4° présider au placement ou à la classification dans les portiques, les salles et les armoires ou réduits du dépôt. C'étaient là des soins profanes et des soins immenses. Ils entraînaient avec eux le maniement de fonds considérables et rendaient indispensables quatre catégories d'auxiliaires ou d'employés secondaires, c'est-à-dire, des greffiers pour la tenue des comptes et des registres, je n'ose pas dire des catalogues ; des copistes pour transcrire les exemplaires qu'on restituait ou qu'on gardait; des savants et des critiques pour la vérification et le classement des volumes ; et enfin des ouvriers de plusieurs classes pour les travaux manuels et la surveillance ordinaire. Les greffiers étaient d'autant plus nécessaires, que la bibliothèque n'avait pas de revenus propres comme le Musée, que le gouvernement demeurait chargé directement de tous les frais, que les dépenses étaient énormes, vu l'élévation du prix des manuscrits, et que l'attention du chef était partagée entre des travaux de nature diverse. Toutefois, le nombre de ces comptables a pu être petit : Hérodote ne parle (113) que d'un seul greffier pour la gestion des revenus du collège sacerdotal de Saïs.
Le nombre des copistes et des calligraphes était naturellement plus considérable, vu la quantité d'ouvrages à copier, d'abord, pour les collections d'Alexandrie; plus tard, pour celles d'autres villes qu'on voulait ou qu'il fallait servir, comme cela se fit pour Rome sous Domitien (96).
Les savants chargés d'examiner et de classer les livres, sous la direction du bibliothécaire, ont dû être nombreux aussi. Quand on considère combien, avant les travaux du Musée et même depuis , il régnait d'incertitude sur l'authenticité des ouvrages, même d'auteurs tels que Platon et d'Aristote; combien, avant les canons dressés par les savants d'Alexandrie, surtout les Tableaux de Callimaque, les écrits de l'antiquité étaient mal classés et peu connus; combien était grande la foule des anonymes et des pseudonymes; combien l'esprit de spéculation inventait de fraudes et d'altérations : quand on envisage, en outre, l'absence de tout moyen de critique générale et de contrôle public, on conçoit que les premiers bibliothécaires d'Alexandrie aient eu besoin de s'entourer d'un grand nombre de collaborateurs instruits. Pour les premiers achats on n'y regardait pas de trop près : on recevait tout. Bientôt on fut sur ses gardes, et quoique, suivant Galien (97), l'ardeur d'un Ptolémée, roi d'Egypte, fût telle qu'il pressait tous les navigateurs qui abordaient en Egypte de lui apporter des livres, il prenait des précautions. Il faisait écrire les volumes qu'on lui prêtait sur de nouvelles feuilles (εἰς καινοὺς χάρτας) , rendait aux propriétaires ces copies — ce qui indique le goût des originaux — et faisait ensuite déposer dans les bibliothèques les originaux avec cette épigraphe, τῶν ἐκ πλοίων — ce qui révèle des projets de révision critique. Le nom de χωρίζοντες, séparateurs, don- (114) né aux employés qu'on chargeait de cette révision, indique parfaitement la nature de leurs travaux, puisqu'ils mettaient à part, sur une tablette, πινακίδιον, ce qui était éprouvé (98). Il n'exclut pas de cette tâche les membres du Musée.
Quant aux travaux manuels, tels que préparation de papyrus, formation de rouleaux ou de volumes, fabrication de boîtes ou de capsules, dorure et surveillance, ils demandaient à-la-fois de nombreux ouvriers et une inspection suivie, puisqu'on n'avait pas les ressources de nos jours pour remplacer les accidents.
En un mot, l'administration de la première bibliothèque était à-la-fois laborieuse et honorable; elle était digne du personnage qui en avait donné l'idée, de Démétrius de Phalère, qui en conférait directement avec le prince, et qui résidait sans doute soit au palais des rois, soit dans celui de la bibliothèque, mais qui certainement ne demeura pas au Musée, vu qu'il n'eût pas été convenable de placer un homme aussi éminent sous l'action du prêtre qui dirigeait cet asile.
Toutefois, de fréquents rapports ont dû exister entre les membres des deux institutions. Aucune des deux ne pouvait se passer de l'autre : sans les volumes de la bibliothèque les travaux du Musée demeuraient stériles, et sans ces travaux la collection des manuscrits perdait son importance. Elle était amassée pour les savants autant que pour le Lagide dont elle devait éclairer la conduite, selon la pensée de Démétrius de Phalère. Il paraît qu'on ne songea nullement au public quand on fit cette première collection; c'est à la troisième seulement qu'on aurait pris en considération, et qu'on aurait établi pour lui des salles de lecture, si Aphthonius disait vrai.
Unies ensemble ces deux institutions mettaient Alexa ndrie bien au-dessus d'Athènes et d'Héliopolis ; car autant le Musée, (115) qui embrassait tous les travaux de l'esprit humain, dépassait les écoles de philosophie de la Grèce et les collèges sacerdotaux de l'Egypte, autant la Bibliothèque qui réunissait à peu-près tout ce qu'on pouvait acquérir, éclipsait celles dont on parlait jusque-là.
Dès-lors on conçoit que ces deux institutions ont dû jouer dans Alexandrie un grand rôle, donner dès leur début, une vive impulsion aux études, et faire concevoir de leurs progrès les plus hautes espérances.
ProgrÈs De La PremiÈre BibliothÈque Et Du Premier MusÉe Sous Le RÈgne De PtolÉmÉe Soter , Et Situation De L'École D'alexandrie A La Mort De Ce Prince, L'an 283 Avant JÉsus-christ.
Si le fondateur des institutions littéraires d'Alexandrie a commencé son œuvre dès l'arrivée de Démétrius de Phalère à sa cour, il a pu s'en occuper pendant l'espace de vingt trois ans, n'étant mort qu'en 283 avant J.-C. Quoiqu'il fût alors âgé de quatre-vingts ans, il avait sans doute donné aux lettres, dans les dernières années de sa vie où il était déchargé d'une partie du gouvernement, encore plus de temps qu'à l'ordinaire. Voyons maintenant quels progrès la Bibliothèque et le Musée avaient faits dans ces vingt-trois ans, et quel rang l'école d'Alexandrie avait dans le monde grec et égyptien.
Quant à la Bibliothèque, nous ne combattrons plus ceux qui en renvoient l'origine au règne suivant. Nous avons établi par des textes et des considérations d'un ordre général, que ce fut Ptolémée Soter qui commença la première des grandes collections d'Alexandrie. Il est certain aussi que le palais de cette bibliothèque fut distinct de celui du Musée; que cette institution fut conçue sur un plan assez vaste pour demander dès l'origine un autre local que le palais du prince, et que ce local se remplit promptement d'un grand nombre de volumes. L'extrême bienveillance des traditions Alexandrines pour Ptolémée Philadelphe revendique à ce dernier presque toutes les institutions du premier, mais ce n'est pas une raison pour nous d'être incertains à l'égard du fondateur de la bibliothèque. Un texte formel donne (117) jusqu'au chiffre des volumes ou rouleaux de la collection du fondateur. En effet, suivant la lettre écrite sous le nom d'Aristée, officier de la garde, sur la version des Septante, Ptolémée Soter — car il ne peut être question que de ce prince, le nom qui suit le prouve, — ayant demandé à Démétrius de Phalère, combien il possédait de livres, en apprit qu'on en avait déjà réuni 200,000, et que dans peu de temps on espérait en avoir jusqu'à 500,000. Chacun sait ce que vaut le témoignage d'Aristée et le degré d'importance que mérite sa relation. Mais il est évident qu'il a pris le chiffre et le nom de Démétrius dans la tradition grecque, car s'il se jette dans le roman toutes les fois que son amour-propre de juif est enjeu, aucun motif de nationalité ne pouvait le porter à changer le fait que nous lui empruntons. Puis, si Josèphe, qui le copie en l'altérant, et Zonaras qui suit Josèphe tout en conservant les mêmes faits, rapportent cette anecdote au règne de Philadelphe, ajoutera-t-on plus de foi à des copistes qu'à l'auteur original (99) ? Ce ne serait pas au moins l'élévation du chiffre qui ferait difficulté, car nous verrons tout-à-l'heure comment il faut entendre ces volumes, et un critique exact, d'accord avec nous, dit à juste titre, en parlant des 400,000 volumes laissés par Ptolémée II, qu'il n'y a rien d'étrange dans l'hypothèse que le père de ce prince en ait fait acheter la moitié (100). C'est donc un fait, que Ptolémée 1er transmit à son fils une quantité considérable de manuscrits.
Mais était-ce là une bibliothèque publique ou bien une collection particulière du prince? Puis, un bibliothécaire spécial était-il chargé d'en diriger l'administration, ou bien quelque courtisan en avait-il la garde dans les appartements (118) du roi? Quoique les questions du bibliothécaire et celle du local se tiennent de près (v. ci-dessus p. 109), l'on arrive pour l'une à un résultat plus net que pour l'autre. En effet, Démétrius de Phalère, qui est cité par Plutarque comme créateur de l'institution, par Aristée et beaucoup d'autres comme premier bibliothécaire eut réellement cette qualité, que les premiers achats fussent déposés au palais du prince ou dans un édifice spécial. Conseiller du Lagide et préposé par lui à la législation du royaume, Démétrius ne fui pas, sans doute, bibliothécaire assujetti au même travail que les successeurs qu'il eut plus tard; cette position était au-dessous de son rang, et c'est pour cette raison même qu'il n'est pas mentionné, dans les traditions alexandrines, au même titre que Zénodote, Callimaque, Apollonius de Rhodes et Aristophane de Byzance; mais cette nuance ne change rien au fait en lui-même, qui est hors de doute.
Nous arrivons au Musée. En quel état se trouva cette institution à la fin du règne de Ptolémée 1er?
Après Déméirius de Phalère, il se rencontre quinze savants dont on peut affirmer qu'ils habitèrent Alexandrie sous ce règne; ce sont le dialecticien Diodore, le cyrénaïcien Théodore, Hégésias, autre cyrénaïcien, le stoïcien Posidonius, l'érétricien Ménédème, le péripatéticien Straton, les poètes Philétas, Archélaùs, Asclépiade elRhinton; Zénodote, le célèbre critique, l'historien Lycus, les médecins Hérophile et Erasistrate, et le mathématicien Euclide.
Ces quinze savants furent-ils membres du Jlusée? Aucun texte ne le dit; mais voici des faits et des inductions sur chacun d'eux.
Diodore, dialecticien et inventeur d'un syllogisme fort embarrassant, se trouva auprès de Ptolémée Soter. En effet, Diogène de Laërte nous apprend qu'il fut interpellé sur un point de dialectique par Stilpon de Mégare, pendant son séjour auprès de ce prince (παρὰ τῷ Πτολεμαίῳ διατρίβων), et qu'il mourut à la suite du chagrin que lui donnèrent son échec et une (119) plaisanterie du roi (101). Mais cette scène se passa-t-elle en Grèce ou en Egypte? On l'ignore. Ce qui me fait croire que ce fut en Grèce, c'est qu'un des interlocuteurs, Stilpon de Mégare, refusa de suivre le roi en Egypte (102), et que l'anecdote qui d'ailleurs peint si bien les mœurs du temps, et notamment celle du fondateur du Musée, qui aimait à plaisanter les savants, se rapporte parfaitement à l'un de ses voyages en Grèce. Ce qui me fait penser que Diodore ne fut pas de la syssitie alexandrine, c'est que ce philosophe avait quatre filles; qu'il les exerçait sans cesse à la dialectique, et qu'on ne voit pas trop ce qu'il en aurait fait au Musée. Cependant toutes ces considérations ne tranchent pas la question. En effet, les mots de διατρίβων παρὰ Πτολεμαίῳ.) , dont se sert le biographe, indiquent plus qu'une simple apparition à la cour de Ptolémée visitant la Grèce, et puisque Stilpon a deux fois accepté de l'argent du roi, il pourrait bien n'avoir pas toujours refusé l'invitation de le suivre en Egypte. Un de ses dialogues portait le nom de Ptolémée; ne faut-il pas conclure de cette flatterie qu'il vécut près du roi?
Quant au cyrénaïcien Théodore, qui combattait avec tant de franchise les dieux du polythéisme et que Démétrius de Phalère avait arraché aux rigueurs de l'Aréopage, pendant qu'il gouvernait Athènes, il se rendit à la cour du Lagide ainsi que son protecteur; mais ce qui peut faire douter qu'il fût membre du Musée, c'est qu'il eût été peu convenable de l'associer à une institution dont il importait de faire respecter le berceau. Ce fut peut-être pour cette raison même que Ptolémée le chargea d'une mission au dehors, et la preuve que cette mesure était très sage, quant au Musée, se voit dans l'accueil que le roi Lysimaque fit en Thrace au philosophe expulsé d'Athènes : il le renvoya après avoir échangé avec lui, sur un fait si grave à ses yeux, quelques paroles (120) fort vives (103). Si Ptolémée Ier avait justement hésité, avant cette scène si mortifiante pour lui, d'agréger au Musée le protégé de Démétrius de Phalère, il ne pouvait plus y songer depuis; et la démarche que fit Théodore, en allant chercher un asile à Cyrène, auprès de Magas, fils de Ptolémée Soter, qui le reçut avec distinction, semble prouver qu'il ne fut pas admis à la syssitie de la capitale.
Hégésias le fut-il ? Contemporain d'Annicéris et de Théodore , dont il partageait généralement les principes, il fut admis à professer dans Alexandrie, sous Ptolémée Soter. Mais ses doctrines n'étaient pas faites non plus pour recommander une institution naissante; et si le Lagide ne l'admit pas au Musée, avant d'autoriser son enseignement, il n'a pas dû l'y recevoir, après l'avoir interdit. Or, il fut obligé de prendre cette mesure. Hégésias, dont la mollesse trouvait les peines de la vie trop lourdes, conseillait la mort (πεισιθάνατος) avec tant d'éloquence qu'il entraîna plusieurs personnes à se tuer. Ptolémée ne pouvait tolérer ce fanatisme et il fit cesser l'enseignement d'Hégésias (104).
Un élève d'Hégésias, Posidonius le stoïcien, pourrait être considéré comme membre du Musée avec d'autant plus de raison qu'il était d'Alexandrie. Mais, loin de s'attacher aux institutions naissantes de sa patrie, il se dégoûta même des doctrines qu'on y professait, et alla suivre en Grèce l'école que Zénon venait d'ouvrir pour combattre les déplorables tendances de son époque- On ignore si, dans la suite, il a reparu à la cour des Lagides ; mais Pépithète d'Alexandrin qu'on lui donne constamment et qui aurait dû empêcher qu'on le confondît avec Posidonius de Rhodes, le fait supposer (105).
Ménédème y parut sans contredit; mais ce ne fut pas comme membre du Musée, ce fut comme délégué de la ré- (121) publique de Mégare, sa patrie, qu'il administrait et qui le chargea de plusieurs missions auprès des rois Ptolémée, Démétrius et Lysimaque. Ces trois princes s'étant trouvés tous trois en Grèce, on pourrait admettre que ce fut là qu'il traita avec eux et qu'il ne vit jamais ni la ville d'Alexandrie, ni le Musée. Mais l'historien Josèphe rapporte qu'il assistait au banquet donné aux Septante (106); et s'il y a beaucoup d'erreurs ou d'inventions dans les récits que les Juifs nous ont laissés sur l'origine de leur code grec; si ce banquet lui-même est peut-être de pur ornement dans leurs récits, la présence de Ménédème en Egypte est un fait sur lequel l'indication de Josèphe confirme trop bien celle de Diogène, pour qu'on puisse le révoquer en doute. Toutefois, si Ménédème visita le Musée et la Bibliothèque d'Alexandrie, il ne fut ni de l'une ni de l'autre de ces institutions. Un auteur étranger, qui est d'ordinaire plus exact, me reproche de l'avoir agrégé sans raison aux savants d'Alexandrie, et cite, pour prouver qu'il n'alla pas en Egypte, Diogène de Laërte, que je citais pour prouver qu'il y alla. Ce savant a tort envers Diogène et envers moi. Voici ce que je disais (Essai historique sur l'École d'Alexandrie, t. I, p. 70): Le fondateur de l'Ecole èretriaque, Ménédème, n'appartient guère non plus à la congrégation du Musée; mais il s'est trouvé à Alexandrie [J'avais raison, puisque Diogène dit qu'il fut chargé de plusieurs ambassades près de Ptolémée, etc.] ; on y a connu sa doctrine [Il a parlé sur la providence au banquet des Septante, Josèphe le dit, et il ne le ferait pas assister à ce banquet réel ou fictif si le philosophe n'était jamais venu en Egypte] et ses mœurs [Un membre du Musée, Lycophron, en a fait l'objet de ses épigrammes, Diogène nous l'apprend]. Je tiens d'ailleurs médiocrement à garder raison sur un point aussi secondaire, et je comprends qu'un étranger ait pu se tromper sur le sens du passage que je viens de citer.
(122) II est certain aussi que l'historien Lycus vécut en Egypte sous le premier des Lagides; et quoiqu'il y fût mal avec Démétrius de Phalère, ce n'est pas une raison pour croire que le prince, historien distingué, l'ait exclu de la syssitie du Musée (107).
Il y admit sans doute les épigrammatistes Archélaüs et Asclépiade, dont l'Anthologie nous a conservé quelques unes de ces petites compositions qui devinrent la grande passion d'Alexandrie (108) ; et Rhinton de Tarente, poète comique, qui, plus facile à séduire que Ménandre (d'Athènes), ne consola pas la cour des refus de ce dernier (109).
S'il est probable au plus haut degré que les littérateurs que nous venons de nommer furent en effet commensaux de la syssitie du Lagide, cela paraît certain à l'égard de Philétas, de Zénodote et de Straton, qui tous les trois donnèrent des leçons au prince connu plus tard sous le nom de Ptolémée Philadelphe. Les Lagides ayant eu l'habitude de prendre des leçons de la part de leurs plus savants commensaux , à la rigueur on pourrait considérer les personnages dont il est question comme les contemporains de Philadelphe, au lieu de les placer sous le règne de son père, mais voici ce qui s'oppose à cette hypothèse. Le docte poète Philétas était contemporain d'Alexandre, et s'il a pu vivre jusque dans les premières années du règne de Philadelphe (110), l'époque où il florissait est bien |celle de Ptolémée Soter. C'est donc sous le règne de ce prince qu'il a dû donner des leçons à Philadelphe, et c'est probablement en lui que nous voyons le plus ancien membre du Musée.
Zénodote, qui seconda l'éducation de Philadelphe (111), était plus jeune que Philétas, dont il avait suivi les leçons; mais (123) s'il était né, comme on le pense, vers la 115e olympiade, il avait sur Philadelphe, né la 3e année de la 117e olympiade, une suffisante supériorité d'âge pour justifier le choix de Ptolémée I°r et l'expression de Suidas, qui le nomme contemporain de ce prince ()επὶ Πτολεμαίου γεγονὼς τοῦ πρώτου). Ou peut donc sans hésitation voir en lui un des savants du Musée. L'auteur d'un roman sur Alexandrie sous le règne de Ptolémée II, Manso, applique, il est vrai, aux enfants de Philadelphe le fait si précis que nous transmet Suidas dans ces mots, καὶ τοὺς παῖδας Πτολεμαίου ἐπαίδευσεν, et qu'il est si naturel d'entendre des fils du prince qu'il vient de nommer. On a pourtant pris cette conjecture pour une découverte. MM. Parthey et Ritschl l'ont adoptée comme Weichert. C'est une opinion qui ne peut se soutenir, et qu'on ne saurait faire prévaloir. On dit 1" que Suidas n'entend pas les fils de Ptolémée Soter, en parlant des enfants de Ptolémée, parce qu'il n'entend pas non plus le règne du premier des Lagides quand il parle de la charge de bibliothécaire qu'avait Zénodote: mais ce n'est là qu'une assertion, puisque rien n'empêche d'admettre que ce savant fut employé à la bibliothèque sous la direction de Démétrius, qui, certes, n'était pas bibliothécaire exclusif; 2° que le premier des Lagides n'avait pas d'autres fils plus jeunes que Philadelphe : mais chacun sait qu'il en avait de plus âgés et une fille qui fut en correspondance avec son maître Straton ; 3° que Zénodote et Philadelphe ne différaient pas assez d'âge pour que le second fût élevé par le premier : mais une différence de dix à douze ans est plus que suffisante pour justifier l'expression de ἐπαίδευσεν, qui ne signifie vraiment pas que Zénodote fut chargé de suivre le jeune prince en nourrice; 4° que Philadelphe fut le condisciple de Zénodote aux leçons de Philétas et qu'il n'a pas dû avoir pour précepteur un ancien camarade : mais c'est là une objection qu'on s'est créée en traitant sans façon de condisciples deux élèves du même maître (112).
(124) Pour ce qui concerne Straton, ce philosophe ayant succédé à Théophraste au Musée de ce dernier, la lte ou la 3e année de la 123e olympiade, et n'ayant plus quitté ce poste avant sa mort, la 3e année de la 127e olympiade ou l'année suivante, il n'a pu être l'instituteur de Philadelphe qu'avant la 123e olympiade, c'est-à-dire sous le règne de Ptolémée Soter, vers 287 avant l'ère chrétienne. Comme il n'est pas probable que Straton eût recueilli la succession de Théophraste, s'il n'avait pas été avec son maître les dernières années de sa vie, il faut même admettre que ce fut vers l'an 290 avant J.-C. qu'il quitta la cour d'Egypte. A. cette époque le jeune prince, né la 3e année de la 117e olympiade, atteignait sa vingtième année, et cessait d'avoir besoin d'un précepteur, καθηγητής, car telle est l'expression dont Suidas et Diogène se servent l'un et l'autre. Son père, cédant sans doute à regret aux instances de Théophraste, qui avait refusé de joindre, auprès de Ptolémée, son ami Démétrius de Phalère et qui redemandait le célèbre disciple envoyé à sa place, respecta néanmoins cette demande, et lui renvoya Straton avec une récompense de 80 talents (444, 872 francs). Cette somme, accordée à la célébrité de Théophraste autant qu'au mérite de Straton, permit sans doute à ce dernier de faire exécuter au Musée péripatéticien les travaux que lui prescrivait, dans son testament, le chef qui lui léguait sa dignité, et qui n'aurait pu mieux choisir pour la direction de ces travaux qu'en prenant un membre du Musée d'Alexandrie. (113)
Ajoutons, pour mieux montrer au regard les faits curieux de ce temps, que Démétrius de Phalère, qui sans doute avait désigné Straton au choix du Lagide, concourut ainsi deux fois dans sa vie à doter d'une résidence les péripatéticiens, dont il partageait les principes (v. ci-dessus, p. 33). Puis, remarquons aussi que Ptolémée eut peu de bonheur dans (125) ses relations avec Théophraste et ses disciples. Non-seulement le maître avait refusé de venir lui-même inaugurer le Musée, mais il rappela de cette institution son élève favori. Un autre auditeur de Théophraste rejeta aussi les sollicitations royales qui furent accompagnées d'offres moins prodigieuses qu'Alciphron ne le fait dire à la belle Glycère, dans une lettre à Ménandre, mais qui, certes, furent pressantes , puisqu'il s'agissait du créateur de la nouvelle comédie et de la conquête la plus importante qu'Alexandrie pût faire sur Athènes. Cette négociation a dû être vive, en effet. Théophraste et Épicure ne furent peut-être pas consultés à ce sujet, quoiqu'on dise Alciphron, et la plupart des raisons que donne cet écrivain, pour expliquer le refus du poète, peuvent manquer de valeur. Nul doute néanmoins qu'il n'indique aussi le véritable motif qui décida Ménandre, c'est-à-dire, l'absence en Egypte de ces institutions libres et de ces mœurs brillantes que le célèbre comique savait si bien exposer sur un théâtre dont il connaissait les spectateurs (114). Quoiqu'il en soit, il n'est pas de document de l'antiquité qui peigne, mieux que ces frivoles épîtres, les efforts et les sacrifices que faisait Ptolémée Soter pour illustrer son règne par l'éclat des lettres. Alciphron, à la vérité, ne nomme pas celui des Lagides, qui promit à Ménandre, dans une missive scellée du sceau royal, les trésors de la terre (livre II, lettre 3),ou presque la moitié de son empire (lettre 4), et qui offrit aux Athéniens des navires chargés de blé pour compenser leur perte; mais l'homme de génie qui fut l'objet de ces séductions étant mort la 4° année de la 121e olympiade, ou l'an 292 avant J.-C., il ne saurait y avoir doute sur le prince dont il s'agit.
Un illustre mathématicien, Euclide, est le dernier savant de l'époque qu'on puisse ajouter avec quelque certitude à la liste que nous cherchons à refaire. Né en Egypte, ou attiré (126) par la renommée du premier des Lagides, l'illustre géomètre, dont la patrie est incertaine , fut accueilli par le fondateur des institutions littéraires d'Alexandrie, avec tout l'empressement d'un homme curieux d'étudier lui-même une science si utile sur les bords du Nil. Il prit des leçons d'Euclide, et subit sans se fâcher celle, que, pour apprendre, les princes doivent s'appliquer comme le vulgaire, puisqu'on géométrie il n'y a pas de chemin royal (115).
D'après tout ce qui précède, nous pouvons donc refaire de la manière suivante, en onze catégories, la liste nécessairement mutilée des premiers personnages qui figurent dans les annales de la Bibliothèque et du Musée d'Alexandrie:
1. Ptolémée Ier Soter, fondateur.
2. Démétrius de Phalère, intendant de la Bibliothèque.
3. Théophraste, Menandre) appelés sans succès.
4. Stilpon, appelé d'abord sans succès, mais probablement arrivé plus tard.
5. Ménédème, accueilli comme député de Mégare.
6. Diodore Kronos, Théodore Athéos, Hégésias Peisithanatos, appelés ou accueillis en Egypte mais membres douteux du Museé.
7. Lycus, historien, Arhelaüs et Asclépiade, Rhinton, poète comique, appelés ou accueillis et membres probables du Musée.
8. Philétas, Zénodote, Straton, accueillis ou appelés, précepteurs de Ptolémée Philadelphe, membres du Musée.
9. Savants dont les noms se sont oubliés.
(127) 10. Savants dont les premiers travaux paraissent avoir commencé sous ce règne : Erasistrate et Hérophile.
11. Disciples d'Hégésias, Philétas, Zénodote, Straton, Euclide.
Cela ne forme pas une école imposante par le nombre. Mais les traditions ne s'attachant qu'aux hommes célèbres et tous les commentaires sur le Musée ayant péri, on peut, sans crainte de se tromper, augmenter au moins de deux tiers en sus le chiffre total des savants qui peuplaient Alexandrie , de 305 à 283 avant J.-C. Or si petit que paraisse le chiffre conservé, il indique l'importance du Musée à la mort de son fondateur. Ni la syssitie des membres du Musée de Platon, s'il eut une syssitie; ni celle des péripatéticiens qui occupait le Musée de Théophraste et qui est hors de doute; ni celle des Epicuriens, qui demeurait au jardin d'Epicure, ne furent plus nombreuses; et si l'école naissante de l'Egypte était moins spéciale que celles de la Grèce pour les études philosophiques, elle était plus complète pour la science en général et cultivait la philosophie elle-même. En effet, à côté des doctrines d'Aristippe que Théodore et Hégésias purent professer, Straton et Ménédème, si courte que fût leur apparition auprès des Lagides, jetèrent les principes de deux autres écoles. Puis à côté des leçons de poésie, de critique et de grammaire que donnaient Rhinton, Archélaüs, Philétas et Zénodote, Ptolémée lui-même, Démétrius de Phalère et Lycus publiaient leurs ouvrages sur l'histoire, la morale et la politique. Enfin, à côté des cours de géométrie que faisait Euclide, Hérophile et Erasistrate préludaient glorieusement à leurs savantes innovations en médecine. Dès lors nulle école de la Grèce — si grand que fût le prestige des noms de Socrate, de Platon et d'Aristote qui leur servaient de bannières — nulle école d'Egypte, ni celle d'Héliopolis, ni celle de Thèbes, ni celle de Memphis, ne pouvait plus se comparer à celle d'Alexandrie.
(128) Ajoutons que le chiffre des 200,000 volumes de la bibliothèque, quand même on le réduirait de moitié, dépassait encore de beaucoup toutes les collections du monde égyptien ou grec, y compris celle d'Aristote échue à Théophraste.
Dès lors nous concevons à-la-fois la magnificence du legs qu'allait recueillir Ptolémée Philadelphe, et le haut rang qu'occupaient depuis ce moment les institutions littéraires d'Alexandrie.
ProgrÈs De L'École D'alexandrie sous Le RÈgne De PtolÉmÉe PHILADELPHE. — TRAVAUX ORDONNÉS ET DISPOSITIONS PRISES PAR CE PRINCE A LA BIBLIOTHÈQUE. — BIBLIOTHÈQUE D'ARISTOTE. — CLASSIFICATIONS ET TRADUCTIONS. — LES SEPTANTE. — CHIFFRE.
Si belle que fût l'œuvre de Ptoléme Soter, son fils lui fit faire de
tels progrès, qu'on a pu , sans trop exagérer, le considérer comme
le véritable créateur des institutions littéraires d'Alexandrie. Il
en fit du moins autre chose que ce qu'elles devaient être dans
l'origine -, et, si nous lui avons contesté à plusieurs reprises des
faits que lui attribue la tradition vulgaire, c'est que sa part
légitime de gloire est assez grande pour qu'on ne la grossisse pas
aux dépens du règne de son père.
Il n'eut pas besoin de donner un local spécial à la première Bibliothèque, vu qu'elle en avait un, mais il augmenta à tel point la collection des livres réunis par les efforts de son père, la fit classer avec tant de soin , en régla si bien l'administration, et imprima aux études du Musée une marche si brillante, qu'il put passer pour être le créateur des deux institutions. En effet, il ordonna des traductions, appela des savants et des professeurs, prit part à leurs discussions, les anima par des prix littéraires, fit explorer les régions éloignées dans l'intérêt des sciences, prodigua aux arts et à la religion les mêmes encouragements qu'aux lettres, et répandit sur sa dynastie, par ses libéralités et ses travaux, un tel éclat, que, dans la tradition générale, il éclipsa (130) jusqu'au nom d'un père dont le génie avait été si supérieur au sien.
Voyons d'abord ce qu'il fit pour la Bibliothèque et les travaux qui s'y rattachaient, en réservant le Musée et ce qui le concerne pour un chapitre spécial ; pais disons dès ce moment que ceux qui soutiennent, que la seconde de ces institutions ne fut fondée que sous Ptolémée II et qu'elle renfermait la première, sont dans un singulier embarras. Ne pouvant pas admettre que Ptolémée Ier mît sa Bibliothèque dans un bâtiment spécial (116), ils la tiennent comme en réserve, en attendant que Ptolémée II ait fondé le Musée.
Cette hypothèse de promiscuité une fois abandonnée, les rôles des deux princes se démêlent, au contraire, et l'histoire de la Bibliothèque devient aussi nette que celle du Musée.
Quant à la Bibliothèque, un fragment grec, publié par M. Cramer, et une scolie latine écrite au xve siècle, publiée en partie par M. Osann (117), d'après un manuscrit de Plaute qui se trouve dans la collection du Collegio Romano, et plus complètement par M. RitschI (118), ajoutent aux anciens renseignements des indications d'une telle importance, qu'on peut y rattacher toute l'histoire de cette institution. Seulement il faut consulter ces documents. avec la réserve que demande leur caractère; car, s'ils sont importants, Us sont loin de mériter une confiance absolue, et si quelques critiques affectent de trop les dédaigner (119), d'autres, surtout l'un des éditeurs, en ont trop exagéré le prix (120). Quand même le Caecius à qui se rapporte la scolie latine serait l'auteur du. fragment grec, et quand même ce serait Tzetzès (121), il (131) aurait pu faire cette note avec la même légèreté que d'autres. Mais M. Cramer a fait voir contre d'autres que Caecius ne peut être Tzetzès, puisque ce dernier met dans ses notes sur Homère (in Iliad. p. 125) ce que Caecius blâme ici, une grosse erreur d'Héliodore, et je ferai remarquer à M. Cramer que ce ne peut pas être non plus le Cecilius Calactianus de Suidas, qui vécut sous Auguste ou sous Adrien, puisqu'il cite Proclus. Cœcius est donc un scoliaste à déchiffrer, comme l'auteur du fragment grec, qui a puisé aux mêmes sources que lui, quoiqu'ils diffèrent d'ailleurs sur beaucoup de points, ainsi qu'on va le voir dans des versions calquées sur leurs textes. (122)
|
FRAGMENT.
« II faut savoir qu'Alexandre
l'Etolien et Lycophron de Chalcis, invités par Ptolémée Philadelphe,
ont corrigé les ouvrages dramatiques, Lycophron les comédies,
Alexandre les tragédies et les satyres. Car Ptolémée, qui était fort
ami des lettres, employa Démétrius de Phalère et d'autres hommes
éminents pour amasser dans Alexandrie des livres de tous les côtés.
Il les y fit déposer dans deux Bibliothèques. Le nombre de ceux qui
se trouvaient en dehors du palais fut de 42,800, Celui des livres du
quartier des palais fut de 400,000 comnixtes et de 110,000
simples et non commixtes (ἀμιγῶν ἁπλῶν).
Sur ces derniers Callimaque mit plus tard des titres (πίνακας).
Ce trésor de livres fut confié par le roi à Eratosthène,
contemporain de Callimaque. Or ce n'étaient pas là seulement des
ouvrages grecs, c'étaient des livres de toutes les autres nations
qu'on avait amassés. Il y en avait même des Juifs. Confiant ceux des
autres nations à des hommes instruits et sachant bien le grec, à
chacun ceux de sa langue, il (le roi) les fit ainsi traduire dans
celle de la Grèce. Pour les ouvrages dramatiques, ce furent, comme
je l'ai déjà dit, Alexandre l'Etolien et Lycophron qui les mirent en
ordre (διωρθώσαντο), tout comme 72 grammairiens arrangèrent, sous
Pisistrate, le Tyran d'Athènes, les écrits auparavant disséminés
d'Homère. Ces ouvrages furent revus à la même époque par Aristarque
et Zénodote de ceux qui les corrigèrent sous Ptolémée. Or ceux-ci
attribuent la recension faite sous Pisistrate à ces quatre savants :
Orphée de Crotone, Zopyre d'Héraclée, Onomacrite d'Athènes
(133) et Concylus. Tous
ces ouvrages poétiques et dramatiques forent surtout commentés plus
tard par Didyme , Tryphon, Apollonius, Hérodien, Ptolémée Ascalonite,
les philosophes Porphyre, Plutarque, Proclus et celui qui les
précéda tous, Aristote. »
|
SCOLIE. « Alexandre l'Étolien, Lycophron de Chalcis et Zénodote d'Éphèse, en vertu de l'invitation du roi Ptolémée, surnommé Philadelphe, qui favorisait de la manière la plus étonnante Je génie et la renommée des savants, réunirent et mirent en ordre les livres poétiques de l'art grec, Alexandre s'étant chargé des tragédies, Lycophron des comédies, Zénodote des poëmes d'Homère et de ceux des autres poetes illustres ; car ce prince, singulièrement porté vers les philosophes et tous les autres écrivains célèbres , ayant réuni chez lui, avec le secours de Démétrius de Phalère , et moyennant les sacrifices d'une munificence royale, de tous les pays de la terre, autant de volumes qu'il le put (2), fonda deux bibliothèques , l'une hors du quartier des palais, l'autre dans ce quartier. Il y eut 42,800 volumes dans celle hors du quartier royal ; mais il y en eut 400,000 de Commixtes et 90,000 de Simples et Digestes dans celle du palais, ainsi que le rapporte Callimaque, homme de cour et bibliothécaire royal, qui inscrivit des titres sur chaque volume. La même chose a été affirmée, peu de temps après, par Eratosthène , gardien de la même Bibliothèque. C'étaient là les doctes volumes que ledit prince avait pu se procurer dans toutes les langues et chez tous les peuples , et qu'il avait fait traduire en grec très soigneusement par les meilleurs interprètes ».
« Au surplus, Pisistrate, 200 ans
avant Ptolémée Philadelphe, avait fait, des poésies auparavant
disséminées d'Homère , les volumes que nous avons maintenant,
employant pour ce divin ouvrage les soins et le travail de quatre
nommes très érudits et très célèbres, Concylus, Onomacrite
d'Athènes, Zopyre d'Héraclée et Orphée de Crotone, car auparavant on
ne lisait Homère que par morceaux et difficilement. Même après les
soins de Pisistrate et de Ptolémée, Aristarque a mis ses veilles à
faire une collection plus exacte et plus pure des vers d'Homère.
Héliodore fait sur tout cela des contes que Cécius censure
longuement. En effet, il prétendait qu'Homère a été arrangé tel
qu'il est par 72 savants commis pour ce travail par Pisistrate, et
qui auraient approuvé le travail de Zénodote et d'Aristarque préféré
à tous les autres. Ce qui est très faux, puisqu'il s'est écoulé plus
de 200 ans entre Pisistrate et Zénodote, et qu'Aristarque fut plus
jeune de quatre ans que lui, que Zénodote et Ptolémée. » |
A en croire ces deux textes qui remontent évidemment à un auteur commun que j'appellerai l'Inconnu, Ptolémée II aurait: 1° fondé deux Bibliothèques; 2°acheté des livres dans tous les pays de la terre, en fait traduire d'autres de toutes les langues; 3° appelé trois savants à la tète de ses collections ; 4° fait classer les poètes ; 5° séparer les volumes simples des volumes commixtes; 6° étiqueter toute la collection par Callimaque; et 7° compter les deux collections et les deux espèces de livres qu'elles contenaient. Qu'y a-t-il d'exact dans ces assertions?
Et d'abord, j'examine la question à savoir si Ptolémée II a fondé deux Bibliothèques. L'existence simultanée de deux Bibliothèques dans les derniers temps des Lagides est hors de doute depuis longtemps ; mais si jusqu'ici les avis étaient partagés sur le fondateur de la première, aie l'étaient bien plus au sujet de la seconde. Les uns attribuaient la création de celle-ci à Ptolémée II, les autres à Ptolémée VII, et j'étais de ce nombre; d'autres encore n'osaient pas suppléer au silence unanime des anciens, et n'en étaient peut-être que plus sages : voilà enfin un Inconnu qui vient jeter son poids dans la balance et désigner Ptolémée II écartant, du même coup, le premier et le septième des Lagi- (134) des. Mais, s'il y a erreur évidente dans ce qu'il affirme sur la première des deux Bibliothèques, et s'il a tort d'en attribuer la création au prince qu'il a pris à tâche d'assimiler à Pisistrate, y a-t il au moins probabilité dans ce qu'il dit sur l'origine de la seconde? Je ne le crois pas; et plus son opinion à cet égard gagne de partisans,— car, depuis les lettres romanesques de Manso sur la cour de Ptolémée Philadelphe, les plus graves critiques se livrent à cet égard aux plus crédules errements des traditions alexandrines, — plus il m'importe de montrer toute l'invraisemblance d'une opinion qui ne soutient pas l'examen. En effet, saint Épiphane dit, avec une sage réserve, ce que voici : « Une autre Bibliothèque s'établit plus tard (ἔτι δὲ ὕστερον καὶ ἕτερα ἐγένετο) dans le Sérapéum, plus petite que La première, et qu'on appela fille de celle-ci (123). Les autres écrivains de l'antiquité gardent la même réserve dès qu'il s'agit de l'origine de cette Bibliothèque ; et ce qu'aucun témoignage ancien n'osait attribuer à Ptolémée, l'Inconnu copié par le fragment et la scolie est le premier et le seul qui l'affirme ; car il est évident que la Bibliothèque qu'il met hors du quartier des palais n'est autre que celle du Sérapéum. Mais, peut-on raisonnablement attacher quelque importance à une assertion qui est postérieure au moins de huit siècles au fait qu'elle affirme ? Voici des raisons contre lesquelles l'autorité d'un écrivain plus jeune que Proclus ne prévaudra jamais.
1° Si favorables que soient les traditions alexandrines à Ptolémée II, nulle ne lui prête la fondation de la bibliothèque du Sérapéum. Cependant, si cette création était de lui, ceux qui revendiquaient en son honneur la fondation du Musée et de la grande Bibliothèque n'auraient pas oublié de rappeler aussi la petite. Quand on considère que cette collection était déposée au principal sanctuaire du pays, dans ce Sérapéum dont parlaient tous ceux qui visitaient la ville (135) d'Alexandrie, par quel hasard les panégyristes dé Philadelphe se seraient-ils tus d'un commun accord sur un fait si glorieux pour celui qui était l'objet de tous leurs hommages? Or ce Lagide n'eut que des panégyristes, tandis que d'autres n'eurent pas même des historiens.
2° Le texte de saint Épiphane est contraire à Ptolémée II. En effet, que nous dit, dans son chapitre xi, ce même écrivain qui, au chapitreix, attribue la première Bibliothèque à Philadelphe ? Nous l'avons vu : plus tard il s'établit encore âne autre Bibliothèque. Or, est-ce bien ainsi que s'exprimerait cet auteur, si l'institution dont il parle était du même prince qu'il vient de célébrer pour une création si fameuse?
3° II est peu probable, malgré toutes les acquisitions de Ptolémée II, que la quantité des livres amassés par lui ait demandé un second établissement ; et il n'est pas croyable qu'un prince de tendances aussi purement grecques que lui ait déposé ces trésors au temple de Sérapis. S'il les a réunis , et je ne conteste pas cela d'une manière absolue, je ne vois parmi ses successeurs qu'Évergète Ier ou Evergète II qui ait pu en faire le fonds de la Bibliothèque du Sérapéum; et ce n'est pas là une opinion ancienne que je viens soutenir de nouveau, c'est la seule opinion qui ait quelques caractères de probabilité.
4° L'Inconnu dit, à la vérité , duas fecit bibliothecas, alteram extra regiam, alteram autem in regia; mais il ne parle pas du Sérapéum. II en parlerait tout explicitement, que son autorité ne serait qu'un témoignage isolé contre le témoignage unanime de ses prédécesseurs ; car, leur silence en est un, quand il s'agit d'un fait aussi grave et aussi bon à mettre dans l'éloge d'un favori de l'opinion.
On le voit, tout ce que fait l'auteur de la tradition suivie par le fragment et la scolie, consiste à résumer et à cumuler sur un seul des Lagides les institutions les plus célèbres de tous. Ses prédécesseurs mettaient l'origine de la première Bibliothèque sous le règne de Ptolémée Ier ou (136) celui de Ptolémée II, et se taisaient sur le fondateur de la seconde. Pour lui, moins scrupuleux qu'eux tous, parce qu'il est à une distance où les nuances se confondent, il met tout sur le compte de celui dont parlaient toutes les traditions. Gela ne saurait surprendre personne. Au vie siècle, les scoliastes n'ont dû admirer, de tous les Lagides, que Ptolémée Philadelphe ; et un écrivain qui compilait à cette époque en face du beau Philadelphéum de Constantinople, a dû nommer Philadelphe à la place de tous les autres.
Ce qui est le plus vraisemblable quant à la seconde Bibliothèque, celle du Sérapéum, c'est qu'elle n'a été fondée par aucun des Ptolémées en particulier; qu'elle s'est formée, au contraire, comme dit saint Épiphane, sans qu'on puisse dire précisément à quelle époque. Cela se conçoit. Il y avait dans le quartier des palais d'Alexandrie tant de locaux où l'on pouvait déposer provisoirement des manuscrits, en attendant qu'ils fussent un peu dépouillés, classés ou définitivement établis , et l'on a dû si souvent y faire des dépôts provisoires, que, plus tard, quand il s'agissait du fondateur de la petite collection, il a pu être difficile de choisir entre celui des Lagides qui en avait fait acheter la plus grande partie, celui qui en avait fait transporter le premier dépôt au Sérapéum, et celui qui avait définitivement organisé cette Bibliothèque. Que serait-ce si l'on était amené à croire que, le Sérapéum eut ses archives dès l'origine, et qu'on ne fit rien de nouveau en y envoyant, du quartier des Palais, quelques manuscrits de plus? Dans cette hypothèse, il ne pourrait plus être question désormais du créateur de la seconde Bibliothèque, et le silence que l'on garde sur les chefs qui veillèrent à cette collection nous indiquerait suffisamment que, pour les volumes grecs qui furent ajoutés successivement aux rouleaux égyptiens, elle demeura toujours une simple succursale de celle du quartier des Palais.
Nous arrivons à des questions plus importantes que la première : Ptolémée II a-t-il fait acheter des livres dans tous les (137) pays de la terre qu'il a pu aborder, et fait traduire par les meilleurs interprètes ceux qu'il a pu se procurer en quelque langue que ce fût ?
Ce prince paraît avoir augmenté considérablement la collection dont il avait hérité , d'abord en faisant acheter des manuscrits dans toute la Grèce, surtout à Rhodes et à Athènes , les deux villes où il s'en faisait le plus grand commerce (124), puis en acquérant une partie de la fameuse collection d'Aristote dont on parlait tant à cette époque, et dont le péripatéticien Straton, l'un de ses précepteurs, avait dû l'entretenir plus d'une fois; enfin, en faisant traduire en grec des ouvrages de littérature étrangère.
Pris dans toute leur simplicité, ces trois faits, attestés par des écrivains dignes de foi, sont hors de doute ; mais il faut réellement les prendre dans cette simplicité.
Et d'abord, si Athénée affirme que Ptolémée II acquit la Bibliothèque d'Aristote tout entière, cela ne saurait être exact; car Strabon et Plutarque rapportent que cette collection, léguée à Théophraste avec l'école d'Aristote, fut laissée à Nélée de Scepsis, transportée dans le pays de ce dernier et plus tard enfouie sous terre, lorsque les héritiers de Nélée eurent à redouter l'avidité des Attales; que, tout altérés, les livres d'Aristote et de Théophraste furent achetés par Apellicon de Téos, et transcrits tant bien que mal par cet amateur, qui combla les lacunes comme il put; qu'enfin, enlevés d'Athènes par Sylla, ils furent confiés successivement à Tyrannion et à Andronicus de Rhodes, qui y apportèrent, à leur tour, des changements et des classifications arbitraires (125).
S'il en est ainsi, Ptolémée II n'a eu ni la collection de Nélée, ni les ouvrages d'Aristote, ni ceux de Théophraste, compris dans cette collection. Or, on ne saurait reléguer, comme cela s'est fait, dans l'empire des fables, le récit si (138) détaillé et si probable de Plutarque et de Strabon, écrivains qui connaissaient si bien les affaires d'Alexandrie et les acquisitions littéraires de Ptolémée II. Athénée paraît donc s'être trompé en affirmant que Ptolémée II acheta la Bibliothèque de Nélée. D'un autre côté, Athénée connaissait aussi les affaires d'Alexandrie. Athénée avait non-seulement sous les yeux les écrits de Callimaque, d'Aristonicus et d'autres, sur le Musée, sur la ville d'Alexandrie et sur le règne des' Lagides, mais il savait parfaitement l'histoire de Nélée et d'Apellicon (126) : Athénée ne saurait donc débiter une fable lion plus quand il affirme l'acquisition de la Bibliothèque d'Aristote par Ptolémée II.
Quel parti prendre sur cet écrivain? Pour moi, je crois que son récit est exact, en ce sens-que le roi d'Égypte acheta des livres de Nélée et crut acheter les ouvrages d'Aristote, que, suivant le philosophe Ammonius Hermiae, il recherchait beaucoup et payait fort cher (127), mais dont Nélée avait eu soin de garder on de vendre des copies, comme il avait eu soin de faire pour tout le reste. Dès lors, le fait général qui nous est rapporté par Strabon et Plutarque conserve son exactitude aussi. En effet, si Nélée vendit au roi d'Egypte une grande partie de sa collection et un exemplaire des ouvrages d'Aristote, il paraît certain qu'il en garda une autre partie, et surtout les originaux des ouvrages les plus précieux.
Cette hypothèse n'explique pas comment Apellicon, Tyrannion et Andronicus ont été embarrassés de compléter leur exemplaire d'Aristote, puisque cet exemplaire n'était pas unique; elle explique encore moins comment ils ont pu se permettre, dans leur édition, des changements si arbitraires, puisqu'on pouvait leur opposer celles qu'on avait ailleurs. Mais de toutes les solutions auxquelles a donné lieu le récit contradictoire des trois écrivains, celle que j'offre est jusqu'ici la seule ad- (139) missible; elle sauve des faits généraux qu'on ne saurait rejeter, et montre, dans son vrai jour, le mérite d'un prince qui acheta beaucoup, mais qui fui souvent trompé; elle rend justice à des auteurs qui peuvent avoir erré sur quelques détails, mais qui n'ont pas dû se tromper sur l'ensemble. Je ne m'arrête pas à réfuter d'autres systèmes; je dirai seulement qu'une argumentation avancée à ce sujet repose sur l'hypothèse qu'il s'agit d'autographes d'Aristote (128), tandis qu'aucun ancien ne parle de cette circonstance.
La traduction, par ordre de Ptolémée, d'ouvrages étrangers, est-elle mieux établie que l'acquisition de la Bibliothèque d'Aristote? Elle n'est attestée, dans la mesure que veut le scoliaste, par aucun écrivain de la tradition païenne d'Alexandrie ; et ceux de la tradition juive ou chrétienne en parlent généralement avec une emphase qui les rend suspects. Strabon (xvi, c. 1) dit simplement que les Grecs n'ont connu la durée de l'année que par des traductions faites de traités égyptiens; il ne dit pas un mot de Ptolémée H à ce sujet. Mais suivant Eusèbe et S. Épiphane, Démétrius de Phalère aurait appelé l'attention de Ptolémée Philadelphe sur les écrits importants que possédaient les Éthiopiens, les Indiens, les Perses, les Elamites, les Babyloniens, les Assyriens, les Chaldéens, les Romains, les Phéniciens, les Syriens, les Grecs, Jérusalem et la Judée. C'est là une énumération oratoire, ce n'est pas une indication historique, car Démétrius ne fut pas le conseiller de Ptolémée II, et ce prince eût mieux reçu de son père, qui connaissait l'Asie et l'Afrique, que de l'ancien gouverneur d'Athènes, qui connaissait peu ces régions, les renseignements dont il s'agit.Dans tous les cas, le conseil serait demeuré stérile pour toute autre littérature que celle des Juifs (129). Suivant le Syncelle, qui est à-la-fois plus réservé et plus hardi que ses prédécesseurs (130), Philadelphe (140) aurait réuni les livres de tous les Grecs, des Chaldéens, des Égyptiens et des Romains; il aurait fait traduire en grec tous ceux qui étaient rédigés en langue étrangère, et déposé 80,000 volumes dans les Bibliothèques qu'il avait fondées.
Ce sont des autorités de ce genre que suit notre Inconnu; seulement, plus concis que le Syncelle qui lui-même était plus concis qu'Eusèbe et S. Épiphane, il se borne à dire que Ptolémée fit traduire des livres de toutes les langues dont il put se procurer des écrits. Mais ce n'est ni un fait nouveau qu'il vient nous apprendre, ni un témoignage qui s'ajoute à un autre témoignage; c'en est un seul, celui d'Eusèbe grossi par S. Épiphane.
Cependant, le fait général de certaines traductions faites par ordre de Ptolémée II n'en est pas moins vrai; seulement il faut le dépouiller de tous les ornements oratoires dont on l'a paré. Ce qui est historique, c'est qu'on a traduit quelques volumes tirés des sanctuaires d'Héliopolis et de Jérusalem.
Quant aux volumes égyptiens, le Syncelle nous apprend que Manéthon et Eratosthène traduisirent des documents anciens pour leurs travaux de chronologie, et cela est tellement probable, qu'on peut le considérer comme acquis; mais, pour tout ce qui concerne la littérature d'Égypte, il n'y a que cela de probable, et cela même ne peut être revendiqué tout-à-fait au règne de Ptolémée II, puisqu'Ératosthène fleurit sous Ptolémée III.
La question des traductions faites sur l'hébreu est plus compliquée. Le faux Aristée, Josèphe, et les écrivains ecclésiastiques qui les suivent, rapportent que, sur le conseil de Démétrius de Phalère, Je premier ou le second des Lagides (le fils acheva sans doute l'œuvre commencée par le père, ce qui explique le rôle de Démétrius), fit faire à Alexandrie la version dite des Septante; qu'elle y fut déposée à la Bibliothèque et conservée avec le plus grand soin (Euseb., Chron. I, p. 53, ed. Maii). Mais, sur ce fait encore, on débite beaucoup d'exagérations de détail qu'il faut rejeter. En ef- (141) fet, quand on considère qu'Aristée, Josèphe et ceux qui ont cru à la bonne foi de ces deux écrivains, donnent successivement, sur l'origine de la version dont ils parlent, les récits les plus variés; que les juifs les plus instruits de ces temps, tels que Philon, ne craignent pas de débiter les plus singulières fictions sur les préférences dont ils étaient l'objet sous les Lagides ; que la convocation des LXX interprètes aurait été faite sur l'avis du même personnage qui a conseillé aux Lagides la création, pour les Grecs, de la Bibliothèque et du Musée d'Alexandrie ; que, d'un côté, on parle d'un Pentateuque grec que Platon déjà aurait consulté, et qui aurait précédé de beaucoup celui des Septante, tandis que d'un autre côté, la plupart des livres de l'Ancien Testament qui faisaient partie des Septante au temps d'Eusèbe, n'ont été traduits en grec qu'après le règne de Ptolémée II; quand on considère de plus que, dans ces différents livres, le style des traducteurs diffère singulièrement ; qu'en général le texte traduit se rapproche du code samaritain plutôt que du code palestinien ; que si les Juifs de Palestine, et Josèphe surtout, ont partagé un instant l'enthousiasme de ceux d'Egypte pour cette version, ils l'ont bientôt traitée avec une antipathie que le Talmud ne cache pas: quand on considère tout cela, la seule chose qui demeure probable, c'est que les Juifs d'Alexandrie traduisirent les livres de Moïse sous le règne des premiers Lagides, et que ces princes accueillirent ce travail avec l'empressement d'avides collecteurs (131).
Mais le firent-ils déposer à la Bibliothèque, comme les traductions faites par Manéthon et Ératosthène? Je n'en doute (142) pas. On objecte contre cette pensée queTertullien ne trouva de son temps, au Sérapéum, qu'un exemplaire du texte hébraïque (132); mais si le dépôt n'eut pas lieu au Sérapéum, — et cela est probable — l'incendie de la première Bibliothèque dans la guerre de César explique la remarque de Tertullien, et le fait d'une traduction déposée au Bruchium demeure probable.
Toutefois ce qui ne sourient pas l'examen, ce sont les fictions qu'Aristée et ses imitateurs ont successivement répandues sur ce fait. A qui persuader, en effet, que dans un pays où il y avait tant de Juifs, dans une capitale où ils avaient des synagogues régulièrement établies, il ait été nécessaire que Philadelphe fît venir leur code de Jérusalem; qu'il ait appelé jusqu'à soixante-dix interprètes d'une ville où l'on savait peu le grec, tandis que tout le monde le savait dans sa capitale; qu'ils aient fait un travail si imparfait par vote d'inspiration, et traduit si vite et lu en public une collection d'ouvrages si divers; qu'on ait disposé pour eux une sorte de Musée ou de Syssitie transitoire et qu'on ait institué en leur honneur des banquets, sans que, de tout cela, rien ne fût venu à la connaissance de ces nombreux organes de la tradition alexandrine qui ont tant célébré leur favori?
Qui ne voit pas, au contraire, par ce chiffre de LXX, que c'est ici le conte judaïsé des soixante-douze Grammairiens de Pisistrate ? En voyant une célèbre Bibliothèque se former sous la direction de Démétrius, les Juifs d'Alexandrie se seront empressés d'offrir leur Code pour cette collection, et, pour donner à leur version toute l'autorité dont elle avait besoin, ils l'auront attribuée à un conseil de traducteurs appelés de Jérusalem. Le chiffre de LXX n'est-il pas ce même nombre sacré qu'on trouve partout cité dans leurs affaires religieuses? En effet, ce sont soixante-dix chefs qui assistent Moïse au désert ; soixante-dix magistrats qui forment le (143) sanhédrin de Jérusalem. Le fond historique d'une version faite en Égypte pour les besoins des Juifs qui cessaient de comprendre l'hébreu une fois adoptée, le narrateur primitif avait son thème fait pour tout le reste.
Mais c'est bien le Pentateuque seul qu'on a traduit sous les premiers Lagides ; et, en résumé, c'est aux cinq livres de Moïse et à quelques traités d'astronomie ou de chronologie égyptienne que.se réduisent toutes les traductions faites sous Ptolémée ll. C'est donc se tromper singulièrement, que de composer tout le fond de la première Bibliothèque d'Alexandrie d'ouvrages égyptiens ou traduits de la littérature orientale (133). Non seulement personne ne connaît avant Eusèbe et l'Inconnu les interprètes dont ils parlent, mais personne n'a vu les ouvrages qu'ils auraient traduits. Aussi les excellents interprètes qu'ils mentionnent ne sont pas les Manéthon et les Ératosthène, mais les Septante dont il est question dans la tradition d'Aristée et de Josèphe adoptée à Byzance; car c'est celle-là qu'ils suivent en cet endroit, ce n'est pas celle des Strabon, des Plutarque, des Athénée. Si la Bibliothèque d'Alexandrie avait possédé réellement des ouvrages d'Orient traduits en grecs, les membres du Musée ne se seraient pas dispensés si complètement de les étudier. De cette étude, ils eussent été entraînés dans celle des monuments de l'Asie, et, de là, dans l'exploration de l'histoire, de la religion, des mœurs, de la politique de l'Égypte; ils seraient entrés ainsi dans les vues de Ptolémée Soter, au lieu de se perdre dans celles de son fils, et le Musée ne serait pas devenu, contrairement aux vues de son fondateur, une simple école d'études grecques.
Ptolémée II a-t-il mérité le nom de fondateur de la Bibliothèque par d'autres travaux? A-t-il donné, à cette institution, une organisation plus précise? A-t-il, en particulier, appelé simultanément plusieurs savants à la tête de l'établis- (144) sement ; et a-t-il chargé chacun d'eux d'un département spécial ?
D'après l'Inconnu, trois savants distingués se seraient trouvés en même temps bibliothécaires, ou du moins collaborateurs à la Bibliothèque, et chacun d'eux, Zénodote, Alexandre et Lycophron, aurait dirigé un travail spécial. Si cela est exact, une organisation nouvelle et plus positive que la première a été donnée à l'institution de Ptolémée Ier par son fils. Or cela n'a rien que de probable ; car si l'un de ces princes fut plus grand politique, l'autre, élevé par trois savants, était plus instruit : il a donc pu faire ce que dit le scoliaste. Mais si, par hasard , ce dernier confondait en cet endroit les travaux qu'il attribue aux trois personnages en question avec d'autres travaux qu'ils firent réellement, moins en qualité de bibliothécaires qu'en qualité de membres du Musée, son texte n'ajouterait à l'histoire déjà si obscure de la célèbre Bibliothèque, qu'une erreur de plus. Or, cette pensée se présente naturellement; et, en nous apprenant que Ptolémée II a fait classer les poètes grecs par les trois savants qu'il nomme, il me paraît simplement changer des travaux librement exécutés en travaux ordonnés par un prince qu'il se plaît à mettre au-dessus de Pisistrate ; car tel est presque le but de son récit. En effet, Zénodote a donné aux poésies d'Homère des soins extraordinaires ; c'est là ce que la tradition a voulu dire et ce qu'elle dit à sa manière. A la vérité, Zénodote n'a pas fait le même travail pour les autres poètes dont le scoliaste parle aussi ; mais en bien examinant le texte de ce dernier, on voit qu'il ne s'agit pas de révision, qu'il y est à peine question d'un peu plus que d'un simple travail de bibliothécaire. Les mots in unum collegerunt et in ordinem redegerunt ne disent pas que, des trois savants, l'un a formé un cycle épique, l'autre un cycle tragique, le troisième un cycle comique ; ils indiquent seulement qu'on a fait une collection complète et une mise en ordre des poètes comiques, tragiques, épiques et autres. Ce travail, (145) Ptolémée II pouvait l'ordonner et les trois savants l'accomplir, cela est hors de doute; mais la question est de savoir si le scoliaste du vie siècle, qui a fourni ce fait au scoliaste du xve, n'a pas altéré une tradition déjà fort altérée. Il se pourrait, en effet, qu'il y eût dans cette tradition une grande méprise sur le travail exécuté par Zénodote à l'égard d'Homère; une autre méprise sur un travail de Lycophron, qui avait écrit, sur la Comédie, un ouvrage dont Athénée a cité le neuvième livre, mais qui ne fut pas un travail de bibliothécaire sur les poètes comiques ; et une méprise encore au sujet d'Alexandre l'Étolien, qu'on aurait chargé d'un travail sur les poètes tragiques, parce qu'il était poète élégiaque et tragique, mais dont l'ouvrage indiqué par le scoliaste est demeuré inconnu à toute l'antiquité. Dans mon hypothèse, le récit fait enfin par un dernier scoliaste d'après plusieurs générations d'autres scoliastes ne serait autre chose qu'un résumé fort libre des travaux exécutés réellement, sous le deuxième des Lagides, par un éditeur d'Homère, Zénodote, deux membres de la Pléiade tragique, Alexandre et Lycophron, et un membre de la Pléiade générale, Callimaque. Je ne pense pas qu'il y ait davantage; et toute cette histoire doit désormais occuper, dans l'opinion des critiques, une place un peu différente de celle qu'on a voulu lui assigner. J'arrive au cinquième point des travaux exécutés, suivant ces textes, sous Ptolémée II : Callimaque aurait mis des titres sur tous les volumes de la collection des ouvrages simples, non mixtes. Ce travail était utile, peut-être nécessaire ; le prince a pu le désirer, et Callimaque, le plus universel et le plus laborieux des savants, le faire. Mais le poète Callimaque aurait-il réellement mis des étiquettes sur les volumes d'une collection que le fragment porte à 110,000, la scolie à 90,000 ouvrages? Aurait-il même présidé à l'entreprise, ou bien cette tradition ne serait-elle pas encore l'amplification d'un autre travail plus certain, j'entends les Tableaux de tous les genres de littérature, ouvrage célèbre, qu'avait inspiré à Callimaque (146) la collection que l'Inconnu lui fait cliqueter, mais ouvrage dont il a tort de faire une opération de bibliothécaire? Le mot de πίνακες qui signifie libellus et index libri,, pourrait s'expliquer dans un autre sens par le travail que, suivant Plutarque (Syllac. 26) Andronicus a fait pour les écrits d'Aristote, auxquels il ajouta les titres et ta table des matières, ἀναγράψαι τοὺς νῦν φερομένους πίνακας.. Mais je pense qu'on peut renoncer aux titres et aux tables comme aux étiquettes.
J'arrive au sixième travail indiqué par les textes , la séparation des volumes simples et de, volumes commixtes, point important et qui se confond avec le septième, le relevé du chiffre des uns et des autres, relevé fait, suivant la scolie, sous le règne de Ptolémée II, et constaté dans un ouvrage de Callimaque. Ici, point de doute, l'Inconnu avait sous les yeux l'auteur qu'il copiait, Callimaque, et peut-être le Musée de ce savant, ou quelque notice extraite de ce livre, si déjà il n'existait plus; car je ne pense pas que les chiffres qui nous sont donnés se trouvassent dans les Tableaux. Ce que les textes disent, à cet égard, étant précis, mérite créance; cela ne s'inventait pas et cela est d'accord avec d'autres données.
En effet, des relevés analogues ont été faits pendant le règne de Ptolémée II, sous la direction de Démétrius de Phalère, si Josèphe est digne de foi, et Ptolémée III, a pu faire répéter cette opération par Eratosthène, car celle où figure le nom d'Eratosthène , appartient à ce règne. Dans ces indications toutes positives, il n'y a donc rien qui ne soit vraisemblable. Les princes qui faisaient tant de sacrifices pour une collection qu'ils désiraient rendre unique et fameuse partout, étaient naturellement curieux de savoir et de publier un chiffre; et plus ce chiffre se présentait ronflant, mieux il était accueilli. Celui du relevé de Callimaque pouvait être considérable, le zèle du prince pour les lettres était réellement extraordinaire, et, quelque opinion qui puisse prévaloir dans ta question de la seconde bibliothèque, c'est un fait incontestable qu'une (147) étonnante quantité de livres fut ajoutée par Ptolémée II à la Collection faite par son père. Quelle fut cette quantité?
Le chiffre en varie chez les anciens, et ces variante» font mauvais jeu aux modernes qui ne distinguent pas les époques, mais en tenant compte de tous les faits, on arrive à des résultats acceptables. Nous avons vu qu'à la mort de Ptolémée I, il y avait, nombre rond, 200,000 volumes; La chronique de Manassès donne pour l'époque de Philadelphie le nombre rond de 400,000, (134) que donnent aussi Sénèque et Orose,dont les indications relatives à l'époque du grand incendie semblent établir que la bibliothèque du Bruchium ne contint jamais plus de 400,000 volumes, et qu'après le règne de Ptolémée II on déposa ailleurs les acquisitions nouvelles, indications qui simplifient et éclaircissent beaucoup la discussion (135). Eusèbe, Cedrénus et le Syncelle, au contraire, se sont attachés au chiffre de 100,000. S. Epiphane a celui de 54,800, que nous allons tout-à-l'heure expliquer (136)
Ces différences, si notables et si frappantes chez les auteurs qui suivaient des indications anciennes et qui n'ont pas pu inventer de chiffres, étonnent à juste titre. Elles ont amené toutes sortes de conjectures. On aurait dû en faire une de plus, celle que ces variantes tiennent moins à des négligences ou à des exagérations qu'à des manières différentes de compter les volumes. Cette pensée se présente naturellement quand on considère le caractère de la Collection dont il s'agit. En effet, on l'avait composée, dans l'origine, de tout ce qui pouvait s'acquérir; et, pour avoir la meilleure édition d'ouvrages fort altérés, on avait réuni un grand nombre d'exemplaires. Il y avait donc des doubles. Dès-lors il y avait deux manières au moins de faire le relevé de l'ensemble : on comptait ou l'on excluait les doubles, les triples, les quadruples, etc. Sans doute, il (148) n'était pas également important de faire l'un ou l'autre de ces relevés, mais on était bien aise de faire l'un et l'autre.
Dans l'origine ceux qui écrivaient sur le Musée ou la Bibliothèque, se trompaient d'autant moins à cet égard que c'étaient des écrivains d'Alexandrie, tels que Callimaque, Ératosthène, Ptolémée VII, Aristonicus, etc. Ceux qui les copièrent plus lard prirent, au contraire, sans en avertir leurs lecteurs, tantôt le chiffre de tous les volumes, tantôt celui des volumes qu'on obtenait en comptant un seul exemplaire par ouvrage. De cette différence dans les indications résulta la confusion qui a désolé si longtemps la critique.
Plutarque avait, il est vrai, mis sur la voie d'une distinction, en donnant d'après Calvisius le chiffre de la bibliothèque de Pergame, livrée à Cléopâtre par Antonin. Il disait qu'il y avait 200,000 βιβία ἁπλόα (137). Mais ce terme technique était devenu inintelligible, et de toutes les explications qu'on avait proposées, celles d'autographes, d'ouvrages simples à l'exclusion des doubles, de feuilles de parchemin ou de papyrus simples (non doubles), aucune n'avait prévalu. Notre Inconnu qui a pu copier en cet endroit Callimaque ou un scoliaste de l'auteur du Musée, en venant faire une distinction formelle entre les volumes simples, ἀμιγᾶ, volumina simplicia et digesta, et les volumes commixtes, συμμιγᾶ, semble expliquer le terme de βιβλία ἁπλόα qu'emploie Plutarque, dans le sens d'ouvrages dont le dépouillement est fait, dont l'intégrité et l'authenticité sont arrêtées, dont toutes les pièces faussement attribuées à l'auteur ont été écartées par les Chorizontes, en un mot, qui ont passé sur la planchette (πινακίδιον) où, suivant Galien, on déposait les ouvrages examinés, et dont enfin on ne comptait pas les doubles.
En effet, la scolie donne pour la bibliothèque du palais, 400,000 volumes commixtes et 90,000 volumes simples, nombre quo le fragment porte à 110,000. Or, les mots, et, ce (149) qui n'est pas moins décisif, les proportions des chiffres, si conformes à la nature des choses, autorisent également notre interprétation. On comprend, sans peine, que tout compte fait, il n'y ait eu, sur 400,000 volumes, que 100,000 ouvrages, et que la majeure partie de la collection faisait double emploi. Et tout s'explique dans ce système: les 100,000 volumes simples sont les 100,000 d'Eusèbe, de Syncelle et de Cedrénus élevés à l'état de nombre rond; les 54,800 de S. Epiphane, sont les livres simples des 200,000 commixtes laissés par Ptolémée Soter ; les 400,000 de Sénèque, d'Orose et de Manassès sont les 400,000 commixtes, et avec les 90 ou 110,000 simples, ils forment les 500,000 d'Aristée.de Josèphe et de Zonaras (138).
La tradition qui fixe le chiffre de la seconde bibliothèque (celle qui était située hors du quartier des Palais) à 42,800 volumes ne distingue pas là les volumes simples et digestes des commixtes. Cela confirme l'exactitude de ses données ; car il est naturel de penser que le dépouillement d'une collection qu'on venait de verser dans l'ancien quartier n'était pas fait, lorsqu'Ératosthène en prit le relevé. On a dit, il est vrai, que la bibliothèque du Sérapéum s'étant formée pour les besoins de l'enseignement dans ce quartier, n'a eu qu'un exemplaire de chaque ouvrage; mais cette hypothèse ne soutient pas l'examen. Rhakotis, habitée par la population égyptienne et dominée par son antique sacerdoce, ne fut pas le siège d'un enseignement grec sous les premiers Lagides ; elle ne l'est devenue que dans la suite des temps, après l'incendie de la bibliothèque du Bruchium, après les ravages exercés, dans le quartier des Palais , par Caracalla, Aurélien et Dioclétien, et après l'alliance qui se fit, entre toutes les fractions de la population païenne, à la suite du progrès, si alarmant pour elles, des institutions chrétiennes. Il serait d'ailleurs difficile de rien concevoir de plus moderne (150) que cette hypothèse d'une bibliothèque académique, et rien de plus contraire à l'histoire qu'un enseignement grec institué au Sérapéum à une époque où toutes les études alexandrines se concentraient auprès de la cour et dans le quartier des Palais.
Tout s'accorde donc à rendre les dernières indications de l'Inconnu aussi vraisemblables que ses premières étaient fausses ; et la diversité de leur origine suffit pour nous en expliquer la différence. Il avait puisé les unes, celles sur les traductions, dans les traditions judaïsées; il avait résumé sur les traditions générales les travaux de Philadelphe, et prit dans Callimaque , dans Eratosthène, ou dans des scoliastes qui avaient copié ces auteurs, les chiffrât des deux relevés. On n'objectera pas, je crois, que les chiffres de 400,000 et de 100,000 sont trop ronds pour être copiés dans Callimaque; car Callimaque était non-seulement bibliothécaire, mais poète et courtisan, et l'ami de ce Conon qui voyait parmi les constellations la chevelure de Bérénice, avait pu arrondir un chiffre si susceptible de l'être. Une exactitude rigoureuse était, je crois, sinon impossible, du moins d'une difficulté extrême et en dehors des habitudes de Callimaque comme de celles de Lycophron et d'Alexandre.
Il en a été autrement du relevé d'Eratosthène, qui nous présente un chiffre plut mathématique. En effet, le scoliaste invoque l'autorité d'un relevé fait par Ératosthène, un peu après celui de Callimaque; et c'est suivant moi à cette opération qu'appartient le chiffre moins rond,. ou plus exact, de 43,800. Car, à cet égard, on doit dira de deux choses l'une: ou le témoignage d'Ératosthène se rapporte à un relevé spécial, ou bien il est une simple répétition de celui de Callimaque. Mais ce dernier cas n'est pas admissible, Ératosthène n'ayant ni vérifie ni écrit, dans la pensée du scoliaste, la même année que Callimaque, son prédécesseur à la Bibliothèque. Reste le cas d'un relevé spécial qui n'a pu se faire que sous le règne de Ptolémée III, Eratosthène n'avant pré- (151) sidé à la Bibliothèque que sous ce prince. Aussi le scoliaste, tout en se bornant à résumer en traits généraux et sans distinction de règnes, indique-t-il une remarquable différence entre les deux opérations, en nous donnant le chiffre moins rond de 42,800 volumes, qui est celui de la seconde Bibliothèque, collection dont on ne saurait mieux placer l'origine que sous le règne de Ptolémée III et sous le bibliothécariat d'Ératosthène. On conçoit d'ailleurs qu'un troisième relevé porte un cachet spécial d'exactitude.
Après cela, je n'ai plus qu'à vider un incident et une objection. S'il est certain qu'Ératosthène a pu faire un relevé, puisqu'il a été bibliothécaire pendant de longues années, et sous le règne de Ptolémée III, Callimaque avait-il pu en faire un autre, et avait-il été bibliothécaire sous celui de Ptolémée II? On en doutait avant l'assertion si formelle de la scolie latine, et l'on combattait surtout l'hypothèse que j'avais émise de plusieurs bibliothécariats simultanés (139). Or, si Caecius dit vrai en attribuant des travaux de bibliothécaires à Alexandre, à Lycophron et à Callimaque, qui secondèrent les soins de Zénodote, il confirme à-la-fois mon hypothèse et le bibliothécariat de Callimaque, qui étaient mis en doute.
En effet, comme ce savant n'a pu être chef de la Bibliothèque que de l'an 246 à l'an 248 avant J.-C., il a dû être avant cette époque le collaborateur de Zénodote, comme Alexandre et Lycophron. Le docte Zénodote, qui remplaça Démétrius de Phalère la deuxième année de la 124e olympiade et 283 ans avant J.-C., vécut jusqu'à la 133e olympiade, et rien ne porte à croire qu'avant sa mort il ait laissé son poste à Callimaque, qui mourut lui-même fort âgé vers la deuxième année de la même olympiade, et qui, d'après cela, n'aurait passé à la Bibliothèque que les dernières années d'une vieillesse fatiguée. Pour qu'il ait pu exécuter une partie seule- (152) ment des immenses travaux que le scoliaste lui attribue, et composer même les πίνακες, étiquettes, tables ou tableaux, il faut nécessairement qu'il ait été associé à Zénodote, avant de le remplacer. La simultanéité de plusieurs bibliothécariats est donc désormais aussi hors de doute que la réalité de celui de Callimaque.
Constituée en deux grandes divisions, celle des commixtes et celle des simples ou digestes, la bibliothèque , y compris peut-être le dépôt qu'on devait transporter plus tard au Sérapéum, mais qui était encore indigeste, se trouvait désormais dans une voie régulière, grâce aux travaux de chefs éminents et de subordonnés moins illustres. On savait ce qu'on possédait d'ouvrages à la grande Bibliothèque, et l'on pouvait compter le moment où, ce qui restait à dépouiller, serait également catalogué, si l'on m'accorde ce terme, pour former ensuite la petite. On pouvait donc dire, en parlant en poète, comme Callimaque a dû parler dans son Musée, que deux collections différentes devaient leur origine à Ptolémée II, d'autant plus que la séparation avait peut-être commencé sous le règne de ce prince.
Voyons maintenant ce qui seflit pour le Musée.
(1) Liv. XVII.
(2) Steph. Byz. v. Alex.. Mêla, I, 9; II, 7; III, 9. — Plin., V, 10.
(3) Bonamy, Mém.de l'Acad. des Insc. IX. — Pococke, Voy. en Orient., t.1. — Clarke, édition de César. — Cuper, De apotheosi Homeri. — D'Anville, Mémoires sur l'Egypte ancienne et moderne, p. 53. — Saint-Genis, Desc. de l'Ég., t. V. — Gr. Lepère, ibid., XVIII. — Mannert, Geog. der Gr. und Roem. Africa, I, p. 615.
(4) L'an 333 avant notre ère.
(5) A 31° 11' 20" de latitude, 47" 51' de longitude.
(6) Arrian., lib. III, c. 1.
(7) Vitruv., II, praef. cf. Plin., V, 10. — Strabon. XIV, c. 1 — Justin nomme le gouverneur Cléomène, XIII, c. 4. — Julius Solinus, c. 45.
(8) Jablonsky, Pantheon, II, c. 5, prétend que les Égyptiens continuèrent à désigner la ville sous le nom de Rhakotis. Cela est douteux; mais Ptolémée nomme la ville Alexandrie et Rhakotis.
(9) In Flaccum, p. 973, a.
(10) Journal des savants, 1837, cah. de nov., p, 659.
(11) 2,400,000 fr.
(12) Établissements de la marine, arsenaux, chantiers et magasins ; car le mot νεώρια est évidemment général.
(13) Ἀποστάσεις. Ce mol peut se traduire différemment, soit par darses, soit par magasins de marchandises.
(14) Strabon, XVII, c. 1. — Dio Cassius, LI, c. 18. — Joseph., Bell, jud., IV, c. 11.
(15) Ouvrages exécutés ou dons présentés, soit à la suite d'un vœu, soit pour gagner la faveur des dieux.
(16) Lib. V, c. 1, p. 187, éd. Mitscherlich.
(17) Diod., XVlI, c. 52.—Strab.,lib. XVII, c. 1. — Joseph. Bell. Jud. ,ll, c. 28.
(18) De apotheosi Homeri , p. 159.
(19) Herodian., IV, 3; VII, c. 6. — Ammian. Marcellin, 1. XXII, c. 10.
(20) Description de l'Egypte, t. III, p. 454. — Sur l'ambition d'Héliogabale. V. Aelii Lampridii Holiogabalus, c. 24.
(21) Saint-Genis, l l.
(22) Cuper , p. 160.
(23) Les Lagides partagèrent l'ambition d'Alexandre et la transmirent aux Césars.
(24) Δίι εἰκασμένος, dit Pausanias. Eliac., V, 24.
(25) Champollion jeune dit que le nom de ce palais est écrit sur toutes les murailles ; que les Egyptiens l'appelaient Ramesseion, comme ils nommaient Aménophion le Memnonium, et Ménephtheion le palais de Kournah (V. Letronne, sur le monument d'Osymandias, p. 5. note 1], Si les inscriptions égyptiennes qu'on y lit portent réellement une terminaison grecque, elles datent indubitablement de la domination des Lagides; et ces dénominations elles-mêmes sont imitées de celles des édifices d'Alexandrie.
(26) Dion, lib. LI, c. 16. — Sueton. August. c. 18.
(27) Lib. XIII. c. 22.
(28) Plin., lib. XXXVI, c. 16.— Descript. de l'Egypte, Ant,, vol. V, p. 437.
(29) Proverb. 16, au mot Naëra. cf. Dio Cas,., Ll, 10.
(30) Légat, ad Caj.,p. 697, éd. Turn.
(31) Sainte-Croix, l.l.
(32) Progytnnasmata, 335, éd. Elz.
(33) Norden, v. I, p. 6.
(34) Diod., XVII, 115. — Sainte-Croix, Examen, p. 472 —Caylus, Hist. de l'Acad. des Inscr., t. XXXI, p. 76. — Mémoires de l'Institut, IV, 395.
(35) On n'ignore pas que les grottes sacrées jouent un grand rôle dans le culte des anciens. V. Cuper, De apotheosi Homeri, p. 31.
(36) Pococke croit en reconnaître les ruines dans la colline que nous considérons comme les débris du Sérapéum. Description of the cast, I, p. 6.
(37) Arrien, lib. III, c. 1.
(38) Am. Marcell., lib. XXII, c. 16. — Ruffln., lib, XI, c. 28.
(39) Ruffin., lib. XI, 23. cf. Norden, I, 243, éd. de Langlès.
(40) M. Letronne, Recherches sur l'hist. de l'Egypte. ,introduc., p. 24 et passim.
(41) Saint-Genis, p. 364. — On voit aujourd'hui un massif de ruines que l'on considère comme le dernier reste de cette célèbre institution.
(42) Cf. Norden, I, 20. A cette hypothèse se joint celle que le goût des Grecs les porta à faire effacer les hiéroglyphes ou du moins une partie de ces signes.
(43) Οἴκος μέγας.
(44) 'Ἐξέδρα
(45) Περίπατος
(46) T. I, p. 3 et 35.
(47) Magas. Encycl., 5e année, vot. 4, p. 434.
(48) Dio Cassius, III, c. 38.
(49) Aelian., lib. iii,c, 17. Συνὼν τῷ Πτολεμαίῳ νομοθεσίας ἤρξε.
(50) Philo, vita Mosis, et Joseph, contra Apion., lib. ii, passim.
(51) Voyez ci-dessus, p. 33.
(52) Regum et imperat.Apophthegm.
(53) Iren., III, 21. — Euseb., H. E. V, 8. — Clem. Alex. Strom., I, 22. - Theodor., Prœf. in Psalm.— Euseb., Chronic., éd. Scalig., p. 66. —Tertult., Apol., c. 18. — Epiph., de mensur. et pond., c. 0 — August., Civ Dei, XVIII, c. 42.
(54) Joseph., Antiq., XII, 2, — Suidu, au mot Zénodote.
(55) Geogr. lib. XVII, c. 1.
(56) Vitœ Sophist., lib. I. Vita Dionys.
(57) Keilhacker , de Museo Alexandrino , Leips., 1698. — Geriscber, de Museo Alexardirino ejusque δωρεαίς et δώροις, ib., 1730, — Gronovius, de Museo Alex-. ; in Thes, antiq. Grae., t., VIII, in calce. - Kuster, ib. - Manso, Briefe aus Alexandrien, Vermischte Schriften. I.—Parthey, das Alexandrinische Museum. — Klippel, über das Alexandr. Museum. — cf. Heyne , de genio seculi Ptokmœorum. — Sprengel, die Alexandrinische Schule, dans l'Encyclopédie (allemande) de MM. Ersch et Gruber. — Voir aussi les écrits de Sainte-Croix, Reinhard, Beck, Dedel, M. Auguis, etc., sur la Bibliothèque d'Alexandrie
(58) Chronologie des Lagides, par M. Champollion-Figeac, et les observations de Saint-Martin sur cette chronologie. L'adjonction de Ptolémée Philadelphe au règne de son père paraît être du 2 novembre 285, A. J. Ch.
(59) Du Traité, Ὅτι οὐδὲ ζῇν ἐστιν ἡδέως, c. 13.
(60) Deipnosoph., V, p. 284, éd. Schw.
(61) Arrian. in Prœf., lib. I, c. 1. — Plutarch. in Alexandre. — Id., de Alexandri fortuna, II, c. 1. — ld., de cohibenda ira. 1,9.— Quint.-Curt., IX., c. 8. — Diog. Laert. dans les vies de Stilpon, Straton, Démétrius et Théophraste.
(62) Voy. ci-dessus, p. 33.
(63) Πολλοὶ μὲν βόσκονται ἐν Αἰγύπτῳ πολυφύλῳ || βιβλιακοὶ χαρακεῖται, ἀπείρετα δηριόωντες. Athen.Deipn., î, p. 29. éd. Casaub., p. 84. Schweigh.
(64) Geog., lib. XVII, c. 1.
(65) Lib. V, c. 11. cf. Cicer. Tusc. quaest. in intio. - Id. ad familiares, VII, 23.
(66) Rob. Walpole, Memoirs relating to Turkey, t. I, éd. de 1818.
(67) M. Letronne, sur le monument d'Osynandyas, p. 28.
(68) Lib. VI, c. 5.— Cf. Gronovius et Kuster, Thesaur. Antiq., t. VIII.
(69) Parthey, das Alexandrin. Museum, p. 52.
(70) Artemidor. Ephes., in geogr. Minor,, éd. Hudson, l , p. 62.
(71) Geog. der Griech. u. Roem. t.. X, p. 628, 1er partie.
(72) Voyez le traité de Ménage, Historia mulierum philotopharum, à la suite de son édition de Diogène de Laërce.
(73) M. Parthey lui donne tout un stade carré; mais c'est là la mesure du Gymnase, et il n'en fallait pas autant pour trente à quarante savants qu'à toute la jeunesse grecque d'Alexandrie.
(74) Οἴκων παντοδαπῶν πλήρης.
(75) Athen., lib. XI, e. 12, p. 331. Schw.
(76) Un grand-prêtre d'Eleusis, un grand-prêtre de Bacchus (Philiskus), un prêtre d'Héliopolis (Manéthon), et peut-être deux grands-prêtres du judaïsme (Zédékias et Eléazar).
(77) Gronov., Thes. Antiq., VIII, p. 2762.
(78) M. Klippel.p. 92 .note 4.
(79) Letronne, la statue vocale de Memnon, p. 145 et suiv.
(80) Certamine facto Aegyptiorum et Graecorum, quis eorum Musium accipiat, argutiores et perfectiores inventi suni Aegyptii, et vicerunt, et Musium ad eos judicatum est. Vetus descriptio orbis, éd. Gothof., p. 19.
(81) Arrian., III, 1.
(82) V, ci-dessous, Ptolémée II et Ptolémée VII.
(83) Vit. Dionysii, p. 524 éd. Morel.
(84 V. ci-dessous, Claude.
(85) P. 102.
(86) P. 99.
(87) M. Parthoy, Das Alexandr. Museum, p. 58. On peut comparer Heyne, Opus Acad., I, p. 124, et Manso, Vermisch. Schrift., I, 236.
(88) Philost. vita Dionys., p. 524, éd. Morel.
(89) Τῶν ἐν τῷ μουσείῳ σιτουμένων ἀτελῶν φιλοσόφων. Gronov., L. L. Falconieri Insc. Athlet. n. iv. p. 97.
(90) Dio Cassius, LXXVII, 7.
(91) Philost. in Polem., p. 532.
(92) Suidas, aux mots confondus Aristophane et Aristonyme.
(93) Plusieurs membres du Musée furent chargés de ces fonctions.
(94)M. Parthey, das Alex. Museum, p, 32.
(95) Apoll. Rhod., éd. Brunk, I, p. 10.
(96) Strabo, XIII, c. 1. - Sueton. in Domit., c. 20.
(97) Comment. II ad Hippoc. lib. III. Epidem. p. 411.
(98) Gallien, de Dypsnaea, lib. II, p. 181. - Lib. III, Epidem., comm. 2., p. 411. - Lib. de Natura hum., p. 4.
(99) V. la lettre d'Aristée, et les témoignages qui s'y rapportent dans Galland, Biblioth. Patr., II, p. 809., seq. - Cf. Joseph., Antiq., XII, 2, 2-14, Zonar., Annal., IV, 16, p. 199, ed. P aris.
(100) Ritschl., die Alexendr. Bibliotheken, p. 32.
(101) Diog. Laert., lib. II, n° 111.
(102) lb., n° 113.
(103 Diog. Laert., II, c. 8. § 102.
(104) Cicero, Tusc., I, 34. - Valer. Max., VIII, 9, 3.
(105) Diog. Laert., VII, c. l, n. 31. - Suidas, s. h. voce.
(106) Archœol., XII, 2, l2.
(107) Suidas. V. Lycus.
(108) Brunck, II, 58 ; III, 330; IV, 554.
(109) Suidas. V. Rhinton.
(110) V, Theocrit., VII, 40. Schol., p. 805, 810, éd. Kiessl. — Vita Arati in Arati opp., I, p. 3; II, p.442, éd. Buhle. Cf. Suidas. V. Philetas.
(111) V. Suidas, v. Zenodot.
(112) M. Parthey, p. 71.
(113) V. ci-dessus, p. 30 et suiv.
(114) Alciphron., Epistol., lib. II, cpp. 3 et 4.
(115) Proclus ad Euclidem (11, 20), dit expressément que ce géomètre enseigna sous Ptolémée Ier et Saxius le place avec raison à l'an 306 avant notre ère (in Onomast.).
(116) So scheint zur Zeit des Ptolomaus Soter, mochte er auch fur Zusnmmenbringung von Büchern noch so thätig seyn, doch ein eigenes Bibliotheksgebaude noch nicht bestanden zu haben. M. RitschI, p. 14.
(117) Dans Meineke, Quaest, scen. spec., III, p. 3.
(118) Die Alexandrinischen Bibbiotheken, p. 3.
(119) Preller, Allg. Litter. Zeit., janvier 1837.
(120) Voyez aussi Welcker, Uber den epischen Cyclus, p. 8 et soir.
(121) Dindorf, Rhein, Museum, IV, 232, —Lobeck, Zum Ajax, p. 112.
(122) Voir les textes et notes à la fin du volume.
(123) De ponderib. et mensur, c. 11.
(124) Athen. Deipnos., I. p. 10, éd. Schw.
(125).Strabo, XIII, c. 1. - Plut., in Sylla, c. 29.
(126) Lib. I, p. 10, éd. Schw.
(127) Comment, in Aristot. Cath. apud Ald., fol. 3. a.
(128) Rheinisch.Museum, I, 3, p. 236; III, 1, 93.
(129) Eus. Chron., p. 66,2. éd. Scal. — Epiphan. De ponderib. et mensur. 9.
(130) P. 271. D. Cf. Cedrenus, p. 165, ed. Paris.
(131) On connaît sur ce sujet les textes d'Aristée, de Josèphe, de Philon, de Justin Martyr, de S. Irénée, de S. Clément d'Alexandrie, de S. Jérôme, de S. Épiphane, etc. qui se copiaient ; ainsi que les écrits de Vivés, Scaliger, de Magistris, Hody, Van-Dale, Vossius, Valknœr, Eishhorn. Nous nous bornons à indiquer ceux de Spittler (De usu versionis Alexandrinœ apud Josephum. Gott. 1779), et de Reinhard (De versionis Alexandrinœ auctoritate et usu. Opusc. éd. Pœllz. I, p. 36), qui sont moins connus.
(132) Apol. c. 18.— Cf. Epiph. de Pond. 11, et Scaliger in Euseb,, p. 134.
(133) Beck, § III , p. IV.
(134) Edit. Paris, p. 20.
(135) De Tranquill. c. 9. — Oros. VI. c, 15.
(136) De mensuris et ponderibus. c. 9 et 11.
(137)
Vita Antonii. c. 58.
(138)
(139) Essai historique sur l'École d'Alexandrie, I, 92,131.