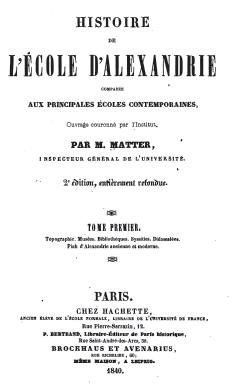
MATTER
HISTOIRE DE L'ECOLE D'ALEXANDRIE
Préface + Introduction
Première Période. (332 —146 avant J.-C. ) chapitres I à VI
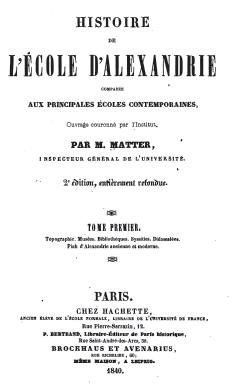
HISTOIRE DE L'ECOLE D'ALEXANDRIE
Préface + Introduction
Première Période. (332 —146 avant J.-C. ) chapitres I à VI
HISTOIRE
DE
L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE
COMPARÉE
AUX PRINCIPALES ÉCOLES CONTEMPORAINES,
TOME I.
IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUARD,
RUE GARANGIERE, N° 5.
HISTOIRE
DE
L'ECOLE D'ALEXANDRIE
COMPAREE
AUX PRINCIPALES ECOLES CONTEMPORAINES,
Ouvrage couronné par l'Institut.
PAR M. MATTER,
INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNIVERSITE.
2e édition, entièrement refondue.
TOME PREMIER
Topographie. Musées. Bibliothèques. Syssities. Didascaléee.
Plan d'Alexandrie ancienne et moderne.
PARIS.
CHEZ HACHETTE,
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ECOLE NORMALE, LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE,
Rue Pierre-Sarrazin, 12. P.
BERTRAND, Libraire-Éditeur 4e Paris historique,
Rue Saint-André-des-Arcs, 38.
BROCKHAUS ET AVENARIUS,
RUE RICHELIEU, 60;
MÊME MAISON, A LEIPZIG
1840.
PREFACE.
J'ai publié » il y a dix-huit ans, l'ouvrage dont je donne aujourd'hui une nouvelle édition ; et depuis dix-huit ans, je me suis peu détaché de ce travail. Aussi les questions se sont bien agrandies dans cet intervalle ; et si c'est encore le même sujet que je traite, ce n'est presque plus le même livre que je présente.
Je n'avais fait que l'histoire générale de l'École d'Alexandrie, sans m'occuper de celle des divers Musées et des diverses Bibliothèques de celte célèbre cité; et je m'étais arrêté à la naissance du nouveau platonisme, dont je recherchais l'origine. Je poursuis aujourd'hui la savante École jusqu'à sa fin, et je donne une attention spéciale à l'organisation intérieure du grand Musée, son foyer, ainsi qu'aux destinées de la grande Bibliothèque, sa lumière.
Dans mon premier travail, j'avais à peine abordé la question si instructive de l'existence simultanée dans la cité d'Alexandre, des divers Musées et des diverses Bibliothèques qui l'ont illustrée; j'em- II brasse aujourd'hui l'ensemble de ces institutions, et pour l'exposer avec plus de clarté, je joins à la topographie générale de la ville, que j'accompagne d'un plan nouveau, des indications sur chacun des édifices qui figurent dans l'histoire des lettres.
Cependant, ce sont là des choses secondaires ; j'ai à rendre compte de changements plus importants.
Ce sont les Écoles de l'Egypte et de la Grèce qui ont amené celle d'Alexandrie. Or il n'en était pas tenu compte.
Aujourd'hui je mets ces institutions en regard de celle qui est venue les remplacer ou les compléter : il me semble que l'École des Lagides reçoit de ce rapprochement un jour nouveau, et que les institutions de Memphis et d'Athènes font mieux comprendre celles d'Alexandrie.
Les destinées de ces dernières se sont gravées profondément dans les monuments de l'histoire. En effet, elles ont été liées à celles des cinq principaux systèmes de philosophie ancienne (platonisme, péripatétisme, scepticisme, nouveau platonisme, syncrétisme); et celles des cinq systèmes religieux qui occupent la plus grande place dans l'histoire de l'humanité (polythéisme égyptien, grec et romain, judaïsme, christianisme, gnosticisme, mahomé- III tisme ); à celles enfin des cinq plus grands systèmes politiques de l'époque (ceux d'Alexandre, de César, de Constantin, de Théodose, de Mahomet).
Était-il possible de méconnaitre cette liaison et de ne pas la mettre en relief après l'avoir reconnue ?
Mais cette liaison a-t-elle été bien réelle, et dans cette mémorable succession d'institutions et de doctrines, le rôle du principal sanctuaire de la science a-t-il été assez important pour que l'histoire le constatent le proclame? Quelle influence la grande École de l'Egypte a-t-elle exercée sur les idées et les institutions du temps? Si les Écoles de philosophie de la Grèce ont eu sur ce pays une action immense; si elles ont, plus que nulle autre institution, changé les mœurs et les croyances de la plus célèbre de toutes les nations, l'École d'Alexandrie, plus riche et plus nombreuse qu'aucune d'elles, cette puissante École qui a existé neuf cents ans, qui a vu s'élever et tomber tant de systèmes, a-t-elle joué un rôle analogue?
Par cette seconde série de questions, les premières acquéraient à mes yeux une importance nouvelle.
Mais, pour aborder des problèmes aussi vastes, il a fallu examiner, en vue des institutions littéraires d'Alexandrie, tontes celles qui se sont trouvées en IV rapport avec elles dans le cours de neuf siècles : institutions grecques, judaïques, chrétiennes, gnostiques.
Je me suis livré à cet examen d'autant plus volontiers que des travaux plus importants ont été publiés, sous nos yeux, sur les siècles qui ont précédé immédiatement et suivi de près l'apparition du christianisme, et que, dans ces travaux, on m'a paru se tromper plus gravement sur des époques qui me préoccupent depuis que je travaille.
Si mon choix avait été libre, j'examinais les travaux de l'École d'Alexandrie en eux-mêmes, abstraction faite de leurs rapports avec les systèmes de religion, de politique et de philosophie qui les ont dominés ou qu'ils ont dominés; j'évitais ainsi toute la partie épineuse de mon livre. Mais d'abord, le sujet ne se présentait avec toute son importance que dans toute sa grandeur ; ensuite, ayant moi-même des; opinions très arrêtées sur les siècles qui touchent au berceau du christianisme, je ne pouvais prendre sur moi d'arracher l'École d'Alexandrie à son enchâssement naturel.
Ecrire sur une institution qui a vu tomber le paganisme, décliner le judaïsme, naître et grandir le christianisme ; sur une institution qui a vu se V former, dans son sein ou à côté d'elle, les plus célèbres Écoles de ces trois systèmes, sans la montrer en lutte ou en harmonie avec elles, cela me semblait désormais impossible.
Ma tâche s'étant agrandie ainsi à mesure que j'adoptais ou que je subissais mon sujet dans toute son étendue, je n'ai pu me hâter de donner une seconde édition d'un ouvrage depuis longtemps épuisé. En effet, publié en 1820, il manquait dans la librairie depuis 1826; mais avec quelque bienveillance qu'on me pressât à cet égard, j'avais à traiter trop de questions nouvelles, pour donner plus tôt ce que je présente maintenant.
Aujourd'hui même les questions fondamentales, celles qui concernent le but religieux ou politique de l'École d'Alexandrie, le caractère et l'importance de ses travaux philosophiques, le rôle qu'elle a joué au milieu des institutions contemporaines, et l'in¬fluence qu'elle a exercée sur les études des siècles les plus décisifs dans l'histoire de l'humanité, ces questions sont encore et demeureront toujours sujettes à controverse.
Elles étaient naguère dédaignées et par là fort peu étudiées. Et il en était de même des institutions de l'antiquité qui ont rendu aux sciences le plus de VI services, l'Académie, le Lycée, le Lycée de Théophraste, le Portique, le Cynosarge, l'Épicurium, écoles qui n'étaient pas appréciées dans leurs rapports avec l'état et la religion, et que j'ai cru devoir considérer sous ce point de vue.
Ce qui nous avait dérobé l'importance qu'elles eurent dans l'état, c'est qu'on avait à peine effleuré la question de leur organisation, de la succession de leurs chefs, des relations de ces chefs entre eux et avec leur disciples. On est même encore dans les erreurs les plus singulières sur les lieux où enseignaient plusieurs de ces philosophes, et beaucoup de critiques en sont à croire qu'Aristote habitait le Lycée, que ses successeurs y enseignèrent comme lui» qu'au Lycée il y avait un Musée, que la Bibliothèque du philosophe était déposée dans ce Musée, et que ce fut delà que les Lagides la firent transporter dans leur capitale.
Il était temps que l'étude plus spéciale du Musée d'Alexandrie, institut dont l'origine reçoit tant de jour de l'histoire des Écoles de l'Egypte et de la Grèce, vînt à son tour répandre quelque lumière sur celles d'Athènes, sinon sur celles de Memphis.
Cette étude était assez difficile. Les indications que donne Strabon étaient trop importantes pour VII n'être pas approfondies, mais trop concises pour qu'on se flattât de les bien entendre. Celle qu'il donne sur la présidence de Musée, et qui est si caractéristique, avait étonné sans instruire. Pour mon compte, j'en avais tiré peu de parti, et je me félicitais prèsque d'avoir détaché l'histoire de l'École d'Alexandrie de celle des Écoles d'Athènes et d'Héliepolis, qui pouvaient seules en expliquer la naissance.
C'est un tort que je viens réparer aujourd'hui aussi complètement qu'il m'est possible, et il me semble qu'en prenant mon point de départ dans les institutions mêmes qui ont servi de types à celles d'Alexandrie, j'ai mieux caractérisé les unes et les autres.
Après cela, je n'ai plus qu'un mot à dire sur le plan que j'ai adopté dans cette édition, L'histoire complète de l'École d'Alexandrie est à-la-fois celle des plus célèbres institutions littéraires de l'antiquité et celle du mouvement intellectuel de huit à neuf siècles. Elle embrasse donc deux objets distincts; l'un plus extérieur, l'autre plus intérieur: 1° l'histoire du Musée ou plutôt des différents Musées, des Bibliothèques, des Didascalées et des Syssities, en un mot de cet ensemble d'établissements et de savants qu'on appelle École d'Alexandrie; et 2° l'histoire des travaux de cette École, qui furent VIII si complets et si supérieurs à ceux des Écoles contemporaines.
La première, l'histoire extérieure, nous offre des phases très diverses. On le comprend, cette institution dure du siècle d'Alexandre à celui de Mahomet. Pendant ce long espace de temps, elle est à la tête du mouvement delà pensée ou en lutte avec ceux qui le dirigent. Rivale des Écoles d'Héliopolis, de Memphis, de Pergame, d'Athènes, de Rome et d'Antioche, et entraînée dans tous les débats du temps, elle passe par toutes les révolutions des idées et des empires, par tous les genres de protections et de persécutions, par toutes les faveurs et toutes les catastrophes. Réunie autour des palais des rois, partagée en une série nombreuse d'Écoles spéciales, de Syssities plus ou moins libres > elle doit suivre successivement les tendances d'âges divers, celles du scepticisme le plus absolu comme celles du mysticisme le plus exalté. Enfin engagée par la force des choses dans la lutte de plusieurs religions qui se combattent, l'École d'Alexandrie, dont les Musées et les Bibliothèques sont tour-à-tour livrés à tous les genres de violence, à l'incendie, au pillage et à la démolition systématique, offre dans son histoire un drame fortement marqué de péripéties.
IX Je distingue l'histoire de cette grande institution en six périodes.
La première est celle de son origine et de ses débuts sous les règnes si glorieux de ses deux fondateurs. (De l'an 295, à Tan 246 avant J.-C.)
Pendant la seconde, protégée par les Lagides, jouissant de tous les genres de faveur, l'École d'Alexandrie lutte glorieusement avec celles qu'elle a imitées, et celles qui l'imitent à leur tour. (De l'an 246 à l'an 146 avant notre ère ).
Pendant la troisième, tour à tour persécutée, délaissée, ou troublée par des catastrophes qui la privent d'une partie de ses ressources, mais soutenue encore par de puissantes sympathies, elle demeure en possession de tous les moyens de progrès jusqu'à la fin de la domination grecque. (146 à 47 av. l'ère chrétienne).
La domination romaine, qui marque la quatrième, s'ouvre par une catastrophe, l'incendie de la grande Bibliothèque; mais la faveur impériale met de nouvelles créations à côté de celles des Lagides, et l'Ecole refleurit un instant. (47 avant J.-C. à 158 après J.-C.)
La cinquième période lui crée une série de rivales en Egypte et ailleurs ; elle attire sur la capitale. qui la nourrit, une suite de catastrophes et se clôt par X une rigueur, l'Abandon des institutions polythéistes de la part du chef de l'empire. (De l'an 158 à 312 après J.-C.).
A partir du moment où lé christianisme s'élève sur le trône de l'empire, et ou Constantinople l'emporte sur Rome, Athènes l'emporte aussi sur Alexandrie. L'antique Ecole de cette cité lutte plus péniblement contre une rivale si puissante et contre plusieurs instituts qui, nés dans son sein ou à côté d'elle, travaillent à sa ruine, c'est-à-dire, l'École chrétienne et les Écoles gnostiques.
Pendant cette dernière période, privée des faveurs du pouvoir, des sympathies de la population, de ses membres les plus illustres, de son premier asile, de sa dotation et de ses principaux établissements, elle combat avec une sorte de désespoir contre le nouvel ordre de choses et d'idées que veut le monde et que protègent les chefs de l'empire. Cependant, si elle succombe, dernier asile du polythéisme, sous le progrès des institutions chrétiennes, bien plus que sous les persécutions byzantines, elle est encore une ruine glorieuse, lorsqu'elle expire sous le mahométisme qui vient faire son entrée triomphante dans Alexandrie. (312-641.)
DEFINITION DE L'ECOLE D'ALEXANDRIE.
— ETAT DES ECOLES DE L'EGYPTE ET DE LA GRECE A L'EPOQUE OU ELLE FUT FONDEE.
On appelle école d'Alexandrie, vingt à trente générations de savants, dont les travaux, protégés par les Ptolémées et leurs successeurs, les Césars, ont pendant plus de neuf siècles illustré les sciences et les lettres. Cette école ne fut pas une institution, ce ne fut ni le célèbre musée, ni la fameuse bibliothèque, ce ne fut aucun des musées, aucune des bibliothèques d'Alexandrie; ce fut une société libre, et en quelque sorte une réunion fortuite de savants, rattachés aux institutions publiques fondées pour eux par les Ptolémées et conservées religieusement par leurs héritiers, les empereurs.
L'école d'Alexandrie, c'est-à-dire l'école polythéiste, dont il faut distinguer l'école judaïque, l'école chrétienne et l'école gnostique, se distingue elle-même en plusieurs autres: écoles de poètes, de grammairiens, de philosophes, de mathématiciens et de médecins. Elle diffère donc singulièrement des anciennes écoles de la Grèce et de l'Egypte. Cependant, pour saisir le but spécial et le véritable caractère des institutions littéraires fondées sur les bords du Nil par un des lieutenants d'Alexandre devenu roi, il convient d'abord d'examiner quelle était la portée et quelle était l'organisation des écoles qui furent le point de départ de celle des Lagides.
Quel était l'enseignement de ces écoles? Quel en était le caractère littéraire ou scientifique, moral ou politique? Dans quels rapports se trouvaient-elles avec l'état? Qui les fon- (2) dait, les entretenait et les dirigeait? Quel rôle jouaient-elles dans les institutions, dans les mœurs, dans les croyances?
En considérant sut ces questions le silence des monuments de l'Egypte et la brièveté des textes grecs, c'est à peine si l'on a le courage de les poser. Mais, sur l'école d'Alexandrie elle-même, les renseignements sont rares et défectueux; en cherchant à combler quelques lacunes sur les autres, nous accepterons celles qu'il faut subir sur le Musée.
D'abord, quant à l'Egypte, ce pays dont les institutions sacerdotales ont dû frapper l'attention du fils de Lagus, comme elles avaient frappé celle d'Alexandre, nous ignorons aujourd'hui jusqu'au nom qu'elle a pu donner à ses écoles, mais nous savons qu'elle en eut de célébrée, celles de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis. Nous savons qu'elles se confondaient avec les collèges des prêtres, mais qu'elles étaient en possession d'une Science remarquable, qui se transmettait dé génération en génération. Nous ignorons s'il y eut un enseignement régulier, mais nous savons qu'on y apprenait là religion, les lois du pays ét les devoirs de la morale; l'écriture, la grammaire ét l'histoire; la physique, la chimie et la médecine, l'arithmétique, là géométrie et l'astronomie ; la météorologie, l'agriculture et là science du calendrier ; la musique, l'architecture, la sculpture, la peinture.
Cela résulte des rapports d'Hérodote, de Strabon et de Diodore, ou des monument de l'Egypte, et sil est impossible de déterminer d'une manière un peu précisé quel fut l'état des sciences dans l'ancienne Egypte, il est aisé d'établir qu'il s'y fit des études sérieuses.
En effet, la religion y était une science riche et étendue: Elle embrassait des observations astronomiques et des traditions mythologiques ; la connaissance des symboles, dés rites, des oracles et des fêtes ; l'étude des livres et des dogmes sacrés. L'Egypte ne rendait pas de culte aux héros (1), mais (3) elle avait des traditions héroïques, et, d'Un autre côté, sa religion dominait la politique, la législation et la morale, qui s'y rattachaient l'une et l'autre de la manière la plus intime (2). L'histoire en offre des preuves nombreuses, et une indication frappante se trouve à ce sujet dans le résumé d Diodore sur l'Egypte. Cet historien nous apprend, qu'au nom de la religion, le sacerdoce conduisait tous les jours le prince devant la divinité, lui rappelait ses devoirs devant elle, invoquait sur lui la bénédiction du ciel dans le cas où il accomplirait ses obligations, implorait le pardon de ses fautes d'ignorance, et rendait ses conseillers responsables de tous ses méfaits, idée tellement constitutionnelle, qu'on la croirait moderne (3). Le jugement qu'il était permis au peuple de porter, en présence du sacerdoce, sur ou contre un roi défunt, atteste le même lien entre la religion et la politique, et constate des droits qu'on ne permettrait aujourd'hui à aucune nation d'exercer ainsi en masse (4).
Il est très vrai que l'étude de la religion ne se faisait point par voie de raisonnement, qu'il y avait transmission plutôt que discussion de là part des maîtres, et soumission plutôt qu'examen de la part des disciples ; il est très vrai que celle des sciences qui fait de la théologie moderne la plus vaste des études, la philosophie, manquait aux sanctuaires de l'Egypte; mais leur enseignement suppléait à l'élévation par la richesse, et ce serait une singulière erreur, que d'admettre une complète stagnation des intelligences au milieu de tant de traditions et de doctrines, toutes intimement liées à la politique. Sans doute, il y avait une grande fixité dans les croyances et dans les symboles, les (4) monuments, il y avait progrès dans les idées, car il y en avait dans les arts, et les opinions ont dû varier avant eux. Quand on a dit, pour résumer les doctrines religieuses de l'Égypte, qu'elles n'offraient au fond que l'antithèse du bon et du mauvais principe, l'un sous le symbole du Nil, cette source de fécondité, l'autre sous celui d'un désert brûlé, cette éloquente image de la destruction ; qu'Osiris représentait le Nil ; sa sœur Isis, la terre fécondée par le dieu du fleuve; Typhon, le vent de l'ouest; sa sœur Nephtys, la terre frappée de stérilité, quand on l'a dit, on a fait l'esquisse et non pas l'inventaire de ce polythéisme. Il n'est pas même très vrai que l'enseignement philosophique ait manqué à l'enseignement religieux. Point de doute que cette dialectique, cette logique et cette métaphysique que nous a données la Grèce, étaient inconnues à l'Égypte; que l'étude des facultés du raisonnement était peu cultivée : mais ces facultés étaient-elles aussi négligées qu'on ledit? Je le demande, toutes ces facultés, l'observation et la réflexion, l'abstraction et la généralisation, l'induction et la déduction, l'analyse et la synthèse, ne sont-elles pas dans l'esprit humain des puissances à tel point spontanées, que, le voulût-il, il ne pourrait s'en abstenir, dès qu'il pense une chose quelconque? Le jeu de ces facultés a eu son cours en Égypte, comme ailleurs, et ce pays a eu aussi inévitablement des notions de psychologie, de logique et de métaphysique, que de politique et de religion. On n'a pas une théologie riche comme la sienne ni une pneumatologie aussi immense, sans avoir aussi une philosophie. S'il fallait en croire Diodore de Sicile, l'Égypte, et surtout la ville de Thèbes, aurait eu les premiers philosophes du monde. Nous sommes loin d'admettre cette prétention ; cependant, chez les premiers comme chez les derniers sages de la Grèce, c'était une opinion reçue, que l'Égypte était le berceau de la science. La Grèce entière n'a pas dû se tromper complètement à cet égard.
Deux lignes de Diodore et le célèbre passage de saint Clé- (5) ment d'Alexandrie, sur l'écriture et la grammaire, confirment le mouvement intellectuel de l'Égypte. Les prêtres, dit le premier, enseignent à leurs fils deux genres de caractères, les uns dits sacrés, les autres qu'on apprend communément (5). Ceux qui reçoivent l'instruction chez les Egyptiens, dit le second, apprennent d'abord la méthode de toutes les lettres égyptiennes, celle qu'on appelle épistolographique, ensuite la hiératique dont se servent les écrivains sacrés, enfin la hiéroglyphique. Celle-ci a deux genres, l'un qui procède par les premiers éléments, la kyriologique, l'autre la symbolique. Dans la symbolique, on distingue une méthode qui exprime le mot propre par imitation, une autre qui écrit par voie de tropes, et une autre enfin qui allégorise tout-à-fait, par voie d'énigmes (6).
. Ce n'est pas le lieu de nous arrêter sur les savantes explications qu'on a données récemment de ces divers genres d'écritures (7), le seul fait de leur diversité nous suffit. Il prouve l'activité et la fécondité d'esprit du peuple d'Égypte. S'il est vrai qu'il ne se servit des caractères de l'alphabet qu'en partie et en quelque sorte exceptionnellement, loin d'en inférer que l'écriture qu'il préférait a dû s'opposer à un grand développement d'intelligence, nous dirons, au contraire, que l'emploi de signes si divers et l'impulsion continuelle qu'il donnait à la pensée commandait une étude approfondie de la langue et une analyse constante des rapports du signe avec l'idée. Il n'est rien de plus abstrait, de plus philosophique que cette étude, et ce fait me semble mériter attention.
Nous n'appellerons pas d'autres preuves d'études grammaticales, critiques et littéraires, et nous avouerons que les Egyptiens redoutaient l'éloquence, qu'ils l'interdisaient (6) aux avocats, que la religion et la politique ne la favorisaient pas plus que la loi civile (8). Leur austérité traitait la poésie comme l'éloquence; ils n'en souffraient pas, et leur littérature donne un démenti formel à cette opinion, que, chez tous les peuples, la poésie précède la prose. Dion Chrysostome dit qu'il leur était défendu de parler selon quelque rythme, qu'ils n'avaient point de vers (9), On pourrait toutefois regarder cette opinion comme une des nombreuses erreurs que se débitaient les Grecs, et dont quelques-unes se sont dissipées si complètement devant les découvertes modernes. En effet, on a trouvé sur les monuments une chanson de batteurs en grange (10), et Hérodote parle d'un chant de Linus (11). Mais quand même on admettrait que les Egyptiens eurent un ou deux chants populaires, que seraient quelques airs nationaux auprès des immenses richesses de poésie que nous offrent d'autres régions de l'antiquité, surtout l'Inde et la Grèce?
Pour l'histoire, les Egyptiens se bornaient trop à celle de leur pays, dont ils déposaient le récit dans les archives de leurs sanctuaires et qu'ils figuraient sur les monuments. Au temps de Diodore, ils prétendaient connaître les régions étrangères; et aies entendre, toutes les nations de la terre sortaient de la vallée du Nil, leur commun berceau, leur école primitive (12). Mais alors la science grecque et l'école d'Alexandrie avaient à tel point envahi la vieille Egypte, qu'on ne trouvait plus de renseignements purs sur sa situation intellectuelle avant Alexandre. D'après les débris qui nous restent, ses travaux d'histoire se seraient bornés à des canons dynastiques, et Diodore prétend que les traditions écrites (7) des sanctuaires avaient peu d'intérêt (13). liais ce n'est point sur cet écrivain ni sur ces débris que doit se former notre jugement. A la vérité, les traditions du sacerdoce Egyptien, recueillies par les auteurs grecs, sentent la fable, et celles de Thèbes paraissent avoir été combattues par celles de Memphis et d'Héliopolis ; mais du moins elles étaient toutes d'une, grande richesse.
Il en était de la géographie des Egyptiens comme de leur histoire ; elle se bornait à l'étude dit pays, méprisant le reste, Sésostris doit avoir exposé dans les temples la carte de l'Egypte et des contrées qu'il avait soumises jusqu'à l'Inde ; mais, au temps de Ptolémée II, personne n'avait franchi les limites de l'Éthiopie (14) ; et personne n'eût prévu alors que, dans une région qui faisait abstraction de toute autre, le le génie viendrait un jour créer ensemble la cosmographie et la géographie.
Les sciences naturelles, la physique et la chimie, étaient cultivées avec tout le soin qu'exigeaient certains arts, surtout la peinture des monuments publics et l'embaumement des corps, mais la science alla-t-elle au-delà de ces besoins? Il paraît que l'anatomie était très avancée ; Macrobe et Aulu-Gelle le disent. Ils parlent peut-être de l'époque grecque (15); mais Manéthon nous apprend qu'un roi d'Egypte avait écrit sur cette science, et la coutume d'embaumer explique le progrès.
La médecine était pratiquée avec une grande recherche ; on avait des médecins spéciaux pour les diverses parties du corps. Ces médecins étaient payés par l'état, guérissaient d'après des lois écrites provenant des plus célèbres praticiens, et risquaient leur vie en y contrevenant (16). C'é- (8) tait certes un mauvais moyen d'avancer, mais l'hygiène avait plus de liberté que la thérapeutique, et la preuve qu'on connaissait bien l'art de guérir, c'est qu'on le pratiquait bien. Suivant Hérodote, la population égyptienne était la mieux portante qu'il eût jamais vue, (17) et c'est à la science autant qu'au climat du pays qu'il attribue ce résultat.
Quant aux mathématiques, la géométrie née du besoin de retrouver les propriétés après les grandes inondations de chaque année demeurait un peu à l'état d'arpentage, et quand Thalès visita l'Egypte, les prêtres en étaient à des problèmes élémentaires. Hérodote dit néanmoins que les Grecs ont dû la géométrie aux Egyptiens (18), qui cultivaient l'arithmétique pour les besoins de l'économie domestique, ceux de la géométrie et de l'astronomie. D'après Diodore, ils observaient les mouvements des astres; ils s'y étaient appliqués de temps immémorial, surtout au collège d'Héliopolis, et ils possédaient des catalogues fort anciens. D'après Hérodote, ils calculaient savamment les éclipses (19). Cependant aucune de leurs observations n'est mentionnée par les Grecs, et leur astronomie, servait à la théologie, se perdant un peu dans l'astrologie, dans la divination, dans l'horoscopie (20). Elle enfanta toutefois la météorologie et la science du calendrier. Elle possédait bien l'année solaire (21). Hérodote ajoute que ce n'est pas à l'Egypte, mais à la Babylonie, que la Grèce emprunta la division du jour en douze heures et les instrumens qui la constataient (22).
La géographie mathématique était-elle moins négligée que ta géographie politique, peu connue au temps d'Hérodote (23)? Suivant St-Clément d'Alexandrie, le hiérogrammatiste, qui (9) occupait le troisième rang parmi les prêtres des collèges sacerdotaux, devait, outre la géographie, la chorographie de l'Egypte et la topographie du Nil, posséder la cosmographie (24). Il paraît aussi qu'à une époque fort ancienne, on a construit en Egypte une carte où la valeur des degrés fut établie d'après le module trouvé à la hauteur de l'Egypte moyenne ; mais les Egyptiens ignoraient la sphéricité de la terre, et ils supposèrent tous les degrés égaux entre eux et à celui de l'Egypte moyenne, dont ils avaient déterminé l'étendue (25). Si les inondations du Nil les avaient conduits à la géométrie, les travaux d'irrigation leur apprirent évidemment des principes d'hydraulique et de statique ; l'usage des poids et des mesures, qu'on faisait remonter à Hermès ou Toth, ce ministre d'Osiris à qui l'on attribuait la découverte de l'arithmétique et de la géométrie, atteste aussi des habitudes de science (26). Quant à l'art, des monuments nombreux en montrent le haut développement. L'art égyptien suit sans doute d'autres règles du beau que l'art grec, mais personne ne lui conteste plus aujourd'hui son mérite, ce caractère de douceur, de calme et de gravité religieuse dont rien n'approche ailleurs. Et quels immenses travaux nous restent de cet art. Et de quelle immensité ce qui nous reste est-il la simple ruine ! On ne saurait se faire une idée, dit un des auteurs de la Description de l'Egypte, de ce que les Egyptiens ont fait en statues de ronde-bosse, soit de granit, soit d'albâtre, soit de brèche, soit de porphyre (27). C'est qu'ils avaient introduit la division du travail jusque dans la sculpture, surtout quand il s'agissait de statues colossales (28), et que par ce moyen ils multipliaient singulièrement les artistes. Cherchant le mouvement des idées dans l'enseignement supérieur, nous ne (10) parlerons pas du progrès des arts vulgaires, nous dirons toutefois qu'en Egypte l'artisan était sans cesse associé à l'artiste et qu'ils se rattachaient ensemble à ce commun foyer de science, à ces collèges de prêtres qui étaient en possession du gouvernement des esprits, qui fournissaient d'âge en âge les doctrines et les règles à suivre d^ns chaque genre de travaux.
En effet, les sanctuaires donnaient tout l'enseignement de la nation. Les prêtres, qui seuls en étaient chargés, ne faisaient pas sans doute de cours réguliers suivant nos usages modernes, mais ils transmettaient leur savoir à des disciples capables de le transmettre à leur jour, et ils leur apprenaient ce qu'ils devaient communiquer à chaque caste ; car la science et les arts étaient mesurés à chacune d'elles d'après des lois à peu près invariables,
Pour se faire de l'état véritable de cet enseignement une idée plus nette, on voudrait connaître les moyens d'étude, les instruments, les collections et les bibliothèques que possédaient les sanctuaires. Mais à cet égard les indications sont tout-à-fait vagues, et on doit admettre que ces moyens étaient fort limités, l'Egypte s'étant réduite à elle seule, même sous la domination des Perses. Tout ce qu'on cite se borne aux archives des temples, aux bibliothèques des palais. Là des salles spéciales étaient affectées aux collections. Dans le Ramesseum la pièce qui suit la salle hypostyle porte encore cette inscription lue par Champollion : Salle des livres (29). On a souvent parlé de la bibliothèque d'Osymandyas, mais la collection de ce prince, si elle a jamais, existé, ce qui est au moins douteux, puisqu'il est maintenant démontré que le palais d'Osymandyas, qui doit l'avoir renfermée, n'a jamais existé tel que le décrit Diodore, le seul écrivain qui parle de ce monument; cette collection, disons-nous, était plutôt faite dans des vues morales que dans (11) un but scientifique, à en juger par le nom de sacrée que lui donne Diodore, et sa fameuse inscription de remède de l'Orne. Elle contenait dans ce cas des ouvrages d'histoire, de religion, de législation et de politique ; et cette observation s'applique plus ou moins aux autres collections de liyres qui ont existé en Egypte, car toutes ne sont pas douteuses comme celle de l'Osymandéum. En effet, d'après l'opinion commune des Egyptiens et des Grecs, et d'après les monuments qui existent encore, les palais des rois avaient leurs collections de livres comme les sanctuaires des prêtres. Les archives des temples ont existé jusque dans les siècles de la domination grecque et romaine, puisqu'Alexandre, les Lagides et les empereurs romains en ont pris soin.
Ces collections auraient pu être très complètes ; car les moyens de réunir des livres et des objets d'instruction ne manquaient pas aux écoles sacerdotales, les revenus dont jouissaient les prêtres étant considérables (30). Mais ce qui manquait sans doute à cette caste, c'était l'amour désintéressé de la science. L'intérêt de la caste et l'intérêt de la nation, telles étaient les bornes de ses investigations. Au progrès complet du savoir manquaient aussi ces instruments et ces appareils d'observation, sans lesquels on ne saurait faire certaines découvertes. D'ailleurs nuls revenus spéciaux n'étaient affectés aux études, que les prêtres, qui avaient institué tous les genres d'instruction, dotaient comme ils l'entendaient et après avoir d'abord satisfait aux besoins de la religion. ll est à croire que sous la domination grecque les collèges de l'ancien sacerdoce se sont inspirés de quelque émulation, qu'ils ont enrichi leurs archives et augmenté leurs bibliothèques ; mais rien ne le prouve. On sait seulement qu'ils en avaient le moyen, et qu'au temps de Diodore ces revenus sacerdotaux n'étaient pas fort diminués depuis Hérodote qui les avait trouvés très considérables (31).
(12) La transmission de la science étant exclusivement l'affaire de la caste lettrée, une partie de cette science n'étant communiquée par les prêtres qu'à leurs fils (32), et les autres Egyptiens n'apprenant que les métiers de leur caste, tout l'enseignement était entre les mains du sacerdoce; mais n'était-il pas au moins surveillé, et en quelque sorte dirigé par l'état et dans l'intérêt de l'état?
Il était, sans nul doute, sous l'action suprême de la royauté. Le sacerdoce, il est vrai, élevait, conseillait, surveillait les rois; mais, plusieurs révolutions l'attestent, les rois observèrent constamment le sacerdoce et lui résistèrent quelquefois. Psammétique, roi nouveau, entouré de prétendants qu'il avait rejetés en Libye, s'affranchit du sacerdoce et fit élever ses fils dans les études grecques (33). Si soumis que fussent d'autres princes, ils ne pouvaient rester indifférents à la conduite des esprits par les sanctuaires, à la distribution du savoir par les prêtres : l'intérêt de leur dynastie ne le permettait pas. Sans doute, le rôle de l'enseignement dans le monde ancien, avant les philosophes d'Athènes, était secondaire, et pour bien apprécier l'Égypte, il faut faire abstraction de ces habitudes d'investigation et d'examen, de ce besoin de mouvement et de progrès, qui date des beaux temps de la Grèce et que la renaissance, époque essentiellement grecque, a jeté dans la société moderne. Certes, sous ce rapport, l'enseignement égyptien n'offrait rien qui pût faire ombrage au pouvoir, et jamais ces collèges de prêtres qui se bornaient à transmettre, sans chercher à perfectionner, n'ont dû agiter les esprits. Cependant, l'histoire intérieure de l'Égypte, si peu connue qu'elle soit, attestant une lutte à-peu près permanente entre les deux castes qui donnaient des rois au pays, celle des prêtres et celle des guerriers; plusieurs révolutions ayant été amenées par cette rivalité, et les prêtres ayant été successivement dépouillés d'une grande partie (13) de leurs privilèges, on ne conçoit aucune époque où le gouvernement, ou la caste militaire, n'aurait pas surveillé avec attention l'action qu'exerçait le sacerdoce.
On admet d'ordinaire, dans l'histoire intellectuelle de l'Égypte, l'impossible, c'est-à-dire, l'immobilisme des idées, ou du moins un degré de fixité ou de stagnation qui en approche. Mais le mouvement de l'intelligence humaine vient d'une loi suprême, et cette loi se joue de toutes les autres. Les Égyptiens, si enchaînés qu'ils fussent sous de puissantes institutions, avaient un penchant prononcé pour les discussions politiques : la preuve en est dans la loi qui les leur interdit (34). D'ailleurs, au milieu de tant de révolutions, d'invasions étrangères et d'émigrations qui remontaient jusqu'aux temps les plus reculés et qui sans cesse mettaient l'Égypte en rapport avec l'Éthiopie, l'Inde, l'Arabie, la Judée, la Grèce, le mouvement des esprits était inévitable ; et dans les siècles qui précédèrent immédiatement la fondation d'Alexandrie, de fortes commotions, la révolution de Psammétique, la conquête de Cambyse, l'établissement d'une colonie grecque à Naucratis, plusieurs révoltes, l'expédition d'Agésilas, la formation d'une caste d'interprètes, et enfin la conquête macédonienne avec ses colonies grecques et juives, avaient fourni à l'esprit public des éléments tout nouveaux.
Pour apprécier à leur juste valeur et ce mouvement et la science de l'Egypte, il faut mettre de côté les exagérations de ses prêtres et celles des Grecs qui les consultèrent ; mais il faut aussi se défier des assertions trop restrictives de la critique moderne. Comment les Grecs qui traitaient tous les peuples de barbares auraient-ils conçu des Egyptiens une opinion si haute sans aucun fondement? Et pourquoi cette opinion, si elle était fausse, percerait-elle dans toutes les traditions, dans celles encore qui voulaient qu'Homère et (14) Lycurgue se fussent instruits en Egypte comme Orphée, Musée, Mélampus et Dédale? Pourquoi dans des temps plus rapprochés cette opinion aurait-elle Subjugué Solon, Pythagore et Platon, qui avaient visité le pays ? On dit qu'elle se rapporte à la sagesse morale, à la pureté religieuse et aux institutions sociales, plutôt qu'à la force des études; on dit que les Grecs, toujours agités par les débats de l'aristocratie et de la démocratie, furent naturellement frappés d'admiration pour cet ordre de choses si régulier et si calme qu'offrait l'Egypte : mais plusieurs d'entre eux avaient vu en Perse le même calme et la même régularité sans se livrer au même enthousiasme. On dit enfin, que Solon, Pythagore et Platon étaient poètes autant que philosophes : mais trois historiens, Hérodote (35), Strabon (36), et Diodore (37) pensèrent comme eux.
Dans tous les cas les collèges sacerdotaux ayant le dépôt de la science, le privilège de la répartir entre les différentes castes et celui d'en transmettre aux fils des prêtres ce qu'ils voulaient, étaient pour la politique d'une haute importance, même sous les institutions anciennes et à l'époque des Pharaons. Leur importance était bien plus grande encore depuis qu'un étranger campé à l'extrémité du Nil, à la tête d'une colonie Grecque, présentait à la population indigène une dynastie qui avait d'autres mœurs, une autre langue, une autre religion. Le fondateur de Cette dynastie, son intérêt moral et politique l'exigeait, a dû donner la plus grande attention à celles des institutions dû pays qui étaient en possession de diriger les idées. Ptolémée comprit cette nécessité. Il conserva les collèges investis de la science et de l'enseignement, mais en même temps il (15) éleva Une école qui put insensiblement affaiblir leur action. Plus il comptait sur cette institution, plus en la créant il imita ce qu'il s'agissait de remplacer. Cependant il était Grec, émule d'Alexandre et admirateur d'Aristote : en consultant, pour l'organisation du musée, les usages de l'Egypte, il ne pouvait négliger ceux de la Grèce. Quelles institutions littéraires voyait-il en Grèce ?
Les écoles supérieures de la Grèce : j'entends surtout les écoles d'Athènes, offraient un tout autre caractère que celles de l'Egypte. Celles-ci appartenaient à des institutions monarchiques et sacerdotales, celles-là à des mœurs démocratiques et philosophiques.
Les écoles grecques commencent en général dans l'histoire de la science une ère à part : la Grèce est le premier pays où l'enseignement se constitue en dehors du sanctuaire » indépendant de l'état. En Egypte il allait du sanctuaire à quelques castes, dans la mesure qu'on croyait devoir accorder à chacune d'elles -, mais il était distribué à toutes d'après les mêmes vues de politique sacerdotale ; il formait donc une institution à la fois religieuse et politique. En Grèce, au contraire, vers l'époque d'Alexandre toutes les écoles sont indépendantes du sacerdoce, et celles qui s'occupent des hautes sciences sont indépendantes de l'état. Au premier aspect on est tenté de croire le contraire. On trouve une surveillance exercée par l'état au nom de la loi, surveillance qui embrasse l'ordre et les mœurs des écoles aussi bien que les principaux exercices de la jeunesse (38). Mais si précis que soit le texte de la loi à cet égard, l'effet en est peu sensible dans l'histoire. Si la juridiction que devaient avoir les magistrats fut quelquefois réelle, d'ordinaire elle était illusoire, et si elle pouvait empêcher qu'on n'enseignât rien contre la religion > elle ne fit jamais enseigner cette science. Si les ministres des autels pouvaient (16) porter plainte contre les chefs des écoles, ils étaient, ainsi que la religion elle-même, en dehors de l'enseignement public. Sous quelque point de vue qu'on examine les diverses catégories d'écoles, qu'on recherche par qui elles étaient fondées et entretenues, dirigées et surveillées, ou quelle était la portée de l'enseignement qu'on y donnait, quel en était l'esprit et quelle en était l'influence sur les mœurs et les institutions, on n'y rencontre le sacerdoce nulle part, et le plus grand fait qui s'y présente, c'est qu'on n'y aperçoit pas la religion. En effet, qu'on pénètre dans l'école de lecture et d'écriture dirigée par le grammatistes, dans l'école de musique dirigée par le kilkaristes, dans les gymnases ou dans les cours de philosophie, on ne trouve d'instruction religieuse dans aucune de ces institutions, à moins qu'on ne veuille considérer comme telle l'étude de certains passages qu'on choisissait dans les poésies d'Homère ou d'Hésiode (39), qu'on faisait expliquer et réciter aux enfants. On ne trouve pas non plus pour ce degré d'autre étude de morale que celle des fables d'Esope, que faisaient apprendre les grammairiens.
Le jeune Grec restait dans ces écoles de l'âge de sept ans jusqu'à celui de douze, avec cette différence pour les riches et les pauvres que les premiers y faisaient conduire leurs enfants par un pédagogue, qui n'était qu'un esclave et souvent le plus inutile, le plus vieux ou le plus faible des esclaves. A l'âge de douze ans, commençaient les exercices des gymnases, où l'on apprenait l'histoire et la géographie d'après le fameux catalogue du deuxième livre de l'Iliade, l'éloquence, les belles-lettres et les mathématiques. Chacun de ces gymnases s'élevait près de quelque temple et partout la jeunesse y trouvait les images des dieux, mais là non plus il n'y avait d'enseignement spécial sur la religion.
Enfin l'école de rhétorique et l'école de philosophie, qui formaient le dernier degré des études grecques (à moins qu'on (17) ne veuille considérer comme supérieures les leçons de médecine données dans quelques écoles de l'Asie-Mineure ou des îles, mais qui n'exerçaient aucune influence sur la politique ), embrassaient tout le savoir grec, l'histoire naturelle, la physique et l'astronomie (40). Mais dans ces écoles non plus nous ne trouvons d'enseignement religieux. Il est très vrai que les questions d'éthique, de dialectique et de physique qu'on y débattait, touchaient aux questions fondamentales de la théologie et de la mythologie, mais ces débats n'avaient rien de religieux, et n'étaient ni dirigés ni surveillés par les ministres de la religion. Les prêtres se transmettaient sans doute, dans leurs sanctuaires, de sacerdoce en sacerdoce, les mystères et les traditions du culte dont ils communiquaient une partie aux initiés ; mais à cela se bornait de leur part l'action de la parole sur la jeunesse, et il n'y avait pas plus d'enseignement public sur les lois de la religion qu'il n'y en avait sur celles de l'état. J'ajouterai qu'on ne voit pas même de traces précises d'écoles sacerdotales, et que la situation de la Grèce au temps d'Alexandre peut se résumer, sous ce rapport, en ces deux mots : c'est qu'on ne trouve l'influence de ses prêtres que dans les sanctuaires (41a), et qu'entre la science et la religion il y a scission complète. Or ce fait constitue dans l'histoire des études une ère nouvelle.
Ce fait s'explique d'ailleurs par un autre, c'est qu'en Grèce le sacerdoce est demeuré étranger à la fondation des écoles.
(18) Par qui les écoles de ce pays furent-elles fondées, entretenues et surveillées?
Dans les temps anciens il n'y avait en Grèce, comme en Égypte, d'autres écoles que les sanctuaires. Cela es\ hors de doute, et la tradition elle-même ne nomme pas une seule école profane qui eût été contemporaine des vieux instituts sacerdotaux de Thrace ou de Samothrace. En effet, il n'y eut dans le monde grec aucun enseignement profane avant Thalès, et ce fait ne doit pas nous, surprendre. Que les premiers établissements religieux de la Grèce fussent sortis de ceux de l'Égypte, de ceux de la Phénicie ou de ceux de l'Asie-Mineure, la Grèce n'avait trouvé des écoles profanes, dressées en face de celles du sanctuaire ni dans l'une ni dans l'autre de ces régions. Si la Grèce, tolérante d'ailleurs pour quelques cultes étrangers, s'est donné elle-même ses institutions religieuses, ce que paraît confirmer le cachet d'originalité qui les distingue, elle a traversé bien des siècles sans songer à ces écoles qui devaient faire, au temps d'Alexandre, une scission si complète avec la religion. En général, avant la guerre de Troie, on ne rencontre en Grèce aucun genre d'institutions auxquelles on puisse donner le nom d'écoles. Ce qu'on trouve à cette époque, ce sont quelques générations de poètes mythologiques, qu'on peut considérer avec M. Creuzer comme un institut permanent ; mais évidemment ces chantres inspirés ou ces prophètes poétiques, les Olen, les Orphée et les Musée (42), ne formaient pas d'école; la nature de leurs inspirations était même loin de se prêter à cet enseignement régulier, à toute cette transmission de science, que nous avons reconnue dans les collèges sacerdotaux de l'Égypte. Nous admettons bien avec M. Creuzer, qu'il fut un temps où la Thrace et les îles voisines gouvernées par une espèce de caste sacerdotale, sortirent d''un état de barbarie, qui devait les ressaisir dans la suite (43), et nous (19) pensons qu'on peut supposer toute une succession de traditions orphiques. Mais si l'on employait, pour désigner cet institut, le nom d'école, il serait synonyme de sanctuaire.
Dans tous les cas, ces sanctuaires étaient bien loin d'embrasser les mêmes études que celles de l'Égypte et loin de saisir le sacerdoce du même empire sur les esprits. Personne He s'aviserait assurément de croire que les collèges de Samothrace, ou même ceux de Dodone, de Delphes et d'Eleusis, aient possédé à aucune époque, en morale, en poétique, en médecine, en mathématiques,, dans les beaux-arts e{ dans les arts vulgaires, les mêmes connaissances que ceux de Thèbes, de Memphis et d'Héliopolis.
C'est précisément cette infériorité des col èges sacerdotaux de la Grèce à l'égard de ceux de l'Égypte, qui explique, dans le premier de ces pays, l'absence de toute domination morale ou politique de la part des prêtres et la fondation d'écoles profanes de la part des philosophes. En effet, en Egypte où il n'était pas possible de fonder des institutions enseignantes en dehors de l'action sacerdotale, cela n'était pas non plus nécessaire. En Grèce, il était, au contraire, indispensable qu'il y eût des institutions de ce genre, puisque le sacerdoce n'en fondait point pour les besoins du pays. Le sacerdoce était plus négligent encore : il ne veillait pas même sur le dépôt qui lui était propre, et avant que les sophistes, et les philosophes vinssent ouvrir des écoles pour les autres sciences, les poètes, qui avaient cessé d'être prêtes ou. chantres sacrés, étaient venus dépouiller les sanctuaires du privilège de diriger les croyances publiques. L'histoire du sacerdoce grec présente ainsi, soit une institution vicieuse dès le début, soit une série de chutes.
Nous ignorons ses débuts, nous connaissons les spoliations qu'il subit. Ce furent d'abord les poètes qui lui disputèrent le privilège d'instruire la nation. Or les poètes du cycle mythique, de l'école homérique, du cycle troyen, de l'école d'Hésiode, de l'école d'Epiménide et d'Onomacrite, appor- (20) tèrent à la théologie de la Grèce des innovations profondes. Dans l'origine, les poètes étaient prêtres : depuis Homère peu furent, et l'indifférence que montrent les sanctuaires à l'égard d'une si puissante série de compositions, est un phénomène que n'offrent les annales d'aucun autre peuple.
Les sanctuaires de la Grèce présentent encore le même spectacle d'inertie, lorsque à la suite des poètes viennent les artistes, constituer une nouvelle théologie, un culte à eux; lorsque à la suite des artistes les philosophes et les rhéteurs ouvrent des arènes pour débattre, devant tous (enseignement exotérique) ou dans l'intimité (enseignement ésotérique), toutes les questions, celles de littérature et de politique, celles de religion et de morale.
Les premières de ces écoles furent contemporaines de ce mystérieux Epiménide, que le sacerdoce d'Athènes, dominé par l'oracle de Delphes, laissa installer par Solon sur le territoire de la république. En effet, pendant que ce thaumaturge, qu'un sacerdoce plus soucieux de ses prérogatives eût exclu ou absorbé, opérait ses saintes purifications et écrivait ses puissants oracles, Thales aborda le principe même de l'enseignement religieux, en expliquant la cosmogonie et la théogonie d'après la seule raison.
A partir de cette innovation, les écoles philosophiques se succédèrent sur tous les points du monde grec, sans qu'y intervînt le sacerdoce. Et cependant, le débat qui s'ouvrait, de grave devint bientôt périlleux, car on passa vite aux sommités, a l'origine des choses; on posa ici le matérialisme, là le spiritualisme, ailleurs le monothéisme ; partout on discuta l'existence des dieux, l'immortalité de l'âme. Déjà la Grèce éclairée s'unissait à ce débat, que les sophistes traînaient devant leurs innombrables auditeurs; déjà les femmes elles-mêmes, associées à l'institut de Pythagore, suivaient déguisées les leçons de Platon et se glissaient nombreuses dans les jardins d'Épicure, sans que les prêtres songeassent à diriger ce mouvement. On dit que la Grèce n'avait pas (21) de sacerdoce héréditaire, et cela est vrai ; mais elle avait des familles sacerdotales, elle avait des prêtres, des oracles, des sanctuaires, des lois. Le sacerdoce disposait de ces moyens d'influence. Or quel usage en fit-il ? Et n'était-il pas inévitable que la Grèce échappât à un corps, qui ne faisait rien pour garder son empire; inévitable, qu'on désertât des sanctuaires qui demeuraient muets devant les écoles ?
On a dit qu'en voyant poètes, artistes, philosophes et rhéteurs, tout ce qui agit puissamment sur les esprits, concourir ensemble à la ruine des croyances, les prêtres ont institué ceux des mystères où ils enseignaient à leurs initiés les doctrines les plus élevées. Il est possible que plusieurs cultes secrets soient postérieurs à Homère, et que les prêtres les aient établis pour rattacher la nation aux sanctuaires par un enseignement meilleur (44); mais dans ce cas, pourquoi tant le cacher, et pourquoi, de Thalès à Aristote, ne pas ouvrir une seule école ? Pour le gouvernement des intelligences qu'était-ce faire, en effet, que de continuer à Delphes à formuler en mauvais vers d'absurdes oracles, ou de présider aux pompes vaines et secrètes d'Eleusis, tandis que la jeunesse du pays venait s'instruire dans la morale, la politique, la philosophie, au Lycée, à l'Académie, au Cynosarge, au jardin d'Épicure?
Mais si le sacerdoce ne concourut ni à la fondation, ni à la direction, ni à la surveillance des grandes écoles, qui prenait ce soin et qui exerçait ce droit?
Pour répondre à cette question, distinguons les diverses sortes d'écoles, celles où un penseur éminent philosophait chez lui avec quelques disciples de choix, de celles que fréquentait publiquement une nombreuse jeunesse. Les premières demandaient peu de frais et ne permettaient pas de surveillance externe. Pour les autres, l'état qui concourait à les fonder, pouvait les surveiller. Un coup d'œil sur les (22) principales écoles tic la Grèce, celles d'Athènes est particulier, éclaircira la question.
L'école d'Ionie, fondée par Thalès, si l'on peut dire qu'un sage dont l'enseignement paraît s'être borné à des entretiens avec des amis intimes a fondé une école, n'était pas publique. Cependant, plusieurs de ses chefs, hommes éminents, jouèrent un grand rôle dans cette contrée et exercèrent sur le développement intellectuel de l'Ionie, une influence aussi profonde que si leur enseignement eût été officiel.
L'école de Pythagore présente un caractère plus imposant encore. Elle n'était pas publique non plus, puisqu'il fallait, pour y entrer, obtenir l'admission du chef, et, pour passer dans les grades supérieurs, traverser des épreuves et recevoir dés initiations. D'un autre côté une association qui pratiquait un culte solennel et établissait entre ses membres la communauté des repas, peut-être même celle des biens: une association dont le chef était le premier magistrat de Crotone, dont l'action S'étendait Sur les plus puissantes cités de la Grande-Grèce et dont les tendances aristocratiques alarmèrent la république de Sybaris, au point qu'elle demanda l'extradition de ces sages et fit la guerre à Crotone pour l'obtenir — une association de cette nature avait bien un caractère public. N'était-ce pas là, dans d'autres conditions, un de ces collèges de prêtres à-la-fois philosophes, moralistes et politiques, que Pythagore avait vus en Égypte? Car on ne saurait plus contester les relations du philosophe de Samos avec l'Égypte; et l'immense portée de sort institution fut si bien Sentie qu'après l'expulsion des Pythagoriciens, on brûla leurs écoles dans la Grande-Grèce.
L'école d'Elée fut une institution publique. Ce fut une lice de sophistes plutôt qu'une association de sages; mais, pour cette raison même, et puisqu'elle attaquait comme immoral le polythéisme, la religion du pays, et qu'elle combattait Homère, Hésiode et Epiménide, en leur qualité de poètes religieux, elle eût mérité une attention spéciale de la (23) part du sacerdoce et du gouvernement. Au fond de son enseignement il y avait quelques vérités, une sorte de monothéisme, il était pourtant plus dangereux et plus grossier que le polythéisme, puisque c'était le panthéisme. Et néanmoins il ne s'éleva contre cette école nul institut de la part de l'état ou de la part du sacerdoce.
Dans l'école d'Empédocle se montre un fait extraordinaire. Ce philosophe de grande naissance, se met au-dessus de la religion de l'état, refuse la première magistrature d'Agrigente eh Sicile, sa patrie, prend le costume pontifical, se fait thaumaturge, conjure la peste et les tempêtes et institue des purifications. C'est un homme qui n'est ni prêtre ni magistrat, mais qui exerce sur la morale et la religion de son pays l'action la plus profonde et qui enseigne la théologie d'Élée, sans que son enseignement soit contrôlé par qui ce soit.
Toutes ces écoles, il est vrai, ne s'adressaient qu'aux hommes d'un âgé mûr ou aux jeunes gens destinés â la politique, et le nombre des disciples qui les suivaient était peu considérable. Mais il n'en fut pas de même de celles des sophistes, qui succédèrent immédiatement à Xénophane et â Empédocle, et qui embrassèrent dans leur enseignement l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, la rhétorique, la morale, la philosophie, la politique et la religion elle-même. Un nombreux auditoire vint à ces leçons faites avec toutes les subtilités de la dialectique et toutes les pompes de l'éloquence, et ce furent la des institutions d'une espèce nouvelle, fondées encore par des citoyens, mais ouvertes au public et à la jeunesse, comme aux hommes plus avancés en âge. Nomades et dirigées dans un esprit de spéculation mercantile, elles exploitèrent les cités du monde grec, sans être dirigées par aucune autorité. Or il est évident que, si le sacerdoce avait eu action sur leur enseignement, il n'aurait pas permis que partout elles agitassent ces deux questions : Les dieux de l'Olympe existent-ils, et y it-il des dieux? Il n'aurait pas permis du moins qu'elle ré- (24) pondissent par cette déclaration : Il n'y a pas de dieux. N'est-il pas évident aussi, que si l'état avait surveillé les professeurs, ils n'auraient pas enseigné ce principe, que c'est la loi et non pas la nature qui fait le juste et l'injuste (45), principe qui n'est qu'un appel permanent de la loi à la nature. Cette indépendance des instituts de philosophie cessa tout-à-coup dans Athènes, et l'école qui venait combattre celles des sophistes, et qui aurait dû, en raison de ce courage, recevoir l'appui de la cité, devint la première victime des colères concentrées du sacerdoce et de l'état. Ce fut celle de Socrate, école à tel point insaisissable, qu'on ne saurait dire quel lieu public en fut le théâtre, mais institution qui jeta un tel éclat et exerça sur la jeunesse aristocratique, les femmes éminentes et les hommes de talent une influence si grande, qu'enfin les magistrats, sur les plaintes d'un poète, d'un démagogue et d'un orateur, s'en occupèrent avec passion. Socrate, accusé de corrompre la jeunesse, denier les dieux du pays et d'en introduire d'autres (46), fut condamné plutôt que jugé. Son supplice n'a même rien d'étonnant. La démocratie, irritée des maux dont l'accablait l'aristocratique Lacédémone, savait que Socrate et ceux de ses disciples qui avaient joué un rôle pendant la désastreuse guerre du Péloponnèse, étaient les défenseurs de l'aristocratie ; et dans son regret d'avoir négligé l'enseignement de cette école, la justice populaire frappa avec d'autant plus de violence, que l'archontat avait plus longtemps manqué à ses obligations, en abandonnant aux sophistes comme aux philosophes la direction de leurs écoles. Ajoutez que la corruption des mœurs, favorisée par les Périclès, les Alcibiade et par toute l'aristocratie, ruinait la république; qu'à cette corruption, qui remontait aux guerres médiques, se joignait le mépris du culte, qui remontait aux sophistes, ennemis (25) publics des dieux du pays: ajoutez qu'on ne distinguait pas suffisamment le maître d'Alcibiade et de Critias des autres sophistes; que le titre de philosophe, qu'on prenait à l'école socratique, était peu compris, et que Socrate fut jugé avec d'autant plus de rigueur, qu'il était plus célèbre. Le sacerdoce, d'abord plus clairvoyant que ses adversaires, l'avait déclaré, par l'oracle de la Pythie, le plus sage des hommes. On n'eut aucun égard pour Delphes, mais quand le supplice fut consommé, on prit le deuil, et pour y associer la jeunesse, on ferma les gymnases et les palestres. Toutefois, l'opinion surveilla désormais les écoles des philosophes, et Platon, pour éviter le sort de son maître, fit un double enseignement, l'un public, l'autre confidentiel. Aristote prit en vain cette précaution; il fut accusé comme l'avait été Socrate, d'enseigner des dieux nouveaux, mais il aima mieux se retirer en Eubée, que de jeter la ville d'Athènes dans un nouveau crime contre la philosophie.
Il avait raison. Depuis la
condamnation de Socrate, si regrettable qu'elle parût aux citoyens,
le gouvernement d'Athènes ne perdait plus de vue les philosophes. ll
leur avait ouvert les bâtiments de la république ou plutôt il les
avait mis dans les gymnases surveillés par l'Aréopage, et il les
tenait comme en ses mains. Nous avons dit que l'école de Socrate
était insaisissable, qu'on ne trouvait pas de lieu de réunion qu'on
pût appeler école de Socrate. En effet, ce qu'on nommait
ainsi, c'était lui et ses amis, c'étaient les doctrines qu'ils
professaient, c'étaient les conférences qu'ils tenaient soit chez
lui, soit chez eux, dans les rues, sur les places publiques, dans
les ateliers d'Athènes (47). ll n'en
fut pas de même des écoles de Platon, d'Aristote, d'Antisthène, de
Zénon, qui professèrent dans les bâtiments de la république, à
l'académie, au lycée, au cynosarge, au portique, fait qui constitue
un changement immense.
Cependant l'état ne se chargea pas des écoles de philoso-
(26) phie, il n'en nomma
pas les chefs, n'en régla pas les études, n'en fit pas les frais.
Platon, Aristote et Zénon n'eurent pas plus de salaire que Socrate.
Si l'état intervint dans les affaires de ces écoles, il y intervint
d'une manière différente pour chacune d'elles; et si l'organisation
intérieure de ces instituts offre des faits propres à éclairer
l'organisation intérieure de l'école d'Alexandrie, elle en diffère
néanmoins sous plusieurs rapports.
Et d'abord l'académie, jardin où la république avait bâti un gymnase, ne fut ouverte à Platon que d'une manière fort restreinte. Pour nous en assurer d'une manière intuitive et préparer par-là l'intelligence des questions que présente le musée d'Alexandrie, considérons les diverses parties dont se composait un gymnase grec (48). Elles étaient les unes essentielles, telles que la Palestre, le Stade, l'Ephébseum, le Sphéristérium (que d'autres confondent avec le Coryceum), l'Apodytérium, l'Elaiothésium, le Konistérium, la Kolymbethra, le Xyste ou les Portiques stadiés, les Péridromides ou les promenoirs en plein air (49); les autres accessoires, telles que les salles (50), les salles ouvertes (51) et les portiques, appelés plus tard Scholœ et Bibliothecœ. Or il est évident que Platon ne pouvait avoir entrée qu'aux parties accessoires, aux Péridromides et aux trois portiques que Vitruve appelle simples, pour les distinguer du quatrième, qui était double et qui conduisait aux parties essentielles de l'édifice : la sévérité des règlements sur l'admission des personnes étrangères à la direction des gymnases ne laisse pas le moindre doute à cet égard. Il est vrai qu'il s'établit pour les philosophes et les sophistes une sorte de tolérance, qu'ils avaient accès à l'Apodytérium, ce qui résulte positive- (27) ment des dialogues de Platon, puisque cet écrivain place dans l'Apodytérium du Lycée un entretien entre Socrate et quelques sophistes, et que d'autres passages de Platon montrent également des philosophes allant enseigner dans les palestres et les apodytéria (52). Cependant si cette tolérance s'établit, en dépit des lois, par la raison que l'apodytérium était à l'entrée même de l'édifice et du xyste, et qu'on pouvait voir de tous les côtés ceux qui y étaient assis, cette tolérance n'était encore qu'une exception à la règle. Dans la règle, c'étaient les portiques que Vitruve appelle simples, qui servaient de rendez-vous aux hommes d'une certaine célébrité ou à ceux qui les recherchaient (53), et ces portiques offraient des salles spacieuses avec des sièges pour ceux des philosophes et des rhéteurs qui, pour s'entretenir d'études, ne préféraient pas se rendre dans le Péripatos,
Dans aucun cas, Platon qui n'était ni gymnasiarque ni surveillant de l'Académie, ne pouvait y établir sa demeure j et non-seulement il acheta dans le voisinage, pour 3,000 drachmes, un terrain où il bâtit une maison (54); mais il paraît que peu à peu il y transporta le siège de son enseignement. En effet, il y éleva de ses deniers un musée ou un temple consacré aux Muses, décoré des statues de ces divinités et qui fut désormais considéré comme le véritable chef-lieu de sa philosophie (55). La république souffrit bien qu'il s'installât dans le voisinage des allées académiques, mais elle ne songea ni à lui livrer la direction de ce gymnase, ni à se charger des frais de l'institut qu'il avait créé (56). Elle laissa (28) à sa charge, sa maison, son temple, et ce qu'on appelle son école ; et il put léguer le tout à ses disciples avec sa bibliothèque. Sa propriété ou l'école, qui, sous le nom d'académie, s'éleva désormais près de l'ancien gymnase du même nom, en éclipsa la renommée à tel point qu'à partir de ce moment c'est l'institut particulier de Platon, ce n'est plus l'académie publique qu'on entend communément quand il est question de l'académie d'Athènes, distinction importante et propre à éviter bien des erreurs.
Si célèbre que fût l'institut de Platon, il paraît qu'il n'eut jamais d'autre local à lui propre que la maison et la Musée du fondateur. Quand Diogène de Laërte dit de Xénocrate, qu'il succéda à Speusippe, et qu'il dirigea l'école pendant vingt-cinq ans (57), cela n'implique nullement l'existence d'une maison spéciale ; et quand il nous apprend à cet égard que Polémon entra ivre et couronné de fleurs dans l'école de Xénocrate, c'est le portique de Platon où elle se tenait qu'il désigne sous le nom de σχολὴ (58).
Ce musée fut donc le véritable chef-lieu de l'Académie et la propriété des Platoniciens. Rien n'empêcha toutefois Platon, qui enseignait en se promenant, qui lisait ses compositions au milieu de ses disciples et discutait avec eux en plein air les questions qu'il leur jetait —rien n'empêcha Platon ni ses successeurs de se promener sous les allées de l'Académie. Mais outre son enseignement public, Platon en faisait un autre plus important, dont il était seul le maître et qu'il n'accordait qu'à ses disciples intimes. Cet autre enseignement il le faisait chez lui, et certaines traditions anciennes sur la mésintelligence qui éclata entre lui et Aristote, paraissent répandre quelque jour sur l'organisation intérieure des écoles de philosophie. Par exemple, on dit que Platon ne fut pas toujours le maître à l'Académie, qu'Aristote y parvint à usurper sur son autorité, à l'éclipser auprès des (29) Platoniciens et à le rejeter dans son intérieur en l'embarrassant de fatigantes objections. Si ces récits ont quelque fondement, ils prouvent que Platon, au lieu de se rendre soit au gymnase public, soit au portique de la petite Académie, préféra l'enseignement ésotérique, tandis qu'Aristote faisait celui du dehors. Ces traditions peuvent prouver aussi que le disciple resté vingt ans à l'Académie finit par ne plus se trouver d'accord avec le maître, et qu'Aristote exerça néanmoins les fonctions de second chef de l'école, comme cela se pratiqua plus tard sous d'autres formes. En effet, plus tard on trouve à l'académie et au lycée, auprès du véritable chef de l'école, des sous-chefs qui exercent dans ces maisons une sorte d'autorité, dont la durée est de dix jours, circonstance doublement curieuse, en ce qu'elle prouve qu'un auxiliaire était devenu indispensable et qu'on avait limité ses pouvoirs avec jalousie. En tout cas, on avait donné aux écoles des statuts précis (59).
L'état n'intervint ni dans ces règlements ni dans la succession des chefs, et Platon légua son académie à son neveu Speusippe comme on lègue son bien. Plus tard Xénocrate recueille de la même manière une succession dont Speusippe est fatigué, et l'Académie ou le Musée de Platon demeure aux Platoniciens, comme les jardins d'Académus et le gymnase de la république demeurent à l'état, qui permet à la jeunesse de suivre les leçons du Musée, ou aux Platoniciens de faire des cours au gymnase, mais qui ne (loge pas les philosophes. C'est cette distinction qui jusqu'à présent, n'a pas été faite; et il en est résulté dans l'histoire de l'académie beaucoup d'obscurité. Faite avec soin (60), elle éclaircit la question de l'intervention du gouvernement dans les écoles et la nature si différente des deux institutions, qu'on désigne sous le nom commun d'académie.
(30) Une distinction encore plus importante doit être faite au sujet du lycée, gymnase public, fondé et entretenu par le gouvernement pour l'éducation de la jeunesse, comme l'académie (61), mais plus important peut-être. En effet, non-seulement il offrait, dans le voisinage d'un temple d'Apollon, un ensemble de vastes édifices, entourés de jardins et d'un bois sacré, mais on y trouvait, dans une sorte de splendeur, tout ce qu'il fallait pour exercer une nombreuse jeunesse : des cours spacieuses (dont l'une de deux stades), des portiques, avec des salles garnies de sièges pour les Cours des professeurs, des promenoirs couverts, des salles de bains, des lices pour les luttes, de stade pour la course à pied. En un mot, fondé par Pisistrate et embelli par Périclès, le lycée était le plus beau des trois principaux gymnases de la république et on l'avait augmenté et décoré avec une sorte d'orgueil : les murs en étaient enrichis de peintures (62), les jardins ornés d'allées garnies de sièges pour les promeneurs (63).
Mais dans quels rapports Aristote fut-il avec ce gymnase?
Selon l'opinion vulgaire, le Lycée et l'école d'Aristote se confondent presque, et le premier n'aurait tiré son importance que de la seconde. Cependant Aristote, sujet du roi de Macédoine, fut bien loin, d'avoir avec le Lycée des rapports aussi intimes que l'Athénien Platon en eut avec l'Académie. On permit, il est vrai, au philosophe de Stagire de se rendre deux fois par jour, le matin et le soir, au gymnase qu'il devait Illustrer; et d'y enseigner au péripatos, comme il aimait a le faire ; mais s'il fut le maître des philosophes jeunes ou vieux qui préféraient ses leçons à celles de ses contemporains, il ne fut jamais le chef du gymnase qui lui donnait l'hospita- (31) lité. Platon acquit, de ses deniers, un jardin et bâtit un musée près l'Académie. Aristote, qui était d'ailleurs plus riche que lui et qui possédait une bibliothèque plus considérable, n'acheta jamais rien ni au lycée ni auprès, soit qu'il n'y eût rien à y vendre, soit qu'il se considérât comme étranger à Athènes. D'ailleurs, sa résidence au lycée devenait un embarras et peut-être même pour la jeunesse un médiocre exemple : on sait quel fut son second mariage. Ceux qui s'imaginent que sa bibliothèque fut déposée au lycée, sont dans une grande erreur. M. Klippel, qui cite, à l'appui de cette opinion, le testament de Théophraste, ne considère pas qu'il s'agit dans cette pièce d'une propriété particulière de ce philosophe, et nullement d'un musée public. Si ce testament parlait d'un musée public, comment Théophraste mourant aurait-il pu ordonner en maître les constructions et les réparations que devaient y faire ses disciples ? Je sais que j'avance ici des idées nouvelles ; mais tout-à-I'heure je citerai les textes qui les établissent. Je dirai dès à présent que la démocratique Athènes n'eût pas souffert qu'un édifice appartenant à l'Etat, fondé et sans cesse embelli par ses chefs les plus illustres, fût aliéné ou confié à la direction d'un ami du tyran d'Atarne et du roi de Macédoine.
L'intervention de l'Etat dans l'enseignement d'Aristote, dans l'école péripatéticienne, fut aussi nulle que dans l'école de Platon. Comme Platon, Aristote désigna son successeur. Mais il ne put pas, comme son maître, lui léguer de local, par la raison qu'il n'en avait pas, et quand il se fut retirée Chalcis avec quelques-uns de ses disciples, laissant à Théophraste la direction de l'école, il se fit dans la résidence des péripatéticiens un changement qui, je crois, a passé jusqu'ici inaperçu. En effet, on croit communément que la république permit à Théophraste de disposer du péripatos et des portiques du lycée pour y continuer l'enseignement d'Aristote ; or voici une série de faits positifs qui non-seulement rendent la chose douteuse, mais qui prouvent le contraire.
Si Diogène de Laërte nous dit que lors de la retraite d'Aristote dans l'île d'Eubée Théophraste lui succéda dans la direction de l'école (64), cela prouve qu'il fut à la tête des Péripatéticiens, mais cela ne prouve nullement qu'il enseigna au lycée. Il est possible qu'il y enseigna quelque temps, et ce qui porte à le croire c'est la faveur publique dont ce philosophe jouissait à Athènes, où il eut jusqu'à deux mille auditeurs (65) ; mais ce qui rend plus que douteux qu'il y ait continué son enseignement, c'est un décret spécial que fit passer cette même opposition qui avait conduit Socrate à la mort, forcé Platon de faire un enseignement ésotérique et Aristote de fuir. Ce décret, proposé par un certain Sophocle, la 3me année de la 118e olympiade (l'an 306) portait que, sous peine de mort, aucun philosophe ne pourrait être chef d'une école, à moins que le sénat et le peuple ne l'eussent voulu (66). Or ce qui rend ce décret si important pour la question, c'est qu'il fut rendu un an après l'expulsion d'Athènes du savant Démétrius de Phalère, qui avait si bien gouverné depuis dix ans, et qui était disciple d'Aristote. D'après cela on serait tenté d'admettre que Théophraste a pu enseigner au lycée depuis la retraite d'Aristote (323 avant J.-C.) jusqu'à l'expulsion de Démétrius, 307, et je ne nie pas cela d'une manière positive ; mais il est certain que Théophraste s'exila par suite du décret si violent qui portait la peine de mort contre tout chef d'école, qui n'aurait pas l'agrément de la plus capricieuse et de la plus passionnée des démocraties, et qu'à cette époque il cessa d'enseigner au lycée. Je dirai plus, si tant est qu'il y ait enseigné un instant, je pense qu'il avait cessé depuis longtemps de s'y rendre.
En effet, dès après la mort d'Aristote, il avait acheté un (33) jardin particulier (67), et ce jardin était assez considérable pour que le philosophe, qui n'était pas pauvre, eût besoin d'être aidé dans son acquisition des moyens de Démétrius de Phalère, qui avait aidé aussi un disciple de Platon, Xénocrate. Ce qui prouve que l'école avait été transférée dans la propriété de Théophraste, c'est que dans son testament ce philosophe ordonne qu'on y achève ce qui regarde le Musée et les Déesses (68); qu'on orne le tout au mieux; qu'on mette au Temple l'image d'Aristote, ainsi, que les autres Anathemata qui y étaient auparavant; qu'on construise près du musée un petit portique qui ne soit pas moindre que le premier, et qu'on suspende dans le portique inférieur (69) les tableaux où sont peints les cercles (70) de la terre (71) ; enfin qu'on y mette un autel, pour que rien de convenable n'y manque. Théophraste ajoute ensuite que son domaine de Stagire sera pour Callinus, ses livres pour Nélée, le jardin Péripatos ( et qu'on remarque ici que dans le système de M. Klippel, !e Péripatos du lycée devient une propriété particulière) et toutes les maisons qui touchent aux jardins, aux amis qui voudront philosopher ensemble, à cette condition toutefois, qu'ils conserveront cette propriété comme un bien commun et sacré.
On le voit, c'est d'abord d'une propriété particulière, ce n.'est nullement d'un local public qu'il s'agit ici; c'est ensuite d'un lieu d'étude philosophique; c'est môme d'un établissement considérable, et non pas d'un jardin d'amateur qu'il est question, puisque l'on y distingue quatre parties importantes (72); c'est enfin d'un lieu qui devra appar- (34) tenir à l'école de Théophraste et à ses amis intimes, de telle sorte que ce ne soit ni leur chef, ni un individu quelconque, mais la corporation entière qui en demeure propriétaire.
Il est donc évident qu'à l'époque de Théophraste, le véritable siège du péripatétisme n'était plus le Lycée, si même il l'avait été. Après la retraite d'Aristote, c'était le Musée ou le jardin de Théophraste. Maintenant je vais plus loin, et je dis que si Théophraste a enseigné au Lycée, ce n'a été qu'un moment. Et d'abord on rapporte l'acquisition de son jardin immédiatement après sa succession aux honneurs d'Aristote. Ensuite les réparations qu'il prescrit dans son testament, l'an 286, quand déjà son ami Démétrius de Phalère a fondé le musée d'Alexandrie, font connaître des ravages qui ont été exercés par le feu ou la guerre dans un sanctuaire qui avait joui antérieurement d'une certaine prospérité. Enfin il est certain que l'acquisition du musée péripatéticien eut lieu avant l'an 306, puisque à cette époque Démétrius de Phalère s'était réfugié en Egypte, et même avant 316, puisque l'illustre péripatéticien gouvernant Athènes depuis ce tems, n'eût pas mis son condisciple dans le cas de quitter le Lycée. C'est donc entre les années 322 et 316 qu'a eu lieu l'acquisition de Théophraste ; et quand je considère la défiance réciproque qui existait entre la république et les philosophes à la mort d'Aristote expulsé d'Athènes, c'est plus de la première que de la seconde de ces époques que je rapproche la translation de la résidence péripatéticienne.
Nous l'avons dit, la distinction entre le Lycée et le Musée péripatéticien a plus d'importance encore que celle entre l'Académie et le Musée platonicien.
Nous remarquons maintenant que depuis l'époque où Platon avait mis son enseignement sous le patronage des muses, divinités dont le culte se rattachait à celui des dieux suprêmes, les écoles importantes se donnaient un musée; qu'au moment où Théophraste fait réparer le sien, son condisciple Démétrius de Phalère en a déjà fait fonder un par Ptolé- (35) mée, fils de Lagus; mais que le Musée se distingue toujours de l'école, c'est-à-dire, du portique ou de l'oxèdre, qui porte le nom de σχολὴ, ou plus tard de βιβλιοθήκη (73).
L'établissement de l'école d'Aristote dans la propriété de Théophraste lui avait rendu toute son indépendance; et ce philosophe, nonobstant la communauté du local souverainement donné à tous ses disciples, nomme l'un d'eux, Straton, chef de l'école. A son tour, Straton nomme Lycon, avec beaucoup plus d'autorité qu'Aristote lui-même désignant son successeur (74). Lycon, au contraire, se sentant mourir à son tour, abandonnera le soin déplacer sa statue où l'on jugera convenable, et de choisir pour son successeur celui des siens qui sera le plus utile. Mais à cette époque le chef-lieu du péripatétisme ne se désignera plus que par le nom de περίπατος (75) ; le ἱερὸν, le μουσεῖον, le κῆπος ne seront plus nommés; soit qu'ils en aient été détachés quand Athènes obéissait à la garnison macédonienne d'Antigone Gonatas, soit qu'on ait négligé ces accessoires quand Alexandrie attirait, sous les Lagides, les savants, courtisans de la fortune.
Le Cynosarge, le troisième des gymnases d'Athènes où les philosophes allèrent enseigner, paraît avoir suivi l'exemple de l'Académie et du Lycée. Si tué hors de l'enceinte d'Athènes, près du temple d'Hercule — car le Ptolémaïon seul fut mis dans l'intérieur de la ville —ce gymnase était affecté à la jeunessô d'une naissance inférieure; et Antisthène, le fondateur des Cyniques qui était lui-même dans cette catégorie par son origine, obtint la permission d'y enseigner à l'époque où Platon s'établit près de l'Académie. Mais le chef des Cyniques (36) ne fut jamais celui du Cynosarge, et il ne paraît pas que ses disciples aient enseigné plus longtemps dans cette école que ceux d'Aristote n'enseignèrent au Lycée, ou ceux de Platon au Gymnase d'Acadème (76). Ils ne suivirent l'exemple de Platon et de Théophraste qu'à moitié, c'est-à-dire qu'ils cessèrent d'aller dans un bâtiment de la république, mais qu'ils n'achetèrent pas de propriété particulière pour y établir le siège de leur école. En effet, ni Diogène, ni Cratès, ni Onésicrite ne professèrent dans un gymnase public ; et aucun d'eux ne paraît avoir fait l'acquisition d'un musée. Celui des philosophes d'Athènes, qui amenda le plus leur doctrine, Zénon, professa au pœcilé, portique qui jadis avait servi de lieu d'assemblée aux poètes et qui revenait naturellement aux philosophes, leurs successeurs.
Ariston, un des disciples de Zénon, rentrera au Cynosarge à une époque où Athènes, dépouillée par les Lagides de sa supériorité intellectuelle, comme elle a été dépouillée par la Macédoine de sa valeur politique, se montrera facile aux philosophes. Cependant un autre disciple de Zénon, Sphérus, aimera mieux le Musée d'Egypte (77). Son véritable successeur, Cléanthe, n'enseignera pas au Cynosarge ; et le disciple de Cléanthe fera ses leçons à l'Odéon. Il est donc vrai de dire qu'aucun disciple de Platon ne lui a réellement succédé au gymnase d'Acadème, qu'aucun disciple d'Aristote ne lui a réellement succédé au Lycée, qu'aucun Cynique n'a remplacé Antisthène au Cynosarge, et qu'aucun Stoïcien n'a succédé à Zénon au pœcilé ; et le tout pour la même raison, l'incompatibilité de la philosophie avec la république.
Epicure mieux inspiré, avait pris un parti plus simple dès le début : il avait établi son école dans sa maison de campagne, près d'Athènes (78). A l'imitation de Platon et (37) de Théophraste, il transmit son jardin et son école à ses successeurs, sans que l'état se mêlât de ce qu'on y enseignait ou pratiquait, quoique il eût dû y porter une sérieuse attention. En effet, cet institut, important par l'influence qu'exerçait sa doctrine sur la religion et les mœurs, méritait encore l'attention du gouvernement par la constitution que lui donna son fondateur. Quand Platon remit son Musée à son neveu et quand Théophraste donna le sien à ses disciples, ils ne statuèrent rien sur la doctrine qu'il faudrait y professer. Epicure, en léguant sa propriété à ses disciples, non seulement leur recommanda de reconnaître Hermachus pour chef, mais il voulut qu'elle n'appartiendrait qu'à ceux qui y resteraient, qui y conserveraient sa doctrine dans une parfaite union, et y célébreraient en commun les fêtes commémoratives qu'il indiquait (79). Il n'affecta ses biens à leur entretien qu'à ces conditions ; et donnant une grande autorité à Hermachus, il ne leur légua sa bibliothèque qu'au nom de ce chef. Aussi, grâce à ces dispositions, le gouvernement de l'école se transmit avec la propriété dans une régularité parfaite pendant plusieurs générations (80). Et plus il y avait de perpétuité dans un enseignement qui combattait la religion et les mœurs, plus il y avait lieu de la part de l'état à y intervenir. Mais déjà l'intervention n'était plus possible; exilées des établissements de la république, les écoles des philosophes, devenues d'autant plus fortes qu'elles étaient plus indépendantes, avaient fait pénétrer leurs principes dans toutes les intelligences élevées etdans toutes les institutions publiques.
Nous dirons maintenant que de tous ces faits il résulte qu'au temps d'Alexandre le gouvernement d'Athènes ne fondait, n'entretenait et ne dirigeait aucune école de philosophie ; que ces écoles étaient instituées et gouvernées d'une manière absolue par les divers chefs de doctrine ; qu'à (38) partir de l'époque de Platon, la république avait admis les philosophes dans certaines parties des trois gymnases principaux ; mais qu'immédiatement après la retraite d'Aristote à Chalcis, cette alliance paraît avoir cessé, et qu'aucune des grandes écoles ne paraît avoir continué à résider dans les gymnases dont elles portaient le nom-, que les Platoniciens eurent leur chef-lieu au Musée de Platon, les Péripatéticiens, au Musée de Théophraste, les Epicuriens, au jardin d'Epicure, tandis que les autres philosophes, les Stoïciens et les Cyniques, qui enseignèrent au Cynosarge, au Pœcilé et à l'Odéon, n'eurent plus aucun chef-lieu habituel ; que si l'autorité publique permit pendant quelque temps aux philosophes d'exposer leurs théories ou d'enseigner dans les gymnases publics, jamais elle n'en logea aucun dans ces établissements ni ne leur alloua de traitement pour leurs leçons ; qu'en général, après leur avoir ouvert les gymnases, elle ne fit plus rien pour eux; que pendant long-temps, de Thales à Socrate, elle se montra presque indifférente à l'égard de leurs doctrines, et qu'après avoir sévi un instant contre Socrate, comme elle avait eu l'idée de sévir contre Anaxagore, après avoir rendu un instant une loi pour se réserver l'autorisation d'ouvrir des écoles de philosophie, elle se rétracta ; qu'elle ferma les yeux sur les théories de Platon, qui n'étaient pas plus d'accord avec le culte qu'avec la politique de l'état; sur celles d'Aristote, qui n'étaient guère orthodoxes, mais que tout autreque le sujet et l'ami du roi de Macédoine eût pu professer toute sa vie ; sur celles d'Epicure lui-même dont l'enseignement attaquait directement les mœurs et les institutions religieuses du pays; enfin que le sacerdoce n'exerça aucune influence ni sur les écoles publiques ni sur les écoles privées; qu'à la vérité les trois principaux gymnases d'Athènes s'élevaient près de trois édifices sacrés, mais que la religion n'était pas comprise dans les études qu'on y faisait, et que ce n'étaient passes ministres qui l'enseignaient.
Nous l'avons dit, ce qui explique cette séparation si com- (39) plète entre les sanctuaires et les écoles, c'est l'origine indépendante de ces dernières.
Le gouvernement d'Athènes fondait et entretenait, à la vérité, quelques écoles; mais les seules auxquelles il accordât ses soins et ses sacrifices, c'étaient les Didascalées et les Gymnases, institutions qui n'ont pour nous que peu d'importance. En effet, le didascalée, toujours séparé du gymnase, ne recevait que de jeunes enfants, et s'il était assez considérable pour qu'on y trouvât un local exclusivement réservé aux leçons et distingué par un nom spécial (81), l'enseignement y était sans caractère. Aussi c'était moins l'état que les citoyens qui en faisaient les frais, puisque les lois obligeaient chaque tribu de payer les leçons de musique et de gymnastique données aux enfans qui lui appartenaient (82) . En effet, l'enseignement supérieur, dont les prix s'élevaient au point que Démosthène ne put pas suivre l'école d'Isocrate, où l'honoraire était de dix mines (83), restait seul à la charge des familles. Quant aux gymnases, si le gouvernement d'Athènes entretenait ces établissements qu'il avait fondés, son attention ne s'y portait guère que sur les exercices du corps, les mœurs et la discipline. Les dispositions essentielles de la loi sur les gymnases sont celles qui ordonnent aux maîtres d'ouvrir ces institutions après le lever du soleil et de les fermer avant son coucher -, interdisent sous peine de mort l'entrée de ces écoles aux personnes qui avaient passé l'âge puéril ; rendent les gymnasiarques responsables à cet égard, et prescrivent des choragi âgés de plus de quarante ans. La plupart des employés du gymnase s'occupaient dela direction des exercices et de la surveillance des mœurs (84). Les Sophronistes, nommés par les dix tribus, et le gymnasiarque, investi d'une autorité générale sur (40) les gymnases, ne pouvaient pas non plus intervenir dans les études, et l'Aréopage lui-même, qui surveillait tous ces fonctionnaires, ne paraît pas s'en être mêlé davantage. (85)
Quant aux écoles de philosophie, l'état et le sacerdoce ne se souciaient ni de fonder ni d'entretenir, ni même de surveiller sérieusement ces institutions. Sans doute un gouvernement où le peuple était associé à l'administration comme à la législation avait le droit de toucher à tout; et plus d'une fois celui d'Athènes intervint dans les affaires des philosophes, plus d'une fois l'opinion publique persécuta ces chefs du mouvement des idées ; mais leurs écoles demeurèrent toujours à leur charge, et si l'état s'avisa un instant de leur donner asile, pour les avoir sous sa main, il laissa bientôt se rompre une alliance à laquelle il n'avait jamais mis trop de prix. Quelquefois la démocratie de l'Agora aima mieux frapper que surveiller. Dans un de ses accès de colère, elle fit une loi formelle, pour proscrire toute école de philosophie (86). Il en fut de cette loi comme d'une autre que nous avons déjà citée, et qui voulait que nul ne pût diriger une école de philosophie sans l'autorisation du sénat et du peuple. Aucune des deux ne demeura en vigueur, et toutes deux, loin de prouver ce qu'on serait tenté d'en conclure, c'est-à-dire une surveillance sérieuse de l'enseignement supérieur, attestent le contraire. En effet, ce ne furent que des lois de réaction qu'emportèrent d'autres réactions. La première, rendue sur la proposition de Critias, fut abolie par le gouvernement des Trente. La seconde, sollicitée par Sophocle de Sunium contre Théophraste et les autres philosophes, sous l'invasion de Démétrius, fils d'Antigone (87), fut rapportée au bout de l'année, les philosophes rappelés, et Sophocle puni d'une amende de cinq (41) talents. Par ces deux actes de réaction, il fut, pour ainsi dire, déclaré légalement que les philosophes dirigeraient leurs écoles comme ils l'entendraient, sauf vindicte publique.
Cela établi, on peut demander si le gouvernement et le sacerdoce ont eu tort ou raison de négliger ces institutions? Pour apprécier leur conduite, il faut envisager deux choses : les institutions générales de la république et le rôle que la philosophie a joué dans le pays. Quant aux institutions politiques depuis que Pisistrate avait chassé Solon, celui des législateurs qui avait eu le plus de crédit, c'était un mélange d'aristocratie et de démocratie qui changeait de face chaque jour, avec chaque chef assez éloquent ou assez riche pour séduire par son or ou sa parole. Dans ce brillant chaos, rien ne dominait, si ce n'est l'esprit d'indépendance des Athéniens. Plus cet esprit était ingouvernable, et plus était grand le rôle des orateurs, des rhéteurs, des philosophes, des écoles, en un mot. Et point de doute, l'enseignement de ces écoles méritait de la part de l'état et du sacerdoce la plus sérieuse attention. Religieux dans les écoles de Thalès, de Pythagore, d'Empédocle, de Socrate et de Platon, il fut non-seulement contraire au culte du pays, mais à toute religion, dans celles de Xénophane, de Leucippe, de Démocrite et d'Epicure. Il était douteux dans celle d'Aristote, et mauvais dans celles des Sophistes; car lors même que les dieux, dont la loi ordonnait le respect, n'y étaient pas niés ouvertement, ils y étaient débattus avec ce mélange de dédain et de pitié plus dangereux que la polémique. Des principes de morale étaient donnés, il est vrai, dans les instituts de tous les philosophes; mais dans plusieurs ces principes étaient frivoles; dans d'autres, pernicieux. Quant à la politique, on professait dans les unes des utopies, dans les autres des théories plus aristocratiques, ou même plus monarchiques que ne le voulait la démocratie du pays ; et le gouvernement d'Athènes, comme tant d'autres, eut rarement pour lui la sympathie de ceux qui dirigeaient l'opinion publique.
(42)
Ainsi au temps d'Alexandre, il y avait non-seulement
scission entre les écoles et les institutions, mais hostilité
profonde entre le gouvernement et les écoles de philosophie. Et
cependant toute la jeunesse des classes aisées, tous ceux qui
devaient un jour proposer ou débattre les lois, parler dans l'agora
ou conduire les affaires de la république, puisaient leurs doctrines
dans ces écoles. N'est-il pas évident que cette scission devait
compromettre le gouvernement comme les institutions? Et n'est-il pas
évident aussi que les Lagides, sur le point de fonder dans
Alexandrie des institutions littéraires, comparant ensemble celles
de l'Egypte et celles de la Grèce, où tout était dans l'anarchie,
ont dû emprunter à ces dernières la science, aux premières
l'organisation ? Un coup d'œil sur le théâtre où les nouvelles
institutions furent fondées et sur la situation où se trouvait leur
auteur, fera comprendre encore mieux cette vérité.
(1) (Hérod. II, 50.
(2) Diod. S., c. I, 17.
(3) I, 70.
(4) I, 72.
(5) Diod., I,81.
(6) Stromata, V, p. 657; edit. Potter. Oxon.
(7) Par M. Letronne. F. Champollion, Précis du syst. hiérog., p. 403.
(8) Diod., 1, 76.
(9) Oratio XI, p. 162.
(10) Champollion, lettres écrites de l'Egypte, p. 160. Acerbi Bibliot. Ital., 1829, Nov.
(11)Lib. II,9.
(12) Diod. Sic., lib. I, c, 18, 28, cf. 69, 96, 98.
(13) Lib. I, c. 44, cf. 69. Dans ces derniers chapitres, Diodore entreprend de faire l'histoire véritable de l'Egypte et de la dépouiller des fables d'Hérodote.
(14) Diod., I, 37.
(15) Saturn, VII, c. 13. - Noc. Attic, lib. X, c. 10.
(16) Diod., I, 82.
(17) Herod., II, 77, 84.
(18) Herod., II, 109.
(19) Diod. Sic, I, 50, f. 94.
(20) Herod., II, 82 et 83.
(21) Herod., II, 4.
(22) Herod., II, 109.
(23) Exemple frappant, liv. II, 28.
(24) Strom. V, p. 702; éd. de Paris 1566.
(25) Desc. de l'Egypte, t. VII, Antiquités, p. 14,
(26) Plato in Phœdro.
(27) Desc. de l'Egypte, I. p. 315.
(28) Diod., lib. I, sub fine.
(29) Letronne, Recherches sur le monument d'Osym., p. 73.
(30) Hérodote (II, 28) parle du greffier des trésors de Sais.
(31) Diod., 1,73.
(32) Diod., 1,81.
(33) Diod., I, 67.
(34) Diod., I, 74.
(35) Herod., lib. II.
(36) Strab., lib. XVII, p. 806. Strabon dit que Platon et Eudoxe ne furent pas heureux en interrogeant les prêtres ; mais il insinue que ceux-ci étaient savants.
(37) Diod., i, 69, p. 79 et 96; p. 107, éd. Wessel.
(38) Petit, leges Atticœ, p. 22.
(39) Quinct. Inst. or. I, 8.—Eustath.ad II. B.— Elian., XIII, 38.— Plato, de leg., VII.
(40) On peut même induire des travaux auxquels se livra Aristote pendant son séjour a l'Académie, qu'on y trouvait les moyens d'étudier la médecine. Et, en effet, on ne voit pas où les Athéniens et les Grecs du continent auraient fait leurs études médicales, si ce n'est dans les écoles de philosophie, puisqu'il n'y avait d'écoles spéciales pour la médecine qu'à Cos, Crotone, Cnide et Rhodes, et qu'il n'y en avait pas à Athènes. — Galen., Meth. med., I, t. 4, p. 35.
(41) Goette, das delphische Orakel in seinem politischen, rellgiösen und siltlichen Einlfuss auf die alte Welt.
(42) (1) Sphoell, 1, 143, parle à tort d'une école d'Homérides.
(43) Religions de l'antiquité, II, 1er p., p, 200, trad, de Guigalant.
(44) De Orphei actate, par Lobek.
(45) Plato, Gorgias. —Theaet., p. 167. — De legib., X, p. 889.
(46) Plato, Apol. — Eutyphron. — Xénophon, Apol., 12.
(47) Ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐν τῇ ἀγορᾴ.
(48) Vitruv., V, 11. Ce chapitre de Vitruve, de palestrarum œdificatione, traite des gymnases, et non des palestres proprement dites.
(49) Hypœtrai ambulationes.
(50) Οἴκος, mot qui reparaîtra dans l'histoire du Musée d'Alexandrie.
(51) Les ἐξέδραι qui y reparaissent de même.
(52) Euthyd,, in initio. — Lysis., p, 4, sect. II; p. 11, sect. VIII. — Menex., sect. X, p. 14. — Charmidas, in initio,
(53) Petiti leges Atticœ, p. 297. —Cf. Mercurialis, de re gymnastica, lib. I, cap. 10.
(54) Le Κηπίδιον de Diogène de Laërte ( III, 14, 20 ), qu'on acheta au prix de 20 à 30 mines. Plut., de exil., 10.
(55) Diogène dit de Speusippe : Xράτων ἀγαλμένα ἀνέθηκεν ἐν τῷ μουσεῷ τῷ ὑπὸ Πλάτωνοϲ ἐν Ἀκαδημίᾳ ἱδρύτεντι.
(56) Cf. Plutarch. de exilio. — Diog. Laert., III, ii. 9 - Aelan., II, 10. — Conring. Antiq. Acad.
(57) Διεδέξατο Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τῆς σχολῆς.
(58) Diog., lib IV, c. 111.
(59) V. c. I, 56. Ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ σχολῇ νομοθετεῖν, μιμούμενον ξενοκράτην· ὥστε κατὰ δέκα ἡμέρας ἄρχοντα ποιεῖν.
(60) Hesych., v. Acad. - Suidaq, v. Hipparch.
(61) Ulpian. inTimocrat. Démosth. et Eschin. Opp. éd. Basil, 1572, t. V, p. 236.
(62)Suidas et Harpoc. in v. Λύκειον. — Xenoph. Anab., VII, 8, 1. — Vitruv., V, 11. —Platon, Eutyph. — Démet., de interp., § III. — Lucian., dial. mort., I, p. 329. — Paus., I, cap. 19 et 29.
(63) Induction à tirer de Lucien., de gymn., t. II, p. 887.
(64) Diog., p. 202, ed. Kraus.
(65) Diog., p. 303.
(66) Μηδένα τῶν φιλοσοφῶν σχολῆς ἀφηγε$ισθαι, ἂν μὴ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δημῷ δοφῇ. Εἰ δὲ μὴ θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. Diog., 303.
(67) Ἴδιον κῆπον.
(68) Θεὰς.
(69) Εἰς τὴν κάτω στοάν.
(70) Περίοδοι.
(71) Ἀναθεῖναι δὲ καὶ τοὺς πίνακας ἐν οἷς αἱ τῆς γῆς περίοδοί εἰσιν εἰς τὴν κάτω στοάν. Plutarque, dans la vie de Thésée, mentionne aussi des peintures de géographie. Properce les appelle mundos pictos. V. Ménage, ad h. l.
(72) Le μοθσεῖον ou ἱερὸν, le μνημεῖον, le περίπατος et le κῆπος
(73) II se trouvait aussi près l'enceinte d'Athènes un Μουσεῖον, montagne qui n'avait rien de commun avec les études. Paus. l, 35. Avant que Platon eût appliqué ce nom à son école, on appelait μούσεια les fêtes très bruyantes que les écoliers célébraient dans les gymnases «n l'honneur des Muses. Petiti Leges Atiicœ, p. 297.
(74) 127e olympiade, 2e année, ou 270 ans av. J.-C.
(75) Diog., p. 318 et 233, ed. Kraus.
(76) Demosth. in Aristoc., Demosth. in Leptin. — Liv., lib. 31, c. 24 - Diog. Laert., lib. VI, c. 1. Cf. Ménage, ad h. 1. —Plut, in Themist., c. 1.
(77) Diog. Lacrt., lib. VII, c. 6.
(78) Diog. Laert., lib. X, c. 9. .
(79) Diog. Laert., p. 657, éd. Kraus.
(80) Plin., h. n. XIX, 4. — Euseb., Pr. Ev., XIV, 5.
(81) Le muni de our les élèves. V. Plato, Protager. ad. Heindorf, p. 325. Les sont évidemment des bancs.
(82) Boech, Staathous I 122
(83) Plut. Demosth., c. 5.
(84 Petiti Leges Atticae,p, 22 et 297.
(85) Demosth. in Lept. — Ulpian. in Lept. orat., p. 575. — Stob., sermo 5. Isoc. Areop., c. 15—17.
(86) Λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν. Petiti Leg. Attic. p. 22.
(87) Athénée. l. XIII, p. 211, éd. Schw., parle d'une polémique qui s'ensuivit.