|
I. Cum defensionum laboribus senatoriisque
muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando liberatus, rettuli
me, Brute, te hortante maxime ad ea studia, quae retenta animo,
remissa temporibus, longo intervallo intermissa revocavi, et cum
omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio et
disciplina studio sapientiae, quae philosophia dicitur, contineretur,
hoc mihi Latinis litteris inlustrandum putavi, non quia philosophia
Graecis et litteris et doctoribus percipi non posset, sed meum semper
iudicium fuit omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut
accepta ab illis fecisse meliora, quae quidem digna statuissent, in
quibus elaborarent. Nam mores et instituta vitae resque domesticas ac familiaris
nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero publicam nostri maiores
certe melioribus temperaverunt et institutis et legibus. Quid loquar de re
militari? In qua cum virtute nostri multum valuerunt, tum plus etiam
disciplina. Iam illa, quae natura, non litteris adsecuti sunt,
neque cum Graecia neque ulla cum gente sunt conferenda. Quae enim tanta
gravitas, quae tanta constantia, magnitudo animi, probitas,
fides, quae tam excellens in omni genere virtus in ullis fuit, ut
sit cum maioribus nostris comparanda? Doctrina Graecia nos et omni litterarum
genere superabat; in quo erat facile vincere non repugnantes. Nam cum apud
Graecos antiquissimum e doctis genus sit poetarum, siquidem Homerus fuit
et Hesiodus ante Romam conditam, Archilochus regnante Romulo, serius
poeticam nos accepimus. Annis fere cccccx post Romam conditam Livius fabulam
dedit, C. Claudio, Caeci filio, M.Tuditano consulibus,
anno ante natum Ennium. Qui fuit maior natu quam Plautus et Naevius.
II. Sero igitur a nostris poetae vel cogniti
vel recepti. Quamquam est in Originibus solitos esse in epulis canere convivas
ad tibicinem de clarorum hominum virtutibus; honorem tamen huic generi non
fuisse declarat oratio Catonis, in qua obiecit ut probrum M.Nobiliori,
quod is in provinciam poetas duxisset; duxerat autem consul ille in Aetoliam,
ut scimus, Ennium. Quo minus igitur honoris erat poetis, eo minora
studia fuerunt, nec tamen, si qui magnis ingeniis in eo genere
extiterunt, non satis Graecorum gloriae responderunt. An censemus,
si Fabio, nobilissimo homini, laudi datum esset, quod pingeret,
non multos etiam apud nos futuros Polyclitos et Parrhasios fuisse? Honos alit
artes, omnesque incenduntur ad studia gloria, iacentque ea semper,
quae apud quosque improbantur. Summam eruditionem Graeci sitam censebant in
nervorum vocumque cantibus; igitur et Epaminondas, princeps meo iudicio
Graeciae, fidibus praeclare cecinisse dicitur, Themistoclesque
aliquot ante annos cum in epulis recusaret lyram, est habitus indoctior.
Ergo in Graecia musici floruerunt, discebantque id omnes, nec qui
nesciebat satis excultus doctrina putabatur. In summo apud illos honore
geometria fuit, itaque nihil mathematicis inlustrius; at nos metiendi
ratiocinandique utilitate huius artis terminavimus modum.
III. At contra oratorem celeriter complexi sumus,
nec eum primo eruditum, aptum tamen ad dicendum, post autem eruditum.
Nam Galbam Africanum Laelium doctos fuisse traditum est, studiosum autem
eum, qui is aetate anteibat, Catonem, post vero Lepidum,
Carbonem, Gracchos, inde ita magnos nostram ad aetatem, ut non
multum aut nihil omnino Graecis cederetur. Philosophia iacuit usque ad hanc
aetatem nec ullum habuit lumen litterarum Latinarum; quae inlustranda et
excitanda nobis est, ut, si occupati profuimus aliquid civibus
nostris, prosimus etiam, si possumus, otiosi. In quo eo magis
nobis est elaborandum, quod multi iam esse libri Latini
dicuntur scripti
inconsiderate ab optimis illis quidem viris, sed non satis eruditis. Fieri
autem potest, ut recte quis sentiat et id quod sentit polite eloqui non
possit; sed mandare quemquam litteris cogitationes suas, qui eas nec
disponere nec inlustrare possit nec delectatione aliqua allicere lectorem,
hominis est intemperanter abutentis et otio et litteris. Itaque suos libros ipsi
legunt cum suis, nec quisquam attingit praeter eos, qui eandem
licentiam scribendi sibi permitti volunt. Quare si aliquid oratoriae laudis
nostra attulimus industria, multo studiosius philosophiae fontis aperiemus,
e quibus etiam illa manabant.
IV. Sed ut Aristoteles, vir summo ingenio,
scientia, copia, cum motus esset Isocratis rhetoris gloria,
dicere docere etiam coepit adulescentes et prudentiam cum eloquentia iungere,
sic nobis placet nec pristinum dicendi studium deponere et in hac maiore et
uberiore arte versari. Hanc enim perfectam philosophiam semper iudicavi,
quae de maximis quaestionibus copiose posset ornateque dicere; in quam
exercitationem ita nos studiose [operam] dedimus, ut iam etiam scholas
Graecorum more habere auderemus. Ut nuper tuum post discessum in Tusculano cum
essent complures mecum familiares, temptavi, quid in eo genere
possem. Ut enim antea declamitabam causas, quod nemo me diutius fecit,
sic haec mihi nunc senilis est declamatio. Ponere iubebam, de quo quis
audire vellet; ad id aut sedens aut ambulans disputabam. Itaque dierum quinque
scholas, ut Graeci appellant, in totidem libros contuli. Fiebat
autem ita ut, cum is qui audire vellet dixisset, quid sibi videretur,
tum ego contra dicerem. Haec est enim, ut scis, vetus et Socratica
ratio contra alterius opinionem disserendi. Nam ita facillime, quid veri
simillimum esset, inveniri posse Socrates arbitrabatur. Sed quo commodius
disputationes nostrae explicentur, sic eas exponam, quasi agatur res,
non quasi narretur. Ergo ita nascetur exordium:
V. Malum mihi videtur esse mors. Iisne, qui
mortui sunt, an iis, quibus moriendum est? Utrisque. Est miserum
igitur, quoniam malum. Certe. Ergo et ii, quibus evenit iam ut
morerentur, et ii, quibus eventurum est, miseri. Mihi ita
videtur. Nemo ergo non miser. Prorsus nemo. Et quidem, si tibi constare
vis, omnes, quicumque nati sunt eruntve, non solum miseri,
sed etiam semper miseri. Nam si solos eos diceres miseros quibus moriendum esset,
neminem tu quidem eorum qui viverent exciperes —moriendum est enim omnibus, —
esset tamen miseriae finis in morte. Quoniam autem etiam mortui miseri sunt,
in miseriam nascimur sempiternam. Necesse est enim miseros esse eos qui centum
milibus annorum ante occiderunt, vel potius omnis, quicumque nati
sunt. Ita prorsus existimo. Dic quaeso: num te illa terrent, triceps apud
inferos Cerberus, Cocyti fremitus, travectio Acherontis, 'mento
summam aquam attingens enectus siti' Tantalus? Tum illud, quod
Sisyphus versat saxum sudans nitendo neque
proficit hilum?
Fortasse etiam inexorabiles iudices, Minos
et Rhadamanthus? Apud quos nec te L.Crassus defendet nec M.Antonius nec,
quoniam apud Graecos iudices res agetur, poteris adhibere Demosthenen;
tibi ipsi pro te erit maxima corona causa dicenda. Haec fortasse metuis et
idcirco mortem censes esse sempiternum malum.
VI. Adeone me delirare censes, ut ista esse
credam? An tu haec non credis? Minime vero. Male hercule narras. Cur? Quaeso.
Quia disertus esse possem, si contra ista dicerem. Quis enim non in eius
modi causa? Aut quid negotii est haec poetarum et pictorum portenta convincere?
Atqui pleni libri sunt contra ista ipsa disserentium philosophorum. Inepte sane.
Quis enim est tam excors, quem ista moveant? Si ergo apud inferos miseri
non sunt, ne sunt quidem apud inferos ulli. Ita prorsus existimo. Ubi sunt
ergo ii, quos miseros dicis, aut quem locum incolunt? Si enim sunt,
nusquam esse non possunt. Ego vero nusquam esse illos puto. Igitur ne esse
quidem? Prorsus isto modo, et tamen miseros ob id ipsum quidem, quia
nulli sint. Iam mallem Cerberum metueres quam ista tam inconsiderate diceres.
Quid tandem? Quem esse negas, eundem esse dicis. Ubi est acumen tuum? Cum
enim miserum esse dicis, tum eum qui non sit dicis esse. Non sum ita hebes,
ut istud dicam. Quid dicis igitur? Miserum esse verbi causa M.Crassum, qui
illas fortunas morte dimiserit, miserum Cn.Pompeium, qui tanta
gloria sit orbatus, omnis denique miseros, qui hac luce careant.
Revolveris eodem. Sint enim oportet, si miseri sunt; tu autem modo negabas
eos esse, qui mortui essent. Si igitur non sunt, nihil possunt esse;
ita ne miseri quidem sunt. Non dico fortasse etiam, quod sentio; nam istuc
ipsum, non esse, cum fueris, miserrimum puto. Quid? Miserius
quam omnino numquam fuisse? Ita, qui nondum nati sunt, miseri iam
sunt, quia non sunt, et nos, si post mortem miseri futuri
sumus, miseri fuimus ante quam nati. Ego autem non commemini, ante
quam sum natus, me miserum; tu si meliore memoria es, velim scire,
ecquid de te recordere.
VII. Ita iocaris, quasi ego dicam eos
miseros, qui nati non sint, et non eos miseros, qui mortui
sunt. Esse ergo eos dicis. Immo, quia non sint, cum fuerint,
eo miseros esse. Pugnantia te loqui non vides? Quid enim tam pugnat, quam
non modo miserum, sed omnino quicquam esse, qui non sit? An tu
egressus porta Capena cum Calatini, Scipionum, Serviliorum,
Metellorum, sepulcra vides, miseros putas illos? Quoniam me verbo
premis, posthac non ita dicam, miseros esse, sed tantum
miseros, ob id ipsum, quia non sint. Non dicis igitur: 'miser est
M.Crassus', sed tantum: 'miser M.Crassus'? Ita plane. Quasi non necesse
sit, quicquid isto modo pronunties, id aut esse aut non esse! an tu
dialecticis ne imbutus quidem es? In primis enim hoc traditur: omne pronuntiatum
(sic enim mihi in praesentia occurrit ut appellarem axioma, —utar post
alio, si invenero melius) id ergo est pronuntiatum, quod est verum
aut falsum. Cum igitur dicis: 'miser M.Crassus', aut hoc dicis: 'miser est
Crassus', ut possit iudicari, verum id falsumne sit, aut nihil
dicis omnino. Age, iam concedo non esse miseros, qui mortui sint,
quoniam extorsisti, ut faterer, qui omnino non essent, eos ne
miseros quidem esse posse. Quid? Qui vivimus, cum moriendum sit,
nonne miseri sumus? Quae enim potest in vita esse iucunditas, cum dies et
noctes cogitandum sit iam iamque esse moriendum?
VIII. Ecquid ergo intellegis, quantum mali
de humana condicione deieceris? Quonam modo? Quia, si mors etiam mortuis
miserum esset, infinitum quoddam et sempiternum malum haberemus in vita;
nunc video calcem, ad quam cum sit decursum, nihil sit praeterea
extimescendum. Sed tu mihi videris Epicharmi, acuti nec insulsi hominis ut
Siculi, sententiam sequi. Quam? Non enim novi. Dicam, si potero,
Latine. Scis enim me Graece loqui in Latino sermone non plus solere quam in
Graeco Latine. Et recte quidem. Sed quae tandem est Epicharmi ista sententia?
Emori nolo, sed me esse mortuum nihil
aestimo.
'Iam adgnosco Graecum. Sed quoniam coegisti,
ut concederem, qui mortui essent, eos miseros non esse,
perfice, si potes, ut ne moriendum quidem esse miserum putem. Iam
istuc quidem nihil negotii est, sed ego maiora molior. Quo modo hoc nihil
negotii est? Aut quae sunt tandem ista maiora? Quia, quoniam post mortem
mali nihil est, ne mors quidem est malum, cui proxumum tempus est
post mortem, in quo mali nihil esse concedis: ita ne moriendum quidem esse
malum est; id est enim perveniendum esse ad id, quod non esse malum
confitemur. Uberius ista, quaeso. Haec enim spinosiora, prius ut
confitear me cogunt quam ut adsentiar. Sed quae sunt ea, quae dicis te
maiora moliri? Ut doceam, si possim, non modo malum non esse,
sed bonum etiam esse mortem. Non postulo id quidem, aveo tamen audire. Ut
enim non efficias quod vis, tamen, mors ut malum non sit,
efficies. Sed nihil te interpellabo; continentem orationem audire malo. Quid,
si te rogavero aliquid, nonne respondebis? Superbum id quidem est,
sed, nisi quid necesse erit, malo non roges.
IX. Geram tibi morem et ea quae vis, ut
potero, explicabo, nec tamen quasi Pythius Apollo, certa ut
sint et fixa, quae dixero, sed ut homunculus unus e multis
probabilia coniectura sequens. Ultra enim quo progrediar, quam ut veri
similia videam, non habeo; certa dicent ii, qui et percipi ea posse
dicunt et se sapientis esse profitentur. Tu, ut videtur; nos ad audiendum
parati sumus. Mors igitur ipsa, quae videtur notissima res esse,
quid sit, primum est videndum. Sunt enim qui discessum animi a corpore
putent esse mortem; sunt qui nullum censeant fieri discessum, sed una
animum et corpus occidere, animumque in corpore extingui. Qui discedere
animum censent, alii statim dissipari, alii diu permanere,
alii semper. Quid sit porro ipse animus, aut ubi, aut unde,
magna dissensio est. Aliis cor ipsum animus videtur, ex quo excordes,
vecordes concordesque dicuntur et Nasica ille prudens bis consul 'Corculum' et
'egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus'. Empedocles animum esse
censet cordi suffusum sanguinem; aliis pars quaedam cerebri visa est animi
principatum tenere; aliis nec cor ipsum placet nec cerebri quandam partem esse
animum, sed alii in corde, alii in cerebro dixerunt animi esse sedem
et locum; animum autem alii animam, ut fere nostri declarat nomen: nam et
agere animam et efflare dicimus et animosos et bene animatos et ex animi
sententia; ipse autem animus ab anima dictus est; Zenoni Stoico animus ignis
videtur.
X. Sed haec quidem quae dixi, cor,
cerebrum, animam, ignem volgo, reliqua fere singuli.
Ut multo
ante veteres, proxime autem Aristoxenus, musicus idemque
philosophus, ipsius corporis intentionem quandam, velut in cantu et
fidibus quae harmonia dicitur: sic ex corporis totius natura et figura varios
motus cieri tamquam in cantu sonos. Hic ab artificio suo non recessit et tamen
dixit aliquid, quod ipsum quale esset erat
multo ante et dictum et
explanatum a Platone. Xenocrates animi figuram
et quasi corpus negavit esse
ullum, numerum dixit esse, cuius vis, ut iam ante Pythagorae
visum erat, in natura maxuma esset. Eius doctor Plato triplicem finxit
animum, cuius principatum, id est rationem, in capite sicut in
arce posuit, et duas partes parere voluit, iram et cupiditatem,
quas locis disclusit: iram in pectore, cupiditatem supter praecordia
locavit. Dicaearchus autem in eo sermone, quem Corinthi habitum tribus
libris exponit, doctorum hominum disputantium primo libro multos loquentes
facit; duobus Pherecratem quendam Phthiotam senem, quem ait a Deucalione
ortum, disserentem inducit nihil esse omnino animum, et hoc esse
nomen totum inane, frustraque animalia et animantis appellari, neque
in homine inesse animum vel animam nec in bestia, vimque omnem eam,
qua vel agamus quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis
aequabiliter esse fusam nec separabilem a corpore esse, quippe quae nulla
sit, nec sit quicquam nisi corpus unum et simplex, ita figuratum ut
temperatione naturae vigeat et sentiat. Aristoteles, longe omnibus
Platonem semper excipio praestans et ingenio et diligentia, cum quattuor
nota illa genera principiorum esset complexus, e quibus omnia orerentur,
quintam quandam naturam censet esse, e qua sit mens; cogitare enim et
providere et discere et docere et invenire aliquid et tam multa [alia]
meminisse, amare, odisse, cupere, timere, angi,
laetari, haec et similia eorum in horum quattuor generum inesse nullo
putat; quintum genus adhibet vacans nomine et
sic ipsum animum ἐντελέχειαν
appellat novo nomine quasi quandam continuatam motionem et perennem.
XI. Nisi quae me forte fugiunt, haec sunt
fere de animo sententiae. Democritum enim, magnum illum quidem virum,
sed levibus et rotundis corpusculis efficientem animum concursu quodam fortuito,
omittamus; nihil est enim apud istos, quod non atomorum turba conficiat.
Harum sententiarum quae vera sit, deus aliqui viderit; quae veri
simillima, magna quaestio est. Utrum igitur inter has sententias
diiudicare malumus an ad propositum redire? Cuperem equidem utrumque, si
posset, sed est difficile confundere. Quare si, ut ista non
disserantur, liberari mortis metu possumus, id agamus; sin id non
potest nisi hac quaestione animorum explicata, nunc, si videtur,
hoc, illud alias. Quod malle te intellego, id puto esse commodius;
efficiet enim ratio ut, quaecumque vera sit earum sententiarum quas eui,
mors aut malum non sit aut sit bonum potius. Nam si cor aut sanguis aut cerebrum
est animus, certe, quoniam est corpus, interibit cum reliquo
corpore; si anima est, fortasse dissipabitur; si ignis, extinguetur;
si est Aristoxeni harmonia, dissolvetur. Quid de Dicaearcho dicam,
qui nihil omnino animum dicat esse? His sententiis omnibus nihil post mortem
pertinere ad quemquam potest; pariter enim cum vita sensus amittitur; non
sentientis autem nihil est ullam in partem quod intersit. Reliquorum sententiae
spem adferunt, si te hoc forte delectat, posse animos, cum e
corporibus excesserint, in caelum quasi in domicilium suum pervenire. Me
vero delectat, idque primum ita esse velim, deinde, etiamsi
non sit, mihi persuaderi tamen velim. Quid tibi ergo opera nostra opus
est? Num eloquentia Platonem superare possumus? Evolve diligenter eius eum
librum, qui est de animo: amplius quod desideres nihil erit. Feci
mehercule, et quidem saepius; sed nescio quo modo, dum lego,
adsentior, cum posui librum et mecum ipse de inmortalitate animorum coepi
cogitare, adsensio omnis illa elabitur. Quid? Hoc dasne aut manere animos
post mortem aut morte ipsa interire? Do vero. Quid, si maneant? Beatos
esse concedo. Sin intereant? Non esse miseros, quoniam ne sint quidem; iam
istuc coacti a te paulo ante concessimus. Quo modo igitur aut cur mortem malum
tibi videri dicis? Quae aut beatos nos efficiet, animis manentibus,
aut non miseros sensu carentis.
XII. Expone igitur, nisi molestum est,
primum, si potes, animos remanere post mortem, tum, si
minus id obtinebis —est enim arduum—, docebis carere omni malo mortem. Ego
enim istuc ipsum vereor ne malum sit non dico carere sensu, sed carendum
esse. Auctoribus quidem ad istam sententiam, quam vis obtineri, uti
optimis possumus, quod in omnibus causis et debet et solet valere
plurimum, et primum quidem omni antiquitate, quae quo propius aberat
ab ortu et divina progenie, hoc melius ea fortasse quae erant vera
cernebant. Itaque unum illud erat insitum priscis illis,
quos cascos
appellat Ennius, esse in morte sensum neque excessu vitae sic deleri
hominem, ut funditus interiret; idque cum multis aliis rebus, tum e
pontificio iure et e caerimoniis sepulcrorum intellegi licet, quas maxumis
ingeniis praediti nec tanta cura coluissent nec violatas tam inexpiabili
religione sanxissent, nisi haereret in eorum mentibus mortem non interitum
esse omnia tollentem atque delentem, sed quandam quasi migrationem
commutationemque vitae, quae in claris viris et feminis dux in caelum
soleret esse, in ceteris humi retineretur et permaneret tamen. Ex hoc et
nostrorum opinione
Romulus in caelo cum diis agit aevum,
ut famae adsentiens dixit Ennius, et apud
Graecos indeque perlapsus ad nos et usque ad Oceanum Hercules tantus et tam
praesens habetur deus; hinc Liber Semela natus eademque famae celebritate
Tyndaridae fratres, qui non modo adiutores in proeliis victoriae populi
Romani, sed etiam nuntii fuisse perhibentur. Quid? Ino Cadmi filia nonne
Leukothea nominata a Graecis Matuta habetur a nostris? Quid? Totum prope caelum,
ne pluris persequar, nonne humano genere completum est?
XIII. Si vero scrutari vetera et ex is ea quae
scriptores Graeciae prodiderunt eruere coner, ipsi illi maiorum gentium
dii qui habentur hinc nobis profecti in caelum reperientur. Quaere, quorum
demonstrentur sepulcra in Graecia; reminiscere, quoniam es initiatus,
quae tradantur mysteriis: tum denique, quam hoc late pateat,
intelleges. Sed qui nondum ea quae multis post annis (homines) tractare
coepissent physica didicissent, tantum sibi persuaserant, quantum
natura admonente cognoverant, rationes et causas rerum non tenebant,
visis quibusdam saepe movebantur, iisque maxime nocturnis, ut vide
rentur ei, qui vita excesserant, vivere. Ut porro firmissimum hoc
adferri videtur cur deos esse credamus, quod nulla gens tam fera,
nemo omnium tam sit inmanis, cuius mentem non imbuerit deorum opinio
(multi de diis prava sentiunt —id enim vitioso more effici solet — omnes tamen
esse vim et naturam divinam arbitrantur, nec vero id conlocutio hominum
aut consessus efficit, non institutis opinio est confirmata, non
legibus; omni autem in re consensio omnium gentium lex naturae putanda est)
—quis est igitur, qui suorum mortem primum non eo lugeat, quod eos
orbatos vitae commodis arbitretur? Tolle hanc opinionem, luctum
sustuleris. Nemo enim maeret suo incommodo: dolent fortasse et anguntur,
sed illa lugubris lamentatio fletusque maerens ex eo est, quod eum,
quem dileximus, vitae commodis privatum arbitramur idque sentire. Atque
haec ita sentimus, natura duce, nulla ratione nullaque doctrina.
XIV. Maxumum vero argumentum est naturam ipsam de
inmortalitate animorum tacitam iudicare, quod omnibus curae sunt, et
maxumae quidem, quae post mortem futura sint. 'serit arbores, quae
alteri saeclo prosint', ut ait (Statius) in Synephebis, quid
spectans nisi etiam postera saecula ad se pertinere? Ergo arbores seret diligens
agricola, quarum aspiciet bacam ipse numquam; vir magnus leges,
instituta, rem publicam non seret? Quid procreatio liberorum, quid
propagatio nominis, quid adoptationes filiorum, quid testamentorum
diligentia, quid ipsa sepulcrorum monumenta, elogia significant nisi
nos futura etiam cogitare? Quid? Illud num dubitas, quin specimen naturae
capi deceat ex optima quaque natura? Quae est melior igitur in hominum genere
natura quam eorum, qui se natos ad homines iuvandos, tutandos,
conservandos, arbitrantur? Abiit ad deos Hercules: numquam abisset,
nisi, cum inter homines esset, eam sibi viam munivisset. Vetera iam
ista et religione omnium consecrata:
XV. Quid in hac re publica tot tantosque viros ob
rem publicam interfectos cogitasse arbitramur? Iisdemne ut finibus nomen suum
quibus vita terminaretur? Nemo umquam sine magna spe inmortalitatis se pro
patria offerret ad mortem. Licuit esse otioso Themistocli, licuit
Epaminondae, licuit, ne et vetera et externa quaeram, mihi;
sed nescio quo modo inhaeret in mentibus quasi saeclorum quoddam augurium
futurorum, idque in maximis ingeniis altissimisque animis et existit
maxime et apparet facillime. Quo quidem dempto, quis tam esset amens,
qui semper in laboribus et periculis viveret? loquor de principibus; quid? Poetae nonne post mortem nobilitari volunt? Unde
ergo illud:
Aspicite, o cives, senis Enni
imaginis
formam:
Hic vestrum panxit maxima facta patrum?
Mercedem gloriae flagitat ab iis quorum patres
adfecerat gloria, idemque:
Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu Faxit.
Cur? Volito vivos per ora virum.
Sed quid poetas? Opifices post mortem nobilitari
volunt. Quid enim Phidias sui similem speciem inclusit in clupeo Minervae,
cum inscribere (nomen) non liceret? Quid? Nostri philosophi nonne in is libris
ipsis, quos scribunt de contemnenda gloria, sua nomina inscribunt?
Quodsi omnium consensus naturae vox est, omnesque qui ubique sunt
consentiunt esse aliquid, quod ad eos pertineat qui vita cesserint,
nobis quoque idem existimandum est, et si, quorum aut ingenio aut
virtute animus excellit, eos arbitrabimur, quia natura optima sint,
cernere naturae vim maxume, veri simile est, cum optumus quisque
maxume posteritati serviat, esse aliquid, cuius is post mortem
sensum sit habiturus.
XVI. Sed ut deos esse natura opinamur,
qualesque sint, ratione cognoscimus, sic permanere animos arbitramur
consensu nationum omnium, qua in sede maneant qualesque sint,
ratione discendum est. Cuius ignoratio finxit inferos easque formidines,
quas tu contemnere non sine causa videbare. In terram enim cadentibus corporibus
isque humo tectis, e quo dictum est humari, sub terra censebant
reliquam vitam agi mortuorum; quam eorum opinionem magni errores consecuti sunt,
quos auxerunt poetae. Frequens enim consessus theatri, in quo sunt
mulierculae et pueri, movetur audiens tam grande carmen:
Adsum atque advenio Acherunte vix via alta atque
ardua
Per speluncas saxis structas asperis pendentibus
Maxumis, ubi rigida constat crassa caligo inferum,
tantumque valuit error —qui mihi quidem iam
sublatus videtur —, ut, corpora cremata cum scirent, tamen ea
fieri apud inferos fingerent, quae sine corporibus nec fieri possent nec
intellegi. Animos enim per se ipsos viventis non poterant mente complecti,
formam aliquam figuramque quaerebant. Inde Homeri tota νέκυια,
inde ea quae meus amicus Appius νεκυομαντεῖα faciebat,
inde in vicinia nostra Averni lacus,
unde animae excitantur obscura umbra opertae,
imagines
mortuorum, alto ostio Acheruntis, falso sanguine.
Has tamen imagines loqui volunt, quod fieri
nec sine lingua nec sine palato nec sine faucium, laterum, pulmonum
vi et figura potest. Nihil enim animo videre poterant, ad oculos omnia
referebant. Magni autem est ingenii sevocare mentem a sensibus et cogitationem
ab consuetudine abducere. Itaque credo equidem etiam alios tot saeculis,
sed quod litteris exstet, Pherecydes Syrius primus dixit animos esse
hominum sempiternos, antiquus sane; fuit enim meo regnante gentili. Hanc
opinionem discipulus eius Pythagoras maxime confirmavit, qui cum Superbo
regnante in Italiam venisset, tenuit Magnam illam Graeciam cum [honore]
disciplinae, tum etiam auctoritate, multaque saecula postea sic
viguit Pythagoreorum nomen, ut nulli alii docti viderentur.
XVII. Sed redeo ad antiquos. Rationem illi
sententiae suae non fere reddebant, nisi quid erat numeris aut
descriptionibus explicandum: Platonem ferunt, ut Pythagoreos cognosceret,
in Italiam venisse et didicisse Pythagorea omnia primumque de animorum
aeternitate, non solum sensisse idem quod Pythagoram, sed rationem
etiam attulisse. Quam, nisi quid dicis, praetermittamus et hanc
totam spem inmortalitatis relinquamus. An tu cum me in summam exspectationem
adduxeris, deseris? Errare mehercule malo cum Platone, quem tu
quanti facias scio et quem ex tuo ore admiror, quam cum istis vera
sentire. Macte virtute! ego enim ipse cum eodem ipso non invitus erraverim. Num
igitur dubitamus —an sicut pleraque— quamquam hoc quidem minime; persuadent enim
mathematici terram in medio mundo sitam ad universi caeli complexum quasi puncti
instar optinere, quod κέντρον illi vocant; eam
porro naturam esse quattuor omnia gignentium corporum, ut, quasi
partita habeant inter se ac divisa momenta, terrena et umida suopte nutu
et suo pondere ad paris angulos in terram et in mare ferantur, reliquae
duae partes, una ignea, altera animalis, ut illae superiores
in medium locum mundi gravitate ferantur et pondere, sic hae rursum rectis
lineis in caelestem locum subvolent, sive ipsa natura superiora adpetente
sive quod a gravioribus leviora natura repellantur. Quae cum constent,
perspicuum debet esse animos, cum e corpore excesserint, sive illi
sint animales, id est spirabiles, sive ignei, sublime ferri.
Si vero aut numerus quidam sit animus, quod subtiliter magis quam
dilucide dicitur, aut quinta illa non nominata magis quam non intellecta
natura, multo etiam integriora ac puriora sunt, ut a terra
longissime se ecferant. Horum igitur aliquid animus, ne tam vegeta mens
aut in corde cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat.
XVIII. Dicaearchum vero cum Aristoxeno aequali et
condiscipulo suo, doctos sane homines, omittamus; quorum alter ne
condoluisse quidem umquam videtur, qui animum se habere non sentiat,
alter ita delectatur suis cantibus, ut eos etiam ad haec transferre
conetur. Harmonian autem ex intervallis sonorum nosse possumus, quorum
varia compositio etiam harmonias efficit plures; membrorum vero situs et figura
corporis vacans animo quam possit harmoniam efficere, non video. Sed hic
quidem, quamvis eruditus sit, sicut est, haec magistro
concedat Aristoteli, canere ipse doceat; bene enim
illo Graecorum
proverbio praecipitur: 'quam quisque norit artem, in hac se exerceat.'
illam vero funditus eiciamus individuorum corporum levium et rutundorum
concursionem fortuitam, quam tamen Democritus concalefactam et spirabilem,
id est animalem, esse volt. Is autem animus, qui, si est horum
quattuor generum, ex quibus omnia constare dicuntur, ex inflammata
anima constat, ut potissimum videri video Panaetio, superiora
capessat necesse est. Nihil enim habent haec duo genera proni et supera semper
petunt. Ita, sive dissipantur, procul a terris id evenit, sive
permanent et conservant habitum suum, hoc etiam magis necesse est ferantur
ad caelum et ab is perrumpatur et dividatur crassus hic et concretus aer,
qui est terrae proximus. Calidior est enim vel potius ardentior animus quam est
hic aer, quem modo dixi crassum atque concretum; quod ex eo sciri potest,
quia corpora nostra terreno principiorum genere confecta ardore animi
concalescunt.
XIX. Accedit ut eo facilius animus evadat ex hoc
aere, quem saepe iam appello, eumque perrumpat, quod nihil est
animo velocius, nulla est celeritas quae possit cum animi celeritate
contendere. Qui si permanet incorruptus suique similis, necesse est ita
feratur, ut penetret et dividat omne caelum hoc, in quo nubes,
imbres, ventique coguntur, quod et umidum et caliginosum est propter
exhalationes terrae. Quam regionem cum superavit animus naturamque sui similem
contigit et adgnovit, iunctis ex anima tenui
et ex ardore solis temperato
ignibus, insistit et finem altius se ecferendi facit. Cum enim sui similem
et levitatem et calorem adeptus (est), tamquam paribus examinatus
ponderibus nullam in partem movetur, eaque ei demum naturalis est sedes,
cum ad sui simile penetravit; in quo nulla re egens aletur et sustentabitur
iisdem rebus, quibus astra sustentantur et aluntur. Cumque corporis
facibus inflammari soleamus ad omnis fere cupiditates eoque magis incendi,
quod iis aemulemur, qui ea habeant quae nos habere cupiamus,
profecto beati erimus, cum corporibus relictis et cupiditatum et
aemulationum erimus expertes; quodque nunc facimus, cum laxati curis
sumus, ut spectare aliquid velimus et visere, id multo tum faciemus
liberius totosque nos in contemplandis rebus perspiciendisque ponemus,
propterea quod et natura inest in mentibus nostris insatiabilis quaedam
cupiditas veri videndi et orae ipsae locorum illorum, quo pervenerimus,
quo faciliorem nobis cognitionem rerum caelestium, eo maiorem cognoscendi
cupiditatem dabant. Haec enim pulchritudo etiam in terris 'patritam' illam et
'avitam', ut ait Theophrastus, philosophiam cognitionis cupiditate
incensam excitavit. Praecipue vero fruentur ea, qui tum etiam, cum
has terras incolentes circumfusi erant caligine, tamen acie mentis
dispicere cupiebant.
XX. Etenim si nunc aliquid adsequi se putant,
qui ostium Ponti viderunt et eas angustias, per quas penetravit ea quae
est nominata
Argo, quia
Argivi in ea delecti viri
Vecti petebant pellem inauratam arietis,
aut ii qui Oceani freta illa viderunt,
'Europam Libyamque rapax ubi dividit unda', quod tandem spectaculum fore
putamus, cum totam terram contueri licebit eiusque cum situm,
formam, circumscriptionem, tum et habitabiles regiones et rursum
omni cultu propter vim frigoris aut caloris vacantis? Nos
enim ne nunc quidem oculis cernimus ea quae videmus; neque est enim ullus sensus
in corpore, sed, ut non physici solum docent verum etiam medici,
qui ista aperta et patefacta viderunt, viae quasi quaedam sunt ad oculos,
ad auris, ad naris a sede animi perforatae. Itaque saepe aut cogitatione
aut aliqua vi morbi impediti apertis atque integris et oculis et auribus nec
videmus, nec audimus, ut facile intellegi possit animum et videre et
audire, non eas partis quae quasi fenestrae sint animi, quibus tamen
sentire nihil queat mens, nisi id agat et adsit. Quid, quod eadem
mente res dissimillimas comprendimus, ut colorem, saporem,
calorem, odorem, sonum? Quae numquam quinque nuntiis animus
cognosceret, nisi ad eum omnia referrentur et is omnium iudex solus esset.
Atque ea profecto tum multo puriora et dilucidiora cernentur, cum,
quo natura fert, liber animus pervenerit. Nam nunc
quidem, quamquam foramina illa, quae patent ad animum a corpore,
callidissimo artificio natura fabricata est, tamen terrenis concretisque
corporibus sunt intersaepta quodam modo: cum autem nihil erit praeter animum,
nulla res obiecta impediet, quo minus percipiat, quale quidque sit.
XXI. Quamvis copiose haec diceremus, si res
postularet, quam multa, quam varia, quanta spectacula animus
in locis caelestibus esset habiturus. Quae quidem
cogitans soleo saepe mirari non nullorum insolentiam philosophorum, qui
naturae cognitionem admirantur eiusque inventori et principi gratias exultantes
agunt eumque venerantur ut deum; liberatos enim se per eum dicunt gravissimis
dominis, terrore sempiterno, et diurno ac nocturno metu. Quo
terrore? Quo metu? Quae est anus tam delira quae timeat ista, quae vos
videlicet, si physica non didicissetis, timeretis, 'Acherunsia
templa alta Orci, pallida leti, nubila tenebris loca'? Non pudet
philosophum in eo gloriari, quod haec non timeat et quod falsa esse
cognoverit? E quo intellegi potest, quam acuti natura sint, quoniam
haec sine doctrina credituri fuerunt. Praeclarum autem
nescio quid adepti sunt, quod didicerunt se, cum tempus mortis
venisset, totos esse perituros. Quod ut ita sit —nihil enim pugno —,
quid habet ista res aut laetabile aut gloriosum? Nec tamen mihi sane quicquam
occurrit, cur non Pythagorae sit et Platonis vera sententia. Ut enim
rationem Plato nullam adferret —vide, quid homini tribuam —, ipsa
auctoritate me frangeret: tot autem rationes attulit, ut velle ceteris,
sibi certe persuasisse videatur.
XXII. Sed plurimi contra nituntur animosque quasi
capite damnatos morte multant, neque aliud est quicquam cur incredibilis
is animorum videatur aeternitas, nisi quod nequeunt qualis animus sit
vacans corpore intellegere et cogitatione comprehendere. Quasi vero intellegant,
qualis sit in ipso corpore, quae conformatio, quae magnitudo,
qui locus; ut, si iam possent in homine vivo cerni omnia quae nunc tecta
sunt, casurusne in conspectum videatur animus, an tanta sit eius
tenuitas, ut fugiat aciem? Haec reputent isti qui
negant animum sine corpore se intellegere posse: videbunt, quem in ipso
corpore intellegant. Mihi quidem naturam animi intuenti multo difficilior
occurrit cogitatio, multo obscurior, qualis animus in corpore sit
tamquam alienae domi, quam qualis, cum exierit et in liberum caelum
quasi domum suam venerit. Si enim, quod numquam vidimus, id quale
sit intellegere non possumus, certe et deum ipsum et divinum animum
corpore liberatum cogitatione complecti possumus. Dicaearchus quidem et
Aristoxenus, quia difficilis erat animi quid aut qualis esset
intellegentia, nullum omnino animum esse dixerunt.
Est illud quidem vel maxumum animo ipso animum videre, et nimirum hanc
habet vim praeceptum Apollinis, quo monet ut se quisque noscat. Non enim
credo id praecipit, ut membra nostra aut staturam figuramve noscamus;
neque nos corpora sumus, nec ego tibi haec dicens corpori tuo dico. Cum
igitur 'nosce te' dicit, hoc dicit: 'nosce animum tuum.' nam corpus quidem
quasi vas est aut aliquod animi receptaculum; ab animo tuo quicquid agitur,
id agitur a te. Hunc igitur nosse nisi divinum esset, non esset hoc
acrioris cuiusdam animi praeceptum tributum deo. Sed si,
qualis sit animus, ipse animus nesciet, dic quaeso, ne esse
quidem se sciet, ne moveri quidem se? Ex quo illa ratio nata est Platonis,
quae a Socrate est in Phaedro explicata,
a me autem posita est in sexto
libro de re publica:
XXIII. 'Quod semper movetur, aeternum est;
quod autem motum adfert alicui quodque ipsum agitatur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est. Solum igitur,
quod se ipsum movet, quia numquam deseritur a se, numquam ne moveri
quidem desinit; quin etiam ceteris quae moventur hic fons, hoc principium
est movendi. Principii autem nulla est origo; nam e
principio oriuntur omnia, ipsum autem nulla ex re alia nasci potest; nec
enim esset id principium, quod gigneretur aliunde. Quod si numquam oritur,
ne occidit quidem umquam; nam principium extinctum nec ipsum ab alio renascetur,
nec ex se aliud creabit, siquidem necesse est a principio oriri omnia. Ita
fit, ut motus principium ex eo sit, quod ipsum a se movetur; id
autem nec nasci potest nec mori, vel concidat omne caelum omnisque natura
<et> consistat necesse est nec vim ullam nanciscatur, qua a primo inpulsa
moveatur. Cum pateat igitur aeternum id esse, quod se ipsum moveat,
quis est qui hanc naturam animis esse tributam neget? Inanimum est enim omne,
quod pulsu agitatur externo; quod autem est animal, id motu cietur
interiore et suo; nam haec est propria natura animi atque vis. Quae si est una
ex omnibus quae se ipsa [semper] moveat, neque nata certe est et aeterna
est'. Licet concurrant omnes plebei philosophi —sic enim
ii, qui a Platone et Socrate et ab ea familia dissident, appellandi
videntur —, non modo nihil umquam tam eleganter explicabunt, sed ne
hoc quidem ipsum quam subtiliter conclusum sit intellegent. Sentit igitur animus
se moveri; quod cum sentit, illud una sentit, se vi sua, non
aliena moveri, nec accidere posse ut ipse umquam a se deseratur. Ex quo
efficitur aeternitas, nisi quid habes ad haec. Ego vero facile sim passus
ne in mentem quidem mihi aliquid contra venire; ita isti faveo sententiae.
XXIV. Quid? Illa tandem num leviora censes,
quae declarant inesse in animis hominum divina quaedam? Quae si cernerem quem ad
modum nasci possent, etiam quem ad modum interirent viderem. Nam
sanguinem, bilem, pituitam, ossa, nervos, venas,
omnem denique membrorum et totius corporis figuram videor posse dicere unde
concreta et quo modo facta sint: animum ipsum —si nihil esset in eo nisi id,
ut per eum viveremus, tam natura putarem hominis vitam sustentari quam
vitis, quam arboris; haec enim etiam dicimus vivere. Item si nihil haberet
animus hominis nisi ut appeteret aut fugeret, id quoque esset ei commune
cum bestiis. Habet primum memoriam, et eam
infinitam rerum innumerabilium. Quam quidem Plato recordationem esse volt vitae
superioris. Nam in illo libro, qui inscribitur Menon, pusionem
quendam Socrates interrogat quaedam geometrica de dimensione quadrati. Ad ea sic
ille respondet ut puer, et tamen ita faciles interrogationes sunt,
ut gradatim respondens eodem perveniat, quo si geometrica didicisset. Ex
quo effici volt Socrates, ut discere nihil aliud sit nisi recordari. Quem
locum multo etiam accuratius explicat in eo sermone, quem habuit eo ipso
die, quo excessit e vita; docet enim quemvis, qui omnium rerum rudis
esse videatur, bene interroganti respondentem declarare se non tum illa
discere, sed reminiscendo recognoscere, nec vero fieri ullo modo
posse, ut a pueris tot rerum atque tantarum insitas et quasi consignatas
in animis notiones, quas ennoias vocant, haberemus, nisi
animus, ante quam in corpus intravisset, in rerum cognitione
viguisset. Cumque nihil esset, ut omnibus locis a Platone
disseritur —nihil enim putat esse, quod oriatur et intereat, idque
solum esse, quod semper tale sit quale est, (ἰδέαν
appellat ille, nos speciem) —, non potuit animus haec in corpore
inclusus adgnoscere, cognita attulit; ex quo tam multarum rerum
cognitionis admiratio tollitur. Neque ea plane videt animus, cum repente
in tam insolitum tamque perturbatum domicilium inmigravit, sed cum se
collegit atque recreavit, tum adgnoscit illa reminiscendo. Ita nihil est
aliud discere nisi recordari. Ego autem maiore etiam
quodam modo memoriam admiror. Quid est enim illud quo meminimus, aut quam
habet vim aut unde naturam? Non quaero,
quanta memoria Simonides fuisse
dicatur, quanta Theodectes, quanta is, qui a Pyrrho legatus ad
senatum est missus, Cineas, quanta nuper
Charmadas, quanta,
qui modo fuit, Scepsius Metrodorus, quanta noster Hortensius: de
communi hominum memoria loquor, et eorum maxume qui in aliquo maiore
studio et arte versantur, quorum quanta mens sit, difficile est
existimare; ita multa meminerunt.
XXV. Quorsus igitur haec spectat oratio? Quae sit
illa vis et unde sit, intellegendum puto. Non est certe nec cordis,
nec sanguinis, nec cerebri, nec atomorum; animae sit ignisne nescio,
nec me pudet ut istos fateri nescire quod nesciam: illud, si ulla alia de
re obscura adfirmare possem, sive anima sive ignis sit animus, eum
iurarem esse divinum. Quid enim, obsecro te, terrane tibi hoc
nebuloso et caliginoso caelo aut sata aut concreta videtur tanta vis memoriae?
Si quid sit hoc non vides, at quale sit vides; si ne id quidem, at
quantum sit profecto vides. Quid igitur? Utrum
capacitatem aliquam in animo putamus esse, quo tamquam in aliquod vas ea,
quae meminimus, infundantur? Absurdum id quidem; qui enim fundus aut quae
talis animi figura intellegi potest aut quae tanta omnino capacitas? An inprimi
quasi ceram animum putamus, et esse memoriam signatarum rerum in mente
vestigia? Quae possunt verborum, quae rerum ipsarum esse vestigia,
quae porro tam inmensa magnitudo, quae illa tam multa possit effingere?
Quid? Illa vis quae tandem est quae investigat occulta, quae inventio
atque excogitatio dicitur? Ex hacne tibi terrena mortalique natura et caduca
concreta ea videtur? Aut qui primus, quod summae sapientiae Pythagorae
visum est, omnibus rebus imposuit nomina? Aut qui dissipatos homines
congregavit et ad societatem vitae convocavit, aut qui sonos vocis,
qui infiniti videbantur, paucis litterarum notis terminavit, aut qui
errantium stellarum cursus, praegressiones, institutiones notavit?
Omnes magni; etiam superiores, qui fruges, qui vestitum, qui
tecta, qui cultum vitae, qui praesidia contra feras invenerunt,
a quibus mansuefacti et exculti a necessariis artificiis ad elegantiora
defluximus. Nam et auribus oblectatio magna parta est inventa et temperata
varietate et natura sonorum, et astra suspeximus cum ea quae sunt infixa
certis locis, tum illa non re sed vocabulo errantia, quorum
conversiones omnisque motus qui animo vidit, is docuit similem animum suum
eius esse, qui ea fabricatus esset in caelo. Nam
cum Archimedes lunae, solis, quinque errantium motus in sphaeram
inligavit, effecit idem quod ille, qui in Timaeo mundum aedificavit,
Platonis deus, ut tarditate et celeritate dissimillimos motus una regeret
conversio. Quod si in hoc mundo fieri sine deo non potest, ne in sphaera
quidem eosdem motus Archimedes sine divino ingenio potuisset imitari.
XXVI. Mihi vero ne haec quidem notiora et
inlustriora carere vi divina videntur, ut ego aut poetam grave plenumque
carmen sine caelesti aliquo mentis instinctu putem fundere, aut
eloquentiam sine maiore quadam vi fluere abundantem sonantibus verbis
uberibusque sententiis. Philosophia vero, omnium mater artium, quid
est aliud nisi, ut Plato, donum, ut ego, inventum
deorum? Haec nos primum ad illorum cultum, deinde ad ius hominum,
quod situm est in generis humani societate, tum ad modestiam
magnitudinemque animi erudivit, eademque ab animo tamquam ab oculis
caliginem dispulit, ut omnia supera, infera, prima,
ultima, media videremus. Prorsus haec divina mihi
videtur vis, quae tot res efficiat et tantas. Quid est enim memoria rerum
et verborum? Quid porro inventio? Profecto id, quo ne in deo quidem
quicquam maius intellegi potest. Non enim ambrosia deos aut nectare aut
Iuventate pocula ministrante laetari arbitror, nec Homerum audio,
qui Ganymeden ab dis raptum ait propter formam, ut Iovi bibere
ministraret; non iusta causa, cur Laomedonti tanta fieret iniuria.
Fingebat haec Homerus et humana ad deos transferebat: divina mallem ad nos. Quae
autem divina? Vigere, sapere, invenire, meminisse. Ergo animus
qui, ut ego dico, divinus est, ut Euripides dicere
audet, deus. Et quidem, si deus aut anima aut ignis est, idem
est animus hominis. Nam ut illa natura caelestis et terra vacat et umore,
sic utriusque harum rerum humanus animus est expers; sin autem est quinta
quaedam natura, ab Aristotele inducta primum, haec et deorum est et
animorum. Hanc nos sententiam secuti his ipsis verbis in Consolatione hoc
expressimus:
XXVII. 'Animorum nulla in terris origo inveniri
potest; nihil enim est in animis mixtum atque concretum aut quod ex terra natum
atque fictum esse videatur, nihil ne aut umidum quidem aut flabile aut
igneum. His enim in naturis nihil inest, quod vim memoriae, mentis,
cogitationis habeat, quod et praeterita teneat et futura provideat et
complecti possit praesentia. Quae sola divina sunt, nec invenietur umquam,
unde ad hominem venire possint nisi a deo. Singularis est igitur quaedam natura
atque vis animi seiuncta ab his usitatis notisque naturis. Ita, quicquid
est illud, quod sentit, quod sapit, quod vivit, quod
viget, caeleste et divinum ob eamque rem aeternum sit necesse est. Nec
vero deus ipse, qui intellegitur a nobis, alio modo intellegi potest
nisi mens soluta quaedam et libera, segregata ab omni concretione mortali,
omnia sentiens et movens ipsaque praedita motu sempiterno. Hoc e genere atque
eadem e natura est humana mens.' Ubi igitur aut qualis
est ista mens? —ubi tua aut qualis? Potesne dicere? An, si omnia ad
intellegendum non habeo quae habere vellem, ne iis quidem quae habeo mihi
per te uti licebit? Non valet tantum animus, ut se ipse videat, at
ut oculus, sic animus se non videns, alia cernit. Non videt autem,
quod minimum est, formam suam (quamquam fortasse id quoque, sed
relinquamus); vim certe, sagacitatem, memoriam, motum,
celeritatem videt. Haec magna, haec divina, haec sempiterna sunt;
qua facie quidem sit aut ubi habitet, ne quaerendum quidem est.
XXVIII. Ut cum videmus speciem primum candoremque
caeli, dein conversionis celeritatem tantam quantam cogitare non possumus,
tum vicissitudines dierum ac noctium commutationesque temporum quadrupertitas ad
maturitatem frugum et ad temperationem corporum aptas eorumque omnium
moderatorem et ducem solem, lunamque adcretione et deminutione luminis
quasi fastorum notantem et significantem dies, tum in eodem orbe in
duodecim partes distributo, quinque stellas ferri eosdem cursus
constantissime servantis disparibus inter se motibus, nocturnamque caeli
formam undique sideribus ornatam, tum globum terrae eminentem e mari,
fixum in medio mundi universi loco, duabus oris distantibus habitabilem et
cultum, quarum altera, quam nos incolimus,
Sub axe posita ad stellas septem, unde
horrifer,
Aquilonis stridor gelidas molitur nives,
altera australis, ignota nobis, quam
vocant Graeci ἀντίχθονα, ceteras
partis incultas, quod aut frigore rigeant aut urantur calore; hic autem,
ubi habitamus, non intermittit suo tempore
Caelum nitescere, arbores frondescere,
Vites laetificae pampinis pubescere,
Rami bacarum ubertate incurvescere,
Segetes largiri fruges, florere omnia,
Fontes scatere, herbis prata convestirier,
tum multitudinem pecudum partim ad vescendum,
partim ad cultus agrorum, partim ad vehendum, partim ad corpora
vestienda, hominemque ipsum quasi contemplatorem caeli ac deorum cultorem
atque hominis utilitati agros omnis et maria parentia —:
haec igitur et alia innumerabilia cum cernimus, possumusne dubitare quin
iis praesit aliquis vel effector, si haec nata sunt, ut Platoni
videtur, vel, si semper fuerunt, ut Aristoteli placet,
moderator tanti operis et muneris? Sic mentem hominis, quamvis eam non
videas, ut deum non vides, tamen, ut deum adgnoscis ex
operibus eius, sic ex memoria rerum et inventione et celeritate motus
omnique pulchritudine virtutis vim divinam mentis adgnoscito.
XXIX. In quo igitur loco est? Credo equidem in
capite, et cur credam adferre possum. Sed alias, ubi sit animus;
certe quidem in te est. Quae est ei natura? Propria, puto, et sua.
Sed fac igneam, fac spirabilem: nihil ad id de quo agimus. Illud modo
videto, ut deum noris, etsi eius ignores et locum et faciem,
sic animum tibi tuum notum esse oportere, etiamsi ignores et locum et
formam. In animi autem cognitione dubitare non possumus,
nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil sit animis admixtum,
nihil concretum, nihil copulatum, nihil coagmentatum, nihil
duplex: quod cum ita sit, certe nec secerni, nec dividi, nec
discerpi, nec distrahi potest, ne interire (quidem) igitur. Est enim
interitus quasi discessus et secretio ac diremptus earum partium, quae
ante interitum iunctione aliqua tenebantur. His et talibus rationibus adductus
Socrates nec patronum quaesivit ad iudicium capitis nec iudicibus supplex fuit
adhibuitque liberam contumaciam a magnitudine animi ductam, non a
superbia, et supremo vitae die de hoc ipso multa disseruit et paucis ante
diebus, cum facile posset educi e custodia, noluit, et tum,
paene in manu iam mortiferum illud tenens poculum, locutus ita est,
ut non ad mortem trudi, verum in caelum videretur escendere.
XXX. Ita enim censebat itaque disseruit,
duas esse vias duplicesque cursus animorum e corpore excedentium: nam qui se
humanis vitiis contaminavissent et se totos libidinibus dedissent, quibus
caecati vel domesticis vitiis atque flagitiis se inquinavissent vel, re
publica violanda, fraudes inexpiabiles concepissent, iis devium
quoddam iter esse, seclusum a concilio deorum; qui autem se integros
castosque servavissent, quibusque fuisset minima cum corporibus contagio
seseque ab is semper sevocavissent essentque in corporibus humanis vitam imitati
deorum, iis ad illos a quibus essent profecti reditum facilem patere.
Itaque commemorat, ut cygni, qui non sine causa Apollini
dicati sint, sed quod ab eo divinationem habere videantur, qua
providentes quid in morte boni sit cum cantu et voluptate moriantur, sic
omnibus bonis et doctis esse faciendum. (nec vero de hoc quisquam dubitare
posset, nisi idem nobis accideret diligenter de animo cogitantibus,
quod iis saepe usu venit, qui cum acriter oculis deficientem solem
intuerentur, ut aspectum omnino amitterent; sic mentis acies se ipsa
intuens non numquam hebescit, ob eamque causam contemplandi diligentiam
amittimus. Itaque dubitans, circumspectans, haesitans, multa
adversa reverens tamquam in rate in mari inmenso nostra vehitur oratio).
Sed haec et vetera et a Graecis; Cato autem sic abiit e vita, ut
causam moriendi nactum se esse gauderet. Vetat enim dominans ille in nobis deus
iniussu hinc nos suo demigrare; cum vero causam iustam deus ipse dederit,
ut tunc Socrati, nunc Catoni, saepe multis, ne ille me Dius
Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit, nec
tamen ille vincla carceris ruperit —leges enim vetant —, sed tamquam a
magistratu aut ab aliqua potestate legitima, sic a deo evocatus atque
emissus exierit. Tota enim philosophorum vita, ut ait idem,
commentatio mortis est.
XXXI. Nam quid aliud agimus, cum a
voluptate, id est a corpore, cum a re familiari, quae est
ministra et famula corporis, cum a re publica, cum a negotio omni
sevocamus animum, quid, inquam, tum agimus nisi animum ad se
ipsum advocamus, secum esse cogimus maximeque a corpore abducimus?
Secernere autem a corpore animum, nec quicquam aliud, est mori
discere. Quare hoc commentemur, mihi crede, disiungamusque nos a
corporibus, id est consuescamus mori. Hoc, et dum erimus in terris,
erit illi caelesti vitae simile, et cum illuc ex his vinclis emissi
feremur, minus tardabitur cursus animorum. Nam qui in compedibus corporis
semper fuerunt, etiam cum soluti sunt, tardius ingrediuntur,
ut ii qui ferro vincti multos annos fuerunt. Quo cum venerimus, tum
denique vivemus. Nam haec quidem vita mors est, quam lamentari possem,
si liberet. Satis tu quidem in Consolatione es
lamentatus; quam cum lego, nihil malo quam has res relinquere, his
vero modo auditis, multo magis. Veniet tempus, et quidem celeriter,
sive retractabis, sive properabis; volat enim aetas. Tantum autem abest ab
eo ut malum mors sit, quod tibi dudum videbatur, ut verear ne homini
nihil sit non malum aliud certius, nihil bonum aliud potius, si
quidem vel di ipsi vel cum dis futuri sumus Quid refert? Adsunt enim, qui
haec non probent. Ego autem numquam ita te in hoc sermone dimittam, ulla
uti ratione mors tibi videri malum possit. Qui potest, cum ista
cognoverim? Qui possit, rogas? Catervae veniunt contra dicentium,
nec solum Epicureorum, quos equidem non despicio, sed nescio quo
modo doctissimus quisque contemnit, acerrume autem deliciae meae
Dicaearchus contra hanc inmortalitatem disseruit. Is enim tris libros scripsit,
qui Lesbiaci vocantur quod Mytilenis sermo habetur, in quibus volt
efficere animos esse mortalis. Stoici autem usuram nobis largiuntur tamquam
cornicibus: diu mansuros aiunt animos, semper negant.
XXXII. Num non vis igitur audire, cur,
etiamsi ita sit, mors tamen non sit in malis? Ut videtur, sed me
nemo de inmortalitate depellet. Laudo id quidem,
etsi nihil nimis oportet confidere; movemur enim saepe aliquo acute concluso,
labamus mutamusque sententiam clarioribus etiam in rebus; in his est enim aliqua
obscuritas. Id igitur si acciderit, simus armati. Sane quidem, sed
ne accidat, providebo. Num quid igitur est causae, quin amicos
nostros Stoicos dimittamus? Eos dico, qui aiunt manere animos, cum e
corpore excesserint, sed non semper. Istos vero qui, quod tota in
hac causa difficillimum est, suscipiant, posse animum manere corpore
vacantem, illud autem, quod non modo facile ad credendum est,
sed eo concesso, quod volunt, consequens, id vero non dant,
ut, cum diu permanserit, ne intereat. Bene
reprehendis, et se isto modo res habet. Credamus igitur Panaetio a Platone
suo dissentienti? Quem enim omnibus locis divinum, quem sapientissimum,
quem sanctissimum, quem Homerum philosophorum appellat, huius hanc
unam sententiam de inmortalitate animorum non probat. Volt enim, quod nemo
negat, quicquid natum sit interire; nasci autem animos, quod
declaret eorum similitudo qui procreentur, quae etiam in ingeniis,
non solum in corporibus appareat. Alteram autem adfert rationem, nihil
esse quod doleat, quin id aegrum esse quoque possit; quod autem in morbum
cadat, id etiam interiturum; dolere autem animos, ergo etiam
interire.
XXXIII. Haec refelli possunt: sunt enim
ignorantis, cum de aeternitate animorum dicatur, de mente dici,
quae omni turbido motu semper vacet, non de partibus iis, in quibus
aegritudines, irae, libidinesque versentur, quas is,
contra quem haec dicuntur, semotas a mente et disclusas putat. Iam
similitudo magis apparet in bestiis, quarum animi sunt rationis expertes;
hominum autem similitudo in corporum figura magis exstat, et ipsi animi
magni refert quali in corpore locati sint. Multa enim e corpore existunt,
quae acuant mentem, multa, quae obtundant.
Aristoteles quidem ait
omnis ingeniosos melancholicos esse, ut ego me tardiorem esse non moleste
feram. Enumerat multos, idque quasi constet, rationem cur ita fiat
adfert. Quod si tanta vis est ad habitum mentis in iis quae gignuntur in
corpore, ea sunt autem, quaecumque sunt, quae similitudinem
faciant, nihil necessitatis adfert, cur nascantur animi,
similitudo. Omitto dissimilitudines. Vellem adesse posset
Panaetius — vixit cum Africano —, quaererem ex eo, cuius suorum
similis fuisset Africani fratris nepos, facie vel patris, vita
omnium perditorum ita similis, ut esset facile deterrimus; cuius etiam
similis P.Crassi, et sapientis et eloquentis et primi hominis, nepos
multorumque aliorum clarorum virorum, quos nihil attinet nominare,
nepotes et filii. Sed quid agimus? Oblitine sumus hoc nunc nobis esse
propositum, cum satis de aeternitate dixissemus, ne si interirent
quidem animi, quicquam mali esse in morte? Ego vero memineram, sed
te de aeternitate dicentem aberrare a proposito facile patiebar.
XXXIV. Video te alte spectare et velle in caelum
migrare. Spero fore ut contingat id nobis. Sed fac, ut isti volunt,
animos non remanere post mortem: video nos, si ita sit, privari spe
beatioris vitae; mali vero quid adfert ista sententia? Fac enim sic animum
interire ut corpus: num igitur aliquis dolor aut omnino post mortem sensus in
corpore est? Nemo id quidem dicit, etsi Democritum insimulat Epicurus,
Democritii negant. Ne in animo quidem igitur sensus remanet; ipse enim nusquam
est. Ubi igitur malum est, quoniam nihil tertium est? An quod ipse animi
discessus a corpore non fit sine dolore? Ut credam ita esse, quam est id
exiguum! sed falsum esse arbitror, et fit plerumque sine sensu, non
numquam etiam cum voluptate, totum. Que hoc leve est, qualecumque
est; fit enim ad punctum temporis. 'Illud angit vel
potius excruciat, discessus ab omnibus iis quae sunt bona in vita'. Vide
ne 'a malis' dici verius possit. Quid ego nunc lugeam vitam hominum? Vere et
iure possum; sed quid necesse est, cum id agam ne post mortem miseros nos
putemus fore, etiam vitam efficere deplorando miseriorem? Fecimus hoc in
eo libro, in quo nosmet ipsos, quantum potuimus, consolati
sumus. A malis igitur mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus.
Et quidem hoc a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege
Ptolomaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, quod multi is
auditis mortem sibi ipsi consciscerent.
Callimachi quidem
epigramma in Ambraciotam Theombrotum est, quem ait, cum ei nihil
accidisset adversi, e muro se in mare abiecisse, lecto Platonis
libro. Eius autem, quem dixi, Hegesiae liber est
Ἀποκαρτερῶν, quo a vita quidem per inediam discedens revocatur ab
amicis; quibus respondens vitae humanae enumerat incommoda. Possem idem facere,
etsi minus quam ille, qui omnino vivere expedire nemini putat. Mitto
alios: etiamne nobis expedit? Qui et domesticis et forensibus solaciis
ornamentisque privati certe si ante occidissemus, mors nos a malis,
non a bonis abstraxisset.
XXXV.Sit igitur aliquis, qui nihil mali
habeat, nullum a fortuna volnus acceperit: Metellus ille honoratis
quattuor filiis aut quinquaginta Priamus, e quibus septemdecim iusta uxore
natis; in utroque eandem habuit fortuna potestatem, sed usa in altero est:
Metellum enim multi filii, filiae, nepotes, neptes in rogum
inposuerunt, Priamum tanta progenie orbatum, cum in aram
confugisset, hostilis manus interemit. Hic si vivis filiis incolumi regno
occidisset
astante ope barbarica
Tectis caelatis laqueatis,
utrum tandem a bonis an a malis discessisset? Tum
profecto videretur a bonis. At certe ei melius evenisset nec tam flebiliter illa
canerentur:
Haec omnia vidi inflammari,
Priamo vi vitam evitari,
Iovis aram sanguine turpari.
Quasi vero ista vi quicquam tum potuerit ei melius
accidere! quodsi ante occidisset, talem eventum omnino amisisset; hoc
autem tempore sensum amisit malorum. Pompeio,
nostro familiari, cum graviter aegrotaret Neapoli, melius est
factum. Coronati Neapolitani fuerunt, nimirum etiam Puteolani; volgo ex
oppidis publice gratulabantur: ineptum sane negotium et Graeculum, sed
tamen fortunatum. Utrum igitur, si tum esset extinctus, a bonis
rebus an a malis discessisset? Certe a miseris. Non enim cum socero bellum
gessisset, non inparatus arma sumpsisset, non domum reliquisset,
non ex Italia fugisset, non exercitu amisso nudus in servorum ferrum et
manus incidisset, non liberi defleti, non fortunae omnes a
victoribus possiderentur. Qui, si mortem tum obisset, in amplissimis
fortunis occidisset, is propagatione vitae quot, quantas, quam
incredibilis hausit calamitates!
XXXVI. Haec morte effugiuntur, etiamsi non
evenerunt, tamen, quia possunt evenire; sed homines ea sibi accidere
posse non cogitant: Metelli sperat sibi quisque fortunam, proinde quasi
aut plures fortunati sint quam infelices aut certi quicquam sit in rebus humanis
aut sperare sit prudentius quam timere. Sed hoc ipsum
concedatur, bonis rebus homines morte privari: ergo etiam carere mortuos
vitae commodis idque esse miserum? Certe ita dicant necesse est. An potest is,
qui non est, re ulla carere? Triste enim est nomen ipsum carendi,
quia subicitur haec vis: habuit, non habet; desiderat requirit indiget.
Haec, opinor, incommoda sunt carentis: caret oculis, odiosa
caecitas; liberis, orbitas. Valet hoc in vivis, mortuorum autem non
modo vitae commodis, sed ne vita quidem ipsa quisquam caret. De mortuis
loquor, qui nulli sunt: nos, qui sumus, num aut cornibus
caremus aut pinnis? Ecquis id dixerit? Certe nemo. Quid ita? Quia, cum id
non habeas quod tibi nec usu nec natura sit aptum, non careas,
etiamsi sentias te non habere. Hoc premendum etiam atque
etiam est et urguendum confirmato illo, de quo, si mortales animi
sunt, dubitare non possumus, quin tantus interitus in morte sit,
ut ne minima quidem suspicio sensus relinquatur —hoc igitur probe stabilito et
fixo illud excutiendum est, ut sciatur, quid sit carere, ne
relinquatur aliquid erroris in verbo. Carere igitur hoc significat: egere eo
quod habere velis; inest enim velle in carendo, nisi cum sic tamquam in
febri dicitur alia quadam notione verbi. Dicitur enim alio modo etiam carere,
cum aliquid non habeas et non habere te sentias, etiamsi id facile
patiare. (ita) carere in morte non dicitur; nec enim esset dolendum; dicitur
illud: 'bono carere', quod est malum. Sed ne vivus quidem bono caret,
si eo non indiget; sed in vivo intellegi tamen potest regno te carere —dici
autem hoc in te satis subtiliter non potest; posset in Tarquinio, cum
regno esset expulsus —: at in mortuo ne intellegi quidem. Carere enim sentientis
est; nec sensus in mortuo: ne carere quidem igitur in mortuo est.
XXXVII. Quamquam quid opus est in hoc
philosophari, cum rem non magnopere philosophia egere videamus? Quotiens
non modo ductores nostri, sed universi etiam exercitus ad non dubiam
mortem concurrerunt! quae quidem si timeretur, non Lucius Brutus arcens
eum reditu tyrannum, quem ipse expulerat, in proelio concidisset;
non cum Latinis decertans pater Decius, cum Etruscis filius, cum
Pyrrho nepos se hostium telis obiecissent; non uno bello pro patria cadentis
Scipiones Hispania vidisset, Paulum et Geminum Cannae, Venusia
Marcellum, Litana Albinum, Lucani Gracchum. Num quis horum miser
hodie? Ne tum quidem post spiritum extremum; nec enim potest esse miser
quisquam, sensu perempto. 'At id ipsum odiosum est,
sine sensu esse.' Odiosum, si id esset carere. Cum vero perspicuum sit
nihil posse in eo esse, qui ipse non sit, quid potest esse in eo
odiosum, qui nec careat nec sentiat? Quamquam hoc quidem nimis saepe,
sed eo, quod i hoc inest omnis animi constracto ex metu mortis. Qui enim
satis viderit, id quod est luce clarius, animo et corpore consumpto
totoque animante deleto et facto interitu universo illud animal, quod
fuerit, factum esse nihil, is plane perspiciet inter Hippocentaurum,
qui numquam fuerit, et regem Agamemnonem nihil interesse, nece
pluris nunc facere M. Camillum hoc civilie bellum, quam ego vivo illo
fecerim Romam captam. Cur igitur et Camillus doleret, si haec post
trecentos et quinquaginta fere annos eventura putaret, et ego doleam,
si ad decem milia annorum gentem aliquam urbe nostra potituram putem? Quia tanta
caritas partiae est, ut eam non sensu nostro, sed salute ipsius
metiamur.
XXXVIII. Itaque non deterret sapientem mors, quae
propter incertos casus cotidie imminet, propter brevitatem vitae numquam potest
longe abesse, quo minus in omne tempus rei p. Suisque consulat, cum posteritatem
ipsam, cuius sensum habiturus non sit, ad se putet pertinere.quare licet etiam
mortalem esse animum iudicantem aeterna moliri, non gloriae cupiditate, quam
sensurus non sis, sed virtutis, quam necessario gloria, etiamsi tu id non agas,
consequatur. Natura vero <si> se sic habet, ut, quo modo initium nobis rerum
omnium ortus noster adferat, sic exitum mors, ut nihil pertinuit ad nos ante
ortum, sic nihil post mortem pertinebit.in quo quid potest esse mali, cum
mors nec ad vivos pertineat nec ad mortuos? Alteri nulli
sunt, alteros non attinget.quam qui leviorem faciunt, somni simillimam volunt
esse: quasi vero quisquam ita nonaginta annos velit vivere, ut, cum saxaginta
confecerit, reliquos dormiat; ne sui quidem id velint, not modo ipse.Endymion
vero, si fabulas audire volumus, ut nescio quando in Latmo obdormivit, qui est
mons Cariae, nondum, opinor, est experrectus.num igitur eum curare censes, cum
Luna laboret, a qua consopitus putatur, ut eum dormientem
oscularetur? Quid curet autem, qui ne sentit quidem? Habes somnum imaginem
mortis eamque cotidie induis: et dubitas quin sansus in morte nullus sit,
cum in eius simulacro videas esse nullum sensum?
XXXIX. Pellantur ergo istae ineptiae paene aniles,
ante tempus mori miserum esse. Quod tandem tempus? Naturaene? At ea quidem dedit
usuram tamquam pecuniae nalla praestituta die.quid est igitur quod querare,
si repetit, cum volt? Ea enim condicione acceperas.
Idem, si puer parvus occidit, aequo animo
ferendum putant, si vero in cunis, ne querendum quidem. Atqui ab hoc
acerbius exegit natura quod dederat. 'nondum gustaverat', inquit, 'vitae
suavitatem; hic autem iam sperabat magna, quibus frui coeperat.' at id quidem in
ceteris rebus melius putatur, aliquam partem quam nullam attingere: cur in
vita secus? (quamquam non male ait Callimachus multo saepius lacrimasse Priamum
quam Troilum). Eorum autem, qui exacta aetate moriuntur, fortuna laudatur. Cur?
Nam, reor, nullis, si vita longior daretur, posset esse
iucundior; nihil enim est profecto homini prudentia dulcius, quam, ut
cetera auferat, adfert certe senectus. Quae vero aetas longa est,
aut quid omnino homini longum? Nonne
Modo pueros, modo
adulescentes in cursu a tergo insequens
Nec opinantis adsecuta est
senectus? Sed quia ultra nihil habemus, hoc
longum dicimus. Omnia ista, perinde ut cuique data sunt pro rata parte,
ita aut longa aut brevia dicuntur. Apud Hypanim fluvium, qui ab Europae
parte in Pontum influit, Aristoteles ait bestiolas quasdam nasci,
quae unum diem vivant. Ex his igitur hora VIII quae mortua est, provecta
aetate mortua est; quae vero occidente sole, decrepita, eo magis,
si etiam solstitiali die. Confer nostram longissimam aetatem cum aeternitate: in
eodem propemodum brevitate qua illae bestiolae reperiemur.
XL. Contemnamus igitur omnis ineptias — quod enim
levius huic levitati nomen inponam? — totamque vim bene vivendi in animi robore
ac magnitudine et in omnium rerum humanarum contemptione ac despicientia et in
omni virtute ponamus. Nam nunc quidem cogitationibus mollissimis effeminamur,
ut, si ante mors adventet quam Chaldaeorum promissa consecuti sumus,
spoliati magnis quibusdam bonis, inlusi destitutique videamur.
Quodsi expectando et desiderando pendemus animis, cruciamur,
angimur, pro di immortales, quam illud iter iucundum esse debet,
quo confecto nulla reliqua cura, nulla sollicitudo futura sit! quam me
delectat Theramenes! quam elato animo est! etsi enim flemus, cum legimus,
tamen non miserabiliter vir clarus emoritur: qui cum coniectus in carcerem
triginta iussu tyrannorum venenum ut sitiens obduxisset, reliquum sic e
poculo eiecit, ut id resonaret, quo sonitu reddito adridens 'popino'
inquit 'hoc pulchro Critiae', qui in eum fuerat taeterrimus. Graeci enim
<in> conviviis solent nominare, cui poculum tradituri sint. Lusit vir
egregius extremo spiritu, cum iam praecordiis conceptam mortem contineret,
vereque ei, cui venenum praebiberat, mortem eam est auguratus,
quae brevi consecuta est. Quis hanc maximi animi
aequitatem in ipsa morte laudaret, si mortem malum iudicaret? Vadit enim
in eundem carcerem atque in eundem paucis post annis scyphum Socrates,
eodem scelere iudicum quo tyrannorum Theramenes. Quae est igitur eius oratio,
qua facit eum Plato usum apud iudices iam morte multatum?
XLI. 'Magna me' inquit 'spes tenet, iudices,
bene mihi evenire, quod mittar ad mortem. Necesse est enim sit alterum de
duobus, ut aut sensus omnino omnes mors auferat aut in alium quendam locum
ex his locis migretur. Quam ob rem, sive sensus extinguitur morsque ei
somno similis est, qui non numquam etiam sine visis somniorum
placatissimam quietem adfert, di boni, quid lucri est emori! aut
quam multi dies reperiri possunt, qui tali nocti anteponantur! cui si
similis est perpetuitas omnis consequentis temporis, quis me beatior? Sin
vera sunt quae dicuntur, migrationem esse mortem in eas oras, quas
qui e vita excesserunt incolunt, id multo iam beatius est. Tene, cum
ab is, qui se iudicum numero haberi volunt, evaseris, ad eos
venire, qui vere iudices appellentur, Minoem Rhadamanthum Aeacum
Triptolemum, convenireque eos qui iuste <et> cum fide vixerint —haec
peregrinatio mediocris vobis videri potest? Ut vero conloqui cum Orpheo Musaeo
Homero Hesiodo liceat, quanti tandem aestimatis? Equidem saepe emori,
si fieri posset, vellem, ut ea quae dico mihi liceret invisere.
Quanta delectatione autem adficerer, cum Palamedem, cum Aiacem,
cum alios iudicio iniquo circumventos convenirem! temptarem etiam summi regis,
qui maximas copias duxit ad Troiam, et Ulixi Sisyphique prudentiam,
nec ob eam rem, cum haec exquirerem sicut hic faciebam, capite
damnarer.— Ne vos quidem, iudices i qui me absolvistis, mortem
timueritis. Nec enim cuiquam bono mali quicquam evenire potest nec vivo nec
mortuo, nec umquam eius res a dis inmortalibus neglegentur, nec mihi
ipsi hoc accidit fortuito. Nec vero ego is, a quibus accusatus aut a
quibus condemnatus sum, habeo quod suscenseam, nisi quod mihi nocere
se crediderunt.' et haec quidem hoc modo; nihil autem melius extremo: 'sed
tempus est' inquit 'iam hinc abire, me, ut moriar, vos,
ut vitam agatis. Utrum autem sit melius, dii inmortales sciunt,
hominem quidem scire arbitror neminem.'
XLII. Ne ego haud paulo hunc animum malim quam
eorum omnium fortunas, qui de hoc iudicaverunt. Etsi, quod praeter
deos negat scire quemquam, id scit ipse utrum sit melius —nam dixit ante
—, sed suum illud, nihil ut adfirmet, tenet ad extemum; nos
autem teneamus, ut nihil censeamus esse malum, quod sit a natura
datum omnibus, intellegamusque, si mors malum sit, esse
sempiternum malum. Nam vitae miserae mors finis esse videtur; mors si est
misera, finis esse nullus potest. Sed quid ego Socratem aut Theramenem,
praestantis viros virtutis et sapientiae gloria, commemoro, cum
Lacedaemonius quidam, cuius ne nomen quidem proditum est, mortem
tantopere contempserit, ut, cum ad eam duceretur damnatus ab ephoris
et esset voltu hilari atque laeto dixissetque ei quidam inimicus: 'contemnisne
leges Lycurgi?', responderit: 'ego vero illi maximam gratiam habeo,
qui me ea poena multaverit, quam sine mutuatione et sine versura possem
dissolvere.' o virum Sparta dignum! ut mihi quidem, qui tam magno animo
fuerit, innocens damnatus esse videatur. Talis innumerabilis nostra
civitas tulit. Sed quid duces et principes nominem, cum legiones scribat
Cato saepe alacris in eum locum profectas, unde redituras se non
arbitrarentur? Pari animo Lacedaemonii in Thermopylis occiderunt, in quos
Simonides:
Dic, hospes, Spartae nos te hic
vidisse iacentis,
Dum sanctis patriae legibus obsequimur.
Quid ille dux Leonidas dicit? 'pergite animo
forti, Lacedaemonii, hodie apud inferos fortasse cenabimus.' fuit
haec gens fortis, dum Lycurgi leges vigebant. E quibus unus, cum
Perses hostis in conloquio dixisset glorians: 'solem prae iaculorum multitudine
et sagittarum non videbitis', 'in umbra igitur' inquit 'pugnabimus.' viros
commemoro: qualis tandem Lacaena? Quae cum filium in proelium misisset et
interfectum audisset, 'idcirco' inquit 'genueram, ut esset, qui pro
patria mortem non dubitaret occumbere'.
XLIII. Esto: fortes et duri Spartiatae; magnam
habet vim rei p. Disciplina. Quid? Cyrenaeum Theodorum, philosophum non
ignobilem, nonne miramur? Cui cum Lysimachus rex crucem minaretur, 'istis,
quaeso' inquit 'ista horribilia minitare purpuratis tuis: Theodori quidem nihil
interest, humine an sublime putescat.' Cuius hoc dicto admoneor, ut
aliquid etiam de humatione et sepultura dicendum existimem, rem non
difficilem, is praesertim cognitis, quae de nihil sentiendo paulo
ante dicta sunt. De qua Socrates quidem quid senserit, apparet in eo libro
in quo moritur, de quo iam tam multa diximus. Cum enim de inmortalitate
animorum disputavisset et iam moriendi tempus urgeret, rogatus a Critone,
quem ad modum sepeliri vellet, 'multam vero' inquit 'operam, amici,
frustra consumpsi; Critoni enim nostro non persuasi me hinc avolaturum neque mei
quicquam relicturum. Verum tamen, Crito, si me adsequi potueris aut
sicubi nanctus eris, ut tibi videbitur, sepelito. Sed, mihi
crede, nemo me vestrum, cum hinc excessero, consequetur.'
praeclare is quidem, qui et amico permiserit et se ostenderit de hoc toto
genere nihil laborare. Durior Diogenes, et is quidem eadem sentiens,
sed ut Cynicus asperius: proici se iussit inhumatum. Tum amici: 'volucribusne et
feris?' 'minime vero' inquit, 'sed bacillum propter me, quo abigam,
ponitote.' 'qui poteris?' illi, 'non enim senties.' 'quid igitur mihi
ferarum laniatus oberit nihil sentienti?' praeclare Anaxagras, qui cum
Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis, velletne Clazomenas in
patriam, si quid accidisset, auferri, 'nihil necesse est'
inquit, 'undique enim ad inferos tantundem viae est.' totaque de ratione
humationis unum tenendum est, ad corpus illam pertinere, sive
occiderit animus sive vigeat. In corpore autem perspicuum est vel extincto animo
vel elapso nullum residere sensum.
LXIV. Sed plena errorum sunt omnia. Trahit
Hectorem ad currum religatum Achilles: lacerari eum et sentire, credo,
putat. Ergo hic ulciscitur, ut quidem sibi videtur; at illa sicut
acerbissimam rem maeret:
Vidi, videre quod me passa aegerrume,
Hectorem curru quadriiugo raptarier.
Quem Hectorem, aut quam diu ille erit
Hector? Melius Accius et aliquando sapiens Achilles:
Immo enimvero corpus Priamo reddidi, Hectora
abstuli.
Non igitur Hectora traxisti, sed corpus quod
fuerat Hectoris. Ecce alius exoritur e terra, qui matrem dormire non
sinat:
Mater, te appello, tu, quae
curam somno suspensam levas,
Neque te mei miseret, surge et sepeli natum —!
Haec cum pressis et flebilibus modis, qui
totis theatris maestitiam inferant, concinuntur, difficile est non
eos qui inhumati sint miseros iudicare. 'prius quam ferae volucresque —' metuit,
ne laceratis membris minus bene utatur; ne combustis, non extimescit.
Neu reliquias semesas sireis denudatis ossibus
Per terram sanie delibutas foede divexarier —
Non intellego, quid metuat, cum tam
bonos septenarios fundat ad tibiam. Tenendum est igitur nihil curandum esse post
mortem, cum multi inimicos etiam mortuos poeniuntur. Exsecratur luculentis
sane versibus apud Ennium Thyestes, primum ut naufragio pereat Atreus:
durum hoc sane; talis enim interitus non est sine gravi sensu; illa inania:
Ipse summis saxis fixus asperis,
evisceratus,
Latere pendens, saxa spargens tabo, sanie et sanguine atro —
non ipsa saxa magis sensu omni vacabunt quam ille
'latere pendens', cui se hic cruciatum censet optare. Quae essent dura,
si sentiret, <sunt> nulla sine sensu. Illud vero perquam inane:
Neque sepulcrum, quo recipiat, habeat,
portum corporis,
Ubi remissa humana vita corpus requiescat malis.
Vides, quanto haec in errore versentur:
portum esse corporis et requiescere in sepulcro putat mortuum; magna culpa
Pelopis, qui non erudierit filium nec docuerit, quatenus esset
quidque curandum.
XLV. Sed quid singulorum opiniones animadvertam,
nationum varios errores perspicere cum liceat? Condiunt Aegyptii mortuos et eos
servant domi; Persae etiam cera circumlitos condunt, ut quam maxime
permaneant diuturna corpora. Magorum mos est non humare corpora suorum,
nisi a feris sint ante laniata; in Hyrcania plebs publicos alit canes,
optumates domesticos: nobile autem genus canum illud scimus esse, sed pro
sua quisque facultate parat a quibus lanietur, eamque optumam illi esse
censent sepulturam. Permulta alia colligit Chrysippus, ut est in omni
historia curiosus, sed ita taetra sunt quaedam, ut ea fugiat et
reformidet oratio. Totus igitur hic locus est contemnendus in nobis, non
neglegendus in nostris, ita tamen, ut mortuorum corpora nihil
sentire vivi sentiamus; quantum autem consuetudini
famaeque dandum sit, id curent vivi, sed ita, ut intellegant
nihil id ad mortuos pertinere. Sed profecto mors tum aequissimo animo oppetitur,
cum suis se laudibus vita occidens consolari potest. Nemo parum diu vixit,
qui virtutis perfectae perfecto functus est munere. Multa mihi ipsi ad mortem
tempestiva fuerunt. Quam utinam potuissem obire! nihil enim iam adquirebatur,
cumulata erant officia vitae, cum fortuna bella restabant. Quare si ipsa
ratio minus perficiet, ut mortem neglegere possimus, at vita acta
perficiat, ut satis superque vixisse videamur. Quamquam enim sensus
abierit, tamen suis et propriis bonis laudis et gloriae, quamvis non
sentiant, mortui non carent. Etsi enim nihil habet in se gloria cur
expetatur, tamen virtutem tamquam umbra sequitur.
XLVI. Verum multitudinis
iudicium de bonis <bonum> si quando est, magis laudandum est quam illi ob
eam rem beati. Non possum autem dicere, quoquo modo hoc accipietur,
Lycurgum Solonem legum et publicae disciplinae carere gloria, Themistoclem
Epaminondam bellicae virtutis. Ante enim Salamina ipsam Neptunus obruet quam
Salaminii tropaei memoriam, priusque e Boeotia Leuctra tollentur quam
pugnae Leuctricae gloria. Multo autem tardius fama deseret Curium Fabricium
Calatinum, duo Scipiones duo Africanos, Maximum Marcellum Paulum,
Catonem Laelium, innumerabilis alios; quorum similitudinem aliquam qui
arripuerit, non eam fama populari, sed vera bonorum laude metiens,
fidenti animo, si ita res feret, gradietur ad mortem; in qua aut
summum bonum aut nullum malum esse cognovimus. Secundis vero suis rebus volet
etiam mori; non enim tum cumulus bonorum iucundus esse potest quam molesta
decessio. Hanc sententiam significare videtur
Laconis
illa vox, qui, cum Rhodius Diagoras, Olympionices nobilis,
uno die duo suos filios victores Olympiae vidsset, accessit ad senem et
gratulatus: 'morere Diagora' inquit; 'non enim in caelum ascensurus es.' magna
haec, et nimium fortasse, Graeci putant vel tum potius putabant,
isque, qui hoc Diagorae dixit, permagnum existimans tris
Olympionicas una e domo prodire cunctari illum diutius in vita fortunae obiectum
inutile putabat ipsi. Ego autem tibi quidem, quod satis esset,
paucis verbis, ut mihi videbar, responderam — concesseras enim nullo
in malo mortuos esse —; sed ob eam causam contendi ut plura dicerem, quod
in desiderio et luctu haec est consolatio maxima. Nostrum enim et nostra causa
susceptum dolorem modice ferre debemus, ne nosmet ipsos amare videamur;
illa suspicio intolerabili dolore cruciat, si opinamur eos quibus orbati
sumus esse cum aliquo sensu in is malis quibus volgo opinantur. Hanc excutere
opinionem mihimet volui radicitus, eoque fui fortasse longior.
XLVII. Tu longior? Non mihi quidem. Prior enim
pars orationis tuae faciebat, ut mori cuperem, posterior, ut
modo non nollem, modo non laborarem; omni autem oratione illud certe
perfectum est, ut mortem non ducerem in malis. Num igitur etiam rhetorum
epilogum desideramus? An hanc iam artem plane relinquimus? Tu vero istam ne
relinqueris, quam semper ornasti, et quidem iure; illa enim te,
verum si loqui volumus, ornaverat. Sed quinam est iste epilogus? Aveo enim
audire, quicquid est. Deorum inmortalium iudicia
solent in scholis proferre de morte, nec vero ea fingere ipsi, sed
Herodoto auctore aliisque pluribus. Primum Argiae sacerdotis Cleobis et Bito
filii praedicantur. Nota fabula est. Cum enim illam ad sollemne et statum
sacrificium curru vehi ius esset satis longe ab oppido ad fanum morarenturque
iumenta, tum iuvenes i quos modo nominavi veste posita corpora oleo
perunxerunt, ad iugum accesserunt. Ita sacerdos advecta in fanum,
cum currus esset ductus a filiis, precata a dea dicitur, ut id illis
praemii daret pro pietate, quod maxumum homini dari posset a deo; post
epulatos cum matre adulescentis somno se dedisse, mane inventos esse mortuos.
Simili precatione Trophonius et Agamedes usi dicuntur; qui cum Apollini
Delphis templum exaedificavissent, venerantes deum petiverunt mercedem non
parvam quidem operis et laboris sui: nihil certi, sed quod esset optimum
homini. Quibus Apollo se id daturum ostendit post eius diei diem tertium; qui ut
inluxit, mortui sunt reperti. Iudicavisse deum dicunt, et eum quidem
deum, cui reliqui dii concessissent, ut praeter ceteros divinaret. XLVIII.
Adfertur etiam de Sileno fabella quaedam: qui cum a Mida captus esset, hoc
ei muneris pro sua missione dedisse scribitur: docuisse regem non nasci homini
longe optimum esse, proximum autem quam primum mori.
Qua est sententia in Cresphonte usus Euripedes:
Nam nos decebat coetus celebrantis domum
Lugere, ubi esset aliquis in lucem editus,
Humanae vitae varia reputantis mala;
At, qui labores morte finisset gravis,
Hunc omni amicos laude et laetitia exsequi.
Simile quiddam est
in Consolatione Crantoris: ait
enim Terinaeum quendam Elysium, cum graviter filii mortem maereret,
venisse in psychomantium quaerentem, quae fuisset tantae calamitatis
causa; huic in tabellis tris huius modi versiculos datos:
Igraris homines in vita mentibus errant:
Euthynous potitur fatorum numine leto.
Sic fuit utilius finiri ipsique tibique.
his et talibus auctoribus usi
confirmant causam
rebus a diis inmortalibus iudicatam. Alcidamas quidem, rhetor antiquus in
primis nobilis, acripsit etima laudationem mortis, quae constat ex
enumeratione humanorum malorum; cui rationes eae quae exquisitius a philosophis
colliguntur defuerunt, ubertas orationis non defuit. Clarae vero mortes
pro patria oppetitae non solum gloriosae rhetoribus, sed etiam beatae
videri solent. Repetunt ab Erechtheo, cuius etiam filiae cupide mortem
expetiverunt pro vita civium; <commemorant> Codrum, qui se in medios
inmisit hostis veste famulari, ne posset adgnosci, si esset ornatu
regio, quod oraculum erat datum, si rex interfectus esset,
victrices Athenas fore; Menoeceus non praetermittitur, qui item oraculo
edito largitus est patriae suum sanguinem; <nam> Iphigenia Aulide duci se
immolandam iubet, ut hostium elicatur suo. Veniunt inde ad propiora:
XLIX. Harmodius in ore est et Aristogiton;
Lacedaemonius Leonidas, Thebanus Epaminondas viget. Nostros non norunt,
quos enumerare magnum est: ita sunt multi, quibus videmus optabilis mortes
fuisse cum gloria. Quae cum ita sint, magna tamen
eloquentia est utendum atque ita velut superiore e loco contionandum, ut
homines mortem vel optare incipiant vel certe timere desistant? Nam si supremus
ille dies non extinctionem, sed commutationem adfert loci, quid
optabilius? Sin autem perimit ac delet omnino, quid melius quam in mediis
vitae laboribus obdormiscere et ita coniventem somno consopiri sempiterno? Quod
si fiat, melior Enni quam Solonis oratio. Hic enim noster: 'nemo me
lacrimis decoret' inquit 'nec funera fletu faxit!' at vero ille sapiens:
Mors mea ne careat lacrimis: linquamus amicis
Maerorem, ut celebrent funera cum gemitu.
nos vero, si quid tale acciderit, ut a
deo denuntiatum videatur ut exeamus e vita, laeti et agentes gratias
paremus emittique nos e custodia et levari vinclis arbitremur, ut aut in
aeternam et plane in nostram domum remigremus aut omni sensu molestiaque
careamus; sin autem nihil denuntiabitur, eo tamen simus animo, ut
horribilem illum diem aliis nobis faustum putemus
nihilque in malis ducamus,
quod sit vel a diis inmortalibus vel a natura parente omnium constitutum. Non
enim temere nec fortuito sati et creati sumus, sed profecto fuit quaedam
vis, quae generi consuleret humano nec id gigneret aut aleret, quod
cum exanclavisset omnes labores, tum incideret in mortis malum
sempiternum: portum potius paratum nobis et perfugium putemus. Quo utinam velis
passis pervehi liceat! sin reflantibus ventis reiciemur, tamen eodem paulo
tardius referamur necesse est. Quod autem omnibus necesse est, idne
miserum esse uni potest? Habes epilogum, ne quid preatermissum aut
relictum putes. Ego vero, et quidem fecit etiam iste me epilogus
firmiorem. Optime, inquam. Sed nunc quidem valetudini tribuamus aliquid,
cras autem et quot dies erimus in Tusculano, agamus haec et ea potissimum,
quae levationem habeant aegritudinum formidinum cupiditatum, qui omnis
philosohpiae est fructus uberrimus. |
I. Quand j'ai vu enfin, qu'il
n'y avait presque plus rien à faire pour moi, ni au barreau,
ni au sénat, j'ai suivi vos conseils, Brutus, et
me suis remis à une sorte d'étude, dont le goût m'était
toujours resté, mais que d'autres soins avaient souvent
ralentie, ou même interrompue longtemps. Par cette étude,
j'entends la philosophie, qui est l'étude même de la sagesse,
et qui renferme toutes les connaissances, tous les préceptes
nécessaires à l'homme pour bien vivre. J'ai donc jugé à propos de
traiter en notre langue ces importantes matières : non pas que la
Grèce n'ait à nous offrir, et livres et docteurs, qui
pourraient nous les enseigner : mais il m'a toujours paru, ou
que nos Romains ne devaient rien qu'à leurs propres lumières,
supérieures à celles des Grecs; ou que s'ils avaient trouvé quelque
chose à emprunter d'eux, ils l'avaient perfectionné. Il y a
dans nos coutumes et dans nos mœurs, il y a dans la conduite
de nos affaires domestiques, plus d'ordre, plus de
dignité. Pour le gouvernement de l'État, nos ancêtres nous ont
certainement laissé de meilleures lois. Parlerai-je de notre milice,
toujours recommandable par la valeur, et plus encore par la
bonne discipline? Tout ce qui pouvait, en un mot, nous
venir de la nature, sans le secours de l'étude, nous
l'avons eu, mais à un tel point, que ni la Grèce,
ni quelque nation que ce puisse être, ne doit se comparer avec
nous. Où trouver, en effet, ce fonds d'honneur,
cette fermeté, cette grandeur d'âme, cette probité,
cette bonne foi, et pour tout dire enfin, cette vertu
sans restriction, au même degré qu'on l'a vue dans nos pères?
J'avoue qu'en tout genre d'érudition les Grecs nous surpassaient.
Victoire aisée, puisqu'on ne la leur disputait pas. Leurs
premiers savants, ce furent des poètes, et qui sont très
anciens : car Homère et Hésiode florissaient avant la fondation de
Rome, Archiloque, sous le règne de Romulus : au lieu que
nous autres Romains nous n'avons su que fort tard ce que c'était que
vers. La première pièce de théâtre, qui ait été jouée à Rome,
le fut sous le consulat de Claudius et de Tuditanus, vers l'an
de Rome cinq cent dix. Ennius naquit l'année suivante; il a précédé
Plaute et Névius.
II. Ainsi c'est bien tard que les
poètes ont été, ou connus, ou soufferts parmi nous. A la
622 vérité,
c'était anciennement la coutume dans les festins, comme Caton
le dit dans ses Origines, que les convives chantassent,
au son de la flûte, les louanges des grands hommes. Mais ce
qui fait bien voir qu'alors les poètes étaient peu estimés,
c'est que Caton lui-même, dans une de ses oraisons,
reproche à un consul de son temps, comme quelque chose de
honteux, d'avoir mené des poètes avec lui dans la province où
il commandait. Il y avait mené Ennius. Moins la poésie était honorée
alors, moins on s'y attachait. Cependant, parmi ceux qui
la cultivèrent, nous avons eu de beaux génies, qui ne
demeurèrent pas fort au-dessous des Grecs. Si l'on eût fait à
l'illustre Fabius un mérite de ce qu'il savait peindre,
combien n'aurions-nous pas eu de Polyclètes et de Parrhasius? C'est
la gloire qui nourrit les arts : le goût du travail sans elle ne
nous vient point : et tout métier auquel on attachera du mépris,
sera toujours négligé. Savoir chanter, et jouer des
instruments, était de toutes les perfections la plus vantée
chez les Grecs. Aussi dit-on qu'Épaminondas, qui selon moi a
été le premier homme de la Grèce, jouait parfaitement du luth.
Thémistocle, qui était de quelques années plus ancien,
passa pour un homme mal élevé, sur ce qu'étant invité à
prendre une lyre dans un festin, il avoua qu'il n'en savait
pas jouer. De là vient que les Grecs ont eu quantité de célèbres
musiciens. Ils se piquaient tous de savoir ce qu'ils n'auraient pu
ignorer sans honte. Par la même raison, comme ils faisaient un
grand cas des mathématiques, ils y ont excellé : au lieu que
chez nous on a cru que de savoir compter et mesurer, c'était
assez.
III. Au contraire, nous avons de
bonne heure aspiré à être orateurs. Ce fut d'abord sans y chercher
d'art; on se contentait d'un talent heureux; l'art vint ensuite au
secours. Il y avait effectivement du savoir dans Galba, dans
Scipion l'Africain, dans Lélius. Avant eux, Caton avait
été homme d'étude. Lépidus, Carbon, les Gracques sont
venus depuis : et à descendre jusqu'au temps où nous sommes,
le nombre et le mérite de nos orateurs est tel, que la Grèce,
ou ne l'emporte nullement sur nous, ou l'emporte de peu. Pour
la philosophie, elle a été jusqu'à présent négligée; et dans
notre langue nous n'avons point d'auteurs, qui lui aient donné
une sorte d'éclat. C'est à quoi j'ai dessein de m'appliquer,
afin que si nos Romains ont autrefois retiré quelque fruit de mes
occupations, ils en retirent encore, s'il est possible,
de mon loisir. J'embrasse d'autant plus volontiers ce nouveau
travail, que déjà certains philosophes, dont je veux
croire les intentions bonnes, mais dont le savoir ne va pas
loin, ont témérairement répandu, à ce qu'on dit,
plusieurs ouvrages de leur façon. Or il se peut faire qu'on pense
bien, et qu'on ne sache pas s'expliquer avec élégance. Mais en
ce cas, c'est abuser tout à fait de son loisir, et
écrire en pure perte, que de mettre ses pensées sur le papier,
sans avoir l'art de les arranger, et de leur donner un tour
agréable, qui attire son lecteur. Aussi les auteurs dont je
parle n'ont-ils de cours que dans leur parti : et s'ils trouvent à
se faire lire, c'est seulement de ceux qui veulent qu'on leur
permette à eux-mêmes d'écrire dans ce goût-là. Après avoir donc
tâché de porter l'art oratoire à un plus haut point qu'il n'avait
été parmi nous, je m'étudierai avec plus de soin encore à bien
mettre en son jour la philosophie, qui est la
623 source d'où je tirais
ce que je puis avoir eu d'éloquence.
IV. Aristote, ce rare génie,
et dont les connaissances étaient si vastes, jaloux de la
gloire que s'acquérait Isocrate le Rhéteur, entreprit à son
exemple d'enseigner l'art de la parole, et voulut allier
l'éloquence avec la sagesse. Je veux de même, sans oublier mon
ancien caractère d'orateur, me jeter sur des matières de
philosophie. Je les trouve plus grandes, plus abondantes que
celles du barreau : et mon sentiment fut toujours que ces questions
sublimes, pour ne rien perdre de leur beauté, avaient
besoin d'être traitées amplement et avec toutes les grâces qui
dépendent du langage. J'ai essayé si j'y réussirais, et cela
est allé déjà si loin, que j'ai même osé tenir des conférences
philosophiques, à la manière des Grecs. Dernièrement,
après que vous fûtes parti de Tusculum, j'y éprouvai mes
forces en présence d'un grand nombre d'amis. C'est ainsi que ces
déclamations d'autrefois, où j'avais pour but de me former au
barreau, et dont j'ai continué l'usage plus longtemps que
personne, sont aujourd'hui remplacées par un exercice de
vieillard. Je faisais donc proposer la thèse, sur laquelle on
voulait m'entendre : je discourais là-dessus, assis, ou
debout : et comme nous avons eu de ces sortes d'entretiens durant
cinq jours, je les ai rédigés en autant de livres. Voici comme
nous faisions. D'abord celui qui voulait m'entendre, disait
son sentiment, et moi ensuite je l'attaquais. Vous savez que
cette méthode est celle de Socrate, et qu'il la regardait
comme le plus sûr moyen de parvenir à démêler où est le
vraisemblable. Mais pour vous mettre mieux au fait de nos
conférences, je n'en ferai pas un simple récit; je les rendrai
comme si elles se tenaient actuellement. Commençons.
V. L'AUDITEUR. Je trouve que la mort
est un mal. CICÉRON. Pour les morts, ou pour ceux qui ont à
mourir? L'A. Pour les uns, et pour les autres. C. Puisque
c'est un mal, c'est donc une chose qui rend misérables ceux
qu'elle regarde. L'A. Oui sans doute. C. Ainsi, et ceux qui
sont déjà morts, et ceux qui doivent mourir, sont
misérables. L'A. Je le crois. C. Personne donc, qui ne soit
misérable. L'A. Personne du tout. C. Donc, pour raisonner
conséquemment, tout ce qu'il y a d'hommes, nés ou à
naître, non seulement sont misérables, mais le seront
toujours. Car n'y eût-il de mal que pour ceux qui ont à mourir,
cela regarderait tous les vivants, puisque sans exception ils
sont tous mortels. Avec leur vie, cependant, leur misère
finirait. Mais d'ajouter que les morts eux-mêmes sont misérables,
c'est vouloir que nous soyons nés pour une misère sans bornes : que
ceux qui moururent il y a cent mille ans, et que tous les
hommes, en un mot, soient misérables. L'A. Aussi est-ce
bien mon avis. C. Dites-moi, je vous prie, n'est-ce
point que l'image des enfers vous effraye? Un Cerbère à trois têtes;
les flots bruyants du Cocyte; le passage de l'Achéron; un Tantale
mourant de soif, et qui a de l'eau jusqu'au menton, sans
qu'il puisse y tremper ses lèvres;
Ce rocher que Sisyphe épuisé,
hors d'haleine,
Perd à rouler toujours ses efforts et sa peine;
des juges inexorables, Minos et
Rhadamanthe, devant lesquels, au milieu d'un nombre
infini d'auditeurs, vous serez obligé de plaider vous-même
votre cause, sans qu'il vous soit permis d'en charger,
ou Crassus, ou Antoine, ou, puis-
624 que ces Juges sont
Grecs, Démosthène. Voilà peut-être l'objet de votre peur : et
sur ce fondement vous croyez la mort un mal éternel.
VI. L'A. Pensez-vous que j'extravague
jusqu'à donner là-dedans? C. Vous n'y ajoutez pas foi? L'A. Pas le
moins du monde. C. Vous avez, en vérité, grand tort de
l'avouer. L'A. Pourquoi, je vous prie? C. Parce que, si
j'avais eu à vous réfuter sur ce point, j'allais m'ouvrir une
belle carrière. L'A. Qui ne serait éloquent sur un tel sujet? Où est
l'embarras de prouver que ces tourments des enfers ne sont que pures
imaginations de poètes et de peintres? C. Tout est plein,
cependant, de traités philosophiques, où l'on se propose
de le prouver. L'A. Peine perdue : car se trouve-t-il des hommes
assez sots pour en avoir peur? C. Mais, s'il n'y a point de
misérables dans les enfers, personne n'y est donc. L'A. Je n'y
crois personne. C. Où donc sont-ils ces morts que vous croyez
misérables? Quel lieu habitent-ils? Car enfin, s'ils existent,
ils ne sauraient ne pas être dans quelque lieu. L'A. Je crois qu'ils
ne sont nulle part. C. Vous croyez qu'ils n'existent donc point?
L'A. Oui, et c'est justement parce qu'ils n'existent point,
que je les trouve misérables. C. Je vous pardonnerais encore plutôt
de croire un Cerbère, que de parler si peu conséquemment. L'A.
Hé comment? C. Vous dites du même homme, qu'il est, et
qu'il n'est pas. Y songez-vous? Quand vous dites qu'un mort est
misérable, c'est dire d'un homme qui n'existe pas, qu'il
existe. L'A. Je ne suis pas si peu sensé que de tenir ce langage. C.
Que dites-vous donc? L'A. Je dis, par exemple, que
Crassus est à plaindre d'avoir perdu de si grandes richesses en
mourant : que Pompée est à plaindre d'avoir perdu tant de gloire,
tant d'honneurs : qu'enfin tous ceux qui ont perdu le jour sont à
plaindre de l'avoir perdu. C. Vous y revenez toujours. Car,
pour être à plaindre, il faut exister. Or, tout à
l'heure vous disiez que les morts n'existaient plus. Donc,
s'ils n'existent plus, ils ne sauraient être quelque chose,
et par conséquent ils ne sauraient être misérables. L'A. Je ne
m'explique pas bien, apparemment. J'ai prétendu dire que de
n'être plus après que l'on a été, c'est de tous les maux le
plus grand. C. Pourquoi plus grand que de n'avoir absolument point
été ? Il s'ensuivrait de votre raisonnement, que ceux qui ne
sont pas nés encore, sont déjà misérables et cela, parce
qu'ils ne sont point. Car, s'il est vrai qu'après notre mort
nous souffrirons de n'être plus, il faut qu'avant notre
naissance nous ayons souffert de n'être pas. Je n'ai, pour
moi, nulle idée d'avoir eu des maux avant ma naissance
peut-être vous souvenez-vous des vôtres : je vous prie de m'en faire
le récit.
VII. L'A. Vous le prenez sur un ton de
plaisanterie, comme si j'avais parlé des hommes qui sont à
naître, et non pas de ceux qui sont morts. C. Mais ceux qui
sont morts, vous dites donc qu'ils sont? L'A. Au contraire,
je dis qu'ils sont misérables de n'être pas, après qu'ils ont
été. C. Vous ne sentez pas que cela implique contradiction? Qu'y
a-t-il, en effet, de plus contradictoire, que de
n'être point du tout, et d'être, ou misérable, ou
tout ce qu'il vous plaira? Quand, au sortir de la porte Capène,
vous voyez les tombeaux de Calatinus, des Scipions, des
Servilius, des Métellus, jugez-vous que ces gens-là
soient misérables? L'A. Puisque vous me chicanez sur ce mot,
sont, je le supprimerai : et au lieu de vous dire que
les morts sont misérables, je dirai que c'est pour eux
un mal de n'être plus. C. Quand vous dites eux, vous
supposez des gens qui exis- 625
tent. Ainsi vous retombez toujours dans le même inconvénient; et
quelque tour que vous preniez pour dire, Crassus qui n'est
plus, est misérable, vous joindrez ensemble deux
choses incompatibles, parce que l'un des termes, est,
affirme ce que nie l'autre, qui n'est plus. L'A. Hé
bien, puisque vous me forcez d'avouer que ceux-là ne sont pas
misérables, qui ne sont point du tout, je reconnais que
les morts ne sont pas misérables. Mais pour nous qui vivons,
n'est-ce pas un mal que la nécessité de mourir? Quel plaisir est-on
capable de goûter, lorsqu'on a jour et nuit à penser que la
mort approche?
VIII. C. Remarquez-vous que voilà de
retranché déjà une bonne partie de la misère humaine? L'A. Voyons
comment. C. Parce que si la mort avait des suites fâcheuses,
rien ne bornerait nos maux; ils seraient infinis. Mais de la manière
dont nous l'entendons présentement, je vois qu'il y a un terme
où j'arriverai, et au delà duquel je n'aurai plus à craindre.
Vous entrez, à ce qu'il me paraît, dans la pensée
d'Épicharme, qui était, comme la plupart des Siciliens,
homme de beaucoup d'esprit. L'A. Que dit-il? Je n'en sais rien. C.
Je vous le rendrai, si je puis, en latin; car vous savez
que ma coutume n'est pas de mettre du grec dans mon latin, non
plus que du latin dans mon grec. L'A. Vous avez raison : mais cette
pensée d'Épicharme, dites-la moi. C.
Mourir peut être un mal : mais être
mort n'est rien.
L'A. Je me remets à présent le vers
grec. Mais après m'avoir fait avouer que les morts ne sont pas
misérables, prouvez-moi, s'il vous est possible,
que la nécessité de mourir ne soit pas un mal. C. Très aisément,
et j'ai encore de plus grands projets. L'A. Très aisément,
dites-vous? C. Oui, parce que la mort n'étant suivie d'aucun
mal, la mort elle-même n'en est pas un : car vous convenez que
dans le moment précis, qui lui succède immédiatement, il
n'y a plus rien à craindre : et par conséquent mourir n'est autre
chose que parvenir au terme, où, de votre aveu,
finissent tous nos maux. L'A. Je vous en prie, mettez ceci
dans un plus grand jour. Avec des raisonnements trop serrés on me
fait dire oui, avant que je sois persuadé. Mais quels sont ces
grands projets, dont vous me parliez? C. Je veux essayer de
vous convaincre, non seulement que la mort n'est point un mal;
mais que même c'est un bien. L'A. Je n'en demandais pas tant. Je
meurs d'envie cependant de voir comment vous le prouverez. Si vous
n'en venez pas à bout, du moins il en résultera que la mort
n'est point un mal. Au reste, je ne vous interromprai point.
Un discours suivi me fera plus de plaisir. C. Et si j'ai à vous
interroger, ne me répondrez-vous pas? L'A. Il y aurait une
sotte fierté à ne pas répondre : mais, autant qu'il se pourra,
passez-vous de me faire des questions.
IX. Vous serez obéi. Je vais
débrouiller cette matière tout de mon mieux. Mais en m'écoutant,
ne croyez pas entendre Apollon sur son trépied, et ne prenez
pas ce que je vous dirai pour des dogmes indubitables. Je ne suis
qu'un homme ordinaire, je cherche à découvrir la
vraisemblance; mes lumières ne sauraient aller plus loin. Pour le
vrai et l'évident, je le laisse à ceux qui présument qu'il est
à la portée de leur intelligence, et qui se
626 donnent pour des sages
de profession. L'A. A la bonne heure : me voilà prêt a vous écouter.
C. Premièrement donc, voyons ce que c'est que la mort,
qui paraît une chose si connue. II y en a qui pensent que c'est la
séparation de l'âme avec le corps. D'autres, qu'il ne se fait
point de séparation, mais que l'âme et le corps périssent en
même temps, et que l'âme s'éteint dans le corps. Parmi ceux
qui tiennent que l'âme se sépare, les uns croient qu'elle se
dissipe incontinent : d'autres, qu'elle subsiste encore
longtemps après : et d'autres, qu'elle subsiste toujours. Mais
cette âme, qu'est-ce que c'est? Où se tient-elle? Quelle est
son origine? Autant de questions, sur quoi l'on est peu
d'accord. Selon quelques-uns, l'âme n'est autre chose que le
cœur même. Empédocle voulait que ce fût le sang répandu dans le
cœur. D'autres prétendent que c'est une certaine partie du cerveau.
D'autres, que ni le cœur ni le cerveau ne sont l'âme
elle-même, mais seulement le siège de l'âme. D'autres,
que l'âme c'est de l'air. Zénon le stoïcien, que c'est du feu.
X. Voilà d'abord les opinions
communes, cœur, sang, cerveau, air, et
feu. En voici de particulières, et dans lesquelles peu de gens
ont donné. Aristoxène, musicien et philosophe tout ensemble,
dit que comme dans le chant, et dans les instruments, la
proportion des accords fait l'harmonie: de même toutes les parties
du corps sont tellement disposées, que du rapport qu'elles ont
les unes avec les autres, l'âme en résulte. Il a pris cette
idée de l'art qu'il professait. Mais elle ne vient pourtant pas de
lui ; car Platon en avait parlé longtemps auparavant, et fort
au long. Xénocrate, selon les anciens principes de Pythagore
qui attribuait aux nombres une prodigieuse vertu, a soutenu
que l'âme n'avait point de figure, que ce n'était pas une
espèce de corps, mais que c'était seulement un nombre. Platon,
son maître, divise l'âme en trois parties, dont la
principale, savoir la raison, se tient dans la tête,
comme dans un lieu éminent; d'où elle doit commander aux deux
autres, qui sont la colère et la concupiscence, toutes
deux logées à part; la colère dans la poitrine, la
concupiscence au-dessous. On a de Dicéarque un dialogue en trois
livres, où il rapporte ce qui fut dit entre de savants hommes
à Corinthe. Dans le premier livre, il introduit divers
interlocuteurs; dans les deux autres, un certain vieillard de
Phthie, nommé Phérécrate, qu'il fait descendre de
Deucalion et qui tient ce discours : Que l'âme n'est absolument rien
: que c'est un mot vide de sens : qu'il n'y a d'âme, ni dans
l'homme, ni dans la bête : - que le principe qui nous fait
agir, qui nous fait sentir, est répandu également dans
tous les corps vivants. - que l'âme n'étant rien, elle ne
saurait donc être séparée du corps : et qu'enfin il n'y a d'existant
que la matière, qui est une, simple, et dont les
parties sont naturellement arrangées de telle sorte qu'elle a vie et
sentiment. Aristote, qui, du côté de l'esprit, et
par les recherches qu'il a faites, est infiniment au-dessus de
tous les autres philosophes (j'excepte toujours Platon), ayant
d'abord posé pour principe de toutes choses les quatre éléments que
tout le monde connaît, il en imagine un cinquième, d'où
627 l'âme tire son
origine. Il ne croit pas que penser, que prévoir,
apprendre, enseigner, inventer, se souvenir,
aimer, haïr, désirer, craindre, s'affliger,
se réjouir, et autres opérations semblables, puissent
être l'effet des quatre éléments ordinaires. Il a donc recours à un
cinquième principe, qui n'a pas de nom; et il donne à l'âme un
nom particulier, qui signifie à peu près mouvement sans
discontinuation et sans fin.
XI. Telles sont, autant que je
me les rappelle, les diverses opinions, qui ont été
avancées sur ce sujet. Je passe à dessein celle d'un grand homme,
Démocrite, qui prétend que l'âme se forme par je ne sais quel
concours fortuit de corpuscules unis et ronds : car, selon
lui, il n'est rien que les atomes ne fassent. Or de toutes ces
opinions, il n'y a qu'un Dieu qui puisse savoir quelle est la
vraie. Pour nous autres hommes, nous ne sommes pas peu
embarrassés à démêler la plus vraisemblable. Voulez-vous que je
m'arrête à en faire l'examen, ou que j'en revienne à notre
proposition? L'A. Je voudrais fort l'un et l'autre, mais il
est difficile d'embrasser tout cela ensemble. Si vous pouvez,
sans entrer dans cette discussion, me guérir de la crainte que
j'ai de la mort, n'allons pas plus loin. Ou, s'il faut
auparavant savoir à quoi s'en tenir sur l'essence de l'âme,
voyons-le présentement. Une autre fois le reste viendra. C. Je vois
lequel vous plairait davantage, et ce m'est aussi le plus
commode : car de toutes les opinions que j'ai rapportées,
quelle que soit la véritable, il s'ensuivra toujours que la
mort, ou n'est point un mal, ou plutôt est un bien.
Prenons effectivement que l'âme soit ou le cœur, ou le sang,
ou le cerveau. Tout cela étant partie du corps, périra
certainement avec le reste du corps. Que l'âme soit d'air, cet
air se dissipera. Qu'elle soit de feu, ce feu s'éteindra. Que
ce soit l'harmonie d'Aristoxène, cette harmonie sera
déconcertée. Pour Dicéarque, puisqu'il n'admet point d'âme,
il est inutile que j'en parle. Après la mort, selon toutes ces
opinions, il n'y a plus rien qui nous touche, car le
sentiment se perd avec la vie. Or, du moment qu'on ne sent
plus, il n'y a plus de risque à courir. Quant aux autres
opinions, elles n'ont rien qui ne flatte vos espérances :
supposé qu'il vous soit doux de croire qu'un jour votre âme peut
aller dans le ciel, comme dans sa véritable patrie. L'A. Oui
sans doute, j'aime à le croire, et je souhaite ne point
me tromper : mais cette opinion fût-elle fausse, je saurais
gré à qui me la persuaderait. C. Pour cela qu'avez-vous besoin de
moi? Puis-je surpasser l'éloquence de Platon? Voyez ce qu'il a écrit
de l'âme, pesez-le bien, vous n'aurez rien de,
plus à désirer. L'A. Je l'ai lu, et plus d'une fois. Pendant
que je suis à ma lecture, je sens, à la vérité,
qu'elle me persuade. Mais du moment que j'ai quitté le livre,
et que je rêve en moi-même à l'immortalité de l'âme, il
m'arrive, je ne sais comment, de retomber dans mes
doutes. C. Voyons. Avouez-vous que les âmes, ou subsistent
après la mort, ou périssent à l'instant de la mort? L'A.
Assurément, l'un des deux. C. Et si elles subsistent? L'A.
J'avoue qu'elles seront heureuses. C. Et si elles périssent? L'A.
Qu'elles n'auront point à souffrir, puisqu'elles n'existeront
point. A l'égard de ce dernier article, vous m'avez mis,
il y a un moment, dans la nécessité d'en convenir. C. Par où
donc trouvez-vous que la mort puisse être un mal, puisque,
si les âmes sont immortelles, à la mort nous de-
628 venons heureux,
et si elles périssent, nous ne serons plus capables de
souffrir, ayant perdu tout sentiment ?
XII. L'A. Je vous en supplie,
commencez par me démontrer, s'il vous est possible, que
l'âme est immortelle; et comme peut-être vous n'y réussirez point
(car la chose n'est pas aisée), ensuite vous me ferez voir,
du moins, que la mort n'a rien de fâcheux. Je la trouve à
craindre, non pas quand elle m'aura privé de sentiment,
mais parce qu'elle doit m'en priver. C. Pour appuyer l'opinion,
dont vous demandez à être convaincu, j'ai à vous alléguer de
fortes autorités; espèce de preuve qui dans toutes sortes de
contestations est ordinairement d'un grand poids. Je vous citerai
d'abord toute l'antiquité. Plus elle touchait de près à l'origine
des choses, et aux premières productions des Dieux, plus
la vérité, peut-être, lui était connue. Or, la
croyance générale des anciens était, que la mort n'éteignait
pas tout sentiment, et que l'homme au sortir de cette vie
n'était pas anéanti. Quantité de preuves, mais surtout le
droit pontifical, et les cérémonies sépulcrales, ne
permettent pas d'en douter. Jamais des personnages d'un si grand
sens n'auraient révéré si religieusement les sépulcres, ni
condamné à de si graves peines ceux qui les violent, s'ils
n'avaient été bien persuadés que la mort n'est pas un
anéantissement, mais que c'est une sorte de transmigration,
un changement de vie, qui envoie au ciel et hommes et femmes
d'un rare mérite : tandis que les âmes vulgaires sont retenues
ici-bas, mais sans êtres anéanties. Plein de ces idées,
qui étaient celles de nos pères, et conformément au bruit de
la renommée, Ennius a dit:
Romulus est au ciel, il vit avec
les dieux.
Hercule fut pareillement reconnu pour
un très grand et très puissant dieu, d'abord dans la Grèce,
ensuite parmi nous, et jusqu'aux extrémités de l'Océan. On a,
sur ce principe, déifié Bacchus, fils de Sémélé,
et les deux célèbres Tyndarides, qui daignèrent, à ce
qu'on dit, non seulement nous rendre victorieux dans un
combat, mais en apporter eux-mêmes la nouvelle à Rome. Ino,
fille de Cadmus, ne doit-elle pas aussi sa divinité à ce
préjugé? En un mot, et pour éviter un plus long détail,
n'est-ce pas les hommes qui ont peuplé le ciel?
XIII. Si je fouillais dans
l'antiquité, et que je prisse à tâche d'approfondir les
histoires des Grecs, nous trouverions que ceux même d'entre
les Dieux, à qui l'on donne le premier rang, ont vécu
sur la terre, avant que d'aller au ciel. Informez-vous quels
sont ceux de ces Dieux, dont les tombeaux se montrent en
Grèce. Puisque vous êtes initié aux mystères, rappelez-vous en
les traditions. Vous tirerez de là vos conséquences. Car, dans
cette antiquité si reculée, la physique n'était pas connue :
elle ne l'a été que longtemps après : en sorte que les hommes
bornaient alors leurs notions à ce que la nature leur mettait devant
les yeux : ils ne remontaient point des effets aux causes : et c'est
ainsi que sur de certaines visions, la plupart nocturnes,
souvent ils se déterminaient à croire que les morts étaient vivants.
Appliquons ici ce qu'on regarde comme une très forte preuve de
l'existence des Dieux, qu'il n'y a point de peuple assez
barbare, point d'homme assez farouche, pour n'en avoir
pas l'esprit imbu. Plusieurs peuples, à la vérité, n'ont
pas une idée juste des Dieux; ils se laissent tromper à des coutumes
629 erronées; mais
enfin ils s'entendent tous à croire qu'il existe une puissance
divine. Et ce n'est point une croyance qui ait été concertée ; les
hommes ne se sont point donné le mot pour l'établir; leurs lois n'y
ont point de part. Or, dans quelque matière que ce soit,
le consentement de toutes les nations doit se prendre pour loi de la
nature. Tous les hommes donc ne pleurent-ils pas la mort de leurs
proches; et cela, parce qu'ils les croient privés des douceurs
de la vie? Détruisez cette opinion, il n'y aura plus de deuil.
Car le deuil que nous prenons, ce n'est pas pour témoigner la
perte que nous faisons personnellement. On peut s'en affliger,
s'en désoler au fond du cœur, mais ces pompes funèbres,
ces lugubres appareils ont pour motif la persuasion où nous sommes,
que la personne à qui nous étions tendrement attachés, est
privée des douceurs de la vie. C'est un sentiment naturel, et
qu'on ne peut attribuer, ni à la réflexion, ni à
l'étude.
XIV. Par où encore on voit que la
nature elle-même décide tacitement pour notre immortalité,
c'est par cette ardeur avec laquelle tous les hommes travaillent
pour un avenir, qui ne sera qu'après leur mort. «Nous plantons
des arbres qui ne porteront que dans un autre siècle» dit Cécilius
dans les Synéphèbes. Pourquoi en planter, si les siècles qui
nous suivront ne nous touchaient en rien? Et de même qu'un homme qui
cultive avec soin la terre, plante des arbres sans espérer d'y
voir jamais de fruit : un grand personnage ne plante-t-il pas,
si j'ose ainsi dire, des lois, des coutumes, des
républiques? Pourquoi cette passion d'avoir des enfants, ou
d'en adopter, et de perpétuer son nom ? Pourquoi cette
attention à faire des testaments? Pourquoi vouloir de magnifiques
tombeaux, avec leurs inscriptions, si ce n'est parce que
l'idée de l'avenir nous occupe? On est bien fondé (n'en
convenez-vous pas?) à croire qu'il faut, pour juger de la
nature, la chercher dans les êtres les plus parfaits de chaque
espèce. Or, entre les hommes, les plus parfaits ne
sont-ce pas ceux qui se croient nés pour assister, pour
défendre, pour sauver les autres hommes ? Hercule est au rang
des Dieux : il n'y fût jamais arrivé, si, pendant qu'il
était sur la terre, il n'eût pris cette route. Je vous cite là
un exemple ancien, et que la religion de tous les peuples a
consacré.
XV. Mais tant de grands hommes qui ont
répandu leur sang pour notre république, pensaient-ils
autrement? Pensaient-ils, dis-je, que le même jour qui
terminerait leur vie, terminait aussi leur gloire? Jamais,
sans une ferme espérance de l'immortalité, personne
n'affronterait la mort pour sa patrie. Thémistocle pouvait couler
ses jours dans le repos, Épaminondas le pouvait, et sans
chercher des exemples dans l'antiquité, ou parmi les
étrangers, moi-même je le pouvais. Mais nous avons au dedans
de nous je ne sais quel pressentiment des siècles futurs et c'est
dans les esprits les plus sublimes, c'est dans les âmes les
plus élevées, qu'il est le plus vif, et qu'il éclate
davantage. Ôtez ce pressentiment, serait-on assez fou pour
vouloir passer sa vie dans les travaux et dans les dangers? Je parle
de grands. Et que cherchent aussi les poètes, qu'à éterniser
leur mémoire? Témoin celui qui dit :
Ici sur Ennius, Romains,
jetez les yeux.
Par lui furent chantés vos célèbres aïeux.
Tout ce qu'Ennius demande pour avoir
chanté 630 la gloire
des pères, c'est que les enfants fassent vivre la sienne.
Qu'on ne me rende point de funèbres
hommages,
Je deviens immortel par mes doctes ouvrages,
dit-il encore. Mais à quoi bon parler
des poètes? Il n'est pas jusqu'aux artisans, qui n'aspirent à
l'immortalité. Phidias n'ayant pas la liberté d'écrire son nom sur
le bouclier de Minerve, y grava son portrait. Et nos
philosophes, dans les livres même qu'ils composent sur le
mépris de la gloire, n'y mettent-ils pas leur nom? Puis donc
que le consentement de tous les hommes est la voix de la nature,
et que tous les hommes, en quelque lieu que ce soit,
conviennent qu'après notre mort, il y a quelque chose qui nous
intéresse, nous devons aussi nous rendre à cette opinion : et
d'autant plus qu'entre les hommes, ceux qui ont le plus
d'esprit, le plus de vertu, et qui par conséquent savent
le mieux où tend la nature, sont précisément ceux qui se
donnent le plus de mouvement pour mériter l'estime de la postérité.
XVI. Mais comme l'impression de la
nature se borne à nous apprendre l'existence des Dieux, et
qu'ensuite, pour découvrir ce qu'ils sont, nous avons
besoin de raisonner: aussi le consentement de tous les peuples ne va
qu'à nous enseigner l'immortalité des âmes, mais nous ne
saurions qu'à l'aide du raisonnement découvrir ce qu'elles sont,
et où elles résident. Parce qu'on l'ignorait, on a imaginé des
enfers, avec tous ces objets formidables, que vous
paraissiez tout à l'heure mépriser si justement. On se persuadait
que les cadavres ayant été inhumés, les morts allaient pour
toujours vivre sous la terre. C'est ce qui donna lieu à ces
grossières erreurs, que les poètes ont bien fortifiées. Une
assemblée nombreuse, toute pleine de femmes et d'enfants,
ne tient point contre la peur, lorsqu'au théâtre on fait
ronfler ces grands vers:
A travers les horreurs de la nuit
infernale,
J'arrive en ce séjour, par un affreux dédale
De rocs entrecoupés, d'antres fuligineux,
De profondes forêts et de monts caverneux.
On avait même poussé l'erreur jusqu'à
un excès dont il me semble qu'on est revenu aujourd'hui. Car nos
anciens croyaient qu'un mort, dont le cadavre avait été brûlé,
ne laissait pas de faire dans les enfers ce qu'absolument on ne peut
faire qu'avec un corps. Ils ne pouvaient pas comprendre une âme
subsistante par elle-même, ils lui donnaient une forme,
une figure. Et de là toutes ces histoires de morts dans Homère. De
là cette Nécromancie de mon ami Appius. De là, dans mon
voisinage, ce lac d'Averne:
Où l'art qui commande aux morts,
Va, de leurs demeures sombres,
Évoquer les pâles Ombres,
Vaines images des corps.
Images, qui, à ce qu'on
croyait, ne laissaient pas de parler : comme s'il était
possible d'articuler sans langue, sans palais, sans
gosier, et sans poumons. Autrefois on ne pouvait rien voir
mentalement; on ne connaissait que le témoignage des yeux. Il
n'appartient en effet qu'à un esprit sublime, de se dégager
des sens, et de se rendre indépendant du préjugé. Les siècles
antérieurs à Phérécyde n'ont pas été, apparemment, sans
quelques esprits de ce caractère, qui auront bien compris que
l'âme était immortelle. Mais de tous ceux dont il nous reste des
écrits, Phérécyde est 631
le premier qui l'ait soutenu. Il est ancien, sans doute : car
il vivait sous celui de nos rois qui portait même nom que moi.
Pythagore, disciple de Phérécyde, appuya fort cette
opinion. Il arriva en Italie sous le règne de Tarquin le Superbe ;
et ayant ouvert une école dans la grande Grèce, il s'y acquit
tant de considération, que durant plusieurs siècles après lui,
à moins que d'être pythagoricien, on ne passait point pour
savant.
XVII. Mais hors des cas où les nombres
et les figures pouvaient servir d'explication, les anciens
pythagoriciens ne rendaient presque jamais raison de ce qu'ils
avançaient. Platon étant, dit-on, venu en Italie pour
les voir, et y ayant connu, entre autres, Archytas
et Timée, qui lui apprirent tous les secrets de leur secte :
non-seulement il embrassa l'opinion de Pythagore touchant
l'immortalité de l'âme, mais le premier de tous il entreprit
de la démontrer. Passons sa démonstration, si vous le jugez à
propos, et renonçons une bonne fois à tout espoir
d'immortalité. L'A. Hé quoi, au moment que mon attente est la
plus vive, vous m'abandonneriez? Je sais combien vous estimez
Platon, je le trouve admirable dans votre bouche, et
j'aime mieux me tromper avec lui, que de raisonner juste avec
d'autres: C. Je vous en loue : et moi de mon côté je veux bien aussi
m'égarer avec un tel guide. Pour entrer donc en matière,
admettons d'abord un fait, qui pour nous-mêmes, quoique
nous doutions presque de tout, n'est pas douteux, car
les mathématiciens le prouvent. Que la terre n'est, à l'égard
de l'univers entier, que comme un point, qui,
étant placé au milieu, en fait le centre. Que les quatre
éléments, principes de toutes choses, sont de telle
nature qu'ils ont chacun leur détermination. Que les parties
terrestres et les aqueuses tombant d'elles-mêmes sur la terre et
dans la mer, occupent par conséquent le centre du monde. Qu'au
contraire les deux autres éléments, savoir le feu et l'air,
montent en droite ligne à la région céleste; soit que leur nature
particulière les porte en haut; soit qu'étant plus légers, ils
soient repoussés par les deux autres éléments, qui ont plus de
poids. Or, cela supposé, il est clair qu'au sortir
du corps, l'âme tend au ciel, soit qu'elle soit d'air,
soit qu'elle soit de feu. Et si l'âme est un certain nombre,
opinion plus subtile que claire; ou si c'est un cinquième élément,
dont on ne saurait dire le nom, ni comprendre la nature ; à
plus forte raison s'éloignera-t-elle de la terre, puisqu'elle
sera un être moins grossier encore et plus simple que l'air et le
feu. Reconnaissons, au reste, qu'elle doit son essence à
quelqu'un de ces principes, plutôt que de croire qu'un esprit
aussi vif que celui de l'homme, soit lourdement plongé dans le
cœur ou dans le cerveau; ou, comme le veut Empédocle,
dans le sang.
XVIII. Je ne parle, ni de
Dicéarque, ni d'Aristoxène son contemporain, et son
condisciple. Ils avaient du savoir : mais l'un, apparemment,
puisqu'il ne s'aperçoit pas qu'il ait une âme, n'a donc jamais
éprouvé qu'il fût sensible : et pour ce qui est de l'autre, sa
musique le charme à un tel point, qu'il voudrait que l'âme fût
musique aussi. On peut bien comprendre que différents tons,
qui se succèdent les uns aux autres, et qui sont variés avec
art, forment des accords harmonieux mais que les diverses
parties d'un corps inanimé forment une sorte d'harmonie, parce
qu'elles sont placées et figurées d'une telle façon, c'est ce
que je 632 ne conçois
pas. Aristoxène donc, tout docte qu'il est d'ailleurs,
ferait mieux de laisser parler sur ces matières Aristote son maître.
Qu'il montre à chanter : voilà ce qui lui convient à lui; car le
proverbe des Grecs, Que chacun fasse le métier qu'il entend,
est bien sensé. Quant à Démocrite, pure folie que cette
rencontre fortuite d'atomes unis et ronds, d'où il fait
procéder le principe de la respiration et de la chaleur. Pour en
revenir donc aux quatre éléments connus, il faut, si
l'âme en est formée, comme l'a cru Panétius, qu'elle
soit un air enflammé. D'où il s'ensuit qu'elle doit gagner la région
supérieure, car ni l'air ni le feu ne peuvent descendre,
ils montent toujours. Ainsi, supposé qu'enfin ils se
dissipent, c'est loin de la terre : et supposé qu'ils ne se
dissipent pas, mais qu'ils se conservent en leur entier,
dès lors ils tendent encore plus nécessairement en haut, et
percent cet air impur et grossier qui touche la terre. Car il y a
dans notre âme une tout autre chaleur, que dans cet air épais.
On le voit bien, puisque nos corps, qui sont composés de
terre, empruntent de l'âme tout ce qu'ils ont de chaleur.
XIX. Ajoutons que l'âme étant d'une
légèreté sans égale, il lui est bien facile de fendre cet air
grossier, et de s'élever au-dessus. Rien n'approche de sa
vélocité. Si donc elle demeure incorruptible, et sans
altération, il faut que montant toujours, elle pénètre
au travers de cet espace où se forment les nuées, les pluies,
les vents; et qui, à cause des exhalaisons terrestres,
est humide et ténébreux. Quand elle l'a traversé, et qu'elle
se trouve où règne un air subtil avec une chaleur tempérée, ce
qui est conforme à sa nature, là elle se range avec les
astres, et ne fait plus d'efforts pour monter plus haut. Elle
s'y tient immobile, et toujours dans l'équilibre. C'est là,
enfin, sa demeure naturelle, où elle n'a plus besoin de
rien, parce que les mêmes choses qui servent d'aliment aux
astres, lui en servent aussi. Qu'est-ce qui enflamme nos
passions? Ce sont les sens. L'envie nous dévore à la vue des
personnes qui ont ce que nous voudrions avoir. Quand donc nous
aurons quitté nos corps, nous serons certainement
heureux, sans passions, sans envie. Aujourd'hui,
dans nos moments de loisir, nous aimons à voir, à
étudier quelque chose de curieux; et nous pourrons alors nous
satisfaire bien plus librement. Alors nous méditerons, nous
contemplerons, nous nous livrerons à ce désir insatiable de
voir la vérité. Plus la région où nous serons parvenus, nous
mettra à portée de connaître le ciel, plus nous sentirons
croître en nous le désir de le connaître. Ce fut, dit
Théophraste, la beauté des objets célestes, qui fit
naître dans l'esprit des hommes la philosophie, que nous
tenons de nos ancêtres. Si ces découvertes ont de grands charmes,
ce doit être, surtout, pour ceux qui dès cette vie
cherchaient à les faire, malgré les ténèbres dont nous sommes
environnés.
XX. On se fait une joie d'avoir vu
l'embouchure du Pont-Euxin, et le détroit que passa
633 l'Argo, ce
fameux navire, ainsi nommé à cause
Des vaillants Argiens, qui sur
ses bords reçus,
Allaient dérober l'or du Bélier de Phryxus.
On se sait gré d'avoir vu cet autre
détroit,
où Neptune en furie,
Des liens de l'Europe affranchit la Libye.
Que sera-ce donc, et quel
spectacle, quand d'un coup d'œil on découvrira toute la terre;
quand on pourra en voir la position, la forme, l'étendue
; ici les régions habitées, ailleurs celles que trop de chaud
ou trop de froid rend désertes? Aujourd'hui, les choses mêmes
que nous voyons, nous ne les voyons pas de nos yeux. Car le
sentiment n'est pas dans le corps : mais, selon les
physiciens, et selon les médecins eux-mêmes, qui ont
examiné ceci de plus près, il y a comme des conduits qui vont
du siège de l'âme aux yeux, aux oreilles, aux narines.
Tellement qu'il suffit d'une maladie, ou d'une distraction un
peu forte, pour ne voir ni n'entendre, quoique les yeux
soient ouverts, et les oreilles bien disposées. Preuve que ce
qui voit, et ce qui entend, c'est l'âme; et que les
parties du corps qui servent à la vue et à l'ouïe, ne sont,
pour ainsi dire, que des fenêtres, par où l'âme reçoit
les objets. Encore ne les reçoit-elle pas, si elle n'y est
attentive. De plus, la même âme réunit des perceptions très
différentes, la couleur, la saveur, la chaleur,
l'odeur, le son : et pour cela il faut que ses cinq messagers
lui rapportent tout, et qu'elle soit elle seule juge de tout.
Or, quand elle sera arrivée où naturellement elle tend,
là elle sera bien plus en état de juger. Car présentement,
quoique ses organes soient pratiqués avec un art merveilleux,
ils ne laissent pas d'être bouchés en quelque sorte par les parties
terrestres et grossières, qui servent à les former. Mais quand
elle sera séparée du corps, il n'y aura plus d'obstacle qui
l'empêche de voir les choses absolument comme elles sont.
XXI. Que n'aurais-je pas à dire,
si je m'étendais ici sur la variété, sur l'immensité des
spectacles réservés à l'âme dans sa demeure céleste! Toutes les fois
que j'y pense, j'admire l'effronterie de certains philosophes,
qui s'applaudissent d'avoir étudié la physique, et qui,
transportés de reconnaissance pour leur chef, le révèrent
comme un dieu. A les entendre, il les a délivrés d'une erreur
sans borne, et d'une frayeur sans relâche,
insupportables tyrans. Mais cette erreur, mais cette frayeur,
sur quoi fondées? Où est la vieille assez imbécile pour craindre
Ces gouffres ténébreux, ces
lieux pâles et sombres,
Effroyable séjour de la mort et des Ombres?
II y avait donc là de quoi vous faire
peur, sans le secours de la physique? Tirer vanité de ne pas
craindre ces sortes d'objets, et d'en avoir reconnu le faux,
quelle honte pour un philosophe ! Voilà des gens à qui la nature
avait donné un esprit bien pénétrant, puisque, si
l'étude n'était venue à leur aide, ils allaient croire tout
cela ! Un point capital, selon eux, c'est d'avoir été
conduits par leurs principes à croire qu'à l'heure de la mort ils
seront anéantis. Soit. Que trouve-t-on dans l'anéantissement,
ou d'agréable, ou de glorieux? Au fond, je ne vois rien
qui démontre que l'opi- 631
nion de Pythagore et de Platon ne soit pas véritable. Quand même
Platon n'en apporterait point de preuves, il m'ébranlerait par
son autorité toute seule, tant je suis prévenu en sa faveur.
Mais à cette quantité de preuves qu'il entasse, on juge qu'il
avait intention de convaincre ses lecteurs, et qu'il était
convaincu tout le premier.
XXII. A l'égard de ces autres
philosophes, qui condamnent les âmes, comme des
criminelles, à perdre la vie, ils ne se fondent,
au contraire, que sur une seule raison. Ce qui leur rend
incroyable, disent-ils, l'immortalité des âmes,
c'est qu'ils ne sauraient comprendre une âme sans corps. Mais
ont-ils une idée plus claire de ce qu'est l'âme dans le corps,
de sa forme, de son étendue, du lieu où elle réside ?
Quand il serait possible de voir dans un homme plein de vie,
toutes les parties qui le composent au dedans, y verrait-on
l'âme? A force d'être déliée, elle se dérobe aux yeux les plus
perçants. C'est la réflexion que doivent faire ceux qui disent ne
pouvoir comprendre une âme incorporelle. Comprennent-ils mieux une
âme unie au corps? Pour moi, quand j'examine ce que c'est que
l'âme, je trouve infiniment plus de peine à me la figurer dans
un corps, où elle est comme dans une maison étrangère,
qu'à me la figurer dans le ciel, qui est son véritable séjour.
Si l'on ne peut comprendre que ce qui tombe sous les sens, on
ne se formera donc nulle idée, ni de Dieu lui-même, ni
de l'âme délivrée du corps, et de la divine. La difficulté de
concevoir ce qu'elle est, lors même qu'elle est unie au corps,
fît que Dicéarque et Aristoxène prirent le parti de nier que ce fût
quelque chose de réel. Et véritablement il n'y a rien de si grand,
que de voir avec les yeux de l'âme, l'âme elle-même. Aussi
est-ce là le sens de l'oracle, qui veut que chacun se
connaisse. Sans doute qu'Apollon n'a point prétendu par là nous dire
de connaître notre corps, notre taille, notre figure.
Car qui dit nous, ne dit pas notre corps; et quand je parle à
vous, ce n'est pas à votre corps que je parle. Quand donc
l'oracle nous dit: Connais-toi, il entend, Connais ton
âme. Votre corps n'est, pour ainsi dire, que le
vaisseau, que le domicile de votre âme. Tout ce que vous
faites, c'est votre âme qui le fait. Admirable précepte,
que celui de connaître son âme! On a bien jugé qu'il n'y avait qu'un
homme d'un esprit supérieur, qui pût en avoir conçu l'idée :
et c'est ce qui fait qu'on l'a attribué à un Dieu. Mais l'âme
elle-même ne connut-elle point sa nature; dites-moi, ne
sait-elle pas du moins qu'elle existe, et qu'elle se meut? Or,
son mouvement, selon Platon, démontre son immortalité.
En voici la preuve, telle que Socrate l'expose dans le
Phèdre de Platon, et que moi je l'ai rapportée dans mon
sixième livre de la République.
XXIII. «Un être qui se meut toujours,
existera toujours. Mais celui qui donne le mouvement à un autre,
et qui le reçoit lui-même d'un autre, cesse nécessairement
d'exister, lorsqu'il perd son mouvement. Il n'y a donc que
l'être mû par sa propre vertu, qui ne perde jamais son
mouvement, parce qu'il ne se manque jamais à lui-même. Et de
plus il est pour toutes les autres choses qui ont du mouvement,
la source et le principe du mouvement qu'elles ont. Or, qui
dit principe, dit ce qui n'a point d'origine. Car c'est du
principe que tout vient, et le principe ne saurait venir de
nulle autre chose. Il ne serait pas principe, s'il venait
d'ailleurs. Et n'ayant point d'origine, il
635 n'aura par conséquent
point de fin. Car il ne pourrait, étant détruit, ni être
lui-même reproduit par un autre principe, ni en produire un
autre, puisqu'un principe ne suppose rien d'antérieur. Ainsi
le principe du mouvement est dans l'être mû par sa propre vertu.
Principe qui ne saurait être ni produit ni détruit. Autrement il
faut que le ciel et la terre soient bouleversés, et,
qu'ils tombent dans un éternel repos, sans pouvoir jamais
recouvrer une force, qui, comme auparavant, les
fasse mouvoir. Il est donc évident, que ce qui se meut par sa
propre vertu, existera toujours. Et peut-on nier que la
faculté de se mouvoir ainsi ne soit un attribut de l'âme? Car tout
ce qui n'est mû que par une cause étrangère, est inanimé. Mais
ce qui est animé, est mû par sa propre vertu, par son
action intérieure. Telle est la nature de l'âme, telle est sa
propriété. Donc l'âme étant, de tout ce qui existe, la
seule chose qui se meuve toujours elle-même, concluons de là
qu'elle n'est point née, et qu'elle ne mourra jamais ». Que
tout ce bas peuple de philosophes (c'est ainsi que je traite
quiconque est contraire à Platon, à Socrate, et à leur
école ) que tous ces autres philosophes, dis-je, se
réunissent : et non seulement ils ne développeront jamais un
raisonnement avec tant d'art, mais ils ne viendront pas même à
bout de bien prendre le fil de celui-ci. L'âme sent qu'elle se meut
: elle sent que ce n'est pas dépendamment d'une cause étrangère,
mais que c'est par elle-même, et par sa propre vertu ; il ne
peut jamais arriver qu'elle se manque à elle-même, la voilà
donc immortelle. Auriez-vous quelque objection à me faire là-contre?
L'A. J'ai été très aise qu'il ne s'en soit présenté aucune à mon
esprit, tant j'ai de goût pour cette opinion.
XXIV. C. Trouverez-vous moins de force
dans les preuves suivantes? Je les tire des propriétés divines,
dont l'âme est revêtue; propriétés qui me paraissent n'avoir pu être
produites, ni par conséquent pouvoir finir. Car je comprends
bien, par exemple, de quoi et comment ont été produits
le sang, la bile, la pituite, les os, les
nerfs, les veines, et généralement tout notre corps,
tel qu'il est. L'âme elle-même, si ce n'était autre chose dans
nous que le principe de la vie, me paraîtrait un effet
purement naturel, comme ce qui fait vivre à leur manière la
vigne et l'arbre. Et si l'âme humaine n'avait en partage que
l'instinct de se porter à ce qui lui convient, et de fuir ce
qui ne lui convient pas, elle n'aurait rien de plus que les
bêtes. Mais ses propriétés sont, premièrement, une
mémoire capable de renfermer en elle-même une infinité de choses. Et
cette mémoire, Platon veut que ce soit la réminiscence de ce
qu'on a su dans une autre vie. Il fait parler dans le Ménon
un jeune enfant que Socrate interroge sur les dimensions du quarré :
l'enfant répond comme son âge le permet : et les questions étant
toujours à sa portée, il va de réponse en réponse si avant,
qu'enfin il semble avoir étudié la géométrie. De là Socrate conclut
qu'apprendre, c'est seulement se ressouvenir. Il s'en explique
encore plus expressément dans le discours qu'il fit le jour même de
sa mort. Un homme, dit-il, qui paraît n'avoir jamais
acquis de lumières sur rien, et qui cependant répond juste à
une question, fait bien voir que la matière sur laquelle on
l'interroge, ne lui 636
est pas nouvelle ; et que dans le moment qu'il répond, il ne
fait que repasser sur ce qui était déjà dans son esprit. Il ne
serait effectivement pas possible, ajoute Socrate, que
dès notre enfance nous eussions tant de notions si étendues,
et qui sont comme imprimées en nous-mêmes, si nos âmes
n'avaient pas eu de connaissances universelles, avant que
d'entrer dans nos corps. D'ailleurs, suivant la doctrine
constante de Platon, il n'y a de réel que ce qui est immuable,
comme le sont les idées. Rien de ce qui est produit, et
périssable, n'existe réellement. L'âme enfermée dans le corps
n'a donc pu se former ces idées : elle les apporte avec elle en
venant au monde. Dès là ne soyons plus surpris que tant de choses
lui soient connues. Il est vrai que tout en arrivant dans une
demeure si sombre et si étrange pour elle, d'abord elle ne
démêle pas bien les objets : mais quand elle s'est recueillie,
et qu'elle se reconnaît, alors elle fait l'application de ses
idées. Apprendre n'est donc que se ressouvenir. Quoi qu'il en soit,
je n'admire rien tant que la mémoire. Car enfin, quelle est sa
nature, son origine? Je ne parle pas d'une mémoire
prodigieuse, telle que l'a été celle de Simonide, de
Théodecte, de Cynéas, de Charmidès, de Métrodore,
d'Hortensius. Je parle d'une mémoire commune, telle que l'ont
tous les hommes, et particulièrement ceux qui cultivent des
sciences de quelque étendue. A peine croirait-on de combien d'objets
ils la chargent, sans qu'elle succombe.
XXV. Quelle est donc la nature de la
mémoire? D'où procède sa vertu? Ce n'est certainement ni du cœur,
ni du cerveau, ni du sang, ni des atomes. Je ne sais si
notre âme est de feu, ou d'air; et je ne rougis point,
comme d'autres, d'avouer que j'ignore ce qu'en effet j'ignore.
Mais qu'elle soit divine, j'en jurerais, si dans une
matière obscure, je pouvais parler affirmativement. Car la
mémoire, je vous le demande, vous paraît-elle n'être
qu'un assemblage de parties terrestres, qu'un amas d'air
grossier et nébuleux? Si vous ne savez ce qu'elle est, du
moins vous voyez de quoi elle est capable. Hé bien,
dirons-nous qu'il y a dans notre âme une espèce de réservoir,
où les choses que nous confions à notre mémoire, se versent
comme dans un vase? Proposition absurde : car peut-on se figurer que
l'âme soit d'une forme à loger un réservoir si profond? Dirons-nous
que l'on grave dans l'âme comme sur la cire, et qu'ainsi le
souvenir est l'empreinte, la trace de ce qui a été gravé dans
l'âme? Mais des paroles et des idées peuvent-elles laisser des
traces? Et quel espace ne faudrait-il pas pour tant de traces
différentes? Qu'est-ce que cette autre faculté, qui cherche à
découvrir ce qu'il y a de caché, et qui se nomme intelligence,
génie? Jugez-vous qu'il ne fût entré que du terrestre et du
corruptible dans la composition de cet homme, qui le premier
imposa un nom à chaque chose? Pythagore trouvait à cela une sagesse
infinie. Regardez-vous comme pétri de limon, ou celui qui a
rassemblé les hommes, et leur a inspiré de vivre en société?
Ou celui qui dans un petit nombre de
637 caractères, a
renfermé tous les sons que la voix forme, et dont la diversité
paraissait inépuisable? Ou celui qui a observé comment se meuvent
les planètes, et qu'elles sont tantôt rétrogrades,
tantôt stationnaires? Tous étaient de grands hommes: ainsi que
d'autres encore plus anciens, qui enseignèrent à se nourrir de
blé, à se vêtir, à se faire des habitations, à se
procurer les besoins de la vie, à se précautionner contre les
bêtes féroces. C'est par eux que nous fûmes apprivoisés et
civilisés. Des arts nécessaires, on passa ensuite aux beaux
arts. On trouva, pour charmer l'oreille, les règles de
l'harmonie. On étudia les étoiles, tant celles qui sont fixes,
que celles qu'on appelle errantes, quoiqu'elles ne le soient
pas. Quiconque découvrit les diverses révolutions des astres,
il fit voir par là que son esprit tenait de celui qui les a formés
dans le ciel. Faire, comme Archimède, une sphère qui
représente le cours de la lune, du soleil, des cinq
planètes; et par un seul mouvement orbiculaire, régler divers
mouvements, les uns plus lents, les autres plus vite;
c'est avoir exécuté le plan de ce Dieu, par qui Platon dans le
Timée fait construire le monde. Autant que les révolutions célestes
sont l'ouvrage d'un Dieu, autant la sphère d'Archimède
est l'ouvrage d'un esprit divin.
XXVI. Je trouve même qu'il y a du
divin dans d'autres arts plus connus, et qui ont quelque chose
de plus brillant. Un poète ne produira pas des vers nobles et
sublimes, si je ne sais quelle ardeur céleste ne lui échauffe
l'esprit. Sans un pareil secours, l'éloquence ne joindra pas à
l'harmonie du style la richesse des pensées. Pour la philosophie,
mère de tous les arts, n'est-ce pas, comme l'a dit
Platon, un présent, ou, comme je l'appelle,
une invention des Dieux? C'est d'elle que nous avons appris,
et à leur rendre d'abord un culte; et à reconnaître ensuite des
principes de justice, qui soient le lien de la société civile;
et à nous régler enfin nous-mêmes sur les sentiments qu'inspirent la
modération et la magnanimité. C'est aussi par elle que les yeux de
notre esprit ont été ouverts, en sorte que nous voyons tout ce
qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre,
l'origine, les progrès, la fin de tout ce qui existe.
Une âme donc, douée de si rares facultés, me paraît
certainement divine. Car, après tout, qu'est-ce que la
mémoire, qu'est-ce que l'intelligence, si ce n'est tout
ce qu'on peut imaginer de plus grand, même dans les Dieux?
Apparemment leur félicité ne consiste, ni à se repaître
d'ambroisie, ni à boire du nectar versé à pleine coupe par la
jeunesse; et il n'est point vrai que Ganymède ait été ravi par les
Dieux à cause de sa beauté, pour servir d'échanson à Jupiter.
Le motif n'était pas suffisant pour faire à Laomédon une injure si
cruelle. Homère, auteur de toutes ces fictions, donnait
aux Dieux les faiblesses des hommes. Que ne donnait-il plutôt aux
hommes les perfections des Dieux? Et quelles sont-elles?
Immortalité, sagesse, intelligence, mémoire.
Puisque notre âme rassemble ces perfections, elle est par
conséquent divine, comme je le dis : ou même c'est un Dieu,
comme Euripide a osé le dire. En effet, si la nature divine
est air ou feu, notre âme sera pareillement l'un ou l'autre.
Et comme il n'entre ni terre ni eau dans ce qui fait la nature
divine, aussi n'en doit-on point supposer dans ce qui fait
notre âme. Que s'il y a un cinquième élément, selon
qu'Aristote l'a dit le premier, il sera commun, et à la
nature divine, et à l'âme humaine.
638
XXVII. C'est ce dernier sentiment que j'ai suivi dans ma
Consolation, où je m'explique en ces termes : «On ne peut
absolument trouver sur la terre l'origine des âmes. Car il n'y a
rien dans les âmes, qui soit mixte et composé; rien qui
paraisse venir de la terre, de l'eau, de l'air, ou
du feu. Tous ces éléments n'ont rien qui fasse la mémoire,
l'intelligence, la réflexion; qui puisse rappeler le passé,
prévoir l'avenir, embrasser le présent. Jamais on ne trouvera
d'où l'homme reçoit ces divines qualités, à moins que de
remonter à un Dieu. Et par conséquent l'âme est d'une nature
singulière, qui n'a rien de commun avec les éléments que nous
connaissons. Quelle que soit donc la nature d'un être, qui a
sentiment, intelligence, volonté, principe de vie,
cet être-là est céleste, il est divin, et de-là
immortel. Dieu lui-même ne se présente à nous que sous cette idée
d'un esprit pur, sans mélange, dégagé de toute matière
corruptible, qui connaît tout, qui meut tout, et
qui a de lui-même un mouvement éternel. »
XXVIII. Tel, et de ce même
genre, est l'esprit humain. Mais enfin, où est-il,
me direz-vous, et quelle forme a-t-il? Pourriez-vous bien,
vous répondrai-je, m'apprendre où est le vôtre, et
quelle est sa forme? Quoi! parce que mon intelligence ne s'étend pas
jusqu'où je souhaiterais, vous ne voudrez pas que du moins
elle s'étende jusqu'où elle peut? Si notre âme ne se voit pas,
elle a cela de commun avec l'œil, qui sans se voir lui-même,
voit les autres objets. Elle ne voit pas comment elle est faite :
aussi lui importe-t-il peu de le voir : et d'ailleurs,
peut-être le voit-elle. Quoi qu'il en soit, elle voit au moins
de quoi elle est capable; elle connaît qu'elle a de l'intelligence
et de la mémoire; elle sent qu'elle se meut avec rapidité, par
sa propre vertu. Or, c'est là ce qu'il y a dans l'âme de
grand, de divin, d'éternel. Mais à l'égard de sa figure
et de sa demeure, ce sont choses qui ne méritent seulement pas
d'être mises en question. Quand, par exemple, nous
regardons la beauté et la splendeur du ciel; la célérité avec
laquelle il roule, qui est si grande qu'on ne saurait la
concevoir; la vicissitude des jours et des nuits; le changement des
quatre saisons, qui servent à mûrir les fruits, et à
rendre les corps plus sains; le soleil qui est le modérateur et le
chef de tous les mouvements célestes; la lune, dont le
croissant et le décours semblent faits pour nous marquer les Fastes;
les planètes, qui, avec des mouvements inégaux,
fournissent également la même carrière, sur un même cercle
divisé en douze parties; cette prodigieuse quantité d'étoiles,
qui durant la nuit décorent le ciel de toutes parts; quand nous
jetons ensuite les yeux sur le globe de la terre, élevé
au-dessus de la mer, placé dans le centre du monde et divisé
en cinq parties, deux desquelles sont cultivées, la
septentrionale que nous habitons ; l'australe où sont nos antipodes,
qui nous est inconnue; et les trois autres parties incultes,
parce que le froid ou le chaud y domine avec excès; quand nous
observons que dans la partie où nous sommes, on voit toujours
au temps marqué,
Une clarté plus pure
Embellir la nature ;
Les arbres reverdir;
639 Les fontaines
bondir;
L'herbe tendre renaître;
Le pampre reparaître;
Les présents de Cérès emplir nos magasins,
Et les tributs de Flore enrichir nos jardins;
quand nous voyons que la terre est
peuplée d'animaux, les uns pour nous nourrir, les autres
pour nous vêtir ; ceux-ci pour traîner nos fardeaux, ceux-là
pour labourer nos champs; que l'homme y est comme pour contempler le
ciel, et pour honorer les Dieux; que toutes les campagnes,
toutes les mers obéissent à ces besoins.
XXIX. Pouvons-nous à la vue de ce
spectacle, douter qu'il y ait un être, ou qui ait formé
le monde, supposé que, suivant l'opinion de Platon,
il ait été formé : ou qui le conduise et le gouverne, supposé
que, suivant le sentiment d'Aristote, il soit de toute
éternité? Or de même qu'aux ouvrages d'un Dieu, vous jugez de
son existence, quoiqu'il ne vous tombe pas sous les sens : de
même, quoique votre âme ne soit pas visible, cependant
la mémoire, l'intelligence, la vivacité, toutes
les perfections qui l'accompagnent, doivent vous persuader
qu'elle est divine. Mais, encore une fois, où
réside-t-elle? Je la crois dans la tête, et j'ai des raisons
pour la croire là. Mais enfin, quelque part qu'elle soit,
il est certain qu'elle est dans vous. Qu'elle est sa nature? Je lui
crois une nature particulière et qui n'est que pour elle. Mais
faites-la de feu ou d'air, peu importe; pourvu seulement que,
comme vous connaissez Dieu, quoique vous ignoriez et sa
demeure et sa figure, vous tombiez d'accord que vous devez
aussi connaître votre âme, quoique vous ignoriez et où elle
réside, et comment elle est faite. Cependant, à moins
que d'être d'une crasse ignorance en physique, on ne peut
douter que l'âme ne soit une substance très simple, qui
n'admet point de mélange, point de composition. Il suit de là
que l'âme est indivisible, et par conséquent immortelle. Car
la mort n'est autre chose qu'une séparation, qu'une désunion
des parties, qui auparavant étaient liées ensemble. Pénétré de
ces principes, Socrate, au point d'être condamné à mort,
ne daigna, ni faire plaider sa cause, ni se montrer
devant les juges en posture de suppliant. Il conserva une fierté,
qui venait, non d'orgueil, mais de grandeur d'âme. Le
jour même de sa mort, il discourut longtemps sur le sujet que
nous traitons. Peu de jours auparavant, maître de s'évader de
sa prison, il ne l'avait point voulu. Et dans le temps qu'on
allait lui apporter le breuvage mortel, il parla, non en
homme à qui l'on arrache la vie, mais en homme qui monte au
ciel.
XXX. « Deux chemins, disait-il,
s'offrent aux âmes, lorsqu'elles sortent des corps. Celles
qui, dominées et aveuglées par les passions humaines,
ont à se reprocher, ou des habitudes criminelles, ou des
injustices irréparables, prennent un chemin tout opposé à
celui qui mène au séjour des Dieux. Pour celles qui ont, au
contraire, conservé leur innocence et leur pureté; qui se sont
sauvées, tant qu'elles ont pu, de la contagion des sens;
et qui, dans des corps humains, ont imité la vie des
Dieux, le chemin du ciel, d'où elles sont venues,
leur est ouvert. On a consacré les cygnes à Apollon, parce
qu'ils semblent tenir de lui l'art de connaître l'avenir; et c'est
par un effet de cet art, que, prévoyant de quels
avantages la mort est suivie, ils
640 meurent avec volupté,
et tout en chantant. Ainsi doivent faire, ajoutait Socrate,
tous les hommes savants et vertueux. Personne n'y trouverait la
moindre difficulté, s'il ne nous arrivait, quand nous
voulons trop approfondir la nature de l'âme, ce qui arrive
quand on regarde trop fixement le soleil couchant. On en vient à ne
voir plus. Et de même, quand notre âme se regarde, son
intelligence vient quelquefois à s'émousser; en sorte que nos
pensées se brouillent. On ne sait plus à quoi se fixer, on
retombe d'un doute dans un autre, et nos raisonnements ont
aussi peu de consistance; qu'un navire battu par les flots.» Mais ce
que je dis là de Socrate, est ancien, et tiré des Grecs.
Parmi nous, Caton est mort dans une telle situation d'esprit,
que c'était pour lui une joie d'avoir trouvé l'occasion de quitter
la vie. Car on ne doit point la quitter sans l'ordre exprès de ce
Dieu, qui a sur nous un pouvoir souverain. Mais, quand
lui-même il nous en fait naître un juste sujet, comme
autrefois à Socrate, comme à Caton, et souvent à bien
d'autres, un homme sage doit, en vérité, sortir
bien content de ces ténèbres, pour gagner le séjour de la
lumière. Il ne brisera pas les chaînes qui le captivent sur la
terre; car les lois s'y opposent; mais lorsqu'un Dieu l'appellera,
c'est comme si le magistrat, où quelque autre puissance
légitime, lui ouvrait les portes d'une prison. Toute la vie
des philosophes, dit encore Socrate, est une continuelle
méditation de la mort.
XXXI. Car enfin, que
faisons-nous, en nous éloignant des voluptés sensuelles,
de tout emploi public, de toute sorte d'embarras, et
même du soin de nos affaires domestiques, qui ont pour objet
l'entretien de notre corps? Que faisons-nous, dis-je,
autre chose que rappeler notre esprit à lui-même, que le
forcer à être à lui-même, et que l'éloigner de son corps,
tout autant que cela se peut? Or, détacher l'esprit du corps,
n'est-ce pas apprendre à mourir? Pensons-y donc sérieusement,
croyez-moi, séparons-nous ainsi de nos corps,
accoutumons-nous à mourir. Par ce moyen, et notre vie tiendra
déjà d'une vie céleste, et nous en serons mieux disposés à
prendre notre essor, quand nos chaînes se briseront. Mais les
âmes qui auront toujours été sous le joug des sens, auront
peine à s'élever de dessus la terre, lors même qu'elles seront
hors de leurs entraves. Il en sera d'elles comme de ces prisonniers,
qui ont été plusieurs années dans les fers; ce n'est pas sans peine
qu'ils marchent. Pour nous, arrivés un jour à notre terme,
nous vivrons enfin. Car notre vie d'à-présent, c'est une mort
: et si j'en voulais déplorer la misère, il ne me serait que
trop aisé. L'A. Vous l'avez déplorée assez dans votre Consolation.
Je ne lis point cet ouvrage, que je n'aie envie de me voir à
la fin de mes jours : et cette envie, par tout ce que je viens
d'entendre, augmente fort. C. Vos jours finiront, et de
force, ou de gré, finiront bien vite, car le temps
vole. Or, non-seulement la mort n'est point un mal,
comme d'abord vous le pensiez mais peut-être n'y a-t-il que des maux
pour l'homme, à la mort près, qui est son unique bien,
puisqu'elle doit ou nous rendre Dieux nous-mêmes, ou nous
faire vivre avec les Dieux. L'A. Qu'importe lequel ? Car il y a des
gens qui n'admettent ni l'un ni l'autre. C. Vous ne m'échap-
641 perez
d'aujourd'hui, que je n'aie dissipé absolument tout ce qui
peut vous faire craindre la mort. L'A. Par où la craindrais-je,
après ce que vous venez de m'apprendre? C. Par où? Eh! ne se
présente-t-il pas une foule de contradicteurs? Vous n'avez pas
seulement les Épicuriens, qui, selon moi, ne sont
point à mépriser : quoique tous nos savants, je ne sais
pourquoi, les regardent en pitié. Vous avez un auteur dont je
suis charmé, Dicéarque, qui combat vivement
l'immortalité de l'âme dans les trois livres qu'il appelle
Lesbiaques, parce que Mytilène dans l'île de Lesbos
est la scène de son dialogue. Pour les Stoïciens, ils
prétendent que nos âmes ne vivent que comme des corneilles:
longtemps, mais non pas toujours.
XXXII. Voulez-vous donc voir que,
même en supposant l'âme mortelle, la mort n'en deviendrait pas
redoutable? L'A. Volontiers : mais quelque chose qu'on puisse dire
contre l'immortalité de l'âme, on ne me dissuadera pas. C. Je
vous en loue. Cependant ne comptons point trop sur notre fermeté.
Quelquefois, il ne faut pour nous renverser, qu'un
argument un peu subtil. Dans les questions même les plus claires,
nous hésitons, nous changeons d'avis. Or, celle dont il
s'agit entre nous, n'est pas sans quelque obscurité. De peur
donc d'être surpris, ayons nos armes toujours prêtes. L'A.
Précaution sage ; mais cet accident ne m'arrivera pas, j'y
mettrai ordre. C. Quant à nos amis les Stoïciens, avons-nous
tort d'abandonner ceux d'entre eux qui disent que les âmes
subsistent encore quelque temps au sortir du corps, mais
qu'elles ne subsistent pas éternellement? Ils accordent d'une part
ce qu'il y a de plus difficile, que l'âme, quoique
séparée du corps, peut subsister - et d'autre côté, ils
ne veulent pas que l'âme puisse subsister toujours. De ces deux
points, non seulement le dernier est aisé à croire, mais
il suit naturellement du premier. L'A. Vous dites vrai, les
Stoïciens n'ont rien à répliquer. C. Que penser donc de Panétius,
qui se révolte ici contre Platon, après l'avoir partout
ailleurs appelé divin, très sage, très saint,
l'Homère des philosophes? Il ne rejette de toutes ses opinions,
que celle de l'immortalité, et il appuie la négative sur deux
raisons. L'une, que la ressemblance des enfants aux pères,
ressemblance qui se remarque non seulement dans les traits,
mais encore dans l'esprit, fait voir que les âmes sont
engendrées; d'où il conclut que les âmes sont mortelles, parce
que tout être qui a été produit, doit être détruit,
comme tout le monde en convient. L'autre, que tout ce qui peut
souffrir, peut aussi être malade que tout ce qui est malade,
est mortel : et que par conséquent les âmes, puisqu'elles
peuvent souffrir, ne sont pas immortelles.
XXXIII. A l'égard de cette dernière
preuve, elle porte à faux. Il ne prend pas garde que Platon,
lorsqu'il fait l'âme immortelle, parle de l'intelligence,
qui n'est pas susceptible d'altération, et qui est,
selon Platon, entièrement séparée des autres parties,
que les passions et les infirmités attaquent. Pour la ressemblance,
sur quoi il fonde son premier argument, c'est dans l'âme des
bêtes, qui n'est pas raisonnable, qu'elle se fait le
mieux sentir. D'homme à homme, elle n'est guère que
corporelle. Mais en cela même elle a du rapport à l'âme, parce
qu'il n'est pas indifférent à l'âme d'être dans un corps disposé et
organisé de telle ou de telle façon. Les organes et le tempérament
contribuent fort à la rendre ou plus vive, ou plus lourde.
Aristote dit que la 642
mélancolie est le partage des grands génies : et c'est ce qui
me console de la médiocrité du mien. Il confirme sa remarque par
divers exemples : après quoi, comme si le fait était certain,
il en donne la raison. Quoi qu'il en soit, puisque les organes
influent sur les qualités de l'âme, et que la ressemblance
d'une âme à l'autre ne peut venir que de là seulement, cette
ressemblance, par conséquent, ne prouve pas que les âmes
elles-mêmes soient engendrées. Je voudrais que Panétius fût au
monde, lui qui était contemporain et ami de Scipion
l'Africain. Je lui demanderais à qui de toute la famille des
Scipions ressemblait le neveu de cet illustre personnage? Pour les
traits, c'était son père : pour les mœurs, il fallait
chercher son semblable dans le plus scélérat de tous les hommes. Et
Crassus, dont la sagesse, dont l'éloquence, dont
le rang était si considérable, n'a-t-il pas eu de même un
petit-fils, qui ne tenait rien de son mérite? Combien d'autres
grands hommes, qu'il est inutile de nommer, ont eu une
postérité indigne d'eux ? Mais où tend ce discours? Oublions-nous
qu'après en avoir dit assez sur l'immortalité de l'âme, notre
but présentement doit être de montrer que, même en supposant
l'âme mortelle, nous n'avons point à redouter la mort? L'A. Je
ne l'oubliais pas : mais tant que vous me parliez de l'immortalité,
je vous laissais volontiers perdre de vue l'autre objet.
XXXIV. C. Vos desseins, à ce que
je vois, sont grands ; vous aspirez au ciel. J'espère que nous
y arriverons. Mais enfin, puisqu'il y a des philosophes d'un
autre sentiment, prenons que l'âme soit mortelle. L'A. Toute
espérance d'une vie plus heureuse que celle-ci est donc nulle dès
lors? C. Que nous en revient-il de mal? Est-ce qu'après l'extinction
de l'âme, le sentiment continuera dans le corps? On ne l'a
jamais dit. Épicure, à la vérité, soupçonne Démocrite de
l'avoir cru: mais les partisans de Démocrite le nient. Or le
sentiment ne continuera pas non plus dans l'âme, puisque l'âme
n'existera plus. Dans quelle partie de l'homme feriez-vous donc
résider le mal? Car il n'y a qu'âme et corps. Le mettez-vous en ce
que la séparation de l'un et de l'autre ne se fait pas sans douleur?
Mais cette douleur combien peu dure-t-elle? D'ailleurs,
êtes-vous sûr qu'il y ait de la douleur? Je crois, moi,
qu'on meurt pour l'ordinaire sans le sentir, et que même
quelquefois il s'y trouve du plaisir. Quoi qu'il en soit, ce
qui se passe alors en nous ne saurait être que peu de chose,
puisque c'est l'affaire d'un instant. L'A. Par où la mort nous
afflige, nous met au désespoir, c'est que dans ce moment
nous quittons les biens de cette vie. C. Peut-être, si vous
disiez ses misères, parleriez-vous plus juste. A quoi bon
déplorer ici la destinée des hommes? Je n'en aurais que trop de
sujet. Mais puisque ici mon but est de prouver qu'après la mort nous
n'aurons plus à souffrir, pourquoi rendre cette vie plus
fâcheuse encore par le récit des souffrances qui l'accompagnent? Je
les ai décrites dans ce livre, où j'ai cherché à me donner
autant que j'en étais capable, quelque consolation. La vérité,
si nous voulons en convenir, est que la mort nous enlève,
non pas des biens, mais des maux. Hégésias le prouvait si
éloquemment, que le roi Ptolémée, dit-on, lui
défendit de traiter cette matière, dans ses leçons publiques,
à cause que plusieurs de ses auditeurs se donnaient la mort. Nous
avons une épigramme de Callimaque sur Cléombrote d'Ambracie,
qui, sans avoir d'ail- 648
leurs aucun sujet de chagrin, se précipita dans la mer,
après avoir lu le Phédon. Et cet Hégésias, que je viens de
vous citer, a composé un livre où il fait parler un homme
déterminé à se laisser mourir de faim : les amis de cet homme
tâchent de l'en dissuader : lui, pour toute réponse, il
leur détaille les peines de cette vie. Je ne dirai point, à
l'exemple de ce philosophe, que la vie soit onéreuse
généralement à tout homme sans exception. Je ne parle pas des
autres. Pour ce qui est de moi, si j'étais mort avant que
d'avoir perdu, et secours domestiques, et fonctions du
barreau, et toutes dignités, n'est-il pas vrai que la
mort, loin de m'arracher des biens, m'eût fait prévenir
des maux?
XXXV. Mais jetons les yeux sur
quelqu'un d'heureux, que jamais la fortune n'ait traversé en
rien. Tel a été ce Métellus, qui s'est vu quatre fils élevés
aux premiers honneurs. Opposons-lui Priam, qui avait cinquante
fils, entre lesquels dix-sept de légitimes. Le pouvoir de la
fortune était le même sur ces deux hommes, elle fait grâce à
l'un, elle frappe l'autre. Métellus fut porté sur son bûcher
par ses fils, par ses filles, par tous leurs descendants
: et Priam, au contraire, après avoir vu égorger sa
nombreuse postérité, fut égorgé lui-même au pied d'un autel,
où il s'était réfugié. Or, supposons que la mort de Priam eût
précédé le carnage de ses enfants, et la chute de son royaume;
supposons qu'on l'eût vu paisiblement expirer
Au comble du bonheur, dans une
douce paix,
Sous les lambris dorés d'un superbe palais;
lequel eût-on dit, ou que la
mort lui enlevait des biens, ou qu'elle lui épargnait des
maux? On eût sans doute jugé qu'elle lui enlevait des biens.
L'événement prouve le contraire. Aujourd'hui nos théâtres ne
retentiraient pas de ces plaintes lamentables :
J'ai vu cette fameuse Troie
Au carnage, aux flammes en proie.
J'ai vu Priam expirer sous le fer,
Et souiller de son sang l'autel de Jupiter.
Comme si dans cette extrémité,
la mort n'était pas tout ce qu'il y a de mieux pour lui. En se
hâtant, elle lui eût sauvé d'étranges disgrâces. Mais au moins
lui en a-t-elle fait perdre le sentiment. Pompée, étant à
Naples, y tomba dangereusement malade. Dès que le danger fut
passé, tout Naples se couronna de fleurs; Pouzzol en fit de
même; les villes d'alentour signalèrent leur allégresse par des
fêtes publiques. Ce sont de petites flatteries à la Grecque,
mais qui font voir qu'un homme est dans la prospérité. S'il fût donc
mort dans ce temps-là, eût-il quitté des biens, ou des
maux? Assurément des maux, et très cruels. Il n'eût pas fait
la guerre à son beau-père; il ne s'y fût pas engagé sans
préparatifs; il n'eût pas abandonné son foyer; il ne se fût pas
enfui d'Italie ; il ne fût pas tombé, après la déroute de son
armée, seul et sans défense, entre les mains de
misérables esclaves, qui le poignardèrent; il n'eût pas laissé
sa famille dans une affreuse situation ; toute son opulence n'eût
pas été la proie du vainqueur. En mourant plus tôt, il mourait
comblé de gloire. Quels affreux, quels incroyables accidents,
une plus longue vie lui a-t-elle réservés?
XXXVI. La mort les prévient ces
accidents; et quand même ils ne devraient pas nous arriver,
c'est assez qu'ils soient possibles. Mais les hommes n'envisagent
l'avenir que du bon côté. Il n'y en a point qui ne se promettent le
sort de Métellus. Comme si le nombre des heureux passait celui des
misérables ; qu'il y eût quelque sorte de sta-
644 bilité dans les choses
humaines, et qu'il fût de la prudence d'espérer plutôt que de
craindre! Accordons pourtant que la mort nous fasse perdre des
biens. En conclurez-vous que les morts manquent de ces biens,
et que par conséquent ils souffrent? Mais de quoi peut manquer celui
qui n'est pas? A ce mot, manquer, nous attachons
une idée fâcheuse, parce que c'est comme si l'on disait,
avoir eu, n'avoir plus, désirer, tâcher d'avoir,
être dans le besoin. Tout cela ne peut avoir lieu qu'à l'égard des
vivants. Pour ce qui est des morts, on ne saurait dire que les
commodités de la vie leur manquent, pas même la vie. Car selon
ce que nous supposons à présent, les morts ne sont rien. On ne
dirait pas de nous vivants, que nous manquons de plumes ou de
griffes. Pourquoi? Parce que n'avoir pas des choses qui ne nous sont
ni utiles, ni convenables, ce n'est pas manquer. Il n'y
a qu'à bien insister là-dessus, lorsqu'une fois on est convenu
que les âmes sont mortelles, et que par conséquent, à la
mort, nous sommes tellement anéantis, qu'on ne saurait
nous soupçonner de conserver le moindre sentiment. Il n'y a,
dis-je, qu'à bien examiner ce qu'on appelle manquer, et
on verra que ce terme, pris dans son vrai sens, ne
saurait être appliqué à un mort. Car manquer, dit avoir
besoin; le besoin suppose du sentiment; un mort est insensible; donc
il ne manque point.
XXXVII. Est-il nécessaire après tout,
de tant philosopher sur une chose qui sans philosophie se comprend
assez, puisqu'on a vu tant de fois courir à une mort certaine,
non pas nos généraux seulement, mais nos armées entières?
Brutus, si la mort était à redouter, ne l'aurait pas
affrontée dans une bataille, pour empêcher le retour du tyran
qu'il avait lui-même chassé. Jamais les trois Décies ne se fussent
jetés, comme ils firent, au milieu des ennemis; le père
en combattant contre les Latins; le fils, contre les Etruriens;
le petit-fils, contre Pyrrhus. L'Espagne n'eût pas vu deux
Scipions, dans une même guerre, verser leur sang pour la
patrie. Paulus et Servilius n'auraient pas généreusement perdu la
vie à Cannes; Marcellus à Vénouse; Albinus dans le pays des Latins;
Gracchus dans la Lucanie. Quelqu'un d'eux souffre-t-il aujourd'hui?
Dès l'instant même qu'ils eurent rendu le dernier soupir, ils
cessèrent de pouvoir souffrir. Car on ne souffre plus, dès
qu'on a perdu tout sentiment. L'A. Perdre tout sentiment,
n'est-ce donc pas quelque chose d'affreux? C. Oui, si celui
qui a perdu le sentiment, connaissait qu'il l'a perdu. Mais
puisqu'il est clair que le non-être n'est susceptible de rien,
il n'y a donc rien de fâcheux pour qui n'est pas, et ne sent
pas. C'est trop souvent le répéter. Il est pourtant à propos d'y
revenir, parce que c'est faute d'y faire attention, que
l'on craint la mort. Car si l'on voulait bien comprendre,
ce qui est plus clair que le jour, qu'après la destruction de
l'âme et du corps, l'animal est si parfaitement anéanti,
que dès lors il n'est absolument rien, on verrait
645 qu'il n'y a nulle
différence aujourd'hui entre un Hippocentaure qui n'exista jamais,
et le roi Agamemnon qui existait autrefois : et que Camille n'est
aujourd'hui pas plus sensible à notre guerre civile, que moi,
de son vivant, je l'étais à la prise de Rome. Pourquoi
cependant Camille se fût-il affligé, s'il eût prévu qu'environ
trois cent cinquante après lui; nous serions en guerre les uns avec
les autres? Et pourquoi me chagrinerais-je, si je prévoyais
que dans dix mille ans une nation barbare envahira l'empire romain?
Parce que l'amour que nous portons à la patrie se mesure, non
sur la part que nous aurons à son sort, mais sur l'intérêt que
nous prenons à son salut.
XXXVIII. Quoiqu'a toute heure mille
accidents nous menacent de la mort, et que même, sans
accident, elle ne puisse jamais être bien éloignée, vu
la brièveté de nos jours, cependant elle n'empêche pas le Sage
de porter ses vues le plus loin qu'il peut dans l'avenir, et
de regarder l'avenir comme étant à lui, en tant que la patrie
et les siens y sont intéressés. Tout mortel qu'il se croit, il
travaille pour l'éternité. Et le motif qui l'anime, ce n'est
pas la gloire, car il sait qu'après sa mort il y sera
insensible : mais c'est la vertu, dont la gloire est toujours
une suite nécessaire, sans que l'on y ait même pensé. Tel est
effectivement l'ordre de la nature, que tout commence pour
nous à notre naissance, et que tout finit pour nous à notre
mort. Comme rien avant notre naissance ne nous intéressait, de
même rien après notre mort ne nous intéressera. Que craignons-nous
donc, puisque la mort n'est rien, ni pour les vivants,
ni pour les morts? Rien pour les morts, car ils ne sont plus.
Rien pour les vivants, car ils ne sont pas encore dans le cas
de l'éprouver. Ceux qui veulent adoucir cette idée d'anéantissement,
disent que la mort ressemble au sommeil. Mais souhaiteriez-vous
quatre-vingt-dix années de vie, à condition de passer les
trente dernières à dormir? Un porc n'en voudrait pas. Endymion,
si l'on en croit la Fable; s'endormit, il y a je ne sais
combien de siècles, sur le mont Latmos en Carie, ou
peut-être dort-il encore. Ce fut, dit-on, la Lune,
qui, pour pouvoir le baiser plus à son aise, le jeta
dans ce profond sommeil. Or pensez-vous que, lorsqu'elle
s'éclipse, il s'en inquiète? Comment s'en inquiéterait-il,
puisqu'il n'a pas de sentiment? Voilà l'image de la mort, le
sommeil. Et vous doutez si la mort nous prive de sentiment,
vous qui tous les jours expérimentez que le sommeil, qui n'en
est que l'image, opère le même effet?
XXXIX Peut-on, après cela,
donner dans ce préjugé ridicule, qu'il est bien triste de
mourir avant le temps? Et de quel temps veut-on parler? De celui que
la nature a fixé? Mais elle nous donne la vie, comme on prête
de l'argent, sans fixer le terme du remboursement. Pourquoi
trouver étrange qu'elle la reprenne, quand il lui plaît? Vous
ne l'avez reçue qu'à cette condition. Qu'un petit enfant meure,
on s'en console. Qu'il en meure un au berceau, on n'y songe
seulement pas. C'est pourtant d'eux que la nature a exigé le plus
durement sa dette. Mais, dit-on, ils n'avaient pas
encore goûté les douceurs de la vie; au lieu que tel autre,
pris dans un âge plus avancé, se promettait une fortune
riante, et déjà commençait à en jouir. D'où vient qu'il n'en
est donc pas de la vie comme des autres biens, dont on aime
mieux avoir une partie, que de manquer le tout? Priam,
dit Callimaque, et c'est une sage réflexion, Priam a
plus souvent pleuré que 646
Troïlus. On loué la destinée de ceux qui meurent de vieillesse. Par
quelle raison? Il me semble, au contraire, que si les
vieillards avaient plus de temps à vivre, c'est eux dont la
vie serait la plus agréable. Car de tous les avantages dont l'homme
peut se flatter, la prudence est certainement le plus
satisfaisant; et quand il serait vrai que la vieillesse nous prive
de tous les autres, du moins nous procure-t-elle celui-là.
Mais qu'appelle-t-on vivre longtemps? Eh! qu'y a-t-il pour nous
qu'on puisse appeler durable? Il n'y a qu'un pas de l'enfance à la
jeunesse; et notre course est à peine commencée, que la
vieillesse nous atteint, sans que nous y pensions. Comme la
vieillesse est notre borne, nous appelons cela un grand âge.
Vous n'êtes censé vivre peu, ou beaucoup, que
relativement à ce que vivent ceux-ci, ou ceux-là. Aristote dit
que sur les bords du fleuve Hypanis, qui tombe du côté de
l'Europe dans le Pont-Euxin, il se forme de certaines petites
bêtes, qui ne vivent que l'espace d'un jour. Celle qui meurt à
deux heures après midi, meurt bien âgée; et celle qui va
jusqu'au coucher du soleil, meurt décrépite, surtout un
grand jour d'été. Si vous comparez avec l'éternité la vie de l'homme
la plus longue, vous trouverez que ces petites bêtes y
tiennent presque autant de place que nous.
XL. Méprisons donc toutes ces
faiblesses, car quel autre nom donner aux idées que l'on se
fait d'une mort prématurée? Cherchons la félicité de la vie dans la
constance, dans la grandeur d'âme, dans le mépris des
choses humaines, dans toute sorte de vertus. Hé quoi, de
vaines imaginations nous efféminent! Que les Chaldéens nous aient
fait de belles promesses, nous croyons, si la mort en
prévient l'effet, avoir été trahis, et réellement volés.
Dans l'attente de ce qui nous arrivera, nos désirs sont sans
cesse balancés par nos craintes, et ce n'est qu'angoisses et
que perplexités. Heureux le moment après lequel nous n'aurons plus
d'inquiétude, plus de souci! Que j'aime à me représenter le
grand courage de Théramène! Car sa mort, quoiqu'on ne puisse
la lire sans pleurer, n'est pourtant digne que d'admiration,
et nullement de pitié. Ayant été mis en prison par l'ordre des
trente Tyrans, il avala, comme s'il avait eu soif,
la liqueur empoisonnée : et après avoir bu, il jeta ce qui en
restait, de manière que cela fit un peu de bruit. Je la
porte, dit-il en souriant, au beau Critias,
qui avait été de tous ses juges le plus acharné à sa perte. Les
Grecs ont cette coutume dans leurs festins, de nommer,
quand ils ont bu, celui à qui la coupe doit passer. Ce grand
homme, lorsque déjà le poison courait dans ses veines,
plaisanta; et bientôt après sa mort, celle de Critias vérifia
son présage. Une intrépidité si marquée, et poussée si loin,
mériterait-elle nos louanges, si la mort était un mal? A
quelques années de là, Socrate, livré à des juges aussi
injustes que l'avaient été les Tyrans à l'égard de Théramène,
est mis dans la même prison, et condamné à boire dans la même
coupe. Quel discours donc tient-il à ses juges après que sa sentence
lui a été prononcée? Le voici, tel que Platon l'a rendu.
XLI. «Je suis véritablement plein de
cette espérance, que la mort qui m'attend, sera un
avantage pour moi. Car il faut nécessairement l'un des deux,
ou qu'à la mort nous perdions tout sentiment, ou qu'en sortant
de ces lieux nous allions en d'autres. Si donc nous perdons tout
sentiment, et que la mort ressemble à un profond
647 sommeil, dont la
tranquillité n'est troublée par aucun songe, bons Dieux ! que
l'on gagne à mourir? Y a-t-il bien des jours qui soient préférables
à une nuit passée dans un si doux sommeil? Et supposé qu'après la
mort, toute l'éternité ressemble à une telle nuit, quel
homme plus heureux que moi! Mais si, comme on le dit, la
mort nous envoie dans un séjour destiné à une autre vie, c'est
un bonheur plus grand encore. Quoi, échapper d'entre les mains
de juges qui n'en ont que le nom; se trouver devant Minos,
Rhadamanthe, Éaque, Triptolème, qui sont de
véritables juges; et n'avoir plus de commerce qu'avec des âmes qui
ont toujours chéri la justice et la probité! Que pensez-vous d'un
voyage dont le terme est si agréable? Vous paraît-il que de pouvoir
converser avec Orphée, avec Musée, avec Homère,
Hésiode, cela soit à compter pour peu? Je voudrais, s'il
était possible, mourir plusieurs fois, pour arriver où
l'on jouit de cette félicité. Quel charme pour moi d'y voir
Palamède, Ajax, tant d'autres qui ont été injustement
condamnés! Il me semble qu'à nous conter nos aventures, nous y
trouverions un plaisir réciproque. Mais un plaisir que je mettrais
au-dessus de tous, ce serait d'y passer le temps à interroger,
à examiner les uns et les autres, comme j'ai fait ici,
pour démêler ceux qui ont été véritablement sages, d'avec ceux
qui, ne l'étant pas, se piquaient de l'être. J'y
étudierais, par exemple, quelle a été la sagesse du roi
Agamemnon, celle d'Ulysse, de Sisyphe, d'une
infinité d'autres hommes et femmes. Et pour avoir fait cet examen,
il ne m'arriverait point, comme ici, d'être condamné au
dernier supplice. Juges, qui avez été d'avis de m'absoudre,
ne vous faites pas non plus une idée terrible de la mort. Un homme
de bien, ni pendant la vie, ni après la mort,
ne peut recevoir de mal. Jamais les Dieux immortels ne
l'abandonnent. Et ce qui m'arrive à moi, n'est point l'effet
du hasard. Je ne me plains, ni de ceux qui m'ont accusé,
ni de ceux qui m'ont condamné ou si j'ai à m'en plaindre,
c'est seulement parce que leur intention était de me nuire.» La fin
de son discours mérite encore plus d'attention. « Il est temps »,
dit-il, « que nous nous séparions, moi, pour
mourir; vous, pour continuer à vivre. Des deux lequel est le
meilleur? Les Dieux immortels le savent, mais je crois
qu'aucun homme ne le sait ».
XLII. Que cette fermeté de Socrate est
bien, selon moi, préférable à toute la fortune de ceux
qui le condamnèrent ! Du reste, quoiqu'il dise que les Dieux
savent eux seuls lequel vaut le mieux de la vie ou de la mort,
ce n'est pas qu'il ne le sache très bien lui-même; car il s'en est
expliqué auparavant : mais comme c'était sa coutume de ne rien
affirmer, il la garde jusqu'au bout. Pour nous,
tenons-nous-en à cette maxime, que rien de tout ce qui est
donné par la Nature à tous les hommes, n'est un mal; et
comprenons que si la mort était un mal, ce serait un mal
éternel. Car, d'une vie misérable, la mort en paraît
être la fin : au lieu que si d'autres misères suivent la mort,
il n'y a plus de fin à espérer. Mais devais-je recourir à Socrate et
à Théramène, deux hommes d'une si rare vertu, et d'une
sagesse si renommée, puisque ce grand mépris de la mort s'est
vu dans un simple Lacédémonien, dont même le nom n'est pas
venu jusqu'à nous? Condamné au dernier supplice par les éphores,
il s'y rendait d'un air gai et riant, lorsqu'un
648 de ses ennemis lui dit
: « Est-ce que tu méprises les lois de Lycurgue? » A quoi il répond
: « J'ai au contraire bien des grâces à lui rendre de ce qu'il m'a
condamné à une amende, que je puis payer sans emprunt ». Vrai
Lacédémonien, et qui fait honneur à sa patrie! J'ai peine à
croire qu'avec cette fermeté d'esprit, il pût n'être pas
innocent. Rome a fourni une infinité de grands courages mais
n'aurais-je pas tort de vanter ici nos généraux, et ceux qui
ont eu les premiers emplois dans nos armées, puisque Caton
écrit que souvent des légions entières sont allées avec joie dans
des lieux d'où elles croyaient ne devoir pas revenir? Telle fut
l'intrépidité de ces Lacédémoniens, qui périrent aux
Thermopyles, et que Simonide fait ainsi parler dans leur
épitaphe: « Passant, qui nous vois ici, va dire à Sparte
que nous y sommes morts en obéissant aux lois saintes de la patrie
». Quel discours leur tient Léonidas, leur chef? «
Lacédémoniens, marchons hardiment, ce soir peut-être
nous souperons chez les morts ». Un d'eux ayant entendu qu'un Perse
disait par bravade, « Nous darderons tant de flèches qu'ils ne
verront pas le soleil » - « Hé bien », reprit-il, « nous
nous battrons à l'ombre ». Je ne parle là que des hommes : et quelle
fermeté dans cette Lacédémonienne, qui, apprenant que
son fils avait été tué dans un combat, « Voilà,
dit-elle, pourquoi je l'avais mis au monde; c'était pour
défendre sa patrie au prix de son sang ».
XLIII. Tant que les lois de Lycurgue
furent en vigueur à Sparte, il y eut de la valeur.
L'éducation, il faut l'avouer, servait fort à en faire
des hommes courageux, et durs à eux-mêmes. Mais
n'admirons-nous pas Thèodore de Cyrène, célèbre philosophe,
qui, menacé par le roi Lysimaque d'être pendu à une croix : «
Intimidez », lui dit-il, « vos courtisans avec de telles
menaces; pour Théodore, il lui est indifférent qu'il
pourrisse, ou dans la terre, ou dans l'air ». Réponse
qui me fait songer qu'il est à propos de parler ici de la sépulture
et des funérailles. Il n'y a qu'un mot à en dire, surtout
après ce que nous venons de voir, que les morts ne sentent
rien. On voit dans le Phédon, que j'ai déjà tant cité,
de quelle manière Socrate pensait sur ce sujet. Quand il eut bien
raisonné sur l'immortalité de l'âme, et que déjà son dernier
moment approchait, Criton lui demanda comment il souhaitait
d'être enterré. « Mes amis », reprit Socrate, « je me
suis donné une peine bien inutile, puisque je n'ai pas
persuadé à notre cher Criton que je m'envolerai d'ici, et que
je n'y laisserai rien de moi. Cependant, Criton, si vous
pouvez me rejoindre, ou si vous me trouvez quelque part,
ordonnez, comme il vous plaira, de ma sépulture. Mais,
croyez-moi, aucun de vous ne m'atteindra, quand je serai
parti d'ici ». Une parfaite indifférence de sa part, une
entière liberté à son ami, rien de mieux. Diogène pensait de
même, mais en qualité de Cynique, il s'est plus durement
expliqué : « Qu'on me jette, dit-il, au milieu des
champs ». - Pour être dévoré par lés vautours? Repartent ses amis. -
Point du tout, mettez auprès de moi un bâton pour les chasser.
- Hé ! comment les chasser, ajoutèrent-ils, puisque vous
ne les sentirez pas? - Si je ne les sens pas, reprit Diogène,
quel mal donc me feront-ils en me dévorant? Anaxagore étant
dangereusement malade à Lampsaque, ses amis lui demandèrent
s'il voulait être reporté à Clazomène sa patrie. Il leur répondit
très bien: « Cela n'est pas nécessaire, car de quelque endroit
que 649 ce soit,
on est également proche des enfers ». A ce sujet donc la seule
réflexion à faire, c'est que la sépulture ne regarde que le
corps, soit que l'âme périsse avec le corps, soit quelle
lui survive. Or, dans l'un et dans l'autre cas, il est
certain que le corps ne conserve point de sentiment.
XLIV. Mais tout est rempli d'erreurs.
Achille traîne Hector attaché à son char; apparemment il se figure
qu'Hector le sent; il croit par là se venger; et l'on se récrie
là-dessus, comme sur la chose du monde la plus douloureuse :
A la suite d'un char, ah! j'en
frémis encor,
Quatre coursiers traînaient le redoutable Hector.
Quel Hector? Et pour combien de temps
sera-t-il Hector? Un autre de nos poètes fait parler Achille plus
sagement :
De son illustre fils Priam n'a que le
corps,
Et j'ai précipité son âme aux sombres bords.
Votre char, Achille, ne
traînait donc pas Hector; il ne traînait qu'un corps qui avait été
celui d'Hector. Un autre sortant de dessous terre, réveille sa
mère, et lui dit,
O vous, dont le sommeil tient
les sens assoupis,
Ma mère, écoutez-moi, prenez pitié d'un fils.
Quand ces vers sont récités d'un ton
lugubre, et qui émeut tous les spectateurs, il est
difficile de ne pas croire dignes de pitié, ceux à qui les
devoirs funèbres n'ont pas été rendus.
Souffrez que d'un bûcher les flammes
honorables
Dérobent aux vautours mes restes déplorables :
(Il craint que si ses membres sont
déchirés, il ne puisse s'en servir; mais il ne le craint pas
si on les brûle.)
Et ne leur laissez pas, sur ces
champs désolés,
Trainer d'un roi sanglant les os demi-brûlés.
Puisqu'il récite de si beaux vers au
son de la flûte, je ne vois pas de quoi il a peur. Un principe
certain, c'est qu'on ne doit point se mettre en peine de ce
qui n'arrive qu'après la mort, quoiqu'il y ait des fous qui
étendent leur vengeance jusque sur le cadavre de leur ennemi.
Thyeste, dans une tragédie d'Ennius, faisant des
imprécations contre Atrée, lui souhaite de périr par un
naufrage. C'est lui souhaiter un affreux genre de mort, et qui
fait cruellement souffrir. Mais ce qu'il ajoute :
Que poussé sur un roc de pointes
hérissé,
Il meure furieux, de mille coups percé;
Que de leur sang impur ses entrailles livides
Noircissent les ronces arides;
c'est une imprécation bien vaine,
car le rocher où il veut qu'on l'attache, n'est pas plus
insensible que le cadavre, pour lequel il s'imagine que ce
sera un grand tourment d'y être attaché. La peine serait horrible
pour qui la sentirait; elle est nulle pour qui ne sent rien. Il
ajoute encore une autre chose, qui n'est pas moins frivole:
Et qu'exclu de la tombe, il soit privé du port,
Qui nous met à l'abri des atteintes du sort.
Quelle erreur de se figurer que le
tombeau soit comme un port où le cadavre est à l'abri, et où
le mort prend du repos! Pélops n'est pas excusable d'avoir si mal
endoctriné son fils, et de ne lui avoir pas donné de plus
saines idées.
XLV. Mais pourquoi nous arrêter aux
opinions de quelques particuliers? Tous les peuples ont leurs
préjugés. Les Égyptiens embaument
650 les morts, et les gardent dans leurs maisons.
Les Perses les enduisent de cire, pour les conserver le plus
qu'ils peuvent. Les Mages n'enterrent les leurs qu'après les avoir
fait déchirer par des bêtes. En Hyrcanie on croit que d'être mangé
par un chien, c'est le tombeau le plus honorable. Ils ont pour
cet effet une espèce particulière de chiens, dont ils font
grand cas. Les riches en nourrissent chez eux pour leur personne,
il y en a de nourris pour le commun aux frais du public; et chacun,
selon ses facultés, pourvoit à ce qu'il soit déchiré après sa
mort. Chrysippe, qui se plaisait fort aux recherches
historiques, parle de quantité d'autres coutumes semblables,
mais parmi lesquelles il s'en trouve de si vilaines, que
j'aurais horreur de les rapporter. Ou voit donc par tout. Ce que
j'ai dit, que nous n'avons point à nous inquiéter de nos
funérailles. Mais d'un autre côté aussi, nous ne devons pas
négliger celles de nos proches, quoique les morts ne sachent
point ce qui se fait pour eux. C'est aux vivants à regarder ce
qu'ils doivent en pareil cas à la bienséance, et à la coutume;
persuadés que c'est leur affaire propre, et que les morts n'y
sont intéressés en rien. Quant aux mourants, ce leur est une
ressource bien consolante, que le souvenir d'une belle vie. En
quelque temps que meure un homme qui a toujours fait tout le bien
qu'il a pu, il n'a point à se plaindre de n'avoir pas vécu
assez. Pour moi, je me suis vu, en diverses
conjonctures, où ma mort se fût placée bien à propos : et plût
à Dieu qu'elle n'eût pas tardé à venir! Je ne pouvais m'acquérir une
plus haute réputation; j'avais rempli tous les devoirs de la
société; il ne me restait qu'à combattre la fortune. Aujourd'hui
donc, si ma raison n'a pas la force de m'aguerrir contre la
mort, je n'ai qu'à me remettre devant les yeux ce que j'ai
fait, et je trouverai que ma vie n'aura pas été trop courte,
à beaucoup près. Car enfin, quoique l'anéantissement
nous rende insensibles, cependant la gloire qu'on s'est
acquise est un bien dont il ne nous prive pas : et quoiqu'on ne
recherche point la gloire directement pour elle-même, elle ne
laisse pas pourtant de marcher toujours à la suite de la vertu,
comme l'ombre à côté du corps. Il est bien vrai que quand les hommes
s'accordent unanimement à louer les vertus d'un mort, ces
louanges font plus d'honneur à ceux qui les donnent, qu'elles
ne servent à la félicité de celui qui en est l'objet.
XLVI. Mais après tout, de
quelque manière qu'on l'entende, je ne saurais dire
qu'aujourd'hui Lycurgue et Solon n'aient pas la gloire d'avoir été
de grands législateurs : que Thémistocle et qu'Épaminondas n'aient
pas celle d'avoir été de grands guerriers. Plutôt Salamine sera
ensevelie dans la mer, qu'on ne perdra le souvenir de la
victoire remportée à Salamine : et plutôt la ville de Leuctres sera
détruite, que la bataille de Leuctres ne tombera dans l'oubli.
Des noms encore plus durables, sont ceux de Curius, de
Fabricius, de Calatinus, des deux Scipions, des
deux Africains, de Maximus, de Marcellus, de
Paulus, de Caton, de Lélius, et de bien d'autres
Romains. Quiconque sera parvenu à retracer en soi quelques-unes de
leurs vertus, et non pas dans l'esprit du peuple, mais
au jugement des sages, il n'a, si l'occasion s'en
présente, qu'à marcher d'un pas intrépide à la mort,
persuadé que mourir est le souverain bien, ou que du moins ce
n'est pas un mal. Il souhaitera même d'être surpris au milieu de ses
prospérités, parce que le plaisir de les accroître ne saurait
être aussi vif pour lui, que le chagrin qu'il risque d'en dé-
651 choir. Et c'est
apparemment ce qu'un Lacédémonien voulait faire entendre à Diagoras
de Rhodes, lequel, après avoir été autrefois couronné
lui-même aux Jeux Olympiques, eut la joie d'y voir ses deux
fils couronnés dans une même journée. Il aborda le vieux athlète,
et dans son compliment, « Mourez », lui dit-il, «
car vous ne monterez pas au ciel ». On attache parmi les Grecs,
ou plutôt anciennement on attachait à ces sortes de victoires
beaucoup d'honneur, peut-être trop. Ainsi ce Lacédémonien
jugeait qu'une famille, qui avait elle seule remporté trois
prix à Olympie, ne pouvait aspirer à rien de plus grand; et
que Diagoras par conséquent serait heureux, s'il ne demeurait
pas plus longtemps exposé aux coups de la fortune. Je vous avais
d'abord répondu en peu de mots : et ce peu vous suffisait à vous,
car vous étiez convenu qu'après la mort on ne souffrait pas. J'ai
poussé ensuite mes réflexions plus loin, exprès pour avoir de
quoi nous consoler, quand nous venons à perdre quelqu'un de
nos amis. Si nos intérêts en souffrent, et que ce soit là ce
qui cause notre affliction, il faut y mettre des bornes,
pour n'en pas laisser voir le principe, qui est l'amour de
nous-mêmes. Mais ce sera un tourment affreux, intolérable,
si nous avons dans l'esprit que les personnes qui sont l'objet de
nos regrets, conservent du sentiment, et se trouvent
plongées dans ces horreurs dont le peuple se forge l'idée. J'ai
voulu me désabuser là-dessus une bonne fois pour toutes : et de là
vient que peut-être j'ai été trop long.
XLVII. L'A. Vous trop long? Du moins
ce n'a pas été pour moi. Par la première partie de votre discours,
vous m'avez fait désirer la mort; par la dernière vous me l'avez
fait regarder, ou avec indifférence, ou avec mépris : et
ce qui résulte enfin de ce que j'ai entendu, c'est que la mort
bien sûrement ne doit point être comptée au nombre des maux. C.
Attendez-vous, que suivant les préceptes de la rhétorique,
je fasse ici une péroraison? Ou plutôt, ne faut-il pas que je
renonce pour jamais à tout ce qui sent l'orateur? L'A. Vous auriez
tort de renoncer à un art qui vous doit une partie de sa gloire. Et
pour le dire franchement, vous lui devez la vôtre. Ainsi
voyons cette péroraison. J'en suis curieux. C. On a coutume dans les
écoles de faire voir quelle opinion les Dieux ont de la mort : et
cela, non par des fictions, mais par des récits tirés
d'Hérodote, et de plusieurs autres auteurs. On raconte surtout
la fameuse histoire d'une prêtresse d'Argos, et de Cléobis et
Biton ses enfants. Un jour de sacrifice solennel, cette
prêtresse devant se trouver dans le temple à heure marquée, et
les bœufs qui devaient la conduire, tardant trop à venir,
ses deux enfants aussitôt quittèrent leurs habits, se
frottèrent d'huile, et s'étant attelés eux-mêmes,
traînèrent le char jusqu'au temple, qui était assez éloigné de
la ville. Quand la prêtresse fut arrivée, elle pria Junon de
leur accorder, en reconnaissance de leur amour filial,
le plus grand bien qui puisse arriver à l'homme : ils soupèrent avec
leur mère, ils s'endormirent après, et le lendemain
matin on les trouva morts. Trophonius et Agamède firent,
dit-on, une prière semblable après qu'ils eurent bâti le
temple de Delphes. En récompense d'un travail si considérable,
ils demandèrent à Apollon ce qui pouvait leur être le plus
avantageux, sans rien spécifier. Apollon leur fit entendre
qu'à trois jours de là ils seraient exaucés : et le troisième jour
on les trouva morts. D'où l'on infère qu'Apollon, ce
652 Dieu à qui tous les
autres Dieux ont donné en partage la connaissance de l'avenir,
a jugé que la mort était le plus grand bien de l'homme.
XLVIII. On rapporte aussi de Silène,
qu'ayant été pris par le roi Midas, il lui enseigna,
comme une maxime d'assez grand prix pour payer sa rançon, «
Que le mieux qui puisse arriver à l'homme, c'est de ne point
naître; et que le plus avantageux pour lui quand il est né,
c'est de mourir promptement ». Euripide, dans une de ses
tragédies, a employé cette pensée:
Qu'à l'un de nos amis un enfant vienne
à naître
Loin de fêter ce jour ainsi qu'un jour heureux,
On devrait au contraire en pleurer avec eux.
Mais si ce même enfant aussitôt cessait d'être,
C'est alors qu'il faudrait, en bénissant le sort,
Aller fêter le jour d'une si prompte mort .
Il y a quelque chose de semblable dans
la consolation de Crantor, où il est dit qu'un certain Élysius
de Térine, au désespoir d'avoir perdu son fils, alla
pour savoir la cause de sa mort, dans un lieu où l'on évoque
les ombres; et que là, pour réponse on lui donna ces vers par
écrit.
La mort est un bien désirable.
Les hommes dans l'erreur connaissent peu ce bien.
Ton cher fils en jouit par un sort favorable.
C'est son avantage et le tien.
Voilà sur quelles autorités on dit
dans les écoles, que les Dieux ont décidé cette question. Et
nous avons même l'Éloge de la mort, composé par Alcidamas,
qui fut un des grands rhéteurs de l'antiquité. Il a bâti son
discours sur l'énumération des misères humaines : les raisons
spéculatives des philosophes ne s'y trouvent pas : mais du côté de
l'éloquence, le discours a son mérite. Toutes les fois que les
autres rhéteurs parlent des morts souffertes pour la patrie,
ils en parlent comme des morts, non seulement glorieuses,
mais heureuses. Ils exaltent la mort d'Érechthée, de ses
filles, qui eurent le courage de prodiguer leur vie pour le
salut des Athéniens. Ils exaltent la mort de Codrus, qui,
pour n'être point reconnu à ses habits royaux, se déguisa en
esclave et se jeta au milieu des ennemis, parce que l'oracle
avait répondu qu'Athènes remporterait la victoire, si son roi
était tué dans le combat. Ils n'oublient pas Ménécée, qui,
sur un oracle à peu près semblable, versa son sang pour sa
patrie. Ils comblent d'éloges Iphigénie, qui se fit conduire
en Aulide, et demanda d'y être immolée, pour acheter au
prix de ses jours la perte des ennemis.
XLIX. De là passant à des temps moins
reculés, ils célèbrent la mémoire d'Harmodius et d'Aristogiton;
celle de Léonidas parmi les Spartiates; celle d'Épaminondas parmi
les Thébains. Et combien y a-t-il de nos Romains, qui ont
regardé une mort accompagnée de gloire, comme le plus digne
objet de leurs désirs? Mais les rhéteurs grecs n'en font pas
mention, parce qu'ils ne les connaissent point. Après de si
grands exemples, ne laissons pas d'employer toutes les forces
de l'éloquence, comme si nous haranguions du haut d'une
tribune, pour obtenir des hommes, ou qu'ils commencent à
désirer la mort, ou que du moins ils cessent de la craindre.
Car enfin, si elle ne les anéantit pas, et qu'en mourant
ils ne fassent que changer de séjour, y a-t-il rien de
653 plus désirable pour
eux? Et si elle les anéantit, quel plus grand avantage que de
s'endormir au milieu de tant de misères, et d'être doucement
enveloppé d'un sommeil qui ne finit plus? Je trouve, cela
étant, que notre Ennius, lorsqu'il disait :
Qu'on ne me rende point de funèbres
hommages,
parlait mieux que le sage Solon,
qui, au contraire, dit :
Qu'au jour de mon trépas, tous
mes amis en deuil
Gémissent, et de pleurs arrosent mon cercueil.
Pour nous, au cas que nous
recevions du ciel quelque avertissement d'une mort prochaine,
obéissons avec joie, avec reconnaissance, bien
convaincus que l'on nous tire de prison, et que l'on nous ôte
nos chaînes, afin qu'il nous arrive, ou de retourner
dans le séjour éternel, notre véritable patrie, ou
d'être à jamais quittes de tout sentiment et de tout mal. Que si le
ciel nous laisse notre dernière heure inconnue, tenons-nous
dans une telle disposition d'esprit, que ce jour, si
terrible pour les autres, nous paraisse heureux. Rien de ce
qui a été déterminé, ou par les Dieux immortels, ou par
notre commune mère, la Nature, ne doit être compté pour
un mal. Car enfin, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas
une cause aveugle qui nous a créés : mais nous devons l'être
certainement à quelque puissance, qui veille sur le genre
humain. Elle ne s'est pas donné le soin de nous produire, et
de nous conserver la vie, pour nous précipiter, après
nous avoir fait éprouver toutes les misères de ce monde, dans
une mort suivie d'un mal éternel. Regardons plutôt la mort comme un
asile, comme un port qui nous attend. Plût à Dieu que nous y
fussions menés à pleines voiles! Mais les vents auront beau nous
retarder, il faudra nécessairement que nous arrivions,
quoiqu'un peu plus tard. Or, ce qui est pour tous une
nécessité, serait-il pour moi seul un mal? Vous me demandiez
une péroraison, en voilà une, afin que vous ne
m'accusiez pas d'avoir rien omis. Je sens qu'elle me donne encore de
nouvelles forces contre les approches de la mort. C. J'en suis ravi.
Mais présentement songeons à prendre un peu de repos. Demain,
et tout le temps que nous serons à Tusculum, nous continuerons
nos entretiens, où surtout nous travaillerons à nous guérir de
nos chagrins, de nos erreurs, de nos passions. C'est de
toute la philosophie ce qu'on peut recueillir de plus utile. |
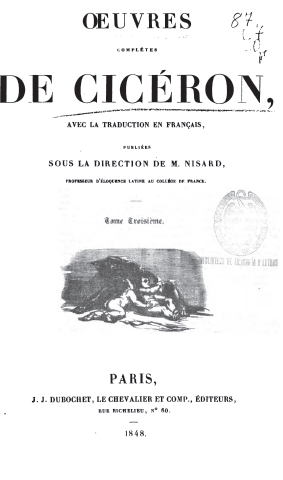
![]() Notes des Vrais biens et des Vrais Maux -
Tusculane II
Notes des Vrais biens et des Vrais Maux -
Tusculane II
![]()