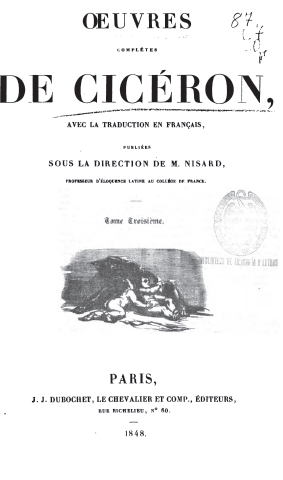|
LIBER QUARTUS
I. Quae cum dixisset, finem ille. Ego autem: Ne
tu, inquam, Cato, ista exposuisti, ut tam multa memoriter, ut tam obscura,
dilucide. Itaque aut omittamus contra omnino velle aliquid aut spatium sumamus
ad cogitandum; tam enim diligenter, etiam si minus vere— nam nondum id
quidem audeo dicere—, sed tamen accurate non modo fundatam, verum etiam
extructam disciplinam non est facile perdiscere. - Tum ille: Ain tandem? Inquit,
cum ego te hac nova lege videam eodem die accusatori respondere et tribus
horis perorare, in hac me causa tempus dilaturum putas? quae tamen a te agetur
non melior, quam illae sunt, quas interdum optines. Quare istam quoque aggredere
tractatam praesertim et ab aliis
et a te ipso saepe, ut
tibi deesse non possit oratio. - Tum ego: Non mehercule, inquam, soleo
temere contra Stoicos, non quo illis admodum assentiar, sed pudore impedior; ita
multa dicunt, quae vix intellegam. - Obscura, inquit, quaedam esse confiteor,
nec tamen ab illis ita dicuntur de industria, sed inest in rebus ipsis
obscuritas. - Cur igitur easdem res, inquam, Peripateticis dicentibus verbum
nullum est, quod non intellegatur? - Easdemne res? Inquit, an parum disserui non
verbis Stoicos a Peripateticis, sed universa re et tota sententia dissidere? -
Atqui, inquam, Cato, si istud optinueris, traducas me ad te totum licebit. -
Putabam equidem satis, inquit, me dixisse. Quare ad ea primum, si videtur; sin
aliud quid voles, postea. - Immo istud quidem, inquam, quo loco quidque, nisi
iniquum postulo, arbitratu meo. - Ut placet, inquit. Etsi enim illud erat
aptius, aequum cuique concedere.µ
II. Existimo igitur, inquam, Cato, veteres illos
Platonis auditores, Speusippum, Aristotelem, Xenocratem, deinde eorum,
Polemonem, Theophrastum, satis et copiose et eleganter habuisse constitutam
disciplinam, ut non esset causa Zenoni, cum Polemonem audisset, cur et ab eo
ipso et a superioribus dissideret. Quorum fuit haec institutio, in qua
animadvertas velim quid mutandum putes nec expectes, dum ad omnia dicam, quae a
te dicta sunt; universa enim illorum ratione cum tota vestra confligendum puto.
Qui cum viderent ita nos esse natos, ut et communiter ad eas virtutes apti
essemus, quae notae illustresque sunt, iustitiam dico, temperantiam, ceteras
generis eiusdem—quae omnes similes artium reliquarum materia tantum ad meliorem
partem et tractatione differunt—, easque ipsas virtutes viderent nos
magnificentius appetere et ardentius, habere etiam insitam quandam vel potius
innatam cupiditatem scientiae natosque esse ad congregationem hominum et ad
societatem communitatemque generis humani, eaque in maximis ingeniis maxime
elucere, totam philosophiam tris in partis diviserunt,
quam partitionem a Zenone esse
retentam videmus. Quarum cum una sit, qua mores conformari putantur, differo
eam partem, quae quasi stirps est huius quaestionis. Qui sit enim finis bonorum,
mox, hoc loco tantum dico, a veteribus Peripateticis Academicisque, qui re
consentientes vocabulis differebant, eum locum, quem civilem recte appellaturi
videmur, Graeci πολιτικόν, graviter et copiose esse tractatum.
III. Quam multa illi de re publica scripserunt,
quam multa de legibus! quam multa non solum praecepta in artibus, sed etiam
exempla in orationibus bene dicendi reliquerunt! primum enim ipsa illa, quae
subtiliter disserenda erant, polite apteque dixerunt tum definientes, tum
partientes, ut vestri etiam; sed vos squalidius, illorum vides quam niteat
oratio. Deinde ea, quae requirebant orationem ornatam et gravem, quam magnifice
sunt dicta ab illis, quam splendide! de iustitia, <de temperantia,> de
fortitudine, de amicitia, de aetate degenda, de philosophia, de capessenda re
publica, de temperantia de fortitudine hominum non spinas vellentium, ut Stoici,
nec ossa nudantium, sed eorum, qui grandia ornate vellent, enucleate minora
dicere. Itaque quae sunt eorum consolationes, quae cohortationes, quae etiam
monita et consilia scripta ad summos viros! erat enim apud eos, ut est rerum
ipsarum natura, sic dicendi
exercitatio duplex. Nam, quicquid quaeritur, id habet aut generis ipsius
sine personis temporibusque aut his adiunctis facti aut iuris aut nominis
controversiam. Ergo in utroque exercebantur, eaque disciplina effecit tantam
illorum utroque in genere dicendi copiam. Totum genus hoc Zeno et qui ab eo sunt
aut non potuerunt <tueri> aut noluerunt, certe reliquerunt. Quamquam scripsit
artem rhetoricam Cleanthes, Chrysippus etiam, sed sic, ut, si quis obmutescere
concupierit, nihil aliud legere debeat. Itaque vides, quo modo loquantur. Nova
verba fingunt, deserunt usitata. - At quanta conantur! mundum hunc omnem oppidum
esse nostrum! incendi igitur eos, qui audiunt, vides. Quantam rem agas,
ut Circeiis qui habitet totum hunc mundum suum
municipium esse existimet? - Quid? Ille incendat? Restinguet citius, si ardentem
acceperit.
Ista ipsa, quae tu breviter: regem, dictatorem,
divitem solum esse sapientem, a te quidem apte ac rotunde; quippe; habes enim a
rhetoribus; illorum vero ista ipsa quam exilia de virtutis vi! quam tantam
volunt esse, ut beatum per se efficere possit. Pungunt quasi aculeis
interrogatiunculis angustis, quibus etiam qui assentiuntur nihil commutantur
animo et idem abeunt, qui venerant. Res enim fortasse verae, certe graves, non
ita tractantur, ut debent, sed aliquanto minutius.
IV. Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;
nam de summo bono mox, ut dixi, videbimus et ad id explicandum disputationem
omnem conferemus. In his igitur partibus duabus nihil erat, quod Zeno commutare
gestiret. Res enim se praeclare habebat, et quidem in utraque parte. Quid enim
ab antiquis ex eo genere, quod ad disserendum valet, praetermissum est? qui et
definierunt plurima et definiendi artes reliquerunt, quodque est definitioni
adiunctum, ut res in partes dividatur, id et fit ab illis et quem ad modum fieri
oporteat traditur; item de contrariis, a quibus ad genera formasque generum
venerunt. Iam argumenti ratione conclusi caput esse faciunt ea, quae perspicua
dicunt, deinde ordinem sequuntur, tum, quid verum sit in singulis, extrema
conclusio est. Quanta autem ab illis varietas argumentorum ratione concludentium
eorumque cum captiosis interrogationibus dissimilitudo! Quid, quod plurimis
locis quasi denuntiant, ut neque sensuum fidem sine ratione nec rationis <sine>
sensibus exquiramus, atque ut eorum alterum ab altero <ne> separemus? Quid? Ea,
quae dialectici nunc tradunt et docent, nonne ab illis instituta aut inventa
sunt? De quibus etsi a Chrysippo maxime est elaboratum, tamen a Zenone minus
multo quam ab antiquis; ab hoc autem quaedam non melius quam veteres, quaedam
omnino relicta. Cumque duae sint artes, quibus perfecte ratio et oratio
compleatur, una inveniendi, altera disserendi, hanc posteriorem et Stoici
et Peripatetici, priorem autem illi egregie tradiderunt, hi omnino ne attigerunt
quidem. Nam e quibus locis quasi thesauris argumenta depromerentur, vestri ne
suspicati quidem sunt, superiores autem artificio et via tradiderunt. Quae
quidem res efficit, ne necesse sit isdem de rebus semper quasi dictata decantare
neque a commentariolis suis discedere. Nam qui sciet ubi quidque positum sit
quaque eo veniat, is, etiamsi quid obrutum erit, poterit eruere semperque esse
in disputando suus. Quod etsi ingeniis magnis praediti quidam dicendi copiam
sine ratione consequuntur, ars tamen est dux certior quam natura. Aliud est enim
poetarum more verba fundere, aliud ea, quae dicas, ratione et arte distinguere.
V. Similia dici possunt de explicatione naturae,
qua et hi utuntur et vestri, neque vero ob duas modo causas, quo modo Epicuro
videtur, ut pellatur mortis et religionis metus, sed etiam modestiam quandam
cognitio rerum caelestium affert iis, qui videant quanta sit etiam apud deos
moderatio, quantus ordo, et magnitudinem animi deorum opera et facta
cernentibus, iustitiam etiam, cum cognitum habeas quod sit summi rectoris ac
domini numen, quod consilium, quae voluntas; cuius ad naturam apta ratio vera
illa et summa lex a philosophis dicitur. Inest in eadem explicatione naturae
insatiabilis quaedam e cognoscendis rebus voluptas, in qua una confectis rebus
necessariis vacui negotiis honeste ac liberaliter possimus vivere. Ergo in hac
ratione tota de maximis fere rebus Stoici illos secuti sunt, ut et deos esse et
quattuor ex rebus omnia constare dicerent. Cum autem quaereretur res admodum
difficilis, num quinta quaedam natura videretur esse, ex qua ratio et
intellegentia oriretur, in quo etiam de animis cuius generis essent
quaereretur, Zeno id dixit esse ignem, non nulla deinde aliter, sed ea pauca; de
maxima autem re eodem modo, divina mente atque natura mundum universum et eius
maximas partis administrari. Materiam vero rerum et copiam apud hos exilem, apud
illos uberrimam reperiemus. Quam multa ab iis conquisita et collecta sunt de
omnium animantium genere, ortu, membris, aetatibus! quam multa de rebus iis,
quae gignuntur e terra! quam multae quamque de variis rebus et causae, cur
quidque fiat, et demonstrationes, quem ad modum quidque fiat! qua ex omni copia
plurima et certissima argumenta sumuntur ad cuiusque rei naturam explicandam.
Ergo adhuc, quantum equidem intellego, causa non videtur fuisse mutandi nominis.
Non enim, si omnia non sequebatur, idcirco non erat ortus illinc. Equidem etiam
Epicurum, in physicis quidem, Democriteum puto. Pauca mutat vel plura sane; at
cum de plurimis eadem dicit, tum certe de maximis. Quod idem cum vestri faciant,
non satis magnam tribuunt inventoribus gratiam.
VI. Sed haec hactenus. Nunc videamus, quaeso, de
summo bono, quod continet philosophiam, quid tandem attulerit, quam ob rem ab
inventoribus tamquam a parentibus dissentiret. Hoc igitur loco, quamquam a te,
Cato, diligenter est explicatum, finis hic bonorum qui continet philosophiam et
quis a Stoicis et quem ad modum diceretur, tamen ego quoque exponam, ut
perspiciamus, si potuerimus, quidnam a Zenone novi sit allatum. Cum enim
superiores, e quibus planissime Polemo, secundum naturam vivere summum bonum
esse dixissent, his verbis tria significari Stoici dicunt, unum eius modi,
vivere adhibentem scientiam earum rerum, quae natura evenirent. Hunc ipsum
Zenonis aiunt esse finem declarantem illud, quod a te dictum est, convenienter
naturae vivere. Alterum significari idem, ut si diceretur, officia media omnia
aut pleraque servantem vivere. Hoc sic expositum dissimile est superiori. Illud
enim rectum est—quod κατόρθωμα dicebas—contingitque sapienti soli, hoc autem
inchoati cuiusdam officii est, non perfecti, quod cadere in non nullos
insipientes potest. Tertium autem omnibus aut maximis rebus iis, quae secundum
naturam sint, fruentem vivere. Hoc non est positum in nostra actione. Completur
enim et ex eo genere vitae, quod virtute fruitur, et ex iis rebus, quae sunt
secundum naturam neque sunt in nostra potestate. Sed hoc summum bonum, quod
tertia significatione intellegitur, eaque vita, quae ex summo bono degitur, quia
coniuncta ei virtus est, in sapientem solum cadit, isque finis bonorum, ut ab
ipsis Stoicis scriptum videmus, a Xenocrate atque ab Aristotele constitutus est.
Itaque ab iis constitutio illa prima naturae, a qua tu quoque ordiebare, his
prope verbis exponitur:
VII. Omnis natura vult esse conservatrix sui, ut
et salva sit et in genere conservetur suo. Ad hanc rem aiunt artis quoque
requisitas, quae naturam adiuvarent in quibus ea numeretur in primis, quae est
vivendi ars, ut tueatur, quod a natura datum sit, quod desit, adquirat. Idemque
diviserunt naturam hominis in animum et corpus. Cumque eorum utrumque per se
expetendum esse dixissent, virtutes quoque utriusque eorum per se expetendas
esse dicebant, <et> cum animum infinita quadam laude anteponerent corpori,
virtutes quoque animi bonis corporis anteponebant. Sed cum sapientiam
totius hominis custodem et procuratricem esse vellent, quae esset naturae comes
et adiutrix, hoc sapientiae munus esse dicebant, ut, <cum> eum tueretur, qui
constaret ex animo et corpore, in utroque iuvaret eum ac contineret. Atque ita
re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona
facilem quandam rationem habere censebant; de animi bonis accuratius exquirebant
in primisque reperiebant inesse in iis iustitiae semina primique ex omnibus
philosophis natura tributum esse docuerunt, ut ii, qui procreati essent, a
procreatoribus amarentur, et, id quod temporum ordine antiquius est, ut coniugia
virorum et uxorum natura coniuncta esse dicerent, qua ex stirpe orirentur
amicitiae cognationum. Atque ab his initiis profecti omnium virtutum et originem
et progressionem persecuti sunt. Ex quo magnitudo quoque animi existebat, qua
facile posset repugnari obsistique fortunae, quod maximae res essent in
potestate sapientis. Varietates autem iniuriasque fortunae facile veterum
philosophorum praeceptis instituta vita superabat. Principiis autem a natura
datis amplitudines quaedam bonorum excitabantur partim profectae a
contemplatione rerum occultiorum, quod erat insitus menti cognitionis amor, e
quo etiam rationis explicandae disserendique cupiditas consequebatur; quodque
hoc solum animal natum est pudoris ac verecundiae particeps appetensque
coniunctionum hominum ad societatem animadvertensque in omnibus rebus, quas
ageret aut diceret, ut ne quid ab eo fieret nisi honeste ac decore, his initiis,
ut ante dixi, <et> seminibus a natura datis temperantia, modestia,
iustitia et omnis honestas perfecte absoluta est.
VIII. Habes, inquam, Cato, formam eorum, de quibus
loquor, philosophorum. Qua exposita scire cupio quae causa sit, cur Zeno ab hac
antiqua constitutione desciverit, quidnam horum ab eo non sit probatum; quodne
omnem naturam conservatricem sui dixerint, an quod omne animal ipsum sibi
commendatum, ut se et salvum in suo genere et incolume vellet, an <quod>, cum
omnium artium finis is esset, quem natura maxime quaereret, idem statui debere
de totius arte vitae, an quod, cum ex animo constaremus et corpore, et haec ipsa
et eorum virtutes per se esse sumendas. An vero displicuit ea, quae tributa est
animi virtutibus tanta praestantia? An quae de prudentia, de cognitione rerum,
de coniunctione generis humani, quaeque ab eisdem de temperantia, de modestia,
de magnitudine animi, de omni honestate dicuntur? Fatebuntur Stoici haec omnia
dicta esse praeclare, neque eam causam Zenoni desciscendi fuisse. Alia quaedam
dicent, credo, magna antiquorum esse peccata, quae ille veri investigandi
cupidus nullo modo ferre potuerit. Quid enim perversius, quid intolerabilius,
quid stultius quam bonam valitudinem, quam dolorum omnium vacuitatem, quam
integritatem oculorum reliquorumque sensuum ponere in bonis potius, quam
dicerent nihil omnino inter eas res iisque contrarias interesse? Ea enim omnia,
quae illi bona dicerent, praeposita esse, non bona, itemque illa, quae in
corpore excellerent, stulte antiquos dixisse per se esse expetenda; sumenda
potius quam expetenda. Ea denique omni vita, quae in una virtute consisteret,
illam vitam, quae etiam ceteris rebus, quae essent secundum naturam, abundaret,
magis expetendam non esse. Sed magis sumendam. Cumque ipsa virtus efficiat ita
beatam vitam, ut beatior esse non possit, tamen quaedam deesse sapientibus tum,
cum sint beatissimi; itaque eos id agere, ut a se dolores, morbos, debilitates
repellant.
IX. O magnam vim ingenii causamque iustam, cur
nova existeret disciplina! Perge porro. Sequuntur enim ea, quae tu scientissime
complexus es, omnium insipientiam, iniustitiam, alia vitia similia esse,
omniaque peccata esse paria, eosque, qui natura doctrinaque longe ad virtutem
processissent, nisi eam plane consecuti essent, summe esse miseros, neque inter
eorum vitam et improbissimorum quicquam omnino interesse, ut Plato, tantus ille
vir, si sapiens non fuerit, nihilo melius quam quivis improbissimus nec beatius
vixerit.
Haec videlicet est correctio philosophiae veteris
et emendatio, quae omnino aditum habere nullum potest in urbem, in forum, in
curiam. Quis enim ferre posset ita loquentem eum, qui se auctorem vitae graviter
et sapienter agendae profiteretur, nomina rerum commutantem, cumque idem
sentiret quod omnes, quibus rebus eandem vim tribueret, alia nomina inponentem,
verba modo mutantem, de opinionibus nihil detrahentem? Patronusne causae in
epilogo pro reo dicens negaret esse malum exilium, publicationem bonorum? Haec
reicienda esse, non fugienda? Nec misericordem iudicem esse oportere? In
contione autem si loqueretur, si Hannibal ad portas venisset murumque iaculo
traiecisset, negaret esse in malis capi, venire, interfici, patriam amittere? An
senatus, cum triumphum Africano decerneret, “quod
eius virtute” aut “felicitate” posset dicere, si neque virtus in ullo
nisi in sapiente nec felicitas vere dici potest? quae est igitur ista
philosophia, quae communi more in foro loquitur, in libellis suo? Praesertim
cum, quod illi suis verbis significent, in eo nihil novetur, de ipsis rebus
nihil mutetur eaedem res maneant alio modo. Quid enim interest, divitias, opes,
valitudinem bona dicas anne praeposita, cum ille, qui ista bona dicit, nihilo
plus iis tribuat quam tu, qui eadem illa praeposita nominas? Itaque homo in
primis ingenuus et gravis, dignus illa familiaritate Scipionis et Laelii,
Panaetius, cum ad Q. Tuberonem de dolore patiendo scriberet, quod esse caput
debebat, si probari posset, nusquam posuit, non esse malum dolorem, sed quid
esset et quale, quantumque in eo inesset alieni, deinde quae ratio esset
perferendi; cuius quidem, quoniam Stoicus fuit, sententia condemnata mihi
videtur esse inanitas ista verborum.
X. Sed ut propius ad ea, Cato, accedam, quae a te
dicta sunt, pressius agamus eaque, quae modo dixisti, cum iis conferamus, quae
tuis antepono. Quae sunt igitur communia vobis cum antiquis, iis sic utamur
quasi concessis; quae in controversiam veniunt, de iis, si placet, disseramus. -
Mihi vero, inquit, placet agi subtilius et, ut ipse dixisti, pressius. Quae enim
adhuc protulisti, popularia sunt, ego autem a te elegantiora desidero. - A mene
tu? Inquam. Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista
popularia. Sed primum positum sit nosmet ipsos commendatos esse nobis primamque
ex natura hanc habere appetitionem, ut conservemus nosmet ipsos. Hoc
convenit; sequitur illud, ut animadvertamus qui simus ipsi, ut nos, quales
oportet esse, servemus. Sumus igitur homines. Ex animo constamus et corpore,
quae sunt cuiusdam modi, nosque oportet, ut prima appetitio naturalis postulat,
haec diligere constituereque ex his finem illum summi boni atque ultimi. Quem,
si prima vera sunt, ita constitui necesse est: earum rerum, quae sint secundum
naturam, quam plurima et quam maxima adipisci. Hunc igitur finem illi tenuerunt,
quodque ego pluribus verbis, illi brevius secundum naturam vivere, hoc iis
bonorum videbatur extremum.
XI. Age nunc isti doceant, vel tu potius—quis enim
ista melius?—, quonam modo ab isdem principiis profecti efficiatis, ut honeste
vivere—id est enim vel e virtute vel naturae congruenter vivere—summum bonum
sit, et quonam modo aut quo loco corpus subito deserueritis omniaque ea, quae,
secundum naturam cum sint, absint a nostra potestate, ipsum denique officium.
Quaero igitur, quo modo hae tantae commendationes a natura profectae subito a
sapientia relictae sint. Quodsi non hominis summum bonum quaereremus, sed
cuiusdam animantis, is autem esset nihil nisi animus —liceat enim fingere
aliquid eius modi, quo verum facilius reperiamus—, tamen illi animo non esset
hic vester finis. Desideraret enim valitudinem, vacuitatem doloris, appeteret
etiam conservationem sui earumque rerum custodiam finemque sibi constitueret
secundum naturam vivere, quod est, ut dixi, habere ea, quae secundum naturam
sint, vel omnia vel plurima et maxima. Cuiuscumque enim modi animal
constitueris, necesse est, etiamsi id sine corpore sit, ut fingimus, tamen esse
in animo quaedam similia eorum, quae sunt in corpore, ut nullo modo, nisi
ut exposui, constitui possit finis bonorum. Chrysippus autem exponens
differentias animantium ait alias earum corpore excellere, alias autem animo,
non nullas valere utraque re; deinde disputat, quod cuiusque generis animantium
statui deceat extremum. Cum autem hominem in eo genere posuisset, ut ei
tribueret animi excellentiam, summum bonum id constituit, non ut excellere
animus, sed ut nihil esse praeter animum videretur.
XII. Uno autem modo in virtute sola summum bonum
recte poneretur, si quod esset animal, quod totum ex mente constaret, id ipsum
tamen sic, ut ea mens nihil haberet in se, quod esset secundum naturam, ut
valitudo est. Sed id ne cogitari quidem potest quale sit, ut non repugnet ipsum
sibi. - Sin dicit obscurari quaedam nec apparere, quia valde parva sint, nos
quoque concedimus; quod dicit Epicurus etiam de voluptate, quae minimae sint
voluptates, eas obscurari saepe et obrui. Sed non sunt in eo genere tantae
commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Itaque in
quibus propter eorum exiguitatem obscuratio consequitur, saepe accidit, ut nihil
interesse nostra fateamur, sint illa necne sint, ut in sole, quod a te
dicebatur, lucernam adhibere nihil interest aut teruncium adicere Croesi
pecuniae. Quibus autem in rebus tanta obscuratio non fit, fieri tamen potest, ut
id ipsum, quod interest, non sit magnum. Ut ei, qui iucunde vixerit annos decem,
si aeque vita iucunda menstrua addatur, quia momentum aliquod habeat ad iucundum
accessio, bonum sit; si autem id non concedatur, non continuo vita beata
tollitur. Bona autem corporis huic sunt, quod posterius posui, similiora. Habent
enim accessionem dignam, in qua elaboretur, ut mihi in hoc Stoici iocari
videantur interdum, cum ita dicant, si ad illam vitam, quae cum virtute degatur,
ampulla aut strigilis accedat, sumpturum sapientem eam vitam potius, quo haec
adiecta sint, nec beatiorem tamen ob eam causam fore. Hoc simile tandem est? Non
risu potius quam oratione eiciendum? Ampulla enim sit necne sit, quis non iure
optimo irrideatur, si laboret? At vero pravitate membrorum et cruciatu dolorum
si quis quem levet, magnam ineat gratiam, nec si ille sapiens ad tortoris
eculeum a tyranno ire cogatur, similem habeat vultum et si ampullam perdidisset,
sed ut magnum et difficile certamen iniens, cum sibi cum capitali adversario,
dolore, depugnandum videret, excitaret omnes rationes fortitudinis ac
patientiae, quarum praesidio iniret illud difficile, ut dixi, magnumque
proelium. Deinde non quaerimus, quid obscuretur aut intereat, quia sit admodum
parvum, sed quid tale sit, ut expleat summam. Una voluptas e multis obscuratur
in illa vita voluptaria, sed tamen ea, quamvis parva sit, pars est eius vitae,
quae posita est in voluptate. Nummus in Croesi divitiis obscuratur, pars est
tamen divitiarum. Quare obscurentur etiam haec, quae secundum naturam esse
dicimus, in vita beata; sint modo partes vitae beatae.
XIII. Atqui si, ut convenire debet inter nos, est
quaedam appetitio naturalis ea, quae secundum naturam sunt, appetens, eorum
omnium est aliquae summa facienda. Quo constituto tum licebit otiose ista
quaerere, de magnitudine rerum, de excellentia, quanta in quoque sit ad beate
vivendum, de istis ipsis obscurationibus, quae propter exiguitatem vix aut
ne vix quidem appareant.
Quid, de quo nulla dissensio est? Nemo enim est,
qui aliter dixerit quin omnium
naturarum simile esset id, ad quod omnia referrentur, quod est ultimum rerum
appetendarum. Omnis enim est natura diligens sui. Quae est enim, quae se umquam
deserat aut partem aliquam sui aut eius partis habitum aut vim aut ullius earum
rerum, quae secundum naturam sunt, aut motum aut statum? quae autem natura suae
primae institutionis oblita est? Nulla profecto <est>, quin suam vim retineat a
primo ad extremum. Quo modo igitur evenit, ut hominis natura sola esset, quae
hominem relinqueret, quae oblivisceretur corporis, quae summum bonum non in toto
homine, sed in parte hominis poneret? quo modo autem, quod ipsi etiam fatentur
constatque inter omnis, conservabitur ut simile sit omnium naturarum illud
ultimum, de quo quaeritur? Tum enim esset simile, si in ceteris quoque naturis
id cuique esset ultimum, quod in quaque excelleret. Tale enim visum est ultimum
Stoicorum. Quid dubitas igitur mutare principia naturae? quid enim dicis omne
animal, simul atque sit ortum, applicatum esse ad se diligendum esseque in se
conservando occupatum? quin potius ita dicis, omne animal applicatum esse ad id,
quod in eo sit optimum, et in eius unius occupatum esse custodia, reliquasque
naturas nihil aliud agere, nisi ut id conservent, quod in quaque optimum sit?
quo modo autem optimum, si bonum praeterea nullum est? Sin autem reliqua
appetenda sunt, cur, quod est ultimum rerum appetendarum, id non aut ex
omnium earum aut ex plurimarum et maximarum appetitione concluditur? Ut Phidias
potest a primo instituere signum idque perficere, potest ab alio inchoatum
accipere et absolvere, huic est sapientia similis; non enim ipsa genuit hominem,
sed accepit a natura inchoatum. Hanc ergo intuens debet institutum illud quasi
signum absolvere. - Qualem igitur hominem natura inchoavit? Et quod est munus,
quod opus sapientiae? quid est, quod ab ea absolvi et perfici debeat? Si est
nihil in eo, quod perficiendum est, praeter motum ingenii quendam, id est
rationem, necesse est huic ultimum esse ex virtute agere; rationis enim
perfectio est virtus; si est nihil nisi corpus, summa erunt illa: valitudo,
vacuitas doloris, pulchritudo, cetera. Nunc de hominis summo bono quaeritur;
XIX. Quid ergo dubitamus in tota eius natura
quaerere quid sit effectum? Cum enim constet inter omnes omne officium munusque
sapientiae in hominis cultu esse occupatum, alii—ne me existimes contra Stoicos
solum dicere—eas sententias afferunt, ut summum bonum in eo genere ponant, quod
sit extra nostram potestatem, tamquam de inanimo aliquo loquantur, alii contra,
quasi corpus nullum sit hominis, ita praeter animum nihil curant, cum praesertim
ipse quoque animus non inane nescio quid sit—neque enim id possum intellegere—,
sed in quodam genere corporis, ut ne is quidem virtute una contentus sit, sed
appetat vacuitatem doloris. Quam ob rem utrique idem faciunt, ut si laevam
partem neglegerent, dexteram tuerentur, aut ipsius animi,
ut fecit Erillus, cognitionem amplexarentur, actionem relinquerent.
Eorum enim omnium multa praetermittentium, dum eligant aliquid, quod sequantur,
quasi curta sententia; at vero illa perfecta atque plena eorum, qui cum de
hominis summo bono quaererent, nullam in eo neque animi neque corporis partem
vacuam tutela reliquerunt. - Vos autem, Cato, quia virtus, ut omnes
fatemur, altissimum locum in homine et maxime excellentem tenet, et quod eos,
qui sapientes sunt, absolutos et perfectos putamus, aciem animorum nostrorum
virtutis splendore praestringitis. In omni enim animante est summum aliquid
atque optimum, ut in equis, in canibus, quibus tamen et dolore vacare opus est
et valere; sic igitur in homine perfectio ista in eo potissimum, quod est
optimum, id est in virtute, laudatur. Itaque mihi non satis videmini considerare
quod iter sit naturae quaeque progressio. Non enim, quod facit in frugibus, ut,
cum ad spicam perduxerit ab herba, relinquat et pro nihilo habeat herbam, idem
facit in homine, cum eum ad rationis habitum perduxit. Semper enim ita adsumit
aliquid, ut ea, quae prima dederit, non deserat. Itaque sensibus rationem
adiunxit et ratione effecta sensus non reliquit. Ut si cultura vitium, cuius hoc
munus est, ut efficiat, ut vitis cum partibus suis omnibus quam optime se
habeat—, sed sic intellegamus—licet enim, ut vos quoque soletis, fingere aliquid
docendi causa—: si igitur illa cultura vitium in vite insit ipsa, cetera, credo,
velit, quae ad colendam vitem attinebunt, sicut antea, se autem omnibus vitis
partibus praeferat statuatque nihil esse melius in vite quam se. Similiter
sensus, cum accessit ad naturam, tuetur illam quidem, sed etiam se tuetur;
cum autem assumpta ratio est, tanto in dominatu locatur, ut omnia illa prima
naturae huius tutelae subiciantur. Itaque non discedit ab eorum curatione,
quibus praeposita vitam omnem debet gubernare, ut mirari satis istorum
inconstantiam non possim. Naturalem enim appetitionem, quam vocant ὁρμήν,
itemque officium, ipsam etiam virtutem tuentem volunt esse earum rerum, quae
secundum naturam sunt. Cum autem ad summum bonum volunt pervenire, transiliunt
omnia et duo nobis opera pro uno relinquunt, ut alia sumamus, alia expetamus,
potius quam uno fine utrumque concluderent.
XV. At enim iam dicitis virtutem non posse
constitui, si ea, quae extra virtutem sint, ad beate vivendum pertineant. Quod
totum contra est. Introduci enim virtus nullo modo potest, nisi omnia, quae
leget quaeque reiciet, unam referentur ad summam. Nam si †omnino nos†
neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti
ipsi principia dederimus; sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni
referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Duarum enim vitarum nobis
erunt instituta capienda. Facit enim ille duo seiuncta ultima bonorum, quae ut
essent vera, coniungi debuerunt; nunc ita separantur, ut disiuncta sint,
quo nihil potest esse perversius. Itaque contra est, ac dicitis; nam constitui
virtus nullo modo potest, nisi ea, quae sunt prima naturae, ut ad summam
pertinentia tenebit. Quaesita enim virtus est, non quae relinqueret naturam, sed
quae tueretur. At illa, ut vobis placet, partem quandam tuetur, reliquam
deserit. - Atque ipsa hominis institutio si loqueretur, hoc diceret, primos suos
quasi coeptus appetendi fuisse, ut se conservaret in ea natura, in qua ortus
esset. Nondum autem explanatum satis erat, quid maxime natura vellet. Explanetur
igitur. Quid ergo aliud intellegetur nisi uti ne quae pars naturae neglegatur?
In qua si nihil est praeter rationem, sit in una virtute finis bonorum; sin est
etiam corpus, ista explanatio naturae nempe hoc effecerit, ut ea, quae ante
explanationem tenebamus, relinquamus. Ergo id est convenienter naturae vivere, a
natura discedere. Ut quidam philosophi, cum a sensibus profecti maiora quaedam
et diviniora vidissent, sensus reliquerunt, sic isti, cum ex appetitione rerum
virtutis pulchritudinem aspexissent, omnia, quae praeter virtutem ipsam
viderant, abiecerunt obliti naturam omnem appetendarum rerum ita late patere, ut
a principiis permanaret ad fines, neque intellegunt se rerum illarum pulchrarum
atque admirabilium fundamenta subducere.
XVI. Itaque mihi videntur omnes quidem illi
errasse, qui finem bonorum esse dixerunt honeste vivere, sed alius alio magis,
Pyrrho scilicet maxime, qui virtute constituta nihil omnino, quod appetendum
sit, relinquat, deinde Aristo, qui nihil relinquere non est ausus, introduxit
autem, quibus commotus sapiens appeteret aliquid,
quodcumque in mentem incideret,
et quodcumque tamquam occurreret. Is hoc melior quam Pyrrho, quod aliquod genus
appetendi dedit, deterior quam ceteri, quod penitus a natura recessit. Stoici
autem, quod finem bonorum in una virtute ponunt, similes sunt illorum; quod
autem principium officii quaerunt, melius quam Pyrrho; quod ea non occurrentia
fingunt, vincunt Aristonem; quod autem ea, quae ad naturam accommodata et per se
assumenda esse dicunt, non adiungunt ad finem bonorum, desciscunt a natura et
quodam modo sunt non dissimiles Aristonis. Ille enim occurrentia nescio quae
comminiscebatur; hi autem ponunt illi quidem prima naturae, sed ea seiungunt a
finibus et a summa bonorum; quae cum praeponunt, ut sit aliqua rerum selectio,
naturam videntur sequi; cum autem negant ea quicquam ad beatam vitam pertinere,
rursus naturam relinquunt.
Atque adhuc ea dixi, causa cur Zenoni non
fuisset, quam ob rem a superiorum auctoritate discederet. Nunc reliqua videamus,
nisi aut ad haec, Cato, dicere aliquid vis aut nos iam longiores sumus. -
Neutrum vero, inquit ille. Nam et a te perfici istam disputationem volo, nec tua
mihi oratio longa videri potest. - Optime, inquam. Quid enim mihi potest esse
optatius quam cum Catone, omnium virtutum auctore, de virtutibus disputare? Sed
primum illud vide, gravissimam illam vestram sententiam, quae familiam ducit,
honestum quod sit, id esse bonum solum honesteque vivere bonorum finem, communem
fore vobis cum omnibus, qui in una virtute constituunt finem bonorum,
quodque dicitis, informari non posse virtutem, si quicquam, nisi quod honestum
sit, numeretur, idem dicetur ab illis, modo quos nominavi. Mihi autem aequius
videbatur Zenonem cum Polemone disceptantem, a quo quae essent principia naturae
acceperat, a communibus initiis progredientem videre ubi primum insisteret et
unde causa controversiae nasceretur, non stantem cum iis, qui ne dicerent quidem
sua summa bona esse a natura profecta, uti isdem argumentis, quibus illi
uterentur, isdemque sententiis.
XVII. Minime vero illud probo, quod, cum
docuistis, ut vobis videmini, bonum solum esse, quod honestum sit, tum rursum
dicitis initia proponi necesse esse apta et accommodata naturae, quorum ex
selectione virtus possit existere. Non enim in selectione virtus ponenda erat,
ut id ipsum, quod erat bonorum ultimum, aliud aliquid adquireret. Nam omnia,
quae sumenda quaeque legenda aut optanda sunt, inesse debent in summa bonorum,
ut is, qui eam adeptus sit, nihil praeterea desideret. Videsne ut, quibus summa
est in voluptate, perspicuum sit quid iis faciendum sit aut non faciendum? Ut
nemo dubitet, eorum omnia officia quo spectare, quid sequi, quid fugere debeant?
Sit hoc ultimum bonorum, quod nunc a me defenditur; apparet statim, quae sint
officia, quae actiones. Vobis autem, quibus nihil est aliud propositum nisi
rectum atque honestum, unde officii, unde agendi principium nascatur non
reperietis. Hoc igitur quaerentes omnes, et ii, qui quodcumque in mentem veniat
aut quodcumque occurrat se sequi dicent, et vos ad naturam revertemini.
Quibus natura iure responderit non esse verum aliunde finem beate vivendi, a se
principia rei gerendae peti; esse enim unam rationem, qua et principia rerum
agendarum et ultima bonorum continerentur, atque ut Aristonis esset explosa
sententia dicentis nihil differre aliud ab alio, nec esse res ullas praeter
virtutes et vitia, inter quas quicquam omnino interesset, sic errare Zenonem,
qui nulla in re nisi in virtute aut vitio propensionem ne minimi quidem momenti
ad summum bonum adipiscendum esse diceret et, cum ad beatam vitam nullum
momentum cetera haberent, ad appetitionem tamen rerum esse in iis momenta
diceret; quasi vero haec appetitio non ad summi boni adeptionem pertineret! Quid
autem minus consentaneum est quam quod aiunt cognito summo bono reverti se ad
naturam, ut ex ea petant agendi principium, id est officii? Non enim actionis
aut officii ratio impellit ad ea, quae secundum naturam sunt, petenda, sed ab
iis et appetitio et actio commovetur.
XVIII. Nunc venio ad tua illa brevia, quae
consectaria esse dicebas, et primum illud, quo nihil potest brevius: Bonum omne
laudabile, laudabile autem honestum, bonum igitur omne honestum. O plumbeum
pugionem! quis enim tibi primum illud concesserit?—quo quidem concesso nihil
opus est secundo; si enim omne bonum laudabile est, omne honestum est—quis
tibi ergo istud dabit praeter Pyrrhonem, Aristonem eorumve similes, quos tu non
probas? Aristoteles, Xenocrates, tota illa familia non dabit, quippe qui
valitudinem, vires, divitias, gloriam, multa alia bona esse dicant,
laudabilia non dicant. Et hi quidem ita non sola virtute finem bonorum contineri
putant, ut rebus tamen omnibus virtutem anteponant; quid censes eos esse
facturos, qui omnino virtutem a bonorum fine segregaverunt, Epicurum,
Hieronymum, illos etiam, si qui Carneadeum finem tueri volunt? Iam aut Callipho
aut Diodorus quo modo poterunt tibi istud concedere, qui ad honestatem aliud
adiungant, quod ex eodem genere non sit? Placet igitur tibi, Cato, cum res
sumpseris non concessas, ex illis efficere, quod velis? Iam
ille sorites <est>, quo nihil putatis esse vitiosius: quod bonum sit, id
esse optabile, quod optabile, id expetendum, quod expetendum, id laudabile,
deinde reliqui gradus. Sed ego in hoc resisto; eodem modo enim tibi nemo dabit,
quod expetendum sit, id esse laudabile. Illud vero minime consectarium, sed in
primis hebes, illorum scilicet, non tuum, gloriatione dignam esse beatam vitam,
quod non possit sine honestate contingere, ut iure quisquam glorietur. Dabit hoc
Zenoni Polemo, etiam magister eius et tota illa gens et reliqui, qui virtutem
omnibus rebus multo anteponentes adiungunt ei tamen aliquid summo in bono
finiendo. Si enim virtus digna est gloriatione, ut est, tantumque praestat
reliquis rebus, ut dici vix possit, et beatus esse poterit virtute una praeditus
carens ceteris, nec tamen illud tibi concedetur, praeter virtutem nihil in bonis
esse ducendum. Illi autem, quibus summum bonum sine virtute est, non dabunt
fortasse vitam beatam habere, in quo iure possit gloriari, etsi illi quidem
etiam voluptates faciunt interdum gloriosas.
XIX. Vides igitur te aut ea sumere, quae non
concedantur, aut ea, quae etiam concessa te nihil iuvent. - Equidem in omnibus
istis conclusionibus hoc putarem philosophia nobisque dignum, et maxime, cum
summum bonum quaereremus, vitam nostram, consilia, voluntates, non verba
corrigi. Quis enim potest istis, quae te, ut ais, delectant, brevibus et acutis
auditis de sententia decedere? Nam cum expectant et avent audire cur dolor malum
non sit, dicunt illi asperum esse dolere, molestum, odiosum, contra naturam,
difficile toleratu, sed, quia nulla sit in dolore nec fraus nec improbitas nec
malitia nec culpa nec turpitudo, non esse illud malum. Haec qui audierit, ut
ridere non curet, discedet tamen nihilo firmior ad dolorem ferendum, quam
venerat. Tu autem negas fortem esse quemquam posse, qui dolorem malum putet. Cur
fortior sit, si illud, quod tute concedis, asperum et vix ferendum putabit? Ex
rebus enim timiditas, non ex vocabulis nascitur.
Et ais, si una littera commota sit, fore tota ut
labet disciplina. Utrum igitur tibi litteram videor an totas paginas commovere?
Ut enim sit apud illos, id quod est a te laudatum, ordo rerum conservatus et
omnia inter se apta et conexa—sic enim aiebas—, tamen persequi non debemus, si a
falsis principiis profecta congruunt ipsa sibi et a proposito non aberrant. In
prima igitur constitutione Zeno tuus a natura recessit, cumque summum bonum
posuisset in ingenii praestantia, quam virtutem vocamus, nec quicquam
aliud bonum esse dixisset, nisi quod esset honestum, nec virtutem posse
constare, si in ceteris rebus esset quicquam, quod aliud alio melius esset aut
peius, his propositis tenuit prorsus consequentia. Recte dicis; negare non
possum. Sed ita falsa sunt ea, quae consequuntur, ut illa, e quibus haec nata
sunt, vera esse non possint. Docent enim nos, ut scis, dialectici, si ea, quae
rem aliquam sequantur, falsa sint, falsam illam ipsam esse, quam sequantur. Ita
fit illa conclusio non solum vera, sed ita perspicua, ut dialectici ne rationem
quidem reddi putent oportere: si illud, hoc; non autem hoc; igitur ne illud
quidem. Sic consequentibus vestris sublatis prima tolluntur. Quae sequuntur
igitur? Omnes, qui non sint sapientes, aeque miseros esse, sapientes omnes summe
beatos, recte facta omnia aequalia, omnia peccata paria; quae cum magnifice
primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Sensus enim cuiusque et
natura rerum atque ipsa veritas clamabat quodam modo non posse <se> adduci, ut
inter eas res, quas Zeno exaequaret, nihil interesset.
XX. Postea
tuus ille Poenulus—scis enim Citieos, clientes tuos, e Phoenica profectos—,
homo igitur acutus, causam non optinens repugnante natura verba versare coepit
et primum rebus iis, quas nos bonas ducimus, concessit, ut haberentur
aestimabiles et ad naturam accommodatae, faterique coepit sapienti, hoc est
summe beato, commodius tamen esse si ea quoque habeat, quae bona non audet
appellare, naturae accommodata esse concedit, negatque Platonem, si sapiens non
sit, eadem esse in causa, qua tyrannum Dionysium; huic mori optimum esse
propter desperationem sapientiae, illi propter spem vivere. Peccata autem partim
esse tolerabilia, partim nullo modo, propterea quod alia peccata plures, alia
pauciores quasi numeros officii praeterirent. Iam insipientes alios ita esse, ut
nullo modo ad sapientiam possent pervenire, alios, qui possent, si id egissent,
sapientiam consequi. Hic loquebatur aliter atque omnes, sentiebat idem, quod
ceteri. Nec vero minoris aestimanda ducebat ea, quae ipse bona negaret esse,
quam illi, qui ea bona esse dicebant. Quid igitur voluit sibi, qui illa
mutaverit? Saltem aliquid de pondere detraxisset et paulo minoris aestimavisset
ea quam Peripatetici, ut sentire quoque aliud, non solum dicere videretur. Quid?
De ipsa beata vita, ad quam omnia referuntur, quae dicitis? Negatis eam esse,
quae expleta sit omnibus iis rebus, quas natura desideret, totamque eam in una
virtute ponitis; cumque omnis controversia aut de re soleat aut de nomine esse,
utraque earum nascitur, si aut res ignoratur aut erratur in nomine. Quorum si
neutrum est, opera danda est, ut verbis utamur quam usitatissimis et quam maxime
aptis, id est rem declarantibus. Num igitur dubium est, quin, si in re ipsa
nihil peccatur a superioribus, verbis illi commodius utantur? Videamus igitur
sententias eorum, tum ad verba redeamus.
XXI. Dicunt appetitionem animi moveri, cum aliquid
ei secundum naturam esse videatur, omniaque, quae secundum naturam sint,
aestimatione aliqua digna eaque pro eo, quantum in quoque sit ponderis, esse
aestimanda, quaeque secundum naturam sint, partim nihil habere in sese eius
appetitionis, de qua saepe iam diximus, quae nec honesta nec laudabilia
dicantur, partim, quae voluptatem habeant in omni animante, sed in homine
rationem etiam. Ex ea quae sint apta, ea honesta, ea pulchra, ea laudabilia,
illa autem superiora naturalia nominantur, quae coniuncta cum honestis vitam
beatam perficiunt et absolvunt. Omnium autem eorum commodorum, quibus non illi
plus tribuunt, qui illa bona esse dicunt, quam Zeno, qui negat, longe
praestantissimum esse, quod honestum esset atque laudabile. Sed si duo honesta
proposita sint, alterum cum valitudine, alterum cum morbo, non esse dubium, ad
utrum eorum natura nos ipsa deductura sit. Sed tamen tantam vim esse honestatis,
tantumque eam rebus omnibus praestare et excellere, ut nullis nec suppliciis nec
praemiis demoveri possit ex eo, quod rectum esse decreverit, omniaque, quae
dura, difficilia, adversa videantur, ea virtutibus iis, quibus a natura essemus
ornati, opteri posse, non faciles illas quidem <res> nec contemnendas —quid enim
esset in virtute tantum?—, sed ut hoc iudicaremus, non esse in iis partem
maximam positam beate aut secus vivendi. Ad summam ea, quae Zeno aestimanda et
sumenda et apta naturae esse dixit, eadem illi bona appellant, vitam autem
beatam illi eam, quae constaret ex iis rebus, quas dixi, aut plurimis aut
gravissimis. Zeno autem, quod suam, quod propriam speciem habeat, cur appetendum
sit, id solum bonum appellat, beatam autem vitam eam solam, quae cum virtute
degatur.
XXII. Si de re disceptari oportet, nulla mihi
tecum, Cato, potest esse dissensio. Nihil est enim, de quo aliter tu sentias
atque ego, modo commutatis verbis ipsas res conferamus. Nec hoc ille non vidit,
sed verborum magnificentia est et gloria delectatus. Qui si ea, quae dicit,
ita sentiret, ut verba significant, quid inter eum et vel Pyrrhonem vel
Aristonem interesset? Sin autem eos non probabat, quid attinuit cum iis,
quibuscum re concinebat, verbis discrepare? quid, si reviviscant Platonis illi
et deinceps qui eorum auditores fuerunt, et tecum ita loquantur? “Nos cum te, M.
Cato, studiosissimum philosophiae, iustissimum virum, optimum iudicem,
religiosissimum testem, audiremus, admirati sumus, quid esset cur nobis Stoicos
anteferres, qui de rebus bonis et malis sentirent ea, quae ab hoc Polemone Zeno
cognoverat, nominibus uterentur iis, quae prima specie admirationem, re
explicata risum moverent. Tu autem, si tibi illa probabantur, cur non propriis
verbis ea tenebas? Sin te auctoritas commovebat, nobisne omnibus et Platoni ipsi
nescio quem illum anteponebas? Praesertim cum in re publica princeps esse velles
ad eamque tuendam cum summa tua dignitate maxime a nobis ornari atque instrui
posses. <a> nobis enim ista quaesita, a nobis descripta, notata, praecepta sunt,
omniumque rerum publicarum rectionis genera, status, mutationes, leges etiam et
instituta ac mores civitatum perscripsimus. Eloquentiae vero, quae et
principibus maximo ornamento est, et qua te audimus valere plurimum, quantum
tibi ex monumentis nostris addidisses!” Ea cum dixissent, quid tandem talibus
viris responderes? - Rogarem te, inquit, ut diceres pro me tu idem, qui
illis orationem dictavisses, vel potius paulum loci mihi, ut iis
responderem, dares, nisi et te audire nunc mallem et istis tamen alio tempore
responsurus essem, tum scilicet, cum tibi.
XXIII. Atque, si verum respondere velles, Cato,
haec erant dicenda, non eos tibi non probatos, tantis ingeniis homines tantaque
auctoritate, sed te animadvertisse, quas res illi propter antiquitatem parum
vidissent, eas a Stoicis esse perspectas, eisdemque de rebus hos cum acutius
disseruisse, tum sensisse gravius et fortius, quippe qui primum valitudinem
bonam expetendam negent esse, eligendam dicant, nec quia bonum sit valere, sed
quia sit non nihilo aestimandum—neque tamen pluris quam illis videtur, qui illud
non dubitant bonum dicere—; hoc vero te ferre non potuisse, quod antiqui illi
quasi barbati, ut nos de nostris solemus dicere, crediderint, eius, qui honeste
viveret, si idem etiam bene valeret, bene audiret, copiosus esset, optabiliorem
fore vitam melioremque et magis expetendam quam illius, qui aeque vir bonus
“multis modis” esset, ut Ennii Alcmaeo, 'ci/rcumventus mo/rbo, exilio
atque i/nopia'. Illi igitur antiqui non tam acute optabiliorem illam vitam
putant, praestantiorem, beatiorem, Stoici autem tantum modo praeponendam in
seligendo, non quo beatior ea vita sit, sed quod ad naturam accommodatior.
Et, qui sapientes non sint, omnes aeque esse
miseros, Stoici hoc videlicet viderunt, illos autem id fugerat superiores, qui
<non> arbitrabantur homines sceleribus et parricidiis inquinatos nihilo
miseriores esse quam eos, qui, cum caste et integre viverent, nondum perfectam
illam sapientiam essent consecuti. Atque hoc loco similitudines eas, quibus illi
uti solent, dissimillimas proferebas. Quis enim ignorat, si plures ex alto
emergere velint, propius fore eos quidem ad respirandum, qui ad summam iam aquam
adpropinquent, sed nihilo magis respirare posse quam eos, qui sint in profundo?
Nihil igitur adiuvat procedere et progredi in virtute, quo minus miserrimus sit,
ante quam ad eam pervenerit, quoniam in aqua nihil adiuvat, et, quoniam catuli,
qui iam dispecturi sunt, caeci aeque et ii, qui modo nati, Platonem quoque
necesse est, quoniam nondum videbat sapientiam, aeque caecum animo ac Phalarim
fuisse?
XXIV. Ista similia non sunt, Cato, in quibus
quamvis multum processeris tamen illud in eadem causa est, a quo abesse velis,
donec evaseris; nec enim ille respirat, ante quam emersit, et catuli aeque
caeci, prius quam dispexerunt, ac si ita futuri semper essent. Illa sunt
similia: hebes acies est cuipiam oculorum, corpore alius senescit; hi curatione
adhibita levantur in dies, valet alter plus cotidie, alter videt. His similes
sunt omnes, qui virtuti student; levantur vitiis, levantur erroribus, nisi forte
censes Ti. Gracchum patrem <non> beatiorem fuisse quam filium, cum alter
stabilire rem publicam studuerit, alter evertere. Nec tamen ille erat sapiens—
quis enim hoc aut quando aut ubi aut unde?—; sed quia studebat laudi et
dignitati, multum in virtute processerat. Conferam avum tuum Drusum cum C.
Graccho, eius fere aequali? quae hic rei publicae vulnera inponebat, eadem ille
sanabat. Si nihil est, quod tam miseros faciat quam inpietas et scelus, ut iam
omnes insipientes sint miseri, quod profecto sunt, non est tamen aeque miser,
qui patriae consulit, et is, qui illam extinctam cupit. Levatio igitur
vitiorum magna fit in iis, qui habent ad virtutem progressionis aliquantum.
Vestri autem progressionem ad virtutem fieri aiunt, levationem vitiorum fieri
negant. At quo utantur homines acuti argumento ad probandum, operae pretium est
considerare. Quarum, inquit, artium summae crescere possunt, earum etiam
contrariorum summa poterit augeri; ad virtutis autem summam accedere nihil
potest; ne vitia quidem igitur crescere poterunt, quae sunt virtutum contraria.
Utrum igitur tandem perspicuisne dubia aperiuntur, an dubiis perspicua
tolluntur? Atqui hoc perspicuum est, vitia alia in aliis esse maiora, illud
dubium, ad id, quod summum bonum dicitis, ecquaenam possit fieri accessio. Vos
autem cum perspicuis dubia debeatis illustrare, dubiis perspicua conamini
tollere. Itaque rursus eadem
ratione, qua sum paulo ante usus, haerebitis. Si enim propterea vitia alia
aliis maiora non sunt, quia ne ad finem quidem bonorum eum, quem vos facitis,
quicquam potest accedere, quoniam perspicuum est vitia non esse omnium paria,
finis bonorum vobis mutandus est. Teneamus enim illud necesse est, cum
consequens aliquod falsum sit, illud, cuius id consequens sit, non posse esse
verum.
XXV. Quae est igitur causa istarum angustiarum?
Gloriosa ostentatio in constituendo summo bono. Cum enim, quod honestum sit, id
solum bonum esse confirmatur, tollitur cura valitudinis, diligentia rei
familiaris, administratio rei publicae, ordo gerendorum negotiorum,
officia vitae, ipsum denique illud honestum, in quo uno vultis esse omnia,
deserendum est. Quae diligentissime contra Aristonem dicuntur a Chrysippo. Ex ea
difficultate illae 'fallaciloquae', ut ait Accius, “malitiae” natae sunt. Quod
enim sapientia, pedem ubi poneret, non habebat sublatis officiis omnibus,
officia autem tollebantur dilectu omni et discrimine remoto, quae esse <non>
poterant rebus omnibus sic exaequatis, ut inter eas nihil interesset, ex his
angustiis ista evaserunt deteriora quam Aristonis. Illa tamen simplicia, vestra
versuta. Roges enim Aristonem, bonane ei videantur haec: vacuitas doloris,
divitiae, valitudo; neget. Quid? quae contraria sunt his, malane? Nihilo magis.
Zenonem roges; respondeat totidem verbis. Admirantes quaeramus ab utroque,
quonam modo vitam agere possimus, si nihil interesse nostra putemus, valeamus
aegrine simus, vacemus an cruciemur dolore, frigus, famem propulsare possimus
necne possimus. Vives, inquit Aristo, magnifice atque praeclare, quod erit
cumque visum ages, numquam angere, numquam cupies, numquam timebis. Quid Zeno?
Portenta haec esse dicit, neque ea ratione ullo modo posse vivi; se dicere inter
honestum et turpe nimium quantum, nescio quid inmensum, inter ceteras res nihil
omnino interesse. Idem adhuc; audi reliqua et risum contine, si potes:
Media illa, inquit, inter quae nihil interest, tamen eius modi sunt, ut eorum
alia eligenda sint, alia reicienda, alia omnino neglegenda, hoc est, ut eorum
alia velis, alia nolis, alia non cures.—At modo dixeras nihil in istis rebus
esse, quod interesset.—Et nunc idem dico, inquiet, sed ad virtutes et ad vitia
nihil interesse. —
XXVI. Quis istud, quaeso, nesciebat? Verum
audiamus.— Ista, inquit, quae dixisti, valere, locupletem esse, non dolere, bona
non dico, sed dicam Graece προηγμένα, Latine autem producta—sed praeposita aut
praecipua malo, sit tolerabilius et mollius—; illa autem, morbum, egestatem,
dolorem, non appello mala, sed, si libet, reiectanea. Itaque illa non dico me
expetere, sed legere, nec optare, sed sumere, contraria autem non fugere, sed
quasi secernere. Quid ait Aristoteles reliquique Platonis alumni? Se omnia, quae
secundum naturam sint, bona appellare, quae autem contra, mala. - Videsne igitur
Zenonem tuum cum Aristone verbis concinere, re dissidere, cum Aristotele et
illis re consentire, verbis discrepare? Cur igitur, cum de re conveniat, non
malumus usitate loqui? Aut doceat paratiorem me ad contemnendam pecuniam fore,
si illam in rebus praepositis quam si in bonis duxero, fortioremque in patiendo
dolore, si eum asperum et difficilem perpessu et contra naturam esse quam si
malum dixero. Facete M. Piso,
familiaris noster, et alia multa et hoc loco Stoicos irridebat: “Quid enim?”
aiebat. 'Bonum negas esse divitias, praepositum esse dicis? quid adiuvas?
Avaritiamne minuis? quo modo? Si verbum sequimur, primum longius verbum
praepositum quam bonum'.—Nihil ad rem!—'Ne sit sane; at certe gravius. Nam bonum
ex quo appellatum sit, nescio, praepositum ex eo credo, quod praeponatur aliis.
Id mihi magnum videtur.' itaque dicebat plus tribui divitiis a Zenone, qui eas
in praepositis poneret, quam ab Aristotele, qui bonum esse divitias fateretur,
sed neque magnum bonum et prae rectis honestisque contemnendum ac
despiciendum nec magnopere expetendum, omninoque de istis omnibus verbis a
Zenone mutatis ita disputabat, et, quae bona negarentur ab eo esse et quae mala,
illa laetioribus nominibus appellari ab eo quam a nobis, haec tristioribus. Piso
igitur hoc modo, vir optimus tuique, ut scis, amantissimus. Nos paucis ad haec
additis finem faciamus aliquando; longum est enim ad omnia respondere, quae a te
dicta sunt.
XXVII. Nam ex eisdem verborum praestrigiis et
regna nata vobis sunt et imperia et divitiae, et tantae quidem, ut omnia, quae
ubique sint, sapientis esse dicatis. Solum praeterea formosum, solum liberum,
solum civem, <stultos> omnia contraria, quos etiam insanos esse vultis.
Haec παράδοξα illi, nos admirabilia
dicamus. Quid autem habent admirationis, cum prope accesseris? Conferam tecum,
quam cuique verbo rem subicias; nulla erit controversia. Omnia peccata paria
dicitis. Non ego tecum iam ita iocabor, ut isdem his de rebus, cum L. Murenam te
accusante defenderem. Apud imperitos tum illa dicta sunt, aliquid etiam coronae
datum; nunc agendum est subtilius. Peccata paria. —Quonam modo?—Quia nec honesto
quicquam honestius nec turpi turpius.—Perge porro; nam de isto magna dissensio
est. Illa argumenta propria videamus, cur omnia sint paria peccata.—Ut, inquit,
in fidibus pluribus, nisi nulla earum <non> ita contenta nervis sit, ut
concentum servare possit, omnes aeque incontentae sint, sic peccata, quia
discrepant, aeque discrepant; paria sunt igitur.—Hic ambiguo ludimur. Aeque enim
contingit omnibus fidibus, ut incontentae sint, illud non continuo, ut aeque
incontentae. Collatio igitur ista te nihil iuvat. Nec enim, omnes
avaritias si aeque avaritias esse dixerimus, sequetur, ut etiam aequas esse
dicamus. Ecce aliud simile dissimile. Ut enim, inquit, gubernator aeque peccat,
si palearum navem evertit et si auri, item aeque peccat, qui parentem et qui
servum iniuria verberat.—Hoc non videre, cuius generis onus navis vehat, id ad
gubernatoris artem nil pertinere! itaque aurum paleamne portet, ad bene aut ad
male gubernandum nihil interesse! at quid inter parentem et servulum intersit,
intellegi et potest et debet. Ergo in gubernando nihil, in officio plurimum
interest, quo in genere peccetur. Et si in ipsa gubernatione neglegentia est
navis eversa, maius est peccatum in auro quam in palea. Omnibus enim artibus
volumus attributam esse eam, quae communis appellatur prudentia, quam omnes, qui
cuique artificio praesunt, debent habere. Ita ne hoc quidem modo paria peccata
sunt.
XXVIII. Urgent tamen et nihil remittunt. Quoniam,
inquiunt, omne peccatum inbecillitatis et inconstantiae est, haec autem vitia in
omnibus stultis aeque magna sunt, necesse est paria esse peccata. Quasi vero aut
concedatur in omnibus stultis aeque magna esse vitia, et eadem inbecillitate et
inconstantia L. Tubulum fuisse,
qua illum, cuius is condemnatus est rogatione, P. Scaevolam, et quasi nihil
inter res quoque ipsas, in quibus peccatur, intersit, ut, quo hae maiores
minoresve sint, eo, quae peccentur in his rebus, aut maiora sint aut
minora! Itaque—iam enim concludatur oratio—hoc uno vitio maxime mihi premi
videntur tui Stoici, quod se posse putant duas contrarias sententias optinere.
Quid enim est tam repugnans quam eundem dicere, quod honestum sit, solum id
bonum esse, qui dicat appetitionem rerum ad vivendum accommodatarum <a>
natura profectam? Ita cum ea volunt retinere, quae superiori sententiae
conveniunt, in Aristonem incidunt; cum id fugiunt, re eadem defendunt, quae
Peripatetici, verba tenent mordicus. Quae rursus dum sibi evelli ex ordine
nolunt, horridiores evadunt, asperiores, duriores et oratione et moribus. Quam
illorum tristitiam atque asperitatem fugiens Panaetius nec acerbitatem
sententiarum nec disserendi spinas probavit fuitque in altero genere mitior, in
altero illustrior semperque habuit in ore Platonem, Aristotelem, Xenocratem,
Theophrastum, Dicaearchum, ut ipsius scripta declarant. Quos quidem tibi
studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Sed quoniam et advesperascit
et mihi ad villam revertendum est, nunc quidem hactenus; verum hoc idem
saepe faciamus. - Nos vero, inquit ille; nam quid possumus facere melius? Et
hanc quidem primam exigam a te operam, ut audias me quae a te dicta sunt
refellentem. Sed memento te, quae nos sentiamus, omnia probare, nisi quod verbis
aliter utamur, mihi autem vestrorum nihil probari. - Scrupulum, inquam, abeunti;
sed videbimus. - Quae cum essent dicta, discessimus.
|
LIVRE QUATRIÈME.
I. Après que Caton eut parlé de la sorte, il se tut; et je lui dis:
Vous venez de nous exposer une si grande quantité de choses avec une
mémoire admirable, et des choses si obscures avec tant de netteté,
qu'il faut ou renoncer absolument à vous
561 contredire ou vous demander du temps pour y penser.
Car votre doctrine, dont je n'oserais dire encore qu'elle n'est pas
vraie, est au moins fondée et construite de telle manière, qu'on ne
peut se mettre aisément dans l'esprit tout ce qu'il faut pour la
combattre. – Est-ce à vous, reprit-il, à vous excuser de la sorte,
vous que j'ai vu, selon la nouvelle loi, répondre le même jour à
votre partie et fournir abondamment votre carrière de trois heures?
Croyez-vous que je veuille remettre à une autre fois cette cause-ci?
Elle n'est pas excellente pour vous, j'en conviens, mais vous en
avez gagné qui ne valaient guère mieux. Attaquez-la donc; déjà elle
a été traitée et par d'autres et par vous-même, et certes vous ne
sauriez demeurer court sur un tel sujet. – Je vous assure, lui
répondis-je, que je ne me hasarde pas volontiers contre les
Stoïciens; non pas que je sois trop de leur sentiment, mais je suis
retenu par une espèce de honte, tant ils disent de choses que je
n'entends presque pas. – J'avoue, repartit-il, qu'il y a de
l'obscurité dans certaines parties de leur doctrine, mais
certainement elle n'est pas de leur fait; c'est aux choses
elles-mêmes qu'il faut reprocher d'être obscures. – D'où vient donc,
répliquai-je, que quand les Péripatéticiens disent absolument les
mêmes choses, ils ne prononcent pas un seul mot qu'on n'entende? –
Les mêmes choses! reprit-il. Est-ce donc que je n'ai pas assez
montré que ce n'est point à l'égard des termes, mais sur le fond
même des idées et l'essence de la doctrine, que les péripatéticiens
diffèrent des nôtres? – Si vous parvenez à le prouver, Caton, je
passe tout entier de votre côté. – Je croyais, dit-il, l'avoir assez
démontré. Commencez donc par ce point, si vous le trouvez à propos;
si vous en avez d'autres à traiter, ils viendront après. – J'aime
mieux, lui dis-je, traiter cette question en son lieu; à moins que
ce ne soit une prétention exagérée de vouloir vous répondre comme je
l'entends. – Comme il vous plaira, répondit-il; il eût mieux valu
commencer par là, mais rien de plus juste que de laisser chacun
libre de choisir sa méthode.
II. Il me semble, lui dis-je, Caton, que les premiers disciples de
Platon, Speusippe, Aristote, Xénocrate, et les disciples de ceux-ci,
Polémon et Théophraste, avaient amplement et assez bien établi leur
doctrine pour ne pas donner sujet à Zénon, après avoir été
l'auditeur de Polémon, de se séparer de lui, et de tous les anciens
maîtres qui avaient soutenu ces mêmes dogmes. Que pensez-vous donc
qu'il faille changer dans ce système? Je voudrais que vous le
fissiez d'abord bien entendre, car, je vous prie, n'attendez pas que
je réponde à tout ce que vous avez dit; c'est l'ensemble de leur
doctrine que je veux opposer à l'ensemble de la vôtre. Comme ils
virent que généralement les hommes sont nés avec une disposition
naturelle pour ces vertus, si connues et si louées, la justice, la
tempérance, et les autres qui, semblables au reste des arts, ne
diffèrent les unes des autres que par la matière à laquelle elles
s'appliquent, et le mode de leur exercice; voyant que nous nous
portons à ces vertus avec ardeur et générosité; que nous avons un
désir naturel, et comme un besoin inné de connaître; que nous sommes
nés pour nous réunir à nos semblables et former en commun la société
du genre humain, et que ces sentiments-là reluisent le plus dans les
plus grands esprits, les anciens maîtres dont je parle divisèrent
toute la philosophie en trois parties; et cette division a été
conservée par Zénon. Je néglige pour un moment la
562 partie de la philosophie qui
concerne les mœurs, et la question du souverain bien; ce qui est le
fond même de notre controverse, ce que je veux dire maintenant,
c'est que les anciens Péripatéticiens et les Académiciens qui
partageaient les mêmes sentiments sans employer les mêmes termes,
ont traité admirablement bien tout ce qui concerne la vie civile, ce
que les Grecs nomment politique.
III. Combien de livres n'ont-ils pas écrits sur la république et sur
les lois! Combien de préceptes et de modèles ne nous ont-ils pas
laissés dans l'art de l'éloquence! Car premièrement, tous les sujets
où il faut employer une rigoureuse méthode, ils en ont parlé avec
élégance et justesse, en se servant de définitions et de divisions,
ce que votre école fait aussi, mais d'une manière fort embarrassée,
au lieu que les autres sont clairs et intelligibles dans tout ce
qu'ils disent. Avec quelle gravité ensuite et quelle magnificence
n'ont-ils point parlé des choses qui étaient susceptibles des grands
ornements de l'éloquence! Que de beautés brillent dans tout ce
qu'ils ont écrit sur la justice, sur la force, l'amitié, la conduite
de la vie, la philosophie, l'administration des États, la
tempérance! Ils n'écrivent pas en hommes qui ne font qu'arracher des
épines et décharner des os, comme les Stoïciens, mais en hommes qui
savent parler noblement des grandes choses, et clairement des
petites. Aussi ne sont-ce pas tout autant de merveilles que leurs
consolations, leurs exhortations, leurs avertissements et leurs
conseils aux grands personnages? Tout comme on voit dans la nature
des choses deux ordres de questions, on trouve chez eux deux sortes
de travaux différents; car dans tous les sujets qu'on traite, on
trouve ou une question générale sans aucune application de personnes
ni de temps, ou une question particulière déterminée, de nom, de
fait ou de droit. Les anciens s'exerçaient dans ces deux genres
d'écrire, et c'est de là que nous sont venus dans l'un et dans
l'autre tant d'excellents ouvrages. Mais le second fut entièrement
abandonné par Zénon et ses sectateurs, soit impuissance, soit esprit
de système. Il est vrai que Cléanthe et Chrysippe lui-même ont écrit
des traités de rhétorique; mais à coup sûr, si quelqu'un veut
apprendre l'art de se taire, il ne lui faut pas d'autre manuel. Vous
voyez vous-même comment ils parlent; ils forgent des mots nouveaux,
abandonnent ceux qui sont en usage. – Mais aussi quelles grandes
pensées ne veulent-ils pas répandre! Ne disent-ils pas que le monde
entier est notre ville? – Oui, mais voyez le bel ouvrage; voilà
l'habitant de Circéii qui va croire que le monde entier, c'est son
village. – Zénon enflamme donc ceux qui l'écoutent! – Zénon
enflammer quelqu'un! donnez-lui un esprit en feu, il l'aura bientôt
rendu froid comme glace.
Ce que vous avez dit en peu de mots qu'il n'y a de roi, de
dictateur, de riche que le sage, m'a semblé plein de bonheur et
d'éloquence; mais je sais pourquoi, c'est un emprunt que vous
faisiez à la rhétorique. Mais que vos Stoïciens parlent
misérablement de la dignité de la vertu! eux qui cependant en font
tant d'estime qu'ils voient en elle seule la source de tout bonheur.
Ils piquent avec de courtes interrogations comme avec des pointes
acérées; et ceux qui se rendent à ces armes, n'éprouvent aucune
impression profonde, et s'en retournent tels qu'ils étaient venus;
parce que ces dogmes qui sont peut-être vrais, ou du
563 moins très graves, sont
exposés plus sèchement qu'il ne faudrait.
IV. Viennent ensuite la dialectique et la physique; car nous
arrivons bientôt à ce qui touche le souverain bien, et nous ferons
porter toute notre controverse sur cette question. Mais dans les
deux parties de la philosophie, il n'était rien que Zénon dût
souhaiter bien vivement de changer; de part et d'autre, tout y
semble accompli. Qu'est-ce en effet que les anciens avaient oublié
sur la dialectique? Ils ont donné une foule de définitions, et en
même temps des règles pour bien définir; et quant à la division qui
doit suivre la définition, ils nous en ont laissé pareillement des
exemples et des préceptes. Ils ont parlé tout aussi complètement des
contraires, et de là ils ont passé aux genres et aux essences. A la
tête des raisonnements, ils mettent ces propositions qu'ils nomment
évidentes; après quoi ils lient la seconde proposition avec la
première; et la conclusion met enfin en lumière la vérité renfermée
dans les prémisses. Au reste, de combien de sortes d'arguments dont
on peut tirer de justes conclusions, ne sont-ils point auteurs? Et
quelle différence de cela à des interrogations captieuses! Ne
déclarent-ils pas aussi en beaucoup d'endroits qu'il ne faut
consulter ni les sens sans la raison, ni la raison sans les sens, et
que jamais on ne doit les entendre isolément? Et tout ce qu'on
enseigne aujourd'hui dans la dialectique, n'est-ce pas eux qui l'ont
inventé et lui ont donné cours? C'est une étude dont Chrysippe s'est
fort occupé, mais que Zénon avait beaucoup moins cultivée que les
anciens; cependant votre Chrysippe n'a jamais été plus loin que nos
maîtres, et il a même laissé beaucoup de choses sans y toucher. Et
tout ce qui regarde la perfection du raisonnement et du discours se
trouvant compris dans l'art de l'invention et dans celui de
l'argumentation, les Stoïciens et les Péripatéticiens ont traité du
dernier; mais du premier sur lequel ceux-ci ont excellemment écrit,
les Stoïciens n'ont pas touché un mot. Ils n'ont pas eu le moindre
soupçon des lieux d'où l'on pouvait tirer, comme d'un trésor, les
exemples et les preuves; tandis que les Péripatéticiens nous en ont
enseigné l'artifice et les ressources; ce qui fait qu'on n'a pas
besoin de répéter sans cesse sur le même sujet comme une leçon qu'on
aurait apprise et de se tenir constamment dans les amplifications de
ses cahiers. Car lorsqu'on sait où se trouve chaque argument, et par
quelle voie il est facile de le joindre, on peut tirer à tout
instant de la mine les richesses que l'on n'a pas présentes, et en
même temps ne cesser jamais d'être soi dans ses discours. Encore
qu'il y ait de grands esprits qui, d'eux-mêmes et sans méthode,
rencontrent l'éloquence, l'art est cependant un guide plus certain
que la nature. Autre chose est de se livrer à son inspiration comme
les poètes, autre chose, de parler avec netteté, règle et mesure.
V. On peut faire les mêmes réflexions au sujet de la physique que
les uns et les autres ont aussi cultivée, non pas seulement, comme
le veut Épicure, parce qu'elle délivre des terreurs de la mort et de
la superstition, mais parce que la connaissance des choses célestes
donne je ne sais quelle sagesse à ceux qui voient la modération et
l'ordre dont sont empreints les conseils des Dieux; parce qu'elle
inspire de la grandeur d'âme à ceux qui étudient l'œuvre des
immortels; et qu'elle porte à la justice quand on est parvenu à con-
564 naître la providence, les
décrets et la volonté du Souverain Maître qui gouverne tout, et dont
il faut que la raison reproduise en quelque façon les caractères
sacrés pour être appelée par les philosophes la véritable et suprême
loi. De cette étude de la nature, et des connaissances qu'on en
tire, il nait une volupté que l'esprit ne peut jamais épuiser, et
qui suffirait seule, lorsque nous avons rempli nos principaux
devoirs, et que les affaires humaines ne nous réclament plus, pour
embellir et honorer notre vie. Les Stoïciens ont donc suivi les
Péripatéticiens dans tout ce que la physique renferme de plus
considérable; ils ont admis comme eux qu'il y avait des Dieux et que
tout était composé de quatre éléments. Mais ici l'on agitait une
question très difficile, celle qui concerne l'existence d'un
cinquième élément, d'où la raison et l'intelligence auraient pris
leur origine; et par suite celle qui touche la formation et la
nature des âmes. Zénon, lui, déclara que l'élément des âmes était le
feu; il adopta encore quelques autres opinions, mais en fort petit
nombre, différentes de celles des Péripatéticiens; mais sur la plus
grave de toutes les questions, sur le gouvernement de l'univers par
une nature divine et intelligente, il fut du même sentiment qu'eux.
Quant au corps de la doctrine, il n'y a que stérilité et sécheresse
parmi les Stoïciens; les Péripatéticiens au contraire, nous
présentent une richesse infinie. Combien de découvertes n'ont-ils
pas faites et rassemblées sur les diverses races d'animaux, sur leur
production, leur figure et la durée de leur vie? Combien d'autres
sur tout ce qui sort du sein de la terre? N'ont-ils pas, montré
pourquoi une infinité de choses se font et comment elles se font? Et
ce trésor de leurs découvertes ne nous sert-il pas à expliquer
abondamment et certainement la nature de tout au monde? Jusqu'ici
donc je ne vois pas que Zénon ait eu un motif plausible de donner à
cette doctrine un nom nouveau. Car pour n'être pas en tous points du
sentiment des Péripatéticiens, en était-il moins de leur école?
C'est ainsi qu'Épicure, dans sa physique, n'est pour moi que l'écho
de Démocrite; il introduit bien quelques changements, mais quand il
les multiplierait, il ne reproduirait pas moins la plupart des
dogmes de Démocrite, et parmi ces dogmes les plus importants. Vos
Stoïciens en font tout autant, et ne témoignent pas assez de
reconnaissance pour leurs maîtres.
VI. Mais brisons là, et arrivons enfin au souverain bien, qui
embrasse toute la philosophie, et voyons ce que Zénon peut avoir
apporté de nouveau sur ce point-là, qui ait dû l'obliger à se
séparer de ses maîtres, comme un fils qui abandonnerait ses parents.
Ici, Caton, quoique vous ayez expliqué avec grand soin ce que c'est
que le souverain bien, et ce que les Stoïciens entendent par là,
vous permettrez que je l'explique aussi à mon tour, afin que nous
puissions mieux connaître ce que nous devons à Zénon comme
inventeur. Car les anciens, et plus particulièrement Polémon, ayant
dit que le souverain bien est de vivre selon la nature, les
Stoïciens prétendent que cela signifie trois choses; la première,
vivre en réglant sa conduite par la connaissance des choses qui
arrivent naturellement, et c'est là, disent-ils, ce que Zénon a
entendu, et ce qui répond parfaitement au précepte de vivre
conformément à la nature, dont vous nous avez expressément
entretenus. La seconde signification, c'est de vivre en observant
tous ou la plupart des devoirs intermédiaires comme vous les
565 appelez; cette règle de la
vie est bien loin de ressembler à la première, qui en supposant la
droiture et la perfection dans ce qu'on fait (c'est ainsi que vous
avez rendu κατόρθωμα), ne convient qu'au sage;
tandis que celle-ci, qui ne demande qu'un bien ébauché et imparfait,
peut quelquefois se rencontrer dans ceux qui n'ont pas la sagesse.
La troisième enfin est de vivre en jouissant de tous les avantages
qui sont selon la nature, ou au moins des plus grands d'entre eux;
dernière règle qui nous propose ce qui ne dépend pas de nous; car
elle comprend à la fois la vertu et tous ces avantages, conformes à
la nature, mais qui ne sont pas en notre pouvoir. Je l'accorde, mais
il n'en est pas moins vrai que le souverain bien ainsi défini, et la
vie qui se règle d'après lui et dont la vertu est inséparable, ne
conviennent absolument qu'au sage. C'est là, comme les Stoïciens
eux-mêmes l'ont écrit, le souverain bien tel que l'entendent
Xénocrate et Aristote. Et voici à peu près en quels termes ils
expliquent cette première institution de la nature où vous prenez
aussi votre point de départ.
VII. Ils disent donc que toute nature en ce monde tend à se
conserver, et à demeurer dans son espèce. De là vient, ajoutent-ils,
que les hommes ont inventé les arts pour aider la nature, et surtout
l'art de la vie pour conserver ce que la nature nous a donné et
acquérir ce qui naturellement nous manque. Ils ont aussi divisé la
nature de l'homme en deux parties, l'âme et le corps; et après avoir
établi que l'une et l'autre de ces parties a par elle-même un grand
prix pour nous, ils ont dit que les bonnes qualités de toutes les
deux devaient être recherchées pour leur mérite propre; mais, en
même temps comme ils préféraient infiniment l'âme au corps, ils ont
mis les bonnes qualités de l'âme fort au-dessus des biens corporels.
Et parce qu'ils regardaient la sagesse comme la gardienne et la
tutrice de tout l'homme, et comme l'aide et la compagne de la
nature, ils ont dit que l'office de la sagesse était de veiller sur
cette nature humaine composée d'âme et de corps, de la servir et de
la conserver dans chacune de ses parties. Après avoir d'abord établi
simplement ces premiers principes, ils sont entrés ensuite dans les
détails. Pensant qu'il était facile d'entendre tout ce qui
concernait les biens du corps, ils se sont appliqués à traiter avec
le plus grand soin des biens de l'esprit. Ils ont trouvé dès l'abord
au fond de l'âme des semences de justice, et les premiers de tous
les philosophes ils ont enseigné que c'est par une impulsion
naturelle que les parents aiment leurs enfants; que c'est
pareillement la nature qui par un lien plus ancien joint les hommes
et les femmes dans le mariage; et que de ces premières institutions
sont venues toutes les affections de famille. Partis de ces premiers
éléments, ils ont expliqué l'origine et les développements de toutes
les vertus. Bientôt ils ont vu naître la grandeur d'âme, qui nous
met en état de tenir tête à la fortune, parce que les plus grands
biens du monde sont dans la puissance du sage. Et de fait, un esprit
formé par les préceptes des anciens philosophes se met aisément
au-dessus des accidents et des injures du sort. Ils nous ont
enseigné aussi que les germes déposés par la nature dans nos âmes
nous ont excités à l'acquisition de certains biens qui grossissent
comme des trésors; c'est ainsi que nous sommes engagés à la
contemplation des secrets de la nature, par un désir inné de
566 connaître qui enflamme nos
esprits, et qui nous fait aimer en conséquence à communiquer notre
savoir et à démontrer nos convictions. Et parce que de tous les
animaux l'homme est le seul qui soit capable de honte et de pudeur,
qu'une impulsion naturelle porte à lier société avec ses semblables,
et qui prenne garde, dans tout ce qu'il fait et ce qu'il dit, à ne
rien laisser échapper qui ne soit honnête et décent; ces tendances
naturelles leur ont paru, comme j'ai dit, des semences déposées dans
nos âmes pour leur faire porter des fruits de tempérance, de
modestie, de justice et de toute sorte de perfections et de vertus.
VIII. Voilà, Caton, toute la doctrine des philosophes dont je parle.
Après vous l'avoir exposée, je voudrais bien savoir pourquoi Zénon a
rompu avec l'ancienne école et ce qu'il a trouvé à blâmer dans ce
système. Serait-ce le principe que toute nature tend à se conserver
elle-même? que tout être animé est en quelque façon confié à
lui-même, et doit pourvoir à son salut et se maintenir dans son
espèce? Serait-ce ce dogme, que tous les arts ayant pour but de
répondre le mieux possible aux vœux de la nature, il en doit être de
même du grand art de la vie? Ou bien celui-ci, que l'homme étant
composé d'âme et de corps, ces deux parties ont chacune, ainsi que
leurs qualités, un prix qui leur est propre? Est-ce que cette grande
prééminence accordée par les anciens aux qualités de l'âme lui
aurait déplu? Aurait-il trouvé mauvais tout ce qu'ils disent de la
prudence, de la science, de la société du genre humain, et aussi de
la tempérance, de la modération, de la grandeur d'âme, en un mot, de
toutes les vertus? Les Stoïciens eux-mêmes avoueront que tout cela
est parfaitement bien dit, et qu'il n'y a rien jusqu'ici qui ait pu
motiver la rupture de Zénon. Mais ils en allégueront sans doute
quelques autres sujets importants; ils diront que les anciens
étaient dans de grandes erreurs, et que lui, qui cherchait ardemment
la vérité, n'a pu les souffrir. En effet, qu'y a-t-il de plus mal
entendu, de plus insoutenable et de plus extravagant que de mettre
la santé, l'absence de la douleur, l'intégrité de la vue et des
autres sens au rang des biens, au lieu de dire qu'entre toutes ces
choses-la et leurs contraires il n'est aucune différence véritable?
Car tous ces prétendus biens ne sont pas des biens, mais des objets
préférés. Quant aux qualités du corps, n'y avait-il pas aussi de la
folie aux anciens à dire qu'elles sont à rechercher pour
elles-mêmes? On peut les prendre, mais non pas les rechercher. Même
folie en ce qui touche la vie entière, dont tout le prix est dans la
vertu; il ne faut pas dire que la vie où abondent ces avantages
conformes à la nature, est plus à rechercher, mais seulement qu'elle
est préférable. Enfin quoique la vertu seule rende la vie tellement
heureuse qu'elle ne puisse pas l'être davantage, il faut avouer que
le sage, alors même qu'il est au comble du bonheur, peut encore
manquer de quelque chose; et c'est pourquoi il prend soin d'éloigner
de lui les douleurs, les maladies et toutes les infirmités
corporelles.
IX. O la grande force d'esprit et le juste sujet d'établir une
nouvelle doctrine! Mais poursuivons, et nous allons voir paraître
ces conséquences que vous avez très méthodiquement exposées
vous-même. Voilà que la vanité de l'esprit, l'injustice, tous les
vices sont semblables; que toutes les fautes sont égales; et que
ceux 567 qui, par un heureux
naturel, et par le secours de l'étude, auraient fait de grands
progrès dans la vertu, s'ils n'en ont atteint la perfection, sont
encore souverainement misérables, et qu'il n'est aucune différence
entre leur vie et celle des plus grands scélérats. Ainsi Platon, un
si grand homme, s'il n'a pas été véritablement sage, n'a pas mené
une vie plus estimable ni plus heureuse que le plus méchant homme du
monde.
Voilà ce qui s'appelle corriger l'ancienne philosophie et la
réformer. Mais quel accès une pareille réforme peut-elle avoir dans
la ville, au barreau, dans le sénat? Comment souffrir un homme qui
prétendrait enseigner le premier l'art de vivre avec dignité et
sagesse en ne faisant que changer les noms des choses; et qui,
pensant comme tout le monde, se contenterait de créer un nouveau
vocabulaire pour une doctrine dont il ne changerait ni la portée ni
l'esprit; réformant les mots, laissant les opinions intactes? Un
avocat, défendant un accusé, irait-il dire, en terminant son
plaidoyer, que l'exil, que la confiscation des biens n'est pas un
mal? que ce sont là des choses à rejeter, mais non pas à fuir, et
qu'un juge ne doit point avoir de pitié? Qu'Annibal soit aux portes
de Rome, qu'il lance un javelot par-dessus les remparts, un orateur
dira-t-il au peuple que ce n'est point un mal d'être pris, vendu,
mis à mort, de perdre la patrie? Et quand le sénat décerna le
triomphe à l'Africain, quelle mention de sa vertu ou de son bonheur
aurait-il pu faire dans le décret, s'il n'y a véritablement de vertu
ni de bonheur que dans le sage? Quelle est donc cette philosophie
qui parle comme tout le monde en public, et qui dans ses livres a
son langage à part; de telle sorte pourtant que les expressions dont
elle se sert, ne changent rien à la nature des choses, qui demeurent
toujours les mêmes sous des termes différents? Qu'importe en effet
que les richesses, le pouvoir, la santé, soient appelés des biens ou
des choses à préférer, si celui qui les appelle des biens n'y
attache pas plus de prix que vous qui les appelez d'une autre sorte?
Aussi un philosophe de beaucoup d'autorité et d'esprit, un homme
véritablement digne de l'amitié de Scipion et de Lélius, Panétius,
dans le livre qu'il adresse à Tubéron sur le dogme qu'il faut
supporter la douleur, ne dit jamais que la douleur ne soit point un
mal, ce que cependant il aurait dû écrire en tête de son ouvrage,
s'il avait pu raisonnablement le défendre; il dit seulement ce que
c'est que la douleur, quelle en est la force, combien elle est
contraire à la nature, et nous enseigne enfin l'art de la supporter.
Voilà donc un Stoïcien dont le sentiment me paraît condamner ce
qu'il y a de dur et d'étrange dans le langage de son école.
X. Mais, Caton, pour me rapprocher de ce que vous avez dit, serrons
les choses de plus près et comparons les dogmes que vous avez
exposés avec ceux que je préfère. A l'égard des principes qui vous
sont communs avec les anciens, tenons-les pour accordés; quant à
ceux qui sont en contestation entre nous, examinons-les, s'il vous
plaît. – Je le veux bien, répondit – il, et je suis d'avis que nous
serrions les choses de plus près, comme vous venez de le proposer.
Jusqu'ici tout ce que vous avez dit est bon pour le public; mais
j'attends de vous quelque chose de mieux. – De moi? Repris-je; j'y
ferai mon possible, mais si je ne suis pas en veine, vous me
permettrez d'en revenir au simple bon sens. Avant tout, posons ce
principe, que la nature nous a recommandés à nous-mêmes, et que le
premier désir 568 qu'elle nous
donne est celui de notre conservation. Voilà un point dont nous
convenons tous deux. Accordons ensuite qu'il nous faut chercher à
savoir qui nous sommes, pour que nous puissions nous conserver tels
que nous devons être, c'est-à-dire, comme des hommes composés d'âme
et de corps, et faits de telle et telle manière. Il faut que nous
aimions ces diverses parties de notre être comme le demande notre
premier désir naturel; il faut que, sans en négliger aucune, nous
établissions un souverain bien qui offrira, si nos premières
impressions sont vraies, la réunion la plus complète et la plus
parfaite: des choses conformes à la nature. Voilà le premier
principe de la morale stoïcienne, avec cette différence toutefois
que votre école l'exprime en moins de paroles que moi; "Vivre selon
la nature", voilà pour elle le souverain bien.
XI. Que les Stoïciens nous enseignent maintenant ou plutôt
enseignez-nous vous-même (car qui le peut faire mieux que vous?)
comment étant partis des mêmes principes que nous, vous arrivez à
conclure que vivre honnêtement (c'est-à-dire, selon vous, vivre
vertueusement ou conformément à la nature) soit uniquement le
souverain bien; comment et en quel endroit vous avez tout à coup
abandonné le corps, et tout ce que vous reconnaissez conforme à la
nature, mais qui n'est pas en notre puissance; et enfin le devoir
lui-même. Je vous demande comment il est arrivé que de si grandes
recommandations faites d'abord par la nature, aient été ensuite
négligées par la sagesse! Si nous cherchions quel pourrait être le
souverain bien, je ne dis pas d'un homme, mais d'un pur esprit (car
il est permis de faire des fictions pour trouver plus aisément la
vérité), nous verrions que votre souverain bien ne serait pas encore
uniquement le sien. Il désirerait encore le bon état de son être, et
l'absence de toute douleur; il tendrait de toutes ses puissances à
la conservation et au maintien de ses qualités naturelles, et
regarderait comme son bien suprême de vivre selon la nature,
c'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué, d'avoir ou toutes les
choses qui seraient conformes à sa nature, ou du moins la plupart
d'entre elles et les plus considérables. Car de quelque sorte que
vous imaginiez un être animé, quand même il serait sans corps, comme
nous le supposons ici, il faudrait cependant que ce pur esprit eût
en lui quelque trait équivalent à ceux qui se trouvent dans le
corps, et par suite que le souverain bien, tel que je l'ai exposé,
pût seul lui convenir. Chrysippe parlant des différentes espèces
d'êtres animés, dit que les uns excellent par le corps, les autres
par l'esprit, et d'autres enfin par l'un et par l'autre; il
recherche ensuite quel doit être le bien suprême de chaque espèce.
Puis, comme il met l'homme dans la classe des êtres qui excellent
par l'esprit, il fait consister le souverain bien de notre nature,
non pas à exceller toujours par l'esprit, mais à vivre comme si nous
n'étions qu'esprit.
XII. De toutes façons on ne pourrait mettre le souverain bien
uniquement dans la vertu, que pour un être animé qui serait un pur
esprit, à cette condition cependant que ce pur esprit n'aurait en
lui rien de conforme à sa nature, comme, par exemple, le bon état de
son être. Mais c'est une chose qui ne se peut pas même imaginer, et
qui implique contradiction. Si Chrysippe prétend qu'il est certains
biens d'une si médiocre im-
569 portance qu'ils s'évanouissent en comparaison de la vertu, je
suis d'accord avec lui. C'est ce que dit Épicure de la volupté,
qu'il est des plaisirs si faibles que les grandes voluptés les
obscurcissent et les étouffent en quelque sorte. Mais on ne peut
mettre dans cette classe une foule d'avantages corporels très
considérables par leur prix ou par leur durée. Véritablement pour
ceux qui sont si légers qu'à peine on les aperçoit, nous en
souvenons volontiers; il est indifférent de les avoir ou de ne les
avoir pas; c'est comme ce que vous disiez tantôt de la lumière d'un
flambeau ajoutée à celle du soleil ou d'une obole de plus dans le
trésor de Crésus. Pour les biens qui ont un peu plus d'éclat, il se
peut faire encore que leur possession vous intéresse médiocrement.
Si l'on donnait un mois de plus de félicité à un homme qui aurait
vécu dix ans dans le bonheur; ce surcroît de jouissance aurait son
prix et serait un bien; mais retranchez-le et le bonheur ne sera pas
détruit pour cela. Il en est à peu près de même des biens du corps;
ils ajoutent au bonheur de la vie un complément qui mérite qu'on y
travaille. Et les Stoïciens se moquent quand ils disent, que si à
une vie vertueuse on ajoute une bouteille ou une étrille de plus, le
sage doit donner la préférence à la vie qui se trouve enrichie de
cette sorte, et que cependant il n'en sera pas plus heureux. On rit
de tels discours, on ne les réfute pas. N'aurait-on pas trois fois
raison de se moquer d'un homme qui se mettrait en peine d'une
bouteille de plus ou de moins? Mais quel est l'homme qui ne se
sentirait pas obligé à celui qui le délivrerait ou d'une paralysie
ou d'une violente douleur? Certes, le sage qu'un tyran ferait mettre
sur le chevalet, n'aurait pas alors le même visage que s'il venait
de perdre une bouteille; mais un homme qui va livrer un grand et
difficile combat contre un ennemi aussi terrible que la douleur, il
recueillerait en lui-même tout ce qu'il aurait de courage, et il
s'armerait de force et de patience pour bien soutenir une si
violente attaque. Après tout, il ne s'agit pas ici des avantages que
leur peu d'importance rend inaperçus ou indifférents, mais de ceux
qui peuvent combler la mesure du souverain bien. Dans une vie toute
sensuelle, une volupté de plus est effacée et perdue; mais quelque
petite qu'on l'imagine, elle compte cependant parmi les voluptés qui
remplissent cette vie. Une obole n'est rien dans les trésors de
Crésus, et cependant elle compte parmi ses richesses. Tout
pareillement, que dans une vie heureuse, on ne s'aperçoive pas de
ces faibles biens, qui sont conformes à la nature, je le veux; mais
ils n'en font pas moins partie intégrante du bonheur.
XIII. Puisque nous convenons qu'il y a dans l'homme une impulsion
naturelle vers les choses qui sont conformes à la nature, toutes
ensemble forment une certaine somme de biens que nous devons
calculer. Après ce premier travail nous pourrons à loisir estimer
leur importance relative, examiner en quoi chacune contribue, selon
son excellence, à rendre la vie heureuse, et porter nos regards
jusque sur ces biens cachés que leur médiocrité nous laisse à peine
entrevoir, ou même nous dérobe entièrement.
Mais que dirons-nous de ce principe que personne ne révoque en
doute? Il est universellement admis que tous les êtres de la nature
ten- 570 dent à une fin
semblable et que le souverain bien est le même pour tous. Car tout
ce qui est dans la nature s'aime. Est-il un être qui veuille
renoncer à lui-même ou à quelqu'une de ses parties, ou à l'intégrité
et au plein exercice de l'un de ses membres, au mouvement, au repos,
ou enfin à la moindre des choses qui sont selon la nature? Est-il un
être animé qui jamais ait méconnu les lois primitives de sa
constitution et de son caractère? Certainement non; tous d'un bout à
l'autre de leur vie se montrent toujours semblables à eux-mêmes.
Comment donc est-il arrivé que la nature de l'homme seule se soit en
quelque façon répudiée elle-même, qu'elle ait oublié entièrement le
corps, et qu'au lieu de mettre le souverain bien dans tout l'homme,
elle ne l'ait mis que dans une seule partie de l'homme? Que devient
alors cet axiome universel dont les Stoïciens eux-mêmes tombent
d'accord: que la fin naturelle et dernière des actions, qui fait
l'objet actuel de nos recherches, est semblable pour tous les êtres
animés? Le seul moyen de maintenir cette similitude serait de
déclarer que, pour les autres espèces aussi, le souverain bien est
ce qu'il y a de plus excellent dans chacune d'elles. C'est là, ce me
semble, où devrait conduire l'opinion des Stoïciens. Pourquoi donc
ne réformez-vous pas les premières impulsions de la nature? Pourquoi
dites-vous que tout animal, dès qu'il est né, est appliqué tout
entier à s'aimer et n'est occupé que du soin de sa conservation? Que
ne dites-vous plutôt qu'il ne s'attache qu'à ce qu'il y a plus
excellent en lui, ne s'applique qu'à le conserver, et qu'en général
la nature ne tend qu'au maintien de ce qu'elle a mis de plus
excellent dans chaque espèce? Pourquoi d'ailleurs ce terme de plus
excellent, s'il n'y a absolument aucun autre bien? Mais si l'on doit
rechercher sans exception tout ce que la nature désire
primitivement, pourquoi ne pas faire correspondre le souverain bien
à tous ces vœux de la nature ou du moins aux plus considérables
d'entre eux? Comme Phidias pourrait avoir commencé une statue et
puis la finir, il pourrait aussi l'avoir reçue ébauchée par un autre
et puis l'achever. C'est là l'image de la sagesse; elle n'a pas fait
l'homme, elle l'a reçu tout ébauché des mains de la nature; elle
doit donc, sans perdre de vue la nature, poursuivre son ouvrage, et
mettre la dernière main à cette statue qu'on lui confie. Mais
comment la nature a-t-elle ébauché l'homme? Que reste-t-il à faire à
la sagesse? Que doit-elle achever et mener à terme? S'il n'y a rien
en lui à perfectionner que le mouvement de l'esprit, c'est-à-dire la
raison, il faut qu'il n'ait point d'autre objet dans toute sa vie
que la vertu, qui est la perfection de la raison. S'il n'y a en lui
que le corps à développer, alors c'est la santé, c'est l'absence de
la douleur, la beauté, en un mot tout ce qui appartient au corps qui
doit faire uniquement son objet. Mais c'est du bien de tout l'homme
qu'il est maintenant question.
XIV. Pourquoi donc n'examinons-nous pas ce qui regarde toute sa
nature? Comme on convient universellement que le véritable emploi de
la sagesse est d'avoir soin de former l'homme, les uns (car vous ne
devez pas vous imaginer que je parle contre les Stoïciens
seulement), les uns font consister le souverain bien de l'homme en
ce qui ne dépend pas de lui, comme s'il s'agissait de quelque brute;
les autres, au contraire, comme si le corps n'était absolument rien,
ne songent uniquement qu'à l'esprit; quoique cependant l'esprit ne
soit pas un je ne sais quel souffle
571 sans consistance et pour moi parfaitement
incompréhensible, mais un sujet renfermé dans une certaine espèce de
corps, à qui par conséquent la vertu ne peut suffire, et qui
recherche aussi l'absence de la douleur. De sorte que les uns et les
autres sont comme un soldat qui découvrirait le côté gauche pour
protéger le droit, ou comme ces philosophes, semblables à Hérille,
qui, dans l'esprit lui-même, ne s'inquiéteraient que de la
connaissance et négligeraient entièrement l'action. L'opinion de
ceux qui, au mépris de la plupart de nos biens, n'en choisissent et
n'en glorifient qu'un seul, est, pour ainsi dire, un système boiteux
et mutilé, tandis que la doctrine de ceux qui, en recherchant le
souverain bien de l'homme, ont compris et consacré à la fois tous
les intérêts de l'âme et du corps, est seule entière et complète.
Mais, vous autres Stoïciens, parce que la vertu, de notre aveu
unanime, est la pièce la plus parfaite et la gloire sans rivale de
la nature humaine, et parce que nous regardons les sages comme des
hommes accomplis et excellents, vous voulez éblouir nos esprits par
l'éclat de la vertu. Il y a dans chaque animal quelque chose en quoi
il excelle, témoin les chevaux et les chiens; et cependant,
direz-vous que la santé et l'absence de la douleur ne sont pas
encore des besoins pour eux? Il en est de même de l'homme; la
perfection pour lui, répond à ce qu'il y a de plus parfait et de
plus excellent dans sa nature, et réside dans la vertu. Je vous
reprocherai donc de ne pas faire assez d'attention à la marche de la
nature, et à ses progrès en toute chose. Ce qu'elle fait dans les
grains, lorsque l'herbe est montée en épi, qui est de compter alors
l'herbe pour rien, elle ne le fait pas dans l'homme lorsqu'elle l'a
conduit jusqu'à l'usage et à l'habitude de la raison. Au contraire
elle agit toujours en lui de telle sorte que, malgré ses nouvelles
conquêtes, elle ne renonce pas à ses premiers biens, et qu'après
avoir ajouté la raison aux sens, elle n'abandonne pas les sens. La
vigne a besoin de culture, et si cette culture, dont l'objet est de
maintenir toutes les parties de la vigne dans le meilleur état
possible (car il nous est permis aussi bien qu'à vous de faire des
fictions, pour mieux éclaircir les choses), si, dis-je, cet art de
cultiver la vigne appartenait tout à coup à la vigne elle-même,
cette nouvelle partie voudrait, je crois, tout ce qui pourrait
servir à bien entretenir la vigne comme auparavant; et néanmoins
elle se préférerait à toutes les autres parties de la plante,
jugeant qu'il n'est rien dans la vigne de si excellent qu'elle. De
la même sorte, tant qu'il n'y a encore que les sens qui soient unis
à la nature de l'homme, ils ont soin de la conserver en se
conservant eux-mêmes. Dès que la raison survient, comme elle porte
avec elle des titres incomparables de souveraineté, tout ce que la
nature avait mis d'abord en l'homme devient soumis à son empire;
mais, reine prévoyante, c'est en veillant à la conservation de tous
ces biens naturels, qu'elle gouverne la vie humaine. Je ne puis donc
assez m'étonner de l'inconséquence des Stoïciens. Ils disent que
l'impulsion naturelle qu'ils nomment ὁρμήν, que le
devoir, et la vertu elle-même, servent à conserver en nous ce qui
est conforme à la nature; ensuite, quand ils veulent arriver au
souverain bien, ils oublient tout ce qu'ils ont dit, et nous donnent
deux ouvrages 572 au lieu
d'un, prendre simplement telles choses, en rechercher telles autres,
au lieu de soumettre toutes nos actions à une seule et même règle.
XV. Mais, dites-vous, il est impossible de fonder la vertu sur la
nature, si ce qui est étranger à la vertu peut contribuer au bonheur
de la vie. C'est tout le contraire; il n'y a plus de moyen d'établir
la vertu, si tout ce qu'elle doit choisir ou rejeter ne se rapporte
à une même fin suprême. Car si nous venons à négliger les vœux de la
nature, nous tomberons dans les rêves et dans les folies d'Ariston,
et nous oublierons quels principes nous avons donnés à la vertu. Si
nous ne méprisons pas ces vœux et que cependant nous ne les
rapportions pas à l'objet du souverain bien, nous ne serons guère
éloignés de la frivolité d'Hérille. Il faudra que nous nous
proposions deux sortes de vie, puisqu'il établit deux fins dernières
des biens, qui, pour être véritables, ne devraient en composer
qu'une seule. Mais voilà que ces deux ordres de biens sont séparés
de telle sorte, qu'entre les uns et les autres on ne laisse plus
aucun lien: je ne connais rien de plus déplorable. Car certainement
la vérité est en contradiction avec vos maximes; et il ne saurait y
avoir de vertu, si elle ne répond à tous les premiers vœux de la
nature, et ne les regarde tous comme se rapportant au souverain
bien. La vertu n'est pas faite pour mutiler la nature, mais pour la
conserver; et cependant, selon vous, elle ne prend soin que d'une
partie de nous-mêmes, et abandonne l'autre. Que si notre humaine
condition pouvait prendre la parole, elle nous dirait certainement:
que le premier mobile de ses désirs a été de conserver l'homme dans
l'état où la nature l'a fait naître, mais qu'alors le principal vœu
de la nature n'était pas encore bien éclairci. Éclaircissons-le
donc. Qu'y trouverons-nous, si ce n'est qu'il ne faut négliger
aucune partie de notre être? S'il n'y a rien en nous que la raison,
il ne faut mettre le souverain bien que dans la vertu. Mais si nous
avons de plus un corps, cette lumière portée sur les vœux de la
nature, aura-t-elle pour résultat l'abandon de ce qui auparavant
partageait nos soins? Est-ce donc vivre conformément à la nature que
de s'écarter d'elle? Semblables à ces philosophes qui, des
perceptions des sens s'élevant à des conceptions plus nobles et plus
divines, abandonnèrent bientôt les sens, vos Stoïciens, quand les
vœux de la nature leur ont fait connaître la beauté de la vertu,
méprisent tout à coup les sources de cette précieuse connaissance,
ne prenant pas garde que les secrètes impulsions de notre nature ont
une telle portée, qu'elles embrassent depuis nos premiers désirs
jusqu'à la fin dernière de nos actions; et ne comprenant pas qu'en
les négligeant ils détruisent le fondement des excellentes choses
qu'ils prétendent établir.
XVI. C'est pourquoi il me semble que tous ceux qui font consister le
souverain bien à vivre honnêtement, se sont trompés, les uns plus,
les autres moins; Pyrrhon plus qu'aucun autre, lui qui, en dehors de
la vertu, ne laisse absolument rien qu'on puisse désirer; ensuite
Ariston, qui, n'osant pas aller jusqu'à cette extrémité, admet une
impulsion secondaire qui porte le sage à désirer les avantages
naturels, suivant qu'ils frappent son esprit, ou s'offrent à lui
dans la carrière. Et véritablement, il est plus raisonnable que
Pyrrhon, en ce que du moins il admet quelque espèce de désir; mais
il l'est moins que tous les autres, en ce qu'il s'est entièrement
écarté de 573 la nature. Les
Stoïciens qui mettent le souverain bien uniquement dans la vertu,
ressemblent beaucoup par là à ces deux philosophes, mais ils valent
mieux que Pyrrhon, en ce qu'ils remontent à la source du devoir; et
ils sont plus sensés qu'Ariston, en ce qu'ils n'admettent point que
la règle de nos désirs soit le hasard. Cependant, lorsqu'ils ne
rattachent pas au souverain bien les choses conformes à la nature,
et qui, de leur aveu même, méritent d'être choisies, ils s'éloignent
de la nature, et rentrent dans la compagnie d'Ariston. Celui-ci
imagine je ne sais quels désirs fortuits; votre école admet les
premières impulsions de la nature, mais elle les sépare du souverain
bien et de notre but suprême; quand elle les reconnaît et convient
qu'elles peuvent régler les choix du sage, il semble qu'elle suive
la nature; mais lorsqu'elle prétend que l'objet de ces vœux ne
contribue en rien au bonheur, elle abandonne la nature tout de
nouveau.
Jusqu'ici je n'ai rien dit que pour marquer le peu de sujet que
Zénon avait eu de secouer l'autorité des anciens. Passons maintenant
au reste; si ce n'est, Caton, que vous avez quelque chose à
répondre, ou que vous trouviez que j'aie déjà trop parlé. – Ni l'un
ni l'autre, me dit-il; car je suis bien aise que vous acheviez ce
que vous avez à dire; et vous ne sauriez jamais parler trop
longtemps à mon gré. – J'en suis ravi, lui dis-je; et que
pourrais-je avoir de plus à souhaiter que de m'entretenir de la
vertu avec Caton, le modèle de toutes les vertus? Mais en premier
lieu remarquez, s'il vous plaît, que la maxime mère de tout votre
système, “qu'il n'y a rien de bien que ce qui est honnête, et que
c'est à vivre honnêtement que consiste la souveraine félicité de la
vie,” vous est commune avec tous ceux qui mettent le souverain bien
uniquement dans la vertu; et ce que vous dites, qu'il ne peut y
avoir de vertu, si on attache le moindre prix à ce qui n'est pas
l'honnête, ceux que j'ai nommés tout à l'heure le disent comme vous.
Il me semble donc que dans la controverse que Zénon soutint contre
Polémon, de qui il avait reçu le dogme des premières impulsions de
la nature, il eût beaucoup mieux fait, partant des mêmes principes
que son maître, de signaler le premier point où il se voyait arrêté,
et d'où leur contestation devait naître, que d'employer contre son
propre sentiment les termes et les maximes de ceux qui ne voulaient
pas même que leurs souverains biens fussent provenus de la nature.
XVII. Je n'approuve pas non plus que les Stoïciens, après avoir dit,
comme ils font, que le seul bien c'est l'honnête, déclarent ensuite
qu'il faut admettre des mobiles d'actions conformes à la nature et
en harmonie avec elle, afin que l'art de les bien choisir donne
naissance à la vertu. Car il ne fallait pas faire résider la vertu
dans cet art de bien choisir, pour arriver à cette contradiction,
que le souverain bien eût encore besoin d'acquérir autre chose que
lui. Il faut en effet que ce qui est à prendre, à choisir ou à
désirer, soit tellement compris dans telle somme parfaite de biens,
que celui qui la possède, n'ait plus rien à souhaiter. Voyez comme
ceux qui font tout consister dans la volupté, sont éclairés sur ce
qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. On sait infailliblement à quoi
tendent toutes leurs actions, ce qu'ils se proposent de suivre ou
d'éviter. Que le 574 souverain
bien soit celui que je soutiens maintenant, on voit aussitôt quels
seront les devoirs et les mobiles de l'homme. Mais vous qui ne vous
proposez uniquement que ce qui est droit et honnête, vous ne sauriez
dire d'où vous tirez le principe de tout ce que vous faites; et vous
n'êtes pas moins embarrassés là-dessus que ceux dont la devise est
de suivre tout ce qui leur vient dans l'esprit et se présente à eux;
c'est alors que vous revenez à la nature. Mais elle vous répondra
fort justement que c'est une grave erreur de lui demander à elle les
principes de nos actions, et de chercher ailleurs le souverain bien;
que ces principes et le bien suprême sont intimement unis. Elle dira
que, de même qu'on a rejeté l'opinion d'Ariston qui niait la
différence naturelle des choses, et soutenait qu'il n'y a au monde
d'autre distinction à établir qu'entre les vertus et les vices, de
même Zénon s'est trompé en prétendant que rien ne peut servir, même
dans la plus faible mesure, à acquérir le souverain bien, si ce
n'est la vertu seule; qu'il s'est contredit en refusant toute
influence sur le bonheur aux avantages naturels, et en affirmant
toutefois qu'il y a en eux je ne sais quel mérite qui porte à les
désirer; comme si le désir qu'ils inspirent n'avait pas un rapport
nécessaire à l'acquisition du souverain bien! Quoi de moins
conséquent que cette maxime des Stoïciens, qu'après être parvenus à
reconnaitre le souverain bien, ils retournent à la nature pour
prendre d'elle le principe des actions et le fondement du devoir?
Car ce n'est point ce que nous faisons qui nous porte à désirer les
biens naturels; ce sont au contraire les biens naturels qui excitent
d'abord nos désirs, ensuite nos actions.
XVIII. Je viens maintenant à vos conclusions vives et courtes, comme
vous les nommez; et premièrement à cet argument si court, que rien
ne peut l'être davantage: “Tout ce qui est bien est louable; tout ce
qui est louable est honnête; donc tout ce qui est bien est honnête.”
Voilà un poignard à lame de plomb! Croyez-vous donc que quelqu'un
vous accordera votre première proposition? Et si on vous l'accorde,
qu'est-il besoin d'un argument en forme? Car si tout ce qui est bien
est louable, incontestablement il est honnête. Mais qui vous
accordera ce premier point, hormis peut-être Pyrrhon, Ariston, ou
leurs semblables, que vous n'approuvez pas? Pour Aristote,
Xénocrate, et tous ceux de la même école, ils ne vous l'accorderont
jamais, eux qui mettent la santé, les forces, les richesses, la
gloire et tant d'autres avantages au nombre des biens, mais qui ne
disent pas que ce soient des choses louables. Il est vrai que s'ils
ne font pas consister le souverain bien dans la vertu seule, ils
mettent cependant la vertu fort au-dessus de tous les autres biens.
Que feront donc, à votre avis, ceux qui ne comprennent point la
vertu dans le souverain bien, comme Épicure, Hiéronyme et ceux
encore qui soutiennent l'opinion de Carnéade? Et comment enfin,
Calliphon et Diodore vous accorderaient-ils votre principe, eux qui
ajoutent à l'honnêteté des biens d'une tout autre espèce? Vous voyez
donc, Caton, qu'en prenant pour accordé ce qui ne l'est pas, il vous
est aisé d'en tirer telle conséquence qu'il vous plait. J'en dis
autant du sorite que vous faites (quoique ce soit une sorte
d'argument que vous n'approuviez guère): “Tout ce qui est bien est
désirable; tout ce qui est désirable est à rechercher; tout ce qui
est à rechercher 575 est
louable,” et le reste de la gradation; mais je m'arrête à ce terme,
et je déclare que personne non plus ne vous accordera que tout ce
qui est à rechercher soit louable. C'est encore un de vos arguments,
qui ne conclut rien, et qui est émoussé et sans force, que l'on peut
se glorifier d'une vie heureuse, ce que l'on ne ferait jamais à bon
droit si elle n'était honnête. Zénon invoque ici un principe qui lui
sera accordé par Polémon, par son maître et par tous ceux de la même
école, et généralement par les philosophes qui préfèrent la vertu à
toutes choses, mais qui ne laissent pas de lui donner quelque
auxiliaire pour accomplir le souverain bien. Car si la vertu mérite
qu'on s'en glorifie comme elle le mérite en effet, si elle l'emporte
sur tout au monde plus qu'on ne peut dire, il pourra bien se faire
que l'homme doué seulement de la vertu et manquant des autres biens,
soit heureux, mais on ne vous accordera pas pour cela que la vertu
seule doive être mise au rang des biens. Quant à ceux qui ne
comprennent point la vertu dans le souverain bien, ils ne
conviendront peut-être pas qu'on puisse à bon droit se glorifier
d'une vie heureuse, quoiqu'ils ne laissent pas de se glorifier
quelquefois de leurs voluptés.
XIX. Vous voyez donc que vous raisonnez sur des principes ou qu'on
ne vous accorde point, ou qui ne peuvent vous servir, s'ils vous
sont accordés. En entendant tous ces arguments, je ne puis me
défendre de croire qu'il serait bien plus digne de la philosophie,
et de nous surtout, dans cette recherche du souverain bien, de nous
attacher à réformer non pas des termes, mais notre vie, notre
conduite et nos sentiments. Quel est l'homme, dites-moi, que ces
conclusions courtes et vives, qui vous plaisent tant, feront changer
d'opinion? On est attentif, on a le plus vif désir d'apprendre
pourquoi la douleur n'est pas un mal; qu'enseignez-vous? que c'est
une chose dure, fâcheuse, contraire à la nature, difficile à
supporter que de souffrir; mais que la douleur ne renfermant en elle
ni fraude, ni improbité, ni malice, ni rien de déshonnête et de
honteux, ce n'est point un mal. Si après avoir entendu cette réponse
on ne se met point à rire, du moins ne s'en retournera-t-on pas plus
ferme qu'auparavant contre les attaques de la douleur. Et cependant
vous soutenez que l'on ne peut avoir l'âme forte, si l'on croit que
la douleur est un mal. Mais comment pourra-t-on l'avoir plus forte,
tant que l'on croira, ce que vous accordez vous-même, que la douleur
est une chose fâcheuse et à peine supportable? C'est la chose en
elle-même, et non pas ce qu'on en dit, qui rend l'homme faible.
Vous prétendez qu'on ne peut changer une seule lettre de votre
doctrine, sans qu'à l'heure même elle ne s'écroule toute.
Trouvez-vous donc que je n'y change qu'une lettre ou bien des pages
entières? Mais quand nos Stoïciens auraient aussi bien observé
l'ordre des choses que vous le dites, et que tout serait
admirablement lié dans leur doctrine, à quoi sert cette belle
conséquence, si le fondement est vicieux? Zénon s'est écarté de la
nature dès les premiers pas. Après avoir établi le souverain bien
dans l'excellence de l'esprit, que nous appelons la vertu; après
avoir dit qu'il n'y a rien de bien que ce qui est honnête; et que la
vertu est impossible, si en dehors d'elle les choses sont meilleures
ou pires les unes que les autres; il est vrai que dans la suite de
la doctrine nous le trouvons très fidèle à ces principes. Vous avez
raison; je ne puis le nier. Mais les consé-
576 quences sont si fausses, que
de toute nécessité les principes d'où elles sont sorties ne peuvent
être vrais. Car vous savez que les Dialecticiens nous apprennent que
si une conséquence bien tirée est fausse, le principe est
nécessairement faux. Voici le raisonnement qu'ils font; il est
incontestable et tellement évident qu'ils croient inutile de
l'appuyer de preuves: “Si cela est, ceci est nécessairement; or ceci
n'est pas, donc cela n'est pas non plus.” Ainsi, en détruisant vos
conséquences, on ruine vos principes. Vous êtes conduits à déclarer:
“Que tous ceux qui n'ont pas la sagesse sont également misérables;
que tous les sages sont extrêmement heureux; que toutes les bonnes
actions sont de même mérite; tous les péchés égaux;” toutes
propositions qui au premier coup d'œil sont magnifiques, mais qui
tombent dès qu'on les examine de près. Le sens commun et la nature y
répugnent; la vérité elle-même réclame en quelque sorte contre le
niveau absolu imposé aux choses par Zénon.
XX. Alors votre Phénicien (car vous savez que ceux de Citium, vos
clients, sont originaires de Phénicie), voyant qu'il ne pouvait
gagner sa cause, parce que la nature même luttait contre lui,
commença à donner un nouveau tour à ses expressions; et d'abord il
consentit à ce que ces choses que nous croyons des biens, fussent
regardées comme étant propres et convenables à la nature, et en
harmonie avec elle; bientôt il reconnaît que le sage, c'est-à-dire,
l'homme souverainement heureux, serait encore plus favorisé, s'il
avait ce que lui, Zénon, n'ose appeler des biens, mais qu'il avoue
être des convenances de la nature; enfin il déclare que Platon, s'il
n'avait pas eu la sagesse, n'aurait pas été dans la même condition
que Denys le Tyran; que celui-ci, qui devait désespérer de la
sagesse, n'avait rien de mieux à faire que de mourir; mais que pour
Platon, à qui un si bel espoir était permis, la raison lui
conseillait de vivre. Il disait aussi, que des fautes les unes sont
tolérables, les autres, non; parce que les unes transgressent un
plus grand nombre des devoirs de la vie, et les autres un moindre;
que parmi les insensés, il en est qui ne peuvent jamais devenir
sages, d'autres qui atteindraient à la sagesse, s'ils y employaient
leurs efforts. Ainsi donc, il parlait autrement que tout le monde,
en pensant comme le reste des hommes. Il n'attachait pas moins de
prix à ces avantages auxquels il refusait le titre de biens, que
ceux qui le leur accordaient. Qu'a-t-il donc prétendu en changeant
les dénominations des choses? Encore s'il avait rabattu quelque peu
de leur valeur, et s'il en avait fait moins d'estime que les
Péripatéticiens, il aurait montré que non seulement il parlait, mais
qu'il pensait encore autrement qu'eux.
Parlons maintenant du bonheur; car c'est à lui qu'il faut tout
rapporter; qu'en disent les Stoïciens? Ils prétendent que le bonheur
ne consiste pas dans la possession de tout ce que la nature désire,
mais dans la seule vertu. Comme dans toute dispute il s'agit ou de
la chose qui est en question, ou du nom qu'on lui donne, la
controverse tombe également sur l'une et sur l'autre, si l'on
méconnaît la chose, ou qu'on lui donne une fausse dénomination. Mais
si aucune sorte d'erreur n'a été admise, il faut alors avoir soin de
se servir des termes les plus usités, les plus propres, et qui
peuvent le mieux faire entendre
577 ce que l'on veut dire. Mais si les anciens ne se sont point trompés
sur les choses, peut on douter qu'ils ne se soient servis
d'expressions plus intelligibles? Voyons donc leurs opinions; nous
reviendrons ensuite à ce qui regarde les termes.
XXI. Ils disent que les désirs sont excités dans l'esprit, quand
quelque chose lui paraît être selon la nature; et que tout ce qui
est selon la nature est digne d'estime, à proportion de ce que
chaque chose en mérite par sa valeur naturelle. Qu'entre les choses
conformes à la nature, celles qui ne sont ni honnêtes ni louables,
n'excitent en aucune façon le désir dont je viens de parler; celles
au contraire qui provoquent le plaisir chez tous les êtres animés,
mais sont en même temps réglées par la raison de l'homme, se
présentent en grande partie comme convenables, et de plus comme
honnêtes, belles et louables. Les premières qu'ils appellent
naturelles, venant se joindre à celles qui sont honnêtes, composent
et accomplissent le bonheur. De tous ces avantages naturels, dont
les philosophes qui les nomment des biens ne font pas plus d'estime
que Zénon qui leur refuse ce titre, le plus excellent de beaucoup,
est celui qui est honnête et louable. Cependant s'il faut choisir
entre deux choses honnêtes dont l'une est en compagnie de la santé,
et l'autre de la maladie; on ne peut douter du choix vers lequel
notre nature nous portera. Mais dans leur opinion le pouvoir de la
vertu est si grand, elle a une telle supériorité et une telle
excellence, qu'il n'est au monde ni récompenses ni supplices assez
puissants pour détourner le sage de ce qu'il sait être juste. D'un
autre côté il n'est ni revers, ni tourments, ni malheurs dont ne
puissent triompher les vertus que la nature a mises en germes dans
toutes les âmes; non pas que ce triomphe soit facile et cette lutte
méprisable, car alors où serait le prix de la vertu? Mais pour que
nous entendions que ce ne sont pas tous les biens secondaires qui
composent la pièce la plus importante du bonheur ou du malheur de la
vie. En résumé, les choses que Zénon appelle estimables, acceptables
et propres à la nature, les Péripatéticiens les nomment des biens;
ils appellent vie heureuse celle qui contient la plupart ou les plus
considérables des biens; Zénon n'appelle bien que ce qui mérite par
lui-même et par sa propre excellence d'être recherché, et il dit que
le bonheur est uniquement dans la vertu.
XXII. S'il n'est question ici que des choses, vous voyez, Caton,
qu'il n'y a aucun sujet de discussion entre vous et moi; car nous
avons absolument les mêmes sentiments aux termes près. C'est ce que
Zénon a parfaitement vu lui-même; mais il y avait pour lui de la
joie et de l'orgueil à employer ces expressions magnifiques. Que
s'il pensait effectivement comme il parle, quelle différence y
aurait-il entre lui et Pyrrhon ou Ariston? Et s'il n'approuvait pas
leur doctrine, pourquoi tenir un autre langage que ceux dont il
partageait les sentiments? Que dis-je? Si les Platoniciens et tous
ceux de la même école pouvaient revivre et venaient vous dire:
“Lorsque nous avons appris, M. Caton, que vous cultiviez la
philosophie avec une ardeur extrême, que vous étiez un parfait homme
de bien, le plus équitable des juges, le plus religieux des témoins,
nous avons été fort surpris de savoir que vous nous ayez préféré les
Stoïciens dont les sentiments sur les biens et les
578 maux, sont ceux que Zénon
leur maître a reçus de Polémon que vous voyez au milieu de nous, et
dont le langage nouveau, au premier abord excite l'admiration, mais,
après examen, provoque le rire. Si vous pensez comme nous, pourquoi
ne pas vous servir des termes naturels et propres? Si l'autorité des
noms glorieux avait du pouvoir sur votre esprit, d'où vient qu'à
nous tous et à Platon lui-même vous préférez je ne sais quel
novateur? Vous surtout qui aviez de légitimes espérances de devenir
le premier citoyen de la république, et qui auriez pu recevoir de
nous d'excellentes instructions pour l'administrer d'une manière
digne de vous. Car nous avons traité avec un soin particulier de la
politique, et prodigué sur ce sujet enseignement et préceptes; nous
avons marqué les principes, les constitutions, le développement
naturel de tous les genres de gouvernement; lois, institutions,
mœurs, nous n'avons rien négligé! Et quant à l'éloquence, qui est
d'un si grand ornement aux chefs de l'État, et en laquelle nous
avons ouï dire que vous excelliez, combien n'auriez-vous pas trouvé
de secours et de modèles dans nos écrits?” Si ces grands hommes vous
parlaient de cette sorte, que pourriez-vous leur répondre? – Je vous
prierais, me dit-il, vous qui avez fait le discours pour eux, de
faire aussi pour moi la réponse, ou plutôt je vous demanderais un
peu de temps pour la leur adresser moi-même, si je n'aimais beaucoup
mieux vous entendre maintenant, et leur répondre plus tard en même
temps qu'à vous.
XXIII. Mais, Caton, si vous vouliez dire la vérité, voici, je crois,
ce que vous répondriez Que vous n'avez garde de n'estimer pas des
hommes de tant de génie et d'autorité; mais que le temps reculé où
ils vivaient les avait empêchés de bien connaître ce que les
Stoïciens depuis ont parfaitement démêlé; que les maximes de ces
derniers sont beaucoup plus graves et plus fortes, et qu'ils ont
parlé avec plus de pénétration et de justesse; que les premiers ils
ont dit que la santé n'est pas à rechercher, mais qu'il est permis
de la choisir, non pas véritablement comme un bien, mais comme
n'étant pas indigne de toute estime; quoique au fond, ceux qui
l'appellent un bien, n'y aient pas attaché plus de prix. Que vous
n'avez pu souffrir que ces philosophes, ces anciens à la longue
barbe, comme nous le disons de nos aïeux, aient cru que si un homme
sage et vertueux était de plus en bonne santé, qu'il eût une bonne
réputation et qu'il fût riche, il mènerait une vie plus souhaitable
et plus digne d'estime que celui qui avec autant de vertus serait
accablé de toutes sortes de maux comme l'Alcméon d'Ennius, “En proie
aux douleurs, exilé, sans pain.” Ils ont parlé en hommes peu
éclairés, quand ils ont dit que la vie du premier était préférable,
meilleure et plus heureuse. Les Stoïciens déclarent au contraire
qu'une telle existence est seulement à préférer, non pas qu'elle
soit au fond plus heureuse, mais parce qu'elle est plus conforme à
la nature. Ils ajoutent que tous ceux qui n'ont pas la sagesse sont
également misérables. Voilà ce que les Stoïciens ont bien vu, tandis
que leurs devanciers n'avaient pas découvert que des gens souillés
de crimes et de parricides n'étaient pas pourtant plus malheureux
que ceux qui, menant d'ailleurs une vie irréprochable, n'auraient
pas encore atteint une sagesse parfaite.
Ici, Caton, vous avez allégué des comparai-
579 sons dont votre école se sert
ordinairement; et qui sont les plus fausses du monde. Qui ignore,
dites-vous, que de plusieurs gens qui se noient et veulent se
sauver, ceux qui approchent le plus de la surface de l'eau sont plus
près de respirer que les autres? Comme cependant en réalité ils ne
respirent pas plus que ceux qui sont au fond, de même on n'est pas
plus avancé pour avoir fait quelques progrès dans la vertu, tous
ceux qui n'ont pas la parfaite sagesse, étant souverainement
malheureux. Et comme les petits chiens sur le point de voir, sont
encore aussi aveugles que ceux qui ne font que de naître, ainsi
Platon, qui ne voyait pas encore la pure sagesse, était aussi
aveugle des yeux de l'esprit que Phalaris.
XXIV. Ces sortes de comparaisons-là, Caton, dans lesquelles le mal
dont vous voulez vous tirer, est toujours le même, jusqu'à ce que
vous soyez complètement dehors, sont toutes fausses. Certainement
celui qui se noie ne peut respirer: qu'il ne soit hors de l'eau; et
les petits chiens avant de commencer à voir sont aussi aveugles que
s'ils devaient toujours l'être. Mais voici les comparaisons que l'on
peut faire: Un homme a mal aux yeux, un autre a la fièvre; bien
traités, ils se trouvent soulagés tous deux, l'un reprend chaque
jour des forces, l'autre voit plus clair de jour en jour. Il en est
de même de ceux qui travaillent à devenir vertueux; ils se corrigent
de leurs vices, ils reviennent de leurs erreurs. A moins que vous ne
pensiez que Tib. Gracchus le père qui ne songeait qu'à bien affermir
la république ne fût pas plus heureux que son fils qui ne
travaillait qu'à la ruiner. Et pourtant le père n'était pas encore
parvenu à la parfaite sagesse; (qui donc y est parvenu? Où? Et
quand?) mais ses guides étaient l'honneur et la gloire, et il avait
fait beaucoup de progrès dans la vertu. Comparons Drusus votre aïeul
avec C. Gracchus son contemporain. Toutes les plaies que celui-ci
faisait à la république, l'autre s'appliquait à les guérir. Or s'il
n'est rien qui rende les hommes si misérables que l'impiété et le
crime, de telle sorte que tous ceux qui n'ont pas la sagesse soient
misérables, comme ils le sont en effet; cependant il faut avouer que
celui qui travaille au salut de sa patrie, ne peut être aussi
misérable que celui qui travaille à la détruire. Le vice diminue
donc à mesure que l'on fait quelques progrès dans la vertu. Vos
philosophes admettent bien du progrès dans la vertu, mais de la
diminution dans le vice, point. L'argument dont ils se servent pour
prouver leur opinion est curieux. “Si une chose parfaite,
disent-ils, peut recevoir augmentation, celle qui lui est opposée en
peut recevoir aussi; or on ne peut rien ajouter à une vertu
parfaite, donc le vice qui lui est opposé, ne peut non plus recevoir
d'accroissement.” Est-ce là éclaircir le doute par l'évidence ou
obscurcir l'évidence par le doute? Ce qui est évident pour tout le
monde, c'est qu'il y a des vices plus grands les uns que les autres;
ce qu'il y a de douteux, c'est qu'on ne puisse rien ajouter à ce que
vous appelez le souverain bien. Ainsi, au lieu de faire succéder la
lumière à l'obscurité, vous vous efforcez de mettre l'obscurité à la
place de la lumière. Mais je vais vous prendre au même piège où je
vous ai déjà pris. Vous dites que tous les vices sont égaux et qu'on
n'y peut rien ajouter, parce qu'on ne peut rien ajouter au souverain
bien tel que vous l'éta-
580 blissez; et moi je dis qu'il est évident que les vices ne sont pas
égaux, et que par conséquent il faut que vous changiez de souverain
bien. Car nous ne pouvons abandonner ce principe, que lorsqu'une
conséquence est fausse, la proposition sur laquelle elle est fondée
est nécessairement fausse aussi.
XXV. Mais quelle est la cause des embarras où Zénon se jette?
L'ostentation et la gloriole d'établir un souverain bien. Car dès
que l'on soutient qu'il n'y a d'autre bien que ce qui est honnête,
dès lors il faut abandonner le soin de sa santé, négliger ses
intérêts privés, laisser là les affaires publiques; plus de
conduite, plus de conseils, plus de devoirs; l'honnête lui-même, qui
est tout pour vous, l'honnête vous échappe de toutes parts. C'est ce
que Chrysippe a fort bien remarqué contre Ariston. Et voilà la
difficulté qui a fait naître toutes ces façons de parler ambiguës et
menteuses, comme le dit Attius. Car la sagesse n'ayant plus où
mettre pied dès que les devoirs de la vie sont retranchés (et
n'est-ce pas retrancher les devoirs que de supprimer les différences
des choses, de rendre impossible le choix de l'esprit, et de
soumettre tout dans le monde à un même niveau?) les Stoïciens, pour
se tirer d'embarras, furent obligés de tenir un langage plus
détestable encoreque celui d'Ariston. Au moins ce qu'il dit est
franc, tandis que vos réponses sont pleines d'artifice. Demandez à
Ariston si l'absence de la douleur, les richesses, la santé, sont
des biens, il vous dira que non. Et leurs opposés sont-ils des maux?
Non plus. Faites ensuite les mêmes questions à Zénon, vous aurez
absolument les mêmes réponses. Étonnés, nous leur demanderons à tous
deux, comment il faudra se conduire dans la vie; si nous croyons
qu'il n'importe pas que nous soyons malades ou en santé, que la
douleur nous épargne ou nous accable, que nous puissions ou non nous
défendre du froid et de la faim? Vous mènerez une existence superbe,
dit Ariston; vous n'aurez qu'à faire tout ce qui vous viendra dans
l'esprit, et jamais vous n'éprouverez ni tourments, ni désirs, ni
craintes. Que dira Zénon? que ce sont là des monstruosités, et qu'on
ne peut en aucune façon vivre de la sorte; mais qu'entre ce qui est
honnête et ce qui est honteux, il y a une si grande différence qu'on
ne peut pas se l'imaginer, qu'entre tout le reste il n'y en a
aucune. Ce n'est pas tout, écoutez le surplus, et empêchez-vous de
rire si vous pouvez. Parmi toutes ces choses intermédiaires entre
lesquelles il n'est aucune différence, il y eu a quelques-unes à
choisir, d'autres à rejeter, d'autres encore à négliger
complètement, de telle façon, que le sage voudra les unes, écartera
les autres, et ne s'inquiètera nullement des dernières. – Mais vous
venez de dire qu'entre les unes et les autres il n'y a aucune
différence. – Je le répète, répondrez-vous; mais cela s'entend par
rapport au vice et à la vertu.
XXVI. Voilà bien une grande nouvelle! nous l'ignorions, sans doute?
Mais écoutons encore. La santé, les richesses, l'absence de la
douleur, je ne les appelle pas des biens, dit Zénon, mais, dans ma
langue, je les nomme προηγμένα (ce que nous pouvons traduire,
élevées en dignité, ou plutôt préférables et principales,
expressions plus supportables et plus douces); et l'indigence, la
maladie, la douleur, je ne les appelle pas des maux, mais si vous le
voulez, des choses à rejeter. 531
C'est pourquoi je ne dis pas que je rejette les unes, mais que je
les choisis, ni que je les désire, mais que je les accepte; je ne
dis pas non plus que je fuis les autres, mais seulement que je les
écarte. Que disent Aristote et les autres disciples de Platon?
Qu'ils appellent biens tout ce qui est conforme à la nature, et maux
tout ce qui y est contraire. Vous voyez donc que votre Zénon parle
comme Ariston, quoiqu'il ne pense pas comme lui; et qu'il pense
comme Aristote et les Platoniciens, quoiqu'il parle tout autrement
qu'eux. Pourquoi donc, puisqu'il a les mêmes sentiments que nous, ne
pas parler comme tout le monde? Que Zénon m'apprenne au moins en
quoi je serai plus disposé à mépriser les richesses, si je vois
seulement en elles des choses à préférer, que si je les mets au rang
des biens; et comment je serai plus ferme contre la douleur, en
disant que c'est une chose fâcheuse, difficile à supporter et
contraire à la nature, qu'en disant que c'est un mal. Pison, notre
ami, disait plaisamment en parlant aux Stoïciens: Vous niez que les
richesses soient un bien, vous les appelez seulement des choses
préférables, à quoi bon cela? Les hommes en deviennent-ils moins
avares? Que si nous voulons ne regarder que les mots, d'abord
préférable est un plus grand mot que bien. Qu'est-ce que cela fait à
la chose? Direz-vous. Cela n'y fait rien, je le veux; mais c'est du
moins un terme plus emphatique. Pour le mot de bien, je ne sais pas
trop d'où il est tiré, mais préférable, qui marque une supériorité
reconnue sur d'autres choses, me semble un terme bien fort. Il
disait donc que Zénon, en mettant les richesses parmi les choses à
préférer, les traite plus avantageusement que ne fait Aristote en
avouant que c'est un bien, mais un bien très médiocre, méprisable en
comparaison de la vertu, et qui ne mérite pas qu'on le recherche
vivement. Enfin, en examinant ainsi tous les nouveaux termes de
votre école, il disait que les noms inventés par Zénon donnent plus
d'attrait aux choses qu'il refuse d'appeler des biens et rendent
plus repoussantes celles qu'il ne veut point nommer des maux. C'est
ainsi que parlait Pison, cet homme excellent et qui avait, comme
vous le savez, tant d'attachement pour vous. Je n'ai plus qu'un mot
à ajouter et j'achève; car il serait trop long de répondre à tout ce
que vous avez dit.
XXVII. C'est de ce même jeu de paroles que vous viennent vos
royaumes, vos commandements, vos richesses, et des richesses si
grandes que tout ce qu'il y a dans le monde appartient au sage. De
plus il n'y a que lui de beau, de libre et de citoyen, à ce que vous
dites. Tous les défauts et toutes les misères accablent ceux qui
n'ont pas la sagesse, et que vous appelez même des insensés. Voilà
ce que vous nommez des paradoxes, nous, des choses merveilleuses.
Qu'ont-elles pourtant de si merveilleux quand on les regarde de
près? Je vais examiner avec vous ce que vous entendez par chaque
mot, et nous n'aurons plus la moindre dispute ensemble. Vous dites
que tous les péchés sont égaux. Je ne plaisanterai pas maintenant
là-dessus, comme lorsque je plaidais contre vous pour Muréna que
vous accusiez. Je parlais alors devant des ignorants; il fallait
bien donner quelque chose à la multitude; aujourd'hui raisonnons en
philosophes. Tous les péchés sont égaux. Comment cela? C'est,
dites-vous, qu'il n'y a rien de plus honnête que ce qui est honnête,
ni rien de plus honteux que ce qui est honteux. Ce n'est pas là une
chose sans contestation, mais continuez et faites-nous voir par
532 quel argument tout
particulier vous démontrez l'égalité des fautes. Si, dans un
instrument de musique, dit Zénon, toutes les cordes sont si mal
montées qu'on n'en puisse tirer d'harmonie, toutes sont mal d'accord
également; il en est de même des fautes; comme chaque faute produit
une dissonance morale, toutes sont pareillement discordantes, et
partant toutes sont égales. Mais ici nous sommes dupes d'une
ambiguïté de mots. Je veux que toutes les cordes d'un instrument
soient mal d'accord, il ne s'ensuit pas qu'elles le soient toutes
également. Ainsi votre comparaison ne sert de rien. Car encore que
toutes les avarices soient également des avarices, il ne s'ensuit
pas pour cela que toutes soient égales entre elles. Voici encore une
autre de vos comparaisons qui ne prouve rien. Comme un pilote qui
fait périr un vaisseau, pèche, dites-vous, également contre son art,
que le vaisseau soit chargé de paille ou qu'il soit chargé d'or;
ainsi, celui qui maltraite son esclave sans sujet pèche tout autant
que celui qui outrage son père. Mais ne voyez-vous pas que la charge
d'un navire n'a aucun rapport avec l'art de le gouverner? qu'il soit
rempli d'or ou de paille, qu'est-ce que cela fait à l'habileté ou à
la maladresse du pilote? Mais tout le monde sait et doit savoir
combien il y a de disproportion entre un père et un esclave. Ainsi
donc si dans le gouvernement d'un navire peu importe sur quel objet
tombent les conséquences de la faute, dans l'accomplissement des
devoirs de la vie, rien au contraire de plus important à considérer.
Supposé pourtant que la négligence du pilote a fait périr le
vaisseau, la faute est plus grande si le vaisseau était chargé d'or
que s'il était chargé de paille, n'y ayant point d'art qui ne
demande dans ceux qui le professent une certaine prudence, et une
plus grande attention suivant les choses dont il s'agit; de sorte
que, même dans l'exemple que vous proposez, la faute des deux côtés
n'est pas égale.
XXVIII. Ils insistent pourtant et ne se rebutent point. Comme toutes
les fautes, disent-ils, viennent d'imbécillité et de légèreté, et
que ces défauts-là sont égaux dans tous ceux qui n'ont pas la
sagesse, il faut nécessairement que toutes les fautes qu'ils
commettent soient égales. Comme si on demeurait d'accord avec eux
que les vices sont égaux dans tous ceux qui n'ont pas la sagesse; et
que l'on puisse reprocher la même imbécillité et la même légèreté à
L. Tubulus et à P. Scévola qui le fit condamner; ou comme s'il n'y
avait aucune différence à faire entre les choses dans lesquelles on
manque; et que les fautes ne soient pas plus on moins grandes
suivant que leurs objets et leurs conséquences sont plus ou moins
considérables.
Ainsi, car il est temps de finir, il me semble que vos Stoïciens ont
principalement tort en ce qu'ils veulent qu'on leur accorde deux
propositions toutes contraires. En effet, quoi de plus
contradictoire que de soutenir qu'il n'est rien de bien que ce qui
est honnête, lorsqu'on déclare en même temps que le désir des choses
convenables à la vie a sa source dans la nature. Lorsqu'ils veulent
être conséquents à leur première proposition, ils tombent dans les
extravagances d'Ariston. Dès qu'ils les veulent éviter, ils
soutiennent en effet les mêmes principes qu'Aristote; mais attachés
à leurs termes, ils n'en veulent pas démordre; et pour ne se les pas
laisser arracher l'un après l'autre, ils en deviennent plus
hérissés, plus âpres et plus farouches dans leurs discours et dans
leurs mœurs. Aussi Panétius, ne
583 pouvant s'accommoder de leurs manières sauvages, ni
approuver la dureté de leurs sentiments et la sécheresse de leurs
discours épineux, était bien plus modéré qu'eux dans ses opinions et
bien plus clair et plus intelligible dans tout ce qu'il disait; nous
voyons même par des écrits qu'il avait toujours à la bouche Platon,
Aristote, Xénocrate, Théophraste et Dicéarque, à la lecture desquels
je crois de toutes les forces de ma conviction que vous devriez,
vous aussi, consacrer sérieusement vos soins. Mais parce qu'il se
fait tard, et qu'il faut que je retourne à ma campagne, en voilà
assez pour à présent. Une autre fois et le plus souvent que nous
pourrons, nous nous entretiendrons sur ce sujet. Pour moi, très
volontiers, dit Caton, car que pourrions-nous faire de mieux? Mais
je vous demande une chose, c'est que je puisse d'abord vous réfuter
à mon tour. Souvenez-vous cependant que vous approuvez tout de nos
Stoïciens, hormis les termes dont ils se servent; mais que de vos
philosophes je n'approuve quoi que ce soit. C'est une pierre, lui
dis-je, que vous jetez dans mon chemin; mais nous nous reverrons.
Là-dessus nous nous séparâmes.
|