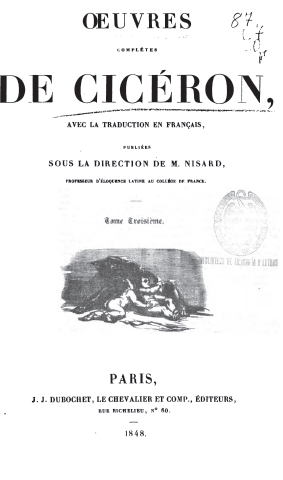|
LIBER QUINTUS
I. Cum audissem Antiochum, Brute, ut solebam, cum
M. Pisone in eo gymnasio, quod Ptolomaeum vocatur, unaque nobiscum Q.
Frater et T. Pomponius Luciusque Cicero, frater noster cognatione patruelis,
amore germanus, constituimus inter nos ut ambulationem postmeridianam
conficeremus in Academia, maxime quod is locus ab omni turba id temporis vacuus
esset. Itaque ad tempus ad Pisonem omnes. Inde sermone vario sex illa a Dipylo
stadia confecimus. Cum autem venissemus in Academiae non sine causa nobilitata
spatia, solitudo erat ea, quam volueramus. Tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit,
datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos
viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum
ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod legamus? Velut ego nunc moveor.
Venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum;
cuius etiam illi hortuli propinqui non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum
videntur in conspectu meo ponere. Hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius
auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam
nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse videtur, posteaquam
est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis
avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis
memoriae ducta sit disciplina. - Tum Quintus: Est plane, Piso, ut dicis,
inquit. Nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese
Coloneus ille locus,
cuius incola Sophocles ob oculos versabatur, quem scis quam admirer quamque eo
delecter. Me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis et illo
mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec loca requirentis species quaedam
commovit, inaniter scilicet, sed commovit tamen. - Tum Pomponius: At ego,
quem vos ut deditum Epicuro insectari soletis, sum multum equidem
cum Phaedro,
quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis, quos modo praeteribamus, sed
veteris proverbii admonitu vivorum memini, nec tamen Epicuri licet oblivisci, si
cupiam, cuius imaginem non modo in tabulis nostri familiares, sed etiam in
poculis et in anulis habent.
II. Hic ego: Pomponius quidem, inquam, noster
iocari videtur, et fortasse suo iure. Ita enim se Athenis collocavit, ut sit
paene unus ex Atticis, ut id etiam cognomen videatur habiturus. Ego autem tibi,
Piso, assentior usu hoc venire, ut acrius aliquanto et attentius de claris viris
locorum admonitu cogitemus. Scis enim me quodam tempore Metapontum venisse tecum
neque ad hospitem ante devertisse, quam Pythagorae ipsum illum locum, ubi vitam
ediderat, sedemque viderim. Hoc autem tempore, etsi multa in omni parte
Athenarum sunt in ipsis locis indicia summorum virorum, tamen ego
illa moveor
exhedra. Modo enim fuit Carneadis, quem videre videor—est enim nota imago—, a
sedeque ipsa tanta ingenii magnitudine orbata desiderari illam vocem puto. - Tum Piso: Quoniam igitur aliquid omnes, quid Lucius noster?
Inquit. An eum locum
libenter invisit, ubi Demosthenes et Aeschines inter se decertare soliti sunt? Suo enim quisque studio maxime ducitur. - Et ille, cum erubuisset: Noli, inquit,
ex me quaerere, qui in Phalericum etiam descenderim, quo in loco ad fluctum
aiunt declamare solitum Demosthenem, ut fremitum assuesceret voce vincere. Modo etiam paulum ad dexteram de via declinavi, ut ad Pericli sepulcrum
accederem. Quamquam id quidem infinitum est in hac urbe; quacumque enim
ingredimur, in aliqua historia vestigium ponimus. - Tum Piso: Atqui,
Cicero, inquit, ista studia, si ad imitandos summos viros spectant, ingeniosorum
sunt; sin tantum modo ad indicia veteris memoriae cognoscenda, curiosorum. Te
autem hortamur omnes, currentem quidem, ut spero, ut eos, quos novisse vis,
imitari etiam velis. - Hic ego: Etsi facit hic quidem, inquam, Piso, ut vides,
ea, quae praecipis, tamen mihi grata hortatio tua est. - Tum ille amicissime, ut
solebat: Nos vero, inquit, omnes omnia ad huius adolescentiam conferamus, in
primisque ut aliquid suorum studiorum philosophiae quoque impertiat, vel ut te
imitetur, quem amat, vel ut illud ipsum, quod studet, facere possit ornatius. Sed utrum hortandus es nobis, Luci, inquit, an etiam tua sponte propensus es?
Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. - Tum ille
timide vel potius verecunde: Facio, inquit, equidem, sed audistine modo de
Carneade? Rapior illuc, revocat autem Antiochus, nec est praeterea, quem
audiamus.
III. Tum Piso: Etsi hoc, inquit, fortasse non
poterit sic abire, cum hic assit—me autem dicebat—, tamen audebo te ab hac
Academia nova ad veterem illam vocare, in qua, ut dicere Antiochum audiebas, non
ii soli numerantur, qui Academici vocantur,
Speusippus, Xenocrates, Polemo,
Crantor ceterique, sed etiam Peripatetici veteres, quorum princeps
Aristoteles, quem excepto Platone haud scio an recte dixerim principem
philosophorum. Ad eos igitur converte te, quaeso. Ex eorum enim scriptis et
institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans
sumi potest, tum varietas est tanta artium, ut nemo sine eo instrumento ad ullam
rem illustriorem satis ornatus possit accedere. Ab his oratores, ab his
imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt. Ut ad minora veniam,
mathematici, poetae, musici, medici denique ex hac tamquam omnium artificum
officina profecti sunt. - Atque ego: Scis me, inquam, istud idem sentire,
Piso, sed a te oportune facta mentio est. Studet enim meus audire Cicero quaenam
sit istius veteris, quam commemoras, Academiae de finibus bonorum
Peripateticorumque sententia. Censemus autem facillime te id explanare posse,
quod et Staseam Neapolitanum multos annos habueris apud te et complures iam
menses Athenis haec ipsa te ex Antiocho videamus exquirere. - Et ille ridens:
Age, age, inquit,—satis enim scite me nostri sermonis principium esse
voluisti—exponamus adolescenti, si quae forte possumus. Dat enim id nobis
solitudo, quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam
philosophum disputaturum. Sed ne, dum huic obsequor, vobis molestus sim. - Mihi,
inquam, qui te id ipsum rogavi? - Tum, Quintus et Pomponius cum idem se velle
dixissent, Piso exorsus est. Cuius oratio attende, quaeso, Brute, satisne
videatur Antiochi complexa esse sententiam, quam tibi, qui
fratrem eius Aristum frequenter audieris, maxime probatam existimo.
IV. Sic est igitur locutus: Quantus ornatus in
Peripateticorum disciplina sit satis est a me, ut brevissime potuit, paulo ante
dictum. Sed est forma eius disciplinae, sicut fere ceterarum, triplex: una pars
est naturae, disserendi altera, vivendi tertia. Natura sic ab iis investigata
est, ut nulla pars caelo, mari, terra, ut poetice loquar, praetermissa sit;
quin etiam, cum de rerum initiis omnique mundo locuti essent, ut multa non modo
probabili argumentatione, sed etiam necessaria mathematicorum ratione
concluderent, maximam materiam ex rebus per se investigatis ad rerum occultarum
cognitionem attulerunt. Persecutus est Aristoteles animantium omnium ortus,
victus, figuras, Theophrastus autem stirpium naturas omniumque fere rerum, quae
e terra gignerentur, causas atque rationes; qua ex cognitione facilior facta est
investigatio rerum occultissimarum. Disserendique ab isdem non dialectice solum,
sed etiam oratorie praecepta sunt tradita, ab Aristoteleque principe de singulis
rebus in utramque partem dicendi exercitatio est instituta, ut non contra omnia
semper, sicut Arcesilas, diceret, et tamen ut in omnibus rebus, quicquid ex
utraque parte dici posset, expromeret. Cum autem tertia pars bene vivendi
praecepta quaereret, ea quoque est ab isdem non solum ad privatae vitae
rationem, sed etiam ad rerum publicarum rectionem relata. Omnium fere civitatum
non Graeciae solum, sed etiam barbariae ab Aristotele mores, instituta,
disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus. Cumque uterque eorum
docuisset qualem in re publica principem <esse> conveniret, pluribus praeterea
conscripsisset qui esset optimus rei publicae status,
hoc amplius Theophrastus:
quae essent in re publica rerum inclinationes et momenta temporum, quibus esset
moderandum, utcumque res postularet. Vitae autem degendae ratio maxime
quidem illis placuit quieta, in contemplatione et cognitione posita rerum, quae
quia deorum erat vitae simillima, sapiente visa est dignissima. Atque his de
rebus et splendida est eorum et illustris oratio.
V De summo autem bono, quia duo genera librorum
sunt, unum populariter scriptum, quod ἐξωτερικόν appellabant, alterum limatius,
quod in commentariis reliquerunt, non semper idem dicere videntur, nec in summa
tamen ipsa aut varietas est ulla apud hos quidem, quos nominavi, aut inter ipsos
dissensio. Sed cum beata vita quaeratur idque sit unum, quod philosophia
spectare et sequi debeat, sitne ea tota sita in potestate sapientis an possit
aut labefactari aut eripi rebus adversis, in eo non numquam variari inter eos et
dubitari videtur. Quod maxime efficit Theophrasti de beata vita liber, in quo
multum admodum fortunae datur. Quod si ita se habeat, non possit beatam
praestare vitam sapientia. Haec mihi videtur delicatior, ut ita dicam,
molliorque ratio, quam virtutis vis gravitasque postulat. Quare teneamus
Aristotelem et eius filium Nicomachum, cuius accurate scripti de moribus libri
dicuntur illi quidem esse Aristoteli, sed non video, cur non potuerit patri
similis esse filius. Theophrastum tamen adhibeamus ad pleraque, dum modo plus in
virtute teneamus, quam ille tenuit, firmitatis et roboris. Simus igitur contenti
his. Namque horum posteri meliores illi quidem mea sententia quam reliquarum
philosophi disciplinarum, sed ita degenerant, ut ipsi ex se nati esse videantur.
Primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; in quo etsi est magnus, tamen
nova pleraque et perpauca de moribus. Huius, Lyco, oratione locuples,
rebus ipsis ieiunior. Concinnus deinde et elegans huius, Aristo, sed ea, quae
desideratur a magno philosopho, gravitas, in eo non fuit; scripta sane et multa
et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Praetereo multos,
in his doctum hominem et suavem, Hieronymum, quem iam cur Peripateticum appellem
nescio. Summum enim bonum exposuit vacuitatem doloris; qui autem de summo bono
dissentit de tota philosophiae ratione dissentit. Critolaus imitari voluit
antiquos, et quidem est gravitate proximus, et redundat oratio, ac tamen <ne> is
quidem in patriis institutis manet. Diodorus, eius auditor, adiungit ad
honestatem vacuitatem doloris. Hic quoque suus est de summoque bono dissentiens
dici vere Peripateticus non potest. Antiquorum autem sententiam Antiochus noster
mihi videtur persequi diligentissime, quam eandem Aristoteli fuisse et Polemonis
docet.
VI. Facit igitur Lucius noster prudenter, qui
audire de summo bono potissimum velit; hoc enim constituto in philosophia
constituta sunt omnia. Nam ceteris in rebus sive praetermissum sive ignoratum
est quippiam, non plus incommodi est, quam quanti quaeque earum rerum est, in
quibus neglectum est aliquid. Summum autem bonum si ignoretur, vivendi rationem
ignorari necesse est, ex quo tantus error consequitur, ut quem in portum se
recipiant scire non possint. Cognitis autem rerum finibus, cum intellegitur,
quid sit et bonorum extremum et malorum, inventa vitae via est conformatioque
omnium officiorum, cum quaeritur, quo quodque referatur; ex quo, id
quod omnes expetunt, beate vivendi ratio inveniri et comparari potest. Quod
quoniam in quo sit magna dissensio est, Carneadea nobis adhibenda divisio est,
qua noster Antiochus libenter uti solet. Ille igitur vidit, non modo quot
fuissent adhuc philosophorum de summo bono, sed quot omnino esse possent
sententiae. Negabat igitur ullam esse artem, quae ipsa a se proficisceretur;
etenim semper illud extra est, quod arte comprehenditur. Nihil opus est exemplis
hoc facere longius. Est enim perspicuum nullam artem ipsam in se versari, sed
esse aliud artem ipsam, aliud quod propositum sit arti. Quoniam igitur, ut
medicina valitudinis, navigationis gubernatio, sic vivendi ars est prudentia,
necesse est eam quoque ab aliqua re esse constitutam et profectam. Constitit
autem fere inter omnes id, in quo prudentia versaretur et quod assequi vellet,
aptum et accommodatum naturae esse oportere et tale, ut ipsum per se invitaret
et alliceret appetitum animi, quem ὁρμὴν Graeci vocant. Quid autem sit, quod ita
moveat itaque a natura in primo ortu appetatur, non constat, deque eo est inter
philosophos, cum summum bonum exquiritur, omnis dissensio. Totius enim
quaestionis eius, quae habetur de finibus bonorum et malorum, cum quaeritur, in
his quid sit extremum et ultimum, fons reperiendus est, in quo sint prima
invitamenta naturae; quo invento omnis ab eo quasi capite de summo bono et malo
disputatio ducitur.
VII. Voluptatis alii primum appetitum putant et
primam depulsionem doloris. Vacuitatem doloris alii censent primum ascitam et
primum declinatum dolorem. Ab iis alii, quae prima secundum naturam nominant,
proficiscuntur, in quibus numerant incolumitatem conservationemque omnium
partium, valitudinem, sensus integros, doloris vacuitatem, viris,
pulchritudinem, cetera generis eiusdem, quorum similia sunt prima in animis
quasi virtutum igniculi et semina. Ex his tribus cum unum aliquid sit, quo
primum natura moveatur vel ad appetendum vel ad repellendum, nec quicquam omnino
praeter haec tria possit esse, necesse est omnino officium aut fugiendi aut
sequendi ad eorum aliquid referri, ut illa prudentia, quam artem vitae esse
diximus, in earum trium rerum aliqua versetur, a qua totius vitae ducat
exordium. Ex eo autem, quod statuerit esse, quo primum natura moveatur, existet
recti etiam ratio atque honesti, quae cum uno aliquo ex tribus illis congruere
possit, ut aut id honestum sit, facere omnia aut voluptatis causa, etiam si eam
non consequare, aut non dolendi, etiam si id assequi nequeas, aut eorum, quae
secundum naturam sunt, adipiscendi, etiam si nihil consequare. Ita fit ut,
quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum
malorumque dissimilitudo. Alii rursum isdem a principiis omne officium referent
aut ad voluptatem aut ad non dolendum aut ad prima illa secundum naturam
optinenda. Expositis iam igitur sex de summo bono sententiis trium proximarum hi
principes: voluptatis Aristippus, non dolendi Hieronymus, fruendi rebus iis,
quas primas secundum naturam esse diximus, Carneades non ille quidem auctor, sed
defensor disserendi causa fuit. Superiores tres erant, quae esse possent, quarum
est una sola defensa, eaque vehementer. Nam voluptatis causa facere omnia, cum,
etiamsi nihil consequamur, tamen ipsum illud consilium ita faciendi per se
expetendum et honestum et solum bonum sit, nemo dixit. Ne vitationem quidem
doloris ipsam per se quisquam in rebus expetendis putavit,
nisi etiam evitare posset. At vero facere omnia, ut adipiscamur, quae secundum naturam sint, etiam
si ea non assequamur, id esse et honestum et solum per se expetendum et solum
bonum Stoici dicunt.
VIII. Sex igitur hae sunt simplices de summo
bonorum malorumque sententiae, duae sine patrono, quattuor defensae. Iunctae
autem et duplices expositiones summi boni tres omnino fuerunt, nec vero plures,
si penitus rerum naturam videas, esse potuerunt. Nam aut voluptas adiungi potest
ad honestatem, ut Calliphonti Dinomachoque placuit, aut doloris vacuitas, ut
Diodoro, aut prima naturae, ut antiquis, quos eosdem Academicos et Peripateticos
nominavimus. Sed quoniam non possunt omnia simul dici, haec in praesentia nota
esse debebunt, voluptatem semovendam esse, quando ad maiora quaedam, ut iam
apparebit, nati sumus. De vacuitate doloris eadem fere dici solent, quae de
voluptate. Quando igitur et de voluptate
cum Torquato et de honestate, in qua una omne bonum poneretur, cum Catone est
disputatum, primum, quae contra voluptatem dicta sunt, eadem fere cadunt contra
vacuitatem doloris. Nec
vero alia sunt quaerenda contra Carneadeam illam sententiam. Quocumque enim modo
summum bonum sic exponitur, ut id vacet honestate, nec officia nec virtutes in
ea ratione nec amicitiae constare possunt. Coniunctio autem cum honestate vel
voluptatis vel non dolendi id ipsum honestum, quod amplecti vult, id efficit
turpe. Ad eas enim res referre, quae agas, quarum una, si quis malo careat, in
summo eum bono dicat esse, altera versetur in levissima parte naturae,
obscurantis est omnem splendorem honestatis, ne dicam inquinantis. Restant
Stoici, qui cum a Peripateticis et Academicis omnia transtulissent, nominibus
aliis easdem res secuti sunt. Hos contra singulos dici est melius. Sed nunc,
quod agimus; de illis, cum volemus. Democriti autem securitas, quae est
animi tamquam tranquillitas, quam appellant εὐθυμίαν, eo separanda fuit ab hac
disputatione, quia ista animi tranquillitas ea ipsa est beata vita; quaerimus
autem, non quae sit, sed unde sit. Iam explosae eiectaeque sententiae Pyrrhonis,
Aristonis, Erilli quod in hunc orbem, quem circumscripsimus, incidere non
possunt, adhibendae omnino non fuerunt. Nam cum omnis haec quaestio de finibus
et quasi de extremis bonorum et malorum ab eo proficiscatur, quod diximus
naturae esse aptum et accommodatum, quodque ipsum per se primum appetatur, hoc
totum et ii tollunt, qui in rebus iis, in quibus nihil quod non aut honestum aut
turpe sit, negant esse ullam causam, cur aliud alii anteponatur, nec inter eas
res quicquam omnino putant interesse, et Erillus, si ita sensit, nihil esse
bonum praeter scientiam, omnem consilii capiendi causam inventionemque officii
sustulit. Sic exclusis sententiis reliquorum cum praeterea nulla esse possit,
haec antiquorum valeat necesse est. Ergo instituto veterum, quo etiam Stoici
utuntur, hinc capiamus exordium.
IX. Omne animal se ipsum diligit ac, simul et
ortum est, id agit, se ut conservet, quod hic ei primus ad omnem vitam tuendam
appetitus a natura datur, se ut conservet atque ita sit affectum, ut
optime secundum naturam affectum esse possit. Hanc initio institutionem confusam
habet et incertam, ut tantum modo se tueatur, qualecumque sit, sed nec quid sit
nec quid possit nec quid ipsius natura sit intellegit. Cum autem processit
paulum et quatenus quicquid se attingat ad seque pertineat perspicere coepit,
tum sensim incipit progredi seseque agnoscere et intellegere quam ob causam
habeat eum, quem diximus, animi appetitum coeptatque et ea, quae naturae sentit
apta, appetere et propulsare contraria. Ergo omni animali illud, quod appetit,
positum est in eo, quod naturae est accommodatum. Ita finis bonorum existit
secundum naturam vivere sic affectum, ut optime affici possit ad naturamque
accommodatissime. Quoniam autem sua cuiusque animantis natura est, necesse est
finem quoque omnium hunc esse, ut natura expleatur—nihil enim prohibet quaedam
esse et inter se animalibus reliquis et cum bestiis homini communia, quoniam
omnium est natura communis—, sed extrema illa et summa, quae quaerimus, inter
animalium genera distincta et dispertita sint et sua cuique propria et ad id
apta, quod cuiusque natura desideret. Quare cum dicimus omnibus animalibus
extremum esse secundum naturam vivere, non ita accipiendum est, quasi dicamus
unum esse omnium extremum, sed ut omnium artium recte dici potest commune esse,
ut in aliqua scientia versentur, scientiam autem suam cuiusque artis esse, sic
commune animalium omnium secundum naturam vivere, sed naturas esse diversas, ut
aliud equo sit e natura, aliud bovi, aliud homini. Et tamen in omnibus est summa communis, et quidem non solum in animalibus, sed etiam in rebus omnibus iis,
quas natura alit, auget, tuetur, in quibus videmus ea, quae gignuntur e terra,
multa quodam modo efficere ipsa sibi per se, quae ad vivendum crescendumque
valeant, ut <in> suo genere perveniant ad extremum; ut iam liceat una
comprehensione omnia complecti non dubitantemque dicere omnem naturam esse
servatricem sui idque habere propositum quasi finem et extremum, se ut custodiat
quam in optimo sui generis statu; ut necesse sit omnium rerum, quae natura
vigeant, similem esse finem, non eundem. Ex quo intellegi debet homini id esse
in bonis ultimum, secundum naturam vivere, quod ita interpretemur: vivere ex
hominis natura undique perfecta et nihil requirente. Haec igitur nobis
explicanda sunt, sed si enodatius, vos ignoscetis. Huius enim aetati et huic
nunc haec primum fortasse audientis servire debemus. - Ita prorsus, inquam; etsi
ea quidem, quae adhuc dixisti, quamvis ad aetatem recte isto modo dicerentur.
X. Exposita igitur, inquit, terminatione rerum
expetendarum cur ista se res ita habeat, ut dixi, deinceps demonstrandum est. Quam ob rem ordiamur ab eo, quod primum posui, quod idem reapse primum est, ut
intellegamus omne animal se ipsum diligere. Quod quamquam dubitationem non
habet—est enim infixum in ipsa natura comprehenditur<que> suis cuiusque sensibus
sic, ut, contra si quis dicere velit, non audiatur—, tamen, ne quid
praetermittamus, rationes quoque, cur hoc ita sit, afferendas puto. Etsi
qui potest intellegi aut cogitari esse aliquod animal, quod se oderit? Res enim
concurrent contrariae. Nam cum appetitus ille animi aliquid ad se trahere
coeperit consulto, quod sibi obsit, quia sit sibi inimicus, cum id sua causa
faciet, et oderit se et simul diliget, quod fieri non potest. Necesseque est, si
quis sibi ipsi inimicus est, eum quae bona sunt mala putare, bona contra quae
mala, et quae appetenda fugere, quae fugienda appetere, quae sine dubio vitae
est eversio. Neque enim, si non nulli reperiuntur, qui aut laqueos aut alia
exitia quaerant aut ut ille apud Terentium, qui 'decrevit tantisper se minus
iniuriae suo nato facere', ut ait ipse, 'dum fiat miser', inimicus ipse sibi
putandus est. Sed alii dolore moventur, alii cupiditate, iracundia etiam multi
efferuntur et, cum in mala scientes inruunt, tum se optime sibi consulere
arbitrantur. Itaque dicunt nec dubitant:
Mihi sic usus est, tibi ut opus est facto, face :
velut, qui ipsi sibi bellum indixissent, cruciari
dies, noctes torqueri vellent, nec vero sese ipsi accusarent ob eam causam, quod
se male suis rebus consuluisse dicerent. Eorum enim est haec querela, qui sibi
cari sunt seseque diligunt. Quare, quotienscumque dicetur male quis de se mereri
sibique esse inimicus atque hostis, vitam denique fugere, intellegatur aliquam
subesse eius modi causam, ut ex eo ipso intellegi possit sibi quemque esse
carum. Nec vero id satis est, neminem esse, qui ipse se oderit, sed illud quoque
intellegendum est, neminem esse, qui, quo modo se habeat, nihil sua
censeat interesse. Tolletur enim appetitus animi, si, ut in iis rebus, inter
quas nihil interest, neutram in partem propensiores sumus, item in nobismet
ipsis quem ad modum affecti simus nihil nostra arbitrabimur interesse.
XI Atque etiam illud si qui dicere velit,
perabsurdum sit, ita diligi a sese quemque, ut ea vis diligendi ad aliam rem
quampiam referatur, non ad eum ipsum, qui sese diligat. Hoc cum in amicitiis,
cum in officiis, cum in virtutibus dicitur, quomodocumque dicitur, intellegi
tamen quid dicatur potest, in nobismet autem ipsis <ne> intellegi quidem, <ut>
propter aliam quampiam rem, verbi gratia propter voluptatem, nos amemus; propter
nos enim illam, non propter eam nosmet ipsos diligimus. - Quamquam quid
est, quod magis perspicuum sit, <quam> non modo carum sibi quemque, verum etiam
vehementer carum esse? Quis est enim aut quotus quisque, cui, mors cum
adpropinquet, non 'refugiat timido sanguen atque exalbescat metu'?
Etsi hoc
quidem est in vitio, dissolutionem naturae tam valde perhorrescere—quod item est
reprehendendum in dolore—, sed quia fere sic afficiuntur omnes, satis argumenti
est ab interitu naturam abhorrere; idque quo magis quidam ita faciunt, ut iure
etiam reprehendantur, hoc magis intellegendum est haec ipsa nimia in quibusdam
futura non fuisse, nisi quaedam essent modica natura. Nec vero dico eorum metum
mortis, qui, quia privari se vitae bonis arbitrentur, aut quia quasdam post
mortem formidines extimescant, aut si metuant, ne cum dolore moriantur,
idcirco mortem fugiant; in parvis enim saepe, qui nihil eorum cogitant, si
quando iis ludentes minamur praecipitaturos alicunde, extimescunt. Quin etiam
'ferae', inquit Pacuvius, 'quibus
...abest ad praecavendum intellegendi astutia,
sibi iniecto terrore mortis 'horrescunt'.
Quis
autem de ipso sapiente aliter existimat, quin, etiam cum decreverit esse
moriendum, tamen discessu a suis atque ipsa relinquenda luce moveatur? Maxime
autem in hoc quidem genere vis est perspicua naturae, cum et mendicitatem multi
perpetiantur, ut vivant, et angantur adpropinquatione mortis confecti homines
senectute et ea perferant, quae Philoctetam videmus in fabulis. Qui cum
cruciaretur non ferendis doloribus, propagabat tamen vitam aucupio, 'sagittarum
<ictu> configebat tardus celeres, stans volantis', ut apud Accium est,
pennarumque contextu corpori tegumenta faciebat. De hominum genere aut omnino de
animalium loquor, cum arborum et stirpium eadem paene natura sit? Sive enim, ut
doctissimis viris visum est, maior aliqua causa atque divinior hanc vim
ingenuit, sive hoc ita fit fortuito, videmus ea, quae terra gignit, corticibus
et radicibus valida servari, quod contingit animalibus sensuum distributione et
quadam compactione membrorum. Qua quidem de re quamquam assentior iis, qui haec
omnia regi natura putant, quae si natura neglegat, ipsa esse non possit, tamen
concedo, ut, qui de hoc dissentiunt, existiment, quod velint, ac vel hoc
intellegant, si quando naturam hominis dicam, hominem dicere me; nihil enim hoc
differt. Nam prius a se poterit quisque discedere quam appetitum earum rerum,
quae sibi conducant, amittere. Iure igitur gravissimi philosophi initium summi
boni a natura petiverunt et illum appetitum rerum ad naturam
accommodatarum ingeneratum putaverunt omnibus, quia continentur ea commendatione
naturae, qua se ipsi diligunt.
XII. Deinceps videndum est, quoniam satis apertum
est sibi quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Id est enim, de quo
quaerimus. Atqui perspicuum est hominem e corpore animoque constare, cum primae
sint animi partes, secundae corporis. Deinde id quoque videmus, et ita figuratum
corpus, ut excellat aliis, animumque ita constitutum, ut et sensibus instructus
sit et habeat praestantiam mentis, cui tota hominis natura pareat, in qua sit
mirabilis quaedam vis rationis et cognitionis et scientiae virtutumque omnium. Iam quae corporis sunt, ea nec auctoritatem cum animi partibus comparandam et
cognitionem habent faciliorem. Itaque ab his ordiamur. - Corporis igitur
nostri partes totaque figura et forma et statura quam apta ad naturam sit,
apparet, neque est dubium, quin frons, oculi, aures et reliquae partes quales
propriae sint hominis intellegatur. Sed certe opus est ea valere et vigere et
naturales motus ususque habere, ut nec absit quid eorum nec aegrum debilitatumve
sit; id enim natura desiderat. Est autem etiam actio quaedam corporis, quae
motus et status naturae congruentis tenet; in quibus si peccetur distortione et
depravatione quadam aut motu statuve deformi, ut si aut manibus ingrediatur quis
aut non ante, sed retro, fugere plane se ipse et hominem ex homine exuens
naturam odisse videatur. Quam ob rem etiam sessiones quaedam et flexi fractique
motus, quales protervorum hominum aut mollium esse solent, contra naturam sunt,
ut, etiamsi animi vitio id eveniat, tamen in corpore immutari hominis
natura videatur. Itaque e contrario moderati aequabilesque habitus, affectiones
ususque corporis apti esse ad naturam videntur. - Iam vero animus non esse
solum, sed etiam cuiusdam modi debet esse, ut et omnis partis suas habeat
incolumis et de virtutibus nulla desit. Atque in sensibus est sua cuiusque
virtus, ut ne quid impediat quo minus suo sensus quisque munere fungatur in iis
rebus celeriter expediteque percipiendis, quae subiectae sunt sensibus.
XIII. Animi autem et eius animi partis, quae
princeps est, quaeque mens nominatur, plures sunt virtutes, sed duo prima
genera, unum earum, quae ingenerantur suapte natura appellanturque non
voluntariae, alterum autem earum, quae in voluntate positae magis proprio nomine
appellari solent, quarum est excellens in animorum laude praestantia. Prioris
generis est docilitas, memoria; quae fere omnia appellantur uno ingenii nomine,
easque virtutes qui habent, ingeniosi vocantur. Alterum autem genus est magnarum
verarumque virtutum, quas appellamus voluntarias, ut prudentiam, temperantiam,
fortitudinem, iustitiam et reliquas eiusdem generis. - Et summatim quidem haec
erant de corpore animoque dicenda, quibus quasi informatum est quid hominis
natura postulet. Ex quo perspicuum est, quoniam ipsi a nobis diligamur omniaque
et in animo et in corpore perfecta velimus esse, ea nobis ipsa cara esse propter
se et in iis esse ad bene vivendum momenta maxima. Nam cui proposita sit
conservatio sui, necesse est huic partes quoque sui caras esse carioresque, quo
perfectiores sint et magis in suo genere laudabiles. Ea enim vita
expetitur, quae sit animi corporisque expleta virtutibus, in eoque summum bonum
poni necesse est, quandoquidem id tale esse debet, ut rerum expetendarum sit
extremum. Quo cognito dubitari non potest, quin, cum ipsi homines sibi sint per
se et sua sponte cari, partes quoque et corporis et animi et earum rerum, quae
sunt in utriusque motu et statu, sua caritate colantur et per se ipsae
appetantur. Quibus expositis facilis est coniectura ea maxime esse expetenda ex
nostris, quae plurimum habent dignitatis, ut optimae cuiusque partis, quae per
se expetatur, virtus sit expetenda maxime. Ita fiet, ut animi virtus corporis
virtuti anteponatur animique virtutes non voluntarias vincant virtutes
voluntariae, quae quidem proprie virtutes appellantur multumque excellunt,
propterea quod ex ratione gignuntur, qua nihil est in homine divinius. Etenim
omnium rerum, quas et creat natura et tuetur, quae aut sine animo sunt aut <non>
multo secus, earum summum bonum in corpore est, ut non inscite illud dictum
videatur in sue, animum illi pecudi datum pro sale, ne putisceret.
XIV. Sunt autem bestiae quaedam, in quibus inest
aliquid simile virtutis, ut in leonibus, ut in canibus, in equis, in quibus non
corporum solum, ut in suibus, sed etiam animorum aliqua ex parte motus quosdam
videmus. In homine autem summa omnis animi est et in animo rationis, ex qua
virtus est, quae rationis absolutio definitur, quam etiam atque etiam
explicandam putant. - Earum etiam rerum, quas terra gignit, educatio
quaedam et perfectio est non dissimilis animantium. Itaque et “vivere” vitem et
“mori” dicimus arboremque et “novellam” et “vetulam” et “vigere” et 'senescere'.
Ex quo non est alienum, ut animantibus, sic illis et apta quaedam ad naturam
putare et aliena earumque augendarum et alendarum quandam cultricem esse, quae
sit scientia atque ars agricolarum, quae circumcidat, amputet, erigat, extollat,
adminiculet, ut, quo natura ferat, eo possint ire, ut ipsae vites, si loqui
possint, ita se tractandas tuendasque esse fateantur. Et nunc quidem quod eam
tuetur, ut de vite potissimum loquar, est id extrinsecus; in ipsa enim parum
magna vis inest, ut quam optime se habere possit, si nulla cultura adhibeatur. At vero si ad vitem sensus accesserit, ut appetitum quendam habeat et per se
ipsa moveatur, quid facturam putas? An ea, quae per vinitorem antea
consequebatur, per se ipsa curabit? Sed videsne accessuram ei curam, ut sensus
quoque suos eorumque omnem appetitum et si qua sint adiuncta ei membra tueatur?
Sic ad illa, quae semper habuit, iunget ea, quae postea accesserint, nec eundem
finem habebit, quem cultor eius habebat, sed volet secundum eam naturam, quae
postea ei adiuncta erit, vivere. Ita similis erit ei finis boni, atque antea
fuerat, neque idem tamen; non enim iam stirpis bonum quaeret, sed animalis. Quid, si non sensus modo ei sit datus, verum etiam animus hominis?
Non necesse
est et illa pristina manere, ut tuenda sint, et haec multo esse cariora,
quae accesserint, animique optimam quamque partem carissimam, in eaque
expletione naturae summi boni finem consistere, cum longe multumque praestet
mens atque ratio? Sic, quod est extremum omnium appetendorum atque ductum a
prima commendatione naturae, multis gradibus adscendit, ut ad summum perveniret,
quod cumulatur ex integritate corporis et ex mentis ratione perfecta.
XV. Cum igitur ea sit, quam exposui, forma
naturae, si, ut initio dixi, simul atque ortus esset, se quisque cognosceret
iudicareque posset quae vis et totius esset naturae et partium singularum,
continuo videret quid esset hoc, quod quaerimus, omnium rerum, quas expetimus,
summum et ultimum nec ulla in re peccare posset. Nunc vero a primo quidem
mirabiliter occulta natura est nec perspici nec cognosci potest. Progredientibus
autem aetatibus sensim tardeve potius quasi nosmet ipsos cognoscimus. Itaque
prima illa commendatio, quae a natura nostri facta est nobis, incerta et obscura
est, primusque appetitus ille animi tantum agit, ut salvi atque integri esse
possimus. Cum autem dispicere coepimus et sentire quid simus et quid <ab>
animantibus ceteris differamus, tum ea sequi incipimus, ad quae nati sumus. Quam
similitudinem videmus in bestiis, quae primo, in quo loco natae sunt, ex eo se
non commovent, deinde suo quaeque appetitu movetur. Serpere anguiculos, nare
anaticulas, evolare merulas, cornibus uti videmus boves, nepas aculeis,
suam denique cuique naturam esse ad vivendum ducem. Quae similitudo in genere
etiam humano apparet. Parvi enim primo ortu sic iacent, tamquam omnino sine
animo sint. Cum autem paulum firmitatis accessit, et animo utuntur et sensibus
conitunturque, ut sese erigant, et manibus utuntur et eos agnoscunt, a quibus
educantur. Deinde aequalibus delectantur libenterque se cum iis congregant
dantque se ad ludendum fabellarumque auditione ducuntur deque eo, quod ipsis
superat, aliis gratificari volunt animadvertuntque ea, quae domi fiunt,
curiosius incipiuntque commentari aliquid et discere et eorum, quos vident,
volunt non ignorare nomina, quibusque rebus cum aequalibus decertant, si
vicerunt, efferunt se laetitia, victi debilitantur animosque demittunt. Quorum
sine causa fieri nihil putandum est. Est enim natura sic generata vis hominis,
ut ad omnem virtutem percipiendam facta videatur, ob eamque causam parvi
virtutum simulacris, quarum in se habent semina, sine doctrina moventur; sunt
enim prima elementa naturae, quibus auctis virtutis quasi germen efficitur. Nam
cum ita nati factique simus, ut et agendi aliquid et diligendi aliquos et
liberalitatis et referendae gratiae principia in nobis contineremus atque ad
scientiam, prudentiam, fortitudinem aptos animos haberemus a contrariisque rebus
alienos, non sine causa eas, quas dixi, in pueris virtutum quasi scintillas
videmus, e quibus accendi philosophi ratio debet, ut eam quasi deum ducem
subsequens ad naturae perveniat extremum. Nam, ut saepe iam dixi, in infirma
aetate inbecillaque mente vis naturae quasi per caliginem cernitur; cum autem progrediens confirmatur animus, agnoscit ille quidem naturae vim, sed ita, ut
progredi possit longius, per se sit tantum inchoata.
XVI. Intrandum est igitur in rerum naturam et
penitus quid ea postulet pervidendum; aliter enim nosmet ipsos nosse non
possumus. Quod praeceptum quia maius erat, quam ut ab homine videretur, idcirco
assignatum est deo. Iubet igitur nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos. Cognitio autem haec est una nostri, ut vim corporis animique norimus sequamurque
eam vitam, quae rebus iis ipsis perfruatur. Quoniam autem is animi appetitus a
principio fuit, ut ea, quae dixi, quam perfectissima natura haberemus,
confitendum est, cum id adepti simus, quod appetitum sit, in eo quasi in ultimo
consistere naturam, atque id esse summum bonum; quod certe universum sua sponte
ipsum expeti et propter se necesse est, quoniam ante demonstratum est etiam
singulas eius partes esse per se expetendas. In enumerandis autem corporis
commodis si quis praetermissam a nobis voluptatem putabit, in aliud tempus ea
quaestio differatur. Utrum enim sit voluptas in iis rebus, quas primas secundum
naturam esse diximus, necne sit ad id, quod agimus, nihil interest. Si enim, ut
mihi quidem videtur, non explet bona naturae voluptas, iure praetermissa est;
sin autem est in ea, quod quidam volunt, nihil impedit hanc nostram
comprehensionem summi boni. Quae enim constituta sunt prima naturae, ad ea si
voluptas accesserit, unum aliquod accesserit commodum corporis neque eam
constitutionem summi boni, quae est proposita, mutaverit.
XVII. Et adhuc quidem ita nobis progressa ratio
est, ut ea duceretur omnis a prima commendatione naturae. Nunc autem aliud iam
argumentandi sequamur genus, ut non solum quia nos diligamus, sed quia cuiusque
partis naturae et in corpore et in animo sua quaeque vis sit, idcirco in his
rebus summe nostra sponte moveamur. Atque ut a corpore ordiar, videsne ut, si
quae in membris prava aut debilitata aut inminuta sint, occultent homines? Ut
etiam contendant et elaborent, si efficere possint, ut aut non appareat corporis
vitium aut quam minimum appareat? Multosque etiam dolores curationis causa
perferant, ut, si ipse usus membrorum non modo non maior, verum etiam minor
futurus sit, eorum tamen species ad naturam revertatur? Etenim, cum omnes natura
totos se expetendos putent, nec id ob aliam rem, sed propter ipsos, necesse est
eius etiam partis propter se expeti, quod universum propter se expetatur. Quid?
In motu et in statu corporis nihil inest, quod animadvertendum esse ipsa natura
iudicet? Quem ad modum quis ambulet, sedeat, qui ductus oris, qui vultus in
quoque sit? Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse
ducamus? Nonne odio multos dignos putamus, qui quodam motu aut statu videntur
naturae legem et modum contempsisse? Et quoniam haec deducuntur de corpore, quid
est cur non recte pulchritudo etiam ipsa propter se expetenda ducatur? Nam si
pravitatem inminutionemque corporis propter se fugiendam putamus, cur non etiam,
ac fortasse magis, propter se formae dignitatem sequamur? Et si
turpitudinem fugimus in statu et motu corporis, quid est cur pulchritudinem non
sequamur? Atque etiam valitudinem, vires, vacuitatem doloris non propter
utilitatem solum, sed etiam ipsas propter se expetemus. Quoniam enim natura suis
omnibus expleri partibus vult, hunc statum corporis per se ipsum expetit, qui
est maxime e natura, quae tota perturbatur, si aut aegrum corpus est aut dolet
aut caret viribus.
XVIII. Videamus animi partes, quarum est
conspectus illustrior; quae quo sunt excelsiores, eo dant clariora indicia
naturae. Tantus est igitur innatus in nobis cognitionis amor et scientiae, ut
nemo dubitare possit quin ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata
rapiatur. Videmusne ut pueri ne verberibus quidem a contemplandis rebus
perquirendisque deterreantur? Ut pulsi recurrant? Ut aliquid scire se gaudeant?
Ut id aliis narrare gestiant? Ut pompa, ludis atque eius modi spectaculis
teneantur ob eamque rem vel famem et sitim perferant? Quid vero? Qui ingenuis
studiis atque artibus delectantur, nonne videmus eos nec valitudinis nec rei
familiaris habere rationem omniaque perpeti ipsa cognitione et scientia captos
et cum maximis curis et laboribus compensare eam, quam ex discendo capiant,
voluptatem? <ut> mihi quidem Homerus huius modi quiddam vidisse videatur in iis,
quae de Sirenum cantibus finxerit. Neque enim vocum suavitate videntur aut
novitate quadam et varietate cantandi revocare eos solitae, qui
praetervehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad
earum saxa discendi cupiditate adhaerescerent. Ita enim invitant Ulixem—nam
verti, ut quaedam Homeri, sic istum ipsum locum—:
O decus Argolicum, quin puppim flectis, Ulixes,
Auribus ut nostros possis agnoscere cantus!
Nam nemo haec umquam est transvectus caerula cursu,
Quin prius adstiterit vocum dulcedine captus,
Post variis avido satiatus pectore musis
Doctior ad patrias lapsus pervenerit oras.
Nos grave certamen belli clademque tenemus,
Graecia quam Troiae divino numine vexit,
Omniaque e latis rerum vestigia terris.
Vidit Homerus probari fabulam non posse, si
cantiunculis tantus irretitus vir teneretur; scientiam pollicentur, quam non
erat mirum sapientiae cupido patria esse cariorem. Atque omnia quidem scire,
cuiuscumque modi sint, cupere curiosorum, duci vero maiorum rerum contemplatione
ad cupiditatem scientiae summorum virorum est putandum.
XIX. Quem enim ardorem studii censetis fuisse in
Archimede, qui dum in pulvere quaedam describit attentius, ne patriam <quidem>
captam esse senserit? Quantum Aristoxeni ingenium consumptum videmus in musicis?
Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse? Quid de Pythagora?
Quid de Platone aut de Democrito loquar? A quibus propter discendi cupiditatem
videmus ultimas terras esse peragratas. Quae qui non vident, nihil umquam magnum
ac cognitione dignum amaverunt. - Atque hoc loco, qui propter animi voluptates
coli dicunt ea studia, quae dixi, non intellegunt idcirco esse ea propter
se expetenda, quod nulla utilitate obiecta delectentur animi atque ipsa
scientia, etiamsi incommodatura sit, gaudeant. Sed quid attinet de rebus tam
apertis plura requirere? Ipsi enim quaeramus a nobis stellarum motus
contemplationesque rerum caelestium eorumque omnium, quae naturae obscuritate
occultantur, cognitiones quem ad modum nos moveant, et quid historia delectet,
quam solemus persequi usque ad extremum, <cum> praetermissa repetimus, inchoata
persequimur. Nec vero sum nescius esse utilitatem in historia, non modo
voluptatem. Quid, cum fictas fabulas, e quibus utilitas nulla elici potest, cum
voluptate legimus? Quid, cum volumus nomina eorum, qui quid gesserint, nota
nobis esse, parentes, patriam, multa praeterea minime necessaria? Quid, quod
homines infima fortuna, nulla spe rerum gerendarum, opifices denique delectantur
historia? Maximeque eos videre possumus res gestas audire et legere velle, qui a
spe gerendi absunt confecti senectute. Quocirca intellegi necesse est in ipsis
rebus, quae discuntur et cognoscuntur, invitamenta inesse, quibus ad discendum
cognoscendumque moveamur. Ac veteres quidem philosophi in beatorum insulis
fingunt qualis futura sit vita sapientium, quos cura omni liberatos, nullum
necessarium vitae cultum aut paratum requirentis, nihil aliud esse acturos
putant, nisi ut omne tempus inquirendo ac discendo in naturae cognitione
consumant. Nos autem non solum beatae vitae istam esse oblectationem videmus,
sed etiam levamentum miseriarum. Itaque multi, cum in potestate essent hostium
aut tyrannorum, multi in custodia, multi in exilio dolorem suum doctrinae
studiis levaverunt. Princeps huius civitatis Phalereus Demetrius cum
patria pulsus esset iniuria, ad Ptolomaeum se regem Alexandream contulit. Qui
cum in hac ipsa philosophia, ad quam te hortamur, excelleret Theophrastique
esset auditor, multa praeclara in illo calamitoso otio scripsit non ad usum
aliquem suum, quo erat orbatus, sed animi cultus ille erat ei quasi quidam
humanitatis cibus. Equidem e Cn. Aufidio, praetorio, erudito homine, oculis
capto, saepe audiebam, cum se lucis magis quam utilitatis desiderio moveri
diceret. Somnum denique nobis, nisi requietem corporibus et medicinam quandam
laboris afferret, contra naturam putaremus datum; aufert enim sensus actionemque
tollit omnem. Itaque si aut requietem natura non quaereret aut eam posset alia
quadam ratione consequi, facile pateremur, qui etiam nunc agendi aliquid
discendique causa prope contra naturam vigilias suscipere soleamus.
XX. Sunt autem etiam clariora vel plane perspicua
minimeque dubitanda indicia naturae, maxime scilicet in homine, sed in omni
animali, ut appetat animus aliquid agere semper neque ulla condicione quietem
sempiternam possit pati. Facile est hoc cernere in primis puerorum aetatulis. Quamquam enim vereor, ne nimius in hoc genere videar, tamen omnes veteres
philosophi, maxime nostri, ad incunabula accedunt, quod in pueritia facillime se
arbitrantur naturae voluntatem posse cognoscere. Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint.
Cum vero paulum processerunt, lusionibus vel
laboriosis delectantur, ut ne verberibus quidem deterreri possint, eaque
cupiditas agendi aliquid adolescit una cum aetatibus. Itaque, ne si
iucundissimis quidem nos somniis usuros putemus, Endymionis somnum nobis velimus
dari, idque si accidat, mortis instar putemus. Quin etiam inertissimos homines
nescio qua singulari segnitia praeditos videmus tamen et corpore et animo moveri
semper et, cum re nulla impediantur necessaria, aut alveolum poscere aut
quaerere quempiam ludum aut sermonem aliquem requirere, cumque non habeant
ingenuas ex doctrina oblectationes, circulos aliquos et sessiunculas consectari.
Quin ne bestiae quidem, quas delectationis causa concludimus, cum copiosius
alantur, quam si essent liberae, facile patiuntur sese contineri motusque
solutos et vagos a natura sibi tributos requirunt. Itaque ut quisque optime
natus institutusque est, esse omnino nolit in vita, si gerendis negotiis orbatus
possit paratissimis vesci voluptatibus. Nam aut privatim aliquid gerere malunt
aut, qui altiore animo sunt, capessunt rem publicam honoribus imperiisque
adipiscendis aut totos se ad studia doctrinae conferunt. Qua in vita tantum
abest ut voluptates consectentur, etiam curas, sollicitudines, vigilias
perferunt optimaque parte hominis, quae in nobis divina ducenda est, ingenii et
mentis acie fruuntur nec voluptatem requirentes nec fugientes laborem. Nec vero
intermittunt aut admirationem earum rerum, quae sunt ab antiquis repertae, aut
investigationem novarum. Quo studio cum satiari non possint, omnium ceterarum
rerum obliti nihil abiectum, nihil humile cogitant; tantaque est vis
talibus in studiis, ut eos etiam, qui sibi alios proposuerunt fines bonorum,
quos utilitate aut voluptate dirigunt, tamen in rebus quaerendis explicandisque
naturis aetates conterere videamus.
XXI. Ergo hoc quidem apparet, nos ad agendum esse
natos. Actionum autem genera plura, ut obscurentur etiam minora maioribus,
maximae autem sunt primum, ut mihi quidem videtur et iis, quorum nunc in ratione
versamur, consideratio cognitioque rerum caelestium et earum, quas a natura
occultatas et latentes indagare ratio potest, deinde rerum publicarum
administratio aut administrandi scientia, tum prudens, temperata, fortis, iusta
ratio reliquaeque virtutes et actiones virtutibus congruentes, quae uno verbo
complexi omnia honesta dicimus; ad quorum et cognitionem et usum iam corroborati
natura ipsa praeeunte deducimur. Omnium enim rerum principia parva sunt, sed
suis progressionibus usa augentur, nec sine causa; in primo enim ortu inest
teneritas ac mollitia quaedam, ut nec res videre optimas nec agere possint.
Virtutis enim beataeque vitae, quae duo maxime expetenda sunt, serius lumen
apparet, multo etiam serius, ut plane qualia sint intellegantur.
Praeclare enim
Plato: “Beatum, cui etiam in senectute contigerit, ut sapientiam verasque
opiniones assequi possit!” Quare, quoniam de primis naturae commodis satis
dictum est, nunc de maioribus consequentibusque videamus.
Natura igitur corpus quidem hominis sic et
genuit et formavit, ut alia in primo ortu perficeret, alia progrediente aetate fingeret neque sane multum adiumentis externis et adventiciis uteretur.
Animum autem reliquis rebus ita perfecit, ut corpus; sensibus enim ornavit ad
res percipiendas idoneis, ut nihil aut non multum adiumento ullo ad suam
confirmationem indigerent; quod autem in homine praestantissimum atque optimum
est, id deseruit. Etsi dedit talem mentem, quae omnem virtutem accipere posset,
ingenuitque sine doctrina notitias parvas rerum maximarum et quasi instituit
docere et induxit in ea, quae inerant, tamquam elementa virtutis. Sed virtutem
ipsam inchoavit, nihil amplius. Itaque nostrum est—quod nostrum dico, artis
est—ad ea principia, quae accepimus, consequentia exquirere, quoad sit id, quod
volumus, effectum. Quod quidem pluris est haud paulo magisque ipsum propter se
expetendum quam aut sensus aut corporis ea, quae diximus, quibus tantum praestat
mentis excellens perfectio, ut vix cogitari possit quid intersit. Itaque omnis
honos, omnis admiratio, omne studium ad virtutem et ad eas actiones, quae
virtuti sunt consentaneae, refertur, eaque omnia, quae aut ita in animis sunt
aut ita geruntur, uno nomine honesta dicuntur. Quorum omnium quae sint notitiae,
quae quidem significentur rerum vocabulis, quaeque cuiusque vis et natura sit
mox videbimus.
XXII. Hoc autem loco tantum explicemus haec
honesta, quae dico, praeterquam quod nosmet ipsos diligamus, praeterea suapte
natura per se esse expetenda. Indicant pueri, in quibus ut in speculis natura
cernitur. Quanta studia decertantium sunt! quanta ipsa certamina! ut illi
efferuntur laetitia, cum vicerunt! ut pudet victos! ut se accusari nolunt! quam
cupiunt laudari! quos illi labores non perferunt, ut aequalium principes sint!
quae memoria est in iis bene merentium, quae referendae gratiae cupiditas! atque
ea in optima quaque indole maxime apparent, in qua haec honesta, quae
intellegimus, a natura tamquam adumbrantur. Sed haec in pueris; expressa vero in
iis aetatibus, quae iam confirmatae sunt. Quis est tam dissimilis homini, qui
non moveatur et offensione turpitudinis et comprobatione honestatis? Quis est,
qui non oderit libidinosam, protervam adolescentiam? Quis contra in illa aetate
pudorem, constantiam, etiamsi sua nihil intersit, non tamen diligat? Quis Pullum
Numitorium Fregellanum, proditorem, quamquam rei publicae nostrae profuit, non
odit? Quis <suae> urbis conservatorem Codrum, quis
Erechthei filias non maxime
laudat? Cui Tubuli nomen odio non est? Quis Aristidem non mortuum diligit? An
obliviscimur, quantopere in audiendo in legendoque moveamur, cum pie, cum amice,
cum magno animo aliquid factum cognoscimus? Quid loquor de nobis, qui ad laudem
et ad decus nati, suscepti, instituti sumus? Qui clamores vulgi atque
imperitorum excitantur in theatris, cum illa dicuntur:
Ego sum Orestes,
contraque ab altero: “Immo enimvero ego sum,
inquam, Orestes!” cum autem etiam exitus ab utroque datur conturbato errantique
regi, ambo ergo se una necari cum precantur, quotiens hoc agitur, ecquandone
nisi admirationibus maximis? Nemo est igitur, quin hanc affectionem animi
probet atque laudet, qua non modo utilitas nulla quaeritur, sed contra
utilitatem etiam conservatur fides. Talibus exemplis non fictae solum fabulae,
verum etiam historiae refertae sunt, et quidem maxime nostrae. Nos enim ad sacra
Idaea accipienda optimum virum delegimus, nos tutores misimus regibus, nostri
imperatores pro salute patriae sua capita voverunt, nostri consules regem
inimicissimum moenibus iam adpropinquantem monuerunt, a veneno ut caveret,
nostra in re publica Lucretia et quae per vim oblatum stuprum voluntaria morte
lueret inventa est et qui interficeret filiam, ne stupraretur. Quae quidem omnia
et innumerabilia praeterea quis est quin intellegat et eos qui fecerint
dignitatis splendore ductos inmemores fuisse utilitatum suarum nosque, cum ea
laudemus, nulla alia re nisi honestate duci?
XXXIII. Quibus rebus expositis breviter—nec enim sum copiam, quam potui, quia
dubitatio in re nulla erat, persecutus—sed his rebus concluditur profecto et
virtutes omnes et honestum illud, quod ex iis oritur et in iis haeret, per se
esse expetendum. In omni autem honesto, de quo loquimur, nihil est tam illustre
nec quod latius pateat quam coniunctio inter homines hominum et quasi quaedam
societas et communicatio utilitatum et ipsa caritas generis humani. Quae nata a
primo satu, quod a procreatoribus nati diliguntur et tota domus coniugio et
stirpe coniungitur, serpit sensim foras, cognationibus primum, tum
affinitatibus, deinde amicitiis, post vicinitatibus, tum civibus et iis, qui
publice socii atque amici sunt, deinde totius complexu gentis humanae. Quae animi affectio suum cuique tribuens atque hanc, quam dico, societatem
coniunctionis humanae munifice et aeque tuens iustitia dicitur, cui sunt
adiunctae pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, comitas, quaeque sunt
generis eiusdem. Atque haec ita iustitiae propria sunt, ut sint virtutum
reliquarum communia. Nam cum sic hominis natura generata sit, ut habeat quiddam
ingenitum quasi civile atque populare, quod Graeci πολιτικόν vocant, quicquid
aget quaeque virtus, id a communitate et ea, quam exposui, caritate ac societate
humana non abhorrebit, vicissimque iustitia, ut ipsa se fundet in ceteras
virtutes, sic illas expetet. Servari enim iustitia nisi a forti viro, nisi a
sapiente non potest. Qualis est igitur omnis haec, quam dico, conspiratio
consensusque virtutum, tale est illud ipsum honestum, quandoquidem honestum aut
ipsa virtus est aut res gesta virtute; quibus rebus vita consentiens
virtutibusque respondens recta et honesta et constans et naturae congruens
existimari potest. Atque haec coniunctio confusioque virtutum tamen a
philosophis ratione quadam distinguitur. Nam cum ita copulatae conexaeque sint,
ut omnes omnium participes sint nec alia ab alia possit separari, tamen proprium
suum cuiusque munus est, ut fortitudo in laboribus periculisque cernatur,
temperantia in praetermittendis voluptatibus, prudentia in dilectu bonorum et
malorum, iustitia in suo cuique tribuendo. Quando igitur inest in omni virtute
cura quaedam quasi foras spectans aliosque appetens atque complectens, existit
illud, ut amici, ut fratres, ut propinqui, ut affines, ut cives, ut omnes
denique—quoniam unam societatem hominum esse volumus—propter se expetendi
sint. Atqui eorum nihil est eius generis, ut sit in fine atque extremo bonorum.
Ita fit, ut duo genera propter se expetendorum reperiantur, unum, quod est in
iis, in quibus completur illud extremum, quae sunt aut animi aut corporis; haec
autem, quae sunt extrinsecus, id est quae neque in animo insunt neque in
corpore, ut amici, ut parentes, ut liberi, ut propinqui, ut ipsa patria, sunt
illa quidem sua sponte cara, sed eodem in genere, quo illa, non sunt. Nec vero
umquam summum bonum assequi quisquam posset, si omnia illa, quae sunt extra,
quamquam expetenda, summo bono continerentur.
XXIV. Quo modo igitur, inquies, verum esse poterit omnia referri ad summum bonum, si
amicitiae, si propinquitates, si reliqua externa summo bono non continentur? Hac
videlicet ratione, quod ea, quae externa sunt, iis tuemur officiis, quae
oriuntur a suo cuiusque genere virtutis. Nam et amici cultus et parentis ei, qui
officio fungitur, in eo ipso prodest, quod ita fungi officio in recte factis
est, quae sunt orta <a> virtutibus. Quae quidem sapientes sequuntur duce natura
tanquam videntes; non perfecti autem homines et tamen ingeniis excellentibus
praediti excitantur saepe gloria, quae habet speciem honestatis et
similitudinem. Quodsi ipsam honestatem undique perfectam atque absolutam. Rem
unam praeclarissimam omnium maximeque laudandam, penitus viderent, quonam gaudio
complerentur, cum tantopere eius adumbrata opinione laetentur? Quem enim deditum
voluptatibus, quem cupiditatum incendiis inflammatum in iis potiendis,
quae acerrime concupivisset, tanta laetitia perfundi arbitramur, quanta aut
superiorem Africanum Hannibale victo aut posteriorem Karthagine eversa? Quem
Tiberina descensio festo illo die tanto gaudio affecit, quanto L. Paulum, cum
regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? -
Age nunc, Luci noster, extrue animo altitudinem excellentiamque virtutum: iam non dubitabis, quin earum compotes homines magno animo erectoque viventes
semper sint beati, qui omnis motus fortunae mutationesque rerum et temporum
levis et inbecillos fore intellegant, si in virtutis certamen venerint. Illa
enim, quae sunt a nobis bona corporis numerata, complent ea quidem beatissimam
vitam, sed ita, ut sine illis possit beata vita existere. Ita enim parvae et
exiguae sunt istae accessiones bonorum, ut, quem ad modum stellae in radiis
solis, sic istae in virtutum splendore ne cernantur quidem. -
Atque hoc ut vere dicitur, parva esse ad beate vivendum momenta ista corporis
commodorum, sic nimis violentum est nulla esse dicere; qui enim sic
disputant, obliti mihi videntur, quae ipsi fecerint principia naturae. Tribuendum est igitur his aliquid, dum modo quantum tribuendum sit intellegas.
Est enim philosophi non tam gloriosa quam vera quaerentis nec pro nihilo putare
ea, quae secundum naturam illi ipsi gloriosi esse fatebantur, et videre <esse>
tantam vim virtutis tantamque, ut ita dicam, auctoritatem honestatis, ut reliqua
non illa quidem nulla, sed ita parva sint, ut nulla esse videantur. Haec est nec
omnia spernentis praeter virtutem et virtutem ipsam suis laudibus
amplificantis oratio, denique haec est undique completa et perfecta explicatio
summi boni. Hinc ceteri particulas arripere conati suam quisque videri voluit
afferre sententiam.
XXV. Saepe ab Aristotele, a Theophrasto mirabiliter est laudata
per se ipsa rerum scientia; hoc uno captus Erillus scientiam summum bonum esse
defendit nec rem ullam aliam per se expetendam. Multa sunt dicta ab antiquis de
contemnendis ac despiciendis rebus humanis; hoc unum Aristo tenuit: praeter
vitia atque virtutes negavit rem esse ullam aut fugiendam aut expetendam. Positum est a nostris in iis esse rebus, quae secundum naturam essent, non
dolere; hoc Hieronymus summum bonum esse dixit. At vero Callipho et post eum
Diodorus, cum alter voluptatem adamavisset, alter vacuitatem doloris, neuter
honestate carere potuit, quae est a nostris laudata maxime. Quin etiam ipsi
voluptarii deverticula quaerunt et virtutes habent in ore totos dies
voluptatemque primo dumtaxat expeti dicunt, deinde consuetudine quasi alteram
quandam naturam effici, qua inpulsi multa faciant nullam quaerentes voluptatem.
Stoici restant. Ei quidem non unam aliquam aut alteram <rem> a nobis, sed totam
ad se nostram philosophiam transtulerunt; atque ut reliqui fures earum rerum,
quas ceperunt, signa commutant, sic illi, ut sententiis nostris pro suis
uterentur, nomina tamquam rerum notas mutaverunt. Ita relinquitur sola haec
disciplina digna studiosis ingenuarum artium, digna eruditis, digna claris
viris, digna principibus, digna regibus. - Quae cum dixisset paulumque institisset, Quid est?
Inquit; satisne vobis
videor pro meo iure in vestris auribus commentatus? - Et ego: Tu vero, inquam, Piso, ut saepe alias, sic hodie ita nosse ista visus
es, ut, si tui nobis potestas saepius fieret, non multum Graecis supplicandum
putarem. Quod quidem eo probavi magis, quia memini Staseam Neapolitanum,
doctorem illum tuum, nobilem sane Peripateticum, aliquanto ista secus dicere
solitum, assentientem iis, qui multum in fortuna secunda aut adversa, multum in
bonis aut malis corporis ponerent. -
Est, ut dicis, inquit; sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur multo
melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quamquam ego non quaero, quid tibi
a me probatum sit, sed huic Ciceroni nostro, quem discipulum cupio a te
abducere.
XXVI. Tum Lucius: Mihi vero ista valde probata sunt, quod item fratri puto.
Tum mihi Piso: Quid ergo? Inquit, dasne adolescenti veniam?
An eum discere ea
mavis, quae cum plane perdidicerit, nihil sciat?
Ego vero isti, inquam, permitto. Sed nonne meministi licere mihi ista probare,
quae sunt a te dicta? Quis enim potest ea, quae probabilia videantur ei, non
probare?
An vero, inquit, quisquam potest probare, quod perceptum, quod comprehensum,
quod cognitum non habet?
Non est ista, inquam, Piso, magna dissensio. Nihil enim est aliud, quam ob rem
mihi percipi nihil posse videatur, nisi quod percipiendi vis ita definitur a Stoicis, ut negent quicquam posse percipi nisi tale verum, quale falsum esse non
possit. Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Sed
haec omittamus; habent enim et bene longam et satis litigiosam disputationem.
Illud mihi a te nimium festinanter dictum videtur, sapientis omnis esse semper
beatos; nescio quo modo praetervolavit oratio. Quod nisi ita efficitur, quae
Theophrastus de fortuna, de dolore, de cruciatu corporis dixit, cum quibus
coniungi vitam beatam nullo modo posse putavit, vereor, ne vera sint. Nam illud
vehementer repugnat, eundem beatum esse et multis malis oppressum. Haec quo modo
conveniant, non sane intellego.
Utrum igitur tibi non placet, inquit, virtutisne tantam esse vim, ut ad beate
vivendum se ipsa contenta sit? An, si id probas, fieri ita posse negas, ut ii,
qui virtutis compotes sint, etiam malis quibusdam affecti beati sint?
Ego vero volo in virtute vim esse quam maximam; sed quanta sit alias; nunc
tantum possitne esse tanta, si quicquam extra virtutem habeatur in bonis.
Atqui, inquit, si Stoicis concedis ut virtus sola, si adsit, vitam
efficiat beatam, concedis etiam Peripateticis. Quae enim mala illi non audent
appellare, aspera autem et incommoda et reicienda et aliena naturae esse
concedunt, ea nos mala dicimus, sed exigua et paene minima. Quare si potest esse
beatus is, qui est in asperis reiciendisque rebus, potest is quoque esse, qui
est in parvis malis.
Et ego: Piso, inquam, si est quisquam, qui acute in causis videre soleat quae
res agatur, is es profecto tu. Quare attende, quaeso. Nam adhuc, meo fortasse
vitio, quid ego quaeram non perspicis. Istic sum, inquit, expectoque quid ad id, quod quaerebam, respondeas.
XXVII. Respondebo me non quaerere, inquam, hoc tempore quid virtus efficere possit,
sed quid constanter dicatur, quid ipsum a se dissentiat.
Quo igitur, inquit, modo?
Quia, cum a Zenone, inquam, hoc magnifice tamquam ex oraculo editur: 'Virtus ad
beate vivendum se ipsa contenta est', <et> Quare? Inquit, respondet: “Quia, nisi
quod honestum est, nullum est aliud bonum.” Non quaero iam verumne sit; illud
dico, ea, quae dicat, praeclare inter se cohaerere. Dixerit hoc idem Epicurus,
semper beatum esse sapientem—quod quidem solet ebullire non numquam—, quem
quidem, cum summis doloribus conficiatur, ait dicturum: 'Quam suave est! quam
nihil curo!'; non pugnem cum homine, cur tantum habeat in natura boni; illud
urgueam, non intellegere eum quid sibi dicendum sit, cum dolorem summum malum
esse dixerit. Eadem nunc mea adversum te oratio est. Dicis eadem omnia et bona
et mala, quae quidem dicunt ii, qui numquam philosophum pictum, ut dicitur,
viderunt: valitudinem, vires, staturam, formam, integritatem unguiculorum omnium
<bona>, deformitatem, morbum, debilitatem mala. Iam illa externa parce tu
quidem; sed haec cum corporis bona sint, eorum conficientia certe in bonis
numerabis, amicos, liberos, propinquos, divitias, honores, opes. Contra hoc
attende me nihil dicere, <illud dicere>, si ista mala sunt, in quae potest
incidere sapiens, sapientem esse non esse ad beate vivendum satis.
Immo vero, inquit, ad beatissime vivendum parum est, ad beate vero satis.
Animadverti, inquam, te isto modo paulo ante ponere, et scio ab Antiocho nostro
dici sic solere; sed quid minus probandum quam esse aliquem beatum nec satis
beatum? Quod autem satis est, eo quicquid accessit, nimium est; et nemo nimium
beatus est; ita nemo beato beatior. Ergo, inquit, tibi Q. Metellus, qui tris filios consules vidit, e quibus
unum etiam et censorem et triumphantem, quartum autem praetorem, eosque salvos
reliquit et tris filias nuptas, cum ipse consul, censor, etiam augur fuisset
<et> triumphasset, ut sapiens fuerit, nonne beatior quam, ut item sapiens
fuerit, qui in potestate hostium vigiliis et inedia necatus est, Regulus?
XXVIII. Quid me istud rogas? Inquam. Stoicos roga.
Quid igitur, inquit, eos responsuros putas?
Nihilo beatiorem esse Metellum quam Regulum.
Inde igitur, inquit, ordiendum est.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non enim quaero quid verum, sed quid
cuique dicendum sit. Utinam quidem dicerent alium alio beatiorem! iam ruinas
videres. In virtute enim sola et in ipso honesto cum sit bonum positum, cumque
nec virtus, ut placet illis, nec honestum crescat, idque bonum solum sit, quo
qui potiatur, necesse est beatus sit, cum id augeri non possit, in quo uno
positum est beatum esse, qui potest esse quisquam alius alio beatior? Videsne, ut haec concinant?
Et hercule—fatendum est enim, quod sentio—mirabilis
est apud illos contextus rerum. Respondent extrema primis, media utrisque, omnia
omnibus. Quid sequatur, quid repugnet, vident. Ut in geometria, prima si
dederis, danda sunt omnia. Concede nihil esse bonum, nisi quod honestum sit:
concedendum est in virtute <esse> positam beatam vitam. Vide rursus retro: dato hoc dandum erit illud. Quod vestri non item. 'Tria genera bonorum';
proclivi currit oratio. Venit ad extremum; haeret in salebra. Cupit enim dicere
nihil posse ad beatam vitam deesse sapienti. Honesta oratio, Socratica, Platonis
etiam. Audeo dicere, inquit. Non potes, nisi retexueris illa. Paupertas si malum
est, mendicus beatus esse nemo potest, quamvis sit sapiens. At Zeno eum non
beatum modo, sed etiam divitem dicere ausus est. Dolere malum est: in crucem qui
agitur, beatus esse non potest. Bonum liberi: misera orbitas. Bonum patria:
miserum exilium. Bonum valitudo: miser morbus. Bonum integritas corporis: misera
debilitas. Bonum incolumis acies: misera caecitas. Quae si potest singula
consolando levare, universa quo modo sustinebit? Sit enim idem caecus, debilis,
morbo gravissimo affectus, exul, orbus, egens, torqueatur eculeo: quem hunc
appellas, Zeno? Beatum, inquit. Etiam beatissimum? Quippe, inquiet, cum tam
docuerim gradus istam rem non habere quam virtutem, in qua sit ipsum etiam
beatum. Tibi hoc incredibile, quod beatissimum. Quid? Tuum credibile? Si enim ad populum me vocas, eum, qui ita sit affectus, beatum esse numquam
probabis; si ad prudentes, alterum fortasse dubitabunt, sitne tantum in virtute,
ut ea praediti vel in Phalaridis tauro beati sint, alterum non dubitabunt, quin
et Stoici convenientia sibi dicant et vos repugnantia.
Theophrasti igitur, inquit, tibi liber ille placet de beata vita?
Tamen aberramus a proposito, et, ne longius, prorsus, inquam, Piso, si ista mala
sunt, placet.
Nonne igitur tibi videntur, inquit, mala? Id quaeris, inquam, in quo, utrum respondero, verses te huc atque illuc
necesse est.
Quo tandem modo? Inquit.
Quia, si mala sunt, is, qui erit in iis, beatus non erit; si mala non sunt,
iacet omnis ratio Peripateticorum.
Et ille ridens: Video, inquit, quid agas; ne discipulum abducam, times.
Tu vero, inquam, ducas licet, si sequetur; erit enim mecum, si tecum erit.
XXIX. Audi igitur, inquit, Luci; tecum enim mihi instituenda oratio est. Omnis
auctoritas philosophiae, ut ait Theophrastus, consistit in beata vita
comparanda; beate enim vivendi cupiditate incensi omnes sumus. Hoc mihi cum tuo
fratre convenit. Quare hoc videndum est, possitne nobis hoc ratio philosophorum
dare. Pollicetur certe. Nisi enim id faceret, cur Plato Aegyptum peragravit, ut
a sacerdotibus barbaris numeros et caelestia acciperet? Cur post Tarentum ad Archytam?
Cur ad reliquos Pythagoreos, Echecratem, Timaeum, Arionem, Locros, ut,
cum Socratem expressisset, adiungeret Pythagoreorum disciplinam eaque, quae
Socrates repudiabat, addisceret? Cur ipse Pythagoras et Aegyptum lustravit et
Persarum magos adiit? Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria
transmisit? Cur haec eadem Democritus? Qui —vere falsone, quaerere
mittimus—dicitur oculis se privasse; certe, ut quam minime animus a
cogitationibus abduceretur, patrimonium neglexit, agros deseruit incultos, quid
quaerens aliud nisi vitam beatam? Quam si etiam in rerum cognitione ponebat,
tamen ex illa investigatione naturae consequi volebat, bono ut esset animo. Id
enim ille summum bonum εὐθυμίαν et saepe ἀθαμβίαν appellat, id est animum
terrore liberum. Sed haec etsi praeclare, nondum tamen perpolita. Pauca enim,
neque ea ipsa enucleate, ab hoc de virtute quidem dicta. Post enim haec in hac
urbe primum a Socrate quaeri coepta, deinde in hunc locum delata sunt, nec
dubitatum, quin in virtute omnis ut bene, sic etiam beate vivendi spes
poneretur. Quae cum Zeno didicisset a nostris, ut in actionibus praescribi
solet, 'de eadem re fecit alio modo'. Hoc tu nunc in illo probas. Scilicet
vocabulis rerum mutatis inconstantiae crimen ille effugit, nos effugere non
possumus! ille Metelli vitam negat beatiorem quam Reguli, praeponendam tamen,
nec magis expetendam, sed magis sumendam et, si optio esset, eligendam Metelli,
Reguli reiciendam; ego, quam ille praeponendam et magis eligendam, beatiorem
hanc appello nec ullo minimo momento plus ei vitae tribuo quam Stoici. Quid interest, nisi quod ego res notas notis verbis appello, illi nomina nova
quaerunt, quibus idem dicant? Ita, quem ad modum in senatu semper est aliquis,
qui interpretem postulet, sic isti nobis cum interprete audiendi sunt. Bonum
appello quicquid secundum naturam est, quod contra malum, nec ego solus, sed tu
etiam, Chrysippe, in foro, domi; in schola desinis. Quid ergo? Aliter homines,
aliter philosophos loqui putas oportere? Quanti quidque sit aliter docti et
indocti, sed cum constiterit inter doctos quanti res quaeque sit—si homines
essent, usitate loquerentur—, dum res maneant, verba fingant arbitratu suo.
XXX. Sed venio ad inconstantiae crimen, ne saepius dicas me aberrare; quam tu ponis
in verbis, ego positam in re putabam. Si satis erit hoc perceptum, in quo
adiutores Stoicos optimos habemus, tantam vim esse virtutis, ut omnia, si ex
altera parte ponantur, ne appareant quidem, cum omnia, quae illi commoda certe
dicunt esse et sumenda et eligenda et praeposita —quae ita definiunt, ut satis
magno aestimanda sint—, haec igitur cum ego tot nominibus a Stoicis appellata,
partim novis et commenticiis, ut ista “producta” et 'reducta', partim idem
significantibus—quid enim interest, expetas an eligas? Mihi quidem etiam lautius
videtur, quod eligitur, et ad quod dilectus adhibetur—, sed, cum ego ista omnia
bona dixero, tantum refert quam magna dicam, cum expetenda, quam valde. Sin
autem nec expetenda ego magis quam tu eligenda, nec illa pluris aestimanda ego,
qui bona, quam tu, producta qui appellas, omnia ista necesse est obscurari nec
apparere et in virtutis tamquam in solis radios incurrere. At enim, qua in
vita est aliquid mali, ea beata esse non potest. Ne seges quidem igitur spicis
uberibus et crebris, si avenam uspiam videris, nec mercatura quaestuosa, si in
maximis lucris paulum aliquid damni contraxerit. An hoc usque quaque, aliter in
vita? Et non ex maxima parte de tota iudicabis? An dubium est, quin virtus ita
maximam partem optineat in rebus humanis, ut reliquas obruat? Audebo igitur
cetera, quae secundum naturam sint, bona appellare nec fraudare suo vetere
nomine neque iam aliquod potius novum exquirere, virtutis autem amplitudinem
quasi in altera librae lance ponere. Terram, mihi crede, ea lanx et maria
deprimet. Semper enim ex eo, quod maximas partes continet latissimeque funditur,
tota res appellatur. Dicimus aliquem hilare vivere; ergo, si semel tristior
effectus est, hilara vita amissa est? At hoc in eo
M. Crasso, quem semel ait in
vita risisse Lucilius, non contigit, ut ea re minus ἀγέλαστος, ut ait idem,
vocaretur. Polycratem Samium felicem appellabant. Nihil acciderat ei, quod
nollet, nisi quod anulum, quo delectabatur, in mari abiecerat. Ergo infelix una
molestia, felix rursus, cum is ipse anulus in praecordiis piscis inventus est? Ille vero, si insipiens—quod certe, quoniam tyrannus—, numquam beatus; si
sapiens, ne tum quidem miser, cum ab Oroete, praetore Darei, in crucem actus
est. At multis malis affectus. Quis negat? Sed ea mala virtutis magnitudine
obruebantur.
XXXI. An ne hoc quidem Peripateticis concedis, ut dicant omnium bonorum virorum, id
est sapientium omnibusque virtutibus ornatorum, vitam omnibus partibus
plus habere semper boni quam mali? Quis hoc dicit? Stoici scilicet. Minime; sed
isti ipsi, qui voluptate et dolore omnia metiuntur, nonne clamant sapienti plus
semper adesse quod velit quam quod nolit? Cum tantum igitur in virtute ponant
ii, qui fatentur se virtutis causa, nisi ea voluptatem faceret, ne manum quidem
versuros fuisse, quid facere nos oportet, qui quamvis minimam animi praestantiam
omnibus bonis corporis anteire dicamus, ut ea ne in conspectu quidem
relinquantur? Quis est enim, qui hoc cadere in sapientem dicere audeat, ut, si
fieri possit, virtutem in perpetuum abiciat, ut dolore omni liberetur? Quis
nostrum dixerit, quos non pudet ea, quae Stoici aspera dicunt, mala dicere,
melius esse turpiter aliquid facere cum voluptate quam honeste cum dolore? Nobis
Heracleotes ille Dionysius flagitiose descivisse videtur a Stoicis propter
oculorum dolorem. Quasi vero hoc didicisset a Zenone, non dolere, cum doleret!
illud audierat nec tamen didicerat, malum illud non esse, quia turpe non esset,
et esse ferendum viro. Hic si Peripateticus fuisset, permansisset, credo, in
sententia, qui dolorem malum dicunt esse, de asperitate autem eius fortiter
ferenda praecipiunt eadem, quae Stoici. Et quidem Arcesilas tuus, etsi fuit in
disserendo pertinacior, tamen noster fuit; erat enim Polemonis. Is cum arderet
podagrae doloribus visitassetque hominem Charmides Epicureus perfamiliaris et
tristis exiret, Mane, quaeso, inquit, Charmide noster; nihil illinc huc
pervenit. Ostendit pedes et pectus. Ac tamen hic mallet non dolere.
XXXII. Haec igitur est nostra ratio, quae tibi videtur inconstans, cum propter
virtutis caelestem quandam et divinam tantamque praestantiam, ut, ubi virtus sit
resque magnae <et> summe laudabiles virtute gestae, ibi esse miseria et aerumna
non possit, tamen labor possit, possit molestia, non dubitem dicere omnes
sapientes esse semper beatos, sed tamen fieri posse, ut sit alius alio beatior.
Atqui iste locus est, Piso, tibi etiam atque etiam confirmandus, inquam; quem si
tenueris, non modo meum Ciceronem, sed etiam me ipsum abducas licebit. Tum Quintus: Mihi quidem, inquit, satis hoc confirmatum videtur, laetorque
eam philosophiam, cuius antea supellectilem pluris aestimabam quam possessiones
reliquarum—ita mihi dives videbatur, ut ab ea petere possem, quicquid in studiis
nostris concupissem—, hanc igitur laetor etiam acutiorem repertam quam ceteras,
quod quidam ei deesse dicebant.
Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; sed mehercule pergrata mihi
oratio tua. Quae enim dici Latine posse non arbitrabar, ea dicta sunt a te
verbis aptis nec minus plane quam dicuntur a Graecis. Sed tempus est, si
videtur, et recta quidem ad me.
Quod cum ille dixisset et satis disputatum videretur, in oppidum ad Pomponium
perreximus omnes.
|
I. Comme j'étais à Athènes, et qu'un jour, selon ma coutume, j'avais
entendu Antiochus dans le Gymnase de Ptolémée, en compagnie de M.
Pison, de mon frère Quintus, de T. Pomponius, et de L. Cicéron mon
cousin germain, que j'aime comme s'il eût été mon frère; nous fîmes
dessein de nous aller promener ensemble l'après-midi à l'Académie,
parce que dans ce temps-là, il ne s'y trouvait d'ordinaire presque
personne. Nous nous rendîmes donc tous chez Pison au temps marqué;
et de là, en nous entretenant de choses diverses, nous fîmes les six
stades de la porte Dipyle à l'Académie. Quand nous fûmes arrivés
dans un si beau lieu, et qui n'est pas célèbre sans cause, nous y
trouvâmes toute la solitude que nous voulions. Alors Pison: Est-ce
par un dessein de la nature, nous dit-il, ou par une erreur de notre
imagination, que lorsque nous voyons des lieux où l'histoire nous
apprend que de grands hommes ont passé une partie de leur vie, nous
nous sentons plus émus que quand nous écoutons le récit de leurs
actions ou que nous lisons quelqu'un de leurs écrits? C'est là ce
que j'éprouve moi-même en ce moment. Le souvenir de Platon me vient
assaillir l'esprit; c'est ici qu'il s'entretenait avec ses
disciples; et ses petits jardins que vous voyez si près de nous, me
rendent sa mémoire tellement présente qu'ils me le remettent presque
devant les yeux. Ces lieux ont vu Speusippe, ils ont vu Xénocrate et
Polémon son disciple dont voici la place favorite. Je n'aperçois
même jamais le palais du sénat (j'entends la cour Hostilie, non pas
ce palais nouveau, monument bien plus vaste et qui paraît plus petit
à mes yeux), que je ne songe à Scipion, à Caton, à Lélius, et
surtout à mon aïeul. Enfin les lieux ont si bien la vertu de nous
faire ressouvenir de tout, que ce n'est pas sans raison qu'on a
fondé sur eux l'art de la mémoire. – Rien n'est plus vrai, Pison,
lui dit mon frère Quintus. Moi-même en venant ici, les yeux fixés
sur Colone, le séjour de So-
534 phocle, je croyais voir devant moi ce grand poète à qui j'ai voué
une si profonde admiration, vous le savez, et qui fait mes délices.
L'image même d'Œdipe qu'il représente venant ici, et demandant dans
ces vers qui arrachent les larmes, en quels lieux il se trouve, m'a
tout ému; ce n'est qu'une image vaine, et cependant elle m'a remué.
– Et moi, dit Pomponius, à qui vous faites la guerre de m'être rendu
à Épicure, dont nous venons de passer les jardins, je vois s'écouler
dans ces jardins bien des heures en compagnie de Phèdre que j'aime
plus qu'homme au monde. Il est vrai qu'averti par l'ancien proverbe,
je pense toujours aux vivants; mais quand je voudrais oublier
Épicure, comment le pourrais-je, lui dont nos amis ont le portrait
non seulement reproduit à grands traits par la peinture, mais encore
gravé sur leurs coupes et sur leurs bagues?
II. Notre ami Pomponius, dis-je alors, veut s'égayer, et il est
peut-être dans son droit. Car il s'est établi de telle sorte à
Athènes, que déjà on peut le prendre pour un Athénien, et que je ne
serais pas surpris qu'un jour il ne portât le surnom d'Atticus. Mais
je suis de votre avis, Pison; rien ne nous fait penser plus vivement
et plus attentivement aux grands personnages que les lieux
fréquentés par eux. Vous savez que j'allai une fois à Métaponte avec
vous, et que je ne mis le pied chez mon hôte qu'après avoir vu le
lieu où Pythagore rendit le dernier soupir, et le siège où il
s'asseyait d'ordinaire. Tout présentement encore, quoique l'on
trouve partout à Athènes les traces des grands hommes qu'elle a
portés, je me suis senti ému en voyant cet hémicycle où Charmadas
enseignait naguère. Il me semble que je le vois (car ses traits me
sont bien connus); il me semble même que sa chaire, demeurée, pour
ainsi dire, veuve d'un si grand génie, regrette à toute heure de ne
plus l'entendre. – Alors Pison: Puisque tout le monde, dit-il, a été
frappé de quelque souvenir, je voudrais bien savoir ce qui a fait
impression sur notre jeune Lucius? Serait-ce le lieu où Démosthène
et Eschine se livraient leurs grands combats? Chacun en effet est
surtout guidé par ses études de prédilection. – Lui en rougissant:
Ne m'interrogez pas là-dessus, dit-il, moi qui suis même descendu
sur la plage de Phalère, où l'on dit que Démosthène déclamait au
bruit des flots, pour s'habituer à vaincre par sa voix le
frémissement de la place publique. Je viens même de me détourner un
peu sur la droite pour voir le tombeau de Périclès. Mais dans cette
ville-ci, les souvenirs sont inépuisables; il semble à chaque pas
que l'on y fait que du sol jaillisse l'histoire. – Ces recherches,
lui dit Pison, quand on les fait dans la vue d'imiter un jour les
grands personnages, sont d'un excellent esprit, mais quand elles
n'ont pour but que de nous mettre sur les traces du passé, elles
témoignent seulement d'un esprit curieux. Aussi nous vous exhortons
tous, et je vois que déjà vous vous y portez de vous-même, à marcher
sur les pas des grands hommes dont vous prenez plaisir à reconnaître
les vestiges. – Vous savez, dis-je alors à Pison, qu'il a déjà
prévenu vos conseils; mais je vous suis obligé des encouragements
que vous lui donnez. – Il faut donc, reprit-il avec son extrême
bienveillance, que nous tâchions tous de contribuer aux progrès de
notre jeune ami; il faut avant tout qu'il tourne un peu ses études
585 vers la philosophie, tant
pour vous imiter, vous qu'il aime, que pour être en état de mieux
réussir dans l'éloquence. Mais vous, Lucius, continua-t-il, est-il
besoin de vous y exhorter, et ne vous y sentez-vous pas tout
naturellement enclin? Au moins il me semble que vous écoutez avec
beaucoup d'intérêt les leçons d'Antiochus. – J'ai grand plaisir à
les suivre, répondit Lucius avec une honnête timidité; mais vous
venez l'entendre parler de Charmadas, je me sens entraîné de ce
côté-là: ensuite Antiochus me rappelle, et c'est la seule école que
je fréquente.
III. Quoiqu'en présence de cet homme-ci, dit Pison en me montrant,
ce ne soit pas une chose aisée, j'oserai cependant entreprendre de
vous faire revenir de la nouvelle Académie à l'ancienne dans
laquelle on comprend non seulement ceux qu'on appelle Académiciens,
Speusippe, Xénocrate, Polémon, Crantor, et les autres; mais aussi
les anciens Péripatéticiens, à la tête desquels est Aristote, que
l'on pourrait peut-être, si vous exceptez Platon, nommer à bon droit
le prince des philosophes. Attachez-vous à eux, croyez-moi; c'est de
leurs écrits et de leurs préceptes que l'on peut tirer tout ce qu'il
y a de plus considérable dans les hautes sciences, dans l'histoire
et l'éloquence. Ils ont traité de tant de matières, que sans leur
secours on ne peut guère parler comme il faut d'aucune chose
importante. Ils ont formé des orateurs, ils ont formé des généraux
d'armée, et des hommes d'État; et pour en venir à des professions
moins relevées, c'est d'eux, comme du foyer commun de tous les arts,
que les mathématiciens, les poètes, les musiciens, les médecins
eux-mêmes sont sortis. – Vous savez, dis-je à Pison, que je pense
comme vous là-dessus; mais c'est très à propos que vous venez d'en
parler. Car Lucius a une extrême envie de savoir quel est le
sentiment de l'ancienne Académie, dont vous invoquez le souvenir, et
de tous les Péripatéticiens, sur le souverain bien; et nous croyons
que personne ne peut mieux l'en instruire que vous qui avez eu
plusieurs années auprès de vous Staséas de Naples, et qui, depuis
plusieurs mois que vous êtes à Athènes, vous entretenez souvent sur
ces questions avec Antiochus. – Fort bien, dit-il en riant, c'est
donc pour cela que vous m'avez amené ici? je veux bien pourtant, si
je le puis, dire à ce jeune homme tout ce que j'en sais; le lieu et
la solitude nous le permettent. Mais je n'aurais jamais pu croire,
quand même quelque dieu me l'eût dit, que je dusse un jour discourir
en philosophe dans l'Académie; et cependant je crains fort qu'en
voulant le contenter, je vous ennuie. – Au moins ce ne serait point
moi, lui dis-je, moi qui vous ai fait cette prière. Quintus et
Pomponius ayant témoigné le même désir, Pison commença à parler. Je
vous prie, Brutus, de voir s'il a bien rendu toute l'opinion
d'Antiochus, dont il me semble que vous approuvez fort la doctrine,
vous qui avez si souvent entendu son frère Aristus.
IV. Voici donc ce que dit Pison. Je viens de toucher suffisamment en
peu de mots de quelle beauté est la doctrine des Péripatéticiens,
qui se divise comme presque toutes les autres en trois parties. La
première est l'étude de la nature, la seconde renferme la
dialectique, la troisième
586 l'art de la vie. Pour l'étude de la nature, ils l'ont poussée si
loin, qu'à parler poétiquement, il n'est rien dans le ciel, rien
dans la mer ou sur la terre, qui leur ait échappé. Après avoir
traité des principes des choses, et de l'ensemble du monde, de telle
sorte que la plupart de leurs dogmes ne reposent pas seulement sur
des raisons probables, mais sur des démonstrations mathématiques,
ils nous ont encore facilité par leurs recherches la connaissance
des choses les plus cachées. Aristote en parlant de tous les
animaux, a décrit leur naissance, leur manière de vivre, leurs
figures. Théophraste dans ses écrits a traité des diverses sortes de
plantes, et presque de toutes les productions de la terre; il en a
examiné les causes et les lois, et par là aussi il a rendu beaucoup
plus facile l'étude des choses les plus secrètes. Les
Péripatéticiens nous ont donné pareillement d'excellents préceptes
non seulement pour la dialectique, mais encore pour l'art oratoire;
Aristote leur chef nous a enseigné à soutenir le pour et le contre
sur chaque question, non pas comme Arcésilas toujours prêt à
disputer contre quelque proposition que ce fût, mais en faisant
ressortir tout ce qui peut se dire de part et d'autre sur toutes
sortes de matières. En ce qui touche l'art de bien vivre, ils en ont
donné les préceptes non seulement pour la vie privée, mais encore
pour la conduite des États. Les mœurs, les coutumes, les
institutions de presque toutes les villes grecques et même d'un
grand nombre d'États barbares ont été décrites par Aristote;
Théophraste nous en a fait connaître aussi les lois. L'un et l'autre
ayant marqué quel devait être le chef d'une société, et longuement
enseigné quelle est la meilleure forme possible de gouvernement;
Théophraste s'est attaché de plus à montrer quels sont dans les
États les secrets entraînements des choses et la force des
conjonctures, sur lesquelles il faut se régler pour savoir manier
les affaires et les hommes. Le genre de vie qui leur a plu davantage
a été une vie tranquille, tout écoulée dans l'étude et la
méditation; celle de toutes qui approche le plus de la vie des
Dieux, et qui par là est la plus digne du sage. Ils ont exprimé
toute cette doctrine morale dans un langage plein de beautés et de
noblesse.
V. Sur le souverain bien ils ont composé deux sortes de livres. Les
uns écrits simplement et à la portée du peuple (ils les nomment
exotériques), les autres plus profondément raisonnés et qui
n'étaient pas destinés à voir le jour; d'où il résulte qu'ils ne
paraissent pas toujours d'accord avec eux-mêmes: et toutefois, sur
le fond de la doctrine, les auteurs que je viens de nommer sont du
même sentiment, et ne varient jamais. Mais, comme ils cherchent
quelle peut être la félicité de la vie, et agitent cette question
suprême de toute philosophie: Le bonheur dépend-il du sage, ou
peut-il être entamé et même ruiné par la fortune contraire? On peut
dire que leur accord et la fermeté de leurs opinions semblent ici
quelquefois ébranlés. Ce qui y porte surtout atteinte, c'est le
livre de Théophrate, sur la félicité de la vie, où il donne beaucoup
de pouvoir à la fortune; et s'il était vrai qu'elle en eût tant,
certes la sagesse ne pourrait faire le bonheur. C'est une opinion
qui me paraît plus molle et plus faible que la force et la gravité
de la vertu ne le comportent; et par conséquent je crois que, sur la
morale, il faut s'en tenir à Aristote et à Nicomaque son fils. Je
sais bien que les livres excellemment écrits
587 que nous avons sous le nom de
Nicomaque sont attribués à Aristote; mais je ne vois pas pourquoi le
fils n'aurait pu ressembler au père. Quoi qu'il en soit, nous
pouvons aussi recevoir Théophraste en plusieurs choses, pourvu que
nous ayons sur la vertu des sentiments plus fermes et plus virils
que les siens. Mais contentons-nous de ces auteurs. Ceux qui sont
venus ensuite, sont, à mon avis, préférables à tous les philosophes
des autres sectes; mais ils ont tellement dégénéré de leurs maîtres,
qu'ils semblent pour ainsi dire n'être nés que d'eux-mêmes. D'abord,
Straton, disciple de Théophraste, s'est adonné principalement à la
physique, et quoiqu'il y ait réussi, presque tous ses dogmes sont
nouveaux; du reste, il a peu écrit sur les mœurs. Lycon, après lui,
est fleuri et abondant en paroles, mais très maigre d'idées. Son
disciple Ariston a un style agréable et élégant; mais on ne trouve
pas en lui cette gravité requise dans un grand philosophe; ses
livres sont nombreux et écrits avec soin, mais je ne sais pourquoi
il n'a conquis aucune autorité. J'en passe beaucoup d'autres sous
silence, et parmi eux un homme savant et aimable, Hiéronyme, que je
mets, je ne sais trop pourquoi, parmi les Péripatéticiens, lui qui
fait consister le souverain bien dans la privation de la douleur;
puisque c'est être d'un sentiment différent sur toute la philosophie
que de l'être sur le souverain bien. Critolaüs a voulu imiter les
anciens; il approche de leur gravité, quoique son style soit un peu
trop abondant, mais au moins est-il fidèle aux traditions de son
école. Diodore, son disciple, joint à la vertu la privation de la
douleur; de sorte qu'il forme aussi un parti à lui seul, et qu'étant
d'un autre sentiment que les Péripatéticiens sur le souverain bien,
on ne peut le compter parmi eux. Quant à notre Antiochus, il me
semble qu'il remet en honneur avec un grand zèle l'opinion des
anciens, opinion qu'il montre avoir été professée également par
Aristote et Polémon.
VI. Le jeune Lucius a donc raison de vouloir principalement
s'instruire de ce que c'est que le souverain bien. Dès que ce point
fondamental en philosophie est établi, tout le reste l'est
conséquemment. Partout ailleurs, l'oubli ou l'ignorance ne peut
préjudicier qu'à proportion de l'importance du sujet où l'on a
failli; mais ignorer ce que c'est que le souverain bien, c'est
ignorer tout ce qui regarde la conduite de la vie, et arriver par
suite à cette déplorable erreur de ne plus savoir en quel port on
doit se réfugier. Mais lorsqu'on connaît la fin de toutes choses, et
que l'on sait quel est le souverain bien et le souverain mal, on a
découvert dans quelle voie la vie doit s'engager, et comment il faut
en dessiner les devoirs. Il y a donc un terme suprême auquel toutes
choses se rapportent, et qui contient le secret du bonheur si
ardemment désiré par tous les hommes. Et comme sur la nature de ce
terme suprême les opinions sont très partagées, nous devons avoir
recours à la division de Carnéade, dont Antiochus aime à se servir.
Carnéade donc a recherché non seulement combien il y avait
d'opinions différentes parmi les philosophes sur le souverain bien,
mais combien même il pouvait y en avoir. Il commence par affirmer
qu'il n'est aucun art qui se renferme en lui-même, et que tout art a
son objet hors de soi. C'est là une vérité qui n'a pas besoin d'être
éclaircie par des exemples. Car il est évident qu'aucun art ne
588 trouve son objet en soi,
et qu'autre chose est cet objet, autre chose l'art lui-même. Et la
prudence étant l'art de la vie, comme la médecine est l'art de
guérir, et le pilotage l'art de gouverner un vaisseau, il faut
nécessairement que la prudence ait un point de départ et un objet
hors d'elle. Et presque tout le monde est d'accord que l'objet que
la prudence se propose et auquel elle veut parvenir, doit être
convenable et accommodé à la nature, et tel qu'il puisse de lui-même
nous inviter et exciter dans nos âmes cette impulsion que les Grecs
nomment ὁρμὴν. Mais qu'est-ce qui a le don de nous
attirer ainsi et d'être recherché par les premiers vœux de la
nature, voilà ce dont les philosophes ne conviennent pas entre eux
et ce qui cause tout leur dissentiment dans la recherche du
souverain bien. En effet lorsqu'en parlant des vrais biens et des
vrais maux, on veut savoir ce qu'il y a de principal et de suprême
dans les uns et dans les autres, il faut venir à la source des
premiers mouvements et des premières impressions de la nature; et
quand on l'a trouvée, c'est de là que doit découler tout ce qu'on
peut avoir à dire sur le souverain bien et le souverain mal.
VII. Les uns disent que les premiers mouvements de la nature en nous
sont le désir de la volupté, l'aversion de la douleur; les autres,
que notre premier vœu est d'être sans douleur, et notre première
crainte d'éprouver la souffrance. D'autres encore prennent leur
point de départ dans ce qu'ils appellent les premières convenances
de la nature, parmi lesquelles ils comptent l'entière et parfaite
possession de tous nos membres, la santé, l'intégrité des sens;
l'absence de la douleur, les forces, la beauté et tous les autres
avantages du corps; en regard desquelles ils mettent pour l'âme ces
premières impressions morales, qui sont comme des étincelles et des
semences de vertu. Comme de ces trois principes d'impulsion, il en
est un qui certainement a inspiré nos premiers vœux et nos premières
craintes, et comme en dehors de ces trois principes, il n'en est
plus, il faut nécessairement que ce soit à l'un des trois que se
rapporte tout ce que nous avons à rechercher et à éviter dans la
vie, et que par conséquent, la prudence, que nous avons dit être
l'art de bien vivre, se règle sur l'un ou l'autre de ces mobiles,
pour en faire le fondement de toute sa conduite. Après avoir bien
établi quelle est véritablement en nous la première impression de la
nature, elle connaîtra quelle règle de justice et d'honnêteté peut
convenir tellement avec l'un de ces trois principes, qu'il soit
juste et honnête de tout faire, soit en vue de la volupté, quand
même on ne devrait jamais la goûter, soit pour s'affranchir de la
douleur, quand même on n'y parviendrait pas, soit enfin pour
acquérir les premiers biens conformes à la nature, dût-on ne pas les
acquérir; de sorte qu'autant il y a d'opinions différentes sur les
principes naturels, autant il y en a sur ce qui regarde les vrais
biens et les vrais maux. D'autres philosophes encore, partant des
mêmes principes, rapportent tous les devoirs de la vie ou à la
volupté, ou à l'absence de la douleur, ou à l'acquisition des
premiers biens de la nature. Voilà donc six opinions diverses sur le
souverain bien. Les chefs des trois dernières sont: pour la volupté,
Aristippe; pour l'absence de la douleur, Hiéronyme; pour les
premiers biens de la nature,
589 Carnéade, qui sans être l'auteur de ce système, l'a défendu et s'en
est fait une arme de controverse. Des trois premières opinions,
toutes possibles, il n'en est qu'une qui ait été soutenue, mais elle
l'a été avec ardeur. Car, de vouloir que nous agissions sans cesse
en vue de la volupté, quand même nous ne recueillerions aucune
jouissance, de prétendre que ce but est seul désirable et honnête
par lui-même, et que c'est là le bien suprême; c'est un système que
personne ne soutient. On ne trouve non plus aucun partisan de
l'opinion que l'absence de la douleur doive être mise au rang des
choses désirables, quand bien même on ne parviendrait pas à s'en
affranchir. Mais que, de tout faire pour parvenir à ce qui est selon
la nature, quand même on ne réussirait pas, ce soit une règle de
conduite honnête, un but désirable, en un mot le seul bien, c'est ce
que les Stoïciens prétendent.
VIII. Il y a donc six opinions simples sur le souverain bien et le
souverain mal, deux qui ne sont soutenues de personne et quatre qui
ont leurs défenseurs. Quant aux opinions doubles et mêlées,
l'histoire nous en présente trois, et, si on examine bien la nature
des choses, on verra qu'il ne peut y en avoir davantage. On peut
ajouter à la vertu, ou la volupté, comme l'ont fait Calliphon et
Dinomaque; ou l'absence de la douleur, comme Diodore; ou les
premiers biens de la nature, comme les anciens, je veux dire, comme
la double école académique et péripatéticienne. Mais, comme on ne
peut pas tout dire en une fois, il suffira pour le moment de
remarquer qu'il faut exclure la volupté du souverain bien, puisque
nous sommes nés pour quelque chose de plus grand, comme nous le
verrons bientôt. On peut porter sur l'absence de la douleur le même
jugement à peu près que sur la volupté. {L'opinion qui met le
souverain bien dans la volupté et celle qui le met uniquement dans
la vertu ont été suffisamment examinées dans les deux discussions
précédentes, l'une avec Torquatus, l'autre avec Caton; et toutes les
critiques dirigées contre la volupté, tombent à peu près avec la
même force sur l'absence de la douleur.} Et il n'est pas besoin de
chercher d'autres arguments contre le système défendu par Carnéade.
De quelque manière qu'on établisse le souverain bien, dès qu'on n'y
comprend pas l'honnête, on bannit de la vie les devoirs, les vertus
et l'amitié. Quant aux théories qui joignent à ce qui est honnête ou
la volupté, ou l'absence de la douleur, elles déshonorent, pour
ainsi dire, l'honnêteté même qu'elles veulent consacrer; car
rapporter toutes nos actions à des fins, dont l'une permet à l'homme
qui ne souffre pas de dire qu'il est dans le souverain bien, dont
l'autre met en jeu la partie la plus frivole de notre nature, c'est
non seulement obscurcir tout l'éclat de la vertu, c'est la souiller.
Restent maintenant les Stoïciens, qui, ayant pris toutes leurs
opinions des Péripatéticiens et des Académiciens, ont exprimé les
mêmes sentiments sous d'autres termes. Il serait peut-être à propos
de réfuter en particulier chacune des opinions que j'ai marquées;
mais poursuivons notre premier dessein; nous pourrons, quand nous le
voudrons, essayer de la controverse. Quant à la sécurité de
Démocrite, qui n'est autre que cette tranquillité d'âme que les
Grecs appellent εὐθυμίαν, il faut la mettre hors de
cause dans le sujet qui nous occupe; parce que cette tranquillité de
l'âme n'est rien moins que le bonheur lui-même et que nous ne
cherchons pas ce que c'est que le bonheur, mais d'où il vient. En ce
qui tou- 590 che les opinions
de Pyrrhon, d'Ariston, d'Hérille, abandonnées et mortes depuis si
longtemps, comme elles ne peuvent rentrer dans le cercle que nous
avons tracé, elles n'auraient jamais dû voir le jour. Car tout le
système des vrais biens et des vrais maux étant fondé sur ce que
nous avons dit être propre et convenable à la nature et sur ses
premiers vœux, ce fondement est ruiné par ceux qui prétendent que,
parmi les choses où l'on ne voit rien d'honnête ni de honteux, il
n'est aucun motif de préférer les unes aux autres, et qui suppriment
absolument toute distinction entre elles. Hérille aussi en soutenant
qu'il n'est d'autre bien que la science, met l'homme dans
l'impossibilité de s'orienter en ce monde, de comprendre et de
remplir ses devoirs. Comme donc il ne peut y avoir d'autre opinion
sur le souverain bien que celles que nous avons dites, il faut
nécessairement que toutes les autres étant convaincues d'erreur,
celle des anciens, que je propose, soit la véritable. A leur
exemple, et comme ont fait depuis les Stoïciens, je vais reprendre
les choses à l'origine.
IX. Tout animal s'aime naturellement lui-même, et dès qu'il est né,
il tend à sa conservation, parce que le premier désir que la nature
lui donne, c'est de se conserver et de se mettre dans le meilleur
état où, selon sa nature, il puisse être; ce désir est d'abord
obscur et confus. Il veut se conserver tel qu'il est, mais il ne
sait encore ni ce qu'il est, ni ce qu'il peut, ni ce qu'est sa
propre nature. Quand il est un peu plus avancé, et qu'il commence à
voir comment chaque chose l'affecte et l'intéresse, il vient alors à
faire insensiblement de nouveaux progrès, à se connaître lui-même et
à comprendre pourquoi la nature lui a donné cette première impulsion
dont nous parlions; alors enfin il se porte de lui-même à rechercher
ce qu'il sent être conforme à sa nature, à fuir ce qui lui est
contraire. Ainsi ce que tout animal désire, c'est précisément ce qui
est en harmonie avec sa nature, et par conséquent son bien souverain
doit être de vivre selon la nature, dans l'état le plus parfait où
naturellement il puisse atteindre. Or comme chaque animal a sa
nature qui lui est particulière, il faut nécessairement que chacun
tende à la perfection de sa propre nature. Rien n'empêche cependant
qu'il y ait quelques biens communs entre les diverses espèces
d'animaux, d'un côté et de l'autre, entre les bêtes et l'homme. Mais
le bien souverain et dernier que nous cherchons, est varié et
distinct pour chacune des espèces, approprié toujours et partout aux
vœux les plus importants de la nature. C'est pourquoi, quand nous
disons que le souverain bien de tous les animaux est de vivre selon
la nature, on ne doit pas croire que nous prétendions qu'ils ont
tous un même et unique bien souverain; mais de même que l'on peut
dire véritablement que tous les arts ont ce trait commun de se
rapporter à quelque science, mais que chacun d'eux se rapporte à une
science particulière, ainsi nulle contradiction à prétendre que le
but commun de toute créature vivante est de vivre selon la nature,
mais que la nature varie suivant les espèces; le cheval n'étant pas
le bœuf, la bête n'étant pas l'homme, quoique cependant le but
dernier de toutes les actions soit le même non seulement pour les
animaux, mais pour tous les êtres que la nature produit, développe
et con- 591 serve. Nous
voyons, par exemple que les plantes font en quelque sorte
d'elles-mêmes tout ce qu'il faut pour vivre, pour croître, et pour
parvenir, chacune dans son espèce, au meilleur état qu'elles
puissent atteindre. De sorte que je ne fais point difficulté de
comprendre tout sous une même proposition, et de dire que la nature
tend sans cesse et partout à sa conservation; que ce qu'elle se
propose comme sa fin principale, c'est de maintenir chaque espèce
dans l'état le plus parfait; qu'ainsi le but de tous les êtres
auxquels elle a donné quelque sorte de vie, est semblable quoiqu'il
ne soit pas le même. D'où nous devons conclure que le souverain bien
de l'homme est de vivre selon la nature, c'est-à-dire, si nous
l'entendons bien, de donner à la nature humaine toute la perfection
et la plénitude qu'elle comporte. Voilà ce que nous avons maintenant
à développer; et, si j'entre dans trop de détails; vous me le
pardonnerez; car il faut que je m'accommode à l'âge de Lucius, qui
peut-être entend parler de tout ceci pour la première fois. – Vous
avez raison, lui dis-je; quoique tout ce que nous avons entendu
jusqu'ici puisse fort bien convenir à des auditeurs de tous les
âges.
X. Après avoir exposé, reprit Pison, à quoi se réduisent tous les
vœux de la nature, il faut maintenant faire voir d'où vient qu'ils
ont tous ainsi un objet commun. Dans ce dessein, retournons d'abord
à ce que nous avons posé pour premier principe, d'accord en cela
avec la réalité, qui nous montre que tout animal s'aime
naturellement lui-même. Quoique ce sentiment ne puisse être révoqué
en doute, puisqu'il est gravé dans la nature de chacun, inévitable,
manifeste, éclatant, de telle sorte que, si quelqu'un voulait le
combattre ou le nier, on ne l'écouterait pas; cependant, pour ne
manquer à rien, je crois qu'il est à propos de montrer sur quelles
raisons cette première proposition est fondée. Peut-on comprendre,
peut-on imaginer, je vous le demande, qu'un être animé se haïsse
lui-même? Mais c'est une contradiction flagrante! car, lorsque
l'impulsion d'un tel être le porterait vers quelque chose de
préjudiciable, parce qu'il se haïrait, comme ce serait pour lui
qu'il s'y porterait, il faudrait qu'il se haït et s'aimât en même
temps, ce qui est impossible. Il faudrait aussi que celui qui serait
ennemi de lui-même, regardât comme mauvais ce qui est bon et comme
bon ce qui est mauvais; qu'il eût soin de fuir ce qui est désirable
et de rechercher ce qui est à fuir; et n'est-ce pas là un entier
renversement de la vie? On trouve, il est vrai, des gens qui
recourent au lacet ou à tout autre instrument de mort; on voit, dans
Térence, Ménédème s'imaginer “qu'il sera un peu moins injuste envers
son fils, s'il se rend malheureux”, mais il ne faut pas croire que
de telles gens se haïssent. Les uns se laissent aller à la douleur,
les autres à une folle passion; le plus grand nombre est emporté par
une colère aveugle; et, lors même qu'ils se jettent de propos
délibéré dans quelque malheur extrême, ils ne laissent pas de
prétendre que ce qu'ils font leur convient parfaitement, de sorte
qu'ils n'hésitent point à dire:
“C'est ainsi que je vis, vivez à votre mode,”
comme s'ils s'étaient déclaré la guerre, et qu'ils eussent décidé de
passer les jours et les nuits à s'affliger, à se torturer. Mais
cependant ils ne devraient pas se plaindre et s'accuser eux-mêmes de
592 leur mauvaise fortune; car
cette douleur ne convient qu'aux gens qui s'aiment et ont à cœur
leurs propres intérêts. Ainsi toutes les fois qu'on dit qu'un homme
se traite durement lui-même et qu'il est son propre ennemi, enfin
qu'il a la vie en horreur, on peut hardiment soupçonner qu'il y a en
lui quelque ressort secret qui vient de l'amour de soi-même. Ce
n'est pas assez de reconnaître que personne ne se hait, il faut
comprendre aussi que personne ne peut être indifférent à son propre
sort; car s'il était possible qu'on eût pour toutes les affections
que l'on éprouve la même indifférence que l'on témoigne avec raison
pour certaines choses qui ne méritent pas de nous émouvoir, tout
désir alors serait éteint et anéanti dans l'homme.
XI. II n'y aurait pas moins d'absurdité à dire que l'amour que
chacun a pour soi se rapporte à quelque autre objet différent de la
personne qui s'aime. Lorsque l'on prétend que ce n'est pas à nous
que se rapportent nos amitiés, nos devoirs, nos vertus, il n'y a là
rien qu'on ne puisse comprendre; mais lorsqu'il est question de
l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, on ne peut pas même
entendre comment ce ne serait pas à nous qu'il s'adresserait
entièrement. Car, par exemple, ce n'est point pour l'amour de la
volupté qu'on s'aime; c'est pour l'amour de soi qu'on aime la
volupté. Enfin comment pourrait-on douter que tout homme ne se soit
cher et extrêmement cher à lui-même? En est-il beaucoup, en est-il
un seul qui, à l'approche de la mort, “ne sente refluer son sang
dans les veines, et ne pâlisse de crainte?” Il est vrai que c'est
une faiblesse coupable d'avoir trop d'horreur pour la dissolution de
son être, comme d'avoir trop d'aversion pour la douleur; mais tout
le monde ressentant à peu près le même effroi, c'est une preuve que
la crainte de la mort est naturelle; et même la frayeur excessive
qu'en ont quelques gens, sert à marquer que, puisqu'elle est si
grande en eux, il faut du moins que la nature nous y ait disposés
dans une certaine mesure. Je ne parle point ici de ceux qui
craignent la mort parce qu'ils s'imaginent qu'ils seront alors
privés des commodités de la vie, ou parce qu'ils redoutent quelque
avenir effrayant par delà le tombeau, ou parce qu'enfin ils
appréhendent de mourir avec douleur; les enfants mêmes, à qui rien
de tout cela ne passe par l'esprit, lorsqu'en badinant on les menace
de les jeter de haut en bas, se mettent à trembler; et les bêtes,
dit Pacuvius, “qui n'ont point cette finesse d'esprit, source de la
prévoyance,” la terreur de la mort les fait frémir. Peut-on même
penser que le sage, quoique déterminé à mourir, ne soit pas touché
de se séparer des siens et d'abandonner la lumière? Où la force de
la nature se reconnaît le mieux dans cette aversion de la mort,
c'est quand on voit des gens réduits à l'indigence s'attacher à la
vie; des hommes cassés de vieillesse qui ont horreur des approches
de la mort; d'autres qui endurent les plus terribles tourments,
comme Philoctète qui, au milieu de souffrances intolérables
prolongeait sa vie en perçant les oiseaux de ses flèches, ainsi que
le dit Attius, “Il se traîne, il s'arrête, et les rapides habitants
de l'air tombent sous ses coups.” Et il se fait un vêtement du
593 tissu de leurs plumes. Ce que
je viens de dire des hommes et des autres animaux, arrive presque de
même dans les arbres et dans les plantes, soit qu'une puissance
supérieure et divine, comme de très grands esprits l'ont pensé, leur
aient imprimé cette tendance invincible, soit qu'il n'y ait ici en
jeu d'autre puissance que le hasard. Voyez comment tous les fruits
de la terre sont conservés et protégés par leurs racines et leurs
écorces, tandis que les animaux trouvent les mêmes secours dans la
distribution de leurs sens et dans toute l'économie de leur
organisation. Et, bien que je sois de l'opinion de ceux qui pensent
que tout cela est gouverné par la nature, et que sans elle et sa
prévoyance, rien au monde ne pourrait subsister, je laisse pourtant
à chacun la liberté d'en croire ce qu'il voudra; pourvu que l'on se
souvienne que toutes les fois que je dis la nature de l'homme,
j'entends toujours l'homme même, n'y ayant aucune différence à faire
entre l'un et l'autre, et chacun pouvant plutôt se séparer de
lui-même, que de perdre le désir des choses qui servent à sa
conservation. C'est donc à bon droit que les plus grands philosophes
ont cherché dans la nature le principe du souverain bien, et qu'ils
ont cru que le désir des choses conformes à la nature était inné
dans tous les êtres soumis à cette impulsion féconde par laquelle on
s'aime naturellement soi-même.
XII. Après avoir montré avec la dernière évidence que tout être est
naturellement cher à lui-même, il faut maintenant examiner quelle
est la nature de l'homme; c'est là le point essentiel de nos
recherches. Or il est manifeste que l'homme est composé d'âme et de
corps, que l'âme est ce qu'il y a de principal en lui, et que le
corps ne fait que le second personnage. Il est constant aussi que le
corps de l'homme est formé de telle sorte qu'il excelle sur tous les
autres, et que l'âme, outre qu'elle préside à la fonction des sens,
est douée d'une intelligence qui l'ennoblit et à laquelle toute la
nature de l'homme doit obéir. Dans cette intelligence brille une
force et une propriété merveilleuse pour le raisonnement, pour la
connaissance, la science et toutes les vertus. Comme le corps de
l'homme, quoique incomparablement au-dessous de l'âme, est beaucoup
plus facile à connaître, commençons par ce qui le regarde. On voit
assez combien toute l'organisation en est entendue; comment tout en
lui figure, conformation, stature, est en harmonie avec la nature de
l'homme. Le front, les yeux, tous ces organes délicats, ne sont-ils
pas visiblement appropriés à notre condition humaine? Mais ce n'est
pas assez; la nature qui nous a donné tous ces membres, veut qu'ils
soient conservés sains et entiers, avec le libre usage des
mouvements qui leur sont propres, et qu'il n'y en-ait aucun de
souffrant ni perclus. Il y a même des manières de se mouvoir et de
se tenir tellement conformes à la nature, que si l'on voyait des
contorsions ou des bizarreries monstrueuses, comme de marcher sur
les mains, ou d'aller à reculons, il semblerait que ce serait, en
quelque façon, se fuir soi-même, dépouiller l'homme de la nature
humaine, et avoir cette nature en aversion: c'est pourquoi certaines
contenances et certaines postures indécentes, certaines démarches
nonchalantes, affectées, comme celle des effrontés ou des efféminés,
sont contre la nature, qui semble par là toute
594 changée à l'égard du corps,
quoique ce soit une dépravation qui ne vienne que de l'esprit; au
lieu que tout ce que l'on voit de réglé et de bienséant dans la
contenance, dans la posture, le mouvement et la démarche parait
convenable et selon la nature. Quant à l'âme, il ne suffit pas non
plus qu'elle se conserve, il faut qu'elle vive de telle sorte que
toutes ses facultés soient heureusement développées et qu'il ne lui
manque aucune vertu. Les sens ont chacun leur propriété, et leur
perfection consiste à n'être empêchés par aucun obstacle de remplir
les fonctions qui les regardent et de percevoir nettement et
promptement leurs objets.
XIII. L'âme, et surtout cette partie principale de l'âme qu'on
appelle l'esprit, a plusieurs vertus qui se divisent en deux genres;
les unes nous sont données par la nature, et on les nomme
involontaires; les autres ont leur principe dans la volonté et sont
appelées plus particulièrement vertus; c'est en elles que se trouve
le plus beau titre d'excellence de l'âme humaine. Dans le premier
genre, on met la facilité de concevoir, la mémoire, et l'on comprend
d'ordinaire toutes les qualités naturelles sous le nom d'esprit, et
celui qui les possède est appelé homme d'esprit. L'autre genre
comprend les grandes et véritables vertus, filles de notre liberté,
telles que la prudence, la tempérance, la force, la justice, et les
autres de même nature. Voilà succinctement ce que j'avais à dire du
corps et de l'âme, en quoi consiste tout ce qui appartient à la
nature de l'homme. Puisqu'il est donc indubitable que nous nous
aimons nous-mêmes et que nous voulons que tout ce qui est de nous
soit accompli, il est impossible que tout ce qui regarde notre âme
et notre corps ne nous soit cher par lui-même, et ne soit d'une
extrême considération pour la félicité de la vie. Car celui qui veut
se conserver, doit nécessairement vouloir aussi conserver toutes les
parties dont il est composé, et il faut qu'il les aime d'autant plus
ardemment qu'elles sont plus parfaites et plus estimables dans leur
genre; et comme une vie accompagnée de tous les avantages de l'âme
et du corps, est celle qu'on souhaite, il est infaillible que c'est
en cela que consiste le souverain bien, puisque le souverain bien
doit être tel, que hors de lui, il n'y ait plus rien à souhaiter.
Ainsi l'homme étant naturellement cher à lui-même, on ne peut pas
douter que toutes les parties de son âme et de son corps et toutes
les choses qui en concernent les fonctions ne lui soient
pareillement chères par elles-mêmes et à rechercher pour leur propre
mérite. Ces principes établis, il est facile de concevoir, que ce
qui doit surtout appeler nos soins, c'est ce qu'il y a de plus
excellent en nous, et que le premier objet de nos vœux, ce doit être
la perfection de la plus noble partie de notre être. Par là nous
préférerons les avantages de l'âme à ceux du corps, et les qualités
naturelles de l'âme le cèderont aux vertus libres, qui sont
proprement les véritables vertus, et qui l'emportent de beaucoup sur
les autres, comme étant l'ouvrage de la raison, le plus divin
attribut de l'homme. Pour toutes les espèces que la nature engendre
et conserve, et qui sont sans âme, ou peu s'en faut, le souverain
bien est uniquement dans le corps, de sorte qu'en parlant du
pourceau, on n'a pas mal dit que la nature lui avait donné une sorte
d'âme au lieu de sel, pour l'empêcher de pourrir.
595
XIV. Il y a pourtant des bêtes qui ont en elles quelque chose de
semblable à la vertu, comme les lions, les chiens, les chevaux, dans
lesquels nous ne voyons pas seulement des mouvements corporels comme
chez les pourceaux, mais de certains élans qui semblent partir de
l'âme. A l'égard de l'homme, ce qu'il y a de principal en lui c'est
l'âme, et dans l'âme, la raison; c'est de la raison que vient la
vertu, qu'on définit l'accomplissement de la raison; ce qui demande
d'être amplement éclairci. Il y a aussi dans toutes les choses que
la terre produit une espèce d'éducation et de perfection qui ne
diffère pas beaucoup de ce que l'on voit dans les animaux. C'est
ainsi qu'en parlant d'un plant de vigne, nous disons qu'il se porte
bien, ou qu'il se meurt, et en parlant d'un arbre nouvellement ou
anciennement planté, qu'il est dans sa force, ou qu'il vieillit. De
sorte qu'il n'est pas étrange qu'on attribue aux arbres et aux
plantes, ainsi qu'à tous les animaux, certaines choses comme
conformes à leur nature, et d'autres comme contraires; et que, pour
les élever et les faire croître, il y ait un art particulier, celui
de l'agriculture, par lequel on a soin de les tailler, de les
former, de les redresser, de les soutenir et les faire parvenir
jusqu'où leur nature peut aller. La vigne même, si elle pouvait
parler, dirait qu'il faut la soigner et la cultiver ainsi. Mais
remarquons, puisque j'en suis venu à parler de la vigne, que tout ce
qui sert à la conserver, lui vient du dehors; en elle-même, elle ne
trouverait guère de ressources pour se développer et mûrir, si on
n'avait soin de la cultiver. Mais s'il lui survenait quelque
sensation, quelque désir, et qu'elle pût avoir un mouvement
intérieur qui lui fût propre, que croyez-vous qu'elle fit? Vous
imaginez-vous qu'elle se contenterait de se cultiver elle-même,
comme le vigneron la cultivait auparavant, ou plutôt n'aurait-elle
pas soin aussi des sens qui lui seraient survenus; ne
veillerait-elle pas à leurs besoins, à ceux de ses membres nouveaux?
Ainsi à ce qui lui a toujours appartenu, elle unira intimement ce
qu'elle aura acquis de nouveau; et il ne lui suffira pas d'avoir
pour elle le même but que le vigneron avait naguère; elle voudra de
plus pouvoir vivre conformément à la nature qui lui est survenue.
L'objet qu'elle se proposera pour son bien sera semblable à celui
qu'avait le vigneron, mais il ne sera pas le même, parce que ce ne
sera plus le bien d'une plante, mais celui d'un animal qu'elle
recherchera. Supposons maintenant que ce n'est pas seulement la vie
animale, mais l'âme humaine qui est survenue dans cette plante, ne
faudra-t-il pas qu'elle continue à prendre soin de tout ce qu'elle
avait en premier lieu; qu'elle cultive bien plus soigneusement
encore les nouvelles parties qu'elle a acquises; que ce qu'il y a de
plus excellent dans l'âme, et surtout l'intelligence et la raison,
la gloire de l'âme humaine, lui devienne plus chère que tout le
reste; et qu'elle mette enfin son souverain bien dans la complète
perfection de sa nature? C'est ainsi que des premières impulsions de
la nature, à prendre les choses à leur source, on s'élève par degrés
au désir du souverain bien, qui est à son comble par l'intégrité du
corps et la parfaite raison de l'âme.
XV. Ainsi donc la nature humaine étant telle que nous l'avons
exposé, si chacun, comme je l'ai dit en commençant, pouvait se
connaître dès qu'il est né et remarquer en lui-même la di-
596 gnité de sa nature en
général, et l'importance de chacune de ses parties, il découvrirait
aussitôt ce que nous cherchons maintenant, je veux dire, ce qu'il y
a de plus accompli et de meilleur à se proposer, et jamais il ne
ferait de faute dans sa vie. Mais la nature dans notre enfance est
si prodigieusement enveloppée, qu'alors on ne la peut ni bien
démêler, ni connaître. Ce n'est que peu à peu, avec le temps, et
quelquefois même fort tard que nous ouvrons les yeux sur nous-mêmes.
Ce premier sentiment que la nature imprime en nous est obscur et
vague, et le premier désir qu'elle nous donne, ne va qu'à nous
conserver tels que nous naissons. Dans la suite, quand nous venons à
nous apercevoir de ce que nous sommes, et de la différence qu'il y a
entre nous et le reste des animaux, nous nous attachons alors aux
choses pour lesquelles nous sommes nés. Il en est à peu près de même
des bêtes; d'abord elles ne bougent de l'endroit où elles naissent;
et puis chacune se meut différemment selon l'instinct particulier de
sa nature. Les serpents rampent, les canards nagent, les merles
s'envolent, les bœufs se servent de leurs cornes, les scorpions de
leur aiguillon; enfin chaque bête suit son propre instinct, ce guide
naturel de tout ce qui respire.
Telle est aussi l'histoire de l'homme. On dirait des enfants gisant
dans leur berceau, qu'ils n'ont point d'âme. Quand ils commencent à
avoir un peu de force, ils commencent aussi à faire quelque usage de
leur esprit et de leurs sens; ils tâchent de se tenir debout, ils se
servent de leurs mains, et reconnaissent les personnes qui les
élèvent. Plus tard ils se plaisent avec les enfants du même âge; ils
s'assemblent volontiers en troupe et se prêtent de tout cœur à
former des jeux; ils sont ravis d'entendre des fables, ils donnent
volontiers à leurs compagnons ce qu'ils ont de trop. Ils prennent
curieusement garde à tout ce qu'on fait au logis; ils commencent à
inventer, et à apprendre; ils veulent savoir les noms de ceux qu'ils
voient. Si dans leurs luttes avec leurs égaux ils sont victorieux,
ils ne se sentent pas de joie; s'ils sont vaincus, ils sont tristes
et abattus. Et ce n'est point sans fondement que tout se passe de la
sorte dans ces jeunes esprits. Car dans la nature de l'homme on
trouve une disposition secrète et profonde à recevoir toutes les
vertus; c'est ce qui fait que les enfants, sans aucun autre
enseignement que celui de la nature, se sentent excités par les
apparences des vertus dont ils portent en eux les semences. Ce sont
là comme les premiers éléments de la nature; ces germes se
développent, et l'œuvre de la vertu s'accomplit. Nous sommes nés et
faits de telle sorte que nous avons en nous certains principes
d'activité, d'amitié, de libéralité, de reconnaissance, et que notre
esprit est capable de science, de prudence et de force, en même
temps qu'il éprouve de l'aversion pour l'ignorance et la faiblesse
C'est ce qui explique ces étincelles de vertu, que nous voyons dans
les enfants, étincelles où doit s'allumer pour le philosophe le
flambeau de la raison qui nous guidera comme une divinité dans toute
notre vie, et nous fera parvenir à la perfection de notre nature.
Or, comme je l'ai dit souvent, dans la faiblesse de l'âge et
l'imbécillité de l'âme, ce n'est qu'à travers un nuage qu'on peut
entrevoir le vrai génie de sa nature; mais quand l'âme se développe
et se fortifie, elle arrive enfin à voir clair dans cette nature
qu'elle trouve tout ébauchée, mais dont elle peut porter
l'excellence beaucoup plus loin.
597 XVI. Il faut donc pénétrer dans les secrets de la nature et tâcher
d'approfondir ce qu'elle demande; autrement nous ne pouvons nous
connaître nous-mêmes, et pratiquer ce précepte qui a paru si fort
au-dessus de l'esprit humain, que l'antiquité l'a attribué à un
Dieu. Apollon Pythien nous ordonne donc de nous connaître nous-même.
Cette connaissance consiste uniquement à bien entendre la nature de
notre âme et de notre corps, afin que nous puissions suivre un genre
de vie qui nous mette en possession de tous les biens faits pour
nous. Or comme notre vœu le plus ardent a toujours eu pour objet la
perfection accomplie de notre nature, il est certain que quand ce
vœu est rempli, la nature s'arrête là comme au dernier terme de ses
efforts, et que nous jouissons du souverain bien. Ce bien suprême et
complet doit nécessairement être recherché pour lui-même, puisque
nous avons montré que chacune des parties qui le composent mérite
d'être recherchée pour sa valeur propre. Si, dans l'énumération que
j'ai faite des avantages du corps, quelqu'un s'imagine que j'ai omis
la volupté, c'est une question à remettre à une autre fois. Que la
volupté doive en effet être ou non comptée parmi les objets des
premiers vœux de la nature, c'est ce qui n'intéresse en rien la
recherche qui nous occupe. Car si la volupté, comme je le crois,
n'est pas un complément des biens de la nature, j'ai eu raison de
n'en point parler; s'il faut voir en elle un de ces biens, comme
quelques philosophes le veulent, ce que nous avons établi sur le
souverain bien n'en est pas moins parfaitement vrai. Car si l'on
joint la volupté aux avantages naturels que nous avons reconnus, ce
sera y ajouter un simple avantage du corps, ce qui ne donne aucune
atteinte à la définition du souverain bien telle que je l'ai
exposée.
XVII. Jusqu'ici toute la suite de mes considérations repose sur la
première impulsion que nous recevons de la nature. Je me propose
maintenant de prouver par un autre ordre d'arguments, que ce n'est
pas seulement parce que nous nous aimons nous-mêmes que nous nous
portons avec tant de zèle à la conservation de toutes les parties de
notre âme et de notre corps, mais parce que dans chacune de ces
parties il y a une force et une vertu qui nous poussent. Et pour
commencer par le corps, quand les hommes ont quelque vice de
conformation, quand ils sont estropiés ou privés de quelques
membres, remarquez-vous avec quel soin ils tâchent de cacher leur
infirmité; combien ils se donnent de peine pour faire, ou qu'il n'y
paraisse point ou qu'il y paraisse le moins possible, et à combien
même de douleurs ils s'exposent pour y apporter quelque remède?
En
sorte que quand l'usage du membre affligé devrait en devenir moins
libre, ils ne laissent pas autant qu'ils peuvent, de vouloir lui
faire reprendre sa forme et sa situation naturelle. Car tous les
hommes, par un sentiment indestructible, et seulement en pensant à
eux-mêmes, voulant se conserver dans toute l'intégrité de leur
nature, il faut nécessairement que chacune des parties dont ils sont
composés mérite pour elle-même une partie de ce soin que l'on donne
au tout. Ne semble-t-il pas même que la nature demande de nous une
attention particulière à ce qui regarde l'attitude et les mouvements
du corps, à notre démarche, à notre posture, au port de notre tête,
à 598 la composition de notre
physionomie? En tout cela n'y a-t-il rien qui soit convenable à un
honnête homme, ou indigne de lui? Et ne trouvons-nous pas haïssables
ceux qui dans leurs mouvements et leur contenance, semblent en
quelque façon mépriser la loi de la nature? Et puisqu'on proscrit
tout ce qui blesse ainsi la bienséance, pourquoi n'admettrait-on pas
que l'on doive estimer la beauté pour elle-même? Si la difformité du
corps et la mutilation des membres sont des objets de légitime
aversion, pourquoi ne pas déclarer et à plus forte raison encore que
l'élégance et la grâce sont pour l'homme d'un prix véritable?
Et si
nous croyons que dans la contenance et les mouvements du corps, il
faut éviter tout ce qui est honteux, pourquoi ne pas reconnaître
qu'il faut rechercher la beauté? La santé, les forces, l'absence de
la douleur méritent aussi d'être estimées non seulement pour leur
utilité, mais pour elles-mêmes. Car puisque la nature veut être
accomplie de tous points, il faut qu'elle aspire à la condition
physique qui est le plus parfaitement dans ses convenances; et
certainement notre nature éprouve une perturbation générale, lorsque
le corps est débile, malade ou frappé de douleur.
XVIII. Jetons maintenant un regard sur l'âme dont les diverses
parties sont beaucoup plus nobles, et nous font d'autant mieux
connaître le génie de notre nature, qu'elles sont fort au-dessus de
celles du corps. L'homme naît avec une si forte passion d'apprendre
et de savoir, qu'on ne peut nier que sa nature ne soit entraînée
vers la science, sans aucune vue d'utilité. Ne voyons-nous pas
quelquefois qu'on ne peut pas même par le châtiment empêcher les
enfants d'être curieux et les détourner de leurs investigations?
Ne
voyons-nous pas comme ils reviennent à la charge quand on les a
rebutés, comme ils sont ravis d'apprendre et heureux de raconter,
comme ils sont attachés aux jeux, aux pompes et aux spectacles,
jusques à en souffrir la faim et la soif? Quant aux hommes qui
cultivent les arts et les études libérales, ne s'y plaisent-ils pas
quelquefois de telle sorte qu'ils en négligent leur santé et leurs
affaires; et ne les voyons-nous pas souffrir les plus dures
incommodités pour se livrer à leurs travaux favoris? Labeurs,
soucis, tourments, tout est pour eux compensé par le plaisir qu'ils
trouvent à apprendre. Il me semble qu'Homère a feint quelque charme
de cette nature dans le chant des sirènes. Car il ne paraît pas que
ce fût par la douceur de leur voix, ou par la nouveauté et la
variété de leurs chants qu'elles eussent le pouvoir d'attirer les
navigateurs à leur écueil: mais elles se vantaient d'une science
merveilleuse, et l'espoir d'y participer poussait les infortunés à
leur ruine. Au moins c'est par là qu'elles invitent Ulysse dans ce
passage d'Homère que j'ai traduit ainsi que plusieurs autres:
“Ulysse, l'honneur de la Grèce, dirige vers nous ton vaisseau, et
viens prêter l'oreille à nos chants. Jamais le nautonnier n'a fui
loin de nous sur ces flots azurés, sans avoir suspendu sa course au
doux bruit de nos voix qui le charmaient; l'esprit tout plein de nos
doctes merveilles, enrichi du trésor des Muses, il revit enfin les
rives de sa patrie. Nous savons les grands combats que les Grecs,
par la volonté des Dieux, ont livrés dans les champs d'Ilion, nous
en connaissons l'issue fameuse; rien ne nous échappe de tout ce qui
arrive dans ce vaste univers”.
Homère vit bien qu'il n'y aurait aucune vraisemblance dans sa fable
s'il représentait un aussi
599 grand homme qu'Ulysse, séduit par des chansons. Elles lui promettent
la science, qu'il n'était pas étonnant qu'un homme amoureux de la
sagesse préférât à sa patrie. Et véritablement si l'on peut dire que
l'envie déréglée de tout connaître indistinctement témoigne d'une
vaine curiosité d'esprit, il faut avouer que l'amour de la science
inspiré par le désir de s'élever aux vérités les plus sublimes,
n'appartient en ce monde qu'aux grands hommes.
XIX. Quelle ardeur et quelle application à l'étude n'était pas celle
d'Archimède, qui, traçant dés figures sur le sable, ne s'aperçoit
pas même que Syracuse est prise? Aristoxène n'épuisa-t-il pas tout
son grand esprit dans l'étude de la musique? Quel goût pour les
lettres que celui d'Aristophane passant à les cultiver sa vie
entière? Que dire de Pythagore, de Platon et de Démocrite, que le
désir d'apprendre engagea dans de si lointains voyages? Ceux qui ne
comprennent pas la force de cette passion, n'ont jamais rien aimé
qui fût digne d'occuper nos esprits. Ceux qui disent qu'on ne
s'attache à l'étude de la science qu'à cause de la volupté que
l'esprit en reçoit, ne prennent pas garde que ce qui fait
précisément toute l'excellence de cette étude, c'est qu'on s'y porte
sans aucune vue d'utilité, et qu'on trouve son contentement dans la
science, à quelque prix qu'il faille l'acheter. Mais à quoi bon
s'étendre davantage sur des faits si manifestes? Demandons-nous à
nous-mêmes à quel point nous sommes touchés, quand nous observons le
mouvement des étoiles, quand nous contemplons toutes les révolutions
célestes ou que nous pénétrons dans les mystères de la nature. Quel
charme ne trouvons-nous pas dans la lecture de l'histoire? Ne
sont-ce pas là des livres que nous poursuivons jusqu'au bout,
revenant sur nos pas, comblant les lacunes, épuisant les sujets? Il
est vrai qu'il n'y a pas moins d'utilité que d'agrément dans la
lecture de l'histoire; mais ne lisons-nous pas aussi avec plaisir de
pures fables dont nous ne pouvons tirer aucune utilité? Et quand
nous lisons la vie des grands hommes, ne nous plaisons-nous pas à
nous informer de leurs noms, de leurs parents, de leur patrie, et
d'une foule de détails qui ne nous importent en rien? Les gens même
qui sont dans une fortune si basse qu'elle ne leur permet pas de
pouvoir jamais parvenir aux affaires, tous jusqu'aux artisans ne
prennent-ils pas plaisir à lire l'histoire; et ne voyons-nous pas
que ce sont surtout des gens cassés de vieillesse et dont le rôle
est joué, qui aiment à entendre ou à lire le récit de ce qui s'est
fait autrefois? C'est pourquoi il faut absolument que, dans les
choses mêmes qu'on apprend, il y ait un attrait qui nous invite à
les connaître. Aussi les anciens philosophes voulant donner une idée
de la vie des sages dans les îles fortunées, ont feint que, délivrés
de tous soins, et sans se mettre en peine des nécessités du corps,
ils ne faisaient autre chose que d'employer tout le temps à méditer,
à apprendre, à pénétrer dans les secrets de la nature. Mais nous
autres mortels nous voyons que cette occupation divine n'est pas
seulement le charme inépuisable d'une vie de félicité, mais encore
le soulagement de nos misères. Combien d'hommes, les uns tombés
entre les mains de leurs ennemis, les autres au pouvoir des tyrans,
ceux-ci dans les fers, ceux-là dans l'exil, n'ont trouvé
d'adoucissement à leurs peines que dans
600 l'étude? Le maitre d'Athènes, Démétrius de Phalère,
banni injustement de sa patrie, se retira à Alexandrie, auprès du
roi Ptolémée; et comme il avait été disciple de Théophraste, et
qu'il excellait dans cette philosophie, que je vous exhorte à
cultiver, Lucius, il écrivit dans le malheur de son exil un grand
nombre de fort beaux ouvrages, non pour sa propre utilité, puisqu'il
ne lui était plus permis d'appliquer ses préceptes, mais parce que
cette culture de son esprit était en quelque sorte pour lui le pain
de sa vie morale. Je me souviens d'avoir ouï dire souvent à Cn.
Aufidius, très savant homme, qui avait été préteur, et qui était
devenu aveugle, que ce qui le désolait surtout dans son infortune,
c'était de ne pouvoir plus jouir de la lumière. Enfin si le sommeil
n'était absolument nécessaire pour le repos du corps, et pour donner
quelque relâche à nos peines, nous le regarderions comme contraire à
la nature; car il assoupit les sens, et nous ôte toute activité. Il
serait à souhaiter que la nature pût se passer de repos, ou réparer
autrement ses forces; puisque souvent même nos devoirs, nos travaux,
nos études, nous entraînent à des veilles qui semblent contraires à
la nature.
XX. On voit dans toutes les classes d'animaux, mais surtout dans
l'homme, des marques certaines, frappantes, incontestables, de ce
besoin qu'éprouve la nature de toujours agir et de ne s'accommoder,
à aucune condition, d'un repos perpétuel. C'est ce qu'il est facile
de remarquer dans les premiers temps de l'enfance. Je crains de
revenir trop souvent peut-être à ces sortes d'exemples; cependant
tous les anciens philosophes et surtout mes maîtres aiment à venir
s'instruire près du berceau des enfants, parce qu'ils croient que
c'est dans le premier âge qu'on peut le mieux juger des inclinations
de la nature. Nous voyons qu'ordinairement les enfants ne peuvent se
tenir en repos; quand ils sont plus grands, ils se plaisent à des
jeux même pénibles, sans qu'on puisse les en détourner par le
châtiment; et ce besoin d'agir augmente sans cesse avec l'âge. Très
certainement nous ne voudrions pas du sommeil d'Endymion, même
bercés continuellement par les plus agréables songes; et si le sort
en était jeté, nous nous regarderions déjà comme morts. Ne voit-on
pas aussi que les gens du monde les plus inutiles, et qui semblent
condamnés à une déplorable impuissance, ne laissent pas d'être dans
une agitation perpétuelle de corps et d'esprit, et que quand ils
n'ont rien d'indispensable qui les en détourne, ils demandent les
dés, les jeux de toutes sortes; ou ils vont chercher le passe-temps
de la conversation, et que ne pouvant goûter le plaisir libéral d'un
entretien élevé, ils couvent les cercles et les assemblées frivoles?
Les bêtes mêmes que nous renfermons pour notre divertissement,
quoiqu'elles soient alors beaucoup mieux nourries que si elles
étaient libres, ne souffrent qu'avec peine d'être captives, et
n'aspirent suivant leur instinct qu'à retrouver la liberté de leurs
allures, et à reprendre leurs bonds désordonnés. Il n'est pas
d'homme bien né et libéralement élevé, qui n'aimât mieux renoncer à
la vie que de la passer dans une complète oisiveté, où les plaisirs
viendraient d'eux-mêmes s'offrir à lui. Aussi les uns se font
quelques occupations particulières, les autres, qui ont l'âme plus
grande, ou se mêlent des affaires publiques et s'engagent dans la
carrière du pouvoir et des honneurs, ou s'a-
601 donnent entièrement à
l'étude. Et dans cette vie, bien loin d'avoir la volupté pour objet,
les soins, les veilles et les fatigues sont leur partage. Toute leur
ambition est de mettre en œuvre ce divin attribut de notre nature,
l'intelligence et la pensée; sans rechercher le plaisir, et sans
fuir la peine, ils ne cessent d'interroger avec une curiosité
intarissable les découvertes anciennes et d'en poursuivre eux-mêmes
de nouvelles; pour eux la mesure de la science n'est jamais épuisée;
oubliant tout le reste ils ne nourrissent que pensées nobles et
pures; enfin la passion de l'étude a tant de puissance sur les
esprits, que souvent même ceux d'entre eux qui rapportent tout à
l'utilité, ou à la volupté, comme au souverain bien véritable, ne
laissent pas de consumer leur vie dans une continuelle méditation de
la nature.
XXI. Nous voyons donc manifestement que l'homme est né pour agir. Et
comme il y a diverses sortes d'occupations à se proposer en ce
monde, et que les plus considérables doivent effacer les autres, la
plus noble de toutes, à mon avis et au jugement de ceux dont je vous
développe maintenant la doctrine, c'est la connaissance des choses
célestes et la découverte de ce qu'il y a de plus caché et de plus
secret dans la nature. Je mets ensuite l'administration des États,
ou pour mieux dire, la science de les administrer; puis le
développement de cette raison, mère de la prudence, de la
tempérance, de la force et de la justice enfin toutes les vertus, et
leurs œuvres. C'est là ce que nous exprimons d'un seul mot,
l'honnête; c'est à la connaissance et à la pratique de toutes ces
grandes choses que la nature nous mène, comme un guide, lorsque
l'âge nous a fortifiés. Les commencements de toutes choses sont
faibles; mais peu à peu elles se développent et grandissent. Loi
fort sage! Car il y a dans l'enfance je ne sais quelle tendresse et
quelle mollesse qui ne permet ni les nobles connaissances ni les
grandes actions. La lumière de la vertu et du bonheur, les deux
choses les plus importantes de la vie, ne se découvre que
tardivement à nous; et ce n'est que beaucoup plus tard encore que
nous pouvons les bien comprendre. Platon a fort bien dit: “Heureux
celui qui, même dans sa vieillesse, a pu parvenir à la sagesse et à
la vérité!”
Mais c'est assez parlé des premières impressions que la nature donne
à l'homme; venons à ce qu'elle fait ensuite de plus considérable en
lui. Elle a formé le corps humain de telle sorte qu'il y a des
parties que d'abord elle a rendues parfaites, et d'autres qu'elle
s'est réservé de perfectionner avec l'âge; et ce travail, elle
l'accomplit presque entièrement sans aides ni secours étrangers.
Elle a donné les mêmes soins à l'âme qui, à une seule perfection
près, est son ouvrage. Elle l'a dotée de sens propres à percevoir
tout ce que le monde renferme, et de ce côté-là, elle ne lui a
laissé presque rien à souhaiter. Mais quant à la suprême beauté et à
la véritable excellence de notre être, elle a laissé son ouvrage
imparfait, quoiqu'elle ait donné à l'homme une intelligence capable
de toutes les vertus; elle a gravé dans notre esprit, qui les trouve
sans travail, quelques faibles notions de tout ce qui est grand;
elle nous a donné les premières leçons, elle a mis en nous des
semences de vertus; mais enfin, de la vertu elle-même, elle n'a fait
que l'ébauche et s'est arrêtée là. C'est
602 donc à nous (et quand je dis nous, c'est de la
philosophie que je veux parler), à développer avec soin ces germes
que nous avons reçus de la nature, jusqu'à ce qu'ils aient porté ce
beau fruit que nous recherchons, et qui est bien plus désirable par
lui-même que la conservation des sens et tous les avantages du
corps, en comparaison desquels la perfection de l'esprit est quelque
chose de si excellent qu'on peut à peine mesurer toute la différence
qui les sépare. Aussi toute notre estime, toute notre admiration,
toute notre émulation ont-elles pour objet la vertu et les œuvres
qu'elle produit; qualités et actions diverses qui sont comprises
sous le nom commun de l'honnête. Quelles idées doit-on s'en former,
quel sens attacher aux termes qui les expriment, quelle est la
nature et le génie de chacune d'elles, c'est ce que nous verrons
bientôt.
XXII. En ce moment tout ce que je me propose de montrer, c'est que
les choses que j'appelle honnêtes sont à rechercher, non seulement
pour l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, mais pour leur
excellence propre. C'est ce que les enfants, en qui l'on voit la
nature comme dans un miroir, nous font parfaitement connaître. Avec
quels soins ne se préparent-ils pas à leurs petits combats! quelle
chaleur n'y font-ils point paraître! quel emportement de joie, quand
ils sont victorieux! quelle honte, quand ils sont vaincus! Comme ils
redoutent le blâme! Comme ils souhaitent la louange! Quelles peines
ne se donnent-ils point pour primer leurs rivaux! Quelle vive
mémoire des bienfaits qu'ils ont reçus! et quelle ardente
reconnaissance! Tout ce que nous disons là se remarque
principalement dans les esprits heureux où la nature semble avoir
donné une première touche des vertus et de leurs nobles
inspirations. Tels sont les enfants; mais dans l'âge mûr lui-même,
trouverait-on un homme qui ait assez complètement dépouillé la
nature humaine, pour être devenu insensible aux crimes comme aux
belles actions? Qui ne haïrait pas une jeunesse débordée et
licencieuse? Qui pourrait, au contraire, ne pas aimer une jeunesse
sage et réglée même sans aucun sujet particulier d'y prendre
intérêt? Qui de nous ne se sent de la haine pour le traître de
Frégelles, Pullus Numitorius, quoique cette trahison ait servi Rome;
et ne trouve digne des plus grands éloges Codrus le sauveur
d'Athènes, et les filles d'Erecthée? Qui n'a pas le nom de Tubulus
en horreur, et ne rend un culte à la mémoire d'Aristide? Ne
savons-nous pas combien quelquefois nous nous sentons émus au récit
ou à la lecture de quelque noble trait de piété, d'amitié, de
grandeur d'âme? Mais pourquoi parler de nous qui sommes nés, qui
avons été nourris et élevés pour la gloire et l'honneur? Quelles ne
sont point au théâtre les acclamations du peuple et des ignorants,
quand ils entendent ces mots:
Je suis Oreste;
et cette prompte repartie:
Non, non, c'est moi qui suis Oreste!
Lorsque ensuite ils mettent un terme aux embarras du tyran, en
s'écriant: “qu'on nous donne la mort à tous deux!” représente-t-on
jamais cette belle scène, sans qu'elle excite des applaudissements
extraordinaires? Il n'y a donc personne qui n'approuve et ne loue ce
mutuel témoignage 603 d'amitié, qui, bien loin de cacher une vue d'intérêt, leur fait
mépriser la vie, pour conserver leur foi inviolable. Mais ce n'est
pas seulement dans les fables inventées à plaisir que l'on peut
trouver de pareils exemples de vertus; les histoires en sont
pleines, et surtout la nôtre. Nous avons choisi l'homme de bien le
plus parfait pour recevoir la statue de Cybèle; nous avons envoyé
des tuteurs aux rois; nos généraux se sont dévoués pour la patrie;
nos consuls ont prévenu un roi, ardent ennemi de Rome, et qui déjà
s'approchait de nos murs, du dessein qu'on avait de l'empoisonner.
Il s'est vu dans notre république une femme qui, victime d'une
infâme violence, l'expia par sa mort volontaire, et un père qui tua
sa fille pour lui sauver l'honneur. Toutes ces actions-là et une
infinité d'autres, quel mobile les a inspirées? Peut-on douter que
ce ne fût l'amour de la vertu, le mépris de ses intérêts, l'oubli de
soi-même? Et nous, quand nous les louons, quel motif nous inspire,
si ce n'est leur propre beauté?
XXIII. Ces choses-là sont si claires, et parlent tellement
d'elles-mêmes, que je ne les ai touchées qu'en peu de mots; et ne
prouvent-elles pas suffisamment que toutes les vertus et ce noble
caractère de l'honnêteté qui résulte de la vertu, et y est
inséparablement attaché, doivent être recherchés pour leur propre
excellence? Mais de tout ce qui est honnête, rien n'a plus d'éclat
et ne s'étend plus loin que l'union des hommes avec leurs
semblables; cette société et cette communauté d'intérêts, cet amour
de l'humanité, amour qui naît avec la tendresse des pères pour leurs
enfants, se développe dans les liens du mariage, au milieu des nœuds
les plus sacrés, puis coule insensiblement au dehors, s'étend aux
parents, aux alliés, aux amis, aux relations de voisinage, grandit
avec le titre de citoyen, se répand sur les nations alliées et
attachées à ta nôtre, enfin est consommé par l'union de tout le
genre humain. Lorsque dans cette union universelle, on rend à chacun
ce qui lui appartient, lorsqu'on se fait le soutien équitable et
zélé de cette société générale des hommes, alors on pratique la
justice, qui a pour compagnes la piété, la bonté, la libéralité, la
bienveillance, la douceur, et toutes les qualités qui viennent du
même esprit; mais ces qualités ne sont pas tellement attachées à la
justice, qu'elles n'appartiennent également aux autres vertus. Car
telle étant la nature de l'homme, que visiblement sa place est
marquée dans la société, il faut que chaque vertu, dans toutes les
actions qui lui sont propres, contribue à établir cette communauté
et cet amour de nos semblables dont je parlais; il faut pareillement
que la justice, dont la pratique a tant d'influence sur les autres
vertus, les embrasse toutes; car il n'y a point de vraie justice,
sans force ni sagesse. Cet accord unanime et ce mutuel concours de
toutes les vertus vers une même fin est proprement ce que nous
appelons l'honnête, puisque l'honnête c'est la vertu, ou les actions
que la vertu inspire; et quand la vie d'un homme y est parfaitement
conforme, toujours réglée et dominée par la vertu, on doit la
regarder comme une vie honnête, droite, ferme et véritablement
convenable à la nature. Cette union cependant, et cette connexité de
toutes les vertus, n'empêchent pas que les philosophes ne les
distinguent les unes des autres.
604 Car encore qu'elles soient tellement liées ensemble,
qu'elles participent toutes les unes des autres, et qu'on ne les
puisse réellement séparer, chacune n'en a pas moins sa fonction
particulière. Ainsi la force se reconnaît dans les travaux et les
dangers; la tempérance dans le mépris des plaisirs; la prudence dans
le discernement des biens et des maux; la justice enfin, dans
l'habitude constante de rendre à chacun ce qui lui appartient. Comme
donc il y a en chaque vertu une espèce de regard au dehors de
l'homme, un soin et une providence qui s'étend à nos semblables, il
en faut conclure que nos amis, nos frères, nos proches, nos alliés,
nos concitoyens, tous les hommes enfin, puisque nous n'avons fait
qu'une seule société de tout le genre humain, doivent être
recherchés et aimés pour eux-mêmes; quoique l'on puisse dire que
rien de tout cela ne fasse partie du souverain bien. Ainsi, il y a
deux sortes de choses à rechercher pour elles-mêmes, les unes, dans
lesquelles réside le souverain bien, et qui regardent l'âme et le
corps; les autres qui sont hors de nous, comme les amis, les
parents, les proches et la patrie, tous objets qui nous sont chers
par eux-mêmes, mais non pas de la même sorte que les précédents. En
effet, quelque estime que l'on doive faire des choses qui sont hors
de nous, si elles étaient une condition du souverain bien, personne
ne pourrait jamais parvenir à ce bien suprême.
XXIV. Comment se peut-il-donc faire, dites-vous, que tout se
rapporte au souverain bien, si les liaisons d'amitié et. De parenté,
et rien de ce qui est hors de nous, ne s'y trouve compris. Et moi je
vous répondrai que ces diverses liaisons se rapportent au souverain
bien, parce que les devoirs qui nous exhortent et nous servent à les
cultiver, ont tous leur source dans quelqu'une des vertus. Ainsi, se
dévouer à ses amis, s'acquitter envers ses parents, en un mot,
remplir ses devoirs, ce sont là de bonnes actions; et toute bonne
action a son origine dans la vertu. Telle est la conduite du sage,
qui fait le bien sous la direction de la nature.
Les hommes qui, sans être parfaits, ont néanmoins un grand génie,
sont entraînés souvent par l'amour de la gloire, qui a l'apparence
et quelques traits de la vertu. Que s'ils pouvaient voir la vertu
elle-même dans sa perfection et sa toute beauté, la pure vertu
enfin, cette merveille incomparable et sublime, de quelle joie ne
seraient-ils point comblés, puisqu'une vaine ébauche, une ombre les
charme et les enivre? Car quel homme si abandonné à la volupté, et
si enflammé par les passions, a jamais éprouvé tant de plaisir à
goûter les molles délices qu'il avait le plus ardemment désirées,
que le premier Scipion, après avoir vaincu Annibal, et le second
après avoir renversé Carthage? Et lorsqu'il y eut, ce jour de fête
solennelle, un si grand concours sur le Tibre pour voir le roi
Persée que Paul-Émile amenait captif, quel autre homme eut alors une
joie si pure et si véritable que ce triomphateur?
Courage donc, mon cher Lucius, amassez-vous de bonne heure un
précieux trésor de vertus, vous verrez qu'elles rendent toujours
heureux ceux qui les possèdent et qui ont l'âme noble et élevée. De
tels hommes comprennent facilement que, quels que soient les
révolutions et les coups
605 du sort, c'est toujours un vain et faible combat que celui de la
fortune contre la vertu. Car les biens du corps dont j'ai parlé
mettent effectivement le comble au bonheur, mais non pas de telle
sorte que sans eux la vie ne puisse être heureuse; ce qu'ils
ajoutent à la félicité est si peu de chose qu'au prix de la vertu
ils n'ont pas plus de mérite, que les étoiles n'ont de clarté au
regard du soleil. Mais comme on a raison de dire qu'ils ne sont que
d'une légère considération pour le bonheur de la vie, c'est une
exagération de croire qu'ils n'y contribuent absolument en rien.
Ceux qui soutiennent ce sentiment-là me paraissent avoir oublié
comment ils ont d'abord établi leur système sur les premiers
principes de la nature. Il faut donc accorder quelque chose aux
biens du corps, mais il faut comprendre aussi le peu qu'on leur doit
accorder; et comme un vrai philosophe qui cherche la vérité et non
le faste doit ne pas réduire au néant ce que ces orgueilleux mêmes
reconnaissaient être selon la nature, il doit aussi reconnaître si
bien l'excellence, et pour ainsi dire l'autorité de la vertu, que
tout le reste, je ne dis pas, disparaisse à ses yeux, mais lui
semble de si médiocre importance qu'il n'en tienne à peu près nul
compte. Tel sera le langage d'un homme qui n'affecte point de
mépriser tout ce qui dans ce monde n'est pas la vertu, et qui
cependant fait de la vertu toute l'estime qu'elle mérite. Enfin, tel
est le souverain bien et de tous points accompli et parfait. De tout
ce qui le compose, les uns ont pris une partie, les autres une
autre; chacun a visé à l'honneur d'apporter un nouveau système.
XXV. Souvent Aristote et Théophraste ont fait l'éloge de la science
et de son admirable beauté. Hérille, séduit par cet unique mérite,
déclare que la science est le souverain bien, et que hors d'elle, il
n'y a plus rien à rechercher. Les anciens ont beaucoup parlé sur le
mépris des choses humaines. Ariston, abondant exclusivement dans
cette idée, soutient qu'à l'exception des vertus et des vices, il
n'y a rien à rechercher ni à fuir. Nos sages ont compté parmi les
choses qui sont selon la nature l'absence de la douleur. Aussitôt
Hiéronyme dit que c'est là le souverain bien. Pour Calliphon et
Diodore, quoique le premier soutînt le parti de la volupté, et le
second celui de l'absence de la douleur, cependant ni l'un ni
l'autre n'ont pu se passer de la vertu, que les nôtres ont toujours
préférée à tout. Il n'y a pas jusqu'aux voluptueux qui ne cherchent
des subterfuges, et qui n'aient sans cesse le nom de l'a vertu à la
bouche; ils disent que c'est bien à la volupté que la nature se
porte d'abord, mais que l'habitude est comme une seconde nature, par
l'impulsion de laquelle on fait ensuite beaucoup de choses, sans
avoir la volupté, pour objet. Quant aux Stoïciens, ce n'est pas une
maxime ou deux qu'ils ont prises de nous, mais ils se sont approprié
toute notre doctrine. Et comme d'ordinaire les voleurs altèrent les
marques des choses qu'ils ont dérobées, les Stoïciens, pour pouvoir
se servir de nos dogmes comme s'ils leur appartenaient, ont pris
soin de changer les termes qui en étaient comme la marque. Il n'y a
donc aucune autre philosophie que la nôtre qui soit digne des
esprits voués aux études libérales, digne des savants et des grands
hommes, digne des premiers citoyens et des rois.
Après que Pison eut ainsi parlé et qu'il eut fait quelque pause: Eh
bien, dit-il, n'ai-je pas usé largement de la permission que vous
m'aviez 606 donnée de vous
fatiguer les oreilles? – Vous venez, Pison, lui dis-je, de nous
faire voir que vous possédez si bien toute cette matière que, si
nous pouvions vous avoir toujours, nous nous passerions aisément des
Grecs; et ce que j'en estime davantage, c'est que je me souviens que
Staséas de Naples, qui vous enseignait la philosophie, et qui était
un excellent Péripatéticien, avait coutume de parler un peu
autrement sur le même sujet et qu'il était de l'avis de ceux qui
comptent pour beaucoup la prospérité et l'adversité, pour beaucoup
les biens et les maux du corps. – Cela est vrai, reprit-il; mais
notre ami Antiochus parle bien mieux de toutes ces choses-là et avec
beaucoup plus de force que ne faisait Staséas. Au reste, ce que je
voudrais savoir ce n'est pas quel est votre sentiment sur tout ce
que j'ai dit, mais quel est celui de notre jeune Cicéron, que j'ai
envie de vous enlever.
XXVI. Pour moi, dit Lucius, tout ce que vous avez dit me plaît fort,
et je ne doute point que mon frère ne pense comme moi. – Eh bien!
reprit Pison, en m'adressant la parole, lui donnez-vous permission
de me suivre? Ou aimez-vous mieux qu'il étudie cette doctrine dans
laquelle le comble de la perfection est de ne rien savoir? – Quant à
moi, repartis-je, je lui donne toute sorte de permissions, mais ne
songez-vous pas qu'il m'est permis aussi de donner mon approbation à
ce que vous venez de dire? Qui peut en effet ne pas approuver ce qui
lui paraît probable? – Est-ce que quelqu'un, dit-il, peut approuver
ce qu'il ne voit pas clairement, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il
ne connaît pas bien? – Sur ce point, Pison, il n'y a pas grand
dissentiment entre nous; car, ce qui m'empêche de croire que l'on
puisse avoir une perception claire des choses, c'est uniquement la
définition que les Stoïciens donnent de la faculté de percevoir,
quand ils disent qu'il n'y a de perception que de ce qui porte
tellement les caractères de la vérité que l'erreur ne puisse en
prendre les traits. Je n'ai donc de démêlé là-dessus qu'avec les
Stoïciens; avec les Péripatéticiens, nullement. Mais laissons cela;
car c'est une controverse que j'ai traitée assez longuement ailleurs
et vivement agitée. Il me semble que vous avez été beaucoup trop
bref sur un point de grande importance, à savoir, que tous les sages
sont toujours heureux; vous l'avez touché, et je ne sais comment
vous êtes passé tout d'un coup à un autre sujet. Si pourtant on n'en
donne des preuves solides, je crains fort que Théophraste n'ait dit
vrai, quand il a déclaré que l'adversité, les chagrins, les grandes
souffrances sont incompatibles avec le bonheur de la vie, car il y a
de la contradiction à dire qu'un même homme soit heureux et soit
accablé de maux, et je ne comprends pas trop comment cela peut
s'accommoder. – Est-ce que vous ne voulez pas, répliqua-t-il, que la
vertu puisse se suffire à elle-même pour le bonheur? Ou, si vous
croyez qu'elle se suffise, n'accorderez-vous pas que les hommes
vraiment vertueux, quand même ils seraient affligés de quelques
maux, ne puissent mener une vie heureuse? – Pour moi, répondis-je,
je veux bien donner à la vertu toute la force imaginable; mais
jusqu'où cette force peut aller, c'est une recherche à remettre à
une autre fois; je demande seulement si, en admettant quelque autre
chose que la vertu au rang des biens, il est raisonnable de lui
donner autant de pouvoir. – Si vous accordez, dit-il, aux Stoïciens,
607 que la vertu seule fasse
le bonheur, il faut que vous l'accordiez aussi aux Péripatéticiens;
car les mêmes choses que les Stoïciens n'osent appeler des maux,
mais qu'ils conviennent être dures, fâcheuses, odieuses, contraires
à la nature, nous les appelons des maux, mais des maux légers et
presque de nulle importance; de sorte que, si celui qui éprouve des
choses dures et odieuses, peut être heureux, celui qui n'éprouve que
des maux légers, peut, je crois, l'être également. – S'il y a
quelqu'un, repris-je, qui pénètre mieux qu'un autre ce dont il
s'agit dans une affaire, c'est assurément vous, Pison. C'est
pourquoi prêtez-moi un peu d'attention, car vous n'entendez pas bien
ce que je veux dire, et c'est peut-être de ma faute. – Je vous
écoute, dit-il, et j'attends ce que vous allez répondre à la
question que je vous fais.
XXVII. Je vous répondrai que je ne cherche pas en ce moment quelle
peut être la puissance de la vertu, mais si ce qu'on en dit est
conséquent et s'il n'y a pas de contradiction dans la doctrine. –
Comment donc? Reprit-il. – C'est, répondis-je, que quand Zénon,
comme rendant un oracle, a prononcé magnifiquement: “La vertu n'a
besoin que d'elle-même pour rendre la vie heureuse;” et qu'on lui
demande pourquoi, il répond que c'est parce qu'il n'y a rien de bien
que ce qui est honnête. Je ne cherche pas maintenant si ses
principes sont vrais ou non; je dis seulement qu'ils sont bien liés.
Épicure lui-même conviendra que le sage est toujours heureux; car il
prend quelquefois le haut ton, et il va jusqu'à dire que le sage,
dans les plus grandes douleurs, s'écriera: Que cela est doux! et que
je m'en soucie peu! Je ne m'attacherai point à lui demander comment
la nature peut avoir tant de force. J'insisterai seulement pour lui
montrer qu'il ne prend pas garde au langage qu'il devrait tenir
après avoir établi que la douleur est le souverain mal, et c'est
précisément la même objection que j'ai à vous faire. Vous mettez au
nombre des biens et des maux tout ce qu'y mettent ceux qui n'ont
même jamais vu un philosophe en peinture, comme on dit; au nombre
des biens, la santé, la force du corps, l'élégance de la taille, la
beauté de la figure, enfin même jusqu'à l'intégrité des moindres
parties du corps; et au nombre des maux, la laideur, la maladie,
l'affaiblissement. Quant à tout ce qui est hors de nous, comme les
amis, les enfants, les parents, les richesses, les honneurs, la
puissance, vous y attachez un prix très secondaire; mais enfin
puisque les biens du corps viennent en partie de là, vous êtes forcé
d'y reconnaître tout autant de biens. Et remarquez que je suis loin
de prétendre que vous ayez tort; mais si tous les accidents qui
peuvent arriver au sage sont des maux, on doit avouer qu'il ne
suffit pas d'être sage pour vivre heureux. – A la vérité, reprit-il,
la sagesse seule ne nous met pas au comble du bonheur; mais, pour
vivre heureux, elle suffit. – J'ai déjà remarqué tout à l'heure, lui
répondis-je, que vous vous expliquiez de la sorte; et je sais que
notre ami Antiochus tient pour ce sentiment. Mais qu'y a-t-il de
moins soutenable que de dire qu'un homme soit heureux, et qu'en même
temps il ne soit pas assez heureux? Car tout ce qu'on ajoute à ce
qui est assez, est trop; et personne ne peut être trop heureux;
d'ailleurs je ne connais pas de degrés dans le bonheur. – Quoi donc,
répliqua-t-il, Q. Métellus, que je suppose avoir été sage, qui vit
trois de ses fils consuls, l'un des trois censeur et triomphateur,
et le quatrième préteur; qui les laissa tous pleins de
608 vie, et ses trois filles
mariées, après avoir été lui-même consul, censeur, augure et
triomphateur, n'a-t-il pas été, à votre avis, plus heureux que
Régulus, que je suppose de même avoir été sage, et que les
Carthaginois firent mourir de faim et de veilles?
XXVIII. Pourquoi me faites-vous cette question?
Lui dis-je;
faites-la aux Stoïciens. – Mais que croyez-vous qu'ils répondent?
Continua-t-il. – Ils répondront, lui dis-je, que Métellus ne fut
nullement plus heureux que Régulus. – Eh bien! qu'ils le prouvent. –
Mais, repris-je, nous nous sommes écartés de notre question; car je
ne cherche pas ce qu'il y a de vrai dans un dogme, mais ce qu'on
doit dire pour ne pas se contredire. Plût à Dieu que les Stoïciens
voulussent avouer qu'un sage est plus heureux qu'un autre sage! vous
verriez tout leur système s'écrouler à l'instant; puisqu'ils mettent
le souverain bien dans la vertu seule et dans l'honnête, puisqu'ils
prétendent que ni l'un ni l'autre n'admettent de degrés, et que
c'est là le seul bien avec lequel on est nécessairement heureux,
comment se pourrait-il faire qu'un sage fût plus heureux qu'un
autre, quand le bien qui seul rend heureux ne peut recevoir
d'accroissement? Vous voyez comme tout cela se tient ensemble, et,
par Hercule, il faut l'avouer, il y a un merveilleux enchaînement
dans toutes leurs propositions. Les dernières s'accordent avec les
premières; le milieu répond au commencement et à la fin; tout se lie
admirablement; enfin, ils voient parfaitement bien ce qui est
conséquent ou contradictoire. En géométrie, accordez une
proposition, il faut que vous admettiez toutes les autres. Tout
pareillement, convenez avec les Stoïciens qu'il n'y a rien de bien
que ce qui est honnête, il faudra convenir avec eux que la vertu
seule peut rendre la vie heureuse. Et réciproquement, si vous tombez
d'accord de ce dernier dogme, il faudra que vous accordiez le
premier principe. Il n'en est pas de même de votre doctrine: vous
établissez trois sortes de biens; rien de plus commode d'abord; la
doctrine coule aisément, vous arrivez aux conséquences, mais vous
êtes arrêtés. Vous avez fort envie de dire qu'il ne manque rien au
sage pour être heureux; c'est une belle maxime, c'est celle de
Socrate et de Platon; mais vos philosophes ont beau vouloir la
soutenir, ils ne le peuvent, s'ils ne réforment ce qu'ils ont dit
d'abord. Car si la pauvreté est un mal, un homme qui est dans
l'indigence ne peut être heureux, quelque sage qu'il soit. Les
Stoïciens ne prétendent pas seulement qu'il est heureux, ils
soutiennent même qu'il est riche.
La douleur est-elle un mal? Celui qui est mis en croix ne peut pas
être heureux. Est-ce un bien que d'avoir des enfants? C'est un
malheur que de les perdre. Est-ce un bien que de vivre dans sa
patrie? L'exil est un malheur. La santé est-elle un bien? La maladie
est un malheur. L'intégrité des membres est-elle un bien? C'est un
malheur que d'être estropié. Est-ce un bien que de jouir de la vue?
C'est un malheur que d'être aveugle. Que si à chacun de ces maux
votre doctrine peut trouver quelque remède, comment remédiera-t-elle
à toutes ces infortunes réunies? Qu'un homme sage soit en même temps
aveugle, estropié, grièvement malade; qu'il soit de plus exilé,
indigent, qu'il ait perdu ses enfants, et qu'on le déchire sur le
chevalet, comment l'appellerez-vous, Zénon? – Je dirai que c'est un
homme heureux. – Mais, très heureux, le diriez-vous? – Sans doute;
car j'ai enseigné qu'il n'y a pas plus de degrés dans le véritable
bonheur que dans la vertu qui le fonde. Cela vous paraît incroyable
à vous qu'un homme puisse être très
609 heureux dans cet état. Mais, vous Pison, quand vous dites
qu'il est heureux, êtes-vous plus croyable? Si vous en faites le
peuple juge, vous ne prouverez jamais qu'un tel homme soit heureux.
Si vous vous en rapportez aux gens capables, ils douteront peut-être
que la vertu ait assez de force pour faire qu'un homme dans le
taureau de Phalaris soit heureux; mais ils ne douteront nullement
que les Stoïciens ne soient conséquents avec eux-mêmes, et que votre
doctrine ne se contredise. – Vous approuverez donc, me dit Pison, le
livre de Théophraste sur la félicité de la vie. Nous sortons de la
question, lui dis-je, mais pour n'en pas sortir davantage, oui, je
l'approuve, si vous avez raison d'appeler ces inconvénients des
maux. – Vous ne croyez donc pas que ce soient des maux? Reprit-il. –
Vous me faites cette question? Lui dis-je; mais, de quelque façon
que j'y réponde, vous serez également embarrassé. – Comment cela? –
Si ce sont des maux, celui qui en sera attaqué, ne pourra jamais
être heureux; si ce ne sont pas des maux, toute la doctrine des
Péripatéticiens est renversée. – Je vois bien ce que c'est, dit-il
en riant; vous craignez que je ne vous emmène votre disciple. – Non
pas, repliquai-je, vous pouvez l'emmener, si toutefois il veut vous
suivre. Être avec vous, c'est toujours être avec moi.
XXIX. Écoutez-moi donc, Lucius, reprit-il, car c'est à vous
maintenant, comme le dit Théophraste, que je vais adresser la
parole. Tout le prix de la philosophie, c'est qu'elle est la clef du
bonheur; les hommes en effet n'aspirent tous qu'à être heureux; et
sur ce point-là, nous sommes d'accord, votre frère et moi. II faut
donc voir si la philosophie nous peut mener au bonheur; elle le
promet du moins. S'il en était autrement, Platon aurait-il parcouru
l'Égypte afin d'apprendre des prêtres barbares la science des
nombres et celle des choses célestes? Aurait-il ensuite été chercher
Architas â Tarente, et à Locres, les autres pythagoriciens,
Échécrate, Timée, Acrion, pour ajouter aux connaissances qu'il avait
puisées dans l'enseignement de Socrate la doctrine des
pythagoriciens, et apprendre d'eux ce que Socrate ne se souciait pas
de savoir? Pourquoi Pythagore lui-même voyagea-t-il en Égypte, et
alla-t-il ensuite consulter les mages de Perse? Pourquoi
parcourut-il à pied tant de régions barbares et traversa-t-il tant
de mers? Pourquoi Démocrite a-t-il lui aussi visité le monde? On
assure qu'il s'est crevé les yeux; que ce fait soit vrai au non, il
est certain que pour être moins détourné de ses profondes
méditations, il négligea entièrement le soin de son patrimoine; et
que poursuivait-il? Un seul problème, celui du bonheur. Car encore
qu'il mît le bonheur dans la connaissance des choses, il voulait par
la recherche et l'étude de la nature, parvenir à cette égalité
d'âme, que tantôt il appelle εὐθυμίαν et tantôt ἀθαμβίαν, qui consiste surtout à avoir l'esprit
affranchi de toute terreur, et qui constitue pour lui le souverain
bien. Tout ce qu'il imagina alors d'excellent, il fut loin de le
porter à sa perfection; il a même dit fort peu de choses de la
vertu, et qui ne sont pas assez développées. Toute cette grande
question fut ensuite examinée dans Athènes par Socrate, et puis
agitée dans le lieu même où nous sommes maintenant. Ici personne ne
douta que toutes nos espérances non seulement de sagesse, mais de
bonheur, ne dussent être fondées uniquement sur la vertu. Zénon
après avoir reçu ces 610 principes de nos maîtres, a suivi la règle des causes judiciaires;
il a dit les mêmes choses en d'autres termes. Et voilà ce que vous
approuvez en lui; d'avoir évité, par le changement des termes
l'espèce de contrariété dont vous nous faites un crime et à laquelle
nos expressions nous condamnent. Il dit que la vie de Métellus n'est
pas plus heureuse que celle de Régulus, mais qu'elle est préférable;
qu'elle n'est pas plus à rechercher, mais qu'il faut plutôt la
prendre; et que si on avait le choix entre les deux, il faudrait
choisir celle de Métellus, et rejeter celle de Régulus. Moi
j'appelle plus heureuse la vie qu'il nomme préférable, et qu'il dit
qu'on devrait choisir; mais je ne lui attribue pas le moindre degré
de valeur de plus que les Stoïciens. La différence qu'il y a entre
nous, c'est que j'appelle des choses connues par leurs noms propres,
et qu'eux ils cherchent de nouveaux noms, pour ne rien dire de
nouveau. Aussi, comme il y a toujours dans le sénat quelqu'un qui
demande un interprète, il faudrait continuellement un interprète
avec ces gens-là. J'appelle bien tout ce qui est conforme, et mal
tout ce qui est contraire à la nature. Et ce n'est pas moi seulement
qui parle de la sorte, c'est vous aussi, Chrysippe, quand vous êtes
chez vous ou dans la place publique; dès que vous êtes dans votre
école, c'est un autre langage. Quoi donc! pensez-vous qu'il faille
que les philosophes parlent autrement que les autres hommes? Que les
savants aient un vocabulaire, et que les ignorants en aient un
autre? Mais puisque les gens habiles sont d'accord sur le mérite
relatif des choses en ce monde, on pourrait, il est vrai, s'ils sont
hommes, leur demander d'employer les expressions universellement
reçues; toutefois pourvu que les principes restent les mêmes, on
peut leur donner la licence d'inventer des termes à leur guise.
XXX. Mais afin que vous ne me disiez pas davantage que je sors
toujours de la question, je viens au reproche de contradiction que
vous me faites; vous la mettez dans les paroles; et moi je la
croyais dans les choses. Si nous avons bien compris toute la force
de ce principe que les Stoïciens nous aident si puissamment à
établir qu'il y a un tel prix dans la vertu, que si l'on met tous
les autres avantages du monde auprès d'elle, ils seront éclipsés par
son éclat; peu importent les noms que je donnerai à ce que les
Stoïciens appellent des choses avantageuses, qu'on peut prendre,
qu'il faut choisir et dont ils disent qu'on doit faire une certaine
estime. Ils multiplient les expressions, ils imaginent des termes
bizarres, comme élevés en dignité ou abaissés, et parfois ils
emploient des mots qui n'ont pas d'autre sens que les nôtres; car
quelle différence y a-t-il entre rechercher et choisir? Je trouve
même que choisir dit quelque chose de plus, et que l'objet d'un
choix a une importance toute particulière; mais quand je nomme
toutes ces choses-là des biens, la question est de savoir si je les
regarde comme de grands biens, et si je pense qu'on doive les
poursuivre avec beaucoup d'ardeur quand je dis qu'elles sont à
rechercher. Mais si en les appelant des biens, je ne les estime pas
plus que vous qui les nommez des choses préférables, et je ne leur
attache pas plus de prix que vous qui les déclarez élevées en
dignité, il faut nécessairement qu'elles disparaissent toutes
également devant l'éclat de la vertu, comme de faibles lumières
devant les rayons du soleil. Mais, direz-vous, une vie affligée de
quelque mal ne peut être heureuse. Quoi! ni une moisson non
611 plus, quelque fertile qu'elle
soit, s'il s'y rencontre une seule mauvaise herbe; et un commerce,
quelque brillant qu'il puisse être, ne sera plus regardé comme
lucratif, si, parmi des gains magnifiques, une légère perte se fait
éprouver? Mais en est-il jamais autrement dans la vie, et n'est-ce
pas la pièce la plus considérable qui doit faire juger du tout? Et
peut-on douter que la vertu ne soit tellement au-dessus de la
plupart des choses humaines, qu'elle les efface toutes? J'aurai donc
la hardiesse d'appeler bien tout ce qui est selon la nature, et je
ne supprimerai point les noms reçus pour en inventer de nouveaux,
mais cela ne m'empêchera pas de mettre la vertu dans une balance, et
croyez-moi, si l'on mettait de l'autre côté la terre et les mers, la
vertu l'emporterait. C'est toujours au nom de ce qu'il y a de
principal en chaque chose et qui en embrasse la plus grande partie,
que l'on caractérise la chose entière. Un homme mène d'ordinaire une
vie très agréable; s'il vient une fois à être triste, dira-t-on
qu'il a perdu toute la joie et tout l'agrément de sa vie? M.
Crassus, pour avoir ri une fois, à ce que nous rapporte Lucilius,
n'en a pas moins été appelé ἀγέλαστος, “qui ne rit
jamais”. Polycrate, tyran de Samos, qui fut appelé heureux, parce
qu'il ne lui était jamais rien arrivé que d'agréable, fut-il
malheureux tant qu'on ne retrouva point la bague qu'il avait jetée
dans la mer, et quand elle eut été retrouvée dans les entrailles
d'un poisson, redevint-il heureux? Certainement, s'il n'était pas
sage (et la sagesse n'est point compatible avec la tyrannie), il n'a
jamais été heureux; que s'il eût été sage, il n'aurait jamais pu
devenir misérable, non pas même quand Oroès, le lieutenant de
Darius, le fit mettre en croix. Mais il souffrait beaucoup; qui en
disconvient? Mais s'il était sage, tout ce qu'il souffrait était
comme étouffé par la force et par la grandeur de la vertu.
XXXI. Est-ce que vous ne permettez pas même aux Péripatéticiens de
dire que la vie des gens de bien, des sages, qu'une vie ornée de
toutes les vertus est toujours plus remplie de biens que de maux?
Savez-vous qui tient ce langage? – Les Stoïciens sans doute. – Non
pas; mais ces philosophes voluptueux qui rapportent tout au plaisir
et à la douleur, ne disent-ils pas hautement qu'il se présente
toujours au sage un plus grand nombre de choses qu'il veut que de
celles qu'il ne voudrait pas? S'ils tiennent ce langage, eux qui
disent qu'ils ne remueraient pas le bout du doigt pour la vertu, si
elle n'était une ouvrière de volupté, que ne devons-nous faire, nous
qui soutenons que le moindre avantage de l'esprit est au-dessus de
tous les biens du corps, et les efface de son éclat? Qui oserait
dire qu'il pût tomber dans l'esprit d'un sage de vouloir renoncer
pour toujours à la vertu, pourvu qu'il fût assuré d'être à jamais
affranchi de toute douleur? Et nos philosophes, qui n'ont point
honte d'appeler des maux ce que les Stoïciens appellent des choses
dures et fâcheuses, ont-ils jamais dit qu'il valût mieux faire
quelque chose de honteux avec plaisir, que de se conduire
honnêtement, au prix de la douleur! Nous trouvons que Denys
d'Héraclée a quitté fort indignement les Stoïciens, à cause de
violentes douleurs d'yeux; comme si Zénon avait promis de lui
apprendre à ne point souffrir quand il souffrirait! Il lui avait
bien ouï dire que la douleur n'est pas un mal, parce que ce n'est
pas une chose honteuse et qu'un homme de cœur doit la supporter,
mais il n'avait pas profité du précepte. Si Denys avait été
péripatéticien, je crois
612 qu'il n'aurait jamais changé de sentiment; car les Péripatéticiens
avouent que la douleur est un mal; mais ils enseignent aussi bien
que les Stoïciens à la supporter courageusement. Et votre Arcésilas,
quoiqu'il soutînt ses opinions avec ardeur, était néanmoins des
nôtres, puisqu'il avait eu Polémon pour maître. Un jour qu'il était
dans les douleurs de la goutte, et que Carnéade, grand ami
d'Épicure, après avoir passé quelque temps avec lui, s'en allait
tout triste; “Demeurez, je vous prie lui dit-il, en mettant la main
sur son cœur; la douleur des pieds n'est pas encore venue
jusqu'ici.” Cependant il eût beaucoup mieux aimé ne point souffrir.
XXXII. Voici donc quelle est notre doctrine qui vous paraît se
contredire. Comme l'excellence presque divine de la vertu est telle,
que partout où se trouve ce bien merveilleux et où il y a quelque
chose de grand et de noble à faire, il peut bien se rencontrer du
travail et de la peine, mais non pas de la misère ou du chagrin, je
ne fais aucune difficulté de dire que tous les sages sont toujours
heureux; mais je tiens aussi qu'il se peut faire que l'un soit plus
heureux que l'autre. – Voilà, lui dis-je, Pison, ce que vous avez
principalement à prouver; et si vous pouvez en venir à bout, non
seulement je vous laisserai Lucius pour disciple, mais je me ferai
moi-même le vôtre. – Pour moi, dit Quintus, cela me paraît
suffisamment prouvé. Avant de vous avoir entendu, Pison, je ne
doutais point que cette philosophie ne fût assez riche pour pouvoir
fournir à tous mes besoins et à tous les désirs de mon esprit, et
j'en estimais déjà l'accessoire plus que le fond même de toutes les
autres doctrines; mais je suis ravi de voir qu'elle a encore plus de
pénétration et de profondeur que ses rivales, ce que certains
esprits contestaient. – Elle n'en a pas du moins plus que la nôtre,
dit Pomponius en riant. Mais, je dois l'avouer, Pison, vous m'avez
fait un extrême plaisir; car les idées que je ne croyais pas qu'on
pût développer dans notre langue, vous les avez si bien exprimées et
dans des termes si propres et si précis, que les Grecs ne
s'expliquent pas mieux eux-mêmes. Mais il est temps de venir tous
chez moi, si vous le trouvez bon. – Après ces mots de Pomponius,
comme il nous semblait que la discussion avait assez duré, nous
rentrâmes à Athènes, et l'accompagnâmes chez lui.
|