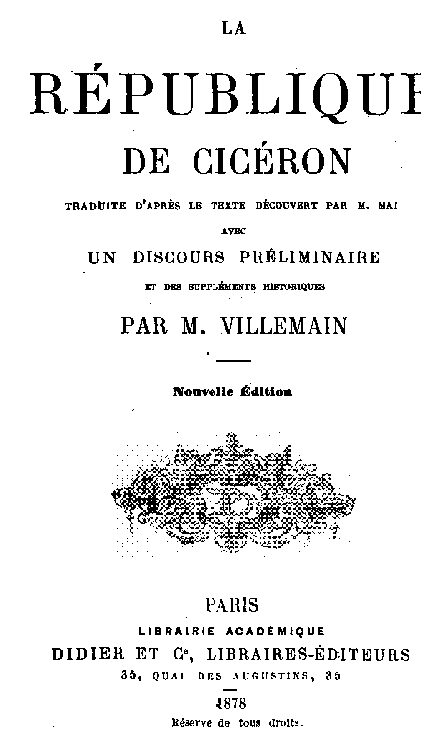|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.livre I - livre II - livre III - livre V
*******************
ANALYSE DU QUATRIÈME LIVRE.
Le précieux manuscrit, que nous publions, ne contient que de bien faibles débris du quatrième livre de la République; et si l'authenticité de ces fragments leur donne toujours un haut degré d'intérêt pour les philologues, aux yeux desquels une phrase même est précieuse, leur peu d'étendue n'offrira qu'un attrait bien médiocre à la curiosité littéraire. Quelques pages sans suite, sans indication du nom des interlocuteurs, voilà tout ce que l'infatigable patience de M. Mai a pu exhumer, et tout ce qu'elle produit à nos yeux, pour représenter ce quatrième livre, qui paraît avoir embrassé d'importantes et utiles questions, l'état et les mœurs des femmes, l'éducation des enfants, le luxe, les jeux publics, les théâtres. Combien ce cadre, dont nous sommes réduits à conjecturer l'étendue, aurait, sous la plume de Cicéron, renfermé de vues ingénieuses, et probablement de rares et curieux détails, que la critique savante ne devinera jamais qu'en partie. Combien la vie intérieure des Romains, et c'est toujours le côté le plus instructif de l'histoire d'un peuple, nous aurait vivement apparu dans le libre entretien de ces grands personnages que faisait parler Cicéron, et qui sans doute se partageaient l'un l'autre la censure, la satire, l'explication et l'apologie des mœurs romaines! Nous voyons en effet, et par les nouveaux fragments qu'a découverts notre savant éditeur, et par quelques phrases recueillies avant lui, que tout dans le quatrième livre de la République se rapportait à ce texte piquant et varié. Quelques-unes de ces phrases seulement semblent offrir un caractère de généralité métaphysique, qui ferait supposer qu'en tête de ce livre, où il devait traiter de la famille et de l'éducation domestique et publique, Cicéron avait placé quelques réflexions sur la nature de l'homme, et sur l'union de l'âme et du corps. Lactance l'indique d'une manière positive ; et il ajoute que Cicéron n'avait fait qu'ébaucher ce vaste sujet, tout en annonçant l'intention de l'approfondir. Le christianisme devait trouver bien courtes et bien confuses toutes les vues de la sagesse antique sur ce mystère de l'existence humaine : mais, au rapport de l'un des plus grands génies de la société chrétienne, le livre de Cicéron, à la suite de ces spéculations imparfaites, renfermait la plus vive peinture et te plus éloquent éloge des vertus morales et domestiques. C'est que l'homme impuissant à pénétrer par ses propres forces le secret de la nature, ne l'était pas à s'élever à la pratique des devoirs, dont il trouve l'instinct et le prix dans son cœur. La justesse admirable du génie de Cicéron, et la méthode toute pratique, qu'il s'était proposée, par une application continuelle de ses idées à l'exemple de la république romaine, nous avertissent assez que, sur la question des devoirs et des liens de famille, principe de tout ordre social, il avait rejeté bien loin les chimériques hypothèses de Platon, et toute cette théorie d'innovations contre le cœur humain. Sans doute il avait dû lui en coûter de combattre ce beau génie, dont il adorait l'éloquence; mais il lui avait emprunté l'exemple d'un tel courage : « Je le repousserai loin de nous, dit-il, comme lui-même exile Homère de la cité qu'il veut bâtir, en le couvrant de fleurs et de parfums. » L'admirateur de ces vieilles mœurs romaines, où le mariage était si respecté et si saint, et le divorce inouï, quoique permis par les lois, où la puissance paternelle était une véritable magistrature, une souveraineté absolue, pouvait-il tolérer cette bizarre promiscuité de toutes les familles, imaginée par Platon? Ne devait-il pas reproduire avec plus de force les objections qu'Aristote avait opposées à cet étrange système? Sur un autre point, l'esprit de travail, d'ordre, de parcimonie qui caractérisait les premiers Romains, et que Cicéron avait sans doute célébré, ne formait pas un contraste moins remarquable avec cette abolition des propriétés particulières également proposée par Platon, à l'imitation de Lacédémone : et Cicéron, l'ennemi des lois agraires, le soutien des fortunes aristocratiques, devait repousser une telle idée, comme un rêve impraticable et dangereux. Il me paraît donc vraisemblable qu'une assez vive réfutation de ces théories, qui se trouve dans Lactance, est un extrait, et peut-être une fidèle copie de ce que Cicéron avait dit sur ce sujet, dans son quatrième livre. Le passage est curieux, et d'une élocution latine qui n'appartient guère au siècle de Lactance. « Platon s'est souvent égaré autant que personne au monde, surtout dans ses livres politiques, lorsqu'il veut établir la communauté de toutes choses, entre les citoyens. Pour les fortunes, cela est encore tolérable, bien que fort injuste car, personne ne doit souffrir dommage, pour s'être enrichi par son industrie, ni gagner à s'être appauvri par sa faute. Cependant, comme je l'ai dit, cela peut se supporter. Mais existera-t-il aussi communauté de femmes et d'enfants? N'y aura-t-il plus de naissances distinctes, plus de race assurée; plus de familles, plus de parenté, plus de liens du sang? Quelle tendresse conjugale peut-il y avoir entre les sexes, quand la possession n'est ni fixe, ni durable? Quelle piété filiale peut sentir celui qui ne sait de quel père il est né? quel homme peut aimer un fils, qu'il croira le fils d'autrui? Ce n'est pas tout : Platon ouvre le sénat aux femmes, il leur confie le soin de la guerre, les magistratures, les commandements. Mais quel sera le malheur de cette ville, où les femmes occuperont les fonctions des hommes! » Sans doute les personnages que faisait parler Cicéron ajoutaient encore à cette réfutation l'exemple de ces matrones romaines, si graves, si sévères, si modestes dans l'expression même de leur patriotisme, qui n'étaient point guerrières, comme les femmes de la république de Platon, mais qui donnaient naissance aux plus vaillants hommes de la terre ; qui n'immolaient pas les sentiments de la nature, comme les femmes de Sparte, mais qui savaient à la fois inspirer le courage de leurs fils, et les pleurer morts. On conçoit les vives couleurs, dont Cicéron avait dû peindre quelques-unes des belles traditions de la République sur la vertu des femmes. Peut-être aussi avait-il éclairci quelques faits singuliers, qui semblent contrarier ces traditions; par exemple, celui que Tite-Live place au commencement du quatrième siècle de Rome, la condamnation de cent soixante-douze femmes, la plupart de famille sénatoriale, convaincues d'empoisonnement sur la personne de leurs maris. Mais ce fait presque incroyable est unique dans l'histoire de la République ; et Rome était pleine de monuments consacrés à l'héroïsme des femmes. Fort anciennement même, l'éloge funèbre de toute femme illustre était prononcé sur la place publique, comme celui des premiers citoyens. Que de réflexions ne devait pas faire naître cet usage, et l'influence qu'on y attachait? Sans doute elles occupaient une place, dans ce quatrième livre. Peut-être Scipion ou Lælius entrait-il dans quelques détails sur l'éducation qui formait dans les femmes ces mœurs fortes et simples ; peut-être Scipion parlait-il de cette sublime Cornélie, sa sœur et son ennemie, moins heureuse et moins fière d'être la fille du premier Africain que de s'appeler la mère des Gracques. Un savant moderne nous a donné un curieux travail sur les éléments qui composaient la toilette d'une dame romaine, dans le siècle d'Auguste. Il serait plus intéressant de recueillir quelques particularités sur la vie des femmes, dans le siècle de Scipion, aux jours où la République, brillante de gloire, et éclairée par la lumière naissante des arts, conservait encore la pureté de.la discipline domestique et des mœurs. Comment se formait l'esprit délicat et ingénieux de ces femmes, près desquelles Cicéron, dans sa jeunesse, allait étudier les grâces de la diction romaine, la force et la beauté du langage, sans qu'elles eussent, comme l'Aspasie de Socrate, la prétention de donner des leçons aux rhéteurs? Quelques mots sur ce point de la civilisation romaine auraient été d'un grand prix. Le théâtre, cette histoire familière des mœurs, où chez nous les femmes occupent tant de place, instruit ordinairement à cet égard la postérité; mais le théâtre latin ne parle pas des femmes romaines : mœurs romaines, mais qui nous en laisse beaucoup ignorer. Dans tous les cas, on conçoit bien que Scipion ou quelque autre des interlocuteurs, avait dû parler de cette fameuse loi Oppia, rendue dans la crise de la guerre punique, et qui restreignait la parure et le luxe des femmes. Elle fut abrogée, avant la mort de Scipion, sur la demande de deux tribuns fort jaloux de popularité, et malgré la résistance et les prédictions chagrines de Caton. Tite-Live nous a conservé un tableau admirable de cette curieuse controverse: et il a vivement retracé la brigue publique et la sollicitation des dames romaines, pour soutenir leur orateur. Il s'agissait en effet de l'abolition d'une loi bien dure, puisqu'elle défendait « d'avoir sur soi plus d'une demi-once de parures d'or, de porter une robe à couleur mélangée, et d'aller en voiture traînée de deux chevaux, à Rome et dans les environs, à la distance de deux mille pas, excepté pour un sacrifice public. » On voit dans le grave Tacite la même question, modifiée par les temps et les mœurs, occuper plus d'une fois le sénat, et faire hésiter Tibère. Ne serait-il pas curieux de savoir comment elle fut jugée, dans l'origine, par les sages? et, à côté des austères réprimandes de Caton et des molles complaisances de deux tribuns, n'aimerions-nous pas à voir ce que pensaient sur ce point Scipion, Lælius, ou du moins ce que Cicéron croyait pouvoir leur attribuer avec vraisemblance? Au lieu de tout cela, que nous reste-t-il? Quelques phrases ramassées par les grammairiens, pour fixer une étymologie ou le sens d'un mot. Nous y voyons que par un principe d'éducation et de décence, toutes les femmes s'abstiennent du vin. Une loi de Romulus leur en avait autrefois défendu l'usage, sous peine de la vie. Quelques autres mots nous apprennent que, lorsque la réputation d'une femme était équivoque, ses parents refusaient de l'embrasser. Enfin, il nous reste encore une réflexion que faisait Cicéron sur les fonctions du magistrat qui, dans la Grèce, présidait à la conduite des femmes, avec une vigilance assez médiocre, s'il faut en juger par les comédies d'Aristophane. « N'imposons pas, dit-il, aux femmes la surveillance d'un magistrat particulier, comme celui qu'on élit chez les Grecs; mais ayons un censeur qui instruise les maris à gouverner leurs femmes. » Un autre point dont Cicéron s'était occupé dans ce quatrième livre, et sur lequel nous avons peu de lumières, c'était l'éducation de la jeunesse romaine. Tout le monde a lu le beau chapitre de Quintilien, sur le choix à faire entre l’éducation publique et l'éducation domestique : et on conclut des expressions de ce morceau, qu'il existait à Rome de vastes établissements, où les enfants de famille étaient réunis pour les études, et probablement vivaient en commun. Mais cette indication même, qui se rapporte au temps des Césars, ne nous dirait rien pour les époques antérieures; et elle nous laisse ignorer d'ailleurs quelle était la nature et la forme de ces établissements, s'ils appartenaient à l'État, s'ils étaient dirigés par son influence, si les maîtres en étaient rétribués sur les fonds du trésor, s'ils étaient placés dans un certain ordre de fonctions publiques, enfin quel rapport les écoliers avaient avec l'administration. Une lettre de Pline le Jeune nous le montre établissant à ses frais un instituteur, dans je ne sais quelle petite ville municipale; Horace nous parle des enfants de famille allant à l'école, leurs livres et leurs tablettes sous le bras; ailleurs, il se représente à nous conduit à Rome comme dans le chef-lieu de toutes les études, et fréquentant divers maîtres, toujours sous la garde incorruptible de son père ; enfin, il a bien voulu immortaliser le nom de l'un de ces maîtres, par une épithète assez bizarre. Mais ces détails et l'éducation qu'ils supposent sont d'une autre date que celle de la République, et ne nous apprennent rien sur le temps, dont Cicéron avait parlé dans son ouvrage. Nos fragments nouveaux donnent-ils à cet égard quelques idées précises et détaillées? Non; mais ils nous indiquent seulement que Polybe blâmait l'éducation de la jeunesse chez les Romains, en leur reprochant d'avoir négligé cette portion de l'ordre politique si honorée et si soigneusement surveillée chez les Grecs; et ce fait sert à comprendre comment il n'est resté que peu de notions historiques, sur un objet qui n'avait peut-être jamais été régulièrement fixé par les Institutions et les lois. Une autre cause explique l'absence d'un système d'éducation publique chez les Romains : c'est le caractère qu'y prenait l'autorité paternelle. On sait quelles étaient à cet égard les lois : le père était maître absolu de son fils, en disposait souverainement même au delà du premier temps de la jeunesse, pouvait le vendre jusqu'à trois fois, et le condamner à mort. Cette législation barbare venait de Romulus, et avait été conservée par les Décemvirs. Il en résultait qu'à Rome l'éducation, pour être assortie à ce principe, devait être toute de famille et tout intérieure; en cela fort différente de l'éducation de Sparte, où les enfants appartenaient à l'État beaucoup plus qu'à leurs parents. Ce fut même là un des traits distinctifs de la république romaine, si on la compare à toutes les autres. Il y resta toujours dans la constitution de la famille un principe de monarchie et môme de despotisme : le père était un dictateur domestique; et ce pouvoir était représenté par la belle expression d'un ancien : patria majestas, la majesté paternelle. L'adoucissement progressif, et même la corruption des mœurs romaines laissa subsister ce principe dans sa force, puisque nous voyons du temps de Cicéron un père rappeler par un simple ordre son fils, qui avait suivi Catilina, le juger dans sa maison, et le mettre à mort. On concevra dès lors que, dans les époques les plus reculées, dans celles dont Scipion pouvait parler, cet état de la famille chez les Romains, rapproché d'ailleurs de leur simplicité de mœurs, de leur vie agreste et guerrière, avait dû rendre les écoles publiques assez rares et peu nécessaires dans Rome. On ne saurait douter cependant qu'il en existât fort anciennement, même pour les femmes, puisque dans le drame sublime de la mort de Virginie, retracé par Tite-Live, cette jeune fille est représentée allant avec sa nourrice à une des écoles de lecture. Tite-Live indique par un mot la forme de ces écoles. Elles se tenaient dans des boutiques, près de la place publique. Sans doute d'autres écoles du même genre recevaient les jeunes Romains, pendant quelques heures de la journée. C'était l'usage chez les autres peuples de l'Italie voisins de Rome; et cet usage avait dû passer chez les Romains, comme l'atteste l'emploi du mot ludus, dans leur langue : mais il n'avait produit sans doute, comme l'indique aussi le choix de ce mot, que des écoles de peu d'importance, regardées comme un lieu de passe-temps, au milieu des rudes exercices du Champ de Mars, bornées à l'enseignement de quelques notions fort simples, et présidées sans doute par des affranchis, qui s'en faisaient une industrie, dont l'État avait fort peu à s'occuper. Quand les Romains de ces premiers temps de la République voulaient pour leurs enfants une instruction plus sérieuse et plus étendue, ils les envoyaient étudier chez les Étrusques : c'est un fait curieux attesté par Tite-Live. L'Étrurie, dans les premiers temps delà République, était pour les Romains ce que la Grèce fut quelques siècles plus tard. Ils en avaient tiré leurs augures, leurs auspices, plusieurs de leurs rois ; ils y cherchaient également l'espèce d'éducation littéraire, que comportait l'état de leur civilisation. « J'ai de bons garants, » dit Tite-Live, parlant du troisième siècle de Rome, « qu'alors les jeunes Romains étaient habituellement élevés dans l'élude des lettres étrusques, comme ils le sont aujourd'hui dans l'étude des lettres grecques. » On doit supposer, au reste, que ces expressions de l'historien ne s'appliquent qu'aux enfants des grandes familles de Rome, qui cherchaient à réunir en elles les lumières et toutes les dignités. Et on conçoit alors que ces études faites en Etrurie se liaient à cette science des auspices, dont les Étruriens étaient les inventeurs, et que la politique des patriciens se réservait exclusivement. Mais de là sans doute il ne résultait aucun système d'instruction publique et populaire. Si des écoles plus savantes s'établirent dans la suite à Rome, elles furent fondées par les Grecs, et plutôt avec la tolérance des chefs de l'État que par aucune vue de leur politique. Suétone nous dit que le goût de la grammaire, c'est-à-dire de la littérature, fut introduit dans Rome par un certain Crates Mallotes, que le roi Attale avait chargé d'une ambassade pour le sénat, dans l'intervalle de la seconde à la troisième guerre punique. Ce Grec, s'étant cassé la jambe à Rome, ne trouva rien de mieux à faire, pendant sa convalescence, que de donner des leçons publiques. Il eut des imitateurs parmi les Romains. Rome avait déjà quelques poètes : l'usage s'établit de lire, et sans doute de commenter leurs vers, devant des réunions nombreuses. Un certain Quintius Vargonteius faisait ainsi, à jours fixes, des lectures du poème d'Ennius. D'autres Romains, parmi lesquels on nommé Lælius, lurent en public les satires de Lucile. Les maîtres de philosophie, d'éloquence se multiplièrent. Mais il semble qu'alors ces études nouvelles étaient plutôt une distraction recherchée par les hommes, qu'elles n'entraient dans un système d'éducation pour la jeunesse; elles trouvèrent d'ailleurs bientôt de grands obstacles dans la défiance des magistrats. Suétone a conservé sur ce point deux actes infiniment curieux, l'un est un ancien édit de préteur ainsi conçu : « Caius Fannius Strabo, Marcus Valerius Messala, étant consuls, Marcus Pomponius, préteur, a fait rapport au sénat; et, sur ce qui a été dit touchant les philosophes et les rhéteurs, le sénat a décrété que Marcus Pomponius, préteur, y prit garde, et qu'il eût soin dans l'intérêt de la république et pour l'acquit de son devoir, de ne point laisser ces hommes dans la ville. » Un autre édit d'une époque moins reculée, en exprimant la même réprobation de toutes ces sciences nouvelles, indique l'existence dans Rome d'autres écoles anciennement approuvées par l'État, et qui sans doute étaient ces écoles inférieures, dont nous avons parlé. Voici les termes de ce singulier monument : « Enæus Domitius Ænobarbus et Lucius Licinius Crassus Censeurs ont déclaré ce qui suit : Nous avons été informés qu'il y avait des hommes qui ont établi un nouveau genre d'instruction, et près desquels la jeunesse affluait dans les écoles ; que ces hommes s'étaient donné le nom de rhéteurs latins ; que les jeunes gens restaient là des journées entières. Nos aïeux ont réglé ce qu'ils voulaient enseigner à leurs enfants, et quelles écoles ils voulaient leur faire suivre. Ces nouveautés qui choquent la coutume et l'usage de nos aïeux, nous déplaisent et ne nous paraissent pas bonnes : ainsi, il nous semble nécessaire de faire connaître, et à ceux qui tiennent ces écoles, et à ceux qui ont l’habitude d'y venir, notre décision, que cela nous déplaît. » Cet édit, qui semble plutôt une censure morale qu'une interdiction, n'empêcha pas sans doute la jeunesse romaine de courir à ces écoles d'éloquence, qui offraient tant d'attraits à la curiosité, et où même l'ambition politique pouvait chercher des instruments de succès, pour, les combats du Forum. L'éloquence avait été certainement cultivée à Rome, dès les premiers jours de la république. Fit-on jamais une révolution populaire sans éloquence? et le Tribun seul n'était-il pas un grand maître de rhétorique? Mais cette éloquence avait été d'abord inspirée par les passions et la nécessité, plutôt que soutenue et développée par l’étude. Lorsque les lettres grecques se présentèrent, on les reçut comme un secours, en dépit de la résistance des magistrats. Caton même, l'ennemi de la philosophie et des arts, finit par apprendre la langue grecque. Les deux premiers grands orateurs de Rome, les Gracques, fortifièrent dans l'étude des lettres attiques leur génie naturel. Dès cette époque, où la république romaine était déjà si puissante, si remplie de richesses, le luxe des grands fut d'avoir près d'eux et pour leur usage un grammairien, un rhéteur, ou un philosophe grec. Tibérius Gracchus avait pour commensal et pour ami un célèbre philosophe grec, dont la conversation le fortifia dans ses hardis desseins. Il est inutile de rappeler que Scipion s'était également attaché deux Grecs d'un esprit supérieur, Polybe et Panætius. Un des premiers maîtres d'éloquence et de philosophie, qui s'était illustré dans Rome, Aurelius Opelus, quitta ce brillant théâtre par dévouement au vertueux Rutilius, et pour le suivre, dans son exil à Smyrne. Enfin, Cicéron fut un des plus zélés auditeurs de ces Grecs ingénieux, qui venaient réciter dans Rome les traditions du génie de leurs grands hommes, et s'exerçaient eux-mêmes à des déclamations sur des sujets factices. Il paraît que ce fut dans ces écoles grecques établies à Rome, que Cicéron, dès l'enfance, excita l'admiration notée par Plutarque : car, il nous apprend quelque part, que les hommes graves qui dirigeaient ses études, ne lui permirent pas d'aller entendre les rhéteurs romains, et particulièrement un certain Plotius, qui le premier s'était avisé de professer en langue latine, et qui attirait un grand concours. On aimerait, sans doute, à savoir dans les dialogues de la République, comment Cicéron jugeait l'influence morale de ces études oratoires, qu'il ne considère ailleurs, que sous le rapport de l'art et du génie. Il nous eût sans doute révélé, par la bouche des illustres Romains qu'il mettait en scène, beaucoup de précieux détails sur cette première époque de culture littéraire et de politesse sociale, dont Scipion fut contemporain. A son défaut, le hasard nous a conservé un monument fort singulier de cette même époque, un passage d'une harangue authentique du principal interlocuteur employé par Cicéron, de Scipion Émilien lui-même, passage qui porte précisément sur la molle éducation des jeunes Romains, et sur l'abus que l'on faisait déjà des arts d'agrément. Ce morceau précieux, transcrit par le compilateur Macrobe, se trouvait dans le discours que Scipion prononça contre la loi proposée par Tibérius Gracchus, pour ôter au Sénat le pouvoir judiciaire. Ce sont des réflexions qui sans doute faisaient partie de quelque avertissement sévère, que Scipion adressait aux patriciens, dont il défendait la cause, en blâmant leur luxe et leurs vices, qui compromettaient leur pouvoir. « On enseigne, dit-il, à nos jeunes Romains des arts prestigieux et déshonnêtes. Au milieu de petits baladins, de guimbardes, de flûtes, ils vont dans une école d'histrions; ils apprennent à chanter, chose que nos ancêtres voulaient que l’on regardât comme honteuse pour les personnes de condition libre! Je le répète, les jeunes vierges, les jeunes Romains vont dans une académie de danse, parmi les baladins. Quelqu'un m'ayant raconté cela, je ne pouvais me persuader que des patriciens donnassent une semblable instruction à leurs enfants; mais m'étant fait conduire dans une école de danse, j'ai vu dans cette école plus de cinq cents jeunes garçons et jeunes filles, et dans ce nombre (ce qui me fit pitié pour la République) le fils d'un candidat, un enfant qui n'avait pas moins de douze ans, et qui dansait aux cymbales, exercice qu'un esclave débauché ne pourrait a faire sans déshonneur. » Cette molle éducation de la jeunesse, ces danses ioniennes dont se plaint Horace, ou des danses qui ne valaient pas mieux, avaient, comme on le voit, précédé de longtemps la monarchie d'Auguste. Scipion, auquel un historien attribue l'introduction du luxe dans Rome, Scipion, accusé lui-même par l'austère Caton d'être un corrupteur de la vertu romaine, avait déjà besoin de réprimander les mœurs de son temps. Il avait voulu donner à sa patrie la politesse et les arts : et il était devancé par le débordement du luxe et des vices. Cette corruption hâtive et précipitée des Romains doit trouver, ce me semble, encore son explication dans leur négligence à l'égard de l'éducation publique. Ils n'avaient pas, comme les Grecs, cette foule de jeux, d'exercices et de fêtes établis, pour développer les corps et les âmes de la jeunesse. Leurs exercices étaient uniquement bornés à la guerre. Ce n'était pas cette gymnastique élégante de la Grèce. C'était seulement un apprentissage militaire commencé dans le Champ de Mars, et continué sous le drapeau, pour se rendre plus capable de soutenir de longues marches, de porter de lourds fardeaux, et de manier adroitement les armes. Nulle image de ces danses graves et religieuses, où paraissaient les jeunes files de l'Attique, la tête couronnée de fleurs ; point de ces chœurs de musique, ou chantaient les vieillards, les jeunes hommes et les enfants; point de ces théories gracieuses qui parcouraient, aux sons de la lyre, les flots et les rivages de la Grèce ; point de ces jeux olympiques, où l'on couronnait tour à tour la force de l'athlète, l'art du musicien et le génie du poète. Rome avait méprisé, dans l'instruction de ses enfants, tout ce qui ne servait pas immédiatement à la guerre ; elle n'eût pas compris comment le plus habile général de la Grèce avait su danser et jouer de la flûte. Qu'arriva-t-il de cette rude indifférence? Ces mêmes choses que Rome avait dédaignées comme des arts, elle les reçut bientôt comme des vices, alors qu'elles entrèrent dans son sein, avec tout le cortège du luxe asiatique, et qu'elles furent trouvées, pour ainsi dire, dans le butin de la victoire, parmi des amas d'esclaves qui en étaient les précepteurs, les dépositaires, et qui empoisonnaient de leur corruption ces sciences frivoles et innocentes, dont les magistrats de la Grèce avaient su jadis faire un instrument de gloire et d'enthousiasme. Cicéron, qui, d'après les nouveaux fragments du quatrième livre de la République, adressait aux peuples de la Grèce des reproches trop fondés, et accusait avec justice l'infâme souillure qui déshonorait trop souvent les mœurs de leur jeunesse, avait-il également reconnu ce qui manquait à l'éducation de ces Romains infectés sitôt par tous les vices du reste de la terre? Il parait avoir blâmé cette bizarre institution qui exerçait au larcin les enfants de Sparte. Il félicite Rome de n'avoir jamais eu de plan d'éducation uniforme et publique ; mais, n'avait-il rien à blâmer dans ces institutions domestiques confiées, dans Rome, presque toujours à des affranchis, ou à des esclaves? N'était-ce pas, pour les plus riches Romains, une déplorable grandeur, que celle qui leur permettait de ne placer auprès de leurs enfants, pour les instruire même dans les plus hautes études, que des hommes de condition servile, achetés chèrement, à cause de leurs talents, comme ce Dionysius, dont Cicéron admirait le savoir, qu'il avait affranchi, pour lui confier le soin d'élever son fils et son neveu, et par lequel il fut lâchement trahi! L'instruction n'est qu'une partie de l'éducation. Quel enseignement libéral un esclave peut-il donner? La timidité, la flatterie, l'abjection d'âme attachée à son sort, ne doivent-elles pas altérer, dans sa bouche, ce que la science a de plus noble et de plus pur? N'est-il pas tenté naturellement de faire des calculs sur les vices du maître qu'il élève? Si on cherche la cause principale de cette corruption, trop fréquente dans les derniers temps de la République et sous l'Empire, on la trouvera peut-être dans l'usage de donner pour précepteurs aux jeunes patriciens et même aux héritiers des Césars, de misérables affranchis, pour qui la science n'était qu'un métier appris dans l'esclavage, et qui la transmettaient, comme ils l'avaient reçue, sans en faire la force et la lumière de l'âme. Au reste, ce ne serait pas le seul exemple de cette justice de la Providence, qui veut que les vices produits par l'oppression servent à corrompre encore les oppresseurs, et qui leur renvoie ainsi la plus grande partie du mal qu'ils ont fait. Aussitôt que, chez les Romains, l'austère simplicité de l'éducation paternelle eut fait place à l'enseignement de ces arts étrangers qu'apportaient des esclaves ou des vaincus, aucune institution publique n'étant établie pour en régler l'usage, la pente vers la corruption fut irrésistible; et on vit paraître cette insatiable frénésie de jouissances qui, nourrie sans cesse par les trésors de la conquête, enfanta ces prodigieux raffinements de luxe et de débauche, dont l'histoire de Rome est remplie. Ils étaient portés à l'excès du temps de Cicéron, et le siècle de Scipion les avait vus naître et se développer rapidement. Les efforts de la législation, pour arrêter ce torrent, les diverses métamorphoses du luxe, pour éluder les lois somptuaires, la nature même et la succession de ces lois, leur sévérité décroissante, et pour ainsi dire, la corruption progressive qui les gagnait elles-mêmes, ou les rendait inutiles : voilà des choses qui, dans les idées de l'antiquité, tenaient de trop près à l'histoire de la Constitution romaine, pour ne pas occuper une grande place dans l'ouvrage de Cicéron. Nous voyons dans Tacite que, sous les empereurs, ces questions étaient encore agitées dans le sénat, bien que le despotisme n'ait rien à redouter du luxe et de la mollesse. Combien ne devaient-elles pas avoir eu d'importance, à une époque on la liberté florissante et jalouse s'effrayait de tout ce qui portait atteinte aux anciennes mœurs!Tout ce qui, chez les Romains corrompus, produisit dans la suite tant d'inventions bizarres de faste et de débauche, avait été d'abord réprimé par les lois. Nous avons vu celle qui restreignait la parure des femmes. Le luxe de table attira également des prohibitions sévères : il paraît même que l'on ordonna, pendant quelque, temps, de tenir, aux heures des repas, les portes des maisons ouvertes, et de ne souper que sous les yeux et, pour ainsi dire, sous la censure du public. C'était un acheminement vers l'institution de ces tables communes établies à Lacédémone, et qui ne pouvaient guère convenir à Rome, divisée eu deux ordres inégaux, et sans cesse enrichie par le butin de la guerre. Aussi cette loi ne dura point; et on se borna bientôt à régler par d'autres décrets la forme et la magnificence des repas. La loi Orchia intervint la première : elle réduisit le nombre des convives. Cette disposition ne tarda pas à être violée, malgré les plaintes et les cris de Caton qui, dans ses harangues, revenait souvent sur cet éternel abus des invitations à dîner. Vingt-deux ans après, une loi plus forte et mieux observée parut nécessaire : et l'on rendit la loi Fannia; elle avait été présentée par les Consuls, et sur le vœu de tous les gens de bien. « Car, dit un auteur ancien, cité par Macrobe, le mal était venu à ce point, que la plupart des jeunes citoyens vendaient, pour les jouissances de table, leur honneur et leur liberté, et que beaucoup de gens du peuple romain se rendaient pris de vin à l'assemblée des comices, et délibéraient dans un état d'ivresse sur le salut de la République. » Un orateur, qui soutint le projet de loi, porta plus loin l'amertume de ces descriptions, et représenta ceux de ses concitoyens qui exerçaient les fonctions de législateurs et de juges, sous des traits peu conformes à nos idées de la dignité romaine, et trop librement énergiques pour permettre une traduction entièrement fidèle : « On reste, dit-il, à jouer aux dés, la tête parfumée d'encens, parmi des courtisanes, dix heures arrivent-elles, on fait venir un esclave, que l'on charge d'aller sur la place s'enquérir de ce qui a été fait dans le forum, quels orateurs ont parlé pour ou contre, combien de tribus ont décrété l'adoption d'une loi, combien ont voté le rejet. On arrive aux comices, triste et appesanti; on ordonne aux orateurs de parler: ceux dont c'est l'affaire parlent. Le juge appelle les témoins; puis il sort pour quelques besoins; il rentre, il dit qu'il a tout entendu, il demande les bulletins, il regarde les votes. A peine soutient-il ses paupières « demi-fermées par l'ivresse. Au moment de délibérer, voici son discours: Qu'ai-je à faire avec tous ces drôles? Que ne suis-je plutôt à boire du vin doux mêlé de vin grec, à manger une grive bien grasse, ou quelque bon poisson, un vrai loup du Tibre, péché entre les deux ponts? » La loi Fannia réglait la dépense de la table : elle la fixait habituellement à dix sous d'airain par jour, portait cette somme à trente sous, pendant dix jours de chaque mois, et retendait jusqu'à cent sous, pendant les jeux romains, les saturnales, et quelques autres jours privilégiés. Douze ans après, cette loi trop faible et hors d'usage fut fortifiée par la loi Didia, qui appliquait à toute l'Italie des prohibitions bornées d'abord aux habitants de Rome, et qui rendait passibles des peines fixées, non seulement ceux qui auraient donné des festins défendus, mais tous les convives et tous les assistants. Nous ne parlerons pas des lois qui suivirent, et particulièrement d'une loi somptuaire, portée par le dictateur Sylla, monument de luxe bien plus que de sévérité1, puisqu'elle s'occupait seulement de taxer le prix des mets, et qu'elle en énumérait une quantité prodigieuse, composés des substances les plus rares. Mais on voit que, bien avant cette époque, et dans!e temps seul qui nous occupe, les désordres de la table avaient été portés assez loin ; et on peut supposer que, dans le quatrième livre de la République, Scipion ne faisait pas sur ce point des plaintes moins inutiles et moins sévères que sur les danses corruptrices de la jeunesse romaine. Le luxe de la parure, faiblement réprimé dans les femmes par la loi Oppia, se communiquait aussi dès lors â ces Romains, qui longtemps n'avaient eu d'autre ornement que leurs armes et les couronnes de chêne conquises sur le champ de bataille. Ce luxe, fort différent dans nos États modernes, où il n'est considéré que comme un objet de commerce, pouvait avoir trop d'influence sur des mœurs républicaines pour ne pas inquiéter le zèle des bons citoyens. On sait quel soin les Romains avait apporté au choix, à la distinction graduée, à la simplicité des vêtements : la dignité de la toge caractérisait la paisible autorité du commandement. Le respect pour la toge romaine faisait considérer la moindre altération dans la forme d'un si noble vêtement, comme un luxe blâmable. Nous pouvons encore invoquer sur ce point l'autorité de Scipion lui-même. Dans un passage rapporté par Aulu-Gelle, Scipion s'élevant avec amertume contre un certain Sulpicius Gallus, dont il accusait publiquement les mœurs et la vie dissolue, lui reprochait, entre autres griefs, de paraître dans les festins avec une tunique à longues manches. Nous voyons ailleurs que Virgile désigne ces tuniques comme une parure efféminée, peu faite pour une jeunesse guerrière : Et tunicæ manicas et habent redimicula mitræ. Cet éloignement pour un luxe si commun dans l'Asie, et même dans la Grèce, se concevra sans peine, si on songe qu'à Rome le commerce fut longtemps ignoré ou méprisé. La monnaie même, agent principal du commerce, n'y était point connue, dans les deux premiers siècles. On ne frappa de pièces de cuivre que sous le règne de Servius; et le métal d'argent ne fut employé au même usage, qu'après les guerres contre Pyrrhus, et cinq années seulement avant la première guerre punique. Enfin, l'or monnayé n'eut cours que soixante-douze ans après cette époque, c'est-à-dire, du temps même de Scipion. Pline observe même que les Romains n'exigeaient pas des peuples vaincus de l'or pour rançon, et que dans le tribut imposé aux Carthaginois, après la défaite d'Annibal, ce métal n'est point spécifié. Il était, à cette époque, d'un usage fort rare à Rome ; et, suivant une autre remarque de Pline, ce ne fut qu'après la troisième guerre punique et la ruine de Carthage, que l'on dora les lambris du Capitole, magnificence qui, sous les empereurs, devint commune dans les maisons des simples particuliers. Ces faits, qui supposent bien peu de développement donné au commerce, expliquent comment» lors même que la conquête de tant d'États eût livré à Rome les productions et les industries du reste du monde, le négoce était encore, aux yeux des admirateurs de l'ancien temps, une profession avilissante, compagne du luxe et de la décadence. Ce qui paraissait autrefois une occupation indigne d'un peuple laboureur et guerrier, paraissait alors également indigne d'un peuple dominateur. Les lois fiscales, les taxes sur les produits que le commerce étranger apportait à Rome, ne semblait pas non plus un mode assez honorable de remplir ce trésor de la République, enrichi par la dépouille des rois, « Je ne veux pas, » disait Scipion, dans une phrase de ce quatrième livre conservée par le grammairien Nonius, « je ne veux pas que le même peuple soit le roi et l'entreposeur de l'univers; et j'estime, que pour les États, comme pour les particuliers, le meilleur revenu c'est l'économie. » Une telle maxime suffirait pour indiquer la prodigieuse différence qui sépare les temps anciens de nos temps modernes, où l'on trouverait peut-être, que le peuple roi est précisément celui qui est en même temps le facteur et le douanier de l'univers. A côté des progrès du luxe matériel, jugés suivant les opinions de l'antiquité, Cicéron avait dû traiter plus soigneusement encore ce qui tient au luxe de l'esprit, les arts, les lettres, les théâtres, tout ce brillant cortège de la civilisation et de la richesse. Rien n'était plus ancien, chez les Romains, que les fêtes et les pompes publiques. Mais ces fêtes, assorties d'abord au goût d'un peuple de pâtres et de soldats, avaient conservé l'empreinte de cette rude origine ; et lors même que la magnificence et le génie des arts étaient venus les embellir, il y était resté quelque chose de dur et de barbare comme les premières mœurs qui les avaient inspirées. Fort anciennement, les citoyens prenaient part aux combats du cirque, soit par eux-mêmes, soit en y faisant paraître leurs chevaux ou leurs esclaves. Pline le naturaliste cite un fragment de la loi des Douze Tables relatif aux récompenses et aux couronnes qui pouvaient s'obtenir ainsi dans ces jeux guerriers. Cela, comme on voit, se rapprochait assez des coutumes élégantes de la Grèce, dans ses fêtes d'Olympie. Mais le jeu sanguinaire des gladiateurs n'appartenait qu'à Rome, ou du moins aux Samnites, à qui Rome l'avait emprunté. Cicéron, dans aucun de ses ouvrages connus, n'a réprouvé cet affreux usage qui faisait du sang et du meurtre le passe-temps des spectateurs romains. N'en avait-il rien dit dans ce quatrième livre? L'exemple de Platon, si attentif à rendre les guerriers de sa république aussi humains que braves, et à fortifier leurs muscles et leurs âmes par des exercices sans danger pour les vertus morales, ne lui avait-il pas fait sentir, sur ce point, ce qui manquait aux vieilles mœurs romaines? Nous l'ignorons et nous en doutons : telle est la puissance d'un préjugé national sur les plus beaux génies d'une nation! Les Romains, il faut le dire, comparés aux Grecs, ne furent jamais que des sauvages civilisés, des barbares pleins d'un admirable talent d'imitation, et instruits, à force d'art, dans une urbanité qui ne passait pas jusqu'au fond de leurs mœurs, et qui polissait leur langage, sans humaniser leur nature. La guerre continuelle, le besoin de la destruction ou de l'esclavage des autres peuples, renouvelaient sans cesse en eux cette férocité primitive. Les combats de gladiateurs avaient été d'abord, dans leurs usages religieux, une espèce d'hécatombe offerte à la mort, et par laquelle on honorait les funérailles des citoyens illustres. Le goût du sang inné dans ce peuple en fit bientôt une partie nécessaire de toutes les fêtes publiques, et de ces jeux sans nombre consacrés à la foule des divinités que Rome adorait. Comment Scipion Émilien, malgré son atticisme, aurait-il blâmé cette coutume? Nous lisons dans l'histoire que le premier Africain, son illustre et vertueux modèle, donna dans Carthagène un spectacle de gladiateurs, d'où Von rejeta les esclaves comme un sang trop vil, et où l’on n'admit que des hommes de condition libre, qui se dévouaient à la mort, pour plaire au général. Sien plus, deux jeunes princes d'Ibérie, parents et issus des deux sœurs, se disputaient alors le misérable trône d'une ville soumise à la protection romaine. Scipion leur permit de combattre corps à corps dans cette fête sanglante, avec un acharnement qui ne se termina que par la mort du plus jeune, et qui, ajoute froidement Tite-Live, fit voir à l'armée, par un remarquable exemple, combien la passion du Pouvoir est un dangereux fléau pour les mortels. Il est à croire que la philosophie, complice de l'orgueil et de l'ambition de Rome, n'éleva aucune plainte contre cette barbare coutume, et laissa le peuple jouir d'un spectacle, que l'on croyait salutaire au courage, et politiquement utile. Cette réclamation, comme beaucoup d'autres, était réservée au christianisme, qui la fit entendre dans les premiers siècles de l'empire, où ce genre de férocité, mêlé à des mœurs molles et lâches, était devenu encore plus révoltant. Et cependant telle était la puissance d'une atroce habitude, que les combats de gladiateurs se renouvelèrent même sous les empereurs chrétiens, et ne cédèrent qu'à la longue opiniâtreté de l'éloquence évangélique. Le poète Prudence, dans le quatrième siècle, représentait en vers énergiques ces affreux spectacles, et les jeunes Romaines attentives aux vicissitudes du combat, à la chute du vaincu, et donnant elles-mêmes le signal de sa mort : .................................. Pectusque jacentis Virgo modesta jabet conversa pollice rumpi. Il pressait Théodose le Jeune d'abolir ces jeux barbares, et de mériter cette palme d'humanité, que son père lui avait laissée à cueillir. « Plus de supplicié, disait-il, dont la souffrance soit un amusement public. Que ce cirque odieux, satisfait du sang des bêtes, ne se fasse plus un jeu des meurtres humains. » Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam, Quodque patris superest, successor laudis, habeto. Nullus in urbe cadat, cujus sit pœna voluptas. Jam, solis contenta feris, infamis arena Nulla cruentatis homicidia ludat in amis. Rome chrétienne avait encore besoin de telles leçons ; et il y avait cependant plus de six siècles que Térence avait fait applaudir, dans l'Andrienne, ce beau vers qui semblait inspiré par l'humanité la plus tendre : Homo sum, et humani nihil a me alienum puto! Tant les maximes ont peu d'influence sur les mœurs! Au reste, si le théâtre romain avait quelquefois retenti d'accents si purs, il avait été plus souvent l'imagé d'une société corrompue ; et peut-être les sages de l'ancienne Rome s'étaient-ils montrés moins indulgents pour la licence de la scène que pour la cruauté du cirque. On connaît ce trait de Caton assistant aux jeux de la déesse Flore, et sortant de l'assemblée, parce que le peuple n'osait pas, sous ses yeux, demander la représentation de quelques bouffonneries obscènes, qui faisaient un accessoire ordinaire de la fête. Quelle que soit l'idée que cette anecdote nous donne du caractère des jeux scéniques, n'oublions pas que ces jeux, à Rome, comme dans la Grèce, avaient une origine religieuse. Ce fut l'an 391 de Rome, après les ravages d'une maladie contagieuse, qu'on employa ce moyen de conjurer le fléau et d'apaiser les dieux. Ce n'était d'abord qu'une sorte de pantomime jouée par des Et ru riens appelés pour cet usage. Ensuite, la jeunesse romaine, mêlant à l'imitation de ces danses des plaisanteries en vers grossiers, il en naquit un art nouveau. Des histrions romains se formèrent; et bientôt s'exercèrent à des représentations nommées satires, mélange de chants, de danses, et de vers semblables à ces vers fescennins dont parle Horace. Livius Andronicus fut le premier qui remplaça ces satires par des espèces de fables dramatiques. Rien n'était plus imparfait et plus grossier que ces commencements. L'auteur, à ce qu'il parait, représentait à lui seul toute sa pièce. Un premier pas vers le progrès de l'art fut la permission donnée à Livius de se faire aider par un enfant qui chantait, tandis que lui-même continuait à faire la pantomime. La loi s'occupa bientôt de réprimer les écarts de ces jeux nouveaux, et les réduisit, comme dit Tite-Live, à être un art. Alors de jeunes Romains empruntèrent aux Osques, peuple d'Italie fort anciennement civilisé, une autre forme de drame plus régulier, plus décent, et qui prit le nom d'atellanes, genre de composition théâtrale, dont il ne nous reste aucun vestige. Avec quelle curiosité n'aurions-nous pas entendu Scipion, le protecteur et l'ami déférence, expliquer .es progrès de cet art du théâtre qui, se développa si vite à Rome, et en marquer l'influence sur les mœurs publiques! De précieux et trop courts fragments de cette partie du quatrième livre nous ont été conservés. On y voit les différences, assez connues, qui séparèrent le théâtre romain de celui des Grecs, et ne permirent jamais qu'il eût le même génie et la même puissance. Mais ces fragments nous laissent bien des questions à faire et des doutes insolubles. Quant à la tragédie romaine, il ne paraît pas qu'elle ait pu fournir, du temps de Scipion, beaucoup de remarques et de vues morales. Elle était toute grecque et toute mythologique. Cicéron aimait et citait les vieux poètes, qui donnèrent à cette tragédie quelque énergie mêlée de rudesse. Il leur enlève souvent des expressions hardies et nerveuses, dont il admire la force, dans un temps où la poésie romaine était encore si loin de la perfection. Mais ces mêmes poètes, considérés sous un point de vue plus élevé, ne pouvaient rien lui offrir de ce que la tragédie d'Athènes présentait aux méditations des sages et au patriotisme des citoyens. Ennius, qui chanta en vers héroïques les actions des Romains, n'avait mis sur la scène que les traditions de la Grèce. Pacuvius, contemporain de Scipion, n'avait traité aucun sujet national, et n'avait ainsi fait de la tragédie qu'une œuvre Littéraire, une imitation des fables de la Grèce. Ce ne fut que plus tard, et presque du temps de Cicéron, que l’idée vint au poète Accius de mettre sur la scène l'expulsion des Tarquins. Mais jusque-là Hécube, Priam, Oreste, Achille, Agamemnon, et tout ce fonds de tragédie grecque qui dure encore, avait seul occupé le théâtre romain. Du reste, ce point admis que, chez les Romains, la tragédie fut d'abord et longtemps étrangère à toute intention politique et nationale, il restait à examiner, pour Scipion et pour ses amis, l'influence que pouvaient avoir sur les mœurs de la république ces représentations tout idéales, toutes littéraires, des crimes, des passions, des aventures qui formaient les annales héroïques de la Grèce. De plus, ces premières tragédies d'Ennius et de Pacuvius, imitées entièrement de Sophocle et d'Euripide, étaient pleines des maximes et des sentences de la philosophie grecque : et cette philosophie, ainsi rendue populaire, était une innovation qui avait son importance. Cicéron, dans un ouvrage entièrement philosophique, dans les Tusculanes, a blâmé la morale de la tragédie, les fausses idées qu'elle donnait des héros et des dieux, et le tort même qu'elle faisait à la nature humaine, en la montrant faible, furieuse, abattue par la douleur. Il a supposé que ces spectacles de larmes et de désespoir affaiblissaient les âmes; et cette observation, empruntée de Platon, porte évidemment sur les mœurs de la tragédie grecque, où, comme on le sait, tous les excès de la souffrance, et même les cris et les gémissements de la douleur physique, étaient un moyen convenu d'attendrissement et de terreur. De là Cicéron conclut, dans ce passage, que Platon avait eu raison, en traçant sa république idéale, d'en bannir ces poètes qui, par leurs accents trop pathétiques, brisent la mâle vigueur de la vertu. Mais, malgré cette proscription philosophique une première fois exprimée, je ne suis pas convaincu qu'il ait dû reproduire le même anathème dans la théorie de sa propre république, beaucoup moins spéculative que celle de Platon. Les Romains du temps de Scipion n'étaient pas comme les Grecs de l'Académie, ou comme les Français du siècle de Rousseau, des hommes fatigués de toutes les jouissances littéraires, et ramenés par la satiété même de ce noble délassement à une sorte d'austérité systématique et paradoxale, qui discute et réprouve ses propres émotions. Platon argumente sérieusement contre les vices de la morale d'Homère. Le premier Scipion, au contraire, avait encouragé de son admiration et de son amitié le viens Ennius, qui traduisit pour les Romains l’Iliade avec tous les beaux délires dont elle est remplie. La poésie, les fables héroïques, les traditions de la Grèce, étaient alors, pour les Romains, une passion de jeunesse, à laquelle ils se livraient sans calcul. Le second Scipion, l'Émilien de nos dialogues, était encore plus épris des lettres, et y portait un sentiment plus délicat et plus élevé. Celui qui, vainqueur de Carthage, et voyant, d'une colline élevée, l'incendie de cette malheureuse ville, et la chute de ses palais abîmés dans les flammes, redisait, les yeux en pleurs, et en songeant à Rome, les beaux vers d'Homère : « Un jour viendra que la ville sacrée de Troie, et Priam, et le peuple du vaillant Priam, seront anéantis; » cette âme douce et fière, tout émue du charme encore nouveau des beaux-arts, devait jouir du grand pathétique des tragédies grecques transportées sur le théâtre romain, plutôt que de discuter subtilement le danger que ces attendrissantes peintures pouvaient avoir pour la fermeté stoïque. Dans un autre ouvrage, Cicéron nous a retracé, par la bouche de Lælius, les vertueuses et pures émotions qu'excitait dans l'âme des Romains la belle scène imitée du théâtre grec, où les deux héros, de l'amitié, Oreste et Pylade, se disputaient l'honneur de mourir l'un pour l'autre, et où chacun des deux amis se prétendait la victime, que le tyran voulait immoler. Du reste, ou ce même Lælius, ou Scipion avait blâmé, dans le quatrième livre de la République l'abus que les poètes dramatiques pouvaient faire quelquefois de la puissance qu'ils exerçaient sur les cœurs égarés par le prestige du théâtre. Saint Augustin nous en a conservé la preuve dans un passage où lui-même, avec sa pureté chrétienne, s'élève contre les fictions dangereuses dont la mythologie remplissait les théâtres. Il représente la faiblesse des lois et des prohibitions morales contre les exemples de ces dieux qui, dit-il, « semblaient multiplier et semer les crimes, en les faisant solennelle-u ment connaître au peuple, parmi les pompes de la scène, comme des actions qu'eux-mêmes avaient faites, afin que la perversité humaine fût animée par une autorité divine. » Il ajoute : « Vainement Cicéron réclamait-il ; vainement s'écriait-il en parlant des poètes : Lorsque ces hommes se voient encore appuyés par les cris et les suffrages du peuple, sage et beau précepteur sans doute, que de ténèbres ils répandent! que de vaines terreurs ils inspirent! que de passions ils enflamment! » Cette corruption du théâtre, touchant les fausses idées qu'il donnait des dieux, les vices qu'il leur attribuait, était le tort commun de tout le paganisme-, mais l'empreinte dut en être plus sensible encore dans la comédie que dans la tragédie. Les courroux injustes, les ressentiments implacables imputés aux dieux, sous la loi suprême d'une inexplicable fatalité, étaient bien moins dangereux pour le sentiment moral, que la peinture trop libre de leurs ridicules aventures et de leurs humaines faiblesses. Là, nécessairement, l'incrédulité sortait de l'image du vice ; et le culte périssait avec les mœurs. Les vieux Romains qui croyaient au dieu du Capitole, ne devaient-ils pas voir d'un front chagrin, Plaute lui faisant jouer la comédie, suivant son expression? et les défenseurs des anciennes mœurs, dans lesquelles l'adultère d'une femme était puni de mort, ne devaient-ils pas s'inquiéter, qu'aux yeux du peuple, ce délit fût consacré par l'exemple de Jupiter? On sait jusqu'à quel point avait été portée à cet égard la hardiesse du théâtre d'Athènes et l'impiété d'Aristophane, l'accusateur de Socrate. Le théâtre romain ne prenait pas des libertés! moins étranges : on y voyait tous les caprices amoureux de Jupiter; on y voyait sa mort; et on y entendait lire sous son nom un testament burlesque. La chaste Diane, était ignominieusement fouettée sur la scène. Il y paraissait trois Hercules, dont la voracité famélique était un sujet inépuisable de bouffonneries. La loi n'avait mis aucun terme à cette licence. Elle avait protégé contre toute attaque injurieuse la réputation des citoyens, mais nullement celle des dieux. Aussi saint Augustin, frappé de cette apparente contradiction, s'écrie-t-il, en faisant allusion au traité de la République, et en apostrophant le principal interlocuteur de ce dialogue : « Eh quoi! Scipion, vous louez cette précaution qui interdit aux poètes l'injure contre tout citoyen romain, tandis que nul des dieux n'est épargné! Vous tenez donc plus à la considération du sénat qu'à celle du Capitole : Rome vous parait plus a digne de respect que le ciel. De sorte que les poètes ne peuvent exercer leur malignité contre vos concitoyens, et que, tranquilles à l'égard des dieux, ils peuvent leur prodiguer l'insulte, sans que ni censeur, ni magistrat ni pontife les empêche. Il a paru scandaleux apparemment, que Plaute, que Nævius pût médire des Scipions, ou Cæcilius de Caton : et il a paru convenable que votre ami Térence excitât les vices d'un jeune homme, par l'exemple de Jupiter très-grand et très bon. » Le passage auquel l'apôtre chrétien fait une allusion si sévère, est, au reste, le seul qui, dans les six comédies de Térence, soit marqué d'une telle empreinte. Partout ailleurs ce pur et gracieux écrivain, lors même qu'il peint la passion sous de vives couleurs, conserve la décence du langage, et respire même une sorte de bonté morale, qui sans doute n'est pas la vertu, mais qui n'est dénuée ni de charme, ni de puissance, La politesse et la dignité de Scipion semblent avoir passé sur ces élégants ouvrages; et sans doute c'est à Térence que s'appliquait, dans le dialogue de la République, cette définition de la comédie conservée par le grammairien Donat : « La comédie est l'imitation de la vie, le miroir de la coutume, et l'image fidèle de la vérité. » Pour exprimer quelques idées sur l'influence morale du théâtre comique, le cadre choisi par Cicéron était d'autant plus favorable, que ce fut précisément dans le siècle de Scipion que la comédie latine fit ses plus heureux progrès, et reçut un degré de perfection refusé, dans la même époque, au reste de la littérature romaine. De plus, cette renommée qui attribuait à Lælius une part dans les ouvrages de Térence, ne paraît pas avoir été un vain bruit; et le poète, dans un de ses prologues, la combat avec une molle complaisance qui semble la fortifier. Il est même resté sur ce point des traditions détaillées. Un certain Mummius, dans une harangue citée par Suétone, avait dit en termes exprès : « Scipion l'Africain, empruntant le personnage de Térence, fit sous ce nom paraître sur la scène les a jeux secrets de son loisir. » Cornélius Népos, autorité plus connue, raconte à ce sujet une anecdote assez piquante, si elle est vraie. Un jour, Lælius, alors à sa campagne de Putéoles, étant à composer dans son cabinet, fit longtemps attendre, pour souper, sa femme et ses amis ; venant enfin, il dit qu'il n'avait jamais été mieux inspiré, en écrivant. On le pressa de montrer ce qu'il avait fait ; et il récita des vers qui se trouvent aujourd'hui dans l’Heautontimorumenos. Au reste, pour contrepartie de cette anecdote, Suétone nous a conservé une vieille épigramme assez spirituellement maligne, où l’on reproche à Térence d'avoir perdu son temps et sa gloire à fréquenter les palais des grands de Rome, à écouter la voix éloquente de Scipion, à souper chez Lælius, pour aller mourir ensuite dans la pauvreté, et loin de sa patrie, oublié de ses illustres amis. Ne croyons pas cette épigramme. En vérité, il serait trop cruel que ce patronage de la puissance envers le talent, toujours assez redoutable pour les hommes de lettres, ait si mal fini, même de la part de Scipion, et lorsqu'il s'agissait de Térence. Quoi qu'il en soit de ces minutieuses anecdotes, dont certainement Cicéron ne parlait pas dans le quatrième livre de la République, on conçoit assez l'ingénieuse supposition d'un dialogue, où l'on avait le plaisir d'entendre parler sur l'influence du théâtre Scipion et Lælius, soupçonnés d'avoir fait des comédies. Un peu avant eux, ou de leur temps, six poètes s'étaient déjà illustrés dans cette carrière, en imitant, non pas le cynisme politique d'Aristophane, mais le ton de la moyenne comédie, et les pièces de Ménandre, Philémon, Diphile, Epicharme, et de cette foule d'ingénieux comiques produits par la Grèce. On sait, et Milton a dit, il y a longtemps, que dans Athènes, la comédie politique était véritablement ce que la liberté de la presse est dans quelques États modernes, une espèce de puissance démocratique jugeant des affaires et des hommes. Le caractère des mœurs romaines, et la fierté du patriciat, n'admettaient pas l'imitation de cette licence athénienne. D'ailleurs, les lois des Douze Tables, fort antérieures aux monuments connus de la poésie latine, avaient condamné tous les écrits satiriques avec la rigueur, que l'aristocratie porte dans la répression de ce genre de délit; et ces lois subsistaient. On ne peut douter que leurs dispositions menaçantes n'aient servi, autant que l'attrait d'un travail facile, à porter les comiques latins vers l'imitation exclusive et la traduction presque littérale de la moyenne comédie grecque, de celle qui se bornait uniquement aux tableaux de la vie commune, et à la supposition de quelques aventures particulières. Tel est le caractère de tout le théâtre de Plaute et de Térence. Noms des personnages, lieux de la scène, peintures de mœurs, choix de détails, tout est étranger, grec, sicilien, asiatique; tout se passe dans Athènes, à Calydon, à Épidamme, à Éphèse, etc. : et, en même temps tout appartient à l'ordre privé, aux situations domestiques; et rien ne rappelle, même par des allusions éloignées et inoffensantes, même par des imitations qui n'auraient plus été qu'historiques, les souvenirs de la comédie politique d'Eupolis et d'Aristophane. Quelques essais dans le genre hardi de la vieille comédie grecque avaient été cependant tentés à Rome, un peu avant Plaute, et se reproduisirent du temps de Cicéron, au milieu des luttes si vives de l'ambition et de la liberté. Après la première guerre punique, Nævius, qui fut poète et soldat, et qui chanta cette guerre, dans laquelle il avait combattu, s'était avisé, dans des espèces de drames nationaux, de traduire sur la scène, et de poursuivre de ses sarcasmes, les personnages les plus illustres de Rome. Le croira-t-on? il n'avait pas respecté la vertu même du premier Scipion, et cette pureté de mœurs, dont les historiens or t fait tant de bruit. Dans ses vers malins, il représentait le vainqueur de l'Afrique, le héros des Romains, arraché demi-nu, par son père, de chez une courtisane. Telle fut même, au rapport d'Aulu-Gelle, l'influence de ces méchancetés du poète, qu'elles induisirent, dans la suite, un historien célèbre, Valérius Antias, à démentir l'opinion commune sur la magnanimité de Scipion en Espagne, et à prétendre que le jeune Romain, loin de rendre généreusement la belle captive à ses parents, l'avait aimée avec passion, et au lieu d'imiter Alexandre, avait fait ce que fit Masinissa. Et puis maintenant, croyez à l'histoire; ou plutôt dites, si vous l'osez, que les calomnies des poètes ne sont pas dangereuses! Le second Africain, apparemment par dépit d'une telle insulte à la gloire de son aïeul, ne ménageait pas, comme nous le verrons dans quelques fragments de ce quatrième livre, les abus de la licence théâtrale, et il félicitait la législation romaine de les avoir sévèrement réprimés. En effet, l'audace de Nævius n'avait pas été impunie. Jeté dans un cachot par l'ordre des magistrats nommés Triumvirs, il fut en vain réclamé par les tribuns, protecteurs naturels de tous les médisants; il ne put sortir de prison qu'après avoir eu le temps d'v composer deux comédies, où il rétractait les injures et les sarcasmes, dont il avait blessé plusieurs des principaux personnages de l'État. Mais toujours poursuivi par la haine de ces puissants ennemis, il fut réduit à s'expatrier, et il alla mourir à. Utique, dans le même pays qui bientôt après devait envoyer à Rome l'élégant et sage Térence. Cet exemple, et sans doute l'exacte surveillance des édiles qui jugeaient les pièces de théâtre, détourna les poètes comiques d'une franchise, ou d'une malignité si dangereuse. Nous voyons bien dans les lettres de Cicéron, que Publius, auteur de petites comédies appelées mimes, laissait échapper contre la puissance de malignes allusions, vivement saisies par cette sagacité populaire, que développe le sentiment de la servitude. Macrobe nous raconte aussi comment Labérius, dans une pièce, où César l'avait forcé de jouer lui-même, glissa quelques vers dont l'application, faite par tous les assistants, blessa le dictateur. Mais ces anecdotes appartiennent à une époque de politesse sociale où l'extrême raffinement des esprits donne à la satire des armes puissantes fussent-elles imperceptibles. Il n'en est pas moins vrai que, dans le long intervalle depuis Nævius jusqu'à César, la comédie, constamment cultivée à Rome, parait n'y avoir été qu'une œuvre littéraire, un amusement de l'esprit, étranger à toute intention morale ou politique. Elle n'en fut pas moins florissante, et elle n'en peignit pas moins quelquefois des personnages romains, mais toujours, à ce qu'il semble, sans personnalités contemporaines, sans désignation individuelle. Indépendamment des pièces imitées des Grecs, telles que celles de Plaute, de Cæcilius, de Térence, le théâtre romain eut des comédies nationales, où l'on mettait en scène tous les rangs des citoyens, et qui portaient les noms de Prœtextæ, de Togatœ, de Tabernariæ, suivant qu'elles offraient des personnages du premier ordre, de simples citoyens, ou des esclaves. Afranius s'était exercé dans ce genre, et avait mérité presque d'être comparé à Ménandre. Dicitur Afrant toga convenisse Menandro. Il paraît que ses pièces bornées à des peintures de mœurs privées, et remarquables par la gracieuse élégance du style, respiraient un genre de corruption trop commun dans les mœurs antiques, mais dont l'impudente publicité sur un théâtre parait le plus honteux et le plus inconcevable degré de l'abjection humaine. Ce poète était contemporain de Scipion et de Térence. Si Quintilien trouve que les comédies de Térence, dont l'expression conserve tant de décence, ne devaient pas être lues avant l'âge où les mœurs sont en sûreté, suivant sa belle expression, de quelle censure les grands hommes de la république ne devaient-ils pas frapper, dans Afranius, une licence odieuse? Sans parler de cette affreuse dépravation, nous voyons assez, par les comédies de Plaute, à quel excès de grossièreté impure était porté le langage habituel de la scène comique chez les Romains. On ne doit pas s'étonner dès lors qu'elle eût plus d'une fois attiré la réprobation des censeurs, de ces magistrats gardiens des mœurs publiques, et dont quelques arrêts offrent une sévérité que nous avons peine à concevoir. L'énergique Tertullien, en attaquant les théâtres de son temps, s'appuyait de cette antique autorité, et citait à cette occasion une curieuse anecdote: « Souvent, dit-il, les censeurs faisaient détruire les théâtres, dans l'intérêt des mœurs. Aussi, lorsque le grand Pompée, petit par cette seule faiblesse, fit bâtir son théâtre, ce réceptacle de tous les vices, craignant dans l'avenir, pour sa mémoire, le blâme des censeurs, il construisit au-dessus un édifice consacré à Vénus ; et, convoquant le peuple par un édit pour l'inauguration de ce lieu, il en fit la dédicace sous le titre, non pas de théâtre, mais de' temple de Vénus, au pied duquel, ajouta-t-il, j'ai fait placer des gradins pour un spectacle. Ainsi il couvrit du frontispice d'un temple ce monument condamné et digne de l'être; et il éluda la morale par la superstition. » On voit par ce fait, et par la réflexion de l'orateur chrétien, que le théâtre latin remontait, en vieillissant, vers l'origine toute religieuse qu'avaient eue ses premiers et informes essais, et dont il avait paru si longtemps s'écarter. Le vice affectait par calcul ce qui n'avait été d'abord que le résultat du hasard et de l'ignorance. On concevra, pour le dire en passant, que cette disposition dut s'accroître, dans la suite, par les progrès du christianisme, et qu'ainsi les théâtres devinrent le point d'appui, et pour ainsi dire la principale forteresse du culte païen faiblement défendu par ses prêtres. C'est l'explication des anathèmes terribles lancés par les premiers chrétiens contre les théâtres ; et cela montre aussi combien ces anciens anathèmes s'appliqueraient peu justement à nos théâtres modernes, et à un état de société si différent de cette première époque. Quoi qu'il en soit, une sorte d'hypocrisie publique eut beau vouloir, à Rome, consacrer les théâtres, jamais on ne leur donna, chez un peuple lier et grave, l'importance et la considération qu'ils avaient dans la Grèce. Cette vérité se marque assez par la manière différente, dont les acteurs étaient traités dans les deux pays. Cicéron n'avait pas cru ce fait indigne d'observation. Il remarquait, dans le quatrième livre de la République, qu'Eschine qui, dans sa jeunesse, avait joué la tragédie, prit part au gouvernement d'Athènes; et que le comédien Aristodème fut envoyé en ambassade auprès de Philippe, pour les négociations les plus importantes. A Rome, au contraire, la profession d'acteur était réputée déshonorante et non seulement elle éloignait de toute dignité, mais elle entraînait la privation des droits civiques, et l'exclusion du service militaire. Celte sévérité souffrait pourtant une exception, pour ceux qui jouaient dans les pièces nommées Atellanes. Cicéron, l'élève de Roscius dans l'art de la déclamation, son ami, son admirateur passionné, souscrivait-il, dans le traité de la République, à cet anathème, dont les vieilles mœurs romaines frappaient la profession du théâtre? Nous sommes tentés de le croire, en l'entendant ailleurs, lors même qu'il fait le plus touchant éloge du caractère et des vertus de Roscius, regretter qu'un si honnête homme ait paru sur la scène. De son temps, il est vrai que déjà la licence des comédiens, le scandale de leurs fortunes, l'orgueil de leur luxe étaient portés à un excès qui devait, aux yeux des partisans de l'ancienne discipline, renforcer le préjugé défavorable attaché à cette profession. Æsopus, acteur célèbre, contemporain de Cicéron, laissa en mourant deux millions de biens à sa fille. Et le sage Roscius, dont Cicéron vante le désintéressement, ne paraissait jamais dans une représentation, à moins d'une somme considérable que lui payait L'État. Au siècle de Scipion, il était à croire que l'on ne connaissait pas encore ces abus, qui furent si prodigieusement surpassés dans la suite par les honneurs et les richesses, dont la folie des empereurs combla quelquefois un danseur, ou un baladin. Sous Tibère, on rendit un décret, pour interdire à tout sénateur de faire visite à des pantomimes, et aux chevaliers de les accompagner, lorsqu'ils sortaient en public. Mais dans les premiers siècles de la République, les acteurs, confondus sous le nom d'histrions, étaient passibles des verges, sur l'ordre du préteur. L'histoire ne nous a transmis le nom d'aucun de ceux qui jouèrent dans les pièces de Térence. Il semble que ces comédies, pleines de délicatesse et d'élégance, exigeaient un jeu aussi naturel que savant, et qui élevait déjà les efforts du comédien à la dignité d'un art, et d'un art difficile autant que flatteur pour le goût et l'imagination. Était-il juste que des hommes occupés d'un tel emploi, et qui le remplissaient avec distinction, fussent traités comme gens de condition servile? Et n'y avait-il pas un milieu entre cette dure proscription et l'apothéose du comédien Paris, sous le règne de Néron? L'art théâtral, dans ses rapports avec une des parties les plus importantes de l'art oratoire, devait d'ailleurs, dans une république, patrie naturelle de l'éloquence, paraître fort digne d'intérêt. Sans doute c'était une grande présomption à Roscius lui-même de composer un livre, où il mettait le talent de l'acteur en parallèle avec celui de l'orateur; mais ce don précieux de la scène, lorsqu'il est porté à la perfection, n'en est pas moins une grande puissance, une source de belles émotions, un rare talent, dont il est d'autant plus juste de jouir avec enthousiasme, qu'il ne dure que l'instant de la vie, et meurt tout entier. Dans ce quatrième livre, où conversaient les esprits les plus polis d'une époque éclairée, et où Cicéron tenait la plume, sans doute à l'examen moral et politique du théâtre se trouvaient joints des jugements ingénieux et rapides, sur le mérite des principales productions de l'art dramatique. Quintilien nous dit, avec toute l'autorité d'une opinion mûrement approfondie, que le poète comique Ménandre est, de tous les écrivains grecs, le plus propre à former l'orateur homme d'État et philosophe. Bien qu'au jugement de César, Térence ne soit qu'un demi-Ménandre, cependant des pièces qui, pour l'élégance du style et l'expression naïve des mœurs, étaient une image de cet admirable modèle, devaient fournir plus d'une remarque, touchant les progrès de la langue et du goût. Elles avaient paru, d'ailleurs, au milieu d'une foule d'autres comédies également distinguées par toutes les grâces de la diction-romaine. Dans quel rang s'y trouvaient-elles placées? Faut-il en croire un écrivain cité par Aulu-Gelle, qui dans une liste des poètes comiques de Home, n'accorde à Térence que la sixième place? Nous pouvons juger cette décision par rapport à Plaute, que le nomenclateur place le second. Mais Cæcilius, Nævius, Licinius, Attilius, méritaient-ils d'être préférés à Térence? S'il en est ainsi, quels trésors d'élégance et d'esprit renfermait donc cette partie de la littérature latine, ou Quintilien prétend cependant que Rome ne possédait rien, en comparaison de la Grèce? Aulu-Gelle, dans un chapitre de ses Nuits attiques, a rapproché divers passages de ce désespérant Ménandre, et de Cæcilius, son imitateur habituel ; et il montre combien l'expression grecque l'emporte par le tour, la grâce, l'abandon, sur tout l'art du comique latin. Mais ces parallèles sont courts, choisis peut-être avec peu de goût, et appliqués à des citations d'un intérêt médiocre. Combien quelques mots de Scipion, ou de Lælius, nous en auraient dit davantage! La comédie parait avoir été le fruit le plus abondant et le plus heureux de la littérature latine, dans le siècle de Scipion ; mais, elle était loin d'être le seul. Les lettres, sans devenir encore une espèce de profession, comme dans nos temps modernes, et sans être animées par .l'enthousiasme inspirateur qui les fit paître dans la Grèce, se produisaient déjà sous des formes diverses. Il faut nommer d'abord la satire, dont Quintilien attribue l'invention aux Romains, et qui fut pour, eux une espèce de supplément à leur théâtre comique, trop gêné par les lois, et une véritable imitation des libertés de la vieille comédie d'Athènes. Lucile, encore admiré du temps d'Horace, dont il importunait la renommée, fut le premier maître dans ce genre hardi. Ses satires, fort nombreuses, et divisées en trente livres, s'il faut en croire les citations éparses qui nous restent, attaquaient sans réserve les vices des grands et du peuple, désignaient librement un juge prévaricateur, up citoyen pervers, un fripon, un débauché. Son vers âpre et dur était un fer chaud, qui imprimait des notes d'infamie. Mais Lucile, au milieu de ses témérités et de son ardent cynisme, avait recherché, par conscience ou par politique, l'amitié de Scipion et de Lælius, les premiers des Romains. Sous l'abri de leur crédit et de leurs vertus, il lançait les traits de sa verve meurtrière; il peignait d'un style d'airain les vices et la corruption de ses concitoyens ; il les montrait attentifs à se tromper les uns les autres par défausses caresses et de faux semblants d'amitié, se faisant, sous le masque de la probité, une guerre sourde et continue, comme des peuples ennemis, enfin, usant déjà de tous les vices d'une vieille société. Mais dans ses plus amères invectives, il laissait quelque chose de consolant pour l'orgueil national. Nommait-il le peuple romain, il avait soin de dire : « Ce peuple qui vaincu dans beaucoup de combats, ne l'a été dans aucune guerre ; avantage qui renferme tous les autres. » Ailleurs, il fait consister la vertu à être l'ennemi public et personnel des méchants et des mauvaises mœurs ; définition parfaitement analogue au caractère et au besoin des États libres. Enfin, dans l'ordre des intérêts qui sont à consulter, il place d'abord l'intérêt de notre patrie, ensuite celui de nos parents, et le nôtre, au troisième et dernier rang. Sans doute, aux yeux du sage Scipion et du doux Lælius, ce virulent accusateur des vices était un citoyen utile, dont ils calculaient l'influence, au profit des mœurs et de la vertu. Un demi-siècle auparavant, Ennius, uniquement attentif à chanter les guerres et les faits d'armes des Romains, avait mérité l'estime du premier Africain, dont il célébrait la gloire. Rome, encore rude et toute belliqueuse, n'avait pas alors besoin d'une autre poésie, et n'aurait pas voulu l'entendre. Les expressions ardentes d'Ennius, sa verve toute pleine du feu des combats, étaient assorties à des imaginations sans cesse occupées par les travaux de la guerre. C'était le poète d'une armée. L'époque plus avancée de Scipion Émilien devait demander autre chose aux lettres et à la poésie ; elle pouvait y chercher un correctif salutaire contre les vices grossiers et la licence. Lucile était le poète d'une société déjà corrompue. Du reste, à cette époque, on écrivait encore assez peu en prose, et seulement sur des objets d'utilité immédiate, la guerre, l'agriculture, l'histoire. Caton, que Pline appelle le premier des hommes dans la pratique de toutes les choses utiles, avait embrassé) à cet égard, toutes les connaissances de son temps, dans un style, concis et simple, dont le siècle d'Auguste prisait encore le bon sens et l'énergie. Son ouvrage de Re Rusticat conservé jusqu'à nous, semble le recueil des axiomes d'un fermier laborieux. Passionné pour l'étude, mais ennemi des arts de la Grèce, dont Rome devait subir to joug, Caton avait eu pour principal objet, dans son livre des Origines, de contester aux Grecs l'honneur d'avoir colonisé l’Italie; et il s'était attaché à retrouver sur le sol du Latium la trace des vieilles mœurs nationales et de la civilisation indigène. Il racontait aussi, dans cet ouvrage, la première et la seconde guerre punique, et plusieurs autres expéditions des Romains, mais avec une grande brièveté, et en marquant les événements décisifs de chaque campagne, sans nommer les généraux. Les autres historiens latins de cette époque inspiraient peu d'estime à Cicéron; et dans son traité des Lois, il les nomme d'une manière assez dédaigneuse, en leur reprochant d'être tout à fait privés, de force et d’élégance. Un de ces historiens, jugés avec tant de rigueur avait cependant une idée très vraie de son art, si nous en jugeons par un court passage, que nous a conservé Aulu-Gelle. « Raconter, dirait cet écrivain, sous quel consul la guerre a commencé, de quelle manière elle s'est terminée, quel général est entré en triomphe dans Rome ; puis, rebattre en détail tous les faits de cette guerre, et en même temps oublier de dire quelle mesure a décrétée le sénat, quelle loi, quelle proposition a passé, quelle politique a tout dirigé, c'est faire des contes pour les enfants, et non pas écrire l'histoire. » Il paraît enfin que Cicéron, à l’exemple de Platon avait, dans ce quatrième livre, blâmé l'influence de la musique, et qu'un des interlocuteurs du dialogue la proscrivait comme un art dangereux pour les mœurs. Un Grec du quatrième siècle, Quintilien Aristide, auteur d'un traité sur la musique, rappelle et combat cette opinion, « qu'il ne peut, dit-il, imputer à Cicéron lui-même, aspirateur du comédien Roscius et si passionné pour tout ce qui tenait au rythme oratoire? On voit, par ce genre d'objection à quel point la musique, chez les anciens, se confondait avec tous les arts!
et cela même peut
expliquer l’importance qu’on lui attribuait, et le soin jaloux, avec
lequel on surveillait tous les effets d’un art si puissant. Pour nous,
froids habitants d’une zone humide, nous ne pouvons juger de la
domination que le charme des sons exerçait sur ces mitions poétiques et
musicales, dont hi langue seule était une perpétuelle mélodie. Les
Romains mêmes semblent déjà, sur ce point, doués d’une sensibilité bien
infé-rieure à celle des Grecs; et nous ne croyons pas que ce soit à Rome
qu’on ait jamais pu dire qu’une innovation dans la musique faisait une
révolution dans l’État, ni que jamais aucun censeur se soit cru obligé,
comme cet éphore de Sparte, de couper, par mesure de prudence, quelques
cordes nouvelles ajoutées à la lyre. Il semble d’ailleurs que la musique
est une science de doux loisir et de vie voluptueuse, dont l’influence,
lors même qu’elle était favorisée, chez les Romains, par la nature et le
climat, devait être restreinte et tempérée par l’austérité laborieuse
des mœurs. La perfection dans la musique est bonne pour les Italiens de
Rome : les Ro-mains avaient mieux à faire. Cicéron nous dit, dans un fragment de ce quatrième livre, qu'une magistrature si sévère épouvanta d'abord les Romains; et il ajoute : « L'arrêt du censeur n'inflige presque au condamné que de la honte; aussi, comme toute cette pénalité se résout en flétrissure nominale, le châtiment appliqué en ce cas s'appelle « ignominie. » Admirable rapprochement d'idées! cette magistrature, dont la rigueur fit trembler Rome, n'avait pour frapper que des peines d'opinion. Elle était simplement l'organe d'un point d'honneur public. N'y a-t-il pas dans ce peu de mots un bel éloge du peuple qu'elle effrayait? Nous verrons plus tard, et Cicéron avait probablement examiné ailleurs, comment la censure était un des principaux ressorts du gouvernement même, par l'influence qu'elle exerçait sur la formation de ce sénat, dont la politique profonde et constante préparait l'esclavage du monde. Rappelons seulement ici que, lorsque Scipion Émilien élevé à la dignité de censeur, célébra l'imposante cérémonie du Lustre, et qu'au milieu de toutes les pompes religieuses et guerrières, dont cette fête était entourée, le héraut prononça la formule de la prière publique, par laquelle on demandait aux dieux l'agrandissement du peuple romain, le vainqueur de Carthage fit suspendre cette lecture; et déclara que désormais la République était assez puissante, et qu'il suffisait de demander aux dieux la conservation de sa prospérité. Dans la pensée de l'ouvrage écrit par Cicéron, dans ce désir si noble de montrer la République au comble de sa gloire, et libre encore, pouvait-il choisir un plus heureux interprète, que ce même Scipion qui avait ainsi rectifié les vœux de l'ambition romaine, que le grand homme qui semblait avoir ainsi voulu, en présence des dieux, poser un terme au prodigieux accroissement de cette grandeur, qui ne pouvait plus périr que par elle-même? Imaginez quel admirable mouvement, quelle touchante allusion l'idée de ce grand jour et de ce vœu sublime, devait inspirer à Cicéron faisant parler l'Africain! Quelle éloquence de l'âme et du patriotisme devait vivifier ces peintures des mœurs romaines, que nous, compilateurs du dix-neuvième siècle, nous avons faiblement essayé de remplacer par des anecdotes et des traits épars recueillis sur les raines de la littérature romaine, à deux mille ans de tels hommes et de tels souvenirs! LIVRE QUATRIÈME.
I. …..[1] Quelle convenance dans la distinction par ordres, par âges,[2] par classes, en y comprenant l'ordre équestre, où votent les sénateurs! Trop de gens veulent, il est vrai, follement détruire cette institution, dans l'espoir de quelque largesse sur la valeur des chevaux, qu'un plébiscite ferait restituer au trésor. II. Voyez d'ailleurs que de précautions sagement prises, afin d'assurer aux citoyens les avantages d'une vie heureuse et pure : tel est en effet le premier but de la société, et ce qui doit résulter, pour les individus, des soins de la République, par le concours des mœurs et des lois. D'abord, quant à la manière d'élever des enfants de condition libre, objet habituel des vains efforts des Grecs, et le seul point sur lequel Polybe accuse la négligence de nos institutions, les Romains ont voulu que l'éducation ne fût ni fixée, ni réglée par les lois, ni donnée publiquement, ni uniforme pour tous. …………………………………………………………………………………………………………… III. Dans nos mœurs anciennes, il était interdit au jeune homme pubère de se montrer nu dans le bain : tant on s'y prenait de loin, pour jeter, le germe des sentiments de pudeur! Chez les Grecs,[3] au contraire, quelle inconvenante école pour la jeunesse que les exercices de leurs gymnases! quelle frivole préparation aux travaux de la guerre! quelles luttes indécentes, quels impurs amours libres et permis! Je ne parle point des Éléens et des Thébains, chez; lesquels cette passion jouit d'une licence entière et autorisée ; mais les Lacédémoniens, même en permettant tout à cet égard, hors le crime de. violence, n'ont laissé à la pudeur et à l'honnêteté que de bien faibles barrières. Lælius. Je vois parfaitement, Scipion, qu'au sujet de ces institutions grecques dont vous faites la censure, vous aimez mieux encore vous attaquer aux coutumes des peuples les plus renommés, que de lutter contre votre cher Platon ; vous ne l'effleurez même pas…………………………………………………………. IV. [4] Jamais la comédie,[5] si l'habitude des mœurs publiques n'avait autorisé, n'aurait pu faire goûter les infamies qu'elle étalait sur le théâtre. Les anciens Grecs mêmes avaient été conséquents à cette erreur de l'opinion chez eux, en donnant par la loi à la comédie le privilège de dire ce qu'elle voudrait, et de qui elle voudrait, en propre nom. Qui n'a-t-elle pas atteint? ou plutôt qui n'a-t-elle pas déchiré? à qui fit-elle grâce? Qu'elle ait blessé des flatteurs populaires, des citoyens malfaisants, séditieux, Cléon, Cléophon, Hyperbolus, à la bonne heure; souffrons : bien que, pour de tels hommes, la censure du magistrat vaille bien mieux que celle du poète. Mais que Périclès, gouvernant la république depuis tant d'années, avec le plus absolu crédit, dans la paix ou dans la guerre, soit outragé par des vers, et qu'on les récite sur la scène : cela n'est pas moins étrange que si, parmi nous, Plaute et Nævius se fussent avisés de médire de Scipion, ou Cæcilius de Caton. Nos lois des Douze Tables, au contraire, si attentives à ne porter la peine de mort que pour un bien petit nombre de faits, ont compris dans cette classe le délit d'avoir récité publiquement, ou d'avoir composé des vers, qui attireraient sur autrui le déshonneur ou l'infamie ; et elles ont sagement décidé : car, notre vie doit être soumise à la sentence des tribunaux, à l'examen légitime des magistrats, et non pas aux fantaisies des poètes ; et nous ne devons être exposés à entendre une injure, qu'avec le droit d'y répondre, et de nous défendre, devant la justice.
FRAGMENTS
Ce soin minutieux nous fait rassembler ici quelques fragments du quatrième livre, qui n'ont pu se lier aux passages retrouvés par l'éditeur romain, ni même s'encadrer dans l'espèce de supplément que nous avons essayé. Ce sont des phrases, ou peu significatives, ou citées d'une manière incomplète par les grammairiens, qui n'y cherchaient que l'exemple de l'emploi d'un mot. Faut-il les traduire? Apprendrai-je quelque chose au lecteur, en répétant dans notre langue des termes presque isolés qui ne disent rien, même dans l'original? « On emploie des bergers pour la garde des troupeaux. » « Armentum vient d’armentarius. » « Dans cette discussion, je n'ai pas pris la cause du peuple, mais celle des gens de bien. » « Puissé-je lui avoir fait d'avance une prédiction assez fidèle! » D'autres phrases apprennent quelques petits faits de philologie, « J'admire dans ces lois non seulement la justesse des choses, mais celle des termes : s'agit-il de plaider? la discussion entre amis, et non la querelle entre ennemis, s'appelle plaidoirie, dit la loi. » Dans une autre de ces phrases mutilées, Cicéron paraît rappeler la barbare sentence des Athéniens, qui firent périr les capitaines de leur flotte, parce qu'ils n'avaient pu, après une tempête, recueillir les corps de leurs soldats, et leur donner la sépulture. Cependant, au milieu de ces débris énigmatiques de phrases sans liaison, il en est une qui conserve beaucoup de sens : « On ne résiste pas aisément au peuple devenu puissant, soit qu'où ne lui accorde aucun droit, soit qu'on lui en accorde trop peu. »
[1] Ce livre est réduit à un seul feuillet dans le manuscrit du Vatican. L'éditeur de Rome réunit à ce faible débris les passages, que saint Augustin avait transcrits dans la Cité de Dieu, et dans une épître à Nectaire. Il croit pouvoir y rapporter aussi quelques fragments de Cicéron, transmis et conservés sans indication de l'ouvrage auquel ils appartenaient. Ces fragments, précieux pour les philologues, ne pouvaient trouver place dans la traduction. Ils sont cités au bas du texte latin. [2] « Romulus avait divisé le peuple romain en vieillards et en jeunes gens. Servius Tullius établit, dans la suite, cinq divisions dans la classe des jeunes gens. » Aulu-Gelle donne ce détail, d'après un historien nommé Tubéron (Aul.-Gell. liv. X, chap. xxviii.) [3] Dans cette juste et vive censure, Cicéron s'est abstenu de rappeler la république de Platon. Polybe, en comparant les Institutions des divers États, ne parle pas non plus des Institutions idéales proposées par Platon. Il donne une raison ingénieuse de ce silence. « Je ne puis, dit-il, admettre cette constitution toute chimérique à entrer en concurrence avec les Républiques réelles et effectives ; de même que l'on ne permet pas l'accès de la lice à ceux qui n'ont pas fait les exercices ordonnés, et qui ne sont pas inscrits sur le rôle des athlètes. [4] De longues lacunes séparent ce passage du précédent; et il n'est lui-même qu'un bien faible débris de ce que ce livre contenait sur le théâtre. [5] Cicéron paraissait goûter assez médiocrement les jeux scéniques de son temps ; du moins, si nous en jugeons par la manière chagrine et dédaigneuse, dont il rend compte à un ami de la plus magnifique de ces solennités, de celle qui eut lieu pour inaugurer le théâtre du grand Pompée. On voit par sa lettre à Marius, que la profusion et l'entassement des spectacles divers réunis dans ces fêtes en rendaient la pompe fatigante, et que le bon goût avait peu de choses à y faire. C'étaient déjà tous les inconvénients dont se plaint Horace, et surtout l'empiétement du cirque sur le théâtre, l'abus des représentations matérielles, des spectacles qui ne parlent qu'aux yeux, substitués à l'intérêt dramatique et aux beautés littéraires. Verum equitis quoque jam migravit ab sure volnptas Omnis ad incertos oculos et gaudia vana. Quatuor aut plures aulæa premuntur in boras. Dum fugiunt equitum turmæ, peditumque catervæ. Mox trahitur, manibus, regum fortuna, retortis, Esseda festinant, pilenta, petorrita, naves; Captivum portatur ebur, captiva Corinthus. (Horace, Epist. II, 1.) Cet abus existait au siècle de Scipion, puisqu'il causa la chute de la plus intéressante des pièces de Térence, de l’Hécyre, dont le peuple interrompit la représentation, pour courir à une danse de pantomimes. A l'époque de Cicéron, il paraît, qu'afin de satisfaire toutes les curiosités à la fois, on s'était avisé d'introduire dans les pièces mêmes tout ce que l'on pouvait rassembler de magnificences et de merveilles faites pour les yeux ; et c'est là ce qui choquait Cicéron. « Quel plaisir, écrivait-il à son ami, peut-on trouver à voir, dans Clytemnestre, des multitudes de mulets, dans le cheval de Troie, plusieurs milliers de boucliers, et, à l'occasion du plus mince combat, un équipement complet d'infanterie et de cavalerie? »
|