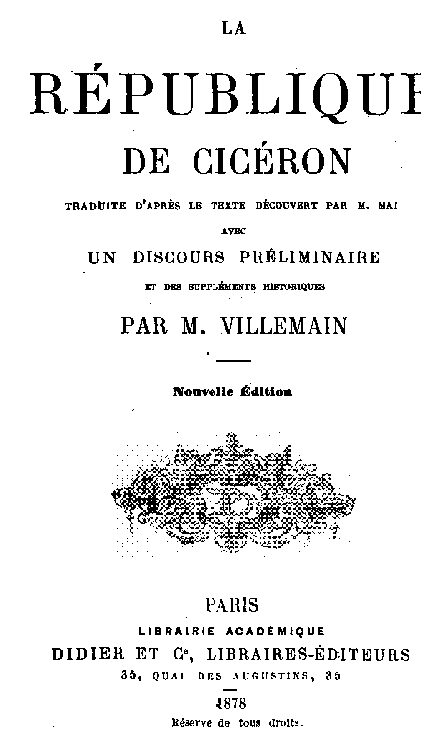|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.
*******************
LIVRE PREMIER.
I.... Sans cette vertu,[1] Duillius, Régulus, Métellus n'auraient point affranchi Rome de la terreur de Cartilage; les deux Scipions n'auraient point éteint dans leur sang l'incendie à peine allumé de la seconde guerre punique; Fabius n'eût point amorti, Marcellus n'eût point étouffé ce fléau réveillé plus terrible; et Scipion, l'arrachant de nos portes, ne l'eût point refoulé tout entier dans les murs de nos ennemis. Caton, que nous tous, ambitieux de la même gloire, suivons comme le premier guide dans la route du talent et de la vertu, Caton, d'abord homme nouveau et inconnu, était libre de jouir, à Tusculum, d'un agréable repos, dans une retraite salutaire et peu éloignée; mais cet homme, insensé, s'il faut en croire de tels philosophes, aima mieux, quand nulle nécessité ne lui en faisait une loi, être battu par les flots de ces tempêtes publiques, jusqu'à la dernière vieillesse, que de mener une vie délicieuse, dans cette paix et ce loisir. Je laisse de côté cette foule d'hommes qui ont servi tour à tour au salut de là République; je ne rappelle point ceux dont les noms touchent encore aux souvenirs de nos contemporains, de peur que quelqu'un ne me reproche d'oublier ou sa famille, ou lui-même. J'établis seulement une vérité. La nature donne à l'homme un sentiment si impérieux de la vertu et une ardeur si vive pour la défense du salut commun, que cet instinct triomphe en lui de tous les charmes du plaisir et du repos. II. Or, la vertu n'est pas comme un art qu'il suffise de posséder, sans le mettre en pratique. Un art, en effet, lors même que vous ne l'appliquez pas, peut vous appartenir par la théorie ; mais la vertu n'est rien, si elle n'est active. Son activité la plus glorieuse, c'est le gouvernement de l'État et l'application, non pas en paroles, mais en fait, des choses mêmes que ces gens-là débitent dans leurs écoles. Car rien n'est dit par les philosophes, du moins de juste et d'honnête, que les premiers législateurs des États n'aient découvert, n'aient proclamé. D'où viennent en effet le respect des dieux et le culte public? D'où vient le droit des gens, et cette législation, que l’on appelle le droit civil? D'où vient la justice,[2] la foi, l'équité? D'où vient le sentiment de la pudeur,[3] la continence, l'horreur de l'infamie, l'ambition de la gloire et de l'estime, le courage dans les peines et dans les dangers? De ces hommes qui, après en avoir préparé le principe par l'éducation, l’ont ou affermi par l'influence des mœurs, ou consacré par les lois. On rapporte que Xénocrate, philosophe du premier ordre, interrogé sur l'avantage que ses disciples retiraient de ses leçons, répondit : « Ils apprennent à faire par leur choix ce que les lois leur ordonnent de faire. » Le citoyen qui, par l'autorité et les menaces de la loi, oblige tout un peuple aux mêmes choses, que les conseils de la philosophie peuvent inspirer à quelques hommes, ce citoyen est donc préférable même aux démonstrateurs les plus éloquents des vérités, que seul il met en action. Quel discours si achevé peuvent-ils faire qui vaille mieux qu'un État sagement ordonné, qu'une constitution sociale, que des mœurs publiques? Pour moi, autant les grandes cités, les cités dominatrices, suivant l'expression d'Ennius, me paraissent supérieures à des villages et à des châteaux, autant les hommes qui gouvernent ces villes par le conseil et le commandement, l'emportent, âmes yeux, en sagesse véritable sur ces esprits spéculatifs, étrangers à toute affaire publique. Aussi, puisque notre passion la plus vive est d'accroître l'héritage du genre humain,[4] puisque nos pensées et nos efforts aspirent à rendre l'existence humaine plus forte et plus assurée, puisque nous sommes excités à cette heureuse lâche par le cri même de la nature, suivons, dans ce but, la route qui fut toujours celle des plus grands hommes, et n'écoutons point ce signal de la retraite, qui retentit à nos oreilles, et voudrait rappeler ceux mêmes qui déjà se sont avancés dans la carrière. III. A ces raisons si certaines et si visibles nos adversaires opposent les travaux à supporter, dans la défense de l'État, faible obstacle pour le zèle et pour le talent, considération méprisable, lors même qu'il s'agît d'intérêts médiocres, de devoirs, d'occupations secondaires, loin que l'on puisse jamais l'appliquer à des intérêts si grands! On ajoute les périls, dont la vie est menacée ; on allègue cette crainte de la mort, si honteuse aux yeux des hommes de courage, qui trouvent bien plus malheureux de périr lentement consumé parle temps et la vieillesse, que de saisir un moment, pour déposer, au profit de la patrie, cette vie mortelle, qu'il fallait bien toujours rendre à la nature. Cependant, c'est là surtout que nos contradicteurs triomphent et se croient éloquents, lorsqu'ils rassemblent toutes les infortunes des grands hommes, et les injustices qu'ont fait peser sur eux d'ingrats concitoyens. Là se retrouvent ces fameux exemples empruntés aux Grecs, Miltiade, vainqueur et exterminateur des Perses, encore tout saignant des blessures qu'il avait reçues en face, dans une glorieuse journée, et préservé des glaives ennemis, pour venir expirer dans les cachots d'Athènes; Thémistocle, proscrit et chassé de sa patrie délivrée, se réfugiant non dans les ports de la Grèce sauvés par son bras, mais sur les rivages de la Puissance barbare, qu'il avait abattue. Les exemples de l'inconstance et de la cruauté des Athéniens envers leurs plus grands hommes ne manquent pas : ces exemples, nés et souvent renouvelés chez ce peuple, ont passé, dit-on, jusque dans la gravité des mœurs romaines; et on rappelle alors, ou l'exil de Camille, ou la disgrâce d'Ahala, ou l'impopularité de Nasica, ou le bannissement de Lénas, ou la condamnation d'Opimius, ou la fuite de Métellus, ou le désastre de Marius, et les morts violentes des chefs, et les meurtres si nombreux qui suivirent. On en vient à citer mon nom ; et peut-être même, dans la pensée qu'on doit à mes conseils et à mes périls la conservation de la vie et du repos, on s'arrête avec plus de force et d'attendrissement sur les maux que j'ai soufferts. Hais moi, j'ai peine à concevoir dans les mêmes hommes, que l'étude ou la curiosité entraine au delà des mers, l’étonnement que d'autres aient bravé de plus grands périls, pour servir la patrie[5] … IV.... Lorsque sortant du consulat, je jurai, dans l'assemblée du peuple romain que j'avais sauvé la patrie, et que le peuple entier répéta mon serment, ce jour-là, je reçus le dédommagement de toutes les injustices et de toutes les douleurs. Ma disgrâce même, à tout prendre, fut plus éclatante que pénible, j'y trouvai moins d'amertume que de gloire; et la joie d'être regretté par les bons citoyens surpassa la douleur, que m'inspirait l'allégresse des méchants, mais, le succès même eût-il été différent, quelle plainte pouvais-je former? Il ne me serait arrivé rien d'imprévu, rien de plus terrible que ce qu'il était naturel d'attendre pour prix de si grandes actions. N'étais-je pas maître, en effet, de partager le repos général, et d'en faire un plus heureux emploi que tout autre, par la douceur et la variété des études, que j'avais cultivées dès l'enfance? Ne pouvais-je pas même, s'il survenait quelque désastre public, ne m'y trouver associé que dans la proportion commune, et sans un surcroît personnel de malheur? Et n'était-ce pas volontairement que j'avais couru au-devant des plus terribles tempêtes et des fleuves débordés, pour sauver mes concitoyens, et conquérir, par mes périls, le repos de tous les autres! En effet, je le pense, la patrie ne nous a point donné la naissance et l'éducation, pour n'espérer de nous, en retour, aucun subside alimentaire, dirai-je, et pour être seulement la servante de nos intérêts, fournir un sûr asile à notre oisiveté, un lieu tranquille pour notre repos; elle entend au contraire avoir un droit privilégié sur les plus nombreuses et les meilleures facultés de notre âme, de notre esprit, de notre raison, et ne nous en laisse, pour notre propre usage, que la part qui lui est inutile à elle-même. V. Les détours, les excuses que l'on prend, pour s'autoriser plus facilement dans l'inaction, ne méritent pas d'être écoutés. On allègue que la République est entourée par des hommes incapables de tout bien, avec lesquels le parallèle est humiliant,[6] et le combat déplorable et dangereux, surtout en présence des passions populaires, que dès lors, il n'appartient ni au sage de prendre en main les rênes, puisqu'il ne pourrait contenir les mouvements aveugles et désordonnés de la foule; ni à l'homme généreux de s'exposer, en luttant contre d'impurs et coupables adversaires, à subir d'outrageuses atteintes, et de se livrer en butte à des injures intolérables pour sa vertu; comme si, pour les hommes vertueux, fermes, et doués d'une grande âme, il pouvait y avoir plus juste cause d'approcher le gouvernement, que ce besoin même de ne pas obéir aux méchants, et de ne pas leur laisser la République en proie, pour se voir ensuite, lorsqu'on vent la secourir, incapable de le faire. VI. Quant à cette restriction qui interdit au sage de se charger d'aucune partie de la chose publique, à moins que la circonstance et la nécessité ne l'y forcent, peut-on jamais l'approuver? Certes, il ne saurait survenir pour personne une nécessité plus pressante que celle, où je me suis rencontré : eh bien, qu'aurais-je pu faire dans cette grande circonstance, si, alors même, je n'avais été consul? et comment pouvais-je me trouver consul, si je n'avais suivi dès l'enfance tous les degrés de la carrière qui, du point où j'étais né, dans le rang des chevaliers, devait me conduire à cet honneur suprême? Vous ne pouvez donc trouver en vous à l’improviste et à volonté, la puissance de secourir l'État, quelque grands que soient ses périls, si vous ne vous êtes ménagé d'avance une situation qui vous permette d'agir. Et, ce qui m'étonne le plus dans les discours de nos sages, c'est d'entendre les mêmes hommes qui s'avouent impuissants à gouverner sur une mer paisible, parce qu'ils n'ont, à cet égard, ni instruction, ni expérience, déclarer qu'ils prendront le gouvernail au milieu de la tempête. C'est une chose en effet qu'ils disent hautement, et dont ils aiment à tirer gloire ; ils n'ont point recherché, et ils n'enseignent pas les moyens qui servent a l'établissement ou à la défense des États, ils regardent cette connaissance comme étrangère à la méditation des savants et des sages, et l'abandonnent aux hommes qui en ont fait leur étude exclusive. Sont-ils donc raisonnables et conséquents, de promettre leur secours à la République, dans la chance d'une impérieuse nécessité, lorsque, trop faibles pour une tâche plus aisée, ils ne savent point conduire l'État, en l'absence même de tout péril? Pour moi, en admettant tout à la fois, que le sage n'a pas coutume de descendre spontanément au soin de l'administration civile, et que, si les circonstances l'y forcent, il ne se refuse point à ce devoir, je croirais encore qu'il ne doit en rien négliger la science des affaires publiques, pour se préparer d'avance toutes les ressources, dont il ignore s'il n'aura pas besoin quelque jour. VII. J'ai donné sur ce point quelque développement à mes idées, parce que cet ouvrage est une discussion entreprise et suivie par moi, sur le gouvernement de l'État, et que, pour ne pas la rendre vaine, j'ai dû, avant tout, combattre cette hésitation pusillanime, qui éloigne des affaires publiques. S'il est des personnes qui soient fort touchées de l'autorité des philosophes, je les engage à prendre garde au choix, et à écouter de préférence, parmi ces philosophes, ceux qui ont le plus de gloire et d'autorité, dans l'opinion des esprits les plus éclairés : elles verront que ces hommes, lors même qu'ils n'ont point personnellement régi la chose publique, doivent être considérés, par l'étendue de leurs recherches et de leurs écrits sur l'administration des États, comme ayant exercé[7] une sorte de magistrature politique. Quant à ceux que la Grèce a désignés sous le nom de sept sages, je vois qu'ils ont tous vécu au milieu des affaires. Et en effet, il n'est rien qui place le génie de l'homme plus près de la providence des dieux que de fonder, ou de maintenir les États. VIII. Pour nous, s'il nous a été donné de faire dans le gouvernement quelque chose digne de mémoire, et si nous avons d'ailleurs quelque aptitude à expliquer les mouvements et les ressorts de la politique, nous pouvons porter dans ce sujet, avec notre expérience, l'art d'étudier et d'instruire, tandis que, avant nous, les uns, habiles, dans la théorie, ne s'étaient signalés par aucun acte; les autres, hommes d'État estimés, étaient inhabiles à parler. Au reste, il ne s'agit pas ici pour moi d'établir un système nouveau et arbitrairement imaginé. Je veux reproduire l'opinion des hommes les plus illustres de leur, siècle et de notre République, telle que vous et moi, dans notre jeunesse, nous trouvant à Smyrne, l'avons entendue de la bouche de Rutilius,[8] qui nous rendit compte d'un entretien prolongé pendant plusieurs jours, et dans lequel, à mon avis, on n'avait oublié aucun point de ces grandes questions. IX. Sous le consulat de Tuditanus et d'Aquilius, Scipion l'Africain, le fils de Paul-Émile, ayant fait le projet de passer les fériés latines dans ses jardins, où ses plus intimes amis lui avaient promis de fréquentes visites, pendant ces jours de repos, dès le matin de la première férié, il vit entrer, avant tout le monde, son neveu Quintus Tubéron.[9] Charmé de le voir, et l'accueillant avec amitié : Comment, vous, de si bonne heure, mon cher Tubéron! lui dit-il ; il me semble que ces jours de fête vous donnaient une favorable occasion pour vous livrer à vos études. Mais, répondit Tubéron, tout le temps qui me reste est bon pour mes livres; car ils sont toujours là, et n'ont rien à faire que de m'attendre; tandis que vous, Scipion, il y a grande difficulté à vous trouver libre, surtout dans cette crise de la République. Vous me trouvez en effet, dit Scipion, plutôt libre d'affaires que d'inquiétude. Il faudra bien, répondit Tubéron, que votre liberté d'esprit soit entière; car nous sommes plusieurs, suivant nos conventions, très disposés, si notre empressement ne vous gène pas, à perdre avec vous ces moments de loisir. — Très volontiers de ma part, si nous pouvons y gagner quelques notions sur la science. X. Eh bien, dit Tubéron, puisque vous m'y invitez, et que vous vous offrez vous-même, examinons d'abord, avant l'arrivée de nos amis, ce que signifie cette apparition d'un double soleil, dont il a été parlé dans le sénat. Les témoins prétendus de ce prodige ne sont ni peu nombreux, ni peu dignes de foi, de sorte qu'il s'agit moins désormais de le nier que d'en chercher l'explication. Ah! dit Scipion, que je voudrais avoir ici notre ami Panætius,[10] qui, dans les recherches de son esprit curieux, se plaît surtout à l'étude de ces merveilles célestes! Pour moi, cependant, Tubéron (car, avec vous, je dirai franchement ce que je pense), je ne saurais, en toute cette matière, me ranger à l'opinion de notre ami, lorsque, sur des choses que nous pouvons à peine soupçonner par conjecture, je l'entends parler avec tant de certitude qu'il semblerait les voir de ses yeux et les toucher de ses mains ; et je n'en admire que davantage la sagesse de Socrate, d'avoir laissé là toute curiosité semblable, et d'avoir dit que ces investigations sur la nature étaient, ou supérieures aux efforts de l'humaine raison, ou indifférentes à la conduite de la vie humaine. Mais, dit Tubéron, je ne sais, vainqueur de l'Afrique, d'où vient cette tradition, qui suppose Socrate ennemi de toute étude semblable, et occupé seulement de recherches sur les mœurs et la conduite de la vie. A son égard, quelle autorité plus imposante pouvons-nous citer que celle de Platon? Et dans ses ouvrages, en beaucoup d'endroits, tel est le langage de Socrate, que, même discutant sur les mœurs, sur les vertus, sur le gouvernement, il a soin d'y mêler toujours la puissance des nombres, la géométrie, l'harmonie, suivant le procédé de Pythagore. Il est vrai, dit Scipion; mais vous le savez, je crois: Platon, après la mort de Socrate, avait été conduit en Egypte, par le goût des sciences, puis en Italie, en Sicile, par l'envie de pénétrer les dogmes de Pythagore; il communiqua beaucoup avec Archytas de Tarente et Timée de Locres, recueillit les ouvrages de Philolaüs, et trouvant, à cette époque et dans ces lieux, la renommée de Pythagore toute florissante, il s'était livré aux hommes de cette école et à leurs études : puis, dans sa première et dominante affection pour Socrate, voulant tout reporter sur lui, il unit avec art l'enjouement et la finesse de l'élocution socratique,[11] à la profondeur de Pythagore et à cette variété de hautes connaissances. XI. Scipion achevait ces mots, lorsqu'il vit entrer Furius; et, après un salut plein d'amitié, lui prenant la main, il le plaça près de lui. Au même instant Rutilius, celui qui nous a si heureusement conservé cet entretien, étant survenu, il le fit, avec le même accueil, asseoir près de Tubéron. Eh bien, dit Furius, où en êtes-vous? notre présence a-t-elle coupé court à quelque conversation? Nullement, reprit Scipion; car vous êtes, pour votre part, habituellement curieux de toutes les questions qui rentrent dans le sujet que Tubéron avait tout à l'heure entrepris, et notre ami Rutilius, même au siège de Nu m an ce, s'occupait quelquefois avec moi de recherches semblables. Quel était enfin l'objet en discussion? reprit Philus. — Nous parlions du double soleil récemment apparu; et, sur ce point, je voudrais savoir de vous ce que vous pensez. XII. Dans le moment où Scipion parlait, un esclave annonça que Lælius[12] allait venir, et qu'il était déjà sorti de chez lui. Scipion, s'étant chaussé et habillé, quitta aussitôt son appartement; et à peine avait-il fait quelques pas, sous le portique, qu'il vit à portée du salut Lælius et ceux qui raccompagnaient. C'était Mummius, que Scipion aimait particulièrement, C. Fannius et Q. Scévola, gendres de Lælius, jeunes gens fort instruits, et déjà dans l'âge de la questure. Après les avoir tous salués, il fit un nouveau tour sous le portique, en donnant à Lælius la place du milieu car, dans leur amitié, ce fut un principe de droit, pour ainsi dire, que dans les camps, Lælius, en considération de la gloire éminente du vainqueur de l'Afrique, révérait Scipion comme un Dieu, et que dans la vie civile[13] Scipion, à son tour, par égard pour la supériorité de l'âge, honorait Lælius comme un père. Lorsqu'ils se furent un moment entretenus, en faisant un ou deux tours d'allée, Scipion, que flattait et charmait leur présence, eut envie de les faire asseoir dans le lieu de la prairie le plus exposé au soleil; car c'était encore la saison de l'hiver. Comme ils s'y rendaient, survint un homme fort éclairé, également agréable et cher à tous les amis assemblés, Manilius. Après le plus affectueux accueil, il s'assit à côté de Lælius. XIII. Philus prenant alors la parole : Je ne crois pas, dit-il, que la présence de ces nouveaux venus nous oblige de chercher un autre texte à nos entretiens : elle nous prescrit seulement une discussion plus soignée, et des paroles quelque peu dignes des oreilles qui nous écoutent. Mais enfin, dit Lælius, que disiez-vous? quelle conversation avons-nous interrompue? Philus. Scipion venait de me demander mon opinion sur le fait généralement attesté de l'apparition de deux soleils. Lælius. Eh! quoi, Philus,[14] avons-nous déjà si fort éclairci ce qui intéresse nos maisons et la République, pour nous enquérir de ce qui se passe dans le ciel? Pensez-vous donc, reprit Philus, que nos demeures ne soient pas intéressées à ce qui survient dans cette grande demeure, qui n'est pas celle qu'enferment ici-bas nos murailles, et qui n'est autre que le monde lui-même, dans son immensité, le monde, que les dieux nous ont donné pour domicile et pour patrie à partager avec eux-mêmes? D'ailleurs, on ne peut ignorer ces choses, sans renoncer à de nombreuses et hautes vérités. Pour moi, ainsi que vous, certainement, Lælius, et comme tous les esprits amoureux de la sagesse, l'étude et la seule pensée de ces grands objets me ravissent. Je ne m'y oppose en rien, reprit Lælius, surtout dans cette oisiveté d'un jour de fête. Mais pourrons-nous encore entendre quelque chose, ou sommes-nous arrivés trop tard? — Scipion. Il n'y a pas encore de débat commencé; et la question demeurant tout entière, je vous céderai volontiers la parole, pour que vous en disiez votre avis. Lælius. Ayons plutôt le plaisir de vous entendre, à moins que Manilius ne juge à propos de régler le litige entre ces deux soleils, et d'ordonner de part et d'autre le maintien du possessoire.[15] Manilius reprit aussitôt : Voulez-vous donc, Lælius, toujours vous moquer d'une science, où d'abord je me pique d'être habile, et sans laquelle d'ailleurs, personne ne pourrait distinguer son bien, ni le bien d'autrui? Mais nous y reviendrons : il faut d'abord écouter Philus, que je vois, en ce moment, consulté sur une difficulté plus grave que toutes celles dont s'occupe ou Mucius, ou moi. XIV. Philus prenant la parole : Je ne vous présenterai, dit-il, rien de nouveau, ni découverte, ni pensée qui m'appartienne; car, voici ce dont je me souviens. Sulpicius Gallus,[16] homme d'une profonde doctrine, comme vous le savez, entendant un jour le récit d'un prodige semblable, et se trouvant chez Marcellus, qui avait été son collègue dans le consulat, demanda qu'on lui mit sous les yeux un globe céleste, que l'aïeul de Marcellus avait autrefois enlevé, à la prise de Syracuse, du milieu de cette magnifique et opulente ville, sans rapporter dans sa maison autre butin d'une si grande conquête. J'avais entendu souvent citer cette sphère, à cause de la grande renommée d'Archimède. L'aspect ne m'en parut pas fort remarquable. Il en existait une autre, d'une forme plus élégante et plus connue du vulgaire, ouvrage du même Archimède, et placée par le même Marcellus à Rome, dans le temple de la Vertu. Mais, sitôt que Gallus eut commencé d'expliquer avec une haute science la composition de cette machine, je jugeai qu'il y avait eu dans le géomètre sicilien un génie supérieur à ce qui semblait la portée de l'humaine nature. Gallus nous disait, que cette autre sphère solide et compacte était d'invention fort ancienne, et que le premier modèle en avait été donné par Thalès de Milet; que, dans la suite, Eudoxe de Cnide, disciple de Platon, avait tracé sur ses contours les astres attachés à la voûte des cieux; et que beaucoup d'années après, empruntant à Eudoxe ce dessin et cette belle ordonnance, Aratus leur avait donné l'éclat des vers, sans avoir lui-même connaissance de l'astronomie, et par la seule force de son instinct poétique. Il ajoutait que cette transfiguration de la sphère, qui représente les mouvements de la lune, du soleil, et des cinq étoiles nommées errantes ou irrégulières, n'avait pu s'appliquer à ce premier globe d'une forme solide ; et que l'art merveilleux d'Archimède était d'avoir tellement combiné sa nouvelle sphère, que dans le jeu de mouvements disparates, une seule impulsion déterminait des résultats inégaux et variés. Et en effet, Gallus touchait-il cette sphère,[17] on voyait, sur sa surface, la lune remplacer le soleil par un tour de cercle, autant de fois qu'elle le remplace dans les cieux par l'intervalle d'un jour, d'où il résultait que la disparition du soleil s'y trouvait marquée comme dans les cieux, et que la lune touchait le point où elle est obscurcie par l'ombre de la terre, à l'instant où le soleil reparaissait sur l'horizon, etc. XV. Scipion. D'ailleurs, j'aimais moi-même Gallus, et je savais qu'il avait été placé très haut dans l'estime et l'affection de mon père Paulus. Je me souviens que, dans ma première jeunesse, lorsque mon père, consul, commandait en Macédoine, comme nous étions en campagne, notre armée fut saisie d'une pieuse terreur, parce que, dans une nuit claire, la lune pleine et brillante s'était soudainement éclipsée. Gallus, qui se trouvait alors notre lieutenant, l'année même avant celle où il fut nommé consul, n'hésita point à publier le lendemain dans le camp qu'il n'y avait point là de prodige; que cet effet avait eu lieu par une cause qui se reproduirait toujours à certaines époques, quand la position du soleil ne le laisserait pas atteindre la lune de sa lumière. Pouvait-il donc, suivant vous, dit Tubéron, faire comprendre cette explication à des hommes grossiers, et osait-il bien parler ainsi devant des ignorants? Scipion. Tout à fait. Je vous assure ………………………….. ……………………………. La prétention ne sembla point orgueilleuse de sa part; et son discours ne parut point s'éloigner de la dignité d'un si grave personnage. Et réellement, il avait fait une grande chose, en ôtant à des esprits troublés leurs craintes et leurs vaines superstitions. XVI. On raconte même, d'une manière à peu près semblable, que, dans cette grande guerre où les Athéniens et les Lacédémoniens luttèrent ensemble avec une si violente animosité, ce fameux Périclès, le premier homme de son pays par le crédit, l'éloquence et le génie politique, voyant les Athéniens préoccupés d'une excessive frayeur, à la suite d'une éclipse de soleil qui avait répandu tout d'un coup les ténèbres, leur enseigna, ce qu'il avait lui-même appris à l'école d'Anaxagore, que de semblables effets arrivaient, dans un intervalle précis et nécessaire, lorsque la lune se trouvait placée tout entière sous le soleil ; et que par ce motif, bien qu'il n'en fût pas ainsi à tous, les commencements de mois, cela ne pouvait jamais avoir lieu qu'à des renouvellements de lune. Ayant démontré cette vérité par le raisonnement, il délivra le peuple de ses craintes. Car, c'était alors un système nouveau et inconnu, que celui de l'obscurcissement du soleil par l'interposition de la lune; et on dit que Thalès de Milet l'avait entrevu le premier; mais dans la suite, cette notion ne fut pas ignorée même de notre Ennius, qui écrit que vers l'an 350 de la fondation de Rome, aux nones de juin, Le soleil fut couvert par la lune et la nuit. Telle est, au reste, en cette matière, la perfection du calcul et de l'art, qu'à partir de ce jour ainsi consigné par nous dans les vers d'Ennius et dans les registres des Pontifes, on a supputé les éclipses antérieures, jusqu'à celle qui était arrivée aux nones de juillet, sous le règne de Romulus, éclipse dont la soudaine obscurité fit croire que Romulus, en dépit de cette périssable nature qui le précipita vers une fin tout humaine, avait été, pour sa vertu, enlevé dans les cieux. XVII. Ne vous semble-t-il pas, Émilien, dit alors Tubéron, que cette science, qui paraissait tout à l'heure de peu de prix, mérite d'être enseignée?[18] ….. Scipion ….. Que peut-il exister de grand parmi les hommes, aux yeux de celui qui a pénétré ce domaine des dieux? Quoi de durable, pour celui qui connaît ce qu'il y a d'éternel! quoi de glorieux, enfin, pour celui qui voit combien la terre est petite, et dans toute l'étendue de sa surface, et dans la portion qu'en habitent les hommes, et quel imperceptible point nous en occupons, pour espérer que de ce point qui nous laisse inconnus à beaucoup de nations, notre nom pourra se répandre et voler au loin! Que sont, enfin, toutes les choses terrestres pour celui qui n'admet, ni ne reconnaît comme des biens les terres, les palais, les troupeaux, les amas d'argent et d'or, parce qu'à ses yeux la jouissance en est médiocre, l'usage borné, la propriété incertaine, et que, souvent, les derniers des hommes en ont d'immenses possessions! Combien doit-on estimer heureux l'homme qui, seul, peut réellement, non pas au nom du droit romain, mais par le privilège des sages, prétendre à la propriété de toutes choses, et s'autoriser, non d'un contrat civil, mais de la loi commune de la nature, par laquelle une chose n'appartient qu'à celui qui en sait la direction et l'usage! l'homme qui, plaçant les dictatures, les consulats dans le rang des devoirs imposés, et non dans celui des jouissances désirables, croit qu'il faut les subir, pour acquitter une dette, et non les briguer, en vue des récompenses et de la gloire; l'homme, enfin, qui peut dire de lui-même le mot qu'au rapport de Caton, mon aïeul l'Africain aimait à répéter : « qu'il ne faisait jamais mieux que lorsqu'il ne faisait rien, et qu'il n'était jamais moins seul que dans la solitude. » Qui peut, en effet, croire sérieusement que Denys, lorsqu'il fut parvenu, par mille efforts, à ravir à ses concitoyens leur liberté, avait accompli une plus grande œuvre qu'Archimède, son compatriote, au moment où, tandis qu'il paraissait ne rien faire, ce globe céleste dont nous parlions tout à l'heure sortit de ses mains? Aux yeux de quel homme ceux qui, dans la place publique au milieu de la foule, ne trouvent personne à qui il leur soit doux de parler, ne sont-ils pas plus réellement seuls que celui qui, sans témoins, s'entretient avec lui-même, ou assiste à la confidence des hommes les plus sages, en se nourrissant du charme de leurs inventions et de leurs écrite? Peut-on imaginer quelqu'un,-ou plus riche que celui auquel il ne manque rien de ce que demande la nature, ou plus puissant que celui qui atteint le terme de tous ses vœux, ou plus heureux que celui qui est affranchi de toute agitation de l'Ame, ou plus affermi dans son bonheur, que celui qui peut, suivant l'expression commune, emporter avec lui tout ce qu'il possède, même dans un naufrage? Et quel pouvoir, quelle magistrature, quelle royauté peuvent être préférables à une sagesse qui, regardant de haut tous les biens terrestres, et les voyant au-dessous d'elle, ne roule incessamment dans ses pensées rien que d'éternel et de divin, et demeure persuadé que le nom d'homme se prend vulgairement, mais qu'il n'y a d'hommes en effet que par la culture des connaissances, attribut personnel de l'humanité? C'est en ce sens qu'un mot de Platon, ou peut-être de quelque autre philosophe, me parait fort heureux. La tempête ayant jeté son vaisseau vers des terres inconnues et sur une plage déserte, au milieu de la crainte que l'ignorance des lieux inspirait à ses compagnons, il aperçut, dit-on, des figures de géométrie que l'on avait tracées sur le sable, et s'écria aussitôt qu'il fallait avoir bonne espérance, puisqu'il avait vu des vestiges d'hommes : interprétation qu'il tirait, vous le voyez, non de la culture des campagnes, mais de la vue de ces signaux de la science. Aussi, Tubéron, pour ma part, j'ai toujours aimé et la science et les hommes savants, et vos doctes études. XVIII. Lælius prenant alors la parole : Je n'ose, Scipion, répondre à cela; je n'ai pas la hardiesse d'attaquer, ou vous, ou Manilius, ou Philus. Nous avons eu, dans la famille de Tubéron, un ami qui pourrait lui servir de modèle. Un vieux Romain Sextus, le sage et l'avisé. Sage et avisé il fut en effet, et bien nommé par Ennius, non pour avoir cherché ce qu'il n'aurait pu trouver, mais parce qu'il faisait les réponses les plus propres à tirer de peine et d'embarras tous ceux qui le consultaient. C'était lui qui, raisonnant contre les études astronomiques de Gallus, avait toujours à la bouche ces paroles d'Achille, dans Iphigénie : Ces chercheurs d'avenir, astrologues, devins, Follement entêtes de leurs présages vains, Des signes étoilés de la Chèvre et de l’Ourse Attendent le retour, interrogent la course : Ils ne savent point voir ce qu’ils ont sous les yeux Et se flattent de lire en l’abîme des cieux. [19] Il disait encore, car je l'écoutais souvent et avec plaisir, que Zethus, dans la pièce de Pacuvius, était trop ennemi de la science. Il goûtait davantage le Neoptolème d'Ennius, qui dit quelque part qu'il veut de la philosophie, mais sobrement, et sans s'y livrer tout entier. Si les études des Grecs ont tant de charmes pour vous, il en est d'autres, plus libres et plus communicatives, que nous pouvons appliquer à l'usage de la vie, ou même à la chose publique. Quant à ces sciences abstraites, leur utilité, si elles peuvent en avoir, sera d'affiner et, en quelque sorte, d'agacer l'esprit de l'enfance, pour lui rendre plus faciles de plus grandes études. XIX. Tubéron. Je ne m'éloigne pas de votre opinion, Lælius; mais quelles études, je vous prie, concevez-vous plus importantes? Lælius. Je le dirai; et je m'exposerai peut-être à vos dédains, puisque c'est vous qui avez interrogé Scipion sur ces objets célestes, et que moi, je crois les choses qui sont devant nos yeux plus faites pour occuper nos recherches.[20] En effet, d'où vient que le petit-fils de Paul-Émile, le neveu d'Émilien, l'enfant d'une si noble famille et d'une si glorieuse république, s'inquiète de l'apparition de deux soleils, et ne cherche pas pourquoi nous avons aujourd'hui, dans une seule République, deux sénats et presque deux peuples en présence? Car, vous le voyez, la mort de Tibérius Gracchus, et auparavant tout le système de son Tribunat, a divisé la nation en deux partis. Les calomniateurs et les ennemis de Scipion, soulevés d'abord par P. Crassus[21] et Appius Claudius, persévèrent, depuis la mort de ces deux chefs, à maintenir contre nous la scission d'une moitié du sénat, sous l'influence de Métellus et de Mucius; et l'homme qui, seul, pourrait tout, dans ce mouvement des alliés et des Latins vers la révolte, parmi les traités rompus, en présence des Triumvirs factieux suscitant chaque jour quelque intrigue nouvelle, au milieu de la consternation des riches et des bons citoyens, ils ne lui permettent pas de prêter secours à nos périls! Aussi, jeunes gens, si vous m'en croyez, ne redoutez pas ce phénomène d'un second soleil : car, ou il ne peut exister; ou il peut exister, comme on l’a vu, sans être fâcheux pour nous, ou, de quelque manière qu'il existe, nous sommes hors d'état d'en rien connaître; ou, lors même que nous en aurions la plus exacte notion, ce savoir ne nous rendrait ni meilleurs, ni plus heureux. Mais l'unité du peuple, l'unité du sénat est chose possible : c'est très grand dommage, si elle fait défaut, et nous savons qu'elle n'est pas, et que, si elle existait, nous serions plus sages et plus heureux. XX. A votre avis, dit alors Mucius, que nous faut-il donc apprendre, pour être à portée de faire ce que vous demandez? Lælius. Les sciences, qui ont pour effet de nous rendre utiles à la république ; car c'est là, je pense, le plus glorieux bienfait de la sagesse, et le plus grand témoignage de la vertu, comme son plus grand devoir. Ainsi, pour employer ces jours de fête aux entretiens qui peuvent être le plus profitables à l'État, prions Émilien de nous exposer quelle est, à ses yeux, la meilleure forme de gouvernement; ensuite,1 nous passerons à d'autres points, dont la connaissance nous ramènera, j'espère, au sujet du moment, et nous expliquera les causes des dangers qui nous menacent aujourd'hui. XXI. Philus, Manilius et Mummius approuvèrent fort cette idée[22] ……………………………….. Lælius....... J'ai insisté pour cela, d'abord parce qu'il était juste que, sur la République, le premier citoyen de la République parlât de préférence : de plus, je me souviens que vous aviez coutume de discuter avec Panætius et devant Polybe, deux Grecs fort instruits dans les questions politiques, et que vous établissez, par beaucoup de particularités et de raisonnements, l'excellence de notre Constitution sociale, telle que nous l'avons reçue de nos aïeux. Préparé comme vous l'êtes sur ce sujet, si vous voulez donc nous exposer votre pensée touchant la république (je parle ici pour nos amis et pour moi), vous nous ferez plaisir à tous. XXII. Scipion reprenant alors : Je puis dire qu'il n'est aucun sujet de méditation, où mon esprit se porte habituellement avec plus d'ardeur et de soin que celui même, Lælius, qui m'est en ce moment proposé par vous : et, en effet, lorsque dans chaque profession, je vois tout artisan, j'entends celui qui se distingue, ne rêver, ne chercher, ne travailler qu'à obtenir la supériorité de son art; moi, dont l'œuvre unique, à l'exemple de mon père et de mes ancêtres, doit être la défense et l'administration de l'État, ne serais-je pas, de mon propre aveu, plus indolent qu'un ouvrier vulgaire, si je donnais au plus noble des arts moins de peine et de soin qu'ils n'en mettent aux plus obscurs métiers? Au reste, d'une part, je ne suis point satisfait des choses que nous ont laissées sur cette question les hommes les plus grands et les plus sages de la Grèce ; et, de l'autre, je n'ose préférer mes propres vues aux leurs. Ainsi, je vous prie, ne me regardez ni comme tout à fait étranger aux lettres grecques, ni comme disposé à leur accorder, surtout en ce genre, la prééminence sur les nôtres. Voyez plutôt en moi un de nos Romains élevés, par les soins de son père,[23] avec le goût peut-être des études libérales, passionné, dès l'enfance, du désir d'apprendre, mais en tout formé par l'expérience et les leçons domestiques, beaucoup plus que par les livres. XXIII. Philus dit alors : Je crois que, pour le génie naturel, personne ne vous est supérieur, et que pour l'expérience des plus grandes choses, en fait de gouvernement, vous l'emportez facilement sur tout le monde. Nous savons, d'ailleurs, quelles furent toujours vos études; et si, comme vous le dites, vous avez également porté votre esprit vers ces spéculations, vers cette science de la politique, je remercie beaucoup Lælius, car j'ai l'espérance que vos idées sur ce sujet seront bien plus fécondes que tout ce que les Grecs en ont écrit pour nous. Scipion reprit : Vous appelez une grande attention sur mon discours; et c'est le fardeau le plus pénible pour qui va traiter un sujet difficile. Philus. Quelle que soit notre attente, vous la surpasserez, suivant votre habitude : et il n'est pas à craindre que vous, Scipion, parlant de la république, les expressions vous manquent. XXIV. Scipion. Je ferai ce que vous voulez, de mon mieux ; et en commençant, je me prescrirai la règle que l’on doit, à mon avis, observer dans toute discussion, si l'on veut éviter l'erreur : c'est, lorsque l’on est d'accord sur la dénomination de l'objet discuté, d'expliquer nettement ce qu'elle signifie; et, ce point convenu, d'entrer aussitôt en matière. Car, jamais on ne pourra comprendre quels sont les éléments de la chose sur laquelle on discute, si l'on n'a d'abord compris ce qu’elle est. Ainsi, nos recherches portant sur République, voyons d’abord quel est cet objet que cherchons. Lælius fit un signe d’approbation; et Scipion poursuivant : Je n’adopterai pas, dit-il, sur une chose si claire et si connue, ce système de discussion qui remonte aux premières origines, comme le font ordinairement nos savants, de manière à reprendre les faits, à partir du premier rapprochement des deux sexes, pour passer ensuite à la première naissance et à la formation de la première famille, et pour définir vingt fois chaque fait et chacune de ses variétés. En effet, parlant à des hommes instruits, et qui se sont mêlés avec gloire à toutes les transactions militaires et civiles d’une puissante république, je n’aurai pas ce tort; que la chose dont je raisonne, soit par elle-même plus claire que mon explication. Car je ne me suis pas chargé de suivre magistralement la question dans tous ses points; et je ne m’engage pas à ne laisser échapper aucun détail. Lælius. Pour moi, j'attends de vous précisément le genre de discussion que vous promettez. XXV. Eh bien! dit Scipion, la chose publique est la chose du peuple ; un peuple n'est pas toute agrégation d'hommes formée de quelque manière que ce soit : mais seulement une réunion cimentée par un pacte de justice et une communauté d'intérêts. La première cause pour se réunir, c'est moins la faiblesse de l'homme, que l'esprit d'association qui lui est naturel. Car l'espèce humaine n'est pas une race d'individus isolés, errants, solitaires ; elle naît avec une disposition qui, même dans l'abondance de toutes choses et sans besoin de secours, lui rend nécessaire la société des hommes ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. XXVI. Il faut supposer ces germes originels ; car, on ne trouverait nulle convention première, qui ait institué ni les autres vertus, ni même l'état social. Ces réunions, formées par le principe dont j'ai parlé, établirent d'abord leur habitation dans un lieu fixe, choisi pour la demeure commune : l'ayant fortifiée par l'avantage du site et par des travaux, ils appelèrent forteresse ou ville cet assemblage de maisons, entremêlé de temples et de places destinés à l'usage public. Or, tout peuple, c'est-à-dire toute réunion d'une multitude aux conditions que j'ai posées, toute cité, c'est-à-dire toute constitution particulière d'un peuple, toute chose publique enfin, et par là j'entends, comme je l'ai dit, la chose du peuple, a besoin, pour se maintenir durable, d'être régie par une autorité intelligente.[24] Cette autorité doit toujours se rapporter, avant tout, au premier principe qui a produit la Cité. Ensuite, il faut qu'elle soit placée, ou dans la main d'un seul, ou dans quelques mains choisies, ou qu'elle soit prise par la multitude, par l'universalité. Ainsi, lorsque la direction de toutes choses dépend d'un seul, nous appelons cet individu roi, et cette forme de Constitution politique, royaume. Lorsque la souveraineté dépend d'un petit nombre choisi, on dit que c'est une cité soumise à la volonté de l'aristocratie. Enfin, l'état populaire, car telle est l'expression usitée, est celui où toute chose réside dans le peuple. Et si le lien qui a primitivement réuni les hommes en société, dans un intérêt commun, conserve toute sa force, chacune de ces formes de gouvernement est, je ne dirai pas parfaite, ni même bonne, à mon avis, mais tolérable et susceptible d'être préférée l’une à l'autre. En effet, soit avec un roi juste et sage, soit avec une élite de citoyens éminents, soit avec le peuple lui-même, bien que cette supposition paraisse la moins favorable, il peut, sauf quelques injustices et quelques passions jetées à la traverse, s'établir un état de choses assez régulier. XXVII. Mais, dans la monarchie, tout ce qui n'est pas le monarque est trop dépouillé de droit et de pouvoir public : sous la domination aristocratique, la multitude participe à peine à la liberté, étant privée de toute puissance et de toute délibération publique; et dans les États où le peuple fait tout, en le supposant juste et modéré, l'égalité même devient une injuste inégalité, en ce qu'elle ne souffre aucune gradation dans les rangs. Aussi, que Cyrus ait été le plus juste et le plus sage des rois, je ne trouve pas pour cela fort désirable cette chose du peuple (telle est, je l'ai dit, ma définition de la chose publique), qui dépendait du clin d'œil d'un seul homme. Et maintenant, si les Marseillais, nos clients, sont gouvernés avec la plus grande justice par quelques citoyens principaux, il y a toujours, dans cette condition d'un peuple, je ne sais quelle apparence de servitude. Enfin, si les Athéniens, à certaines époques, après avoir supprimé l'aréopage, faisaient tout par les actes et les décrets du peuple, leur république, n'offrant plus alors une gradation de rangs et d'honneurs, avait perdu son plus bel ornement. XXVIII. Et je raisonne ainsi sur ces trois formes de gouvernement, en les concevant, non pas désordonnées et confondues, mais dans leur situation fixe et régulière. Ces trois formes, en effet, ont d'abord, chacune en soi, les défauts que j'ai désignés ; puis elles ont d'autres défauts encore qui sont cause de ruine. Car, il n'existe aucune de ces formes de gouvernement, qui n'ait son passage glissant et rapide vers un écueil voisin. Après ce roi tolérable, pour me servir de l'ex pression la plus juste, ou même si vous le voulez, après ce roi digne d'amour, Cyrus enfin, je vois paraître, avec la licence du pouvoir absolu, un barbare Phalaris, exemple odieux, dont la domination d'un seul tend toujours à se rapprocher, par une pente facile et naturelle. A côté de cette sage aristocratie de Mar seille, se présente ce qui exista dans Athènes, à une certaine époque, le complot et la faction des Trente. Enfin, pour ne pas chercher d'autres exemples, chez les Athéniens, le pouvoir illimité du peuple étant dévolu aux mains d'une multitude aveugle et effrénée, causa la ruine de ce même peuple[25] ………………………………………………….. XXIX. Le pire état de choses résulte quelquefois d'une confusion de l'aristocratie, de l'oligarchie factieuse, du pouvoir royal, et même du pouvoir populaire; et il arrive aussi que, de ces éléments divers, on voit éclore une nouvelle espèce de gouvernement. Car, il y a dans la constitution des États un merveilleux enchaînement, et comme des retours périodiques de changements et de vicissitudes. Il appartient au sage de les connaître; mais, en calculer l’approche, et joindre à cette prévoyance l'habileté qui modère le cours des événements et les retient dans sa main, c'est l'œuvre du grand citoyen, et je dirai presque de l'homme inspiré. Aussi, je crois qu'une quatrième forme politique particulièrement digne d'éloges, est celle qui se forme par le balancement et le mélange des trois premières que j'ai désignées. XXX. Lælius. Je n'ignore pas, Scipion, que c'est là votre préférence;[26] je vous l'ai souvent entendu dire. Je n'en désire pas moins, si je ne parais pas importun, apprendre de vous quel est, de ces trois modes de gouvernement, le meilleur, à vos yeux. Cela doit toujours servir pour l'examen de la question…………………….. XXXI. ……….[27] Chaque forme de gouvernement vaut suivant la nature et la volonté du pouvoir qui la dirige. Nulle autre société que celle où le peuple exerce la puissance souveraine, n'est véritablement le séjour de la liberté, de cette liberté le plus doux des biens, et qui, si elle n'est pas égale pour tous, n'est plus la liberté. Et comment peut-elle avoir ce caractère d'égalité, je ne dis pas sous la monarchie, où l'esclavage n'est ni douteux, ni déguisé, mais même dans ces États, où tous les citoyens ne sont libres que de nom? En effet, ils donnent des suffrages, ils délèguent des commandements; ils sont sollicités, suppliés par les candidats aux magistratures; mais ils donnent des choses que, bon gré mal gré, il faut toujours donner; des choses qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes, bien que l'on vienne les chercher près d'eux. Car ils ne sont point admis au commandement, à l'exercice de l'autorité publique, au rang des juges, avantages qui se déterminent par l'antiquité des familles, ou d'après la richesse. Mais dans une nation vraiment libre, à Athènes, à Rhodes, il n'est aucun citoyen qui ne puisse parvenir à tout. XXXII. ……………… Suivant ces philosophes, sitôt que, chez un peuple, un ou plusieurs hommes se sont élevés par la richesse et la puissance, on a vu les privilèges naître de leurs prétentions et de leur orgueil, les timides et les faibles s'empressant de céder, et pliant sous l'orgueil des riches. Ils ajoutent qu'au contraire, si le peuple savait maintenir son droit, rien ne serait plus glorieux, plus libre et plus prospère : car il resterait alors souverain dispensateur des lois, des jugements, de la guerre, de la paix, des traités, de la fortune et de la vie de chaque citoyen, et ainsi seulement, à leur gré, l'État pourrait être appelé chose publique, c'est-à-dire chose du peuple. C'est par ce principe que suivant eux, l'on voit souvent une nation remonter de la domination des patriciens ou des rois vers la liberté, et non pas de son état de peuple libre, se remettre sous le gouvernement des rois, ou sous l'influence et la protection des grands. Ils ne croient pas, d'ailleurs, que les excès d'un peuple sans frein soient un motif de repousser, dans son ensemble, ce caractère d'un peuple libre. Ils disent que, si ce peuple est uni, et rapporte inviolablement tous ses efforts au salut et à la liberté commune, rien n'est plus fort, rien n'est plus immuable ; que cette union nécessaire est très facile dans une république ordonnée de manière à créer le même intérêt pour tous; que les diversités d'intérêt, l'utilité de l'un, opposée à celle de l'autre, produisent les discordes ; qu'ainsi, tant que le sénat avait été maître, jamais la République n'avait eu de stabilité ; que cet avantage était encore plus rare dans les royautés, où, comme l'a dit Ennius, La puissance jamais ne peut se partager. Or, la loi étant le lien de la société civile, et le principe de la loi étant l'égalité, quel droit peut-il rester à une association de citoyens, lorsque la condition de ces citoyens n'est pas égale? Si, en effet, on n'a point voulu mettre l'égalité entre les fortunes, si on ne peut la mettre entre les esprits, au moins doit-elle exister, entre les droits de ceux qui sont citoyens d'une même république. Qu'est-ce, en effet, qu'une cité, sinon une association au partage du droit?[28] ………………………………………………………………… XXXIII. Quant aux autres formes politiques, ces philosophes ne les croient pas dignes des noms qu'elles prétendent s'attribuer. Pourquoi, en effet, du nom de Roi réservé à Jupiter très bon, irais-je qualifier un homme avide du commandement, de l'unité de pouvoir, et dominant sur un peuple abattu? Pourquoi ne l'appellerai s-je pas plutôt du nom de tyran? Car, il est tout aussi facile à un tyran d'être clément, qu'à un roi d'être .oppresseur. Toute la question, pour le peuple, est de servir sous un maître indulgent, ou cruel ; mais, il ne saurait s'épargner de servir. Du reste, comment Lacédémone pouvait-elle, à l'époque même de la supériorité prétendue de son institution politique, avoir des rois justes et bons, puis qu'elle recevait nécessairement pour roi l'héritier, quel qu'il fût, sorti du sang royal? Quant aux aristocrates, peut-on supporter des hommes se décernant eux-mêmes un tel titre, non de l'aveu du peuple, mais par leurs propres suffrages? où est-il en effet, parmi eux, cet homme jugé le meilleur par la science, les talents, les travaux?[29] ………………………….. XXXIV. Si l'État choisit ses guides au hasard, il s'abîme aussi vite qu'un vaisseau, où l'on appellerait au gouvernail un des passagers désigné par le sort. Si un peuple est libre, il aura le choix de ceux auxquels il entend se confier; et s'il veut sa propre conservation, il choisira toujours les plus sages. C'est aux avis des sages que le salut des États est attaché, d'autant plus que la nature, non seulement a donné à ces hommes supérieurs par la vertu et le génie, de l'ascendant pour gouverner les faibles, mais qu'elle inspire à ceux-ci l'envie d'obéir aux hommes supérieurs. Mais l'excellence de cette combinaison est détruite, dit-on, par les faux jugements de la foule qui, dans l'ignorance de cette vertu, dont les modèles sont si peu nombreux, et dont les juges et les appréciateurs ne sont pas moins rares, s'imagine que, parmi les hommes, les meilleurs sont les puissants, les riches et ceux qui descendent d'une illustre origine. Lorsqu'à la faveur de cette méprise du vulgaire, la puissance, et non la vertu de quelques hommes, a pris possession de l'État, ces hommes principaux retiennent obstinément le titre de grands : mais, dans le fait, ils ne le justifient pas ; car les richesses, le nom, la puissance, dépourvues de la sagesse et d'un juste tempérament pour se conduire et pour commander aux autres, ne sont plus que déshonneur et fastueuse insolence ; et il n'est pas de Cité, dont l'aspect soit plus révoltant que celle, où les plus riches sont considérés comme les meilleurs. Quoi de plus admirable, au contraire, qu'une république gouvernée par la vertu, alors que celui qui commande aux autres n’est lui-même esclave d'aucune passion honteuse, alors que toutes les choses, dont il fait la règle et le but des citoyens, il les embrasse lui-même, qu'il n'impose pas de loi à laquelle lui-même n'obéisse, et que sa propre vie est comme une loi qu'il présente à ses concitoyens! Si un homme pouvait suffire à tout, il ne serait pas besoin de plusieurs; et si l'universalité des citoyens pouvait toujours voir le bien et s'accorder sur ce point, personne ne demanderait des chefs élus. La difficulté d'une sage détermination a fait passer le pouvoir du roi aux grands ; l'ignorance et l'aveuglement des peuples l’a ramené des mains de la foule dans celles du petit nombre. De cette manière, entre l'impuissance d'un seul et l'égarement du grand nombre, les Aristocrates ont occupé une situation moyenne, la mieux ordonnée de toutes ; et, tandis qu'ils surveillent la chose publique, les peuples jouissent nécessairement du plus grand bonheur possible, étant libres de tout soin et de toute pensée, et s'en étant remis de leur repos à d'autres, qui doivent le garantir, et non pas commettre la faute de laisser croire au peuple que ses intérêts sont négligés par les grands. Quant à cette égalité de droits que chérissent les peuples libres, remarquons qu'elle ne saurait se maintenir : les peuples mêmes les plus ennemis du joug et de la contrainte ont toujours de grandes condescendances pour beaucoup de personnes; et il existe dans leur esprit un merveilleux discernement des rangs et des hommes : de plus, cette égalité prétendue est la plus injuste du monde. En effet, si semblable honneur est .exactement rendu aux plus éminents et aux plus infimes, dans toute la masse d'un peuple, il est inévitable que l'égalité même devienne une extrême injustice : c'est le malheur que n'ont pas à craindre les États qui sont gouvernés par l'élite des citoyens. Ces raisonnements, et quelques autres du même genre, Lælius, sont à peu près le texte habituel des plus zélés partisans de cette forme politique. XXXV. Mais vous Scipion, des trois natures de gouvernement, quelle est celle que vous approuvez le plus? Scipion. Vous avez raison de me demander celle que j'approuve le plus ; car, il n'est aucune de ces formes, prise isolément, que j'approuve d'une manière absolue ; et je préfère à chacune d'elles un gouvernement sorti du mélange de toutes. S'il fallait cependant me borner à une de ces formes, dans sa simplicité et dans son unité, mon approbation, mes premiers éloges seraient pour la monarchie. Mais, dans les idées que je renferme sous cette dénomination, se présente d'abord le titre de père attaché à celui de roi, pour exprimer qu'il veille sur ses concitoyens, comme sur ses enfants, et s'applique bien plus à les conserver qu'à les assujettir ; d'où il résulte que les petits et les faibles gagnent à être soutenus par cette surveillance protectrice d'un seul homme, très bon et très puissant. Viennent aussi les grands qui s'offrent à faire la même chose et à la faire mieux; ils disent, qu'il y a plus de lumières dans plusieurs que dans un seul; et ils promettent, d'ailleurs, la même justice et la même bonne foi. Enfin, voici venir le peuple nous crier tumultueusement qu'il ne veut obéir ni à un seul, ni à plusieurs; que, pour les bêtes même, la liberté est le plus doux des biens ; et que les hommes en sont privés, soit qu'ils servent un roi, ou des grands. Ainsi, les rois nous présentent l'attrait de l'affection, les grands celui du talent, les peuples celui de la liberté; et, dans cette concurrence, le choix est difficile.[30] Je conçois, dit Lælius ; mais, il n'est guère possible d'éclairer le reste de la question, si vous laissez ce premier point encore en ébauche. XXXVI. Scipion. Il faut donc imiter Aratus, qui, se préparant à traiter de grandes choses, se croit obligé de commencer par Jupiter. Lælius. Pourquoi Jupiter? et qu'a de commun ce discours avec le poème d’Aratus? Scipion. C'est un avis pour nous de remonter à celui que d'une voix unanime les ignorants et les sages nomment tous également le seul maître de tous, les dieux et les hommes. Comment? dit Lælius. Scipion reprit : Que pouvez-vous supposer autre chose que ce qui frappe les yeux? Si ce sont les chefs des États qui ont établi, pour l'utilité de la vie humaine, la croyance qu'il existe un roi unique dans les deux, dont le clin d'œil, suivant l'expression d'Homère, fait mouvoir tout l'Olympe, et qui est le roi et le père de tous les êtres : voilà toujours une éclatante autorité et de nombreux, ou plutôt d'universels témoignages, qui nous attestent que les nations ont unanimement reconnu, par les décrets des princes, l'excellence de la royauté, puisqu'elles s'accordent à penser que tous les dieux sont gouvernés par la providence d'un seul; et si nous avons appris que cette opinion reposait sur l'erreur des ignorants, et devait être rangée parmi les fables, écoutons du moins, comme les précepteurs publics des gens éclairés, les hommes qui ont vu, pour ainsi dire de leurs yeux, ce que nous savons à peine par ouï-dire. Quels sont ces hommes? dit Lælius. Ceux, dit Scipion, qui, par l'investigation de la nature, sont arrivés à l'opinion que ce monde tout entier est ma par une âme universelle ……………………….. XXXVII. Mais si vous voulez, Lælius, je vous citerai des autorités qui ne sont ni trop antiques, ni barbares en aucune façon. Lælius. A ce compte, je le veux. Scipion. Et d'abord, remarquez-vous qu'il s'est écoulé un peu moins de quatre cents ans, depuis que cette ville n'a plus de rois, Lælius. Un peu moins, en effet. Scipion. Eh bien! que sont quatre cents années, dans l'âge d'une ville, d'un État? est-ce une longue durée? Lælius. C'est à peine l'âge viril. Scipion. Ainsi donc, à quatre cents ans de nous, il y avait un roi dans Rome, Lælius. Et certes un roi superbe. Scipion. Mais, avant lui? Lælius. Il y avait un roi très juste, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à Romulus, qui, six cents années avant cette époque, était roi. Scipion. Ainsi, lui-même n'est pas fort ancien. Lælius. Nullement; c'était déjà presque l'époque de la Grèce vieillissante. Scipion. Mais, dites-moi, Romulus fut-il roi d'un peuple barbare? Lælius. Si, à l'exemple des Grecs, on ne fait d'autre distinction que celle de peuple grec et de peuple barbare, j'ai bien peur qu'il n'ait été un roi de barbares; mais, si cette dénomination doit s'appliquer à l'état des mœurs, et non à la différence des langues, je ne crois pas les Romains plus barbares que les Grecs. Au reste, reprit Scipion, pour notre point de vue, ce que nous cherchons, ce n'est point un peuple, mais des esprits; et, de fait, si des hommes raisonnables et d'une époque peu ancienne ont voulu le gouvernement des rois, en citant cet exemple, je me sers de témoins qui ne sont ni trop antiques, ni grossiers, ou barbares. XXXVIII. Lælius. Je vois, Scipion, que les autorités ne vous manquent pas : mais auprès de moi, comme de tout bon juge, les preuves valent mieux que les témoins. Servez-vous donc, Lælius, reprit Émilien, d'une preuve tirée de vous-même et de votre expérience. Comment! dit Lælius, quelle expérience? Scipion. Celle que vous faites lorsque, par hasard, vous vous sentez en colère contre quelqu'un. Lælius. Cela m'arrive plus souvent que je ne voudrais. Scipion. Eh bien! lorsque vous êtes irrité, laissez-vous la colère maîtresse absolue de votre âme? Lælius. Non, par Hercule, j'imite cet Archytas de Tarente, qui, arrivant à sa maison de campagne, y trouva toute chose autrement qu'il n'avait ordonné. Malheureux! dit-il à son métayer, je t'aurais déjà tué de coups, si je n'étais en colère. très bien, dit Scipion ; ainsi Archytas regardait la colère, j'entends celle qui fait divorce avec la raison, comme un désordre séditieux de l'âme, qu'il voulait apaiser par la réflexion : comptez encore l'avarice ; comptez l'amour du commandement, de la gloire ; comptez les passions voluptueuses, et vous verrez que, dans l'esprit de l'homme, il se forme une sorte de royauté qui domine sur tous ces désordres par un seul principe, la réflexion. C'est, en effet, la partie la plus excellente de rame; et, sous son empire, il n'y a plus aucune place pour les voluptés, aucune pour la colère, aucune pour l'emportement aveugle. Lælius. Oui, sans doute. Scipion. Eh bien! approuvez-vous une âme ainsi disposée? Lælius. Plus que toute chose au monde. Scipion. Ainsi, vous n'approuveriez pas que les mauvais désirs qui sont innombrables, et les passions haineuses chassant la réflexion, s'emparassent de l'homme tout entier? Lælius. Moi, je ne concevrais rien de plus misérable qu'une intelligence ainsi dégradée, et qu'un homme animé par une telle âme. Scipion. Vous voulez donc que toutes les parties de l'âme soient soumises à une autorité régnante; en un mot, dirigées par la réflexion? Lælius. Je le désire ainsi. Scipion. Comment donc, alors, pouvez-vous être en doute de votre opinion sur le gouvernement des Etats, où, si les affaires sont partagées entre plusieurs, la conséquence immédiate, c'est qu'il n'y aura pas d'autorité qui commande; car si le pouvoir n'est un, il n'existe nul pouvoir? XXXIX. Mais, dit Lælius, qu'importe, je vous prie, d'un seul ou de plusieurs, si la justice se trouve également dans la pluralité? Scipion. Comme je vois, Lælius, que l'autorité de mes témoins vous touche fort médiocrement, je continue de vous prendre encore vous-même pour témoin, en preuve de ce que je dis. Moi, dit-il, à quel sujet? Scipion. Au sujet que je vous ai entendu prescrire fortement à vos esclaves, dans notre dernier voyage à Formies, de ne suivre les ordres que d'une seule personne. Lælius. Oui, sans doute, de mon métayer. Scipion. Et à Rome, vos affaires sont-elles en plusieurs mains? Lælius. Non, dans les miennes seules. Scipion. Mais en On, toute votre maison a-t-elle quelque autre chef que vous? Lælius. Nullement. Scipion. N'accordez-vous donc pas également que dans l'ordre politique, le pouvoir d'un seul, pourvu qu'il soit juste, est le plus salutaire? Lælius. Vous me conduisez là ; et je suis presque de votre avis. XL. Scipion. Vous en serez bien davantage, reprit Scipion, si laissant de côté la comparaison du pilote et du médecin, et ne m'arrêtant pas à vous dire que, pour la conduite d'un vaisseau, ou le salut d'un malade, on se confie à un seul, en le supposant au niveau de son art, de préférence â plusieurs, je passe à des considérations plus élevées. Lælius. Quelles sont ces considérations? Scipion. Quoi! ne voyez-vous pas que la cruauté et le génie superbe du seul Tarquin attira la haine du peuple sur le nom de roi? Lælius. Je le sais. Scipion. Alors vous savez aussi ce que, dans la suite de ce discours, je crois avoir bientôt à dire, que le peuple, à l'expulsion de Tarquin, fut emporté par an merveilleux excès de liberté nouvelle. Alors, des bannissements injustes, le pillage d'un grand nombre de propriétés, les consulats annuels, et l'abaissement des faisceaux, en présence du peuple ; alors, le droit d'appel étendu à toute chose ; alors, la retraite séditieuse des plébéiens; alors, enfin, cette conduite presque générale des affaires qui tendait à placer tous les pouvoirs dans le peuple. Lælius. Il est vrai. Et cela, reprit Scipion, dans les époques de paix et de repos; car, on peut se permettre quelque licence, tant qu'on n'a rien à craindre, comme dans une navigation paisible, ou dans une indisposition légère. Mais, de même que si la mer noircit sous la tempête, ou si la maladie s'aggrave, on voit le voyageur, ou le malade implorer le secours d'un seul; ainsi notre nation, en paix et dans ses foyers, domine et menace ses magistrats, les récuse, les dénonce, les insulte; mais, en guerre, elle leur obéit, comme à des rois. L'intérêt du salut l'emporte sur la passion ; et même, dans les guerres les plus importantes, nos Romains ont voulu que tout le commandement fût placé sans partage dans la main d'un seul, dont le nom même indique l'étendue de sa puissance. On l'appelle dictateur, parce qu'il est élu par le dire d'un consul; mais dans nos livres sacrés, Lælius, vous le voyez nommé maître du peuple. Lælius. Je le sais. Scipion. Nos ancêtres firent donc sagement[31]. ……………………… XLI. Lorsque le peuple est privé d'un roi juste, comme le dit Ennius, après la mort d'un grand roi, D'un souvenir pieux, longtemps il le regrette; Les yeux levés au ciel, es pleurant il répète : O divin Romulus!... roi guerrier, fils de Mars! Défends nos murs sacrés, protège tes remparts!... Nos Romains n'appelaient point maîtres, ni seigneurs ceux auxquels ils obéissaient suivant la loi; ils ne leur donnaient pas même le titre de rois, mais les noms de gardiens de la patrie, les noms de pères et de dieux ; et ils avaient raison ; n'ajoutent-ils pas, en effet, en s'adressant à Romulus? ………………………...Auteur de la patrie, Tu nous donnas, toi seul, la naissance et la vie. Ils croyaient que l'existence, la gloire, l'honneur, étaient un don de la justice du roi. La même volonté se serait maintenue dans leurs descendants, si les mêmes vertus s'étaient conservées sur le trône; mais vous le voyez, par l'injustice d'un seul, s'écroula tout cet ordre de gouvernement. Lælius. Je le vois, et je m'étudie à connaître la marche de ces grandes muta-lions, et dans notre république, et dans toutes les autres. XLII. Scipion reprit : Lorsque j'aurai exposé toute mon opinion touchant la forme de gouvernement que je préfère, il me faudra parler avec quelque étendue sur les révolutions des États, bien que ce soit Le danger le moins à craindre dans le gouvernement que je conçois. Quant à la royauté absolue, elle offre une première et inévitable chance de révolution. Un roi a-t-il commencé d'être injuste, aussitôt disparaît cette forme de gouvernement ; et ce tyran est à la fois le pire de tous les pouvoirs, et le plus voisin du meilleur. A-t-il succombé sous les efforts des grands, l'État prend alors la seconde des trois formes que j'ai désignées, et il se forme une espèce d'autorité royale, c'est-à-dire paternelle, par la réunion des principaux citoyens veillant avec zèle aux intérêts du peuple. Est-ce, au contraire, le peuple seul qui, spontanément, a immolé ou banni un tyran, il se montre plus modéré de toute la force de sa raison et de ses lumières, et, dans la joie d'avoir accompli son ouvrage, il veut maintenir l'ordre politique établi par lui-même. Mais si jamais le peuple en est venu à frapper un roi juste, ou à lui ravir le trône; ou même, et l'exemple en est plus fréquent, s'il a goûté du sang des grands, et qu'il ait prostitué l'État tout entier à la fureur de ses caprices, sachez bien qu'il n'est pas de mer, ou d'incendie si terrible, dont il ne soit plus facile d'apaiser la violence que celle d'une multitude insolente et déchaînée. XLIII. Alors, on voit se réaliser ce qui est éloquemment décrit dans Platon, pour peu que je parvienne à l'exprimer dans notre langue, effort difficile,[32] mais que je tenterai du moins. « Lorsque, dit-il, l'ardeur du peuple s'est enflammée d'une soif intarissable d'indépendant, et que, servi par des complaisants pervers, il a bu avidement la coupe remplie de liberté sans mélange, alors, ses magistrats et ses chefs, s'ils ne sont tout à fait mous et obéissants, et s'ils ne lui versent à flots la liberté, il les poursuit, les incrimine, les accuse, les appelle dominateurs, rois, tyrans. » Vous connaissez, je crois, ce passage, Lælius. Il m'est très familier. Scipion. Et ensuite : « Alors ceux qui veulent obéir aux chefs de l'État sont tourmentés par ce même peuple, qui les nomme esclaves volontaires ; mais ceux qui, dans les Magistratures, affectent l'égalité populaire, ou qui, dans la vie privée, travaillent à effacer toute distinction entre le magistrat et le simple citoyen, on les exalte de louanges, on les surcharge d'honneurs et il devient inévitable que, dans une république ainsi conduite, la liberté surabonde de toutes parts; que la famille même soit, dans son intérieur, dépourvue d'une autorité, et que cette contagion semble presque passer jusqu'aux animaux, que le père craigne le fils, que le fils méprise le père, que toute pudeur soit détruite, pour rendre l'indépendance plus entière, qu'il n'importe d'être citoyen ou étranger, que le maître craigne les élèves, et qu'il les flatte; que les élèves prennent en mépris les maîtres; que les jeunes gens s'arrogent l'ascendant des vieillards; que les vieillards s'abaissent aux jeux folâtres de la jeunesse, pour ne pas lui être odieux et insupportables. De là, bientôt les esclaves se donnent toute licence ; les femmes prennent mêmes droits que leurs maris; enfin les chevaux, les chiens, les ânes, sont libres d'une telle liberté, et courent si impétueusement, qu'il faut se retirer de leur passage. De cette licence excessive le résultat dernier, c'est que les âmes des citoyens deviennent si ombrageuses et si délicates, qu'au moindre essai d'autorité qui se montre, elles s'indignent, ne peuvent rien souffrir; et bientôt arrivent à mépriser aussi les lois, afin d'être plus complètement affranchies de tout maître.[33] » XLIV. Lælius. Vous venez de reproduire exactement ce qu'avait dit Platon. Scipion. Maintenant, pour reprendre la suite et le ton de mon discours : de cette extrême licence qui, seule à leurs yeux, était la liberté, Platon fait sortir et naître la tyrannie, comme de sa souche naturelle. Car, de même que le pouvoir excessif des grands amène la destruction des grands, de même ce peuple trop libre est bientôt affligé de servitude par sa liberté même. C'est ainsi que l'on voit, dans la température, dans le sol, dans le corps humain, les dispositions trop favorables se tourner, par leur excès même, en un mal contraire. Le même effet se marque plus sensiblement encore dans les États. Cette excessive liberté aboutit bientôt, pour les peuples et pour les individus, en excessive servitude. Ainsi, dans une extrême liberté, s'engendre un tyran, et le plus dur comme le plus injuste esclavage. En effet, du milieu de ce peuple indompté et comme effarouché, on choisit presque toujours, en haine de ces grands, naguère abattus et dégradés de leur rang, quelque chef nouveau, hardi, corrompu, insolemment acharné sur les citoyens qui souvent ont le mieux mérité de la patrie, prêt enfin a prostituer au peuple, et les autres, et lui-même. Comme la condition privée le laisse en butte à des craintes, on lui donne, on lui continue les commandements. De tels hommes sont bientôt, comme Pisistrate dans Athènes, entourés d'une barrière de gardes, et ils finissent par s'ériger en tyrans de ceux qui les ont élevés. S'ils périssent par la vengeance des bons citoyens, comme il arrive souvent, alors la Cité renaît à la vie ; si, par le bras des méchants, ils sont remplacés par une faction, autre espèce de tyrans. On voit la même révolution succéder aussi quelquefois à ce beau système de l'aristocratie, lorsque des vices ont égaré les grands qui le composent. Ainsi, le pouvoir est comme une balle que l'on s'arrache l'un à l'autre, et qui passe des rois aux tyrans, des tyrans aux aristocrates et au peuple, et de ceux-ci aux factions et aux tyrans, sans que jamais la même forme de Constitution politique se maintienne longtemps. XLV. Les choses étant ainsi, la royauté, dans mon opinion, est de beaucoup préférable aux trois autres formes ; mais elle est elle-même inférieure à celle qui se composera du mélange égal des trois meilleurs modes de gouvernement réunis, et tempérés l'un par l'autre. J'aime, en effet, que dans l'État il existe un principe éminent et royal, qu'une autre portion de pouvoir soit acquise et donnée à l'influence des grands, et que certaines choses soient réservées au jugement et à la volonté de la multitude. Cette constitution a d'abord un grand caractère d'égalité, condition nécessaire à l'existence de tout peuple libre; elle offre ensuite une grande stabilité. En effet, les premiers éléments dont j'ai parlé, lorsqu'ils sont isolés, se dénaturent aisément et tombent dans l'extrême opposé, de manière qu'au roi succède le despote, aux grands l'oligarchie factieuse, au peuple la tourbe et l'anarchie. Souvent aussi, ils sont remplacés et comme expulsés l'un par l'autre. Mais, dans cette combinaison de gouvernement qui les réunit et les confond avec mesure, pareille chose ne saurait arriver, sans de grands vices dans les chefs de l'État : car, il n'y a point de cause de révolution, là où chacun est assuré dans son rang, et ne voit pas au-dessous de place libre, pour y tomber. XLVI. Mais, ô Lælius, et vous, mes chers et judicieux amis, je pourrais craindre, si je m'arrêtais trop longtemps sur ce sujet, que mes paroles ne ressemblassent aux leçons d'un maître, plus qu'au libre entretien d'un ami qui conjecture avec vous. Aussi, je vais passera des choses qui sont connues de tous, et que j'ai, pour ma part, étudiées dès longtemps; et sur cette matière, j'estime, je sens, je déclare que de tous les gouvernements, il n'en est aucun qui, pour la constitution et la distribution de ses parties, et pour la discipline des mœurs, puisse être comparé avec celui que nos pères avaient reçu de nos aïeux, et qu'ils nous ont transmis à nous-mêmes; et, puisque vous voulez m'entendre dire ce que vous savez, je montrerai quel il est, et qu'il est le plus excellent de tous. Ainsi, les yeux fixés sur notre République,[34] je tâcherai de rapporter à ce modèle tout ce que j'ai à dire sur la meilleure forme de cité. Si j'y parviens, si je le fais, j'aurai, dans mon opinion, par delà rempli la tache que m'a confiée Lælius. XLVII. Lælius. Dites bien votre tâche, Scipion; car elle est réellement la vôtre. Qui peut, en effet, de préférence à vous, parler soit des institutions de nos pères, lorsque vous êtes issu de si glorieux ancêtres, soit de la meilleure forme de Cité, lorsque la nôtre ne peut exister, et elle existe à peine aujourd'hui, sans que vous y soyez au premier rang ; soit, enfin, des prévoyances de notre politique, lorsque vous, Scipion, en faisant disparaître les deux terreurs de cette ville, vous avez pour jamais assuré l'avenir?
FRAGMENTS
La fin de ce premier livre paraît manquer, quoique l'éditeur de Rome n'en dise rien. Il se borne à rapporter quelques phrases isolées, anciennement citées par Nonius et Lactance, et qui faisant partie, sans doute, d'un passage entièrement perdu, n'ont retrouvé leur place nulle part dans le manuscrit palimpseste. Rien n'a moins d'intérêt, à nos yeux, que ces débris d'expressions latines dénuées de rapport et de liaison : c'est la poussière du marbre de la statue brisée. Cependant nous avons conservé tout ce que le savant éditeur a recueilli. Voici la traduction de celles de ces phrases qui offrent un sens intelligible; et ce sens est quelquefois assez beau. « Comme la patrie est la source des plus grands bienfaits, comme elle est notre mère bien avant celle qui nous a donné la vie, nous lui devons plus de reconnaissance qu'aux auteurs de nos jours. » « Carthage n'aurait pas eu tant de puissance, durant près de six siècles, sans politique et sans institutions. » « Tous les raisonnements de ces esprits spéculatifs, quelque source abondante de science et de vertu qu'ils renferment, si cependant on les compare aux actions et aux œuvres effectives des hommes d'État, paraîtront, je le crains, offrir moins une utilité pour les affaires qu'une distraction dans le loisir. »
[1] Cette première lacune du manuscrit paraît peu considérable. Elle nous prive seulement de quelques pages, par lesquelles Cicéron ouvrait ce beau prologue, où il s'attache à combattre les philosophes qui défendaient au sage de prendre part dans les affaires publiques. On connaît la célèbre maxime des Épicuriens, si ingénieusement et si poétiquement commentée dans une pièce de Chaulieu : Sapiens ne accedat ad Rem publicam. Les Pythagoriciens avaient développé le même principe avec plus de gravité. Aristote examine le pour et le contre de la question, en concluant pour la vie active. Parmi les disciples d'Aristote, Théophraste, écrivain si élégant et si pur, avait soutenu la prééminence de la vie contemplative sur l'activité politique, dans un ouvrage dont Cicéron parle avec admiration, et auquel il semblait revenir avec complaisance, toutes les fois qu'il était las et découragé des affaires. Mais ici, ce grand homme, intéressé par le sujet qu'il traite et par sa vie tout entière, à réfuter les maximes d'une sagesse timide, ou d'un insouciant égoïsme, avait sans doute énoncé d'abord le préjugé qu'il voulait combattre, en avait indiqué les différents prétextes et les formes diverses ; puis il se hâtait d'y opposer les grands exemples et les glorieux effets du patriotisme : notre manuscrit mutilé commence à cet endroit même. Les deux premiers mots qu'il offre, étant séparés de toute construction, et ne formant pas un sens, ne pouvaient pas être traduits ; mais on doit présumer, avec M. Mai, d'après le mouvement et l'idée de la phrase qui suit immédiatement, que ces expressions, impetu liberavissent, se rapportaient à l'invasion des Gaulois, ou à celle de Pyrrhus, et que l'auteur, préludant à l’énumération que présente le texte, avait dit : « Sans cet amour de la patrie, Camille n'aurait pas délivré l'Italie de l'assaut des Gaulois; Duillius, etc. » Ces exemples étaient, dans la bouche d'un Romain, la plus belle réponse à l'éloge exclusif de la vie contemplative; et ils servaient le but de Cicéron, qui était de faire de tout son ouvrage de Republica, l'apothéose de l'ancienne constitution romaine, sous laquelle s'étaient élevés tant de grands hommes. [2] La justice ne vient pas du législateur. Montesquieu a mieux dit : « Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste, que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. » Au reste, cette manière élevée de concevoir la justice, et de la lier à l'éternelle vérité des choses, n'était pas inconnue des anciens : on en trouverait bien des exemples dans Platon ; et, dans les mémoires sur Socrate, Xénophon lui fait dire qu'aucune volonté du peuple ne peut créer la justice; que cette justice est indépendante de l'homme, et ne peut être ni changée, ni remplacée par la loi. Nous verrons Cicéron lui-même revenir à ce grand principe, et le présenter avec beaucoup de force. [3] Rousseau, dans la Lettre sur les Spectacles, a donné une autre origine au sentiment de la pudeur. Au lieu d'en faire une convention sociale, comme le voulaient quelques épicuriens du dix-huitième siècle, et comme Cicéron le veut ici, dans une autre pensée, Rousseau y voit un instinct de la nature, une disposition native ; et le développement de cette idée a pris, sous sa plume éloquente, un charme de passion et de pureté. [4] On trouve rarement, chez les anciens, cette espérance de perfectionnement et surtout ce vœu du perfectionnement général de l'espèce humaine. Sous ce double rapport, le passage de Cicéron est fort remarquable. [5] La phrase latine est incomplète; mais le sens est assez marqué par les premières expressions, pour, que la traduction ait pu facilement le rendre, sans aucune supposition arbitraire. L’éditeur de Rome annonce ici une lacune de deux pages. On présume sans peine que Cicéron insistait sur la grandeur du but que son ambition patriotique s'était proposé, et qu'il comparait probablement cette noble poursuite aux autres objets des passions humaines. De là, sans doute, il passait aux récompenses que lui avait décernées l'estime de ses concitoyens ; il en venait à ce magnifique témoignage que lui rendit le peuple romain, à la sortie de son consulat. La phrase qui exprime cette dernière idée est encore mutilée dans le texte; mais le sens est visible, et nous l'avons traduit sans la plus légère addition. [6] Tacite, qui, plus qu'on ne le croit, a fait des emprunts à Cicéron, paraît avoir imité la tournure de ce passage, dans la Vie d’Agricola, lorsqu'il dit : Procul a contentione adversus procuratores et vincee inglorium, et atteri sordidum, arbitrabatur. L'imitation est légère, presque imperceptible ; mais elle ne trompera pas les latinistes. [7] Sénèque paraît avoir eu souvenir de ce passage, Dans le chapitre iii du traité de Tranquillitate animi, il reproduit cette belle idée d'une magistrature publique toujours exercée par l'homme de talent, sans qu'il ait besoin de porter aucun titre. Sénèque amplifie par des antithèses ce que Cicéron avait noblement exprimé ; mais le fond est le même. [8] Ce Rutilius, élève du philosophe Panætius, et sectateur de la philosophie stoïcienne, fut l'un des hommes les plus vertueux de l'ancienne Rome. Il avait été l'ami de Scipion et son compagnon d'armes au siège de Numance. Il composa une vie de ce grand homme, et une histoire de la république, en grec. Il écrivit également sa propre vie : ce qui, de sa part, dit Tacite, était plutôt la confiance de la vertu, que le faste de l’amour-propre. Banni par une intrigue des chevaliers romains dont il avait réprimé les concussions, il vécut en exil à Smyrne, et devint citoyen de cette ville. On voit assez avec quelle vraisemblance et quel goût Cicéron a pu supposer tenir d'un pareil témoin l'entretien, qu'il va rapporter. Cette forme de transmission orale, imitée de Platon, est ici bien heureusement amenée. C'est l'ami de Scipion, c'est un sage aussi incorruptible qu'éclairé, qui, dans un exil mérité par sa vertu, a raconté à Cicéron, tout jeune encore, ce qu'avait dit Scipion. Belle et simple fiction! Entre le grand homme dont les paroles sont conservées, et Cicéron qui les écrit, il n'y a que le témoignage du plus vertueux des Romains. [9] Quintus Ælius Tubero était petit-fils de Paul-Emile, et neveu de Scipion. Il s'adonnait beaucoup à l'étude de la philosophie, et avait adopté la secte stoïque. L'austérité de ses principes nuisit à son élévation politique et à son éloquence. Le peuple romain fut blessé de voir sa contenance impassible aux funérailles de Scipion. [10] Suidas, et après lui quelques savants, ont parlé de deux Panætius, tous deux philosophes, et natifs de l'Ile de Rhodes. Celui dont il est question dans le texte, est le plus célèbre, ou même le seul célèbre. Il avait été le maître et l'ami de Scipion l'Africain, qui, dans sa fameuse ambassade en Egypte, et auprès des rois de l'Asie, se fit accompagner par lui. Il appartenait à la secte stoïque, et avait composé beaucoup d'ouvrages sur les matières de philosophie. On sait que Cicéron a tiré d'un livre de ce Grec la plus grande partie de son immortel traité des Devoirs. Un passage du dialogue de Legibus prouve que Panætius avait écrit avec un égal succès sar la politique et le gouvernement ; et nous voyons ici qu'il cultivait les sciences naturelles. Quel peuple que celui dont la décadence produisait encore de tels hommes, des hommes dignes d'éclairer la grande âme de Scipion, et d'inspirer le génie de Cicéron! [11] Saint Jérôme et saint Augustin, grands admirateurs de Cicéron, et quelquefois ses copistes, ont évidemment imité ce passage. La ressemblance sera plus sensible, en citant leurs expressions en latin. Saint Jérôme a dit le premier : Plato post Academiam et innumerabiles discipulos, sentiens multum suœ deesse doctrinœ venit ad magnam Grœciam; ibique ab Archyta tarentino et Timœo locrensi Pythagorœ doctrina eruditus, elegantiam et saporem Socratu cum hujus miscuit disciplinis. — C'est l'expression même de Cicéron, légèrement affaiblie. Saint Augustin répète les mêmes choses presque dans les mêmes termes : Plato dicitur, post mortem Socratis magistri sut, quem singulariler dilexerat, a Pythagoreis etiam multa didicisse; igitur adjiciens lepori subtilitatique sooraticœ naturalium divinarumque rerum scientiam, etc. [12] Presque tous les personnages placés ici par Cicéron figurent déjà dans son traité de l'Amitié. Il est inutile de citer Lælius, aussi connu que Scipion lui-même; car l'amitié d'un grand homme est presque un partage de sa gloire. Fannius avait composé des annales que Cicéron a louées ailleurs, et dont Brutus n'avait pas dédaigné de faire un abrégé. Quintus Scévola est le même qui, dans sa vieillesse, fut pour Cicéron l'objet d'une tendre vénération et d'une curieuse assiduité. Sp. Mummius était frère de Mummius qui prit Corinthe. Il connaissait mieux que lui les arts de la Grèce, avait étudié la philosophie stoïque, et écrit beaucoup de harangués politiques. [13] Cette pensée a, dans l'original, un tour de simplicité antique, et une grâce inexprimable. Jamais la célèbre amitié de Scipion et de Lælius n'a inspiré une réflexion plus délicate et plus noble. Bien déplus heureux que cette manière de combler par la vertu et par le respect de l'âge, tout l'intervalle que laisse après elle une gloire comme celle de Scipion. Les détails qui précèdent et qui suivent n'ont pas moins de charme, et sont tout à fait dans la manière de Platon. [14] Dans cette manière d'amener le véritable sujet du dialogue au milieu d'une digression qui s'en écarte si fort, on peut remarquer un art tout imité de Platon. [15] Cicéron fait ici une application plaisante de quelques expressions de droit qui n'ont pas beaucoup de grâce en notre langue. La formule du préteur, sur laquelle il joue, était ainsi conçue : Uti nunc possidetis, quomium ita possideatis, vim fieri veto. [16] Cicéron nomme plusieurs fois ce Gallus, pour sa science et sa passion de l'astronomie. — Pline, liv. II, ch. xix, le cite comme partageant l'opinion de Pythagore, que la terre est éloignée de la lune de 126.000 stades, et que sa distance du soleil est double de ce nombre. [17] Cette sphère, a l'exactitude près, ressemblait, comme l'on voit, à la sphère mobile que les Anglais ont appelée Orery, du nom d'un célèbre protecteur des sciences, qui fît construire cette machine : « C’est, dit Voltaire, une très faible copie de notre monde planétaire et de ses révolutions. La période même du changement des solstices et des équinoxes, qui nous amène, de jour en jour, une nouvelle étoile polaire, cette période, cette course si lente d'environ vingt-six mille ans, n'a pu être exécutée par des mains humaines, dans nos Orery. Cette machine est très imparfaite; il faut la faire tourner avec une manivelle. Cependant c'est un chef-d'œuvre de l'habileté de nos artisans. Jugez donc quelle est la puissance, quel est le génie de l'éternel Architecte, si l'on peut se servir de ces termes impropres, si mal assortis à l'Être suprême! » La science actuelle parlerait avec moins de respect de ces Orery; mais on concevra sans peine quelle admiration devait inspirer, dans la peu savante et très ingénieuse antiquité, la première ébauche d'un semblable travail. [18] Une lacune fait perdre ici la suite des paroles de Tubéron, et mutile même la première phrase, dont le sens reste pourtant assez visible. Il est à croire qu'après quelques autres phrases, Scipion, reprenant la parole, expliquait sa pensée sur tes études astronomiques, dans leur rapport avec la contemplation de la puissance céleste; ce qui le conduisait à l'admirable passage qu'on lit dans le texte. [19] Je dois cette traduction à mon collègue, M. Andrieux, poète et professeur si distingué, classique par son style, comme par ses leçons. [20] Cette digression scientifique, un peu longue pour des lecteurs modernes, précisément parce qu'elle n'est pas assez savante, se termine enfin : et nous arrivons, par une transition ingénieuse et naturelle, au véritable sujet du dialogue. On pourra sans doute traiter de hors-d'œuvre tout ce morceau. On peut y reconnaître aussi la manière de Platon, et cette marche irrégulière, ces fréquents détours, par lesquels l'élève de Socrate imita l'allure des entretiens familiers. Cicéron, ordinairement plus méthodique, est par cela même moins naturel et moins varié. Nous n'oserons pu lui reprocher, cette fois, d'avoir reproduit toute la liberté de son modèle. Sous un autre point de vue, nous avons indiqué l'intérêt qui s'attache à ces excursions, qu'un esprit tel que celui de Cicéron a besoin d'essayer dans tous les domaines de la science. [21] Cicéron, qui, dans ses ouvrages, a tantôt loué, tantôt blâmé l'entreprise des Gracques, parle ailleurs de ce P. Crassus comme ayant été, avec son frère Mucius Scévola, le conseiller de Tibérius Gracchus, et l'inspirateur des lois agraires; et il lui donne, en cet endroit même, le titre d'homme très sage et très illustre. (Acad. IV. 8.) [22] Il manque ici deux pages. Scipion s'était sans doute excusé de traiter un sujet si grave; et ses amis lui répondaient par de nouvelles instances. On voit, en effet, dans la suite du texte, que Lælius a repris la parole, et qu'il presse son illustre ami de leur expliquer ces grandes questions, que seul il a le droit de bien juger. Le savant éditeur de Rome a cru devoir rapporter à cette lacune deux parcelles de phrase citées par les grammairiens, comme appartenant au premier livre du traité de la République, et dont la place probable ne pourrait être assignée à nulle autre partie de ce même livre. Nous respectons cette superstitieuse exactitude mais le premier de ces imperceptibles fragmenta donne à peine un sens. Il signifie peut-être : « Un autre pourrait-il, mieux que vous, concevoir un type de gouvernement? » L'autre phrase est une instance nouvelle adressée à Scipion : « Veuillez faire descendre vos discours de cette sphère « céleste à notre monde d'ici-bas. » [23] « Après la défaite de Persée, dit Pline, Paul-Emile ayant « demandé aux Athéniens de lui envoyer leur philosophe le plus a estimé, pour élever ses enfants, et un peintre non moins habile, pour retracer son triomphe, les Athéniens choisirent Métrodore, en promettant que seul il remplirait ce double vœu avec une égale supériorité; et Paul-Emile en jugea de même. » On voit par là que cette glorieuse maison de Paul-Emile, où naquit Scipion Émilien, avait dû lui offrir une école de science, comme de vertu. [24] Cicéron est ici bien supérieur à l'Anglais Hobbes, à ce dur partisan du despotisme, qui faisait résulter tout état social de la peur et de la force. Quel malheur que ces beaux principes de philosophie, politique, exposés par Cicéron, nous arrivent tronqués et incomplets! Mais on admire, et on a reçu avec reconnaissance cette Statue antique si mutilée, et pourtant si bette, qu'un diplomate lettré, M. de Marcellus, a récemment apportée de la Grèce. [25] Cette dernière phrase, encore mutilée dans le texte, laisse cependant apercevoir un sens qui n'est pas douteux. La suite de ce beau développement remplissait deux pages, qui manquent au manuscrit. Cicéron nous paraît avoir résumé, avec une admirable précision, et une sagesse impartiale, les avantages et les inconvénients de chaque forme de gouvernement. Il n'est là ni républicain, ni Romain : il juge comme Montesquieu. [26] On doit supposer, d'après ces mots, que Cicéron, en attribuant à Scipion du goût pour un gouvernement mixte et un pouvoir modérateur, suivait quelque tradition généralement connue. N'oublions pas, d'ailleurs, qu'aux yeux de Cicéron, ce pouvoir modérateur existait dans le sénat ; et que dès lors Scipion souhaite moins ici une innovation politique, que le retour à l'ancienne Constitution de Rome, c'est-à-dire la prééminence du Consulat et de l'Aristocratie. [27] Il est évident, par les pages qui suivent, que Scipion a repris ici la parole, et qu'il expose, non pas son opinion personnelle, mais les objections des partisans de l'extrême démocratie. [28] Il manque ici deux pages au manuscrit. C'était le développement de cette idée simple et féconde, qui fait consister la perfection de l'ordre public, non pas dans un nivellement chimérique de rangs et de fortunes, non pas dans le principe antisocial des lois agraires ; mais dans l'impartialité de la loi, et la jouissance égale pour tous de tous les droits civils. [29] Encore une lacune. Nous ne dissimulons pas qu'il résulte de ces interruptions désespérantes quelque obscurité. On verra cependant, par la suite du texte, que Scipion, sans doute après avoir exposé tous les raisonnements des sectateurs de l'extrême démocratie, était passé à l'examen de l'aristocratie, et la faisait parler à son tour. Nous n'essayerons ni de suppléer, ni de discuter par conjecture ce que renfermait cette lacune intermédiaire. Une indication suffit au lecteur. [30] Si l'on s'étonne de cette balance égale que Scipion, on plutôt Cicéron, citoyen d'une république, paraît garder entre les formes de gouvernement les plus opposées, et de cette impartialité avec laquelle il apprécie la royauté, il faut se souvenir de tout ce que les philosophes grecs avaient dit en faveur de la monarchie, par haine de la licence populaire. Il faut se souvenir que Cicéron regardait presque le Consulat comme une royauté temporaire et limitée; qu'il l'avait ainsi exercé lui-même; qu'il le représente ainsi dans son traité des Lois; et qu'il a dit quelque part : Nil unquam mihi populare placuit. Il faut se souvenir que Scipion Émilien, quoique sa modération et sa vertu relevassent au-dessus du projet d'asservir ses concitoyens, avait dans la dignité de sa vie et l'élégance de ses mœurs quelque chose qui rappelait le génie doucement impérieux et la séduisante domination de Périclès ; que surtout il haïssait les assemblées tumultueuses du peuple, et que sa gloire avait été souvent insultée par les déclamations des tribuns. Il eût sans doute abhorré le funeste exemple que César donna dans la suite; mais, habitué au commandement militaire, adoré dans les camps, il souffrait la liberté du Forum, avec l'impatience naturelle à un vainqueur. Ce que son génie guerrier avait emprunté de politesse et d'humanité à la philosophie grecque l'éloignait encore de ces tumultes politiques, où la raison était si souvent opprimée par la passion et la violence. Enfin, comme nous l'avons vu, sa lecture favorite était la Cyropédie de Xénophon, ouvrage immortel, mais dans lequel on voit le bonheur du peuple naître des vertus idéales et du pouvoir illimité d'un seul homme. [31] Une lacune de deux pages était sans doute remplie par la continuation de cet éloge singulier que Scipion fait delà monarchie. Peut-être rappelait-il une tradition qui se retrouve dans Denys d'Halicarnasse, et d'après laquelle le peuple romain avait adopté le gouvernement d'un seul, sur l'invitation que lui faisait Romulus de choisir entre la royauté et la république, alternative qui, à la vérité, dans la bouche d'un vainqueur et d'un guerrier, ne laisse jamais les choix parfaitement libres. Peut-être aussi ce passage renfermait-il quelque réflexion sur la manière, dont les Romains avaient conservé le nom de roi dans diverses cérémonies, et même employé temporairement le nom et la chose dans L'ordre politique, comme, par exemple, par la création de cet Interrex, nommé pour cinq jours, et chargé, dans certaines circonstances, d'élire ou de suppléer tous les magistrats. Au reste, indépendamment de toute conjecture, ce qui suit dans texte nous parait une des choses les plus curieuses et les plus belles que l'on puisse trouver dans aucun auteur ancien. Avec quelle vigueur de raison et quelle rapidité de coup d'œil, toutes les chances et toutes les formes de révolution sont-elles saisies et exprimées! Ce n'est qu'un sommaire ; et c'est un vivant tableau. [32] Cicéron traduisant Platon, quel objet d'étude! On peut remarquer le soin un peu trop littéraire, et l'importance que Cicéron semble attacher à cette lutte de style et d'expression. En effet, quoiqu'il imite sans cesse Platon, nulle part, dans ce qui nous reste de ses écrits, si l'on excepte le Timée, il ne lui emprunte un passage aussi étendu et aussi célèbre. Cette traduction vive et libre nous paraît égaler la beauté de l'original. Quant à nous, traducteur de seconde main, nous appliquons volontiers à notre version ce que Platon disait de ces œuvres dramatiques qui, reproduisant des actions humaines, faiblement imitées elles-mêmes d'après les idées éternelles, ne lui paraissaient que des copies de copies. [33] Ces idées, ces expressions, sont encore empruntées de Platon; mais ce n'est plus une traduction littérale. Il semblé que Cicéron s'attache à resserrer l'abondance de son brillant modèle, et qu'il lui donne quelque chose de plus sévère, tempérant la vive imagination du philosophe grec par l'expérience d'un Consul romain. Sous ce rapport, rien de plus beau, de plus expressif et de plus vrai que la peinture du tyran populaire s'élevant du milieu de l'anarchie. On peut lire tout le morceau de Platon dans l'élégant recueil de M. Leclerc. [34] Ceci confirme ce qui a déjà été plus d'une fois indiqué, touchant le projet de Cicéron, dans cet ouvrage. On a vu, à la vérité, que la pensée dominante qui le préoccupe ne lui interdit pas de fréquentes digressions sur toutes les natures et toutes les formes de gouvernement : mais il revient toujours à l'ancienne Constitution romaine, telle qu'elle a existé dans les premiers siècles, ou plutôt telle qu'il la conçoit, telle qu'il la suppose, depuis qu'elle n'est plus : car, dans les regrets et les retours de la politique vers un ancien régime social, il y a presque toujours autant d'imagination que de souvenir. Au temps où Cicéron écrivait, après Marius et Sylla, entre les fureurs de Clodius, la dictature de Pompée et la prochaine usurpation de César, la république romaine qu'il se plaît à retracer, n'était guère moins idéale que celle de Platon : et on peut ajouter que, même dans des temps meilleurs, Rome, toujours agitée, n'avait jamais offert dans ses lois et dans ses mœurs la perfection que Cicéron prétend lui attribuer. Mais quand on a le dégoût du présent ou la crainte de l'avenir, on est naturellement conduit à faire l’utopie du passé. C'est dans cette disposition d'esprit qu'écrivait Cicéron.
|