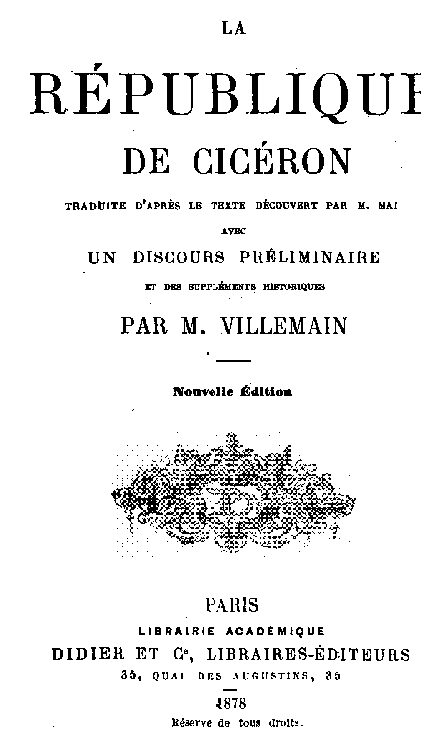|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.
*******************
ANALYSE DU TROISIÈME LIVRE******************** Tirée de la Cité de Dieu, liv. II, ch. 21. ********************
Dans le troisième livre, la question est fort vivement discutée. Philus s'est chargé de soutenir la thèse de ceux qui pensaient que l'on ne peut gouverner sans le secours de l'injustice. Il se défend de partager lui-même celte opinion; mais il plaide soigneusement pour l'injustice contre la justice, s'efforçant, par des exemples et des arguments spécieux, de montrer la première comme aussi utile aux États que l'autre leur est dommageable. Alors Lælius, à la prière de tout le monde, entreprit de défendre la justice, et soutint de toutes ses forces, que rien n'était si mortel aux États que l'injustice, et qu'il n'y avait pour les États ni gouvernement ni existence possible, sans une suprême justice. Ce point suffisamment débattu, Scipion revient à la discussion principale; et il reproduit et fait valoir la courte définition qu'il avait donnée de la République, en l'appelant la chose du peuple, et en désignant par ce mot de peuple, non pas toute agrégation, mais celle-là seulement qui est liée par l'adoption du même droit et la communauté des mêmes intérêts. Il rappelle ensuite combien les définitions sont importantes dans tout débat ; et il conclut de celles qu'il avait établies, qu'il existe réellement une chose publique, c'est-à-dire une chose du peuple, toutes les fois qu'elle est régie avec sagesse et justice, ou par un roi, ou par un petit nombre de grands, ou par l'universalité du peuple. Mais que le roi soit injuste, supposition, dans laquelle il l'appelait tyran, ou les grands injustes, ce qui de leur union fait une faction, ou le peuple injuste, ce qui ne laisse plus d'autre nom à lui donner que le nom même de tyran : alors, disait-il, non seulement la république est corrompue, comme on le soutenait hier, mais, comme le démontre un argument qui sort de nos définitions précédentes, elle a cessé d'être ; car elle ne serait plus la chose du peuple, lorsqu'un tyran ou une action la maîtriserait ; et le peuple lui-même ne serait plus un peuple s'il était injuste, puisqu'il ne serait plus une multitude réunie par l'adoption du même droit et la communauté des mêmes intérêts, suivant notre définition du peuple. LIVRE TROISIÈME.
I. [1]…………….. L'homme ne faisait d'abord entendre d'une voix bruyante que des sons confus et imparfaits. L'intelligence lui apprit à séparer, à varier les articulations ; elle attacha des mots aux choses, pour en être comme le signe ; et, par ce doux commerce du langage, elle réunit les hommes auparavant isolés. Grâce à cette même intelligence, les inflexions de la voix, qui semblaient innombrables, furent toutes exprimées et notées par un petit nombre de caractères convenus, propres à nous faire converser avec les absents, et à fixer l'expression des volontés de notre âme, et les monuments du passé. Vint ensuite l'usage des nombres, chose si nécessaire à la vie, et de plus, seule chose immuable et éternelle. Cette science nous conduisit à lever les yeux au ciel, et à ne pas voir indifféremment la marche des astres et le partage des jours et des nuits. ……………………………………………………………………………………………………… II. ………….. Alors il y eut des hommes, dont les âmes s'élevèrent plus haut, et exécutèrent ou conçurent quelque chose digne du bienfait, qu'elles avaient reçu des dieux. Aussi, que ceux qui nous ont laissé de profonds raisonnements sur la conduite de la vie humaine passent pour de grands hommes, comme ils le sont en effet ; qu'on les nomme savants ; qu'ils restent les précepteurs de la vérité et de la vertu ; j'y consens, si l'on reconnaît que l'art social et le gouvernement des peuples, soit dans la première application qu'en firent des hommes jetés au milieu des diverses sociétés humaines, soit dans les spéculations qu'il a fournies aux loisirs et à l'éloquence de ces mêmes philosophes, est une science qu'on ne doit nullement dédaigner, science qui dans les génies heureux fait éclore, comme on l'a vu souvent, une puissance incroyable et presque divine. Et, lorsqu'à ces hautes facultés de l'âme, reçues de la nature et développées par les institutions sociales, on a su joindre une riche variété d'études et de connaissances, comme les personnages que j'introduis dans cet entretien, nul ne refusera d'avouer la supériorité de tels hommes sur tous les autres. Que peut-il en effet y avoir de plus admirable que la pratique et l'habitude des grandes choses unies au goût et à la connaissance de ces arts ingénieux? Et que peut-on imaginer de plus parfait qu'un Scipion, un Lælius, un Philus, qui, pour ne rien négliger de ce qui compose la gloire du grand homme, joignirent aux exemples de nos aïeux et aux traditions domestiques les leçons étrangères venues de Socrate! Aussi, avoir su et voulu ces deux choses, s'être appuyé à la fois sur nos antiques mœurs et sur la philosophie, c'est, à mes yeux, avoir fait tout ce qui peut conduire à la gloire. Mais, s'il fallait choisir entre ces deux voies de la sagesse, bien que l'on puisse trouver plus heureuse cette vie tranquille passée dans l'étude et les lettres, la vie des affaires, la vie civique est certainement plus estimable et plus éclatante. C’est la vie où se sont illustrés de grands hommes, comme Curius, Que le fer et que l'or trouvèrent invincible. ……………………………………………………………………………………………………………. III. ………….. Il y avait cette différence entre ces deux classes de grands hommes que, chez les premiers, le développement des principes naturels était l'ouvrage de l'éloquence et de l'étude, chez les autres, celui des Institutions et des lois. Notre patrie a produit à elle seule un grand nombre, je ne dirai pas de sages (puisque la philosophie est si avare de ce nom), mais d'hommes au moins qui méritent une louange immortelle, pour avoir mis en pratique les leçons et les découvertes des sages. Et si vous considérez qu'il existe et qu'il a existé beaucoup d'empires dignes de gloire; si vous songez que, dans l'univers, la plus grande œuvre du génie est de constituer une société qui puisse être durable, voyez, à ne compter qu'un législateur par chaque empire, quelle foule de grands hommes vous apparaîtra! Si nous jetons en effet nos regards, dans l'Italie, sur le Latium, sur le peuple sabin, sur les Volsques, sur les Samnites, sur l'Étrurie, si nous examinons la grande Grèce, si nous passons ensuite aux Assyriens, aux Perses, aux Carthaginois, combien de législateurs, combien de fondateurs d'empires.[2] …………………………………………… IV.......[3] Philus dit alors : Vous me renvoyez là une belle cause : vous voulez que j'entreprenne de plaider pour le vice. Probablement, reprit Lælius, vous avez à craindre, en reproduisant les objections ordinaires alléguées contre la justice, de paraître exprimer vos propres sentiments, vous, Philus, qui passez pour le premier modèle de la bonne foi et de la probité antiques, vous à qui on connaît d'ailleurs cette pratique habituelle de discuter une question dans les deux sens, persuadé que c'est la voie la plus facile, pour découvrir la vérité? Hé bien! dit Philus, je vous obéirai ; je vais me salir, en connaissance de cause. On ne refuse pas de le faire, pour trouver de l'or : ainsi, nous qui cherchons la justice, chose plus précieuse que l'or, nous devons braver toute répugnance. Que ne puis-je du moins, en empruntant les discours d'un autre, emprunter aussi son organe! Mais il faut que ce soit aujourd'hui moi, Philus, qui répète ce que disait Carnéade, un Grec, un homme accoutumé à exprimer tout ce qu'il lui plaisait ………………………………………….. Je ne parlerai donc pas, pour énoncer mes propres sentiments, mais pour vous donner occasion de réfuter Carnéade, qui, par les perfidies de son art, savait ruiner les meilleures causes. V. ………….. Aristote a traité la question de la justice, et en a rempli quatre livres assez étendus. Quant à Chrysippe, je n'en ai rien attendu de grand et d'élevé : il traite cette question à sa manière, en pesant tout au poids des mots, et non à celui des choses ; mais, il était digne des héros de la philosophie de relever par leurs efforts une vertu qui, pour peu qu'elle existe, est surtout bienfaisante et libérale, qui préfère tous les autres à soi, qui vit pour eux, plutôt que pour elle-même ; il était digne de ces grands hommes de la faire asseoir sur un trône immortel, non loin de la sagesse. Et certes, à cet égard, l'intention ne leur a pas manqué. Quel autre motif en effet ont-ils eu d'écrire? quel autre but, en écrivant? Le génie ne leur a pas manqué non plus : ils remportaient par là sur le reste des hommes. Mais le vice de leur cause a été plus fort que leur-volonté et que leur éloquence. En effet, ce droit, sur lequel nous raisonnons, peut bien exister, en tant que droit civil ; mais pour le droit naturel, il n'y en a point. S'il y en avait, le juste[4] et l'injuste seraient les mêmes pour tout le monde, comme le chaud et le froid, comme le doux et l'amer. VI. Maintenant, si quelqu'un, porté sur ce char aux serpents ailés, dont parle le poète Pacuvius, pouvait planer sur les nations et les villes diverses, et les parcourir de ses regards, il verrait d'abord chez ce peuple immuable de l'Egypte, qui conserve dans ses archives la mémoire de tant de siècles et d'événements, un bœuf adoré comme dieu, sous le nom d'Apis, et une foule d'autres monstres et d'animaux de toute espèce admis au nombre des dieux. Il verrait dans la Grèce, comme parmi nous, des temples magnifiques consacrés à des idoles d'une forme humaine. Les Perses, d'autre part, regardèrent ces monuments comme impies : et le seul motif de Xerxès, dit-on, pour ordonner l'incendie des temples d'Athènes, fut la croyance qu'il y avait sacrilège à tenir enfermés entre des murailles les dieux, dont cet univers entier est la demeure. Plus tard, Philippe, dans ses projets de guerre contre les Perses, et Alexandre, dans son expédition, alléguaient pour prétexte le besoin de venger les temples de la Grèce, et les Grecs avaient même eu soin de ne pas les rétablir, afin que, aux yeux de la postérité, il subsistât du crime des Perses un avertissement éternel. Que d'hommes, tels que les habitants de la Tauride, tels que le roi d'Egypte, Busiris, tels que les Gaulois, les Carthaginois, ont cru qu'il était pieux et agréable aux dieux d'immoler des hommes! Voyez d'ailleurs quelle diversité dans les maximes des peuples : les Crétois et les Étoliens regardent le brigandage comme honorable : les Lacédémoniens disaient familièrement que leur territoire s'étendait à tous les lieux où pouvait toucher le fer de leur lance. Les Athéniens avaient coutume de déclarer par un serment public, qu'à eux seuls appartenaient toutes les terres produisant des olives et du blé. Les Gaulois trouvent honteux de se procurer du blé par le travail. Aussi vont-ils, les armes à la main, couper la moisson sur les champs d'autrui. Et nous, le plus équitable des peuples, afin de hausser la valeur de nos vins et de nos olives, nous ne souffrons pas que les peuples d'au-delà des Alpes fassent des plants de vignes et d'oliviers. En cela, on dit que nous agissons avec prudence ; mais non pas que nous agissons avec justice. Vous voyez donc que la sagesse est autre chose que l'équité. Lycurgue, ce créateur des lois les plus sages et du droit le plus équitable, donnait les champs des riches à cultiver au peuple réduit en servitude. VII. Si je voulais décrire les divers genres de lois, d'institutions, de mœurs, de coutumes, non seulement dans leur variété, de nation à nation, mais considères dans une seule ville, dans Rome, je trouverais qu'ils ont changé mille fois. Par exemple, cet interprète des lois que nous avons ici, Manilius, consulté relativement aux legs et aux héritages des femmes, vous répondrait aujourd'hui par un droit tout différent de celui qu'il avait coutume d'exposer dans sa jeunesse, avant la promulgation de la loi Voconia, loi qui, rendue dans l'intérêt des hommes, est pleine d'injustice à l'égard des femmes. Pourquoi, en effet, une femme ne pourrait-elle posséder? Pourquoi une vestale peut-elle instituer héritier? une mère ne le peut-elle pas? Pourquoi, en admettant qu'il eût fallu mettre des bornes à la richesse des femmes, la fille de Crassus, si elle était fille unique, pourrait-elle avoir des millions, sans blesser la loi, tandis que la mienne ne pourrait pas recueillir sa part d'un modique héritage? VIII. ………. Si la justice était naturelle et innée, tous les hommes admettraient le même droit; et les mêmes hommes ne se feraient pas un droit divers, en différents temps. S'il est d'un homme juste, s'il est d'un homme vertueux d'obéir aux lois, à quelles lois, je le demande, doit-il obéir? Serait-ce à toutes indifféremment? Mais la vertu n'admet pas cette inconstance, une telle variété n'est pas compatible avec la nature et les lois s'appuient sur la sanction de la peine, et non sur l'assentiment de notre justice. Le droit n'a donc pas de base naturelle ; d'où il suit qu'il n'y a pas d'homme juste par nature. Dira-t-on que la variété existe dans les lois; mais que les hommes vertueux par nature suivent ce qui est vraiment la justice, et non ce qu'on prend pour elle; que le caractère de l'homme vertueux et juste est de rendre à chacun ce qui lui est dû? Je vous réponds alors : Que devons-nous rendre aux animaux? car je ne dis pas de médiocres esprits, mais de grands, de savants hommes, Pythagore et Empédocle, déclarent que toutes les espèces vivantes ont droit à la même justice. Ils s'écrient, que des peines, que des tourments inexpiables sont réservés à ceux qui ont attenté sur un être animé. C'est donc un crime de nuire à un animal. ……………………………………………….. Alexandre demandait à un pirate par quel attentat il osait infester la mer avec un misérable brigantin. Par le même droit, dit-il, qui vous fait ravager le monde.[5] …………………………………………………………………………………………………………….. IX. ……. La prudence humaine nous dit d'augmenter notre puissance, nos richesses, d'agrandir notre territoire. Cet Alexandre, ce grand général, qui étendit son empire dans l'Asie, comment aurait-il pu, sans l'envahissement du bien d'autrui, commander au loin, jouir des plus grandes voluptés, être puissant, maître, dominateur? Mais la justice nous ordonne au contraire d'épargner tout le monde, de ménager l'intérêt du genre humain, de rendre à chacun ce qui lui est dû, de ne point toucher aux choses sacrées, aux propriétés publiques, aux biens des particuliers. Qu'arrive-t-il donc? Si vous écoutez la prudence, les richesses, les grandeurs, la puissance, les honneurs, l'autorité, l'empire, deviennent le partage des individus et des peuples. Comme nous traitons de là République, les exemples d'intérêt public auront plus d'éclat; et comme le principe du droit est le même dans les deux cas, je pense qu'il vaut mieux citer en exemple la politique d'un peuple. Je laisse de côté les autres nations. Notre peuple romain, que Scipion, dans son discours d'hier, a suivi dès le berceau, et dont l'empire embrasse aujourd'hui l'univers, est-ce par la justice, ou par la politique que, du moindre de tous les peuples, il est de venu le peuple-roi?[6] X. …………… Tous ceux qui ont usurpé le droit dévie et de mort sur le peuple sont des tyrans ; mais ils aiment mieux se faire appeler du nom de roi, réservé à Jupiter très bon. Lorsque certains hommes, à la faveur de la richesse, de la naissance, ou de toute autre force, envahissent la chose publique, c'est une faction; maison les appelle les grands. Si le peuple prédomine et régit toute chose, à sa volonté, on nomme liberté cet état, qui n'est réellement que licence. Lorsqu'on se redoute l'un l'autre, homme contre homme, classe contre classe, alors, par la défiance que chacun a de soi-même, il se fait une espèce de traité entre le peuple et les grands ; de là sort ce genre mixte de gouvernement, que Scipion admirait. Ainsi la justice est fille, non de la nature, ni de la volonté, mais seulement de la faiblesse humaine. Lorsqu'il faut choisir de trois choses, ou de faire l'injustice, sans la souffrir, ou de la faire et de la souffrir, ou d'éviter l'un et l'autre, le meilleur lot, sans doute, c'est de faire l'injustice impunément, si vous pouvez ; le second, de ne la point faire, et de ne la point souffrir; et le plus misérable lot, de guerroyer éternellement entre le mal qu'on fait et celui qu'on reçoit.[7] …………….. ……………………………………………………… …………………………………………………. XI. …………. Tous les peuples, s'ils restituaient ce qu'ils ont usurpé, n'auraient plus de patrie, à l'exception des Arcadiens et des Athéniens qui, je le suppose, dans la crainte que ce grand acte de justice n'eût lieu quelque jour, se sont avisés de prétendre qu'ils étaient nés du sol, comme ces rats qui sortent de terre, dans les champs. XII. A ces arguments on ajoute ce que disent souvent quelques hommes, dissertateurs sans artifice, et qui en cette matière, où nous cherchons l'homme de bien, c'est-à-dire, avant tout l'homme droit et sincère, sont d'autant plus recevables, qu'eux-mêmes ne portent dans la controverse, ni sophisme, ni ruse, ni malignité. Ils disent que le sage ne recherche pas la vertu, à cause d'une jouissance personnelle et spontanée, que lui procurent la bienfaisance et la justice, mais par cette seule raison que la vie de l'homme vertueux est exempte de soucis, de craintes, de périls, tandis que les méchants sentent toujours dans l’âme quelque pointe de remords, et voient toujours devant eux les condamnations et les supplices; ils ajoutent qu'il n'est si précieux bien obtenu par l'injustice qui vaille la peine de craindre toujours, de croire toujours que la punition vous atteint, ou pend sur votre tête …………………………………………………….. XIII. Supposez, je vous prie, deux hommes,[8] l'un le meilleur des mortels, d'une équité, d'une justice parfaite, d'une foi inviolable, l'autre d'une perversité et d'une audace insigne ; supposez encore l'erreur d'un peuple qui aura pris cet homme vertueux pour un scélérat, un méchant, un infâme, et aura cru tout au contraire que le méchant véritable est plein d'honneur et de probité : qu'en conséquence de cette opinion universelle, l'homme vertueux soit tourmenté, traîné captif; qu'on lui mutile les mains, qu'on lui arrache les yeux; qu'il soit condamné, chargé de fers, torturé dans les flammes; qu'il soit rejeté de sa patrie, qu'il meure de faim; qu'il paraisse enfin à tous les yeux le plus misérable des hommes, et le plus justement misérable; au contraire, que le méchant soit entouré de louanges et d'hommages ; qu'il soit aimé de tout le monde; que tous les honneurs, toutes les dignités, toutes les richesses, toutes les jouissances viennent affluer vers lui; qu'il soit enfin, dans l'opinion de tous, l'homme le plus vertueux et jugé le plus digne de toute prospérité : est-il quelqu'un assez aveugle, pour hésiter sur le choix entre ces deux destinées? XIV. Il en est des États comme des individus : il n'est pas de peuple assez insensé, pour ne pas aimer mieux régner par l'injustice que de tomber par la justice dans l'esclavage. Je ne chercherai pas mes exemples au loin. Pendant mon consulat, je me suis trouvé juge du traité de Numance ; je vous avais pour conseillers. Personne n'ignorait que Pompée avait signé le traité, et que la situation de Mancinus était la même. Mancinus, homme vertueux, appuya la proposition[9] que je portai devant le peuple, d'après un sénatus-consulte. Pompée s'y opposa vigoureusement. Cherche-t-on l'honneur, la probité, la bonne foi, on les trouve dans Mancinus. Mais pour la sagesse, la conduite, la prudence, c'est Pompée qui l'emporte ……………………….. XV. Qu'un honnête homme ait un esclave infidèle, ou une maison malsaine et infectée ; qu'il en connaisse seul le vice, et qu'il les fasse en conséquence afficher, pour les vendre, publiera-t-il qu'il met en vente un esclave fugitif et une maison infectée, ou le cachera-t-il à l'acheteur? S'il le déclare, il sera honnête homme, parce qu'il ne trompera point; mais il n'en passera pas moins pour un maladroit, parce qu'il manquera de vendre, ou ne vendra qu'à vil prix. S'il ne dit rien, il sera sans doute habile homme, parce que ses affaires y gagneront; mais c'est un méchant, puisqu'il trompe. Autre supposition : que cet homme rencontre quelqu'un qui vende de l'or, ou de l'argent, croyant ne vendre que du similor, ou du plomb ; se taira-t-il pour acheter bon marché, ou avertira-t-il son vendeur, afin d'acheter plus cher? Préférer le second parti semblera pure sottise. Certainement la justice consiste à ne pas tuer un homme, à ne point toucher au bien d'autrui. Que fera donc le juste si, dans un naufrage, il voit un plus faible que lui qui s'est saisi d'une planche? Ne l'en fera-t-il pas sauter, pour y monter à sa place, s'y fixer, et survivre, surtout lorsqu'au milieu de la mer, nul n'est témoin de son action? S'il a du sens, il n'y manquera pas : car il est sûr de périr, s'il ne le fait. Qu'il aime mieux au contraire périr que de frapper un autre homme, il se montre juste sans doute; mais, il est insensé de sacrifier sa vie, pour épargner celle d'autrui. De même, si dans une déroute, poursuivi par les ennemis, cet homme juste rencontre quelqu'un blessé et monté sur un cheval, le respectera-t-il, au risque d'être tué lui-même, ou lui prendra-t-il son cheval, pour échapper à l'ennemi? S'il le fait, il est homme sage ; mais il est méchant : s'il ne le fait pas, il est homme juste; mais il est insensé……………………………………………….. XVI. ………. Scipion. Je n'insisterais pas, Lælius, si je ne croyais que nos amis désirent, et si je ne souhaitais moi-même vous entendre traiter quelque partie de ma thèse. Vous promettiez hier que vous iriez plus loin que moi ; mais si la chose ne se peut faire, du moins ne restez pas en arrière : nous sommes tous à vous en prier …………………….. Lælius ...... Carnéade ne doit pas être écouté de notre jeunesse : s'il pense comme il parle, c'est un homme corrompu. S'il en est autrement, et j'aime aie croire, son discours n'en est pas moins affreux[10] ……… XVII. Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende, ses paroles ne sont ni vaines auprès des bons, ni puissantes sur les méchants. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière. Ni le sénat, ni le peuple, ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète, ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre, dans Rome, autre, dans Athènes; elle ne sera pas demain autre qu'aujourd'hui : mais, dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable; et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi, que l'homme ne peut méconnaître, sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, et par cela seul, sans subir les plus dures expiations, eût-il évité d'ailleurs tout ce qu'on appelle supplice[11] ………………… XVIII. La vertu veut franchement la gloire : il n'est pas d'autre prix pour elle. Ce prix, la vertu le reçoit avec empressement, et l'exige sans amertume ………………………….. Quels trésors offrirez-vous à l'homme inspiré par elle? quels trônes? quels empires? Il considère de tels biens comme mortels, et ceux qu'il possède, comme divins. Que si l'ingratitude de la foule, ou l'envie de quelques-uns, ou si enfin des ennemis puissants dépouillent la vertu de ses récompenses, elle jouit encore de nombreuses consolations, et surtout elle se console par sa propre beauté ……………………………………….. XIX...... Gracchus persévéra dans la justice, à l'égard des citoyens ; mais il dédaigna les droits et les traités garantis à nos alliés et au peuple latin. Si cette habitude de violence et d'arbitraire s'étend plus loin, si elle fait passer notre autorité du droit à la force, de manière que ceux qui nous obéissent encore de leur gré, ne soient tenus que par la crainte, nos veilles auront suffi peut-être au salut de la génération présente ; mais je suis en inquiétude sur le sort de nos descendants et sur l'immortalité de la République. Cette immortalité, elle pouvait se l'assurer en conservant les institutions et les mœurs antiques. XX. Quand Lælius eut achevé de parler, tous ceux qui étaient présents laissaient voir l'extrême plaisir que leur avait fait son discours. Mais Scipion, plus touché que les autres, et comme ravi de joie, lui dit : O Lælius! vous avez plaidé bien des causes, avec une éloquence à laquelle, pour la grâce et pour la force, je n'oserais comparer ni celle de Servius Galba, notre collègue, que de son vivant vous préfériez à tous les autres, ni celle des orateurs athéniens, mais jamais vous n'avez parlé mieux qu'aujourd'hui, et dans une plus noble cause[12] XXI. ……….. Scipion. Verrez-vous une République dans Agrigente, lorsque tous y étaient opprimés par la cruauté d'un seul, et qu'il n'existait plus de lien légal, plus de société, plus de consentement public, ce qui seul fait un peuple? Il en est de même de Syracuse, cette ville superbe,[13] que Timée nomme la plus grande des villes grecques, et la plus belle de toutes les villes. Cette citadelle admirable, ces ports qui s'étendaient jusque dans l'intérieur des murs, et baignaient les quais de la ville, ces rues si larges, ces portiques, ces temples, ces murailles ne faisaient pas que Syracuse fût une république, tant que régnait Denys: rien de tout cela n'appartenait au peuple ; et le peuple lui-même appartenait à un homme. Ainsi donc, où je vois un tyran, non seulement la chose publique est défectueuse, comme je le disais hier; mais, il faut le dire, et la raison le veut: il n'existe là nulle espèce de chose publique. XXII. Vous parlez admirablement, reprit Lælius, et j'aperçois où tend ce discours. Scipion. Vous comprenez alors qu'un État, qui est tout entier au pouvoir d'une faction, ne saurait non plus être appelé justement une société politique. Lælius. Je le pense. Scipion. Et vous avez raison. Que fut dans la réalité la ville d'Athènes, lorsqu’après la grande guerre du Péloponnèse, elle se trouva sous l'injuste domination de trente chefs imposés? L'antique gloire de cette cité, le pompeux aspect de ses édifices, son théâtre, son gymnase, ses portiques, les célèbres parvis de ses temples, sa citadelle, les admirables ouvrages de Phidias, le port magnifique du Pirée, en faisaient-ils une République? Nullement, dit Lælius : il n'y avait point là la chose du peuple. Scipion. Et à Rome, lorsque dix hommes dominaient, sans appel de leurs sentences, dans cette troisième année de leur pouvoir, où la liberté elle-même fut frappée de séquestre? Lælius. Alors la chose du peuple n'existait plus; et même bientôt le peuple agit, pour la reconquérir. XXXIII. Scipion. Je viens maintenant à cette troisième forme de gouvernement, où l'on trouvera peut-être quelque difficulté. Je parle de celle, où le peuple est désigné comme ayant tout en sa puissance, alors que la multitude inflige, comme elle veut, les supplices, lorsqu'elle enlève, saisit et prodigue à son gré ; pouvez-vous, Lælius, méconnaître qu'il y ait là république, toute chose y dépendant du peuple? et nous voulons que la chose publique soit la chose du peuple. Lælius reprit : Il n'est point d'État, auquel je refuse plus nettement le nom de chose publique, qu'à celui qui est placé tout entier dans la main de la multitude. Il ne nous paraissait pas exister de république dans Agrigente, dans Syracuse et dans Athènes, quand les tyrans y dominaient, ni à Rome, sous les décemvirs : je ne vois pas comment le nom de république pourrait se placer davantage, au milieu du despotisme de la multitude : d'abord, parce que, suivant votre heureuse définition, Emilien, il n'existe point de peuple, pour moi, s'il n'est contenu par le lien commun de la loi. Hors de là, cet assemblage d'hommes est tyran aussi bien qu'un seul homme, et même tyran d'autant plus odieux, qu'il n'est rien de plus terrible que cette bote féroce, qui prend la forme et le nom de peuple. Et lorsque nos lois placent les biens des insensés sous la tutelle de leurs proches, il n'est pas conséquent de laisser une aveugle multitude maîtresse absolue de tout faire[14] XXIV. ………….. On peut soutenir qu'une sage aristocratie mérite le nom de chose publique, de chose du peuple, titre que l'on applique à l'État monarchique. Oui, dit Mummius, elle le mérite à plus juste titre. L'unité de pouvoir, en effet, expose davantage le roi à ressembler au despote. Mais, lorsque plusieurs hommes vertueux exercent la puissance, il ne saurait exister d'État plus fortuné qu'une telle République. Du reste, j'aime mieux même la royauté que la domination du peuple libre; car il vous reste encore à examiner cette troisième forme de gouvernement corrompu. XXV. Scipion reprit : Je reconnais ici, Mummius, votre aversion décidée pour le système populaire ; et bien que l'on puisse le traiter avec plus d'indulgence que vous ne faites ordinairement, je vous accorde cependant que des trois formes de gouvernement, il n'en est aucune qui soit moins digne d'éloge. Mais je ne vous accorde pas que l'aristocratie soit préférable à la royauté. Car, si vous supposez la sagesse à la tête des affaires, qu'importe que cette sagesse réside dans un seul, ou dans plusieurs? Mais une erreur de mots nous abuse dans cette discussion. Prononce-t-on ce nom d'aristocratie, qui exprime le gouvernement des meilleurs, l'imagination ne peut concevoir rien de préférable. Que peut-on, en effet, préférer à ce qui est bon par excellence? Est-il au contraire mention d'un roi, aussitôt se présente à l'esprit l'idée d'un roi injuste. Mais moi, je n'entends point parler du roi injuste, en ce moment, où je recherche la nature du gouvernement royal. Concevez, à ce mot de roi, l’idée d'un Romulus, d'un Numa, d'un Tullus, et peut-être alors serez-vous moins sévère pour cette forme de constitution. Mummius. Quel mérite laissez-vous donc à la constitution purement démocratique? Scipion reprit : Je vous le demande, cette île de Rhodes, où nous étions naguère ensemble, vous parait-elle avoir une constitution républicaine? Mummius. Oui, à mon avis; et une constitution fort peu répréhensible. Scipion. Vous avez raison : eh bien! si vous vous en souvenez, tous les citoyens étaient également membres du sénat et du peuple ; et ils passaient alternativement quelques mois, dans leurs fonctions populaires, et quelques autres dans leurs fonctions sénatoriales. Des deux côtés ils recevaient un droit de séance : les mêmes hommes, sur le théâtre et dans le sénat, connaissaient des accusations, et de toutes les autres affaires
FRAGMENTS.
« Il y a, dans chaque homme, un élément désordonné qui s'exalte par le plaisir et s'abat par la douleur. » (Nonius.) « Les Phéniciens ont les premiers, par leur négoce et leurs échanges, importé dans la Grèce l'avarice, la somptuosité et l'insatiable passion de toutes les jouissances. » (Nonius.) Voilà tout ce qu'il y a de traduisible dans les courts et informes fragments, que le savant éditeur réunit, à la fin de ce troisième livre, si curieux par le sujet, et si malheureusement mutilé dans le manuscrit du Vatican. Nous n'avons donc qu'une bien faible partie de cette belle discussion sur la justice ; mais nous ne pouvons douter que les principaux arguments qu'elle offrait ne se retrouvent dispersés, sous mille formes, dans les ouvrages des premiers défenseurs du christianisme. Lactance et saint Augustin en sont remplis : le premier, dans le cinquième livre de ses Institutions, où il traite particulièrement de la justice, après avoir transcrit les sophismes de Carnéade, reproche à Lælius, ou plutôt à Cicéron, de ne les avoir repoussés que faiblement, parce qu'il ne connaissait pas la source souveraine de toute justice. Mais l'éloquent évêque d'Hippone accepte le secours des vérités naturelles démontrées par Cicéron ; il invoque au profit du christianisme, si longtemps persécuté par les lois, cette belle pensée de Scipion, que les ordonnances arbitraires des hommes ne prescrivent jamais contre la justice. Il résume, il réunit ce que Cicéron avait mis à cet égard dans la bouche de Scipion et de Lælius; il triomphe d'opposer cette grande autorité à l'antique tradition des préjugés païens. Comme cette analyse reproduit les idées déjà exprimées dans le texte, nous croyons inutile de la traduire. Saint Augustin, d'ailleurs, conserve rarement les formes de l'éloquence de Cicéron ; mais, dans un autre passage, il nous fait connaître du moins les idées, que Cicéron avait prêtées à ses interlocuteurs, sur un point assez difficile : comment concilier les conquêtes et la domination des Romains avec ce principe de justice proclamé si hautement? « Dans ces livres de la République, dit-il, on plaide très fortement et très vivement la cause de la justice contre l'iniquité. La cause de l'injustice avait été soutenue d'abord : il avait été dit en sa faveur, que nul État ne pouvait s'accroître et se maintenir sans l'injustice ; on avait cité en preuve, et comme le plus fort exemple, cette injustice qui veut que des hommes obéissent servilement à d'autres hommes; injustice sans laquelle cependant une cité puissante, dont la domination s'étend au loin, ne pourrait gouverner ses provinces. A cela, les partisans de la justice répondent, que cet ordre de chose est juste, parce que la servitude est utile à de tels hommes; qu'il est établi dans leur intérêt, lorsqu'il est régulier, c'est-à-dire, lorsqu'il en résulte pour les méchants l'impuissance de mal faire, et qu'ils se trouvent bien d'être assujettis, parce qu'ils abusaient de leur liberté. On ajoute, pour appuyer ce raisonnement, une belle comparaison prise à la nature. On dit : « Pourquoi Dieu commande-t-il à l'homme, l'âme au corps, la raison à la passion et à toutes les autres parties vicieuses de l'âme? » Saint Augustin, dans son traité contre Pélage, revient à ces mêmes raisonnements, et les reproduit avec plus d'étendue, et sans doute, dans l'exactitude même des expressions originales. Singulier hasard littéraire! révolution bizarre de l'esprit humain qui, dans un intervalle de quatre siècles, fait servir à défendre la doctrine théologique de la grâce ces mêmes pensées, ces mêmes images que Cicéron avait employées, pour justifier la dictature de Rome sur l'univers! « Écoute, dit saint Augustin à l'hérésiarque Pélage, écoute les arguments de Cicéron dans le troisième livre de sa République, lorsqu'il explique la raison du Pouvoir. Ne voyons-nous pas, dit-il, que la nature donne partout l'autorité à ce qu'il y a de meilleur, pour la plus grande utilité de ce qu'il y a de plus faible, etc., etc.? Écoute ce qui suit peu après : Il y a, dit-il encore, divers modes de commandement et d'obéissance on dit également que l'âme commande au corps, et qu'elle commande aux passions. Mais, elle commande au corps comme un roi à ses compatriotes, un père à ses enfants, et avec les passions, elle est comme un maître avec ses esclaves: elle les réprime, elle les dompte. L'autorité des rois, des généraux, des magistrats, des sénateurs, des peuples, doit s'exercer, à l'égard des citoyens et des alliés, comme celle de l'âme s'exerce sur le corps. Mais l'empire violent du maître sur les esclaves est l'image de celui que la partie la plus pure de l'âme, c'est-à-dire la sagesse, prend sur les parties faibles ou corrompues de l'âme, sur les passions, sur la colère, et sur les autres désordres de l'intelligence. »
[1] Cicéron avait fait précéder le troisième entretien par un prologue, où il parlait en son nom. Ce qui reste ici de ce début présente d'assez grandes pensées, pour donner une haute idée du morceau original. On voit que pour préluder à l'examen approfondi de la question de la justice, qui renferme nécessairement la question d'une morale primitive, Cicéron était remonté à l'origine et à l'essence de l'homme, et avait recherché les premiers développements de ses facultés et de son intelligence. C'était là sans doute que se rapportait un fragment du troisième livre de la République cité par saint Augustin, et qui ne se retrouve pas dans le manuscrit du Vatican : « La nature, plus marâtre que mère, a jeté l'homme dans la vie, avec un corps nu, frêle et ce débile, une âme que l'inquiétude agite, que la crainte abat, que la fatigue épuise, que les passions emportent, mais où cependant reste comme à demi étouffée une divine étincelle d'intelligence et de génie. » L'éditeur de Rome suppose avec vraisemblance que ce même début du troisième livre avait fourni plus d'une inspiration à Lactance, qui traite un sujet semblable, dans son traité sur l'Œuvre du Créateur. Peut-être même ne serait-il pas difficile de deviner, en lisant ce dernier écrit, les pensées, les tours, les expressions que le chrétien du quatrième siècle a pu dérober au consul romain et au disciple de Platon. Mais comme Lactance, cette fois, ne cite pas son modèle, nous n'essayerons pas de suppléer, par une restitution un peu arbitraire, à ce qui manque au texte original de notre manuscrit. [2] La suite de ce beau préambule est perdue; et le manuscrit mutilé recommence au moment, où le dialogue paraît s'établir de nouveau, par la tâche imposée à Philus de parler contre la justice. [3] On voit la marche du dialogue : Philus est chargé, pour ainsi dire d'office, de plaider en faveur de l’injustice, ou plutôt de reproduire les sophismes, dont Carnéade avait scandalisé la bonne foi romaine, lorsqu'il était venu à Rome, quelques années auparavant, avec deux autres philosophes, députés comme lui par la ville d'Athènes, pour demander la réduction d'une amende imposée par le Sénat. Ce Grec, pour amuser les maîtres qu'il implorait, après avoir disserté publiquement sur l'existence de la justice, avait soutenu le lendemain la thèse contraire, avec la même facilité, et probablement une conviction à peu près pareille. Quoi qu'il en soit, son éloquence étonna les Romains. Le vieux Caton, effrayé, opina qu'il fallait renvoyer sans retard une si dangereuse ambassade. « Parce que, disait-il, avec les raisonnements de cet homme, on ne pouvait plus discerner où était la vérité. » Cicéron, dans ses autres écrits, a marqué plus d'une fois son aversion pour les doctrines sceptiques de Carnéade. Dans le traité des Lois, après avoir posé le principe du droit naturel, et s'être promis l'approbation des Stoïciens et de l'académie de Platon, il s'écrie : « Quant à cette académie perturbatrice, fondée par Arcésilas et Carnéade, nous implorons son silence. Car si elle se précipitait sur les principes, qui nous semblent à nous assez bien établis, elle les déracinerait de son choc. Je n'ai garde de la défier; je désire plutôt l'apaiser. » « C'est ainsi, dit un ingénieux écrivain, qu'il parle de la philosophie du doute, comme d'une divinité infernale, qu'il faut conjurer, et qui réduit tout en poussière. » Le grammairien Nonius a conservé deux phrases qui semblent se rapporter au portrait que Philus va faire de la justice. En voici le sens : « La justice agit extérieurement; elle est tout entière en dehors, tout entière visible; plus que toute autre vérin, elle se dirige et se déploie dans l'intérêt d'autrui. » [4] Pascal, dans un de ces moments de misanthropie sceptique, dont il se sauvait à peine dans les bras de la religion, a nié la justice ; il a raisonné comme Carnéade : « Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence; un méridien décide de la vérité, ou peu d'années de possession. Les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques. Plaisante justice, qu'une rivière ou une montagne borne vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà! » Mais Pascal ajoutait : « Il y a sans doute des lois naturelles : cette belle raison seule a tout corrompu. » [5] Ici commence une assez longue lacune, qui interrompt la série de ces tristes sophismes, que l'Anglais Mandeville et quelques autres écrivains ont renouvelés avec moins de force et de subtilité. Ces sophismes étaient, comme on le voit, mêlés de quelques vérités, et de beaucoup d'inductions fausses. Sans doute la pitié envers les animaux est un devoir de la nature. Sans doute la réponse du pirate à Alexandre n'était nullement déraisonnable. Mais, qu'importe tout cela? En est-il moins vrai que Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'instinct du juste, que cet instinct lui apparaît comme une vérité démontrée par l'intelligence, et que rien ne peut détruire? Quant à ces bizarreries de mœurs locales, ces démentis partiels donnés par quelque peuplade obscure à la conscience du genre humain, on sait avec quel ; déplorable soin notre Montaigne compilait de telles anecdotes, et avec quelle puissance Rousseau détruit ce frôle échafaudage. « O Montaigne! s'écrie l'éloquent Genevois, toi qui te piques de la franchise et de vérité, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l'être, et dis-moi s'il est quelque pays sur la terre où ce soit un crime de garder sa foi, d'être clément, bienfaisant, généreux, où l'homme de bien soit méprisable, et le perfide honoré. » [6] L'éditeur de Rome rapporte à cet endroit deux passages : que Lactance a imités, et peut-être littéralement transcrits de Cicéron, et qui renferment quelques-uns des sophismes de Carnéade, en faveur de l'injustice dans la politique. C'est le développent qui manque ici au texte mutilé. — « Le peuple romain même montre combien l'utilité s'éloigne de la justice, lui qui, en déclarant la guerre par les féciaux, en faisant légalement des injustices, et en ne cessant de convoiter et de ravir le bien d'autrui, s'est acquis la possession du monde entier. » Et ailleurs : « Qu'est-ce que l'intérêt de la patrie, sinon le dommage d'un autre état, d'un autre peuple? C'est-à-dire une extension de territoire par la conquête, un accroissement d'empire, une augmentation de tributs. L'bomme qui procure de tels avantages à sa patrie, c'est-à-dire qui, en renversant les villes, en exterminant les nations, a rempli d'argent le trésor public, a usurpé du terrain, a enrichi ses concitoyens; cet homme est porté aux cieux. On voit en lui la souveraine et parfaite vertu ; et cette erreur est celle non seulement du peuple et des ignorants, mais celle des philosophes qui donnent aussi des leçons d'injustice. » [7] Lactance continue d'abréger les opinions de Carnéade, qu'il résume ainsi : « Les hommes ont institué des lois, suivant l'intérêt; lois dès lors variables comme le génie des peuples, et qui, chez un même peuple, changent selon les temps. Pour le droit naturel, il n'existe pas. Tous les hommes et les autres animaux vont droit à leur utilité par l'impulsion de la nature. Ainsi il a n'existe pas de justice, ou s'il en existe, c'est une souveraine folie, puisqu'elle se ferait tort à elle-même en ménageant les aubes. » Et il ajoutait en preuve : « Tous les peuples qui ont possédé l'empire, et les Romains eux-mêmes, maîtres du monde, s'ils voulaient être justes, c'est-à-dire restituer le bien d'autrui, en reviendraient aux cabanes, et n'auraient plus qu'à languir dans le malheur et la pauvreté. » Qu'est-ce que tout cela prouve contre l'éternelle justice? [8] Cet éloquent passage, imité de Platon, est, comme on le voit, placé dans la bouche de l'adversaire de la justice. C'est Philus, au nom de Carnéade, qui présente cette double hypothèse du juste accablé d'ignominie, et du méchant comblé de tous les prix de la vertu; et dans sa pensée, le choix qu'il offre entre deux destinées si différentes implique une préférence en faveur de la seconde. La question posée dans un sens inverse serait bien plus belle; et c'est ainsi que l'on est tenté de la concevoir et de la résoudre. [9] Cette proposition avait pour objet de livrer Mancinus aux ennemis, afin de dégager la foi publique et de rompre le traité, que ce consul avait signé. Cicéron, dans les Offices, rappelle aussi ce trait, et oppose également la conduite de Mancinus à celle de Pompée. [10] Le discours de Lælius, en faveur de la justice, dans le gouvernement et la vie privée, cette belle thèse si favorable à l'éloquence, et qui nous aurait dédommagé des sophismes tant rebattus de Carnéade, manque au manuscrit palimpseste, à l'exception de quelques phrases. Le peu de pages que présente ici le texte sur cette question, se compose donc en partie de fragments déjà connus, et qui avaient été conservés par Lactance. On a laissé dans les notes quelques autres passages, qui sont rapportés moins littéralement, ou dont la liaison avec le reste aurait paru peu sensible. On y verra que Lælius, dans son discours, s'était élevé à de hautes considérations sur l'existence des sociétés ; qu'il avait proclamé la justice comme le principe du patriotisme, et avait prétendu justifier cette vérité par l'exemple même de Rome, exemple, dont le choix était un peu paradoxal. [11] « Je sais, dit saint Augustin, que dans le troisième livre du traité de la République, on soutient qu'une sage république n'entreprend jamais de guerre, hormis pour le devoir et pour le salut. » Ailleurs, dit-il, pour expliquer ce qu'il entend par salut de l'État, et de quel salut il veut parler, Cicéron s'exprime ainsi : « Ces peines, dont les esprits les plus grossiers ont le sentiment, la pauvreté, l'exil, la prison, les tourments, on s'y dérobe individuellement, à la faveur d'une prompte mort. Mais pour les États, la plus grande peine est cette même mort, qui paraît un refuge pour les individus. Un État, en effet, doit être constitué pour vivre éternellement. Il n'y a donc pas pour une république de destruction naturelle, comme pour l'homme à qui la mort est non seulement nécessaire, mais souvent désirable. Qu'une république disparaisse, soit détruite, anéantie; c'est, dans la proportion de la grandeur à la petitesse, quelque chose de semblable à la ruine et à la destruction même de l'univers. » Il y a certes de la grandeur dans ces idées; elles sont bien d'un Romain, d'un citoyen de la ville éternelle. Le reste de ces fragments n'offre pas le même intérêt. Cicéron dit, dans sa République : « Toutes les guerres entre prises sans motif sont injustes. » Il ajoute, peu après : « Aucune guerre n'est réputée juste, si elle n'est annoncée, si elle n'est déclarée, si elle n'est précédée d'une demande de restitution. » (Isidore, Origines.) « Notre peuple romain, en défendant ses alliés, s'est emparé de l'univers. » (Nonius.) « Autrement, le consul eut tort de dédaigner les largesses de Pyrrhus ; et les trésors des Samnites manquèrent à Curius. » « Notre Caton, quand il venait chez lui, au pays des Sabins, ne manquait pas, comme nous l'avons appris de lui-même, d'aller voir le foyer, près duquel était assis Curius, lorsqu'il renvoya les présents des Samnites, naguère ses ennemis et déjà ses clients. » (Nonius.) [12] La traduction a suppléé quelques mots. L'éditeur de Rome rapporte à cet endroit une phrase du troisième livre de la République, citée par Nonius, et dans laquelle Lælius disait, que deux choses lui avaient manqué pour parler devant la foule et dans le Forum, la hardiesse et la voix. [13] Montesquieu trace un admirable tableau du gouvernement variable de cette ville, et des alternatives de despotisme et d'anarchie, dont elle fut sans cesse tourmentée. « Syracuse, qui se trouva placée au milieu d'un grand nombre de petites oligarchies changées en tyrannies, Syracuse qui avait un sénat, dont il n'est presque jamais fait mention dans l'histoire, essuya des malheurs, que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville, toujours dans la licence ou dans l'oppression, également travaillée par sa liberté et par sa servitude, recevant toujours l'une et l'autre comme une tempête, et, malgré sa puissance au dehors, toujours déterminée à une révolution par la plus petite force étrangère, avait dans son sein un peuple immense qui n'eut jamais d'autre alternative que de se donner un tyran, ou de l'être lui-même. » (Esprit des Lois.) [14] Plusieurs pages perdues nous enlèvent la suite de ces réflexions si énergiques et si vraies. A l'endroit où le texte recommence, la première phrase est imparfaite et mutilée; et la traduction a suppléé quelques mots, pour marquer la liaison des idées.
|