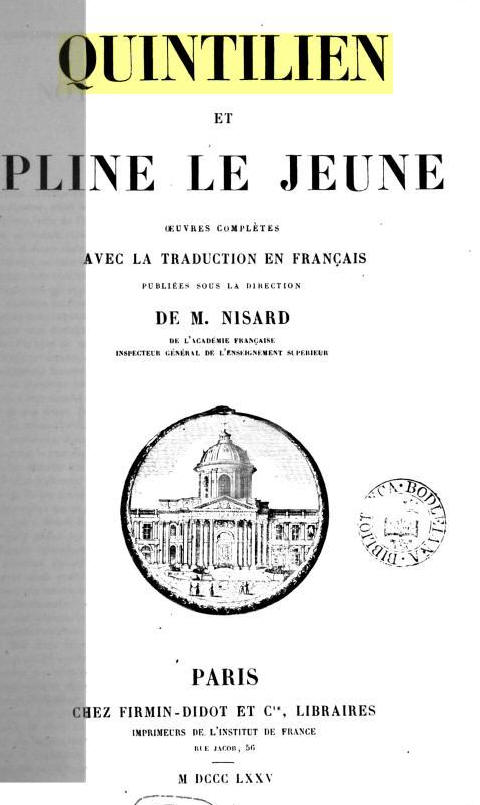
QUINTILIEN
INSTITUTION ORATOIRE.
LIVRE IX
.
|
316 LIVRE IX. I. En quoi les figures diffèrent des tropes— II. Des figures de pensées. — III. Des figures de mots. — IV. De la composition. CHAP. I. Après avoir parlé des tropes dans le livre précédent, l'ordre veut que je passe aux figures, σχήματα, lesquelles se lient naturellement à cette matière. La plupart même des rhéteurs ont pensé que les figures n'étaient que des tropes, en ce que, soit que les tropes tirent leur nom de la manière dont ils sont formés, soit qu'ils le tirent du changement qu'ils opèrent dans le style, d'où on les a appelés aussi mouvements, il faut convenir que ces deux propriétés résident également dans les figures. Leur fin est la même, puisqu'elles donnent ou plus de force ou plus de grâce aux choses. On trouve aussi des auteurs, entre autres C. Artorius Proculus, qui donnent aux tropes le nom de figures. A dire vrai, leur ressemblance est telle, qu'il n'est pas aisé de les distinguer. Car si d'un côté il y a certaines espèces de tropes et de figures qui diffèrent visiblement, quoique ces formes aient cela de commun, qu'elles s'éloignent également du langage simple et direct par un détour qui donne au style plus de beauté, d'un autre côté, il en est quelques-unes dont la différence est très peu sensible, comme l'ironie, qu'on retrouve et parmi les figures de pensées et parmi les tropes; comme encore la périphrase, l'hyperbate et l'onomatopée, où des auteurs distingués ont vu plutôt des figures de mots que des tropes. II est donc essentiel de bien marquer leur différence. Le TROPE est une façon de parler que l'on détourne de sa signification naturelle et principale pour lui en donner une autre, dans la vue d'embellir le style; ou, comme le définissent la plupart des grammairiens, une diction que l'on transporte du lieu où elle est propre, dans un lieu où elle n'est pas propre. La FIGURE, comme son nom même l'indique, est une certaine forme de style, éloignée de cette manière commune qui se présente d'abord à l'esprit. Ainsi, dans les tropes, ce sont des mots que l'on met à la place d'autres mots, comme dans la métaphore, la métonymie, l'antonomase, la métalepse, la synecdoche, la catachrèse, l'allégorie, et le plus souvent dans l'hyperbole; je dis le plus souvent, parce que l'hyperbole a lieu et dans les choses et dans les mots. L'onomatopée consiste à forger un nom : c'est donc aussi un nom que l'on met à la place d'un autre, dont on se serait servi, si l'on n'eût pas imaginé celui-là. La périphrase, quoiqu'elle renferme ordinairement le mot même qui y donne lieu, ne laisse pas de se servir de plusieurs mots, au lieu d'un seul. L'épithète fait ordinairement une partie de l'antonomase, et devient trope par cette union. L'hyper- 317 bate n'est qu'une interversion, et c'est pour cela que beaucoup de rhéteurs la retranchent du nombre des tropes. Cependant elle ne laisse pas de transporter un mot, ou partie d'un mot, de sa véritable place dans une autre. Rien de tout cela clans les figures; car une figure comporte et le mot propre et l'ordre naturel. Je dirai en son lieu comment il se fait que l'ironie soit tantôt trope, tantôt figure; car j'avoue que l'on emploie indifféremment ces deux dénominations, et je sais aussi que cette question de nom est une source intarissable de chicanes et de subtilités; mais elle ne fait rien au but que je me propose; et peu m'importe le nom qu'on donne à ces deux formes de style, pourvu qu'on sache en quoi consiste leur beauté. D'ailleurs les noms ne changent point l'essence des choses; et comme les personnes, en changeant de nom, ne laissent pas d'être ce qu'elles étaient, ainsi les ornements dont je parle, qu'on les appelle tropes ou figures, produiront toujours les mêmes effets, parce que leur utilité ne consiste pas dans leur nom, mais dans leur effet. Ainsi il est indifférent de dire état conjectural, ou négatif, ou de fait, ou d'existence, pourvu qu'on sache qu'il s'agit toujours de la même question. Le mieux donc en ceci est de suivre l'usage, et de s'attacher uniquement à bien comprendre la chose, de quelque nom qu'on l'appelle. Remarquons cependant que les mêmes pensées comportent souvent l'union du trope et de la figure; car le style est aussi bien figuré par des mots métaphoriques que par des mots propres. Or, ce n'est pas un petit sujet de discussion entre les auteurs, que de définir la valeur du mot figure, combien il y en a de genres, en combien d'espèces ces genres se divisent, et quelles sont ces espèces. Examinons donc d'abord ce qu'on doit entendre par figure. Ce mot, en effet, a une double acception : ou c'est la forme, quelle qu'elle soit, d'une pensée, comme les corps, quels qu'ils soient, ont une certaine forme extérieure ; ou bien, et c'est là proprement ce qu'on appelle figure, une manière de penser ou de parler qui s'écarte à dessein de la manière ordinaire et directe, à peu près comme le corps à ses différentes postures, tantôt assis, tantôt penché, tantôt la tête en arrière, etc. Voilà pourquoi, quand un orateur emploie toujours ou trop souvent les mêmes cas, les mêmes temps, les mêmes nombres, ou les mêmes pieds, on lui recommande de varier ses figures, pour éviter la monotonie. Or, parler ainsi, c'est dire que tout langage a sa figure, comme on dit que cursitare et lectitare sont la même figure, c'est-à-dire une déviation du même genre. Il faut donc convenir que dans le premier sens, c'est-à-dire dans le sens absolu, il n'est rien qui ne soit figuré; et si on s'en tient là, ce n'est pas à tort qu'Apollodore a cru, au rapport de Cécilius, que les règles qui concernent cette matière sont infinies. Mais si nous regardons les figures comme des attitudes, et, pour ainsi dire, comme les gestes de l'âme, le nom de figure convient seulement à ce qui, par un tour poétique ou oratoire, s'éloigne de la manière simple et directe de parler. Et alors il sera vrai de dire qu'il y a un style dépourvu de figures, ἀσχημάτιστον, ce qui n'est pas un petit défaut, et un style figuré, ἐσχηματισμένον. Mais Zoïle donne à cela même des bornes trop étroites, en ne voulant reconnaître pour figures que celles où, en disant une chose, on en fait entendre une 318 autre. Sans doute, le mot figure se prend communément aussi dans cette acception : de là ces controverses que l'on nomme figurées, et dont je vais bientôt parler; mais, pour moi, j'entends par figure une forme de style où il entre un peu d'art, et qui par là cesse d'être commune. Quelques rhéteurs n'admettent qu'un seul genre de figures, encore qu'ils ne laissent pas d'avoir sur cela même des opinions différentes. Les uns, parce que le changement qui affecte les mots affecte aussi la pensée, veulent que toutes les figures soient dans les mots; les autres, parce que les mots doivent se rapporter aux choses, veulent, au contraire, qu'elles soient toutes dans les pensées: mais c'est évidemment une pure chicane de part et d'autre. En effet, comme une même chose peut s'exprimer de plusieurs manières, et que le sens reste le même indépendamment de l'expression, il s'ensuit qu'une figure de pensée peut comporter plusieurs figures de mots; car la figure de pensée consiste dans la conception de l'esprit, et la figure de mot dans l'énonciation; mais très souvent elles se trouvent réunies, comme ici : Jamjam, Dolabella, neque me tui, neque tuorum liberum. Car cette phrase contient une figure de pensée dans l'apostrophe faite à Dolabella, et des figures de mots dans jamjam et liberum. Et, en effet, la plupart des rhéteurs s'accordent, si je ne me trompe, à reconnaître deux sortes de figures: l'une de pensée, διανοίας, mentis, sensus, sententiarum; l'autre, de mot, λέξεως, dictionis, elocutionis, sermonis, orationis; car ils se servent de tous ces noms, dont la différence, au fond, importe peu. Cependant Cornélius Celsus ajoute aux figures de mots et de pensées les figures de couleurs, et en cela certainement il s'est laissé trop entraîner à l'amour de la nouveauté; car qui peut croire qu'un homme, si habile d'ailleurs, ait ignoré que les couleurs et les pensées sont des sens? Il est donc certain que les figures, comme tout ce qui s'appelle oraison, ne peuvent résider que dans le sens ou dans les mots. Et comme il est dans l'ordre naturel de concevoir une pensée avant que de l'énoncer, je traiterai en premier lieu des figures qui se rapportent à l'esprit : figures dont l'utilité est si grande, si multiple, qu'il n'est pas une seule partie de l'oraison où elle ne se fasse manifestement sentir; car, encore que dans quelques endroits d'un plaidoyer, comme dans la preuve, il ne semble pas fort nécessaire de recourir aux figures, elles contribuent néanmoins à rendre croyable ce que nous disons, en se glissant dans l'esprit du juge par l'endroit où il n'est point sur ses gardes. En effet, comme au combat des armes il est aisé non seulement de parer, mais même de repousser les coups directs, parce qu'on les voit venir, et qu'au contraire il est difficile d'éviter les feintes et les coups détournés; qu'enfin l'art consiste à menacer un endroit pour en frapper plus sûrement un autre; de même un orateur qui manque d'astuce ne combat que par son poids et son impétuosité, tandis qu'à l'aide de la feinte, il varie ses attaques, se porte tantôt à droite, tantôt à gauche, attire d'un côté les forces de son ennemi pour le surprendre de l'autre, et le met en défaut par un simple signe. Les figures sont aussi d'une grande efficacité pour émouvoir les passions; car si l'air, le regard, le geste de l'orateur, font tant d'impression sur les cœurs, quelle puissance n'aura pas l'air même du discours, si nous savons le composer selon le dessein que nous voulons accomplir? Cependant elles ont encore plus d'insinuation que de force, 319 soit pour donner une bonne opinion des mœurs de l'orateur, soit pour prévenir les juges en faveur de sa cause, soit pour ranimer l'attention par la variété, soit enfin pour indiquer certaines choses avec plus de bienséance, ou d'une manière qui tire moins à conséquence. Mais avant d'enseigner l'emploi des figures, je dois déclarer que le nombre n'en est pas aussi grand que quelques rhéteurs le font; car je ne me préoccupe nullement de tous ces noms qui coûtent si peu aux Grecs. Premièrement donc, je ne partage pas l'opinion de ceux qui comptent autant de figures que d'affections de l'âme : non qu'une affection ne soit une certaine qualité de l'âme, mais parce que toute figure proprement dite, et comme on doit l'entendre, n'est point une simple expression de quelque chose que ce soit. Ainsi, témoigner de la colère, du déplaisir, de la pitié, de la crainte, de la confiance, du mépris, ce n'est point là user de figures, non plus que d'exhorter, de menacer, de prier, d'excuser. Ce qui trompe ceux qui n'y regardent pas de fort près, c'est qu'ils voient dans tout cela des figures; et même ils en allèguent des exemples tirés de nos orateurs, ce qui n'est pas fort difficile, puisqu'il n'y a pas de partie dans l'oraison qui ne puisse comporter quelque figure. Mais autre chose est d'admettre une figure, autre chose d'être une figure par soi-même; car je ne crains pas de répéter si souvent le même mot, pour bien faire entendre la chose. On pourra donc me faire voir une apparence de figure dans le langage d'un orateur qui témoigne de la colère, de la pitié, ou qui descend à des prières; mais il ne s'ensuit pas que supplier, qu'être ému de colère ou de pitié, soit une figure. Cicéron a compris sous le nom de figure tout ce qui contribue à l'ornement du style; et en cela, ce me semble, il tient un certain milieu, ne croyant pas, d'un côté, que tout soit figuré, et, de l'autre, n'admettant pas seulement pour figures les formes qui sortent de la manière commune, mais regardant, en général, comme figuré tout ce qui rehausse l'éclat du style et fait impression sur l'auditeur. Il a traité cette matière dans deux ouvrages, et je rapporterai mot pour mot les deux passages qui concernent les figures, pour ne pas priver le lecteur du jugement d'un auteur si considérable. Voici comme il parle dans son traité, intitulé de l'Orateur (III, 52, 53, 54) : Tout le fait de l'orateur, pour la composition des phrases, consiste d'abord à donner à l'élocution la douceur et l'harmonie, ensuite à l'embellir en y répandant çà et là les ornements des figures, soit de mots, soit de pensées. La commoration, par laquelle on insiste sur quelques détails; l'hypotypose, qui les décrit, les développe et les met, pour ainsi dire, sous les yeux de l'auditeur, sont d'un grand secours pour exposer les faits: elles les présentent avec plus de clarté, elles les agrandissent, elles en donnent la plus haute idée possible à ceux qui nous écoutent. A ces développements sont opposées la précision, la signification, qui dit moins qu'elle ne donne à entendre; l'abréviation, concise avec netteté; l'atténuation; la raillerie, qui en est voisine, et qui rentre dans les matières dont César nous a entretenus. Vient ensuite la digression, qui, après avoir distrait quelque temps l'esprit du sujet, demande qu'on l'y ramène adroitement; la proposition, qui annonce ce qu'on va dire; la séjonction, qui abandonne un point pour passer à un 320 autre; le retour au sujet et la répétition; la conclusion; l'hyperbole, qui exagère ou diminue la vérité; l'interrogation et la question, qui s'en rapproche; l'exposition de son sentiment; l'ironie, qui exprime une chose pour en faire entendre une autre, cette figure qui pénètre si sûrement dans les esprits, et qui produit un effet si agréable lorsqu'on y joint, non la véhémence, mais un ton de familiarité; la dubitation, la distribution, la correction, soit pour modifier ce qu'on a dit ou ce qu'on va dire, soit pour repousser un reproche; la prémunition, soit que nous préparions les esprits à recevoir nos arguments, soit que nous rejetions sur un adversaire l'imputation dirigée contre nous; la communication, qui est une espèce de délibération avec ceux à qui on s'adresse; l'éthopée, ou imitation des moeurs, soit que l'on mette en scène les personnages, soit qu'on ne les fasse pas paraître : cette figure est un des plus riches ornements du discours; elle est surtout propre à disposer favorablement les esprits, souvent même à les émouvoir; la prosopopée, qui répand le plus d'éclat sur l'amplification oratoire; la description; l'action d'induire en erreur ou d'exciter l'hilarité; l'antéoccupation; ensuite ces deux figures dont l'effet est si grand, la similitude et l'exemple; la division, l'apostrophe, l'antithèse, la réticence, la recommandation; la liberté du langage, qui quelquefois s'emporte au delà des bornes, et sert à l'amplification; la colère, l'invective, la promesse, la déprécation, l'obsécration; une légère déviation du sujet, différente de la digression, dont j'ai déjà parlé; la justification, la conciliation, lit dépréciation, l'optation, l'imprécation. Telles sont les figures de pensées dont on peut orner le discours. Quant aux figures de mots, on peut les comparer à l'escrime, qui sert non seulement pour se mettre en garde et pour attaquer, mais encore pour manier son arme avec grâce. Ainsi, la répétition donne tantôt de la force, tantôt de l'agrément au style; il en est de même des altérations qu'on fait subir aux mots, de leur redoublement, soit au commencement, soit à la fin de la phrase, de la complexion, de l'adjonction, de la progression, de l'intention particulière attachée à un mot qu'on ramène souvent, de ces chutes et de ces terminaisons semblables, de ces membres qui se correspondent, ou se répètent symétriquement. Il y a encore la gradation, la conversion, l'hyperbate employée avec goût, les contraires, la dissolution, la déclinaison, la répréhension, l'exclamation, l'imminution, l'usage d'un mot à différents cas; l'énumération de parties, qui reprend tout en détail; la preuve confirmative, jointe à la proposition générale ou à chacune de ses parties ; la permission, une autre dubitation, la surprise, la dinumération; une autre correction, la distinction, la continuation, l'interruption, l'image, la subjection, la paronomase, la disjonction, l'ordre, la relation, la digression, la circonscription. Telles sont à peu près les figures de pensées et de mots qui contribuent à l'ornement du style: on en pourrait citer bien davantage. La plupart 321 des figures qu'énumère ici Cicéron se trouvent répétées dans son traité intitulé l'Orateur; non pas toutes néanmoins, mais il les présente d'une manière plus distincte, parce que, après avoir parlé des figures de mots et de pensées, il ajoute un troisième article concernant les autres beautés du style, comme il le dit lui-même. Les figures qui naissent de la combinaison des mots servent aussi à embellir le discours. On peut les comparer à ces décorations qui ornent le théâtre ou la place publique les jours de fêtes; elles ne sont pas les seuls ornements du spectacle, mais elles brillent entre toutes les autres. Les figures de mots font le même effet dans le discours, et l'attention devient naturellement plus vive lorsque les termes sont répétés et redoublés à propos, soit avec un léger changement, soit au commencement ou à la fin de la phrase, ou dans ces deux endroits, ou au milieu, soit avec un sens différent, à la fin, de celui qu'ils avaient au commencement; lorsque plusieurs membres de phrase ont la même chuté ou la même désinence, ou que l'orateur oppose les contraires, procède par gradation, supprime les particules conjonctives, s'impose silence à lui-même, se reprend comme d'une erreur; exprime, par des exclamations, l'admiration ou la plainte; change plusieurs fois le cas d'un même nom, etc. Mais les figures de pensées ont un tout autre éclat; et comme Démosthène en faitun fréquent usage, quelques-uns croient que c'est une des plus grandes beautés de son éloquence. En effet, il a peu d'endroits qui ne soient relevés par quelqu'une de ces figures; et même l'art de la parole n'est guère que celui de revêtir toutes ses pensées, ou du moins la plupart, d'une forme vive et brillante. Est-il besoin, Brutus, pour un lecteur tel que vous, de nommer les figures de pensées, ou d'en citer des exemples? Il suffit de les indiquer. Je crois donc voir cet orateur que nous cherchons présenter une seule et même chose sous différents aspects, et amplifier une même pensée pour y fixer l'attention; atténuer certains objets; railler avec art; s'écarter du sujet par une digression; annoncer ce qu'il va dire; conclure après chaque point; revenir sur ses pas, et reprendre en peu de mots ce qu'il a dit; donner une nouvelle force à ses preuves en les résumant; presser l'adversaire par de vives interrogations; se répondre à lui-même, comme s'il était interrogé; dire une chose et en faire entendre une autre; paraitre incertain sur le choix de ses pensées et de ses paroles; établir des divisions; omettre et négliger certaines choses; prévenir les esprits en sa faveur; rejeter les fautes qu'on lui impute sur son adversaire; entrer comme en délibération avec les juges, et même avec sa partie; décrire les mœurs des personnes, et raconter leurs entretiens; faire parler les choses inanimées; détourner les esprits de la question; exciter souvent la gaieté et le rire; aller au-devant des objections; offrir des comparaisons et des exemples; distribuer une idée en plusieurs points qu'il parcourt successivement; arrêter l'adversaire qui veut l'interrompre; déclarer qu'il ne dit pas tout; avertir les juges d'être sur leurs gardes; parler avec une noble har- 322 diesse; s'abandonner quelquefois à la colère, aux reproches; prier, supplier; guérir les blessures; se détourner un peu de son but; faire des vœux, des imprécations; s'entretenir familièrement avec ceux qui l'écoutent. Il n'oublie point non plus les autres perfections du discours; il est vif et serré, s'il le faut; il peint à l'imagination; il exagère; il laisse plus à entendre qu'il ne dit; il s'égaye; il trace des portraits et des caractères. Voilà le vaste champ ouvert à l'éloquence, qui tire souvent des figures de pensées sa grandeur et son éclat. CH.II. Quiconque voudra donc prendre ce qu'on appelle figure dans une signification un peu étendue, il a qui suivre; et je n'oserais pas affirmer qu'on pût dire quelque chose de mieux. Cependant je prie qu'on lise cette citation au point de vue de ma doctrine; car, pour moi, je me propose de traiter seulement des figures de pensées qui s'éloignent de la manière commune de s'exprimer, et je vois que beaucoup d'hommes très doctes ont restreint leurs préceptes à cette espèce de figures. Du reste, ces beautés d'une autre espèce, qu'enumère Cicéron, sont des qualités tellement inhérentes au style, que l'on ne saurait se faire une idée d'un discours où elles ne se trouveraient pas. Car comment peut-on instruire le juge sans le mettre au courant du fait, sans émettre sa proposition, sans promettre ses preuves, sans définir ce qui est controversé, sans séparer les points de la discussion, sans exposer son sentiment, sans conclure, sans prémunir l'esprit du juge contre certaines objections, sans recourir à des similitudes et à des exemples, sans plan, sans distribution, sans interrompre l'adversaire ou s'opposer à ce qu'il interrompe, sans discuter, sans se justifier, sans blesser même la partie adverse? Que deviendrait l'éloquence sans l'amplification et l'exténuation ? l'amplification, qui donne à entendre plus qu'on ne dit, qui va au delà de la réalité; l'exténuation, qui consiste à adoucir, à pallier. Où seront les mouvements pathétiques, sans la hardiesse, l'indignation, les reproches, les vœux, les imprécations? Où seront les sentiments doux et modérés, si l'on ne sait ni s'accréditer auprès du juge, ni se le concilier, ni le dérider au besoin? Enfin, comment peut-on espérer de plaire, ou au moins donner une idée même médiocre de sa capacité, si, pour mieux faire entendre les choses, on ne sait pas les répéter ou s'y arrêter avec insistance ; si l'on ignore l'art de faire une digression et de rentrer dans le sujet; si l'on ne sait aussi éloigner de soi l'odieux d'une cause pour le rejeter sur autrui, ni enfin juger ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut mépriser. Voilà ce qui donne du mouvement et de l'action à un plaidoyer : ôtez cela, ce n'est plus qu'un corps sans âme. Mais ii ne suffit pas encore que toutes ces qualités s'y trouvent, il faut qu'elles soient disposées et variées de telle sorte qu'elles charment l'oreille, comme les sons d'un instrument qui est parfaitement d'accord. Or, le plus souvent tout cela est rendu d'une manière directe, sans déguisement, sans artifice. Quelquefois aussi cela, comme je l'ai dit, est figuré; et un exemple, que je n'irai pas chercher fort loin, fera comprendre ce que j'entends ici par figure. Quoi de plus commun que d'interroger ou de questionner? Car nous nous servons indifféremment de ces deux termes, bien que l'un semble marquer un 323 simple désir de connaître, et l'autre le dessein de presser celui à qui l'on parle. Quoi qu'il en soit, la chose en elle-même, quel que soit le nom qu'on lui donne, peut être figurée diversement. Commençons donc par les figures qui rendent la preuve plus vive et plus véhémente, car j'ai donné le premier rang à la preuve. L'interrogation simple est celle-ci : Mais vous, qui êtes-vous ? d'où venez-vous ? Elle est figurée, toutes les fois qu'on se propose, non de s'informer purement et simplement d'une chose, mais de presser celui qu'on interroge : Dites-nous, Tubéron; que faisait votre épée dans les champs de Pharsale? et, Jusques à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience?... Ne sens-tu pas que tes complots sont découverts? etc. Combien cette forme est plus vive que s'il eût dit: Il y a longtemps que tu abuses de notre patience; tes complots sont découverts. On interroge aussi sur une chose qui ne peut être niée : Est-il vrai que C. Fidiculanius Falcula ait été accusé juridiquement? ou dont il n'est pas facile de rendre raison ; et alors nous recourons d'ordinaire à ces façons de parler : Est-il possible ? Comment se peut-il ? Quelquefois nous interrogeons, pour rendre odieux celui à qui nous adressons la parole, comme Médée, dans Sénèque : Dans quelle contrée m'ordonnez-vous donc d'aller? ou pour exciter la compassion, comme Sinon, dans Virgile : O désespoir ! Quelles mers, quels pays voudront me recevoir? ou pour insister, et ôter à la partie adverse tout moyen de dissimuler, comme a fait Asinius dans un de ses plaidoyers : Entendez-vous? ce n'est pas, dis-je, le testament d'un homme qui ait manqué à ses devoirs, que j'attaque; c'est celui d'un fou, d'un furieux. La forme interrogative, comme on le voit, est infiniment variée : elle marque tantôt l'indignation : Qui voudra désormais encenser nos autels? (DEL.) Tantôt l'étonnement : Que ne peut sur les cœurs l'ardente soif de l'or? (DELILLE) Tantôt elle sert à rendre le commandement plus absolu :
Il
fuit ! et
mes sujets ne s'arment point encore? Quelquefois nous nous interrogeons nous-mêmes, comme dans Térence : Que faire ? etc. La réponse n'est pas non plus sans figure, lorsqu'elle est faite indirectement ; et cela à dessein, soit pour aggraver l'accusation, comme cette réponse d'un témoin interrogé s'il était vrai que l'accusé lui eût donné des coups de bâton : Et pourtant je ne l'avais point offensé; soit pour éluder une accusation, ce qui est encore plus fréquent; par exemple : Est-il vrai que vous avez tué cet homme? DITES CE BRIGAND ; que vous avez envahi ce bien? DITES MON BIEN. Quelquefois la justification précède l'aveu, comme chez ces deux bergers dans les Bucoliques de Virgile. L'un dit :
T'ai-je pas vu, dis-moi,
détourner méchamment L'autre réplique : n prix si bien gagné, sans crime se peut prendre. Ce genre de réponse a beaucoup d'affinité avec la dissimulation, qui n'a d'autre but que de faire rire, et dont par conséquent il a été parlé en son lien; car si ces réponses se faisaient 324 sérieusement, ce seraient des aveux. Le dialogue que l'on fait avec soi-même n'est pas non plus sans grâce. Cicéron nous en fournit un exemple dans son oraison pour Ligarius : Devant qui est-ce que je parle ainsi? Devant celui qui, ayant une pleine connaissance de ce que je viens de dire, n'a pas laissé de me rendre à la république, avant même que de m'avoir vu. Il feint aussi une autre sorte d'interrogation dans l'oraison pour Célius : On me dira: Est-ce là votre morale ? est-ce ainsi que vous enseignez la jeunesse? etc. A quoi il répond : Pour moi, je crois que si un homme a eu un tel courage, un tel caractère, une telle force d'âme, etc. Différemment encore on interroge une personne, et on répond pour elle immédiatement : Direz-vous que vous n'aviez pas de maison? mais vous en aviez une; que vous étiez en argent comptant? mais vous étiez dans le dénûment. C'est ce que quelques rhéteurs appellent une suggestion. On interroge aussi par comparaison : Qui des deux motiverait plus aisément son avis? et enfin de mainte autre manière, tantôt plus brièvement, tantôt avec plus d'étendue, soit sur une seule chose, soit sur plusieurs. Mais passons aux autres figures. La présomption, πρόληψις, est d'un secours merveilleux dans les plaidoyers. C'est une figure par le moyen de laquelle nous allons au-devant d'une objection. Elle est d'usage dans toutes les parties du discours, mais elle convient principalement à l'exorde; et quoiqu'il n'y en ait qu'un seul genre, elle se subdivise cependant en plusieurs espèces différentes. Tantôt c'est une prémunition, comme dans l'oraison de Cicéron contre Q. Cécilius, où cet orateur prévient la surprise où l'on aurait pu être de ce qu'il descendait au rôle d'accusateur, lui qui jusque-là n'avait accepté que celui de la défense. Tantôt c'est une manière de confession, comme dans l'oraison pour Rabirius Postumus, où le même Cicéron avoue qu'à ses yeux mêmes Rabirius est blâmable d'avoir prêté de l'argent au roi Ptolémée. Tantôt c'est une prédiction : Car je le dirai, non pour aggraver l'accusation, etc. Tantôt, une correction : Pardonnez-moi si j'ai repris l'affaire d'un peu haut. Le plus souvent, c'est une préparation, laquelle consiste à rendre compte avec quelques détails des motifs de ce que nous voulons faire ou de ce que nous avons fait. La force et la propriété d'un mot se confirment quelquefois par la présomption: Quoique ce fût moins une peine proprement dite qu'une prohibition de crime; ou par l'amendement : Citoyens, citoyens, dis je, si toutefois il m'est permis de les appeler de ce nom. La dubitation donne aussi un certain air de bonne foi à l'orateur, quand il feint de ne savoir par où commencer ni par où finir, ni ce qu'il doit dire ni ce qu'il doit taire. Les exemples abondent, mais un seul me suffira : Pour moi, je ne sais de quel c6té me tourner. Nierai-je que les juges aient eu l'infamie de se laisser corrompre ? etc. Et cette figure embrasse le passé même; car on peut feindre aussi d'avoir été en doute. La communication n'est pas fort différente. Par cette figure, nous consultons notre adversaire lui-même, comme Domitius Afer, plaidant pour Cloantilla: Dans son trouble, elle ne sait ni ce qui est permis à son sexe, ni ce qui convient à une épouse. Peut-être que le hasard vous a rassemblés ici pour la tirer de peine. Vous, son frère, et vous, les amis de son père, que lui conseillez-vous ? ou nous faisons semblant de délibérer avec les juges, ce qui est le plus ordinaire: Qu'en pensez-vous? Je vous le demande 325 à vous-mêmes, que fallait-il faire? ou bien, comme Caton : Dites-moi, je vous prie, si vous aviez été à sa place, quelle autre conduite eussiez-vous tenue ? Et ailleurs: Songez qu'il s'agit de l'intérêt commun, et que vous êtes préposés à cette affaire. Mais quelquefois nous joignons à la communication quelque chose d'inattendu, et cela même est une figure. Par exemple, Cicéron, plaidant contre Verrès, s'écrie : Que pensez-vous après cela qu'ait fait cet homme? peut-être quelque vol, quelque rapine ? Il les laisse ainsi longtemps incertains; puis il ajoute un crime incomparablement plus atroce. C'est ce que, Célsus appelle une sustentation. Or, il y en a de deux sortes; car souvent, au contraire, après avoir fait attendre des choses très graves, nous désappointons l'attention par le récit d'une chose peu importante, ou qui n'a rien de criminel; et comme cela se fait seulement par le moyen de la communication, il a plu à quelques-uns d'appeler cette surprise g-παράδοξον. Mais alors je n'y vois nulle figure, pas même quand nous parlons d'une chose qui, selon nous, est arrivée contre notre attente, comme dans cet exemple de Pollion : Je n'aurais jamais cru, juges, que, Scaurus étant accusé, je me trouverais obligé de demander que le crédit n'eût aucune influence sur votre jugement. Le principe de ce qu'on appelle la permission est à peu près le même que celui de la communication. Elle consiste à laisser les juges, et quelquefois même les adversaires, maîtres de croire ce qu'ils voudront. En voici un exemple dans ces paroles de Calvus à Vatinius : Frottez-vous le front, et dites que vous étiez plus digne de la préture que Caton. Quant aux figures qui sont propres à produire de grands mouvements, elles consistent principalement dans la feinte; car nous y feignons d'être en colère, ou d'avoir de la joie, de la crainte, de l'admiration, de la douleur, de l'indignation, ou d'autres sentiments pareils. De là ces traits : Enfin me voilà délivré; je respire; cela va bien. - Quelle est ma folie ! O temps ! ô mceurs! - O malheureux que je suis! Car lors même que mes larmes sont taries, la douleur déchire encore mon coeur. - O terre, entr'ouvre-toi! Quelques rhéteurs néanmoins nomment ce dernier trait une exclamation, et le rangent parmi les figures de mots. Toutes les fois que ces expressions sont dictées par un sentiment vrai, on ne peut pas dire qu'elles soient figurées au sens que nous l'entendons ici. Mais, étant l'effet de la feinte et de l'art, il est hors de doute qu'on les peut regarder alors comme des figures. J'en dis autant de cette liberté de langage que Cornificius appelle licence, et les Grecs παρρήσια. Car qu'y a-t-il de moins figuré que la franchise? Mais souvent une flatterie délicate est cachée sous ces apparences. Car, par exemple, lorsque Cicéron, plaidant pour Ligarius, dit : La guerre étant entreprise, César, et déjà presque achevée, sans que personne m'y obligeât, et de mon propre mouvement, je partis pour aller prendre les armes contre vous; par là, non seulement il excuse Ligarius en se montrant plus coupable que lui, mais il ne pouvait jamais mieux louer la clémence du vainqueur. Et quand il dit : De bonne foi, Tubéron, quel autre dessein avions-nous en prenant les armes contre César, que de pouvoir nous-mêmes ce que peut aujourd'hui César? il prend un tour admirable pour rendre la cause de l'un et de l'autre également bonne; 326 mais en même temps il flatte, il gagne César, dont au fond la cause était mauvaise. Une figure plus hardie, et qui, selon Cicéron, demande beaucoup plus de force, c'est cette fiction qui fait intervenir les personnes, et qu'on nomme prosopopée. Elle est singulièrement propre à varier et animer le discours ; car, à l'aide de cette figure, tantôt nous exposons au grand jour les pensées de notre adversaire, comme s'il s'entretenait avec lui-même ; et nous ne rencontrons l'incrédulité qu'autant que nous lui prêtons des paroles invraisemblables; tantôt, en restant fidèles à la vraisemblance, nous reproduisons, ou nos propres conversations, ou celles des autres entre eux; tantôt enfin, pour donner plus de poids aux reproches, aux plaintes, à la louange, à la compassion, nous faisons parler des personnes en qui ces sentiments paraissent naturels. On va même encore plus loin : on fait intervenir les dieux, on évoque les morts ; on donne une voix aux villes et aux peuples. Quelques-uns néanmoins n'accordent le nom de prosopopée qu'aux figures où, donnant un corps animé à certains êtres moraux, nous les faisons parler. Quant à ces conversations feintes dont j'ai parlé, ils aiment mieux les appeler dialogues, διαλόγον, ce que quelques rhéteurs latins nomment sermocinatio. Pour moi, j'ai compris l'un et l'autre sous le même nom, suivant l'usage actuellement établi; car on ne peut supposer un discours, qu'on ne l'attribue à quelqu'un. Mais si nous faisons parler une ville ou tout un pays, qui, à vrai dire, n'a point de voix, il y a une manière d'adoucir cette figure, et Cicéron nous en donne un exemple : Car si la patrie, qui m'est infiniment plus chère que ma propre vie, si l'Italie entière, si toute la république pouvait parler et me dire Cicéron, quel est ton dessein? etc. L'exemple qui suit est plus hardi: Écoutez, Catilina, écoutez la voix de la patrie, qui semble vous adresser ses plaintes et vous dire tout bas : Depuis plusieurs années, il ne s'est pas commis un crime dont vous n'ayez été l'auteur, etc. Nous feignons aussi quelquefois avec succès d'avoir devant les yeux une image des choses, des personnes ou des voix, et nous faisons semblant d'être surpris que la partie adverse ou que les juges n'en soient pas frappés comme nous : Il me semble. - Ne vous semble-t-il pas? Mais ces fictions demandent une grande force d'éloquence; car les choses outrées et incroyables n'ont point un effet médiocre : il faut nécessairement ou qu'elles fassent une forte impression sur les esprits, parce qu'elles vont au delà du vrai, ou qu'elles soient regardées comme des puérilités, parce qu'elles sont fausses. Au reste, de même qu'on fait parler une personne, on la fait aussi écrire. Nous en avons un exemple dans l'oraison d'Asinius pour Liburnia, où il feint cette clause de testament : A l'égard de ma mère, qui m'a toujours uniquement aimé et que j'ai chérie de même, qui semble n'avoir vécu que pour moi, et qui m'a donné la vie deux fois en un même jour, etc., je la déshérite : ce qui de soi est une figure, et l'est doublement lorsqu'on emploie cette fiction par opposition à un autre écrit tout contraire, comme dans cette espèce. Car on lisait de l'autre part cette autre clause : Pour reconnaitre les obligations que j'ai à P. Novanius Gallion, et en considération de l'amitié qu'il m'a témoignée, je l'institue mon héritier. Cela devient alors une espèce de parodie, terme qui signifie proprement un air fait à l'imitation d'un autre air, mais que nous appliquons abusivement aux vers et à la prose. Une fiction qui est encore assez fréquente, c'est de donner un corps et une 327 figure à des choses qui n'en ont point : à la Renommée, par exemple, comme l'a fait Virgile; à la Volupté et à la Vertu, comme Prodicus dans Xénophon; à la Vie et à la Mort, dont Ennius décrit le combat dans une satire. Quelquefois on fait parler une personne sans la désigner: Quelqu'un dira peut-être, etc.; et quelquefois on rapporte seulement des paroles, sans les attribuer à personne : Là campait le Dolope et le cruel Achille. (DELILLE) Ce qui se fait par un mélange de figures, lorsque à la prosopopée on joint une figure de mot, je veux dire l'ellipse; car le poète ne dit point qui tenait ce discours. Remarquons qu'assez souvent la prosopopée se change en une sorte de narration. De là ces récits indirects qu'on trouve dans les historiens, comme celui qui se lit dans Tite-Live au début de son premier livre : Que les villes même, comme toutes les choses du monde, ont de faibles commencements; mais qu'avec le temps celles que leur vertu et les dieux assistent se rendent très puissantes et acquièrent un grand nom. L'apostrophe est encore une figure fort vive, soit que l'orateur, oubliant les juges pour un moment, interpelle tout à coup la partie adverse : Dites-moi, Tubéron, que faisait votre épée dans les champs de Pharsale ? etc. ; soit que, par manière d'invocation, il adresse la parole ou à d'illustres morts, ou à des choses inanimées : O vous, sacrés tombeaux des Albains! etc.; soit qu'il implore le secours des lois pour rendre encore plus odieux celui qui les a violées : Saintes lois des Porcius et des Sempronius! Mais, suivant l'étymologie du mot apostrophe, on peut comprendre aussi sous ce genre tout ce qui sert à détourner l'auditeur de la proposition : Je n'ai point conjuré contre Troie, en Aulide. Ce qui se fait de plusieurs manières et au moyen de diverses figures; car tantôt nous feignons ou de nous être attendus à autre chose, ou d'avoir appréhendé quelque chose de pire; tantôt nous supposons que le juge, étant peu instruit du fait, a pu le croire plus grave qu'il n'est. Tel est l'exorde de l'oraison pour Célius. Quant à cette figure qui, comme le dit Cicéron, met la chose sous les yeux, on a coutume de s'en servir, lorsque, au lieu d'indiquer simplement un fait, on le représente exactement comme il s'est passé, non en gros, mais en détail. C'est un article que j'ai traité dans le livre précédent, l'ayant compris sous l'évidence ou illustration, qui est, en effet, le nom que Celsus donne à cette figure. D'autres l'appellent hypotypose, et la définissent une image des choses si bien retracée par la parole, que l'auditeur croit plutôt la voir que l'entendre : Respirant le crime et la fureur, il vint au barreau; ses yeux étincelaient, la cruauté était peinte sur son visage. Non seulement on représente les choses qui sont ou qui ont été, mais aussi celles qui seront ou qui auraient été. Cicéron nous en fournit un exemple admirable dans son oraison pour Milon, quand il dépeint ce qu'eût fait Clodius, s'il se fût emparé de la préture. Mais ces transpositions de temps, qu'on appelle proprement métastases et qui ont quelquefois lieu dans l'hypotypose, étaient employées par les anciens avec certaines précautions oratoires : Imaginez-vous voir, etc. ; ou bien : Ce que vous n'avez pu voir par vos yeux, vous pouvez du moins vous le représenter en esprit. Aujourd'hui nos orateurs, et encore plus nos déclamateurs, outrent leurs images : témoin Sénèque dans cette controverse, où il 328 feint qu'un père qui avait deux fils d'une première femme, averti par l'un d'eux, surprend l'autre en adultère avec sa belle-mère, et se venge en ôtant la vie aux deux coupables. Il fait dire a ce père : Conduis-moi, je te suis. Prends cette main tremblante, et mène-moi où tu voudras. Le fils, ayant conduit son père jusque dans la chambre qui servait de rendez-vous, lui dit: Hé bien! mon père, ce que vous ne vouliez pas croire, le voyez-vous de vos propres yeux? Je ne vois rien, répondit le père. Je suis dans les ténèbres; un nuage épais m'environne et me dérobe la clarté du jour. Voilà une image, mais qui a quelque chose de trop palpable; car il semble que c'est un spectacle, et non un récit. Quelques-uns donnent encore à l'hypotypose le soin de décrire les lieux d'une manière qui les représente au naturel ; et d'autres aiment mieux faire de cette description une figure particulière, qu'ils nomment topographie. Venons à l'ironie. Je sais des écrivains qui, pour exprimer ce terme en notre langue, l'ont rendu par celui de dissimulation. Pour moi, qui ne trouve pas celui-ci fort propre à bien marquer toute la force de cette figure, je m'en tiendrai au terme grec, comme pour la plupart des autres figures. L'ironie donc; considérée comme figure, ne diffère pas beaucoup, quant au genre, de l'ironie considérée comme trope; car, en l'une et en l'autre, il faut toujours entendre le contraire de ce qu'on y dit. Mais si on les examine de près, on n'aura pas de peine à voir que ce sont des espèces différentes. Premièrement, le trope se laisse pénétrer plus aisément, et, bien qu'il présente un sens et en renferme un autre, ce dernier sens est moins déguisé; car tous les accessoires sont ordinairement en dehors de la figure, comme dans ces paroles de Cicéron à Catilina : Métellus n'ayant point voulu de vous, le parti que vous prîtes fut de vous retirer chez votre ami M. Marcellus, cet homme excellent. Car toute l'ironie consiste dans ces mots: cet homme excellent. D'où il suit, en second lieu, que le trope est aussi plus court. Dans la figure, au contraire, on feint tout à fait de penser ce qu'on ne pense pas, mais d'une manière qui est plutôt apparente que véritablement accusée : là ce sont des mots pour d'autres mots, ici c'est un sens qu'on cache sous des mots qui en expriment matériellement un autre. Quelquefois la cause entière est fondée sur cette figure; que dis-je? la vie entière d'un homme peut n'être qu'une ironie continuelle, comme parut l'être celle de Socrate. Aussi l'appelait-on l'ironique, parce qu'il contrefaisait l'ignorant, et faisait semblant d'admirer les autres comme des sages. En un mot, de même qu'une métaphore prolongée devient une allégorie, de même une succession d'ironies qui, prises isolément, formeraient autant de tropes, constitue la figure de l'ironie. Cette figure a cependant certains genres qui n'ont rien de commun avec ce trope : l'antiphrase, par exemple, qui est une figure de pensée, lorsqu'en prétendant que nous ne dirons pas une chose, nous ne laissons pas de la dire : Je n'agirai pas avec vous dans la rigueur du droit, et je n'insisterai pas sur un point que l'on m'accorderait peut-être. - Parlerai-je de ses décrets; de ses rapines, des successions qu'il s'est fait abandonner, de celles dont il s'est emparé? - Je passe sous silence cette première injure qui regarde la débauche. - Je ne lirai pas même ces dépositions faites au sujet des 700,000 sesterces. - Je pourrais dire, etc. Ces genres d'ironie peuvent passer par toutes les questions, comme on le voit dans Cicéron : Si je traitais ce point en homme qui veut détruire une accusation, j'en dirais bien davantage. Il y a en- 329 core ironie, quand nous faisons semblant d'ordonner ou de permettre une chose : Cours, à travers les mers, chercher ton Italie (DELILLE). ou lorsque nous concédons à nos adversaires une qualité que nous serions bien fâchés qu'on leur reconnût : ce qui devient encore plus amer quand c'est nous qui possédons cette qualité, et non pas eux :
Eh bien! parlez, tonnez, insultez à
ma peur, ou bien, au contraire, lorsque nous prenons sur notre compte des reproches que nous ne méritons pas, et qui même retombent sur notre adversaire :
C'est donc moi que l'on
vit, par d'indignes
secours, Cette manière de faire entendre le contraire de ce qu'on dit a lieu pour les choses comme pour les personnes. Tel est l'exorde tout entier de l'oraison pour Ligarius, et ces exclamations qui ne tendent qu'à rabaisser la chose dont on parle : Oh! oui vraiment! Justes dieux! - Sans doute, les dieux s'inquiètent beaucoup de cela! Et tout ce passage de l'oraison pour Oppius : O l'admirable tendresse! ô la rare bienveillance! A ce genre de déguisement on en peut ajouter certains autres qui sont assez semblables entre eux par exemple, lorsqu'on fait un aveu qui ne peut porter aucun préjudice, comme celui-ci : Vous avez, Tubéron, ce qu'il y a de plus souhaitable pour un accusateur, un accusé qui confesse tout; lorsque l'on a l'air de passer à la partie adverse quelque chose d'inique, par suite de la confiance qu'on a dans la bonté de sa cause : Un capitaine de vaisseau, d'une cité illustre, s'est racheté, à prix d'argent, du supplice des verges : humanité du juge; et dans l'oraison pour Cluentius : Que l'envie règne dans les assemblées du peuple, mais qu'elle soit bannie des tribunaux; enfin; quand on convient, comme dans ce même plaidoyer, qu'il y a eu corruption des juges. Cette dernière figure ressort encore mieux, lorsque notre concession doit tourner à notre avantage; ce qui ne peut arriver que par la faute de notre adversaire. La louange est aussi quelquefois ironique. Par exemple, Cicéron dit à Verrès, au sujet d'Apollonius de Drépanum : Si vous lui avez enlevé quelque chose, je m'en réjouis avec vous : c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre vie. Quelquefois encore nous exagérons une accusation qu'il nous serait facile de détruire ou de nier; et cela se voit si souvent, qu'il n'est pas besoin d'en donner des exemples. Souvent même c'est à force d'exagérer une chose que nous la rendons invraisemblable. C'est ainsi que, dans l'oraison pour Roscius, Cicéron ajoute encore par ses paroles à l'énormité du parricide. La figure que Cicéron appelle réticence, Celsus obticence, et quelques-uns interruption, en grec ἀποσιώπησις, manifeste tantôt la colère : Je devrais... Mais il faut calmer les flots émus ; (DELILLE) tantôt l'inquiétude et une sorte de scrupule : Croyez-vous qu'il eût osé faire mention de cette loi dont Clodius se vante d'être l'auteur, si Milon eût été, je ne dis pas consul, mais seulement vivant? car pour nous tous... je n'ose 330 tout dire. Dans l'exorde de Démosthène pour Ctésiphon, on voit un pareil exemple de réticence. Quelquefois cette figure sert de transition : Or Cominius... cependant pardonnez-moi, etc. et il y a même la digression, si toutefois la digression peut être comptée parmi les figures; car d'autres la regardent comme une des parties de la cause. En effet, tout le plaidoyer se résout dans l'éloge de Pompée, ce qui aurait pu se faire sans recourir à la réticence. Quant à ces petites digressions, comme les appelle Cicéron, elles se font de plusieurs manières; deux exemples suffiront : Alors C. Varénus, celui-là même qui fut tué par les gens d'Ancharius (écoutez bien ceci, je vous prie)... et, dans l'oraison pour Milon : Il me regarda avec ces yeux qu'on lui connaissait, quand il menaçait tout le monde de tout. Il y a aussi une autre sorte d'interruption, qui n'est pas précisément une réticence, puisqu'elle ne laisse pas le discours inachevé, mais qui cependant le coupe avant la fin naturelle : Mais je presse trop ce jeune homme; il paraît se troubler; ou bien : Que vous dirai-je de plus? Vous l'avez entendu vous-mêmes L'imitation des mœurs d'autrui, ἠθοποιία, ou, suivant d'autres, μίμησις, est une figure qui convient aux sentiments doux, car elle consiste presque uniquement à éluder; mais elle comprend également les actions et les paroles. A l'égard des actions, elle a beaucoup d'analogie avec l'hypotypose; à l'égard des paroles, en voici un exemple tiré de Térence : Je ne savais où vous vouliez en venir. Elle a été amenée toute petite ici, ma mère l'a élevée comme son enfant; on l'appelait ma sœur; je veux l'emmener pour la rendre à sa famille. Nous nous servons aussi de cette figure en racontant ce que nous avons dit et ce que nous avons fait nous-mêmes; avec cette différence que le plus souvent c'est plutôt pour affirmer que pour éluder. Je disais qu'ils avaient pour accusateur Q. Cécilius. Je mets au même rang certaines formes de style qui, par leur nature et leur variété, donnent de l'agrément au discours et préviennent en notre faveur, en ce qu'elles n'ont rien d'étudié, et nous rendent moins suspects au juge par leur air de simplicité : par exemple, quand nous feignons de nous repentir de ce que nous avons dit, comme dans l'oraison pour Célius : Mais à quoi ai-je songé en introduisant un personnage si grave? ou d'avoir dit une chose par mégarde, ou de chercher ce que nous dirons : Que reste-t-il encore? - N'ai-je rien oublié? ou de dire une chose par occasion, comme Cicéron : Il me reste à vous exposer un grief de cette nature. - Ce fait m'en rappelle un autre. Et cela même donne lieu à des transitions fort belles, quoique, par elle-même, la transition ne soit pas une figure. Cicéron, après avoir raconté que Pison, siégeant sur son tribunal, avait ordonné à un orfèvre de lui fabriquer un anneau d'or, ajoute, comme si ce fait lui en rappelait un autre : Mais l'anneau de Pison me fait souvenir d'une chose qui m'était entièrement échappée. A combien d'honnêtes gens croyez-vous que cet homme ait escroqué des anneaux d'or? Quelquefois on affecte l'ignorance : De qui disait-on qu'étaient ces statues? De qui? Vous faites bien de m'en avertir : c'est de Polyclète. On arrive par là à plus d'une fin; car bien souvent on atteint un 331 but, sans paraître se le proposer. C'est ce que fait ici Cicéron en affectant peu de connaissance dans les arts, afin qu'on ne lui attribue pas la fureur qu'il reproche à Verrès pour les statues et les tableaux. Ainsi, quand Démosthène jure par les mânes des citoyens tués à Marathon et à Salamine, il se propose d'affaiblir le fâcheux souvenir de la défaite de Chéronée. Un moyen de donner encore de l'agrément au discours, c'est de laisser là pour un moment certaines choses dont on a fait mention, en les confiant à la mémoire du juge; puis, d'y revenir à l'aide de quelques figures qui dissimulent l'interruption; car, par elle-même, l'itération n'est point une figure. On reprend donc ces différentes choses séparément, ou du moins on s'attache à quelques-unes en particulier. De cette façon, on varie la figure du plaidoyer; et, de même que les yeux sont captivés par la diversité, l'air de la nouveauté récrée et soutient l'esprit. Il y a aussi une sorte d'emphase, que l'on peut mettre au nombre des figures de pensées, lorsque les mots cachent un sens qu'ils n'expriment pas ouvertement. Ainsi Didon s'écrie dans, Virgile :
Que n'ai-je pu,
dans un chaste veuvage, Quoiqu'elle se plaigne du mariage, on voit bien qu'au fond elle regarde la solitude comme le fait d'une bête sauvage, plutôt que d'un homme ou d'une femme. En voici un autre exemple tiré d'Ovide, mais dont le sens est encore plus caché. Zmyrna trahit l'amour qu'elle a pour son père, en disant à sa nourrice : Auprès d'un tel époux que ma mère est heureuse! C'est à ce genre que se rapporte ou ressemble la figure qui est le plus à la mode aujourd'hui; car il est temps d'y arriver et de satisfaire l'impatience du lecteur. Il s'agit de ces pensées que nous voulons qu'on devine sans le secours des mots. Je n'entends pas par là le contraire de ce qu'on dit, comme dans l'ironie, mais quelque chose de caché et d'énigmatique, que l'on abandonne à la pénétration de l'auditeur. Voilà, comme je l'ai déjà indiqué, ce que nos déclamateurs décorent presque exclusivement du nom de figure; et de là ces controverses appelées figurées. On s'en sert dans l'un de ces trois cas : lorsqu'il n'y a pas sûreté à s'expliquer ouvertement, ou lorsque la bienséance s'y oppose, ou à titre de beauté oratoire, et pour remédier par la nouveauté et la variété à la monotonie du langage direct. Le premier cas se présente souvent dans les écoles, où l'on feint tantôt des tyrans qui se démettent de la souveraine puissance à certaines conditions; tantôt un décret du sénat portant amnistie après des guerres civiles : et comme alors c'est un crime capital de revenir sur le passé, on imite aux écoles les précautions du barreau. Mais l'emploi de la figure n'est pas le même pour l'orateur et le déclamateur; car celui-ci peut se permettre de dire ouvertement tout ce qu'il veut contre le tyran, pourvu que ses paroles soient susceptibles d'une interprétation favorable; il s'agit seulement pour lui d'éviter l'écueil et non l'offense; et, s'il y parvient par l'ambiguïté de sa pensée, tout le monde applaudit à son adresse. Dans les causes réelles, le silence n'a point encore été jusqu'à présent une nécessité; mais l'orateur se trouve exposé à une précaution qui y ressemble, et qui est même beaucoup plus embarrassante, quand, par exemple, il ne peut gagner son procès sans bles- 332 ser des personnages puissants. Aussi faut-il plus de mesure et de circonspection, parce qu'une offense, quelle qu'elle soit, est toujours une offense ; et si la figure se trahit, elle cesse par cela même d'être une figure. Voilà pourquoi quelques rhéteurs rejettent entièrement ce genre d'artifice, soit qu'il se fasse entendre, soit qu'il ne se fasse pas entendre. On peut néanmoins garder un certain milieu. Et d'abord il faut avant tout que la figure ne soit pas palpable; et elle ne le sera pas, si l'on évite les expressions équivoques et à double sens, comme celles-ci, par exemple, au sujet d'une bru soupçonnée d'avoir eu des liaisons avec son beau-père : J'ai pris pour épouse une femme qui ne déplaisait pas à mon père; ou ces rapprochements de mots dont l'ambiguïté est encore plus inconsidérée, comme dans cette controverse où un père, accusé d'avoir déshonoré sa fille, ose lui demander qui l'a séduite : Qui vous a fait violence, ma fille? - Vous, mon père, l'ignorez-vous? Il faut que ce soient les choses mêmes qui éveillent le soupçon du juge. Du reste, bornons-nous à employer le ressort des passions, les pauses, les hésitations. Trompé par cet artifice, qui est très-efficace, le juge cherche de lui-même ce je ne sais quoi qu'il n'aurait pas cru si on le lui eût dit; et, croyant l'avoir deviné par l'effet de sa propre pénétration, il s'y attache avec une foi invincible. Mais quelque finesse que nous mettions à ces figures, il ne faut pas les prodiguer; car elles se trahissent par leur multiplicité, et nous discréditent, sans sauver l'intention d'offenser. Notre circonspection semble alors moins un effet de la pudeur que de la défiance. En un mot, le juge ne se laisse prendre aux figures que là où il ne croit pas en voir. J'ai eu autrefois à remplir des rôles de cette nature, et j'ai plaidé, ce qui est plus rare, une cause qui ne pouvait se gagner que par cet artifice. Je défendais une femme accusée d'avoir supposé un testament de son mari. On disait que les héritiers institués par ce testament avaient remis une obligation au mari au moment où il expirait; et le fait était vrai. En effet, les lois s'opposant à ce que cette femme fût instituée héritière, on avait eu recours à cet expédient pour lui faire passer les biens au moyen d'un fidéicommis. Il était facile de la justifier relativement à la supposition de testament, en déclarant ce qui avait eu lieu; mais alors l'héritage était perdu pour elle. Il me fallut donc plaider de telle sorte que les juges comprissent le fait sans que les dénonciateurs pussent abuser de mes paroles, et j'atteignis ce double but. Je me serais abstenu de me citer pour exemple, dans la crainte d'être taxé de vanité, si je n'eusse tenu à faire voir que les plaidoyers comportent aussi ces figures. Ajoutez qu'il y a des choses dont la preuve est difficile; et, dans ce cas, il vaut mieux les insinuer malicieusement; car alors la figure dont on se sert est comme un trait lancé dans les ténèbres, et qu'on a d'autant plus de peine à arracher qu'on ne le voit pas. Que si, au contraire, vous dites ouvertement la même chose, on vous contredit, et vous êtes forcé de prouver. Si c'est la bienséance qui nous arrête à cause du caractère de la personne, ce qui est le second cas dont j'ai parlé, la précaution est encore plus de saison; car la pudeur est pour l'honnête homme un frein plus puissant que la crainte. Il faut que le juge croie que nous taisons ce que nous savons, et que nous nous faisons violence pour contenir la vérité prête à nous échapper; car ceux même que nous accusons, ou les juges, ou les assistants, détesteront-ils moins notre médisance, toute figurée qu'elle est, s'ils sont persuadés qu'au fond elle est sérieuse et ré- 333 fléchie? Qu'importe la manière dont nous parlons, si la chose et l'intention se devinent? Que gagnons-nous enfin par nos paroles, si ce n'est de mettre en évidence que nous faisons ce que nous savons bien que nous ne devrions pas faire? Or, c'était là le défaut dominant des écoles, dans le temps que je commençais à professer la rhétorique: on prenait plaisir à traiter ces controverses, dont la difficulté faisait tout l'attrait, quoiqu'elles soient beaucoup plus faciles. En effet, le langage simple et direct a besoin, pour se faire goûter, de toutes les forces du génie; au lieu que les faux-fuyants et les circuits sont la ressource de la médiocrité. Ainsi celui qui ne sait pas bien courir échappe par un détour à celui qui le poursuit. Ajoutez à cela que ce langage figuré touche de près à la plaisanterie, et que ceux qui l'affectent comptent sur la complicité de l'auditeur, qui, charmé d'entendre à demi-mot, s'applaudit de sa pénétration, et trouve dans ce qu'un autre dit une part pour sa vanité. De là cet abus du genre figuré, non seulement lorsque le respect dû à la personne interdisait le langage direct, auquel cas il faut plutôt user de ménagement que de figures, mais lors même que ces figures étaient inutiles, ou renfermaient une ironie criminelle. Par exemple, un père a tué secrètement son fils, qui avait eu un commerce incestueux avec sa mère; celle-ci le cite en justice pour mauvais traitements. Le père accusé lance des mots équivoques contre sa femme. Quelle indignité de la part de cet homme, d'avoir gardé une pareille femme ! et, l'ayant gardée, quoi de plus contraire à ses intérêts, étant accusé parce qu'il paraît avoir soupçonné sa femme d'un grand crime, que de confirmer, par le ton de sa défense, le soupçon qu'il devrait lui-même s'attacher à détruire! Si ces déclamateurs se mettaient un instant à la place des juges, ils sentiraient combien un plaidoyer de cette sorte est insupportable, surtout lorsque ce sont des enfants mêmes qui répandent sur leurs parents d'odieuses insinuations. Puisque nous sommes tombés sur cette matière, arrêtons-nous-y un peu en faveur des écoles; car, après tout, c'est là que l'orateur se forme, et l'avocat ne sera que ce qu'aura été le déclamateur. Parlons donc de ces controverses où ce ne sont plus des figures déplacées qu'on emploie, mais le plus souvent des figures évidemment contraires à l'esprit de la cause. Quiconque aura affecté la tyrannie sera mis à la torture, pour faire connaître ses complices. L'accusateur pourra opter pour telle récompense qu'il lui plaira. Un fils, qui avait accusé son père, opte pour qu'il ne soit pas torturé; le père s'y oppose. Il n'est pas de déclamateur qui, représentant le père, n'insinue par des figures que le fils craint d'être nommé parmi les complices. Quoi de plus inepte? car, si les juges devinent les insinuations du père, ou ils ne feront pas mettre le père à la torture, connaissant le but qu'il se propose, ou ils n'auront aucune foi dans ses déclarations, s'il est torturé. Mais, dira-t-on, il est à croire que tel est le dessein du père; soit: qu'il dissimule donc pour réussir. Mais, disent nos déclamateurs, à quoi nous servira d'avoir pénétré sa pensée, si nous ne la faisons pas connaître? La réponse est aisée. S'il s'agissait d'une cause sérieuse, trahiriez-vous un tel dessein? Qui vous assure d'ailleurs que ce soit le véritable? L'accusé ne peut-il pas avoir d'autres raisons pour s'opposer à l'option de son fils? Ne serait-ce pas par respect pour la loi, ou parce qu'il ne veut rien devoir à son accusateur? ou enfin, et c'est là sur- 334 tout à quoi je m'attacherais, ne serait-ce pas pour soutenir son innocence au milieu des tortures? Vous n'avez donc pas même, en plaidant ainsi, cette excuse ordinaire : J'ai plaidé sa cause comme il l'a voulu; car il n'est pas certain que celui que vous défendez l'ait voulu ; et, quand il l'eût voulu, est-ce une raison de partager sa sottise? Je tiens, pour moi, que très souvent il ne faut pas avoir égard à la volonté du plaideur. Une erreur assez fréquente encore dans ce genre de controverse, c'est de supposer que certains personnages, tout en disant une chose, en pensent une autre, surtout quand il est question d'une personne qui demande qu'il lui soit permis de mourir, comme dans le thème suivant : Un homme qui avait fait preuve de bravoure en mainte occasion demande son congé en vertu de la loi, parce qu'il est quinquagénaire. Son fils s'opposant à sa demande, il est forcé de se rendre à l'armée, et déserte. Le fils fait une action d'éclat, et, usant du droit de choisir telle récompense qu'il voudra, opte pour que son père ait la vie sauve : le père refuse sa grâce. Ce n'est pas, disent nos déclamateurs, que celui-ci veuille mourir; il ne veut que rendre son fils odieux. Pour moi, je les admire de vouloir juger de la disposition de cet homme par la leur, et de ne prendre conseil que de leur propre crainte, sans considérer que nous avons mille exemples de gens qui se sont dévoués volontairement à la mort, sans considérer par combien de motifs peut y être déterminé un homme qui de brave est devenu déserteur. Mais il est inutile de chercher dans une seule controverse toutes les preuves qui tendent à faire voir combien ce langage est contraire à l'esprit de la cause. J'aime mieux dire en général que l'orateur ne doit jamais prévariquer, et que je ne vois pas de procès là où les deux parties sont d'accord. Je ne conçois pas non plus qu'un homme soit assez insensé, s'il tient à la vie, pour demander maladroitement la mort, au lieu de ne la pas demander du tout. Cependant je ne nie pas qu'il y ait des controverses figurées de ce genre. En voici une : On était sur le point de condamner un homme accusé de parricide pour avoir tué son frère. Le père, appelé en témoignage, déclare que le meurtre avait été commis par son ordre. Le fils étant absous, le père ne laisse pas de le déshériter. En effet, dans cette espèce, le père ne pardonne pas entièrement à son fils. D'un autre côté, il ne peut pas rétracter ouvertement son premier témoignage. Si son ressentiment ne va pas au delà de l'abdication, il ne laisse pas néanmoins de punir son fils en le déshéritant. D'ailleurs la figure, dans la personne du père, fait plus d'impression qu'il ne faut; et, dans la personne du fils, elle en fait moins. Un orateur ne dit jamais rien de contraire à ce qu'il veut, mais il peut vouloir quelque chose de mieux que ce qu'il dit. Par exemple, ce fils déshérité qui prie son père de recevoir un autre fils expose, que lui déshérité avait élevé, sauf a lui rembourser les frais de nourriture; ce fils déshérité, dis-je, aimerait peut-être mieux être rétabli dans ses droits : on ne peut pas dire cependant qu'il ne veut pas ce qu'il demande. Il y a encore une manière d'insinuer adroitement ce que l'on veut obtenir du juge, c'est de demander justice suivant toute la rigueur des lois, en laissant néanmoins entrevoir quelque espérance d'adoucissement; mais cette espérance ne se trahit pas ouvertement, dans la crainte de paraître transiger : on la laisse deviner par un soupçon probable. Cela se voit dans plusieurs controverses figurées; en voici une espèce : 335 Tout ravisseur qui, dans l'espace de trente jours, n'aura pas apaisé le père de la personne enlevée, et son propre père, sera puni de mort. Un ravisseur qui avait obtenu son pardon du père de la personne enlevée, ne pouvant l'obtenir de son propre père, l'accuse de démence. Dans l'espèce, si le père se laisse fléchir, il n'y a plus de procès; si, au contraire, il ne laisse aucun espoir, sans passer pour être en démence, il passera du moins pour cruel, et s'aliénera le juge. Aussi le rhéteur Latron se tira-t-il adroitement de cette fausse position, en faisant dire au fils: Eh quoi! mon père, vous me ferez donc mourir? et au père : Oui, si je le puis. Gallion père, suivant son caractère doux et modéré, mettait dans la bouche du père un langage moins dur Allons, ferme, mon cœur, point de faiblesse! tu fus hier plus fort. Je rapporte à cette espèce ces figures qui sont si familières aux Grecs, et dont ils se servent pour adoucir l'idée de certaines choses. Ainsi Thémistocle voulant déterminer les Athéniens à abandonner leur ville, leur dit de la déposer entre les mains des dieux. Et cet autre, étant d'avis que, pour subvenir aux frais de la guerre, on fit fondre des statues de la Victoire, qui étaient d'or massif, corrigea ce que la proposition pouvait avoir d'odieux, en disant qu'il fallait profiter de la victoire. Tout ce qui s'appelle allégorie est à peu près semblable, et consiste de même à dire une chose et à en faire entendre une autre. Voyons maintenant comment on doit répondre à ces figures. Quelques rhéteurs pensent qu'il faut les dévoiler et les mettre à nu; et, en effet, c'est ce qu'il faut faire la plupart du temps; car on ne saurait se défendre autrement, surtout lorsque ces figures ont pour objet le point même dont il est question. Mais quand ce ne sont que des traits de médisance, c'est quelquefois un témoignage de bonne conscience que de les laisser passer. Que si ces traits sont si fréquents qu'il soit impossible de faire semblant de ne pas les apercevoir, il faut alors sommer l'adversaire de s'expliquer ouvertement, s'il l'ose, ou du moins de renoncer à exiger que ce qu'il n'ose dire, les juges non seulement le comprennent, mais même qu'ils le croient. La dissimulation est aussi quelquefois très utile. Nous en avons un exemple connu de tout le monde. Un avocat avait dit à la partie adverse : Jurez-en par les cendres de votre patron; la partie répondit qu'elle était prête à le faire, et le juge accepta son offre, nonobstant les clameurs de l'avocat, qui représentait que c'était vouloir abolir entièrement l'usage des figures. Concluons donc qu'il ne faut pas recourir inconsidérément aux figures. Il y aune troisième espèce, dont on se sert uniquement pour donner plus de grâce au style. Et Cicéron pense avec raison qu'elle ne tombe jamais sur le point contesté entre les parties. Tel est ce trait qu'il emploie lui-même contre Clodius : Comme il avait une connaissance particulière de tous nos sacrifices, il ne doutait pas qu'il ne pût aisément apaiser les dieux. L'ironie s'y trouve jointe ordinairement; mais le secret de l'art consiste à faire entendre une chose par une autre. Par exemple, un tyran s'était démis de la souveraine autorité, à condition que le passé serait oublié. Son compétiteur lui dit : Il m'est défendu de parler contre vous; mais vous, parlez contre moi, vous le pouvez : il n'y a pas deux jours que j'avais formé le dessein de vous tuer. On fait aussi un fréquent usage du serment, bien que cette espèce de figure ne doive guère être imitée. Par exemple, un avocat, plaidant pour un enfant déshérité, lui fait faire ce serment : Puissé-je 336 ainsi mourir, en laissant mon fils héritier. Or, en général, il sied peu à un homme grave de jurer, à moins qu'il n'y soit forcé; et Sénèque dit fort bien que c'est le fait des témoins, non des avocats. En effet, celui-là ne mérite pas d'être cru, qui se sert du serment comme d'une beauté oratoire, à moins que ce ne soit comme Démosthène, dans la circonstance solennelle que j'ai rapportée. La plus frivole de toutes les figures est celle qui joue sur un mot, bien qu'on en trouve un exemple dans l'oraison de Cicéron pour Célius. Il dit, au sujet de Clodia : Praesertim, quam omnes amicam omnium, potius quam cuiusquam inimicam putauerunt. Je ne crois pas que la comparaison doive être rangée parmi les figures, attendu qu'elle est tantôt un genre de preuve, tantôt même un genre de cause. D'ailleurs la forme n'a rien de figuré, comme on en peut juger par cet exemple tiré de l'oraison, pour Muréna, que j'ai déjà cité : Vigilas tu de nocte, etc. Peut-être est-elle plutôt une figure de mot qu'une figure de pensée; car la seule différence qu'on puisse remarquer, c'est que ce sont seulement les parties qu'on oppose aux parties. Cependant Celsus, et un autre auteur qui connaît bien la matière, Visellius, la rangent parmi les figures de pensées. Rutilius Lupus l'attribue aux deux classes, et l'appelle antithèse. Le même Rutilius, qui a suivi Gorgias, non celui de Léontium, mais un autre rhéteur de son temps, dont les quatre livres lui ont servi à composer le sien, et Celsus après Rutilius, non contents de toutes ces figures de pensées, énumérées par Cicéron, en ajoutent une foule d'autres, comme la consommation, que Rutilius appelle διαλλαγὴ, laquelle consiste à réunir plusieurs arguments pour prouver une même chose; le conséquent, ἐπακολούθησις dont j'ai parlé à l'article des arguments; la collection, συλλογισμὸς; les menaces, κατάπληξις; l'exhortation, παραινετικόν. Pour moi, je ne vois rien dans tout cela qui s'éloigne du langage direct, à moins qu'on n'y joigne quelqu'une des figures dont j'ai parlé. Celsus enchérit encore sur les rhéteurs que je viens de citer. Par exemple, exclure, affirmer, refuser, animer le juge, citer des proverbes, des vers, employer la raillerie, l'invocation, rendre odieux son adversaire, aggraver l'accusation (δείνωσις), flatter, pardonner, avertir, donner satisfaction, prier, reprendre, ce sont autant de figures, au jugement de ce rhéteur. Il en dit autant de la partition, de la proposition, de la division, et de l'affinité de deux choses, qui fait que des choses, qui paraissent différentes, peuvent néanmoins entraîner la même conclusion, si, par exemple, on veut faire passer pour empoisonneur non-seulement celui qui ôte la vie en donnant un breuvage, mais encore celui qui fait perdre l'esprit. Ceci fait partie de l'état oratoire appelé définition. Rutilius, ou plutôt Gorgias, prétend que c'est user de figures que de représenter vivement la nécessité d'une chose (ἀναγκαῖον), faire ressouvenir l'auditeur de ce qu'il savait déjà (ἀνάμνησις), répondre à une objection qu'on se fait à soi-même (ἀνθυποφορὰ), réfuter ce que dit l'adversaire (ἀντίρρησις), amplifier (παραύξησις). Il y ajoute ce qu'il appelle προέκθεσις, c'est-à-dire ce qu'il fallait faire, et ensuite ce qui s'est fait; la contrariété, ἐναντιότης, qui fournit les enthymèmes appelés κατ' αἰτίασιν enfin la métalepse, dont Hermagoras fait un état particulier de question oratoire. Dans le petit nombre de figures qu'admet Visellius, il donne place à l'enthymème, qu'il appelle com- 337 mentum, invention de l'esprit, et à l'épichérème, qu'il nomme raison ou raisonnement. Celsus approuve en quelque sorte ce système, puisqu'il doute si ce qu'il appelle conséquent n'est pas l'épichérème des Grecs. Visellius ajoute encore la sentence. Je trouve même des auteurs qui veulent mettre au rang des figures ce qu'on appelle en grec διασκεθαὶ, ἀπαγορεύσεις, ἀπαγορευσεις, παραδιηγήσεις; mais comme ce sont plutôt des ornements que des figures, il se peut faire que quelques-unes m'aient échappé, ou que l'on en introduise de nouvelles dans la suite. Je les avouerai même volontiers pour telles, dès qu'elles seront de la nature de celles que j'ai remarquées. CH. III. Quant aux figures de mots, elles ont toujours varié, et suivent le temps et l'usage: aussi, en comparant le vieux langage à celui d'aujourd'hui, on trouvera que presque toutes nos locutions actuelles sont figurées : par exemple, nous disons huic rei invidere, tandis que tous les anciens, et particulièrement Cicéron, disaient hanc rem ; incumbere illi, au lieu de in illum; plenum vivo, au lieu de vini; huic, au lieu de hunc adulari, etc. : trop heureux si le mal ne prend pas la place du bien! Quoi qu'il en soit, il y a deux genres de figures de mots : les unes sont proprement des manières de parler, les autres consistent principalement dans la composition; et quoique les unes et les autres conviennent également à l'art oratoire, on peut néanmoins appeler les premières des figures de grammaire, et les secondes des figures de rhétorique. Les premières naissent des mêmes sources que les vices d'oraison; car toute figure serait un vice, si elle échappait par mégarde et sans dessein. Mais d'ordinaire l'autorité, le temps, l'usage, souvent même quelque raison particulière, la justifie. C'est pourquoi, bien que ces locutions s'écartent du langage simple et direct, elles deviennent des beautés, si elles s'appuient sur l'un de ces motifs. Elles sont de plus très-utiles, en ce qu'elles préviennent l'ennui qui naît de l'uniformité, et relèvent le style, qui autrement n'aurait rien que de vulgaire et de commun. Employées avec sobriété et à propos; elles servent d'assaisonnement au style, qu'elles rendent plus agréable; mais aussi, prodiguées outre mesure, elles perdent jusqu'à la grâce de la variété. Cependant, parmi ces figures, il y en a qui sont tellement usuelles qu'à peine gardent-elles le nom de figures : aussi, quelque multipliées qu'elles soient, l'oreille n'en est pas frappée, à cause de l'habitude. Pour celles qui sont moins connues, moins usitées, et par conséquent plus nobles, comme elles réveillent l'attention par leur nouveauté, aussi, trop multipliées, elles engendrent la satiété, outre que l'on voit manifestement qu'elles ne se sont pas présentées d'elles-mêmes à l'orateur, mais qu'il est allé les chercher bien loin, pour les attirer de force et les entasser dans son discours. Ces figures ont donc lieu, tantôt dans les noms, par rapport au genre, lorsque, par exemple, avec un substantif féminin on met un adjectif masculin, comme fait quelquefois Virgile : oculis capti talpce, timidi damœ. Cependant cette figure a sa raison en ce que les deux sexes ont la même dénomination, et que, par exemple, talpa ou dama s'entend aussi bien du mâle que de la femelle. Tantôt dans les verbes, lorsque la forme passive est substituée à la forme active, comme dans fabricatus est gladium, et inimicum punitus est : ce qui n'a rien d'extraordinaire; car combien de verbes expriment d'une manière passive ce qui est actif, et réci-338 proquement, comme arbitror, suspicor, vapulo! Aussi emploie-t-on souvent les uns pour les autres, et même plusieurs ont-ils les deux formes avec la même signification, comme luxuriatur, luxuriat; fuctuatur, fuctuat; assentior, assentio. Tantôt aussi dans le nombre, soit lorsqu'à un singulier on joint un pluriel, comme ici : gladio pugnacissima gens Romani (gens, nation, étant un mot collectif) ; soit, au contraire, lorsqu'à un pluriel on joint un singulier, comme dans ce passage de Virgile
Qui non risere
parentes, c'est-à-dire parmi ceux qui n'ont pas souri à leurs parents, n'est pas celui qu'un dieu ou une déesse, etc. Tantôt enfin en se servant d'un infinitif comme d'un nom; ainsi nous lisons dans la satire de Perse.
. . .
Et nostrum istud vivere triste où par vivere il faut entendre vita. On met encore l'infinitif pour le participe : . . . . . Magnum dat ferre talentum : ferre au lieu de ferendum; ou le participe pour l'infinitif, volo datum. Quelquefois aussi on ne saurait dire à quel défaut ressemble une figure, comme dans cet exemple : Virtus est vitium fugere, fuir le vice est vertu; car, ou ce sont les parties de l'oraison qui sont changées, fugere au lieu de fuga; ou ce sont les cas, virtus au lieu de virtutis. Il y a néanmoins quelque chose de plus hardi encore : c'est lorsqu'on emploie deux figures à la fois, comme ici: Sthenelus sciens pugnae, au lieu de scitus Sthenelus pugnandi; on met aussi un temps pour un autre : Timarchides negat esse ei periculum a securi.... Ici le présent est substitué au futur. Il en est de même du mode : Hoc Ithacus velit : le subjonctif est mis ici pour l'indicatif. En un mot, il y a autant de genres de figures qu'il y a de genres de solécismes. Celle dont je viens de parler est appelée par les Grecs ἑτέρωσις, et a beaucoup d'affinité avec celle qu'ils nomment ἐξαλλαγὴ, dont voici un exemple tiré de Salluste : Neque ea res falsum me habuit. Le même auteur a dit duci probare. Dans ces figures, outre la nouveauté, c'est la brièveté qu'on recherche ordinairement; à tel point qu'on n'a pas craint de dire non poeniturum, pour non acturum pοenitentiam; visuros, pour ad videndum missos. Ces locutions, qui étaient des figures sous la plume de l'écrivain qui s'en est servi le premier, doivent-elles aujourd'hui garder le même nom? C'est ce qui peut faire question; car elles ont passé dans l'usage commun. L'usage devient une autorité suffisante pour les introduire dans le langage ordinaire, comme rebus agentibus, que Pollion blâme dans Labienus, et contumeliam fecit, que Cicéron, comme on sait, condamne; car on disait alors affici contumelia. Ces figures passent encore à la faveur de l'antiquité, pour laquelle Virgile était singulièrement passionné.
VEL QUUM
se pavidum contra mea jurgia jactat Ce n'est que dans les anciens tragiques et comiques qu'on trouve ces façons de parler; c'est de là qu'est venu notre enimvero, qui est resté en 339 usage. Je trouve quelque chose de plus hardi dans le même poète : NAM QUIS te juvenum confidentissime. . . . . car quis devrait être le commencement du vers; et ces vers du septième livre de l'Énéide :
TAM MAGIS illa tremens, et tristibus
effera flammis, ne sont qu'une inversion de ces mots en prose Quam magis aerumna urget, tain magis ad malefaciendum viget. Les anciens sont pleins de ces locutions. Témoin le quid IGITUR faciam de Térence, qui commence (Eunuque; Allusit TANDEM leno; et ce vers de Catulle, dans un épithalame: . . Dum innupta manet, DUM cara suis est, où le premier dum signifie pendant que, et le second jusque-là. Salluste a emprunté aux Grecs plusieurs tournures, comme celle-ci : Vulgus amat fieri. Horace surtout aimait les hellénismes: Nec ciceris, nec longaa invidit avenae. Virgile également: Tyrrhenum navigat aequor. On en trouve des exemples même dans les actes publics, comme saucius pectus. Un mot ajouté ou supprimé suffit aussi pour faire une figure. Ajouté, il peut paraître superflu, mais il n'est pas sans grâce : Nam neque Parnassi vobis juga, nam neque Pindi. A la rigueur, on pouvait se passer du second nam. Il en est de même de ce vers d'Horace :
.......... Fabriciumque, Les suppressions que l'on fait dans le tissu de l'oraison sont tantôt vice, tantôt figure, comme Accede ad ignem : jans calesces plus satis, c'est-à-dire plus quam satis est. Ici il n'y a qu'un seul mot d'omis; mais il y a un second genre de retranchement, auquel on ne peut suppléer qu'à l'aide de plusieurs mots. On se sert communément aussi du comparatif pour le positif, comme si quelqu'un disait de lui-même, esse infrmiorem, pour infirmum. On oppose encore deux comparatifs l'un à l'autre: Si te, Catilina, comprehendi, si interfici jussero, credo, erit verendum mihi, ne non hoc potius omnes boni SERIUS a me, quam quisquam CRUDELIUS factum esse dicat. Voici quelques autres figures qui, à la vérité, n'ont aucune affinité avec le solécisme, mais qui pourtant consistent dans l'interversion du nombre, et qu'à cause de cela on range ordinairement parmi les tropes : quand, par exemple, on se sert du pluriel en ne parlant que d'une personne, et réciproquement:
Sed nos immensum
spatiis
confecimus aequor Dans l'exemple suivant l'espèce est différente, mais le genre est commun :
Neve tibi
ad solem vergant
vineta cadentem Car ces préceptes que Virgile donne dans ses Géorgiques sont généraux. Tantôt nous parlons de nous-mêmes, comme si nous parlions d'un tiers : Servius dit cela, Cicéron le nie; tantôt nous parlons en notre propre nom, au lieu de faire parler un tiers, et nous faisons parler une personne au lieu d'une autre. Nous en avons des exemples dans l'oraison de Cicéron pour Cécina ; 340 car cet orateur, s'adressant à Pison, avocat de la partie adverse, s'exprime ainsi : Vous avez avancé que vous m'aviez remis en possession, et moi je nie que j'aie été remis en possession selon les termes de l'édit du préteur. Car, dans la vérité, c'est Ebutius (l'adversaire de Cécina ) qui avait dit : Je vous ai remis en possession; et c'est Cécina qui avait répliqué : Je nie, etc. Observons de plus qu'il y a encore une figure grammaticale dans le verbe dixti, où l'on a retranché une syllabe. On peut comprendre aussi dans le même genre l'interposition, παρένθεσιν, laquelle consiste dans une intercalation : Ego quum te (mecum enim sœpissime loquitur) patriae reddidissem. On y ajoute l'hyperbate, qu'on ne veut pas ranger parmi les tropes; secondement, une autre figure qui tient de celle qu'on appelle apostrophe, et qui ne change que la forme de l'expression, comme dans ce passage où, après avoir nommé les Décius, les Marius, les Camille, les Scipions, Virgile dit : Et toi, divin César, qui les effaces tous. Ce qu'il fait d'une manière plus vive encore, lorsqu'il dit, en parlant de Polydore :
Fas omne
abrumpit, Polydorum obtruncat, et auro Ceux qui multiplient les dénominations pour de si petites différences, ont appelé cette figure μετάβασις, qui peut se faire d'une autre manière Que dis-je? où suis-je? Virgile a réuni la parenthèse et l'apostrophe dans l'exemple suivant :
Haud procul inde citae Metium
in diversa
quadrigae Toutes ces figures et autres semblables, qui peuvent se faire par le moyen d'un mot, ou changé, ou ajouté, ou retranché, ou transposé, ont cela de propre qu'en faisant diversion à l'uniformité du discours, elles réveillent et raniment l'auditeur. Leur ressemblance avec les défauts qu'elles éludent leur donne même une certaine grâce. C'est ainsi qu'un peu d'acidité relève quelquefois le goût des aliments. Ces figures auront le même effet si elles ne sont pas prodiguées outre mesure, ou si, étant de même es-pèce, elles ne sont ni trop près les unes des autres, ni trop multipliées. La rareté, comme la variété, prévient la satiété. Les figures qui ont un effet plus marqué sont celles qui n'affectent pas seulement l'élocution, mais qui communiquent aux pensées mêmes et de la grâce et de la force. De ce nombre est, en premier lieu, celle qui a lieu par addition, et qui comprend plusieurs genres. Ainsi, on redouble un mot, tantôt pour amplifier : J'ai tué, oui j'ai tué, non un Sp. Mélius, etc.; où l'on voit que le premier j'ai tué indique seulement le fait, et que le second l'affirme; tantôt pour exprimer un sentiment de compassion : Ah Corydon, Corydon! quelquefois pour exténuer, par manière d'ironie. Ce redoublement a encore plus de force, lorsqu'il est entrecoupé de quelques mots : Bona, miserum me! (consumptis enim lacrymis tamen infixus animo haeret dolor) bona, in quam, etc. Pour presser, pour insister, nous répétons le même mot, tantôt au commencement d'une phrase : Nihilne te nocturnuin praesidium palatii, nihil urbis vigiliae, nihil, 341 etc., tantôt à la fin: Qui les a demandés? Appius; qui les a produits? Appius. Cependant ce dernier exemple appartient à un autre genre de figures, où la répétition a lieu et au commencement et à la fin, comme ici : Qui sont ceux qui ont si souvent rompu les traités? Les Carthaginois. Qui sont ceux qui ont fait une guerre inhumaine en Italie ? Les Carthaginois. Qui sont ceux qui ont ravagé ce pays ? Les Carthaginois. Qui sont ceux qui demandent qu'on les ménage ? Les Carthaginois. Dans les antithèses ou comparaisons, les premiers mots de chaque membre se répondent ordinairement les uns aux autres; et c'est ce qui m'a fait dire un peu plus haut que c'était plutôt une figure de mot que de pensée. Vous vous levez avant le jour pour répondre à des plaideurs; lui, pour arriver avec ses troupes au rendez-vous qu'il a marqué : vous êtes éveillé par le chant du coq; lui, par le son du clairon : vous savez préparer un plaidoyer; lui, ranger une armée en bataille : vous veille à la sûreté de vos clients; lui, à la sûreté de nos villes et de nos champs. Non content de cette beauté, Cicéron change le tour de la figure, et poursuit ainsi : Il sait nous mettre à couvert des incursions de l'ennemi; vous, notas défendre de l'inclémence des saisons : il est expert dans l'art d'étendre nos frontières; vous, dans l'art de fixer les imites d'un champ. Tantôt c'est le milieu qui répond au commencement, comme ici : TE nemus Anguitiae, vitrea TE Fucinus unda; tantôt c'est la fin qui répond au milieu : Haec navis onusta PRAEDA Siciliensi, quum ipsaquoque esset ex PRAEDA. Point de doute qu'on ne puisse aussi répéter les mots qui sont au milieu. Quelquefois, c'est la fin qui répond au commencement : MULTI et graves dolores inventi parentibus, et propinquis MULTI. Mais à la répétition se joint aussi une espèce de division, lorsqu'après avoir fait mention de deux personnes ou de deux choses, on revient sur- le-champ à chacune d'elles.
Ipliitus et Pelias mecum, quorum Iphitus
aevo C'est ce que les Grecs nomment ἀπάνοδος, et nous regressio; soit que les mots qu'on répète aient le même sens, soit qu'ils en aient un différent: Principum dignitas erat pane par, non par fortasse eorum, qui sequebantur. Dans cette répétition, on change quelquefois les cas et les genres. Magnus est labor dicendi, magna res est. Rutilius en fournit un exemple plus étendu; mais je me contenterai d'indiquer ici le commencement de chaque partie de la période :Pater hic tuus? Patrem hunc appellas? patri tu filius es? Par le changement de cas, on obtient quelquefois la figure qu'on nomme polyptote. Elle peut se faire aussi de plusieurs autres manières, comme dans l'oraison pour Cluentius : Quod autem tempus veneni dandi ? Illo die? In illa frequentia? Per quem porro datum? Unde sumptum? Qum porro interceptio poculi? Cur non de integro autem datum? Cécilius appelle métabole tous ces changements réunis, dont voici un exemple tiré de l'oraison pour Cluentius : Illum tabulas publicas. Larini censorial corrupisse, decuriones universi judicaverunt : cum illo 342 nemo rationem, nemo rem ullam contrahebat, : nemo ilium ex tam multis cognatis et affinibus tutorem unquam liberis suis scripsit, et tout ce qui suit. Les différents objets sont ici comme réunis; ils sont séparés dans l'exemple suivant, ce que Cicéron, ce me semble, appelle dissipata :
Hic segetes, illic veniunt felicius uvae, et la suite. Voici encore un exemple de Cicéron, où l'on peut remarquer un mélange de figures fort agréable, et où, après un long intervalle, le dernier mot correspond au premier, et le milieu au commencement ainsi qu'à la fin. Votre ouvrage éclate ici, non le mien; ouvrage que l'on ne peut assez louer : mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. On appelle πλοκὴ cette répétition multipliée, et qui est, comme je l'ai dit, un mélange de plusieurs figures. En voici un exemple dans une lettre à Brutus : Ego quum in gratiam redierim eum Appio Claudio, et redierim per Cn. Pompeium, et ego ergo quum redierim. Elle a lieu aussi lorsque les mots répétés sont à des temps et à des cas différents, comme dans Perse :
.. . Usque adeone Et dans Cicéron : Neque enim poterat indicio et his damnatis, qui indicabantur. Il peut même arriver que le sens total qui commençait la phrase se trouve répété à la fois : Venit ex Asia, hoc ipsum quam bonum? Tribunus plebis venit ex Asia. Dans la même période, le dernier mot correspond au premier; ce qui n'empêche pas d'ajouter encore : Verumtamen venit. Les mots peuvent aussi se répéter dans le même ordre : Quid Cleomenes facere potuit? Non enim possum quemquam insimulare falso; quid, inquam, Cleomenes magnopere facere potuit? Souvent le même mot qui a fini le sens est employé à commencer le sens qui suit, et cela est surtout ordinaire en poésie :
Pierides, vos haec facietis
maxima
GALLO, Mais on en trouve aussi des exemples dans les orateurs : Et cependant il vit! bien plus, il a l'audace de venir au sénat. Quelquefois, ainsi que je l'ai déjà dit à l'occasion de la répétition des mêmes mots, les différentes parties d'une phrase, ou commencent par des mots différents, mais qui ont la même consonnance : DEDIDERIM periculis omnibus, OBTULERIM insidiis, OBJECERIM invidiae; ou finissent de même, comme ce qui suit : Vos enim STATUISTIS, vos sententiam DIXISTIS, vos JUDICASTIS. C'est ce que les uns appellent synonymie, et les autres, disjonction, avec quelque raison, quoique ces mots soient bien différents, puisque cette figure consiste à séparer des mots qui signifient la même chose. Quelquefois on en joint trois ou quatre qui signifient la même chose : Exécutez votre dessein, sortez enfin de la ville; les portes vous sont ouvertes, partez. Et dans un autre endroit : Abiit, excessit, erupit, evasit. Cécilius voit ici un pléonasme, comme dans cet exemple: J'ai vu moi-même, de mes yeux vu; car, dit-il, le mot j'ai vu renferme tous les autres. Il est vrai qu'un mot superflu est vicieux, ainsi que je 343 l'ai déjà dit; mais lorsqu'il rend la pensée plus vive, il devient une beauté, comme ici : J'ai vu moi-même, de mes yeux vu. Chaque parole renferme un sentiment. Je ne vois donc pas pourquoi Cécilius traite cela de pléonasme ; car tout redoublement, toute répétition, enfin toute addition, serait de même un pléonasme. On n'accumule pas seulement les mots, mais encore les pensées, qui tantôt reviennent à la même, comme dans cet exemple : Le trouble de son âme, l'aveuglement du crime, les torches ardentes des Furies, voilà ce qui l'a entraîné dans l'abîme; et tantôt sont différentes : C'est cette femme, c'est la farouche cruauté du tyran, c'est l'amour de son père, la colère, la témérité, la démence, qui l'ont conduit là; et dans Ovide : Mais la puissance redoutable des Néréides ; mais Ammon, dont le front est armé de cornes; mais cette bête féroce qui sortait du sein de la mer pour se nourrir de mes entrailles, etc. Quelques-uns appellent cela une complication de figures. Pour moi, je ne vois là qu'une seule figure, c'est-à-dire un amas de mots, dont les uns signifient presque la même chose, les autres des choses différentes, ce qu'on appelle diallage, comme dans ce passage de Cicéron : Je demande à mes ennemis si ce n'est pas par moi que ces complots ont été suivis, découverts, manifestés, étouffés, détruits, anéantis. En effet, ces mots suivis, découverts, manifestés, renferment des idées différentes; et ceux-ci, étouffés, détruits, anéantis, sont synonymes, mais n'ont rien de commun avec les premiers. Cependant on peut dire que ce dernier exemple, et l'un de ceux que j'ai cités avant, contiennent encore une figure, qui consiste à retrancher toutes les liai–sons, et qui par là devient fort pressante; car on imprime chaque chose dans l'esprit de l'auditeur, et l'objet se multiplie en quelque sorte. Aussi use-t-on de cette figure non-seulement dans les mots pris un à un, mais aussi dans les membres périodiques qui ont chacun leur sens particulier. C'est ce qu'a fait Cicéron dans son oraison contre Métellus : A mesure que l'on m'indiquait ses complices, je les faisais venir, on les arrêtait, on, les amenait au sénat, etc. : ce qui rentre dans ce genre de figure, appelé brachylogie. Par une figure toute contraire, qu'on appelle polysyndète, l'autre se nomme asyndète, on affecte de répéter la conjonction :
... Tectumque, laremque, Dans l'exemple suivant, la conjonction varie :
Arma virumque... On varie aussi les adverbes et les pronoms :
Hic
ilium vidi juvenem.... Mais ces deux figures (l'asyndète et la polysyndète) ne sont autre chose qu'un amas de mots ou de phrases qu'on entasse; avec cette seule différence que quelquefois on y ajoute des liaisons ou particules conjonctives, et quelquefois on les retranche. Cependant ceux qui ont écrit sur la rhétorique ont donné à toutes ces figures des noms particuliers, qui sont différents suivant le génie des auteurs qui les ont inventés. Ces deux figures, quoique opposées, partent du même principe et concourent à la même fin, en ce qu'elles rendent le style plus pressant, plus vif, et sont comme autant de mouvements qui naissent par intervalle de la violence de la passion avec laquelle on parle. La gradation, κλῖμαξ, est encore une figure qui tient de la répétition, puisqu'en 344 effet on y répète plusieurs choses, et que l'on ne passe à ce qui suit qu'en reprenant une partie de ce qui a précédé; mais l'art s'y fait un peu trop sentir. C'est pourquoi il n'en faut user que rarement. En voici un exemple très-connu , tiré du grec : Je n'ai point dit cela, je ne l'ai pas même écrit : non-seulement je ne l'ai point écrit, mais je ne suis pas même allé en ambassade; et, loin d'aller en ambassade, je n'ai rien persuadé aux Thébains. Donnons cependant un exemple latin de la gradation : L'activité de Scipion lui donna le mérite; le mérite lui donna la gloire, et la gloire, des émules. Et dans Calvus : La loi contre les concussions n'est pas plus morte que celle de lèse-majesté; celle de lèse-majesté, que la loi Plautia; la loi Plautia, que la loi contre les brigues; la loi contre les brigues, que toutes les autres lois. Il y en a des exemples dans les poètes, comme dans Homère, lorsqu'il fait remonter le sceptre d'Agamemnon jusqu'à Jupiter même; et dans un de nos poètes tragiques : Tantale, dit-on, descend de Jupiter; Pélops, de Tantale; et Pélops a donné la naissance à Atrée, de qui je suis descendu. Les autres figures naissent, au contraire, du retranchement d'un mot, et tirent particulièrement leur grâce de la brièveté et de la nouveauté. La synecdoche est une des principales : j'avais commencé d'en parler dans le chapitre des tropes; mais j'ai mieux aimé la ranger parmi les figures. Or, ce n'est autre chose qu'un mot supprimé, qui se fait aisément entendre par la suite du discours, comme ces mots de Célius contre Antoine : Stupere gaudio Graecus; car aussitôt on comprend que coepi est sous-entendu. Autre exemple tiré d'une lettre de Cicéron à Brutus : Sermo nullus scilicet, nisi de te : quid enim potius? Tum Flavius : Cras, inquit, tabellarii, et ego ibidem lias inter coenam exaravi. A quoi, ce me semble, il faut rapporter certains tours que l'on prend pour ne pas blesser la pudeur, et où l'on dérobe des mots qu'elle ne souffre pas : tel est ce passage de Virgile :
Novimus et qui te, transversa tuentibus hircis,
C'est ce que quelques-uns nomment aposiopèse, ou réticence; mais, selon moi, ils se trompent; car, dans la réticence, on ne voit pas tout d'un coup ce qui manque, et on ne le peut même suppléer qu'à l'aide de plusieurs mots; au lieu qu'ici il n'y a qu'un mot de supprimé, qui s'aperçoit incontinent. Si on peut appeler cela une aposiopèse, on donnera donc ce nom à toute phrase où il y aura quelque chose de retranché. Pour moi, je n'appelle pas même toujours ainsi tout ce qui laisse quelque chose à deviner, comme ce qu'on lit dans les lettres de Cicéron : Data Lupercalibus, quo die Antonins Coesari... il est évident qu'il faut sous-entendre diadema imposuit. La seconde figure du même ordre, et dont j'ai déjà parlé, consiste à retrancher les conjonctions. La troisième est celle qu'on appelle συνεξευγμένον, parce que, en effet, un même mot lie ensemble plusieurs pensées, dont chacune exigerait ce mot, si elle était isolée. Cela peut se faire, ou en mettant le verbe devant : par exemple, la pudeur a été obligée de céder à l'effronterie, la modestie à l'audace, la raison à la fureur; ou en le mettant à la fin de la phrase dont il est comme la conclusion, : Neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor unquam a turpitudine, aut metus a 345 periculo, aut ratio a furore revocaverit. Quelquefois enfin le verbe peut être placé au milieu, et suffire également à ce qui précède et à ce qui suit. C'est par une extension de la même figure que nous disons filios en parlant de nos enfants, de quelque sexe qu'ils soient. On met aussi les singuliers pour les pluriels, et réciproquement. Encore cette façon de parler est-elle si commune, que je ne sais si elle peut être regardée comme une figure. Mais c'en est une que de donner à un même verbe deux régimes différents, comme ici: Aussitôt je leur ordonne de prendre les armes, et qu'ils aient à combattre cette nouvelle espèce d'ennemis. Car, quoique le mot bellum, qui est dans la seconde partie, soit accompagné d'un participe, le même mot edico régit les deux parties. Cette sorte de jonction, qui n'a point pour but de supprimer quelque mot, tout en embrassant deux choses différentes, se nomme συνοικείωσις : L'avare manque autant de ce qu'il a que de ce qu'il n'a pas. On veut qu'elle soit différente de la distinction, nommée παραδιαστολὴ, et qui consiste à distinguer des choses qui ont de la ressemblance entre elles, comme lorsqu'on donne le nom de prudent à un homme astucieux, de vaillant à un téméraire, d'économe à un avare : ce qui me paraît néanmoins dépendre uniquement de la définition, et n'avoir par conséquent rien de figuré. La figure qui lui est opposée consiste à passer, à raison de la proximité, à des choses différentes, comme semblables : par exemple, Je tâche d'être bref, et je deviens obscur, et ce qui suit. Enfin, il y a une troisième espèce de figures, qui, par la ressemblance, la parité ou l'opposition des mots, frappe l'oreille de l'auditeur et attire son attention. Telle est la paronomase, en latin annominatio, laquelle a lieu de plusieurs manières. Car tantôt le mot répété se met seulement à un autre cas, comme dans ce passage du plaidoyer de Domitius Afer pour Cloantilla : Mulier omnium rerum imperita, in omnibus rebus infelix; tantôt on le rend plus significatif par l'adjonction d'un autre mot : Quando homo, hostis homo. Je me suis servi ailleurs de ces exemples; mais, du reste, la répétition est facile, quand elle ne porte que sur un seul mot. Le contraire de la paronomase est d'opposer un mot à lui- même, comme pour l'arguer de faux : par exemple, quae lex privatis hominibus esse lex non videbatur. Une figure qui a beaucoup d'affinité avec la précédente, c'est l'antanaclase. Proculéius reprochant à son fils d'attendre sa mort : Je ne l'attends nullement, lui dit son fils; Et moi, dit le père, je veux que tu l'attendes. Tantôt les mots sont différents; mais ils ont une certaine ressemblance que l'esprit accepte volontiers, si, par exemple, on employait supplicium au lieu de supplicatio. Quelquefois on se sert des mêmes mots, mais dans un sens différent; quelquefois leur signification change avec la quantité de quelqu'une des syllabes qui le composent; mais tout cela est froid, même en plaisantant, et j'admire qu'on ait réduit ces futilités en préceptes. Aussi, j'en donne des exemples plutôt pour engager à les fuir qu'à les imiter : Amari jucundum est, si curetur, ne quid insit amari; — Avium dulcedo ad avium ducit; et dans Ovide : Cur ego non dicam, Furia, te furiam ? Cornificius appelle cela traduction, c'est-à-dire 346 passage d'un sens à un autre. Cette façon de parler a quelque grâce, quand elle consiste à distinguer la propriété d'une chose : Hanc reipublicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuurn comprimi posse; ou dans le changement de la préposition qui compose le mot, lequel devient brusquement contraire à lui-même: Non emissus ex urbe, sed immissus in urbem esse videatur. Mais quand la figure se trouve jointe à un beau sens, alors le sens et la figure s'embellissent mutuellement : Emit morte immortalitatem. Voici qui n'est que frivole : Non Pisonurn, sed pistorum. — Ex oratore orator. Mais voici qui est détestable : Ne patres conscripti videantur circumscripti; — Raro evenit, sed vehementer venit. Il peut arriver pourtant qu'une pensée forte et vive reçoive quelque grâce du contraste de deux mots, sans s'altérer par cette opposition. Pourquoi la modestie m'empêcherait-elle de citer un exemple domestique? Un certain homme s'était vanté de mourir dans son ambassade plutôt que de ne pas terminer l'affaire dont il était chargé; et cependant le mauvais succès de sa négociation fit qu'il revint au bout de quelques jours. Mon père lui dit : Non exigo, ut immoriaris legationi, immorare. Ce peu de mots, soutenu par le sens, fut trouvé d'autant plus agréable qu'il n'était point recherché, outre que son adversaire lui-même lui avait fourni une des deux expressions dont il se servait. Les anciens rhéteurs étaient fort amoureux de ces mots, pareils quant à la forme, et différents quant au sens. Gorgias les prodiguait outre mesure; Isocrate en fut aussi trop épris dans sa jeunesse. Il paraît même que Cicéron y prenait plaisir. Mais pour lui, outre qu'il ne s'est pas abandonné aveuglément à un goût qui, après tout, ne pèche que par l'excès, il a su relever ces faibles beautés et en remplir le vide par la solidité des pensées. En effet, ce qui est de soi une froide et vaine affectation devient comme naturel, sitôt que la force de la pensée soutient l'inconsistance du mot. La ressemblance peut être de quatre espèces. Premièrement, les mots sont semblables ou presque semblables:... Puppesque tuae, pubesque tuorum. — Sic in hac calamitosa fama, quasi in aliqua perniciosissima flamma. — Non enim tam spes laudanda, quam res est; ou ils se ressemblent par la désinence : Non verbis, sed armis : ce qui donne de la grâce aux pensées, lorsqu'elles sont belles d'ailleurs, comme celle-ci : Quantum possis, in eo semper experire, ut prosis. C'est ce que plusieurs nomment πάρισον, quoique Cléostelée donne ce nom à la réunion de plusieurs membres à peu près égaux. Secondement, ce sont deux ou plusieurs membres dont le sens est différent, mais qui ont la même terminaison, ὁμοιοτέλευτον, c'est-à-dire fin semblable de deux ou plusieurs pensées : Non modo ad salutem ejus exstinguendam, sed etiam gloriam per tales viros infringendam. On peut y joindre, à la différence de terminaison près, ce qu'on appelle τρίκωλα, comme : Vicit pudorem libido, timorem audacia, rationem amentia : ce qui peut aller jusqu'à quatre incises et même davantage. Quelquefois chaque membre est d'un seul mot : Hecuba, hoc dolet, pudet, piget; et : Abiit, excessit, erupit, evasit. Troisièmement, c'est une répétition des mêmes cas : ce qu'on appelle ὁμοιόπτωτον, ressemblance qui est bien différente 347 de celle qu'on nomme ὁμοιοτέλευτον. Dans l'une, il n'y a de semblable que les cas; dans l'autre, que les désinences : celle-ci ne peut se trouver qu'à la fin de la période ; celle-là peut se trouver au commencement, au milieu et à la fin, et correspondre à un autre mot, en quelque lieu qu'il soit placé, pourvu qu'il soit au même cas. II n'est pas même nécessaire qu'il y ait le même nombre de syllabes, comme dans cet exemple de Domitius Afer : Amisso nuper infelicis aulae, si non praesidio inter pericula, tamen solatio inter adversa. Dans ce genre de figures, les plus parfaites sont celles où le commencement correspond à la fin, comme ici : praesidio, solatio; et où les mots, presque semblables, sont aux mêmes cas et ont la même désinence. Quatrièmement enfin, c'est une période dont les membres sont parfaitement égaux : ce qu'on appelle ἰσόκωλον : Si, quantum in agio locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in judiciis impudentia valeret. Voilà deux membres égaux avec une répétition de cas semblables. Autre exemple : Non minus nunc in causa cederet Aulus Caeeina Sexti Aebutii impudentiae, quam tum in vi facienda cessit audaciae : membres égaux, mêmes cas, mêmes terminaisons. Cette figure plaît aussi, lorsqu'on répète un mot en changeant les temps ou les cas : Non minus cederet, quam cessit. Voici encore un exemple où ce qu'on appelle ὁμοιοτέλευτον se βtrouve joint à la paronomase : Neminem alteri posse dare in matrimonium, nisi penes quem sit patrimonium. Il y a aussi plusieurs sortes d'antithèses (en latin contrapositum, contentio). Tantôt on oppose un mot à un autre, comme dans l'exemple que j'ai déjà cité : Vicit pudorem libido, timorem audacia; ou deux mots à deux autres mots : non nostri ingenii, vestri auxilii est. Tantôt c'est me pensée qu'on oppose à une autre : Dominetur in concionibus, jaceat in judiciis. On peut y oindre l'espèce d'antithèse appelée distinction: Odit populus romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit ; et celle qui consiste à placer à la fin un mot qui a la même désinence, mais qui renferme un sens différent : Quod in tempore mali fuit, nihil obsit quin, quod in causa boni fuit, prosit. Quelquefois le terme opposé ne vient pas immédiatement après son corrélatif, comme ici : Ce n'est pas une loi écrite, mais une loi née avec nous; mais, comme dit Cicéron, l'antithèse est multiple, et divisée en deux parties collectives, comme dans la suite de ce que je viens de citer : Quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus. Enfin, l'opposition n'est pas toujours présentée sous la forme de l'antithèse, comme on en peut juger par ces paroles de Rutilius : Nous sommes les premiers aqui les dieux immortels aient donné les biens de la terre, et ce que nous avions reçu seuls, nous en avons fait part au monde entier. L'antithèse a lieu encore au moyen de cette figure qu'on appelle antimétabole, et qui consiste dans une répétition de mots, que l'on met tour à tour au même cas ou au même temps: Je ne vis pas pour manger, mais je mange pour vivre. Quelquefois cette conversion se fait de telle sorte que, bien qu'il y ait changement de cas, la désinence reste la même, comme dans cette phrase de Cicéron : Ut et sine invidia culpa plectatur, et sine culpa invidia ponatur. Elle se 348 termine aussi fort bien par une répétition du même mot, comme dans ce passage du même orateur sur Roscius: C'est un si grand acteur, qu'il semble qu'il n'appartienne qu'à lui de monter sur un théâtre; c'est un si honnête homme, qu'il semble le dernier qui dût y monter. L'opposition des noms n'est pas non plus sans grâce. Si Antoine est consul, Brutus est l'ennemi de la patrie; si Brutus est le sauveur de la république, Antoine en est l'ennemi. Je me suis étendu sur les figures plus qu'il n'était nécessaire ; et cependant il y a des rhéteurs qui regardent comme des figures ces façons de parler : Ce que je dis est incroyable, et cependant vrai (ils appellent cela ἀνυθποφορὰ ; quelqu'un a souffert cela une fois, moi deux fois et trois fois (c'est ce qu'ils nomment διέξοδος); je me suis éloigné de mon sujet, mais j'y reviens (c'est ce qu'ils appellent ἄφοδος). Parmi les figures de mots, il en est quelques-unes qui diffèrent peu des figures de pensées, comme la dubitation, qui appartient à l'une ou à l'autre de ces deux classes de figures, suivant qu'elle tombe sur la chose ou sur le mot, comme : Dois-je nommer cela méchanceté ou folie ? Il en est de même de la correction, qui peut, comme la dubitation, tomber sur une chose ou sur un mot. Quelques-uns ont cru que cette double nature se rencontrait même dans la prosopopée, et que la figure tombait sur les mots dans cette proposition : La cupidité est la mère de la cruauté; dans cette apostrophe de Salluste à Cicéron : O Romule Arpinas! et dans ce qu'on lit chez Ménandre, OEdipus Thriasius. Tout cela a été traité dans le plus grand détail par des rhéteurs, qui ne se sont pas contentés d'effleurer cette matière comme une simple partie de l'art, mais qui lui ont consacré des ouvrages spéciaux, tels que Cécilius, Denys d'Halicarnasse, Rutilius, Cornificius, Visellius, et beaucoup d'autres, sans compter les vivants, qui ne seront pas moins célèbres un jour. J'avoue, au reste, qu'on peut trouver un plus grand nombre de figures de mots, mais je n'accorde pas qu'on en puisse trouver qui vaillent mieux que celles qui sont enseignées par les grands écrivains; et, pour commencer par Cicéron, il en a rapporté beaucoup dans le troisième livre de son traité De Oratore, qu'il semble avoir condamnées lui-même en ne les mentionnant pas dans son Orateur, qu'il a écrit depuis. En effet, les unes sont plutôt des ligures de pensées que des figures de mots, comme celles qu'on nomme imminutio, improvisum, imago, sibi ipsi responsio, digressio, permissio, contrarium, qui est, je crois, ce qu'on appelle ἐναντιότης, sumpta ex adverso probatio. Les autres ne sont nullement des figures, comme ce qu'on nomme ordo, dinumeratio, circumscriptio; soit qu'on entende par ce dernier mot une sentence courte, soit qu'on entende la définition, que Cornilicius et Rutilius rangent parmi les figures de diction. Quant à la transposition élégante des mots, c'est•à-dire à l'hyperbate, que Cécilius regarde aussi comme une figure, je l'ai placée parmi les tropes. Pour la figure appelée mutatio, en admettant que ce soit ce que Rutilius nomme ἀλλοίωσις, son objet est de faire voir la différence des hommes, des choses, des actions : or, si elle a quelque étendue, ce n'est plus une figure; si elle est courte, elle revient à l'antithèse. Que si cette appellation signifie hypallage, j'en ai suffisamment parlé. Mais qu'est-ce que la figure ad propositum subjecta ratio? 349 Est-ce ce que Rutilius appelle αἰτιολογία? Du moins est-il permis de ne pas regarder comme une figure un raisonnement déduit de plusieurs propositions, bien que ce soit ce qu'il traite en premier lieu sous le nom de προσαπόδοσις. Il est certain que la prosapodose exige plusieurs propositions, puisqu'elle consiste, soit à réfuter immédiatement, l'une après l'autre, chaque proposition, comme dans ce passage d'Antoine : Je ne le crains pas comme accusateur, parce que je suis innocent ; je ne le redoute pas comme compétiteur, parce que je suis Antoine; je n'attends rien de lui comme consul, parce qu'il est Cicéron; soit à émettre deux ou trois propositions de suite, et à y répondre dans le même ordre, comme ce que dit Brutus au sujet de la dictature de Pompée : Il vaut mieux ne commander à personne, que d'obéir à quelqu'un. Dans la première condition, on peut vivre honorablement ; dans la seconde, la vie n'est supportable. en aucune manière. Souvent aussi on déduit plusieurs raisons d'une seule proposition, comme dans ces vers de Virgile :
Soit que les sels heureux d'une
cendre fertile
Je n'entends pas bien ce qu'il veut dire par relation : si c'est, ou l'hypallage, ou l'épanode, ou l'antimétabole, j'ai déjà parlé de toutes ces figures. Quoi qu'il en soit, Cicéron, dans son Orateur, ne revient ni sur ces dernières figures, ni sur les précédentes. Dans ce même traité, il ne met, parmi les figures de mots, que l'exclamation, qui, selon moi, est plutôt une figure de pensée, parce qu'elle est l'expression d'un sentiment ; et en cela je suis d'accord avec tous les autres rhéteurs. Cécilius ajoute à ces figures la périphrase, dont j'ai déjà parlé, et Cornificius l'interrogation, le raisonnement, la subjection, la transition, l'occultation, puis la sentence, le membre, l'article, l'interprétation, la conclusion; mais les premières sont des figures de pensées, et les dernières ne sont nullement des figures. J'en dis autant de tout ce que Rutilius ajoute à la nomenclature des autres rhéteurs, sous les dénominations suivantes : παρομολογοία, ἀναγκαῖον, ἠθοποιία, δικαιολογία, πρόληψις, χαρακτηρισμὸς, βραχυλογία, παρασιώπησις, παρρησία. Quant à ces auteurs qui ont poussé presque sans fin cette recherche de noms, et qui ont mis jusqu'aux arguments parmi les figures, je les passerai sous silence. Et même pour ce qui regarde les véritables figures, j'ajouterai, en peu de mots, qu'autant elles contribuent à orner le style quand elles sont placées à propos, autant elles sont froides quand on les prodigue outre mesure. On voit cependant des orateurs qui, sans se mettre en peine du fond des choses et de la solidité des pensées, s'imaginent avoir atteint la perfection de l'éloquence par l'accouplement monstrueux de mots vides de sens. Aussi entassent-ils figures sur figures, ne s'apercevant pas qu'il est aussi ridicule d'associer des mots sans substance que de chercher une forme sans corps. Je dirai plus : il faut être sobre, même du bien. En effet, les divers mouvements du visage, et surtout des yeux, ajoutent beaucoup à l'effet des paroles de l'orateur : cependant si tous ses traits, son front, ses yeux, 350 étaient dans une agitation perpétuelle, on se moquerait de lui. L'oraison a de même son attitude naturelle : sachons éviter et cette immobilité qui tient de la stupeur, et cette mobilité qui tient de la grimace. Mais sachons surtout observer les convenances que nous imposent le lieu, la personne, le temps; car la plupart des figures sont destinées à plaire. Or, dans un sujet où il s'agit d'exciter l'indignation, la haine, la pitié, qui pourrait supporter le langage d'un orateur qui mêlerait aux accents de la colère, aux gémissements et aux prières, l'afféterie des antithèses et tous les faux brillants d'un style artificiel ? car le soin qu'on donne aux mots rend la passion suspecte, et partout où l'art se montre, la vérité disparaît. CH. IV. De toutes les parties de l'art oratoire, la composition est peut- être celle que Cicéron a travaillée avec le plus de soin ; et je n'aurais pas osé la traiter après lui, si quelques-uns de ses contemporains, dans sa correspondance avec lui, n'eussent osé le critiquer sur cette matière, et si, depuis, plusieurs n'eussent écrit sur le même sujet. C'est pourquoi je m'en tiendrai la plupart du temps à ce qu'enseigne Cicéron ; et, dans ce qui est indubitable, je serai fort court. Peut-être m'arrivera-t-il quelquefois de n'être pas tout à fait du même avis; mais je proposerai le mien, sans prétendre y assujettir personne. Je sais qu'il y a des gens qui condamnent absolument le soin de la composition, prétendant qu'un langage inculte, et tel qu'il se présente, a quelque chose de plus naturel, et même de plus mâle. Si ces personnes ne reconnaissent pour naturel que ce qui est le produit brut de la nature, l'art oratoire est une pure inanité; car les premiers hommes ont parlé sans connaître les règles et les soins qu'il comporte. Ils n'ont su ni préparer les esprits par un exorde, ni instruire par une exposition, ni prouver par des arguments, ni émouvoir par les passions. Ce n'est donc pas seulement la composition qui leur a manqué, mais tout ce qui est de l'art. Si en ceci ils n'avaient rien à gagner à la culture, ils ont eu tort de quitter leurs cabanes pour des maisons, leurs peaux de bêtes pour des vêtements, leurs montagnes et leurs forêts pour des villes. Qu'on me cite un art qui soit né soudainement. Qu'y a-t-il au contraire que la parure n'embellisse? Pourquoi tailler la vigne et la fouir? pourquoi défricher les champs? car les ronces sont aussi des fruits naturels de la terre. Pourquoi apprivoiser les animaux ? ne naissent-ils pas indomptés? Disons plutôt que rien n'est plus naturel que ce que la nature permet de développer en elle sans la contrarier. Or, peut-on dire qu'un style où tout marche au hasard soit plus fort qu'un style où tout se lie et s'enchaîne harmonieusement? Car si, dans la poésie, l'emploi de petits pieds, semblables à ceux des vers sotadéens, énerve la pensée; si, de même, la prose perd sa force sous la plume de quelques écrivains prétentieux, il ne faut pas croire que ce soit l'effet de la composition. Au reste, comme un fleuve, entraîné par la pente d'un lit large et uni, est plus impétueux que s'il avait à lutter et à se briser sans cesse contre des rochers, de même un style qui, au moyen d'un certain enchaînement, coule dans toute sa plénitude, vaut mieux qu'un style heurté et continuellement interrompu. Pourquoi donc s'imaginer que la force et la beauté sont incompatibles, quand on voit au contraire que rien ne va fort loin sans 351 le secours de l'art, et que l'art est toujours accompagné de la beauté? Est-ce qu'un javelot habilement lancé ne fend pas l'air avec plus de grâce? Plus la main de l'archer est sûre, plus son attitude est belle. Enfin, au combat des armes et dans tous les exercices gymnastiques, celui-là sait le mieux se défendre ou attaquer, à qui l'art a appris à combiner ses mouvements et e observer certaines mesures. Je tiens donc, pour moi, que la composition est aux pensées ce que l'arc et la corde sont à la flèche. Aussi les doctes sont-ils persuadés qu'elle est d'une merveilleuse efficacité non-seulement pour plaire, mais encore pour émouvoir : d'abord, parce qu'il est impossible qu'une chose entre dans le cœur, lorsqu'elle n'a pu s'introduire dans l'oreille, qui en est comme le vestibule ; en second lieu, parce que le sentiment de l'harmonie nous est naturel. Autrement, comment pourrait-on expliquer l'effet que produisent sur nous les instruments de musique, qui ne rendent pourtant que des sons vagues et inarticulés? Ainsi, dans les combats sacrés, le mode n'est pas le même pour exciter les esprits et pour les calmer; pour faire entendre des accents belliqueux, ou pour accompagner la voix suppliante du gladiateur agenouillé; enfin, la trompette ne sonne pas la charge comme elle sonne la retraite. Les pythagoriciens avaient coutume, à leur réveil, de prendre la lyre pour s'animer aux travaux du jour; et, avant de se coucher, de calmer par le même moyen l'activité tumultueuse de leurs pensées. Que si l'harmonie de la musique est si puissante, combien plus celle de la parole? Si la convenance des mots importe à une pensée, la composition n'importe pas moins aux mots, soit dans le tissu de la phrase, soit à la fin d'une période; car quelquefois la pensée et l'expression n'ont rien que de commun et de médiocre, et s'est la composition seule qui les relève. Enfin, essayez de déranger et d'intervertir l'ordre des mots dans une phrase qui vous aura frappé par sa force, sa douceur ou son éclat, cette force, cette grâce, cette beauté disparaîtra. Cicéron, dans son Orateur, en a fait l'épreuve sur lui-même. Changez, dit-il, quelque chose à la période suivante : Neque me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Laelios multi venalitii mercatoresque superarunt; changez de même les périodes qui viennent après, et il en sera des membres de ces périodes comme de traits à demi rompus ou décochés de travers. Le même orateur a corrigé, au contraire, certains passages des Gracques, qui lui paraissaient durs et négligés : ce qui sied bien à Cicéron; mais, pour nous, contentons-nous de nous corriger nous-mêmes, en resserrant ce que nos ébauches peuvent avoir de lâche et de traînant. Car à quoi bon chercher des exemples étrangers, quand on peut recourir à sa propre expérience? Il me suffit donc de faire remarquer que plus la pensée et l'expression sont belles, plus le style déplaira si la composition est mauvaise, parce que l'éclat des expressions ne contribue alors qu'à faire ressortir la négligence de la composition. C'est pourquoi, si je n'hésite pas à reconnaître que la perfection de cette qualité du style a été un des derniers efforts de l'art, je crois en même temps que les anciens n'ont pas laissé de s'en occuper, à proportion des progrès de l'art ; et l'autorité de Cicéron ne me persuadera pas 352 que Lysias, Hérodote, Thucydide, l'aient regardée comme une chose indifférente. Peut- être cela tient-il à ce qu'ils n'ont pas écrit dans le même genre de littérature que Démosthène et Platon, qui eux-mêmes diffèrent entre eux. Lysias, en effet, dont le style ressemble à une trame fine et déliée, devait-il s'exposer à le corrompre par un nombre trop plein, et à perdre par là cette admirable simplicité qui le distingue? Il n'eût pas même atteint le but qu'il se proposait; car il écrivait pour autrui, et ne prononçait pas lui-même ses plaidoyers, qui par conséquent ne devaient point laisser paraître l'art; et ce déguisement même est un des secrets de la composition. Quant à Thucydide, comme le style de l'histoire doit être rapide et continu, ces repos dont la voix de l'orateur et l'esprit de l'auditeur ont également besoin, cet artifice d'élocution qu'exige la fin ou le commencement d'une période, tout cela ne convenait pas à son genre. Du reste, on rencontre dans ses harangues de ces désinences étudiées et de ces oppositions de mots dont j'ai parlé. Pour Hérodote, outre que son style me paraît fort coulant, le dialecte dont il s'est servi a par lui-même une certaine grâce, qui semble ne pouvoir venir que d'un rythme caché. Mais je parlerai bientôt de la diversité des genres; maintenant il est question des règles de la composition. Distinguons d'abord deux styles : l'un lié et fortement ourdi; l'autre délié, tel que celui de la conversation et de la correspondance épistolaire, à moins qu'on n'y traite des questions d'un ordre relevé, des questions de philosophie, de politique, ou autres d'un semblable intérêt. Je ne veux pas dire que le style délié n'ait aussi ses pieds et une mesure peut-être plus difficile à observer; car le style épistolaire et le style de !a conversation ne souffrent pas de trop fréquents hiatus, ni le défaut absolu de quantité. Je veux dire seulement que, à proprement parler, ce style ne coule pas, que les mots n'y sont point enchaînés et ne s'entraînent pas mutuellement, comme dans un discours ; en un mot, qu'il est plutôt relâché que dépourvu de liaison. La même simplicité convient aussi quelquefois aux petites causes; les nombres n'en sont point bannis, mais ils sont différents, et ils agissent sans se montrer. Pour ce qui est du style lié, il a trois formes, qui se nomment incises, κόμματα; membres, κῶλα; périodes, περίοδοι, en latin ambitus, circumductum, continuatio, conclusio. Or, dans toute composition trois choses sont nécessaires, l'ordre, la liaison, le nombre. Parlons donc d'abord de l'ordre. II faut le considérer par rapport aux mots pris isolément, ἀσύνδετα, et par rapport aux mots joints ensemble. Dans le premier cas, il faut éviter la dégradation, et ne pas dire, par exemple, un sacrilège, un voleur, ou bien un brigand, un audacieux; car les pensées doivent toujours aller en croissant et en s'élevant. C'est ce que Cicéron observe admirablement bien, lorsqu'il dit : Vous, avec cet énorme gosier, avec ces larges poumons, avec cette encolure de gladiateur. Ces mots, en effet, enchérissent. les uns sur les autres; au lieu que, s'il eût commencé par dire, avec cette encolure de gladiateur, il eût eu mauvaise grâce à parler ensuite de son gosier et de ses poumons. L'ordre naturel veut aussi qu'on dise, les hommes et les femmes, le jour et la nuit, l'orient et l'occident, plutôt que, les femmes et les hommes, etc. Il y a certains mots qu'on rend superflus en 353 les déplaçant. Par exemple, on dit fort bien fratres gemini; mais si l'on commence par gemini, il est inutile d'ajouter fratres. Cependant je n'approuve pas le scrupule de ceux qui veulent que le nom marche toujours avant le verbe, le verbe avant l'adverbe, le nom avant l'adjectif et le pronom; car souvent le contraire a beaucoup de grâce. C'est un pur scrupule aussi que de s'attacher rigoureusement à l'ordre des temps, non qu'ordinairement ce ne soit le mieux; mais quelquefois ce qui est antérieur est plus important, et doit par conséquent être placé après ce qui est postérieur, mais moins important. Clore le sens par le verbe, est ce qu'il y a de mieux, si la composition le permet; car toute la force du discours est dans les verbes ; mais si l'harmonie en souffre, cette considération doit l'emporter sur l'autre, comme on peut le voir dans les plus grands orateurs des deux langues. Car il y a certainement hyperbate, toutes les fois que le verbe ne termine pas la phrase; mais l'hyperbate est un trope ou une figure, et partant une beauté. Après tout, les mots ne sont point assujettis à la mesure des pieds, comme dans les vers. Aussi rien n'empêche qu'on ne les transporte d'un lieu en un autre, où ils cadrent mieux ; de même que, dans un édifice, les pierres les plus irrégulières et les plus grosses ne laissent pas de trouver leur place. Cependant le style le plus heureux est celui où l'ordre, la liaison et le nombre se trouvent réunis. Mais il y a quelquefois des transpositions qui sont d'une longueur excessive, comme je l'ai dit dans les livres précédents, et dont la composition est même vicieuse, comme dans ces phrases de Mécène, qui trahissent la recherche et l'afféterie : Sole et aurora rubent plurima. Inter sacra movit aqua fraxinos. Ne exsequias quidem unus inter miserrimos viderem meas. Cette dernière est d'autant plus mauvaise, que Mécène joue sur un sujet triste en lui-même. Souvent néanmoins un mot produit un grand effet à la fin d'une période, qui échapperait à l'attention de l'auditeur s'il était placé au milieu, et, pour ainsi dire, caché dans la foule; tandis que là il fixe l'attention et se grave dans l'esprit, comme on peut le voir dans ce passage de Cicéron : Ut tibi necesse esset in conspectu populi romani vomere postridie. Transposez ce mot postridie; il n'aura plus la même force. En effet, ce mot ressort à la fin de la période comme la pointe d'une épée; car Cicéron, après avoir parlé de la dégoûtante nécessité de vomir, qui semble le terme de la crapule, aiguise le trait, en y ajoutant la honte de n'avoir pu digérer en vingt-quatre heures les viandes dont il s'était gorgé. Domitius Afer avait coutume de clore le sens par un mot transposé, à dessein de donner seulement plus de rudesse à sa composition, notamment dans ses exordes. Ainsi il dit dans son plaidoyer pour Cloantilla : Gratias agam continuo; et dans celui qu'il fit pour Lélia : Eis utrisque apud te judicem periclitatur Laelia. Il était tellement ennemi de ces modulations douces et délicates qui flattent l'oreille, que, loin de les chercher, il en entravait le cours, lorsqu'elles se présentaient d'elles-mêmes. Il n'est personne qui ne sache aussi qu'un mauvais arrangement fait naître l'amphibologie. Voilà, en peu de mots, ce que j'ai cru devoir dire sur l'ordre, sans lequel un discours, fût-il d'ailleurs bien lié et bien 354 cadencé, sera toujours regardé, avec raison, comme un discours mal fait. Vient ensuite la liaison. Elle s'étend aux mots, aux incises, aux membres, aux périodes; car toutes ces parties ont leurs beautés et leurs défauts, par rapport à la manière dont on les joint ensemble. D'abord, pour procéder méthodiquement, il y a de ces liaisons choquantes qui sautent aux yeux des plus ignorants, lorsque, par exemple, deux mots, qui se suivent, sont tels, que la dernière syllabe de l'un et la première de l'autre forment un mot obscène ou grossier. En second lieu, lorsque des voyelles se rencontrent, il en résulte un hiatus qui inter- rompt tout à coup le cours de l'oraison, et le rend, pour ainsi dire, laborieux. Rien n'est encore plus dur à l'oreille que deux voyelles longues de suite, lorsque ce sont les mêmes; et surtout de ces voyelles dont le son se tire du creux du gosier, ou que l'on ne peut articuler sans ouvrir largement la bouche. La lettre E est plus pleine; la lettre I est plus grêle. Aussi la rencontre de ces deux voyelles passe-t-elle presque inaperçue. Une brève après une longue, ou une longue après une brève, n'est pas non plus fort désagréable. Le concours de deux brèves choque encore moins. En un mot, ce concours de deux voyelles sera plus ou moins rude, selon que la prononciation de ces voyelles sera plus ou moins différente. Cependant, quel qu'il soit, il ne faut pas s'en faire un monstre; et je ne sais ce qu'il y a de pis, a cet égard, ou de la négligence, ou du scrupule; car la crainte de tomber dans ce défaut entrave nécessairement l'élan de l'orateur, et détourne son esprit d'objets plus importants. C'est pourquoi, s'il y a de la négligence à n'en tenir aucun compte, d'un autre côté il y a de la petitesse à s'en effrayer continuellement; et ce n'est pas sans raison que l'on reproche aux disciples d'Isocrate, et particulièrement à Théopompe, d'avoir été trop scrupuleux sur ce point. Démosthène et Cicéron s'en sont mis médiocrement en peine. Et en effet, la synalèphe, qui confond deux voyelles en une, rend quelquefois l'oraison plus douce que si chaque mot demeurait en son entier. Quelquefois même l'hiatus n'est pas sans grâce, et donne un certain air de grandeur à ce que nous disons, comme ici : Pulchra oratione acta omnino jactare; outre que les syllabes longues par elles-mêmes, et, pour ainsi dire, plus nourries que les brèves, gagnent encore quelque chose à ce repos qu'on met entre deux voyelles.
|