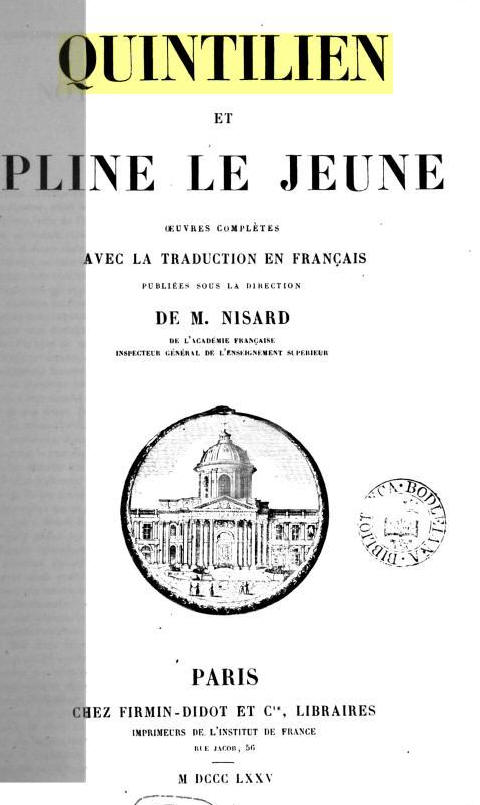CH. I. De l'abondance des mots - II. De l'imitation.
- III. Comment il faut s'exercer à écrire. - IV. De la manière de
corriger. - V. Sur quoi l'on doit principalement s'exercer à écrire.
- VI. De la méditation. - VII. Comment s'acquiert et se conserve la
faculté d'improviser.
CHAP. I. Si les préceptes de
rhétorique que nous avons donnés jusqu'ici sont nécessaires en
théorie, d'un autre côté ils sont insuffisants dans la pratique,
s'il ne s'y joint cette facilité ferme que les Grecs appellent ἕξις.
Est-ce en écrivant, ou en lisant, ou en parlant, que s'acquiert
cette habitude? C'est une question qu'on fait tous les jours, et qui
mériterait d'être approfondie, s'il était vrai qu'on pût se
contenter d'une seule de ces conditions. Mais elles sont tellement
inséparables, que, une seule étant négligée, le soin donné aux
autres serait peine perdue. Notre éloquence, en effet, n'aura jamais
ni solidité ni vigueur, si nous ne la fécondons à force d'écrire; et
cet exercice à son tour, sans la lecture et l'étude des modèles, ne
sera qu'un vain labeur. Enfin, sût-on comment chaque chose doit se
dire, si l'on n'a cette facilité de parler qui n'est jamais en
défaut, en sera comme l'avare couché sur son trésor. Or, de ce qu'un
précepte doit précéder tous les autres, il ne s'ensuit pas que ce
précepte soit la garantie immédiate de l'éloquence. Car l'office de
l'orateur étant de parler, c'est de parler qu'il s'agit avant tout,
et il est évident que c'est aussi par là que l'art oratoire a
commencé; que l'imitation n'est venue qu'ensuite, et que c'est en
dernier lieu qu'on s'est occupé des règles du style. Mais comme on
n'arrive au sommet qu'après avoir passé par les degrés inférieurs,
aussi, à mesure qu'on s'élève, les premiers objets s'amoindrissent
en s'éloignant. Or, au point où je suis arrivé, je n'ai plus à
m'occuper de la théorie de l'art oratoire; car je l'ai suffisamment
développée, autant du moins que je l'ai pu. Mais de même qu'un
maître de palestrique, après avoir enseigné à un jeune athlète la
théorie de son art, lui apprend encore par quel genre d'exercice il
doit se préparer aux combats; de même, supposant que notre orateur
sait inventer et disposer les choses, choisir et placer les mots, je
veux maintenant lui enseigner les moyens de mettre en pratique ce
qu'il sait de la manière la plus parfaite et la plus facile.
Il est hors de doute que l'orateur a
besoin pour cela d'un certain fonds, auquel il puisse recourir au
besoin. Ce fonds consiste dans une certaine abondance d'idées et
de mots. Quant aux idées, elles sont propres et particulières à
chaque sujet, ou du moins communes à un petit nombre. Au contraire,
il faut faire provision de mots pour toutes sortes de sujets. Si
chaque idée avait son mot correspondant, nous serions moins
embarrassés; car les mots se présenteraient tout d'abord avec les
idées; mais, les uns étant plus propres que les autres, ou plus
élégants, ou plus significatifs, ou plus sonores, il faut non
seulement les connaître tous, mais les avoir, pour ainsi dire, sous
la main et sous les yeux, afin de pouvoir, au besoin, choisir
incontinent les meilleurs. Je sais que certains orateurs ont coutume
de faire provision de synonymes, pour être sûrs d'avoir toujours un
mot à leur disposition, ou pour éviter la répétition du même mot,
lorsque, à peu de distance, il est nécessaire de répéter la même
chose : travail puéril, misérable, et d'ailleurs peu utile; car
c'est rassembler une foule de mots, pour user indifféremment du
premier venu. Mais l'abondance dont je parle doit toujours
être accompagnée de discernement; elle a pour fin la
véritable éloquence, et non cette loquacité de charlatan, qui n'est
bonne qu'à imposer à la multitude. Or, cette fécondité s'acquiert en
lisant les meilleurs écrivains et en écoutant les meilleurs
orateurs; car on apprendra par là non seulement à connaître les noms
des choses, mais aussi à les placer de la manière la plus
convenable. En effet, presque tous les mots peuvent trouver place
dans l'oraison, à l'exception d'un petit nombre qui sont peu
honnêtes : encore même ceux-ci sont-ils goûtés souvent dans les
poètes iambiques et les poètes de la vieille comédie; mais, pour
moi, je n'ai en vue pour le moment que l'orateur. Il n'est donc
presque aucun mot, hormis ceux dont je viens de parler, qui ne
puisse fort bien trouver sa place quelque part : car nous avons
besoin quelquefois de termes bas et vulgaires; et même tels, qui
paraîtraient grossiers dans un endroit qui demande de l'éclat,
deviennent propres lorsqu'ils sont placés à propos. De savoir s'en
servir avec discernement, et de connaître non seulement leur
signification, mais encore leur forme et leur mesure, et enfin leur
convenance, c'est ce qu'on ne peut obtenir qu'à force de lire et
d'écouter, puisque c'est par l'oreille que nous commençons à
apprendre toute la langue. C'est pour cela que des enfants que des
princes avaient eu la curiosité de faire élever dans la solitude par
des nourrices muettes, bien qu'on prétende qu'ils aient proféré
quelques mots, ont été privés néanmoins de la faculté de parler. Or,
il y a des mots qui sont de telle nature qu'ils expriment la même
chose; de sorte que, quant à la signification, il est absolument
indifférent de se servir de l'un ou de l'autre, comme ensis
et gladius. Il y en a d'autres qui, bien qu'ils soient les
noms propres de choses différentes, ont métaphoriquement le même
sens, comme ferrum et mucro. C'est aussi par
catachrèse que nous appelons sicaires ceux qui ont commis un
meurtre avec une arme quelconque. Nous exprimons encore certaines
choses par une circonlocution; telle est cette périphrase : et
pressi copia lactis, pour dire du fromage; et nous en figurons
d'autres en changeant l'expression : je sais, je n'ignore pas, il
ne m'échappe pas, qui ne sait? personne ne doute, etc. On peut
quelquefois profiter de l'affinité des mots; ainsi, je comprends,
je sens, je vois, ont souvent la même signification que je
sais. Cette abondance, cette richesse, nous sera donnée par la
lecture, qui nous mettra en état de choisir non seulement un mot
entre plusieurs, mais encore le mot juste; car ils n'ont pas
toujours même réciprocité de valeur. Par exemple, si, en parlant de
l'entendement, on dit fort bien je vois, il ne s'ensuit pas
que, en parlant des yeux du corps, on puisse dire je comprends;
et si mucro donne à entendre gladius, il ne s'ensuit
pas que gladius donne à entendre mucro. Mais, quoique
l'abondance des mots s'acquière par là, il ne faut pas lire ou
écouter seulement pour les mots : car l'exemple ne vient pas
seulement en aide aux mots; il est le complément indispensable de la
théorie entière, surtout lorsqu'on est en état de sentir et de juger
sans le secours d'un maître, et de se servir de ses propres forces;
car ce que le maître enseigne, l'orateur le fait voir.
Or, l'audition et la
lecture ont des avantages différents. Quand nous écoutons, c'est
la chose même, la chose vivante, et non pas seulement sa forme et
son expression, qui nous saisit. Tout vit, tout se meut, et nous
assistons, en quelque sorte, à la naissance d'une chose dont nous
attendons la fin avec intérêt et sollicitude. Non seulement l'issue
du jugement, mais le danger même des parties, nous inquiète. Enfin,
la voix, l'action, la prononciation, moyens si puissants lorsqu'ils
réunissent la noblesse et la convenance, tout, en un mot, enseigne à
la fois. Dans la lecture, le jugement est plus sûr; et l'on n'est
pas exposé, comme lorsqu'on écoute, à se laisser entraîner par une
certaine prévention pour celui qui parle, ou parles acclamations
louangeuses des auditeurs. On a honte, en effet, d'être d'un
sentiment contraire à celui des autres, et une certaine pudeur
secrète nous empêche de nous croire plus éclairés qu'eux, quoique ce
qui est mauvais plaise à la majorité, ou que des gens gagés pour
applaudir louent même ce qui ne leur plait pas; comme, au contraire,
il arrive aussi que le mauvais goût de l'auditeur ne sent pas les
choses les mieux dites. En outre, la lecture est libre, et n'est pas
obligée de courir avec l'orateur. On peut revenir à chaque instant
sur ses pas, soit pour examiner un passage plus attentivement, soit
pour le mieux retenir; et c'est ce qu'il faut faire. De même qu'on
mâche longtemps les aliments pour les digérer plus aisément, de même
ce que nous lisons, loin d'entrer tout cru dans notre esprit, ne
doit être transmis à la mémoire et à l'imitation qu'après avoir été
broyé et trituré. Je veux que, durant un long temps, on ne lise que
les meilleurs auteurs, ceux qu'on peut aimer avec pleine confiance;
mais qu'on les lise avec soin, et presque jusqu'à n'être point
content que l'on n'en ait transcrit des extraits. Ce n'est pas même
seulement au détail que je veux qu'on s'attache; mais, après avoir
bien lu un livre, il faut le reprendre en entier, surtout s'il
s'agit d'un plaidoyer, où parfois l'art est caché à dessein. Car
souvent l'orateur prépare sa voie, dissimule sa marche, tend çà et
là des embûches, et dit au commencement des choses qui ne doivent
produire leur effet qu'à la fin. Aussi nous plaisent-elles peu à la
place où elles sont, parce que nous ignorons encore pourquoi elles y
sont; et c'est pour cela qu'après avoir tout lu il faut tout relire.
Mais rien n'est plus utile que de s'instruire des causes dont on a
les plaidoyers entre les mains, et de lire, toutes les fois qu'on le
pourra, ceux qui ont été prononcés pour et contre; par exemple, les
oraisons de Démosthène et d'Eschine, dans l'affaire de la Couronne;
de Servius Sulpicius et de Messala, dont l'un plaida pour Aufidia,
et l'autre contre; de Pollion et de Cassius, dans la cause d'Asprénas;
et quantité d'autres. Quand les plaidoyers ne seraient pas d'égale
force, il serait bon quelquefois de les lire pour étudier la
question, comme l'oraison de Tubéron contre Ligarius, que Cicéron
défendait, et celles d'Hortensius pour Verrès, contre le même
Cicéron. Il ne sera pas non plus inutile d'examiner comment deux
orateurs ont traité la même cause. En effet, Calidius plaida aussi
pour le rétablissement de la maison de Cicéron; et Brutus, par
manière d'exercice, composa une oraison pour Milon. Cornélius Celsus
prétend qu'il la prononça; mais il se trompe. Pollion et Messala ont
aussi défendu les mêmes personnes; et dans mon enfance on parlait
avec éloge des oraisons de Domitius Afer, de Crispus Passiénus et de
Décimus Lélius, pour Volusénus Catulus. Cependant, en lisant ces
grands orateurs, qu'on ne se persuade pas tout d'abord que tout ce
qu'ils ont dit est parfait; car ils bronchent quelquefois, ils
plient sous le faix, ou ils se laissent trop aller à la pente de
leur génie; ils n'ont pas toujours l'esprit également tendu, ils se
lassent; et Démosthène, selon Cicéron, ainsi qu'Homère lui-même,
selon Horace, sommeille quelquefois. Ce sont de grands hommes, mais
ce sont des hommes pourtant. Or, il arrive que ceux qui se font une
loi de les suivre aveuglément en tout s'exposent à les imiter dans
ce qu'ils ont de mauvais (ce qui est plus aisé), et de croire les
avoir égalés, quand ils n'ont pris que leurs défauts. Ce n'est
toutefois qu'avec réserve et circonspection qu'il faut prononcer sur
ces grands hommes, de peur de s'exposer, comme tant de gens, à
condamner ce qu'on n'entend pas; et si l'alternative était
inévitable, j'aimerais encore mieux un lecteur à qui tout plaît en
eux, qu'un autre à qui beaucoup de choses déplaisent.
Théophraste dit que la lecture des
poètes est infiniment utile à l'orateur, et beaucoup d'autres
rhéteurs partagent son opinion, et avec raison. C'est en effet dans
les poètes qu'il faut chercher le feu des pensées, la sublimité des
expressions, la force et la variété des sentiments, la justesse des
caractères; c'est surtout dans la douceur de leur commerce que
l'esprit de l'orateur, desséché par l'âpreté des débats judiciaires,
se retrempe et se renouvelle. C'est pourquoi Cicéron est d'avis
qu'on se délasse dans la lecture des poètes. Souvenons-nous pourtant
que l'orateur ne doit pas imiter les poètes en tout,
particulièrement dans la hardiesse des expressions et la licence des
figures; que la poésie est née pour l'ostentation ; qu'elle est
uniquement faite pour plaire, et que, pour atteindre ce but, elle
imagine non seulement des choses fausses, mais même quelquefois des
choses incroyables; qu'en outre elle jouit d'un certain privilège,
légitimé par la servitude de la mesure, laquelle l'empêche souvent
de se servir du mot propre, et la force de s'écarter du droit chemin
pour prendre certains détours, de changer certains mots, et même de
les allonger ou de les raccourcir, de les transposer ou de les
diviser. Souvenons-nous qu'au contraire nous autres orateurs nous
sommes comme des soldats sous les armes en présence de l'ennemi, que
nous combattons pour des intérêts sérieux, et que nous ne devons
avoir en vue que la victoire. Je ne veux pas pour cela que nos armes
soient sales et rouillées; mais je veux qu'elles aient un éclat
terrible, qui, comme celui du fer, frappe en même temps l'âme et les
yeux; non tel que celui de l'or et de l'argent, éclat voluptueux, et
plus dangereux qu'utile. On peut aussi trouver dans l'histoire un
aliment doux et abondant, pourvu qu'on sache que l'orateur doit
éviter la plupart des qualités de l'historien : car l'histoire a
beaucoup d'affinité avec la poésie, et n'en diffère qu'en ce qu'elle
n'est pas assujettie à la mesure. Elle se propose de narrer, et non
de prouver. Ce n'est point un débat actuel, un combat présent
qu'elle engage, c'est un récit qu'elle transmet à la mémoire de la
postérité, avec la gloire et le génie de l'écrivain. C'est pourquoi
elle prévient, par la hardiesse des expressions et des figures,
l'ennui inséparable des longues narrations. Ainsi, comme je l'ai
déjà dit, ni la brièveté de Salluste, qui est ce qu'il y a de plus
parfait pour une oreille attentive et délicate, ne nous réussira
auprès d'un juge préoccupé de mille pensées et souvent illettré; ni
l'abondance lactée de Tite-Live n'instruira suffisamment celui qui
cherche moins la beauté d'une exposition que la vérité. Ajoutez que
Cicéron n'a pas cru que Thucydide même et Xénophon fussent utiles à
l'orateur, quoique, de son aveu, le premier ait l'accent belliqueux,
et que les Muses aient parlé par la bouche de l'autre. Cependant il
nous est permis, dans les digressions, d'emprunter quelquefois le
brillant de l'histoire, pourvu que nous nous souvenions que, sur le
terrain de la question, il faut déployer, non les muscles d'un
athlète, mais le bras d'un soldat; et que ce vêtement de gaze dont
se paraît Démétrius de Phalère convient peu à la poussière de la
lice judiciaire. Il y a encore un autre parti à tirer de l'histoire,
et qui est certainement le plus considérable, mais il ne regarde pas
le point que nous traitons : il s'agit de la connaissance des faits
et des exemples, connaissance particulièrement nécessaire à
l'orateur, qui ne doit pas seulement tirer ses témoignages des
parties, mais les puiser dans l'étude approfondie de l'antiquité,
ceux-là étant d'autant plus puissants, que seuls ils ne sont pas
suspects de haine ou de faveur.
Pour ce qui est des philosophes, nous
ne pouvons-nous dispenser de les lire, depuis que les orateurs, par
suite d'un autre défaut, ont délaissé la plus noble partie de leurs
fonctions. Car ce sont aujourd'hui les philosophes qui sont en
possession de discourir et d'argumenter sur le juste, sur l'honnête,
sur l'utile, sur les choses divines; et la manière de Socrate est
très bonne pour former l'orateur, par la subtilité des altercations
et des questions. Mais cette lecture ne demande pas moins de
discernement que les autres, et, traitât-on les mêmes matières, il
ne faut pas oublier qu'il n'en est pas d'un procès comme d'une
discussion philosophique, du barreau comme d'une école, des
préceptes d'un philosophe comme des dangers d'un orateur.
Après avoir fait voir tous les
avantages de la lecture, je laisserais, ce semble, quelque chose à
désirer, si je ne disais aussi quels sont les auteurs qu'il faut
lire, et en quoi chacun de ces auteurs a principalement excellé.
Mais il n'est pas possible de les passer tous en revue. Combien de
pages Cicéron n'a-t-il pas employées, dans son Brutus, pour ne
parier seulement que des orateurs latins, sans même y comprendre ses
contemporains, à l'exception de César et de Marscellus? Or quand
verrais-je la fin de ma revue, s'il me fallait faire mention et de
ceux qu'a omis Cicéron et des autres qui les ont suivis; enfin de
tous les orateurs grecs, et des philosophes et des poètes? Le plus
sûr est donc d'imiter la brièveté de Tite-Live, qui, dans une lettre
à son fils, se borne à lui recommander la lecture de Démosthène et
de Cicéron, et, après eux, celle des autres orateurs, mais à
proportion qu'ils se rapprochent plus de ces deux grands modèles.
Cependant, pour ne pas dissimuler ce que je pense en général, je
dirai que, parmi les écrivains qui ont résisté au temps, il y en a
peu, ou plutôt presque point, qui ne puissent être de quelque
utilité à ceux qui les lisent avec discernement, puisque Cicéron
avoue qu'il a retiré beaucoup de fruit de la lecture même des vieux
auteurs, en qui l'on trouve, il est vrai, de l'esprit, mais nul art.
J'en dis à peu près autant des modernes. Combien peu, en effet, en
trouverait-on d'assez dépourvus de tout mérite pour n'avoir pu, dans
une partie si minime qu'elle soit, espérer raisonnablement un regard
de la postérité? S'il en est un, nous nous eu apercevrons dès les
premières lignes, et nous aurons bientôt jeté le livre, loin de
perdre notre temps à pousser plus loin l'expérience. Mais, pour
avoir quelque chose de bon et d'utile, Il ne s'ensuit pas qu'un
auteur soit directement propre à nous donner cette facilité
d'élocution, φράσις, dont il est ici question.
Or, avant que de parler de chaque
auteur en particulier, il est bon de dire quelques mots en général
sur la diversité des opinions : car les uns croient que les anciens
seuls méritent d'être lus; que l'éloquence naturelle, et ce
caractère mâle qui sied si bien à la dignité de l'homme, ne se
rencontrent que chez les anciens. Les autres n'aiment que cette
délicatesse efféminée, cette afféterie, et tous ces petits moyens
qu'on met en oeuvre pour plaire à une multitude ignorante. Parmi
ceux même qui font profession de n'estimer que le langage direct,
les uns ne reconnaissent pour bon et véritablement attique que ce
qui est concis et léger, et qui ne s'élève en rien au-dessus du
langage familier; les autres veulent de l'élévation, du feu, de
l'enthousiasme; ceux-là sont en assez grand nombre, qui goûtent un
style doux, brillant et châtié. Je traiterai plus au long de ces
divers sentiments, lorsqu'il sera question d'examiner le genre de
style qui est le plus convenable à l'orateur. En attendant, je dirai
sommairement quelles lectures doivent rechercher ceux qui veulent
apprendre à parler avec facilité, et quels avantages ils en peuvent
retirer; et, pour cela, je parlerai d'un petit nombre d'auteurs
choisis, qui ont excellé entre tous. Il sera aisé ensuite au lecteur
studieux de juger des autres par ceux-là : ce que je dis pour éviter
le reproche d'avoir omis par hasard quelque auteur qu'il
affectionne; car j'avoue que ceux que je nommerai ne sont pas les
seuls qu'on doive lire; mais il ne s'agit ici que des genres de
lecture qui, selon moi, conviennent particulièrement à quiconque
veut devenir orateur. A l'exemple d'Aratus, qui, dans ses
Phénomènes, croit devoir commencer par Jupiter, je ne saurais
mieux faire ici que de commencer par Homère. De même que, selon ce
poète, les fleuves et les fontaines prennent leur source dans
l'Océan, on peut dire aussi de lui qu'il est le père et le modèle de
tous les genres d'éloquence. Non, jamais personne ne le surpassera
en sublimité dans les grandes choses, en propriété dans les petites.
Tour à tour fleuri et serré, tour à tour agréable et grave,
également admirable par son abondance et sa concision, il possède au
plus haut degré toutes les qualités non seulement du poète, mais de
l'orateur. Car, sans parler de tant d'endroits où il loue, où il
exhorte, où il console, est-ce que la députation d'Agamemnon à
Achille, dans le neuvième chant, et la dispute de ces deux héros,
dans le premier, et le conseil tenu entre les principaux chefs, dans
le second, ne nous révèlent pas tous les secrets de l'art dans le
genre judiciaire et le genre délibératif? A l'égard des moeurs et
des passions, quel est l'homme assez ignorant pour ne pas
reconnaître que cet auteur les a maniées comme il l'a voulu, et en
maître? Que si nous considérons le début de ses deux poèmes,
n'a-t-il pas dans l'un et dans l'autre, et en quelques vers, je ne
dis pas observé, mais établi la loi de l'exorde? En effet, il rend
le lecteur bienveillant par l'invocation des déesses qui passent
pour présider à la poésie; il le rend attentif par l'importance de
la matière, et docile par l'exposé sommaire du sujet. Où
trouvera-t-on une narration plus brève que celle de la mort de
Patrocle; une description plus vive que celle du combat des Curètes
et des Étoliens? Pour ce qui est des similitudes, des
amplifications, des exemples, des digressions, des signes, des
arguments, et de tout ce qui entre dans la confirmation et la
réfutation, tout cela abonde tellement dans Homère, que la plupart
des rhéteurs ont appuyé leurs préceptes de l'autorité de ce poète.
Mais quel épilogue égalera jamais la prière de Priam redemandant à
Achille le corps de son fils? Enfin, si l'on regarde les mots, les
pensées, les figures, la disposition de l'ouvrage entier, n'a-t-il
pas dépassé les bornes de l'esprit humain? Jusque-là qu'il faut être
un grand homme, je ne dis pas pour rivaliser avec lui ce qui est
impossible, mais pour se faire une idée pleine et entière de son
génie. Cet auteur a donc laissé tous les autres bien loin derrière
lui, dans tous les genres d'éloquence, et notamment les poètes
épiques; car c'est dans l'épopée qu'il tire le plus de gloire de la
comparaison. Hésiode s'élève rarement; son poème n'est, en
grande partie, qu'une nomenclature : cependant ses préceptes sont
entremêlés d'utiles sentences; le poli de son élocution et de sa
composition n'est pas sans mérite. On lui donne la palme dans le
genre tempéré. Antimaque, au contraire, a de la force et de
la gravité; le genre de son éloquence n'est rien moins que vulgaire,
et vaut son prix ; mais, quoique la plupart des grammairiens
s'accordent à lui donner le second rang après Homère, on chercherait
en vain dans cet auteur le sentiment, la grâce, la disposition; il
manque tout à fait d'art : ce qui montre bien qu'autre chose est
d'être voisin de quelqu'un, autre chose d'être le premier après lui.
On prétend que Panyasis tient de ces deux poètes, mais qu'il
n'égale ni l'un ni l'autre pour le style; que cependant il surpasse
Hésiode par le choix du sujet, et Antimaque par la disposition.
Apollonius de Rhodes n'est pas compris par les grammairiens au
nombre des auteurs dont ils nous ont donné la liste, parce
qu'Aristarque et Aristophane, qui étaient en possession de juger les
poètes, n'ont fait mention d'aucun écrivain de leur temps. Cet
Apollonius est auteur d'un ouvrage qui n'est point à dédaigner, à
cause d'une certaine médiocrité qui se soutient. Aratus a
traité une matière inanimée, qui ne comporte ni variété, ni
sentiments, ni personnages qui parlent. Cependant il n'est point
resté au-dessous de son pauvre, et a prouvé qu'il n'avait pas
présumé de ses forces. Théocrite est admirable dans son
genre; mais sa muse, toute champêtre et toute pastorale, aime peu la
ville, encore moins le barreau. Il me semble qu'on m'interrompt de
tous côtés pour me nommer une infinité d'autres poètes. Pisandre
n'a-t-il pas dignement chanté les travaux d'Hercule? Est-ce sans
raison que Macer et Virgile ont imité Nicandre?
Ne direz-vous rien d'Euphorion? Si Virgile ne l'eût pas
goûté, eût-il cité le poète de Chalcis avec honneur dans ses
Bucoliques? Est-ce sans intention qu'Horace nomme Tyrtée
après Homère? Je réponds qu'il n'est personne à qui ces poètes
soient tellement inconnus qu'il ne puisse, à l'aide d'un catalogue
de bibliothèque, transcrire au moins leurs noms dans un ouvrage.
Ainsi, ce n'est pas parce que ces poètes ne me sont pas connus que
je les passe sous silence; ce n'est pas non plus parce que j'en
désapprouve la lecture, puisque j'ai dit que tous avaient leur
utilité; mais ils auront leur tour, quand notre éloquence aura
acquis la force et le point de perfection qui lui est nécessaire.
C'est ainsi que souvent, dans un repas somptueux, après nous être
rassasiés des meilleurs mets, nous cherchons dans des mets plus
communs le plaisir de la diversité. Alors nous pourrons aussi jeter
les yeux sur l'élégie, dans laquelle Callimaque passe pour
avoir excellé, et, après lui, Philétas, du consentement de la
plupart des savants. Mais, tant que nous travaillons à acquérir
cette facilité qui, comme je l'ai dit, soit sûre d'elle-même, c'est
avec les meilleurs auteurs qu'il faut nous familiariser; et ce n'est
pas en lisant beaucoup de livres, mais en lisant beaucoup les bons,
que nous parviendrons à former notre esprit et à colorer notre
style. C'est pourquoi, des trois poètes iambiques dont les noms sont
consacrés par le suffrage d'Aristarque, Archiloque est celui
dont la lecture peut contribuer principalement à donner cette
facilité dont je parle. Il y a en lui une grande vigueur
d'élocution, des pensées fortes, de ces traits qui sont courts, mais
vifs et perçants; il est plein de sang et de nerfs : en sorte que,
au jugement de quelques-uns, s'il est au-dessous de qui que ce soit,
c'est la faute de sa matière, et non de son génie. Parmi les neuf
poètes lyriques, Pindare l'emporte infiniment sur tous les
autres par l'enthousiasme, la magnificence des pensées, la beauté
des figures; par une merveilleuse abondance d'idées et de mots, et
par le caractère de son éloquence, qu'on ne saurait mieux comparer
qu'à un torrent : ce qui a fait dire avec raison à Horace qu'il est
inimitable. Stésichore tient le second rang. L'élévation de
son génie se manifeste jusque dans le choix de ses sujets. Ce sont
toujours des guerres fameuses ou des capitaines illustres qu'il
chante, et sa lyre se soutient à la hauteur de l'épopée. Il fait
agir et parler ses personnages avec toute la dignité qui leur
appartient; et, s'il eût su garder un juste tempérament, nul autre,
ce me semble, n'eût approché plus près d'Homère. Mais il est
redondant, diffus; vice blâmable, à la vérité, mais vice
d'abondance. Alcée mérite bien l'archet d'or que lui donne
Horace, lorsque, animé d'un noble courroux, il se déchaîne contre
les tyrans. Aussi est-il très utile pour les moeurs. Son style est
concis, magnifique, exact, et rappelle souvent celui d'Homère; mais
il s'abaisse jusqu'à badiner avec les jeux et les amours, et y
réussit moins que dans les grands sujets. Simonide est mince,
mais il se recommande par une certaine propriété et un certain
agrément. Cependant il excelle particulièrement à attendrir l'âme
par la pitié; de sorte que quelques-uns, sous ce rapport, le
préfèrent à tous ceux qui ont écrit dans le même genre. L'ancienne
comédie conserve presque seule ces grâces naïves du langage attique
et d'une liberté éloquente. Quoiqu'elle s'attache particulièrement à
faire la guerre aux vices, elle ne laisse pas de déployer beaucoup
de force dans les autres parties; car elle a de l'élévation, de
l'élégance et de la beauté; et, après Homère, qu'il faut toujours
mettre hors de ligne, comme son Achille, peut-être n'y a-t-il rien
qui ait plus d'analogie avec les orateurs, ou qui soit plus propre à
en former. Elle compte plusieurs auteurs; mais Aristophane,
Eupolis et Cratinus sont les principaux. Eschyle
peut être regardé comme le père de la tragédie. Il est sublime,
grave, quelquefois grandiose jusqu'à l'excès; mais il a peu connu
l'art du théâtre, et pèche souvent contre les règles : aussi dans la
suite les Athéniens ont-ils établi un concours pour la correction de
ses pièces, ce qui a valu des couronnes à plusieurs poètes.
Sophocle et Euripide ont porté infiniment plus loin l'art
de la tragédie. Lequel des deux, malgré la différence de leur
caractère, l'emporte sur l'autre, c'est une question souvent
débattue, et que je laisse indécise, parce qu'elle ne fait rien à
mon sujet. Il est néanmoins incontestable qu'Euripide est beaucoup
plus utile que Sophocle à ceux qui se destinent au barreau car,
outre que son style (et c'est précisément ce que blâment ceux à qui
la gravité, le cothurne et le ton de Sophocle semblent avoir quelque
chose de plus élevé), outre que son style, dis-je, se rapproche plus
du genre oratoire, il est plein de sentences; et dans ce qui fait
l'objet des préceptes de la philosophie, il est presque égal aux
philosophes. Enfin, soit qu'il fasse parler ou répliquer ses
personnages, je le trouve comparable aux orateurs les plus diserts,
et il me semble surtout exceller dans l'art d'exciter toutes les
passions, et particulièrement la pitié. Aussi Ménandre
l'a-t-il singulièrement admiré, comme il le témoigne souvent, et
même imité, quoique dans un genre différent; Ménandre, qui, lu avec
soin, peut, selon moi, procurer lui seul tout le fruit que se
proposent mes préceptes : tant il a bien représenté la vie humaine
sous toutes ses faces; tant il a de fécondité dans l'invention et de
facilité dans l'élocution; tant il montre d'art dans la peinture des
choses, des personnes et des passions. Je tiens certainement pour
fort judicieux ceux qui attribuent à Ménandre les oraisons que nous
avons sous le nom de Charisius; mais il me paraît bien plus
orateur dans ses comédies, à moins qu'on ne trouve que les
Arbitres, l'Héritière, les Locriens, ne sont pas
une image fidèle de ce qui se passe au barreau, ou que le
Psophodée, le Nomothète, l'Hypobolimée, ne sont
pas des morceaux achevés d'éloquence. Cependant je crois que c'est
particulièrement aux déclamateurs que la lecture de Ménandre peut
être utile, parce que leurs sujets les obligent à jouer un plus
grand nombre de rôles, à faire le personnage d'un père, d'un fils,
d'un soldat, d'un villageois, d'un riche, d'un pauvre, d'un furieux,
d'un suppliant, d'un homme doux ou brutal : et, dans tous ces
caractères, Ménandre observe admirablement la convenance. On peut
dire qu'il a tellement surpassé tous ceux qui ont écrit dans le même
genre, qu'il les a, pour ainsi dire, éclipsés par l'éclat de son
nom. Il y a pourtant quelques autres auteurs comiques dont la
lecture peut être utile quand on les lit avec indulgence : de ce
nombre est Philémon, qui mérite le second rang avec autant de
justice qu'il a été injustement préféré à Ménandre par le mauvais
goût de son siècle.
Je passe aux historiens. Plusieurs
ont brillé dans ce genre, mais tout le monde convient qu'il en est
deux qui ont laissé loin derrière eux tous les autres, et qui, par
des qualités différentes, ont acquis une gloire presque égale : l'un
serré, coucis, pressé, c'est Thucydide; l'autre doux, clair,
abondant, c'est Hérodote. Le premier peint mieux les passions
violentes, le second les sentiments modérés; Thucydide brille dans
les harangues, Hérodote dans les entretiens familiers; celui-ci
plaît, celui-là subjugue. Théopompe, qui vient après eux dans
l'ordre des temps, leur est inférieur; mais il tient plus de
l'orateur, en ayant longtemps rempli les fonctions, avant que d'être
sollicité à écrire l'histoire. Philiste mérite aussi qu'on le
distingue de la foule des autres, quelque bons qu'ils puissent être
après ces trois. Il a imité Thucydide : beaucoup plus faible que
lui, il est jusqu'à un certain point plus clair. Éphore, au
jugement d'Isocrate, aurait besoin d'éperons. On vante l'esprit de
Clitarque, mais il est sans autorité comme historien.
Longtemps après vint Timagène, qui, au défaut de tout autre
mérite, aurait celui d'avoir été le restaurateur de l'histoire. Je
n'ai pas oublié Xénophon, mais sa place est parmi les
philosophes. Vient ensuite une foule d'orateurs; car il y en a eu à
Athènes jusqu'à dix à la fois dans le même siècle, à la tête
desquels il faut, sans contredit, placer Démosthène, qui peut
être regardé comme la loi même de l'éloquence, tant il est
vigoureux, serré, nerveux, précis; tant il sait garder un juste
tempérament, pour ne rien dire de trop ou de trop peu. Eschine
est plus plein, plus abondant, et d'autant plus grand, en apparence;
qu'il est moins ramassé; mais il a plus de chair que de muscles. Le
caractère d'Hypéride est la douceur mêlée de finesse; mais
son style est plus approprié aux petites causes, pour ne pas dire
plus utile. Lysias, plus ancien qu'eux, est simple et
élégant. S'il suffisait à l'orateur d'instruire, on ne saurait rien
trouver de plus parfait. Chez lui, rien d'inutile, rien de
recherché; cependant il ressemble plutôt à une source d'eau vive
qu'à un grand fleuve. Isocrate, dans un autre genre
d'éloquence, est brillant et paré; plus propre à former un lutteur
qu'à combattre lui-même. Il a ambitionné toutes les beautés du
style, et il a eu raison; car il ne se proposait pas de parler
devant les tribunaux, mais devant l'auditoire d'une école. Il a
l'invention facile, l'amour du beau et de l'honnête; il est si
soigné dans la composition, que ce soin lui est reproché comme un
défaut. Je ne prétends pas que ce soient là les seules qualités des
écrivains dont j'ai parlé, mais ce sont les principales. Je ne
prétends pas non plus que ceux que j'ai omis n'aient pas leur
mérite; j'avouerai même que Démétrius de Phalère, quoiqu'il
passe pour avoir le premier fait fléchir l'éloquence, a eu beaucoup
d'esprit et de faconde, et qu'il est digne de mémoire, ne fût-ce que
pont l'honneur d'être à peu près le dernier des Attiques à qu'on
puisse appeler orateur. Du reste, Cicéron le préfère à tous dans le
genre tempéré. A l'égard des philosophes, dans la lecture desquels
Cicéron reconnaît lui-même qu'il a puisé la meilleure partie de son
éloquence, qui ne met Platon au-dessus de tous les autres,
soit à cause de la vigueur de sa dialectique, soit à cause de son
éloquence homérique et vraiment divine? Il s'élève, en effet,
beaucoup au-dessus de la prose, et même de cette poésie que les
Grecs appellent pédestre; à tel point qu'il me paraît moins
écrire sous l'influence d'un génie purement humain que sous
l'inspiration d'une divinité qui l'agite: Que dirai-je de cette
douceur de Xénophon, si simple, si éloignée de toute affectation,
mais que nulle affectation ne saurait atteindre? On dirait que les
Grâces elles-mêmes ont pétri son langage; et, pour lui appliquer le
témoignage que la comédie ancienne rendit à Périclès , ses lèvres
étaient comme le siège de la déesse de la persuasion. Que dirai-je
de l'élégance des autres écrivains de l'école de Socrate? d'un
Aristote, en qui je ne saurais dire ce qu'on doit admirer
davantage, ou de sa science, ou de la multitude de ses écrits, ou de
la suavité de son style, ou de la pénétration de son esprit, ou de
la variété des sujets qu'il a traités; et d'un Théophraste,
dont le style a quelque chose de si beau, de si divin, qu'on dit
qu'il en a tiré son nom. Les anciens stoïciens faisaient moins de
cas de l'éloquence; mais, outre qu'ils ont toujours enseigné la
vertu, ils ont su joindre à la beauté de leur doctrine la force du
raisonnement et la solidité des preuves. Toutefois, ils se sont
montrés plutôt profonds dialecticiens qu'orateurs magnifiques, genre
de mérite que sans doute ils n'ambitionnaient pas.
Voilà pour les Grecs. Je suivrai le
même ordre pour les auteurs latins; et de même que, en pariant des
Grecs, j'ai commencé par Homère, de même, en parlant des Latins, je
ne saurais mieux commencer que par Virgile, qui, de tous les
poètes épiques des deux langues, est sans contredit celui qui a le
plus approché d'Homère : car je rapporterai ici les mêmes paroles
que j'ai entendues dans ma jeunesse de la bouche de Domitius Afer.
Je lui demandais quel était le poète qui, à son avis, approchait le
plus d'Homère Virgile est le second, me dit-il, mais il
est plus près du premier que du troisième. Et, à dire vrai, si
nous sommes obligés de céder la palme au génie céleste et surhumain
d'Homère, Virgile est plus soigné et plus exact, par cela même qu'il
eut à travailler davantage; et ce que nous perdons du côté de la
hauteur, peut-être le regagnons-nous du côté de l'égalité. Tous les
autres laissent entre eux et lui une vaste carrière : car Macer
et Lucrèce sont, il est vrai, dignes d'être lus, mais ils ne
sauraient donner la phrase, c'est-à-dire le corps de l'éloquence.
Chacun d'eux a traité élégamment sa matière; mais l'un n'a rien
d'élevé, et l'autre est âpre et dur.
Dans les écrits qui lui ont valu
quelque renommée, Varron d'Atace, quoique traducteur, n'est
point à mépriser; mais il est peu capable d'enrichir l'élocution du
lecteur. Révérons Ennius, comme les grands chênes de ces
vieilles forêts qu'une sainte horreur, plutôt que leur beauté
recommande à notre vénération. Nous avons dans le même genre
d'autres poètes plus rapprochés de nous, et aussi plus propres à
procurer le fruit que nous recherchons. Sans doute Ovide
folâtre jusque dans ses poésies héroïques, il est trop amoureux de
son esprit; mais il est louable dans certaines parties. Pour
Cornélius Sévérus, quoiqu'il soit plutôt un bon versificateur
qu'un bon poète, si néanmoins, comme on l'a dit, il eût écrit toute
la guerre de Sicile de la force du premier livre, il aurait droit à
la seconde place; mais sa mort prématurée ne lui a pas laissé le
temps de se perfectionner. Cependant les ouvrages de sa jeunesse
révèlent un beau génie, et un goût admirable pour son âge. Nous
avons beaucoup perdu naguère dans la personne de Valérius Flaccus.
On peut admirer dans Saléius Bassus les prémices d'un talent
poétique et plein de force, mais dont la mort prévint aussi la
maturité. Rabirius et Pédon ne sont pas indignes
d'être lus dans des moments de loisir. Lucain est ardent,
impétueux, étincelant de pensées, et, pour dire ce que je pense,
orateur plutôt que poète.
Je me serais dispensé de nommer tous
ces écrivains, si le gouvernement de l'univers n'eût détourné
Auguste le Germanique des études qu'il avait commencées, et si les
dieux n'eussent jugé que c'était peu pour ce prince d'être le
premier des poètes. Et pourtant, quoi de plus sublime, quoi de plus
docte, quoi de plus beau, quoi de plus achevé, que ces poésies
écloses, loin de la cour, dans les loisirs d'une jeunesse studieuse!
Qui pouvait mieux chanter la guerre,
que celui qui la fait avec tant de succès? A qui les déesses qui
président aux arts eussent-elles été plus propices? Sur qui Minerve
eût-elle épanché plus volontiers ses dons, que sur un prince de son
sang? Les races futures raconteront plus dignement ces merveilles de
notre âge; car maintenant la gloire du poète est absorbée dans la
splendeur de mille autres qualités. Qu'il me soit permis cependant,
ô César, à moi, voué au culte des lettres, de ne pas taire un don
comme celui-là, et de m'écrier du moins avec Virgile
Le lierre sur son front s'entremêle
au laurier.
Dans l'élégie, nous le disputons
aussi aux Grecs; et, dans ce genre, Tibulle me semble le plus
pur et le plus élégant. il en est qui lui préfèrent Properce.
Ovide est plus fardé que ces deux poètes, comme Gallus
est plus dur. La satire est tout à fait nôtre; et Lucilius,
qui le premier s'y est fait un grand nom, a encore aujourd'hui des
partisans si passionnés, qu'ils ne font pas difficulté de le
préférer non seulement à tous les satiriques, mais même à tous les
poètes. Pour moi, je suis aussi éloigné de leur sentiment que de
celui d'Horace, qui se borne à dire qu'il y a quelquefois du bon
dans ce torrent limoneux ; car je trouve en lui une érudition
admirable, et un franc-parler qui lui donne du mordant et beaucoup
de sel. Horace est beaucoup plus châtié et plus pur, et
excelle principalement dans la peinture des moeurs. Perse s'est
acquis beaucoup de vraie gloire par une seule satire. Nous avons
aujourd'hui de célèbres écrivains qui travaillent dans le même
genre, et dont on citera un jour les noms avec éloge. Il y a une
autre espèce ode satire, et plus ancienne, dont Térentius Varron,
le plus savant des Romains, nous a laissé un modèle, qui consiste
dans un mélange de vers et de prose. Cet auteur, qui avait une
profonde connaissance de la langue latine et de toutes les
antiquités grecques et romaines, a composé plusieurs autres ouvrages
pleins d'érudition, mais dont la lecture est plus utile sous le
rapport de la science que sous celui de l'éloquence. L'iambe n'a
jamais été chez nous une forme particulière de poésie; quelques
poètes l'ont seulement mêlé à d'autres vers, et même d'une manière
assez mordante, comme Catulle, Bibaculus, Horace,
quoique ce dernier y joigne d'ordinaire l'épode. Quant aux poètes
lyriques, Horace est presque le seul digne d'être lu. Il
s'élève quelquefois; il est plein de charme et de grâce, varié dans
ses figures, et d'une audace très heureuse dans ses expressions : si
l'on veut lui adjoindre quelqu'un, ce ne peut être que Césius
Bassius, que nous avons connu naguère, mais qui est bien
inférieur aux lyriques actuels. Nos tragiques anciens les plus
célèbres sont Accius et Pacuvius. Ils se recommandent
par la gravité des pensées, par le poids des paroles, et par la
dignité des caractères. Du reste, ils n'ont ni cet éclat ni ce fini
qui est le complément de l'art; mais la faute en est moins à eux, ce
semble, qu'au temps où ils vivaient. On accorde plus de force à
Accius, et ceux qui ambitionnent la réputation d'érudits veulent
que Pacuvius soit plus docte. Le Thyeste de Varius
est comparable à ce que les Grecs ont de mieux; et la Médée
d'Ovide montre ce que ce poète aurait pu faire, s'il eût
mieux aimé mettre un frein à son esprit que d'y donner l'essor. De
tous ceux que j'ai vus, Pomponius Secundus est sans contredit
celui qui a le mieux réussi dans la tragédie. Les vieillards de mon
temps ne le trouvaient pas assez tragique; mais ils avouaient que,
pour l'érudition et l'éclat, il était supérieur à tous les autres.
La comédie est notre endroit le plus faible, quoique Varron dise
que, au jugement d'Élius Stilon, les Muses auraient parlé le
langage de Plaute, si elles eussent voulu parler latin; malgré
l'admiration des anciens pour Cécilius; enfin, malgré la
réputation de Térence, dont les pièces furent attribuées à
Scipion l'Africain. A vrai dire, les comédies de Térence se
distinguent par une rare élégance, et auraient encore plus de grâce,
si elles n'avaient été écrites qu'en vers trimètres. Malgré tout
cela, à peine avons-nous l'ombre de la comédie grecque, tant notre
langue me paraît peu susceptible de cette grâce qui n'a été donnée
qu'aux seuls Attiques, et que les Grecs eux-mêmes n'ont pu retrouver
dans un autre dialecte ! Afranius excelle dans la comédie
purement latine, togata : heureux s'il n'eût point souillé
ses pièces d'infâmes amours, qui ne trahissent que trop ses moeurs!
Pour l'histoire, nous ne le cédons nullement aux Grecs. Ainsi, je ne
craindrai pas d'opposer Salluste à Thucydide; et je ne crois
pas faire injure à Hérodote en lui comparant Tite-Live,
qui n'est pas moins admirable par la clarté, la grâce, la netteté de
sa narration, due par l'éloquence de ses harangues, où il ne dit
jamais rien qui ne soit parfaitement en harmonie avec les choses et
les personnes. Pour ce qui est des passions, surtout de celles dont
les mouvements sont plus doux, je crois m'exprimer avec la plus
extrême réserve, en disant qu'aucun historien n'a mieux réussi à les
peindre. Aussi peut-on dire qu'il supplée par des qualités
différentes la céleste rapidité de Salluste; car ces deux écrivains
sont plutôt égaux que semblables, selon l'heureuse expression de
Servilius Nonianus, que j'ai connu, et qui était lui-même un
historien très distingué, sentencieux, mais plus diffus que ne le
comporte l'autorité de l'histoire. Bassius Aufidius, qui le
précéda de peu, s'y est mieux conformé dans son Histoire de la
guerre contre les Germains: historien recommandable entre tous
sous le rapport des qualités générales, mais qui, dans certaines
parties, est resté au-dessous de lui-même. Nous possédons encore,
pour la gloire et l'ornement de notre siècle, un historien digne de
vivre dans la postérité, et dont le nom, qu'on devine aisément, sera
cité un jour avec honneur. Il a des partisans, sans avoir
d'imitateurs; de sorte que, même en se décidant à des suppressions,
sa franchise n'a pas laissé de lui nuire. Du reste, dans ses
ouvrages ainsi tronqués, on trouve les inspirations d'une âme
élevée, et des pensées hardies. Je pourrais encore nommer d'autres
bons écrivains; mais je me suis proposé de prendre la fleur de
chaque genre, et non de faire une revue de bibliothèques. Mais c'est
surtout à nos orateurs que l'éloquence latine doit la gloire de
marcher de pair avec celle des Grecs; car il n'est personne, parmi
les Grecs, à qui je n'oppose hardiment Cicéron. Je n'ignore
pas quelle querelle je m'attire gratuitement sur les bras, en le
comparant à Démosthène dans un temps comme celui-ci, puisque cette
comparaison n'entre pas dans mon sujet, et que d'ailleurs je
recommande de lire avant tout Démosthène, ou plutôt de l'apprendre
par coeur. Mais je ne laisserai pas de témoigner que, selon moi, ces
deux orateurs se ressemblent dans la plupart de leurs qualités :même
dessein, même méthode dans la division, la préparation et les
preuves, en un mot, dans tout ce qui tient à l'invention. Quant au
style, il y a quelque différence : l'un est plus précis, l'autre
plus abondant; l'un serre de plus près son adversaire, l'autre se
met plus au large pour le combattre; dans l'un, c'est toujours la
pointe de l'épée qu'il faut craindre ; dans l'autre, c'est souvent
aussi le poids des armes; il n'y a rien à retrancher dans l'un, rien
à ajouter dans l'autre; dans fun, le travail se fait plus sentir, et
dans l'autre, la nature. Nous l'emportons certainement pour la
plaisanterie et le pathétique, deux ressorts puissants de
l'éloquence. Les péroraisons, dirait-on, étaient interdites parles
lois d'Athènes; mais, d'un autre côté, la nature de la langue latine
comporte moins les beautés attiques de Démosthène. On a des lettres
de l'un et de l'autre, et, de Cicéron seulement, des dialogues;
mais, à cet égard, nulle comparaison possible ou probable. Cependant
il faut céder en ce point, que Démosthène est venu le premier, et
qu'il a fait Cicéron, en grande partie, tout ce qu'il est; car il me
semble que celui-ci, en s'attachant tout entier à imiter les Grecs,
s'est approprié et la forcé de Démosthène, et l'abondance de Platon,
et la douceur d'Isocrate. Toutefois, ce n'est pas seulement par
l'étude qu'il est parvenu à emprunter à chacun d'eux ce qu'il avait
de meilleur; la plupart des qualités qui le distinguent, ou, pour
mieux dire, toutes, il les a trouvées en lui-même, dans la
merveilleuse fécondité de son divin génie; car son éloquence, pour
me servir d'une comparaison de Pindare, n'est point comme un
réservoir d'eaux pluviales; c'est un torrent qui s'échappe d'une
source vive et profonde. On dirait que le ciel l'a donné à la
terre pour montrer en lui jusqu'où peut aller la puissance de la
parole. Qui, mieux que lui, possède l'art d'instruire et d'émouvoir?
En qui a-t-on jamais trouvé plus de grâce? Ce qu'il vous arrache,
vous croyez le lui accorder. Il entraîne le juge, et celui-ci a
plutôt l'air de le suivre que de céder à une force irrésistible. Il
dit tout avec tant d'autorité, qu'on rougirait d'avoir un autre avis
que le sien : ce n'est pas un avocat qui plaide, c'est un témoin qui
dépose, e 'est un juge qui prononce. Et toutes ces choses, dont une
seule coûterait à tout autre des soins infinis, coulent, chez lui,
sans effort; et cette éloquence, qui est ce qu'on peut entendre de
plus beau, a tous les dehors de la plus heureuse facilité. Aussi
est-ce à juste titre que ses contemporains l'ont proclamé roi du
barreau, et que, dans la postérité, son nom est devenu synonyme de
l'éloquence. Ayons-le donc sans cesse devant les yeux,
proposons-le-nous pour modèle: et que celui-là sache qu'il a
profité, à qui Cicéron ne plaît pas médiocrement. Il y a dans
Asinius Pollion beaucoup d'invention, et une si grande
exactitude, qu'elle a paru excessive à quelques-uns; il ne manque ni
de dessein ni de chaleur, mais il est si loin de Cicéron pour la
brillant et la grâce, qu'il semble l'avoir précédé d'un siècle.
Messala est brillant et poli, et son style reflète, en quelque
sorte, l'éclat de sa naissance; mais il a peu de force. Pour
César, s'il se fût entièrement adonné au barreau, on
n'opposerait pas d'autre nom à Cicéron. Il a tant d'énergie, tant de
pénétration, tant de feu, qu'il semble avoir parlé comme il faisait
la guerre: et tout cela est encore relevé en lui par une
merveilleuse élégance de langage, qualité dont il était
particulièrement soigneux. Célius a beaucoup d'esprit, et une
manière d'accuser pleine d'urbanité. C'était un homme digne d'avoir
un meilleur coeur et une vie plus longue. J'ai trouvé des Grecs qui
préféraient Calvus à tous les autres orateurs; j'en ai vu
qui, sur la foi de Cicéron, croyaient que, par trop de sévérité
envers lui-même, il avait ruiné ses forces : mais, selon moi, son
style est noble, grave, et, quoique réservé d'ordinaire, ne manque
pas de véhémence dans l'occasion. Il a écrit dans le goût attique,
et la mort, qui l'a trop tôt ravi, lui a fait ce tort, qu'il eût pu
ajouter à son talent, auquel, à vrai dire, il n'y avait rien à
retrancher. Servius Sulpicius est digne de la grande renommée
que lui ont valu ses trois oraisons. Cassius Sévérus est un
bon modèle en bien des endroits, pourvu qu'on le lise avec
discernement. Il mériterait d'être compté parmi les orateurs de
premier ordre, si, à ses autres qualités oratoires, il eût joint le
coloris et la gravité. Car il a beaucoup d'esprit, et sait mêler une
rare urbanité à ce que la raillerie a de plus acerbe; mais il donne
trop à la passion, et pas assez à la prudence : en outre, comme ses
sarcasmes sont amers, cette amertume dégénère souvent en ridicule.
Il y a une foule d'autres orateurs diserts, qu'il serait trop long
d'énumérer ici. De tous ceux que j'ai connus, les plus remarquables,
sans contredit, sont, Domitius Afer et Julius Africanus.
Le premier est à préférer pour l'art et les qualités générales du
style: je n'hésite pas à le mettre sur la ligne des anciens. Le
second a plus de feu, mais il est trop recherché dans le choix des
mots; sa composition est quelquefois trop prolixe, et il prodigue
outre mesure les métaphores. Naguère encore nous comptions quelques
beaux génies. L'élévation, sans obscurité, caractérisait
Trachalus, et l'idée de la perfection semblait dominer sa
nature; mais il gagnait surtout à être entendu. Je n'ai jamais connu
dans personne un accent aussi heureux; sa prononciation et sa grâce
eussent été applaudies sur un théâtre; enfin il y avait en lui
surabondance de tous les avantages extérieurs. Vibius Crispus
était harmonieux, agréable, et né pour plaire, meilleur néanmoins
pour les causes privées que pour les causes publiques. Julius
Secundus serait certainement passé à la postérité avec un nom
illustre, s'il eût vécu plus longtemps; car il eût ajouté à ses
autres qualités, comme il le faisait déjà, ce que son talent
laissait à désirer; c'est-à-dire qu'il aurait déployé plus de
vigueur, et qu'il se serait montré moins occupé des mots que des
choses. Au surplus, quoique enlevé prématurément, il peut
revendiquer encore une belle place, tant il a non seulement
d'éloquence mais de grâce à exprimer tout ce qu'il veut; tant son
style est pur, doux et brillant; tant son élocution a de propriété,
même dans les mots qu'il tire de loin, et de clarté dans ses
hardiesses.
Ceux qui écriront après moi auront
une ample et digne matière à louer les orateurs justement renommés
qui honorent aujourd'hui le barreau car nous en avons de vieux, dont
le talent consommé rivalise avec celui des anciens; et nous en avons
de jeunes, qui, pleins d'activité, marchent à la perfection sur les
pas de leurs aînés.
Il me reste à parler des philosophes
latins. Dans ce genre, les lettres romaines n'ont produit jusqu'à ce
jour que fort peu d'écrivains éloquents. Là, comme partout,
Cicéron s'est montré le digne émule de Platon. Une haute
éloquence, même de beaucoup supérieure à celle de ses oraisons,
brille dans les traités philosophiques de Brutus; il soutient
le poids de sa matière, et l'on sent qu'il pense ce qu'il dit.
Cornélius Celsus, de l'école philosophique des Sextius, a
laissé un grand nombre d'écrits qui ne manquent ni d'élégance ni de
brillant. Le stoïcien Plancus est utile pour l'érudition.
L'épicurien Catius est un auteur assez léger de fonds, mais
qui pourtant n'est pas dépourvu d'agrément.
En passant en revue les auteurs qui
se sont distingués dans chaque genre d'éloquence, j'ai cru devoir
réserver Sénèque pour le dernier, à cause de l'opinion
accréditée à tort sur mon compte au sujet de cet écrivain; car on
s'est imaginé que je le condamnais et que même je le haïssais. On a
raisonné ainsi en voyant les efforts que je faisais pour empêcher la
corruption entière de l'éloquence, et la ramener à un goût plus
sévère. Ce qui a pu accroître la prévention publique, c'est que,
Sénèque étant presque le seul auteur que la jeunesse eût entre les
mains, sans prétendre l'exclure tout à fait, je ne souffrais pas
qu'on le préférât à d'autres écrivains qui valent mieux, et contre
lesquels il ne cessait de se déchaîner, parce que, sentant
intérieurement combien sa manière était différente, il espérait peu
que son style pût plaire à ceux qui goûteraient le leur. Cependant
ses partisans l'aimaient plus qu'ils ne l'imitaient, et ils
déclinaient aussi loin de leur modèle que celui-ci s'était écarté
des anciens. Car il serait à souhaiter qu'ils lui eussent ressemblé,
ou du moins qu'ils l'eussent suivi de près; mais ils n'aimaient en
lui que ses défauts, et chacun s'appliquait à reproduire ceux qu'il
pouvait; puis, se vantant de parler comme Sénèque, ils
n'aboutissaient qu'à le déshonorer. Car il a d'ailleurs de belles
qualités, et en grand nombre: un esprit facile et abondant, beaucoup
d'étude, et un grand fonds d'érudition, mêlé néanmoins d'erreurs,
par la faute de ceux qu'il chargeait de faire ses recherches. Il est
peu de matières qu'il n'ait traitées; nous avons de lui des
oraisons, des poésies, des lettres, des dialogues. Comme philosophe,
il est peu exact, mais antagoniste hautement déclaré du vice. Il est
plein de pensées éclatantes, et, par rapport aux moeurs, sa lecture
ne peut qu'être utile; mais, pour son style, il est en général
corrompu, et d'autant plus dangereux qu'il abonde en défauts
aimables. On voudrait qu'il eût écrit avec son esprit, mais avec le
goût d'un autre : car, s'il eût dédaigné certains faux brillants,
s'il eût été moins ambitieux, s'il n'eût pas tant aimé tout ce qu'il
produisait, s'il n'eût pas pris plaisir a morceler et amoindrir ses
pensées, le suffrage des savants, bien plus que l'engouement de la
jeunesse, ferait aujourd'hui son éloge. Toutefois, tel qu'il est, il
ne faudra pas laisser de le lire, quand on aura le goût déjà sûr et
suffisamment formé par un genre de lecture plus sévère, ne fût-ce
que parce qu'il peut juger lui-même ses partisans et ses
détracteurs. Car, ainsi que je l'ai dit, il y a en lui beaucoup à
louer, beaucoup même à admirer, pourvu qu'on sache choisir : ce
qu'il eût été à désirer qu'il fit lui-même; car ce beau génie était
digne de vouloir faire mieux, lui qui a fait tout ce qu'il a voulu.
CH. II. C'est dans
ces auteurs et dans tous ceux qui méritent d'être lus qu'il faut
puiser et l'abondance des mots, et la variété des figures, et l'art
de la composition. On s'appliquera aussi à s'approprier toutes les
qualités; car il est indubitable que l'art consiste en grande partie
dans l'imitation. En effet, si l'invention a précédé
l'imitation, et mérite en soi le premier rang, d'un autre côté
l'imitation de ce qui a été bien inventé ne laisse pas d'avoir son
utilité. Toute la conduite de la vie consiste à vouloir faire ce que
nous approuvons dans autrui. C'est ainsi que l'enfant, pour
s'habituer à écrire, suit les caractères qu'on lui a tracés; que les
musiciens se forment sur la voix du maître; les peintres, sur les
ouvrages de leurs devanciers; les agriculteurs, sur les traditions
de l'expérience. Enfin, nous voyons que toute étude se propose, en
commençant, un modèle à imiter. Et véritablement c'est une nécessité
que nous soyons semblables à ceux qui ont bien fait, ou
dissemblables. La ressemblance est rarement le fruit de la nature,
elle est souvent celui dé l'imitation. Mais cette ressource de
l'imitation, qui nous facilite l'exécution de toutes choses, et qui
manquait aux premiers hommes, tourne contre nous-mêmes, si nous ne
savons en user avec circonspection et discernement.
Premièrement donc, l'imitation toute
seule ne suffit pas, ne fût-ce que parce qu'il est d'un esprit
paresseux de s'en tenir à ce que les autres ont inventé. En effet,
que serait-il arrivé dans ces temps où l'on ne pouvait se proposer
aucun modèle, si les hommes avaient cru ne devoir rien faire, rien
imaginer au-delà de ce qu'ils connaissaient? On serait resté
stationnaire. Pourquoi donc nous serait-il fatalement interdit de
découvrir ce qui ne l'aurait pas été avant nous? Quoi ! les premiers
hommes, tout grossiers qu'ils étaient, et sans autre guide que
l'instinct, auront fait tant de découvertes; et nous, qui savons que
ce n'est qu'en cherchant qu'ils ont trouvé, cela ne nous déterminera
pas à chercher aussi ! Sans le secours d'aucun maître, ils nous ont
transmis une foule d'arts et de sciences; et nous, pour qui cet
héritage devrait être la source de nouvelles richesses, nous ne
posséderons rien que nous ne devions à autrui, semblables à ces
peintres qui ne s'étudient qu'à calquer leurs modèles! C'est encore
une honte de n'aspirer qu'à égaler ce que l'on imite : car, je le
répète où en serait-on, si chacun n'eût fait que suivre son guide?
Nous n'aurions rien en poésie au-dessus de Livius Andronicus;
rien en histoire au-dessus des Annales des pontifes; on
naviguerait encore sur des radeaux, et la peinture se réduirait à
tracer les contours de l'ombre des corps. Passez en revue tous les
arts, vous n'en trouverez pas un qui soit demeuré tel qu'il a été
inventé, et qui n'ait fait aucun progrès. Il faudra donc dire que
notre siècle, seul entre tous les autres, est condamné à
l'impuissance et à la stérilité; car rien ne s'accroît par la seule
imitation. Que s'il est impossible de rien ajouter à ce qui a été
avant nous, le moyen d'espérer de voir jamais cet orateur parfait
dont nous avons l'idée, puisque, de tous les orateurs que nous
connaissons, quelque grands qu'ils aient été, on ne saurait en citer
un seul en qui il n'y ait quelque chose à désirer ou à reprendre? Je
dirai plus : en admettant même qu'on n'aspire point à la perfection,
une noble rivalité vaut mieux qu'une imitation servile; car
quiconque a l'ambition d'aller plus loin qu'un autre peut du moins,
s'il ne le devance, marcher de pair avec lui : ce qui est
impossible, s'il se borne à se traîner sur ses traces. En effet, il
faut nécessairement que celui qui suit reste toujours derrière.
Ajoutez que d'ordinaire il est plus aisé de faire plus, que de faire
de même : car la ressemblance est si difficile à obtenir, que la
nature elle-même n'y a pas réussi; que les choses les plus simples,
et qui paraissent les plus semblables entre elles, ne laissent pas
d'avoir quelque différence qui les distingue. En outre, toute copie
est toujours moindre que l'original; elle est ce que l'ombre est au
corps, le portrait à la figure qu'il représente, et le jeu des
comédiens aux sentiments réels qu'ils veulent exprimer. Il en est de
même de l'éloquence oratoire. Les orateurs qu'on prend pour modèles
reçoivent leur mouvement de la nature, et d'une force réelle qui les
anime intérieurement; l'imitation, au contraire, est servile et
fictive, et n'a jamais rien de propre. Voilà pourquoi les
déclamations ont moins de sang et de nerfs, pour ainsi dire, que les
oraisons, parce que le sujet des unes est réel, et que celui des
autres est fictif. Ajoutez enfin que les qualités les plus
importantes d'un orateur ne sont pas susceptibles d'imitation, je
veux dire l'esprit, l'invention, la force, la facilité, en un mot
tout ce que l'art n'enseigne pas. Cependant bien des gens, pour
s'être approprié certaines expressions, certaines formes de
composition, s'imaginent avoir complètement reproduit leur modèle:
ils ne voient pas que la langue change avec le temps, que les mots
meurent et renaissent au gré de l'usage, qui en est presque runique
règle; car les mots ne sont ni bons ni mauvais, n'étant par eux-
mêmes que des sons; mais ils deviennent bons ou mauvais, selon
qu'ils sont bien ou mal placés. Et quant à la composition, ils ne
songent pas qu'elle doit être en harmonie avec la nature des choses,
et qu'elle tire, de la variété son principal agrément.
Il faut donc examiner avec
l'attention la plus judicieuse tout ce qui regarde cette partie des
études : d'abord, qui sont ceux qu'on se propose d'imiter; car bien
des gens prennent pour modèles de fort mauvais originaux, et même
leur prédilection s'attache aux plus détestables; en second lieu, ce
qu'on a l'intention d'imiter dans ceux-là même qu'on aura choisis;
car les meilleurs auteurs ont leurs défauts, et certains endroits
dont le mérite est débattu entre les savants. Et plût au ciel que
l'imitation de ce qui est bon nous portât à faire mieux, comme
l'imitation de ce qui est mauvais nous porte à faire pis ! Mais que
ceux du moins qui ont assez de jugement pour éviter le mal ne s'en
tiennent pas, en imitant les qualités, à une vaine apparence, qui
n'en est, pour ainsi dire, que l'épiderme, ou qui ressemble, pour
mieux dire, aux simulacres d'Épicure. C'est ce qui arrive à ceux
qui, n'examinant rien à fond, ne s'arrêtent qu'à la surface de
l'éloquence. Comme cette imitation leur réussit sans peine, ils
attrapent bien la ressemblance des mots et des nombres, mais ils ne
reproduisent ni la force de l'élocution ni celle de l'invention. Le
plus souvent, au contraire, ils glissent dans le défaut voisin de la
qualité : ils remplacent l'élévation par l'enflure, la concision par
la maigreur, l'audace par la témérité, la richesse par un faux luxe,
l'harmonie par le désordre, la simplicité par la négligence. Aussi,
dès qu'ils sont parvenus à revêtir quelque pensée froide et vide
d'une forme dure et barbare, ils croient égaler les anciens;
dépourvus d'ornements et de pensées, ils s'imaginent écrire dans le
goût attique; concis jusqu'à l'obscurité, ils surpassent Thucydide
et Salluste; secs et maigres, ils ressemblent à Pollion; oiseux et
languissants, s'ils ont embarrassé une pensée dans une longue
périphrase, ils assurent que Cicéron n'aurait pas mieux dit. J'en ai
connu qui croyaient avoir parfaitement reproduit la manière de ce
divin orateur, lorsqu'ils avaient pu clore une période par un
esse videatur. Il faut donc commencer par bien connaître le
modèle que l'on se propose d'imiter, et par savoir en quoi il mérite
d'être imité; ensuite, on mesurera ses forces; car il y a des choses
qui sont imitables, mais que notre insuffisance naturelle ou le
genre de notre esprit nous interdit d'imiter. Un esprit fin et délié
ne doit pas s'opiniâtrer sur un sujet qui demande de la force et de
la véhémente; un esprit fort, mais fougueux, perdra sa vigueur en
courant après la délicatesse, sans jamais rencontrer l'élégance
qu'il ambitionne; car rien n'a si mauvaise grâce que de manier avec
rudesse ce qui est tendre. Cependant j'ai dit, dans le second livre,
qu'un maître doit non seulement cultiver les dispositions naturelles
d'un enfant, mais venir en aide à ce qu'il y a de bon en lui, et,
autant que possible, ajouter, corriger, modifier: c'est qu'autre
chose est de diriger et de former l'esprit d'autrui, autre chose, et
chose plus difficile, des façonner son propre esprit. Toutefois, le
maître, quel que soit son désir de perfectionner son élève dans tout
ce qu'il a de bon, n'entreprendra pas de forcer en lui la nature. Un
autre défaut à éviter, et dans lequel tombent bien des gens, c'est
d'imiter en prose les poètes et les historiens, et en poésie les
orateurs ou les déclamateurs. Chaque genre d'éloquence a sa loi, sa
convenance : la comédie ne se guinde pas sur le cothurne, et la
tragédie ne chausse point le brodequin. Chaque genre a cependant
quelque chose du commun, et c'est ce point commun qu'il faut imiter.
Et même ceux qui prennent pour modèle un écrivain de même genre ne
laissent pas de s'égarer dans leur imitation. Si, par exemple, la
rudesse d'un orateur leur a plu, ils la transportent jusque dans un
sujet qui demande de la douceur et du poli. Au contraire, ils
appliqueront, par une imitation maladroite, la finesse et l'agrément
à un sujet grave et épineux, et ne réussiront par là qu'à affaiblir
les pensées. Ils ne voient pas qu'il faut traiter différemment non
seulement l'ensemble d'une cause, mais encore ses parties; qu'une
chose doit être exprimée avec douceur, une autre avec rudesse;
celle-ci avec feu, celle-là avec modération; qu'il faut parler
tantôt pour instruire, tantôt pour émouvoir; qu'en tout cela les
procédés sont différents et distincts. Aussi ne conseillerai-je pas
même de s'attacher uniquement à un modèle, pour ne suivre que lui en
tout. Démosthène est sans doute le plus parfait de tous les orateurs
grecs; d'autres cependant peuvent avoir mieux dit quelque chose en
quelque rencontre: et parce qu'il est le plus digne d'être imité,
est-il donc le seul qu'on doive imiter? Quoi donc? ne suffirait-il
pas de parler toujours comme Cicéron? Certainement je me
contenterais de cette ressemblance, si je pouvais y atteindre en
tout; mais où serait le danger de chercher quelquefois à imiter en
sus la véhémence de César, la rudesse de Célius, l'exactitude de
Pollion, le goût de Calvus? Car, outre que la prudence nous
conseille de nous approprier, si cela est possible, ce qu'il y a de
mieux dans chacun, l'imitation est en soi une chose si difficile,
que celai qui s'attache à un seul modèle en rend à peine quelque
partie. Aussi, puisqu'il n'est pas donné à l'homme de reproduire
entièrement son modèle, jetons les yeux sur plusieurs, pour prendre
aux uns et aux autres quelque venable.
Au reste (car je ne me lasserai pas
de le répéter), que l'imitation ne tombe pas seulement sur les mots.
Il faut élever son esprit plus haut, et considérer l'art avec lequel
ces grands auteurs ont observé ce qui regarde la convenance par
rapport aux choses et aux personnes, le dessein, la disposition;
comme ce qu'ils semblent n'avoir dit que pour plaire tend néanmoins
au gain de la cause; ce qu'ils se sont proposé dans l'exorde;
comment et de combien de manières ils s'y sont pris pour narrer;
avec quelle vigueur ils ont traité la confirmation et la réfutation;
avec quelle adresse ils ont manié tous les genres de passions; ce
qu'ils ont, dans l'intérêt de la cause, accordé au soin de plaire à
la multitude, récompense brillante et honorable quand elle vient
trouver l'orateur, et non quand celui-ci court au-devant d'elle.
Celui qui, à ces emprunts, joindra des qualités personnelles, pour
suppléer à ce qui manque à son modèle, et retrancher ce qu'ira de
trop, celui-là sera l'orateur parfait que nous cherchons. Or, s'il
était réservé à un siècle de le voir, quel autre pourrait, plus
raisonnablement que le nôtre, ambitionner cette gloire, environnés
que nous sommes de bien plus de modèles que n'en ont eu ceux qui
sont encore aujourd'hui nos maîtres? Car, pour eux, ils auront
toujours la gloire d'avoir surpassé leurs devanciers, et d'avoir
servi de guides à leurs descendants.
CH.III. La lecture
et l'imitation sont des moyens extrinsèques; quant à ceux que nous
devons chercher en nous-mêmes, si le style est un exercice
laborieux, il est aussi l'exercice le plus utile. Et ce n'est pas
sans raison que Cicéron a dit que le style est le meilleur
artisan, le meilleur maître d'éloquence : parole qu'il met dans
ta bouche de L. Crassus, pour appuyer son jugement de l'autorité de
cet orateur.
Il faut donc écrire avec tout le soin
possible, et beaucoup écrire; car de même que plus on creuse
profondément la terre, plus elle féconde et développe les semences
qui lui sont confiées; de même l'esprit, lorsqu'on ne se borne pas à
une culture superficielle, répand ses fruits avec plus d'abondance
et les conserve mieux. Sans la cons. cience de ce travail
préparatoire, notre improvisation n'aboutira qu'à une vaine
loquacité, et à des mots nés, pour ainsi dire, sur le bout des
lèvres. Là est la racine, le fondement, le trésor de cette éloquence
qui ne fait jamais défaut. Avant tout, créons-nous des forces qui
soient à l'épreuve du combat, et que l'usage n'épuise pas : car la
nature elle-même n'a pas voulu que rien de grand pût se faire en peu
de temps et elle a attaché de la difficulté à tout ce qui est beau.
C'est même une des lois de la génération, que les animaux qui
surpassent les autres en grandeur soient aussi ceux qui restent le
plus longtemps dans les entrailles maternelles.
Mais comme on a coutume d'examiner
ici deux choses, et comment on doit s'exercer à écrire, et
sur quoi, je vais suivre cet ordre. Dans les commencements, que
le style ne soit pas trop précipité, qu'il soit même lent, pourvu
qu'il soit exact; qu'on cherche ce qu'il y a de mieux, et qu'on ne
se contente pas de ce qui se présente d'abord à l'esprit. On
soumettra à un examen judicieux ce qu'on aura inventé, et on
disposera ensuite ce qu'on aura laissé comme bon. Car il y a un
choix à faire, non seulement dans les choses, mais aussi dans les
mots; et chaque chose, chaque mot doit être pesé attentivement.
Ensuite on passera à la composition, on tournera et retournera les
nombres, et on ne laissera pas les mots se placer indifféremment
comme ils se présentent. Et, pour procéder méthodiquement, il faudra
relire souvent les dernières lignes qu'on aura écrites : car, outre
que par là ce qui précède se lie mieux à ce qui suit, la chaleur de
la pensée, qu'a dû nécessairement refroidir l'action d'écrire, se
renouvelle et reprend, pour ainsi dire, son élan. C'est ainsi que
nous voyons les sauteurs reculer de plusieurs pas, et revenir en
courant à l'endroit d'où ils doivent s'élancer; c'est ainsi que,
pour darder un javelot, nous ramenons le bras à nous, et que, pour
décocher un trait, nous tirons la corde de l'arc en arrière.
Quelquefois pourtant, si nous avons le vent en poupe, déployons
toutes nos voiles, mais gardons-nous d'une imprudente sécurité, car
toutes nos pensées nous plaisent dans le moment de leur production;
autrement, nous ne les écririons pas : mais il faut revenir sur son
premier jugement, et remanier ce premier jet d'une facilité
suspecte. C'est ainsi, dit-on, que composait Salluste; et la peine
qu'il se donnait se fait même sentir au lecteur. Varus nous apprend
aussi que Virgile ne faisait que très peu de vers dans un jour. Il
est vrai que la condition de l'orateur est autre : aussi je n'exige
cette lenteur et cette sollicitude que dans les commencements; car
ce que nous devons nous imposer d'abord comme une loi, ce que nous
devons d'abord obtenir, c'est d'écrire le mieux possible; l'habitude
nous donnera la vitesse; peu à peu les idées se présenteront avec
moins d'effort, les mots suivront les idées, la composition
accompagnera les mots; tout enfin, comme dans une maison bien
réglée, sera à son poste. Voilà le point essentiel. On ne parvient
pas à écrire bien en écrivant vite, mais on parvient à écrire vite
en écrivant bien. Mais c'est particulièrement lorsqu'on aura acquis
cette facilité qu'il faudra savoir faire halte, afin de s'orienter,
et mettre un frein à son impétuosité, comme à celle d'un cheval
fougueux : cela même, loin de nous retarder, ranimera nos forces.
Car je ne prétends pas que, après être parvenu à une certaine
maturité de style, on se condamne encore au supplice de chicaner
sans cesse contre soi-même. Qui pourrait suffire à tous les devoirs
de la vie civile, s'il fallait vieillir sur chacune des parties d'un
plaidoyer? Cependant on voit des gens qui jamais ne sont contents
d'eux-mêmes, qui veulent toujours tout changer, tout dire autrement
qu'ils ne l'ont d'abord conçu; il en est d'autres qui sont, pour
ainsi dire, méfiants et ingrats envers eux-mêmes, et qui prennent
pour exactitude le tourment qu'ils se donnent. Je ne saurais dire
lesquels me paraissent le plus condamnables, de ceux qui trouvent
bien tout ce qu'ils font, ou de ceux qui trouvent tout mal: car il
arrive souvent à des jeunes gens, nés avec d'heureuses dispositions,
de se consumer sur leur travail, et de se condamner au silence en
voulant trop bien dire. Cela me rappelle ce que me conta un jour
Julius Secundus, qui a été mon contemporain, et, comme on sait, mon
ami intime; homme d'une rare éloquence, quoique exact jusqu'au
scrupule. Il avait pour oncle Julius Florus, le premier pour
l'éloquence dans les Gaules (car il n'exerça que dans cette
province), comparable, du reste, aux orateurs les plus diserts, et
digne d'être le parent de Secundus. Dans le temps que celui-ci était
encore aux écoles, son oncle, le voyant tout mélancolique, lui
demanda d'où venait son air soucieux. Le jeune homme lui avoua que,
depuis trois jours, il se tourmentait pour trouver un exorde à la
matière qu'on lui avait donnée à traiter, sans en pouvoir venir à
bout : ce qui non seulement le chagrinait pour le présent, mais le
désespérait pour l'avenir. Alors Florus lui souriant : Hé quoi,
dit-il, voulez-vous mieux faire que vous ne pouvez? Tout se
réduit donc à ce précepte : Il faut tâcher d'écrire le mieux qu'on
peut, mais écrire pourtant comme on peut; car ce qui fait qu'on
avance, c'est l'étude, et non le dépit. Or, pour pouvoir écrire
beaucoup et vite, non seulement l'exercice est nécessaire, mais
aussi la méthode. Si donc, au lieu de regarder nonchalamment en
l'air, et d'exciter notre imagination par une espèce de
bourdonnement, comme des rêveurs qui attendent le passage d'une
idée, nous examinons d'abord ce que demande notre sujet, ce que
réclament les personnes et les circonstances, quelles sont les
dispositions du juge, et qu'ensuite nous nous mettions à écrire dans
un état d'esprit purement humain, la nature elle-même nous suggérera
ce que nous devons dire en commençant, et ainsi de suite: car la
plupart des choses que nous devons dire sont déterminées et nous
frapperont les yeux, si nous ne les fermons pas. Voilà pourquoi les
ignorants et les paysans eux-mêmes ne cherchent pas longtemps par où
commencer. Il serait vraiment honteux que l'art ne contribuât qu'à
nous embarrasser. Aussi ne nous figurons pas que ce qui est caché
soit toujours le meilleur. Autrement, si nous ne voyons jamais de
bon à dire que ce que nous n'avons pas trouvé, il ne nous reste
qu'un parti à prendre, celui de nous taire. Ceux-là tombent dans un
défaut contraire, qui traversent rapidement la matière d'un bout à
l'autre, et, s'abandonnant au feu et à l'impétuosité du premier
moment, écrivent d'improvisation tout ce qui leur vient à l'esprit
(ce qu'on appelle silva); puis, revenant sur leurs pas,
corrigent ce qu'ils ont jeté sur le papier. Mais ce sont les mots
qu'ils polissent, ce sont les périodes qu'ils arrondissent; quant
aux choses, elles demeurent aussi superficielles que la
précipitation les avait fait naître. Or, il vaut mieux travailler
tout d'abord avec soin, et, dès le commencement, conduire son oeuvre
de manière à n'avoir plus qu'à la ciseler, et non à la refondre tout
entière.
Quelquefois cependant on pourra
s'abandonner à l'inspiration, parce que d'ordinaire la chaleur fait
plus alors que la réflexion et le soin. Si je blâme ceux qui
écrivent avec négligence, c'est faire entendre assez ce que je pense
de ces sybarites qui ne prennent pas même la peine d'écrire, et qui
dictent; car du moins les premiers, malgré leur précipitation, ne
laissent pas de donner un moment à la réflexion, parce que leur main
ne court pas aussi vite que leur pensée : mais celui à qui vous
dictez vous presse, vous harcèle; et comme on rougirait, ou
d'hésiter, ou de demeurer court, ou de se reprendre, dans la crainte
d'avoir un témoin de sa faiblesse, il arrive que,préoccupé de la
liaison des idées, vous laissez échapper beaucoup de choses qui sont
non seulement brutes et fortuites, mais quelquefois même impropres :
d'où il résulte un travail qui n'a ni le fini d'une, composition
écrite, ni la chaleur d'une improvisation. Que si le secrétaire
écrit lentement, ou relit mal, il devient comme une pierre
d'achoppement qui arrête notre essor et distrait notre attention par
ce retard, auquel se joint quelquefois la mauvaise humeur. Ajoutez à
cela que notre conception est d'ordinaire accompagnée de certains
mouvements extérieurs qui même servent d'aiguillons à la pensée,
comme de gesticuler, de faire des grimaces, de se tourner de côté et
d'autre, et quelquefois de se battre les flancs, et autres
démonstrations auxquelles Perse fait allusion lorsqu'il dit, en
parlant d'un style négligé : L'auteur n'a point brisé son
pupitre, ni rongé ses ongles. Or, toutes ces démonstrations sont
risibles, à moins d'être seul. Enfin, et pour finir par la
considération la plus puissante, la solitude et la dictée sont
incompatibles. Or, nul doute que le secret, le silence absolu, ne
soient des conditions indispensables pour bien composer. Toutefois,
il ne faut pas s'en rapporter sans examen à ceux qui nous
conseillent les bois et les forêts, sous prétexte que rien n'est
plus propre à élever l'âme et à l'inspirer, que le libre espace du
ciel et la beauté de la nature. Pour moi, j'estime que ces retraites
sont plus propices au plaisir qu'à l'étude; car l'agrément qu'elles
ont par elles-mêmes nous distrait nécessairement de notre travail.
Il est impossible que l'esprit s'applique sérieusement et tout
entier à plusieurs choses à la fois, et, du moment que nous levons
les yeux, nous oublions ce que nous étions venus chercher. Le riant
aspect des bois, le murmure des eaux, le souffle de la brise qui se
joue dans les rameaux des arbres, le gazouillement des oiseaux, le
lointain de l'horizon, tout cela nous attire et nous captive; de
sorte que le charme de ces retraites me semble plutôt fait pour
relâcher l'esprit que pour le tendre. Démosthène faisait mieux, qui
s'enfermait dans un lieu d'où il ne pouvait rien entendre, rien voir
qui pût lui donner des distractions. Aussi, lorsque nous veillons,
qu'une chambre fermée, silencieuse, et éclairée d'une seule lumière,
nous tienne, pour ainsi dire, cachés. Mais si tous les genres
d'études demandent une bonne santé, et, ce qui y contribue le plus,
la frugalité, ces deux conditions sont surtout nécessaires à
l'élucubration, puisque nous consacrons au travail le plus vif le
temps que la nature elle-même a destiné au repos et à la réparation
de nos forces. Toutefois, il ne faut prendre que sur le superflu du
sommeil, jamais sur le nécessaire : car la fatigue nuit à
l'application, et le jour suffit à qui a du loisir. La multitude des
affaires peut seule obliger à travailler la nuit.
Du reste, il n'est point de genre de
solitude préférable aux veilles, quand nous y entrons frais et
dispos. Mais si le silence, la retraite, l'entière liberté d'esprit,
sont des avantages très désirables, d'un autre côté ils ne sont pas
toujours en notre pouvoir. Il ne faut donc pas, au moindre bruit,
jeter ses tablettes et déplorer le temps comme perdu. Il faut, au
contraire, résister à ces importunités, et se faire une habitude de
vaincre tous les obstacles par l'application. Or, si nous nous
saisissons fortement de notre objet, rien de ce qui frappera nos
yeux et nos oreilles n'arrivera jusqu'à notre âme. Le hasard même ne
fait-il pas souvent qu'en rêvant profondément à une chose, nous ne
voyons pas les personnes qui viennent à nous, et que nous prenons un
chemin pour un autre? Pourquoi ne parviendrions-nous pas à nous
créer cette solitude intérieure, si nous le voulions? Ne cherchons
pas de prétexte à notre paresse; car si nous croyons ne devoir nous
mettre au travail que bien dispos de corps et d'esprit, nous ne
manquerons jamais d'excuses envers nous-mêmes. Mais, au milieu du
monde, en voyage, à table, il faut que l'âme se fasse une véritable
solitude. Autrement, que sera-ce lorsque, en plein barreau, au
milieu des débats judiciaires, des querelles, des clameurs
fortuites, il nous faudra prendre sur-le-champ la parole et
prononcer un discours suivi; que sera-ce, dis-je, si nous ne pouvons
retrouver que dans la solitude la suite des idées que nous avons
confiées à nos tablettes? C'est pour cela que ce même Démosthène, ce
grand partisan de la retraite, allait souvent déclamer sur le rivage
de la mer, à l'heure où les flots s'y brisaient avec le plus de
fracas, afin de s'accoutumer à braver les frémissements de la
multitude. Rien n'est à négliger de ce qui regarde les études; aussi
recommanderai-je d'écrire de préférence sur des tablettes en cire,
parce qu'on efface plus aisément, à moins que la faiblesse de la vue
ne force à recourir à l'usage du parchemin, qui, à la vérité,
soulage les yeux, mais qui aussi, à cause de la nécessité de tremper
souvent sa plume dans l'encre, retarde la main et entrave l'essor de
la pensée. Dans les deux cas, il faut avoir soin de laisser assez
d'espace pour pouvoir ajouter ce que l'on veut: car, si l'on est à
l'étroit, cela rend quelquefois paresseux pour corriger ou du moins
ce qui a été écrit d'abord se confond avec ce qu'on ajoute. Je ne
veux pas non plus que les tablettes soient démesurément grandes.
J'ai connu un jeune homme, fort laborieux d'ailleurs, qui prononçait
des discours dont l'excessive longueur semblait accuser peu de
préparation, et cela parce qu'il les mesurait par le nombre des
lignes; et ce défaut, dont il ne pouvait, malgré des remontrances
réitérées, parvenir à se défaire, disparut du moment qu'il eut
changé de tablettes. Il faut aussi réserver une marge pour certaines
idées qui se présentent hors de leur rang, c'est-à-dire qui sortent
d'un lieu autre que celui où nous sommes; car il survient
quelquefois, comme à la traverse, d'excellentes pensées, qui ne
peuvent trouver immédiatement leur place, et qu'il n'est pas sûr
d'ajourner, parce qu'elles sont sujettes à échapper; ou, si nous
nous y arrêtions, elles nuiraient à d'autres pensées : le mieux donc
est de les mettre en dépôt.
CHAP. IV. Suit la
correction, une des plus utiles parties des études; car ce n'est
pas sans raison qu'où a dit que le style n'agit pas moins en
effaçant. Or, corriger, c'est ajouter, retrancher,
changer. Quand il ne s'agit que d'ajouter ou de retrancher,
c'est chose assez facile et assez simple; mais lorsqu'il faut
resserrer ce qui est enflé, relever ce qui est rampant, réduire ce
qui est surabondant, digérer ce qui est désordonné, lier ce qui est
lâche, ralentir ce qui est précipité, voilà ce qui coûte doublement;
car il nous faut condamner ce qui nous avait plu, et trouver ce qui
nous avait échappé. Il n'est pas douteux que la meilleure méthode ne
soit de laisser reposer pendant quelque temps. ce qu'on a écrit,
pour le revoir ensuite comme un ouvrage tout nouveau et composé par
un autre, et ne pas se laisser abuser par cette tendresse qu'ont
tous les pères pour l'enfant qui vient de leur naître. Mais cela
n'est pas toujours possible, surtout pour l'orateur, qui est souvent
pressé par le temps. Ensuite, la correction doit avoir une fin ; car
il y a des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'ils ont écrit,
qui y reviennent continuellement; qui, comme si rien ne pouvait être
bon de ce qui s'est d'abord présenté à leur esprit, croient que tout
ce qui est autre est meilleur, et trouvent toujours quelque chose à
corriger, chaque fois que leur écrit leur tombe sous la main ;
semblables à ces médecins qui taillent jusque dans les chairs les
plus vives et les plus saines. Aussi arrive-t-il que leurs écrits
sont, pour ainsi dire, sillonnés de cicatrices, pâles, et exténués
par les remèdes. Souffrons donc que ce que nous avons écrit
parvienne enfin à nous plaire, ou du moins à nous paraître
suffisamment travaillé, de sorte que la lime ne fasse que polir
l'ouvrage, sans l'user. Le temps que nous donnons à la correction
doit avoir aussi ses bornes. Que Cinna ait mis, dit-on, neuf ans à
composer sa Zmyrna, qu'Isocrate en ait mis dix et même quinze
à écrire son Panégyrique, cela ne tire pas à conséquence pour
l'orateur, dont l'assistance sera nulle, si elle est aussi lente.
CHAP. V. J'ai
maintenant à parier des matières dont on doit principalement
faire choix pour écrire. Ce serait tomber dans des redites, que
d'expliquer ici quelles doivent être ces matières, la première, la
seconde, et ainsi de suite; car j'ai traité dans le premier livre et
dans le second de l'ordre à observer dans les études des différents
âges. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de ce qui contribue le plus
à procurer l'abondance et la facilité. Traduire du grec en latin
était, au jugement de nos anciens orateurs, l'exercice le plus
utile. C'est celui auquel L. Crassus dit, dans le traité de Cicéron
intitulé de Oratore, qu'il s'est souvent livré; c'est celui
que Cicéron recommande expressément en son propre nom. On sait même
qu'il publia une traduction de divers ouvrages de Platon et de
Xénophon. C'était l'avis de Messala, qui traduisit aussi un grand
nombre de plaidoyers grecs, entre autres celui d'Hypéride pour
Phryné, où il réussit avec tant de bonheur, que la version le
disputait à l'original pour la délicatesse de style, qualité que le
génie de notre langue a tant de peine à attraper. Et la raison de
cet exercice est évidente; car les auteurs grecs sont pleins de
choses, et ils ont mis beaucoup d'art dans l'éloquence. En les
traduisant, on est maître de se servir des meilleurs termes, car le
traducteur les prend dans sa langue; et quant aux figures, que l'on
doit regarder comme le principal ornement de l'oraison, on est dans
la nécessité d'en imaginer un grand nombre et d'un genre tout
différent, parce que le génie des deux langues est rarement le même.
Mais l'exercice qui consiste à convertir du latin en d'autres termes
est aussi fort utile. Je crois qu'à l'égard des vers personne n'en
doute, et l'on dit que Sulpicius ne s'exerçait pas autrement. En
effet, l'enthousiasme de la poésie peut passer dans la prose, et
l'audace du poète n'ôte pas au prosateur la faculté d'employer les
mêmes mots avec propriété. On peut même, en conservant la substance
des choses, les revêtir de la force oratoire, suppléer ce que le
poète a omis, resserrer ce qu'il a trop étendu; car je veux que
cette paraphrase soit, non une pure interprétation, mais une
imitation libre, ou plutôt un combat d'émulation autour des mêmes
pensées. Aussi je ne partage pas l'opinion de ceux qui blâment cette
dernière sorte d'exercice, sous prétexte que, le mieux étant déjà
trouvé, on ne peut que dire moins bien. il ne faut pas toujours
désespérer de rencontrer mieux; car la nature n'a pas fait
l'éloquence si stérile et si pauvre, que la même chose ne puisse
être bien dite qu'une seule fois. Quoi ! un histrion pourra varier
son jeu dans le même rôle, et l'orateur, moins fécond, n'aura rien à
dire sur une matière, parce qu'elle aura été traitée avant lui? Mais
j'accorde qu'on ne puisse dire ni mieux ni aussi bien : cela
n'exclut pas la proximité. Est-ce que nous-mêmes nous ne parlons pas
deux fois et même plus souvent de la même chose, et cette chose
n'est-elle pas quelquefois la matière d'une longue série de pensées?
Pourquoi donc, si nous pouvons lutter avec nous-mêmes, ne le
pourrions-nous pas avec autrui? S'il n'y avait qu'une seule manière
de bien dire, on pourrait en conclure que nos devanciers nous ont
fermé le chemin; mais il est plus d'une manière de bien dire, et
mille chemins conduisent au même but. La brièveté a sa beauté,
l'abondance a aussi la sienne; ainsi de la métaphore et de la
propriété, ainsi du langage direct et du langage figuré. Enfin, la
difficulté ne peut que rendre cet exercice extrêmement utile, outre
que, parce moyen, on acquiert une connaissance plus approfondie des
bons auteurs : car alors on ne lit pas superficiellement leurs
écrits; mais on pèse, on approfondit tout, et l'impossibilité même
de les imiter nous fait sentir encore mieux leur excellence. Nous
ferons bien de nous exercer ainsi, non seulement sur les écrits
d'autrui, mais encore sur les nôtres, en choisissant, à dessein,
certaines pensées, pour les remanier de plusieurs façons et leur
donner le tour le plus nombreux possible c'est ainsi qu'on façonne
le même morceau de cire en différentes figures. Je crois même que
les matières les plus simples sont aussi les plus propres à former
en nous le talent dont je parle; car la multiplicité des personnes,
des motifs, des temps, des lieux, des dits, des faits, nous permet
de dissimuler notre faiblesse, et il est bien rare que, au milieu de
tant de choses qui s'offrent en foule, nous ne sachions tirer parti
de quelqu'une. Mais où paraît le mérite de l'orateur, c'est à savoir
étendre ce qui est naturellement resserré, donner de l'importance à
ce qui en a peu, jeter de la variété sur ce qui est monotone,
répandre de l'agrément sur les choses les plus communes, parler bien
et longtemps sur un sujet qui semble ne comporter que quelques mots.
Pour cela, les questions générales, qu'on appelle thèses, sont d'un
grand secours, et Cicéron, alors même qu'il était revêtu des
premières charges de la république, ne dédaignait pas d'en faire son
exercice. Il y en a un autre, qui n'est pas fort différent, et qui
consiste à réfuter ou à confirmer des sentences; car ces sentences
étant des espèces de préceptes et de décisions, les questions que
l'on fait sur le fond des choses qui en sont la matière peuvent
aussi tomber sur le jugement qu'on en a porté. On pourra aussi, à
l'exemple de plusieurs orateurs, s'exercer sur des lieux communs.
En effet, quiconque aura traité avec
abondance ces propositions où tout est direct et sans détours, n'en
aura que plus de fécondité dans les sujets qui comportent de
nombreuses excursions, et ne sera jamais au dépourvu dans aucune
cause; car toute cause se résout en questions générales. Qu'importe,
en effet, que Cornélius, tribun du peuple, soit accusé pour avoir
lu le projet de loi; ou qu'on recherche, en général, si un
magistrat a commis un crime de lèse-majesté pour avoir lu lui-même
la loi qu'il proposait? Qu'importe qu'on ait à juger si Milon
a tué Clodius justement, ou s'il nous est permis de tuer un homme
qui nous tend des embûches, ou un citoyen dangereux, quand même il
n'en voudrait pas à notre vie? Si Caton a pu honnêtement donner
Marcia à Hortensius, ou si une pareille action est digne d'un homme
de bien? Le jugement tombe sur les personnes; et la question,
sur les choses. A l'égard des déclamations de l'école, si l'on s'y
propose l'imitation d'un plaidoyer réel, elles sont très utiles non
seulement aux jeunes orateurs, en ce qu'elles exercent à la fois à
l'invention et à la disposition, mais même à des orateurs consommés,
et qui sont déjà célèbres au barreau. Ces déclamations sont comme
une nourriture succulente qui donne de l'embonpoint et de l'éclat à
l'éloquence, la rafraîchit, et renouvelle sa sève, épuisée par la
sécheresse des débats judiciaires. Aussi suis-je d'avis que l'on
s'essaye de temps en temps au style abondant de l'histoire, et à la
vive allure des dialogues. On peut même, sans inconvénient, se
permettre quelques délassements poétiques, à l'exemple des athlètes,
qui interrompent en certains temps leur régime, leurs exercices
ordinaires, pour retraiter plus délicatement et prendre un peu de
relâche. Et je suis persuadé que Cicéron n'a porté si haut
l'éloquence, que parce qu'il savait recourir à cette heureuse
diversion. Car, si nous n'avons jamais d'autres matières que des
procès, il est impossible que notre esprit ne se rouille, ne perde
sa flexibilité, et ne s'émousse comme un glaive, à force de
ferrailler. Mais si ces déclamations, en faisant, pour ainsi dire,
rentrer l'éloquence dans le fourreau, la renouvellent,et la reposent
des fatigues du barreau, d'un autre côté il ne faut pas retenir les
jeunes gens trop longtemps dans ce monde imaginaire, au milieu de
ces simulacres de controverses; de peur que, lorsque le temps est
venu de sortir de cette ombre, où ils ont, pour ainsi dire, vieilli,
les dangers réels ne produisent sur eux l'effet du grand jour. C'est
ce qui est arrivé à plusieurs, et même, dit-on, à Porcius Latron, le
premier professeur célèbre qu'il y ait eu à Rome. Il s'était fait
une grande réputation dans son école; cependant, un jour qu'il
voulut plaider au barreau, il se trouva si déconcerté, qu'il demanda
instamment qu'on transportât l'audience dans un palais voisin.
L'aspect du ciel lui parut si nouveau, que l'on eût dit que toute
son éloquence était renfermée sous un toit, entre quatre murailles.
Je veux donc qu'un jeune homme, après avoir bien appris tout ce qui
regarde l'invention et l'élocution (ce qui ne demande pas un temps
infini, si les maîtres savent et veulent enseigner), et après avoir
acquis un peu d'habitude et de facilité; je veux, dis-je, que, à la
manière des anciens, il fasse choix d'un orateur pour s'attacher à
lui et en faire son modèle; qu'il fréquente assidûment le barreau,
et assiste souvent à ces combats auxquels il se destine; qu'ensuite
il traite lui-même pour et contre les mêmes causes qu'il aura
entendu plaider, ou d'autres, si l'on veut, pourvu que ce soient des
causes réelles; en un mot, qu'il fasse ce que nous voyons faire aux
gladiateurs, c'est-à-dire qu'il s'exerce avec des armes sérieuses.
C'est ainsi, comme je l'ai déjà dit, que Brutus prit pour sujet
d'exercice la cause de Milon ; et cela vaut mieux que de répondre à
d'anciens plaidoyers, comme Cestius, qui entreprit de réfuter
l'oraison de Cicéron pour le même Milon, quoiqu'elle ne fût pas
suffisante pour le mettre au fait de ce qu'il y avait à dire en
faveur de Clodius. Or, pour qu'un jeune homme devienne en peu de
temps apte à ces exercices, il faut que le maître exige de lui que,
dans ses déclamations, il se tienne le plus près possible de la
réalité, et qu'il traite ses matières avec toute l'étendue qu'elles
comportent, au lieu de se contenter, comme aujourd'hui, d'en prendre
ce qu'elles ont de facile et de spécieux. Il y a à cela plusieurs
obstacles, comme je l'ai dit dans le second livre d'abord, et le
plus souvent, le trop grand nombre d'écoliers, ensuite l'audition
des déclamations à jours fixes, et un peu aussi l'erreur des
parents, qui jugent des progrès de leurs enfants plutôt sur le
nombre que sur le mérite de ces déclamations. Mais, comme je l'ai
dit aussi dans le premier livre, un bon maître ne se surchargera pas
d'un trop grand nombre d'élèves, et saura mettre un frein à leur
verbiage, en sorte qu'ils s'en tiennent précisément à leur sujet, et
n'y fassent pas entrer toute sorte de choses, comme ils n'y sont que
trop enclins. D'ailleurs, ou il accordera plus de temps à la
nécessité de les entendre, ou il leur permettra de diviser leurs
déclamations en plusieurs parties, pour les prononcer en plusieurs
fois; car une seule matière bien traitée leur sera plus profitable,
que plusieurs qu'ils n'auraient fait qu'ébaucher et, pour ainsi
dire, effleurer. Autrement rien n'est à sa place, et les règles, qui
déterminent l'ordre des choses, ne sont nullement observées, à cause
de l'empressement des jeunes gens à entasser toutes les fleurs du
sujet sur le point qui doit leur faire honneur : d'où il arrive que,
pour ne rien perdre, ils confondent tout sans ordre ni distinction.
CHAP. VI. Rien n'a
plus d'affinité avec le style que la méditation. Elle tire
beaucoup de force du style, et tient le milieu entre cet exercice et
l'improvisation; et peut-être n'est-il rien qui soit d'un usage plus
fréquent; car on ne peut pas toujours écrire, ni partout, tandis que
la méditation est presque de tous les temps et de tous les lieux. En
très peu d'heures, elle embrasse les causes les plus vastes; dans
les moments d'insomnie, les ténèbres ne la rendent que plus active;
au milieu des occupations du jour, elle sait trouver du loisir et ne
demeure jamais oisive. Non seulement elle ordonne intérieurement les
choses, ce qui est déjà beaucoup, mais elle accouple les mots, et
ourdit si bien tout le tissu du discours, qu'il ne reste plus qu'à
l'écrire. Car même, pour l'ordinaire, la mémoire est d'autant plus
fidèle, qu'elle n'est point relâchée par la sécurité qui suit
toujours le dépôt qu'on a fait au papier. Mais on ne parvient pas à
cette faculté tout d'un coup, ni en peu de temps. Il faut d'abord, à
force d'écrire, acquérir une certaine forme, qui nous accompagne
même dans la méditation. Il faut ensuite accoutumer peu à peu notre
esprit à embrasser un petit nombre de choses que nous puissions
rendre avec fidélité, puis un plus grand nombre, mais par degrés et
avec tant de ménagement , que ce travail ne se fasse pas sentir. Il
faut enfin se fortifier et s'entretenir par beaucoup d'exercice dans
cette aptitude, à laquelle, à dire vrai, la mémoire a beaucoup de
part. C'est pourquoi je ne recommande ici qu'une partie de ce que
j'aurais à dire, réservant le reste pour un autre endroit. Disons,
cependant, qu'un orateur dont la nature ne répugne pas à ce travail
intérieur peut, à force d'application, parvenir à énoncer ce qu'il
n'aura fait que concevoir dans son esprit d'une manière aussi sûre
et aussi fidèle que ce qu'il aurait écrit et appris par coeur.
Cicéron du moins rapporte que Métrodore et Empyle, parmi les Grecs,
et Hortensius, parmi nous, récitaient mot pour mot, en plaidant, ce
qu'ils avaient médité. Si cependant, au milieu de notre plaidoirie,
quelque éclair d'improvisation vient luire à notre imagination, nous
aurions tort de demeurer superstitieusement attachés à nos premières
pensées; car elles ne doivent pas nous être si chères que nous ne
donnions aussi quelque chose à la fortune, puisque souvent même, en
récitant un plaidoyer écrit, nous ne laissons pas d'y introduire des
idées nées du moment. Nous devons donc pratiquer ce genre d'exercice
de telle sorte que nous puissions le quitter et y revenir comme il
nous plaît. Car si, d'un côté, notre premier soin doit être
d'apporter à l'audience des matériaux tout prêts et sur lesquels
nous puissions faire fond, de l'autre ce serait une folie que de
rejeter les avances de l'occasion. Ainsi la méditation doit avoir
pour but de nous mettre à couvert de la surprise, non d'ôter à la
fortune le pouvoir de nous venir en aide. Or, c'est à la mémoire à
faire que ce que nous avons conçu se répande avec une pleine
liberté, au lieu d'être pour nous un sujet d'anxiété et
d'hésitation, comme si nous n'avions de ressource qu'en elle.
Autrement j'aimerais mieux la témérité de l'improvisation, qu'une
méditation qui se produit avec tant d'incohérence. Car rien n'est
pire que de chercher ainsi à reculons : en courant après des idées
qui échappent, on s'éloigne de celles qui se présentent, et on
redemande plus à sa mémoire qu'à son sujet. Or, puisqu'on peut
recourir à l'une et à l'au tre, il vaut mieux recourir au sujet, par
la raison qu'on a toujours trouvé moins qu'on ne peut trouver.
CHAP. VII. Le plus
grand fruit que l'orateur puisse recueillir de ses études, et que je
regarde comme la plus ample récompense de ses longs travaux, c'est
la faculté d'improviser. Que s'il ne parvient pas à l'acquérir, il
fera bien, selon moi, de renoncer au barreau, et d'appliquer à un
autre objet la seule faculté dont il soit maître, celle d'écrire;
car il me semble répugner à la loyauté d'un homme de bien de
promettre une assistance publique, qui vienne à manquer au plus fort
du danger. Autant vaudrait montrer le port à un navire qui n'y
pourrait aborder qu'à la faveur d'une brise légère. En effet, il se
présente, à chaque instant, des circonstances imprévues, qui forcent
à plaider immédiatement, soit devant les magistrats, soit dans les
affaires appelées avant terme. Qu'une de ces circonstances survienne
dans la cause, je ne dis pas d'un citoyen innocent, mais de
quelqu'un de nos amis ou de nos parents, demeurerons-nous muets? et
tandis que le client, dont la perte est imminente si l'on ne vient à
son secours, implore une voix tutélaire, demanderons nous du temps,
de la solitude et du silence, pour élaborer nos phrases à loisir,
les bien graver dans notre mémoire, préparer notre voix et nos
poumons? Quelle raison peut jamais justifier l'orateur de n'être pas
prêt à tout événement? Qu'arrivera-t-il lorsqu'il faudra répliquer à
l'adversaire? car souvent les attaques, auxquelles nous nous
attendions et que nous avions d'avance repoussées par écrit, font
défaut, et toute la cause a changé de face en un instant. De même
que le pilote doit savoir opposer de nouvelles manœuvres aux assauts
de la tempête, de même l'orateur doit varier ses moyens selon les
vicissitudes des causes. A quoi sert, en effet, de tant écrire, de
tant lire, de consumer tant d'années dans l'étude, si la difficulté
demeure la même qu'elle était en commençant? Celui-là bien
certainement s'est fatigué en pure perte, qui est condamné à se
fatiguer toujours autant. Toutefois, je ne dis pas cela pour amener
l'orateur à préférer l'improvisation, mais à s'en rendre capable :
or, voici le plus sûr moyen d'y parvenir. Connaissons bien d'abord
la marche à suivre en parlant; car on court en vain, si l'on ne sait
ni où l'on doit aller, ni par où. Ce n'est pas assez de ne pas
ignorer. quelles sont les parties d'une cause judiciaire, ni de bien
ranger les questions dans leur ordre, quoique ce soit là
l'essentiel; mais il faut encore savoir ce qui, à chaque endroit,
doit être mis au premier rang, au second, et ainsi de suite. Car il
y a un enchaînement naturel qui fait qu'on ne peut rien intervertir
ni rien omettre sans tomber dans la confusion. Or, une fois que
l'orateur sera entré dans la bonne route, il n'aura d'abord qu'à se
laisser guider, comme par la main, par l'ordre des choses : ce qui
suffit aux hommes les moins exercés pour donner sans efforts de la
suite à leurs récits. Ensuite, il saura trouver chaque chose en son
lieu, sans promener ses regards autour de lui, sans se laisser
distraire par des pensées gui viennent s'offrir de côté et d'autre,
sans déplacer à chaque instant son discours, comme ces gens qui
sautent çà et là, et ne s'arrêtent nulle part. Enfin il aura un plan
et un but, ce qu'on ne peut obtenir qu'au moyen de la division.
Quand il aura traité de son mieux toutes les parties de la tâche
qu'il s'était imposée, il sentira qu'il est arrivé au terme. Voilà
les ressources de l'art. Mais c'est à l'étude à nous familiariser,
en suivant les préceptes que j'ai déjà donnés, avec le meilleur
langage. Ce n'est qu'en écrivant beaucoup et en écrivant bien que
l'orateur se forme à parler, au point de donner à des paroles
improvisées la couleur d'une composition écrite; ce n'est enfin
qu'en écrivant beaucoup qu'on parvient à parler beaucoup; car c'est
surtout par l'habitude et l'exercice qu'on acquiert la facilité :
pour peu qu'on s'arrête, non seulement l'imagination perd de sa
promptitude, mais cela va même jusqu'à l'engourdissement. En effet,
quoiqu'on ait besoin d'une certaine vivacité d'esprit naturelle pour
combiner, dans le moment même où l'on parle, ce qu'on dira
ultérieurement, et pour que toujours une pensée, conçue d'avance et
toute prête, vienne comme à la rencontre de notre parole, il n'est
guère possible que la nature ou l'art fasse que l'esprit se
multiplie au point de suffire tout à la fois à l'invention, à la
disposition, à l'élocution, à l'ordre des choses et des mots, à ce
qu'on dit actuellement, à ce qu'on dira immédiatement après, à ce
qu'il faut voir encore au delà, sans compter l'attention à donner à
la voix, à la prononciation, au geste. Car il faut un regard qui, en
même temps qu'il se porte au loin en avant, suive et fasse marcher
tout; il faut qu'à mesure qu'on laisse de l'espace derrière soi,
l'horizon se déploie dans la même proportion : de manière que,
jusqu'à ce qu'on soit arrivé au terme, le regard n'avance pas moins
que le pas, si l'on ne veut s'arrêter ou broncher à chaque pas, et
n'émettre, comme ceux qui sanglotent, que des sons brefs et
entrecoupés. Il y a donc une certaine faculté où la réflexion n'a
point de part, que les Grecs appellent g-, g-, et qui fait que la
main court en écrivant, que les yeux en lisant embrassent plusieurs
lignes entières, avec leurs détours et leurs interruptions, et ont
aperçu ce qui suit avant que la voix n'ait articulé ce qui précède.
C'est à cette faculté qu'il faut rapporter ces tours que nous voyons
faire sur le théâtre aux joueurs de gobelets et aux escamoteurs, et
dont le prestige est tel, qu'on croirait que les objets qu'ils
jettent en l'air vont et viennent à leur commandement. Mais cette
faculté ne deviendra utile qu'autant que l'art, dont nous avons
parlé, en aura précédé l'exercice, de manière que ce qui de soi est
purement instinctif repose cependant sur l'art; car je n'appelle pas
parler, si on ne le fait avec ordre, avec grâce, avec abondance: à
mon avis, ce n'est que du bruit; et jamais je n'admirerai la
structure d'un de ces discours fortuits, que je retrouve, avec plus
de verve encore, jusque dans la bouche des femmes du peuple, quand
elles se querellent . quoiqu'il arrive souvent que la chaleur de
l'esprit et l'enthousiasme improvisent des résultats auxquels ne
saurait atteindre le travail le plus soigné. Aussi les anciens
orateurs y voyaient-ils, au rapport de Cicéron, une inspiration
divine. Mais il est facile de rendre raison de cela. Les sentiments,
quand l'âme est fortement. émue, et les images, quand l'impression
en est récente, se suivent et se succèdent, par l'effet de la
continuité du mouvement qui les entraîne; tandis que ces mêmes
sentiments, ces mêmes images se refroidissent d'ordinaire pendant
qu'on écrit, et, une fois arrêtés dans leur cours, disparaissent et
ne se retrouvent pas. Outre cela, si, par un soin trop 'scrupuleux
des mots, nous chicanons, à chaque instant, contre nous-mêmes, la
pensée n'a ni force ni entraînement; et, quand on réussirait à
trouver les meilleures expressions, l'élocution trahirait les
efforts discontinus d'un travail pénible. Efforçons-nous donc de
concevoir, comme je l'ai déjà dit, une vive image des choses, et de
nous identifier avec tout ce que nous avons à dire, avec les
personnes, les questions, les espérances, les craintes; car c'est le
coeur, c'est la force du sentiment qui rend éloquent. Voilà pourquoi
les gens les plus illettrés trouvent des mots pour s'exprimer, dès
qu'ils sont émus. Ce n'est pas tout . il faut que notre esprit se
porte, non sur un seul objet, mais sur plusieurs de suite et à la
fois : comme, lorsque nous portons les yeux directement sur un
chemin qui s'étend devant nous, nous voyons à la fois tout ce qui
est sur la même ligne et aux alentours, non- seulement ce qui est à
l'extrémité, mais la ligne entière d'un bout jusqu'à l'autre. La
honte de demeurer court et l'attente des applaudissements sont
encore autant d'aiguillons pour l'orateur. Il peut paraître étonnant
que, pour écrire, on cherche le silence et la solitude, tandis que,
pour improviser, plus on a d'auditeurs, plus on est stimulé, comme
le soldat qu'enflamme le groupe agité des étendards. C'est que la
nécessité de parler force l'esprit le plus rétif à aller en avant,
et que le désir de plaire vient encore seconder cette impulsion.
Tant il est vrai qu'en tout on se propose toujours une récompense,
puisque l'éloquence, qui a tant de charmes par elle-même, trouve son
plus puissant mobile dans la gloire et la renommée du moment. On ne
doit pas toutefois présumer assez de son esprit pour croire qu'on
obtiendra tout d'un coup cette facilité. Ce que j'ai dit de la
méditation,je le dis aussi de l'improvisation: d'abord humble et
timide, elle ne doit s'élever que par degrés vers la perfection,
laquelle ne s'acquiert et ne se maintient que par la pratique. Du
reste, elle doit parvenir à ce point, que la méditation n'ait qu'un
seul avantage sur elle, celui de la sûreté ce qui n'est pas
impossible, puisque plusieurs ont acquis cette facilité non
seulement en prose, mais en vers, comme Antipater Sidonius et
Licinius Archias : du moins Cicéron le dit, et je pourrais même, au
défaut de son témoignage, citer certains exemples modernes. Au
surplus, si je parle de ce don singulier, ce n'est pas tant pour le
cas que j'en fais, car il n'est ni utile ni nécessaire, que pour
encourager ceux qui se destinent au barreau. Je ne veux pas non plus
qu'on se fie sur sa facilité, au point de ne pas prendre au moins un
peu de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire; car le temps ne
manque nulle part, et les juges en accordent toujours. Aussi bien,
est-il permis de supposer qu'on puisse plaider une cause qu'on ne
tonnait pas? On voit néanmoins certains déclamateurs qui ont la
misérable gloriole de vouloir parler, sans préparation, sur la
simple donnée d'un sujet quelconque; il en est même qui poussent la
frivolité et le charlatanisme jusqu'à demander par quel mot on veut
qu'ils commencent. Mais, s'ils outragent l'éloquence, l'éloquence se
rit d'eux à son tour; et ceux qui veulent passer pour habiles aux
yeux des sots, passent pour des sots aux yeux des habiles. Que si
cependant on se trouve dans la nécessité de plaider sur-le-champ, on
aura besoin alors d'une grande vivacité d'esprit; il faudra donner
toute son attention aux choses, et se relâcher pour un moment sur le
soin des mots, s'il n'est pas possible de s'occuper des uns et des
autres. De plus, on aura recours à une prononciation plus lente, qui
laisse le temps à la réflexion, mais en ayant soin de dissimuler
cette lenteur de telle sorte qu'on paraisse délibérer, et non
hésiter. Voilà ce qu'il faut faire, lorsque le vent nous force à
quitter le port avant que le navire ne soit entièrement appareillé;
ensuite, chemin faisant, on déploie les voiles, on dispose les
cordages, et l'on n'a plus qu'à souhaiter d'avoir le vent en poupe.
Cela ne vaut-il pas mieux que de se laisser entraîner à un torrent
de vaines paroles, comme un pilote qui abandonnerait son vaisseau
aux hasards de la tempête? Mais il ne faut pas moins d'application
pour conserver cette faculté que pour l'acquérir; car il n'en est
pas de ce talent comme d'un art, qui, une fois appris, n'échappe
pas. L'habitude même d'écrire, si on l'interrompt, perd très peu de
sa célérité; tandis que le talent de l'improvisation, qui consiste à
être toujours prêt à tout, et à avoir toujours, pour ainsi dire, le
pied levé, ne se conserve que par l'exercice. La meilleure manière
de pratiquer cet exercice, c'est de parler tous les jours devant
plusieurs auditeurs, de ceux surtout dont nous avons à coeur
d'obtenir l'approbation et l'estime; car il est rare qu'on se
respecte assez soi-même. Toutefois vaut-il mieux s'exercer à parler
sans témoins, que de ne pas le faire du tout. Il y a encore une
autre manière de s'exercer à l'improvisation, qui peut se pratiquer
en tout temps et en tout lieu, quand on a l'esprit libre: c'est de
choisir un sujet de plaidoyer, et de le développer mentalement dans
toute son étendue. Cette méthode est en partie plus utile, en ce que
la composition est plus soignée que lorsqu'on ne songe qu'à ne pas
interrompre le fil du discours; mais, d'un autre côté, la première a
l'avantage de fortifier la voix, de faciliter la prononciation, et
d'imprimer au corps un mouvement qui, comme je l'ai dit, tient
l'orateur en haleine, et l'échauffe par l'agitation des bras et le
frappement du pied: c'est ainsi, dit-on, que le lion s'anime en se
battant les flancs avec sa queue. Enfin, il faut étudier en tout
temps et en tout lieu; car il est rare qu'il se rencontre un jour où
l'on soit tellement occupé, qu'on ne puisse lui dérober quelques
instants, comme faisait Brutus, au rapport de Cicéron, pour lire,
écrire, ou parler. C. Carbon avait coutume, môme dans sa tente, de
s'exercer ainsi à parler. Je ne dois pas même omettre une
recommandation qu'approuve Cicéron : c'est de n'avoir jamais un
langage négligé, et, même dans la conversation, dé donner à tout ce
qu'on dit le degré de perfection qu'il comporte. Mais il ne faut
jamais tant écrire que lorsqu'on est souvent exposé à parler
sur-le-champ. C'est en effet le moyen de donner du poids à ses
paroles, et de forcer cette éloquence légère à enfoncer plus avant,
au lieu de surnager. Ainsi les vignerons coupent les racines
supérieures de la vigne, de peur que le cep ne s'attache à la
surface du sol, et pour que les racines inférieures soient à la fois
plus profondes et plus fortes. Je ne sais même si ces deux exercices
pratiqués avec soin ne, se prêtent pas un mutuel secours, en sorte
qu'à force d'écrire on parle mieux, et qu'à force de parler on écrit
plus facilement. Écrivons donc toutes les fois que nous le pourrons;
et, si nous ne le pouvons pas, méditons. Si enfin ni l'un ni l'autre
n'est en notre pouvoir, il faut du moins faire en sorte que
l'orateur ne paraisse pas pris au dépourvu, ni le client abandonné.
Or, ce que font d'ordinaire ceux qui sont chargés de beaucoup
d'affaires, c'est de n'écrire que les choses les plus essentielles,
et particulièrement les commencements de chaque point; pour le
reste, ils se contentent de la méditation; et quant aux choses
qu'ils n'ont pas pu prévoir, ils les abandonnent au hasard. C'est
ainsi qu'en usait Cicéron, à en juger par ses commentaires. Mais Il
en existe d'autres qui ont peut-être été trouvés et publiés tels que
les auteurs les avaient composés pour être prononcés; et de ce
nombre sont ceux de Servius Sulpicius, dont nous avons aussi trois
oraisons. Ceux-là, en effet, sont si achevés, qu'ils me semblent
avoir été écrits en vue de là postérité. A l'égard de Cicéron, il
les avait composés seulement pour son usage; et c'est à Tiron, son
affranchi, qui les a recueillis, que nous en devons la publication.
En disant que Cicéron ne les avait écrits que pour son usage
particulier, je n'en parle pas ainsi par manière d'excuse, com me si
j'en faisais peu de eus : c'est plutôt afin qu'on les trouve encore
plus admirables. En fait de précautions de ce genre, on peut, et
j'approuve entièrement ce moyen, consigner de petites notes sur des
tablettes , et même tenir ces tablettes à la main, pour y jeter les
yeux de temps en temps. Mais je ne puis approuver ce que recommande
Lénas, de réduire ce qu'on a composé en sommaires, c'est-à-dire en
notes distribuées par articles; car la sécurité qu'inspire ce
travail fait qu'on se pénètre moins de son sujet, et les lacunes de
la mémoire passent dans le discours et le défigurent. Je ne crois
pas qu'il soit bon d'écrire ce qu'on veut dire de mémoire; car il
arrive alors que la pensée se reporte vers ce qu'on a écrit, au lieu
de se replier sur elle-même, et qu'elle perd son audace et son élan.
Ainsi l'orateur, d'un côté n'ayant pas son écrit sous les yeux, et
de l'autre ne faisant pas d'efforts pour y suppléer, demeure dans la
plus fâcheuse perplexité. Mais j'ai destiné dans le livre suivant un
chapitre à la mémoire; je n'y passe pas immédiatement, parce que
j'ai quelque chose à dire auparavant.
NOTES
LIVRE DIXIÈME.
Igitur ut Aratus ab Jove
incipiendum putat. Dans son poème des Phénomènes, Aratus
débute ainsi : Ἐκ Δίος ἀρχώμεσθα.
Suivant Hérodote, Homère florissait
884 ans avant J. C., et, selon les marbres de Paros, 907. Sept
villes, Smyrne, Chio, Colophon, Salamine, Rhodes, Argos et Athènes,
se disputaient l'honneur de l'avoir vil naître. Quant à l'histoire
de sa vie, c'est un tissu de fables plus invraisemblables les unes
que les autres. Cependant, malgré tant d'incertitude et d'obscurité
sur la personne d'Homère, son existence n'avait pas été mise en
doute chez les anciens; et, chez les modernes même, longtemps un
n'avait pas songé à la contester. Ce n'est que dans les deux
derniers siècles qu'on s'en est avisé. Selon l'opinion de plusieurs
savants, les poèmes attribués à Homère ne seraient qu'un assemblage
des différentes poésies épiques qui, à partir du dixième jusqu'à la
moitié à peu près du huitième siècle avant notre ère, éclorent,
grandirent et se perfectionnèrent dans l'Ionie. Ces poésies éparses
et confuses auraient été recueillies et mises en ordre par de;
chantres ambulants, qui de là prirent le nom de rhapsodes. litais
cette supposition ne résiste pas à l'examen. Fénelon a dit que les
caractères de l'alphabet jetés ou rassemblés au hasard n'auraient
jamais pu produire un poème aussi parfait que l'Iliade : on peut
dire avec autant de raison que des morceaux de poésie , divers et
incohérents, eussent été aussi impuissants à la créer. Il faudrait
donc contester la puissante unité qui règne dans les poèmes
d'Homère. Or, on ne saurait méconnaître celte unité, à moins d'être
aveuglé par l'esprit de système. Ce paradoxe nous remet en mémoire
les vers de M. de Lamartine sur ce grand poète :
Homère! à ce grand nom, du Pinde à l'Hellespont,
Les airs, les cieux, les flots, la terre, tout répond.
Monument d'un autre âge et d'une autre nature,
Homme, l'homme n'a plus de nom qui te mesure!
Son incrédule orgueil s'est lassé d'admirer;
Et, dans son impuissance à te rien comparer,
Il le confond de loin avec ces fables même,
Nuages du passé qui couvrent ton poème.
Cependant tu fus homme : on te sent à tes pleurs!
Un dieu n'eut pas si bien fait gémir nos douleurs.
Il faut que l'immortel qui touche ainsi notre âme
Ait sucé la pitié dans le lait d'une femme.
Mais dans ces premiers jours ou, d'un limon moins vieux,
La nature enfantait des monstres ou des dieux ,
Le ciel t'avait créé, dans sa magnificence,
Comme un autre océan , profond, sans rive, immense,
Sympathique miroir qui, dans son sein flottant,
Sans altérer l'azur de son flot inconstant,
Réfléchit tour à tour les grâces de ses rives,
Les bergers poursuivant les nymphes fugitives,
L'astre qui dort au ciel, le mal brisé qui luit, etc.
Avant Quintilien, Horace avait fait
un éloge non moins remarquable d'Homère dans sa seconde épître :
Trojani belli scriptorem, maxime Lolli,
Drim tu declamas Romae, Praneste relegi,
Qui, quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.
Enfin le Dante a égalé tous ces
panégyristes en mettant dans la bouche de Virgile ce seul vers :
Quegli e Omero , poeta sovrano.
Hic enim, quemadmodum ex Oceano.
Voici les deux sers d'Homère, traduits par Quintilien :
Ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάμασσα,
Καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν.
(Il. xxi, 196.)
Raro
assurgit Hesiodus. Hésiode, contemporain d'Homère, quitta la
ville de Cumes, où il était né, pour venir s'établir à Ascra, petit
bourg aux environs de l'Hélicon. On a de lui deux poèmes didactiques
: le premier, intitulé les Travaux et les Jours, a fourni à
Virgile l'idée de ses Géorgiques; le second, la Théogonie,
ou généalogie des dieux. On lui attribue encore un morceau
descriptif, le bouclier d'Hercule.
Le sujet des poèmes d'Hésiode a été
parfaitement décrit dans ces vers de Manlius
Hesiodus memorat divos divumque parentes,
Et Chaos enixum terras, orbemque sub illo
Infantem; primum, titubantia sidera, corpus;
Titanasque senes, Jouis et cunabula magni,
Et sub fratre viri nomen, sine fratre, parentis,
Atque iterum patrio nascentem corpore Bacchum ,
Omniaque immensum volitantia numina mundo.
Quis etiam ruris cultus legesque rogavit
Militiamque soli, quia colles Bacchus amaret,
Quos fecunda Ceres campos, quod Pallas utrumque,
Atque arbusta vagis essent quod adultera pomis,
Sylvarumque deus, sacrataque numina, nymphas,
Pacis opus magnos naturae candit in usus.
(Astronom, liv. II.)
Contra in Antimacho. L'auteur
anonyme de la description des Olympiades le fait contemporain de
Lysandre, et même de Platon, qui, très jeune encore , assista,
dit-on, à la lecture de sa Thébaïde. Ce poème, et la
Lydienne, élégie louée par Ovide, ne sont pas parvenus jusqu'à
nous.
Panyasin
ex utroque mixtum. Ce poète, oncle de l'historien Hérodote,
était de Samos ou d'Halicarnasse. Il avait composé une Herculéide
en quatorze livres.
Apollonius in ordinem a
grammaticis datum. Apollonius, né à Alexandrie, 194 ans avant J.
C., était appelé le Rhodien, parce qu'il avait enseigné les lettres
à Rhodes. Il s'était occupé d'abord de grammaire et d'antiquités, et
composa ensuite un poème épique sous le titre d'Argonautiques,
lequel est parvenu jusqu'à nous. Il est en quatre chants, et a pour
sujet la conquête de la toison d'or.
Aristarque, critique célèbre, qui a
mérité que son nain désignât, dans tons les siècles, un censeur
sévère , mais juste et éclairé, était né dans la Samothrace, 166 ans
avant J. C., et se fixa à Alexandrie. Ptolémée Philo. pater lui
confia l'éducation de ses enfants.
Aristophane, grammairien, né à
Byzance, vers l'an 200 avant J. C., vint à Alexandrie, où ceux qui
se livraient à la grammaire et à la critique trouvaient le plus de
ressources.
Arati materia motu caret.
Aratus, né à Soles en Cilicie, vers l'an 277 avant J. C., vécut
presque constamment à la cour d'Antiochus Gonatas, roi de Macédoine,
qui l'estimait beaucoup. Il composa un poème sur l'astronomie,
intitulé les Phénomènes. Ce poème nous a été conservé.
Cicéron, Ovide, Claude et Germanicus, le traduisirent en vers
latins.
Admirabili in suo genere
Theocritus. Théocrite, né à Syracuse, florissait sous Ptolémée
II Philadelphe, vers l'an 270 avant J. C. Il nous reste de ce poète
trente idylles et vingt et une épigrammes.
Herculis
acta non bene Pisandros? Quid , Nicandrum... Quid Euphorionem?
Il ne reste rien de ces poètes grecs, qui appartiennent à une époque
de décadence. "Les poésies d'Euphorion, de Callimaque et de
Lycophron sont, dit saint Clément d'Alexandrie, un sujet d'exercice
pour les grammairiens. "
Horatius frustra Tyrteum subjungit ?Tyrtée, poète et
guerrier, né dans l'Attique vers le vue siècle avant J. C. Il reste
de lui quelques fragments, conservés par l'orateur Lycurgue, et par
Stobée.
Cujus princeps habetur
Callimachus; secundas... Philotas occupavit. Callimaque, né à
Cyrène, ouvrit une école de belles-lettres à Alexandrie, sous le
règne de Ptolémée Philadelplie. Il fut le maître d'Apollouius de
Rhodes. Il ne nous reste de ses nombreux ouvrages que trente et une
épigrammes, une élégie et quelques hymnes.
Philétas de Cos, contemporain de
Callimaque, avait été précepteur du même Ptolémée. Il ne reste de
lui que des fragments.
Ad ἕξιν maxime pertinebit unus
Archilochus. Archiloque de Paros, vivait dans le septième siècle
avant J. C., et fut l'inventeur du vers ïambique:
Archilochum proprio rabies armavit iambo)
(Horace, Art poét.)
Novem vero lyricorum longe
Pindarus princeps. Pindare naquit à Thèbes, en Béotie, vers l'an
521 avant J. C. Il composa un grand nombre d'ouvrages. Il ne nous
reste qu'une partie de ses odes, divisées en quatre sections:
olympiques, pythiques, néméennes et isthmiques.
Stesichorum quum sit ingenio
validus. Stésichore, d'Himère en Sicile, florissait vers l'an
570 avant J. C. Ses poésies formaient vingt-six livres : il n'en
reste que de bien faibles débris.
Alceus in parte operis aureo
plectro donatur. Alcée était de Mytilène, ville de Lesbos, et
contemporain de Sapho. Ils florissaient, l'un et l'autre, vers l'an
600 avant J. C. Il ne nous reste d'Alcée que quelques fragments,
conservés par Athénée et Suidas.
Simonides, tennis alioqui.
Simonide, de Cos, vivait dans le sixième siècle avant J. C. Il avait
composé un grand nombre d'élégies, dont nous ne possédons que
quelques fragments.
Aristophanes tamen, et Eupolis,
Cratinusque praecipui. Aristophane était né à Athènes, où il
mourut l'an 386 avant J. C. Des cinquante-quatre comédies qu'il
avait composées, onze seulement nous sont parvenues
Eupolis et Cratinus vécurent dans le
même temps. On n'a que quelques fragments de ces deux poètes, qui,
ainsi qu'Aristophane, appartenaient à l'ancienne comédie.
Tragoedias primum in lucem
Aeschylus protulit. Eschyle naquit à Éleusis l'an 525 avant J.
C., et mourut à Géla, en Sicile, l'an 456. Il avait composé
quatre-vingts tragédies, dont il ne nous reste que sept. En voici
les titres : Prométhée enchaîné, les Sept Chefs devant Thèbes, les
Perses, Agamemnon, les Choéphores, les Euménides, les Suppliantes.
Sed longe clarius illustraverunt
hoc opus Sophocles atque Euripides. Sophocle naquit à Colone,
près d'Athènes, vers l'an 493 avant J. C, et mourut à l'âge de
quatre-vingt-douze ans. Des soixante-dix tragédies qu'il composa, il
n'en est parvenu que sept jusqu'à nous : Ajax furieux, Électre,
Œdipe roi, Antigone, les Trachiniennes, Philoctète, Œdipe à Colone.
Euripide naquit à Salamine 480 ans
tuant J. C., et mourut à l'âge de soixante dix-huit ans. De cent
vingt tragédies, il ne nous en reste que dix-huit, dont les
principales sont Hécube, Iphigénie en Aulide, lesTroyennes,et
Oreste.
Et secutus, quamquam in opere
diverso, Menander. Ménandre, né à Athènes l'an 342 avant J. C.,
composa un très grand nombre de comédies, dont il ne reste que des
fragments. Ce poète appartient à la comédie nouvelle.
Et praecipue Philemon.
Philémon, contemporain de Ménandre, était né en Cilicie, selon
Strabon , et en Sicile, selon Suidas. Le temps n'a pas plus épargné
ses comédies que celles de Ménandre.
Densus, et brevis, et semper
instans sibi Thucydides. Thucydide, né dans l'Attique l'an 471
avant J. C., a écrit l'histoire de la guerre du Péloponnèse jusqu'à
la vingt et unième année inclusivement.
Dulcis, et candidus, et fusus
Herodotus. Hérodote naquit à Halicarnasse l'an 484 avant J. C.
Il composa en neuf livres une histoire des guerres médiques, depuis
Cyrus jusqu'à la bataille de Mycale. Il la lut aux jeux Olympiques
et aux fêtes des Panathénées; et elle excita un si grand
enthousiasme, que les Grecs donnèrent à chacun des livres le nom
d'une Muse. Elle est écrite en dialecte ionique. La forme épique
dont il s'est servi fait que son histoire embrasse presque tous les
temps et tous les peuples.
Theopompus hic proximus.
Théopompe, historien et orateur, de l'île de Chio, vécut du temps
d'Alexandre. Il ne reste rien de lui.
Philistus quoque meretur.
Philiste naquit à Syracuse l'an 481 avant J. C. Il ne reste de cet
historien qu'un seul fragment conservé par saint Clément
d'Alexandrie.
Ephorus, ut Isocrati visum,
calcaribus eget. Éphore naquit à Cumes, vers l'an 363 avant J.
C. D'après le conseil d'Isocrate, il renonça au bareau pour écrire
l'histoire.
Clitarchi probatur ingenium.
Cet historien suivit Alexandre dans ses expéditions. On pense que
Diodore de Sicile et Quinte-Curce en ont fait beaucoup d'usage.
Quorum longe princeps Demosthenes.
Démosthène naquit à Athènes l'an 385 avant J. C., et mourut à
soixante-huit ans, dans l'île de Calaurie, où il s'était réfugié, et
s'empoisonna pour ne pas tomber vivant entre les mains d'Antipater.
On peut ranger les discours de cet orateur, qui sont parvenus
jusqu'à nous, en trois catégories : 1° genre démonstratif,
deux discours; 2° genre délibératif, dix-sept discours; 3°
genre judiciaire, quarante-deux discours.
Plenior
Aeschines, et magis fusus. Eschine, rival de Démosthène, était
de deux ans plus âgé que lui. Nous ne possédons que trois harangues
de cet orateur, un discours contre Timarque, une apologie de sa
conduite pendant son ambassade en Macédoine, et enfin le discours
contre Ctésiphon. Vaincu par Démosthène, et condamné à l'exil, il se
retira à Rhodes, où il donna des leçons de rhétorique. De là il
passa à Samos, où il mourut à l'âge de soixante-quinze ans.
Dulcis imprimis et acutus
Hyperides. Hypéride était contemporain de Démosthène et
d'Eschine, et avait été disciple de Platon et d'Isocrate. Il fit une
fin tragique, comme Démosthène : il aima mieux s'arracher la langue
que de trahir les secrets de sa patrie, et fut mis à mort par ordre
d'Antipater, 322 ans avant J. C. Il ne nous reste de lui qu'une
seule harangue.
His aetate Lysias major.
Lysias, né à Athènes 459 ans, mort 378 ans avant J.-C., composa un
très grand nombre de harangues, dont trente-quatre sont parvenues
jusqu'à nous.
Isocrates in diverso genere
dicendi nitidus et comptus. Isocrate, né vers l'an 439 avant J.
C., mort à l'âge de quatre-vingt-dix ans, composa un grand nombre de
discours, qui sont presque tous venus jusqu'à nous. Ils comprennent
: 1° quatre discours de morale; 2° des éloges, parmi lesquels on
remarque le panégyrique d'Athènes; 3° cinq harangues délibératives;
4° huit plaidoyers.
Quin etiam Phalerea ilium
Demetrium. Démétrius de Phalère, né 317 ans avant J. C., avait
composé des discours et des histoires qui ne nous sont point
parvenus. Il gouverna Athènes pendant dix ans. Chassé de cette ville
par Démétrius Poliorcète, il alla mourir à la cour de Ptolémée
Philadelphe, l'an 284 avant J. C.
Quis dubitet Platonem esse
praecipuum? Platon, né à Athènes 430 ans avant J. C, se livra
d'abord à la poésie; mais avant connu Socrate, il fut tellement
charmé des entretiens de ce sage, qu'il se consacra entièrement à la
philosophie. Après la mort de Socrate, il se rendit à Mégare, où il
assista pendant quelque temps aux dis¬cussions philosophiques
proposées par Euclide; de là il alla dans la Grande-Grèce, auprès
d'Archytas, de Philolaüs et de Timée; il vit aussi Cyrène, et passa
en Égypte. De retour à Athènes, il ouvrit une école dans un jardin
situé hors des murs de la ville, qu'on nommait Académie.
Quid ego commemorem Xenophontis
illam jucunditatem inaffectatam ? Xénophon, né dans un bourg de
l'Attique, 445 ans avant J. C., fut surnommé l'Abeille apique. Ses
principaux ouvrages sont : l'Histoire grecque, en sept livres :
c'est la continuation de l'histoire de Thucydide jusqu'à la bataille
de Mantinêe; l'expédition de Cyrus le jeune et la retraite des dix
mille; la Cyropédie, en huit livres; l'Apologie de Socrate. Il
mourut à Corinthe, âgé de quatre-vingt-dix ans.
Quid Aristolelem? Aristote,
fondateur de l'école péripatéticienne, naquit à Stagyre, petite
ville de la Macédoine, l'an 384 avant J. C., et mourut à Chalcis
l'an 312. Nicomaque, père d'Aristote, était médecin d'Amyntas, père
de Philippe. Aristote fut élevé à la cour d'Amyntas, et y reçut
l'éducation la plus soignée. Il suivit pendant vingt ans les leçons
de Platon.
Nam in Theophrasto.
Théophraste, contemporain et disciple d'Aristote, naquit à Érésos,
une des villes maritimes de 1'lle de Lesbos, l'an 371 ayant J. C. Il
mourut à Athènes dans un âge fort avancé : saint Jérôme dit qu'il
vécut cent sept ans. Tyrtame était le premier nom de Théophraste,
qui dut à son divin langage celui sous lequel il est connu.
Sic apud nos Virgilius
auspicatissimum dederit exordium. Virgile naquit à Andes, petit
bourg près de Mantoue, l'an 70 avant J. C., et mourut à Brindes à
l'âge de cinquante et un ans. Ses restes furent transportés à
Naples, où on lui érigea, sur le chemin de Pouzzoles, un tombeau,
dont on montre encore aujourd'hui la place. il avait composé lui
môme son épitaphe :
Mantua me genuit, Calabri rapuere; tenet nunc
Parthenope : cecini pauscua, rura, duces.
Nam Macer et Lucretius legendi
quidem. Aemilius Macer, poète de Vérone, contemporain de
Virgile, avait écrit en vers latins sur les propriétés des plantes
vénéneuses.
Lucrèce (Titus Lucretius Carus), né
l'an 95 avant J. C., était d'une famille noble. On sait peu de chose
de sa rie. Son poème de rerum Natura est une exposition en
vers de la doctrine d'Épicure. Il se tua, dit la Chronique d'Eusèbe,
à l'âge de quarante-quatre ans.
Atacinus Varro in iis. Voyez,
, sur cet écrivain, la note 2 du 1er livre.
Ennium, sicut sacros vetustate
lucos, adoremus. Ennius, né à Rudies, en Calabre, 230 avant J.
C., fut l'ami de Caton l'Ancien et de Scipion l'Africain. Il composa
les annales de la république romaine en vers héroïques, et un poème
épique sur Scipion l'Africain; il traduisit la Médée et l'Hécube
d'Euripide. et introduisit le premier à Rome le genre satirique. Ce
poète mourut à rage de soixante-dix-neuf ans. Scipion, au lit de
mort, ordonna que son corps fût enseveli à côté de celui du poète
qui avait été sur ami.
Lascivus quidem in Heroicis quoque
Ovidius. Ovide, né à Sulmone l'an 43 avant J. C., mourut à
Tomes, à l'extrémité du Pont-Euxin, où Auguste l'avait relégué.
Cornelius autem Severus.
Cornélius Sévérus, contemporain d'Ovide, avait commencé un poème sur
la guerre de Sicile, et mourut avant de l'avoir terminé. On a de lui
un poème sur l'Etna.
Multum
in Valerio Flacco nuper amisimus. Valérius Flacons, mort, comme
on le voit, sous Domitien, est auteur d'un poème sur l'expédition
des Argonautes, sujet déjà traité par Apollonius de Rhodes. Ce poème
est inachevé.
Vehemens et poeticum ingenium
Saleii Bassi fuit. Ce poète vivait sous Domitien. Un des
interlocuteurs du dialogue de Oratoribus l'appelle optimum
virum et absolutissimum poetam.
Rabirius et Pedo non indigni
cognitione. Rabirius vivait du temps d'Auguste, et avait composé
un poème sur la victoire d'Actium.
Pédon, contemporain de Rabirius,
avait écrit des élégies, des épigrammes, et un poème intitulé la
Théséide. Il ne reste de lui que deux élégies, l'une sur la mort
de Drusus, et l'autre sur celle de Mécène.
Lucanus ardens et concitatus.
Lucain, auteur de la Pharsale, naquit à Cordoue l'an 38 de J. C.,
sous le règne de Caligula. Son père, Annaeus Mela, chevalier romain,
était frère du philosophe Sénèque. Il fut élevé à la cour de Néron,
sous les yeux de son oncle. Accusé d'avoir pris part à la
conspiration de Pison, et condamné à périr, il se fit ouvrir les
veines dans un bain chaud, où il expira à l'âge de vingt-sept ans.
Elegia quoque Graecos provocamus,
cujus... Tibullus. Tibulle, né 43 avant J. C., mourut fort
jeune. On a de lui quatre livres d'élégies.
Sunt
qui Propertiumu malint. Properce naquit en Ombrie, vers l'ait 52
avant J.C. Quoique fils d'un proscrit, il obtint les bennes grâces
d'Auguste. Il a, comme Tibulle, laissé quatre livres d'élégies.
Sicut durior Gallus. Cornélius
Gallus, ami de Virgile, qui lui a dédié sa dixième églogue, naquit à
Fréjus, et se tua à l'âge de quarante-trois ans, pour se soustraire
à la peine portée contre lui pour crime de trahison. il ne nous
reste que quelques fragments de ses élégies.
Satira quidem tota nostra est, in
qua... Lucilius. Lucite, chevalier romain, naquit à Aurunca 148
ans avant J. C., et mourut à Naples , âgé de quarante-six ans. Il
avait composé trente livres de satires, qu'on admirait encore
beaucoup au siècle d'Auguste.
Multo
est tersior ac purus magis Horatius. Horace naquit à Vénuse,
dans l'Apulie, deux ans avant la conjuration de Catilina. Son père,
fils d'un affranchi, et collecteur d'impôts, n'était pas riche, mais
il n'épargna rien pour son éducation. Il le conduisit lui-même à
Rome, lui donna pour maître un certain Orbilius de Bénévent, alors
fameux, et l'envoya ensuite à Athènes pour étudier la philosophie et
se perfectionner le goût. Horace y était encore lors de la
malheureuse campagne de Brutus et de Cassius. Il courut se ranger
sous leurs drapeaux, et y devint tribun militaire à l'âge de
vingt-trois ans. Après la bataille de Philippes, il revint à Rome,
où il acheta une petite charge dans le trésor, et se mit en même
temps à cultiver la poésie. Virgile le présenta à Mécène, qui
l'admit dans sou intimité et le fit connaître à Auguste. Il mourut à
cinquante-neuf ans, peu de temps après Mécène, et fut inhumé à ses
côtés.
Multum
et verae gloriae, quamvis uno libro, Persius meruit,
Perse, né dans la Ligurie, l'an 34 de notre ère, mourut à l'âge de
vingt-huit ans. Il parait, d'après le passage de Quintilien,
quamvis uno libro, que ses six satires n'en formaient
originairement qu'une seule, et que cette division ne lui appartient
pas.
Alterum illud... Terentius Varro.
Cet écrivain, surnommé le plus savant des Romains, avait écrit, dit
saint Augustin, cinq cents volumes, dont il ne nous reste
aujourd'hui que des portions assez considérables d'un traité de
de rustica, et d'en autre de Lingua latina. Il
créa avec succès, sous le nom de satire Ménippée, un genre mixte,
mêlé de vers de différentes mesures, même de prose et de vers, tel
que le traitèrent après lui Sénèque et Julien, et chez nous les
auteurs de notre célèbre Ménippée.
Cujus acerbitas in Catullo,
Bibaculo. Catulle, né à Vérone, 80 ans avant J. C., appartient à
l'aurore du siècle d'Auguste. Il composa des odes, des épigrammes,
et même des morceaux épiques. Il mourut fort jeune.
Furius Bibaculus était contemporain
de Catulle. Il reste quelques fragments de ce poète.
Is erit Caesius Bassus.
Caesius Bassus, poète lyrique, était ami de Perse, qui lui dédia sa
sixième satire
Admovit jam bruma foco te, Basse, Sabino.
Tragediae scriptores veterum
Accius atque Pacuvius. Accius, né à Rome vers l'an 70 avant J.
C., traduisit plusieurs tragédies de Sophocle, et eut aussi le
mérite de s'essayer dans un sujet national.
Pacuvius était neveu d'Ennius. Il
naquit à Brindes vers l'an 221, avant J. C. Ses tragédies étaient
une imitation du théâtre grec.
Jam Varii Thyestes. Varius,
ami de Virgile et d'Horace, et chargé par Auguste de revoir
l'Enéide, n'a transmis à la postérité qu'un nom célèbre dans la
tragédie et dans l'épopée.
Longe princeps Pomponius Secundus.
Pomponius Secundus était contemporain et ami de Pline le
naturaliste, qui avait écrit sa vie en deux livres.
In comoedia maxime claudicamus,
licet... Plautino sermone... licet Caeciliutn... licet Terentii.
Plaute naquit à Sarsine, village d'Ombrie, vers l'an 227 avant J. C.
, et mourut l'an 184. Sur cent trente pièces que l'on attribuait à
Plaute, Varron n'en reconnaissait que vingt et une comme
authentiques, et il nous en est parvenu vingt.
Cecilius Statius, né dans la Gaule
Cisalpine, était contemporain d'Ennius et de Térence.
Térence, né en Afrique vers l'an 192
avant J. C., huit ans après la mort de Plaute, fut enlevé par des
pirates, et vendu comme esclave au sénateur romain Terentius
Lucanus, qui lui rendit la liberté et lui donna son nom. II vécut
dans l'intimité de Lélius et de Scipion, qui, dit-on, l'aidèrent
dans la composition de ses pièces. Il nous reste six de ses
comédies.
Togatis excellit Afranius.
Afranius était contemporain de Térence. Ce fut par opposition aux
pièces de ses prédécesseurs, qui étaient composées à l'imitation des
Grecs, et que, pour cette raison, on appelait palliatae, que
les siennes et toutes celles qui, depuis, s'attachèrent
exclusivement au costume romain, reçurent le nom de togatoe.
Nec opponere Thucydidi Sallustium
verear. Salluste, historien de la conjuration de Catilina et de
la guerre de Jugurtha, naquit à Amiterne, ville du pays des Sabins,
l'an 85 avant l'ère chrétienne. Il avait écrit aussi une histoire de
Rome depuis Sylla jusqu'à Catilina. Ses ouvrages et sa vie forment
le contraste le plus complet.
Neque indignetur sibi Herodotus
aequari T. Livium. Tite Live, né à Padoue, 59 ans avant J. C.,
avait composé une histoire romaine, qui commençait à la fondation de
Rome et finissait à la mort de Drusus. Elle contenait 140 livres,
dont les grammairiens ont formé quatorze décades. Il ne nous en
reste que 35 livres, dont quelques-uns même ne sont pas entiers.
Nam mi hi egregie dixisse videtur
Servilius Nonianus. Servilius Nonianus était, au rapport de
Tacite, un homme aussi distingué par ses moeurs que par son esprit,
et qui s'était fait un nom comme historien, après avoir joui
longtemps d'une grande célébrité au barreau. Perse, dit Suétone,
l'honorait comme un père.
Quam paulo aetate praecedens eum
Bassius Aufidius. Pline le jeune, dans la nomenclature des
œuvres de son oncle, parle d'une continuation de l'histoire d'Aufidius
Bassus.
Nam Ciceronem cuicumque eorum
fortiter opposuerim. Cicéron naquit à Arpinum. patrie de Marius,
la même année que Pompée, le 3 janvier 647 de la fondation de Rome,
et mourut près de Caïète, à l'âge de soixante-trois ans, de la main
d'un satellite d'Antoine.
Multa in Asinio Pollione inventio.
Asinius Pollion, après avoir d'abord embrassé le parti de Pompée,
s'était attaché à la fortune de César, et, après la bataille de
Pharsale, à celle d'Antoine, qui lui donna le commandement des
légions stationnées dans les environs de Mantoue. Ce fut là qu'il
devint le protecteur de Virgile, encore inconnu, et qui, depuis, lui
a dédié sa quatrième églogue. !l vécut dans l'intimité d'Auguste. Ce
fut lui qui établit le premier à Rome une bibliothèque, ouverte à
tout le monde. Asinius Pollion était orateur, historien et poète.
At Messala nitidus et candidus.
Messala, lieutenant de Brutus, se rendit aux triumvirs avec le reste
des légions qui avaient combattu à Philippes. On estimait beaucoup
son éloquence et les grâces de son esprit.
C. vero Ccesar si foro tantum
vacasset. Jules César naquit 100 ans avant J. C., et mourut
assassiné à l'âge de cinquante-sept ans.
Multum
ingenii in Caelio. Il s'agit ici de Marcus Célius Rufus, défendu
par Cicéron dans Paraison pro M. Coelio.
Inveni
qui Calvum. Calvus était un orateur célèbre, du temps de
Cicéron.
Et Servius Sulpicius insignern...
meruit. Servius Sulpicius était contemporain de Cicéron et d'Hortensius.
Multa, si cum judicio legatur,...
Cassius Severus. Cassius Sévérus était un orateur du siècle
d'Auguste.
Eorum, quos viderim , Domitius
Afer, et Julius Africanus. Domitius Afer, né à Nîmes, vers l'an
15 avant J. C. est souvent cité par Quintilien, qui avait étudié
sous lui la rhétorique.
Julius Africanus était probablement,
selon Spalding, fils de celui du même nom qui périt sous Tibère, au
rapport de Tacite (Ann., liv. VI, ch. 7.)
Nam et Trachalus plerumque
subtimis. Trachalus était un peu antérieur à Quintilien , qui
vante surtout la beauté de son organe.
Et Vibius Crispus, compositus et
jucundus. C'est à Vibius Crispus qu'on attribue cette réponse à
quelqu'un qui demandait s'il n'y avait personne avec Domitien :
Personne, pas même une mouche.
Julio
Secundo si longior contigisset aetas. Julius Secundus, ami de
Quintilien , figure comme intenses tour dans le dialogue de
Oratoribus.
Egregius veo... Brutus. Brutus
était stoïcien, et avait composé plusieurs traités sur la doctrine
du Portique.
Scripsit
non parum multa Cornelius Celsus. Celse, médecin du temps de
Tibère, avait écrit sur la médecine, l'agriculture, la rhétorique et
l'art militaire. Il ne nous reste que son ouvrage sur la médecine.
Plancus in stoicis... in
epicureis... Catius. Les savants ne sont pas d'accord sur
l'identité de ce Plancus Plantas, philosophe stoïcien, dont parle
ici Quintilien.
Catius, contemporain de Cicéron ,
avait écrit un traité sur le nature des choses et sur le souverain
bien.
Ex industria Senecam. Sénèque
naquit à Cordoue, en Espagne, l'an 2 ou 3 de notre ère, et mourut à
l'âge de soixante-trois ans.
Nihil
in poetis supra Livium Andronicum. Livius Andronicus est le plus
ancien poète des Romains. Il composa, à l'imitation des Grecs, des
poèmes épiques, des tragédies et des comédies. Ses premiers essais
datent de l'an 240 avant J.-C.