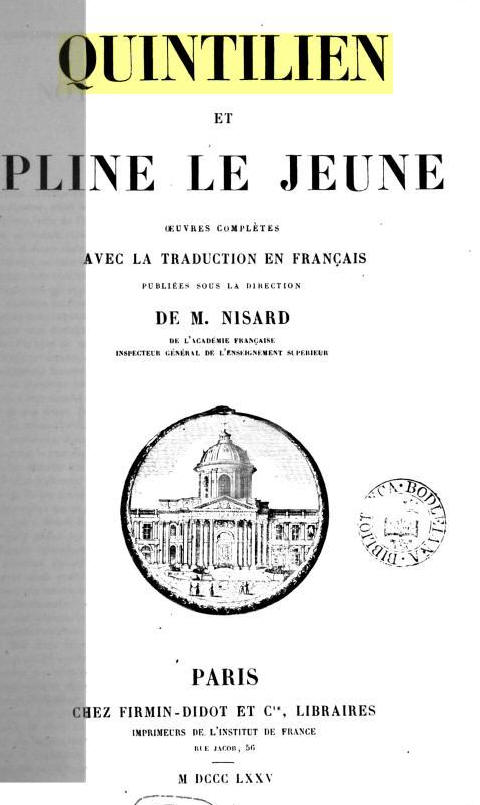LIVRE VIII.
SOMMAIRE.
Introduction.
Chap.1. Ce qu'il faut considérer dans l'élocution. II. De la clarté.
III. De l'ornement. IV. De l'amplification. V. Des genres de
pensées. VI. Des tropes.
Les cinq livres précédents contiennent
à peu près tout ce qui regarde l'invention et la
disposition. Mais si la connaissance approfondie des règles de
ces deux parties de la rhétorique est nécessaire à ceux qui veulent
posséder l'art en son entier, d'un autre côté un enseignement plus
court et plus simple convient mieux aux commençants ; car
d'ordinaire, ou ils se laissent rebuter par la difficulté de suivre
une méthode aussi multiple et aussi compliquée, ou, à cet âge qui a
le plus besoin de nourriture, et surtout d'une nourriture délicate,
ils se dessèchent sur d'âpres matières ; ou bien encore, s'ils font
tant que de les apprendre, mais sans chercher davantage, ils se
croient tout d'abord des orateurs ; ou enfin, esclaves de certaines
règles fixes, ils n'osent rien tenter par eux-mêmes ; et plusieurs
estiment que c'est la raison qui fait que ceux qui ont le plus
approfondi la rhétorique n'ont été rien moins qu'éloquents.
Cependant les commençants ont besoin qu'on les mette dans le chemin
; mais ce chemin doit être facile à suivre et à montrer. Un maître
habile, tel que je le suppose, saura donc faire un choix, et se
bornera pour le moment aux préceptes qui lui paraîtront les
meilleurs, ajournant la discussion des autres ; car les élèves
suivent le maître sans demander où il les conduit. Quand ils seront
en état de réfléchir, il leur en apprendra davantage. Il suffit
d'abord qu'ils croient qu'il n'y a point d'autre route que celle
qu'on leur fait suivre, en attendant qu'ils puissent reconnaître par
eux-mêmes que c'est la meilleure. Au reste, ce n'est pas la doctrine
qu'il faut accuser, mais bien les rhéteurs, qui, par leur dissidence
et leur opiniâtreté, l'ont obscurcie et embarrassée. Aussi, dans
tout ce qui regarde l'art oratoire, il est plus difficile de choisir
ce que l'on doit enseigner que d'enseigner ce qu'on a choisi ; et
particulièrement, dans ce qui concerne l'invention et la
disposition, tout se réduit à un très petit nombre de principes, au
delà desquels l'élève qui aura su les franchir, trouvera une route
où il n'aura plus qu'à courir. Jusqu'à présent, en effet, mon
laborieux traité a eu pour fin d'établir : Que la rhétorique est
la science de bien dire, qu'elle est utile, qu'elle est un art, et
même une vertu ; qu'elle a pour matière toutes les choses sur
lesquelles elle est appelée à parler ; que ces choses peuvent être
comprises sous trois genres, le démonstratif, le délibératif et le
judiciaire ; que toute oraison se compose de choses et de mots ; que
dans les choses il faut considérer l'invention, dans les mots
l'élocution, dans les choses et dans les mots la disposition et la
composition ; et qu'une fois en possession du tout, il faut le
confier comme un dépôt à la mémoire, et le recommander à l'action ;
que le devoir de l'orateur est d'instruire, de toucher et de plaire
; -que les moyens d'instruire sont la narration et l'argumentation ;
les moyens de toucher, les passions, lesquelles doivent régner dans
toute l'oraison, mais surtout au commencement et à la, fin ; que,
pour ce qui est de plaire, quoique l'orateur doive rechercher cette
fin dans les choses et dans les mots, sa place proprement dite est
dans l'élocution ; que, parmi les questions, les unes sont
indéfinies, les autres définies, c'est-à-dire limitées à des
considérations de personnes, de lieux et de temps ; que toute chose
comporte trois questions : si elle est, ce qu'elle est, quelle elle
est. A cela nous avons ajouté que le genre démonstratif
consiste dans la louange ou le blâme ; que, pour le
bien traiter, il faut considérer et ce qu'a fait la personne dont on
parle, et ce qui s'est passé après sa mort ; que par conséquent l'utile
et l'honnête sont la matière des discours de ce genre ; -.
que, dans le genre délibératif, indépendamment de l'honnête
et de l'utile, il faut examiner par conjecture si la chose est
possible, et si, dans le cas de possibilité, il est probable
qu'elle réussisse. J'ai dit que c'est là surtout qu'il faut
considérer qui est celui qui parle, devant qui il parle, et sur
quoi il parle. Ensuite, passant au genre judiciaire, j'ai
fait remarquer que les causes roulent, ou sur un seul chef, ou sur
plusieurs ; que, dans quelques-unes, il suffit à l'accusateur de
se porter comme demandeur, et à l'accusé de se porter comme
défendeur ; que l'accusé peut nier le fait de deux manières, ou
en contestant son existence, ou en contestant sa nature
; qu'il peut aussi le soutenir juste ou le rejeter sur
autrui ; que la question tombe ou sur un fait ou sur un
écrit ; que, dans un fait,on considère sa probabilité, sa
nature, sa qualité, et, dans un écrit, la lettre ou l'esprit
: ce qui renferme une discussion exacte des causes ou hypothèses
oratoires, aussi bien que des actions, c'est-à-dire des procès
civils ou criminels, et ou l'on examine aussi les quatre états de
questions légales, dont le premier se nomme état de la lettre et de
l'esprit ; le second syllogisme ; le troisième amphibologie ; et le
quatrième antinomie. J'ai dit que, dans toute cause judiciaire, il y
a cinq parties : l'exorde, qui sert à préparer le juge ; la
narration, qui expose la cause ; la confirmation, qui
sert à l'établir ; la réfutation, qui sert à la détruire ; la
péroraison, qui a pour fin de rafraîchir la mémoire du juge
ou d'émouvoir les passions. J'ai joint à cela un traité des lieux
d'où se tirent les arguments et les passions, et des moyens par
lesquels on peut irriter le juge, ou l'apaiser, ou le délasser.
Enfin j'ai donné les règles de la division. Mais ceux qui liront cet
ouvrage dans le dessein de s'instruire sont avertis de ne pas
oublier que c'est la nature qui a tracé primitivement la route ; que
c'est elle que nous devons prendre pour guide en mille occasions en
sorte que les règles que j'ai prescrites jusqu'à présent se doivent
moins regarder comme une invention des rhéteurs que comme le
résultat de leurs observations.
Ce qui suit demande plus de travail et
de soin, car je vais maintenant traiter de l'élocution, qui,
de l'aveu de tous les orateurs, est la partie la plus difficile de
la rhétorique. En effet, lorsque Marc-Antoine, dont j'ai déjà parlé,
prétendait qu'il avait vu beaucoup d'hommes diserts, mais pas un
qui fut éloquent, il entendait sans doute qu'il suffit pour
être disert de dire ce qu'il faut ; mais que, pour être
éloquent, il faut déployer toutes les richesses du style. Or, si
cette qualité ne s'est rencontrée dans aucun orateur jusqu'à lui, ni
même en lui ou en L. Crassus, il est certain qu'elle ne leur a
manqué à tous que parce qu'elle est très difficile à acquérir. Enfin
Cicéron déclare que de savoir inventer les choses et les disposer,
c'est le fait de tout homme sensé ; mais que de savoir les exprimer,
c'est le propre de l'orateur. Aussi s'est-il particulièrement
appliqué à cette partie de l'art ; et le nom d'éloquence dont
il se sert fait assez voir qu'il a eu raison ; car s'exprimer,
eloqui, c'est produire au dehors sa pensée et la communiquer
aux auditeurs : sans quoi tout ce qui précède l'élocution est
inutile, et semblable à une épée qui ne sort pas du fourreau.
Voilà donc surtout ce qui s'enseigne ;
voilà ce que nul ne peut acquérir sans l'art ; voilà quel doit être
l'objet de nos ;études ; voilà le but de nos exercices, de notre
imitation ; voilà ce qui peut occuper toute la vie ; voilà enfin ce
qui fait qu'un orateur l'emporte sur un autre orateur, un style sur
un autre style : car il ne faut pas croire que les Asiatiques, ou
toute autre espèce d'orateurs dont le style : est corrompu, n'aient
rien entendu à l'invention ou à la disposition des choses, ; ni que
ceux que nous appelons arides aient été dépourvus de sens et de
raison sous ce rapport, ; mais les premiers n'ont eu ni goût ni
mesure dans leur style, et les seconds ont manqué de force : preuve
évidente que c'est dans le style que réside le défaut ou le mérite
de l'éloquence. Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il faille penser
uniquement aux mots ; et je me hâte de prévenir ceux qui voudraient
m'arrêter, pour ainsi dire, au passage, et abuser de ce que je viens
de confesser. Je ne laisserai tirer aucune conséquence de mes
paroles à ces gens qui, sans se mettre en peine des choses,
lesquelles sont pourtant les véritables nerfs du discours, se
consument sur des mots, et cela pour donner de la grâce à leur style
: ce qui est sans doute un grand mérite, mais quand cela vient
naturellement, et non quand on l'affecte. Les corps sains, dont le
sang est pur et que l'exercice a fortifiés, tirent leur beauté de la
même source que leur vigueur. Ils joignent l'éclat à la mâle
expression de la force, tandis que des corps épilés et fardés nous
déplaisent par cette affectation même de beauté factice ou féminine.
Une parure noble et décente donne de la dignité à l'homme,
dit un vers grec ; mais l'afféterie d'une toilette qui ne convient
qu'aux femmes ne couvre pas le corps, et laisse voir l'âme à nu. De
même cette élocution transparente, et semblable au voile des
courtisanes, donne un air efféminé aux choses qui en sont revêtues.
Je veux donc qu'on accorde du soin aux mots, mais de la sollicitude
aux choses ; car le plus souvent les expressions tiennent aux choses
mêmes, et se découvrent à nous par leur propre éclat. Cependant nous
les cherchons, comme si elles se cachaient toujours et qu'elles
voulussent se dérober à nos yeux. Persuadés qu'elles ne sont jamais
auprès des choses dont nous avons à parler, nous faisons beaucoup de
chemin loin du sujet, et, après les avoir découvertes, nous leur
faisons violence pour les entraîner. La beauté de l'éloquence vent
des ornements plus mâles, et, lorsqu'elle est saine et vigoureuse,
il ne lui faut pas tant de frisure et de façon ; mais il arrive la
plupart du temps que c'est ce soin même qui corrompt le style, parce
que les meilleures expressions sont celles qui ne sentent pas la
recherche, mais qui ont l'air simple et naturel de la vérité. En
effet, celles qui accusent une affectation ambitieuse réussissent
rarement à plaire, et encore moins à convaincre, parce qu'elles
obscurcissent les pensées comme l'ivraie étouffe le bon grain. Plus
amoureux des mots que des choses, ce qui pourrait se dire tout
simplement, nous l'enveloppons de longues circonlocutions ; ce qu'il
suffit d'avoir dit une fois, nous le répétons ; ce qui n'a besoin
que d'un mot, nous le surchargeons d'un amas d'autres mots ; et la
plupart du temps nous aimons mieux faire entendre plus que nous ne
disons, ou même ce que nous ne disons pas, que d'émettre ouvertement
notre pensée. Il y a plus le mot propre déplaît aujourd'hui, rien ne
nous paraissant beau de ce qu'un autre eût dit comme nous. Les
poètes les moins naturels, les plus guindés, sont ceux de qui nous
empruntons des figures ou des métaphores, ne croyant être spirituels
qu'autant qu'il faut de l'esprit pour nous comprendre. Cependant
Cicéron enseigne assez nettement que le plus grand défaut du
style est de s'éloigner de la manière commune de penser et de parler.
Mais Cicéron n'était qu'un barbare, un ignorant, en comparaison de
nous, qui n'aimons rien de ce que la nature nous montre du doigt,
qui cherchons, non l'ornement, mais le raffinement, comme si les
mots, sans cohésion avec les choses, pouvaient avoir quelque valeur.
Or, si pour faire qu'ils soient propres, clairs, élégants et bien
placés, il faut un travail de toute la vie, avouons que nous avons
étudié en pure perte. Voilà cependant ce que font la plupart des
orateurs. Que de peines autour de chaque mot, et pour le trouver, et
pour le peser, et pour le mesurer, après l'avoir enfin trouvé ! Et
quand ils en tireraient cet avantage de ne se servir jamais que des
plus belles expressions, je les trouverais encore fort à plaindre
dans leur résultat. Qu'estce en effet qu'un art qui comprime tout
essor, éteint tout enthousiasme, à force de défiance ? C'est un
orateur bien misérable et, pour ainsi dire, bien pauvre, que celui
qui ne peut se résoudre à perdre un seul mot ; mais ce mot si cher
n'échappera même pas à celui qui connaîtra le vrai principe du
style, qui, par la lecture assidue des modèles, aura fait une ample
provision de mots, qui aura étudié l'art de les arranger, qui enfin,
par un continuel exercice, se sera si bien approprié ces richesses
qu'il les ait toujours sous la main et devant les yeux. Celui-là
verra chaque chose se présenter avec son mot ; mais pour cela il
faut avoir longtemps étudié, et s'être fait un certain fonds, qui
soit comme en réserve pour ne jamais manquer au besoin ; car cette
anxiété qui cherche, juge, compare, c'est en apprenant qu'elle est
de saison, et non en parlant. Autrement, semblables à ces gens qui,
faute de s'être amassé du bien, se trouvent réduits aux expédients,
ces orateurs se trouvent embarrassés faute d'études préliminaires.
Si, au contraire, nous avons eu la prévoyance de nous faire un fonds
pour la nécessité, nous le trouverons en temps et lieu ; et les
mots, sans attendre que nous les cherchions, s'offriront d'euxmêmes
avec les choses, auxquelles ils sont ce que l'ombre est au corps.
Encore ce soin même de l'expression doit-il avoir des bornes ; car
si nos mots sont latins, significatifs, élégants et bien placés, que
nous faut-il davantage ? Cependant il y a des orateurs qui ne
sauraient mettre fin à l'injuste critique qu'ils exercent contre
euxmêmes, et qui pèsent jusqu'aux syllabes ; qui, même après avoir
trouvé les meilleures expressions, cherchent encore s'il n'y en
aurait pas quelque autre qui fût plus antique, plus détournée, plus
imprévue. Ils ne voient pas que la pensée reste, pour ainsi dire,
dans un coin, là où l'admiration est toute pour l'expression.
Je conclus donc qu'il faut apporter le
plus grand soin à l'expression, pourvu toutefois qu'on se souvienne
qu'il ne faut rien faire pour l'amour des mots, puisque les mots ne
sont faits que pour les choses. Or, ceux-là sont les meilleurs qui
expriment le mieux notre pensée et qui produisent sur l'esprit des
juges l'effet que nous souhaitons. Notre diction ne peut alors
manquer de causer de l'admiration et du plaisir ; mais cette
admiration ne sera point celle que causent les monstres, les
prodiges ; ce plaisir ne sera point celui que causent le raffinement
et la corruption, mais un plaisir qui peut compatir avec la dignité.
CHAP. I. Ce que les
Grecs appellent φράσις nous l'appelons élocution. On la
considère dans les mots, ou pris isolément, ou joints
ensemble. Dans les premiers, il faut examiner s'ils sont
latins, clairs, élégants, et appropriés à ce que nous voulons
exprimer ; dans les seconds, s'ils sont corrects, bien placés et
figurés. Pour ce qui est de la manière de parler correctement en
latin, j'ai traité cette matière dans le premier livre, au chapitre
de la grammaire. Mais là mes préceptes se sont bornés aux
vices du langage ; ici, il n'est pas hors de propos de recommander
que les mots ne sentent en rien la province ou
l'étranger ; car on voit beaucoup de gens qui, sans ignorer les
règles du langage, s'expriment néanmoins d'une manière précieuse
plutôt que latine : témoin cette vieille femme d'Athènes qui, en
entendant un seul mot un peu affecté de Théophraste, homme
d'ailleurs fort éloquent, dit : Voilà un étranger ! Et
quelqu'un lui ayant demandé à quoi elle avait remarqué cela :
C'est, dit-elle, qu'il parle d'une manière trop attique.
Pollion, au contraire, trouvait dans Tite-Live, cet écrivain d'une
si rare éloquence, une certaine patavinité. Que tous nos mots
donc, s'il est possible, et que notre accent même révèle un vrai
Romain, né à Rome.
CHAP. II. La
clarté dans les mots naît principalement de la propriété ; mais
la propriété n'a pas qu'une seule acception ; car,
premièrement, on entend par là le vrai nom de chaque chose, mais
l'on ne s'en sert pas toujours, parce qu'on doit éviter ceux qui
sont obscènes, ou dégoûtants, ou bas. Les mots bas sont ceux qui
répugnent à la dignité des choses ou des personnes. Mais, en voulant
éviter ce défaut, quelques personnes tombent dans un autre : c'est
de n'oser se servir des termes consacrés par l'usage, lors même que
leur sujet l'exige : comme un certain orateur qui, en plaidant,
disait l'herbe d'Ibérie ; ce qu'il eût probablement compris
tout seul, si Cassius Severus, pour se moquer de sa puérilité, n'eût
averti que c'était du jonc qu'il voulait parler. Je ne vois
pas non plus pourquoi un célèbre orateur a cru que cette périphrase,
des poissons conservés dans la saumure, était plus élégante
que le terme qu'il évitait. Or, cette propriété qui consiste à se
servir du nom propre est une qualité purement négative, mais le
contraire est un défaut : C'est ce que nous appelons terme impropre,
en grec ἄκυρος telle est cette expression de Virgile, espérer une
si grande douleur, et cette autre d'une oraison de Dolabella,
que j'ai trouvée corrigée par Cicéron, porter la mort ; et quelques
autres qui sont aujourd'hui louées de certaines personnes, comme
decernere, verba ceciderunt. Cependant tout ce qui n'est pas
propre n'est pas toujours pour cela impropre, parce que, entre
autres raisons, il y a beaucoup de choses en grec et en latin qui
n'ont point de nom propre ; car lancer un dard, c'est proprement
darder ; mais pour celui qui jette une balle ou un pieu, il n'y
a point de terme propre qui exprime son action ; et, quoiqu'on dise
fort bien lapider, il n'y a point de mot particulier pour
exprimer l'action de jeter une motte déterre ou une tuile ; de là
vient que le trope appelé κατάχρησις, en latin abusio, est
nécessaire. La métaphore, qui est un des plus beaux ornements
du discours, applique certains mots à des choses auxquelles ils ne
conviennent pas. C'est pourquoi la propriété dont il s'agit ici se
rapporte, non au mot, mais à la signification ; et ce n'est pas à
l'oreille, mais à l'esprit, qu'il appartient d'en juger.
En second lieu on appelle propre un
mot qui appartient à plusieurs choses, mais particulièrement à l'une
d'elles, parce que toutes les autres ont tiré leur dénomination de
celle-là. Par exemple, le mot vertex signifie proprement une
eau qui tournoie, et tout ce qui se meut en forme de tourbillon.
Puis, par métaphore, on a appelé ainsi le sommet de la tête, à cause
des cheveux qui flottent à l'entour ; puis, parce que l'on a donné
ce nom au sommet de la tête, on l'a donné aussi à la partie la plus
élevée d'une montagne. Le mot vertex convient bien à toutes
ces choses, mais proprement il signifie un tourbillon. Les noms de
cettains poissons ont la même origine, comme ceux que nous nommons
soleae et turdi. Troisièmement, un mot est propre
quand, pouvant convenir à plusieurs choses, il est néanmoins comme
affecté à quelqu'une en particulier : tel est le mot nœnia
pour désigner proprement un chant funèbre, et le mot augurale, qui
se dit de la tente d'un général. J'en dis autant des mots qui sont
communs à plusieurs choses de même nature, mais qui s'entendent
particulièrement d'une seule, comme le mot urbs, la ville,
pour dire Rome ; celui de venales pour désigner des esclaves
qui n'ont pas encore servi un an ; celui de Corinthia pour
dire airain de Corinthe, quoiqu'il y ait plusieurs autres villes,
plusieurs autres choses vénales, et de l'argent et de l'or de
Corinthe aussi bien que de l'airain : mais en tout cela il n'y a
rien dont l'orateur puisse se faire un mérite. Mais une sorte de
propriété qui le regarde davantage et dont je fais un grand cas,
c'est celle de certaines expressions significatives, comme celle-ci
de Caton César conçut, en homme sobre, le dessein de renverser la
république ; comme deductum carmen, de Virgile ; acrem
tibiam, Hannibalemque dirum, d'Horace. Quelques-uns rapportent à
cette espèce de propriété l'apposition ou l'épithète, comme dulce
mustum, et cum dentibus albis. Mais c'est une espèce
particulière dont je parlerai ailleurs. Les mots qui sont
heureusement transportés sont aussi appelés propres. Quelquefois
enfin un mot, qui sert à caractériser une personne, est regardé
comme propre : tel est celui de temporiseur, qui fut donné à
Fabius.
Comme il s'agit ici de la clarté dans
les mots, il semble que ce serait le lieu de parler de ces mots qui
signifient plus qu'ils ne disent ; car ils aident à l'intelligence.
Cependant j'aime mieux ranger l'emphase parmi les ornements de
discours, parce qu'elle ne sert pas tant à faire comprendre, qu'à
donner à entendre plus qu'on ne dit.
D'un autre côté, l'obscurité naît
aussi des mots qui s'éloignent de l'usage ordinaire : si, par
exemple, quelqu'un feuilletait les annales des pontifes, les vieux
traités et les écrits surannés des plus anciens auteurs, à dessein
d'y ramasser des expressions que personne ne pût entendre ; car il y
a des gens qui affectent en cela un air d'érudition, voulant passer
pour être les seuls qui sachent certaines choses. On est trompé
aussi à certains mots qui sont particuliers à certains pays ou à
certains arts, comme le vent atabulus, le vaisseau nommé
saccaria, et in malaco sanum. Il ne faut pas s'en servir
devant des juges qui en ignorent le sens, ou du moins il faut avoir
soin de leur en donner l'explication, ainsi que de ceux qu'on
appelle homonymes, comme taures ; car à moins qu'il ne soit
expliqué, on ne sait s'il signifie un animal, ou une montagne, ou
une constellation, ou le nom d'un homme, ou une racine d'arbre.
Toutefois l'obscurité est plus grande dans une longue suite de mots,
c'est-à-dire dans la contexture du discours, et cette obscurité a
plusieurs causes. Prenons donc garde que nos phrases ne soient d'une
telle longueur, qu'une attention raisonnable ne puisse les suivre ;
ni tellement traversées par des membres de phrases intermédiaires,
que, comme dans l'hyperbate, on ne puisse les comprendre que
lorsqu'on est tout à la fin. Un défaut qui est encore pire, c'est le
mélange de mots enchevêtrés les uns dans les autres, comme dans ce
vers
Saxa vocant Itali, mediis quae in fluctibus, aras.
La parenthèse, dont les orateurs et
les historiens se servent fréquemment pour intercaler une pensée au
milieu d'une période, embarrasse ordinairement le sens, à moins
qu'elle ne soit courte. ainsi, Virgile, après avoir dit dans sa
description du jeune cheval : Il ne craint pas les vains bruits,
entremêle une pensée de cinq vers et revient à la première en se
servant d'un autre tour : Puis, si le bruit des armes se fait
entendre au loin, il ne peut rester en place. Surtout il faut
éviter l'ambiguïté, je ne dis pas seulement celle dont j'ai parlé
plus haut, et qui laisse l'esprit dans l'incertitude, comme, par
exemple, Chremetem audivi percussisse Demeam ; mais encore
celle qui, bien qu'elle ne puisse troubler le sens, tombe néanmoins,
quant aux mots, dans le défaut de l'autre, comme dans cette phrase :
visum a se hominem librum scribentem ; car, bien qu'il soit
clair que c'est l'homme qui écrit le livre, l'arrangement est
mauvais, et aussi ambigu qu'il peut l'être. Quelques-uns pèchent
aussi par une malheureuse abondance de termes inutiles. Dans la
crainte de parler comme tout le monde, et séduits par une vaine
apparence de beauté, ils tournent avec une merveilleuse prolixité
autour de ce qu'ils ne veulent pas exprimer. Ensuite, joignant ce
tissu de mots à un autre, et celui-ci à un troisième, ils donnent à
leurs périodes une étendue telle qu'il n'est pas d'haleine qui
puisse y suffire. Il s'en trouve même qui prennent à tâche d'être
obscurs, et ce défaut n'est pas nouveau ; car je lis dans Tite-Live
que, de son temps, il y avait un maître qui recommandait à ses
élèves d'obscurcir ce qu'ils disaient, usant pour cela du mot
grec σκότισον : d'où est venu sans doute cet éloge non-pareil : A
la bonne heure, je n'y comprends rien moi-même. D'autres,
amoureux de la brièveté jusqu'à l'excès, retranchent jusqu'aux mots
nécessaires, et, pourvu qu'ils s'entendent euxmêmes, ne se mettent
nullement en peine d'être entendus de l'auditoire. Pour moi, je ne
vois que des paroles oiseuses dans un discours où l'auditeur ne
comprend quelque chose qu'à la clarté de son propre esprit. D'autres
enfin, en corrompant les mots, trouvent moyen de faire servir les
figures à obscurcir le discours. Mais le genre d'obscurité le plus
détestable est ce que les Grecs appellent ἀδιανόητον. Cette
obscurité consiste dans l'emploi de mots qui, sous un sens clair, en
cachent un autre : ainsi, conducτus est caecus secus viam stare
; ou bien cette sorte de figure par laquelle on peint dans les
écoles un homme déchirant ses membres avec ses dents, supra se
cubasse, se coucher sur soi. Ces tours de force passent pour des
traits hardis d'éloquence ; et plusieurs ont la manie de croire
avoir atteint le terme de l'élégance, lorsque, pour être entendus,
ils ont besoin d'un interprète ; et il y a même une certaine classe
d'auditeurs qui prend plaisir à les écouter ; car, s'imaginant avoir
compris, ils sont charmés de leur pénétration, et s'applaudissent
non d'avoir entendu, mais d'avoir deviné.
Quant à nous, recherchons avant tout
la clarté, la propriété des termes, la continuité sans interruption
ni longueur ; rien de moins, rien de trop : c'est le moyen d'être
approuvé des hommes éclairés et d'être compris des ignorants. Voilà
pour la clarté dans les mots. Pour ce qui est de la clarté dans les
choses, nous en avons parlé au chapitre de la narration. Et l'on
peut dire en général qu'il en est de même pour tout ; car si les
choses que nous disons n'ont ni plus ni moins d'étendue qu'il n'en
faut, et ne sont ni désordonnées ni confuses, elles seront si
claires, si nettes, que l'auditeur le moins attentif les comprendra.
En effet, il faut compter qu'un juge n'est pas toujours assez
attentif pour pouvoir éclaircir en lui notre obscurité, et porter de
luimême la lumière dans les ténèbres d'un plaidoyer ; mais qu'au
contraire il est souvent distrait par une foule de pensées qui
l'empêchent de comprendre nos paroles, à moins que leur clarté
n'illumine son esprit inappliqué, comme le soleil illumine nos yeux,
quoiqu'ils ne soient pas fixés sur lui. Ce n'est donc pas assez de
faire en sorte qu'il puisse nous comprendre, il faut même qu'il ne
puisse aucunement ne pas nous comprendre. C'est pour cela que
souvent nous répétons ce que nous croyons qu'il n'a pas bien compris
d'abord : C'est ma faute, je ne me suis pas bien expliqué ; je
vais donc m'exprimer en termes plus clairs et plus intelligibles
: tout orateur étant bien reçu à répéter ce qu'il feint n'avoir pas
bien dit la première fois.
CH.
III. Je vais maintenant parler de l'ornement, qui, plus que
toute autre partie du discours, invite l'orateur à se donner
carrière ; car il n'y a pas grand mérite à parler correctement et
clairement, et l'absence de vices ne suppose pas une grande
perfection. L'invention peut se rencontrer avec l'ignorance, et la
disposition avec une science médiocre. L'art même que comporte la
disposition se cache le plus souvent, pour mériter ce nom.
D'ailleurs, tout cela se doit rapporter uniquement au bien de la
cause. C'est donc par la parure et l'ornement que l'orateur se
recommande véritablement comme tel. Dans les autres parties il
cherche l'approbation des doctes ; dans celle-ci, la faveur
populaire. Les armes avec lesquelles Cicéron combattit dans la cause
de Cornélius étaient non seulement fortes et de bonne trempe, mais
aussi brillantes ; et s'il se fût contenté d'instruire les juges, de
parler purement, nettement, et en homme qui va simplement au fait,
il n'aurait pas vu le peuple romain témoigner son admiration non
seulement par des acclamations, mais encore par des
applaudissements. Ce furent donc la sublimité, la magnificence,
l'éclat et l'autorité de son éloquence, qui arrachèrent ce bruyant
témoignage ; et certainement son plaidoyer n'eût point été suivi de
ces transports extraordinaires, s'il n'avait eu rien que
d'ordinaire, rien que de commun. Je suis même persuadé que les
auditeurs ne se rendirent pas compte de ce qu'ils faisaient, et
qu'en applaudissant ils cédèrent à un mouvement involontaire, sans
se souvenir du lieu où ils étaient, et semblables à des gens que le
plaisir jette hors d'eux-mêmes. Mais cette beauté dont je parle
contribue même beaucoup au succès de la cause ; car on écoute et on
croit plus volontiers ce qui plaît ; très souvent le plaisir suffit
pour captiver, ou l'admiration pour entraîner. C'est ainsi que
l'éclat du fer effraye les yeux ; et ce n'est pas seulement par son
bruit que le tonnerre nous épouvante, mais aussi par l'éclair qui le
précède. Cicéron a donc raison quand il dit, dans une lettre à
Brutus : L'éloquence qui ne cause pas d'admiration est nulle à
mes yeux. C'est à cet effet qu'Aristote veut aussi qu'on tende
principalement ; mais, je le répète, que cette parure soit mâle,
noble et chaste. Je veux une éloquence ennemie du fard et de toute
afféterie féminine, qui brille pourtant, mais de santé et de force.
Cela est si vrai, que, dans cette partie où la nuance qui distingue
les qualités des défauts est si délicate, ceux même qui tombent dans
les défauts leur donnent les noms des qualités elles-mêmes. Que nul
de ces écrivains corrompus ne s'avise donc de dire que je suis
ennemi de ceux qui parlent élégamment. Je ne nie pas que ce soit une
qualité, mais je ne la leur accorde pas. Un champ où l'on me
montrera des lis, des violettes, des anémones, des eaux
jaillissantes, le croirai-je donc plus orné que si j'y voyais une
riche moisson ou des vignes chargées de raisins ? Veut-on que je
préfère un platane stérile et des myrtes artistement taillés, à un
orme entrelacé de pampres, ou à des oliviers pliant sous leurs
fruits ? Que les riches fassent leurs délices de ces fleurs et de
ces arbres, j'y consens : (que deviendraient-ils pourtant, s'ils
n'avaient pas autre chose ? Mais n'est-il pas permis d'orner un
verger ? qui en doute ? Aussi planterai-je mes arbres avec ordre, et
à une certaine distance les uns des autres. Quoi de plus agréable
qu'un quinconce, qui, de quelque côté qu'on le regarde, est droit et
aligné, ? Et cela même sert à répartir également entre tous le suc
de la terre. J'émonderai mes oliviers, et, en recevant une forme
plus belle et plus arrondie, ils porteront aussi plus de fruits. Un
cheval qui n'a point trop de flanc a certainement plus de grâce ;
mais il est en même temps plus rapide. Un athlète que l'exercice a
développé, et dont les muscles sont bien prononcés, est beau à voir
; mais il est aussi plus propre au combat. La vraie beauté n'est
jamais séparée de l'utilité ; et il ne faut qu'un discernement
médiocre pour reconnaître cette vérité. Mais ce qui est plus digne
de remarque, c'est que l'ornement, tel que je l'entends, doit varier
selon la nature du sujet. Et, pour commencer par notre division
accoutumée, la même beauté ne convient pas aux trois genres
d'éloquence, démonstratif, délibératif, et judiciaire. L'ostentation
du premier n'a d'autre but que le plaisir de l'auditeur. C'est
pourquoi l'orateur y déploie toutes les richesses de l'art ; il en
étale toute la pompe, n'étant pas obligé de cacher sa marche, et
n'ayant pas en vue le gain d'une cause, mais sa propre gloire et sa
réputation. Aussi tout ce qu'il y a de plus populaire dans les
pensées, de plus brillant dans les mots, de plus séduisant dans les
images, de plus magnifique dans les métaphores, de plus châtié dans
la composition, il l'exposera comme un marchand, et le donnera
presque à toucher. C'est que, dans ce genre, le succès ne regarde
que l'orateur. Mais lorsqu'il s'agit d'un procès et d'un combat
sérieux, le soin de sa réputation ne doit venir qu'après tous les
autres. Il ne doit jamais non plus, lorsqu'il s'agit de grands
intérêts, se montrer trop préoccupé des mots : non qu'il doive
mépriser toute espèce d'ornements ; mais il faut que sa parure soit,
en quelque sorte, plus appliquée au corps, plus sévère, par là moins
accusée, et surtout appropriée à la matière. Une délibération dans
le sénat demande quelque chose de plus élevé ; l'assemblée du
peuple, quelque chose de plus véhément ; au barreau, les causes
publiques ou capitales veulent un genre d'éloquence plus grave et
plus exact ; mais dans un conseil privé, et dans des procès de peu
d'importance, comme c'est l'ordinaire, un langage pur, simple et
naturel, est tout ce qu'il faut. Qui ne rougirait de réclamer une
modique somme d'argent en périodes sonores, ou de se passionner en
parlant d'une gouttière, ou de suer sang et eau en plaidant un cas
rédhibitoire contre un marchand d'esclaves ? Mais je reviens à mon
sujet ; et parce que l'ornement, ainsi que la clarté, dépend des
mots pris séparément ou des mots joints ensemble, examinons ce
qu'ils demandent les uns et les autres.
En premier lieu, quoiqu'on enseigne
avec raison que les mots propres contribuent plus à la clarté, et
les métaphoriques à l'ornement, sachons néanmoins que ce qui est
impropre ne saurait être orné. Mais comme plusieurs mots signifient
très souvent la même chose, ce que les Grecs appellent συνωνυμία, il
faut savoir les choisir, ces mots étant plus beaux,plus nobles, plus
brillants, plus agréables, plus harmonieux les uns que les autres ;
car, de même que les lettres qui ont un son plus clair communiquent
cette qualité aux syllabes qu'elles composent, de même les mots qui
sont composés de ces syllabes en deviennent plus harmonieux ; et
plus les syllabes ont de force et de fond, plus elles remplissent
l'oreille. Et ce que fait l'enchaînement des syllabes,
l'enchaînement des mots le fait aussi ; en sorte que tel mot sonne
bien avec l'un, qui sonnerait mal avec un autre. L'emploi des mots
varie néanmoins selon les matières : des termes durs et âpres
conviendront mieux à des choses atroces ; mais en général, lorsque
les mots sont pris isolément, on peut dire que les plus sonores ou
les plus doux sont les meilleurs. Les expressions honnêtes sont
toujours préférables à celles qui choquent la bien ; séance,et
jamais un terme grossier ne doit entrer dans un discours poli. A
l'égard des mots nobles et relevés, c'est le sujet qui décide de
leur choix ; car le même mot qui est magnifique dans un endroit est
enflé dans un autre ; et tel autre qui paraît bas dans un sujet
élevé serait convenable dans un sujet moins sublime ; et de même
qu'un mot trop bas est choquant, et fait, pour ainsi dire, tache
dans un discours brillant, de même un terme pompeux et brillant fait
disparate dans un entretien familier, et devient mauvais, parce
qu'il forme une boursouflure sur un corps uni. II est des
expressions dont l'élégance se fait mieux sentir qu'il n'est aisé
d'en raisonner. Ainsi Virgile, en employant le nom de la femelle
pour celui du mâle
...Caesa jungebant foedera pocta,
a exprimé élégamment une chose qui,
autrement, aurait paru ignoble. Il en est d'autres dont la raison
est manifeste. Ainsi on s'est moqué, et avec raison, d'un poète
contemporain qui avait dit platement
Les souris ont mangé la robe de Camille ;
taudis qu'au contraire on admire cet
hémistiche de Virgile : Souvent un petit rat, etc. ; car
cette épithète, qui est si propre, nous dispose à ne rien attendre
de plus que le monosyllabe qui suit ; le singulier sied mieux aussi,
et cette manière inusitée de finir un vers en achève la grâce. Il ne
faut donc pas s'étonner si Horace a imité Virgile
...... Nascetur ridiculus mus.
En effet, loin de rehausser toujours
notre style, il faut quelquefois l'abaisser, pour lui donner de la
force. Quand Cicéron dit à Pison : Vous, dont on voit aujourd'hui
toute la famille traînée dans un tombereau ; pense-t-on que
cette expression déshonore son discours ? Ne semble-t-il pas plutôt
avoir, par ce terme, rendu plus méprisable l'homme qu'il voulait
perdre ? Et ailleurs n'a-t-il pas dit : Vous donnez de la tête
comme un bélier ? De là naissent quelquefois certains jeux de
mots, que les sots entendent toujours avec plaisir : tels sont les
suivants, qu'on trouve dans Cicéron : Pusio, qui cum majore
sorore cubitabat ; et, Cn. Flavius, qui creva les yeux à des
corneilles ; et, dans son plaidoyer pour Milon, Holà, Ruscion
! et, dans celui pour Varénus, Erutius Antoniaster. Cependant
les déclamations y sont encore plus sujettes ; et je me souviens
que, dans mon enfance, on applaudissait à ces plaisanteries, telles
que : Donnez du pain à votre père ; et, au sujet du même
homme, Vous nourrissez même un chien. Ces plaisanteries ont
néanmoins leurs dangers, surtout dans les écoles, et y sont l'a
plupart du temps un sujet de risée, et, plus que jamais,
aujourd'hui, que les déclamateurs, en haine du naturel et du vrai,
ont, par un dégoût ridicule, condamné une foule de mots,et proscrit
une bonne partie de la langue.
J'ai dit que les mots sont propres,
nouveaux, ou métaphoriques. L'ancienneté donne de la
dignité aux mots propres. En effet, les mots dont l'usage n'est pas
commun à tout le monde rendent le style plus grave et plus
majestueux ; et Virgile, qui avait un tact si délicat, en a fait un
emploi merveilleux. Les mots olli, quianam, mis,
pone, jettent un vif éclat, et répandent ce vernis
d'antiquité, inimitable à l'art, et qui nous plaît jusque dans les
tableaux ; mais il en faut user sobrement, et ne pas aller les
chercher dans les ténèbres d'une antiquité trop reculée. Satis
est assez vieux : à quoi bon oppido, dont on se servait il
n'y a pas longtemps ? Je crains bien qu'aujourd'hui il ne soit pas
supportable. Pour antigerio, dont la signification est la
même, il ne plaira qu'à un orateur prétentieux. Qu'a-t-on besoin d'œrumna
;, comme si labor ne suffisait pas ? Reor est horrible
; autumno peut encore passer ; mais prolem ducendam
sent le vieux tragique, et universam ejus prosapiam est
insipide. Enfin presque toute la langue a changé ; cependant il y a
certains mots auxquels leur antiquité donne quelque grâce ; d'autres
sont même quelquefois nécessaires, comme nuncupare et fari
; il y en a enfin un grand nombre que l'on peut hasarder çà et là,
mais pourvu qu'il n'y paraisse pas d'affectation : défaut que
Virgile a si admirablement blâmé dans l'épigramme suivante
Corinthiorum amator iste verborum,
Thucydides Britannus, atticae febres,
Tau Gallicum, min, al, spinae male illi sit.
Ita omnia ista verba miscuit fratri.
Il s'agit ici de ce Cimber dont
Cicéron a flétri le fratricide par ce mot, Germanum Cimber
occidit ; et Salluste n'est pas plus épargné dans une autre
épigramme que tout le monde connaît : Et toi., Crispus, historien
de la guerre de Jugurtha, qui as dérobé tant de mots au vieux Caton.
Cette affectation est choquante., en ce qu'elle est facile au
premier venu ; et elle est d'autant plus vicieuse que celui qui
l'aime ne songera pas à approprier les mots aux choses, mais sera
obligé d'aller chercher au loin des choses auxquelles les mots
puissent convenir.
Créer des mots, c'est, comme je l'ai
dit dans le premier livre, une licence qui est plus permise aux
Grecs qu'à nous. Ils ont osé même exprimer certains sons et
certaines affections de l'âme par des noms conformes à leur nature,
avec la même autorité que les premiers humains. Mais nous, lorsque
nous avons voulu oser un peu en ce genre, soiten composant un mot de
plusieurs, soit en le faisant dériver de quelque autre, rarement
avons-nous réussi ; et je me rappelle que, lorsque j'étais encore
très jeune, Pomponius et Sénèque discutaient dans des préfaces si
gradus eliminat, qu'on lit dans une tragédie, était bien dit.
Nos pères cependant n'ont pas reculé devant expectorat ; et
certainement exanimat est du même aloi. Quant aux dérivés,
Cicéron nous en donne un exemple dans beatitas et
beatitudo, qui lui paraissent durs, à la vérité, mais que
l'usage, selon lui, peut adoucir. Non seulement certains noms sont
dérivés des verbes, mais certains verbes dérivent aussi des noms
propres, comme Sullaturit, de Cicéron, et Fimbriatus
et Figulatus, dont Asinius est l'auteur. Plusieurs mots
nouveaux ont été formés du grec, et par Sergius Flavius pour la
plupart ; mais quelques-uns paraissent très durs, comme ens
et essentia. Je ne vois pourtant pas ce qui nous les fait
tant mépriser, à moins que nous ne voulions être injustes envers
nous-mêmes, et que nous ne nous complaisions dans notre pauvreté. Il
s'en est trouvé néanmoins qui ont résisté à la première impression ;
car les mots qui nous paraissent anciens aujourd'hui ont été
nouveaux autrefois. Quelques-uns même sont en usage depuis fort peu
de temps, et c'est Messala qui le premier a dit malus, comme
Auguste a inventé munerarium. Piratica, musica,
fabrica, sont des mots dont mes maîtres regardaient encore
l'emploi comme douteux ; et favor, urbanus, étaient
pour Cicéron des mots nouveaux, comme on peut le voir dans une de
ses lettres à Brutus, et dans une autre à Appius Pulcher. Il pense
aussi que ce fut Térence qui se servit le premier du mot
obsequium. Cécilius attribue à Sisenna le mot albenti caelo
; et Hortensius paraît avoir dit le premier cervix ; car les
anciens n'employaient ce mot qu'au pluriel. Il faut donc oser ; car
je ne suis pas de l'opinion de Celsus, qui interdit à l'orateur le
droit de fabriquer des mots. En effet, parmi les mots, les uns sont,
comme dit Cicéron, primordiaux, c'est-à-dire dictés par la
nature, les autres sont de seconde institution,
c'est-à-dire formés des premiers ; mais bien qu'il ne nous soit pas
permis de changer les dénominations que les premiers hommes, tout
grossiers qu'ils étaient, ont données aux choses, le droit de les
dériver, de les détourner, de les composer, dont jouissaient encore
leurs enfants, depuis quand a-t-il dû cesser ? Et d'ailleurs si nos
créations paraissent un peu hasardées, nous avons la ressource des
correctifs, comme, pour ainsi dire, s'il est permis de m'exprimer
ainsi, en quelque sorte, passez-moi cette expression : ressource
également bonne dans l'emploi des métaphores un peu trop hardies. Et
cette précaution sera la preuve que notre goût n'est pas en défaut.
C'est ce que les Grecs appellent si élégamment demander grâce pour
l'hyperbole : προεπιπλήσσειν τῇ ὑπερβόλῃ. Quant aux termes
métaphoriques, ils ne peuvent être bons que dans la contexture du
discours. J'ai donc assez parlé des mots pris isolément, lesquels,
comme je l'ai fait voir ailleurs, n'ont par eux-mêmes aucune
qualité. Toutefois on ne peut pas dire qu'ils soient dépourvus
d'élégance, à moins qu'ils ne soient au-dessous de la chose qu'ils
expriment. J'excepte toujours les mots obscènes, sans vouloir entrer
en discussion avec ceux qui pensent qu'il n'y a aucune raison de les
éviter, soit parce qu'il n'y a, selon eux, aucun mot honteux de sa
nature, soit parce que, si la chose est honteuse en ellemême, de
quelque nom qu'on l'appelle, elle ne laisse pas de se faire
comprendre. Pour moi, sans alléguer d'autre raison que le respect de
la pudeur romaine, je ne défendrai l'honnêteté que par mon silence,
ainsi que je l'ai déjà fait en pareille occasion.
Hâtons-nous donc de passer aux mots
joints ensemble, c'est-à-dire au discours. L'ornement qu'il comporte
veut que l'on considère deux choses : le genre du style que le sujet
réclame, et la manière de le réaliser. D'abord il faut bien
distinguer ce qui a besoin d'être amplifié ou diminué, si nous
voulons parler avec feu ou avec modération ; dans quelles
circonstances le style doit être fleuri ou austère, abondant ou
concis, âpre ou doux, magnifique ou simple, grave ou enjoué : en
second lieu, quel genre de métaphores, de figures, de pensées, quel
tempérament, enfin quel arrangement il est nécessaire d'employer
pour produire l'effet désiré.
Mais
avant de parler de ce qui contribue à orner le discours, je dirai un
mot des défauts contraires à cette fin ; car le commencement de
la vertu est d'être exempt de vices. D'abord, n'espérons pas
qu'un discours puisse être beau sans la convenance. Or, par
convenance, Cicéron entend ce qui n'est ni plus ni moins qu'il
ne faut : non que le discours ne doive être paré et poli, car cela
est une partie de l'ornement, mais parce que tout ce qui tombe dans
l'excès est toujours vicieux. C'est pourquoi il veut que les mots
aient du poids, et que les pensées soient graves, ou du moins
appropriées aux opinions et aux moeurs des hommes. Cela sauf, il
permet du reste de recourir à tout ce qui peut embellir le style,
comme les termes choisis, les métaphores, les hyperboles, les
épithètes, lés répétitions, les synonymes, enfin les mots qui
imitent les actions ou les choses. Mais puisque j'ai entrepris
de parler d'abord des défauts, c'en est un que celui qu'on appelle
καέμφατον, soit que, par l'usage mauvais qu'on en a fait, les mots
aient pris une acception obscène, comme ductare exercitus,
patrare bellum, expressions chastes et antiques dans Salluste,
et qui aujourd'hui font rire les mauvais plaisants : ce qui n'est
pas, selon moi, la faute des écrivains, mais celle des lecteurs. Ne
laissons pas néanmoins de les éviter, puisque les moeurs ont
corrompu les mots, et qu'il faut céder au torrent. On tombe dans le
même défaut en joignant deux mots qui, par leur ;jonction, forment
une consonance sale ou obscène ; si, par exemple, en disant cum
hominibus notis loqui, le mot hominibus n'est pas placé
au milieu. Car la dernière lettre de la première syllabe, qui ne
peut se prononcer sans un rapprochement des lèvres, ou nous force de
faire une pause inconvenante, ou, si nous l'unissons à celle qui
suit, se perd dans la nature de celle-ci. Il y a d'autres jonctions
qui produisent à peu près le même effet ; mais je n'en parlerai pas,
ne voulant pas m'arrêter trop longtemps sur un défaut que je dis
qu'il faut éviter. Je passe à un autre point. Ce que fait l'union de
deux mots ou de deux syllabes, la division le fait aussi ;
c'est-à-dire qu'elle peut également blesser la pudeur, si, par
exemple, on se servait d'intercapedinis au nominatif. Et ce
n'est pas seulement le mot en lui-même qui est exposé à cet
inconvénient, mais très souvent aussi c'est dans la pensée qu'on va
chercher l'obscénité, comme dans cet endroit d'Ovide : Quaeque
latent meliora putat ; enfin, les mots les plus purs sont
quelquefois le sujet d'obscènes allusions, à tel point que Celsus
met au nombre de ces mots ce passage de Virgile Incipiunt agitata
tumescere ; mais, ou Celsus se trompe, ou l'on ne peut rien dire
en sûreté. Après l'obscénité vient la bassesse des termes,
ταπείνωσις, quand, par exemple, ils ne répondent pas à l'importance
ou à la dignité des choses, comme, une verrue de pierre sur le
sommet d'une montagne. Un défaut tout contraire, mais qui
provient de la, même erreur de jugement, c'est de parler des petites
choses en termes trop relevés, si ce n'est à dessein de faire rire.
Ainsi, je ne dirai pas qu'un parricide est un homme de rien,
ni qu'un homme qui aime une courtisane est un scélérat. Dans
le premier cas, ce serait trop peu ; dans le second, ce serait trop.
Il y a donc une certaine diction qui est lourde, grossière,
maigre, triste, désagréable, ignoble :
tous défauts qui se font mieux sentir par leurs contraires ; car il
en est une autre qui est vive, élégante, riche,
enjouée, agréable, noble. Évitons aussi un
certain défaut, μείωσις, qui fait que la phrase n'est pas assez
pleine, parce qu'en effet il y manque quelque chose. C'est néanmoins
le défaut d'une diction obscure plutôt que d'une diction négligée ;
mais quelquefois, et sciemment, on ne s'exprime qu'à demi, et alors
c'est une figure, de même que la répétition d'un mot ou de
plusieurs, appelée par les Grecs ταυτολογία. Quoique des auteurs de
premier ordre se soient mis peu en peine de l'éviter, la répétition
ne laisse pas d'être quelquefois un défaut ; et Cicéron lui-même y
tombe souvent, n'ayant pas daigné s'assujettir à un si petit détail,
comme lorsqu'il dit : Non seulement donc, juges, ce jugement n'a
rien qui ressemble à un jugement. Quelquefois encore cette
répétition, à laquelle on donne aussi le nom d'ἐπανάληψις, a de la
grâce, et on la range parmi les figures ; j'en donnerai des exemples
en son lieu, c'est-à-dire lorsque je parlerai des qualités de
l'ornement. Un défaut plus considérable encore, c'est l'uniformité,
ὁμοιολογία, qui accuse surtout l'absence de l'art, et qui, par la
froideur des pensées et des figures, par la lenteur et la monotonie
des phrases, n'est pas moins insupportable à l'oreille qu'à
l'esprit. Évitons aussi la prolixité, μακρολογία, comme dans ce
passage de Tite-Live : Les ambassadeurs, n'ayant pu obtenir la
paix, s'en retournèrent chez eux, d'où ils étaient venus. La
périphrase, qui a quelque affinité avec ce défaut, est une qualité.
Le pléonasme est aussi un défaut, quand il surcharge l'oraison de
mots superflus, si, par exemple, on disait : Je l'ai vu, moi, de
mes yeux ; car il suffit de dire : J'ai vu. Cicéron
reprit un jour agréablement ce défaut dans Hirtius, qui, en
déclamant contre Pansa, avait dit d'une mère, qu'elle avait porté
son fils pendant dix mois dans son sein. Apparemment,
reprit Cicéron, que les autres mères portent leurs enfants dans
leur poche. Quelquefois cependant le pléonasme, du genre de
l'exemple que j'ai donné en premier lieu, peut être heureusement
employé comme donnant plus d'affirmation à la pensée : Je l'ai
entendu de mes propres oreilles. Ce qui en fait le défaut, c'est
la redondance et la superfluité, et non l'addition du mot en
elle-même. Il y a aussi ce que les Grecs appellent περιεργία,
c'est-à-dire une ambitieuse et inutile recherche : elle est à
l'exactitude ce que la superstition est à la religion. En un mot,
toute expression qui ne contribue ni à la clarté ni à l'ornement
peut être regardée comme vicieuse. La prétention, κακόζηλον, est
partout un défaut. Elle comprend l'enflure, la maigreur, la douceur
fade, la diffusion, la recherche, la précipitation. Enfin, on
appelle de ce nom tout ce qui est au delà du bien, tout ce qui
marque plus d'esprit que de jugement et de goût. De tous les défauts
de l'éloquence, c'est le pire ; car on évite plus ou moins les
autres, mais celui-là on le cherche. Or, il est tout entier dans
l'élocution. Les choses que nous disons peuvent être dépourvues de
sens, communes, contradictoires, superflues : voilà en quoi elles
pèchent d'ordinaire. Mais la corruption du style consiste
particulièrement dans l'impropriété ou la redondance des termes,
dans l'obscurité des phrases, dans une composition lâche et brisée,
dans une recherche puérile de mots semblables ou ambigus. Il faut
remarquer que tout ce qui est affecté est faux, bien que ce qui est
faux ne soit pas affecté. C'est dire les choses autrement qu'elles
ne sont, ou en parler autrement qu'il ne faut, ou plus qu'il ne
faut. Enfin il y a autant de manières de corrompre le style que de
l'orner. C'est un point que j'ai amplement traité dans un autre
ouvrage, qui jusqu'à présent ne m'a pas non plus échappé dans
celui-ci, et qui trouvera sa place encore plus d'une fois ; car, en
parlant de l'ornement, je parlerai de temps en temps des défauts
qu'il faut éviter, et leur affinité avec les qualités suffira pour
m'en faire souvenir. On peut encore mettre au nombre des défauts
contraires à l'ornement ce qui pèche contre la disposition et
l'économie, ἀνοικονόμητον ; ce qui est mal figuré,
ἀσχήματον ; ce qui est mal composé, κακοσύνθετον. Mais j'ai
déjà parlé de la disposition ; quant aux figures et à la
composition, nous en traiterons ailleurs. Les Grecs appellent
κοινισμὸς un style mélangé de plusieurs dialectes, comme de
l'attique avec le dorien, etc. Le même défaut chez nous serait de
mêler confusément des expressions sublimes, ou vieilles, ou
vulgaires, avec des expressions basses, ou neuves, ou poétiques, et
de composer un tout d'éléments divers ; ce qui ferait un monstre
semblable à celui que décrit Vorace au commencement de son Art
poétique : Un peintre qui s'aviserait d'ajuster une tête
d'homme sur un cou de cheval.
Un style est orné, lorsqu'il n'a pas
que la clarté et la convenance. La première condition est de
concevoir vivement les choses ; la seconde, de les exprimer comme on
les conçoit ; la troisième, de répandre sur le tout un certain éclat
qui est, à proprement parler, l'ornement. Aussi faut-il ranger parmi
les moyens d'orner le discours cette qualité que les Grecs appellent
ἐναργαία, dont j'ai parlé dans les préceptes de la narration ; car
l'évidence, ou, selon une autre expression, la
représentation, est plus que la clarté ; celle-ci se laisse
voir, celle-là se montre elle-même. C'est une grande qualité, que de
savoir énoncer clairement les choses dont nous parlons, et de les
mettre en quelque sorte sous les yeux ; car nos paroles font peu
d'effet, et n'ont point cet empire absolu qu'elles doivent avoir,
lorsqu'elles ne frappent que les oreilles, et lorsqu'un juge croit
simplement entendre un récit, et ne voit pas des yeux de l'esprit le
fait dont il s'agit. Mais comme cette qualité se divise en plusieurs
espèces, que même quelques rhéteurs, par une affectation de
suffisance, prennent à tâche de multiplier encore, je toucherai
seulement les principales. La première consiste à présenter l'image
des choses comme dans un tableau. Rappelons-nous, par exemple, ce
passage où Virgile décrit le combat de deux athlètes, leurs
mouvements, leurs postures, nous croirons être spectateurs. Cicéron
excelle dans cette partie comme dans tout le reste. Quand on lit ce
qu'il dit de Verrès : On voyait sur le rivage un préteur romain
vêtu et chaussé à la grecque, en manteau de pourpre, en robe
traînante, appuyé nonchalamment sur une courtisane, est-il
quelqu'un qui ait l'imagination assez froide pour ne pas se
représenter, je ne dis pas seulement l'air, le vêtement et la
contenance de Verrès, mais même d'autres détails que l'orateur n'a
point indiqués ? Pour moi, je crois voir et le visage et les yeux et
les honteuses caresses de ces deux personnages, et le secret dégoût
et la rougeur timide des spectateurs. La seconde espèce est celle
qui, au moyen d'une énumération de parties, trace aux yeux l'image
d'une scène. Telle est, dans Cicéron, la description d'un repas de
débauche (car à lui seul il suffit pour fournir des exemples de tous
les genres d'ornement) : Il me semblait voir les uns entrer, les
autres sortir ; ceux-ci chanceler sous les vapeurs du vin, ceux-là,
encore fatigués de l'orgie de la veille, bâiller d'une manière
ignoble : le sol, humide de vin et fangeux, était jonché de
couronnes fanées et d'arêtes de poissons. Qu'eût-on vu de plus
en entrant dans la salle ? C'est ainsi qu'on arrache des larmes par
la peinture des malheurs d'une ville prise d'assaut. Sans doute
celui qui se borne à dire que la ville a été prise, embrasse
dans ce seul mot toutes les horreurs que comporte un pareil sort ;
mais il ne remue pas les entrailles, et a l'air d'annoncer purement
et simplement une nouvelle : mais développez tout ce qui est
renfermé dans ce mot, alors on verra les flammes qui dévorent les
maisons et les temples, alors on entendra le fra. cas des toits qui
s'abîment, et une immense clameur formée de mille clameurs ; on
verra les uns fuir à l'aventure, les autres étreindre leurs parents
dans un dernier embrassement ; d'un côté, des enfants et des femmes
qui gémissent, et de l'autre, des vieillards qui maudissent le sort
qui a prolongé leur vie jusqu'à ce jour ; puis, le pillage des
choses profanes et sacrées, les soldats courant en tout sens pour
emporter ou pour chercher leur proie, chacun des voleurs poussant
devant soi des troupeaux de prisonniers chargés de chaînes, des
mères s'efforçant de retenir leurs enfants, enfin les vainqueurs
eux-mêmes se battant entre eux à la moindre apparence d'un plus
riche butin. Tout cela, comme je l'ai dit, est renfermé dans l'idée
d'une ville prise d'assaut ; maison dit moins en disant le tout en
gros qu'en énumérant les parties. Or, nous parviendrons à rendre ces
circonstances sensibles, si elles sont vraisemblables ; et même on
peut supposer plusieurs faits qui, sans s'être réellement passés, se
passent quelquefois. Les accidents contribuent aussi à représenter
les choses au naturel : Un frisson me saisit, et tout mon sang se
glace d'horreur. - Les mères tremblantes pressèrent leurs enfants
contre leur sein. Ce talent, qui, selon moi, est de premier
ordre, ne laisse pas d'être aisé à acquérir observons la nature et
suivons-la ; car toute espèce d'éloquence roule sur les choses de la
vie ; chacun rapporte à soi ce qu'il entend, et l'esprit reçoit
toujours volontiers ce qu'il reconnaît. Mais, pour répandre de la
lumière sur les choses dont on parle, les similitudes ont été
surtout bien imaginées. Les unes servent à prouver, et sont rangées
pour cela au nombre des arguments ; les autres, dont je parle ici,
sont plutôt destinées à donner une image des choses : Ensuite,
comme des loups ravissants au sein d'épaisses ténèbres. - Semblable
à l'oiseau qui voltige sur les rivages, et rase à fleur d'eau les
écueils où abonde le poisson. Mais il y a ici une précaution
bien importante à garder : c'est que les objets que nous empruntons
pour nous servir de similitudes ne soient ni obscurs ni inconnus ;
car ce qu'on emploie pour éclaircir une chose doit avoir plus de
clarté que la chose qu'on veut éclaircir. Aussi laissons aux poètes
les comparaisons du genre de celle-ci : Tel Apollon, lorsqu'il
abandonne la froide Lycie et les bords du Xanthe, ou qu'il va
visiter Délos, son île natale. Un orateur ne serait pas reçu de
même à représenter une chose claire par une autre qui le serait
moins. Cependant ce genre de similitude, dont j'ai parlé à l'article
des arguments, contribue aussi à l'ornement du style, en lui donnant
un certain air de noblesse, d'enjouement, de grâce, et même de
merveilleux. En effet, plus elle est tirée de loin, plus elle paraît
neuve et cause de surprise. En voici quelques-unes qui pourront
sembler des lieux communs, et seulement propres à persuader :
Comme la terre par la culture, de même l'esprit par l'étude
s'améliore et se féconde. Comme les médecins retranchent les membres
viciés par la maladie, de même nous devons retrancher les citoyens
infâmes et corrupteurs, nous fussent-ils unis par les liens du sang.
En voici une d'un genre plus élevé, que j'emprunte au plaidoyer pour
Archias L'écho des rochers et des déserts répond à la voix du
poète ; souvent même les bêtes féroces sont émues par ses accents et
s'arrêtent, etc. Mais quelques orateurs ont corrompu ce genre
par un abus de déclamation : ils empruntent de fausses images, ou
ils ne savent pas les appliquer à leur sujet. On peut voir des
exemples de ce double défaut dans ces vers que j'entendais chanter
partout dans ma jeunesse : Les grands fleuves sont navigables à
leur source ; un arbre généreux naît avec du fruit. Dans toute
espèce de paraboles, ou la similitude précède et la chose suit, ou
bien la chose précède et la similitude suit : mais quelquefois la
similitude est indépendante et isolée ; quelquefois, ce qui est
beaucoup vieux, elle est jointe à la chose dont elle est l'image par
une espèce de correspondance qu'on appelle eu grec ἀνταπόδοσις.
La similitude précède dans l'exemple
que j'ai déjà rapporté : Semblables à des loups, etc. Elle
suit dans le 1er livre des Géorgiques, lorsqu'après avoir
longuement déploré les guerres civiles et étrangères, le poète
ajoute : Ainsi, quand la barrière s'ouvre, les chars se
précipitent dans la carrière ; en vain le conducteur retient les
rênes, il est emporté par les chevaux, qui n'obéissent plus au frein.
Mais cette similitude est sans réciprocité. Or, cette réciprocité
met, pour ainsi dire, sous les yeux les deux objets qu'elle compare,
et les fait envisager en même temps. J'en trouve plusieurs beaux
exemples dans Virgile ; mais il vaut mieux en emprunter aux
orateurs. Cicéron dit dans l'oraison pour Muréna Comme on dit
que, parmi les artistes grecs, ceux-là jouent de la flûte qui n'ont
pu jouer de la lyre, de même, parmi nous, ceux qui n'ont pu devenir
orateurs se font jurisconsultes. Voici un autre exemple tiré du
même plaidoyer ; il est presque animé d'un souffle poétique, mais il
a sa réciprocité, ce qui convient mieux à l'ornement : De même
que les tempêtes sont souvent excitées par quelque constellation.,
souvent aussi tout à coup, sans qu'on en puisse rendre raison, et
par une cause occulte, les orages des assemblées populaires naissent
quelquefois d'une maligne influence que tout le monde connaît ;
quelquefois aussi la cause en est si cachée, qu'ils semblent un
effet du hasard. Il y a d'autres similitudes qui sont fort
courtes, comme celle-ci : Errants dans les forêts à la manière
des bêtes ; et celle de Cicéron au sujet de Clodius : Il se
sauva tout nu de ce jugement, comme d'un incendie. Chacun peut
en imaginer de semblables, et la conversation même peut en fournir
des exemples. A cette dernière espèce se rapporte une autre beauté
qui consiste non seulement à peindre les choses, mais à la peindre
avec des traits vifs et courts. Et certainement on a raison de louer
la brièveté à laquelle il ne manque rien. Cependant celle qui fie
dit précisément que ce qu'il faut, que les Grecs appellent
βραχυλογία, et dont je parlerai au chapitre des figures, est moins
estimable ; mais il y en a une plus belle, c'est celle. qui dit
beaucoup en peu de mots Tel est ce mot de Salluste : Mithridate,
homme d'une stature colossale, armé de même. Une imitation
maladroite aboutirait à l'obscurité. Une autre beauté qui a beaucoup
d'affinité avec celle-ci, mais qui est d'un plus grand effet, c'est
l'emphase, laquelle donne à entendre plus que les mots n'expriment.
Il y en a deux espèces l'une qui donne à entendre plus qu'elle ne
dit ; l'autre, même ce qu'elle ne dit pas. Homère nous offre un
exemple de la première, lorsqu'il fait dire à Ménélas que les Grecs
descendirent dans le cheval de bois ; car d'un mot il nous
donne une idée de sa grandeur. Le même Virgile nous donne une idée
de sa profondeur, quand il représente les Grecs se laissant
glisser le long d'une corde ; et quand il dit du Cyclope,
qu'il se coucha en travers de son antre, ne semble-t-il pas
prendre cette caverne pour mesure du corps de ce monstre ? La
seconde espèce consiste à supprimer entièrement une phrase, ou à la
tronquer. Il y a suppression dans cet endroit du plaidoyer de
Cicéron pour Ligarius : Si, au degré de puissance oie vous êtes
parvenu, votre clémence, César, n'était pas telle qu'elle
n'appartint qu'à vous, à vous, dis-je, et je m'entends. En
effet, il supprime une pensée, qu'on ne laisse pas de deviner,
c'est-à-dire qu'il ne manquait pas de gens qui le poussaient à la
cruauté. On tronque la phrase par réticence, ἀποσιώπησις ; mais,
comme c'est une figure, j'en parlerai en son lieu. L'emphase se
rencontre jusque dans les mots les plus vulgaires : Il faut être
homme ; - C'est un homme ; Il faut vivre ; tant la nature
se confond souvent avec l'art ! Cependant ce n'est pas assez pour
l'éloquence de représenter les choses d'une manière vive et
sensible, il y a encore une foule de moyens divers qui peuvent
contribuer à embellir le style ; car cette simplicité, que les Grecs
nomment ἀφέλεια, ne laisse pas d'avoir sa beauté ; elle plaît comme
cette parure sans recherche que nous aimons tant dans les femmes. Le
soin qu'on met à choisir le mot juste, significatif, donne encore au
style un air de propreté délicate qui n'est pas sans attraits. Puis,
il y a une abondance qui est riche, et une autre qui est toute
riante de fleurs. Il y a même plusieurs genres de forces. En effet,
tout ce qui est suffisamment effectué dans son espèce, a de la
force. Cependant cette qualité consiste principalement à exagérer
l'indignité d'une action, δείνωσις ; dans les autres circonstances,
c'est un certain caractère de profondeur ; ou la faculté de
concevoir une vive image des choses, φαντασία ; celle de mener son
oeuvre à fin, ἐξεργασία ; celle enfin d'insister et de combler la
mesure, ἐπεξεργασία, Il faut y joindre l'énergie, ἐνέρφεια, qualité
qui a beaucoup d'affinité avec les précédentes, ainsi que l'indique
son étymologie, et qui consiste à faire que tous les mots portent
coup. C'est même je ne sais quelle amertume, qui a d'ordinaire
quelque chose d'injurieux, comme ce trait de Cassius : Que
feras-tu lorsque j'envahirai ton propre domaine, lorsque je te ferai
voir que tu ne sais pas médire ? C'est enfin quelque chose
d'âcre et de pénétrant, comme ces paroles de Crassus : Moi, je le
traiterai en consul, quand, toi, tu ne crois pas devoir me traiter
en sénateur ! Au reste, toute la force de l'éloquence consiste
dans l'art d'augmenter ou de diminuer. Il y a autant
de moyens pour l'un que pour l'autre ; je toucherai les principaux,
et par ceux-là on pourra juger des autres. Or, ces moyens résident
dans les choses et dans les mots. A l'égard des
choses, comme j'ai déjà traité de leur invention et de leur
disposition, je vais maintenant indiquer comment l'élocution peut
contribuer à les relever ou les rabaisser.
CHAP. IV. La première
manière d'amplifier ou de diminuer consiste dans le
nom même de la chose, lorsqu'on dit, par exemple, d'un
homme blessé, qu'il a été tué ; d'un méchant,
que c'est un scélérat ; et, au contraire, d'un homme qui a
frappé, qu'il n'a fait que toucher ; ou de celui qui a
blessé, qu'il n'a fait que frapper. Cicéron, dans son
oraison pour M. Célius, nous donne, au même endroit, un exemple de
cette double manière : Faudra-t-il donc traiter un homme
d'adultère, parce qu'il aura salué un peu familièrement une veuve
qui ne garde aucune mesure, une coquette éhontée, une femme riche
qui dissipe follement son bien, enfin une libertine qui vit en vraie
courtisane ? D'un côté, il appelle cette coquette une
courtisane, et, de l'autre, il représente celui qui avait eu avec
elle un long commerce de galanterie, comme n'ayant fait que la
saluer un peu librement. L'effet augmente et devient plus sensible,
lorsqu'aux mots qui diraient simplement les choses, nous en opposons
d'autres qui les caractérisent avec plus d'énergie, comme dans ce
passage d'une des Verrines : J'accuse, non un voleur, mais un
ravisseur ; non un adultère, mais un ennemi de toute pudeur ; non un
sacrilège, mais un impie qui se joue de tout ce qu'il y a de plus
saint et de plus sacré ; non un assassin, mais le plus cruel
bourreau des citoyens et des alliés. En effet, la première
manière multiplie les choses ; celle-ci fait plus, elle les grossit.
Cependant je vois que l'amplification s'obtient par quatre moyens,
l'accroissement, la comparaison, le raisonnement,
l'accumulalton. L'accroissement est un moyen très
efficace, qui consiste à donner de la gravité aux choses qu'on dit
d'abord, quoique moins importantes que celles qu'on dira ensuite. Il
y a un ou plusieurs degrés, par lesquels on s'élève nonseulement au
dernier point d'exagération, mais quelquefois même, en quelque
sorte, au delà. Un seul exemple de Cicéron me suffira : C'est un
attentat de jeter dans les fers un citoyen romain ; c'est un crime
de le frapper de verges ; c'est presque un parricide de le mettre à
mort que dirai-je de l'action de le mettre en croix ? car
supposons que ce citoyen romain n'eût été que battu de verges,
Cicéron eût toujours rendu la cruauté de Verrès plus grande d'un
degré, en disant qu'un moindre châtiment serait déjà un attentat ;
et si ce citoyen eût été simplement mis à mort, l'accusation se
serait élevée de plusieurs degrés ; mais comme, après avoir dit que
c'était presque un parricide de le mettre simplement à mort,
il a atteint le dernier degré, il ajoute : Que dirai-je de
l'action de le mettre en croix ? Ainsi, après avoir porté le
crime du préteur jusqu'au comble, il devait nécessairement manquer
d'expressions pour aller plus loin. Il y a encore une autre manière
d'ajouter au superlatif, comme dans ce passage de Virgile : Nul
n'égalait Lausus en beauté, excepté le Laurentin Turnus. En
effet, après avoir dit : Nul ne l'égalait en beauté, il
semble qu'il ne reste plus rien à dire ; cependant le poète trouve
moyen d'aller au delà. Il y a même une troisième espèce
d'accroissement, mais qui ne s'obtient pas par degrés, parce que le
terme de l'excès n'est pas relatif, mais absolu : Vous avez tué
votre mère : que dirai-je de plus ? Vous avez tué votre mère ;
car c'est aussi une manière d'accroître les choses que de les
présenter tout d'abord telles qu'on ne puisse y rien ajouter. C'est
encore une sorte de gradation qui est, à la vérité, moins sensible,
mais peut-être par là même plus efficace, lorsque nous disons sans
distinction, sans pause et tout d'une haleine, plusieurs choses qui
enchérissent les unes sur les autres. Tel est ce passage où Cicéron
reproche à Antoine d'avoir vomi devant tout le monde Que dis je ?
dans l'assemblée du peuple romain ! en traitant des affaires de
l'État ! un maître de cavalerie ! Chaque mot va, comme on le
voit, en augmentant. C'est une chose dégoûtante de soi, que de vomir
pour avoir bu avec excès, ne fût-ce pas en public, ne fût-ce pas en
présence du peuple, ce peuple ne fût-il pas le peuple romain ; c'est
une honte, quand on ne remplirait aucune fonction, quand cette
fonction ne serait pas publique, quand même on ne serait pas maître
de cavalerie. Un autre aurait distingué ces différents degrés :
Cicéron ne s'arrête pas ; c'est en courant qu'il arrive au sommet ;
il l'atteint sans lenteur ni effort, et pour ainsi dire d'un bond.
Mais, si ce genre d'amplification s'élève toujours sans s'arrêter en
chemin, celle qui a lieu par comparaison, au contraire, tire son
accroissement de la considération des circonstances secondaires.
car, en exhaussant ce qui est dessous, on élève nécessairement ce
qui est dessus. En voici un exemple, emprunté au même orateur et
pris dans le même endroit : Si cela vous fût arrivé à table, dans
une de ces orgies qui vous sont si familières, qui n'en rougirait
pour vous ? Mais dans l'assemblée du peuple romain ? etc. Je
citerai encore ces paroles de Cicéron à Catilina : Si mes
esclaves me craignaient comme vous craignent vos concitoyens, je
déserterais ma maison. Quelquefois, en paraissant apporter un
exemple de même nature, on le fera servir à rendre encore plus grave
le fait qu'on veut exagérer. C'est ce que fait Cicéron dans
l'oraison pour Cluentius. Après avoir exposé qu'une femme de Milet,
gagnée par des héritiers substitués, s'était fait avorter, il
s'écrie : Combien le crime d'Oppianieus n'est-il pas plus digne
de supplice, quoique dans la même espèce ? Car, après tout,
la femme de Milet, en déchirant ses entrailles, n'a tourné sa
cruauté que contre elle-même, tandis qu'Oppianicus est arrivé à la
même fin en exerçant sa violence et ses tortures, non sur lui, mais
sur autrui. Et que l'on ne pense pas que ce que je dis ici soit
la même chose que ce que j'ai dit au chapitre des arguments, en
parlant d'un lieu que j'ai appelé du moins au plus ; car là il
s'agissait de prouver, ici il s'agit seulement d'amplifier ; et le
but de Cicéron, dans la comparaison qu'il fait au sujet d'Oppianicus,
n'est pas de prouver qu'il a commis un crime, mais de faire voir que
son crime est plus grand. Cependant la différence n'exclut pas
entièrement l'affinité. C'est pourquoi je me servirai encore ici de
l'exemple dont je me suis servi alors, mais dans une autre vue ; car
je veux montrer que, pour amplifier, on ne compare pas seulement un
tout avec un autre tout, mais aussi les parties entre elles Quoi
donc ! P. Scipion, ce personnage illustre, ce grand pontife, n'étant
que simple particulier, aura tué de sa main Tibérius Gracchus, qui
menaçait de quelque changement la constitution de la république ; et
nous consuls, nous souffrirons que Catilina aspire à dévaster
l'univers par le meurtre et l'incendie ! Voilà Catilina comparé
à Gracchus, la république à l'univers, un léger changement au
meurtre et à l'incendie, un particulier à des consuls : tous lieux
qui peuvent fournir une ample matière à développement, pour peu que
l'on veuille les approfondir. J'ai parlé d'un troisième genre
d'amplification, qui se traite, comme je l'ai dit, par voie de
raisonnement.
Voyons d'abord si je me suis servi
d'un terme suffisamment propre. Ce n'est pas que je me préoccupe du
mot, pourvu que la chose paraisse claire à ceux qui voudront
s'instruire ; mais je m'en suis servi, parce que ce genre
d'amplification se place dans un endroit et produit son effet dans
un autre, parce que l'on exagère une chose pour donner une plus
forte idée d'une autre, et qu'on arrive ainsi par le raisonnement à
la chose lui est l'objet principal de l'amplification. Par exemple,
Cicéron voulant reprocher à Antoine son ivrognerie et ses
vomissements, Quoi ! lui dit-il, avec ce gosier, avec cet
estomac, avec cette encolure de gladiateur ! Quel rapport,
dira-t-on, ce gosier et cet estomac ont-ils avec l'ivresse ? Rien de
tout cela n'est oiseux ; car on peut induire de là que cet ivrogne
devait avoir bu prodigieusement aux noces d'Hippias, puisque, avec
ce tempérament de gladiateur, il n'avait pu venir à bout de digérer
et de supporter ce qu'il avait bu. Si donc une chose s'induit d'une
autre chose, le terme de raisonnement n'est ni impropre ni
inusité, d'autant que, par la même raison, nous avons distingué un
état de cause, qui porte le même nom. Tantôt donc cette sorte
d'amplification se tire de ce qui a suivi : il fallait qu'Antoine
eût fait un furieux excès, puisque ce fut, non par une indisposition
fortuite, ni pour se délivrer d'un léger mal de coeur, mais par
nécessité, qu'il vomit devant tout le peuple assemblé ; puisque ce
n'était pas des aliments récents qu'il rendait, mais le reflux d'une
orgie de la veille. Tantôt elle se tire de ce qui a précédé : ainsi,
lorsque Éole, à la prière de Junon, frappe de son trident le
flanc de la montagne, et que les vents s'échappent, en bataillons
impétueux, par l'issue gui leur est ouverte, on prévoit quelle
terrible tempête va s'élever. N'est-ce pas encore une amplification
par voie de raisonnement, lorsque après avoir exposé des actes
atroces et les avoir dépeints sous les couleurs les plus noires,
nous venons à les atténuer, dans la vue de rendre plus odieuses les
choses que nous avons à dire ensuite ? C'est ce qu'a fait Cicéron
dans un de ses plaidoyers contre Verrès : Ce sont là des
peccadilles pour un tel accusé. Après tout, un capitaine de
vaisseau, d'une cité illustre, s'est racheté dît supplice des verges
moyennant une somme d'argent : de la part de Verrès, c'est de la
bonté. Un autre, pour ne pas avoir la tête tranchée, donne aussi de
l'argent : rien de plus ordinaire. En effet, l'orateur a compté
que les juges feraient ce raisonnement, qu'il faut que le crime dont
on va parler soit bien inouï, puisque tous les autres sont des
bagatelles en comparaison de celui-là. Je rapporte encore au même
genre l'éloge qu'on fait d'une chose dans la vue d'en rehausser une
autre. En vantant les exploits d'Annibal, on fait admirer davantage
le mérite de Scipion, en exaltant le courage des Gaulois et des
Germains, on accroît d'autant plus la gloire de César. J'y rapporte
aussi une amplification où il ne semble pas que ce que l'on dit
regarde une certaine chose, bien qu'on ne le dise qu'en vue de cette
chose. Les chefs des Troyens ne croient pas qu'il soit indigne des
Troyens ni des Grecs de souffrir tant de maux, et pendant si
longtemps, pour la beauté d'Hélène. Quelle idée doit-on se faire de
cette beauté ? Car ce n'est point Pâris, son ravisseur, qui dit
cela', ni quelque jeune lusensé, ni quelqu'un du peuple : ce sont
des vieillards, des hommes recommandables par leur sagesse, et qui
composent le conseil de Priam. Que dis-je ? le roi lui-même, épuisé
par une guerre de dix années, déjà privé de tant de fils, à la
veille de la catastrophe qui doit mettre le comble à ses douleurs,
lui qui ne devrait avoir que de la haine, que de l'horreur pour
cette beauté fatale, source de tant de larmes ; le roi lui-même
entend ces paroles, et, appelant Hélène du nom de fille, la fait
asseoir auprès de lui, la justifie, et ne veut pas voir en elle la
cause de ses malheurs. Ainsi, lorsque Platon, dans son Banquet,
raconte qu'Alcibiade avouait sa bonne volonté pour Socrate, je pense
que Platon a voulu bien moins accuser les moeurs d'Alcibiade que
donner une haute idée de la chasteté de Socrate, qui résista aux
avances du plus beau jeune homme de la Grèce. C'est ainsi que les
poètes nous donnent à juger de la taille de quelques héros de
l'ancien temps par la dimension de leurs armes. Ce qu'ils nous
disent du bouclier d'Ajax et de la lance d'Achille n'a
point d'autre sens. Virgile s'est admirablement servi de cet
artifice dans le portrait de Polyphème. Quelle idée, en effet,
devons-nous avoir d'un géant qui marche appuyé sur un tronc de
pin, en guise de bâton ? Et cette énorme cuirasse que deux
hommes pouvaient à peine porter sur leurs épaules, que doit-elle
nous faire penser de ce Démoléon, qui, sous le poids de cette
armure,
Poursuivait en courant les Troyens éperdus ?
Et Cicéron aurait-il pu imaginer
quelque chose de plus fort sur le luxe d'Antoine, que le fait qu'il
raconte ? On voyait, dans les cellules de ses esclaves, les lits
dressés avec les couvertures de pourpre de Cn. Pompée. Des
couvertures de pourpre ! de Pompée ! dans des cellules d'esclaves !
On ne peut rien dire de plus. Mais qu'était-ce donc de l'appartement
du maître ? L'imagination est forcée de franchir les bornes du
possible. Ce genre d'amplification ressemble assez à ce qu'on
appelle emphase ; mais il y a cette différence, que l'emphase
roule sur le mot, tandis que l'amplification dont je parle roule sur
la chose, et l'emporte d'autant plus sur l'emphase, que les choses
ont plus de force que les mots. On peut enfin mettre au nombre de
ces genres l'accumulation, laquelle consiste à entasser des mots et
des pensées, qui au fond signifient la même chose ; car encore que
ni ces pensées ni ces mots ne présentent pas de gradation, ils ne
laissent pas de s'élever par leur amas : Dites-nous, Tubéron, que
faisait votre épée dans les champs de Pharsale ? qui cherchait-elle
? A qui en voulait votre appareil guerrier ? Quelle était votre
intention ? etc. ; ce qui ressemble à cette figure que les Grecs
appellent συναθροισιμός : mais dans cette figure ce sont plusieurs
choses diverses qu'on entasse les unes sur les autres, tandis qu'ici
c'est la même chose que l'on multiplie. Toutefois rien n'empêche
qu'on ne s'élève aussi par des mots qui soient de plus en plus
significatifs : On voyait à ses côtés le geôlier de la prison,,
le bourreau du préteur, la mort et la terreur des alliés et des
citoyens romains, le licteur Sextius.
Quand il s'agit d'exténuer les choses,
le procédé est à peu près le même ; car il y a autant de degrés pour
descendre que pour monter. Aussi je me contenterai d'un seul
exemple, emprunté au passage où Cicéron parle du discours de Rullus
: Quelques personnes, qui se trouvaient tout près de l'orateur,
ont soupçonné qu'il avait voulu dire je ne sais quoi touchant la loi
agraire. Ou Cicéron a voulu dire qu'on n'avait pas compris
Rullus, et alors c'est une exténuation ; ou il a voulu faire
allusion à son obscurité, et dans ce cas c'est une amplification.
Je sais que l'hyperbole peut aussi passer, aux yeux de
quelques rhéteurs, pour une espèce d'amplification ; et, en effet,
elle est fort propre, soit à exagérer, soit à exténuer les choses ;
mais comme elle excède le nom d'amplification, je la renvoie à
l'article des tropes, dont il serait temps de parler maintenant, si
ce n'était un genre d'élocution tout particulier, où les mots sont
employés, non dans leur sens propre, mais dans leur sens figuré. Il
faut donc que j'accorde quelque chose au goût du public, qui ne me
pardonnerait pas de passer sous silence un genre de beauté que la
plupart regardent aujourd'hui comme le principal, pour ne pas dire
comme le seul ornement du style.
CHAP.
V. Sententia, chez les anciens Latins, signifiait ce que i'on
sent dans l'âme. Outre qu'il est pris le plus souvent dans cette
acception par les orateurs, nous voyons encore les restes de cette
première signification dans le commerce ordinaire de la vie ; car si
nous voulons affirmer une chose avec serment ou féliciter quelqu'un,
nous employons ce mot pour témoigner que nous parlons selon ce
que nous avons dans l'âme, selon ce que nous sentons. Cependant
le mot sensa était aussi employé assez communément dans la
même acception ; car, pour le mot sensus, je crois qu'il ne
s'entendait que du corps ; mais l'usage a changé. Les conceptions de
l'esprit sont présentement désignées sous le nom de sensus,
et nous avons donné celui de sententia à ces pensées
brillantes que l'on place principalement à la fin d'une période.
Autrefois on en était peu curieux, mais aujourd'hui on les prodigue
outre mesure. Je crois donc devoir dire quelques mots de leurs
différentes espèces, et de l'usage qu'on en peut faire.
Les plus connues de l'antiquité sont
celles que nous appelons proprement sentences, et que les
Grecs appellent γνώναι. Quoique le nom de sententia soit
générique, il convient particulièrement à celles-ci, parce qu'elles
peuvent être regardées comme autant de conseils, ou, pour mieux
dire, comme autant d'arrêts en fait de moeurs. J'entends donc par
sentence une pensée morale qui, même hors du sujet auquel on
l'applique, est universellement vraie et louable. Tantôt elle se
rapporte seulement à une chose, comme celle-ci : Rien ne gagne
tant les coeurs que la bonté ; tantôt à une personne, comme
cette autre de Domitius Afer : Un prince qui veut tout savoir
doit s'attendre là beaucoup pardonner. Les uns ont dit que la
sentence était une partie de l'enthymème ; les autres, qu'elle était
le commencement ou la conclusion de l'épichérème : ce qui est vrai
quelquefois, mais non pas toujours. Ce qui est plus vrai, c'est
qu'elle est tantôt simple, comme celles que je viens de citer,
tantôt accompagnée de sa raison, comme celle-ci : Dans toute
contestation, le plus puissant, encore qu'il soit l'offensé, parait
toujours l'offenseur, par cela seul qu'il est le plus puissant ;
tantôt double : La complaisance nous fait des amis, et la vérité
ne nous attire que des ennemis. Il y en a même qui ont distingué
jusqu'à dix genres de sentences, en ce qu'on peut les énoncer par
interrogation, par comparaison, par négation, par
similitude, par admiration, etc. ; mais, à ce compte,
il en faudrait admettre un nombre indéfini ; car toutes les figures
peuvent servir à les exprimer. Un genre des plus remarquables est
celui qui nait de la différence : Ce n'est point la mort qui est
un mal, mais les approches de la mort. Quelquefois on énonce une
sentence d'une manière simple et directe : L'avare manque autant
de ce qu'il a que de ce qu'il n'a pas ; et quelquefois par
figure, ce qui lui donne une plus grande force, comme dans ce vers
de Virgile
Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre ?
(RACINE.)
On sent que cette forme a bien plus
d'énergie que celle-ci : La mort n'est point un malheur. Il
en est de même, lorsqu'une pensée vague et générale devient propre
et particulière par l'application qu'on en fait. Ainsi, au lieu de
dire en général : Il est facile de nuire et difficile d'être
utile, Médée s'exprime plus vivement dans Ovide : J'ai pu le
sauver, et tu me demandes si je pourrai le perdre ? Cicéron
applique ces sortes de pensées à la personne, en disant : Ce
qu'il y a de plus grand, César, dans votre fortune, c'est de pouvoir
sauver les malheureux : ce qu'il y a de plus admirable dans votre
nature, c'est de le vouloir. Ainsi, il attribue à César ce qui
semblait appartenir aux choses. Mais, en ce genre, ce dont il faut
se garder, comme dans tout le reste, c'est que les sentences ne
soient ni trop fréquentes ni visiblement fausses, comme c'est le
défaut de ceux qui croient pouvoir les employer indifféremment
partout, comme étant universelles, καθολικά, et qui regardent comme
indubitable tout ce qui paraît favoriser leur cause ; c'est enfin
qu'elles ne soient pas employées à tort et à travers, ni déplacées
dans la bouche de celui qui parle ; car il faut que l'importance des
choses soit soutenue de l'autorité de la personne. Ne serait-il pas
insupportable de voir un enfant, un adolescent, ou même un homme de
rien, prendre le ton de juge ou de maître ? Toute conception de
l'esprit est aussi un enthymème. Cependant le nom d'enthymème
convient, à proprement parler, à une sentence fondée sur les
contraires, en ce qu'elle paraît briller entre toutes les autres,
comme Homère est le poète, et Rome la ville par excellence. C'est ce
qui a été suffisamment expliqué à l'article des arguments.
Toutefois, elle ne sert pas uniquement à prouver, et elle n'est
quelquefois qu'un pur ornement Quoi ! César, ce sont ceux-là même
dont l'impunité fait l'éloge de votre clémence, qui vous exciteront
à la cruauté ? Car Cicéron dit cela, non pour ajouter une
nouvelle raison à celles qu'il a déjà fait valoir, mais parce qu'il
avait déjà fait voir d'ailleurs combien cette conduite était injuste
; et c'est une réflexion qu'il jette à la fin de son discours par
manière d'épiphonème, non pas tant comme une preuve que comme un
dernier coup porté à son adversaire ; car l'épiphonème est une
réflexion ajoutée à un récit ou à une preuve pour témoigner le
sentiment que nous en avons, comme dans ce vers de Virgile
. . . . . . . . Tant dut coûter de peine
Le long enfantement de la grandeur romaine !
et dans ces paroles de Cicéron :
C'est ainsi que ce vertueux jeune homme aima mieux faire une action
périlleuse, que d'en souffrir une qui le couvrit de honte. Il y
a aussi ce que les rhéteurs modernes appellent νόημα. Ce mot est
générique, mais il a plu néanmoins à nos beaux esprits de
l'attribuer particulièrement aux choses que l'on donne à entendre
sans les dire. Telle est cette réponse d'une soeur à son frère
qu'elle avait racheté plusieurs fois de l'engagement qu'il avait
pris avec des gladiateurs, et qui la poursuivait en justice en vertu
de la loi du talion, parce qu'elle lui avait coupé le pouce pendant
qu'il dormait Va, tu mériterais bien de conserver ta main tout
entière, c'est-à-dire de faire toute la vie le métier de
gladiateur. Il me faut aussi parler de ce qu'on appelle clausula.
Si par là on entend ce qu'on appelle ordinairement conclusion,
elle est bonne et même nécessaire en certains endroits, comme
celle-ci : C'est pourquoi, Tubéron, il faut que vous commenciez
par convenir du fait qui vous est personnel, avant que de rien
reprocher à Ligarius. Mais ce n'est pas ce qu'on entend, on veut
aujourd'hui que toute pensée qui termine une période frappe
l'attention. Un orateur ne peut sans honte et presque sans crime
s'arrêter pour reprendre haleine, s'il n'a en même temps donné lieu
à l'auditeur de se récrier d'admiration. De là ces petites pensées,
ces faux brillants, qu'on va chercher bien loin hors du sujet ; car
enfin il n'est pas possible de trouver autant d'heureuses pensées
qu'il se rencontre de points d'arrêt dans le discours. Ce qu'il y a
de plus à la mode en ce genre, ce sont les traits imprévus, comme ce
mot de Vibius Crispus à un homme qui se promenait en pleine audience
avec une cuirasse sur le dos, sous prétexte qu'il avait peu :r
Qui t'a permis de craindre de la sorte ? et ce compliment
d'Africanus à Néron sur la mort de sa mère : Votre province des
Gaules vous supplie, César, de supporter courageusement votre
bonheur. D'autres consistent dans une allusion indirecte.
Domitius Afer plaidait pour Cloantilla, que Claude avait renvoyée de
l'accusation portée contre elle pour avoir donné la sépulture à son
mari, trouvé mort parmi les rebelles. Dans la péroraison, il
apostropha les enfants de Cloantilla : Ne laissez pas cependant
d'ensevelir votre mère. D'autres consistent dans une pensée
étrangère, c'est-à-dire transportée d'un lieu dans un autre. L'amant
de Spatale l'avait instituée son héritière, et était mort à dix-huit
ans ; Crispus, qui plaidait pour Spatale, dit en parlant de son
amant : Voyez l'esprit de divination de ce jeune homme, qui n'a
rien voulu se refuser ! Quelquefois le redoublement d'un mot
fait presque tout le prix de ces pensées, comme dans cet écrit dont
Sénèque était l'auteur, et que Néron envoya au sénat après le
meurtre de sa mère, voulant qu'on crût qu'il avait couru de grands
dangers : Ma vie, dit-on, est en sûreté : je ne puis
encore ni le croire ni m'en réjouir. Mais la pensée vaut encore
mieux, quand elle naît d'une opposition : J'ai bien qui fuir, je
n'ai pas qui suivre. le malheureux ! il ne pouvait ni parler ni se
taire. Elle est plus belle encore, lorsqu'elle est éclairée par
une comparaison, comme dans ce passage d'un plaidoyer de Trachalus
contre Spatale : O saintes lois, gardiennes de la pudeur,
avezvous donc voulu qu'on pût donner le quart de ses biens à une
concubine, et qu'une épouse ne pût prétendre qu'au dixième ! Au
reste, ce genre peut enfanter le bon et le mauvais. Voici, entre
autres, une pensée que le bon goût réprouvera toujours : Pères
conscrits, car il est bon que je commence ainsi pour vous faire
souvenir des pères. Celle-ci est encore plus mauvaise ; parce
qu'elle est plus fausse et tirée de plus loin : J'ai combattu
jusqu'au doigt : mot qu'un avocat mit dans la bouche d'un
gladiateur à qui sa sueur, ainsi que je l'ai déjà rapporté, avait
coupé le pouce pour le forcer de renoncer à son métier. Mais je ne
sache rien de plus détestable en ce genre que certaines pensées qui
sont fondées sur une équivoque, jointe à une fausse similitude. Par
exemple, je me souviens que, dans ma jeunesse, un célèbre avocat, à
l'occasion d'une blessure que son client avait reçue à la tête,
donna à tenir à la mère les esquilles qu'on avait retirées de la
plaie, en lui disant : Mère infortunée ! vous n'avez pas encore
porté votre fils sur le bûcher, et déjà vous avez recueilli ses os.
Bien plus, la plupart de nos orateurs se complaisent dans de petites
conceptions qui séduisent au premier coup d'oeil par une apparence
ingénieuse, et qui, examinées de près, ne sont que ridicules. Par
exemple, dans une déclamation des écoles, on suppose qu'un homme
ruiné par la stérilité de ses champs, et qui, après ce premier
malheur, a fait naufrage, s'est pendu de désespoir ; et à ce sujet
on dit : Celui dont la terre ni la mer ne veulent pas, que lui
reste-t-il à faire, sinon de chercher un asile dans les airs ?
Voici d'autres traits du même genre : un furieux dévorait ses
membres ; son père lui donna du poison, en lui disant : Qui peut
manger ceci doit boire cela. Un débauché paraissait avoir pris
la résolution de se tuer : Tresse une corde, lui dit-on, tu dois
en vouloir à ton gosier ; avale du poison, un ivrogne doit mourir en
buvant. Tantôt ces pensées sont vides, comme celle-ci : un
déclamateur exhorte les généraux d'Alexandre à ensevelir le
conquérant dans l'incendie de Babylone, et il s'écrie : Quoi !
nous ferions les funérailles d'Alexandre, et quelqu'un y assisterait
tranquillement de sa fenêtre ! Comme si c'était là ce qu'il y
eût de plus déplorable dans cette conjoncture. Tantôt elles sont
outrées, comme ce que j'ai entendu dire à quelqu'un, en parlant des
Germains : Tête placée je ne sais où. Un autre, en parlant
d'un brave soldat, disait : La guerre rebondit sur son bouclier.
Je ne finirais pas, si je voulais rapporter tous les genres de
pensées que le mauvais goût de notre siècle a enfantés. Passons à
une observation plus importante.
Il
existe deux opinions différentes : l'une qui ne fait cas que des
pensées, l'autre qui les condamne absolument. Pour moi, je ne
partage entièrement ni l'une ni l'autre ; car, en premier lieu, il
est certain que les pensées s'entre-nuisent, quand elles sont semées
trop près les unes des autres, comme il arrive des grains et des
fruits des arbres, qui ne peuvent parvenir à un juste développement
lorsqu'ils manquent d'espace pour croître à l'aise. C'est ainsi que,
sans ombres, la peinture n'a point de relief ; et c'est pour cela
que les peintres, après avoir représenté plusieurs sujets dans un
seul et même tableau, les distinguent, les détachent, afin que les
ombres ne tombent pas sur les corps. Cette accumulation de pensées a
encore pour effet de rendre le style trop haché, parce que toute
pensée renferme un sens complet, après lequel commence
nécessairement un autre sens, d'où résulte ordinairement une
composition décousue, plutôt faite de pièces et de morceaux que de
membres proprement dits, sans liaison ni structure. Ces pensées
ressemblent à ces corps ronds et polis qui, quoi qu'on fasse, ne
peuvent s'unir ensemble. La couleur même du style, quelque brillante
qu'elle soit, ne laisse pas d'être étrangement bigarrée. C'est ainsi
qu'un noeud, une bande de pourpre mise à sa place, rehausse la
beauté d'une tunique, tandis qu'un vêtement bariolé de diverses
couleurs sera toujours ridicule. Aussi, malgré leur éclat et leur
consistance apparente, ces pensées me font moins l'effet de la
flamme, que de ces étincelles qui s'échappent du milieu d'une fumée
épaisse. On ne les remarque pas même dans un style où tout éblouit ;
elles y sont absorbées, comme les étoiles dans la lumière du soleil.
Que si quelques-unes font tant que de s'élever par petits bonds, lé
style ressemble alors à un terrain inégal et plein de gravier, qui
ne présente ni l'aspect sublime des montagnes ni la grâce des
prairies. Ajoutez à cela qu'en courant seulement après les pensées,
on s'expose nécessairement à en rencontrer beau.. coup de frivoles,
de froides, d'insignifiantes ; car comment choisir là où on ne peut
compter ? Aussi voit-on que ces orateurs prétentieux vont jusqu'à
donner un air de pensée à leur division, et même à leurs arguments,
en affectant doits leur prononciation une espèce de chute qui
surprend. Vous avez tué votre femme, et vous étiez vous-même
adultère ! N'eussiez-vous fait que la répudier, vous ne seriez pas
même excusable : voilà pour la division. Voulez-vous savoir si
ce philtre était du poison ? Le malheureux vivrait encore, s'il
ne l'eût pas pris : voilà pour l'argument. Ce n'est pas que la
plupart abondent en pensées, mais ils disent tout d'un ton
sentencieux.
D'autres orateurs sont d'un caractère
tout différent. Ils fuient, ils redoutent ce genre d'agrément, comme
une amorce dangereuse, et n'aiment que ce qui est uni, bas et
commun. Aussi rampent-ils toujours, dans la crainte de tomber
quelquefois. Qu'y a-t-il pourtant de si répréhensible dans une bonne
pensée ? N'est-elle pas utile à la cause ? ne touche-t-elle pas le
juge ? ne recommande-t-elle pas l'orateur ? C'est, dit-on, un genre
qui n'était pas en usage chez les anciens. Mais à quelle antiquité
veut-on nous faire remonter ? Si c'est à la plus reculée, Démosthène
a eu beaucoup de belles pensées que personne n'avait eues avant lui.
Comment goûter Cicéron, si l'on ne trouve rien à changer dans Caton
et les Gracques ? Et avant ceux-ci le langage n'était= il pas plus
simple encore ? Pour moi, je regarde ces traits lumineux du style
comme les yeux de l'éloquence ; mais je ne veux pas que le corps
soit tout couvert d'yeux, au détriment des autres membres ; et si
j'étais réduit à la nécessité de choisir, je préférerais la rudesse
des anciens à la licence des modernes : mais on peut tenir un
milieu. Ainsi, dans la manière de vivre et de se vêtir, il règne
aujourd'hui une élégance qui s'accorde avec la vertu. Ajoutons donc
au bien, s'il est possible ; mais avant tout tâchons d'éviter le
mal, de peur qu'en voulant être plus parfaits que nos ancêtres, nous
ne soyons que différents.
Je vais maintenant traiter de ce qui
se rattachait naturellement au quatrième chapitre, c'est-à-dire des
tropes, que nos plus célèbres auteurs appellent motus,
changements, déplacements. Cette partie est
ordinairement du domaine des grammairiens, et il semble que j'aurais
dû m'en occuper en parlant des devoirs de ces derniers ; mais comme
elle m'a paru plus intéressante à étudier sous le rapport de
l'ornement du style, je l'ai ajournée à dessein, pour lui donner une
place plus considérable dans ce traité.
CH. VI. Le trope
est un changement par lequel on transporte un mot ou une phrase de
sa signification propre en une autre gui lui donne plus de force.
Quels sont les différents genres de tropes ; quelles sont leurs
espèces ; quel en est le nombre, et comment sont-ils subordonnés
entre eux, voilà sur quoi et les grammairiens et les philosophes ont
des disputes interminables. Pour moi, sans m'arrêter à ces
subtilités où l'art n'a rien à gagner, je parlerai seulement des
tropes les plus nécessaires et les plus usités. Encore me
contenterai-je de faire remarquer,, à l'égard de ceux-ci, que les
uns s'emploient pour ajouter à la signification, les autres
pour l'ornement du style ; qu'il y en a pour les mots
propres et pour les mots figurés ; et qu'ils changent non
seulement la forme des mots, mais aussi celle des pensées et
de la composition. C'est pourquoi il me semble que c'est une
erreur de croire que le trope consiste uniquement à mettre un mot à
la place d'un autre. Du reste, je n'ignore pas que le trope, qui
ajoute à la signification, contribue aussi d'ordinaire à l'ornement
; mais cela n'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne
peuvent jamais servir que d'ornement. Commençons donc par celui qui
est le plus usité et incomparablement le plus beau ; je veux parler
de la translation, que les Grecs appellent μεταφορά. La
métaphore nous est si naturelle, que les gens ignorants en font
eux-mêmes un fréquent usage sans le savoir. Elle a tant d'agrément
et d'éclat, que, dans le style le plus brillant, elle resplendit
d'une lumière qu'elle ne tient que d'elle-même. Elle ne risque
jamais de paraître commune, basse ou froide, pourvu qu'elle soit
bien amenée. Elle enrichit la langue en lui prêtant ce qui lui
manque, et, grâce au merveilleux secret de ce trope, chaque chose
semble avoir son nom. Ainsi donc on transporte un nom ou un verbe du
lieu où il est propre dans un autre, soit parce que le mot propre
manque, soit parce que le mot métaphorique convient mieux. On en use
ainsi, ou par nécessité, ou pour ajouter à la signification, ou,
comme je l'ai dit, pour donner plus de beauté au style. Lorsqu'elle
ne produit pas un de ces trois effets, elle est odieuse. C'est par
nécessité que les sens de là campagne appellent gemma le
bourgeon de la vigne ; car comment pourraient-ils s'exprimer
autrement ? Ils disent encore que les blés ont soif, que les
fruits souffrent. C'est par nécessité que nous disons qu'un
homme est dur, qu'il est âpre, parce que ces affections de l'âme
n'ont point de terme qui leur soit propre. Mais quand nous disons
qu'un homme est enflammé de colère, brûlant de désir, tombé dans
l'erreur, c'est pour être plus expressifs ; car ces termes
empruntés ont plus de force que les mots propres. On ne se propose
que l'ornement dans ces métaphores : lumière du discours, éclat
de la naissance, orages des assemblées populaires, foudres
d'éloquence. Cicéron dit que Clodius a été une source, une
moisson de gloire pour Milon. La métaphore aide aussi à dissimuler
ce qu'on ne pourrait dire sans blesser la pudeur, comme dans ce
passage de Virgile
Des routes de l'amour l'embonpoint inutile
Aux germes créateurs ouvre un champ moins fertile. (DELILLE.)
En général, la métaphore est une
similitude abrégée ; elle n'en diffère qu'en ce que, dans celle-ci,
on compare la chose qu'on veut peindre avec l'image qui la
représente, et que, dans celle-là ; l'image est substituée à la
chose même. Il s'est battu comme un lion, voilà une
comparaison ; c'est un lion, voilà une métaphore. II me
semble qu'on peut distinguer quatre sortes de métaphores : la
première, lorsqu'en parlant de choses animées, on substitue un mot à
un autre, comme, celui de gubernator, pilote, à celui d'agitator,
cocher ; ou quand Tite-Live dit de Caton, qu'il aboyait après
Scipion. La seconde, lorsque cette substitution s'applique à des
choses inanimées Il lâche les rênes à la flotte. La
troisième, lorsqu'à des choses animées on en substitue d'autres qui
ne le sont pas : C'est par le fer, et non par le destin, qu'est
tombé le REMPART des Grecs ; ou, contrairement, comme dans ce
vers de Virgile, où vertex, qui proprement veut dire
tourbillon, est employé métaphoriquement an lien de cacumen,
sommet : .....
Sedet inscius alto
Accipiens sonitum saxi de VERTICE pastor.
La quatrième enfin, lorsque par une
image hardie et périlleuse, d'où naît particulièrement le sublime,
on donne une armé et des sens à des choses privées de vie ; telle
est cette métaphore L'Araxe s'indignant sous un pont qui l'outrage.
Tel est encore ce passage de Cicéron : Dites-nous, Tubéron, que
faisait votre épée nue dans les champs de Pharsale ? Qui
cherchait-elle ? etc. Quelquefois la métaphore est double ;
ainsi Virgile a dit : Armer un fer de poison ; car armer
de poison est une métaphore, et armer un ter en est une autre.
Ces quatre principaux genres se divisent en plusieurs espèces ; car
les êtres raisonnables peuvent comporter la même substitution ; elle
peut égaiement avoir lieu à l'égard des êtres irraisonnables ; et,
entre choses semblables, on peut substituer le tout à la partie, ou
la partie au tout. Mais je ne parle plus à des enfants ; et, le
genre une fois connu, il est facile d'en déduire les espèces.
Cependant, si ce trope employé avec sobriété et à propos éclaire le
style, d'un autre côté, sa fréquence le rend obscur et fatigant.
S'il se prolonge, il dégénère en allégorie et en énigmes.
Remarquons aussi qu'il y a certaines métaphores qui sont vastes,
comme celle-ci, dont j'ai déjà parlé : Une verrue de pierre ;
d'autres qui réveillent des images dégoûtantes. Car si, pour flétrir
une certaine classe de gens corrompus ; Cicéron a dit, sans blesser
la noblesse, qu'ils étaient la sentine de la république, il
ne s'ensuit pas qu'on puisse approuver cette expression d'un ancien
orateur : Vous avec, percé les abcès de la république. Il
faut donc prendre garde, comme le démontre fort bien Cicéron, de se
servir d'images indécentes, comme : La république a été châtiée
par la mort de Scipion l'Africain. Glaucias, cet excrément du
sénat ce sont ses propres exemples. Il ne veut pas non plus due
la métaphore soit outrée, ni qu'elle soit trop faible, comme il
arrive encore plus souvent, ni fondée sur une fausse similitude :
tous vices dont on ne découvrira que trop d'exemples, quand on saura
que ce sont des vices. La surabondance de métaphores est également
un défaut, surtout quand elles sont de la même espèce. Il en est qui
sont dures, c'est-à-dire tirées d'une similitude éloignée, comme :
Les neiges de la tête, et Jupiter a craché la neige sur
les Alpes. Or, ceux-là raisonnent fort mal, qui s'imaginent que
la prose peut s'arranger de toutes les licences permises aux poètes,
dont l'unique but est de plaire, et que la nécessité de la mesure
force souvent à se servir d'expressions extraordinaires. Homère ne
m'autorisera donc pas à dire, en plaidant, le pasteur des peuples,
pour désigner un roi ; ni Virgile ne m'autorisera pas non plus à
dire que les oiseaux rament avec leurs ailes, quoique ce
poète se soit admirablement servi de cette métaphore en parlant des
abeilles et de Dédale ; car la métaphore est faite pour remplir une
place vacante ; ou, si elle entre dans le domaine d'autrui, elle
doit avoir plus de valeur que le mot qu'elle dépossède.
Ce que je viens de dire de la
métaphore s'applique peut-être encore plus rigoureusement à la
synecdoche. Car la métaphore a été imaginée pour émouvoir, pour
mieux caractériser les choses, et pour les rendre plus sensibles ;
mais le propre de la synecdoche est de varier le style eu donnant à
entendre le pluriel par le singulier, le tout par la partie, le
genre par l'espèce, ce qui suit par ce qui précède, et vice versa
: toutes choses qui sont plus permises aux poètes qu'aux orateurs.
En effet, on peut bien dire en prose le glaive pour l'épée, le toit
pour la maison ; mais on ne dira pas la poupe pour le
vaisseau, ni le sapin pour des tablettes ; et, en second
lieu, de ce qu'on dit le fer pour l'épée, il ne s'ensuit pas
qu'on puisse dire quadrupes pour equus, cheval. Du
reste, quant à l'emploi du singulier pour le pluriel, et
réciproquement, les prosateurs ont pleine liberté. Tite-Live dit
souvent : Le Romain demeure vainqueur, pour dire les Romains
; et Cicéron, au contraire, écrivit à Brutus : Nous avons imposé
au peuple, et l'on a trouvé que nous étions orateurs, quoiqu'il
ne parle que de lui. Cette manière de s'exprimer n'est pas
restreinte au genre oratoire, elle est même d'usage dans la
conversation. C'est encore suivant certains rhéteurs une
synecdoche, lorsque, dans la coutexture de la phrase, il y a
quelque chose de sous-entendu et que l'esprit supplée ; car alors un
mot se devine à l'aide d'un autre : ce qui se range quelquefois
parmi les défauts sous le nom d'ellipse : Les Arcadiens
d'accourir aux portes. Pour moi, cette forme de style me paraît
plutôt appartenir aux figures, et par conséquent j'en parlerai en
son lieu. Une chose peut aussi nous en faire entendre une autre :
Regarde les boeufs dételés ramener la charrue suspendue à leur joug,
c'est-à-dire la nuit approche. Mais cela ne convient à l'orateur que
dans l'argumentation, quand il donne une chose pour signe d'une
autre ce qui n'a rien de commun avec l'élocution.
La métonymie n'est pas fort
différente. Ce trope, qui n'est que la substitution d'un nom à un
autre, est aussi, comme le remarque Cicéron, appelé hypallage par
les rhéteurs. Elle consiste à désigner l'effet par la cause,
l'invention par l'inventeur, la chose possédée pour le possesseur.
Ainsi Virgile a dit : Cérès corrompue par les eaux ; et
Horace : Neptune sur la terre protège les flottes contre les
aquilons. Si, dans le dernier exemple, on employait le mot
propre au lieu de Neptune, l'exactitude toucherait de près à
l'obscurité. Or, il importe d'examiner jusqu'à quel point ce trope
est à la discrétion de l'orateur, car si, d'un côté, on dit
communément Vulcain pour le feu, s'il n'est pas sans élégance
d'employer Mars pour la guerre, et même si la décence exige
qu'on se serve du mot de Vénus pour désigner les plaisirs de
l'amour, d'un autre côté, je doute que la sévérité du barreau
permette de désigner le pain et le vin sous le nom de Cérès
et de Bacchus. Le contenant est aussi pris quelquefois pour
le contenu ; et l'on dit communément : Une ville bien policée,
vider une coupe, un siècle heureux ; mais, dans l'espèce
suivante, où le contenu est au contraire pris pour le contenant, il
n'y a guère qu'un poète qui puisse dire : Déjà, près de moi,
Ucalégon est en feu, à moins qu'on n'objecte que, dans un
passage de Virgile, la métonymie veut, par le possesseur, nous faire
entendre la chose possédée, comme lorsqu'on dit qu'un homme est
dévoré, pour dire que son patrimoine est au pillage. Or, les
métonymies de cette dernière espèce sont innombrables. Ainsi nous
disons : Soixante mille hommes furent taillés en pièces auprès de
Cannes par Annibal ; nous lisons dans un poète tragique qu'Egialée
défit une armée ; on dit encore Virgile pour les poésies de
Virgile ; des vivres sont venus, c'est-à-dire ont été
apportés ; un sacrilège, au lieu de celui qui l'a commis ;
la science des armes, au lieu de la science de l'art des
armes. Une autre espèce de métonymie assez fréquente chez les
poètes et les orateurs est celle qui caractérise la cause par
l'effet qu'elle produit. Horace a dit : La PALE mort frappe
également à la cabane du pauvre et au palais des rois ; et
Virgile : Là sont les PALES maladies et la TRISTE vieillesse.
Les orateurs disent : la colère aveugle, la jeunesse
folâtre, l'inerte oisiveté. Ce trope a bien aussi quelque
affinité avec la synecdoche ; car, lorsque je dis vultus hominis,
les visages de l'homme, pour vultus, le visage, je change le
singulier en pluriel ; et ce n'est pas que je veuille faire
travailler l'esprit du lecteur, car la proposition est trop
évidente, mais je modifie seulement le mot : de même, quand je dis
des lambris d'or pour des lambris dorés, je m'écarte
seulement un peu de la vérité, ce qui est d'or ne s'entendant ici
que de la surface. Mais insensiblement je tombe dans un détail qui
serait même au-dessous d'une moindre entreprise que la mienne.
L'antonomase est un trope qui
remplace un nom par quelque chose d'équivalent. Elle est
trèsfamilière aux poètes, qui s'en servent diversement. Tantôt c'est
une épithète patronymique qui tient lieu du nom, comme Tydides,
Pelides, le fils de Tydée ou de Pélée ; tantôt, un attribut
qui caractérise la personne, comme, le père des dieux et le roi
des hommes ; tantôt, un acte qui désigne celui de qui on parle :
Les armes qu'en partant le cruel a laissées.
Quelquefois même on rencontre ce trope
dans la prose. On ne dira pas, il est vrai, Tydides et
Pelides, mais on dira bien l'impie, en parlant d'un parricide ;
le destructeur de Carthage et de Numance pour Scipion, et le
prince de l'éloquence romaine pour Cicéron. Cicéron lui-même a
usé de cette liberté dans son oraison pour Muréna : Vous ne
faites pas beaucoup de fautes, disait un sage précepteur à un jeune
héros, etc. : il ne nomme ni l'un ni l'autre, et cependant on
sait de qui il veut parler.
L'onomatopée, c'est-à-dire formation
d'un nom, très accréditée chez les Grecs, nous est à peine permise.
La plupart de nos onomatopées, remontent à l'origine de la langue,
comme Mugitus, sibilus, murmur, dont le son
exprime la nature des choses auxquelles les noms ont été donnés.
Mais à présent, comme si le fonds en était épuisé, nous n'osons plus
rien créer, tandis que beaucoup d'anciens mots meurent tous les
jours. A peine nous est-il permis de faire des dérivés, παραγόμενα,
c'est-à-dire de composer un mot d'autres mots déjà consacrés, comme
sullaturit et proscripturit ; laureati postes,
au lieu de lauro coronati, est une création du même genre :
mais si ces mots ont réussi, il n'en est pas de même de vio
pour eo. Quant aux mots tirés du grec, comme obelisco,
coludumo, le mélange des deux langues est trop dur, quoique
septemtriones nous paraisse supportable. C'est ce qui rend
d'autant plus nécessaire l'emploi de l'abusion, nom qui rend
fort exactement celui de πατάχρησις. Ce trope consiste à exprimer
une chose qui n'a pas de terme propre, par le terme d'une chose
analogue. Ainsi Virgile dit que les Grecs, par l'inspiration de
Pallas, construisirent un énorme cheval. On lis dans les anciens
tragiques : Le lion (leo) va enfanter ; et cependant leo,
c'est le mâle. Il y a mille exemples de ces sortes de catachrèses.
C'est ainsi qu'acetabulum se dit de toutes sortes de vases,
quel que soit leur usage, et que pyxis se dit de toutes les
boites, quelle qu'en soit la matière ; c'est ainsi que nous appelons
parricide non seulement le meurtrier de son père, mais aussi celui
qui a tué sa mère ou son frère. Et que l'on ne confonde pas ce trope
avec la métaphore ; car la catachrèse donne un nom aux choses qui
n'en ont pas, tandis que la métaphore donne aux choses un nom autre
que celui qu'elles ont. Les poètes, en effet, ont coutume de donner
abusivement, même aux choses qui ont un nom, un autre nom dont la
signification est approchante ; mais cela est rare en prose.
Quelques rhéteurs veulent qu'il y ait aussi catachrèse, quand nous
transformons la témérité en valeur et la dissipation en libéralité :
mais la catachrèse n'a rien de commun avec cet artifice ; car ici ce
n'est pas un mot que l'on met à la place d'un autre, mais une chose
que l'on substitue à une autre. Il n'est personne, en effet, qui
confonde la dissipation avec la libéralité ; seulement ce que l'un
nomme dissipation, l'autre l'appelle libéralité, quoique chacun
sache bien que ce sont deux choses différentes.
En fait de tropes qui en modifient la
signification, reste la métalepse ou transomption, qui
sert comme de chemin pour passer d'une idée à une autre. Du reste,
il est très peu usité et surtout fort impropre. Les Grecs cependant
en font un usage fréquent : ainsi ils disent le centaure pour
Chiron, et νήσους θοὰς ὀξειας, des îles errantes et pointues,
pour des vaisseaux. Mais chez nous qui pourrait supporter le porc
pour Verrès, et le docte pour Lélius ? La métalepse consiste.
donc dans un terme intermédiaire, qui ne signifie rien par lui-même,
mais qui sert de degré pour passer à un autre terme. Nous affectons
ce trope, afin qu'il soit dit que nous l'avons, plutôt que par
nécessité. Aussi l'exemple que l'on en donne le plus souvent se
réduit-il à cano, canto, dico, où canto
est considéré comme intermédiaire entre cano et dico.
Je ne m'arrêterai pas plus longtemps sur ce trope, qui est
absolument inusité, si ce n'est, comme je l'ai dit, quand il s'agit
d'exprimer une chose qui participe de deux autres.
Pour les autres tropes, ce sont de
simples ornements, qui n'ajoutent rien à la signification des mots
ni à la force du style. Telle est l'épithète, que j'appelle
opposition, nom qui me paraît très exact, et que quelques rhéteurs
appellent suite. Les poètes s'en servent et plus souvent et plus
librement que les orateurs ; car il leur suffit qu'une épithète
convienne au mot auquel ils s'appliquent, comme dents blanches,
vin humide. Mais en prose toute épithète qui ne produit aucun
effet est une redondance. Or, l'épithète produit un effet, lorsque,
sans elle, la chose dont on parle est moins caractérisée. Par
exemple, O crime abominable ! ô passion infâme ! Ce trope
s'embellit surtout par la métaphore : Une cupidité effrénée, des
constructions folles. Souvent même il s'y mêle d'autres tropes,
comme dans Virgile : La hideuse pauvreté, la triste vieillesse.
Telle est cependant la nature des épithètes, que, sans elles, le
style paraît nu et négligé, et que leur multitude le surcharge. En
effet, lorsqu'elles sont prodiguées outre mesure, le style devient
diffus et embarrassé, de sorte que le plaidoyer ressemble à une
armée où l'on compterait autant de valets que de soldats, et où par
conséquent le nombre est double, et non les forces. Cependant on
joint assez souvent jusqu'à plusieurs épithètes à un seul mot, comme
Conjugio Anchisa Veneris dignate superbo.
Mais, même de cette manière, deux mots
joints à un seul n'ont pas beaucoup de grâce, je ne dis pas en
prose, mais en vers. Je ne dissimulerai pas que quelques rhéteurs
retranchent absolument l'épithète du nombre des tropes, parce
qu'elle ne change rien ; car ce qui est mis par apposition, si on le
sépare du mot propre, signifiera toujours quelque chose par
lui-même, et deviendra une antonomase. Si vous dites, par
exemple, le destructeur de Numance et de Carthage, c'est, une
antonomase ; si vous ajoutez Scipion, ce n'est plus qu'une
apposition. Donc l'épithète ne peut pas, en tant qu'épithète, n'être
pas jointe à un mot propre.
Quant à l'allégorie, elle
consiste à présenter un sens différent de celui des paroles, ou même
an sens qui leur est contraire. Horace nous fournit un exemple de la
première sorte d'allégorie
Vaisseau chéri, que vas-tu faire ?
Sur les mers te lancer encore ! etc.
Dans l'ode qui commence ainsi, le
vaisseau, c'est la république ; les tempêtes, ce sont les
guerres civiles ; le port, c'est la paix et la concorde. Tel
est encore ce passage de Lucrèce : Je me fraye un chemin inconnu
jusqu'à présent aux Muses ; et celui-ci de Virgile
Mais ma seconde course a duré trop longtemps,
Et je dételle enfin mes coursiers haletants.
Quelquefois l'allégorie a lieu sans
métaphore, comme dans cet endroit des Bucoliques : N'avais-je pas
ouï dire que, depuis le penchant de celle colline jusqu'à cette
fontaine ombragée d'un vieux hêtre, Ménalque, votre maître, avait,
grâce a ses chansons, conservé tout son, héritage ? Ici, en
effet, tout est exprimé en termes propres et naturels, hors le nom ;
car le berger Ménalque n'est autre que Virgile. Les prosateurs font
souvent usage de ce genre d'allégorie, mais elle est rarement
entière, et la plupart du temps elle est entremêlée de termes
positifs. Elle est entière dans cet exemple, emprunté à Cicéron :
Je m'étonne et m'afflige de voir porter l'inimitié jusqu'à faire
sombrer le navire sur lequel on navigue soi-même. L'allégorie
mixte est très fréquente : Pour les autres tempêtes, j'ai
toujours pensé que Milon n'avait à les craindre que dans le sein
tumultueux des assemblées populaires. Si l'orateur n'eût ajouté,
dans le sein des assemblées, l'allégorie eut été entière ; mais ces
mots la rendent mixte. Dans les allégories de ce genre, la beauté
naît des termes métaphoriques, et la clarté, des termes propres.
Mais rien n'embellit le style comme de joindre ensemble l'allégorie,
la similitude et la métaphore : Quel détroit, quel euripe offre,
à votre avis, autant, de mouvements, autant d'agitations, de
changements et de fluctuations, que nous voyons de bouleversements
et d'orages dans l'assemblée dit peuple ? ll aie faut souvent qu'un
jour, qu'une nuit d'intervalle, pour donner une face toute nouvelle
aux affaires : un bruit, un souffle change tout à coup la
disposition des esprits. Seulement, il faut avoir soin d'être
conséquent, et ne pas faire comme beaucoup de gens, qui, après avoir
commencé par une tempête, finissent par un incendie ou une ruine ;
ce qui est extrêmement vicieux. Au reste, l'allégorie est à la
portée de tout le monde, et se rencontre très souvent dans la
conversation. C'est de là qu'ont passé au barreau ces locutions,
familières aux avocats : En venir aux mains, serrer son
adversaire à la gorge, lui tirer du sang, etc. Quoique
triviales, elles ne choquent pas : tant ce qui est nouveau, figuré,
inattendu, a de charrue dans le langage ! Mais l'excès a suivi de
près le plaisir, et l'affectation a tout gâté. Les exemples
tiennent aussi de l'allégorie, si on les rapporte sans aucune
explication ; car ce mot des Grecs : Denys à Corinthe, n'est
pas le seul que l'on puisse imaginer en ce genre. Quand une
allégorie de cette espèce est plus obscure, on l'appelle énigme
; mais c'est, à mon sens, un défaut, puisque la clarté est une
qualité cependant les poètes ne laissent pas de s'en servir. Ainsi
nous lisons dans Virgile : Dis-moi, et je te tiendrai pour un
Apollon, où le ciel n'a que trois coudées d'étendue. Quelquefois
même les prosateurs se permettent cette allégorie. Ainsi Célius dit
que Clodia est une Clytemnestre des rues, qui est a table une
femme de Cos, et au lit une femme de Note. On pourrait encore
citer plusieurs traits de ce genre, qu'il faut aujourd'hui deviner,
et qui, du temps de leurs auteurs, présentaient moins d'obscurité.
Ce sont néanmoins des énigmes, puisqu'on ne peut les comprendre
qu'autant qu'on est mis sur la voie. La seconde sorte d'allégorie,
qui fait entendre le contraire de ce qu'elle dit, est l'ironie ; et,
pour la saisir, il faut considérer le ton de celui qui parle, la
personne à qui celui-ci s'adresse, et la chose dont il parle ; car
si les paroles ne s'accordent pas avec l'une ou l'autre de ces
circonstances, il est clair que ces paroles cachent un sens autre
que celui qu'elles présentent naturellement. Et ce n'est pas le seul
trope où il importe d'examiner ce qui se dit et de qui, parce qu'il
est vrai, comme je l'ai fait observer ailleurs, qu'on peut blâmer
sous forme d'éloge, et réciproquement. Exemple du premier genre :
C. Verrés, ce préteur si plein d'urbanité, ce magistrat si intègre
et si exact, n'avait point sur son registre l'acte de remplacement
des juges par le sort. Exemple du second : On a trouvé que
nous étions orateurs, et nous avons imposé au peuple.
Quelquefois c'est en accompagnant nos paroles d'un certain rire, que
nous donnons à entendre tout le contraire de ce que nous disons :
Oui, Clodius, croyez-m'en, c'est la pureté de vos moeurs qui vous a
disculpé, c'est votre pudeur qui vous a protégé, c'est votre vie
passée qui vous a sauvé.
Outre cela, l'allégorie sert à voiler
des choses tristes, ou à faire entendre une chose par une autre
toute contraire, pour ménager les esprits, ou à laisser deviner dans
la suite du discours ce que l'on n'a pas voulu hasarder d'abord
toutes choses dont j'ai déjà parlé. C'est ce que les Grecs appellent
sarcasme, astéisme, antiphrase, parabole,
etc. Cependant quelques rhéteurs prétendent que ce sont des tropes,
et non des espèces de l'allégorie ; et ils en donnent une raison
assez forte : c'est que l'allégorie a quelque chose d'obscur, tandis
que, dans toutes ces manières de parler, le sens est clair et
intelligible. Ils ajoutent à cela que le genre est une abstraction
qui n'a rien de propre en elle-même ; ainsi l'arbre a pour espèces
le pin, l'olivier, le cyprès ; mais, considéré
en général, il n'a rien de propre. Or, l'allégorie a sa propriété ;
ce qui ne pourrait être, si elle n'était elle-même une espèce. Mais,
espèce on genre, peu importe quant à l'usage. Enfin, on peut mettre
au même rang une certaine moquerie apparente et dissimulée tout
ensemble, que les Grecs appellent μυκτηρισμός.
Lorsqu'on développe en plusieurs mots
ce qu'on pourrait dire en un seul, ou du moins avec plus de
brièveté, c'est une périphrase, c'est-à-dire un circuit
d'élocution. La bienséance en fait quelquefois une nécessité :
telle est cette expression de Salluste : Pour des besoins
naturels. Quelquefois aussi ce n'est qu'un ornement, dont les
poètes font un usage très fréquent ; par exemple, c'était l'heure
où le premier sommeil, ce sommeil si doux, vient, par la bonté des
dieux, suspendre les fatigues des hommes. La périphrase n'est
pas rare non plus chez les orateurs, mais elle y est plus serrée. En
effet, la périphrase consiste à développer, pour l'ornement du
style, ce qu'on pourrait dire en moins de mots sans nuire à la
clarté. Toutefois le nom latin circumlocutio, que nous lui
avons donné, ne me paraît pas fort propre à désigner une beauté de
style. Au reste, quand ce trope embellit le style, c'est une
périphrase, et quand il n'atteint pas ce but, c' est une
périssologie ; car tout ce qui n'est pas utile est nuisible.
C'est avec raison qu'on met au nombre
des beautés l'hyperbate, c'est-à-dire transposition des
mots ; car l'harmonie et la grâce du discours en font souvent
une loi. Autrement la phrase sera le plus souvent raboteuse, dure,
lâche et comme béante, si l'on s'attache à ranger les mots dans leur
ordre rigoureux, et à les accoler les uns aux autres, à mesure
qu'ils se présentent, sans s'inquiéter s'ils s'ajustent bien
ensemble. Il en est donc qu'il faut mettre après, d'autres avant,
comme on fait des pierres brutes dans les constructions, en plaçant
chacune à l'endroit qui lui est propre ; car nous ne sommes pas
maîtres de tailler les mots ni de les polir, pour les bien lier
ensemble ; nous sommes forcés de les employer tels qu'ils sont, et
de leur choisir une bonne place ; et le seul moyen de rendre le
style nombreux, c'est de savoir intervertir à propos l'ordre des
mots. Et c'est sans doute parce qu'il avait éprouvé combien cette
disposition savante contribue à la beauté du style, que Platon,
ainsi qu'on en peut juger par plusieurs exemplaires de son plus bel
ouvrage, paraît avoir longtemps combiné l'arrangement des quatre
premiers mots.
Lorsque la transposition n'affecte que
deux mots, on l'appelle anastrophe, ou renversement : tels
sont mecum, secum, ou, chez les orateurs et les
historiens, quibus de rebus. Mais ce qui constitue proprement
l'hyperbate, c'est de déranger un mot et de le transporter un peu
loin de sa place naturelle, pour donner plus d'élégance à la phrase,
comme dans cette période : Animadverti, jucdices, omnem
accusatoris orationem in duas divisam esse partes. Si l'orateur
eût dit in duas partes esse divisant, c'eût été exact, mais
dur sans grâce. Les poètes ne se bornent pas à transoser les mots,
ils les coupent
...Hyperboreo SEPTEM subjecta TRIONI.
La
prose ne souffrirait pas cette licence. Cependant c'est en cela,
c'est-à-dire dans la division ou transposition des mots, que le
trope existe, puisque l'intelligence a besoin de réunir. deux idées.
Autrement, quand la signification reste la même et que la
construction seule est dérangée, est plutôt une figure de mots.
Telles sont ces longues hyperbates, auxquelles beaucoup d'orateurs
ont recours pour varier la narration. J'ai parlé ailieurs des
défauts que produit la confusion.
L'hyperbole est une beauté d'un
genre plus hardi, que, par cette raison, j'ai réservée pour fin.
C'est proprement une exagération outrée et qui va au delà du vrai,
mais du reste également propre à augmenter et à diminuer. Elle a
lieu de plusieurs manières. Tantôt nous ajoutons à la vérité du fait
ou de la chose : Il vomit, il remplit son sein et tout le
tribunal de morceaux à peine ingérés.
....Deux rochers orgueilleux
S'élèvent à l'entour, et menacent les cieux.
Tantôt nous agrandissons les choses
par similitude
De loin vous croiriez voir, sur les eaux écumantes,
Voguer, s'entre-choquer les Cyclades flottantes.
Tantôt c'est par comparaison
Plus léger que les vents, que l'aile de la foudre.
Tantôt c'est à l'aide de certains
signes
Elle eût, des jeunes blés rasant les verts tapis,
Sans plier leur sommet, volé sur leurs épis. (DELILLE.)
Ou enfin par métaphore, comme ce mot
volé dans ce dernier vers. Quelquefois l'hyperbole s'accroît par
l'addition d'une autre hyperbole. Cicéron dit, en parlant d'Antoine
: Quelle Charybde fut jamais aussi vorace ? Que dis-je, Charybde
? Si ce monstre a existé, il était le seul. Non, je ne sais si
l'Océan pourrait engloutir en si peu de temps tant de biens divers,
dispersés et placés à des distances éloignées. Mais une des plus
belles hyperboles que j'aie remarquées, c'est celle dont se sert
Pindare, le prince des poètes lyriques, au livre des hymnes.
Voulant peindre l'impétuosité avec laquelle Hercule vint fondre sur
les Méropes, qui habitaient, dit-on, l'île de Cos, il ne la compare
ni au feu, ni aux vents, ni à la mer, mais à la foudre, comme si la
foudre seule pouvait donner une idée de la rapidité du héros. C'est
à l'exemple de Pindare que Cicéron a dit, en parlant de Verrès :
On revoyait dans la Sicile, après de longues années, non un Denys,
non un Phalaris (car on sait combien de cruels tyrans ont autrefois
désolé cette île), mais un monstre d'une nouvelle espèce, composé de
cette ancienne férocité qui avait régné dans les mêmes lieux. Je ne
crois pas, en effet, que jamais Scylla ni Charybde aient été aussi
funestes aux navigateurs, que Verrès l'a été dans ce même détroit.
Il y a autant d'hyperboles pour exténuer que pour exagérer. Telle
est celle dont Virgile se sert pour peindre la maigreur d'un
troupeau : Leurs os se tiennent à peine. Telle est encore
cette épigramme où Cicéron se moque de l'étymologie que Varron
donnait au mot fundus. Mais, jusque dans l'hyperbole, il faut
garder une certaine mesure ; car encore que ce trope dépasse les
bornes du croyable, il ne doit pas néanmoins être excessif ; et il
n'est pas de chemin plus glissant pour ceux qu'entraîne le mauvais
goût. J'aurais quelque regret à signaler tous les défauts qui
naissent de cet excès, d'autant qu'ils ne sont que trop connus et
trop visibles. Qu'il me suffise de faire remarquer que si
l'hyperbole ment, elle ne ment pas pour tromper, et que dès lors il
faut considérer jusqu'à quel point la bienséance nous permet de
surfaire une chose, quand nous savons qu'on ne manquera pas d'en
rabattre beaucoup. Très souvent l'hyperbole touche à la plaisanterie
; si cette plaisanterie est bien placée, c'est urbanité ; si
elle est déplacée, c'est sottise. Or, pourquoi l'hyperbole
est-elle commune aux doctes et aux ignorants ? C'est que nous sommes
tous naturellement portés à exagérer ou à exténuer les choses, et
que personne ne se contente de la réalité ; mais on nous le
pardonne, parce que nous n'affirmons pas. En un mot, l'hyperbole est
une beauté, lorsque la chose dont nous avons à parler est ellemême
extraordinaire ; car on est autorisé à dire plus, faute de pouvoir
dire assez ; et il vaut mieux aller au delà que de rester en deçà.
Mais en voilà assez sur cet article, d'autant que je l'ai déjà
traité plus amplement dans mon livre des causes de la corruption
de l'éloquence.
NOTES
LIVRE HUITIÈME.
Cn. Flavius qui cornicum oculos
confixit. Properce dit que les yeux des corneilles étaient
employés dans les opérations magiques, et que la sorcière se
proposait, en arrachant avec ses ongles les yeux à une corneille,
d'aveugler un mari sur les adultères de sa femme :
Posset ut intentos astu cœcare maritos,
Cornicum emeritas eruit unque genas. (l. IV, 5, 15.)
De là ce proverbe, crever les yeux à
une corneille, pour dire tromper le plus fin.
Ad digiturn pugnari. Cette
locution ne se retrouve que dans une ancienne épigramme attribuée à
Martial : ce qui suffit, sans doute, pour la maintenir, mais non pas
pour l'expliquer ; car Martial ne nous fait pas plus connaître que
Quintilien ce qu'on entendait par pugnare ad digitum.
Quelques commentateurs out pensé que cela signifiait combattre
jusqu'à ce que l'un ou l'autre des gladiateurs s'avouât vaincu, en
élevant le doigt, exerto digito.
Dionysium Corinthi esse.
Philippe, roi de Macédoine, menaçait les Lacédémoniens d'une guerre.
Ceux-ci lui firent pour toute réponse : Denys à Corinthe. C'était
assez lui rappeler l'inconstance de la fortune ; car Denys, tyran de
Syracuse, chassé de son royaume, avait été réduit à enseigner la
musique et les lettres à Corinthe.