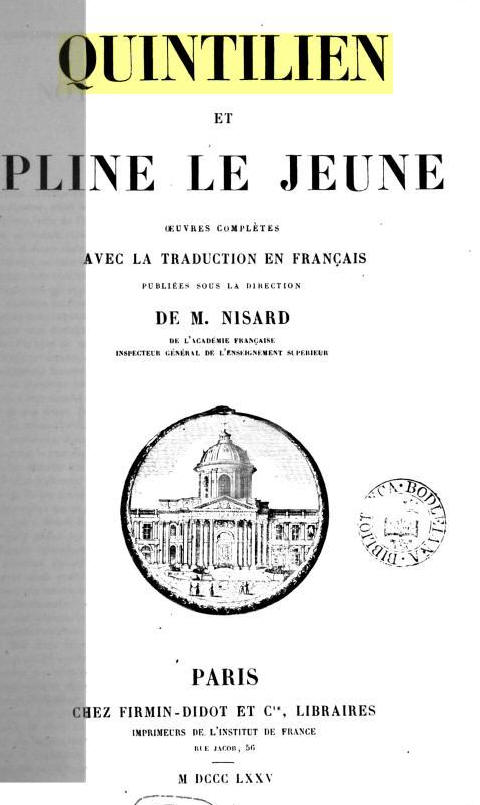|
LIVRE IV.
SOMMAIRE.
Introduction. — Chap. I. De l'exorde.
— II. De la narration. — III. De la digression ou de l'excursion. —
IV. De la proposition. — V. De la partition.
J'avais achevé le troisième livre du
traité que je vous ai dédié, mon cher Victorius, et j'en étais à peu
près au quart de mon ouvrage, lorsqu'une circonstance extraordinaire
est venue m'imposer un redoublement de zèle, et augmenter mon
anxiété sur le jugement que les hommes porteront de moi. Jusqu'ici
ce n'étaient guère que des conférences entre nous; et, lors même que
mon Institution eût été peu goûtée du public, je me serais cru
suffisamment récompensé de mes soins par le fruit que votre fils et
le mien en eussent recueilli pour leur instruction; mais, chargé
aujourd'hui par Domitien Auguste de l'éducation de ses
petits-neveux, je serais indigne d'avoir attiré les regards des
dieux, si je ne mesurais, sur cet honneur, l'étendue de ma tâche.
Quelle vigilance, en effet, ne dois-je pas apporter, et dans le soin
de mes mœurs, pour mériter l'approbation du plus saint des censeurs;
et dans le soin de mes études, pour justifier le choix d'un prince
éminemment supérieur en éloquence comme dans tout le reste? Si les
plus grands poètes débutent, sans qu'on s'en étonne, par invoquer
les Muses ; si même dans le cours de leurs poèmes, et arrivés à
certaines parties importantes, ils s'arrêtent pour renouveler leurs
prières et leur invocation, j'ai lieu de croire qu'on me pardonnera
de faire ici ce que je n'ai point fait au commencement de cet
ouvrage, d'appeler tous les dieux à mon aide, et particulièrement
celui qui, entre tous, veille sur les hommes et préside aux lettres.
Je le prie donc de m'inspirer, de m'assister, de m'être propice,
afin que je puisse répondre a la haute idée qu'il a donnée de moi,
et, en un mot, me montrer tel qu'il m'a supposé.
Mais cette raison, quoiqu'il n'en
faille point d'autre, n'est pas la seule qui me commande cet acte
religieux : à mesure que j'avance, mon sujet croît en importance et
en difficulté. En effet, j'ai à présent à expliquer l'ordonnance des
causes judiciaires, dont les espèces sont si variées et la nature si
multiple : quelles sont les règles et les qualités de l'exorde;
celles de la narration; ce qui constitue la force des
preuves, soit qu'il s'agisse de confirmer ce qu'on a avancé, ou
de réfuter les allégations de la partie adverse; l'art qu'il faut
déployer dans la péroraison, soit qu'il faille, dans un court
résumé, reproduire la cause entière sous les yeux du juge, ou
frapper le dernier coup en déchaînant les passions. Quelques
rhéteurs, effrayés sans doute de l'ensemble d'une
126 pareille tâche, ont
mieux aimé traiter séparément chaque partie, et nous ont même donné
plusieurs volumes sur une seule. Pour moi, qui n'ai pas craint de
les embrasser toutes, j'aperçois devant moi une carrière presque
infinie, et je me sens comme accablé de la seule idée de mon
entreprise; mais il faut persévérer, puisque j'ai commencé; et si
les forces me manquent, au moins mon courage ne doit-il pas
défaillir.
CHAP. I. Ce que nous appelons début
ou exorde, les Grecs l'ont désigné avec plus de justesse, ce
semble, par le nom de προοίμιον. Le mot latin
signifie seulement commencement, tandis que le mot grec
détermine plus clairement cette partie qui précède l'entrée du
sujet. En effet, soit qu'à l'exemple des joueurs de lyre, qui ont
appelé προοίμιον (nom composé du mot
οἴμη, chant) les préludes qu'ils font, pour
se concilier la faveur, avant d'en venir au combat sérieux, les
orateurs aient donné le même nom à ce qu'ils disent, avant d'aborder
la cause, pour se concilier la bienveillance des juges ; soit que ce
nom ait été formé du mot οἶμος, qui veut dire
voie, et signifie l'avenue qui conduit au sujet : toujours
est-il que l'exorde est ce qui sert a préparer le juge à écouter une
cause qu'il ne connaît pas encore. Aussi est-ce un usage vicieux des
écoles, de parler, dans l'exorde, comme si le juge était déjà au
courant de l'affaire. Cet abus provient de ce que les déclamations
sont toujours précédées d'un sommaire de la cause. Ce genre d'exorde
peut aussi avoir lieu au barreau dans les secondes plaidoiries ;
mais quand une affaire se présente pour la première fois, cela est
très-rare, à moins que le juge devant lequel on plaide ne sache
d'ailleurs de quoi il s'agit.
L'exorde n'a pas d'autre but que de
préparer l'esprit de celui qui nous écoute, comme on prépare une
matière qu'on veut rendre plus maniable. On est généralement
d'accord qu'on arrive à cette fin par trois moyens principaux : en
rendant l'auditeur bienveillant, attentif, docile;
non que nous devions négliger ces moyens dans aucune partie du
plaidoyer, mais parce qu'ils nous sont surtout nécessaires en
commençant, pour nous introduire dans l'esprit du juge, et, une fois
admis, pénétrer plus avant.
La bienveillance, ou nous la
tirons des personnes, ou nous la tenons de la cause. Quant aux
personnes, il ne faut pas croire, avec la plupart des rhéteurs,
qu'elles se bornent à celles du demandeur, de la partie
adverse et du juge. Quelquefois l'exorde se tire de celle
du défenseur. En effet, quoiqu'il doive parler peu de sa personne et
avec retenue, il est d'une extrême conséquence qu'il donne de lui
une bonne opinion, et qu'il soit réputé homme de bien ; car
alors on ne voit plus en lui le zèle d'un avocat, mais presque la
foi d'un témoin. Qu'il ait donc soin de persuader qu'il obéit à
quelque devoir de famille ou d'amitié, ou mieux encore, s'il est
possible, à quelque motif d'intérêt public, ou à quelque haute
considération d'ordre moral. A plus forte raison les plaideurs
doivent-ils paraître n'avoir cédé, dans les actions qu'ils
intentent, qu'à des raisons graves et honorables, ou à la nécessité.
Mais s'il importe avant tout au défenseur, pour donner de l'autorité
à ses paroles, d'éloigner de sa personne tout soupçon de s'être
chargé d'une affaire dans des vues de cupidité, de haine ou
d'ambition, c'est aussi une sorte de recommandation tacite
127 pour lui de déclarer
son insuffisance, et de se dire inférieur en talents à son
adversaire, ainsi que le fait Messala dans la plupart de ses
exordes. On s'intéresse naturellement aux faibles; et un juge
consciencieux écoute volontiers un défenseur qu'il regarde comme
incapable de surprendre sa religion. De là ce soin que mettaient les
anciens à dissimuler l'éloquence, bien différent de cette jactance
des orateurs de nos jours. Il faut éviter aussi tout ce qui sent l'outrage,
la malignité, le dédain, l'invective, à l'égard
d'un individu ou d'un ordre quelconque ; mais particulièrement à
l'égard d'un homme ou d'un ordre, qu'on ne peut offenser sans
s'attirer l'animadversion des juges. Quant aux juges, on ne doit
rien se permettre contre eux ni ouvertement ni indirectement ; et
c'est une recommandation que je croirais plus que superflue, si le
contraire n'arrivait.
On peut encore tirer l'exorde de la
personne du défenseur de la partie adverse, en parlant de lui,
tantôt avec honneur, si l'on feint, par exemple, de craindre son
éloquence et son crédit, dans le but de mettre le juge sur ses
gardes ; tantôt, mais très-rarement, avec mépris, comme le fit
Asinius Pollion, qui, plaidant pour les héritiers d'Urbinia,
opposait à la partie adverse, entre autres preuves de l'injustice de
sa cause, le choix qu'elle avait fait de Labiénus pour défenseur.
Cornélius Celsus nie que ce soient là des exordes, parce que tout
cela est en dehors de la cause. Je pense, au contraire, et en cela
j'ai pour moi l'autorité des plus grands orateurs, que tout ce qui
appartient à la personne du défenseur appartient à la cause,
puisqu'il est naturel que les juges soient plus disposés à croire
ceux qu'ils écoutent plus volontiers.
La personne du demandeur peut donner
lieu à des considérations diverses. Tantôt c'est sa dignité qu'on
oppose, tantôt c'est sa faiblesse qu'on recommande ; quelquefois on
est dans le cas de rappeler des actions honorables : ce qui demande
plus de réserve en parlant pour soi, qu'en parlant pour autrui. Le
sexe, l'âge, la condition, font aussi beaucoup, si ce sont, par
exemple, des femmes, des vieillards, des pupilles, qui allèguent les
titres d'épouses, de pères, d'enfants ; car le sentiment de la pitié
suffit pour faire pencher le juge même le plus droit. Cependant il
faut effleurer ces motifs dans l'exorde, et non les épuiser.
A l'égard de la personne de la partie
adverse, elle donne lieu à des considérations qui sont a peu près de
même nature, mais que l'on fait tourner contre elle, en les
interprétant d'une manière toute contraire. En effet, l'envie suit
la puissance; le mépris suit l'obscurité et l'abjection ; la haine
suit l'infamie et le crime : trois choses bien puissantes pour
indisposer l'esprit des juges. Toutefois, il ne suffit pas d'en
faire un emploi banal, ce qui est aisé, même à des ignorants; mais
la plupart du temps il faut savoir les exagérer ou les affaiblir,
selon le besoin : ceci est de l'art, cela est de la matière.
Pour se concilier le juge, il faut
non-seulement le louer (ce qui demande une certaine mesure, et
d'ailleurs est un devoir commun aux deux parties), mais encore faire
tourner son éloge à l'avantage de la cause. Par exemple, si nos
clients sont des personnes de distinction, nous en
appellerons à sa dignité; si ce sont des gens du peuple, à sa
justice ; s'ils sont malheureux, à sa compassion ; s'ils sont
lésés, à sa sévérité ; et ainsi du reste. Je voudrais aussi
que l'on connût, si cela est possible, le caractère du juge; car,
selon que 128 son
humeur sera violente ou douce, enjouée ou
grave, sévère ou indulgente, on s'en emparera au
profit des causes qui y correspondront, ou on cherchera à la
tempérer dans le cas contraire. Il arrive quelquefois que le juge
est, ou notre ennemi personnel, ou l'ami de notre
adversaire : c'est une circonstance qui doit être prise en
considération par les deux parties, et plus particulièrement
peut-être par celle pour qui le juge paraît incliner. Car il se
rencontre des juges qui, par une sorte de vanité de conscience,
prononcent contre leurs amis ou en faveur de leurs ennemis, aimant
mieux commettre une injustice que de paraître injustes en jugeant
selon la justice. Il y a même des cas où le juge est appelé à
prononcer dans sa propre cause. Je vois, dans les livres des
observations publiés par Septimius. que Cicéron eut à plaider dans
une affaire de cette nature; et moi-même j'ai plaidé pour la reine
Bérénice par devant elle. La méthode est la même que dans les
circonstances dont j'ai parlé plus haut. Celui qui plaide contre,
exagère la confiance de son client; et celui qui plaide pour,
témoigne des craintes sur les scrupules de son juge. On a en outre à
détruire ou à fortifier certaines préventions que le juge paraît
avoir apportées de chez lui en faveur de l'une des deux parties.
Quelquefois aussi il faut ou les rassurer, comme l'a fait Cicéron
dans son plaidoyer pour Milon, lorsqu'il s'efforça de leur persuader
que l'appareil militaire, déployé par Pompée, n'était pas dirigé
contre eux; ou les intimider, comme l'a fait le même orateur en
plaidant contre Verres. Mais, des deux moyens en usage pour
intimider les juges, le premier, assez ordinaire et qui n'a rien de
blessant, c'est de leur faire craindre que le peuple romain ne
voie leur jugement de mauvais œil; que l'affaire ne soit évoquée
devant un autre tribunal. Le second, violent, mais rarement
employé, c'est de les menacer d'une accusation pour cause de
corruption; mais le plus sûr, à tous égards, est de n'y recourir que
devant un tribunal nombreux, parce que cette menace retient les
mauvais et réjouit les bons : et je ne le conseillerai jamais,
devant un seul, qu'au défaut de toute autre ressource. Si la
nécessité nous y oblige, ce n'est plus alors l'affaire de la
rhétorique, non plus que d'appeler de son jugement, quoique l'appel
soit souvent utile ; non plus que de le prendre à partie avant qu'il
n'ait prononcé ; car on n'a pas besoin d'être orateur pour menacer
ou dénoncer son juge.
A l'égard de la cause, si elle peut
contribuer, par sa nature, à nous concilier les juges, nous lui
emprunterons, de préférence aux personnes, les éléments de notre
exorde, en nous inspirant de ce qu'elle présente de plus favorable.
Virginius est ici dans l'erreur. Il enseigne que Théodore est d'avis
que chaque question fournisse une pensée à l'exorde. Ce n'est pas ce
que dit ce rhéteur. Il veut seulement que l'on y prépare le juge aux
questions les plus importantes : précepte qui n'aurait rien de
vicieux , si Théodore ne le généralisait; car toute action n'en
comporte pas ou n'en réclame pas l'application. En effet, en se
levant pour la première fois au nom du demandeur, lorsque le juge ne
sait pas encore de quoi il s'agit, le moyen d'emprunter des pensées
à des questions qui ne sont pas connues? n'est-il pas indispensable
d'indiquer préalablement les choses? Admettons qu'on le fasse pour
quelques-unes, ce que le plan exige quelquefois, est-ce une raison
pour indiquer toutes celles qui ont de l'importance, c'est-à-dire la
cause entière? Mais alors l'exorde contiendra la narration. Et si,
comme il arrive souvent, la cause est un peu scabreuse,
129 ne cherchera-t-on pas
ailleurs des titres à la bienveillance du juge, et se
hasardera-t-on, avant de se l'être concilié, à présenter les choses
dans leur âpre nudité? Si elles pouvaient toujours se traiter dès le
début, on n'aurait pas besoin d'exorde. En résumé, il ne sera pas
inutile d'anticiper quelquefois sur les questions, et de faire
entrer dans l'exorde un aperçu de celles qui ne peuvent manquer de
nous concilier le juge. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les
points favorables que peut présenter une cause , ils ressortiront
assez de la nature de chaque affaire : aussi bien, la variété des
causes est telle qu'il est impossible de les indiquer tous. Au
reste, de même que c'est de la cause que nous apprendrons à trouver
ces points favorables pour nous en prévaloir, c'est elle aussi qui
nous fera connaître ceux qui nous sont contraires. C'est d'elle
encore que naîtra quelquefois la pitié, si, par exemple, nous avons
souffert ou si nous sommes menacés de souffrir quelque grave
dommage. Car je ne partage pas l'opinion de ceux qui pensent que
l'exorde diffère de l'épilogue, en ce que l'un n'a trait qu'au
passé, et l'autre qu'à l'avenir. La véritable différence, selon moi,
consiste en ce que, dans l'exorde, l'orateur doit être plus réservé,
et se borner à sonder la compassion du juge ; et que, dans
l'épilogue, il faut déployer toutes les ressources du pathétique,
recourir aux prosopopées, évoquer les morts, et les faire paraître
entourés de ce qu'ils ont de plus cher au monde : ce qui est inusité
dans l'exorde. Au reste, si dans l'exorde il y a lieu quelquefois
d'éveiller la pitié en notre faveur, il n'est pas moins nécessaire
en certains cas de la détourner de notre adversaire : car s'il est
utile de faire voir combien notre sort sera déplorable, si nous
succombons; il ne l'est pas moins de représenter quelle sera
l'insolence de notre adversaire, s'il vient à triompher.
Indépendamment de la cause et des
personnes, l'exorde se tire encore d'objets extérieurs, ou de
circonstances qui s'y rattachent. Aux personnes se rapportent
non-seulement leurs femmes, leurs enfants, mais encore
leurs proches, leurs amis, quelquefois le pays,
la cité, et enfin tout ce qui pourrait souffrir du malheur de
celui que nous défendons. Les circonstances de la cause sont le
temps, le lieu, la forme, l'opinion,
circonstances dont Cicéron a tiré les exordes de ses plaidoyers pour
Célius, pour le roi Déjotare, pour Milon, contre Verrès; enfin, pour
ne pas les énumérer toutes, l'éclat de l'affaire, l'attente du
public. Rien de tout cela n'est dans la cause, et cependant tout
cela ne laisse pas d'avoir une liaison naturelle avec elle.
Théophraste ajoute une autre sorte d'exorde, tirée du plaidoyer,
comme, par exemple l'exorde de Démosthène, qui, en plaidant pour
Ctésiphon, demande qu'il lui soit permis de suivre, dans son
discours, la marche que bon lui semblera, et non celle que lui a
tracée l'accusateur.
L'assurance a souvent l'air de la
présomption. Ce qui concilie la faveur, ce sont les souhaits,
les déprécations, les prières, l'anxiété :
moyens qui sont en général communs aux deux parties, mais qu'il ne
faut cependant pas négliger, ne fût ce que pour empêcher
l'adversaire de s'en emparer. Le juge, en effet, sera plus attentif,
s'il peut croire qu'il s'agit d'une chose extraordinaire, grave,
atroce, criante; surtout si on lui persuade qu'il y va de son
intérêt ou de celui de la société. On mettra donc tout en usage pour
exciter son attention : crainte, espérance, remontrances, prières;
on aura même recours au mensonge, si l'on croit
130 que cela puisse être
utile. Un bon moyen encore de s'en faire écouter, c'est de lui faire
espérer qu'on ne sera pas long, et qu'on ne sortira pas de la cause.
Cette attention seule rendra le juge docile, surtout si l'on sait
lui exposer l'ensemble de l'affaire dans un précis lumineux. C'est
ce que font Homère et Virgile au commencement de leurs poèmes. Quant
à la mesure de ce précis, il doit ressembler plutôt à une
proposition qu'à une exposition, et indiquer, non comment chaque
chose s'est passée, mais ce dont l'orateur parlera. Je ne crois pas
qu'on puisse en trouver un meilleur exemple que dans le plaidoyer de
Cicéron pour Cluentius : J'ai remarqué, juges, que tout le
discours de l'accusateur est divisé en deux parties : dans l'une il
m'a paru mettre son appui et toute sa confiance dans la faveur
attachée depuis longtemps au jugement rendu par Junius; dans
l'autre, et seulement pour la forme, il se borne à loucher avec
timidité et défiance la question d'empoisonnement, quoique, d'après
la loi, ce soit la seule sur laquelle vous ayez à prononcer.
Cependant tout cela est plus facile en répliquant qu'en attaquant ;
car dans le premier cas il suffit d'avertir le juge ; dans le
second, il faut l'instruire.
Je ne crois pas, quoique ce soit
l'opinion de quelques graves auteurs, qu'on puisse jamais se
dispenser de rendre le juge attentif et docile : non que j'ignore la
raison qu'ils en donnent, à savoir que, dans une mauvaise cause, il
n'est pas à propos que le juge voie si clair ; mais parce que cette
obscurité vient moins de l'inattention du juge que de l'erreur où on
le jette à dessein. En effet, notre adversaire a parlé, et peut-être
a-t-il déjà persuadé : il nous faut donc changer l'opinion du juge;
et comment y parviendrons-nous, si nous ne le rendons docile et
attentif à notre réplique? J'accorde, au reste, qu'il faut
quelquefois avoir l'air d'attacher peu d'importance à certaines
choses , de les rabaisser, et môme de les dédaigner, pour affaiblir
l'attention que le juge prête à notre adversaire , comme Cicéron l'a
fait dans la défense de Ligarius. A quoi tendait-il par cette
agréable ironie , sinon à rendre César moins attentif, en lui
présentant la cause comme n'ayant rien d'extraordinaire? Que se
proposait-il encore dans son plaidoyer pour Célius, sinon d'ôter à
l'affaire l'importance qu'on y attachait?
Au surplus, il est évident que
l'application de ce que j'ai dit, relativement aux sources de
l'exorde, varie selon la nature des causes. Or, la plupart des
rhéteurs établissent cinq genres de causes : celles qui sont
nobles , ἔνδοξον; celles qui sont
vulgaires, ἄδοξον; celles qui sont
douteuses ou ambiguës, ἀμφίδοξον;
celles qui sont paradoxales , παράδοξον;
celles qui sont obscures, δυσπαρακολούθητον.
Il en est qui ont cru devoir ajouter à ce nombre les causes
honteuses , que les uns rangent sous les causes vulgaires,
les autres sous les causes paradoxales. On entend par
paradoxal ce qui est contraire à l'opinion commune. On doit
chercher à rendre le juge bienveillant dans les causes douteuses
, docile dans les causes obscures , attentif dans les causes
vulgaires. Les causes nobles se recommandent assez
d'elles-mêmes; dans celles qui sont paradoxales et
honteuses, il faut user de remèdes. Et c'est pour cela que
quelques-uns divisent l'exorde en deux parties , le début et
l'insinuation. Dans le début, on sollicite sans détour la
bienveillance et l'attention ; mais comme cela ne peut pas se faire
dans 131 les causes
honteuses, il faut bien se glisser dans l'esprit du juge au moyen de
l'insinuation, surtout si la cause se présente d'abord sous un jour
peu avantageux, soit parce qu'elle est mauvaise, soit parée que le
préjugé public lui est peu favorable ; ou bien encore si elle a à
surmonter l'odieux qui rejaillit de la présence d'un patron, d'un
père, comme partie adverse; ou la compassion qu'inspire un
vieillard, un aveugle, un enfant. Les mêmes rhéteurs s'étendent en
longs préceptes sur les moyens de remédier à ces difficultés, et
imaginent des matières qu'ils traitent selon les formes du barreau ;
mais comme il est impossible de prévoir toutes les espèces de causes
qui appartiennent au genre judiciaire, ces matières i qui sont des
causes fictives, ne peuvent renfermer que des généralités :
autrement, on tomberait dans l'infini. C'est pourquoi on prendra
conseil de la nature de chaque cause. Ce que je recommande en
général, c'est de se retrancher dans la position la plus
avantageuse. Si c'est la cause qui pèche, que la personne nous
vienne en aide; si c'est, au contraire, la personne, recourons à la
cause; si tout nous manque, cherchons ce qui peut nuire à
l'adversaire; car, après le souhait d'être au mieux dans l'esprit du
juge, il ne reste que celui d'y être le moins mal. Si nous ne
pouvons nier les faits qu'on nous oppose, tâchons d'en atténuer
l'importance ou d'en excuser l'intention. Disons qu'ils ne font rien
à l'état de la question, ou que c'est une faute qui peut être expiée
par le repentir, ou qu'elle a déjà été assez punie. Ce genre de
défense est plus facile à l'avocat qu'à la partie, parce qu'il peut
louer celui qu'il défend sans encourir le reproche d'arrogance, et
quelquefois même le blâmer utilement; Ainsi il feindra, comme
Cicéron l'a fait dans son plaidoyer pour Rabirius, d'être ébranlé
par ce qu'on oppose à son client, et s'introduira de cette manière
dans l'oreille du juge, auquel cette autorité que donne le respect
de la vérité Inspirera plus de confiance lorsqu'il en viendra à
justifier ou à nier ces mêmes actes. C'est pour cela qu'on examine
d'abord si l'on doit parler comme avocat ou comme partie, dans les
cas où l'un ou l'autre se peut également ; car si ce choix est libre
dans les écoles, il est rare qu'on soit bien venu au barreau à
défendre soi-même sa propre cause. Dans les écoles, en effet, les
passions étant le fond des déclamations, il est naturel que les
personnages parlent eux-mêmes; car les passions ne sont pas de ces
choses qui se transmettent par procuration ; et le mouvement que
nous avons reçu ne se communique pas avec la même force que celui
qui part de nous-mêmes. C'est par les mêmes raisons que
l'insinuation est encore nécessaire lorsque l'adversaire s'est rendu
maître de l'esprit des juges, ou lorsque leur attention est déjà
fatiguée. On se tirera de la première difficulté en annonçant qu'on
a aussi ses preuves, et en éludant celles de l'adversaire; et de la
seconde, en promettant d'être court, et en recourant aux autres
moyens que j'ai indiquée pour rendre le juge attentif. La
plaisanterie, maniée délicatement et à propos, contribue aussi à
réveiller l'esprit du juge, et son ennui se prête volontiers à tout
ce qui peut le soulager. Quelquefois même il est bon d'aller
au-devant de ce qu'on pourrait nous opposer, comme l'a fait Cicéron.
Je sais, dit-il, que certaines personnes s'étonnent que le
même homme qui a défendu pendant tant d'années un si grand nombre
d'accusés, qui ne s'est jamais porté pour accusateur contre
personne, entreprenne aujourd'hui d'accuser Verrès. Ensuite il
fait voir qu'en définitive il n'a fait que prendre la défense des
132 alliés. Cette figure
s'appelle prolepse. Mais parce qu'elle peut être quelquefois
employée avec succès, certains déclamateurs s'en servent presque à
tous propos, comme s'il était interdit de commencer autrement qu'au
rebours de l'ordre naturel.
Les partisans d'Apollodore nient que
les moyens de bien disposer le juge se bornent aux trois dont j'ai
parlé. Ils en comptent une infinité d'autres, tirés des mœurs du
juge, de l'opinion qu'on a des circonstances de la cause, de
l'opinion qu'on a de la cause elle-même; enfin, de tous les
éléments dont toute controverse est composée : des personnes, des
faits, des dits, des motifs, des temps, des lieux, des occasions,
etc. Tout cela existe, je l'avoue, mais rentre dans nos trois
moyens, comme l'espèce dans le genre; car, si j'ai mon juge
bienveillant, attentif et docile, je ne vois pas
ce qui me reste à désirer de plus, puisque la crainte même, qui
paraît le plus en dehors de ces moyens, peut rendre le juge
attentif, et le faire renoncer à sa bienveillance pour l'adversaire.
Comme il ne suffit pas d'exposer aux
élèves les principes de l'exorde, et qu'il faut aussi leur en
faciliter l'application, j'ajouterai que l'orateur doit considérer
la nature de la cause, devant qui il parle, pour qui, contre qui,
le temps, le lieu, la conjoncture, le préjugé public, l'opinion
présumable du juge avant de nous entendre ; enfin, ce que
nous cherchons ou ce que nous voulons éviter. La raison lui
indiquera d'elle-même ce qu'il doit dire dans son exorde. Mais
aujourd'hui on croit que tout ce qu'on dit en commençant est un vrai
commencement, et que la première pensée venue, surtout si c'est une
pensée qui flatte, est un exorde. Sans doute il entre dans l'exorde
beaucoup de choses tirées des autres parties du plaidoyer, ou qui
lui sont communes avec elles; cependant il n'y a rien de mieux dit,
quelque part que ce soit, que ce qui ne pourrait être aussi bien dit
ailleurs.
Une grande faveur s'attache à
l'exorde, dont la matière est tirée du plaidoyer de la partie
adverse; et cela, parce qu'il n'a pas été composé à loisir, parce
qu'il est né là et de la circonstance, outre que cette facilité
donne une haute idée de notre esprit, et que l'air simple d'un
discours sans recherche inspire la confiance : ce qui est tellement
vrai, que, bien que le reste ait été écrit et travaillé avec soin,
un discours dont le commencement n'a eu évidemment rien de préparé
semble entièrement improvisé. Mais la plupart du temps rien ne sied
mieux à l'exorde que la modération dans les pensées, dans le style,
dam la voix et dans l'air du visage; à tel point que, dans la cause
la moins douteuse, on ne doit pas laisser paraître trop d'assurance
: car la sécurité du plaideur blesse d'ordinaire le juge; et comme
celui-ci a par devers lui le sentiment de son autorité, il veut
intérieurement qu'on y rende hommage. Prenons bien garde aussi de
nous rendre suspects dans l'exorde ; et pour cela évitons jusqu'à la
moindre apparence d'étude en commençant , parce que autrement l'art
semble entièrement dirigé contre le juge; mais cela même,
c'est-à-dire le soin de dissimuler l'art, est le comble de l'art.
C'est ce qu'enseignent, il est vrai, tous les rhéteurs, et avec
raison ; mais ce précepte ne laisse pas de subir l'influence des
temps. Car aujourd'hui dans certaines affaires, et surtout dans les
causes capitales, ou devant 133
les centumvirs, les juges eux-mêmes exigent dans les plaidoyers
toutes les délicatesses de l'art, et même se croiraient dédaignés,
si l'on n'apportait le plus grand soin dans la manière de le
prononcer: ils veulent non-seulement qu'on les instruise, mais aussi
qu'on leur procure du plaisir. Il est difficile de garder en cela un
juste milieu ; cependant on peut user d'un tempérament tel, que le
soin paraisse sans trahir la finesse. Ce qui doit rester entier des
anciens préceptes, c'est d'éviter dans l'exorde toute expression
insolite, toute métaphore trop hardie, tout mot suranné ou poétique.
Car nous ne sommes pas encore introduits, et l'attention toute
fraîche des auditeurs est là qui nous observe : ce n'est qu'après
nous être concilié les esprits, et les avoir déjà échauffés, que
nous pourrons nous permettre plus de liberté, surtout quand nous
serons entrés dans les lieux communs, dont l'abondance ordinaire
empêche qu'un mot hasardé ne se remarque au milieu de l'éclat qui
l'environne.
Le style de l'exorde ne doit pas
ressembler à celui des arguments, des lieux communs, et de la
narration ; il ne doit pas non plus être trop châtié, nf trop sentir
la période ; mais le plus souvent il doit avoir un air simple,
facile, et qui promet peu. Car un discours où l'art se cache,
ἀνεπίφατος, comme disent les Grecs, est
ordinairement plus insinuant. Au surplus, cela dépend de la
direction qu'il convient de donner à l'esprit du juge.
Se troubler, manquer de mémoire, ou
demeurer court, produit là, plus qu'ailleurs, un fâcheux effet : un
exorde vicieux ressemble à un visage balafré; et il n'y a
certainement qu'un mauvais pilote qui fasse naufrage en sortant du
port. La mesure de l'exorde doit être proportionnée à la nature, de
la cause. Ainsi il sera plus court dans une cause simple, et plus
étendu dans une cause compliquée, suspecte ou honteuse. S'il est
ridicule, d'avoir fait, pour ainsi dire, une loi de renfermer tous
les exordes dans quatre pensées, il faut éviter néanmoins de leur
donner une longueur démesurée, afin que la tête ne soit pas plus
grosse que le reste du corps, et que la partie du discours destinée
à préparer l'attention ne la fatigue pas.
Quelques rhéteurs rejettent tout à
fait do l'exorde la figure par laquelle la parole est détournée du
juge, et que les Grecs appellent ἀποστροφὴ :
et en cela leur opinion n'est pas destituée de raison ; car il faut
convenir que rien n'est plus naturel que de s'adresser de préférence
à ceux dont on veut gagner la bienveillance. Quelquefois néanmoins
il est nécessaire d'animer un peu l'exorde; et l'apostrophe, en ce
cas, rend la pensée plus vive et plus véhémente. Or, quelle loi,
quel scrupule, peut nous interdire d'ajouter de la force à une
pensée au moyen de cette figure? D'ailleurs les maîtres de l'art
l'interdisent, non comme contraire aux règles, mais comme inutile.
Or, si cette utilité nous est démontrée, nous avons alors, pour
faire, la même raison que pour ne pas faire. Démosthène
n'apostrophe-t-il pas Eschine dans son exorde, et Cicéron
n'adresse-t-il pas la parole à qui bon lui semble dans les exordes
de plusieurs plaidoyers, et notamment dans celui de la défense de
Ligarius, où il interpelle Tubéron? Tout autre tour eût rendu cet
exorde languissant. Il ne faut que se souvenir de ce beau passage :
Vous avez donc obtenu, ô Tubéron, ce qui met. le comble aux vœux
d'un accusateur! etc. Supposons qu'il adresse la parole aux
juges, et qu'il dise : Tubéron a dune obtenu ce qui met le comble
aux vœux d'un accusateur, etc; cette
134 manière de parler
n'est-elle pas infiniment plus plus froide et, pour ainsi dire, plus
détournée? Dans la première, l'orateur presse, insiste; dans la
seconde, il eût simplement indiqué la chose. Changez le même tour
dans Démosthène, il en sera de même. Et Salluste n'apostrophe-t-il
pas directement et tout d'abord Cicéron, dans un discours prononcé
contre lui : J'aurais peine à supporter vos invectives de
sang-froid, Marcus Tullius? De même que Cicéron lui-même l'avait
fait contre Catilina : Jusques à quand abuserez-vous de notre
patience ? Mais doit-on s'étonner de l'emploi de l'apostrophe,
lorsque nous voyons le même orateur, dans la défense de Scaurus, qui
était accusé de brigue (je parle du plaidoyer qui s'est trouvé parmi
ses écrits, car il l'a défendu deux fois) ; lorsque nous voyons,
dis-je, cet orateur employer la prosopopée, en introduisant
un personnage qui parle en faveur de son client; faire usage des
exemples, dans la défense de Rabirius Postumus, et dans celle du
même Scanrus, accusé de concussion? enfin commencer par la
division dans la cause de Clueutius, comme je l'ai déjà fait
remarquer tout à l'heure?
Cependant, parce que ces figures sont
quelquefois bien placées, ce n'est pas une raison pour les employer
à tort et à travers, mais c'en est une pour s'en servir, lorsque
l'exception confirme la règle. J'en dis autant de la similitude
pourvu qu'elle soit courte, de la métaphore et des autres tropes,
que ces rhéteurs circonspects et méticuleux ne permettent pas
davantage ; a moins que cette admirable ironie du plaidoyer de
Cicéron pour Ligarius, que j'ai citée un peu plus haut, n'ait le
malheur de déplaire à quelqu'un. Mais il y a devrais défauts, dont
on doit convenir avec eux. Tantôt l'exorde est banal, en ce
qu'il peut s'adapter à plusieurs causes (cependant , quoiqu'il
produise peu d'effet, on s'en sert quelquefois utilement, et de
grands orateurs n'ont pas toujours cherché à l'éviter) ; tantôt il
est commun, c'est-à-dire que l'adversaire peut également s'en
servir; tantôt il est commutable, parce que l'adversaire peut
le faire tourner à son avantage. Il y en a qui n'ont nulle liaison
avec la cause; d'autres, que l'on va chercher ailleurs que dans le
sujet, et qui sont comme transplantés; d'autres, qui sont trop
longs, ou qui pèchent contre les règles. Au surplus, la plupart de
ces défauts ne sont pas particuliers à l'exorde, et peuvent affecter
toutes les parties du discours.
Voilà ce que j'avais à dire sur
l'exorde, en tant, du moins, qu'il est nécessaire ; car il ne l'est
pas toujours. Si, par exemple, le juge est suffisamment préparé, ou
si la cause n'a pas besoin de préparation, l'exorde est alors
superflu. Aristote va même jusqu'à prétendre que l'exorde est
absolument inutile auprès des bons juges. Quelquefois aussi on n'en
peut faire usage lors même qu'on le voudrait, soit à cause des
occupations du juge, soit lorsqu'on est pressé par le temps, soit
enfin lorsqu'une puissance supérieure vous oblige d'entrer
immédiatement dans votre sujet. Quelquefois, au contraire, l'esprit
de l'exorde est transporté dans une autre partie ; et c'est dans la
narration ou dans la confirmation que nous prions les juges de nous
accorder leur attention et leur bienveillance, moyen que Prodicus
jugeait très-propre à les tirer de leur assoupissement. En voici un
exemple : Alors C. Varénus, celui qui fut tué par les esclaves d'Acharius
( ceci, juges, mérite toute votre attention}. Si la cause est
multiple, chaque chef aura son préambule, comme : Écoutez
maintenant 135
ce qui me reste à dire. Je pause à présent à un autre point. Je
pourrais citer aussi des exemples tirés de la confirmation; mais ils
sont si communs, qu'il est inutile de le faire. Il ne faut que lire
les plaidoyers de Cicéron pour Cluentius et pour Muréna; on verra
comment il s'excuse, toutes les fois qu'il est forcé de dire quelque
chose de désagréable à des personnes qu'il respecte, ou qu'il a
intérêt à ménager.
Au reste, quand on fera un exorde,
soit qu'on passe ensuite à la narration, soit qu'on en vienne
immédiatement aux preuves, il faut faire en sorte que la fin se lie
naturellement avec ce qui suit. Evitons toutefois cette froide et
puérile affectation des écoles, où l'on cherche à déguiser la
transition par quelque pensée brillante, qu'on applaudit comme un
tour de force, à peu près comme fait Ovide dans ses Métamorphoses
; avec celte différence pourtant, que le poète, qui voulait donner
l'apparence d'un tout à une foule de pièces diverses et
incohérentes, a la nécessité pour excuse. Mais à l'égard de
l'orateur, qu'est-il besoin qu'il dérobe sa marche aux juges et
qu'il agisse mystérieusement avec eux, puisqu'au contraire il doit
expressément les avertir de s'appliquer à bien observer l'ordre des
faits? En effet, le commencement de la narration sera perdu pour
eux, s'ils ne s'aperçoivent pas d'abord que l'exorde est fini.
Sachons donc garder un juste milieu entre une transition trop
brusque et une transition furtive. Cependant, si la narration doit
être longue et embarrassée, il sera bon d'y préparer le juge, comme
l'a souvent fait Cicéron, et particulièrement dans son plaidoyer
pour Cluentius : Je reprends l'affaire d'un peu haut, et je vous
prie, juges, de ne pas le trouver mauvais; car, lorsque vous
connaître s bien le principe, vous en comprendrez mieux les
conséquences. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu recueillir
sur l'exorde.
CHAP. II. Le juge ainsi préparé par
l'exorde, rien n'est plus naturel, et cela est ordinairement
indispensable, de lui exposer le fait sur lequel il a à prononcer.
C'est ce qu'on appelle la narration.
Je passerai en courant, et à dessein,
sur les divisions trop subtiles de quelques rhéteurs qui distinguent
plusieurs genres du narrations. Car, indépendamment de celle qui a
pour objet l'affaire en litige, ils en admettent quantité d'autres.
Une de personne : Marcus Acilius Palicanus, d'une
naissance obscure, habitant du Picenum, y rand parleur plutôt
qu'éloquent, etc.; une de lieu : Lampsaque est une
ville sur l'Hellespont, etc.; une de temps ; Au retour
du printemps, quand la neige commence à fondre sur la cime blanche
des montagnes ; une de cause : c'est celle dont les
historiens font un usage si fréquent, lorsqu'ils exposent l'origine
d'une guerre, d'une sédition, d'une peste. En outre, ils distinguent
la narration parfaite et la narration imparfaite; mais
qui ignore cette distinction ? Ils ajoutent qu'il y a une narration
qui regarde le passé, et c'est la plus ordinaire; une qui
regarde le présent; telle est celle où Cicéron peint le
mouvement que se donnent les amis de Chrysogonus, après l'avoir
entendu nommer ; enfin, une qui regarde l'avenir, et qu'il faut
laisser aux devins. Quant à l'hypotypose, elle ne doit pas
être considérée comme une narration. Mais occupons-nous de choses
plus intéressantes.
136
La plupart des rhéteurs pensent que la narration est toujours
nécessaire. Cette opinion est mal fondée, et je puis le prouver par
plusieurs raisons. D'abord, il y a des causes tellement simples, que
la proposition y tient lieu de narration; ce qui arrive quelquefois,
lorsqu'on n'a rien à exposer de part ni d'autre, ou qu'on est
d'accord sur le fait et que tout se réduit à une question de droit,
comme dans ces sortes de causes qui sont du ressort des centumvirs :
Est-ce au fils ou au frère à hériter d'une femme qui meurt sans
tester? La puberté doit-elle se juger d'après l'âge ou d'après les
signes extérieurs du corps ? Secondement, la narration, quoique
nécessaire en soi, devient superflue, lorsque le juge est d'avance
instruit de tout, ou lorsque les faits ont été exposés d'une manière
satisfaisante par celui qui a parlé en premier. Quelquefois même
celui qui parle en premier, surtout si c'est au nom du demandeur, se
dispense de faire une narration, soit parce que la proposition
suffit, soit parce que cela est plus expédient. Il suffit, par
exemple, de dire : Je réclame telle créance, aux termes de telle
stipulation; je réclame tel legs, en vertu de telle disposition
testamentaire ; et de laissera la partie adverse le soin
d'exposer pourquoi cette somme ou ce legs n'est pas dû. Quelquefois
encore il suffit à l'accusateur, et il est en même temps plus
expédient, d'articuler le fait en ces mots : Je dis qu'Horace a
tué sa sœur; car, par cette seule proposition, le juge connaît
toute l'accusation. Quant à la manière dont les faits se sont
passés, et aux motifs, c'est plutôt à l'adversaire qu'il appartient
d'en faire l'exposition. De son côté, l'accusé omettra la narration,
lorsqu'il ne pourra nier ni excuser ce qu'on lui impute ; et il se
retranchera dans la question de droit. Par exemple, un homme est
accusé de sacrilège pour avoir volé, dans un temple, l'argent d'un
particulier : en ce cas, un aven marquera plus de pudeur qu'un
récit, et on dira : Nous ne nions pas que l'argent n'ait été
dérobé dans un temple; mais il n'y avait pas lieu à une action en
sacrilège, attendu qu'il s'agit d'une chose privée, et non d'une
chose sacrée : or, vous avez à juger s'il a été commis un sacrilège.
Mais si je crois qu'il y a lieu quelquefois, comme dans les exemples
précédents, d'omettre la narration, je ne suis pas, pour cela, de
l'avis de ceux qui prétendent que la narration n'existe pas dans les
causes où l'accusé se borne à nier ce qu'on lui impute. C'est
l'opinion de Cornélius Celsus, qui range au nombre des causes de
cette nature la plupart de celles où il s'agit de meurtre, et toutes
celles où il s'agit de brigues ou de concussion. Il n'y a narration,
selon lui, que là où il y a exposition générale des faits
incriminés, sur lesquels le juge doit prononcer. Cependant il
reconnaît que Cicéron a fait une véritable narration dans la cause
de Rabirius Postumus, quoique Cicéron niât que Babirius eût touché
aucune somme d'argent, ce qui était le point fondamental de la cause
; et dans cette narration , il ne dit rien du fait incriminé. Pour
moi, et en cela je m'appuie sur de graves autorités, je crois que
les causes judiciaires sont susceptibles de deux espèces de
narrations : l'une intrinsèque; l'autre extrinsèque. Je n'ai pas
tué cet homme : évidemment, il n'y a pas là de narration ; mais
il y en aura une, et quelquefois assez longue, à passer en revue,
pour repousser les arguments de l'accusateur, la vie passée de
l'accusé, les circonstances dont le concours a pu compromettre son
innocence, ou celles qui rendent incroyable ce qu'on lui impute. Car
l'accusateur ne dit pas seulement :
137 Vous avez tué cet
homme, maïs il joint à cette accusation un récit qui tend à la
prouver. Ainsi, dans les poètes tragiques, lorsque Teucer accuse
Ulysse d'avoir tué Ajax : Je l'ai trouvé, dit-il, dans un
lieu écarté, près du corps inanimé de son ennemi, tenant à la main
un fer ensanglanté. De son côté, Ulysse ne se contente pas de
répondre qu'il n'a pas commis le crime; il proteste encore qu'il
n'existait aucune inimitié entre Ajax et lui, qu'ils étaient
seulement rivaux de gloire ; il expose enfin comment il est venu en
ce lieu, où il a vu Ajax gisant et sans vie, et a tiré le fer de sa
blessure ; et ce récit est accompagné de l'argumentation. Il y a
lieu même à narration, dans le cas où, accusé de vous être trouvé
dans le lieu où votre ennemi a été tué, vous vous bornez à nier le
fait; car vous avez à établir où vous étiez. Par la même raison, les
causes de brigues et de concussion sont susceptibles d'autant de
narrations de cette espèce qu'il y a de chefs d'accusation. La
défense sera, il est vrai, négative ; mais elle s'établira sur une
exposition contraire à celle de l'adversaire, pour combattre ses
arguments, tantôt un à un, tantôt en masse. Un homme est accusé de
brigue : pourquoi serait-il mal venu à exposer, dans une narration,
quelle est sa naissance, quelle a été sa vie, quels sont enfin les
services qui justifient son ambition? Il est accusé de concussion :
se nuira-t-il en exposant sa vie passée, et les motifs qui ont pu
soulever contre lui la province entière, ou l'accusateur, ou les
témoins? Si tout cela n'est pas de la narration , ce n'en sera point
une non plus que la première que fait Cicéron dans la défense de
Cluentius et qui commence par ces mots : A Cluentius Habitus ;
car il n'y parle que des causes qui lui ont attiré
l'inimitié de sa mère, sans dire un mot du poison.
Passons aux narrations extrinsèques.
Elles consistent tantôt à citer des exemples analogues à la cause :
ainsi, dans l'affaire de Verrès, Cicéron cite un trait de cruauté de
L. Domitius, qui fit mettre en croix un berger qui avouait avoir tué
avec un épieu un sanglier qu'il lui avait offert ; tantôt à discuter
une accusation étrangère à la cause, comme l'a fait le même orateur
dans son plaidoyer pour Rabirius Postumus : Dès qu'on fut arrivé
à Alexandrie, la roi proposa à Postumus, comme unique moyen de
conserver son argent, de s'en charger à titre d'économe, et pour
ainsi dire d'intendant royal; à rendre l'accusé plus odieux,
comme dans la description de la marche de Verrès. Quelquefois on
introduit une narration purement imaginaire, soit pour exciter
l'indignation des juges, comme l'a fait Cicéron au sujet de
Chrysogonus, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son plaidoyer pour
Roscius; soit pour les délasser par quelque plaisanterie, comme on
peut le voir dans le plaidoyer pour Cluentius, au sujet des frères
Cépasius ; soit par digression et comme ornement, à l'exemple de
Cicéron contre le même Verrès : C'est dans ces lieux qu'autrefois
Cérès chercha, dit-on, sa fille Proserpine. Tout cela prouve que
celui qui nie peut non seulement narrer, mais narrer même sur le
fait qu'il nie.
II ne faut pas prendre à la lettre ce
que j'ai avancé, que la narration est superflue, quand le juge a
connaissance du fait. Cela ne doit s'entendre ainsi qu'autant que le
juge a non-seulement connaissance du fait, mais qu'il l'envisage
sous le point de vue favorable à notre cause. Car le but de la
narration n'est pas tant d'instruire le
138 juge que de lui faire
partager notre manière de voir. Aussi, lors même que le juge aurait
connaissance du fait, s'il est néanmoins nécessaire de l'affecter
d'une certaine manière, nous ferons une narration, en ayant soin de
la justifier par quelques mots préalables : Nous savons qu'il
connaît les faits en général, mais nous le prions de ne pas
trouver mauvais que nous les lui fassions connaître en détail.
Tantôt nous prétexterons la présence d'un nouveau juge, pour revenir
sur notre récit; tantôt ce sera pour rendre tous les assistants
eux-mêmes juges de l'iniquité des allégations de la partie adverse;
et, dans ces cas, il faudra varier l'exposition de plusieurs
figures, pour épargner au juge l'ennui d'entendre le récit de choses
déjà connues : Vous vous souvenez : il est peut-être inutile de
s'arrêter sur ce point; mais pourquoi fatiguer plus longtemps votre
attention, puisque vous êtes parfaitement instruits de ce qui s'est
passé ? vous n'ignorez sans doute pas que.., et autres formules
semblables. Autrement, si la narration paraît toujours superflue,
quand le juge connaît déjà la cause, la plaidoirie même peut
quelquefois paraître inutile.
On agite souvent cette autre question
: la narration doit-elle toujours suivre l'exorde? l'opinion de ceux
qui sont pour l'affirmative ne semble pas dénuée de fondement ; car,
le but de l'exorde étant de rendre le juge bienveillant, attentif et
docile, et les preuves ne pouvant faire impression sur son esprit
qu'autant qu'il connaît les faits, il semble nécessaire de l'en
instruire immédiatement après l'exorde. Mais la nature des causes
veut quelquefois qu'on intervertisse cet ordre, à moins qu'on ne
blâme Cicéron de ce que, dans le beau plaidoyer qu'il a écrit pour
Milon et qu'il nous a laissé, il a traité préalablement trois
questions avant d'en venir à la narration, et qu'on ne pense qu'il
eût mieux fait d'exposer comment Clodius avait tendu des embûches à
Milon, sans s'embarrasser si un accusé, qui avoue qu'il a tué un
homme, ne peut être défendu; si Milon était déjà préjugé et condamné
par le sénat; si enfin Pompée avait cédé à l'esprit de parti en
investissant le tribunal de soldats armés, et se déclarait par là
contre Milon. On pourra dire, à la vérité, que ces questions
rentrent dans l'exorde, puisqu'elles tendent toutes à préparer le
juge. Mais dans son plaidoyer pour Varénus, Cicéron n'aborde la
narration qu'après avoir détruit les objections de l'adversaire.
Cette manière de procéder sera bonne, toutes les fois qu'il s'agira
non-seulement de repousser une accusation , mais de la faire
retomber sur la partie adverse; de sorte qu'après s'être d'abord
défendu, l'accusé se sert de la narration comme d'une transition
pour accuser à son tour. Ainsi, en fait d'escrime, on s'attache
d'abord plutôt à parer qu'à attaquer.
Il y a certaines causes, et ces causes
ne sont pas rares, qui sont faciles à défendre en ce qui touche
l'accusation dont le juge est saisi, mais sur lesquelles pèse
l'infamie d'une vie désordonnée. Or, il faut d'abord écarter ces
antécédents, pour disposer le juge à écouter favorablement la
défense du fait particulier sur lequel il doit prononcer. Ainsi,
qu'il s'agisse de défendre M. Célius; l'avocat ne fera-t-il pas
très-bien d'aller au devant des bruits injurieux qui le
représentaient comme un homme dissolu, effronté, impudique , avant
d'aborder ceux qui avaient trait à l'empoisonnement ? sur quoi roule
uniquement tout le plaidoyer de Cicéron. Puis il racontera ce
139 que son client a fait
de bien, et entrera dans le fond de la cause en ce qui concerne le
fait de violence, sur lequel Célius s'est défendu lui-même. Mais, nu
lieu de cela, nous suivons la coutume des écoles, où l'on détermine
certains points fixes, qu'on appelle thèmes, hors desquels il
n'y a rien à réfuter. C'est pour cela que la narration suit toujours
immédiatement l'exorde. De là la liberté que se donnent nos
déclamateurs de faire une narration, lors même qu'ils plaident en
second ordre. En effet, lorsqu'ils parlent pour le demandeur,
quoique en second ordre, ils font une narration, à cause de la
priorité naturelle du demandeur, et réfutent en même temps les
allégations de la partie adverse, comme parlant de fait après elle :
ce que je ne blâme pas ; car la déclamation étant une préparation
aux plaidoiriesdu barreau, pourquoi ne s'exercerait-on pas à plaider
à la fois en premier et en second ordre? Mais devenus avocats, et
jusqu'alors étrangers à la pratique du barreau en ce qui concerne
l'ordre des plaidoiries, ils suivent toujours leur manière, et
continuent de parler en déclamateurs. Il arrive même aussi
quelquefois, dans les exercices de l'école, que la proposition
suffit sans narration. On accuse un mari jaloux de mauvais
traitements en\ers sa femme; on dénonce un cynique aux censeurs :
qu'y a-t-il à narrer dans ces deux causes, puisque l'accusation est
suffisamment déterminée par un seul mot, dans quelque partie que ce
soit du plaidoyer? Mais en voilà assez; je passe à la manière de
narrer.
La narration est l'exposition
persuasive d'une chose faite ou prétendue faite ; ou, suivant la
définition d'Apollodore, un discours qui instruit l'auditeur de
l'objet de la contestation.
La plupart des rhéteurs, et
particulièrement c eux qui suivent la doctrine d'Isocrate, veulent
que la narration soit lucide, brève et
vraisemblable. Peu importe qu'au lieu de lucide je dise
claire, ou qu'au lieu de vraisemblable je me serve du
mot croyable, ou de quelque autre mot équivalent. J'approuve
cette division. Aristote cependant contredit Isocrate en un point :
il se moque du précepte de la brièveté, comme si la narration
devait être nécessairement longue ou courte, et qu'il n'y eût point
de milieu. Les Théodoriens ne reconnaissent que la dernière qualité,
se fondant sur ce que la brièveté et la clarté ne sont pas toujours
opportunes. Je crois donc nécessaire de bien distinguer les
différents genres de narration, pour faire voir ce qui convient à
chaque circonstance.
La narration est ou toute à notre
avantage, ou toute à l'avantage de notre adversaire; ou elle est en
partie favorable et en partie contraire à l'un et à l'autre. Si elle
est toute à notre avantage, nous nous contenterons des trois
qualités, qui tendent à mettre le juge en état de comprendre,
de retenir et de croire ce qu'on lui dit. Et qu'on ne
me blâme pas d'avancer que la narration, dans ce cas, quoique vraie,
doit être vraisemblable; car il y a beaucoup de choses vraies qui
sont peu croyables, et beaucoup de choses fausses qui ne laissent
pas d'être vraisemblables : aussi n'a-t-on pas moins de peine à
faire croire au juge le vrai que le faux. Ces trois qualités il est
vrai, sont de l'essence des autres parties ; car partout il faut
éviter l'obscurité, partout il faut garder une certaine mesure,
partout il faut que ce qu'on dit soit vraisemblable; mais c'est
surtout dans la partie qui a pour fin de mettre d'abord le juge au
courant de l'affaire, qu'il faut observer ces règles; car s'il
arrive qu'il ne comprenne pas, ou qu'il oublie, ou qu'il ne croie
140 pas ce que nous avons
dit, nous nous fatiguerons en pure perte dans le reste.
La narration sera intelligible et
lucide, si d'abord elle est faite en termes propres et
significatifs, qui n'aient rien de bas, mais qui pourtant ne soient
ni recherchés ni extraordinaires ; ensuite, si l'on distingue
nettement les choses, les personnes, les temps, les lieux, les
motifs, en joignant à tout cela une prononciation convenable, de
manière que le juge saisisse ce qu'on dit sans la moindre peine.
Mais c'est un mérite dont la plupart des orateurs sont peu jaloux.
Tout drapés, pour ainsi dire, dans l'attente des applaudissements
d'une multitude subornée, ou que le hasard a rassemblée autour
d'eux, ils ne peuvent souffrir ce silence judicieux d'un auditoire
attentif, et ne se croient éloquents qu'autant qu'ils sont assourdis
par le tumulte et les vociférations. Raconter simplement la chose,
cela est bon dans la conversation, c'est le fait du premier venu
d'entre les ignorants. Toutefois, ce qu'ils méprisent comme trop
facile, on ne saurait dire s'ils ne le font pas, faute de le vouloir
ou de le pouvoir. Car, de l'avis de ceux qui ont de l'expérience,
rien n'est plus difficile que de dire ce qu'après nous avoir
entendus chacun croit qu'il eût dit aussi bien que nous, par la
raison que ce dont l'auditeur juge ainsi ne lui parait pas beau,
mais seulement vrai. Or, l'orateur ne parle jamais mieux que
lorsqu'il parait dire vrai. Mais aujourd'hui la narration est une
espèce de carrière, où les orateurs se plaisent à donner mille
inflexions à leur voix, à rejeter leur tête en arrière à se frapper
les flancs, et à se jouer dans tous les genres de pensées, de mots
et de composition. Puis, il résulte de là quelque chose de
monstrueux : la plaidoirie plaît, et la cause n'est point comprise.
Mais je passe, de peur de m'attirer moins de faveur en prescrivant
le bien, que d'animadversion en reprenant le mal.
La narration sera courte, d'abord, si
elle part de ce qu'il importe de faire connaître au juge; ensuite ,
si nous ne disons rien d'étranger à la cause ; enfin , si nous
retranchons tout ce qu'on peut retrancher sans rien ôter de ce qui
est utile, soit pour la connaissance des faits, soit pour le bien de
la cause; car il y a souvent une certaine brièveté partielle, qui ne
laisse de faire un tout fort long : J'arrivai sur le port,
j'aperçus un navire, je demandai le prix du passage, je, fis marché,
je montai, on leva l'ancre, on mit à la voile, nous partîmes. On
ne saurait exprimer chaque circonstance plus brièvement ; cependant
il suffit de dire : je m'embarquai; et, toutes les fois que ce qui a
suivi indique suffisamment ce qui a précédé , nous devons nous
contenter de ce qui fait entendre le reste. Ainsi, quand je peux
dire : J'ai un fils jeune, je n'ai pas besoin d'entrer dans
ces circonlocutions : Désirant avoir des enfants, je me suis
marié; il m'est né un fils; je l'ai élevé, il est parvenu à
l'adolescence , etc. C'est pour cela que quelques rhéteurs grecs
distinguent entre une narration précise, σύντομον,
et une narration brève , en ce que la première n'a rien de superflu
, et que la seconde peut n'avoir pas tout ce qui est nécessaire.
Pour moi, je fuis consister la brièveté, non à dire moins, mais à ne
pas dire plus qu'il ne faut; car pour ce qui est des répétitions
oiseuses de mots et des pléonasmes (ταυτολογίας,
περισσολογίας) , que cer-
141 tains auteurs de Rhétoriques recommandent
d'éviter dans la narration, je ne m'y arrêterai pas : ce sont des
défauts en eux-mêmes, et qu'il faut éviter, indépendamment de ce
qu'ils pèchent contre la brièveté.
On ne doit pas moins se tenir en garde
contre l'obscurité qui suit ceux qui veulent tout abréger; car
encore vaut-il mieux dire trop que de ne pas dire assez : le
superflu ennuie, mais on ne retranche pas sans danger le nécessaire.
Aussi faut-il éviter même cette brièveté et cette concision que nous
admirons dans Salluste. Ce qu'un lecteur a le loisir de peser avec
attention, échappe à l'auditeur, et n'attend pas qu'on le répète,
outre qu'un lecteur est ordinairement un homme éclairé, tandis que
le juge des décuries est la plupart du temps un homme qui a quitté
son champ pour venir prononcer sur ce qu'il aura compris. Partout,
je crois, mais particulièrement dans la narration, il est nécessaire
de tenir un juste milieu, et de dire tout ce qu'il faut, et rien
que ce qu'il faut. Je n'entends pas par là qu'on ne doive dire
que ce qu'il faut pour indiquer le fait : la brièveté n'exclut pas
l'ornement ; autrement, il n'y aurait plus d'art. Or le plaisir
donne le change, et ce qui plaît semble toujours court, de même
qu'un chemin agréable et doux, quoique plus long, fatigue moins
qu'un autre plus court, mais rude et triste. Le soin de la brièveté
ne me paraît pas non plus incompatible avec ce qui peut contribuer a
rendre l'exposition vraisemblable. Car une exposition, réduite au
strict nécessaire, ne serait pas tant une narration qu'une
confession. Il est, d'ailleurs, des narrations qui, par la
nature de la cause, sont nécessairement longues, et auxquelles il
faut préparer l'attention du juge dans la dernière partie de
l'exorde, ainsi que je l'ai recommandé. Ce que l'on doit faire
ensuite, c'est d'obvier, par tous les moyens possibles, à la
longueur, on à l'ennui. On obvie à la longueur, en ajournant ce que
l'on pourra, mais toutefois en faisant mention de ce que l'on
ajourne : Quelles ont été ses raisons pour commettre ce meurtre,
quels furent ses complices, comment s'y prit-il pour disposer ses
embûches, c'est ce que je dirai dans la confirmation.
Quelquefois on distrait de la suite du récit certains faits qu'on
laisse de côté, comme Cicéron dans son plaidoyer pour Cécina :
Fulcinius meurt ; car je passerai sous silence plusieurs
circonstances qui ont accompagné cette mort, mais qui sont
étrangères à la cause. On remédie à l'ennui, en divisant son
récit : Je dirai ce qui s'est passé avant le commencement de la
chose, ce qui s'est passé pendant qu'elle a eu lieu, ce qui s'est
passé après. De cette façon on aura l'air de faire plutôt trois
petites narrations qu'une seule longue. Quelquefois il sera bon
d'entrecouper le récit par quelque mot d'avertissement : Vous
avez entendu ce qui s'est passé avant; écoutez maintenant ce qui
s'est passé après. La fin d'un premier récit, en reposant le
juge, le prépare à en écouter un nouveau. Si cependant , malgré tous
ces artifices, le développement des faits nous mène un peu loin, il
ne sera pas inutile de finir chaque partie par une sorte de
récapitulation. C'est ce que fait Cicéron, même dans une narration
de peu d'étendue : Jusqu'ici, César, Ligarius est à l'abri de
tout reproche ; il est parti de chez lui, non-seulement sans qu'il y
eût de guerre, mais même sans qu'il y en eût la moindre apparence.
La narration sera vraisemblable,
d'abord, si 142 l'on
s'interroge soi-même, pour ne rien dire qui ne soit naturel;
ensuite, si l'on donne aux faits des causes et des motifs, non pas à
tous, mais à ceux qui font question; si l'on accorde le caractère
des personnes avec les choses que l'on veut faire croire, en
présentant, par exemple, celui qu'on accuse de larcin, comme un
homme cupide; d'adultère, comme un débauché; d'homicide, comme un
homme emporté ; et réciproquement, si l'on est chargé de la défense.
Enfin, que tout cela concorde avec les lieux, les temps et autres
circonstances semblables.
La conduite du récit contribue encore
à donner de la vraisemblance aux faits, comme dans les comédies et
dans les mimes. En effet, certaines choses se suivent et
s'enchaînent si naturellement, que, la première bien racontée, le
juge devine celle qui suivra. Il sera bon même de jeter cà et là
quelques germes de preuves, sans toutefois perdre de vue qu'on en
est à narrer, et non à prouver. On pourra quelquefois confirmer ce
qu'on aura avancé, pourvu que l'argument soit simple et court. Par
exemple, s'il s'agit de poison, on dira : Il était en parfaite
santé, il boit, tout à coup il tombe, son corps enfle et devient
livide. C'est encore une sorte de préparation qui produit le
même effet, de représenter, d'un côté, l'accusé plein de force,
armé, préoccupé, et, de l'autre, des êtres faibles, sans armes, sans
défiance. Enfin tout ce qu'on approfondira dans la confirmation,
le caractère de la personne, la nature de la cause, le lieu, le
temps, les moyens, la conjoncture , on peut effleurer tout cela
dans la narration. Si ces considérations manquent, on avouera que
le crime est à peine croyable, mais qu'il n'en est pas moins vrai,
et par cela même plus atroce , qu'on ne sait ni comment ni pourquoi
il a été commis ; qu'on s'en étonne, mais que néanmoins on le
prouvera. Mais, de toutes les préparations, la meilleure est
celle dont le dessein est caché. Ainsi, quoique Cicéron donne un ton
infiniment avantageux à tout ce qu'il dit, dans la narration, pour
insinuer que Clodius était l'agresseur, et non pas Milon , rien ne
me paraît plus adroit que l'air de simplicité qui respire dans ces
paroles : Milon, étant resté ce jour-là au sénat jusqu'à lafn de
la séance, revint chez lui, changea de chaussure et de vêtements, et
y resta quelques instants, en attendant que sa femme fût prête.
Que Milon paraît tranquille, étranger à toute idée de préméditation
! C'est l'impression que produisent non-seulement les faits que
raconte cet admirable orateur pour peindre la lenteur du départ de
Milon, mais encore les mots vulgaires et familiers dont il se sert,
et où l'art est si bien caché. S'il eût parlé autrement, le seul
bruit des mots eût éveillé l'attention du juge, et l'eût mis en
garde contre lui. Ce passage paraît froid à la plupart des lecteurs
; mais cela môme prouve que, si on y est trompé en le lisant, à plus
forte raison les juges ont dû s'y laisser prendre en l'écoutant.
Voilà donc comment on rend un récit vraisemblable. Car pour ce qui
est de ne rien dire de contradictoire et d'inconséquent dans la
narration, celui qui aurait besoin d'une pareille recommandation
peut se dispenser d'étudier le reste. Cependant certains rhéteurs
s'applaudissent de ce précepte, comme d'une découverte merveilleuse.
A ces trois qualités de la narration,
quelques-uns ajoutent la magnificence (μαγελοπρέπειαν)
; mais outre que toutes les causes n'en sont pas susceptibles, (à
quoi bon, en effet, un récit pom-
143 peux dans ces
affaires civiles, qui sont du ressort du
préteur, et où il ne s'agit que de créances, de loyers et de
salaires?) elle n'est pas toujours utile, comme il est aisé de le
voir par l'exemple que j'ai tiré de la Milonienne. Souvenons-nous
d'ailleurs que, dans beaucoup de causes, on est forcé
d'avouer les
faits qu'on expose, d'en excuser l'intention,
d'en rabaisser l'importance : toutes choses qui excluent la
magnificence. Cette qualité n'est donc pas plus particulière à la
narration que tant d'autres qualités de même nature, comme de parler
de manière à exciter la pitié ou la haine, avec gravité, avec
douceur, avec urbanité. Tout cela est bien à sa place, sans être
proprement affecté et comme dévoué à la narration. J'en dis autant
d'une autre qualité qu'indépendamment de la magnificence
Théodecte assigne en propre à cette partie de plaidoyer, mais qui ne
lui appartient ni plus ni moins qu'à toute autre : je veux dire l'agrément.
Quelques-uns ajoutent l'évidence, ἐνάργεια.
Je ne dissimulerai pas que Cicéron va encore plus loin ; car, outre
la clarté, la brièveté et la vraisemblance, il
exige l'évidence, la convenance, et la dignité.
Mais, dans toutes les parties du discours, on doit toujours observer
la convenance, et mettre, partout où on le peut, de la dignité.
Quant à l'évidence, elle est, sans doute, une qualité fort
importante, lorsqu'il s'agit de rendre sensible un fait qui
d'ailleurs est avéré; mais n'est-elle pas comprise dans la clarté
? Encore se rencontre-t-il des rhéteurs qui rejettent la clarté
comme une qualité quelquefois nuisible, parce que dans certaines
causes, disent-ils, il est nécessaire d'obscurcir la vérité :
précepte ridicule; car celui qui veut obscurcir la vérité met le
faux à la place du vrai, et n'en doit par conséquent que plus
travailler à rendre évident ce qu'il raconte.
Mais puisque le hasard, outre mon
dessein particulier, m'a fait tomber sur le genre de narration le
plus difficile, c'est-à-dire celui où le fait est contre nous, Je
m'y arrêterai. Quelques rhéteurs estiment que dans ce cas il faut
omettre la narration. En vérité, rien n'est plus facile, si ce n'est
de ne pas plaider du tout. Si cependant quelque juste raison vous
oblige à vous charger d'une cause de cette espèce, quel art y
aura-t-il à confesser, par votre silence, qu'elle est mauvaise? à
moins que vous n'ayez affaire à un juge assez inepte pour vous
donner raison sur un fait dont il saura que vous n'avez pas voulu
lui donner connaissance. Je ne disconviens pas que, dans la
narration, comme il est des choses qu'il est utile de nier, ou
d'ajouter, ou de changer, il en est aussi qu'il est utile de taire;
mais on ne doit les taire qu'autant que cela est nécessaire, et
qu'on est libre de les dire ou de ne pas les dire : ce que l'on fait
quelquefois aussi pour éviter d'être long, en disant, par exemple :
Il répondit ce qu'il crut devoir répondre. Distinguons donc
les genres de causes. En effet, dans celles où il n'est question que
de la forme, quoique le fond soit contre nous, nous pouvons tout
avouer : Oui, il a volé dans un temple, mais c'était l'argent
d'un particulier : donc il n'est pas sacrilège. — Oui, il a
enlevé une jeune fille ; mais il ne s'ensuit pas que le père ait la
liberté d'opter. — Oui, ce jeune homme a été déshonoré, et,
pour ne pas, survivre à sa honte, il s'est pendu; mais le corrupteur
ne doit point pour cela subir la peine capitale, comme auteur de
cette mort; il payera seulement les dix mille
144 sesterces,
amende imposée aux corrupteurs. On peut même, en avouant le
crime, atténuer l'odieux que l'exposition de la partie adverse a
jeté sur le fait. Nos esclaves eux-mêmes ne savent-ils pas pallier
leurs fautes? Tantôt nous affaiblirons la gravité de l'action, sans
avoir l'air de narrer : II n'est point venu dam le temple, comme
le prétend notre adversaire, dans l'intention d'y dérober, et n'y a
pas épié le moment favorable : c'est l'occasion, c'est l'absence de
tout gardien, qui l'a tenté; c'est la vue de l'or, si puissante sur
le cœur des hommes, qui fa vaincu. Mais qu'importe? il a commis une
faute, il a volé : à quoi sert d'excuser une action dont nous ne
refusons pas de subir la peine? Tantôt, comme si nous étions les
premiers à condamner notre client , nous lui adressons la parole:
Que voulez-vous que je dise? que vous avez été poussé par le vin,
que c'est une méprise , favorisée par les ténèbres : tout cela est
vrai peut-être ; mais enfin vous avez déshonoré ce jeune homme,
payes les dix mille sesterces. Quelquefois on peut prémunir la
narration au moyen d'une proposition dont on la fait précéder, comme
dans cette cause si mauvaise au premier aspect. Trois fils avaient
conjuré la mort de leur père. Après avoir tiré au sort, ils entrent
la nuit, l'un après l'autre, un fer à la main, dans son appartement,
pendant qu'il dormait : aucun d'eux n'ose le frapper. Le père se
réveille, ils lui déclarent tout. Si néanmoins le père, qui leur a
partagé sa succession, veut les défendre contre l'accusation de
parricide, il pourra plaider ainsi : On accuse de parricide des
enfants dont le père est plein de vie et se présente lui-même pour
les défendre ; cela suffit pour écarter l'application de la loi.
Il est donc entièrement superflu, de vous raconter comment la chose
s'eut passée, puisque la loi n'a rien à y voir; mais si vous exigez
que je vous fasse l'aveu de ma faute, je vous dirai que je me suis
conduit avec trop de dureté pour un père, et que j'ai retenu trop
longtemps un bien que mes fils auraient mieux administré que moi.
Il ajoutera qu'ils ont été entraînés par des jeunes gens dont les
pères étaient plus indulgents ; qu'ils n'étaient pus capables, ainsi
que l'événement l'a démontré, de commettre une action si dénaturée.
En effet, pourquoi cette précaution de s'y obliger par serment,
s'ils n'y avaient point senti une extrême répugnance ? pourquoi
tirer au sort, sinon parce que chacun d'eux refusait de se charger
d'un tel crime ? Ces raisons bonnes ou mauvaises pourront passer
à la faveur du préambule, qui aura déjà préparé les esprits. Mais
dans les causes où l'on examine si le fait est, ou quel il
est, lors même que tout nous serait contraire, je ne vois pas
comment on peut omettre la narration, sans que la cause en souffre.
En effet, l'accusateur a narré, et il ne s'est pas contenté
d'exposer comment les choses s'étaient passées; il a tout envenimé,
tout exagéré; puis sont venues les preuves, et enfin la péroraison,
qui a enflammé les juges et les a laissés pleins d'indignation. Il
est naturel qu'ils veuillent nous entendre à notre tour; ils
attendent que nous les instruisions. Si nous ne le faisons pas, il
faut bien qu'ils s'en tiennent à ce qu'on leur a dit. Quoi donc !
raconterons-nous les mêmes choses? si le fait est constant et qu'il
ne s'agisse plus que de le qualifier, il faudra raconter les mêmes
choses, mais non de la même manière. On donnera d'autres motifs, on
les présentera sous un autre point de vue ; on atténuera, on
adoucira : 145 la
débauche passera pour gaieté, l'avarice pour économie, la négligence
pour simplicité. On composera son visage, sa voix, son attitude ;
pour gagner leur bienveillance on excitera leur compassion. Un
humble aveu peut quelquefois tirer des larmes. Je demanderais
volontiers à ceux qui sont d'une opinion contraire, s'ils prétendent
défendre, ou non, ce qu'ils ne veulent point narrer. Car s'ils ne
veulent ni défendre ni narrer, ils renoncent à la cause entière;
mais s'ils ont dessein de défendre, il me semble que la plupart du
temps ils doivent exposer ce qu'ils se proposent de prouver.
Pourquoi donc n'exposeraient-ils pas aussi ce qu'ils se proposent de
réfuter, et ce qui évidemment ne peut l'être, si on ne l'indique ?
quelle différence y a-t-il entre la confirmation et la narration, si
ce n'est que la narration est d'un bout à l'autre une préparation de
la confirmation, et qu'à son tour la confirmation ne fait que
vérifier la narration? Voyons donc seulement si cette exposition ne
doit pas être un peu plus longue, un peu plus diffuse, a cause de la
préparation et des arguments qu'il est bon quelquefois d'y mêler :
je dis arguments, et non argumentation. Cette exposition gagnera
beaucoup à être soutenue de temps en temps d'un ton affirmatif :
nous dirons, par exemple, que nous prouverons plus lard ce que
nous avançons; que, dans une première exposition, il n'est pas
possible de satisfaire à tout; qu'ils daignent attendre, suspendre
leur jugement, et qu'ils seront contents. Enfin il faut narrer
tout ce qui peut être exposé autrement que l'adversaire ne l'a fait
; ou bien, et par la même raison, il faut aussi retrancher l'exorde
dans ces sortes de causes, puisqu'il ne sert, à proprement parler,
qu'à préparer le juge à la connaissance du fait. Or, on convient que
l'exorde n'est jamais si nécessaire que lorsqu'il s'agit de faire
revenir le juge d'un préjugé qu'il a pu prendre contre nous.
A l'égard des causes conjecturales,
c'est-à-dire de celles où le fait est douteux, la narration ne roule
pas tant sur le point contesté que sur les circonstances qui servent
à l'éclaircir. Comme, d'un côté, l'accusateur présente les faits
sous un Jour défavorable, et que, de l'autre, l'accusé doit les
rétablir à son avantage, il s'ensuit que les deux narrations doivent
être différemment traitées. Mais, dira-t-on, il y a certains
arguments qui n'ont de force qu'autant qu'ils sont groupés, et qui,
disséminés, n'ont aucune valeur. Je réponds que cela regarde la
manière de narrer, non la - question de savoir s'il faut narrer. Qui
empêche, en effet, d'accumuler les arguments dans la narration , si
cela est utile à la cause, et même d'en promettre d'autres encore?
qui empêche de diviser la narration en plusieurs parties, de joindre
les preuves à chacune d'elles , et de passer ainsi d'une partie à
une autre ? Car je ne. suis pas de l'avis de ceux qui prétendent que
les faits doivent toujours être racontés dans l'ordre où ils se sont
passés; mais je pense qu'il faut adopter l'ordre, qui convient le
mieux au sujet qu'on traite, en recourant pour cela à plusieurs
figures. Tantôt nous feindrons qu'une chose nous a échappé, pour
avoir lieu de la dire plus à propos, en paraissant réparer une
omission ; tantôt nous interromprons notre récit, en assurant que
nous en reprendrons le cours, et que la cause en acquerra plus de
lucidité ; tantôt, après avoir exposé le fait, nous en examinerons
les motifs et les antécédents ; car la défense n'est pas assujettie
à une loi unique, à une règle invariable; il faut consulter la
nature de l'affaire et les circonstances où l'on se trouve. Il en
est comme d'une blessure, qu'il faut guérir sur-le-champ, ou sur
laquelle 146 on
met un appareil, si la cure peut se différer. Je ne fais pas non
plus un crime de narrer plusieurs fois, comme l'a fait Cicéron dans
son plaidoyer pour Cluentius. Non-seulement je le crois permis, mais
quelquefois même nécessaire, dans les causes de concussion, par
exemple, et dans toutes celles qui sont complexes. Car ce serait une
folie que de procéder contrairement à la nature de la cause par un
respect trop superstitieux pour les règles. En effet, pourquoi la
narration est-elle placée devant la preuve? n'est-ce pas pour que le
juge sache de quoi il est question ? Pourquoi donc, si chaque point
a besoin d'être prouvé ou réfuté l'un après l'autre, ne ferait-on
pas autant de narration spartielles? Pour moi, du moins, si mon
expérience peut être comptée pour quelque chose, je sais que j'en
usais ainsi au barreau toutes les fois que j'y voyais de l'utilité,
et qu'en cela j'avais l'approbation des personnes éclairées et des
juges. Je puis même dire sans vanité, comme sans crainte d'être
démenti par ceux avec lesquels je plaidais de concert, que c'était
ordinairement à moi qu'était confiée la narration. Je crois
néanmoins que la plupart du temps le mieux est de suivre l'ordre des
faits. Il serait quelquefois môme ridicule de le changer, comme si
l'on disait, par exemple, qu'une femme a enfanté, puis, qu'elle a
conçu ; qu'un testament a été ouvert, puis, qu'il a été signé. En ce
cas, si l'on dit en premier ce qui devait l'être en dernier, le
mieux est de ne pas retourner sur ses pas.
Il y a aussi des narrations qui sont
fausses : ou en reconnaît de deux sortes au barreau. Les unes
s'appuient sur les moyens, qu'on appelle extrinsèques : ainsi
Clodius soutenait, à l'aide de témoins subornés, qu'il se trouvait à
Intéramne la nuit même où, suivant l'accusation, il avait commis un
inceste à Home. Les autres ne se soutiennent que par l'esprit de
l'orateur, et s'emploient , tantôt pour épargner seulement à la
pudeur l'embarras d'une exposition trop nue, d'où sans doute est
venu le nom de couleur, tantôt pour donner un tour favorable à la
cause. Mais, que l'on ait recours à l'un ou à l'autre de ces deux
genres de narrations, il faut avoir soin d'abord que ce que l'on
invente soit possible; ensuite, que cela ne répugne ni a la
personne, ni au lieu, ni au temps ; que la manière dont on prétend
que les choses se sont passées, et l'ordre dans lequel on les
présente, n'aient rien d'invraisemblable ; qu'on rattache, si on le
peut, ce que l'on feint à quelque chose de vrai ; car, lorsque tout
est pris eu dehors de la cause, le mensonge se trahit de lui-même.
Il faut surtout éviter deux écueils, contre lesquels on échoue
souvent, quand on invente : premièrement, de se contredire; car il
est des choses qui se concilient avec certaines parties, mais qui ne
cadrent pas avec le tout : secondement, d'en alléguer de contraires
à ce qui est avéré. Dans les écoles mêmes, il ne faut pas chercher
la couleur hors du sujet. Mais, soit dans les déclamations, soit au
barreau, l'orateur ne doit pas un instant perdre de vue ce qu'il a
controuvé ; car rien n'échappe si aisément que le faux : et le
proverbe est vrai, qui dit qu'un menteur doit avoir bonne mémoire.
Sachons aussi que, lorsqu'il s'agit d'un fait qui nous est propre,
il faut s'appliquer à faire converger l'exposition vers une
conclusion unique ; tandis que, s'il s'agit du fait d'autrui, on
peut donner prise à plusieurs interprétations, pour éveiller la
défiance. Cependant, dans certaines déclamations des écoles, où il
n'est pas d'usage de répondre aux questions sur lesquelles on est
interrogé, on a la liberté de 147
faire l'énumération de tout ce qui aurait pu être répondu.
Souvenons-nous surtout de ne rien feindre qui puisse être réfuté par
un témoin. Mais que nos fictions n'aient pas à redouter d'autre
témoignage que le nôtre ou celui des morts, qui ne reviennent pas ;
ou celui de personnes qui ont le même intérêt que nous, et par
conséquent ne nous démentiront pas ; ou enfin celui de l'adversaire
lui-même, dont les dénégations ne seront pas crues. A l'égard des
moyens qu'on peut tirer des songes et autres superstitions
semblables, ils ont perdu toute créance, à cause de la facilité
qu'on a d'y recourir. Au reste, il ne suffit pas d'user, dans la
narration, de certaines couleurs; il faut encore que ces couleurs se
soutiennent dans toutes les parties du plaidoyer. Cet avis est
d'autant plus important qu'on ne persuade certaines choses qu'à
force d'affirmation et de persévérance. Un parasite, par exemple,
voyant un jeune homme qui, trois fois renoncé par un riche
personnage , avait été trois fois réintégré dans la maison de ce
riche, s'avise de le réclamer comme son fils. Pour colorer sa
demande, il allègue que sa pauvreté l'avait forcé à l'exposer; que,
plus tard , il a joué le rôle de parasite pour avoir entrée dans la
maison où était son fils; et qu'ainsi ce jeune homme, quoique
innocent, a été trois fois renoncé avec raison, parce qu'en effet il
n'était pas le fils du renonçant. Tout cela sans doute est spécieux;
mais si, d'un bout à l'autre de la plaidoirie, il n'exprime l'amour
paternel le plus tendre, et ne retrace, avec les couleurs les plus
vives, la haine du riche pour le jeune homme, et le danger manifeste
auquel celui-ci est exposé dans une maison étrangère, il ne pourra
échapper au soupçon de subornation.
Il arrive quelquefois, dans les
controverses des écoles, ce que je doute qu'on puisse voir au
barreau, que les deux parties ont recours au même stratagème, mais
en tirent différemment parti. Une femme déclare à non mari que
son beau-fils a voulu In séduire, et qu'il lui a donné rendez-vous à
telle heure, en tel lieu. Le fils en dit autant de sa belle-mère, en
indiquant seulement une heure et un lieu différent. Le mari trouve
son fils à l'endroit qu'avait désigné sa femme; il trouve aussi sa
femme à l'endroit désigné par son fils. Il la répudie; et, comme
elle souffre celte répudiation sans rien dire, il déshérite son fils.
On ne peut rien alléguer en faveur du fils, qu'on ne puisse
également alléguer en faveur de la belle-mère. Cependant on exposera
d'abord ce qui est commun aux deux parties ; mais ensuite on tirera
des arguments particuliers de la comparaison de la belle-mère et du
fils, de l'ordre qu'ils ont gardé en s'entr'accusant, et du silence
de la femme répudiée. Il ne faut pas ignorer non plus qu'il y a
certaines choses qu'on ne peut pas colorer, et qu'il faut seulement
défendre. Telle est l'action de ce riche qui fit flageller la statue
d'un pauvre, son ennemi, et qui est accusé pour fait d'outrages. Il
est impossible de pallier l'intention d'un pareil acte, mais on peut
le soustraire à la peine.
Venons maintenant à la troisième sorte
de narration, celle qui est en partie pour nous et en partie contre.
Faut-il confondre ces deux parties ou les séparer? C'est la nature
de la cause qu'il faut consulter à cet égard. Si ce qui nous est
contraire l'emporte, ce qui nous est favorable en sera comme
accablé. Dans ce cas, le mieux sera donc de diviser, et, après avoir
exposé et confirmé ce qui est à l'avantage de notre partie, d'user
pour le reste de ces remèdes dont j'ai parlé. Si c'est, au
contraire, la partie favorable qui l'emporte, ou pourra confondre
les deux 148 parties,
afin que les choses qui nous sont défavorables , placées au centre,
comme nos troupes auxiliaires, en soient moins à craindre. Cependant
ni les unes ni les autres ne devront être exposées toutes nues; mais
nous confirmerons en même temps par quelques raisonnements celles
qui sont à notre avantage, et nous joindrons au récit de celles qui
nous sont contraires les raisons qui peuvent les rendre
invraisemblables. Car, sans cette distinction, il serait à craindre
que le bien ne fût gâté par le mélange du mal.
Les rhéteurs veulent aussi que, dans
les narrations, on ne se permette ni digression ni
apostrophe, ni prosopopée, ni argumentation.
Quelques-uns retranchent encore les passions. Ces préceptes
doivent être ordinairement observés pour la plupart, et même on ne
doit jamais s'en écarter, à moins qu'on n'y soit forcé par la nature
de la cause. Ainsi, pour que la narration soit claire et brève, rien
ne sera plus rarement motivé que la digression ; et encore ne
devra-telle être employée qu'autant qu'elle sera courte, et telle
que nous paraissions avoir été jetés hors du droit chemin par la
force de la passion, comme Cicéron, par exemple, en parlant des
noces de Sassia : O crime incroyable dans une femme, et dont elle
seule a pu nous offrir l'exemple! ô libertinage effréné et
indomptable! ô inconcevable audace! n'avoir été arrêtée ni par la
crainte des dieux, ni par le jugement des hommes! que dis-je ? avoir
affronté cette nuit même ces torches nuptiales, le seuil de cette
chambre, le lit de sa propre fille, ces murs témoins d'un autre
mariage! Quant à l'apostrophe, elle est quelquefois fort
propre à exprimer une chose d'une manière plus courte et plus
convaincante, et j'en pense ici ce que j'ai dit au sujet de
l'exorde. J'en dis autant de la prosopopée , employée
non-seulement par Servius Sulpicius dans la cause d'Aufidla :
Dois-je croire que vous dormez ou que vous êtes tombé en léthargie
? mais par Cicéron lui-même dans un de ses plaidoyers contre
Verrès, au sujet des capitaines de vaisseaux. Car c'est dans la
narration que se trouve cet entretien d'un licteur avec la mère d'un
détenu : Si vous voulez voir votre fils, vous donnerez tant,
etc. Et dans son plaidoyer pour Cluentius , le colloque entre
Stalénus et Balbus ne contribue-t-il pas à rendre le récit plus
rapide et plus vraisemblable? Or, pour qu'on ne croie pas qu'il a
fait cela sans dessein, ce qu'on ne saurait présumer d'un pareil
orateur, il recommande, dans ses Partitions, de donner de
la douceur à la narration, d'y ménager la surprise, l'attente, les
effets imprévus, d'y introduira des dialogues, enfin toutes les
passions. Pour l'argumentation, nous ne l'emploierons
jamais, comme je l'ai dit, dans la narration. Nous poserons bien
quelquefois un argument, comme le fait Cicéron dans son plaidoyer
pour Ligarius, lorsqu'il dit que son client avait administré sa
province de telle sorte que la paix ne pouvait que lui être
avantageuse. On pourra aussi, dans l'exposition , si la cause le
demande, défendre les faits et en rendre raison en peu de mots ; car
un avocat ne doit pas narrer comme un témoin. Q. Ligarius ,
député en Afrique, partit avec C. Considius : voilà simplement
le fait. Comment Cicéron le présente-t-il? Ligarius, dit-il ,
lorsque la guerre n'était pas même l'objet d'un soupçon, ayant
été député en Afrique, partit avec C. Considius. Et ailleurs :
Non 149
seulement il n'y avait pas de guerre, mais on ne la soupçonnait même
pas. On aurait pu se contenter de dire : Ligarius ne voulut
jamais entrer dans aucune intrigue; Cicéron ajoute : Songeant
à ses foyers, et impatient de revoir sa famille. Ainsi, tout en
exposant les faits, il en rendait raison et leur donnait par là de
la vraisemblance et même, en touchant aux passions, il satisfit à
toutes les conditions d'une bonne narration. Je m'étonne donc de
voir certains rhéteurs blâmer l'emploi des passions dans la
narration. S'ils entendent par là qu'il faut en user sobrement et ne
point s'y abandonner comme dans l'épilogue, je suis de leur avis,
car il faut éviter les longueurs. Du reste, je ne vois pas pourquoi,
tout en instruisant le juge, je ne songerais pas à l'émouvoir ; ni
pourquoi je n'essayerais pas d'obtenir, si cela est possible, dès le
commencement, ce que je dois lui demander à la fin : d'autant que je
le trouverai plus facile et plus maniable, quand j'en viendrai aux
preuves, si j'ai par avance éveillé son indignation ou sa pitié.
Cicéron ne remue-t-il pas toutes les passions sans cesser d'être
bref, lorsqu'il parle de ce citoyen romain que Verrès avait fait
battre de verges, lorsqu'il représente la condition de la victime,
le lieu du supplice, la nature de l'outrage, et surtout la grandeur
d'âme de cet homme généreux, qui, sous le fouet, n'a recours ni aux
gémissements ni aux prières, et ne fait entendre que cette
exclamation : Je suis citoyen romain! par laquelle, en protestant de
son droit, il rend Verres encore plus odieux? N'empreint-il pas
l'exposition entière de l'horreur qu'inspiré le sort cruel de
Philodamus? ne remplit-il pas de larmes la scène du supplice,
lorsqu'il fait voir, plutôt qu'il ne raconte, le père pleurant sur
la mort de son fils, et le fils pleurant sur la mort de son père?
peut-il y avoir péroraison plus touchante? n'est-ce pas, en effet,
s'y prendre un peu tard, que d'attendre à la péroraison pour tâcher
d'émouvoir par des choses qu'on aura froidement exposées dans la
narration ? Le juge, en se familiarisant avec les faits, est devenu
insensible à ce qui ne l'a pas ému d'abord : tant il est difficile
de changer la disposition dans laquelle l'esprit s'est une fois
arrêté! Pour moi, car je ne dissimulerai pas mon sentiment ,
quoiqu'il soit plutôt fondé sur des exemples que sur des préceptes ;
pour moi, dis-je, je pense que de toutes les parties du plaidoyer,
la narration est celle qui a le plus besoin d'être ornée et
embellie. Mais il importe beaucoup de considérer la nature des faits
que l'on raconte. Ainsi, dans les causes de peu de conséquence,
comme le sont la plupart des causes civiles, le vêtement doit être
simple, et, pour ainsi dire, appliqué sur le corps. Si, dans les
lieux communs, les expressions se précipitent et disparaissent au
milieu du luxe qui les environne, elles doivent être ici
soigneusement choisies. Pas une qui ne soit propre, et qui ne soit,
comme le dit Zénon, teinte de la pensée. Le style, sans
trahir l'art, doit être extrêmement agréable. Point décès figures
empruntées à la poésie, ou que l'autorité des anciens fait prévaloir
contre la vérité du langage ; car la diction doit être infiniment
pure, mais de celles qui délassent l'esprit par la variété des
formes, et préviennent l'ennui qui naît ordinairement de
l'uniformité des désinences, des constructions , et des phrases. Car
dans ces petits sujets, la narration n'a nulle autre parure à
espérer; et, si elle ne se recommande par cet agrément, elle est
condamnée à ramper. D'ailleurs le
150 juge n'est nulle part plus attentif, et rien de ce
qui est bien dit n'est perdu. Ensuite, je ne sais comment il est
plus porté à croire ce qu'il a entendu volontiers, et le plaisir
entraîne sa persuasion.
Mais lorsqu'il s'agira d'une cause
importante, la narration devra respirer l'indignation ou la pitié,
selon que les choses que nous aurons à exposer seront atroces ou
déplorables. On se gardera toutefois d'épuiser ces grands
mouvements, et l'on devra se borner à une esquisse qui laisse
deviner ce que sera plus tard le tableau. Je ne dissuaderai pas
néanmoins de laisser reprendre haleine, pour ainsi dire, à la colère
du juge, en entrecoupant le récit par quelque pensée comme celle-ci
: Les esclaves de Milon firent ce que chacun de nous aurait voulu
que ses esclaves fissent en pareille circonstance ; ou quelquefois
par un trait un peu plus hardi : on voit une belle mère épouser
son gendre, sans nuls auspices, sans assemblée de parents, et sous
les plus funestes présages. Que si l'on en usait ainsi à une
époque où tous les orateurs se proposaient bien plutôt l'intérêt de
la cause que l'ostentation, et où les juges conservaient encore
quelque chose de l'austérité des premiers temps, à combien plus
forte raison cela se doit-il pratiquer aujourd'hui, que le plaisir a
fait irruption jusque dans les causes où il s'agit de la vie et de
la fortune des citoyens? Je dirai ailleurs jusqu'à quel point on
doit se conformer au goût de notre siècle. Je me borne à reconnaître
ici qu'il faut lui faire quelques concessions.
Il est très-utile de joindre au récit
des choses vraies des images vraisemblables, qui y fassent, pour
ainsi dire, assister les auditeurs. Telle est cette peinture que
Célius fait d'Antoine : On le trouve plongé dans un profond
sommeil, exhalant les vapeurs de son vin par d'horribles ronflements
et des hoquets redoublés. Autour de lui sont ses nobles compagnes de
chambrée, les unes couchées en travers sur tout le bord de son lit,
les autres étendues ça et là sur le plancher. Tout à coup le bruit
des ennemis se fait entendre. Demi-mortes de frayeur, ces femmes
s'efforcent de réveiller Antoine en l'appelant par son nom, en le
soulevant pur la télé; l'une lui parle à l'oreille d'une voix
tendre, l'autre le secoue rudement. Lui, reconnaissant par habitude
la voix et les attouchements de ces courtisanes, étend les bras pour
embrasser celles qui sont le plus près de lui; mais, trop tourmenté
pour se rendormir, trop ivre pour se tenir éveillé, il est emporté
dans cet état crapuleux entre les bras des centurions et de ses
concubines. On ne saurait inventer avec plus de vraisemblance,
flétrir avec plus de force, peindre avec plus de vivacité.
Je ne dois pas omettre de dire que
rien ne donne plus de créance à un récit que l'autorité du
narrateur; et cette autorité, nous devons l'acquérir principalement,
sans doute, par nos mœurs, mais aussi par notre manière de narrer.
Plus elle sera grave et austère, plus elle donnera de poids à nos
assertions. Il faut donc éviter, ici plus qu'ailleurs, toute
apparence de ruse; car nulle part le juge n'est plus sur les gardes.
Rien n'y doit paraître feint ou étudié; il faut que tout semble
émaner de la cause plutôt que de l'orateur. Mais notre vanité ne
s'arrange pas de cela, et nous croyons que l'art n'est plus, s'il ne
paraît pas; tandis qu'au contraire l'art cesse d'être, s'il paraît.
Nous ne songeons qu'à la louange, et nous en faisons l'unique but de
nos travaux : d'où il 151
qu'en voulant briller aux yeux des assistants , nous nous trahissons
aux yeux des juges.
Il y a encore une espèce de narration
reprise, qu'on appelle ἐπιδήγησις;.
Elle appartient plutôt aux déclamations de l'école qu'aux
plaidoiries du barreau. C'est une seconde narration dans laquelle,
après avoir satisfait à la brièveté dans la première, on expose les
choses avec plus d'étendue et d'ornement, dans la vue d'exciter
l'indignation ou la pitié. J'estime qu'il faut en user rarement, et
surtout qu'il ne faut jamais reprendre la narration tout entière,
dans l'ordre où elle a été faite d'abord, mais revenir seulement sur
certaines parties. Au reste, quand on voudra se servir de ce moyen,
on se contentera d'effleurer le fait dans la narration proprement
dite, en promettant d'exposer plus au long, en son lieu, la manière
dont il s'est passé.
Quelques rhéteurs conseillent de
commencer toujours la narration par le portrait de la personne, en
le flattant s'il s'agit de notre partie, et en le chargeant tout
d'abord s'il s'agit de la partie adverse. Sans doute, c'est le cas
le plus ordinaire, puisque ce sont des personnes qui sont en cause.
Mais tantôt, si on le juge à propos, on peindra la personne avec ses
accidents : A. Cluentius Habitus, père de mon client, était ; né
dans lu ville municipale de Larinum, et il était l'homme le plus
considérable, non-seulement de cette ville, mais de la contrée et
des environs, en mérite, en réputation et en naissance; tantôt
on dira tout simplement : Q. Ligarius étant parti, etc.;
souvent même on commencera par le fait, comme Cicéron plaidant pour
Tullius: M. Tullius possède, dans le territoire de Thurinum, une
terre patrimoniale, ou, comme Démosthène pour Ctésiphon : La
guerre s'étant allumée contre les Phocéens. Où doit finir la
narration? c'est un sujet de dispute avec ceux qui veulent qu'on la
conduise jusqu'au point d'où naît la question : Les choses
s'étant ainsi passées, le préteur P. Dolabella défendit toute
violence aux gens de guerre; l'arrêt portait en général et sans
exception : Quiconque aura chassé quelqu'un du lieu où il était,
sera tenu de l'y rétablir. Cécina a éprouvé cette violence; Ébutius
dit l'avoir rétabli; l'un et l'autre ont donné caution : c'est sur
cette caution que vous avez à juger. Je crois, pour moi, que le
demandeur peut toujours suivre cette méthode, mais que le défendeur
ne le peut pas toujours.
CHAP. III. L'ordre naturel veut que la
confirmation suive la narration; car on ne raconte un fait que pour
le prouver. Mais, avant de traiter cette partie, je dois dire
quelques mots de l'opinion de certains rhéteurs. C'est un usage,
presque général aujourd'hui, de se jeter, aussitôt après la
narration, dans un lieu commun, où l'orateur peut se donner
carrière, et d'y faire une excursion brillante, aux applaudissements
des assistants. Né de l'ostentation déclamatoire, cet usage a passé
de l'école au barreau, depuis que les avocats se sont avisés de
préférer, dans la plaidoirie, leur propre gloire à l'intérêt de
leurs clients, craignant sans doute que le style âpre de
l'argumentation, succédant au style précis et un peu maigre que
demande ordinairement la narration , ne fasse trop attendre le
plaisir et ne refroidisse le discours. Le défaut que je trouve en
cela, c'est de ne point tenir compte de la différence des causes et
de ce qu'elles réclament, comme si les digressions étaient toujours
utiles ou nécessaires ; c'est d'entasser ici des pensées, empruntées
à d'autres parties, au risque ou de tomber dans des
152 redites, ou de ne
pouvoir dire en son lieu ce qu'on a déjà dit ailleurs. J'avoue
néanmoins que ce genre d'excursion peut venir avec opportunité
non-seulement après la narration, mais encore après toutes les
questions, et même après chaque question en particulier, lorsque le
cas le demande ou du moins le permet; j'avoue que les digressions
contribuent beaucoup à embellir et orner le discours, mais pourvu
qu'il y ait cohésion et suite, et non pas si on les fait entrer de
force, en séparant ce qui est naturellement joint. En effet, rien
n'est plus conséquent que de passer immédiatement de la narration à
la preuve, à moins que la digression ne puisse être regardée, ou
comme la fin de l'une, ou comme le commencement de l'autre. Elle
pourra donc avoir lieu quelquefois : par exemple, lorsque, la fin de
l'exposition ayant laissé une impression d'horreur, nous donnons
cours à notre indignation, comme on cède au besoin de respirer.
Cependant on ne devra se permettre cette sortie qu'autant que le
fait ne souffre aucun doute ; autrement, avant que de l'exagérer, il
faut s'attacher à le faire trouver vrai ; car l'odieux du fait
incriminé favorise l'accusé tant qu'il n'est pas prouvé, par la
raison que. plus un crime est énorme, plus on a de peine à y croire.
La digression peut encore avoir son utilité, si, par exemple, à
l'occasion de services rendus à la partie adverse, et dont vous avez
parlé dans la narration, vous vous élevez contre «on ingratitude ;
ou si, après avoir exposé une longue suite d'accusations diverses,
vous faites voir quelle responsabilité dangereuse vous assumez par
là. Mais tout cela doit se faire en peu de mots; car, une fois que
le juge est instruit des faits, il est impatient d'arriver à la
preuve, et brûle de savoir à quoi se déterminer. II est à craindre,
en entre, que l'esprit du juge, distrait par d'autres objets, et
fatigué par des retards inutiles, ne perde de vue la narration.
Mais, de même que la digression n'est
pas toujours nécessaire après la narration, elle est souvent aussi
une préparation utile, quand elle est placée avant la question,
surtout si, au premier aspect, cette question est peu favorable, si
nous soutenons une loi rigoureuse, si nous requérons des peines
contre notre adversaire. C'est le lieu d'une sorte de second exorde,
pour préparer le juge à accueillir nos preuves, pour l'apaiser ou
l'irriter; ce qui peut se faire avec d'autant plus de liberté et de
véhémence, que la cause lui est déjà connue. C'est donc avec ces
lénitifs que nous adoucirons ce qu'il y aura de trop âpre, et que
nous disposerons l'oreille des juges à écouter plus volontiers ce
que nous leur dirons dans la suite, de peur qu'ils ne se révoltent
contre la rigueur de notre droit ; car il n'est pas facile de
persuader les gens malgré eux. Toutefois il est bon, en pareille
circonstance, de connaître le caractère du juge, et de savoir à
quoi, de la justice ou de l'équité, il est le plus attaché, parce
que, selon cette différence, nous le ménagerons plus ou moins. Au
reste, la même chose peut aussi servir de péroraison après comme
avant la question.
Ce que nous appelons digression,
les Grecs l'appellent παρέκβασις. Il en est
de plusieurs sortes , comme je l'ai dit, et qui peuvent être
différemment répandues dans tout le cours du plaidoyer : par
exemple, l'éloge des hommes et des lieux, les descriptions de
pays, le récit de choses vraies ou fabuleuses. De ce genre sont,
dans les plaidoyers de Cicéron contre Verrès, l'éloge de la
Sicile, l'enlèvement de Proserpine; dans la défense de C.
Cornélius, le panégyriste si
153 populaire de
Pompée, lorsque ce divin orateur, comme si le nom de Pompée eût
suspendu le cours de sa plaidoirie, s'interrompt tout à coup pour
passer à l'éloge de ce grand homme.
La digression est, selon moi, une
excursion, hors de tordre des choses, sur un point qui ne laisse pas
d'être utile à la cause. Aussi ne vois-je pas pourquoi on veut
de préférence lui assigner sa place immédiatement après la
narration, ni pourquoi on croit ne devoir lui donner ce nom
qu'autant qu'elle est une suite de la narration ; car le discours
peut s'écarter du droit chemin de mille manières. En effet, tout ce
qui se dit en dehors des cinq parties que nous avons établies, est
digression. Ainsi, exciter l'indignation, la pitié, la haine,
invectiver, excuser, flatter, répondre, à des injures; tout ce qui
n'est pas dans la question, comme amplifier, atténuer, émouvoir; et
ces lieux communs sur le luxe, la cupidité, la religion, les
devoirs, qui contribuent à donner tant d'agrément et d'éclat au
discours, tout cela est digression, quoique l'orateur ne paraisse
pas sortir du sujet, en ce que s'étendant sur une matière de même
nature, il n'interrompt pas la liaison des pensées. Mais combien de
choses y insère-t-on qui en sont entièrement détachées, et dont la
fin est de délasser le juge, de l'avertir, de l'apaiser, de le
prier, de le louer? il y en a une infinité de cette espèce : les
unes sont préparées à l'avance, les autres naissent de la
circonstance ou de la nécessité, si, par exemple, pendant la
plaidoirie, il arrive quelque chose d'extraordinaire, si l'orateur
est interpellé, s'il survient quelque personnage, s'il s'élève du
tumulte. C'est ainsi que, dans la cause de Milon, Cicéron fut forcé
de sortir de son sujet, dès l'exorde, comme on le voit dans le petit
plaidoyer qu'il prononça. Au reste, la digression peut être un peu
plus longue, lorsqu'elle sert de préparation à la question, ou de
complément et de recommandation à la preuve; mais, lorsqu'elle
s'échappe du milieu de l'une ou de l'autre, il faut retourner le
plus tôt possible au point d'où l'on s'est écarté.
CHAP. IV. Il y en a qui placent la
proposition après la narration, comme une partie du genre
judiciaire. J'ai réfuté cette opinion. La proposition est,
selon moi, le commencement de toute confirmation : elle précède
ordinairement la question principale, quelquefois même chaque
argument en particulier, et entre autres, ceux qu'on appelle
épichérèmes. Je parle, pour le moment, de celle qui ouvre la
question principale. Elle n'y est pas toujours nécessaire ; car
quelquefois le fond de la question est suffisamment clair sans
proposition, surtout si la narration finit où commence la question.
Aussi se borne-t-on, dans ce cas, à faire suivre la narration d'une
petite récapitulation, comme cela se pratique pour les preuves :
L'affaire s'est passée, juges, comme je vous l'ai racontée ; celui
qui y avait tendu le piège y a péri, la violence a été vaincue par
la violence, ou plutôt l'audace a été terrassée par le courage.
Mais la proposition est quelquefois très-utile, principalement
lorsque le fait ne peut être défendu, et qu'il s'agit seulement de
le qualifier. Par exemple, si vous plaidez pour un homme accusé
d'avoir dérobé dans un temple l'argent d'un particulier, vous direz
: Il s'agit d'une accusation de sacrilège, c'est d'un sacrilège
que 154 vous
avez à connaître. Par là vous faites comprendre au juge que son
devoir est uniquement d'examiner si le fait incriminé est un
sacrilège. De même dans les causes obscures ou multiples, et cela
pour rendre la cause non-seulement plus claire, mais encore plus
entraînante ; et vous la j rendrez telle, si vous faites précéder la
question d'une proposition qui serve à l'établir d'une manière
précise : La loi porte en termes exprès, que tout étranger qui
escaladera le mur de la ville sera puni de mort. Il est certain que
vous êtes étranger, il ne l'est pas moins que vous avez escaladé le
mur : que reste-t-il, sinon à vous punir? En effet, cette
proposition presse l'aveu de l'adversaire, et met, en quelque sorte,
le juge en demeure de prononcer; elle fait plus que d'indiquer la
question, elle lui vient en aide.
Les propositions sont tantôt
simples, tantôt doubles ou multiples : ce qui
résulte, tantôt de la jonction de plusieurs chefs d'accusation,
comme lorsque Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et
d'introduire de nouvelles superstitions; tantôt de la réduction
de plusieurs chefs en un seul, comme lorsqu'Eschine fut accusé de
prévarication dans son ambassade, parce qu'il avait fait de faux
rapports, parce qu'il avait agi en tout contrairement à son mandat,
parce qu'il avait tardé à revenir, parce qu'il avait accepté des
présents. La défense comporte aussi quelquefois plusieurs
propositions : Vous êtes mal fondé à me demander celle somme; car
premièrement vous n'aviez pas capacité pour recevoir procuration de
celui au nom duquel vous plaidez, ni lui pour vous la donner;
secondement, vous n'êtes pas héritier de celui à qui l'on prétend
que j'ai emprunté; enfin, je ne lui devais rien. Je pourrais
multiplier les exemples à l'infini, mais il suffit de ceux que je
viens de donner. Si les propositions sont placées séparément en tête
de chaque preuve, ce seront plusieurs propositions; si on les
réunit, elles rentrent dans la division.
Quelquefois la proposition est, pour
ainsi dire, toute nue, comme dans la plupart des causes
conjecturales : J'accuse un tel de meurtre, de larcin, etc. ;
quelquefois elle est accompagnée de sa preuve : C. Cornélius a
violé la majesté de ses fonctions, en ce qu'étant tribun du peuple,
il a lu lui-même, en pleine assemblée, le texte de la loi. En
outre, la proposition se fait, tantôt en notre nom : J'accuse un
tel d'adultère; tantôt au nom de la partie adverse : On
m'accuse d'adultère; ou enfin elle est commune aux deux parties
: La question entre mon adversaire et moi est celle-ci : Lequel
de nous deux est le plus proche parent d'un tel mort ab intestat?
Quelquefois on joint ensemble les propositions des deux parties :
Mon adversaire dit que..., et moi je soutiens que... Enfin, il y
a une sorte de proposition que l'on peut appeler tacite, parce que,
sans être une proposition formelle, elle en a néanmoins la force,
comme lorsqu'après avoir exposé les faits on ajoute : Voilà sur quoi
vous avez à prononcer. Ces mots avertissent le juge de redoubler
d'attention, et le réveillent en quelque sorte, pour lui annoncer
que, la narration étant finie, on va passer à la preuve, et pour lui
demander, pour ainsi dire, une nouvelle audience.
CHAP. V. La division est
l'énumération faite par ordre de nos propositions, ou de celles de
notre adversaire, ou des unes et des autres à la fois. Quelques-uns
pensent qu'il faut toujours en faire usage, parce qu'elle contribue
à rendre la 155 cause
plus claire, et parce que le juge est plus attentif et plus docile,
quand il sait de quoi on parle et de quoi on parlera par la suite.
Selon d'autres, au contraire, elle est dangereuse, en ce que
l'orateur ne se souvient pas toujours de ce qu'il a promis de
traiter, et qu'il peut rencontrer sur son chemin des choses qu'il
n'avait pas prévues dans la division ; mais cela ne peut arriver
qu'à un homme tout a fait dépourvu d'esprit, ou qui s'avise de
plaider sans avoir rien préparé ni médité à l'avance. Autrement,
quoi de plus méthodique et de plus claire qu'une division bien
faite? Elle est si conforme à la nature, que rien ne soutient plus
la mémoire que de ne pas s'écarter de la route que l'on s'est
proposé de tenir en parlant. C'est pourquoi je n'approuve pas ceux
qui défendent d'étendre la division au delà de trois propositions.
Il est vrai que, si elle est trop multiple, elle échappera à la
mémoire du juge et troublera son attention ; mais ce n'est pas une
raison pour la restreindre à un nombre fixe et invariable de points,
attendu que la cause peut en exiger davantage.
Il y a plutôt des raisons pour ne pas
toujours user de la division. D'abord, un discours qui paraît ne
rien avoir d'étudié fait ordinairement plus de plaisir à l'auditeur,
tandis que la division sent toujours l'étude et le cabinet. De là
vient que ces figures sont si bien reçues : J'oubliais de vous
dire... je ne songeais pas... vous m'avertissez fort à propos.
Au contraire, si vous annoncez vos preuves, vous privez le reste de
votre discours du charme de la nouveauté. En second lien, nous
sommes obligés quelquefois de recourir à la ruse, et de circonvenir
le juge pour lui dissimuler notre dessein ; car il y a certaines
propositions scabreuses, dont il est effrayé du plus loin qu'il les
voit, à peu près comme un malade quand il aperçoit, dans les mains
du chirurgien, le fer qui doit servir à l'opérer. Mais si vous
entrez, pour ainsi dire, chez lui sans rien annoncer qui trouble sa
sécurité et lui cause de la préoccupation . vous obtiendrez plus que
si vous aviez commencé par lui promettre de le convaincre.
Troisièmement, il faut éviter quelquefois non-seulement de
distinguer les questions, mais même de les traiter; il faut troubler
le juge par le moyen des passions, et le distraire de son attention.
Car, si le devoir de l'orateur est d'instruire , le triomphe de
l'éloquence est d'émouvoir ; et rien n'est plus contraire à cet
effet que le soin scrupuleux que l'on met à distinguer
minutieusement les parties de son discours, dans le temps où il
s'agit d'emporter le suffrage du juge. Ajoutez à cela que bien des
choses sont faibles et sans portée par elles-mêmes, et n'ont de
force que par le nombre. Il vaut donc mieux les réunir en masse, à
l'exemple d'un général qui tente une irruption avec toutes ses
troupes : moyen dont on doit toutefois se servir rarement, et
seulement dans la nécessité, lorsque la raison nous force d'agir, en
quelque sorte, contre la raison. Enfin, dans toute division, il y a
un point plus important que les autres. Le juge l'a-t-il entendu ? A
peine daigne-t-il écouter le reste. Lors donc qu'où a plusieurs
choses à objecter ou à réfuter, la division est utile et agréable,
en ce que l'auditeur voit l'ordre dans lequel nous traiterons chaque
point ; mais elle est superflue si l'accusation est une, quoique
susceptible d'être combattue par plusieurs moyens. Je suppose qu'on
fasse une division comme celle-ci : Je dirai que l'accusé que je
défends n'est pas capable d'un homicide; je dirai qu'il n'avait
aucune raison de commettre
156 un meurtre; je
dirai que, dans le temps où le meurtre a été commis, mon client
était au delà des mers. Tout ce que vous prouverez, avant le
troisième point , paraîtra nécessairement inutile; car le juge court
au-devant du point principal : s'il est patient, il se contentera de
murmurer intérieurement contre vous , comme si vous ne teniez pas ce
que vous lui avez promis; et s'il n'n pas de temps à perdre , ou que
sa dignité le mette au-dessus des ménagements, ou même qu'il soit
d'un caractère peu accommodant, il vous gourmandera d'un ton
pressant. C'est pourquoi on n'a pas manqué de critiquer cette
division de Cicéron , dans son plaidoyer pour Cluentius : Je me
propose d'établir, premièrement, que personne n'a été cité en
justice pour de plus grands crimes ni accablé par de plus graves
témoignages qu'Oppianicus; secondement, que les jugements
préliminaires ont été rendus par les mêmes juges , qui l'ont
condamné définitivement; troisièmement, que, t'il a été fait des
tentatives de corruption auprès des juges, ce n'a pas été de la part
de Cluentius, mais contre Cluentius. On objectait que , si le
troisième point pouvait être prouvé, il était inutile de s'occuper
des autres. En revanche, on ne saurait, sans injustice ou sans
aveuglement , critiquer cette division de son plaidoyer pour Muréna
: Il me semble, juges, que toute l'accusation se réduit à trois
chefs : par le premier, on l'attaque dans ses mœurs ; par le second,
dans sa candidature ; par le troisième, on l'accuse de brigues.
De cette manière l'orateur présente clairement toute la cause, et on
ne peut pas dire qu'un point soit rendu inutile par l'autre. Voici
une autre sorte de division qu'on hésite généralement à approuver:
Si je [ai tué, j'ai bienfait; mais je ne l'ai pas tué. A quoi
sert, dit-on, la première proposition, si la seconde est vraie? ne
se nuisent-elles pas mutuellement? et les avancer toutes deux,
n'est-ce pas s'ôter toute créance pour l'une et pour l'autre? Cette
objection est fondée, si l'on suppose que la dernière proposition
est indubitable. Mais si la plus sûre ne l'est pas tellement que
nous n'ayons lieu de craindre pour elle, nous ne ferons pas mal de
les discuter toutes deux. Ce qui ne touche pas un juge peut toucher
l'autre. Tel croira le fait, qui nous excusera sur le droit; et tel
nous condamnera sur le droit, qui peut-être ne croira pas le fait.
Ainsi, à une main sûre un seul trait suffit ; mais celle qui ne
l'est pas a besoin d'en lancer plusieurs, pour que le hasard ail sa
part. Cicéron s'y prend donc très-bien dans la défense de Milon,
lorsqu'il démontre d'abord que Clodius a été l'agresseur, et ajoute
subsidiairement que, quand même cela ne serait pas, il ne pouvait
être que glorieux à Milon d'avoir eu le courage de tuer un aussi
mauvais citoyen. Ce n'est pas que je blâme la division dont j'ai
parlé plus haut, parce que certaines propositions, quoiqu'un peu
dures en elles-mêmes, ont pour effet d'adoucir celles qui suivent;
et ce n'est pas tout à fait sans raison qu'on dit communément qu'il
faut demander au delà de ce qui est juste, pour obtenir ce qui est
juste. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout oser ; car c'est
un sage précepte que celui que nous donnent les Grecs, de ne pas
tenter l'impossible. Mais toutes les fois qu'on se servira de
deux moyens de défense, il faut faire en sorte que le premier
dispose à croire le second : ainsi on peut nier, sans être suspect
de mensonge, ce qu'on aurait pu avouer en toute sûreté. Cependant si
nous nous apercevons que le juge désire une autre preuve que celle
que nous traitons, ne 157
manquons pas de lui promettre prompte et entière satisfaction,
surtout si l'honneur est en cause; car il arrive souvent que, dans
une cause peu honorable, on ait pour soi le droit. Dans ce cas, pour
que les juges n'écoutent ni avec déplaisir ni avec défaveur,
répétons-leur souvent que nous démontrerons en temps et lieu que
notre client est un homme probe et digne; qu'ils attendent un peu,
et qu'ils nous permettent de procéder avec ordre. Quelquefois
nous feindrons de dire certaines choses contre le gré de notre
client, comme l'a fait Cicéron dans son plaidoyer pour Cluentius, au
sujet de la loi sur les devoirs des juges. Quelquefois nous nous
arrêterons, comme s'il nous interpellait. Souvent nous lui
adresserons la parole, et nous l'inviterons à s'en rapporter à notre
prudence. Par là on s'insinuera dans l'esprit des juges, qui,
s'attendant à la preuve que l'honneur est sauf, verront, avec moins
de répugnance, le côté fâcheux de la cause. Ce point une fois
emporté, ce qui regarde l'honneur passera plus aisément. Ainsi les
deux parties s'aideront mutuellement; car le juge, rassuré sur le
point d'honneur, sera plus attentif à la question de droit, et la
preuve du droit le disposera à mieux penser du point d'honneur.
Mais, si la division n'est pas
toujours nécessaire ni même utile, il est certain qu'employée à
propos elle contribue beaucoup à la clarté et à l'agrément du
discours. En effet, elle n'a pas seulement pour effet de rendre les
choses plus claires, en les tirant, pour ainsi dire, de la foule ,
et en les mettant en présence du juge ; elle délasse encore son
attention au moyen des limites qu'elle assigne à chaque partie, à
peu près comme la vue de ces pierres qui servent à marquer nos
lieues encourage le voyageur fatigué. Car on éprouve du plaisir à
mesurer le chemin qu'on a fait, et rien n'anime plus à poursuivre ce
qu'on a commencé, que de savoir ce qui reste à faire : on ne trouve
jamais long ce dont on aperçoit le terme. C'est donc avec raison
qu'on a tant loué Hortensius du soin qu'il apportait dans la
division, bien que sa manière de compter les points de son discours
sur ses doigts lui ait attiré quelques légères railleries de la part
de Cicéron. C'est que, si l'excès déplaît dans le geste, on doit à
plus forte raison éviter dans le discours les divisions trop
minutieuses et, pour ainsi dire, articulées. En effet cette
dissection, qui présente plutôt des morceaux que des membres, nuit
beaucoup à l'autorité de l'orateur. Celui qui court après ce genre
de gloire, en voulant faire preuve de subtilité et d'abondance, ne
fait que se surcharger de superfluités, coupe ce qui est de soi un
et indivisible, amoindrit les choses plutôt qu'il ne les multiplie,
et, après avoir divisé son sujet en mille et mille petites parties,
retombe dans l'obscurité, dont la division avait pour objet de le
garantir.
La proposition, ou simple ou divisée,
toutes les fois qu'on jugera à propos de l'employer, doit d'abord
être intelligible et claire, car rien n'est plus choquant que d'être
obscur dans la partie même qui est uniquement destinée à éclairer
les autres; en second lieu, elle doit être brève et dégagée de tout
mot superflu ; car il s'agit, non d'expliquer ce que vous dites,
mais d'indiquer ce que vous direz. Enfin il faut faire en sorte que
rien n'y manque, et qu'il n'y ait rien de trop. Or elle pèche par
excès, et ce sont les cas les plus fréquents, si l'on divise en
espèces ce qu'il suffit de diviser en genres, ou si, après avoir
posé 158 le genre, on y
adjoint l'espèce ; par exemple, Je vais parler de la vertu, de la
justice, de la tempérance. Cette division est vicieuse, en ce que la
justice et la tempérance sont des espèces de la vertu.
La division générale doit exposer les
points sur lesquels on est d'accord et ceux sur lesquels on lie
l'est pas; dans les premiers, ce que l'adversaire avoue , ce que
nous avouons nous-mêmes; dans les seconds, quelles sont nos
propositions, quelles sont celles de la partie adverse. Mais ce
qu'il y a déplus vicieux, c'est de ne pas traiter les questions dans
l'ordre où on les a d'abord posées.
|