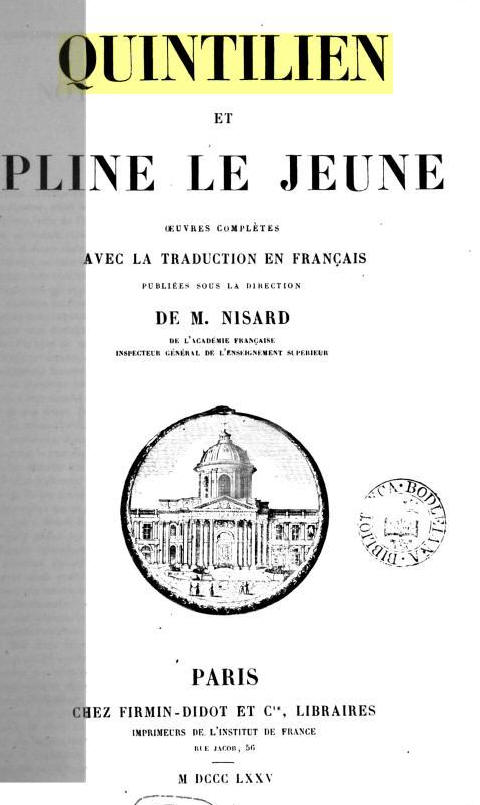LIVRE V.
SOMMAIRE. Introduction. - Chap. I. De la division des
preuves. - II. Des préjugés. -III. Des bruits publics et de la
renommée. - IV. Des tortures. - V. Des pièces. - VI. Du serment. -
VII. Des témoins. - VIII. De la preuve artificielle. - IX. Des
signes. - X. Des arguments. - XI. Des exemples. - XII. De l'usage
des arguments. - XIII. De la réfutation. - XIV. Ce que c'est que
l'enthymème, et combien il y en a de sortes; en quoi consiste
l'épichérème, et de la manière de le réfuter.
De célèbres auteurs ont pensé que le devoir de
l'orateur se bornait à instruire, puisqu'ils prétendaient que
l'emploi des passions lui devait être interdit, et cela pour deux
raisons : d'abord, parce que toute perturbation de l'âme est un mal;
ensuite, parce qu'il n'est pas permis de détourner un juge de la
vérité par l'impulsion de la pitié, de la colère, et de tout autre
sentiment semblable ; et que chercher à plaire à l'auditeur,
lorsqu'il s'agit uniquement de vaincre, est un soin non seulement
superflu pour l'avocat, mais même indigne d'un homme. D'autres, et
en plus grand nombre, sans vouloir, il est vrai, interdire ces
moyens à l'orateur, ont pensé néanmoins que son propre et principal
devoir était de confirmer ses propositions et de réfuter celles de
son adversaire. Quoi qu'il en soit de ces deux opinions, car ce
n'est point ici que je veux interposer là mienne, ce livre sera,
dans l'une comme dans l'autre, jugé infailliblement très nécessaire,
puisqu'il est destiné tout entier à traiter de la preuve et de la
réfutation : à quoi même se lie tout ce qui a été dit jusqu'ici sur
les causes judiciaires; car l'exorde et la narration n'ont pas
d'autre objet que de préparer le juge, et il serait superflu de
connaître les états de la cause, et de s'occuper des autres points
dont j'ai parlé, si l'on n'arrivait à la preuve. Enfin, des cinq
parties que j'ai assignées au plaidoyer, nulle autre n'est tellement
nécessaire, qu'on ne puisse quelquefois l'omettre; mais il n'est
point de procès où l'on puisse se passer de la preuve. Je vais donc
traiter cette importante partie, et, pour le faire avec ordre et
méthode, je commencerai par les préceptes généraux; puis, je
passerai à ceux qui regardent chaque genre de causes en particulier.
CHAP.l. Aristote enseigne une division générale qui a
été généralement adoptée , et qui consiste à distinguer deux sortes
de preuves: celles que l'orateur trouve en dehors de la rhétorique,
et celles qu'il tire lui-même de la cause, et qu'il engendre en
quelque sorte. C'est pourquoi on a appelé les premières des preuves
inartificielles, ἀτέχνους, et les secondes des preuves
artificielles, ἐντέχνους. Du genre des premières sont les
préjugés, les bruits publics, la torture,
les pièces, le serment, les témoins : toutes
choses qui constituent la majeure partie des discussions du barreau.
Mais, si ces preuves par elles-mêmes ne tiennent rien de l'art, il
n'en faut pas moins la plupart du temps employer toutes les forces
de l'éloquence pour les soutenir ou pour les réfuter. Aussi a-t-on
grandement tort de croire que ce genre de preuves n'a pas besoin de
préceptes. Je n'ai pas toutefois l'intention d'embrasser tout ce
qu'on peut dire pour soutenir ou combattre ces preuves ; car il
n'entre pas dans mon dessein d'enseigner la manière de traiter les
lieux communs; je veux seulement indiquer une marche, une méthode :
après quoi chacun se servira de ses propres forces pour la suivre,
ou y suppléera par analogie , suivant la nature des causes. Car,
s'il est impossible d'énumérer tous les exemples, que peuvent
fournir les causes passées? que doit-on penser des causes futures?
CHAP. II. Commençons par les préjugés. On les
comprend tous sous trois genres : les premiers, qui seraient mieux
appelés des exemples, sont fondés sur des choses qui ont déjà
été jugées dans des causes pareilles, comme des testaments de pères,
dont les enfants ont obtenu l'annulation, ou qui ont été maintenus
contre les enfants; les seconds sont fondés sur des jugements
relatifs à la même cause, d'où est venu proprement le nom de
préjugés : tels sont les jugements invoqués contre Oppianicus,
et la condamnation de Milon par le sénat; les troisièmes, sur une
première sentence rendue dans la même affaire, et dont on appelle,
lorsqu'il s'agit, par exemple, ou de déportation,
d'affranchissement, ou d'une de ces causes qui relèvent de la double
juridiction des centumvirs.
On confirme les préjugés, et par l'autorité de ceux
qui ont déjà prononcé, et par la conformité des causes. Mais quand
il s'agit de les détruire, il faut ordinairement éviter d'outrager
les premiers juges, à moins qu'ils ne soient manifestement en faute.
Car il est naturel qu'un juge confirme ce qu'un autre a jugé avant
lui, et que, appelé à prononcer à son tour, il ne donne pas
volontiers un exemple qui pourrait retomber sur lui-même. Il vaut
donc mieux recourir, dans les deux premiers genres, à la différence
qui peut exister entre les causes; car il est bien rare d'en
rencontrer deux qui soient entièrement semblables. Que si néanmoins
ces deux causes n'offraient aucune dissemblance, ou qu'il s'agît du
troisième genre de préjugés, alors on se rejetterait sur les défauts
de formalité, sur la faiblesse de ceux qui ont été condamnés, sur
tout ce qui peut altérer la bonne foi des témoins, comme l'amitié,
la haine, l'ignorance; ou l'on chercherait quelque circonstance qui,
depuis, a pu changer l'état de la cause. Si rien de tout cela ne
peut s'alléguer, on peut dire que de tout temps on a rendu de
mauvais jugements, qu'on a vu condamner Rutilius et absoudre un
Clodius et un Catilina; on peut aussi prier les juges d'examiner
l'affaire en elle-même, plutôt que d'en juger sur la foi d'autrui.
Quant aux sénatus-consultes, et aux décrets des princes ou des
magistrats, je n'y vois point de remède, si ce n'est d'alléguer
quelque point de dissemblance dans la cause, ou d'opposer quelque
décret postérieur, rendu par les mêmes magistrats ou par des
magistrats revêtus de la même autorité, qui déroge au premier. Si
tout cela manque, il faut se résoudre à passer condamnation.
CHAP. III. La renommée et les bruits publics seront
tantôt le consentement de toute une ville, une espèce de témoignage
public; tantôt un bruit sans fondement certain, auquel la malignité
a donné naissance, que la crédulité a grossi, et auquel l'homme le
plus vertueux peut être exposé par l'artifice et le mensonge de ses
ennemis. Les exemples ne manqueront pas de part et d'autre.
CHAP. IV. Il en est de même de la torture, qui
est un lieu commun très souvent traité. Ceux-ci disent que la
question est un moyen infaillible pour faire avouer la vérité;
ceux-là, qu'elle produit souvent un effet tout contraire, en ce
qu'il y a des hommes à qui la force de résister aux tourments permet
de mentir, et d'autres que leur faiblesse y contraint. Je ne
m'étendrai pas davantage sur ce genre de preuves : les plaidoyers
anciens et modernes en offrent une foule d'exemples. Il y a
cependant, dans chaque cause, certaines circonstances particulières
qu'il sera bon de prendre en considération. S'il s'agit, par
exemple, de donner la question, il importera d'examiner quel est
celui qui la demande ou qui s'offre, quel est celui qu'il demande ou
qu'il offre, contre qui et pour quelle raison; si la question a
été déjà donnée, on examinera quel juge y a présidé, quel est
celui qui a été torturé, et comment il l'a été; si ce qu'il a dit
est incroyable ou conséquent; s'il a persisté dans ses premières
déclarations, ou si la douleur l'a forcé à se contredire; si c'est
au commencement de la question, ou lorsque les tortures devenaient
plus violentes : circonstances qui, de part et d'autre, varient
à l'infini comme, les causes elles-mêmes.
CHAP. V. Les pièces ont été et seront souvent
une matière féconde en contestations, puisque nous voyous tous les
jours que non seulement on les récuse, mais que même on les argue de
faux. Comme elles peuvent être attaquées, soit à cause de la
mauvaise foi, soit à cause de l'ignorance de ceux qui les ont
signées, le plus sur et le plus facile est de ne supposer que
l'ignorance; parce qu'il y a moins de personnes enveloppées dans
l'accusation. Au reste, cela n'est pas susceptible de préceptes
généraux, et dépend de la nature de la cause : si, par exemple, les
faits contenus dans ces pièces sont incroyables, ou, ce qui arrive
le plus souvent, qu'ils soient détruits par d'autres preuves de même
espèce; si celui contre lequel l'acte a été signé, ou l'un des
signataires, était absent, ou mort; si les dates ne concordent pas ;
si ce qui est articulé dans ces pièces est démenti par les
événements antérieurs ou postérieurs. Souvent même l'inspection
seule suffit pour en faire découvrir le faux.
CHAP. VI. A l'égard du serment, le plaideur
offre le sien, ou ne reçoit pas celui qui lui est offert; il l'exige
de son adversaire, ou refuse de le prêter quand on l'exige de lui.
Offrir son serment sans la condition que la partie adverse sera
admise à prêter le sien, est d'ordinaire un signe de déloyauté. Au
surplus, celui qui prête serment doit se recommander par une vie qui
fasse présumer qu'il n'est pas capable de se parjurer; ou par
l'autorité même de la religion, surtout quand il ne témoigne ni
empressement ni répugnance à donner son serment; ou, en certains
cas, par le peu d'importance du procès, de sorte qu'on ne puisse
supposer qu'il ait voulu gratuitement encourir la malédiction
céleste; ou enfin, si, pouvant gagner sa cause par d'autres moyens,
il ajoute encore celui-là, comme le témoignage d'une bonne
conscience. Celui qui ne voudra pas recevoir le serment de son
adversaire dira que le serment rend les conditions du combat trop
inégales, que bien des gens ne craignent pas de se parjurer,
puisqu'il s'est même rencontré des philosophes qui ont prétendu que
les dieux ne s'occupaient pas des choses humaines ; que d'ailleurs
celui qui est prêt à jurer, sans qu'on lui défère le serment, semble
vouloir prononcer lui-même dans sa propre cause, et montre par là
que ce qu'il offre de faire est pour lui chose légère et facile.
Mais celui qui défère le serment, outre qu'il parait agir avec
modération, puisqu'il fait son adversaire arbitre du procès,
décharge d'un fardeau la conscience du juge, qui certainement aime
mieux se reposer sur le serment d'autrui que sur le sien. C'est ce
qui rend plus embarrassant le refus de prêter serment, à moins qu'il
ne s'agisse d'une chose dont il est croyable que nous n'avons pas
connaissance. Si cette excuse manque, il ne nous reste qu'une
ressource, qui est de dire que notre adversaire cherche à nous
rendre odieux, et que, ne pouvant gagner son procès, il veut au
moins se réserver le droit de se plaindre ; qu'un homme sans honneur
s'empresserait d'accepter cette condition, mais que, pour nous, nous
aimons mieux prouver ce que nous avons avancé, que de donner
occasion à qui que ce soit de nous soupçonner de parjure. Toutefois
je me souviens que, dans ma jeunesse, lorsque nous commencions à
fréquenter le barreau, nos anciens nous recommandaient de ne jamais
déférer le serment, comme aussi de ne pas laisser à notre adversaire
le choix du juge, ni de le prendre parmi ses conseils; car si un
conseil croit que l'honneur l'oblige à ne rien dire contre son
client, à plus forte raison se croira-t-il engagé à ne rien faire
qui puisse lui nuire.
CHAP. VII. Rien ne donne plus d'exercice aux avocats
que les dépositions des témoins. Elles se font ou par écrit
ou de vive voix. Les dépositions écrites donnent lieu à des débats
moins compliqués. Il semble, en effet, qu'un témoin a dû avoir moins
de peine à trahir la vérité en présence d'un petit nombre de
signataires, et son absence laisse supposer qu'il se défie de
lui-même. Si sa personne est à l'abri de tout soupçon, on peut
décrier ceux qui ont appuyé son témoignage de leur signature. lis
suscitent d'ailleurs contre eux tous une réflexion tacite, en ce que
personne ne témoigne jamais par écrit si ce n'est de son propre
mouvement, et que quiconque le fait avoue par là qu'il ne vent pas
de bien à celui contre lequel il dépose. Cependant un orateur habile
ne se hâtera pas de dire immédiatement qu'un ami qui témoigne pour
son ami, ou un ennemi contre son ennemi, ne peut parler selon la
vérité si sa foi, n'est point suspecte; mais on traitera ces deux
points dans le courant des débats.
Mais, quand les témoins sont présents, le combat est
plus rude, et, pour ainsi dire, double, soit qu'on les attaque, soit
qu'on les défende, en ce qu'il se livre et par le plaidoyer et par
l'interrogatoire. D'abord, dans le plaidoyer, on parle en général ou
pour ou contre les témoins : ce qui est un lieu commun, où l'une des
parties prétend qu'il n'y a pas de preuve plus solide que celle qui
s'appuie sur la connaissance humaine, et l'autre, pour décréditer
cette connaissance, énumère tout ce qui la rend sujette à faillir.
Ensuite on descend au particulier, quoiqu'on ne laisse pas alors
d'embrasser des multiplicités. Ainsi l'on a vu des orateurs
déprécier le témoignage d'une nation entière, et des genres entiers
de témoignages, comme les ouï-dire, ceux qui les invoquent
n'étant pas des témoins, mais ne faisant que rapporter les propos de
gens qui n'avaient pas fait serment de dire la vérité; ou bien
encore comme les dépositions de ceux qui, dans les causes de
concussions, affirment avoir compté de l'argent à l'accusé, lesquels
doivent être considérés, non comme témoins, mais comme parties au
procès. Quelquefois la plaidoirie est dirigée contre chaque témoin
en particulier, genre d'attaque qui est tantôt mêlé à la défense,
comme nous le voyons dans la plupart des, plaidoyers, tantôt l'objet
d'un discours à part, comme celui de Cicéron contre le témoin
Vatinius. Discutons donc ce point à fond, puisque nous avons
entrepris l'institution entière de l'orateur : autrement il
suffirait de lire les deux livres composés sur ce sujet par Domitius
Afer. Je l'ai cultivé, lui déjà vieux, dans ma jeunesse, et je
connais ses préceptes, non seulement pour les avoir lus, mais encore
pour les avoir entendus en grande partie de sa bouche. Celui-ci
enseigne avec beaucoup de raison que, dans le cas dont il est ici
question, le premier devoir de l'orateur est de bien connaître ce
qu'il y a de plus secret dans la cause : ce qui, du reste, est utile
dans tous les cas, et sur quoi je donnerai des conseils en ce qui
touche la manière de parvenir à cette connaissance, quand je serai
arrivé à l'endroit destiné à cette partie; mais ce que recommande
Domitius Afer est particulièrement ici nécessaire, en ce que cette
connaissance fournit une ample matière aux interrogations, et nous
met, pour ainsi dire, des armes dans les mains; en ce qu'elle nous
fait connaître, enfin, à quoi l'esprit du juge doit être préparé par
la plaidoirie; car on doit tendre d'un bout à l'autre du plaidoyer à
inspirer de la confiance dans les témoins, ou à leur ôter toute
créance, puisque chacun n'est touché de ce qu'on lui dit que suivant
qu'il a été disposé à croire ou à ne pas croire.
Mais puisqu'il y a deux espèces de témoins, les uns
volontaires, dont les deux parties se servent également, les
autres cités en justice par le juge, et qui ne sont accordés
qu'à l'accusateur; distinguons l'office de celui qui produit un
témoin d'avec l'office de celui qui le réfute. Si vous produisez un
témoin volontaire, vous pouvez savoir ce qu'il dira, et par
conséquent il vous est plus facile d'établir votre plan
d'interrogatoire; mais on a besoin, même dans ce cas, de finesse et
d'attention, et il faut veiller à ce qu'il ne se montre ni timide,
ni inconséquent, ni peu avisé; car les témoins sont sujets à se
troubler et à tomber dans les piéges que leur tend l'avocat de la
partie adverse, et, une fois enveloppés, ils nuisent plus qu'ils
n'auraient été utiles s'ils fussent restés fermes et imperturbables.
Il faut donc les tourner et retourner avant de les produire, et les
éprouver par mille questions du genre de celles que pourrait leur
faire l'adversaire. Ainsi préparés, ils ne seront pas exposés à se
contredire; ou s'ils viennent à chanceler, une question, faite à
propos par celui qui les a produits, les remettra, pour ainsi dire,
sur leurs pieds. Mais, de la part même de ceux qui paraissent le
plus assurés, il y a des trahisons dont il faut savoir se garder;
car ce sont souvent des témoins subornés par l'adversaire, et qui,
après avoir promis de ne rien dire que de favorable, font tout le
contraire, d'autant plus dangereux qu'avouant au lieu de réfuter,
ils ont plus d'autorité. Il faut donc bien examiner quels motifs les
portent à se déclarer contre la partie adverse ; et il ne suffit
point qu'ils aient été ses ennemis, il faut voir s'ils n'ont pas
cessé de l'être, s'ils ne cherchent point à se réconcilier à vos
dépens, s'ils ne se sont point laissé corrompre, et si le repentir
ne les a point fait changer de dispositions. Si ces précautions sont
nécessaires avec ceux qui s'engagent à dire des choses vraies et
dont la vérité leur est connue, elles le sont encore plus avec ceux
qui promettent de dire ce qui est faux. Car ils sont encore plus
sujets au repentir, bien plus suspects dans leurs promesses; ou
s'ils tiennent parole, il est moins difficile à l'adversaire de les
réfuter.
A l'égard des témoins cités en justice, ils sont ou
favorables ou contraires à l'accusé. Et tantôt l'accusateur connaît
leurs dispositions, tantôt il les ignore. Supposons d'abord qu'il
les connaisse, quoique dans l'un et dans l'autre cas
l'interrogatoire exige beaucoup d'art. En effet, s'il interroge un
témoin disposé à nuire à l'accusé, il doit prendre garde que cette
malveillance ne se trahisse : il évitera de l'interroger tout
d'abord sur le point principal, mais il n'y arrivera que par des
circuits, de manière à paraître lui avoir arraché ce qu'il avait le
plus envie de dire. Il ne le pressera pas trop de questions : un
témoin qui répond à tout se rend suspect; il se contentera de lui
demander ce qu'on peut raisonnablement tirer d'un seul témoin. Si,
au contraire, le témoin est favorable à l'accusé, celui qui
l'interroge doit chercher d'abord à lui extorquer ce qu'il ne
voulait pas dire, et cela ne se peut faire qu'en prenant
l'interrogatoire de loin. Le témoin fera des réponses , qu'il croira
sans conséquence; mais d'aveu en aveu il sera amené à ne pouvoir
nier ce qu'il refusait de déclarer. De même que, dans un plaidoyer,
nous semons d'abord çà et là plusieurs arguments qui, pris
isolément, ont peu de force; puis nous les rassemblons pour en
former un faisceau de preuves, qui force la conviction; de même il
faut faire mainte question à un témoin de cette espèce sur des faits
antérieurs ou postérieurs à la cause, sur le lieu, le temps, la
personne, etc., de manière à le faire tomber dans quelque réponse,
après laquelle il soit forcé d'avouer ce que nous voulons, ou de se
contredire lui-même. Si on ne réussit pas à l'amener à cette fin, il
est manifeste qu'il ne veut point parler; et ce qui reste à faire,
c'est de l'attirer en avant, pour voir s'il ne se laissera point
surprendre dans quelque endroit éloigné de la cause, où on le
retiendra longtemps, afin que, par son affectation à justifier
l'accusé sur des points étrangers au fait, il se rende suspect au
juge; car il ne lui fera pas moins de tort par là que s'il eût
déposé ce qu'il savait de vrai contre lui. Supposons maintenant que
l'accusateur ne connaisse pas les dispositions du témoin. Alors il
le sondera en l'interrogeant peu à peu, et, comme on dit, pied à
pied, et le conduira par degrés à la réponse qu'on veut lui
arracher. Mais, comme c'est quelquefois un artifice des témoins, de
répondre d'abord au gré de celui qui les interroge pour pouvoir
ensuite dire le contraire avec plus d'autorité, il est d'un orateur
habile de laisser là un témoin suspect dans le temps où il est
encore utile.
Pour les avocats de l'accusé, l'interrogatoire est en
partie plus aisé, en partie plus difficile. Plus difficile, en ce
qu'ils peuvent rarement savoir à l'avance ce que le témoin dira;
plus aisé, en ce qu'ils savent ce qu'il a dit, quand c'est à eux de
l'interroger. C'est pourquoi, lorsqu'on est en cela dans
l'incertitude, il faut soigneusement s'enquérir à l'avance quel est
celui qui charge l'accusé, quelle est la nature de son inimitié,
quelle en est la cause, afin de pouvoir détruire, axant
l'interrogation, tout ce qui a pu être inspiré par le désir de la
vengeance, par la haine, l'amitié, ou l'argent. Si la partie adverse
a peu de témoins, on s'en prévaudra; si elle en a beaucoup, on dira
que c'est une coalition. Produit-elle des gens obscurs? on attaquera
la bassesse de leur condition; des gens puissants? on attaquera leur
crédit. Cependant, il vaudra mieux exposer les raisons que ces
témoins peuvent avoir de nuire à l'accusé, raisons qui varient selon
la nature des affaires et la qualité des personnes; car on sent
qu'il n'est pas difficile à l'adversaire de répondre à des lieux
communs par d'autres lieux communs. Il produit peu de témoins? c'est
qu'il se contente de ceux qui savent le fait. Il prend des gens
obscurs? il les prend comme ils sont, en cela triomphe sa bonne foi;
et s'ils sont en grand nombre ou que ce soient des personnes de
considération, la réponse est encore plus facile. Mais de même qu'on
peut quelquefois faire l'éloge des témoins, à mesure qu'on lit leur
déposition ou qu'on les appelle dans le cours de la plaidoirie, on
peut aussi les décrier : ce qui était plus facile et plus ordinaire
autrefois, lorsque la coutume était de ne les interroger qu'après
que la cause avait été plaidée de part et d'autre. Quant à ce que
l'on peut dire contre chacun d'eux en particulier, c'est de leur
propre personne qu'il faut le tirer, et non d'ailleurs.
Reste la manière de procéder à l'interrogatoire. Le
principal est de bien connaître le témoin; car on peut alors, s'il
est timide, l'effrayer; si c'est un sot, le faire donner dans le
piége; s'il est irascible, l'exciter; s'il est vaniteux, le flatter;
s'il est prolixe, l'attirer hors de la cause. Mais si vous avez
affaire à un homme avisé et qui sait se posséder, hâtez-vous de
l'abandonner, en le traitant d'opiniâtre, en lui prêtant des
intentions hostiles, ou, au lieu de l'interroger dans les formes,
contentez-vous de le réfuter en deux mots ; ou, si vous avez
l'occasion de le décontenancer par un bon mot, ne la manquez pas ;
ou enfin, s'il vous offre quelque prise du côté de ses moeurs,
détruisez son autorité en le décriant. Il y a des personnes honnêtes
et réservées, contre lesquelles l'âpreté n'est jamais opportune; car
tel se cabre contre des attaques violentes, que la modération rend
traitable.
Tout interrogatoire ou se renferme dans la cause, ou
s'étend au delà. Dans le premier cas, le défenseur de l'accusé
prendra les choses d'un peu haut, ainsi que je l'ai recommandé pour
l'accusation, et partira d'un point qui n'ait rien de suspect; il
rapprochera les premières réponses des suivantes, amènera souvent le
témoin à faire, malgré lui, une déclaration dont on pourra tirer
avantage. Mais cela ne s'apprend pas dans les écoles, et dépend
plutôt de la pénétration naturelle ou de l'expérience de l'orateur,
que de tous les préceptes. Si pourtant on veut que j'en apporte un
exemple, je proposerai particulièrement les dialogues de
Platon et des autres philosophes qui ont imité la manière de
Socrate, où les questions sont enchaînées avec tant d'art, que, même
en satisfaisant à la plupart d'entre elles, l'interlocuteur est
néanmoins amené à la conclusion où tendaient ces questions. Il peut
arriver quelquefois qu'un témoin ne s'accorde pas avec lui-même,
plus souvent encore qu'il ne s'accorde pas avec les autres témoins ;
mais si vous savez l'interroger adroitement, vous obtiendrez par
l'art ce qui autrement ne serait que l'effet du hasard.
Dans le second cas, c'est-à-dire quand
l'interrogatoire sort de la cause, il y a pareillement bien des
questions à faire : on interroge un témoin sur la conduite de ceux
qui déposent avec lui, sur la sienne; si tel n'est pas décrié pour
ses moeurs, ou de basse condition; s'il n'est pas lié avec
l'accusateur; s'il n'existe pas des causes d'inimitié entre lui et
l'accusé. Il est rare qu'un témoin, pressé par toutes ces questions,
ne fasse pas quelque déclaration dont on puisse profiter, qu'il ne
trahisse son infidélité ou sa malveillance. Mais surtout soyez
circonspect dans votre manière d'interroger; car souvent un témoin
relève les questions des avocats d'une manière spirituelle, qui
d'ordinaire contribue beaucoup à lui concilier la faveur des juges.
Ayez soin aussi de n'employer que les termes les plus usuels, afin
que celui que vous questionnez, et qui le plus souvent est un
ignorant, vous entende sans peine, ou qu'il ne puisse pas dire qu'il
ne vous entend pas, ce qui est toujours un désappointement pour
celui qui interroge.
Quant à ces moyens honteux de suborner un témoin et
de le faire asseoir sur les bancs de la partie adverse, pour qu'en
se levant de là il lui nuise davantage, soit en déposant contre lui,
après avoir paru assis à ses côtés, soit en manifestant à dessein
une joie indiscrète et intempérante de voir que son témoignage a
semblé produire une impression favorable, dans le but de détruire
par là l'autorité de ses propres paroles et de celles des autres
témoins, dont les dépositions auraient pu être utiles : je n'en
parle que pour recommander de s'en abstenir.
Souvent les informations et les témoins ne
s'accordent pas : c'est encore matière à débats pour et contre. Les
témoins se défendent par le serment, les informations parle
consentement unanime de ceux qui les ont signées. Mêmes débats au
sujet des témoins et des arguments. D'un côté, l'on dira que les
témoins ont pour eux la connaissance des faits et la religion du
serment, et que les arguments ne sont que des inductions de
l'esprit; de l'autre, on dira que la faveur, la crainte, l'argent,
la colère, la haine, l'amitié, l'ambition , font les témoins, tandis
que les arguments se tirent de la nature des choses; qu'un juge, qui
se détermine sur des arguments, s'en rapporte à lui-même, tandis
que, en s'en rapportant à des témoins, il croit sur la foi d'autrui
ces questions sont communes à la plupart des causes; de tout temps
elles ont été agitées, et elles le seront toujours.
Quelquefois on produit des témoins de part et
d'autre; et alors il faut examiner : par rapport aux témoins,
lesquels sont les plus gens de bien; par rapport à la cause,
lesquels ont dit les choses les plus vraisemblables; par rapport
aux parties, laquelle avait le plus de crédit.
A tout cela on peut ajouter ce qu'on appelle les
témoignages divins, c'est-à-dire les réponses, les
oracles, les présages. Il y a deux manières de les
traiter : l'une générale, comme ce sujet éternel de dispute entre
les stoïciens et la secte d'Épicure : Ce monde est-il régi par
une providence? l'autre spéciale, et qui regarde certaines
parties de la divination, selon qu'elles tombent dans la
contestation. Car on ne procède pas de la même manière pour
confirmer ou détruire l'autorité des oracles, ou celle des
aruspices, des augures, des devins, des
mathématiciens, parce que la nature de ces témoignages est
différente. Entre autres preuves de cette espèce, il en est
quelques-unes dont la discussion exige beaucoup d'habileté; ce sont
ces paroles échappées dans l'état d'ivresse, de sommeil ou de
démence; ou bien ces déclarations recueillies de la bouche des
enfants, qui, dira l'un, ne savent pas feindre, et qui, dira
l'autre, ne savent pas discerner.
Au reste, la preuve par témoins a tant d'autorité,
que l'on peut tirer des arguments aussi puissants du défaut de
témoins que des dépositions de ceux qui sont produits: Vous avez
payé : qui a remis l'argent ? où a-t-il été compté ? d'où
provenait-il? - Vous m'accusez d'empoisonnement : où ai-je acheté le
poison ? de qui? combien? de qui me suis-je servi ? en présence de
qui? Circonstances que Cicéron discute presque toutes ans son
plaidoyer pour Cluentius, accusé d'empoisonnement. Voilà, dans le
plus court résumé, ce qui regarde les preuves inartificielles.
CHAP. VIII. La seconde partie des preuves, qui est
purement artificielle, et consiste entièrement dans l'emploi
de moyens intellectuels, propres à persuader, est le plus souvent ou
tout à fait négligée, ou très légèrement effleurée par les orateurs,
qui, évitant le sentier épineux et âpre des arguments, se reposent
complaisamment dans des lieux plus agréables. Semblables à ces
voyageurs dont nous parlent les poètes, et qui séduits, chez les
Lotophages, par le goût d'un certain fruit, ou charmés parle chant
des Sirènes, ont préféré la volupté à la vie, ces orateurs, en
poursuivant un vain fantôme de gloire, se laissent ravir la
victoire, qui est pourtant le but unique qu'on se propose en
parlant.
Or, cette éloquence accessoire, qui accompagne le
cours de l'oraison, n'est destinée qu'à revêtir et orner les
arguments, comme la chair couvre les nerfs du corps humain. Si, par
exemple, il s'agit d'une action qu'a fait commettre la colère, ou la
crainte, ou la cupidité, l'orateur pourra s'étendre un peu sur la
nature de chacune de ces passions. Il peut encore entrer dans ces
développements oratoires, si son sujet lui donne occasion de louer,
de blâmer, d'exagérer, d'atténuer, de censurer, de dissuader, de se
livrer à des plaintes, de consoler, d'exhorter. Tout cela,
dira-t-on, n'est pas incompatible avec la certitude ou la
vraisemblance. Non, sans doute, et je ne disconviens pas de
l'utilité de ce qui plaît, encore moins de ce qui émeut; mais tout
cela est encore plus puissant, lorsque le juge se croit bien
instruit : à quoi on ne peut parvenir qu'à l'aide des deux sortes de
preuves dont nous avons parlé.
Avant de distinguer les différentes espèces de
preuves artificielles, je crois nécessaire d'indiquer ce qu'elles
ont de commun. Premièrement, il n'y a point de question qui ne roule
ou sur une chose ou sur une personne; secondement, on n'argumente
jamais que sur les accidents des choses ou des personnes;
troisièmement, les arguments se considèrent en eux-mêmes ou
relativement à d'autres; quatrièmement, la confirmation ne peut
résulter que des conséquents ou des contraires;
cinquièmement, les conséquents ou les contraires ont
nécessairement leur fondement ou dans le temps qui a précédé le
fait, ou dans le temps qui l'a accompagné, ou dans le temps qui l'a
suivi; sixièmement enfin, une chose ne peut se prouver que par une
autre; et cette autre, il faut qu'elle soit ou plus grande, ou
égale, ou moindre. Pour les arguments, ils naissent ou des
questions, qui peuvent être envisagées en elles-mêmes et sans
acception des personnes ni des choses, ou de la cause même,
lorsqu'elle fournit quelque considération particulière et inhérente
à l'affaire dont il s'agit. On peut dire aussi que toute preuve est,
ou nécessaire, ou vraisemblable, ou n'ayant rien qui
répugne. Enfin, toute preuve rentre dans une des quatre formes
suivantes : telle chose n'est pas, parce que telle autre est : il
est jour, donc il n'est pas nuit; telle chose est, parce que
telle autre est aussi : le soleil est sur l'horizon, donc il est
jour; telle chose est, parce que telle autre n'est pas : il
n'est pas nuit, donc il est jour; enfin, telle chose n'est pas,
parce que telle autre n'est pas non plus : il n'est pas
raisonnable, donc il n'est pas homme. Ces généralités posées, je
passe aux espèces.
CHAP. IX. Toute preuve artificielle consiste ou dans
des signes, ou dans des arguments, ou dans des exemples.
Je sais que la plupart des rhéteurs regardent les signes
comme une partie des arguments. Pour moi, j'ai deux raisons pour les
distinguer des arguments : la première, c'est que les signes
appartiennent, ou peu s'en faut, aux preuves inartificielles : en
effet, un vêtement ensanglanté, des cris, des taches livides,
et autres choses semblables, sont des moyens extrinsèques, comme les
pièces, les bruits publics, les témoins; ils ne
sont point de l'invention de l'orateur, mais ils viennent à lui avec
la cause; la seconde, c'est que les signes, s'ils sont indubitables,
ne sont pas des arguments, puisque là où sont ces sortes de signes
il n'y a plus de contestation, et qu'il n'y a lieu d'argumenter que
sur des choses controversées; et s'ils sont douteux, ce ne sont pas
non plus des arguments, ayant eux-mêmes besoin d'arguments. Or, ils
se divisent d'abord en ces deux espèces, les uns étant, comme je
viens de le dire, nécessaires ou certains; les autres,
non nécessaires ou incertains. Les premiers, que les
Grecs appellent τεκμήρια, ἄλυτα σημεῖα, sont ce qu'ils sont, et ne
peuvent pas être autrement; et, en vérité, je ne sais s'ils
comportent les préceptes de l'art. Car là où se rencontre un signe
indestructible, aauTov, il ne peut y avoir lieu à contestation : ce
qui arrive lorsqu'il y a nécessité qu'une chose soit ou ait été, et
réciproquement qu'une chose ne soit pas ou n'ait pas été. Cela
reconnu dans une cause, il ne peut plus y avoir de contestation sur
le fait. Ce genre de preuves embrasse tous les temps : Une femme
est accouchée, donc elle a eu commerce avec un homme : voilà pour le
passé; - Un grand vent s'est élevé sur la mer, donc il y a
des flots : voilà pour le présent; - Quiconque est blessé au
coeur doit mourir : voilà pour le futur. De même, On ne peut
recueillir où l'on n'a pas semé; - On ne peut pas être à
Rome, si l'on est à Athènes; - Il est impossible qu'un homme
ait été blessé d'un coup d'épée, s'il ne porte une cicatrice.
Certains signes sont réciproques : Qui respire, vit; qui vit,
respire. D'autres ne le sont pas car, De ce que marcher,
c'est se mouvoir, il ne s'ensuit pas que se mouvoir soit marcher;
- Une femme peut ne pas enfanter et avoir eu commerce avec un
homme; - Il a pu y avoir des flots sur la mer sans qu'il y
eût du vent; - On peut mourir, sans avoir été blessé au coeur.
De même, On peut avoir semé là où l'on n'a rien recueilli; -
Celui qui n'était pas à Athènes peut n'avoir pas été à Rome;
- On peut avoir une cicatrice, sans avoir été blessé d'un coup
d'épée.
Les signes de la seconde espèce, appelés par les
Grecs εἴκότα, vraisemblables ou non nécessaires, ne suffisent pas
seuls pour lever toute incertitude ; mais joints à d'autres, ils ne
laissent pas d'avoir beaucoup de poids.
On appelle signe, ou, suivant d'autres,
indice, vestige, une chose qui sert à en faire entendre
une autre: ainsi, des traces de sang font supposer un meurtre.
Mais comme ce sang peut provenir d'un sacrifice ou d'un saignement
de nez, un vêtement ensanglanté ne prouve pas toujours un homicide.
Mais ce signe, quoique insuffisant par lui-même, devient un
témoignage, quand il est appuyé de certaines circonstances si, par
exemple, vous étiez ennemi de celui qui a été tué, si vous lui
aviez fait des menaces, si vous étiez dans le même lieu que lui,
cette coïncidence fait paraître certain ce qui n'était que douteux.
Parmi ces signes, il y en a que chaque partie peut interpréter à sa
manière, comme les taches livides, l'enflure; car ils
peuvent être attribués à l'intempérance aussi bien qu'au poison, de
même qu'une blessure dans le sein peut être la suite d'un assassinat
ou d'un suicide. Ces deux interprétations sont également bonnes, et
tout dépend des circonstances.
Hermagoras met au rang des signes, mais des signes
douteux, l'exemple suivant : Atalante n'était pas vierge, parce
qu'elle courait les bois avec les jeunes gens. Si l'on admet
cela pour un signe, je crains bien qu'il ne faille donner ce nom à
toutes les inductions qu'on peut tirer d'un fait; et, à dire vrai,
l'orateur les traite de la même manière. Car, lorsque les juges de
l'Aréopage condamnèrent un enfant pour avoir arraché les yeux à des
cailles, que jugèrent-ils, sinon que c'était le signe d'un naturel
pervers, qui avec l'âge ne manquerait pas de devenir très dangereux
pour ses semblables? C'est ainsi que la popularité de Spurius Mélius
et de Marcus Manlius fut regardée comme le signe d'une ambition qui
les faisait aspirer à la royauté. Mais, encore une fois, ce
raisonnement nous mènerait trop loin; car si c'est un signe
d'adultère dans une femme, de se baigner avec des hommes, c'en sera
un aussi de manger avec des jeunes gens, c'en sera un d'avoir un
ami. Par la même raison on pourra dire qu'un corps épilé, une
attitude brisée, une robe traînante, sont dans un homme les signes
d'un caractère mou et efféminé, s'il est vrai que le signe étant, à
proprement parler, ce qui, à l'occasion de la chose dont il s'agit,
tombe sous les yeux, ces manières décèlent la dépravation des
moeurs, comme des traces de sang décèlent un meurtre. Généralement
encore on regarde comme des signes ces coïncidences, qu'on a eu
souvent occasion de remarquer, et qu'on nomme pronostics. Ainsi
Virgile dit : Le vent rougit le disque d'or de Phébé. - La
corneille sinistre appelle la pluie à pleine voix. Je consens,
pour moi, qu'on donne le nom de signes à ces pronostics, s'ils sont
tirés de l'état du ciel. Car, si le vent rend la lune rouge, cette
rougeur est signe de vent; si, comme l'induit le même poète, l'air
condensé ou raréfié influe sur le chant des oiseaux, le chant devra
aussi être considéré comme un signe. Sur quoi il est à remarquer que
de petites choses sont quelquefois les signes de grands événements.
A l'égard des grandes choses, il n'est pas étonnant qu'elles en
présagent de petites.
CHAP. X. Je passe aux arguments. Je comprends
sous cette dénomination toutes les formes de raisonnement que les
Grecs appellent enthymème, épichérème,
démonstration (ἐνθυμήματα, ἐπιχειρήματα, ἀποδείξεις), et qui, au
fond, tendent à peu près au même but, malgré la différence des noms.
L'enthymème, pour me servir du terme grec, que nous
ne traduisons qu'imparfaitement par commentum et
commentatio, a trois significations. On entend par là,
premièrement, toute conception de l'esprit; mais nous ne le prenons
pas ici dans ce sens; secondement, toute proposition accompagnée de
son raisonnement; troisièmement, une certaine conclusion d'argument,
tirée des conséquents ou des contraires, bien qu'on s'accorde peu
sur cette dernière définition; car il y en a qui donnent le nom
d'épichérème à la conclusion tirée des conséquents, et d'autres, en
plus grand nombre, ne reconnaissent pour véritable enthymème que la
conclusion tirée des contraires : à cause de quoi Cornificius
l'appelle argument des contraires. On le nomme encore
syllogisme de rhétorique; ou syllogisme imparfait, parce
qu'il n'a ni autant de parties ni des parties aussi distinctes que
le syllogisme philosophique, dont la forme n'est pas compatible avec
le genre oratoire.
Quant à l'épichérème, Valgius l'appelle agression.
Celsus pense que l'épichérème consiste, non dans la forme que nous
lui donnons, mais dans la chose que nous attaquons, c'est-à-dire
l'argument par lequel nous nous proposons de prouver quelque chose,
bien que les mots ne le développent pas encore, mais pourvu qu'il
soit conçu dans l'esprit. D'autres veulent que ce soit, non un
argument mental ou ébauché, mais un argument parfait, et descendant
jusqu'à la dernière espèce. Aussi, le plus ordinairement, est-ce le
nom particulier qu'on donne à une proposition renfermée, au moins,
dans trois parties. Quelques-uns ont appelé l'épichérème une raison;
Cicéron la définit un raisonnement, ce qui est mieux, bien
qu'il semble avoir tiré ce nom du syllogisme; car il appelle l'état
syllogistique un état de raisonnement, s'appuyant, à cet
égard, d'exemples philosophiques; et, comme il y a quelque affinité
entre le syllogisme et l'épichérème, il est excusable d'avoir donné
ce nom l'épichérème.
La démonstration, ἀποδείξις, est une preuve
évidente : de là ce que les géomètres appellent des
démonstrations linéaires, γραμμικαὶ ἀποδείξις. Cécilius
prétend que la démonstration ne diffère de l'épichérème que par la
manière de conclure, et qu'elle est un épichérème imparfait, par la
même raison qu'on dit que l'enthymème diffère du syllogisme, dont il
fait cependant partie. Quelques auteurs croient que la démonstration
est renfermée dans l'épichérème, et qu'elle est la partie qui en
fait la preuve. Quoi qu'il en soit, du moins s'accorde-t-on à
définir l'un et l'autre une manière de prouver des choses douteuses
par des choses qui ne le sont pas : ce qui est commun à tout
argument; car on ne peut pas prouver le certain par l'incertain. Les
Grecs comprennent tous ces arguments sous le nom générique πίστεις,
qu'en suivant le sens propre nous pourrions appeler fides,
mais que nous traduirons plus clairement par probatio.
Quant au mot argument, il a aussi plusieurs
significations; car on appelle arguments les fables scéniques; et
Pédianus expliquant le sujet des Oraisons de Cicéron : L'argument,
dit-il, est tel. Cicéron lui-même écrit ainsi à Brutus :
Craignant que par là nous ne fassions tomber quelque reproche sur
notre cher Caton, quoique l'argument soit bien différent, etc. :
ce qui fait voir que toute matière, dont on fait choix pour écrire,
peut être ainsi appelée. Et cela ne doit pas surprendre, puisque
c'est un mot usuel même parmi les artisans : aussi lisons-nous dans
Virgile un grand argument; et un ouvrage un peu considérable
est vulgairement appelé argumentosum. Mais il s'agit ici de
ce qu'on entend par preuve, indice, conviction,
agression, tous noms qu'il faut pourtant distinguer, si je ne
me trompe. En effet, la preuve et la conviction ne s'établissent pas
seulement par des arguments artificiels, mais aussi par des moyens
inartificiels; et quant au signe qu'on appelle indice, j'ai déjà
montré qu'il ne devait pas être mis au nombre des arguments.
Donc, puisque l'argument est une manière de prouver
une chose par une autre, et de confirmer ce qui est douteux par ce
qui ne l'est pas, il est indispensable qu'il y ait en toute cause un
point qui n'ait pas besoin d'être prouvé; car s'il n'y avait rien de
certain, ni qui parût tel, l'orateur serait dans l'impossibilité de
prouver quoi que ce fût. Or nous tenons pour certain ce qui tombe
sous les sens, comme ce que nous voyons, ce que nous entendons :
tels sont les signes; ensuite, les choses sur lesquelles les hommes
sont généralement d'accord, par exemple, qu'il existe des dieux,
qu'il faut honorer son père et sa mère; puis, ce qui est
établi par les lois, ou ce qui est passé en usage, non pas
précisément chez tous les peuples, mais dans la cité, dans le pays
où le procès a lieu; car, dans la jurisprudence, la coutume a force
de loi en bien des rencontres; enfin, ce dont les deux parties
conviennent, ce qui a déjà été prouvé, ce qui n'est point contesté
par l'adversaire. Voici donc, par exemple, comme on peut argumenter
: Puisque le monde est régi par une providence, la république
doit être gouvernée; car, s'il est constant que le monde est
gouverné par une providence, on induit avec raison de là que la
république a également besoin de l'être. Mais pour bien manier les
arguments, il faut que l'orateur ait étudié la vertu et la nature de
chaque chose, et ses effets les plus ordinaires. De là naît ce qu'on
appelle vraisemblance, εἰκότα, que je divise en trois degrés. Le
premier, qui repose sur un fondement très solide, parce qu'il est
ordinairement vrai, par exemple, qu'un père aime ses enfants;
le second, qui, pour ainsi dire, penche un peu vers l'incertitude,
comme dans cet exemple : Celui qui se porte bien aujourd'hui
verra le jour de demain; le troisième, qui n'a seulement rien
qui répugne Un vol commis dans une maison a dû l'être par
quelqu'un de la maison. C'est pour cela qu'Aristote, dans le
second livre de sa Rhétorique, a été si soigneux de
rechercher ce qui affecte d'ordinaire et les personnes et les
choses; quelle convenance ou quelle opposition la nature elle-même a
mise entre telle et telle personne ou entre telle et telle chose;
quelles sont, par exemple, les suites de la richesse, de l'ambition,
de la superstition; quelles sont les inclinations des bons, des
méchants, de l'homme de guerre, de l'homme des champs; par quel
moyen on a coutume de rechercher ou d'éviter ce que l'on regarde
comme un bien ou comme un mal. Pour moi, je ne veux pas traiter à
fond cette matière; ce détail serait non seulement trop long, mais
même impossible, ou plutôt infini; d'ailleurs cela est du domaine de
l'intelligence commune : si pourtant on le désire, on peut consulter
l'ouvrage que j'ai cité. Mais pour donner une idée générale de la
vraisemblance, qui certainement constitue la majeure partie de
l'argumentation, en voici encore quelques exemples, qui sont comme
la source des autres : Est-il croyable qu'un fils ait, tué son
père? ou qu'un père ait commis un inceste avec sa fille?
et contrairement, l'empoisonnement n'est-il pas présumable dans
une marâtre, l'adultère dans un débauché? Est-il croyable qu'un
crime ait été commis à la vue de tout le monde, ou qu'on se soit
décidé à porter un faux témoignage pour une faible somme? En
effet, chacune de ces données a, pour ainsi dire, son caractère
propre, qui ordinairement ne se dément pas : je dis ordinairement,
et non pas toujours; autrement, ce seraient choses indubitables, et
non pas des arguments.
Examinons maintenant les lieux des arguments. Quoique
certains rhéteurs regardent comme tels ceux dont j'ai parlé plus
haut, j'appelle proprement lieux, non ce que l'on entend
d'ordinaire par ce mot, c'est-à-dire ces hors-d'oeuvre qui roulent
sur le luxe, l'adultère, ou autres choses semblables, mais bien
les endroits où se tiennent cachés les arguments, et d'où il faut
les tirer. Car de même que toutes les terres ne produisent pas
toutes sortes de fruits, et qu'on ne peut trouver certains oiseaux
ou autres animaux que dans le pays où ils naissent et où ils
habitent; de même que, parmi les poissons, les uns se plaisent dans
la haute mer, les autres près des rochers, et qu'ils diffèrent
suivant les parages et suivant les côtes; qu'ainsi on ne pêcherait
pas dans notre mer l'esturgeon ou le sarget; de même aussi tous les
arguments ne se trouvent pas partout, et il ne faut pas les chercher
çà et là : autrement, on s'exposerait à errer longtemps, et, après
s'être bien fatigué, on ne devrait qu'au hasard de rencontrer ce
qu'on aurait cherché en aveugle. Mais si l'on connaît bien la source
de chaque argument, arrivé au lieu où il est caché, d'un coup d'oeil
on le découvrira.
C'est surtout de la personne qu'il faut tirer
les arguments, puisque, comme je l'ai dit, les questions ne peuvent
concerner que les personnes ou les choses; tandis que
les motifs, le temps, le lieu, l'occasion,
l'instrument, le mode etc., sont seulement des
accidents des choses. Quant aux personnes, je n'entrerai pas dans
l'examen de leurs accidents, ainsi que la plupart l'ont fait: je me
contenterai d'indiquer les lieux fertiles en arguments.
Or ces lieux sont la naissance : on est
ordinairement porté à croire que les enfants ressemblent à leurs
pères ou à leurs aïeux, et quelquefois leurs murs se ressentent en
bien ou en mal du sang dont ils sont sortis; la nation : chacune a
son caractère propre, et la même chose ne sera pas probable de la
part d'un Romain, d'un Grec ou d'un barbare; la patrie :
chaque cité a ses institutions, ses opinions particulières; le
sexe : vous croirez plutôt au vol de la part d'un homme, à
l'empoisonnement de la part d'une femme; l'âge : autre temps,
autres soins; l'éducation et les maîtres : il importe comment
et par qui on a été élevé; l'extérieur: la beauté marche
rarement avec la sagesse, et la force laisse aisément soupçonner le
libertinage et l'audace; et réciproquement; la fortune : la
même chose ne sera pas croyable de la part d'un riche ou d'un
pauvre, de la part d'un homme qui a nombre de parents, d'amis, de
clients, ou d'un homme privé de tout cela ; la condition : la
différence est grande entre un homme illustre et un homme obscur, un
magistrat et un particulier, un père et un fils, un citoyen et un
étranger, une personne libre et un esclave, un homme marié et un
célibataire, un père de famille entouré d'enfants, et un père qui a
perdu les siens; le naturel: la cupidité, l'irascibilité, la
sensibilité, la cruauté, la sévérité, et autres inclinations
semblables, déterminent souvent a croire ou à ne pas croire; le
genre de vie, selon qu'il est somptueux, ou frugal , ou sordide;
les occupations : un homme des champs, un avocat, un
négociant, un homme de guerre, un marin, un médecin, pensent et
agissent différemment. Il faut aussi examiner dans chacun, non
seulement ce qu'il est, mais ce qu'il affecte de paraître, riche ou
éloquent, vertueux ou puissant. On prend en considération les
antécédents; car on juge ordinairement du présent par le passé.
On ajoute à tout cela ces mouvements soudains qui s'emparent
de l'âme, comme la colère, la peur. A l'égard des desseins, ils
embrassent le passé, le présent, l'avenir; et quoiqu'ils
appartiennent aux personnes, je crois qu'il vaut mieux les rapporter
à cette espèce d'arguments, qui se tire des motifs. J'en dis autant
de ces dispositions d'esprit, à l'aide desquelles on examine
si tel est ami ou ennemi de tel. Au nombre des lieux que fournit la
personne, on met aussi le nom, qui en est sans doute
un accident nécessaire, mais dont on tire rarement des arguments, si
ce c'est lorsque ce nom a été donné pour quelque raison
particulière, comme celui de sage, de grand, etc., ou
lorsqu'il a inspiré quelque pensée à celui qui le porte, comme à
Lentulus, par exemple, qui trempa dans la conjuration de Catilina,
parce que les livres des Sibylles et les réponses des aruspices
promettaient la domination à trois Cornélius; et qu'après
Sylla et Cinna il se croyait le troisième, s'appelant lui-même
Cornélius. Nous voyons aussi, dans Euripide, que le frère de
Polynice lui reproche son nom, comme un argument de son
caractère; mais cette allusion me paraît froide. Il faut avouer
pourtant que le nom donne souvent matière à la raillerie, et nous en
avons plus d'un exemple dans les discours de Cicéron contre Verrès.
Voilà à peu près tous les arguments auxquels peuvent donner lieu les
personnes. Car je ne puis pas tout dire ni sur ce point ni sur les
autres, et je me contente d'indiquer la méthode : chacun y suppléera
de lui-même.
Je passe maintenant aux choses; et, comme les
actions ont un rapport plus immédiat avec les personnes, c'est par
elles que je dois commencer. Or, toute action donne lieu aux
questions suivantes : Pourquoi a-t-elle été faite? ou? quand?
comment? par quels moyens? Les arguments se tirent donc
premièrement des motifs d'une action faite ou à faire. La matière de
ces motifs, que les Grecs appellent, les uns ὕλην, les autres
δύναμιν, se divise en deux genres, dont chacun se subdivise en
quatre espèces. En effet, la raison de toute action a
ordinairement son principe dans le désir d'acquérir un bien, de
l'augmenter, de le conserver, d'en jouir; ou d'éviter un mal, de
s'en délivrer, de le diminuer, de le supporter; et ces motifs
entrent pour une très grande part dans toutes nos délibérations.
Mais ce sont les bonnes actions qui sont inspirées par ces motifs;
les mauvaises, au contraire, viennent des fausses opinions; car leur
origine est dans l'idée qu'on se fait du bien et du mal. De là les
erreurs et les passions déréglées, telle que la colère, la haine,
l'envie, la cupidité, l'espérance, l'ambition, l'audace, la crainte,
etc. Quelquefois à ces passions se joignent des causes fortuites,
telles que l'ivresse, l'ignorance, qui servent tantôt
à excuser, tantôt à prouver le fait incriminé : par exemple, Si
vous avez tué quelqu'un en tendant des embûches à un autre. Or,
on examine les motifs d'une action, non seulement pour soutenir
l'accusation, mais aussi pour la repousser; comme lorsqu'on prétend
qu'on a eu raison de faire telle action, c'est-à-dire qu'on a été mu
par un motif honorable, ce qui a été amplement expliqué dans le
troisième livre. Les questions de définition dépendent aussi
quelquefois des motifs : par exemple, Est-on tyrannicide pour
avoir tué un tyran par qui on a été surpris en adultère? - Est-on
sacrilège pour avoir enlevé des armes suspendues dans un temple,
afin de chasser l'ennemi de la ville?
Les arguments se tirent aussi du lieu. Car une
action est plus ou moins probable, suivant que le fait s'est passé
sur une montagne ou dans une plaine, sur le bord de la mer ou au
milieu, dans un endroit peuplé ou désert, proche ou éloigné,
favorable ou contraire à tel dessein. Cicéron a traité cette
sorte de considérations avec beaucoup de force dans son plaidoyer
pour Milon. La circonstance du lieu est si importante, qu'elle sert
à décider, non seulement la question conjecturale, mais quelquefois
même la question, de droit; si, par exemple, c'est un lieu privé
ou public, sacré ou profane, qui est à nous ou à autrui; de même
qu'à l'égard de la personne, on examine si c'est un magistrat, un
père, un étranger. De là naissent, en effet, les questions
suivantes : Vous avez dérobé l'argent d'un particulier; mais
comme c'était dans un temple, ce n'est pas un larcin, c'est un
sacrilège. - Vous avez tué un adultère, ce que la loi permet;
mais vous l'avez tué dans une maison de débauche, c'est un meurtre.
- Vous avez outragé cet homme, mais cet homme était un magistrat
: or, c'est un crime de lèse-majesté. Ou bien, au contraire :
J'ai pu faire cela, parce que j'étais père, parce que j'étais
magistrat. Il faut donc remarquer que les arguments tirés du
lieu, en même temps qu'ils servent à établir le fait, sont la
matière des questions de droit. Quelquefois aussi le lieu sert à
décider les questions de qualité; car les mêmes choses ne sont pas
permises ou bienséantes partout. Il importe encore de considérer la
ville où l'affaire se juge, parce que chaque pays a ses coutumes et
ses lois. Souvent le lieu suffit pour rendre la cause recommandable
ou odieuse. Ainsi, dans Ovide, Ajax s'écrie : Quoi! c'est devant
les vaisseaux que nous plaidons, et qu'Ulysse est mis en comparaison
avec moi! Ainsi on reprochait particulièrement à Milon
d'avoir tué Clodius sur les tombeaux de ses ancêtres. Enfin la
circonstance du lieu est de la même importance dans les
délibérations, aussi bien que le temps, dont l'ordre veut que
je parle maintenant.
Le temps, comme je l'ai déjà dit ailleurs, est
pris dans deux acceptions, l'une générale, quand on dit :
maintenant, autrefois, sous Alexandre, pendant le siège de Troie;
en un mot, quand on parle indéfiniment du passé, du
présent, ou de l'avenir; l'autre particulière, qui
détermine certaines circonstances naturelles : en été, en hiver,
de nuit, de jour; ou certaines circonstances fortuites :
pendant la peste, pendant la guerre, dans un repas. Quelques-uns
de nos rhéteurs ont cru suffisamment distinguer ces deux acceptions,
en disant, pour l'une, le temps, et pour l'autre, les
temps. Ces distinctions trouvent leur place dans les
délibérations, dans le genre démonstratif, mais surtout dans le
genre judiciaire. En effet, elles soulèvent les questions de droit,
elles déterminent la qualité, et contribuent beaucoup à éclairer la
conjecture. N'en tire-t-on pas quelquefois des preuves
incontestables, lorsqu'on établit, comme dans l'exemple que j'ai
donné, que le signataire d'un acte était mort avant sa date, ou bien
qu'à l'époque où le crime a été commis, l'accusé était encore
enfant, ou que même il n'était pas né? En outre, tous les arguments
se tirent sans peine de ce qui a précédé le fait, de ce qui l'a
accompagné, de ce qui l'a suivi : - de ce qui l'a précédé, vous
l'avez menacé de la mort, vous êtes sorti de nuit, vous avez pris
les devants, outre que les motifs des actions se rattachent
ordinairement au passé; - de ce qui l'a accompagné, sur quoi
certains rhéteurs ont fait une distinction un peu trop subtile du
temps joint : un bruit s'est fait entendre; et du temps lié à
l'action : des cris se sont élevés; - enfin de ce qui l'a suivi,
vous vous êtes caché, vous avez pris la fuite, son corps est
devenu tout livide et enflé. La raison de toute action et de
toute parole se renferme dans ce cercle de considérations, mais sous
un double rapport; car souvent une action présente se lie à la
pensée d'une action future, et réciproquement. On objecte, par
exemple, à un homme accusé de trafic de femmes esclaves, l'achat
qu'il a fait d'une belle femme, qui avait été condamnée pour
adultère; ou à un débauché accusé de parricide, d'avoir dit
précédemment à son père : Vous ne me ferez plus dorénavant de
réprimandes. Ce n'est pas à dire que le premier est un
entremetteur, parce qu'il a acheté une femme; mais il l'a achetée,
parce qu'il était entremetteur. De même, le débauché n'est pas
parricide, parce qu'il a parlé ainsi à son père; mais il a parlé
ainsi, parce qu'il avait l'intention de tuer son père. Quant aux
événements fortuits, qui donnent également lieu aux
arguments, ils appartiennent sans contredit au temps qui a suivi;
mais d'ordinaire on les relève par quelque qualité particulière à la
personne dont on parle : Scipion était un plus grand capitaine
qu'Annibal; il a vaincu Annibal. C'est un bon pilote, il n'a jamais
fait naufrage. C'est un bon laboureur, il a fait une riche moisson.
Et contrairement: il a toujours aimé le faste, il a dissipé son
patrimoine. Il a toujours mené une vie honteuse, il est méprisé de
tout le monde. Il faut encore, surtout dans les causes
conjecturales, considérer les facilités. Ainsi il est
vraisemblable que le petit nombre a été tué par le grand, le faible
par le fort, celui qui dormait par celui qui veillait, et celui qui
ne s'attendait à rien par celui qui était sur ses gardes; et
réciproquement. Ce lieu est aussi d'une grande importance dans les
délibérations; et, dans le genre judiciaire, il porte ordinairement
sur deux points: si on l'a voulu, si on l'a pu; car
l'espérance détermine la volonté. De là cette conjecture dans
Cicéron : C'est Clodius qui a tendu des embûches à Milon, et non
Milon à Clodius : ce dernier était accompagné d'esclaves robustes,
il était à cheval, rien n'embarrassait ses mouvements; Milon n'avait
avec lui que des femmes, il était en voiture, enveloppé dans un
manteau. Aux facilités, on peut joindre l'instrument; car
Il fait partie des facilités et des moyens d'exécution; mais
quelquefois de l'instrument naissent les signes: telle serait la
pointe d'une épée trouvée dans le corps. Enfin, on ajoute à tout
cela le mode, τρόπον, c'est-à-dire la manière dont une chose
s'est passée : autre source d'arguments, qui se rapportent,
tantôt à la qualité et à la question de droit : par exemple, si
l'on soutenait qu'il n'était pas permis de faire mourir un adultère
par le poison, mais par le fer; tantôt à la conjecture, comme si
je dis que telle action a été faite innocemment, qu'ainsi elle
l'a été à la vue de tout le monde; que telle autre a été faite dans
une intention coupable, qu'ainsi on a etc recours à des piéges, à la
nuit, à la solitude.
Il est vrai que, dans toutes les choses que l'on
considère en elles-mêmes, et indépendamment des personnes et de
toutes les circonstances qui font la matière de la cause, il y a
trois questions à examiner : si une chose est, ce qu'elle est,
quelle elle est; mais comme certains lieux d'arguments sont
communs à ces trois questions, il n'est pas facile d'assigner à
chacune ses lieux propres, et je crois qu'il vaut mieux les y
rapporter, suivant l'occurrence.
Les arguments se tirent donc de la définition
ou de la fin, car on dit l'un et l'autre; et on procède de
deux manières: ou l'on recherche simplement si telle chose est
une vertu, ou l'on définit d'abord la vertu. Cette
définition se fait tantôt en termes généraux : la rhétorique est
l'art de bien dire; tantôt d'une manière détaillée : la
rhétorique est l'art de bien inventer, de bien disposer et de bien
exprimer ce que l'on doit dire, et de le prononcer avec une mémoire
sûre et de la dignité dans l'action. En outre, on définit une
chose par sa nature, comme dans l'exemple précédent, ou par
l'étymologie, comme lorsqu'on dit, assiduus vient d'asse
dando; locuples, pecuniosus, viennent de
locorum copia, pecorum copia. Le genre, l'espèce, les
différences, les propriétés, semblent appartenir
particulièrement à la définition, et de toutes ces considérations
naissent des arguments. Le genre ne prouve pas l'espèce, mais
il sert beaucoup à l'exclure : ainsi, de ce que c'est un arbre,
il ne s'ensuit pas que ce soit un platane; mais, si ce n'est point
un arbre, certainement ce n'est point un platane; de même, ce qui
n'est pas vertu ne saurait jamais être justice. Il faut donc
descendre du genre à la dernière espèce. Par exemple, l'homme est
un animal: cela ne suffit pas, car animal est le genre;
un animal mortel: cela ne suffit pas encore, car mortel
est bien une espèce, mais cette définition lui est commune avec les
autres animaux; un animal raisonnable : la définition ne
laisse plus rien à désirer. L'espèce, au contraire, confirme
le genre, et ne l'exclut pas toujours; car ce qui est justice est
toujours vertu, et ce qui n'est pas justice peut néanmoins être
vertu, comme le courage, la fermeté, la tempérance. On ne peut
donc jamais retrancher le genre de l'espèce, à moins de retrancher
de ce genre toutes les espèces qui en dépendent, de cette manière:
ce qui n'est ni immortel, ni mortel, n'est point animal.
Après le genre et l'espèce, viennent les propriétés et les
différences. Les premières confirment la définition, les
secondes la détruisent. La propriété est un accident qui
n'appartient qu'à un seul sujet, comme à l'homme de parler et
de rire: ou qui lui appartient, mais non pas exclusivement,
comme au feu d'échauffer. Ensuite, une même chose peut avoir
plusieurs propriétés, comme le feu de luire et de brûler.
C'est pourquoi le défaut d'une propriété quelconque détruit la
définition; mais une propriété quelconque ne la confirme pas
toujours. Or, on a très souvent à examiner ce qui est le propre de
chaque chose. Par exemple, si, en se fondant sur l'étymologie, on
disait que le propre d'un tyrannicide est de tuer un tyran,
cela serait faux; car le bourreau auquel on l'aurait livré pour le
tuer, ou celui qui l'aurait tué par mégarde ou contre son gré, ne
mériterait pas ce nom. Mais tout ce qui n'est pas propre est
différent. Ainsi, autre chose est d'être esclave, autre chose
est de servir: différence qui, au sujet d'un homme insolvable,
que la loi condamne à servir son créancier, donne lieu à cette
question : Un débiteur, qui recouvre sa liberté, appartient- il à
la classe des affranchis, comme l'esclave, à qui son maître a rendu
la liberté? Il se présente encore d'autres cas, dont je parlerai
dans le septième livre. On appelle différence ce qui, après
que le genre a été divisé en espèces, distingue l'espèce même.
Animal, voilà le genre; mortel, voilà l'espèce;
terrestre ou bipède, voilà la différence, car ce n'est
pas encore la propriété; mais déjà l'espèce diffère de l'aquatique
ou du quadrupède : ce qui, du reste, ne regarde pas tant
l'argument que l'exactitude de la définition. Cicéron sépare dans la
définition le genre et l'espèce, ou la forme,
comme il l'appelle, et les subordonne à la relation. Par
exemple, un testateur lègue à un ami toute son argenterie, et le
légataire réclame également l'argent non payé : la demande est
fondée sur le genre. On nie que le legs fait par un mari à la
mère de famille soit dû à la femme qui n'avait pas cette qualité
: la raison est tirée de l'espèce, parce qu'il y a deux sortes de
mariages.
Le même auteur enseigne que la division est d'un
grand secours pour bien définir, et qu'elle diffère de la partition,
en ce que celle-ci divise un tout en parties, et que celle-là divise
le genre en espèces. Or, dit-il, le nombre des parties est
indéterminé, car on ne peut dire de combien de parties se compose
un État; tandis que le nombre des formes est déterminé:
combien, par exemple, il y a de sortes d'États; car on en
connaît trois le populaire, l'oligarchique, et le monarchique. Ce ne
sont pas les exemples dont Cicéron s'est servi, parce que,
s'adressant à Trébatius, ils a mieux aimé prendre les siens dans le
droit; moi, j'en ai substitué d'autres qui m'ont paru plus à la
portés de tout le monde. Les propriétés appartiennent aussi à
la conjecture. Ainsi, le propre d'un homme vertueux étant de faire
le bien, et le propre d'un homme colère étant de s'emporter en
paroles, il est à croire que celui qui fait le bien est
un homme vertueux, et que celui qui s'emporte en paroles est
un homme irascible; et contrairement, le propre d'un méchant étant
de ne pas faire le bien, et le propre d'un homme doux étant de ne
pas s'emporter en paroles, il est à croire que celui qui ne fait pas
le bien est un méchant, et que celui qui ne s'emporte pas en paroles
est un homme doux; car on est aussi bien fondé à tirer des
inductions de ce qui n'est pas que de ce qui est. La division
sert de la même manière à prouver et à réfuter. S'il s'agit de
prouver, il suffit quelquefois de s'attacher à une seule partie :
vous voulez prouver, par exemple, qu'un homme est citoyen; vous
dites : on est citoyen romain ou de naissance ou par grâce.
Mais si vous réfutez, il faut détruire les deux propositions : il
ne l'est ni de naissance ni par grâce. Quelquefois la division
peut avoir beaucoup plus de membres, et de la réfutation de chacun
d'eux naît une manière d'argumenter qui sert à démontrer tantôt que
le tout est faux, tantôt qu'il n'y a qu'une proposition de vraie. Le
tout est faux de cette sorte : vous dites que vous avez prêté de
l'argent; ou vous en aviez, ou vous en aviez reçu de quelqu'un, ou
vous en avez trouvé, ou vous en avez dérobé. Or vous n'en aviez pas
chez vous, vous n'en avez reçu de personne, etc.; donc vous n'en
avez pas prêté. Dans l'exemple suivant, la dernière proposition
reste vraie : ou l'esclave que vous revendiquez est né chez vous,
ou vous l'avez acheté, ou on vous l'a donné, ou il vous a été légué
par testament, ou vous l'avez pris sur l'ennemi, ou il appartient à
un autre. On réfute successivement toutes ces propositions, hors
la dernière; et il reste vrai que cet esclave appartient à un autre.
Ce genre d'argumentation a son écueil, et exige beaucoup d'attention
; car, si dans votre énumération vous omettez un seul point, non
seulement tout votre édifice tombe, mais vous vous exposez à la
risée. Le plus sûr est de faire comme Cicéron dans son plaidoyer
pour Cécinna, lorsque interrogeant son adversaire, s'il ne s'agit
pas de cela, dit-il, de quoi s'agit-il ? car par là il
écarte un détail dangereux; ou bien d'avancer deux propositions
contraires, dont il suffit que l'une demeure vraie, comme dans cet
autre exemple tiré de Cicéron : Il n'est personne d'assez injuste
envers Claudius pour ne pas m'accorder que, si les juges ont été
corrompus, ils l'ont été ou par Habilus ou par Oppianicus. Si je
démontre que ce n'est point par Habilus, il s'ensuit que c'est par
Oppianicus; si je fais voir que c'est par Oppianicus, je justifie
Habitus. L'argument est donc à peu près de même genre, lorsqu'on
force l'adversaire à choisir entre deux propositions, quoique toutes
deux soient également contre lui. C'est ce que fait Cicéron dans la
défense d'Oppius : Est-ce lorsqu'il voulait se jeter sur Cotta,
ou lorsqu'il voulait se tuer lui-même, qu'on lui arracha son
poignard? Et dans le plaidoyer pour Varénus : Voulez-vous que
Varénus ait pris ce chemin par hasard, ou à l'instigation de.. ? on
vous laisse l'option. Ensuite il tourne ces deux propositions
contre l'accusateur. Quelquefois on émet deux propositions de telle
manière que, quelle que soit celle que l'on choisisse, c'est
toujours la même conséquence. Par exemple, il faut philosopher,
quoiqu'il n'y ait pas lieu à philosopher; et cet autre dilemme
plus usité : à quoi bon vous servir de figures, si l'on vous
entend ? à quoi bon, si l'on ne vous entend pas? et cet autre
encore : celui qui peut supporter la douleur mentira au milieu
des tortures, et celui qui né le peut pas mentira aussi.
De même qu'il y a trois temps, il y a aussi trois
moments dans l'ordre des faits; car tous ont un commencement,
un progrès et une fin : on se querelle, on se bat,
on se tue. Il y a donc là un lieu d'arguments qui se confirment
réciproquement. En effet, le commencement nous fait juger de la fin
: Je ne puis espérer la robe prétexte, sous les auspices de
l'indigence; et réciproquement: Sylla s'est démis de la
dictature; donc il ne s'était pas armé dans des vues de domination.
De même, du progrès d'une chose on tire des conséquences pour son
commencement et pour sa fin, non seulement en fait de conjecture,
mais en matière de droit naturel La fin doit-elle se rapporter au
commencement? c'est-à-dire, Le meurtre doit-il être imputé à
celui qui a commencé la querelle?
Voici encore d'autres lieux d'on se tirent les
arguments. Les semblables : Si la continence est une
vertu, l'abstinence en est également une. Si un tuteur doit donner
caution, un procurateur le doit aussi : ces arguments sont du
genre de celui que les Grecs appellent ἐπαγωγὴ, et Cicéron,
induction. - Les dissemblables : De ce que la joie est
un bien, il ne s'ensuit pas que la volupté en soit un. De ce qu'une
chose est permise à une femme, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit à
un pupille. - Les contraires . La frugalité est un
bien, car la débauche est un mal. Si la guerre est une source de
maux, la paix en sera le remède. Si celui qui a nui par mégarde
mérite indulgence, celui qui a été utile sans le savoir ne mérite
pas de récompense. - Les contradictoires : Celui qui
est sage n'est pas fou. Les conséquents ou les
adjoints : Si la justice est un bien, il faut juger
justement. Si la perfidie est un mal, on ne doit pas tromper: et
de même, en renversant la proposition. Les arguments suivants ne
sont pas fort différents, et je n'hésite pas à les mettre au même
rang, à cause de l'analogie qu'ils ont avec les précédents : On
n'a point perdu ce qu'on n'a jamais eu. On ne nuit pas sciemment à
une personne qu'on aime. On chérit singulièrement celui qu'on
institue son héritier. Mais ces arguments étant indubitables,
ils ont presque la force des signes que j'ai appelés nécessaires.
Toutefois, quoique je paraisse confondre les premiers arguments avec
les derniers, je me servirais volontiers de deux mots grecs,
ἀκόλουθα et παρεπόμενα, pour marquer la différence délicate qui
existe entre les uns et les autres. Ainsi, la bonté est une suite
naturelle de la sagesse, consequens, ἀκολουθον; au lieu
que les autres choses dont j'ai parlé ne sont arrivées ou
n'arriveront qu'après quelque intervalle de temps, sequentia,
περόπομενα. Au reste, qu'on les appelle comme on voudra, je me mets
peu en peine du nom, pourvu que le fond des choses soit entendu, et
qu'on sache que, dans les premiers, la conséquence naît du temps, et
que, dans les autres, elle naît de la nature de la chose. C'est
pourquoi je n'hésite pas à assigner au même lieu certains arguments,
où ce qui doit suivre est inféré de ce qui a précédé, et que
quelques rhéteurs divisent en deux espèces. L'une d'action, comme
dans l'oraison pour Oppius ; Ceux qu'il n'a pu faire venir malgré
eux en province, comment a-t-il pu les retenir malgré eux?
L'autre de temps, comme dans cet endroit d'une des Verrines :
Si les édits du préteur n'ont force de loi que jusqu'aux calendes
de janvier, pourquoi n'auraient-ils pas force de loi à partir de la
même époque? Ces deux exemples sont tels, que les propositions
renversées ont la même force dans un sens différent; car il est
conséquent que l'on ne puisse faire venir malgré eux des gens qu'on
n'aura pu retenir malgré eux. J'hésite encore moins à ranger parmi
les conséquents ces arguments qu'on tire de propositions qui se
confirment mutuellement, quoique quelques rhéteurs en fassent un
genre à part, sous le nom de ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλαs, et que Cicéron les
appelle arguments tirés de propositions fondées sur la même
raison; par exemple, Si les Rhodiens ont pu honnêtement
affermer leur douane, Hermocréon a pu honnêtement en être le
fermier. Ce qu'il est honorable d'apprendre peut être enseigné sans
honte. A quoi je rapporte cette belle pensée de Domitius Afer,
laquelle, quoique exprimée d'une autre manière, a le même effet :
J'ai accusé, vous avez condamné. Quand deux propositions sont
corrélatives, la réciprocité implique un conséquent alternatif : par
exemple, Celui qui dit que le monde a eu un commencement déclare,
par cela même, qu'il aura une fin, parce que tout ce qui commence,
finit. Tels sont encore les arguments qui prouvent l'effet
par la cause ou la cause par l'effet, bien que
les rhéteurs leur donnent un nom particulier, arguments tirés des
causes. Mais tantôt la conséquence est nécessaire, tantôt elle
ne l'est pas, quoique le plus souvent elle ne laisse pas d'être
vraie: ainsi, un corps fait ombre à la lumière, et partout où il
y a de l'ombre il y a nécessairement un corps. Quelquefois,
comme je l'ai dit, la conséquence n'est pas nécessaire, soit par
rapport à la cause et à l'effet, soit par rapport à la cause ou à
l'effet seulement : Le soleil colore; mais tout ce qui est coloré
ne l'est pas par le soleil. Un chemin rend poudreux, mais tout
chemin ne fait pas de la poussière et l'on peut être poudreux sans
que cela ait été causé par un chemin. Autres exemples de l'un et
l'autre cas : Si la sagesse fait l'homme de bien, l'homme de bien
est certainement sage; et de même, Se conduire honnêtement
est d'un homme de bien, se conduire honteusement est d'un méchant
homme; ceux qui se conduisent honnêtement sont réputés gens de bien,
ceux qui se conduisent honteusement sont réputés méchants; et
cela est conséquent: mais : De ce que l'exercice rend d'ordinaire
le corps robuste, il ne s'ensuit pas que quiconque est robuste ait
pris de l'exercice, ni que quiconque a pris de l'exercice soit
robuste. De même, De ce que le courage fait mépriser la mort,
il ne s'ensuit pas que quiconque a mérité la mort doive être réputé
courageux; et De ce, que le soleil cause des maux de tête, il
ne s'ensuit pas que le soleil soit nuisible aux hommes. Cette
sorte d'arguments convient surtout au genre délibératif. La vertu
donne la gloire, il faut donc la cultiver; mais la volupté traîne
après elle l'infamie, il faut donc la fuir. C'est avec raison
qu'on recommande de ne point remonter à des causes trop éloignées, à
l'exemple de Médée : Plût aux dieux que jamais, dans la forêt du
Pélion... ! Comme si les malheurs et les crimes de Médée
venaient de ce qu'on avait abattu des sapins dans cette forêt; ou, à
l'exemple dé Philoctète parlant à Pâris : Si vous aviez su
commander à vos passions, je ne serais pas dans cet état misérable.
En partant de si loin; on peut aller où l'on veut. Il me semblerait
ridicule d'ajouter à ces arguments celui qu'on appelle conjugué,
n'était Cicéron qui en fait usage. Par exemple, Ceux qui font une
chose juste agissent justement. Chacun a le droit de faire paître
son troupeau dans des pâturages communs : à coup sûr, ces
propositions n'ont pas besoin de preuves. Tous ces arguments qu'on
tire, soit des causes, soit des efficients, sont appelés par
quelques rhéteurs grecs ἐκβάσεις, c'est-à-dire issues; et en
effet ils ne traitent que de ce qui résulte de chaque chose.
On appelle arguments d'apposition, ou de
comparaison ceux qui prouvent le grand par le petit,
le petit par le grand, l'égal par l'égal.
La conjecture se confirme par la comparaison du grand au
petit : Qui commet un sacrilège peut bien commettre un vol;
du petit au grand : Qui ment sans peine et publiquement pourra
bien se parjurer; d'égal à égal : Qui a reçu de l'argent pour
juger injustement pourra bien en recevoir pour porter un faux
témoignage. Le droit se confirme de la même manière : S'il
est permis de tuer un adultère, à plus forte raison est-il permis de
lui donner les étrivières. - S'il est permis de tuer un voleur de
nuit, n'a-t-on pas le même droit contre un brigand armé? - Si la
peine que la loi prononce contre celui qui tue son père est juste,
elle l'est également contre celui qui tue sa mère. Ces arguments
sont surtout d'usage dans les causes où l'on procède par syllogisme.
Ceux-ci appartiennent plus particulièrement à la définition ou à la
qualité : Si la force est avantageuse au corps, la santé ne l'est
pas moins. - Si le vol est un crime, le sacrilège en est un plus
grand encore. - Si l'abstinence est une vertu, la continence en est
une aussi. - Si le monde est régi par une providence, la république
a besoin d'être administrée. - Si une maison ne peut être bâtie sans
le secours de l'art, que doit-on penser de la navigation et de la
guerre? Je ne diviserais pas en espèces ce genre d'arguments;
cependant on le divise. Ainsi on argumente de la pluralité à
l'unité, et de l'unité à la pluralité (à quoi
se rapporte: Ce qui est arrivé une fois peut arriver plusieurs)
; de la partie au tout, du genre à l'espèce,
du contenant au contenu, du difficile au
facile, de ce qui est éloigné à ce qui est proche,
et réciproquement. Mais l'argumentation est toujours la même ; car
on raisonne toujours du grand au petit, du petit
au grand, et d'égal à égal. Si on voulait
descendre à toutes les espèces, la subdivision deviendrait
impossible; car la comparaison n'a point de fin, puisqu'il y a aussi
des choses plus douces, plus agréables, plus nécessaires, plus
honnêtes, plus utiles; mais je m'arrête, de peur de tomber
moi-même dans la prolixité, que je veux éviter. Entre autres
exemples que l'on en pourrait donner, et dont le nombre est infini,
j'en toucherai seulement quelques-uns. Du GRAND au PETIT, oraison
pour Cécinna : S'étonnera-t-on que, ce qui a pu émouvoir une
armée ait ému des avocats? Du FACILE au DIFFICILE, oraison
contre Clodius et Curion : Voyez s'il vous était facile d'obtenir
ce que n'a pas obtenu celui qui, de votre aveu, devait l'emporter
sur vous! Du DIFFICILE Au FACILE, : Remarquez, je vous prie,
Tubéron, que, si je ne fais pas difficulté d'avouer mon crime, il
m'est bien plus facile d'avouer celui de Ligarius; et, au même
endroit : Ligarius n'a-t-il pas tout sujet d'espérer, César,
quand il voit que je suis bien reçu à vous demander grâce pour
autrui? Du PETIT AU GRAND, oraison pour Cécinna : Quoi donc?
de savoir qu'il y avait là des gens armés, c'est une preuve de
violence pour vous; et de tomber entre leurs mains, ce n'en sera pas
une pour nous?
En résumé donc, les arguments se tirent des
personnes, des motifs, des lieux, du temps (qui
a précédé, qui a accompagné, qui a suivi), des facilités,
auxquelles nous avons joint l'instrument, du mode,
c'est-à-dire la manière dont une chose s'est faite, de la
définition, du genre, de l'espèce, des
différences, des propriétés, de la réfutation des
parties énumérées, de la division, du commencement,
du progrès, de la fin, des semblables, des
dissemblables, des contraires, des conséquents,
des efficients, des effets, des issues, des
conjugués, et de la comparaison, que l'on divise en
plusieurs espèces. Il me semble qu'il faut encore ajouter à tout
cela qu'on argumente non seulement sur des choses avouées, mais
aussi sur des fictions, ou, comme disent les Grecs, sur des
hypothèses; et, comme la fiction peut avoir autant d'espèces que
la vérité, les lieux des arguments sont les mêmes pour l'une et pour
l'autre. Car j'entends ici par feindre, émettre une proposition qui,
si elle était vraie, ou résoudrait la question, ou aiderait à la
résoudre; puis, montrer la conformité qui existe entre le point dont
il s'agit et le point supposé. Pour me faire comprendre plus
facilement des jeunes gens qui n'ont pas encore quitté les bancs, je
me servirai d'exemples en usage dans les écoles. La loi porte:
Quiconque refusera des aliments à son père, et à sa mère, qu'il soit
mis aux fers. Un homme en refuse, et ne veut pas néanmoins subir
la peine. Que dira-t-il pour sa défense? il a recours à cette
hypothèse : Si j'étais soldat, si j'étais enfant, si j'étais
absent pour le service de la république... ? - Quiconque s'est
distingué à la guerre par quelque action de bravoure, a, selon nos
lois, la faculté de choisir une récompense; mais, s'il demande la
tyrannie, ou la destruction des temples... ? Cette sorte
d'arguments est d'une grande force contre la lettre de la loi.
Cicéron s'en sert dans la défense de Cécinna, au sujet de l'édit qui
commence par ces mots : D'où vos esclaves, ou votre intendant, ou
vous..., si c'était votre fermier seul qui m'eût chassé,
etc.; cependant si vous n'avez pas d'autres esclaves que celui qui
m'a chassé. Ce n'est pas la seule hypothèse qu'on trouve dans le
même plaidoyer. Les hypothèses ne sont pas moins utiles dans les
questions de qualité : Si Catilina pouvait juger de cette affaire
avec ce conseil de scélérats qui l'a suivi, Catilina condamnerait L.
Muréna. Enfin, on en fait usage pour amplifier : Si cela vous
était arrivé à table, dans une de vos orgies et dans la fureur du
vin..., etc. - Si let république pouvait parler.
Tels sont à peu près tous les lieux d'où l'orateur
tire ses preuves, et dont il est parlé dans les livres de
rhétorique. D'un côté, les enseigner en général ne suffit pas,
chaque lieu étant un fonds inépuisable d'arguments; d'un autre côté,
la nature des choses ne permet pas d'en détailler toutes les
espèces, et ceux qui l'ont tenté sont tombés dans le double
inconvénient d'en dire trop et de ne pas tout dire. Aussi, la
plupart des orateurs, une fois engagés dans ces filets
inextricables, perdent toute liberté d'esprit; enchaînés par des
règles inflexibles, et les yeux fixés sur le maître, ils cessent de
suivre la nature, qui doit être en tout notre guide. En effet, comme
il ne suffit pas de savoir que toutes les preuves se tirent des
personnes ou des choses, puisque ces deux chefs se
divisent en une infinité d'autres, de même il ne suffit pas de
savoir due les arguments se tirent de ce qui précède, de ce qui
accompagne et de ce qui suit, pour trouver immédiatement dans ces
circonstances les arguments qui conviennent à chaque cause, d'autant
plus que la plupart des preuves sont essentiellement inhérentes à la
nature d'une cause, et n'ont rien de commun avec aucune autre, et
que ces preuves, outre qu'elles sont les plus puissantes, sont
celles qui se présentent le moins d'elles-mêmes, par la raison que
ce qui est commun à toutes les causes, ce sont les préceptes qui
nous l'apprennent, et que ce qui est propre à chacune, c'est à nous
de le trouver. J'appellerai volontiers ce dernier genre, un genre
d'arguments tirés de la circonstance; car on ne peut rendre
autrement le mot grec περίστασις, ou arguments tirés de ce qui est
propre à chaque chose. Ainsi, dans l'affaire de ce prêtre adultère
qui voulait se sauver en vertu de la loi qui lui permettait de
sauver un criminel, l'argument propre à la cause est celui-ci :
En vous sauvant, vous sauvez plus d'un coupable, puisqu'il faudrait
en même temps accorder la vie à la femme adultère. En effet, cet
argument se tire de la loi qui défend de faire mourir une femme
adultère sans son complice. Autre exemple : la loi autorisait les
banquiers à ne payer que la moitié de ce qu'ils devaient, et à
exiger tout ce qui leur était dû. Un banquier redemande à un
autre banquier tout ce que celui-ci lui doit. L'argument propre à la
cause est celui-ci : Il est expressément, écrit dans la loi que les
banquiers peuvent exiger tout ce qui leur est dû; et en effet ils
n'avaient pas besoin de loi à l'égard des autres, puisqu'il n'est
personne qui ne soit en droit d'exiger tout ce qui lui est dû,
excepté des banquiers. Voilà comme il se présente des considérations
nouvelles et singulières dans tous les genres de causes, mais
principalement dans ces questions qui roulent sur la lettre d'un
écrit, parce qu'il y a souvent ambiguïté dans les mots et plus
encore dans les phrases. Et ces considérations varient
nécessairement en raison de la complication des lois ou des écrits
qu'on produit pour et contre, attendu qu'un fait met sur, la voie
d'un autre fait, ou un point de droit sur la voie d'un autre point
de droit: Je ne vous devais rien, vous ne m'avez jamais cité en
justice; ce ne sont point les intérêts d'un prêt que vous avez
reçus de moi, je n'ai fait que vous prêter ce que vous étiez venu me
demander. Une loi porte : Quiconque n'aura point assisté son
père accusé de trahison, qu'il soit déshérité. Est-ce à dire que
le fils qui n'a point assisté son père doive être déshérité? Non,
à moins que le père n'ait été renvoyé absous. D'où induit-on
cette conséquence? d'une autre loi qui veut que Quiconque a été
condamné pour trahison soit exilé avec son avocat. Cicéron, dans
l'oraison pour Cluentius, dit que Publius Popilius et Tibérius Gutta
n'ont point été condamnés pour avoir corrompu leurs juges, mais
pour s'être rendus coupables de brigues. Comment confirme-t-il
cette assertion? En ajoutant que leurs accusateurs, qui eux-mêmes
avaient été condamnés pour brigues, furent réhabilités, en vertu de
la loi, comme ayant prouvé leur accusation.
Mais ce n'est pas tout que de prouver sa proposition;
il ne faut pas moins prendre garde à ce que l'on propose. C'est en
cela que consiste entièrement la vertu de l'invention, sinon la plus
importante, au moins la première; car, de même que des traits sont
inutiles à qui ne sait où il doit frapper, de même les arguments
sont inutiles à qui n'en a pas prévu l'application : voilà ce que
l'art n'enseigne pas. Aussi plusieurs orateurs, qui auront étudié
les mêmes préceptes, se serviront, il est vrai, d'arguments du même
genre, mais l'un saura mieux que l'autre en tirer parti en les
multipliant. Prenons pour exemple une cause dont les questions sont
d'un ordre tout, fait à part: Après avoir ruiné la ville de
Thèbes, Alexandre trouva un titre constatant que les Thébains
avaient prêté cent talents aux Thessaliens; et, comme les
Thessaliens l'avaient assisté dans le siège de Thèbes, il leur fit
remise, de ce titre. Plus tard, ayant été rétablis par Cassandre,
les Thébains redemandent les cent talents aux Thessaliens. La
cause se plaide devant les amphictyons. Il est constant que les
Thébains ont prêté cent talents, et qu'ils n'en ont point été
remboursés. Tout le procès roule sur ce point, qu'Alexandre en a
fait don aux Thessaliens. Il est constant aussi qu'Alexandre ne leur
a point donné d'argent. Il s'agit donc de savoir si ce qu'il a fait
est la même chose que s'il leur eût donné de l'argent. A quoi me
serviront les lieux d'arguments, si je ne considère préalablement
que la donation faite par Alexandre est nulle, qu'il n'a
pu la faire, qu'il ne l'a point faite ? Et d'abord les Thébains
invoquent le droit contre la force, moyen de défense à la fois
facile, et très propre à leur concilier la faveur des juges mais de
là naît aussi la question sévère et farouche du droit de la guerre;
car les Thessaliens ne manqueront pas de la faire valoir, et de dire
que c'est ce droit qui maintient les royaumes, les peuples, les
limites des nations et des villes. Il faut donc leur opposer quelque
raison qui établisse que le titre, qui fait l'objet de la cause,
diffère de ce qui tombe ordinairement au pouvoir du vainqueur. Et
ici la difficulté n'est pas tant dans la preuve que dans la
proposition. Nous dirons donc avant tout que, dans ce qui peut
être du ressort de la justice, le droit de la guerre est sans
valeur; que ce qui a été ravi par les armes ne peut être retenu que
par les armes; qu'où les armes dominent, il n'y a point de juge, et
qu'où le juge préside, les armes perdent leurs droits. Voilà ce
qu'il faut trouver avant d'en venir aux arguments, à celui-ci, par
exemple: Les prisonniers de guerre qui parviennent à s'échapper
et à retourner dans leur patrie redeviennent libres, parce que tout
ce qui a été conquis par les armes ne peut se conserver que par les
armes. La cause a encore cela de propre, c'est qu'elle se plaide
devant les Amphictyons. Or, dans la même affaire, autre chose est de
plaider devant les centumvirs, autre chose de plaider devant un juge
privé.
Quant au second chef, on dira qu'un vainqueur ne peut
transmettre un droit, parce que le droit est inhérent à celui qui
le possède, parce que le droit est incorporel, et partant
insaisissable. Il était plus difficile de trouver cette
proposition que de la confirmer après l'avoir trouvée, et de
l'appuyer d'arguments semblables à celui-ci : Autre est la
condition d'un héritier, autre la condition d'un vainqueur : au
premier, passe le droit; au second, la chose seulement. La cause
fournit encore le moyen suivant : Une créance publique n'a pas
passer au vainqueur, attendu que le prêt fait par un peuple est dû à
tous; et, ne restât-il qu'un seul individu, cet individu, quel qu'il
soit, devient créancier de la somme entière : or, tous les Thébains
ne sont pas tombés entre les mains d'Alexandre. Cette
proposition se soutient sans l'appui de preuves extrinsèques, et a
en soi une force propre et indépendante des arguments.
A l'égard du troisième chef, on le défendra d'abord
par des propositions plus vulgaires, en disant que le droit ne
réside pas dans les pièces, proposition très facile à confirmer,
et en mettant en doute si Alexandre a eu l'intention d'honorer
les Thessaliens, ou de les tromper. En second lieu (et ce moyen,
tiré du fond de la cause, donnera lieu à une controverse, pour ainsi
dire, nouvelle), on alléguera qu'en admettant que les Thébains
eussent perdu leur droit, ils l'ont recouvré par suite de leur
rétablissement. Ici on examinera quelle a été l'intention de
Cassandre; mais ce qu'il importe surtout de ne pas perdre de vue,
c'est que la cause se plaide devant les Amphictyons, et qu'en
parlant au nom de l'équité, il y a tout à attendre des juges.
Au reste, je n'entends pas dire que la connaissance
de ces lieux, d'où se tirent les arguments, soit inutile ;
autrement, je me serais dispensé d'en parler : mais je veux
seulement que ceux qui connaîtront ces lieux ne se croient pas tout
d'abord, et sans autres conditions, des orateurs parfaits et
consommés ; je veux qu'ils sachent que, s'ils n'ont étudié
soigneusement les autres parties, dont je traiterai tout à l'heure,
ils n'auront acquis qu'une science, pour ainsi dire, muette. Ce
n'est point aux traités de rhétorique qu'on doit l'invention des
arguments, ils ont tous été connus avant les règles : la rhétorique
n'est qu'un recueil d'observations faites sur ce qui existait déjà ;
et la preuve, c'est que les rhéteurs ne se servent que d'exemples,
plus vieux que leurs traités, et empruntés aux orateurs, sans rien
dire de nouveau, et qui n'ait été pratiqué avant eux. Les véritables
auteurs de l'art sont donc les orateurs; mais nous devons pourtant
quelque reconnaissance à ceux qui nous ont aplani les difficultés;
car toutes les vérités que, grâce à leur génie, les orateurs ont
découvertes une à une, les rhéteurs nous ont épargné la peine de les
chercher, et les ont rassemblées sous nos yeux. Mais cela ne suffit
pas plus, qu'il ne suffit, pour être athlète, d'avoir appris la
gymnastique, si l'on n'y joint l'exercice, la continence, une forte
nourriture, et si, par-dessus tout, la nature ne seconde tout cela;
comme aussi toutes ces conditions sont insuffisantes sans le secours
de l'art.
Ceux qui se livrent à l'étude de l'éloquence doi vent
encore observer que chaque cause ne comporte pas tous les arguments
dont j'ai parlé dans ce chapitre, et qu'il ne faut pas se faire une
loi de passer en revue, les uns après les autres, tous les lieux que
j'ai indiqués, en frappant, pour ainsi dire, à la porte, pour voir
si, par hasard, ils ne répondraient pas au besoin de la question
qu'il s'agit de prouver. Cela est bon quand on commence et qu'on
manque encore d'expérience; mais, hors de là, l'orateur se
condamnerait à tâtonner autour de lui sans avancer, s'il se croyait
obligé de s'arrêter autour de chaque argument, et d'en sonder la
convenance et la propriété. Je ne sais même s'il ne vaudrait pas
mieux les négliger tout à fait, à moins que, grâce à une grande
promptitude d'esprit, due à la nature et à l'étude, on n'aperçoive
d'un coup d'oeil chacun de ceux qui conviennent à la cause. Ainsi,
la voix gagne beaucoup à être accompagnée d'un instrument;
cependant, si la main est lente, si, avant de tirer un son, elle est
obligée d'interroger chaque corde l'une après l'autre, la voix seule
et sans accompagnement sera préférable. Il en est de même des règles
de l'art oratoire : elles doivent être à l'éloquence ce que la lyre
est à la voix, c'est-à-dire, l'accompagner et la soutenir. Mais ce
n'est qu'à force d'exercice que, comme ces musiciens habiles qui,
sans regarder l'instrument, et par la seule force de l'habitude,
trouvent tous les tons qu'ils veulent, l'orateur parviendra à se
reconnaître au milieu de cette foule d'arguments de toute espèce,
qui même, loin de retarder sa marche, se présenteront d'eux-mêmes à
lui, l'accompagneront, le suivront, comme les lettres et les
syllabes sous la plume de celui qui écrit.
CHAP. XI. Le troisième genre de preuves extrinsèques
est appelé par les Grecs παράδειγμα et ce nom leur sert à désigner à
la fois tout ce qui est fondé et sur la comparaison des semblables,
et sur l'autorité des faits historiques. La plupart de nos rhéteurs
ont mieux aimé distinguer ces deux genres de comparaison , appelant
le, premier similitude (παραβολὴ), et le second, exemple :
quoique, à vrai dire, l'exemple tienne de la similitude, et la
similitude de l'exemple. Pour moi, afin d'être plus clair, je
comprendrai les deux genres sous le nom d'exemple,
παράδειγμα, et je ne crains pas qu'on m'accuse de me mettre en
contradiction avec Cicéron, qui distingue l'exemple de la
comparaison; car le même auteur divise toute argumentation en
deux parties, l'induction et le raisonnement, comme
font la plupart des rhéteurs grecs, qui divisent aussi toute
argumentation en paradigmes et en épichérèmes, et
qui ajoutent que le paradigme est l'induction de la rhétorique.
En effet, la manière d'argumenter dont Socrate se servait
ordinairement est proprement l'induction. Il interrogeait son
interlocuteur sur plusieurs choses, dont celui-ci était obligé de
convenir, et il finissait par tirer de toutes ces concessions une
conséquence qui confirmait le point controversé. Cela ne peut se
pratiquer dans l'oraison ; mais ce qui est là posé comme question
est ici posé comme principe, puisque, dans un dialogue, ce qui est
posé comme question est ordinairement suivi d'une réponse
affirmative. Supposons, par exemple, la question suivante : Quel
est le fruit le plus noble? N'est- ce-pas celui qui est le meilleur?
la conclusion ne sera pas contestée. - Et, parmi les chevaux,
quel est le plus noble? N'est-ce pas celui qui est le meilleur?
On l'accordera de même. Après mainte question analogue, on arrive à
celle en vue de laquelle toutes les autres ont été faites : Et,
parmi-les hommes, quel est le plus noble? N'est-ce pas aussi celui
qui est le meilleur? De quoi l'interlocuteur sera obligé de
convenir. Ce procédé est très bon quand on interroge des témoins;
mais dans un discours suivi la forme est moins dubitative, parce que
l'orateur se répond à lui-même : Quel est le fruit le plus noble?
celui, sans doute, qui est le meilleur. Quel est le cheval le plus
noble? certainement celui qui est le plus léger à la course. Ainsi
de l'homme : c'est la vertu, et non l'éclat de la naissance, qui
fait sa véritable noblesse. Or, tous les exemples de ce genre
sont nécessairement ou semblables, ou dissemblables, ou contraires.
La similitude n'est quelquefois employée que pour servir d'ornement
au discours : mais j'en parlerai en son lieu; quant à présent, je
m'occuperai seulement de celle qui sert de preuve.
Entre les preuves dont il est question dans ce
chapitre, la plus efficace est celle que j'appelle proprement
exemple, et que je définis : une citation d'un fait historique ou
communément reçu, qui sert à confirmer ce que l'on a avancé. Aussi
faut-il considérer si ce fait est entièrement semblable, ou s'il ne
l'est qu'en partie, afin de l'emprunter tout entier, ou de n'en
prendre que ce qui est utile. Saturninus a été tué justement,
comme les Gracques : l'exemple est semblable. Brutus fit
mourir ses enfants, parce qu'ils avaient conspiré contre la patrie;
Manlius punit de mort le courage de son fils : l'exemple est
dissemblable. Ces tableaux, ces statues que Marcellus rendait à
des ennemis, Verres les enlevait à des alliés : l'exemple est
contraire. Voilà pour le genre judiciaire. Dans le genre
démonstratif, les exemples dont on se sert pour louer ou blâmer sont
aussi de trois sortes. Dans le genre délibératif, qui regarde
l'avenir, rien ne persuade tant que de citer des exemples
semblables, comme si je dis que Denis demande des gardes, non
pour la sûreté de sa personne, mais pour s'en servir à mettre son
peuple sous le joug de la tyrannie, et que j'allègue que
Pisistrate, par le même moyen, usurpa la suprême puissance. Mais
de même qu'il y a des exemples entièrement semblables, comme le
dernier que je viens de citer, il y en a aussi d'autres à l'aide
desquels on argumente du plus au moins, et du moins au plus; tels
sont les suivants : Si la profanation des mariages a causé la
ruine de villes entières, quel châtiment ne mérite pas un adultère ?
- Des joueurs de flûte, qui s'étaient retirés de Rome, y furent
rappelés par un décret du sénat; à combien plus forte raison doit-on
rappeler de grands citoyens qui avaient bien mérité de la
république, et que le malheur des temps avait forcés de s'exiler?
Les exemples inégaux sont très utiles pour exhorter. Le courage est
plus admirable dans une femme que dans un homme. Si donc on veut
exhorter un homme à faire une action courageuse, l'exemple d'Horace
ou de Torquatus sera moins puissant que celui de cette femme qui tua
Pyrrhus de sa main ; et, pour se résoudre à mourir, il trouvera
moins d'encouragement dans l'exemple de Caton et de Métellus
Scipion, que dans celui de Lucrèce : ce qui appartient aux exemples
à l'aide desquels on argumente du plus au moins.
Je vais donner une idée de chacun de ces différents
exemples; je les emprunterai à Cicéron , car où pourrais-je trouver
un meilleur modèle? Dans la défense de Muréna, il dit : Ne
m'est-il pas arrivé d'avoir pour compétiteurs deux patriciens,
Catilina et Galba, connus l'un par son audace, l'autre par sa
modération et sa vertu? et cependant je l'ai emporté en dignité sur
Catilina, et en crédit sur Galba: ici l'exemple est semblable.
Dans la défense de Milon, je trouve deux exemples, l'un du plus au
moins : Nos ennemis prétendent que celui-là est indigne de voir
la lumière, qui confesse avoir commis un meurtre : mais ces
ignorants songent-ils bien dans quelle ville ils parlent? Dans Rome,
où la première cause capitale qu'on ait vue est celle de ce
courageux Horace, qui avait tué sa soeur, qui avouait le meurtre, et
ne laissa pas néanmoins d'être absous dans l'assemblée du peuple,
alors même que la liberté n'existait pas encore; l'autre, du
moins au plus: J'ai tué, non un Spurius Mélius, qui, pour avoir
dépensé tout son bien à faire des largesses au peuple, qu'il
semblait vouloir corrompre, fut soupçonné d'aspirer à la royauté,
etc.; mais un Clodius (car Milon ne craindrait pas de l'avouer,
sachant qu'il a délivré par là sa patrie du plus grand des périls),
mais un sacrilège, qui a porté l'adultère jusque sur les autels des
dieux, etc. L'exemple dissemblable a plusieurs sources. Il se
tire du genre, du mode, du temps, du lieu,
et autres circonstances à l'aide desquelles Cicéron détruit presque
tous les préjugés qui semblaient s'élever contre Cluentius. Dans le
même plaidoyer pour Cluentius, par un exemple des contraires, il
blâme la conduite des censeurs, en louant Scipion l'Africain, qui,
étant censeur lui-même, n'avait point dégradé un chevalier qui
s'était parjuré dans les formes, quoiqu'il eût déclaré publiquement
que ce chevalier s'était effectivement parjuré, promettant même de
témoigner de ce fait, s'il était contesté; mais parce qu'il ne se
présentait pas d'accusateur. Je ne rapporte pas ces derniers
exemples dans les mêmes termes, pour éviter d'être long. Mais
Virgile m'en fournit un du même genre, qui est très court : Cet
Achille, dont tu te vantes faussement d'être fils, ne s'est point
conduit ainsi envers Priam, son ennemi. Quelquefois on racontera
les faits tels qu'ils sont dans l'histoire, comme Cicéron, dans la
défense de Milon : Un tribun militaire de l'armée de Marius, et
parent de ce général, voulait, commettre un attentat infâme sur la
personne d'un jeune soldat celui-ci aimant mieux s'exposer au danger
d'un jugement que de se laisser déshonorer, tua le tribun, qui lui
faisait violence. Qu'arriva-t-il ? Marius, ne considérant que
l'honneur, renvoya le jeune homme impuni. Tantôt on se
contentera d'indiquer les faits, comme le même orateur dans le même
plaidoyer : S'il n'est pas permis de mettre à mort des scélérats,
il faut condamner la conduite d'Hala Servilius, de P. Nasica, de L.
Opimius, du sénat enfin, qui, sous mon consulat, ne les a pas
épargnés. On rapportera ces faits, selon qu'ils seront plus ou
moins connus, ou selon que l'utilité ou la bienséance le demandera.
On traitera de même les exemples tirés des poètes; avec cette
différence pourtant, qu'on les présentera d'une manière moins
affirmative. Cicéron, qui est un grand maître en tout, nous montre
encore la manière dont on doit s'en servir. On trouve un exemple de
ce genre dans le même plaidoyer : Aussi n'est-ce pas sans raison,
juges, que de savants hommes nous racontent, dans d'ingénieuses
fictions, qu'un fils ayant tué sa mère pour venger la mort de son
père, et les hommes étant partagés sur ce fait, il fut absous non
seulement par une sentence divine, mais par la voix même de la
déesse qui préside à la sagesse. Ces fables qu'on appelle
communément Ésopéennes, quoique Hésiode, plutôt qu'Ésope, me
paraisse en être le premier inventeur, ont aussi quelque chose de
très persuasif, surtout auprès des personnes ignorantes et d'un
esprit grossier, que leur simplicité porte à écouter volontiers des
fictions, et qui, partant, se laissent entraîner sans peine à croire
ce qui leur plaît. Ainsi Ménénius Agrippa réconcilia le peuple avec
le sénat, par cette fable, que tout le monde sait, des membres du
corps humain qui s'étaient révoltés contre l'estomac. Horace
lui-même n'a pas dédaigné l'usage de ce genre fictif dans ses
poésies: Un renard rusé dit un jour à un lion malade, etc. Ce
que j'ai appelé fable, les Grecs l'appellent αἶνος, λόγος αἰσωπείος
ou λιβυκός; quelques-uns, parmi nous, ont proposé le mot apologue;
mais ce mot n'est point communément reçu. Le proverbe, παροιμία, est
un genre allégorique qui a beaucoup d'affinité avec la fable;
seulement il est plus court, comme Ce n'est pas à nous, mais au
boeuf, de porter le bât.
Après l'exemple, l'espèce de similitude
qui a le plus de force est celle qui se tire de choses presque
pareilles , et qui n'est mêlée d'aucune métaphore. Telle est
celle-ci : Comme, dans les élections, ceux qui ont coutume de
vendre leurs suffrages ne pardonnent pas volontiers à ceux qui ne
daignent pas les acheter; de même ces juges iniques étaient venus
avec un dessein formé de perdre l'accusé. La parabole, παραβολὴ,
que Cicéron appelle comparaison, prend les choses de plus
loin, et ne se borne pas seulement aux actions de la vie humaine qui
ont entre elles de la ressemblance , comme dans le plaidoyer de
Cicéron pour Muréna : Si les gens de mer, au retour d'un voyage
de long cours, et témoins dit départ d'autres voyageurs,
s'empressent de les avertir des tempêtes, des pirates, et des
écueils qu'ils ont à craindre, par suite de cette bienveillance
naturelle que nous ressentons pour ceux qui vont à leur tour
s'exposer aux mêmes dangers que nous; quels sentiments croyez-vous
que moi, qui, après tant de tempêtes, aperçois enfin la terre, je
doive éprouver pour un homme que je vois prêt à courir une mer aussi
orageuse que l'est aujourd'hui notre république? Mais elle se
tire encore des animaux, et même des choses inanimées.
Comme les choses ne se présentent pas de la même
manière dans un plaidoyer et dans une comédie, l'orateur doit éviter
de peindre trop au naturel les personnes ou les choses, comme fait
Cassius : Quel est cet homme qui fait des grimaces comme un
vieillard dont les pieds sont enveloppés de laine? ce que les
Grecs appellent εἰκὼν, image. Il vaut mieux n'employer que les
similitudes propres à confirmer la proposition. Vous voulez prouver
qu'il faut cultiver son esprit? comparez l'esprit à la terre, qui,
négligée, ne porte que des ronces et des épines, et, cultivée, donne
des fleurs et des fruits. Vous voulez exhorter quelqu'un à prendre
part à l'administration de la république? montrez que les abeilles
et les fourmis, qui sont non seulement des animaux, mais de si
petits animaux, travaillent pour le bien public. De ce genre est
cette comparaison de Cicéron : Une ville sans lois ne peut pas
plus se servir de ses membres, qu'un corps sans âme ne se sert des
nerfs, du sang, et des autres parties qui le composent. Mais ce
n'est pas seulement au corps humain qu'il emprunte ses similitudes,
il les tire aussi des chevaux, dans la défense de Cornélius; et même
des pierres, dans le plaidoyer pour le poète Archias. On ne
va pas chercher les objets aussi loin dans les comparaisons du genre
de celle-ci : Une armée sans chef est comme un navire sans pilote.
Elle est tirée seulement des hommes, ainsi que je l'ai dit.
Cependant les similitudes ont assez souvent des apparences
trompeuses : aussi demandent-elles du discernement; car si un navire
neuf vaut mieux qu'un vieux, on n'en doit pas conclure qu'une
amitié nouvelle est préférable à une amitié ancienne. - Si
une femme est louable de partager son bien à plusieurs, il ne
s'ensuit pas qu'elle le soit de partager sa beauté. Dans ces
exemples, les termes ancienneté et partage sont semblables: mais
autre chose est de prodiguer son argent, autre chose de prodiguer
son corps. Il faut donc examiner avec attention si la proposition
qu'on induit est semblable; et même dans ces dialogues socratiques,
dont j'ai fait mention un peu plus haut, il faut prendre garde de
répondre inconsidérément aux questions, comme fit la femme de
Xénophon, interrogée par la femme de Périclès, dans le dialogue
d'Eschine le Socratique, intitulé Aspasie, Je me sers de la
traduction de Cicéron : Dites-moi, je vous prie, épouse de
Xénophon, si votre voisine avait de l'or plus fin que le vôtre,
lequel aimeriez-vous le mieux, du vôtre ou du sien? Le sien,
répondit-elle. Si elle avait des vêtements et d'autres ornements de
femme plus précieux que les vôtres, lesquels aimeriez-vous le mieux?
Les siens, répondit-elle encore. Mais si son mari valait mieux que
le vôtre, lequel aimeriez-vous le mieux, du vôtre ou du sien?
Ici la femme de Xénophon rougit, et avec raison; car elle avait mal
répondu en disant qu'elle aimerait mieux l'or de sa voisine que le
sien, cela sent trop la cupidité: mais si elle eût dit :
J'aimerais mieux que mon or fût tel que celui de ma voisine elle
eût pu répondre sans rougir : J'aimerais mieux que mon mari
ressemblât à un autre meilleur que lui. Je sais que certains
rhéteurs, par un vain scrupule d'exactitude, sont entrés dans des
divisions très subtiles, et admettent un moins semblable: ainsi,
disent-ils, un singe ressemble à un homme, et une copie ébauchée
à l'original; un plus semblable, comme lorsqu'on dit un œuf ne
ressemble pas plus à un veuf : le semblable dans les
dissemblables, par exemple, dans la fourmi et l'éléphant, car
ils se ressemblent par le genre, puisqu'ils sont animaux ; le
dissemblable dans les semblables, comme dans les
chevreaux comparés à leurs mères; car ils diffèrent par l'âge.
Ils distinguent encore plusieurs espèces de contraires : les
opposés, comme le jour et la nuit; les nuisibles, comme
l'eau froide à un homme qui a la fièvre; les incompatibles,
comme le vrai et le faux; les disparates, comme les corps
droits et ceux qui ne le sont pas ; mais je ne vois pas en quoi,
cela importe beaucoup à notre sujet.
Une remarque plus utile à faire, c'est que, dans les
questions de droit, les semblables, les contraires et les
dissemblables fournissent un grand nombre d'arguments. Ainsi, par
une raison tirée des semblables, Cicéron, dans ses Topiques,
prouve que, si on lègue à quelqu'un l'usufruit d'une maison, et
qu'elle vienne à s'écrouler, l'héritier n'est point tenu de la
rebâtir, parce que, si, au lieu d'une maison, c'eût été un esclave,
et que cet esclave vînt à mourir, on ne serait pas tenu de le
remplacer. Par la raison des contraires, vous prouverez que
le consentement suffit, même sans contrat, pour rendre un mariage
bon et valide, puisque le contrat serait sans valeur, si d'ailleurs
le consentement n'eût pas été donné. Par une raison tirée des
dissemblables, Cicéron conclut ainsi dans la défense de Cécinna :
Si quelqu'un avait employé la violence pour me chasser de chez moi,
j'aurais action contre lui; s'il m'avait seulement empêché d'y
entrer, je ne l'aurais pas. Autre exemple tiré des dissemblables
: Si celui qui a légué toute son argenterie à quelqu'un peut
paraître lui avoir aussi laissé son argent monnayé, il ne s'ensuit
pas qu'il ait voulu lui léguer l'argent qui lui était dû.
Quelques-uns ont séparé l'analogie du genre des semblables: pour
moi, je crois qu'elle en dépend; car dix est à cent comme un est
à dix : or, cette proportion est une ressemblance, comme il y a
proportion et ressemblance entre ennemi de la république et
mauvais citoyen. Ces sortes d'arguments se poussent même
encore plus loin; par exemple, s'il est honteux à une femme de
s'abandonner à son esclave, il n'est pas moins honteux à un maître
d'avoir commerce avec sa servante; si la volupté est la fin des
brutes, pourquoi ne serait-elle pas celle de l'homme ? Mais
aussi la réponse est aisée, et se tire de la dissemblance : ainsi,
autre chose est la pudeur des femmes, autre chose la pudeur des
hommes; et si la volupté est la fin des brutes, il ne s'ensuit pas
qu'elle le soit d'un être raisonnable. Même, par la raison des
contraires, on dira : parce que la volupté est la fin des bêtes,
elle ne peut pros être celle de l'homme.
A toutes les preuves extrinsèques dont j'ai parlé
dans ce chapitre, on ajoute encore l'autorité : c'est ce que
d'autres appellent jugement, du mot grec κρίσεις; non dans le sens
de sentence judiciaire, car alors ce serait un exemple; mais pour
désigner l'opinion d'une nation, d'un peuple, d'hommes renommés pour
leur sagesse, de grands citoyens, d'illustres poètes. Je n'exclus
pas même les proverbes, car ils ne sont pas sans utilité. Ces
opinions, ces proverbes sont, en quelque sorte, des témoignages
publics, d'autant plus puissants qu'ils n'ont été dictés ni par la
haine ni par la faveur, mais qu'ils ont pour fondement la vertu et
la vérité. Si, par exemple, je veux parler des misères de la vie, ne
ferai-je pas impression sur les esprits, en alléguant la pratique de
ces nations qui pleurent sur ceux qui naissent, et mêlent la joie
aux funérailles ? Si je veux attendrir les juges, sera-t-il hors
de propos de dire qu'Athènes, cette ville si sage, regardait la
pitié non seulement comme un tendre sentiment de l'âme, mais comme
une divinité? Et ces maximes des sept sages ne sont-elles pas
autant de règles de conduite? Qu'une femme convaincue d'adultère
soit encore accusée d'empoisonnement, ne semble-t-elle pas condamnée
d'avance par le jugement de Ca ton, qui a dit qu'il n'y a point
de femme adultère qui ne soit une empoisonneuse? Aussi
voyons-nous non seulement que les orateurs sèment leurs discours de
sentences des poètes, mais que les philosophes même, eux qui
méprisent si fort tout ce qui est étranger à leurs études, daignent
emprunter quelquefois l'autorité d'un vers cité à propos. En veut-on
un plus noble exemple que ce fameux différend des Athéniens et
des habitants de Mégare au sujet de Salamine, dont ils se
disputaient la possession, et qui fut adjugée aux premiers sur un
vers d'Homère, qui témoigne qu'Ajax joignit ses vaisseaux à ceux des
Athéniens, bien que le vers manque dans beaucoup d'exemplaires?
Les sentences qui sont dans la bouche de tout le monde, sans que
l'on sache qui en est l'auteur, sont également des témoignages
publics; par exemple : un ami vaut un trésor; la conscience vaut
mille témoins; et, dans Cicéron : ceux qui se ressemblent
s'assemblent, comme dit le vieux proverbe. Et, en effet, ces
sentences ne se perpétueraient pas dans la mémoire des hommes, si
elles ne paraissaient vraies à tout le monde.
Quelques-uns ajoutent, ou, pour mieux dire, mettent
au premier rang, l'autorité des dieux, fondée sur les oracles, comme
celui qui déclara Socrate le plus sage des hommes. On en fait
rarement usage; mais Cicéron n'a pas laissé de s'en servir dans son
livre sur les réponses des aruspices, et dans une de ses harangues
contre Catilina, où il montre au peuple la statue de Jupiter,
placée sur une colonne; et dans son plaidoyer pour Ligarius, où
il reconnaît que la cause de César est la plus juste, puisque les
dieux se sont déclarés pour lui. Ces preuves, si le sujet les
fournit, s'appellent des témoignages divins; et si elles sont
tirées d'ailleurs, ce ne sont que des arguments. Il arrive
quelquefois que l'on peut se prévaloir d'une parole ou d'une action
qui sera échappée, soit au juge, soit à la partie adverse, soit à
son défenseur, comme d'un témoignage qui nous est favorable : ce qui
a donné lieu à quelques auteurs de mettre les exemples et les
autorités au nombre des preuves inartificielles, par la raison que
l'orateur ne les invente pas, mais qu'il les reçoit de la cause :
distinction qui n'est pas sans conséquence; car les témoins,
la torture, et autres preuves inartificielles, décident de la
cause; tandis que les preuves artificielles ne peuvent rien par
elles-mêmes, et ne deviennent utiles que par l'application que
l'orateur en sait faire.
Chap. XII. Voilà à peu près tout ce que j'ai su
recueillir, soit de la lecture des maîtres, soit de l'expérience,
sur les règles de la preuve. Je n'ai pas la présomption de croire
que j'aie épuisé la matière; j'exhorte, au contraire, à chercher
encore après moi, et je conviens qu'on peut faire de nouvelles
découvertes : mais aussi je crois que ce que l'on découvrira
ajoutera peu aux règles que j'ai données. Maintenant je vais dire en
peu de mots de quelle manière il faut s'en servir.
On pose ordinairement en principe que tout
argument doit avoir une certitude reconnue; car l'incertain
ne peut être prouvé par l'incertain. Cependant on allègue
quelquefois, pour prouver un fait, un autre fait qui lui-même a
besoin de preuve. C'est vous qui avez tué votre mari, car vous
étiez adultère. Ne faut-il pas d'abord prouver l'adultère, afin
que ce crime, étant avéré, puisse devenir la preuve de l'autre?
La pointe de votre épée a été trouvée dans le corps de la victime.
L'accusé nie que ce soit la pointe de son épée : il faut donc
prouver ce premier fait pour pouvoir s'en servir à prouver le
second. Il importe beaucoup de remarquer que, de tous les arguments,
les plus forts sont ceux qui deviennent certains après avoir paru
douteux. Vous avez commis ce meurtre, car votre vêtement était
ensanglanté. Si l'accusé convient que son vêtement était
ensanglanté, la conséquence ne sera pas aussi grave que si d'abord
il eût nié le fait, et qu'ensuite on l'en eût convaincu. En effet,
s'il avoue que son vêtement était ensanglanté, il ne s'ensuit pas
qu'il ait commis un meurtre. Mais s'il nie, il place irrévocablement
la cause sur un point dont la décision entraînera nécessairement
tout le reste. Car il n'est pas présumable qu'il eût pris le parti
de nier faussement, s'il n'avait désespéré de pouvoir se défendre en
avouant le fait.
Si nos preuves sont fortes, il faut les proposer
séparément et insister sur chacune ; si elles sont faibles, il faut
les grouper. Car, dans le premier cas, comme elles sont puissantes
par elles-mêmes, il est bon de ne pas les mêler avec d'autres qui
pourraient les obscurcir, afin qu'elles paraissent dans tout leur
jour; et, dans le second comme elles sont faibles, elles se
soutiennent par le secours mutuel qu'elles se prêtent. Si donc ces
dernières preuves ne font pas d'effet par leur qualité, elles en
feront par leur nombre, en concourant toutes à prouver une même
chose. Par exemple, si l'on accuse un homme d'avoir assassiné un de
ses proches, on dira : Vous comptiez sur la succession, et sur
une riche succession ; vous étiez pauvre, vous étiez harcelé par vos
créanciers, vous aviez offensé celui dont vous espériez la
succession, et vous saviez qu'il avait l'intention de faire un autre
testament. Ces preuves, prises séparément, ont peu de poids et
n'ont rien de propre; mais, jointes ensemble, elles ont l'effet, non
de la foudre, mais de la grêle.
Il y a des arguments qu'il ne suffit pas de poser :
il faut encore les développer. Vous dites que la cupidité a été
la cause de ce crime? faites voir quelle est la force de cette
passion; vous dites que c'est la colère? montrez à quels
excès elle porte d'ordinaire les hommes. Par là votre argument
acquerra une nouvelle force, et aura même beaucoup plus de grâce que
s'il ne présentait que des membres nus et décharnés. Vous attribuez
une action à la haine? il importe beaucoup d'établir si cette
haine est causée par l'envie, par une offense, par l'ambition; si
elle est ancienne ou récente, si celui qui en est l'objet est un
inférieur, un égal ou un supérieur, un étranger ou un parent.
Chacune de ces circonstances se traite d'une manière particulière,
et elles doivent toutes être interprétées à l'avantage de celui que
l'on défend. Cependant il ne faut pas toujours accabler le juge de
tous les arguments qui vous viennent à l'esprit. Cette argumentation
est non seulement fatigante, mais même suspecte; car un juge sera
peu disposé à croire vos preuves fort bonnes, si vous paraissez
vous-même vous en délier. Mais quand la chose est évidente, il est
aussi ridicule de recourir à des arguments que d'allumer une lampe
en plein jour. Quelques rhéteurs recommandent en outre les preuves
pathétiques, παθητικὸς, c'est-à-dire qui se tirent des passions; et
la plus puissante, suivant Aristote, est celle qui naît de la
personne même de l'orateur, s'il est homme de bien, ou du
moins ce qui tient le second rang, mais à une grande distance,
s'il le paraît. De là en effet cette noble défense de Scaurus :
Quintus Varius de Sucron accuse Emilius Scaurus d'avoir trahi la
république romaine : Emilius Scaurus le nie. Iphicrate, dit-on,
se défendit de même dans une cause semblable. Ayant demandé à
Aristophon, qui était son accusateur, si pour de l'argent il
trahirait la république, et Aristophon ayant répondu que non :
Quoi! dit-il, ce que tu ne ferais pas, tu veux que je l'aie fait?
Mais il faut surtout considérer quel est celui devant qui on parle,
afin de chercher ce qui est le plus propre à faire impression sur
son esprit. C'est un précepte que j'ai donné à propos de l'exorde et
du genre délibératif.
De même qu'on nie avec assurance, on affirme aussi du
même ton : Oui, j'ai fait cela. - Vous-même me l'avez dit. - O
action indigne! etc. Les affirmations sont nécessaires dans un
plaidoyer et, quand elles ne s'y trouvent pas, la cause souffre.
Cependant il ne faut pas les compter parmi les moyens les plus
puissants, les deux parties pouvant également s'en servir. Les
preuves de cette nature, qui sont accompagnées d'une raison
plausible, sont plus solides. Ainsi, un homme qui a été blessé,
ou dont on a empoisonné le fils, peut alléguer qu'il n'est pas
croyable qu'il en accuse un autre que le coupable, puisque, s'il
s'en prenait à un innocent, ce serait disculper l'auteur du crime.
C'est sur un raisonnement de même espèce que s'appuient les pères
qui sont obligés de plaider contre leurs enfants, ou quiconque
entreprend un procès contre un parent ou un ami intime.
Faut-il placer les preuves les plus fortes au
commencement, pour s'emparer tout d'abord de l'esprit du juge? Ou à
la fin, pour que le juge, en se levant, en emporte l'impression
toute récente? Ou partie au commencement, partie à la fin, avec les
plus faibles au milieu, selon l'ordre de bataille que nous voyons
dans Homère? Ou bien faut-il les présenter dans un ordre progressif,
en commençant par les plus faibles? La disposition des preuves,
selon moi, dépend de la nature de la cause; et je n'accorde à cette
règle qu'une exception, c'est que la confirmation n'aille pas en
déclinant des plus fortes aux plus faibles.
Voilà ce que j'avais à dire des arguments. Je me suis
contenté d'indiquer, le plus clairement que j'ai pu, leurs genres et
les lieux d'où on peut les tirer. Quelques auteurs ont été plus
diffus, ayant pris plaisir à traiter les lieux communs et à
enseigner la manière de les développer. Mais ce détail m'a paru
inutile; car on voit assez ce qu'il y a à dire contre la haine,
contre la cupidité, contre un témoin passionné, contre le crédit
d'amis puissants, et l'on ne finirait pas, si l'on voulait
épuiser tous ces lieux. Autant vaudrait entreprendre d'énumérer
toutes les questions, toutes les preuves et toutes les pensées qui
peuvent entrer dans les causes présentes et futures.
Je ne me flatte pas d'avoir indiqué tous les lieux
des arguments, mais je crois en avoir indiqué le plus grand nombre.
Je m'y suis attaché avec d'autant plus de soin, que les
déclamations, dont nous nous servions autrefois, comme de lances
véritablement armées de fer, pour nous préparer aux combats du
barreau, ne leur ressemblent plus aujourd'hui en rien : ne se
proposant plus que de plaire à l'auditeur, elles manquent tout à
fait de nerfs. Aussi peut-on comparer nos déclamateurs à ces
marchands d'esclaves qui, pour procurer une beauté factice aux
jeunes garçons dont ils font trafic, les dépouillent de leur
virilité. Car, de même que la force des muscles et des bras, la
barbe surtout, et les autres attributs de notre sexe, sont pour eux
sans beauté, et que ce qui serait vigueur, s'ils laissaient faire au
temps, leur paraît une rudesse qu'il faut adoucir; ainsi nous
dissimulons sous une molle délicatesse de langage la mâle vigueur,
et, pour ainsi dire, la virilité de l'éloquence ; et, pourvu qu'un
discours soit poli et brillant, nous nous mettons peu en peine de sa
force. Mais pour moi, qui considère avant tout la nature, il n'est
pas d'homme, ayant sa virilité, qui ne me paraisse plus beau que le
plus bel eunuque. Je ne croirai jamais la Providence si ennemie de
son propre ouvrage, qu'il faille mettre la débilité au rang des
perfections de la nature humaine ; et l'on ne me persuadera pas
qu'une main impie puisse faire quelque chose de beau d'un être qui
serait regardé comme un monstre, s'il était né dans l'état où le fer
l'a réduit. Que l'imposture d'un sexe équivoque serve donc à la
débauche tant que l'on voudra, la dépravation des moeurs ne rendra
jamais bon et honnête ce qu'un caprice extravagant a rendu cher et
précieux. Que des auditeurs voluptueux et efféminés admirent cette
éloquence lubrique; pour moi, je ne donnerai pas même le nom
d'éloquence à un langage entièrement dépouillé des nobles signes de
la virilité, pour ne pas dire de la gravité et de la sainteté. En
effet, ces sculpteurs et ces peintres fameux de l'antiquité,
lorsqu'ils ont voulu représenter un beau corps d'homme, sont-ils
jamais tombés dans la ridicule erreur de prendre pour modèle un
Bagoas ou un Mégabyse? Ils ont choisi le jeune
Doryphore, également propre aux fatigues de la guerre et aux
exercices de la lutte, ou quelque autre guerrier ou athlète, plein
de vigueur. C'est dans ces hommes-là qu'ils ont reconnu et cherché
la véritable beauté. Et moi, dont le dessein est de former un
orateur, j'irais donner à l'éloquence un tambourin, au lieu de
véritables armes? Que les jeunes gens, pour qui j'écris, se
rapprochent donc, autant que possible, de la réalité; et, puisqu'ils
se destinent aux combats du barreau, que, dès leur jeunesse, ils
aient la victoire devant les yeux ; qu'ils apprennent à porter des
coups mortels et à s'en défendre. Que les maîtres exigent surtout
cette mâle vigueur de leurs élèves, et qu'ils les félicitent
particulièrement des preuves qu'ils en auront données : car si les
jeunes gens se laissent entraîner jusqu'au mal par l'amour des
louanges, à plus forte raison aimeront-ils à se voir loués du bien.
Mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire est passé sous silence, et
l'utile n'est plus compté comme un bien. C'est un abus que j'ai
attaqué dans un autre ouvrage, et que je ne saurais assez combattre
dans celui-ci. Mais je reviens à mon sujet et à l'ordre que je me
suis prescrit.
CHAP. XIII. La réfutation peut s'entendre de deux
manières : ou de la plaidoirie du défendeur en général, ou de la
réponse réciproque aux objec- tions qui se font de part et d'autre;
et c'est proprement celle-ci qui occupe le quatrième rang dans un
plaidoyer. Au surplus, pour le défendeur comme pour le demandeur,
les règles sont les mêmes; et, dans la réfutation comme dans la
confirmation, les arguments se tirent des mêmes sources : lieux,
pensées, expressions, figures, tout relève du même principe.
Seulement, la réfutation a d'ordinaire des mouvements plus doux.
Cependant ce n'est pas sans raison qu'on a toujours cru, et Cicéron
l'a reconnu en maint endroit, qu'il est plus difficile de
défendre que d'accuser. D'abord, l'accusation est plus
simple : il n'y a qu'une manière d'avancer une chose ou un fait, et,
pour y répondre, il y en a mille; il suffit la plupart du temps à
l'accusateur que ce qu'il avance soit vrai, tandis que l'accusé est
obligé de nier le fait, de le justifier, de décliner la compétence,
d'excuser l'intention, de prier ou d'attendrir les juges, de pallier
les motifs, d'éluder l'accusation, de faire semblant de la mépriser,
de railler. Ainsi, du côté de l'accusateur, l'action est directe,
et, pour ainsi dire, criarde; la défense, au contraire, a besoin de
prendre mille détours et de recourir à toute sorte d'artifices. En
second lieu, l'accusateur arrive ordinairement tout préparé;
l'accusé a souvent à répondre à des allégations imprévues. L'un se
borne à produire des témoins ; l'autre est obligé de repousser
l'accusation par des preuves tirées du fond de la cause.
L'accusateur trouve une ample matière à discourir dans l'énormité
des faits incriminés, lors même qu'ils sont faux s'il s'agit, par
exemple, de parricide, de sacrilège, de lèse-majesté, l'accusé n'a
pour lui que la négative. C'est pourquoi des orateurs médiocres ont
su quelquefois soutenir une accusation d'une manière satisfaisante;
mais nul, à moins d'être très éloquent, n'a pu se tirer
convenablement d'une défense. Car, pour définir en un mot ma pensée,
il est plus aisé d'accuser que de défendre, comme il est plus aisé
de faire une blessure que de la guérir.
Or, pour défendre, il importe beaucoup de considérer
et ce que l'accusateur a avancé, et en quels termes. On examinera
donc d'abord si ce que l'on a à réfuter est propre ou étranger à la
cause. Dans le premier cas, il faut ou nier le fait, ou le
justifier, ou prouver que l'action est mal intentée. Dans tout
procès, il n'y a guère que ces trois moyens de défense : car la
déprécation, toute seule et sans défense, est tout à fait
exceptionnelle, et ne peut avoir lieu que devant des juges qui sont
au-dessus des lois. Encore même, dans ces causes qui ont été portées
devant César ou les triumvirs, et dans lesquelles il s'agissait de
défendre des personnes qui avaient embrassé un parti contraire au
leur, la défense, tout en recourant aux prières, ne laissa pas d'y
mêler des raisons auxiliaires; à moins qu'on ne prétende que Cicéron
ne défendait pas fortement Ligarius, en disant: Avouons-le,
Tubéron, que cherchions-nous autre chose que de pouvoir nous-mêmes
ce que peut aujourd'hui César? Que si on parle devant le prince,
ou devant tout autre juge, qui soit libre dans ses jugements, et
qu'on ait à dire, pour toute défense, que l'accusé a mérité la mort,
mais que la justice n'exclut pas la clémence, d'abord ce n'est plus
à l'accusateur, mais au juge, qu'on aura affaire; ensuite, la forme
sera plutôt délibérative que judiciaire, en ce qu'on aura à
conseiller de préférer le mérite de l'humanité au plaisir de la
vengeance. A l'égard des causes qui se plaident devant des juges qui
doivent prononcer selon la loi, il serait ridicule de donner des
préceptes sur la manière de se défendre après avoir confessé le
fait. Lors donc qu'un fait ne se peut nier, ou qu'on ne peut prouver
que le juge est incompétent, il faut combattre l'accusation telle
qu'elle est, ou renoncer à se défendre. J'ai déjà enseigné qu'on nie
de deux manières: ou en soutenant que le fait est faux, ou en
soutenant qu'il est différent. Or, tout fait qu'on ne peut
justifier, ou dont on ne peut éluder le jugeaient, il faut le nier,
non seulement dans le cas où sa qualité est contestable, mais lors
même qu'on n'aurait que la ressource de nier purement et simplement.
On produit des témoins, il est vrai; mais que ne peut-on pas dire
contre des témoins? Une signature? l'écriture peut avoir été
contrefaite. Enfin, rien n'est pire que d'avouer. Que si le fait ne
peut être nié ni justifié, il reste un dernier moyen,
l'incompétence. Mais, dira-t-on, il y a des cas où ces trois
moyens ne peuvent être employés. Par exemple, une femme accouche
après un an de veuvage; on l'accuse d'adultère. Dans ce cas, il
n'y a point de procès. Aussi me paraît-il ridicule de faire m
précepte du silence, comme d'un moyen propre à dissimuler ce qu'on
ne peut justifier, puisque c'est sur quoi le juge doit prononcer.
Mais si ce que l'accusateur avance n'appartient pas
essentiellement à la cause, et n'en est seule ment qu'un accessoire,
le mieux, ce me semble, sera de dire que cela est étranger à la
question, qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, et que la chose a
moins d'importance que l'accusateur ne lui en donne. Cependant,
l'avocat pourrait suivre le conseil que je blâmais tout à l'heure,
et faire semblant, par son silence, de n'avoir pas pris garde à un
grief de l'adversaire; parce qu'un bon avocat ne doit pas craindre
d'encourir le reproche de négligence, quand il s'agit de sauver son
client.
On verra aussi s'il est à propos de réfuter les
arguments de l'accusateur tous à la fois ou l'un après l'autre. On
les réfute en masse, lorsqu'ils sont si faibles qu'il suffit d'un
seul coup pour les renverser tous , ou si épineux , qu'il n'est pas
expédient de les attaquer séparément : car il faut alors ramasser
toutes ses forces, et, pour ainsi dire, se précipiter tète baissée
contre l'ennemi. Quelquefois, s'il est trop difficile de détruire
les arguments de l'adversaire, nous les comparerons avec les nôtres,
pourvu toutefois que cette comparaison doive tourner à notre
avantage. On désunira ceux dont la force est dans le nombre, comme
dans l'exemple que j'ai déjà donné : Vous étiez son héritier,
vous étiez pauvre, vous étiez harcelé par vos créanciers, vous
l'aviez offensé, et vous saviez qu'il devait faire un autre
testament. Toutes ces circonstances, jointes ensemble, sont
assez pressantes. Séparez-les, il en sera comme de la flamme
qu'entretenait un grand amas de combustibles, et qui s'évanouit dès
qu'on les éparpille; ou comme d'un fleuve profond, qui devient
guéable partout, si on le divise en plusieurs bras. On verra donc
laquelle des deux manières est la plus avantageuse, et l'on y
conformera la proposition, qui sera tantôt détaillée, tantôt
générale; car il suffira quelquefois de rassembler en une seule
proposition les inductions que l'adversaire aura tirées de plusieurs
faits. Par exemple, s'il a énuméré une foule de motifs qui ont pu
porter l'accusé à commettre le crime dont il s'agit : sans reprendre
tous ces motifs, on dira purement et simplement qu'il n'y a pas lieu
de s'y arrêter, parce qu'un homme a bien pu avoir plusieurs raisons
de commettre un crime, et pourtant ne l'avoir pas commis. La plupart
du temps néanmoins il est expédient à l'accusateur de grouper ses
arguments, et à l'accusé de les réfuter l'un après l'autre.
Mais il faut encore examiner comment on doit réfuter
ce qui a été dit par l'adversaire; car, si cela est visiblement
faux, il suffit de nier. Ainsi, dans la défense de Cluentius, celui
que l'accusateur avait dit être mort incontinent après avoir bu,
Cicéron nie qu'il soit mort le même jour. Quant aux choses qui sont
évidemment contradictoires, oiseuses, dépourvues de sens, comme il
n'y a aucun art à les relever, je ne donnerai là-dessus ni préceptes
ni exemples. J'en dis autant de ce genre de preuves qu'on nomme
obscur, et qui consiste dans des faits si secrets, qu'il ne s'en
trouve ni témoins ni indices. Il suffit alors que l'accusateur ne
confirme pas ce qu'il a avancé. Il en est de même de tout ce qui
sort de la question. Cependant il est quelquefois d'un orateur
habile de discuter les allégations de l'accusateur de manière
qu'elles paraissent ou contradictoires, ou étrangères à la cause, ou
incroyables, ou superflues, ou même favorables à l'accusé. On
reproche à Oppius de s'être enrichi aux dépens des soldats : la
réfutation paraît difficile; mais Cicéron fait voir que le reproche
est contradictoire, en ce que les mêmes personnes accusaient Oppius
d'avoir voulu corrompre l'armée par ses largesses. L'accusateur
de Cornélius s'engage à produire des témoins qui le convaincront
d'avoir lu le texte de la loi : Cicéron rend cela inutile, en
disant que Cornélius en convient lui-même. Q. Cécilius demande la
commission d'accuser Verrès, parce qu'il avait été son questeur;
et Cicéron, qui la demande aussi, tire de cette raison même un moyen
pour l'obtenir. Hors de ces exemples, la manière de traiter les
arguments est la même que pour la confirmation. On examine, par la
conjecture, s'ils sont fondés; par la définition,
s'ils sont propres; par la qualité, s'ils ne sont pas
contraires à l'honnêteté, à l'équité, à la probité, à l'humanité, à
la douceur, et aux autres vertus qui découlent de celles-ci. Et il
faut observer si cela se rencontre non seulement dans les
propositions, mais encore dans toutes les parties de l'accusation :
ainsi Labienus est taxé de cruauté par Cicéron, en ce qu'il poursuit
Rabirius dans toute la rigueur de la loi portée contre les ennemis
de la république; Tubéron, d'inhumanité, en ce qu'il profite de
l'exil de Ligarius pour l'accuser, afin que César ne lui pardonne
pas; l'accusateur d'Oppius, de prétention outrageante, en ce que,
sur une simple lettre de Cotta il se croit permis de dénoncer
Oppius. On relèvera de même ce qui trahit la précipitation, la
perfidie, l'animosité. Mais il faut s'emparer surtout de ce qui peut
tirer à conséquence pour la société ou pour les juges. En voici des
exemples, tirés de Cicéron : Quelle étrange maxime, dit-il
dans la défense de Tullius, et où en serions-nous, si l'on
admettait qu'il fût permis de tuer un homme, par cela seul qu'on
craint d'en être tué? Et, parlant pour Oppius, il s'attache à
détourner les juges d'admettre un genre d'action qui pourrait
retomber sur l'ordre entier des chevaliers. Il y a cependant
certains arguments qu'il est bon de mépriser, ou comme frivoles, ou
comme étrangers à la cause: c'est ce qu'a fait Cicéron dans
plusieurs plaidoyers; et cet air de mépris s'étend quelquefois
jusqu'à des arguments que nous serions fort en peine de réfuter
sérieusement.
Cependant, comme la plupart de ces arguments sont
tirés du lieu des semblables, il faut faire tous ses efforts
pour y découvrir quelque dissemblance. Cela n'est pas difficile dans
les questions de droit; car, si la question à juger ne ressemble
jamais au cas prévu par la loi, il ne doit pas être difficile de
trouver une différence entre deux questions auxquelles l'accusateur
veut rapporter la loi. Quant aux similitudes tirées des bêtes
ou des choses inanimées, il est aisé de les éluder. A l'égard des
exemples tirés des faits, on les peut réfuter de plusieurs manières.
S'ils sont anciens , on les traitera de fabuleux; s'ils sont
indubitables, ou se rejettera, au défaut de toute autre ressource,
sur la disparité; car il est impossible que deux choses soient
entièrement semblables. Veut-on justifier Nasica, qui a tué
Gracchus, par l'exemple d'Aliala, qui tua Mélius ? On dira que
Mélius affectait la royauté, et que Gracchus venait de porter des
lois favorables au peuple; qu'Ahala était maître de la cavalerie, et
que Nasica était un simple particulier. Si toutes ces raisons
manquent, on verra si l'on ne peut pas dire que le fait cité pour
exemple est, à la vérité, autorisé d'un grand nom, mais qu'au fond
il n'en est pas plus légitime. Même règle pour la réfutation des
exemples tirés de la chose jugée.
J'ai enseigné en second lieu qu'il importe de
considérer en quels termes l'accusateur a dit chaque chose. Si donc
il s'est exprimé en termes modérés, nous répéterons ses propres
paroles; si, au contraire, son langage a été âpre et violent, nous
reprendrons ce qu'il a dit en termes plus doux, en ajoutant aussitôt
quelque explication justificative, comme fit Cicéron dans la défense
de Cornélius. Il ne dit pas, comme l'accusateur, Cornelius a lu,
mais Cornélius a touché à la tablette de la loi. S'agit-il
d'un débauché? dites On vous a représenté mon client comme un
homme un peu trop adonné au plaisir. Au lieu d'avare,
dites économe; au lieu de médisant, dites un homme
un peu libre dans ses paroles. Mais ce dont il faut bien se
garder, c'est de rapporter les allégations de l'adversaire avec
leurs preuves ou leur amplification, si ce n'est pour les éluder,
comme dans cet exemple tiré de Cicéron : Vous aurez été toujours
à l'armée, vous n'aurez pas mis le pied dans la place publique
depuis tant d'années, et, après cela, vous viendrez disputer les
honneurs à des gens qui n'ont jamais quitté Rome et les affaires?
Quelquefois dans les répliques on reproduira l'accusation entière,
comme fait Cieéron dans la défense de Scaurus au sujet de Bostaris;
ou bien on joindra plusieurs propositions ensemble, telles que
l'accusateur les a énoncées, comme dans la défense de Varénus :
Lorsque Varénus traversait avec Pompulénus des champs et des lieux
solitaires, ils rencontrèrent, dit-on, les esclaves d'Ancharius :
Pompulénus fut tué, et Varénus enchaîné, en attendant que son parent
Lucius Varénus eût décidé de son sort. Il faut toujours employer
ce dernier moyen, si l'ordre des faits paraît incroyable, et si une
simple exposition suffit pour leur ôter toute vraisemblance. Quand
les propositions se soutiennent par l'ensemble, il faut les réfuter
séparément et en détail ; et c'est ordinairement le plus sûr.
Quelquefois les répliques sont indépendantes les unes des autres, et
il est inutile d'en donner des exemples.
Il y a des arguments qui sont communs, c'est-
à-dire dont chaque partie peut également tirer avantage. Si
l'accusateur s'en est servi, l'accusé s'en servira encore plus
avantageusement, non seulement parce qu'ils sont communs, mais parce
qu'ils sont plus favorables à celui-ci; car, je l'ai dit souvent et
j'aime à le redire : quiconque emploie le premier un argument
commun, se le rend contraire. En effet, un argument devient
contraire, dès que la partie adverse peut s'en servir. Non, il
n'est pas vraisemblable que M. Cotta ait imaginé une action si
noire. Or, est-il vraisemblable qu'Oppius s'y soit déterminé?
Il est d'un habile orateur de découvrir dans le
plaidoyer de son adversaire ce qu'il y a de contradictoire, ou ce
qui paraît l'être. Tantôt la contradiction ressort elle-même des
faits : Clodia prétend, d'un côté, avoir prêté des bijoux à
Célius, ce qui est la marque d'une grande intimité; et, de l'autre,
que Célius a voulu l'empoisonner, ce qui suppose une haine mortelle;
- Tubéron fait un crime à Ligarius d'avoir été en Afrique, et il se
plaint en même temps de ce que celui-ci lui en a fermé l'entrée.
Tantôt la contradiction se rencontre dans certaines paroles
inconsidérées, qui échappent particulièrement à ceux qui, en courant
après des pensées ingénieuses, et ne songeant qu'à montrer de
l'esprit, ne font pas attention à la portée de ce qu'ils disent :
préoccupés du lieu où ils se sont arrêtés, ils perdent de vue
l'ensemble de la cause. Quoi de plus fâcheux, en apparence, pour
Cluentius, que d'avoir été noté d'infamie par les censeurs? Quel
préjugé contre lui, que la conduite d'Egnatius qui avait déshérité
son fils, parce que ce fils, de concert avec Cluentius, avait
corrompu les juges pour faire condamner Oppianicus? Cependant
Cicéron fait voir que ces deux faits se contredisent : Mais vous,
Accius, considérez avec soin si le jugement des censeurs a plus de
gravité que celui d'Égnatius. Si celui-ci vous paraît plus grave,
vous regarderez comme légères les notes de censure portées contre
les autres par les censeurs, puisqu'ils ont exclu du sénat ce même
Egnatius que vous voulez faire passer pour un homme d'une autorité
grave. Si vous préférez le jugement des censeurs, songez que ce même
Égnatius, que son père a noté d'infamie en le déshéritant, a été
conservé dans le sénat par ces mêmes censeurs, qui en même temps
avaient exclu son père du sénat. Il ne faut pas beaucoup de
clairvoyance pour remarquer certaines fautes grossières dans
lesquelles peut tomber l'accusateur, comme de donner un argument
douteux pour un argument certain, un fait contesté pour un fait
avoué; d'alléguer une preuve commune pour une preuve particulière,
une raison triviale, frivole, tardive, incroyable. Car les
orateurs, peu circonspects, tombent dans toutes ces fautes et dans
bien d'autres, comme d'exagérer le fait incriminé, quand il s'agit
de le prouver; de disputer sur le fait, quand il s'agit d'en
chercher l'auteur; de tenter l'impossible; de croire avoir poussé à
bout ce qui n'est qu'ébauché; d'aimer mieux parler de la personne
que de la cause; d'imputer aux choses les vices des hommes, si, par
exemple, on accusait le décernvirat, au lieu d'accuser Appius;
de contredire l'évidence; de s'exprimer d'une manière ambiguë; de
perdre de vue le point capital de la question; de répondre à toute
autre chose que l'objection qui leur est faite : ce qui n'est
excusable que dans le cas où la cause est si mauvaise, qu'elle ne se
peut défendre que par des moyens extrinsèques. Par exemple,
Verrès est accusé de péculat : on louera le courage et l'activité
qu'il a déployés pour défendre la Sicile contre les pirates.
J'étends les mêmes préceptes aux objections. Je ferai
cependant remarquer que beaucoup d'orateurs tombent ici dans deux
défauts opposés. Les uns, même au barreau, les laissent de côté
comme quelque chose de fâcheux et de désagréable, et le plus
souvent, contents de ce qu'ils ont apporté de chez eux , ils parlent
comme s'ils n'avaient pas d'adversaire : défaut qui est encore plus
ordinaire dans les écoles, où non seulement on ne s'occupe pas des
objections, mais même les sujets sont tellement faits à plaisir,
qu'on ne peut rien répliquer en faveur de la partie adverse. Les
autres, exacts jusqu'au scrupule, croient qu'il est nécessaire de
répliquer à tout, à chaque mot, à la plus petite pensée; ce qui est
infini et même inutile : car c'est réfuter la cause, et non
l'orateur, en qui je m'attacherais plutôt à reconnaître toujours un
homme éloquent, afin de pouvoir imputer à son esprit, et non à sa
cause, ce qu'il aura dit de bon, et imputer à sa cause, et non à son
esprit, ce qu'il aura dit de mauvais.
Quand Cicéron reproche à Rullus son obscurité, à
Pison sa stupidité, à Antoine son ignorance crasse et sa sottise, il
est excusable, en ce qu'il cède à la passion ou à de justes
ressentiments; et ces sortes d'invectives contribuent à inspirer aux
juges la haine dont on est animé. Mais à l'égard d'un avocat, il
faut lui répondre autrement que par des injures, bien qu'il soit
permis d'attaquer, je ne dis pas seulement son discours, mais sa
conduite , sa figure, sa démarche, son air. Ainsi nous voyons
Cicéron attaquer dans Quintius jusqu'à sa robe bordée de pourpre,
qui descendait jusqu'à ses talons. On sait que Quintius avait
cherché à soulever le peuple contre Cluentius par des harangues
pleines de violence. Quelquefois, pour diminuer l'odieux de certains
griefs, on les élude par quelque plaisanterie. Triarius faisait un
crime à Scaurus d'avoir fait transporter par la ville des colonnes
sur des chariots : Et moi, dit Cicéron, qui possède des
colonnes d'Albe, je les ai fait apporter sur des bâts. A l'égard
de l'accusateur, on permet plus volontiers contre lui l'invective,
et en certaines occasions le zèle de la défense en fait une loi.
Mais ce qu'il est permis et même d'usage de reprocher, sans blesser
les convenances, au défenseur aussi bien qu'à la personne qu'il
défend, c'est d'avoir à dessein passé sous silence, abrégé, obscurci
ou ajourné quelque partie de la cause; c'est encore un sujet de
blâme assez fréquent, de vouloir donner le change en défendant sa
partie sur une chose dont elle n'est pas accusée. Ainsi Accius qui
prévoyait que Cicéron ne défendrait Cluentius que par la loi qui le
protégeait, et Eschine qui prévoyait, au contraire, que Démosthène
ne parlerait point de la loi en vertu de laquelle il accusait
Ctésiphon, ne manquent pas d'en avertir les juges et de s'en
plaindre. Quant à nos déclamateurs, je leur donnerai un avis, dont
ils ont surtout besoin : c'est de ne point faire de ces objections
qui se réfutent sans peine, et de ne pas supposer qu'ils n'ont
jamais affaire qu'à des sots. Or, pour avoir occasion de traiter des
lieux communs, sur lesquels on ne tarit point, et de placer
quelques-unes de ces pensées brillantes qui plaisent tant à la
multitude, nous nous arrogeons le droit de parler de tout, et nous
aurions besoin de nous souvenir quelquefois de ce bon mot : Il
n'a pas mal répondu, mais la question n'était pas fort embarrassante.
Cependant cette habitude est dangereuse, et sera funeste au barreau,
où il faut répondre à l'adversaire, et non à soi-même. On demandait,
à Accius pourquoi il ne plaidait pas, lui qui mettait tant de force
dans les dialogues de ses tragédies : C'est, répondit-il,
que mes personnages disent ce que je veux, et qu'au barreau mes
adversaires diraient ce que je ne voudrais pas. Il est donc
ridicule que, dans des exercices qui doivent nous préparer au
barreau, on songe à répondre avant de savoir ce que dira
l'adversaire; et un bon maître doit applaudir à la pénétration de
son élève, lorsqu'il découvre les raisons qui peuvent servir à son
adversaire, comme lorsqu'il découvre celles qui sont pour lui.
Cependant il y a une autre manière d'aller au-devant des objections,
qu'on peut se permettre toujours dans les écoles, mais rarement au
barreau. Et cri effet, pour ce qui est du barreau, supposez que vous
êtes demandeur et que vous avez à parler le premier, comment
pourrez-vous contredire votre adversaire et déterminer le véritable
état de la cause, puisqu'il n'a encore rien dit?
La plupart des orateurs tombent néanmoins dans cette
faute, soit par suite de l'habitude qu'ils ont contractée dans les
écoles, soit par la démangeaison de parler, et donnent par là
occasion à l'adversaire de les railler fort agréablement : Je
n'ai point dit et je me garderai bien de dire une pareille sottise;
je remercie mon adversaire de son avis officieux. Très souvent
même (et cette argumentation est très forte) il dira que si
l'adversaire a fait d'avance la réponse, c'est qu'il sentait bien
que la difficulté était fondée, et qu'il n'a pu étouffer la voix de
sa conscience. On trouve un exemple de cette réplique adroite
dans le plaidoyer de Cicéron pour Cluentius: Vous prétendez
savoir de bonne part que mon dessein est d'invoquer la loi en faveur
de cette cause : eh quoi! serions-nous trahis sans le savoir?
Quelqu'un de ceux que nous regardons comme nos amis aurait-il révélé
notre secret à notre adversaire? Qui vous a donc si bien instruit?
quel est ce perfide? à qui me suis-je ouvert? Personne, que je
sache, n'est coupable : c'est la loi qui vous a tout appris.
Quelques-uns, non contents de se faire l'objection, la développent
comme ferait l'adversaire lui-même. Ils savent, disent-ils,
que l'adversaire dira cela, et qu'il le prouvera par telle et
telle raison. De mon temps, Vibius Crispus, homme d'un esprit
agréable et enjoué, se moqua fort plaisamment d'un orateur qui
s'était ainsi mêlé de le faire parler : Je ne parlerai pas de
cela : à quoi bon dire deux fois la même chose?
Cependant on peut quelquefois aller au-devant des
objections, si, en dehors des débats publics, et par suite d'une
enquête, l'adversaire a discuté quelque moyen de défense dans la
consultation ; car alors c'est répondre à ce qu'il a avancé, et non
à ce que nous avons imaginé. On le peut encore lorsque la cause est
de telle espèce, que les objections que nous nous faisons sont les
seules qui se puissent faire. Par exemple, une chose dérobée se
retrouve dans une maison : il faut nécessairement que l'accusé dise
que cette chose ci été apportée chez lui à son insu, ou qu'elle
y avait été mise en dépôt, ou bien qu'on la lui avait donnée.
Ainsi on peut répondre à ces trois objections, sans attendre que
l'adversaire les propose. Mais dans les déclamations des écoles,
nous pouvons aller au-devant des objections et y répondre, afin de
nous exercer tout à la fois à jouer les deux rôles, c'est-à-dire à
parler en premier et en second pour le demandeur. Autrement on
n'aurait jamais l'occasion de débattre les objections, puisqu'on n'a
pas à qui répondre.
Il y a un autre défaut qu'il ne faut pas moins éviter
dans la réfutation, c'est de paraître embarrassé de la difficulté
qu'on a à combattre, et de s'escrimer à chaque pas pour se faire
jour. Cette défense laborieuse inspire de la défiance au juge, et
souvent des raisons qui, présentées hardiment, n'eussent laissé
aucun doute dans son esprit, lui deviennent suspectes par les
précautions mêmes dont on les accompagne; car il sera porté à croire
qu'on ne s'assurait pas beaucoup en elles seules. Que l'orateur
montre donc dans toutes ses paroles une confiance qui témoigne sans
cesse de la bonté de sa cause. C'est en quoi Cicéron brille comme
dans tout le reste. L'assurance qu'il affecte a l'air de la
sécurité, et l'autorité qu'il donne à ses paroles est si puissante
qu'elle tient lieu de preuve : on n'ose. douter de ce qu'il avance.
Au reste, quiconque connaîtra bien le fort et le
faible de l'accusation et de la défense discernera sans peine les
objections au-devant desquelles il doit aller, ou les raisons sur
lesquelles il doit insister. A l'égard de l'ordre qu'il faut tenir,
il n'est nulle part ailleurs plus facile. Si nous sommes demandeurs,
nous confirmerons d'abord nos preuves; ensuite, nous réfuterons
celles qu'on nous objectera : si nous sommes défendeurs, nous
commencerons par la réfutation. Mais d'une objection naît une autre
objection, et cela indéfiniment. Ainsi, dans les luttes de
gladiateurs, les attaques qu'on appelle de seconde main
deviennent de troisième main, si la première a eu pour but
d'attirer l'adversaire au combat; et même de quatrième, si on
a provoqué deux fois, de manière qu'on ait eu à se défendre deux
fois, comme on a attaqué deux fois: ce qui peut encore aller plus
loin.
Dans le chapitre précédent, j'ai parlé d'une preuve
qui n'est que l'expression du témoignage de la conscience, et qui
consiste à affirmer simplement ou à nier, comme fit Scaurus, dont
j'ai rapporté l'exemple. Cette sorte de preuve convient aussi à la
réfutation. Je ne sais même si sa place naturelle n'est point
lorsqu'il s'agit de nier. Mais ce que je recommande surtout aux deux
parties, c'est de bien examiner le point capital du procès; car
souvent on parle de part et d'autre sur beaucoup de choses, et en
définitive le jugement ne porte que sur un très petit nombre de
points.
Telles sont les règles de la confirmation et de la
réfutation. Mais ce n'est pas tout : il faut que la force et l'éclat
de l'éloquence viennent en aide à nos preuves; car, quelque bonnes
qu'elles soient en elles-mêmes, elles paraîtront toujours faibles,
si l'orateur ne les anime et ne les vivifie. Et en effet, ces lieux
communs sur les témoins, sur les pièces, sur les arguments,
et autres preuves de cette espèce, contribuent beaucoup à entraîner
les juges; comme aussi ces lieux particuliers dont on se sert pour
louer ou blâmer une action, pour démontrer qu'elle est juste ou
injuste, pour en exagérer ou en diminuer l'importance, pour la
présenter sous des couleurs odieuses ou favorables. Or, de ces
lieux, les uns sont fort utiles dans la comparaison d'un argument
avec un autre, ou de plusieurs entre eux; d'autres influent sur la
décision de la cause entière; ceux-ci servent -à préparer le juge,
ceux-là à l'affermir dans les dispositions où il est déjà : et
tantôt c'est sur la cause entière, tantôt c'est sur quelques parties
qu'il faut le préparer ou l'affermir, et cela suivant la convenance.
C'est pourquoi j'admire que de célèbres rhéteurs, qui ont été comme
les chefs de deux sectes différentes, aient agité sérieusement
s'il faut traiter ces lieux à la suite de chaque question, comme
le veut Théodore, ou s'il faut instruire le juge avant de songer
à l'émouvoir, ainsi que le veut Apollodore; comme si on ne
pouvait pas tenir le milieu dont je parle, et qu'on ne dût jamais
prendre conseil de son sujet. Ceux qui nous donnent ces préceptes
sont évidemment étrangers au barreau. Aussi leurs règles, fruit de
la spéculation et du loisir, se trouvent-elles en défaut au jour du
combat. En effet, la plupart de ceux qui ont fait de la rhétorique
un art si mystérieux nous ont assujettis à des lois fixes, non
seulement en ce qui regarde les lieux d'où on doit tirer les
arguments, mais encore en ce qui regarde la forme qu'on doit leur
donner. J'en dirai d'abord quelques mots, après quoi j'exposerai
hardiment ce que je pense, c'est-à-dire ce que je vois que les plus
célèbres orateurs ont fait.
CHAP. XIV. On appelle enthymème non seulement
l'argument, c'est-à-dire la chose dont on se sert pour en prouver
une autre, mais encore l'énonciation de l'argument; et, comme je
l'ai déjà dit , cette énonciation est de deux sortes. Car tantôt
l'enthymème se tire des conséquents, et consiste en une proposition
immédiatement suivie de sa preuve, comme celui-ci, dans l'oraison
pour Ligarius : La cause était douteuse alors , parce que chaque
parti pouvait se justifier jusqu'à un certain point; mais
aujourd'hui on ne peut douter que le parti le meilleur ne soit celui
pour lequel les dieux se sont déclarés. Ce raisonnement contient
une proposition avec sa preuve, et n'a point de conclusion; ainsi
c'est un syllogisme imparfait. Tantôt il se tire des contraires,
ce qui, selon certains rhéteurs, constitue seul l'enthymème, et a
beaucoup plus de force. Tel est le suivant, emprunté à l'oraison
pour Milon : Vous êtes donc assemblés ici pour venger la mort
d'un homme, à qui vous ne rendriez pas la vie, s'il était en votre
pouvoir de la lui rendre. On peut quelquefois lui donner un plus
grand nombre de parties, comme fait Cicéron dans le même plaidoyer :
Ainsi Milon, qui a épargné Clodius lorsque sa mort eût fait
plaisir à tout le monde; qui n'a pas osé le tuer, lorsqu'il le
pouvait impunément et avec justice, lorsque le lieu, le temps, tout
lui était favorable; Milon aura indignement assassiné le même
Clodius lorsque le lieu, le temps, tout lui était contraire, et
qu'il ne le pouvait sans être blâmé de plusieurs, sans s'exposer
même à perdre la vie. Cependant l'enthymème qu'on regarde comme
le meilleur est celui dont la preuve est jointe à une proposition
dissemblable ou contraire, comme dans cet exemple; tiré de
Démosthène : Si d'autres avant vous ont violé les lois, il ne
s'ensuit pas que vous, qui avez imité leur conduite, deviez échapper
au châtiment. C'est au contraire, un motif, de plus pour vous
condamner; car, comme vous n'auriez pas suivi leur exemple si
quelqu'un d'eux eût été puni, de même votre condamnation empêchera
un autre de vous imiter à l'avenir.
Selon quelques rhéteurs, l'épichérème est
composé de quatre, de cinq, et même de six parties. Cicéron en admet
cinq : la proposition, ou majeure; la raison de la
majeure ; l'assomption ou mineure; la preuve de la
mineure; enfin, la complexion ou conclusion. Mais comme la
majeure n'a pas toujours besoin de sa raison, ni la mineure de sa
preuve, et que la conclusion même n'est, pas toujours nécessaire,
Cicéron croit que l'épichérème peut quelquefois n'avoir que quatre,
trois, ou deux parties. Pour moi, je tiens, avec un grand nombre
d'auteurs, qu'il n'en a que trois au plus : car l'ordre naturel veut
qu'il y ait une première proposition, qui détermine ce dont il est
question; une seconde, qui serve à prouver la première; et, au
besoin, une troisième, qui soit la conséquence des deux premières.
Ainsi, il y aura la proposition, ou la majeure;
l'assomption, ou mineure, et la connexion, ou conclusion
: car la confirmation ou l'amplification des deux premières
propositions peut rentrer dans les parties auxquelles elle se
rapporte. Prenons dans Cicéron un épichérème de cinq parties : Les
choses auxquelles la sagesse préside sont mieux gouvernées que
celles auxquelles elle ne préside pas. C'est ce qu'on appelle la
première partie, laquelle doit être ensuite appuyée de diverses
raisons, et amplifiée par l'élocution. Pour moi, je crois que
tout cela ne fait qu'une seule et même proposition. Autrement, si la
raison fait une partie, comme il peut y avoir plusieurs raisons, il
y aura donc aussi plusieurs parties. Cicéron passe ensuite à la
mineure : Or, rien n'est mieux gouverné que le monde. Cette
seconde proposition doit avoir sa preuve, qui tient le quatrième
rang. J'en dis autant de la mineure que de la majeure. En cinquième
lieu, on place la complexion ou conclusion, qui tantôt se borne à
résumer ce qui résulte de toutes les parties, en ces termes :
Donc le monde est régi par la sagesse; tantôt, après avoir réuni en
peu de mots la majeure et la mineure, y ajoute ce qui se conclut de
l'une et de l'autre, de la manière suivante : Que si les choses
auxquelles préside la sagesse sont mieux gouvernées que celles
auxquelles elle ne préside pas, et si rien n'est mieux gouverné que
ce monde, il s'ensuit que ce monde est gouverné par la sagesse.
J'admets cette troisième partie. Mais ces trois parties que je donne
à l'épichérème n'ont pas toujours la même forme : tantôt la
conclusion n'est pas autre chose que la majeure; par exemple, l'âme
est immortelle, car ce qui se meut de soi- même est immortel :
or, l'âme se meut d'elle-même; donc l'âme est immortelle. Cette
forme de raisonnement n'est pas restreinte aux arguments, pris
séparément; elle s'étend à la cause entière, lorsque cette cause est
simple, et aux questions. Et en effet, toute cause et toute question
ont une première proposition : Vous avez commis un sacrilège. -
On peut avoir tué un homme sans être coupable de meurtre. Puis
vient la raison, qui est ici plus développée que dans les arguments
particuliers; et enfin la conclusion, qui confirme ce qui précède,
soit par une énumération détaillée, soit par un court résumé. Dans
cet épichérème, la proposition est douteuse, puisque c'est elle qui
fait l'objet de la contestation. Tantôt la conclusion ne reproduit
pas la majeure quant à la forme, mais elle a la même force quant au
fond. La mort n'est rien; car ce qui est dissous est privé de
sentiment; or, ce qui est privé de sentiment n'est rien.
Enfin quelquefois la proposition n'est pas la même
que la conclusion : Les animaux sont plus parfaits que les choses
inanimées; or, rien n'est si parfait que le monde; donc, le monde
est un animal. La proposition qui constitue ici la conclusion
peut être présentée d'une manière dubitative. Par exemple, le monde
est un animal, car tous les animaux sont plus parfaits que les
choses inanimées. Au reste, cette proposition est tantôt évidente,
comme dans le premier de ces deux exemples; tantôt elle a besoin de
preuve, comme dans celui-ci : Quiconque veut vivre heureux doit
philosopher. Car tout le monde n'en convient pas, et le reste ne
peut être admis qu'autant que la première partie est confirmée.
Quelquefois la mineure est évidente : or, tous les hommes veulent
être heureux; quelquefois aussi elle a besoin de preuve : ce
qui est dissous est privé de sentiment. Car il est possible que,
nonobstant la dissolution du corps, l'âme soit immortelle, ou du
moins subsiste pendant un certain temps. Ce que j'appelle
assomption ou mineure, quelques-uns l'appellent raison.
L'épichérème ne diffère du syllogisme qu'en ce que le
syllogisme a un plus grand nombre de formes, et tire ses
conséquences du vrai, tandis que la plupart du temps l'épichérème ne
les tire que du vraisemblable. Car si l'on pouvait toujours
s'appuyer sur une proposition incontestable, à quoi servirait
l'orateur? En effet, qu'est-il besoin d'éloquence pour dire : Ces
biens m'appartiennent, car je suis fils unique du défunt; ou
bien, je suis unique héritier, en vertu du testament du défunt;
donc ces biens m'appartiennent. Mais lorsque la raison même
fiait question, il faut rendre certain ce qui doit servir à prouver
l'incertain. Par exemple, si la partie adverse fait cette objection
: Vous n'êtes pas son fils, ou vous n'êtes pas légitime,
ou vous n'êtes pas seul; ou bien encore, vous n'êtes pas
héritier ou le testament n'est pas bon, ou vous n'avez
pas capacité pour recueillir une succession, ou vous avez des
cohéritiers, il faut alors que le demandeur prouve son droit. Et
comme cette preuve ne se peut faire sans beaucoup de paroles, la
conclusion devient une partie indispensable de l'épichérème. En
d'autres occasions, ta proposition suffit avec sa raison, comme ici
: Les lois se taisent au milieu des armes, et elles n'ordonnent
pas qu'on les attende, et qu'on s'expose à souffrir une mort
injuste, avant d'en pouvoir demander la juste punition. C'est
pourquoi on a dit que cet enthymème, qui se tire des conséquents,
est semblable à la raison. Quelquefois même on se contente d'une
partie, et cette partie suffit, comme : Les lois se taisent au
milieu des armes.
On peut même encore commencer par poser la raison, et
ensuite on conclut; par exemple, Si les Douze Tables permettent
de tuer un voleur de nuit, de quelque manière que ce soit; si elles
autorisent à tuer un voleur de jour, lorsqu'il fait résistance à
main armée, comment peut-on prétendre qu'elle punit sans distinction
tous ceux qui tuent? Cicéron varie encore cet argument, et place
derechef la raison en troisième lieu : Comment peut-on,
prétendre, et surtout lorsqu'on voit qu'en certains cas les lois
elles-mêmes nous mettent les armes à la main...? Ailleurs, il
suit l'ordre naturel : Un brigand, qui nous tend des embûches,
peut-il être tué injustement? C'est la proposition. Que
signifient ces escortes, ces épées? C'est la raison.
Certainement la loi ne les autoriserait pas s'il ne nous était
jamais permis de nous en servir. C'est la conclusion.
Voilà comme on emploie ce genre d'argument : voyons
maintenant comment on le réfute. On peut l'attaquer de trois
manières, c'est-à-dire par toutes les parties qui le composent : car
c'est ou la proposition que l'on combat, ou la mineure, ou la
conclusion, ou ce sont toutes les trois ensemble. Toutes ces parties
se réduisent à trois, comme je viens de le dire. On commence par
réfuter la majeure suivante: Il est permis de tuer un homme qui
nous tend des embûches; car la première question qui se présente
tout d'abord dans l'affaire de Milon est celle-ci: L'impunité
doit-elle être accordée à un homme qui confesse avoir commis un
meurtre ? A l'égard de la mineure, on la combat par les moyens
que j'ai indiqués au chapitre de la réfutation. Quant à la raison,
elle est quelquefois vraie, quoique la proposition soit fausse; et
quelquefois fausse, quoique la proposition soit vraie. La vertu
est un bien: cette proposition est vraie; mais si l'on ajoutait
: car elle nous enrichit, on donnerait une fausse raison
d'une proposition vraie. On réfute la conclusion, soit en la niant
lorsqu'elle ne résulte pas de ce qui précède, soit en disant qu'elle
ne fait rien à la question. Nous sommes en droit de tuer
quiconque nous tend des embûches; car quiconque se conduit en
ennemi, peut être repoussé comme ennemi. Donc Clodius, en se
conduisant comme l'ennemi de Milon, a été tué justement par
celui-ci. Cette conclusion est fausse ; car nous n'avons pas
établi que Clodius eût dressé des embûches à Milon. Nous pouvons
tuer justement, comme ennemi, quiconque nous dresse des embûches.
Cette conclusion est vraie, mais elle ne fait rien à la question,
car elle ne prouve pas que Clodius ait dressé des embûches à Milon.
Il peut arriver que la conclusion soit fausse, quoique la
proposition et la raison soient vraies; mais si la proposition et la
raison sont fausses, la conclusion n'est jamais vraie.
L'enthymème est appelé par quelques-uns le syllogisme
des orateurs, et par d'autres partie du syllogisme, parce que le
syllogisme a toujours toutes ses parties, lesquelles conspirent à
prouver une même chose, au lieu que l'enthymème se contente de faire
entendre sa proposition. Voici, par exemple, un syllogisme : La
vertu est le seul bien véritable; car le seul bien véritable est ce
dont on ne saurait abuser; or, nul ne saurait abuser de la vertu;
donc la vertu est le seul bien véritable. L'enthymème ne se
compose que des conséquents : la vertu est un bien, puisque nul
ne saurait en abuser. Voici un syllogisme négatif : L'argent
n'est point un bien, car une chose dont on peut abuser n'est point
un bien; or, on peut abuser de l'argent; donc l'argent n'est point
un bien. L'enthymème se borne à opposer les contraires :
L'argent peut-il être un bien, puisqu'il n'y a personne qui n'en
puisse abuser? Voici un autre syllogisme dans les formes: Si
l'argent monnayé doit être réputé argenterie, celui qui a légué
toute son argenterie a légué aussi son argent monnayé : or, il a
légué toute son argenterie; donc il a légué aussi son argent
monnayé. Mais un orateur se contente de dire : Puisque le,
testateur a légué toute son argenterie, il a légué aussi son argent
monnayé.
Je crois avoir accompli la tache imposée à un
rhéteur; c'est à l'orateur à faire avec discernement l'application
des règles que j'ai enseignées. Car, de même que je ne crois pas
qu'il soit défendu d'employer quelquefois le syllogisme dans
l'oraison, aussi je n'approuve pas qu'elle se compose uniquement ou
qu'elle soit farcie d'épichérèmes et d'enthymèmes, entassés les uns
sur les autres; car un discours de cette façon ressemblerait plus
aux dialogues et aux disputes des dialecticiens, qu'à un plaidoyer
judiciaire, qui est une chose toute différente. En effet, ces
doctes, qui cherchent la vérité entre eux, approfondissent une
question jusque dans ses plus petits détails, et ne s'arrêtent qu'à
l'évidence. Aussi s'attribuent-ils l'art de trouver et de discerner
le vrai : art qu'ils divisent en deux parties, auxquelles ils
donnent les noms de topique et de critique. Mais nous
autres orateurs, nous avons affaire à d'autres hommes, au goût
desquels nous sommes obligés de nous conformer. Le plus souvent nous
avons à parler à des ignorants, ou du moins à des gens qui ne
connaissent que l'éloquence oratoire. Si nous ne savons les attirer
par le plaisir, les entraîner par la force, et les remuer
quelquefois par le moyen des passions, la justice et la vérité nous
font défaut. L'éloquence veut être riche et brillante : or, elle
n'aura ni l'un ni l'autre de ces attributs, si nous la hachons en
une infinité de propositions invariables et uniformes. Rampante,
elle sera méprisée; servile, elle déplaira; elle causera la satiété
par son abondance, et rebutera par son ampleur démesurée. Qu'elle
prenne donc son cours, non par de petits sentiers, mais en plein
champ; non comme ces eaux souterraines qui coulent dans d'étroits
canaux, mais comme les larges fleuves qui remplissent les vallées,
et se frayent, au besoin, un passage. Quoi de plus misérable que de
s'assujettir aux règles, comme un enfant qui copie, sous les yeux de
son maître, un modèle d'écriture, ou comme ces gens qui, suivant le
proverbe grec, gardent religieusement le vêtement que leur mère leur
a donné? Eh quoi! toujours une proposition et une conclusion, avec
leurs conséquents et leurs contraires? L'orateur ne peut-il donc
animer ces raisonnements, les amplifier, les varier, les déguiser
sous mille figures, en sorte qu'ils paraissent amenés naturellement,
et n'aient rien qui sente la main du maître et la contrainte de
l'art? Quel orateur a jamais parlé ainsi? Démosthène lui-même
n'offre que fort peu d'exemples de cette austérité, qui tient, pour
ainsi dire, de la rigueur du droit. Cependant les Grecs, qui en cela
seul font plus mal que nous, ont une prédilection pour cette
dialectique, où les propositions s'enlacent et s'enchaînent dans une
trame inextricable. Ils se plaisent à tirer des conséquences dans
les raisonnements les moins douteux, à prouver ce qu'on ne leur
conteste pas, et s'imaginent par là ressembler aux anciens. Mais
demandez-leur quel est celui des anciens qu'ils prétendent imiter,
ils seront fort embarrassés de vous répondre.
Je parlerai ailleurs des figures. Quant à présent,
j'ajouterai seulement que je ne suis pas même de l'avis de ceux qui
pensent que les arguments se doivent traiter dans un style pur,
clair et précis, mais sans abondance ni ornement. Sans doute, la
clarté et la précision sont nécessaires, et, même dans les petites
choses, il faut n'employer que les termes les plus propres et les
plus usuels. Mais si la cause est importante, je crois qu'on n'en
doit exclure aucun ornement, pourvu que la clarté n'en souffre pas.
Souvent une métaphore met les choses dans un plus beau jour ; et
cela est si vrai, que les jurisconsultes eux-mêmes, qui s'attachent
surtout à la propriété des termes, ne font pas difficulté de définir
le rivage, l'endroit où le flot vient se jouer. Plus
un sujet est naturellement dépourvu de grâce, plus il faut s'étudier
à l'embellir; l'argumentation est moins suspecte quand elle est
dissimulée, et il n'y a pas loin du plaisir à la persuasion.
Autrement, il faudra dire que Cicéron a eu tort de mêler à son
argumentation ces figures hardies: Les lois se taisent au milieu
du bruit des armes. - Les lois elles-mêmes nous mettent quelquefois
le fer à la main. Cependant il faut user sagement de ces
figures, en sorte qu'elles embellissent le discours sans
l'embarrasser.