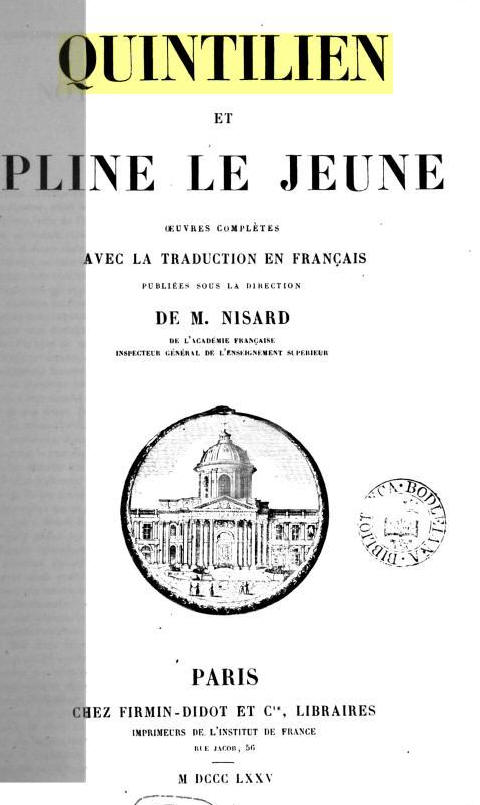|
SOMMAIRE.
CHAP. I. Des auteurs qui ont traité
de la rhétorique. — II. De l'origine de la rhétorique. — III. Que la
rhétorique a cinq parties. — IV. Qu'il y a trois genres da causes. —
V. Des parties qui composent toute espèce de discours. — VI. Ce que
c'est que l'état de la cause; d'où il se tire ; si c'est le
défenseur ou le demandeur qui le détermine; combien il y en a, et
quels ils sont. -- VII. Du genre démonstratif, lequel consiste dans
la louange et le blâme. — VIII. Du genre délibératif et de la
prosopopée. — IX. Des parties d'une cause judiciaire. — X. Des
différents genres de causes judiciaires. — XI. Ce que c'est que
question, moyen de défense, point à juger, point fondamental de la
cause, et jusqu'à quel point tout cela est nécessaire.
CHAP. I. J'ai recherché dans le second livre
ce que c'est que la rhétorique, et quelle est sa fin ;
et j'ai démontré, autant que mes forces me l'ont
permis, qu'elle est un art, qu'elle est utile, qu'elle
est une vertu, et qu'elle a pour matière toutes
les choses sur lesquelles l'orateur est appelé à
parler. Je vais maintenant traiter de son origine,
des parties dont elle se compose, et de la manière
de trouver et de mettre en œuvre les éléments
qui constituent sa matière, le tout dans la mesure
d'étendue que comporte cet art. Car la plupart
de ceux qui ont écrit des rhétoriques n'ont point
embrassé l'art dans son entier, et même Apollodore
s'est borné au genre judiciaire.
Je n'ignore pas que la partie de l'institution
oratoire, qui fait l'objet de ce troisième livre, est
celle que les personnes qui veulent la bien connaître
désiraient plus particulièrement de me
voir traiter: je sais que j'aborde une matière que
rend très épineuse l'excessive diversité des opinions
que j'aurai à examiner, et qui, par la sécheresse
presque nécessaire de sa forme, ne saurait
avoir aucun attrait pour le lecteur. Dans les
autres parties, j'ai cherché à revêtir de quelque
ornement la nudité du sujet, non pour faire parade
d'esprit, car j'aurais pu choisir pour cela
un fond plus riche, mais pour attirer plus facilement
les jeunes gens vers des connaissances qui
me semblent indispensables à qui veut s'instruire,
en les conviant, par le charme de la lecture, à
étudier plus volontiers des choses dont l'enseignement
nu et aride aurait peut-être rebuté leurs
esprits et blessé la délicatesse de leurs oreilles.
C'est dans cette pensée que Lucrèce a mis en
vers les préceptes de la philosophie, ainsi qu'il le
dit lui-même dans cette comparaison si connue :
De même qu'un médecin, pour tromper l'enfant
auquel il présente un breuvage d'absinthe,
humecte les bords de la coupe avec un peu de miel, etc.
Mais, pour moi, je crains bien que ce livre ne
contienne peu de miel et beaucoup d'absinthe,
c'est-à-dire qu'il ne soit plus utile qu'agréable; je
crains surtout qu'il n'obtienne d'autant moins de
faveur, que la plupart des préceptes, qu'il renferme
ne sont pas les miens, mais ceux d'autrui.
Il pourra même rencontrer des contradicteurs, car
la plupart des auteurs, quoique tendant au même
but, se sont frayé des routes différentes, et chacun
d'eux y à fait entrer ses disciples. Or, ceux-ci
regardent toujours comme le meilleur le chemin
dans lequel ils se sont une fois engagés; et
l'on ne revient guère des préjugés de l'enfance,
parce qu'il n'y a personne qui n'aime mieux avoir
appris que d'apprendre.
Comme on le verra à mesure qu'on avancera
dans cet ouvrage, il existe, parmi les auteurs, une
divergence d'opinions infinie, qui provient de
ce que les uns ont voulu perfectionner ce qui
avait été seulement ébauché avant eux et y ajouter
leurs découvertes, et de ce que les autres, pour
avoir l'air d'y mettre du leur, ont fait des changements
où il n'y avait rien à changer. Après
ceux dont il est fait mention dans les poètes, le
premier qui ait, dit-on, agité quelques questions
sur la rhétorique, est Empédocle; et les premiers
qui aient écrit des traités sur cet art, sont Corax
87
et Tisias, de Sicile, qui furent suivis de Gorgias
de Léontium, leur compatriote. Ce dernier avait
été, dit-on, disciple d'Empédocle, et, grâce à sa
longue carrière, car il vécut cent neuf ans, il
fleurit en même temps que beaucoup d'autres
rhéteurs, depuis ceux que j'ai nommés et dont il
avait été le rival, jusqu'à Socrate et par delà. De
ce nombre furent Thrasymaque de Chalcédoine,
Prodicus de Céos, et Protagoras d'Abdère, à qui,
à ce qu'on rapporte, Évathle avait donné dix
mille deniers pour apprendre de lui la rhétorique,
dont il publia un traité; Hippias d'Élis; Alcidame
d'Élée, que Platon appelle Palamède; Antiphon,
qui écrivit le premier plaidoyer, qui composa
même, après, un traité de rhétorique, et plaida
fort bien, dit-on, dans une cause qui lui était personnelle;
Polycrate, qui, comme nous l'avons
déjà dit, fit une harangue contre Socrate, et
Théodore de Byzance, un de ces hommes que
Platon appelle λογοδαιδάλους, artisans ingénieux
de paroles.
Parmi ces rhéteurs, ceux qui passent pour avoir
les premiers traité des lieux communs sont Protagoras,
Gorgias, Prodicus et Thrasymaque.
Cicéron, dans son Brutus, prétend que jusqu'à
Périclès on n'aperçoit dans aucun écrit le moindre
ornement oratoire; il fait mention, à ce sujet, de
quelques fragments attribués à ce grand homme.
Pour moi, je n'y vois rien qui réponde à sa
haute réputation d'éloquence; aussi ne suis-je
point étonné que bien des gens pensent qu'il n'a
rien écrit, et que ce qui court sous son nom n'est pas de lui.
A ces rhéteurs il en succéda une foule d'autres.
Parmi les disciples de Gorgias, le plus célèbre
fut Isocrate, quoique les auteurs ne s'accordent
pas à lui donner Gorgias pour maître; mais je
m'en tiens au témoignage d'Aristote. Il fut le
point d'où la rhétorique commença à se partager
en différentes routes. Les disciples d'Isocrate
excellèrent dans tous les genres de science; et ce
rhéteur étant devenu vieux (il vécut quatre-vingt-dix-huit
ans accomplis), Aristote commença,
dans des leçons qu'il donnait l'après-midi, à professer
l'art oratoire; et parodiant, à ce qu'on
rapporte, un vers connu de la tragédie de Philoctète,
il disait souvent qu'il était honteux de
se taire, et de laisser parler Isocrate.
Ils composèrent l'un et l'autre un traité de
rhétorique, mais celui d'Aristote est plus développé. Théodecte était du même temps. J'ai déjà
parlé de son ouvrage. Théophraste, disciple d'Aristote,
a écrit aussi avec soin sur la rhétorique.
Depuis, les philosophes se sont montrés plus ardents
que les rhéteurs mêmes à traiter cette matière,
et notamment les principaux d'entre les
stoïciens et les péripatéticiens. Ensuite vint Hermagoras,
qui se fraya un chemin tout particulier :
plusieurs l'y suivirent, entre autres Athénée, qui
parait avoir le plus approché de lui. Enfin, après
eux, on vit paraître Apollonius Molon, Aréus,
Cécilius et Denys d'Halicarnasse, qui ont tous
beaucoup écrit.
Mais il en est deux surtout qui ont brillé comme
chefs d'école: ce sont Apollodore de Pergame, que
César Auguste eut pour maître à Apollonie, et
Théodore de Gadare, qui aima mieux se dire de
Rhodes, et dont Tibère César, retiré dans cette île,
suivit, dit-on, les leçons avec assiduité. Ces deux
rhéteurs professaient des opinions différentes,
d'où leurs disciples furent appelés apollodoriens
et théodoriens, à la manière des philosophes, qui
se partagent en certaines sectes. Quant à Apollodore,
c'est plutôt par ses disciples que par lui-
88 même
que nous connaissons sa doctrine. C. Valgius
nous l'a transmise en latin, et Atticus en grec :
l'un et l'autre avec beaucoup d'exactitude. Pour
lui, il n'a laissé qu'un traité de rhétorique, qu'il
adresse à Matius; le reste, il le désavoue dans sa
lettre à Domitius. Théodore a plus écrit, et son
disciple Hermagoras n'est pas si éloigné de notre
temps que quelques personnes ne l'aient pu voir.
Pour ce qui est des Romains, le premier, que
je sache, qui ait donné quelques règles d'éloquence
est Caton le censeur. Après lui, M. Antoine
ébaucha l'art dans un petit traité; c'est le seul
ouvrage que nous ayons de lui, encore est-il inachevé.
Après eux viennent quelques auteurs moins
célèbres, mais dont je ne laisserai pas au besoin
de faire mention. Mais celui qui a donné à la fois
l'exemple et le précepte, celui qui est parmi nous
le modèle par excellence comme orateur et comme
rhéteur, c'est Cicéron. Il conviendrait de se taire
après un si grand maître, s'il ne nous apprenait
lui-même que ses livres de rhétorique étaient pour
ainsi dire échappés à sa jeunesse, et si, dans ses
traités oratoires, il n'eût omis sciemment les préceptes
qui regardent les parties moins relevées de
l'art, et qu'on regrette généralement de n'y point
trouver. Cornificius a beaucoup écrit sur le même
sujet; Stertinius et Gallion le père nous ont aussi
laissé quelque chose; mais Celsus et Lénas, antérieurs
à Gallion; et de notre temps Virginius,
Pline et Tutilius, ont plus approfondi la matière.
Enfin nous avons encore aujourd'hui d'illustres
auteurs qui, s'ils avaient tout embrassé, m'auraient
dispensé d'écrire. Mais je m'abstiens de
nommer les vivants, qui, du reste, n'y perdront
rien; car l'envie s'arrête en deçà du tombeau,
mais la gloire passe au delà. Cependant le respect
que j'ai pour tant de grands noms ne m'empêchera
pas de dire quelquefois ma pensée; car je
ne suis pas du nombre de ceux qui s'attachent
superstitieusement à une secte : j'ai voulu seulement
mettre le lecteur en état de faire un choix,
en rassemblant autour de chaque question les diverses
opinions des autres, n'aspirant qu'au
mérite de l'exactitude toutes les fois que la matière
ne demande rien de plus.
CHAP. II. Quelle est l'origine de la rhétorique?
cette question ne doit pas nous arrêter longtemps.
Qui doute en effet que ce ne soit de la
nature même que les hommes ont reçu le langage
ou du moins le principe du langage, au moment
où ils parurent sur la terre? qu'ensuite le besoin
ne les ait portés à cultiver et accroître cette faculté,
et qu'enfin la réflexion et l'exercice ne
l'aient perfectionnée? Je ne vois pas ce qui a pu
porter à croire que le soin de bien parler ait
commencé avec ceux que le danger de succomber
à quelque accusation a forcés de mettre un peu
d'art dans leur langage. Cette cause est noble
sans doute, mais elle n'est pas la première; car
on ne se justifie pas sans avoir été accusé, à
moins qu'on ne prétende aussi que le premier
glaive fut forgé dans l'intention de se défendre,
et non dans celle d'attaquer.
C'est donc la nature qui a donné naissance au
langage, et c'est l'observation qui a donné naissance
à l'art. En effet, de même que l'art de la
médecine est le résultat des expériences faites
sur ce qui est favorable ou contraire à la santé;
ainsi, l'art de l'éloquence est le résultat des observations
faites sur ce qui était utile ou nuisible
en parlant, et développées ensuite par la réflexion
conformément à ces premières données. Le tout
89
a été éprouvé par l'usage; puis, chacun a enseigné
ce qu'il savait.
Cicéron attribue l'origine de l'éloquence aux
fondateurs des villes et aux législateurs. Je conviens
qu'ils ont eu besoin de beaucoup d'éloquence,
mais je ne vois pas la raison de cette
opinion. N'existe-t-il pas encore aujourd'hui des
peuples qui n'ont ni demeure fixe, ni ville, ni
lois, et qui ne laissent pas d'avoir parmi eux des
hommes qui remplissent le rôle d'ambassadeurs,
qui soutiennent et repoussent des griefs, qui
enfin ne doutent pas que celui-ci ne parle mieux
que celui-là?
CHAP. III. Tout l'art oratoire, comme l'enseignent
la plupart des grands maîtres, consiste
en cinq parties: l'invention, la disposition, l'élocution,
la mémoire, la prononciation ou l'action:
car on dit l'un et l'autre. En effet, tout tissu
d'oraison, qui sert à exprimer un jugement, contient
nécessairement une pensée et des mots. S'il
est court et se résout dans une phrase, cette pensée
et ces mots suffiront peut-être; mais s'il a plus
d'étendue, il exigera davantage; car alors il n'importe
pas seulement de savoir ce que l'on doit
dire et comment, mais encore en quel lieu : on
a donc aussi besoin de la disposition. Maintenant
comment dire tout ce qu'il faut sur un sujet,
et dire chaque chose en son lieu, sans le secours
de la mémoire? aussi doit-elle former une
quatrième partie : enfin, que la prononciation
pèche, soit par le geste, soit par la voix, elle peut
tout gâter, tout perdre : elle doit donc nécessairement
former une cinquième partie.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'opinion de ceux
qui, comme Albutius, n'admettent que les trois
premières parties, sur le fondement que la mémoire
et l'action sont un don de la nature et
non un effet de l'art. Thrasymaque, il est vrai,
est du même sentiment pour ce qui regarde
l'action; mais je ferai voir que l'une et l'autre
tiennent quelque chose de l'art, lorsque j'en exposerai
les préceptes. D'autres, au contraire,
ajoutent une sixième partie, en plaçant le jugement
après l'invention, parce que, disent-ils,
on invente d'abord, puis on juge. Je crois, pour
moi, que qui n'a pas jugé n'a pas même inventé.
Aussi ne dit-on pas d'un homme qui a employé
des arguments contraires à sa cause, communs à
l'intérêt des deux parties, ou destitués de sens,
qu'il a inventé cela; mais on dit qu'il n'a pas su
l'éviter. Cicéron, à la vérité, dans ses livres de
rhétorique, met aussi le jugement après l'invention;
mais il me semble que le jugement est tellement
répandu dans les trois premières parties
(car sans le jugement il ne peut y avoir ni disposition
ni élocution), que je dirai même que la
prononciation lui doit beaucoup. Je parle ainsi
avec d'autant plus d'assurance, que, dans ses
Partitions oratoires, le même auteur aboutit à
la division que j'ai établie plus haut. Car après
avoir divisé d'abord la rhétorique en deux parties,
l'invention et l'élocution, il attribue à la
première le soin de trouver les choses et de les
disposer, et à la seconde les mots et la prononciation.
Puis il constitue une cinquième partie,
commune à toutes les autres, et qui en est comme
la gardienne, la mémoire. Il dit encore dans
l'Orateur que la rhétorique se compose de cinq
parties; et comme ces ouvrages ont été écrits
en dernier, ils sont aussi de plus sûrs garants
de ses opinions.
Ceux-là ne me paraissent pas moins céder au
besoin de dire quelque chose de nouveau, qui,
non contents de la disposition, y ajoutent l'or-
90
dre :
comme si la disposition était autre chose
que l'arrangement du tout dans le meilleur ordre
possible. Dion n'a reconnu que l'invention et
la disposition; mais il fait l'une et l'autre doubles,
en sorte qu'elles s'étendent et aux choses
et aux mots: ainsi, selon lui, l'élocution est une
partie de l'invention, et la prononciation une
partie de la disposition : ce qui fait toujours quatre
parties, auxquelles il faut en ajouter une
cinquième, la mémoire.
Les partisans de Théodore admettent ordinairement
une double invention, l'une pour les
choses et l'autre pour les mots; du reste, ils ne
changent rien aux trois autres parties. Hermagoras
fait dépendre le jugement, la distribution,
l'ordre, et tout ce qui concerne l'élocution, de
ce qu'il appelle l'économie, mot tiré du grec,
qui signifie le soin des affaires domestiques, et
qui est employé ici abusivement, notre langue
n'ayant pas de mot qui y réponde.
C'est encore l'objet d'une question, que de savoir
le rang que doit occuper la mémoire. Les uns
la placent après l'invention, les autres après la
disposition. A mon avis, la quatrième place est
celle qui lui convient le mieux. Car il ne suffit
pas de retenir ce qu'on a inventé pour pouvoir
le disposer, ni de se souvenir de ce qu'on a disposé
pour pouvoir l'énoncer, il faut encore que
la mémoire conserve les mots dont on s'est servi
pour exprimer ses pensées; car c'est elle qui est
dépositaire de tout ce qui est entré dans la composition
du discours.
Plusieurs veulent que tout cela soit l'œuvre
de
l'orateur, et non les parties de la rhétorique. N'est-ce
pas à lui, dit-on, qu'il appartient d'inventer, de
disposer, d'exprimer, etc.? Avec ce raisonnement,
il ne restera rien pour l'art; car il appartient
aussi à l'orateur de bien dire ; et cependant la
rhétorique est la science de bien dire, ou, pour
parler comme quelques-uns, l'orateur persuade,
mais la rhétorique apprend à persuader. De
même, l'orateur invente et dispose, mais la rhétorique
apprend à inventer et à disposer.
Enfin, faut-il voir en cela ou les parties de
la rhétorique, ou l'œuvre de la rhétorique, ou
bien, comme le croit Athénée, ses éléments, en
grec στοιχεῖα? c'est encore un point de controverse
entre un grand nombre d'auteurs. Mais
d'abord il n'est pas exact de dire que ce sont ses
éléments, car on entend par éléments les premiers
principes des choses. Ainsi l'eau, le feu, la matière,
les atomes, sont les éléments du monde.
On ne peut pas non plus appeler œuvre ce qui,
loin d'être le résultat de quelque chose, sert, au
contraire, à effectuer quelque chose. Ce sont donc
les parties de l'art; car puisqu'elles composent
la rhétorique, il est impossible que, un tout étant
composé de parties, ce qui compose ce tout n'en
soit pas les parties. Ceux qui ont mieux aimé
leur donner le nom d'œuvre n'ont voulu, ce
me semble, qu'éviter une répétition de mots,
parce que déjà ils avaient divisé la rhétorique
en trois parties, démonstrative, délibérative, et
judiciaire. Mais ce sont des parties de la matière
plutôt que de l'art; car la rhétorique est tout entière
en chacune d'elles, puisque aucune ne peut
se passer de l'invention, de la disposition, de l'élocution,
de la mémoire, et de la prononciation :
aussi quelques-uns ont-ils cru mieux dire en les
appelant les trois genres de la rhétorique. Mais
ceux qui ont dit les trois genres de causes ont
parlé plus juste, et Cicéron les a suivis.
CHAP. IV. N'y a-t-il que trois genres de causes?
y en a-t-il plus? on n'est pas d'accord sur ce point.
91
Il est certain que la plupart des écrivains les plus
accrédités chez les anciens n'en comptent que trois, à l'exemple
d'Aristote, qui seulement donne au genre délibératif un autre nom,
celui de concional.
Déjà cependant, comme on le voit chez quelques
auteurs grecs, et dans les livres de Cicéron
de Oratore, on éprouvait quelque tendance, et
maintenant on est presque entraîné par l'autorité
du plus grand écrivain de nos jours, à compter
non seulement plus de trois genres, mais à en
admettre un nombre presque infini. En effet, si
l'on établit un genre particulier pour la louange
et le blâme, à quel genre appartiendront les causes
où l'orateur se plaint, console, apaise, excite,
intimide, confirme, enseigne, éclaircit des ambiguïtés
de mots, raconte, adresse des prières ou
des remerciements, félicite, gourmande, invective,
déchire, mande, contremande, émet des vœux,
opine, et tant d'autres choses encore? de sorte
que moi, qui persiste dans le sentiment des anciens,
je me vois réduit à demander grâce, ou du moins
à me justifier, en examinant pourquoi ils ont si
fort restreint une matière aussi étendue.
Ceux qui croient que les anciens sont dans l'erreur
s'imaginent que ce qui les a trompés, c'est
que de leur temps les orateurs ne sortaient guère
de ces trois genres. On écrivait pour louer la vertu
ou décrier le vice; l'oraison funèbre était à la
mode, la tribune et le barreau absorbaient presque
entièrement l'éloquence en sorte que ceux
qui, à cette époque, ont traité de la rhétorique, ont
vu l'exclusion dans la fréquence.
Au contraire, ceux qui défendent les anciens
distinguent trois sortes d'auditeurs : les uns, qui
viennent pour le plaisir d'écouter; les autres, pour
prendre conseil; les autres, pour juger. Pour moi,
tout bien considéré, je crois qu'on pourrait se
borner à distinguer deux sortes d'éloquence, l'éloquence
judiciaire et l'éloquence extrajudiciaire.
Le genre d'affaires, qui est du ressort du juge,
est suffisamment déterminé par lui-même; celles
qui ne sont point du ressort du juge regardent
le passé ou l'avenir: le passé, nous le louons ou
nous le blâmons; l'avenir, nous en délibérons.
Je dirais encore que, quelque sujet qu'on traite,
les choses dont on parle sont certaines ou douteuses.
Si elles sont certaines, on les loue ou on les
blâme, suivant la manière dont on est affecté. Si
elles sont douteuses, ou nous sommes libres de
nous en réserver la décision, ce qui est la matière
des délibérations; ou nous nous soumettons
au jugement d'autrui, c'est la matière des procès.
Anaximène ne reconnaissait que deux genres,
le judiciaire et le délibératif; mais il subdivisait
ces deux genres en sept espèces; conseiller, dissuader;
louer, blâmer; accuser, défendre; et
faire des enquêtes, ἐξεταστικόν. On voit que les
deux premières espèces appartiennent au genre
délibératif, les deux suivantes au démonstratif,
et les trois dernières au judiciaire. Je ne dis rien
de Protagoras, qui réduisait la rhétorique à ces
quatre parties: interroger, répondre, ordonner,
et prier. Platon, dans le Sophiste, ajoute au judiciaire
et au délibératif un troisième genre qu'il
appelle προσομιλητικὸν, c'est-à-dire propre à la
conversation : genre qui n'a aucun rapport avec
celui du barreau, mais qui convient aux discussions
privées, et qui a toute la force de la dialectique.
Isocrate pense que la louange et le blâme
entrent dans ous les genres. Pour moi, je crois
92
que le parti le plus sûr et en même temps le plus
raisonnable est de suivre le plus grand nombre.
Il y a donc, comme je l'ai dit, un genre qui
consiste à louer et à blâmer. Les uns l'appellent
genre laudatif, nom tiré de la plus noble de ses
deux fonctions; d'autres disent démonstratif. On
croit, que ces deux mots sont traduits du grec
ἐγκωμιαστικὸν et ἐπιδεικτικὸν.
Cependant il me semble que le mot ἐπιδεικτικὸν
implique l'idée d'ostentation plutôt que celle de démonstration,
et qu'il diffère beaucoup du genre que les Grecs appellent
ἐγκωμιαστικὸν . Il le contient, à la vérité,
mais il ne s'y renferme pas. Niera-t-on que les
panégyriques chez les Grecs appartiennent au
genre appelé ἐπιδεικτικὸς? Cependant ils ont la
forme délibérative, et traitent le plus souvent
des intérêts de la Grèce. Il faut donc conclure
qu'il y a trois genres de causes, mais que, dans
chacun de ces trois genres, une partie est employée
à traiter des affaires, et une autre à faire parade
d'éloquence. Mais peut-être que notre mot démonstratif
n'est pas emprunté des Grecs, et qu'il
vient seulement de ce que la louange et le blâme
font voir chaque chose telle qu'elle est. Le second
genre est le délibératif; le troisième, le judiciaire.
Toutes les autres espèces rentrent dans ces trois
genres, et l'on n'en trouvera aucune où l'on ait
à louer ou blâmer, à conseiller ou dissuader,
à accuser ou défendre. Pour ce qui est de bien
disposer les esprits, de raconter, d'instruire,
d'amplifier, d'atténuer, d'exciter les passions ou
de les calmer, ce sont des parties communes à
tous les genres. Je ne suis pas même de l'avis de
ceux qui, par une simplification plus commode
que vraie, font consister le genre laudatif dans
les questions qui regardent l'honnête, le genre
délibératif dans celles qui regardent l'utile, et
le judiciaire dans celles qui ont pour objet le
juste. Ces trois genres ne subsistent, au contraire,
que par le secours mutuel qu'ils se prêtent. En
effet, dans un éloge ne traite-t-on pas du juste
et de l'utile ? dans une délibération, de l'honnête ?
Enfin on trouvera difficilement une cause judiciaire
où il n'entre quelque chose de tout cela.
CHAP. V. Tout discours se compose de ce qui est
signifié et de ce qui signifie, c'est-à-dire de choses
et de mots. La faculté oratoire est consommée par
la nature, l'art, et l'exercice. Quelques-uns y
ajoutent l'imitation; mais pour moi je ne la sépare
point de l'art. L'orateur a aussi trois devoirs
à remplir : instruire, toucher, plaire. Cette division
est plus claire que celle qui réduit toute
l'éloquence à deux parties, les choses et les passions;
car ces deux sortes d'éléments ne se rencontrent
pas toujours dans le sujet qu'on traite;
il y a des matières qui ne sont pas susceptibles de
pathétique. Aussi, comme le pathétique ne trouve
pas toujours place en tout, là où il se fait jour
il produit beaucoup d'effet.
Les auteurs les plus éminents pensent qu'il y a
dans la rhétorique des choses qui ont besoin de
preuves, d'autres qui n'en ont pas besoin; et je
suis de leur avis. Quelques-uns, au contraire,
comme Celsus, prétendent que l'orateur ne doit
parler que sur ce qui fait question; en quoi ils
ont contre eux la plupart des rhéteurs, et la division
même de l'éloquence en trois genres de causes,
à moins que l'on ne veuille pas regarder comme
une fonction de l'orateur de louer ce qui est incontestablement
honnête, et de blâmer ce qui est incontestablement honteux.
On convient généralement que toute question
93 est fondée sur ce qui est écrit ou
non écrit. Dans
ce qui est écrit, la question roule sur le droit;
dans ce qui n'est pas écrit, c'est le fait qu'on apprécie.
Le premier genre de question est légal,
le second est rationnel. C'est ce qu'Hermagoras
et ceux qui l'ont suivi ont voulu dire par les deux
mots grecs (νομικὸν et
λογικὸν) dont ils se servent;
et c'est aussi la pensée de ceux qui font consister
toutes les questions dans les choses et dans les mots.
On convient encore que les questions sont ou
indéfinies ou définies. Les premières sont celles
qui, faisant abstraction des personnes, des temps,
des lieux, et autres circonstances semblables,
sont traitées pour et contre : c'est ce que les Grecs
nomment thèse, et Cicéron, proposition; d'autres,
questions civiles universelles; d'autres,
questions philosophiques; et Athénée, partie de
la cause. Cicéron distingue ce genre en spéculatif
et en pratique. Ce monde est-il régi par
une providence? Voilà le genre spéculatif. Doit-on
prendre part à l'administration de la république?
Voilà le genre pratique. Il subdivise le
premier genre de questions en trois autres : si
l'objet dont il s'agit existe, ce qu'il est, quel il
est : car tout cela peut être ignoré; et le second,
en deux autres : quels sont les moyens d'acquérir
ce dont il est question, et comment on en
doit user?
Les questions définies sont elles qui se renferment
dans la considération des choses, des
personnes, des temps, et autres circonstances
de même nature. Les Grecs leur donnent le nom
d'hypothèses (ὑποθέσις), et nous, celui de
causes.
Tout semble s'y réduire aux choses et aux personnes.
La question indéfinie est plus vaste,
puisque la question définie en découle. Rendons
cela plus sensible par un exemple. Doit-on se
marier? Voilà une question indéfinie. Caton
doit-il se marier? Voilà une question définie, et
qui par conséquent peut être la matière d'une
délibération. Cependant les questions indéfinies,
même sans aucune acception des personnes, ne
laissent pas de se rapporter à quelque chose de
particulier. Par exemple, cette question : si l'on
doit prendre part à l'administration de la république,
est purement spéculative; ainsi posée
· peut-on prendre part à l'administration de la
république, lorsqu'elle est en proie à la tyrannie,
elle cesse d'être abstraite; car il y a là
comme une personne cachée, qui rend la question
double, et y mêle des considérations tacites
de temps et de qualité. Mais ce n'est pas encore
là proprement une cause. Au reste, les questions
indéfinies sont aussi appelées questions générales;
et, comme on ne saurait dire que c'est à
tort qu'on les appelle ainsi, les questions définies
seront par conséquent des questions spéciales.
Il faut remarquer que, dans toute question spéciale,
il y en a une générale, qui en est comme
l'antécédent. Je ne sais même si, dans les causes,
la question qui naît au sujet de la qualité n'est
pas une question générale. Milon a tué Clodius,
et il a eu raison, car celui-ci lui dressait des
embûches : n'est-ce pas faire cette question :
Est-il permis de tuer celui qui nous tend des
embûches? Que dirai-je de ce qui est purement
conjectural? Quand on demande: Si c'est la haine
ou la cupidité qui a fàit commettre tel crime;
s'il faut croire à des aveux arrachés par la force
des tourments; si l'on doit ajouter plus de foi
aux témoins qu'aux preuves : ne sont-ce pas
autant de questions générales? Quant à celles qui
ont pour objet la définition, il est certain qu'elles
ne peuvent être qu'universelles.
Quelques-uns croient qu'on peut aussi
quelquefois
donner le nom de thèses à des questions
limitées à des personnes et à des causes, en posant
94
seulement la question d'une autre manière. Ainsi
Oreste est accusé, voilà une cause; mais de savoir
si Oreste a été justement absous; si Caton
a pu honnétement livrer sa femme Marcia à
Hortensius : voilà une thèse. Ils distinguent la
thèse de la cause, en ce que la première appartient
à la spéculation, et l'autre à la pratique.
Dans la thèse, on discute uniquement dans l'intérèt
de la vérité abstraite; dans la cause, c'est
une affaire qu'on plaide.
Cependant certains auteurs pensent qu'il est
inutile à l'orateur de traiter les questions universelles.
A quoi sert, disent-ils, de prouver qu'on
doit se marier, ou qu'on doit prendre part à
l'administration de la république, si l'auditeur
trouve dans son âge ou dans sa santé un obstacle
à l'un ou à l'autre? Mais on ne pourrait faire
la même objection sur toutes les questions du
même genre, comme celles-ci, par exemple : La
vertu est-elle le souverain bien? Le monde est-il
régi par une providence ? Bien plus, dans les
questions qui se rapportent à une personne, non
seulement il ne suffit pas de traiter la question
générale, mais ce n'est qu'après l'avoir approfondie
qu'on peut aborder la question spéciale. En
effet, comment Caton délibérera-t-il s'il doit se
marier, s'il n'est établi que l'on doit se marier?
et comment examinera-t-on s'il doit épouser
Marcia, avant d'avoir établi que Caton doit se marier?
On pourra néanmoins m'opposer l'autorité
d'Hermagoras en faveur de l'opinion que je combats
ici, si toutefois l'ouvrage qui porte son nom
ne lui est pas faussement attribué, ou n'appartient
pas à un auteur du même nom. Comment,
en effet, pourrait-il être de celui qui a écrit tant
de choses admirables sur la rhétorique, et qui,
comme on peut l'induire des paroles de Cicéron
dans son premier traité sur l'art oratoire, a divisé
la matière de l'éloquence en thèses et en causes?
A quoi même celui-ci a trouvé à redire, prétendant
que tout ce qui s'appelle thèse ne regarde
point l'orateur, et que ce genre de question appartient
exclusivement aux philosophes. Mais Cicéron
m'a épargné la pudeur de le contredire, et en
condamnant lui-même l'ouvrage où il parle d'Hermagoras,
et en recommandant dans son Orateur,
dans les livres qu'il a intitulés de l'Orateur, et
dans ses Topiques, d'écarter, dans la controverse,
les considérations de personnes et de temps, parce
que le genre offre une matière plus étendue
que l'espèce, et que ce qui a été prouvé pour le
tout est nécessairement prouvé pour la partie.
Quant à l'état de la question, il est le même
dans toute espèce de thèses que dans les causes.
On ajoute à cela que les questions sont de deux
sortes, absolues et relatives. Doit-on se marier?
Cet homme est-il courageux? ces questions sont
absolues. En voici des relatives : Un vieillard doit-il
se marier? Cet homme est-il plus courageux que cet autre?
Apollodore, pour me servir de la traduction de
son disciple Valgius, définit la cause : une affaire
dont toutes les parties se rapportent à un
point litigieux, ou une affaire qui roule tout
entière sur une contestation. Ensuite il définit
l'affaire: un assemblage de personnes, de lieux,
de temps, de causes, de moyens, d'incidents,
de faits, de pièces, de propos, de choses écrites, et non écrites.
J'entends ici par cause ce que
les Grecs appellent hypothèse; et par affaire,
ce qu'ils nomment péristase. Quelques-uns pour-
95 tant,
prennent le mot de cause au même sens
qu'Apollodore a pris le mot d'affaire. Isocrate
dit que la cause est une question civile et particulière,
au un point litigieux entre un certain
nombre de personnes déterminées. Cicéron enfin
la définit : une contestation limitée à des considérations
de personnes, de lieux, de temps,
d'actions et d'affàires déterminées: si ce n'est
de tout cela ensemble, au moins de la plus grande partie.
CHAP. VI. Toute cause se renferme dans un
état quelconque. Avant donc que d'entreprendre
de dire comment il faut manier chaque genre de
cause, je crois devoir examiner ce qui est commun
à tous ces genres, c'est-à-dire ce que c'est
que l'état de la cause, d'où il se tire, combien
il y en a, et quels ils sont. Quelques auteurs,
il est vrai, ont pensé que cela ne regardait que
les matières judiciaires; mais, quand j'aurai
traité des trois genres, leur ignorance se montrera
d'elle-même.
Ce que j'appelle état, d'autres l'appellent
constitution,
ou ce qui ressort de la question;
Théodore, le chef principal, κεφάλαιον
γενικώτατον, auquel se rapporte tout. Ces différents
noms signifient au fond la même chose, et le mot
importe peu, pourvu que la chose soit claire. Les
Grecs nomment l'état στάσιν. On croit qu'Hermagoras
n'est pas le premier qui se soit servi de
ce nom. Les uns l'attribuent à Naucrate, disciple
d'Isocrate; les autres, à Zopire de Clazomène. Cependant,
ce terme n'était pas inconnu à Eschine;
car nous voyons que, dans son plaidoyer contre
Ctésiphon, il prie les juges de ne pas permettre à
Démosthène de sortir de son sujet, mais de le
forcer à se renfermer dans l'état de la cause. Ce
mot vient, dit-on, de ce que c'est là qu'a lieu le
premier engagement de la cause, ou de ce que
c'est là qu'elle se retranche. Voilà pour l'origine
du mot : venons à la chose. Quelques-uns définissent
l'état le premier conflit de la cause,
ce qui me paraît bien pensé, mais insuffisamment exprimé.
Car l'état n'est pas le premier conflit : Vous l'avez fait.
- Je ne l'ai pas fait, mais ce qui naît du premier conflit,
c'est-à-dire le genre de la question : Vous l'avez fait.
- Je ne l'ai pas fait. - L'a-t-il fait? ou bien,
Vous avez fait cela. - Je n'ai pas fait cela.
- Qu'a-t-il fait? Dans le premier exemple, en
effet, on voit que la question roule sur une conjecture;
et dans le second, sur une définition,
et c'est sur quoi les deux parties insistent. Dans
l'un, l'état de la question, sera conjectural;
dans l'autre, il sera définitif. Si l'on disait : Le
son est le choc de deux corps entre eux, on se
tromperait, je pense; car le son n'est pas un choc,
mais le résultat d'un choc. Toutefois cette définition
ne tire pas à conséquence; car elle ne laisse
pas de se faire entendre. Mais une fausse interprétation
a fait tomber dans une erreur grossière
ceux qui, pour avoir lu premier conflit, se sont
imaginé que l'état de la cause naît toujours de
la première question : ce qui est très faux. En
effet, il n'y a point de question qui n'ait son état,
puisqu'il n'y en a point qui ne soit fondée sur une
contestation entre le demandeur et le défendeur.
Mais les unes font partie intégrante de la cause,
et c'est sur elles qu'on doit prononcer; les autres
sont extrinsèques, quoiqu'elles ne laissent pas
d'être employées comme auxiliaires de la cause
en général. C'est ce qui fait qu'il y a toujours plusieurs
questions dans une même affaire. Et même
96
le plus souvent ce sont les moins importantes qui
occupent le premier rang; car c'est un artifice
assez ordinaire de commencer par celles qui nous
paraissent les plus faibles, soit pour les abandonner
ensuite à la partie adverse par manière de
concession, soit pour monter comme par degrés
à des arguments plus puissants.
Dans une cause simple, quoiqu'il y ait diverses
manières de la défendre, il ne peut jamais y
avoir qu'un point à décider. C'est le point qui fixe
particulièrement l'attention de l'orateur et du
juge, que l'un se propose d'emporter et l'autre
d'examiner; car c'est là qu'est l'état de la cause,
c'est là qu'elle se trouve retranchée. Il peut y
avoir du reste plusieurs questions. Éclaircissons
cela par un exemple très court: Lorsque l'accusé
dit: Quand je l'aurais fait, j'aurais bien
fait,
alors il établit la cause sur la qualité; mais si de
ce premier moyen de défense il passe à celui-ci :
mais je ne l'ai pas fait, l'état sera de conjecture.
Cependant, comme il y a plus de sûreté à
n'avoir point fait ce dont on est accusé, le véritable
état de la cause est, selon moi, dans ce que
je dirais, s'il ne m'était permis d'insister que sur
un seul point. On a donc eu raison de dire premier
conflit des causes, et non des questions. Cicéron
consacre la première partie de son plaidoyer
pour Rabirius Postumus à établir que la loi n'ouvre
pas d'action contre un chevalier romain;
dans la seconde, il prouve que son client n'est
nullement coupable de concussion. Où dirai-je
qu'est l'état de la cause? Dans le dernier moyen,
comme étant le plus puissant. De même, dans le
plaidoyer pour Milon, le véritable conflit de la
cause ne commence pas sur ces premières questions
qu'il traite immédiatement après l'exorde,
mais bien quand il déploie toutes ses forces pour
démontrer que Clodius tendait des piéges à Milon,
et que ce dernier était en droit de le tuer. Ce que
l'orateur doit donc considérer avant tout, même
lorsqu'il a plusieurs moyens à faire valoir dans
l'intérêt de sa cause, c'est le point principal sur
lequel il veut éclairer le juge. Mais quoique ce
soit la première chose à quoi il doive penser, il
ne s'ensuit pas que ce soit toujours par là qu'il
doive entrer en matière.
D'autres ont cru que l'état de la cause était dans ce
que le défendeur commence par repousser: opinion
que Cicéron exprime ainsi : C'est, dit-il, l'endroit
où le défendeur engage en quelque sorte le combat
contre son agresseur. Cette définition à son
tour a fait naître une autre question. Est-ce toujours
le défendeur qui détermine l'état de la cause? Cornélius Celsus est d'un sentiment tout à fait opposé,
et soutient que c'est l'affirmative, et non la négative,
qui détermine cet état. Par exemple, on
vous accuse d'un meurtre, vous niez le fait : c'est
l'accusation qui détermine l'état de la cause, parce
que c'est à elle à prouver. Si, au contraire,
confessant le fait, vous soutenez qu'il est légitime,
c'est à vous de prouver; car vous attaquez à votre
tour, et attirez par là sur votre terrain l'état de
la cause. Je ne partage pas cette opinion. Je trouve
qu'il est plus vrai de dire que, comme il n'y a
pas de procès là où le défendeur ne répond rien,
l'état de la cause est toujours déterminé par celui
qui réplique. Cependant je crois que cela varie
selon la nature des causes; car quelquefois le
demandeur semble fixer l'état, comme dans les
causes conjecturales, puisque alors c'est particulièrement
le demandeur qui est obligé de recourir
à ce genre de preuves. Aussi ceux qui veulent que
l'état de la cause soit toujours déterminé par le
défendeur, l'ont-ils appelé, relativement à celui-ci,
un état négatif. Il en est de même des affaires
qui se traitent par la voie du syllogisme, puisque
97
toute l'argumentation est du côté du demandeur.
Mais dans l'un et l'autre cas, dira-t-on, celui
qui nie met son adversaire dans la nécessité d'accepter
la cause sur le terrain de la défense. Car,
ou il soutient n'avoir pas fait ce dont on l'accuse,
et le demandeur est forcé de recourir à la conjecture,
ou il soutient que celui-ci n'a pas la loi pour
lui, et il l'oblige alors à prouver le contraire par
syllogisme. Soit : mais que s'ensuit-il? que l'état
de la cause naît de la défense; mais toujours est-il
que cet état est déterminé, tantôt par le demandeur,
tantôt par le défendeur. En effet, Vous avez
tué cet homme, dit l'accusateur. Si l'accusé le nie,
c'est lui qui détermine l'état de la cause. S'il l'avoue,
au contraire, mais qu'il ajoute : J'avais
droit de le tuer, l'ayant surpris en adultère (et
en effet la loi l'y autorise dans ce cas), qu'arrivera-t-il?
Si l'accusateur ne réplique rien, le procès
est non avenu; mais s'il réplique: Il n'était point
dans le cas d'adultère, l'accusation et la défense
se confondent, et c'est alors l'accusateur qui détermine
l'état de la cause. Ainsi cet état naît, à la
vérité, de la défense, mais c'est l'accusateur, et
non l'accusé, qui se défend. Je dis plus: dans une
même question on peut être accusateur et accusé
tout à la fois. La loi dit: Quiconque a exercé la
profession de comédien ne peut s'asseoir dans
les quatorze premiers rangs. Un homme qui
avait joué la comédie devant le préteur dans un
jardin, mais hors de la présence du public, vient
s'asseoir dans les rangs interdits par la loi. On
l'accuse pour ce fait: Vous avez, lui dit-on, exercé
le métier de comédien. Il se défend : Je ne l'ai
point exercé. Question : Qu'est-ce qu'exercer le
métier de comédien? S'il est accusé en vertu de
la loi sur les théâtres, c'est à lui de se défendre;
mais s'il a été forcé de se lever, de sortir du cirque,
et qu'il demande réparation de cet outrage,
c'est à l'accusateur à se défendre à son tour. Cependant
ce qu'enseigne le plus grand nombre des
auteurs est ce qui arrive le plus souvent. Ceux-là
ont échappé à toutes ces questions, qui ont dit
que l'état de la cause était ce qui résultait d'abord
du choc de l'attaque et de la défense. Vous
avez fait cela; - je ne l'ai pas fait, ou j'ai
bien fait. Voyons toutefois si c'est là, à proprement
parler, l'état de la cause, ou seulement
ce qui le renferme. Hermagoras appelle état ce
qui fait connaître la chose sur laquelle l'orateur
est appelé à parler, ce à quoi se rapportent
les preuves des parties. Mon opinion a toujours
été que, bien qu'il y ait souvent dans une cause
différents états de questions, l'état de la cause
reposait sur le point le plus important, celui sur
lequel roule principalement la contestation.
Que si on aime mieux l'appeler question générale ou chef général, je ne disputerai pas plus sur ce
nom que sur tout autre qu'on voudra inventer, et
qui fera entendre la même chose, quoique je sache
qu'une foule d'auteurs ait écrit des volumes
entiers sur cette matière. Quant à moi, je m'arrête au mot état.
Maintenant combien y a-t-il de sortes d'états,
quels sont leurs noms, quels sont ceux qu'il faut
considérer comme généraux ou particuliers?
C'est sur quoi l'on n'est pas d'accord; et les auteurs
qui ne s'entendent guère sur toute autre question,
semblent avoir pris à tâche d'émettre, sur
ce point, des préceptes différents. Et d'abord Aristote
a établi dix éléments, d'où, selon lui, découlent
toutes les questions possibles : l'existence,
οὐσίαν, que Flavius appelle essentiam, et qu'on
ne saurait rendre autrement en latin, mais qui,
quel que soit le mot, implique cette demande : la
98
chose est-elle ? la qualité, ce mot s'entend assez ;
la quantité dont on a depuis distingué deux sortes,
l'une pour les choses qui se mesurent, et l'autre
pour celles qui se comptent; la relation,
d'où se tirent les questions de compétence et de
comparaison; puis, le lieu et le temps; ensuite,
l'état actif; l'état passif; l'état extérieur, comme
d'être armé ou vêtu de telle ou telle manière;
enfin, la manière d'être, κεῖσθαι, comme être
assis, debout, ou couché. Mais de tous ces éléments,
les quatre premiers me paraissent appartenir
à l'état de la cause, et les autres à certains
lieux d'arguments.
D'autres auteurs en proposent neuf : la
personne,
ce qui comprend les questions sur l'âme,
le corps, et tout ce qui est placé hors de nous
mais dans tout cela je ne vois que des moyens
d'établir la conjecture et la qualité; le temps,
χρόνος, quand on demande si celui-là est né esclave,
qui est venu au monde pendant que sa
mère était au pouvoir de ses créanciers; le lieu,
s'il est permis de tuer un tyran dans un temple;
si celui qui est resté caché dans sa maison
est censé avoir subi son exil; la conjecture,
καιρὸν, dans laquelle ils veulent voir une espèce
du temps proprement dit : était-ce en hiver ou en
été? c'est à cette catégorie qu'appartient cette
accusation intentée contre un homme qui se livrait
à la débauche dans un temps de peste;
l'action, πρᾶξιν, si l'on a commis un crime
sciemment ou sans intention, par nécessité ou
par hasard, etc. ; le nombre, qui est une espèce
de la quantité : si Thrasybule a mérité trente récompenses
pour avoir délivré sa patrie de trente
tyrans; la cause, ou le motif, ce qui est le fondement
de la plupart des procès, toutes les fois
que le fait n'est pas nié et qu'on le soutient fondé
en justice; la manière, τροπὸν, lorsqu'on dit
qu'une chose s'est faite autrement qu'il n'était
permis de la faire : si, par exemple, on a fait périr
un adultère sous le fouet ou de faim; l'occasion
des faits, ἀφορμὰς ἔργων, et cela est trop
clair pour avoir besoin d'explication ou d'exemples.
Ces auteurs, aussi bien que les premiers,
croient qu'il n'est point de question qui ne soit
renfermée dans un de ces éléments. Quelques-uns
en retranchent deux, le nombre et l'occasion;
et à ce que j'ai appelé action, ils substituent le
mot choses, ou affaires, πρ�γματα. Je me suis
contenté de toucher en peu de mots ces diverses
doctrines, pour ne point paraître les avoir omises.
Du reste, il me semble qu'elles ne déterminent
pas suffisamment les états de causes, et ne
contiennent pas tous les lieux communs : et, en
lisant avec attention ce que je dirai de ces deux
objets, on verra qu'ils ont plus d'étendue que ces
doctrines ne leur en donnent.
J'ai lu dans plusieurs livres que certains rhéteurs
n'admettaient qu'un seul état pour toutes les
causes, l'état conjectural; mais ni, dans ces livres,
ni ailleurs je n'ai pu découvrir leurs noms. On dit
cependant qu'ils s'appuyaient sur cette raison,
que la connaissance de toute chose était renfermée
dans les signes. Mais ils pourraient, par la même
raison, fonder l'état de toutes les causes sur la
qualité; car partout on peut demander quelle est
la nature de l'affaire dont il s'agit. Or, d'un côté
comme de l'autre, il ne peut y avoir que confusion.
En effet, qu'on admette un seul état de
cause, ou qu'on n'en admette pas du tout, c'est
à peu près la même chose, puisque, dans les deux
cas, on range toutes les causes sur la même ligne.
Le mot conjecture vient de coniectus, c'est-à-dire
une certaine direction de l'esprit vers la
99
vérité : d'où le nom de coniectores a été donné
à ceux qui interprètent les songes et les présages.
Cependant ce genre d'état a reçu différents noms,
comme on le verra par la suite.
Quelques-uns ont reconnu deux états, qu'Archidème
appelle, l'un conjectural, et l'autre définitif;
mais il exclut la qualité, parce que, selon
lui, les questions sur la qualité répondent à celles-ci :
Qu'est-ce que l'iniquité, l'injustice, la
désobéissance? ce qu'il appelle question sur l'identité
et la différence. Il y a encore une autre
opinion qui admet aussi deux états, mais l'un
négatif; et l'autre juridicial. Le négatif est celui
que nous nommons conjectural; mais les uns,
ne considérant que le défendeur, le font absolument
négatif ; les autres le font partie négatif, partie
conjectural, parce que si l'accusé se défend par
la dénégation, l'accusateur prouve par la conjecture.
L'état juridicial est celui que les Grecs appellent
δικαιολογικὸς, qui traite du droit; mais de
même qu'Archidème exclut la qualité, ceux-ci
rejettent la définition, qu'ils regardent comme
une dépendance de l'état juridicial; car ils prétendent
que les questions juridiciales doivent être
posées ainsi : Telle action doit-elle être qualifiée
de sacrilège, de vol ou de démence ? C'était aussi
l'opinion de Pamphile; seulement il a divisé la
qualité en plusieurs espèces.
Beaucoup d'écrivains postérieurs se sont bornés
à changer les noms, et ont compris toutes les causes
sous deux genres : celles dont le fait est douteux,
sous le premier; celles dont le fait est constant,
sous le second. Et cela, par la raison évidente
qu'un fait est nécessairement ou certain ou incertain.
S'il ne l'est pas, il y a conjecture; et s'il est
certain, il relève des autres états. C'est en effet
ce que veut dire Apollodore, en prétendant que
la question repose ou sur des choses extérieures,
qui donnent lieu à la conjecture, ou sur nos propres
opinions. Il appelle le premier état réel,
πραγματικὸν, et le second intellectuel,
περὶ ἐννοίας.
C'est aussi ce que veulent dire ceux qui ne distinguent
que le doute et le préjugé, ἀπρόληπτον et
προληπτικὸν,
entendant par préjugé ce qui est évident.
C'est enfin ce que veut dire Théodore, qui réduit
tout à deux questions: Le fait existe-t-il? et,
le fait étant certain, quelles en sont les circonstances?
Car on voit que toutes ces opinions sont
les mêmes au fond, en ce qu'elles assignent la
conjecture au premier genre, et les autres états
au second. Mais il reste à savoir ce que c'est que
ces autres états. Apollodore les réduit à deux :
la qualité et le nom, c'est-à-dire la définition;
selon Théodore, c'est l'essence, la qualité, la
quantité et la relation. Il y en a qui veulent que
la question d'identité et de différence appartienne,
tantôt à la qualité, tantôt à la définition.
Posidonius rapporte aussi tout à deux chefs,
les mots et les choses. Les mots donnent lieu à
ces questions : Ont-ils une signification, quelle
est-elle, quelle en est l'étendue, et comment ont-ils
cette signification? A l'égard des choses, il s'agit
ou de l'existence, et c'est l'objet de la conjecture,
qu'il appelle induction sensible; ou de la qualité;
ou de la définition, qu'il appelle induction intellectuelle;
ou enfin de la relation. De cette division
en est venue une autre, des choses écrites, et
des choses non écrites. Celsus Cornélius a établi
aussi deux états généraux : Si une chose est, quelle
elle est? Dans le premier, il renferme la définition,
parce que, soit qu'un homme accusé d'avoir
dérobé de l'argent dans un temple nie le fait,
soit qu'en l'avouant il prétende que cet argent
appartenait à un particulier, il y a toujours lieu
de rechercher s'il a commis un sacrilège. Quant
à la qualité, il y distingue le fait et ce qui est
100
écrit. Il attribue à ce qui est écrit quatre espèces
de questions légales, dont il exclut la compétence:
pour ce qui est de la quantité et de l'intention,
il ne les sépare point de la conjecture.
Il y a encore une autre manière de diviser les
états. Toute controverse, dit-on, roule sur l'existence ou sur la
qualité. La qualité peut être considérée en général ou
en particulier. L'existence
est l'objet de la conjecture; car on peut demander
de toute chose si elle est, si elle a été, si elle
sera, quelquefois même dans quelle intention elle
a été faite : opinion préférable à celle qui ne voit
dans l'état conjectural qu'un état de fait, comme
s'il ne s'agissait purement et simplement que du
passé et du fait. Quant à la qualité considérée en
général, elle fournit rarement des questions au
barreau, où l'on ne s'avise guère d'examiner si,
par exemple, ce qui est loué de tout le monde doit
être réputé honnête. Considérée en particulier, la
qualité donne lieu à des questions tirées, tantôt
d'une dénomination commune à tout le genre,
par exemple : Si celui qui a dérobé dans un temple
l'argent d'un particulier est coupable de sacrilège;
tantôt d'une chose qualifiée, quand le
fait est certain, et qu'on ne doute pas de ce qu'il
est; à quoi se rattachent toutes les questions de
l'honnête, du juste et de l'utile. On veut aussi
que ces deux états renferment tous les autres,
parce que la quantité se rapporte, tantôt à la conjecture :
Le soleil est-il plus grand que la terre?
tantôt à la qualité : Quel degré de peine ou de récompense
mérite cet homme ? La question de
compétence est également une dépendance de la
qualité, et renferme la définition. Quant aux états
qui, ayant pour fondement la contradiction des
lois, se traitent par voie de raisonnement, c'est-à-dire
par syllogisme, ou qui naissent de la lettre
et de l'esprit, c'est à l'équité qu'on a recours la
plupart du temps, excepté néanmoins que, dans
ce dernier cas, il y a lieu quelquefois à la conjecture,
s'il s'agit, par exemple, de rechercher quelle
a été l'intention du législateur. L'ambigüité, en
effet, ne peut être éclaircie que par la conjecture,
puisque là où il est manifeste que les mots offrent
un double sens, il n'est plus question que de pénétrer
l'intention de celui qui a écrit ou parlé.
Voilà le sentiment de ces auteurs.
Un grand nombre d'autres a reconnu trois états
généraux, et Cicéron a adopté cette division dans
son Orateur, où il dit que tous les sujets de controverse
et de dispute sont renfermés dans ces
trois chefs : Si telle chose est, ce qu'elle est,
quelle elle est: ce qui s'entend suffisamment, et
dispense de rappeler les noms de ces trois questions.
C'est aussi le sentiment de Patrocle. M.
Antoine reconnaît également trois états. La matière
de tout discours, dit-il, se réduit à un très
petit nombre de questions : telle action a été
faite ou non; on a eu droit, ou on n'a pas eu
droit de la faire; elle est bonne, ou elle est mauvaise.
Mais comme le mot droit est équivoque,
et qu'il peut être pris également et pour ce qui est
conforme à la loi et pour ce qui est conforme à
l'équité, ceux qui ont suivi M. Antoine ont voulu
distinguer plus clairement ces trois états, et ont
en conséquence appelé le premier conjectural, le
second légal, et le troisième juridicial: en quoi
Virginius les approuve. Ensuite, divisant ces trois
états en plusieurs espèces, ils ont rangé sous l'état
légal la définition, et les autres états qui ont pour
fondement ce qui est écrit, les lois contraires (ἀντιμονίαν), la
lettre et l'esprit (κατὰ ῥητὸν καὶ
διά- 101 νοιαν), la
translation ou compétence (μετάληψιν),
le raisonnement (συλλογισμὸν), l'ambiguïté (ἀμφιβολίαν),
et que j'énumère ici, parce que la plupart des rhéteurs les
appellent
états, quoique quelques-uns n'aient voulu y voir que des questions
légales.
Athénée admet quatre états : le premier,
προτρεπτικὴν στάσιν ou παρορμητικὴν, qui consiste à
exhorter, et appartient proprement au genre
délibératif; le second, συντελικὴν, et par lequel il
entend la question de fait ou de conjecture, ce
qui résulte de la suite, plutôt que du nom dont
il se sert pour désigner cet état; le troisième,
ὑπαλλακτικὴν, ou l'état de définition, qui consiste
dans une substitution de mots; enfin le quatrième,
qu'il appelle du même nom que les autres
rhéteurs, c'est-à-dire l'état juridicial; car, comme
je l'ai dit, on varie beaucoup dans les dénominations. Il en est qui, par le mot
ὑπαλλακτικὴν,
entendent la translation ou compétence, à cause
de l'idée de changement renfermée dans le mot
grec. D'autres, comme Cécilius et Théon, ont
reconnu aussi quatre états, mais différents :
si une chose est, ce qu'elle est, quelle elle est,
sa quantité. Aristote, dans sa Rhétorique, veut
que toute espèce de matière consiste dans trois
choses à constater : la vérité, ce qu'il faut fuir
ou éviter (ce qui appartient au genre délibératif),
l'identité, et la différence; mais sa division l'amène
à cette conclusion, qu'on doit examiner
l'existence du fait, sa qualité, sa quantité, sa
multiplicité. Il a aussi en vue la définition dans
un endroit où il dit qu'en certains cas on peut se
défendre de cette manière : J'ai pris, mais je
n'ai pas volé; j'ai frappé, mais je n'ai pas
commis d'outrage. Cicéron, dans ses livres de
rhétorique, avait aussi compté quatre états : le
fait, le nom, le genre, et l'action. Par le
fait,
il entendait la conjecture, par le nom la définition,
par le genre la qualité, et par l'action le
droit, auquel il rapportait la compétence. Mais
dans un autre ouvrage il considère les questions
légales comme des espèces de l'action.
Il y a des rhéteurs qui ont reconnu cinq états :
la conjecture, la définition, la qualité, la quantité,
la relation. Théodore, comme je l'ai dit, a
aussi adopté ces principaux chefs : Si une chose
est, ce qu'elle est, sa quantité, sa relation. Il
pense que ce dernier chef consiste principalement
dans la comparaison, parce que meilleur et pire,
plus grand et moindre, sont des termes corrélatifs
qui ne peuvent s'entendre l'un sans l'autre. Mais,
ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, l'état de relation
renferme aussi toutes les questions qui regardent
la compétence : Si tel a droit d'intenter
une action, s'il lui appartient de faire telle
chose contre tel, en tel temps, de telle manière.
Car tout cela suppose nécessairement une
relation avec quelque chose.
D'autres comptent six états : la
conjecture,
qu'ils appellent γένεσιν; la qualité; la
propriété,
ἰδιότητα, ce qui implique la définition; la
quantité,
ἀξίαν; la comparaison; et la translation
pour laquelle on a même imaginé un mot nouveau,
μετάστασις : je dis nouveau pour spécifier
un état; car Hermagoras s'en sert pour désigner
une espèce du genre juridicial. Il a plu à d'autres
d'établir sept états, sans y faire entrer ni la
translation, ni la quantité, ni la comparaison;
mais, à leur place, ils substituent quatre états
légaux, qu'ils ajoutent aux trois états rationnels.
D'autres vont jusqu'à huit, en ajoutant aux sept
102
premiers la translation. Dans le système de quelques-uns,
il faut admettre une division, qui consiste
à ne donner le nom d'états qu'aux états
rationnels, tandis que les états légaux sont,
comme je l'ai dit plus haut, appelés questions :
dans ceux-ci il s'agit de ce qui est écrit; dans
ceux-là, il s'agit du fait. D'autres ont fait tout
le contraire : ils ont nommé états les questions
légales, et questions les états rationnels. D'autres
enfin ne reconnaissent que trois états rationnels :
si la chose est, ce qu'elle est, quelle elle
est. Hermagoras seul en compte quatre : la conjecture,
la propriété, la translation, et la qualité,
qu'il exprime par le mot d'accident, κατὰ
συμβεβηκότα; regardant, sans doute, le vice et la
vertu comme des qualités accidentelles. Il subdivise
ensuite la qualité en quatre espèces, attribuant
la première au genre délibératif, quand
on examine ce qu'il faut rechercher ou fuir; la seconde
au genre démonstratif, quand il s'agit de
la personne; la troisième aux affaires,
πραγματικὴν, quand on discute des choses en abstraction
et sans acception des personnes, comme dans ces
questions : Celui-là est-il libre, à qui on conteste
sa liberté? Les richesses engendrent-elles
l'orgueil? Telle action est-elle juste, est-elle
bonne ? Enfin la quatrième aux questions de droit,
laquelle ne diffère des autres qu'en ce qu'elle se
rapporte à des personnes déterminées . Un tel a-t-il
eu droit ou raison de faire cela? Je n'ignore
pas que Cicéron, dans son premier livre de la
Rhétorique, a donné une autre interprétation de
la troisième espèce, en disant qu'elle a pour
objet les questions de droit qui se décident par
l'usage et par l'équité, et dont l'examen est attribué
chez nous aux jurisconsultes. Mais j'ai
déjà dit quel était le jugement que Cicéron lui-même
portait de cet ouvrage, un des premiers
fruits de sa jeunesse, et où il avait jeté tout ce qu'il
avait appris de ses maîtres; en sorte que, s'il s'y
trouve quelque erreur, ce n'est point à lui qu'il
faut l'imputer. Peut-être aussi s'est-il laissé
préoccuper par les exemples tirés du droit, qu'Hermagoras
cite en premier lieu, ou par le mot
πραγματικοὺς, dont les Grecs se servent pour désigner
les jurisconsultes. Quoi qu'il en soit, en
substituant à sa Rhétorique son admirable traité
de l'Orateur, il s'est mis à l'abri du reproche
d'avoir donné de mauvais préceptes.
Je reviens à Hermagoras. Il est le premier de
tous les rhéteurs qui ait fait de la translation un
état distinct, quoiqu'au nom près, on en trouve
quelques germes dans Aristote. Quant aux questions
légales, il en reconnaît quatre: la question
d'écrit et d'intention, qu'il appelle
κατὰ ῥητὸν, καὶ ὑπεξαίρεσιν, c'est-à-dire
ce qui est dit, et l'exception
(le premier mot lui est commun avec tous
les autres rhéteurs, le dernier est moins usité);
la question de raisonnement, celle d'ambiguïté,
et enfin celle des lois contraires. Albutius a
adopté la même division, mais il en distrait la
translation, qu'il comprend dans les questions
de droit; et parmi les questions légales il ne voit
point de place pour celle de raisonnement. Ceux
qui voudront faire une lecture approfondie des
anciens y trouveront sans doute beaucoup de
choses que je ne rapporte pas; mais, pour moi, je
crains de ne m'être déjà que trop étendu sur cette matière.
Quant à mon opinion personnelle, j'avouerai
qu'elle diffère un peu de celle où j'étais autrefois;
et si je n'avais égard qu'à ma réputation, le plus
sûr serait peut-être de ne rien changer à ce que
j'ai non seulement cru moi-même, mais encore
103 fait
adopter aux autres pendant tant d'années: mais ma conscience
ne saurait se résoudre à user de dissimulation en aucune
circonstance, et moins que jamais dans un ouvrage où je ne me
propose que d'être utile à une jeunesse honnête. C'est ainsi
qu'Hippocrate, si célèbre dans la médecine, pour ne pas exposer la
postérité à faillir avec lui, n'a pas fait difficulté d'avouer qu'il
s'était quelquefois trompé : en quoi il me paraît bien louable.
Cicéron n'a-t-il pas condamné lui-même sans hésitation, dans des
écrits postérieurs, quelques-uns de ses premiers ouvrages, comme son
Catulus
et son Lucullus, et ses livres de rhétorique, dont
j'ai parlé tout à l'heure? A quoi servirait, en effet,
de prolonger ses études et ses travaux, s'il n'était
permis de revenir sur le passé et de trouver mieux?
D'ailleurs, rien de ce que j'ai enseigné autrefois
n'aura été inutile; car je rattacherai mes nouveaux
préceptes à mes premières ébauches, et personne
n'aura lieu de se repentir d'avoir appris ce qu'il
sait. Je ne me propose que de recueillir ce que j'ai
déjà dit, pour le disposer dans un ordre plus clair.
Ce que je veux surtout, c'est que chacun me
rende le témoignage qu'aussitôt que j'ai acquis
de nouvelles lumières, j'en ai fait part aux autres.
A l'exemple d'un grand nombre d'auteurs, je
conservais trois états rationnels : la conjecture,
la qualité, la définition, et un état légal. Tels
étaient pour moi les états généraux. Ensuite, je
divisais l'état légal en cinq espèces : la lettre et
l'esprit, les lois contraires, l'induction, l'ambiguïté,
la translation. Maintenant je reconnais
que l'état légal peut être ôté du nombre des états
généraux. Car il suffit de dire que les uns sont
rationnels, et les autres légaux. Ainsi, ce que j'appelais
état légal ne sera point un état, mais un
genre de questions : autrement il faudrait dire
aussi qu'il y a un état rationnel.
Je retranche également la translation des cinq
espèces d'états légaux dont je viens de parler.
A la vérité, j'avais souvent dit, ainsi que peuvent
se le rappeler tous ceux qui ont suivi mes leçons,
et même dans ces entretiens qu'on a publiés
sans mon aveu on peut lire, qu'il se présente
rarement une cause dont la translation fasse essentiellement
l'état, et qui n'en ait pas un autre
plus véritable : ce qui fait que la translation a
été rejetée par quelques rhéteurs. Je sais qu'elle
a lieu en beaucoup de cas, et surtout dans la
plupart des causes où le demandeur échoue par
vices de forme; car voici, entre autres, les questions
qui se présentent alors: Un tel a-t-il qualité pour
intenter une action contre quelqu'un? a-t-il
droit d'actionner un tel, en vertu de telle loi,
devant tel juge, en tel temps? Mais cette translation
fondée sur les personnes, le temps, le droit
d'action, etc., suppose quelque autre raison pré-existante.
Ainsi, la question n'est pas dans la translation,
mais dans les motifs de la translation. Ce
n'est pas devant le préteur que vous devez réclamer
ce fidéicommis, mais devant les consuls,
attendu que la somme excède la juridiction
du préteur. Il s'agit donc d'examiner si la
somme est telle que le préteur n'en puisse connaître :
c'est une question de fait. Vous n'avez
pas droit de plaider contre moi; car vous n'avez
pas pu être constitué procureur de mon adversaire.
La question à juger est donc celle-ci: L'a-t-il
pu ? - Vous n'avez pas dû m'attaquer au possessoire,
mais au pétitoire. L'action possessoire
est-elle fondée? C'est ce qu'il s'agit de décider.
Dans tous ces exemples, comme on voit, on passe
104 à des questions légales, qui sont le véritable état
de chaque cause. Dans les cas de prescription,
dans ceux même où le défaut d'action est manifeste,
la question n'est-elle pas toujours de même
espèce que la loi en vertu de laquelle on agit?
En sorte que la contestation roule tantôt sur le
nom, ou sur l'écrit et l'intention, ou sur l'induction.
L'état naît de la question, et conséquemment
la translation ne renferme pas la question
sur laquelle, mais à l'occasion de laquelle on
conteste. Un exemple démontrera cela plus clairement:
Vous avez tué un homme. - Je ne l'ai
pas tué. Question: L'a-t-il tué? L'état est de conjecture.
Mais il n'en est pas de même ici : J'ai
action contre vous. - Vous ne l'avez pas. Car il
faudrait que la question fût: A-t-il action? et que
l'état se prit de là : ce qui n'est pas. En effet, qu'il
soit reçu ou non à intenter l'action, c'est la
question finale, et non l'objet de la cause; c'est
sur quoi le juge prononce, mais non la raison
pour laquelle il prononce. Voici un exemple semblable :
Vous méritez d'être puni. - Je ne le
mérite pas. Le juge verra s'il le mérite; mais ni
la question ni l'état ne sont là. Où sont-ils? le
voici: Vous méritez d'être puni, parce que vous
êtes coupable d'homicide. - Je ne le suis pas.
L'est-il? - Il m'est dû des honneurs. - Il ne vous
en est pas dû. Y a-t-il là un état? non, à ce que
je crois. Il m'est dû des honneurs, parce que j'ai
tué un tyran. - Vous ne l'avez pas tué. Question
et état. De même, dans cet autre exemple :
Vous n'avez pas le droit d'intenter une action.
- J'en ai le droit. Il n'y a pas là d'état. Où est-il
donc? Ici : Vous n'avez pas droit d'intenter une
action, parce que vous êtes noté d'infamie. On
examinera s'il est noté d'infamie, ou s'il est permis
à un homme noté d'infamie d'intenter une
action : il y aura là question et état. Il en est
donc de ce genre de cause comme du genre de la
comparaison et de la récrimination.
Mais, dira-t-on, ces propositions : J'ai droit,
- Vous n'avez pas droit, ne sont-elles pas semblables
à celles-ci: Vous avez tué - J'ai eu raison
de tuer. Je ne le nie pas; mais ces dernières propositions
ne déterminent pas l'état; et, à proprement
parler, ce ne sont pas des propositions, car
elles ne développent pas suffisamment la cause :
il faut qu'elles soient accompagnées de leurs
raisons. Horace a commis un crime, il a tué sa sœur. - Il n'a pas commis un crime, car il a
dû tuer une indigne femme, qui pleurait la
mort d'un ennemi. La question sera : Etait-ce un
motif légitime pour la tuer? Et l'état sera de
qualité. De même, dans ces questions de translation :
Vous n'avez pas le droit de déshériter,
parce que la loi interdit toute action à un
homme noté d'infamie. - J'ai ce droit, parce
que déshériter n'est point exercer une action. - Qu'est-ce qu'exercer une action? définition.
- Il ne vous est pas permis de déshériter : syllogisme.
Il en est ainsi de toutes les autres causes,
que l'état soit rationnel ou légal.
Je n'ignore pas que certains auteurs ont compris
la translation dans le genre rationnel, prétendant
qu'elle peut être présentée de la manière suivante :
J'ai tué cet homme, mais par ordre de
l'empereur. - J'ai livré les trésors du temple,
mais j'y ai été forcé par le tyran. - Je ne suis
pas retourné au camp, mais j'en ai été empêché
par la mauvaise saison, par des torrents,
ou par une maladie; c'est-à-dire, ce n'a pas
été ma faute, mais celle de ces obstacles. Je
me trouve moins arrêté par l'opinion de ces auteurs.
En effet, il ne s'agit point ici de l'exception
déclinatoire, mais de la raison du fait, ce qui
arrive dans presque toutes les défenses; ensuite,
105 celui qui emploie ce moyen ne sort pas de la
forme de la qualité, puisqu'il soutient qu'il n'est
pas coupable, en sorte qu'il faut plutôt distinguer
deux espèces de qualités, l'une applicable au
fait; et l'autre à l'accusé. Reconnaissons donc,
avec ceux dont Cicéron a suivi l'autorité, que
toute controverse ne renferme que trois questions :
Si une chose est, ce qu'elle est, quelle elle est ?
C'est ce que la nature elle-même nous enseigne;
car il faut d'abord qu'il y ait un objet de controverse,
puisqu'on ne peut apprécier ce qu'il est et
quel il est, avant d'avoir établi qu'il existe :
voilà donc la première question. Mais de ce que
son existence est constatée, il ne s'ensuit pas
qu'on sache immédiatement ce qu'il est; ce second
point établi, reste la qualité. Et tout cela
éclairci, il ne reste rien au delà.
C#39;est dans ces trois chefs que sont renfermées
les questions générales et les questions particulières;
et c'est toujours un de ces trois chefs que
l'on discute dans quelque matière que ce soit,
démonstrative, délibérative ou judiciaire. En second
lieu, ces trois chefs comprennent aussi tous
les procès sous le rapport rationnel et légal, puisqu'il
n'est aucune contestation judiciaire qui ne
puisse se résoudre en définition, qualité ou
conjecture. Cette division serait suffisante; mais
comme je me propose d'instruire des personnes
encore peu versées dans cette matière, la division
que j'ai d'abord adoptée, étant plus détaillée,
leur sera plus commode; et si ce n'est pas la ligne
la plus droite, c'est au moins un chemin plus
facile et plus ouvert.
Qu'elles sachent donc, avant tout, qu'il y a
dans toute cause quatre moyens que doit avoir
particulièrement en vue le plaideur. Et pour
commencer par le défenseur, le plus fort moyen
de défense, c'est de pouvoir nier ce qu'on lui
impute; ensuite, de dire que ce qu'on lui impute
n'est pas ce qu'il a fait; en troisième lieu, et
c'est ce qu'il y a de plus honorable, de prouver
qu'il a bien fait : que si tout cela manque, il
reste un quatrième mais unique moyen, qui est
de chercher dans le droit quelque expédient
pour échapper à une accusation qu'il ne peut
nier ni combattre, en faisant voir que l'action n'a
pas été intentée dans les formes. De là toutes ces
questions qui regardent l'action ou la compétence.
Il y a, en effet, des choses blâmables de
leur nature, mais autorisées par le droit; telle est
cette loi des Douze Tables, qui permettait aux
créanciers de se partager le corps de leur débiteur,
loi que les mœurs publiques ont répudiée.
Au contraire, il y a des choses équitables en
elles-mêmes, mais défendues par le droit, comme
la liberté de tester.
Quant au demandeur, il doit s'en tenir à prouver
que le fait existe, que c'est précisément le
fait incriminé, que ce fait est criminel, et que
l'action est intentée dans les formes. Ainsi, tout
procès roule sur les mêmes espèces; seulement
les parties changent quelquefois de rôles, comme
dans les causes où il s'agit d'une récompense,
car alors c'est au demandeur à prouver que
l'acte est méritoire.
Ces quatre espèces de propositions et formes
d'actions, dont je faisais autrefois quatre états
généraux, se réduisent donc, ainsi que je l'ai
fait voir, à deux genres, le rationnel et le légal.
Le rationnel est le plus simple, et se borne à considérer
la nature des choses; aussi lui suffit-il
de recourir à la conjecture, à la définition et à la
qualité. Le genre légal admet nécessairement
plusieurs espèces, parce que les lois sont en
grand nombre, et qu'elles présentent plus d'une
face. Tantôt c'est sur la lettre de la loi, tantôt
106 c'est sur l'intention du législateur, que nous nous
appuyons; tantôt, au défaut de loi positive, nous
nous rejetons sur d'autres; tantôt nous comparons
deux lois entre elles, ou nous les interprétons
diversement. Ainsi des trois états de conjecture,
de définition et de qualité, naissent des
simulacres d'états, tantôt simples, tantôt mixtes,
mais ayant cependant une physionomie qui
leur est propre, comme la question qui a pour
objet la lettre et l'intention, et qui, sans aucun
doute, se renferme dans la qualité ou la conjecture;
celle qui se traite par syllogisme, et qui
appartient principalement à la qualité; celle qui
a pour objet la contradiction des lois, et qui se
résout par la conjecture et la qualité; enfin celle
qui a pour objet l'ambiguïté, ἀμφιβιλία, et qui
se résout toujours par la conjecture. A l'égard
de la définition, elle est commune aux deux genres,
à celui qui a pour objet le fait, comme à
celui qui a pour objet l'écrit.
Toutes ces questions rentrent, il est vrai, dans
les trois états; mais comme elles ont, ainsi que
je l'ai dit, quelque chose qui leur est propre, il
n'est pas inutile de les faire remarquer aux étudiants;
et on peut leur permettre de les appeler
ou états légaux, ou questions, ou sortes de chefs
secondaires, pourvu qu'ils sachent qu'il n'y a
rien à y chercher de plus que ce qui est contenu
dans les trois points que j'ai indiqués plus haut.
A l'égard de la quantité, de la multiplicité, de
la relation, et, comme quelques-uns le veulent,
de la comparaison, il n'en est pas de même. Car
ce ne sont pas des variétés du genre légal; mais
elles doivent être rapportées uniquement au genre
rationnel, et doivent par conséquent être rangées
sous la conjecture ou la qualité, comme ces questions
qui regardent l'intention, le temps, le lieu.
Mais nous parlerons de chacune en particulier,
lorsque nous traiterons des préceptes de la division.
On convient généralement que les causes simples
n'ont qu'un seul état, mais que souvent,
dans une seule cause, il peut se rencontrer plusieurs
de ces questions secondaires, qui se rattachent
à ce qui fait le point essentiel du procès. Je
crois encore que l'on petit être quelquefois en
doute sur l'état, dont il est le plus à propos de
se servir, lorsqu'on oppose plusieurs moyens à
une seule accusation; et comme la meilleure couleur
qu'on puisse donner à la narration est celle
qu'on peut le mieux soutenir, ainsi je crois que
de tous les états que peut comporter une cause,
il faut particulièrement choisir celui que l'orateur
sent qu'il défendra le mieux. C'est pour cela que
Brutus voulant, à l'imitation de Cicéron, composer
un plaidoyer pour Milon, sans autre dessein
que d'exercer son éloquence, prit l'affaire
tout autrement que Cicéron. Car celui-ci soutenait
que Clodius avait été tué justement, mais
pourtant sans dessein prémédité de la part de Milon,
à qui il avait dressé des embûches; et, au
contraire, Brutus faisait un titre de gloire à Milon
d'avoir tué un mauvais citoyen.
A l'égard des causes complexes, on convient
encore qu'elles peuvent avoir deux ou trois états
tantôt différents, comme lorsque de deux choses
on nie l'une, et que l'on soutient l'autre juste;
tantôt du même genre, si, par exemple, on nie
tout. Et cela arrive, quoiqu'il ne s'agisse que d'un
seul point, mais pourvu qu'il soit contesté entre
plusieurs personnes; soit qu'elles aient toutes le
même droit, comme celui de parenté, soit que
chacune en ait un différent, comme lorsque deux
héritiers réclament une succession, l'un en vertu
d'un testament, l'autre en qualité de plus proche
parent. Or, toutes les fois qu'il y a plusieurs de-
107 mandeurs,
et que l'on oppose à l'un une chose,
à l'autre une autre, il faut nécessairement qu'il
y ait des états différents, comme dans ce sujet
de controverse : Que tout testament conforme
aux lois ait son effet; que les pères, qui meurent
sans tester, n'aient pour héritiers que leurs enfants;
que tout enfant auquel son père a renoncé
n'ait aucune part dans sa succession; que le bᾶtard né avant l'enfant légitime soit tenu
pour légitime; né après, qu'il soit seulement
citoyen; tout père peut donner son fils à titre
d'adoption, et tout adopté peut rentrer dans sa
famille si son père naturel meurt sans enfants.
Cela posé, un père qui, de deux fils, avait
renoncé à l'un, et donné l'autre à titre d'adoption,
vient d'avoir un bâtard. Il rappelle à sa succession
celui qu'il avait renoncé, l'institue son héritier
et meurt : tous les trois plaident pour avoir
son bien. Je fais observer que les Grecs appellent
νόθος un enfant qui n'est pas légitime, et que
n'ayant point en latin de mot correspondant,
comme Caton le témoigne dans un de ses discours,
nous sommes obligés de nous servir du
mot grec. Mais revenons à notre sujet.
A celui qui est institué héritier, on oppose
cette loi : Que tout enfant que son père a renoncé
soit exclu de sa succession : ce qui fonde un état
de cause, pris du texte de la loi et de l'intention
du législateur; car on examine si cet enfant ne
peut en aucune manière hériter de son père; s'il
ne le peut pas, quand son père le rappelle, quand
son père l'institue héritier.
On allègue au bâtard deux choses : qu'il est
né après les enfants légitimes, et qu'il n'est point
né avant aucun qui soit légitime : d'où naissent
deux états de cause, l'un de raisonnement ou
d'induction ; car voici la question qui se présente :
Un enfant né d'une mère illégitime est-il, par
apport aux enfants légitimes, comme s'il n'était
pas né? l'autre fondé sur la loi et sur l'intention;
car on convient que ce bâtard n'est pas né avant
les enfants légitimes : mais il se défendra par
l'esprit de la loi, en disant qu'un bâtard, suivant
la loi, doit être censé légitime, lequel est né
lorsqu'il n'y avait plus d'enfants légitimes dans
la famille. Il combattra aussi les termes de la loi,
et dira que le défaut de survenance d'enfant légitime
après le bâtard ne saurait nuire à ce dernier;
et voici comme il raisonnera : Supposez
qu'il n'y ait pour tout enfant qu'un bâtard, quelle
sera sa condition? Sera-t-il seulement citoyen?
mais il n'est point né après les enfants légitimes.
Aura-t-il la qualité de fils? mais il n'est point né
avant que son père eût des enfants légitimes.
Puis donc qu'on ne peut pas s'arrêter aux termes
de la loi, il faut s'en tenir à l'esprit. Et l'on ne
doit pas s'étonner qu'une seule loi donné lieu à
deux états différents; car cette loi est double,
et par conséquent équivalente à deux lois.
Venons à celui qui a été adopté; car il veut
rentrer dans la famille et partager aussi les biens.
Premièrement, il aura affaire à l'héritier, qui lui
dira: Je suis institué héritier, la succession m'appartient.
C'est le même état de cause que dans la
demande du fils renoncé par son père, où il s'agit
de savoir si celui que son père a renoncé peut
hériter. En second lieu, l'héritier et le bâtard lui
diront : Notre père n'est point mort sans enfants;
ainsi, aux termes de la loi, vous ne pouvez pas
rentrer dans la famille. Mais, outre cela, chacun
se renfermera dans la question qui lui est propre;
car celui qui a été renoncé dira qu'il n'en est pas
moins fils de son père, et se prévaudra de la loi
même en vertu de laquelle on prétend l'exclure,
puisqu'il aurait été superflu de l'exclure de la
succession s'il eût été considéré comme étranger;
et que comme, en qualité de fils, il aurait été
héritier de son père si ce dernier fût mort sans
tester, la loi qu'on lui oppose pouvait bien le priver
de la succession, mais non le dépouiller de
sa qualité de fils. De là un état de définition :
qu'est-ce qu'être fils? Le bâtard, de son côté,
alléguera que leur père n'est pas mort sans enfants,
et il le prouvera par les mêmes moyens dont
il s'est servi pour soutenir sa demande, à moins
qu'il n'aime mieux recourir à la définition : Les
enfants non légitimes en sont-ils moins des enfants?
Voilà donc spécialement deux états dans une
même controverse, l'un tiré du texte de la loi et
de l'intention, l'autre de syllogisme, et de plus
un état de définition; ou plutôt on y trouve les
trois seuls états véritables, l'état de conjecture
dans l'examen du texte de la loi et de l'intention,
l'état de qualité dans le syllogisme, et enfin
l'état de définition, qui s'entend assez de lui-même.
Toute controverse renferme aussi une
cause,
un point à juger, et un contenant. En effet, il
n'est point de controverse qui ne renferme un
motif, auquel se rapporte le jugement et qui contient
la substance même du procès. Mais comme
tout cela varie suivant la nature des affaires, et a
été ordinairement traité par ceux qui ont écrit
sur les causes judiciaires, je remets à en parler
quand je serai arrivé à cette partie de mon ouvrage.
Quant à présent, comme j'ai divisé les causes en trois
genres, je vais suivre l'ordre que je me suis prescrit.
CHAP. VII. Je commencerai de préférence par
le genre qui consiste dans la louange et le blâme. Il
semble qu'Aristote et Théophraste qui l'a suivi en
aient fait un genre oiseux, qui n'a d'autre but que
de plaire à l'auditeur : c'est en effet tout ce que
promet l'étymologie de son nom. Mais chez les
Romains l'usage en a introduit l'emploi dans les
affaires; car les oraisons funèbres, font partie de
certaines fonctions publiques, et souvent les magistrats
en sont chargés par un sénatus-consulte;
l'éloge ou le blâme d'un témoin n'est pas sans
influence sur les jugements; il est aussi permis
aux accusés de produire des apologistes; et ces
mémoires publiés contre L. Pison, contre Clodius
et Curion, et contre d'autres compétiteurs,
n'ont pas laissé, quoique diffamatoires, de tenir
lieu d'avis dans le sénat. Toutefois, je ne nie
pas que certaines compositions de ce genre, telle
que l'éloge des dieux, ou des héros que les premiers
siècles ont produits, ne soient des discours
de simple apparat: ce qui tranche la question que
nous avons traitée plus haut, et démontre l'erreur
de ceux qui croient que l'orateur n'a jamais
à parler que sur des matières douteuses. Dira-t-on
que l'éloge de Jupiter Capitolin, objet perpétuel
d'une sainte émulation, soit une matière
douteuse, ou ne soit pas traité oratoirement?
D'ailleurs, si la louange, appliquée aux affaires,
ne peut se passer de preuves, elle ne laisse pas
d'en offrir quelque apparence, même dans les
discours d'apparat. S'agit-il, par exemple, de
parler de Romulus, fils de Mars, allaité par une
louve? L'orateur prouvera son origine céleste, en
disant qu'exposé au milieu des eaux, il ne put
être submergé; que toutes ses actions permettent
de voir en lui le fils du dieu de la guerre; qu'enfin
ses contemporains n'ont élevé aucun doute sur
son apothéose. On retrouve même quelquefois
dans les compositions de ce genre une apparence de
109
défense : ainsi, dans l'éloge d'Hercule, l'orateur
peut excuser ce qu'on rapporte de ce héros, qu'il
quitta sa massue pour prendre les vêtements
d'Omphale et filer aux pieds de cette reine. Cependant
le propre du genre laudatif est l'amplification
et l'ornement. Il a principalement pour
objet la louange des dieux et des hommes, et quelquefois
même des animaux et des choses inanimées.
En louant les dieux, on rend d'abord hommage,
en général, à la majesté de leur nature;
ensuite, à la puissance particulière de chacun
d'eux, et aux inventions utiles qu'ils ont communiquées
aux hommes. S'agit-il de leur puissance?
Jupiter gouverne tout; Mars préside à la guerre;
Neptune règne sur les eaux. S'agit-il de leurs
inventions? Nous devons les arts à Minerve; les
lettres, à Mercure; la médecine, à Apollon; les
moissons, à Cérès; le vin, à Bacchus. Si l'antiquité
nous a transmis quelque chose de mémorable
sur eux, on le raconte. On fait valoir aussi
leur origine, comme d'être enfants de Jupiter;
leur ancienneté, comme d'être issus du Chaos;
leur descendance : ainsi Apollon et Diane font
honneur à Latone. On peut louer les uns d'être
nés immortels; les autres, d'avoir mérité l'immortalité
par leur vertu : genre de gloire qui, grâce à la piété de
notre prince, a illustré le siècle où nous vivons.
L'éloge des hommes est plus varié. On y distingue
les temps: celui qui les a précédés, celui
où ils ont vécu, et, s'ils ne sont plus, celui qui
a suivi leur mort. La patrie, les parents, les cieux :
voilà ce qui précède la naissance et donne lieu à
une double considération : ou ils ont soutenu leur
noblesse héréditaire, ou ils ont illustré un nom
obscur par l'éclat de leurs actions. Il y aura lieu
quelquefois de rappeler les prédictions et les augures
qui avaient annoncé leur grandeur future;
cet oracle, par exemple, qui avait déclaré que le
fils qui naîtrait de Thétis serait plus grand que
son père. Les louanges personnelles se tirent des
qualités de l'âme et du corps, des avantages extérieurs.
Mais comme les avantages du corps et
tous ceux que nous tenons du hasard ont peu de
valeur en eux-mêmes, ils peuvent être considérés
sous différents points de vue. Ainsi on vantera
quelquefois la beauté et la force, comme fait Homère
à l'égard d'Agamemnon et d'Achille; mais
quelquefois le contraste de la faiblesse contribue
à redoubler l'admiration, comme lorsque ce poète
nous représente Tydée petit de corps, mais intrépide
guerrier. Il en est de même de la fortune:
si d'un côté elle donne du lustre au mérite, dans
les rois, par exemple, et dans les princes, à qui
elle offre plus d'occasions de bien faire; d'un
autre côté, plus on est dénué de ces secours, plus
la vertu brille par elle-même. En effet, tous les
biens, qui sont hors de nous, et que le hasard dispense
à son gré, recommandent l'homme, non
par eux-mêmes, mais par le bon usage qu'il en
fait. Car les richesses, le pouvoir, le crédit, étant
des instruments puissants pour le bien et pour le
mal, mettent nos mœurs à la plus sûre des épreuves,
et nous rendent toujours ou meilleurs ou pires.
L'éloge de l'âme est toujours vrai; mais il n'y
a pas non plus qu'une seule manière de le traiter.
Tantôt il vaudra mieux suivre la progression de
l'âge et l'ordre des actions, en louant le naturel
dans les premières années, puis l'éducation, et
enfin les fruits qu'elle aura portés, c'est-à-dire
cet enchaînement de dits et de faits qui composent la vie de celui
qu'on loue. Tantôt on prendra pour division un certain nombre de
vertus, telles 110
que le courage, la justice, la tempérance, et on assignera à
chacune d'elles ce qui aura été fait sous son inspiration. Quelle
est la meilleure de ces méthodes? C'est au sujet à nous l'apprendre.
Qu'on se souvienne seulement que rien n'est plus agréable à
l'auditeur que le récit de ce qu'un homme a fait seul, ou le
premier, ou dont il n'a du moins partagé la gloire qu'avec un petit
nombre; d'un trait inespéré ou inattendu, et surtout de quelque
action où l'intérêt personnel a été sacrifié à l'intérêt d'autrui. Quant au temps qui
suit la mort de l'homme, il n'est pas toujours
à propos d'en parler, d'abord parce que l'on a
quelquefois à louer des personnes encore vivantes;
ensuite, parce qu'on a rarement occasion de rappeler
des apothéoses ou des honneurs publics,
comme des statues élevées aux frais de l'État. Je
mets au rang de ces titres d'honneur les monuments
de l'esprit, consacrés par le suffrage des
siècles. Ainsi quelques hommes, comme Ménandre,
ont obtenu plus de justice de la postérité que
de leurs contemporains. La gloire des enfants rejaillit
sur les pères, celle des villes sur leurs fondateurs;
les lois rendent célèbres ceux qui les
ont portées; les arts, ceux qui les ont inventés;
enfin les institutions recommandent le nom de
leurs auteurs : ainsi, le culte que nous rendons
aux dieux honore la mémoire de Numa; et l'usage
d'incliner les faisceaux devant le peuple a
rendu chère celle de Publicola.
S'agit-il de blâmer? on suivra la même méthode,
mais en sens contraire : une honteuse extraction
a couvert d'opprobre un grand nombre
d'hommes; chez d'autres, la noblesse n'a servi
qu'à faire ressortir leurs vices et à rendre leurs
personnes plus odieuses. De funestes prédictions
ont précédé la naissance de quelques-uns : de
Paris, par exemple. Ceux-ci, comme Thersite
et Irus, ont été des objets de mépris, à cause
de leur difformité ou de leur misère; ceux-là,
comme le lâche Nirée ou l'impudique Plisthène,
flétris par les poètes, ont été des objets de haine,
pour s'être rendus indignes des dons que la nature
leur avait départis. Aux vertus de l'âme,
sont opposés autant de vices; et les uns comme
les autres peuvent être présentés de deux
manières. Il y a des hommes que l'infamie a
suivis au delà du tombeau : témoins Mélius,
dont la maison fut rasée, et Marcus Manlius,
dont le prénom fut retiré à toute sa postérité.
Il en est d'autres que nous haïssons jusque dans
leurs pères et mères. Des fondateurs de villes ont
encouru un opprobre éternel pour avoir rassemblé
en corps de peuple une horde funeste aux autres
peuples : tel est le premier auteur de la superstition
judaïque. La haine qu'on porte aux
Gracques a passé jusqu'à leurs lois. Enfin il est
certains crimes dont la solidarité pèse sur toute la
postérité : tel est cet attentat inouï commis par un
Perse sur une femme de Samos. A l'égard des vivants,
le jugement du public dépose de leurs
mœurs; et leur bonne ou mauvaise réputation
justifie l'éloge ou le blâme. Il importe cependant,
suivant Aristote, de considérer le lieu où l'on
parle; les mœurs et les croyances des auditeurs
sont d'un grand poids dans la balance; car ils admettront
sans peine les vertus, qu'ils aiment, dans
celui qu'on loue, ou les vices, qu'ils haïssent,
dans celui qu'on blâme. On aura donc soin de
bien s'assurer, avant de parler, de l'état des esprits.
On aura soin aussi d'y mêler toujours des
louanges pour l'auditoire; car c'est le moyen
111
d'être écouté favorablement : mais, autant que
possible, ces louanges devront tourner en même
temps à l'avantage du sujet. L'étude des lettres
sera louée plus sobrement dans Sparte que dans
Athènes; mais, en revanche, on y exaltera la patience
et le courage. Certains peuples mettent
leur honneur à vivre de brigandage; d'autres, à
vivre selon les lois. L'éloge de la frugalité serait
peut-être odieux aux Sybarites, et chez les anciens
Romains c'eût été un crime capital de faire
l'apologie du luxe. La même diversité se retrouve
dans les particuliers: un juge penche aisément
pour celui en qui il suppose des sentiments conformes aux siens.
Aristote donne un autre précepte, dont Cornélius Celsus s'est emparé, mais pour le pousser à
l'excès : c'est de profiter de l'espèce d'affinité qui
existe entre les vices et les vertus, en faisant
passer, au moyen d'un léger détour des mots, un
téméraire pour brave, un prodigue pour libéral,
un avare pour économe, et réciproquement : ce
que ne fera jamais l'orateur, c'est-à-dire l'homme
de bien, à moins de quelque motif d'intérêt public.
L'éloge des villes se traite de la
même manière que celui des hommes. Les fondateurs en sont comme les
pères. L'antiquité communique à leurs noms une grande autorité :
aussi voyons-nous des peuples se vanter d'être aussi anciens que la
terre qu'ils habitent. Leur vie publique, comme la vie individuelle
de chaque homme, est sujette à la louange et au blâme :
quelques-unes se recommandent par des avantages particuliers, tels
que leur position et leurs fortifications; leurs citoyens font leur
orgueil, comme les enfants font l'orgueil des pères. Les ouvrages
publics sont aussi un sujet d'éloge. On y peut considérer l'idée
d'ornement, l'utilité, la beauté, l'auteur : l'idée d'ornement dans
les temples, l'utilité dans les remparts, la beauté et l'auteur dans
les uns et les autres. On loue encore les lieux : témoin cette
description que Cicéron fait de la Sicile. On y considère la beauté
et l'utilité : la beauté, dans la perspective de la mer, des plaines
ou des prairies; l'utilité, dans la salubrité de la température et
la fertilité du sol. On loue toutes les paroles, toutes les actions
dignes de mémoire. Enfin, que ne loue-t-on pas? On a loué le sommeil
et la mort; les médecins ont fait l'éloge de certains aliments. Si
donc je n'accorde pas que le genre laudatif se renferme dans les
considérations de l'honnête, je crois en même temps qu'il
appartient plus spécialement à la qualité. Cependant
les trois états peuvent s'y rencontrer tous,
et Cicéron remarque que César en a fait usage
dans son Anti-Caton. Enfin on peut dire que,
considéré en général, le genre laudatif a quelque
rapport avec le délibératif, parce que ordinairement
ce que l'on conseille dans l'un, on le loue dans l'autre.
CHAP. VIII. Je m'étonne aussi que quelques
auteurs aient restreint le genre délibératif à l'utile.
S'il fallait le réduire à un seul objet, je m'attacherais
plutôt au sentiment de Cicéron, qui lui
donne la dignité principalement en partage. Je
suis même persuadé que ces auteurs, conformément
à la belle doctrine des stoïciens, ne distinguent
pas l'utile de ce qui est honnête. Et en effet,
la raison nous ferait un devoir de cette doctrine, si
l'on avait toujours affaire à des sages; mais comme
le plus souvent c'est devant des ignorants, et
surtout devant le peuple, généralement composé
d'esprits grossiers, qu'on a à délibérer, il faut bien
faire des distinctions, et parler de manière à se
112
faire comprendre de tout le monde. Que de gens,
tout en reconnaissant qu'une chose est honnête,
ont de la peine à la regarder comme utile; et
combien d'autres, séduits par une apparence
d'utilité, approuvent des choses qu'ils savent
être honteuses, telles que le traité de Numance,
et les Fourches Caudines !
Je ne crois pas même que ce genre puisse être
renfermé dans l'état de qualité, bien que cet
état comprenne toutes les questions qui concernent
l'honnête et l'utile; car souvent la conjecture
et quelquefois la définition y trouvent place;
quelquefois aussi on a occasion d'y traiter des
questions légales, surtout dans les délibérations
privées, quand on examine, par exemple, si telle
chose est permise. Je laisse la conjecture, que
je reprendrai ensuit pour en parler plus amplement,
et je vais, pour le moment, m'occuper
uniquement de la définition. Ne se rencontre-t-elle
pas dans ce passage de Démosthène : Est-ce
un don ou une restitution que Philippe fait
aux Athéniens, en leur livrant Halonèse? Et
dans cet endroit des Philippiques de Cicéron :
Qu'est-ce que le tumulte? Enfin cet orateur n'a-gite-t-il
pas une question légale, quand, au sujet
de Servius Sulpicius, il met en délibération
si l'on ne doit décerner des statues qu'à ceux
qui ont péri par le fer dans leurs ambassades? Le
genre délibératif embrasse donc le passé comme
l'avenir. Quant à ses fonctions, elles consistent
à conseiller et à dissuader.
Ce genre ne réclame pas un exorde en forme,
comme le genre judiciaire, par la raison que tout
homme qui demande un conseil est apparemment
disposé à l'écouter. Cependant on ne peut aborder
aucun sujet sans une espèce d'exorde; car il ne
faut jamais entrer brusquement en matière, ni
suivre sa fantaisie pour guide, parce qu'en toute
chose il y a toujours un point par où l'on doit naturellement
commencer. Dans le sénat, et surtout
dans les assemblées du peuple, on tient la même
conduite que devant les juges, c'est-à-dire que
d'abord on tâche ordinairement de se concilier
la bienveillance des auditeurs; et doit-on s'en
étonner, puisque dans les panégyriques même,
où l'on ne se propose que de louer, sans aucun
but d'utilité, on ne laisse pas de rechercher la
faveur des assistants? Aristote pense avec raison
que, dans les délibérations, nous pouvons souvent
tirer l'exorde tantôt de nous-mêmes, tantôt
de la personne de notre contradicteur, faisant
en cela une sorte d'emprunt aux formes judiciaires;
quelquefois même de l'importance plus ou
moins grande que paraît avoir l'objet dont on
délibère. Dans le genre démonstratif, l'orateur
est, selon lui, tout à fait libre, et peut tantôt
amener son exorde de loin, comme dans le discours
d'Isocrate à la louange d'Hélène; tantôt le
prendre dans le voisinage du sujet, comme l'a
fait le même Isocrate dans le Panégyrique, où
il se plaint de ce qu'on honore plus la beauté du
corps que la beauté de l'âme; et Gorgias, dans
son Olympique, où il commence par louer ceux
qui ont institué les jeux célèbres qui portent ce
nom. C'est sans doute à leur exemple que Salluste,
dans la Guerre de Jugurtha et la Conjuration de
Catilina, entre en matière par des considérations
qui n'ont rien de commun avec l'histoire. Mais
revenons au genre délibératif. Si l'on n'y renonce
pas à un exorde, il faut qu'il soit court, et qu'on
puisse l'appeler plutôt un début, un commencement,
qu'un exorde proprement dit.
La narration n'est jamais nécessaire dans les
délibérations privées, au moins quant à l'objet dont
113
on délibère; car celui qui demande conseil sait
apparemment sur quoi. On peut cependant entrer
dans le récit d'une foule de circonstances qui ont
du rapport avec l'objet de la délibération ; mais
dans les délibérations publiques, une narration qui
expose l'affaire avec ordre est souvent indispensable.
Au reste, le genre délibératif exige plus
que tout autre l'emploi des passions; car il faut
souvent exciter ou apaiser la colère, inspirer la
crainte, le désir, la haine, la bienveillance, éveiller
quelquefois la pitié, soit qu'on ait à conseiller
de porter secours à des assiégés, soit qu'on ait à
déplorer la ruine d'une ville alliée.
Mais ce qui est d'un grand poids dans les délibérations,
c'est l'autorité de l'orateur. Car celui-là
doit être et passer pour supérieur en lumières et
en vertu, qui veut que tous ajoutent foi à ses paroles
en ce qui touche l'honnête et l'utile. Au barreau,
il est admis qu'on peut suivre un peu son
inclination; mais dans les délibérations, la vertu
est, du consentement de tous, l'unique règle de conduite.
La plupart des rhéteurs grecs ont exclusivement
renfermé ce genre dans les affaires publiques :
Cicéron même s'en tient presque là. Il suppose
qu'un orateur n'a guère à délibérer que de la paix,
de la guerre, de la levée des troupes, des travaux
publics et des subsides. C'est pour cela qu'il veut
que l'orateur soit particulièrement instruit des
forces et des mœurs d'un État, afin de conformer
sa consultation à la nature des choses et à la disposition
des esprits. Pour moi, je crois que ce genre
comporte en soi plus de variété; car les délibérations
sont susceptibles de bien des sortes de personnes
et de choses. Il faut donc, soit en conseillant,
soit en dissuadant, considérer d'abord trois
objets : ce dont on délibère, ceux qui consultent,
ceux qui sont consultés.
A l'égard de la chose dont on délibère, ou il
est certain qu'elle est faisable, ou cela est incertain.
S'il y a incertitude, c'est la seule question,
ou au moins la plus importante ; car il peut arriver
souvent que l'on dise d'abord qu'une chose n'est
pas à faire, quand même elle serait faisable; ensuite,
qu'elle n'est pas faisable. Or, dans ce cas,
l'état est de conjecture, comme dans ces questions :
Est-il possible de couper des isthmes,
de dessécher les marais Pontins, de creuser un
port à Ostie? Alexandre aurait-il trouvé des
terres au delà de l'Océan? Quelquefois même
une chose faisable peut donner lieu à l'état de
conjecture, quand on examine, par exemple, si
les Romains se rendront maîtres de Carthage, si
Annibal quittera l'Italie, dans le cas où Scipion
porterait la guerre en Afrique; ou si les Samnites
demeureront fidèles, dans le cas où les Romains
déposeraient les armes. Enfin, il y a des choses qui
peuvent se faire, et qui même, selon toute apparence,
arriveront, mais dans un autre temps,
dans un autre lieu, d'une autre façon.
Quand il n'y a pas lieu à conjecture, il se présente
d'autres considérations. Et d'abord, la délibération
porte, ou sur la chose en elle-même, ou
sur l'appréciation des circonstances. Dans le premier
cas, le sénat délibère, par exemple, s'il y a
lieu d'établir une solde pour les troupes; voilà
une matière simple. Dans le second cas, on délibère,
ou sur les motifs de faire une chose, si, par
exemple, on livrera les Fabius aux Gaulois;
qui, en cas de refus, déclareront la guerre aux
Romains; ou sur les motifs de ne pas faire une
chose, comme César, par exemple, qui ne sait
114
s'il doit persister à marcher en Germanie, parce
que ses soldats font de tous côtés leurs testaments.
Ces deux sujets de délibération sont complexes ;
car, dans le premier, on insiste sur ce que les Gaulois
nous déclareront la guerre; mais on peut
agiter encore cette autre question, si, indépendamment
de la menace des Gaulois, on n'est point
fondé à livrer des hommes qui, oubliant leur
qualité d'ambassadeurs, ont engagé le combat
contre le droit des gens, et massacré le roi auprès
duquel on les avait députés. Dans le second, César
ne délibérerait probablement pas sans la consternation
de ses soldats; et néanmoins il y aurait
lieu d'examiner si, indépendamment de cette circonstance,
il ferait bien de pénétrer en Germanie.
Au surplus, dans ces sortes de délibération, il faut
toujours commencer par la question que l'on aurait
à examiner, toute circonstance à part.
Quelques rhéteurs assignent au genre délibératif
trois parties : l'honnête, l'utile, le nécessaire.
Je ne vois pas ce qui motive la troisième; car, à
quelque épreuve que l'on nous mette, nous
pouvons bien être contraints à souffrir, jamais
à faire : or c'est sur ce qu'on fera qu'on délibère.
Que si l'on appelle nécessité l'extrémité où
nous réduit la crainte d'un plus grand mal, cela
ne sort pas de la question de l'utile. Par exemple,
une ville est assiégée, et les habitants, trop peu
nombreux pour résister et manquant d'eau et de
nourriture, délibèrent s'ils se rendront. Si l'on
dit : Il faut nécessairement se rendre, cette proposition
n'est complète qu'autant qu'on ajoute
parce qu'autrement il faudra périr. Donc il n'y
a pas nécessité, par cela même qu'on peut préférer
la mort; et de fait, ni les Sagontins, ni ces
braves Opitergiens, qu'enveloppait la flotte ennemie,
ne se sont point rendus. Ainsi, même
dans ces rencontres, la question roule uniquement
sur l'utile, ou tout au plus elle embrassera
l'utile et l'honnête. Mais, dira-t-on, n'est-ce
pas une nécessité de se marier à qui veut avoir
des enfants? Qui en doute? Celui qui veut devenir
père ne saurait ignorer qu'il doit nécessairement
se marier. Il n'y a donc pas lieu à délibérer
sur la nécessité non plus que sur l'impossibilité,
car toute délibération suppose un doute :
c'est pourquoi je préfère ceux qui au mot nécessaire
ont substitué celui de possible, possible,
le seul qui rende, quoique d'une manière un peu
dure, le mot grec δυνατόν.
Il est évident, sans que je le démontre, que ces
trois parties ne se rencontrent pas toujours toutes à
la fois dans une délibération. Cependant la plupart
des rhéteurs en admettent un plus grand nombre,
nous donnant pour parties des subdivisions de
parties. Car ce qui est permis, ce qui est juste,
ce que commande la piété, l'équité, la douceur
(τὸ ἥμερον), et tout ce qu'on voudra y ajouter de
semblable, tout cela peut se rapporter à l'honnête,
comme l'espèce à son genre. De même, ce qui
est facile, grand, agréable, sans danger, rentre
dans la question de l'utile. Toutes ces espèces sont
autant de lieux qui naissent de la contradiction
des adversaires : cela est utile, oui, mais difficile,
peu important, désagréable, dangereux.
Quelques-uns néanmoins veulent que ce qui est
purement agréable soit quelquefois l'unique objet
des délibérations, lorsqu'il s'agit, par exemple,
de savoir s'il y a lieu d'édifier un théâtre, d'instituer
des spectacles. Mais quel est l'homme assez
relâché et assez frivole pour réduire une délibération
à une question de plaisir? Le fond de la délibération
doit toujours être dissimulé par des
considérations d'un ordre plus relevé. Ainsi, dans
115
l'institution des jeux, ce sont les dieux qu'on veut
honorer; si l'on propose d'élever un théâtre, c'est
pour procurer au travail un délassement utile, et
prévenir, par une distribution commode des places,
la confusion d'une foule tumultueuse; et
l'on fera voir que la religion n'y est pas moins
intéressée, en disant que ce théâtre sera une espèce
de temple consacré au dieu en l'honneur
duquel ces jeux ont été institués.
Il y a lieu souvent de sacrifier l'utile à l'honnête.
Nous exhorterons, par exemple, ces Opitergiens
à résister, quoiqu'ils n'aient pas d'autre
alternative que de se rendre ou de périr. Dans
d'autres circonstances, c'est le contraire : comme
dans la seconde guerre punique, où nous serons
d'avis d'enrôler les esclaves. Et même ici on se
gardera d'admettre tout d'abord que ce parti soit
déshonorant; car on peut dire que la nature a
fait tous les hommes libres, qu'elle les a formés
des mêmes éléments, et que peut-être les esclaves
sont d'une antique et noble origine. Là où
le danger est évident, on aura recours à d'autres
raisons : par exemple, que, s'ils se rendent, ils
périront peut-être d'une manière plus cruelle,
soit que l'ennemi ne garde pas sa parole, soit que
César demeure victorieux, ce qui est plus probable.
Voilà comme avec des mots on parvient
à faire cesser la lutte des idées les plus opposées;
car l'utile n'est compté pour rien par ceux qui
non seulement placent l'honnête au-dessus de
l'utile, mais veulent encore que ce qui n'est pas
honnête ne soit pas même utile; tandis que d'autres
traitent ce que nous appelons l'honnête, d'inanité,
d'orgueil, de sottise, avec une apparence
de vérité, qui n'est que dans les mots.
Non seulement on compare ce qui est utile avec
ce qui ne l'est pas, mais on compare encore
entre elles deux choses utiles ou préjudiciables,
afin de choisir le plus ou le moins dans l'une ou
dans l'autre. La comparaison peut même s'étendre
à un plus grand nombre d'objets; car il se rencontre
quelquefois jusqu'à trois partis à examiner,
comme lorsque Pompée délibéra s'il se rendrait
chez les Parthes, ou en Afrique, ou en Égypte. Il
est question, dans ce cas, de savoir, non pas si,
entre deux partis, l'un vaut mieux que l'autre,
mais lequel, entre trois, est le meilleur ou le
plus dangereux. En effet, ce qui nous est avantageux
de tout point ne peut donner matière à
une délibération; car où il n'y a pas lieu à contradiction,
quel peut être le motif de douter?
Ainsi toute délibération n'est, à proprement parler, qu'une
comparaison.
Il faut aussi considérer la fin et les moyens,
pour savoir si l'avantage de la fin compense le
désavantage du moyen. On envisage l'utilité par
rapport au temps, au lieu, à la personne, à la manière
d'agir; à la mesure. Il est expédient de faire
cela, mais non pas à présent, non pas ici, ni à nous,
ni contre tels, ni de cette manière, ni jusqu'à tel
point. Mais ce qu'il faut principalement observer,
tant à l'égard de nous-mêmes qu'à l'égard de
ceux devant lesquels on délibère, c'est la convenance.
Ainsi, quoique l'exemple soit ici d'un
grand poids, parce que rien ne détermine tant
les hommes à faire une chose que de leur montrer
que d'autres l'ont faite avant eux, il importe
cependant de voir quels exemples on cite et devant
qui on les cite : tant les esprits sont divers !
ce qui donne lieu â deux considérations princi-
116 pales.
Ou c'est une assemblée qui délibère, ou
c'est un particulier; et ces deux cas exigent encore
des distinctions. Si c'est une assemblée, autre
chose est de parler devant le sénat ou devant
le peuple; devant les Romains ou les Fidénates ;
devant les Grecs ou devant des barbares. Si c'est
un particulier, autre chose est de conseiller à Caton
ou à Marius de briguer les charges publiques;
autre chose encore de parler de l'art militaire
devant le premier Scipion ou devant Fabius.
Il faut aussi avoir égard au sexe, à la dignité,
à l'âge, et surtout aux mœurs; car c'est là ce qui
met le plus de différence entre un homme et un autre.
Rien n'est plus facile que d'exhorter au bien
ceux qui aiment le bien. Mais en s'efforçant de
convertir à la vertu des hommes corrompus, il
faut prendre garde d'avoir l'air de leur reprocher
leur conduite. On ne cherchera pas à les toucher
par la vue du bien en lui-même, auquel leurs
yeux sont fermés, mais par le désir de la gloire
et de la renommée; ou si cette vaine ambition a
peu d'effet sur eux, par les avantages qu'ils retireront
d'une vie vertueuse; ou enfin, et c'est peut-être
le plus sûr, par la considération des malheurs
dont ils sont menacés, s'ils prennent un parti
différent. Car, outre qu'il est aisé d'ébranler par
la terreur ces esprits sans consistance, je ne sais
si la crainte du mal n'a pas naturellement plus
d'influence sur la plupart des hommes que l'espérance
du bien, de même que la plupart comprennent
plus facilement le vice que la vertu. Quelquefois
on conseille à des gens de bien des actions
peu honorables; ou, si l'on a affaire à des gens
d'une vertu médiocre, on ne fera valoir que l'utilité
du parti qu'on leur conseille. Je n'ignore pas
ce que va penser le lecteur. Est-ce donc là ce que
vous enseignez; dira-t-il, et croyez-vous cela
permis? Je pourrais me retrancher derrière l'autorité
de Cicéron, qui, dans une lettre à Brutus,
après avoir énuméré plusieurs conseils honorables
qu'il pouvait donner à César, ajoute : Serais-je
un homme de bien, si je lui donnais ces conseils?
Nullement, car tout homme qui conseille
autrui ne doit envisager que l'intérêt de celui
qu'il conseille. Mais ces conseils sont dictés par
l'honneur! D'accord; mais il n'est pas toujours
bon de conseiller ce qui est honnête. Toutefois,
comme cette question a besoin d'être approfondie,
et ne regarde pas seulement le sujet que je
traite ici, je me réserve de l'examiner dans le
douzième et dernier livre de cet ouvrage. Au
reste, je ne prétends autoriser personne à rien
faire de honteux; et, jusqu'à ce que je m'explique,
ce que j'ai dit ne s'appliquera, si l'on veut,
qu'aux exercices de l'école. Car il est bon de
connaître les voies de l'iniquité, pour mieux défendre l'équité.
Cependant, même en conseillant à un homme
de bien une action déshonnête, qu'on se souvienne
de ne pas la lui présenter comme telle,
et qu'on se garde d'imiter ces déclamateurs, qui
exhortent Sextus Pompée à la piraterie, par cela
même qu'elle est déshonnête et cruelle. Il faut,
au contraire, colorer la difformité du vice, même
auprès des méchants. Ainsi Catilina, dans Salluste,
parle comme s'il se déterminait au plus grand
des crimes, non par perversité, mais par indignation.
Ainsi, dans Varius, Atrée s'écrie :
Je rends guerre pour guerre, et forfait pour forfait.
A combien plus forte raison doit-on recourir à
cette espèce de détour avec ceux à qui l'honneur
est cher? Si donc nous donnons à Cicéron le con-
117 seil
d'implorer la clémence d'Antoine, de brûler
même ses Philippiques, condition à laquelle celui-ci
lui promet sa grâce, nous n'insisterons pas sur
l'amour de la vie, car si cet amour trouve accès
dans son âme, il parlera assez haut de lui-même
sans le secours de notre éloquence; mais nous
l'exhorterons à se conserver pour la république;
et ce motif lui dissimulera la honte de sa faiblesse.
Voulons-nous conseiller à César de s'emparer du
pouvoir suprême? nous prouverons que la république
ne peut désormais subsister qu'autant
qu'elle obéira à un seul. Car quiconque délibère
sur une action criminelle ne cherche qu'à sauver les apparences.
La personne de celui qui conseille importe
beaucoup aussi. Si donc sa vie passée a été illustre,
si l'éclat de sa naissance, son âge, sa condition,
donnent lieu d'attendre beaucoup de lui,
il faut prendre garde que ses paroles ne démentent
l'idée qu'on a de lui. Des antécédents contraires
demandent un ton plus humble; car ce qui passe
pour liberté dans les uns, est appelé licence dans
les autres. A ceux-ci l'autorité suffit; ceux-là
sont à peine protégés par la raison.
C'est pour cela que les prosopopées me paraissent
un genre très difficile; car outre qu'elles
doivent s'assujettir aux règles que je viens de tracer,
il faut encore que les caractères y soient
exactement observés. En effet, César, Cicéron et
Caton, opinant dans une même affaire, parleront
tous trois différemment. Mais c'est aussi un exercice
des plus utiles, en ce qu'il nous forme à deux
choses, et en ce qu'il est d'un grand secours pour
les poètes et ceux qui se destinent à écrire l'histoire.
Je ne le crois pas moins nécessaire à l'orateur.
Combien, en effet, de harangues composées par
des orateurs grecs et romains, non pour eux,
mais pour autrui, et dans lesquelles il leur a fallu
s'accommoder à la condition et aux mœurs de
ceux à l'usage de qui ils les avaient écrites? Cicéron
écrivant pour Cn. Pompée, pour T. Ampius,
et tant d'autres, pensait-il de même dans
ces différentes occasions, et ne jouait-il qu'un seul
personnage? ou plutôt, travaillant d'après l'idée
qu'il s'était faite de la fortune, de la dignité et
des actions de tous ceux auxquels il prêtait sa
voix, ne les représentait-ii pas au naturel? Ils
n'auraient pas si bien parlé sans doute, mais c'étaient
eux cependant qu'on croyait entendre. Car
un discours ne pèche pas moins par défaut de
convenance avec la personne que par défaut de
convenance avec le sujet. Aussi admire-t-on l'air
de vérité que Lysias savait donner à ce qu'il
écrivait pour des ignorants.
Et c'est particulièrement aux déclamateurs à observer
ces convenances. Il est très peu de controverses
où ils parlent comme des avocats; mais le
plus souvent ils se mettent à la place des parties,
et représentent tour à tour un fils, un père, un
riche, un vieillard, un bourru, un débonnaire,
un avare, un superstitieux, un poltron, un railleur.
Je ne sais si un comédien joue plus de rôles
sur le théâtre que nos déclamateurs dans les
écoles. Ces différentes expressions de caractères
peuvent être regardées comme autant de prosopopées.
J'en fais mention ici, parce qu'à la personne
près, ce sont de véritables délibérations. Encore
même cette différence ne se rencontre pas toujours;
car on feint quelquefois des matières de
controverse tirées de l'histoire, et, pour donner
plus de poids aux choses, on introduit de véritables
acteurs qui parlent eux-mêmes.
Je n'ignore pas que dans les écoles on donne
souvent à traiter, à titre d'exercice, des contro-
118 verses
poétiques et historiques, comme Priam
aux pieds d'Achille, ou Sylla se démettant de
la dictature dans l'assemblée du peuple; mais
ni les unes ni les autres ne sont pas plus du genre
judiciaire que des deux autres. Car prier, déclarer,
rendre compte, et tout ce que j'ai déjà énuméré,
entre également dans les trois genres de causes,
sous des formes variées et suivant la nature du sujet.
Très souvent même, dans ces trois genres,
nous mettons la parole dans la bouche
de personnes que nous faisons, en quelque sorte,
lever à notre place. C'est ainsi que, dans le plaidoyer
de Cicéron pour Célius, l'aveugle Appius
et Clodius adressent des reproches à Clodia sur
ses amours, l'un avec amertume, l'autre avec douceur.
On a coutume aussi dans les écoles de donner
des matières de délibération qui se rapprochent
davantage des plaidoyers et sont un mélange des
deux genres, comme lorsqu'on délibère en présence
de César si l'on punira Théodote; car dans
cette délibération on accuse et on défend, ce qui
est le propre des causes judiciaires. Il s'y mêle
aussi une question d'utilité : on demande si le
meurtre de Pompée a été avantageux à César;
s'il n'est pas à craindre que Ptolémée ne lui
déclare la guerre, dans le cas où Théodote serait
mis à mort; si cette guerre ne serait pas
fâcheuse dans l'état présent de ses affaires, ou
dangereuse, ou au moins de longue durée.
Enfin la question de l'honnête y trouve place :
Convient-il à César de venger Pompée? n'est-il
pas à craindre qu'il ne paraisse condamner lui-même son parti, en convenant que Pompée
ne méritait pas une pareille fin? Ce genre de délibérations
peut se rencontrer dans la réalité.
La plupart des déclamateurs tombent, au sujet
des délibérations, dans une erreur qui ne
laisse pas de tirer à conséquence, en s'imaginant
que le style en doit être tout à fait contraire â
celui du genre judiciaire : ils entrent brusquement
en matière, ils affectent une véhémence continuelle,
une magnificence outrée dans les expressions;
et, dans leurs cahiers, on voit qu'ils ont à
dessein donné moins d'étendue aux matières du
genre délibératif qu'à celles du genre judiciaire.
Pour moi, si je crois, par les raisons que j'ai
données plus haut, que les délibérations peuvent
se passer d'exorde, je ne vois pas, d'un autre
côté, pourquoi l'on se livrerait, tout d'abord, à
des exclamations furibondes. Un homme de bon
sens, au contraire, qui est prié de dire son avis
sur une affaire, ne se met pas à crier, mais tâche
de gagner la confiance de celui qui le consulte
par un début doux et modeste. A quoi bon cette
violence emportée, incessante, dans la chose du
monde qui demande le plus de modération et
de méthode? Je sais que, dans les plaidoyers,
l'orateur met plus de modération dans l'exorde,
dans la narration, dans les preuves; que dans le
reste; et c'est à peu près la seule chose qui distingue
les matières judiciaires des matières délibératives:
mais si le ton des délibérations doit être plus égal dans
toutes les parties, l'orateur ne doit pas être pour cela
plus tumultueux et plus désordonné.
Les déclamateurs ne doivent pas non plus
trop rechercher la magnificence du style dans les
délibérations. Il est vrai qu'ils la rencontrent
plutôt qu'ils ne la cherchent. En effet, quand on
est maître de choisir son sujet, on aime à mettre
en scène de grands personnages, tels que des rois,
des princes, le peuple, le sénat, et à discuter de
grands intérêts : de sorte que, quand les mots
119 sont en rapport avec les choses, le discours reflète
l'éclat de la matière. Mais il n'en doit pas être de
même des délibérations sérieuses. Aussi Théophraste
veut-il que l'on évite toute espèce d'affectation
dans le style du genre délibératif, d'accord en cela
avec son maître, bien qu'il ne se fasse pas toujours scrupule
de récuser son autorité.
En effet, Aristote croit que, de tous les genres
de causes, le plus propre à faire briller l'orateur,
c'est le genre démonstratif, et après lui le genre
judiciaire : le premier, parce qu'il n'a pour but
que l'ostentation; le second, parce qu'il ne peut
se passer de l'art, ne fût-ce que pour tromper,
si l'intérêt de la cause l'exige; tandis que les délibérations
n'exigent que de la droiture et du discernement.
A l'égard du genre démonstratif, je
suis de cet avis, et je ne connais aucun uteur
qui n'y souscrive; mais à l'égard des genres judiciaire
et délibératif, je crois qu'il faut approprier
sa manière de parler à son sujet. Il me semble
que les Philippiques de Démosthène n'offrent pas
de moindres beautés que ses plaidoyers. L'éloquence
de Cicéron est également admirable, soit
qu'il délibère dans le sénat et dans les assemblées
du peuple, soit qu'il plaide devant les tribunaux.
Ce même orateur dit pourtant, en parlant du
genre délibératif : Le style en doit être toujours
simple et grave, et plus riche en pensées qu'en
expressions. On convient généralement que l'usage
des exemples n'est jamais mieux placé que
dans les délibérations, et c'est avec raison; car
le passé semble, la plupart du temps, répondre
de l'avenir, et l'expérience est regardée comme
une sorte de seconde raison.
Pour ce qui est de la brièveté ou de la longueur
que doivent avoir les discours délibératifs, cela
dépend, non du genre, mais de la mesure du sujet;
car si, dans les délibérations, la question
est ordinairement simple, aussi dans les matières
judiciaires est-elle souvent de peu d'importance.
On reconnaîtra la vérité de ce que je viens
de dire, si, au lieu de se consumer sur les traités
des rhéteurs, on s'applique à lire, je ne dis pas
seulement les orateurs, mais les historiens ; car
ces derniers, dans les harangues, dans les avis
qu'ils mettent dans la bouche de leurs personnages,
offrent de véritables modèles du genre délibératif.
On verra que les exordes de ce dernier
genre n'ont jamais rien de brusque; on verra
souvent un ton assez animé dans les discours du
genre judiciaire; partout un style adapté au sujet;
quelquefois des plaidoyers plus courts que
des délibérations. On n'y trouvera pas les défauts
où tombent certains déclamateurs, qu'on voit
se déchaîner en invectives contre ceux qui sont
d'un sentiment contraire au leur, et parler la
plupart du temps comme s'ils étaient les adversaires
de ceux qui les consultent : gens farouches,
qui semblent plutôt gourmander que conseiller.
Que les jeunes gens prennent ces réflexions pour
eux, afin qu'ils ne s'exercent pas à parler d'une
manière contraire à celle qu'exigera d'eux la réalité,
et ne perdent pas leur temps à étudier ce
qu'il leur faudra désapprendre. Aussi bien, lorsque,
dans la suite, ils seront appelés comme conseils
auprès de leurs amis, qu'ils auront à opiner
dans le sénat, ou lorsque le prince leur fera
l'honneur de les consulter, l'expérience leur apprendra
ce qu'ils refusent peut-être de croire
sur la foi des préceptes.
CHAP. IX. Parlons maintenant du genre judiciaire,
celui de tous qui est le plus varié dans ses
formes, mais qui au fond se renferme dans deux
devoirs, attaquer et défendre. La plupart des
120
auteurs lui donnent cinq parties. l'exorde, la narration,
la confirmation, la réfutation et la péroraison.
Quelques-uns ont ajouté la partition, la
proposition et la digression; mais les deux premières
rentrent dans la confirmation. Sans doute,
avant de prouver, il faut proposer; mais, après
avoir prouvé, il faut conclure : or, si l'on fait de
la proposition une partie de la cause, pourquoi
n'en ferait-on pas une de la conclusion? Quant
à la partition, elle est une espèce de la disposition,
qui est elle-même une partie de la rhétorique,
et se mêle à l'essence de toutes les matières,
comme l'invention et l'élocution. Il ne faut
donc pas croire qu'elle fasse partie d'un discours
comme d'un tout. Elle est purement et simplement
une partie de chaque question en particulier;
car il n'en est point où l'orateur ne puisse
déterminer d'avance ce qu'il dira en premier,
en second, en troisième lieu; ce qui est le propre
de la partition. N'est-il donc pas ridicule que
la question soit une espèce de la confirmation,
et qu'on appelle en même temps partie du discours
la partition, qui n'est qu'une espèce de la question?
Reste la digression. Ou elle est hors de la
cause, et par conséquent ne saurait en faire partie;
ou elle est dans la cause, et alors elle sert
d'appui ou d'ornement aux parties qu'elle affecte.
En effet, si tout ce qui est dans la cause devait
être considéré comme des parties de la cause,
pourquoi ne donnerait-on pas le même nom à
l'argument, à la similitude, aux lieux communs,
aux passions, aux exemples?
Cependant je ne suis pas de l'avis de ceux
qui, comme Aristote, retranchent la réfutation,
et la regardent comme une dépendance de la
confirmation. En effet, l'une établit, l'autre détruit.
Le même auteur innove aussi jusqu'à un
certain point, en ce qu'il place après l'exorde ,
non la narration, mais la proposition, vraisemblablement
parce qu'il regarde la proposition
comme le genre, et la narration comme
l'espèce, et qu'il croit qu'on peut quelquefois se
passer de celle-ci, jamais et nulle part de celle-là.
Mais je ne prétends pas que la pensée de l'orateur
s'asservisse à ces cinq parties que nous venons
d'établir, dans l'ordre qu'il doit observer en
parlant. Avant tout, il faut considérer quel est
le genre de la cause, quelle est la question, ce
qui peut lui être avantageux, ce qui peut lui
nuire; ensuite, ce qu'il importe de confirmer et
de réfuter; puis, la manière de narrer, car l'exposition
prépare la confirmation, et ne peut être
utile qu'autant que l'orateur sait d'avance ce
qu'il peut prélever sur les preuves : enfin il faut
considérer comment on se conciliera l'esprit du
juge; car ce n'est qu'après avoir étudié soigneusement
et à fond toutes les parties de la cause,
qu'on peut savoir dans quelles dispositions il faut
mettre le juge, s'il faut le rendre sévère ou indulgent,
passionné ou de sang-froid, intraitable ou
facile. Ce n'est pas pour cela que j'approuve
ceux qui veulent qu'on ne compose l'exorde
qu'en dernier; car de même qu'en toute chose,
avant de parler ou d'écrire, il faut avoir bien
médité sa matière et savoir ce qu'elle réclame,
de même il faut débuter par ce qui se présente en
premier. On ne commence pas un portrait ou une
statue par les pieds; aucun art enfin ne trouve
sa consommation dans ce qui fait son commencement.
Et que sera-ce si l'on n'a pas eu, le temps
de rédiger son discours par écrit? Ne se trouvera-
121 t-on
pas en défaut, par suite de cette habitude
d'interversion? Il faut donc méditer sa matière
dans l'ordre que je viens de prescrire, et l'écrire
dans l'ordre que nous observons en parlant.
CHAP. X. Toute cause où l'un se porte pour
demandeur,
et l'autre pour défendeur, roule sur un
seul point litigieux ou sur plusieurs. Dans le premier
cas, la cause est simple; dans le second,
elle est complexe. Un vol, un adultère, donne lieu
à une controverse essentiellement une. Quand la
controverse a plusieurs chefs, ou ces chefs sont
du même genre, comme en matière de concussion;
ou ces chefs sont de genres différents,
comme lorsqu'un homme est accusé à la fois de
sacrilège et d'homicide : ce qui ne se présente
plus dans les jugements publics, parce que le
préteur est déterminé par une loi spéciale pour
chaque chef; outre que le prince et le sénat connaissent
encore d'une foule de causes qui étaient
autrefois soumises à la décision du peuple. Dans
les jugements privés, un même juge peut prononcer
sur plusieurs chefs différents, par suite
des différentes formules dans lesquelles on est
obligé de se renfermer pour intenter une action :
sur quoi il est à remarquer que le nombre des
parties ne multiplie pas les espèces. Ainsi, qu'une
personne intente procès à plusieurs, ou deux à
une, ou plusieurs à plusieurs, pourvu que ce soit
par les mêmes moyens et aux mêmes fins, l'affaire
ne change point de nature. C'est ce qui arrive
souvent dans les procès pour héritages, où
la cause est toujours une malgré le nombre des
parties, à moins que la qualité des personnes ne
différencie les questions.
Il y a un troisième genre de cause, différent
de ceux-ci, et qu'on appelle comparatif, parce
qu'en effet une partie du plaidoyer est employée
à comparer deux personnes ensemble. C'est,
par exemple, lorsque, devant les centumvirs,
après plusieurs questions, on arrive à celle-ci:
Lequel des deux est le plus digne de recueillir une
succession? Je dis devant les centumvirs, parce
qu'il est rare qu'au barreau les jugements n'aient
pas d'autre objet, et que cela n'arrive guère que
dans les divinations, où il s'agit de constituer
un accusateur, ou bien dans les contestations
entre délateurs, quand on recherche: Lequel des
deux a mérité la récompense.
Quelques-uns comptent un quatrième genre,
l'accusation mutuelle ou récrimination,
ἀντικατηγορία.
D'autres veulent que ce genre rentre
dans le troisième, aussi bien que celui où les
parties sont réciproquement demanderesses, ce qui arrive très
souvent. Que si ce dernier genre doit s'appeler aussi
ἀντικατηγορία, car il n'a pas
chez nous de nom qui lui soit propre, il faut le
subdiviser en deux espèces, celle où les parties
s'intentent mutuellement la même accusation,
et celle où elles s'intentent chacune une accusation différente.
J'en dis autant des demandes qu'elles formeront.
Le genre de la cause une fois déterminé, l'orateur
considérera si le fait articulé par l'accusateur est nié,
ou si on prétend le justifier, ou si on veut décliner
l'accusation, soit en donnant un autre nom au fait incriminé,
soit en prétextant que l'action n'a pas été bien intentée. Car
c'est de tout cela que se tire le véritable état de la cause.
CHAP. XI. Après toutes ces considérations, il
faut, suivant Hermagoras, examiner ce que c'est
que question, moyen de défense, point à juger,
point fondamental de la cause, συνέχον.
Question, dans son sens le plus étendu, veut
dire tout ce qui peut donner lieu à deux ou plusieurs
opinions vraisemblables. Mais, dans les
122
matières judiciaires, ce mot a deux acceptions :
l'une, quand nous disons que telle controverse
renferme beaucoup de questions, sans égard à
leur importance; l'autre, quand nous voulons
désigner la question principale, sur laquelle
roule toute la cause. C'est de celle-ci que je parle
maintenant, comme étant celle d'où naît l'état
de la cause : Le fait est-il constant? quel est-il?
est-il juste? Voilà ce qu'Hermagoras, Apollodore,
et beaucoup d'autres, appellent proprement questions,
et que Théodore, ainsi que je l'ai dit, appelle chefs généraux,
comme il appelle chefs spéciaux les questions d'un ordre
secondaire, ou dépendantes des questions principales;
et en effet, tout le monde convient qu'une
question peut donner naissance à une autre question,
une espèce à une autre espèce. Or, c'est à
cette question, d'où naissent toutes les autres,
que les rhéteurs donnent le nom de ζήτημα.
Par moyen, on entend tout ce qui sert à justifier
un fait avéré. Et pourquoi ne me servirais-je pas
d'un exemple dont se sont servis la plupart
des auteurs? Oreste a tué sa mère: le fait
est constant. Il soutient qu'il l'a tuée justement :
l'état sera la qualité. Question: L'a-t-il tuée justement?
Oui, parce que Clytemnestre avait tué
son mari, père d'Oreste : c'est le moyen de défense,
αἴτιον. Mais un fils est-il en droit de tuer
sa mère, fût-elle coupable? voilà le point à juger,
κρινόμενον. Quelques rhéteurs ont vu une différence
entre αἴτιον et αἰτία, prétendant que l'un
signifiait le motif de la mise en jugement, comme
le meurtre de Clytemnestre; l'autre qui sert à
justifier le fait, comme le meurtre d'Agamemnon.
Mais on est si peu d'accord sur la signification de ces mots,
que les uns entendent par αἰτία le motif de la mise en jugement,
et par αἴτιον le moyen de défense, et que les
autres entendent le contraire. Chez nous, les uns ont traduit ces
mots par initium, commencement, ratio, raison, moyen; les autres leur
ont donné un seul et même nom. Une cause
peut naître aussi d'une autre cause, αἴτιον ἐξ
αιτίου, par exemple : Clytemnestre a tué Agamemnon,
parce que celui-ci avait immolé
Iphigénie, leur fille, et parce qu'il ramenait de
Troie une concubine. Les mêmes auteurs, auxquels
j'emprunte ces exemples, croient qu'à une
seule question peuvent être opposés plusieurs
moyens de défense, si, par exemple, Oreste allègue
une autre raison du meurtre de sa mère,
disant qu'il y a été poussé par les oracles. Or,
disent-ils, autant de raisons du fait, autant de
points à juger. Car celui-ci se présente aussitôt :
Oreste devait-il obéir aux oracles? Pour moi,
je crois même qu'une seule raison du fait peut
faire naître plusieurs questions et plusieurs points
à juger. Par exemple, un homme surprend sa
femme en adultère, et la tue; le complice prend
la fuite, mais le mari le rejoint sur la place publique
et le tue aussi : la raison du fait est une :
Je l'ai surpris en adultère. - Mais vous était-il
permis de le tuer en tel temps, en tel lieu?
questions et points à juger. Mais de même que,
malgré le nombre des questions et des états de
questions, il n'y a jamais qu'un seul état de
cause auquel tout se rapporte, de même il n'y
a jamais qu'un seul point proprement dit sur
lequel on ait à prononcer.
Le point fondamental de la cause,
συνέχον, qui, comme je l'ai dit, est appelé
par les uns continens, contenant, et par les autres firmamentum,
fondement, est défini, par Cicéron, le plus
solide argument du défendeur, et le point le plus
123
propre à déterminer le juge. Les uns veulent
que ce soit le point au delà duquel il n'y a plus
rien à chercher; selon d'autres, c'est ce qu'il y a
de plus solide dans une cause.
Toutes les causes ne comportent pas toujours
le moyen de défense fondé sur la raison du fait.
Car, où le fait est nié, qu'importe la raison du
fait? Mais on prétend que, lors même que la raison
du fait est discutée, le point à juger ne repose
pas sur la question; et Cicéron le dit positivement
dans ses livres de rhétorique et dans ses partitions.
En effet, selon lui, dans les causes dont
l'état est conjectural, tout consistant à savoir si
le fait a eu lieu ou n'a pas eu lieu, la question
et le point à juger ne font qu'un, parce que la
première question fait tout le procès. Mais dans
les causes dont l'état est de qualité : Oreste a tué
sa mère; - il a bienfait, - il a mal fait; -
a-t-il bienfait? voilà la question, mais ce n'est
point encore le point à juger. Où est-il donc?
Elle avait tué mon père; - mais vous ne deviez
pas pour cela tuer votre mère; - le devait-il?
voilà le point à juger. Quant au point fondamental,
il le place dans ce que pourrait dire Oreste
pour se justifier : Clytemnestre était animée de
sentiments si indignes d'une épouse, d'une
mère, du trône, du nom et de la race d'Agamemnon,
que c'était un devoir pour ses propres
enfant de la punir de ses crimes. Voici d'autres
exemples, qu'on cite encore : La loi dit : Que
celui qui a dissipé le bien qu'il avait hérité de
son père, soit exclu de la tribune. Mais l'accusé
s'est ruiné à faire bâtir des édifices publics.
La question sera: Quiconque a dissipé son héritage
doit-il être exclu? et le point à juger :
Celui qui l'a dissipé de cette manière est-il dans
le cas de la loi: Un soldat de l'armée de Marius
avait tué le tribun C. Lusius, qui voulait attenter
à son honneur: Était-il en droit de le tuer? voilà
la question. - Oui, parce que ce tribun lui avait
fait violence : voilà le moyen de défense. -
Avait-il le droit de se faire justice à lui-même?
un soldat peut-il jamais avoir le droit de tuer
un tribun? Voilà le point à juger. Selon d'autres
rhéteurs, la question et le point à juger diffèrent
tellement, qu'ils ont chacun un état à part. Milon
a-t-il tué Clodius justement? C'est une question
de qualité. - Clodius avait-il dressé des embûches
à Milon? C'est un point à juger, qui appartient à la conjecture.
Ils ajoutent que la cause s'égare souvent dans
des considérations étrangères à la question, et
sur lesquelles il faut néanmoins que le juge prononce.
Je ne suis pas de leur avis; car cette
question : Tous ceux qui ont dissipé l'héritage
paternel doivent-ils être exclus de la tribune,
veut nécessairement avoir sa décision. La question
n'est donc pas autre que le point à juger,
mais il y a plusieurs questions et plusieurs points
à juger. Je dis plus : dans l'affaire de Milon, la
conjecture n'est même traitée que par rapport à
la qualité, puisque, s'il est vrai que Clodius ait
dressé des embûches à Milon, il s'ensuit que Milon
a eu le droit de le tuer. Mais si l'orateur se
jette dans quelque digression, et s'écarte de la
question qui avait d'abord été posée, alors la
question sera précisément où est le point à juger.
Cicéron lui-même se contredit un peu dans
tout cela. Dans ses livres de rhétorique, il suit,
comme je l'ai dit, Hermagoras; et dans ses Topiques,
il dit que le point à juger, κρινόμενον, est la
contestation qui naît de l'état de la cause; et, faisant
allusion à un mot habituel de Trébatius,
jurisconsulte de son temps, il appelle ce point-là,
ce dont il s'agit. A l'égard de ce qui contient ce
point à juger, il l'appelle contenant, fondement
de la défense, ce sans quoi la défense est nulle.
Au contraire, dans ses Partitions oratoires, il
124
appelle point fondamental ce qui est opposé au
moyen de défense; il dit, en effet, que le contenant
est ce qui est articulé en premier par l'accusateur;
qu'ensuite vient le moyen de défense
de l'accusé, et que c'est de la question qui naît
du moyen de défense et du point fondamental,
que résulte le point à juger. Je crois donc qu'il
est plus vrai et plus court de dire, avec certains
auteurs, que l'état de la cause, le point fondamental
et le point à juger, ne sont qu'une même
chose. Ils entendent par point fondamental ce
qui constitue l'essence même du procès. Par là
ils réunissent ces deux raisons du fait, dont j'ai
parlé plus haut : celle du meurtre de Clytemnestre,
dont on accuse Oreste, et celle du meurtre
d'Agamemnon, dont Oreste accuse Clytemnestre.
Ces mêmes auteurs pensent que l'état de la cause
et le point à juger conspirent toujours au même
but, et ils ne pourraient penser autrement sans
se contredire.
Mais laissons ces subtilités à ceux qu'une
vaine prétention rend esclaves des mots. Pour
moi, je n'ai rapporté cette nomenclature que pour
prouver le soin que j'ai mis dans les recherches
qu'exigeait mon traité. Un maître, qui fuit toute
affectation dans l'enseignement, ne voit pas la
nécessité de morceler aussi minutieusement les
préceptes. Ç'a été le défaut de beaucoup de rhéteurs,
et notamment d'Hermagoras, écrivain rempli
d'ailleurs de sagacité, et admirable dans beaucoup
de parties, auquel on ne peut reprocher
qu'un soin trop scrupuleux; reproche qui ne laisse
pas de faire en même temps son éloge.
La méthode que je suis ici, plus courte que
les autres et par là même plus claire, ne fatiguera
point l'élève par de longs détours, et n'énervera
pas le corps du discours, en le partageant en une
infinité d'articles de nulle conséquence.
En effet, une fois que l'orateur aura reconnu
le point litigieux de la cause, les prétentions et
les moyens des deux parties (et c'est là ce qu'il
doit surtout bien s'attacher à connaitre), il saura
implicitement tout ce qui compose les préceptes
détaillés que nous avons rapportés. Est-il quelqu'un,
à moins qu'il ne soit dépourvu de sens et
tout à fait étranger aux débats judiciaires, qui
ne sache ce qui fait l'objet d'un procès (c'est-à-dire
la cause ou le point fondamental, selon les
termes de l'art, quelle est la question qui divise
les parties), et quel est le point sur lequel les
juges ont à prononcer? Or ces trois choses reviennent
à la même. Car qu'est-ce que la question?
C'est ce qui est en litige. Sur quoi prononce-t-on?
Sur la question. Mais nous n'avons pas toujours
l'esprit fixé sur cela : entraînés par le désir
de briller, de quelque manière que ce soit, ou
par le plaisir de discourir, nous sortons de notre
sujet. C'est que, hors de la cause, la matière
est toujours plus abondante : le sujet a des bornes
étroites; hors du sujet, le champ est libre et spacieux;
ici, on dit tout ce qu'on veut; là, on dit
seulement ce que veut le sujet. Ce qu'il faut donc
recommander à l'orateur, ce n'est pas tant de
découvrir la question, le point fondamental, car
c'est chose aisée, que d'avoir toujours les yeux
fixés sur son sujet, ou du moins, s'il s'en écarte,
de ne point le perdre de vue, de peur qu'en courant
après les applaudissements, ses armes ne
lui échappent.
L'école de Théodore réduit tout, comme je
l'ai dit, à des chefs. Par ce terme on entend plusieurs
choses : premièrement, la question principale,
ou l'état; secondement, les autres questions
qui se rapportent à la question principale;
troisièmement, la proposition accompagnée de
ses preuves, dans le sens de cette formule, le
chef de l'affaire est, et, comme dans Ménandre,
κεφάλαιον ἐστὶν. En général, ce qui a besoin d'être
125
prouvé est un chef, mais tantôt plus important, tantôt moins.
J'ai rapporté, et peut-être avec trop de détails,
ce qui est enseigné sur tout ceci par les maîtres
qui ont écrit sur la rhétorique; j'ai fait connaître,
en outre, les parties dont se compose une
cause judiciaire: je vais maintenant les reprendre,
en commençant par l'exorde. Ce sera la matière du livre suivant.
|