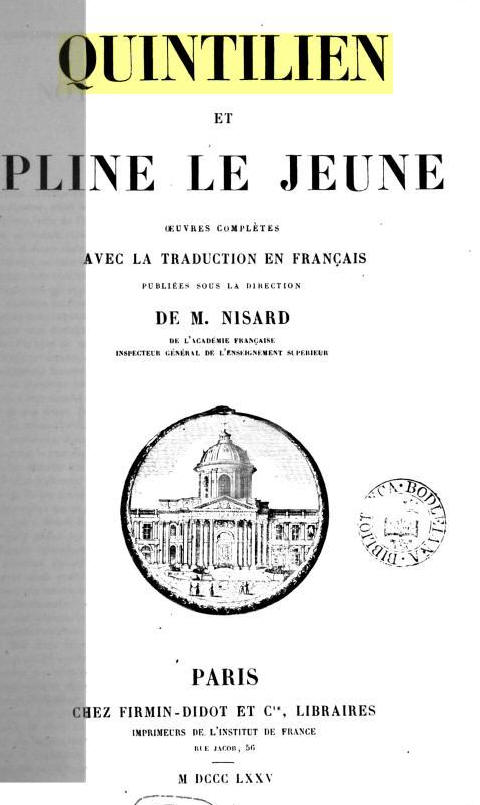LIVRE XI.
ARGUMENT.
Ch. l. PRÉFACE. Des convenances oratoires — II. de
la mémoire. — III. De la prononciation.
CH I. Après avoir acquis, comme je
l'ai enseigné dans te livre qui précède, la faculté d'écrire, de
méditer, et d'improviser même, lorsque l'occasion le demande, le
premier soin est d'apprendre à parler avec convenance.
Cicéron démontre que cette qualité est la quatrième de l'élocution ;
et, selon moi, c'est la plus nécessaire; car les ornements de
l'oraison étant variés et multiples, et convenant les uns à un
genre, les autres à un autre, il est évident que, s'ils ne sont pas
appropriés aux personnes et aux choses, nonseulement ils
n'embelliront pas l'oraison, mais ils contribueront même à en
détruire l'effet, et l'énerveront au lieu de lui donner de la force.
A quoi sert que les mots soient corrects, expressifs, brillants,
figurés même et nombreux, s'ils ne sont pas en harmonie avec les
choses que nous voulons persuader au juge? si, par exemple, notre
style est sublime dans les petites causes, humble et mince dans les
grandes; si nous donnons à la tristesse l'accent de la joie ; si
nous substituons la douceur à la rudesse, la menace à la prière, la
modération à l'emportement, la violence farouche à la politesse?
C'est ainsi que des robes traînantes, des colliers, des perles,
rehaussent la beauté des femmes, et enlaidissent les hommes; et que
l'habit triomphal, qui est ce qu'on peut imaginer de plus auguste,
enlaidirait les femmes.
Cicéron touche légèrement ce point
dans le troisième livre de son traité de Oratore, quoiqu'il
semble n'avoir rien omis en disant que le même genre de style ne
convient ni à toute sorte de causes, ni à toute sorte d'auditeurs,
ni à toutes les personnes, ni à tous les temps; et, dans son
livre intitulé Orator, il exprime la même pensée, presque en
aussi peu de mots. C'est que, dans le premier traité, L. Crassus,
s'adressant à des personnages aussi instruits qu'éloquents, ne croit
pas devoir appuyer sur ce qu'ils savent aussi bien que lui ; et que,
dans le second, Cicéron parlant à Brutus témoigne que, sur ce point,
il ne peut rien dire que celui-ci ne connaisse, et qu'en conséquence
il ne fera qu'effleurer la matière, quoiqu'elle soit vaste, et
qu'elle ait été traitée fort au long par les philosophes. Pour moi,
qui fais profession d'enseigner, et qui m'adresse non seulement à
ceux qui savent, mais encore à ceux qui apprennent, on me permettra
de n'être pas aussi succinct.
Appliquons-nous donc à bien connaître,
avant tout, ce qu'il faut faire pour plaire au juge, pour l'instruire,
pour l'émouvoir, et ce que nous nous proposons dans chaque partie de
l'oraison. Avec cette précaution, nous ne serons pas exposés à
employer dans l'exorde, dans la narration, dans l'argumentation, des
mots surannés, ou métaphoriques, ou trop nouveaux; ni à arrondir
d'élégantes périodes dans la division et dans la partition; nous
saurons que la péroraison n'admet ni un langage bas et familier, ni
une composition relâchée ; et nous nous garderons bien, quand il
s'agira d'attendrir le juge, de sécher ses larmes par des
plaisanteries. Car les ornements sont tels, moins par eux-mêmes que
par l'application qu'on en fait; et il n'importe pas plus que ce
qu'on dit soit bien dit, qu'il n'importe que ce qu'on dit soit à sa
place. Mais l'art de parler avec convenance ne tient pas
moins à l'invention qu'à l'élocution; car si les mots
ont tant d'importance, combien plus les choses? Or, ce qu'il faut
observer à l'égard des choses, je n'ai pas manqué de l'expliquer en
son lieu.
Ce que je ne saurais enseigner avec
trop de soin, c'est que celui-là seul parle avec convenance, qui
consulte non seulement l'utilité, mais encore le devoir.
Je n'ignore pas que ces deux motifs sont le plus souvent confondus;
car il est rare que ce qui est conforme au devoir ne soit pas utile,
et rien ne contribue plus à nous concilier ou à nous aliéner le
juge, que l'opinion bonne ou mauvaise qu'il a de notre vertu.
Quelquefois cependant ces deux principes sont incompatibles; mais
alors il faut préférer le devoir à l'intérêt. Qui ne sait, par
exemple, que Socrate avait tout à espérer de ses juges, s'il eût
voulu recourir à la défense ordinaire de tous les accusés, et se
concilier le tribunal par un plaidoyer humble et soumis; si, enfin,
il eût pris la peine de se débattre? Mais ce genre de défense était
indigne de lui, et il plaida sa cause en homme qui se jugeait
passible des plus grands honneurs; il aima mieux, ce sage par
excellence, perdre ce qui lui restait à vivre, pour conserver ce
qu'il avait vécu. Voyant qu'il n'avait rien à attendre du jugement
de ses contemporains, il s'en remit à celui de la postérité, et, au
prix de quelques jours d'une vieillesse déjà avancée, il acheta une
vie immortelle. Aussi, quoique Lysias, qui passait alors pour le
plus habile orateur, lui eût apporté une défense écrite, il ne
voulut pas s'en servir, non qu'il ne la trouvât bonne, mais parce
qu'elle lui parut peu conforme à son caractère : ce qui prouve, pour
m'en tenir à ce seul exemple, que la fin de l'orateur est de bien
dire, et non de persuader, puisqu'il est quelquefois honteux de
persuader. Cette conduite nuisit à l'accusé; mais, ce qui est plus
important, elle fut utile à l'homme. Aussi est-ce pour me conformer
aux habitudes du langage plutôt qu'à l'exacte vérité, que, par une
sorte de division, je distingue l'utilité du devoir, à moins qu'on
ne trouve que le premier des Scipions entendit mal ses intérêts
quand il se résigna à s'expatrier, plutôt que de contester de son
innocence avec un obscur tribun du peuple; ou que P. Rutilius ne
savait pas ce qui lui était le plus expédient, soit lorsqu'il se
défendit presque à la manière de Socrate, soit quand il aima mieux
rester en exil que de déférer à l'invitation de Sylla qui le
rappelait. C'est que, aux yeux de ces grands hommes, ce que les âmes
abjectes regardent comme utile n'est digne que de mépris, si on le
compare avec la vertu : aussi sont-ils devenus l'éternel objet de
l'admiration des siècles. Sachons, à leur exemple, porter plus haut
nos pensées, et ne traitons pas d'inutile ce que nous estimons
louable. Au reste, cette distinction, quelle qu'elle soit, a très
rarement lieu; et, comme je l'ai dit, dans presque toute espèce de
cause, l'intérêt et le devoir sont inséparables.
Or, il est des choses que tout le
monde peut honnêtement faire et dire en tout temps et partout, comme
il en est que personne ne peut faire et dire sans honte, en aucun
lieu ni en aucun temps; mais il en est d'autres, et en très grand
nombre, qui, moins importantes, tiennent le milieu, pour ainsi dire,
entre le bien et le mal, et dont la nature est telle, que les uns
peuvent se les permettre, et que les autres ne le peuvent pas; ou
que, selon la personne, le temps, le lieu, le motif, on doit plus ou
moins excuser, plus ou moins blâmer. Et comme, en plaidant, nous
parIons ou pour autrui ou pour nous-mêmes, il faut avoir égard à
cette distinction, pourvu que nous sachions que, dans l'un et
l'autre cas, il est une infinité de choses que la bienséance nous
interdit.
Et d'abord il ne sied jamais à
personne de se glorifier, mais un orateur surtout a mauvaise grâce à
vanter son éloquence. Le dégoût, et très souvent l'aversion, sont le
prix de cette jactance; car nous avons naturellement une certaine
fierté, qui nous rend impatients de toute supériorité : aussi
élevons-nous volontiers les petits ou ceux qui se font tels, parce
qu'en les élevant nous avons l'air d'être plus grands qu'eux, et
que, dès qu'on ne sent plus la présence d'un rival, le coeur s'ouvre
à la bienveillance. Ceux, au contraire, qui s'élèvent outre mesure,
semblent vouloir nous rabaisser avec mépris, et moins songer à se
faire grands qu'à nous faire petits. De là l'envie dans les
inférieurs, car l'envie est le vice ordinaire de ceux qui ne veulent
rien céder, quoique incapables de rien disputer; les hommes
supérieurs rient de cette jactance, et les bons la désapprouvent.
Ajoutez à cela que la plupart du temps la vanité est dupe
d'elle-même; mais, eût-on même un véritable mérite, la conscience de
ce mérite ne doit-elle pas suffire? Cicéron n'a pas été peu blâmé
sur ce point, quoique, dans ses oraisons, il ait plutôt vanté ses
actions que son éloquence ; et il faut convenir qu'à l'égard de ses
actions, il a eu quelque raison de le faire, soit pour défendre ceux
qui l'avaient aidé à étouffer la conjuration de Catilina, soit pour
se défendre lui-même contre l'envie, dont pourtant il ne put
triompher, puisqu'on l'envoya en exil pour le punir d'avoir sauvé la
patrie : de sorte qu'on peut croire qu'en parlant si souvent de son
consulat, il cédait moins à un sentiment de vanité qu'au besoin de
se défendre. Quant à l'éloquence, en même temps qu'il rendait sous
ce rapport pleine justice à ses adversaires, jamais, en plaidant, il
ne parla de la sienne avec trop de jactance : témoin ce passage : «
S'il y a en moi quelque talent, et je sens combien j'en ai peu...
» et cet autre : « Plus j'ai senti mon insuffisance, plus j'ai
cherché à y suppléer par mon application. » Bien plus, quand il
disputa à Q. Cécilius l'accusation de Verrès, quoiqu'il fût
important de faire voir qui des deux était le plus capable de porter
la parole contre ce préteur, il s'attacha plutôt à déprécier
l'éloquence de Cécilius qu'à exalter la sienne, disant
« qu'à la vérité, il n'avait
pas non plus les qualités requises, mais qu'il avait tout fait pour
les acquérir » . Ce n'est donc que dans ses lettres, et dans les
épanchements de l'amitié, qu'il dit librement ce qu'il pense de son
éloquence, quelquefois dans ses dialogues, et là même encore, sous
le nom d'un autre. Je ne sais, au reste, si cette jactance n'est pas
plus supportable dans sa naïveté, que la modestie hypocrite de ces
gens qui se disent pauvres, quand ils regorgent de biens; obscurs,
avec un rang illustre; sans crédit, quand on sait qu'ils peuvent
tout; tout à fait novices, avec une grande réputation de savoir et
d'éloquence : car c'est un jeu de la vanité et des plus ambitieux,
que de se rapetisser ainsi.
Laissons donc aux autres le soin de
nous louer; car, pour nous, comme dit Démosthène, nous devons
rougir, même lorsque ce sont les autres qui nous louent. Ce n'est
pas qu'un orateur ne puisse quelquefois parler de ce qu'il a fait,
comme il est arrivé à Démosthène, plaidant pour Ctésiphon; encore
sut-il y mettre tant de délicatesse, qu'il parut céder à la
nécessité, et qu'il en fit retomber tout l'odieux sur Eschine.
Cicéron parle souvent aussi de ses succès contre la conjuration de
Catilina; mais c'est pour les attribuer, tantôt à la fermeté du
sénat, tantôt à la providence des dieux. Il est vrai qu'en répondant
à ses ennemis et à ses détracteurs, il ne se montre pas toujours
aussi modeste; mais c'est qu'alors il avait à justifier les actes
qu'on lui reprochait. Il serait à souhaiter qu'il se fût tenu plus
en garde contre la vanité, et qu'il n'eût pas donné prise à la
malignité par ces vers :
Cedant arma togae, concedat laurea linguae...
O fortunam natam me consule Romam!
et par cette fiction de Jupiter qui
lui ouvre l'Olympe, et cette autre de Minerve qui lui
enseigna elle-même les arts. C'est une petite satisfaction
d'amour-propre qu'il crut pouvoir se permettre, à l'exemple de
quelques Grecs. Mais s'il sied mal à un orateur de se targuer de son
éloquence, il lui est permis quelquefois de témoigner une noble
confiance en lui-même. Qui blâmerait, par exemple, ce passage des
Philippiques: « Que croirai-je ? que je suis méprisé? Mais je ne
vois ni dans ma vie, ni dans la considération dont je jouis, ni dans
ce que j'ai fait, ni dans la médiocrité de mon esprit, rien qui
puisse m'attirer le mépris d'Antoine; » et ce que le même
orateur dit peu après et même plus ouvertement : « A-t-il eu la
prétention de lutter d'éloquence avec moi? Certes, je l'en remercie;
car quelle matière plus abondante et quel plus beau champ pouvais-je
souhaiter, que d'avoir à parler et pour moi-même et contre Antoine?
» Il y a aussi de l'arrogance à avancer qu'on s'est porté juge de sa
cause, qu'elle est bonne, et qu'autrement on ne s'en serait pas
chargé. Les juges écoutent avec défaveur un avocat qui empiète ainsi
sur leur ministère ; et nul orateur ne doit se flatter de trouver
dans ses adversaires le respect religieux des disciples de
Pythagore, que ce seul mot réduisait au silence : « Le maître l'a
dit » . Au reste, ce défaut est plus ou moins choquant, suivant le
caractère des personnes qui parlent; car on le pardonne quelquefois
à l'âge, à la dignité, à l'autorité. Mais en qui ces considérations
peuvent-elles jamais être d'un assez grand poids pour que ce ton
affirmatif puisse se passer d'adoucissement? Il en est de même de
toutes les circonstances où l'orateur tire ses preuves de sa propre
personne. Aurait-on été fondé à taxer Cicéron d'orgueil, s'il eût
objecté que la qualité de fils de chevalier romain ne pouvait être
la matière d'un grief sérieux dans une cause où il défendait celui à
qui on reprochait cette qualité? Non, sans doute, et pourtant
Cicéron aima mieux tirer de là l'occasion de se rendre agréable aux
juges : « En vérité, les accusateurs n'auraient pas dû chercher
le sujet d'un reproche dans la qualité de fils de chevalier romain,
nous ayant, vous, pour juges, et moi, pour adversaire » .
Il ne sied à personne de prendre en
plaidant un ton hautain, tumultueux, emporté; mais cela est encore
plus répréhensible chez ceux que l'âge, la dignité, l'expérience,
doivent rendre plus circonspects. Il est cependant des gens d'une
humeur tellement querelleuse, que rien ne peut les retenir, ni le
respect qu'on doit aux juges, ni les usages et les bienséances du
barreau; et ces avocats sans tenue ne font que trop voir par là
qu'ils ne prennent rien en considération, soit en se chargeant d'une
cause, soit en la plaidant. Car d'ordinaire notre langage trahit nos
moeurs, et découvre le fond de notre âme; et rien n'est plus sensé
que cette maxime des Grecs : Chacun parle comme il vit. Voici
des défauts encore plus avilissants, l'adulation basse, la
bouffonnerie affectée, le mépris de toute pudeur et de toute
modestie dans les mots et les pensées, l'oubli de sa propre dignité
en toutes choses : défauts où tombent d'ordinaire ceux qui
s'étudient trop à flatter ou à faire rire.
Le même genre d'éloquence ne sied pas
non plus à tout le monde. Une élocution riche, fière, hardie,
soigneusement parée, convient moins à un vieillard qu'une élocution
serrée, douce, précise, et conforme à celle dont Cicéron a voulu
donner l'idée, en disant que son éloquence commençait à blanchir.
C'est ainsi que des vêtements où brillent la pourpre et l'écarlate
ne sont plus de mise à cet âge. Un peu de surabondance et de
témérité ne déplaît pas dans les jeunes gens; et, au contraire, une
élocution sèche, circonspecte, châtiée, accuse une affectation de
sévérité, qui est d'ordinaire mal accueillie, puisque le sérieux des
personnes avancées en âge est même regardé comme une chose qui n'est
pas de saison dans la jeunesse. Une éloquence simple est celle qui
convient aux hommes de guerre. Quant à ces gens, comme on en voit
quelques-uns, qui font profession de philosophie, il leur siérait
mal de rechercher la plupart des ornements oratoires, et
particulièrement ceux qui ont leur principe dans ces mouvements de
l'âme, qui, à leurs yeux, sont autant de vices. Leur sublime
ministère exclut de même l'élégance du style et l'harmonie de la
composition. Ainsi, n'attendez d'eux ni ces traits d'une éloquence
gracieuse et fleurie, comme celui-ci, qu'on trouve dans Cicéron :
Les rochers et les déserts répondent à la voix du poète; ni même
des traits d'une éloquence plus mâle, comme cette apostrophe du même
orateur : Tombeaux et bois sacrés des Albains, et vous, autels
aussi anciens et aussi sacrés que les autels de la patrie, vous que
sa fureur a renversés, c'est vous que j'implore et que j'atteste.
Tout cela est indigne de leur barbe et de leur austérité. Mais
l'homme d'État, le citoyen, qui, méprisant d'oiseuses disputes, se
consacre à l'administration des affaires publiques, pour lesquelles
ces prétendus philosophes ont une si dédaigneuse répugnance, le vrai
sage enfin, n'hésitera pas à employer ce que veut la fin de
l'éloquence, bien résolu toutefois à ne jamais rien persuader que
d'honnête. Le prince a ses privilèges; il y a aussi un genre
d'éloquence en quelque sorte à part pour les généraux et les
triomphateurs. Ainsi Pompée était suffisamment disert dans le récit
de ses exploits, et Caton d'Utique a été un sénateur éloquent.
Souvent le même langage aura une acception différente, suivant le
caractère des personnes : dans l'une, ce sera franchise; dans
l'autre, folie ou orgueil. Les reproches que Thersite fait à
Agamemnon ne sont que ridicules; mettez-les dans la bouche de
Diomède, ou de quelqu'un de ses pareils, ce seront les accents d'une
courageuse indépendance. Tu veux que je voie en toi un consul,
dit L. Crassus à Philippe, quand tu ne veux pas voir en moi un
sénateur! voilà le langage d'une noble franchise ; cependant il
ne conviendrait pas à tout le monde. Un certain poète a dit de César
: Peu m'importe, César, que tu sois blanc ou noir; c'est de
la démence : si César en eût dit autant du poète, le mot n'eût été
qu'arrogant.
C'est surtout dans la tragédie et la
comédie qu'il importe d'observer la convenance, à cause du grand
nombre et de la variété des personnages. La même fidélité était
jadis un des devoirs de ceux qui composaient des plaidoyers que les
accusés prononçaient eux-mêmes; elle n'est pas moins nécessaire à
nos déclamateurs, qui ne parlent pas toujours comme avocats, mais le
plus souvent comme parties. Et même, jusque dans les causes où nous
ne sommes qu'avocats, nous devons observer soigneusement les lois de
la convenance ; car nous introduisons souvent des personnages que
nous faisons parler, ou, plutôt, par la bouche de qui nous parlons,
et nous devons par conséquent nous identifier à leur caractère comme
à leur langage. En effet, nous ne ferons point parler P. Clodius
comme Appius l'aveugle, ni un père de la comédie de Cécilius comme
un père de la comédie de Térence. Quelle dureté dans cette réponse
du licteur de Verrès : Pour le voir, c'est tant! Quelle force
dans l'exclamation de cet infortuné qui, sous les coups de fouet, ne
fait entendre que ces mots : Je suis citoyen romain! Voyez
comme le même orateur, jusque dans la péroraison, prête à Milon un
langage digne du citoyen généreux qui, pour l'amour de la
république, a tant de fois réprimé l'audace d'un séditieux, et qui,
par son courage, a triomphé de ses embûches! Enfin, non seulement il
y a autant de variété dans ces prosopopées que dans la cause même ;
mais il y en a d'autant plus que nous faisons agir et parler des
enfants, des femmes, des peuples, et même des choses inanimées : or,
tout cela réclame des convenances. Il en faut aussi à l'égard de
ceux pour qui nous plaidons, et notre langage doit être différent,
selon que notre client est un homme considéré ou obscur, décrié ou
honoré, suivant aussi la différence des principes de conduite et des
antécédents. Quant à l'orateur, rien ne le recommande plus que la
bonté, la douceur, la modération, la bienveillance. Il peut aussi se
rendre agréable par des moyens différents, mais également dignes
d'un homme de bien, en témoignant de la haine pour les méchants, de
la compassion pour les malheurs publies, du zèle pour la répression
des crimes et des injustices; en un mot, par tout ce qui est
honnête, comme je l'ai dit au commencement.
Il importe non seulement de considérer
qui vous êtes et pour qui vous plaidez, mais encore
devant qui; car la fortune et le pouvoir exigent des
distinctions : on ne doit pas parler de la même manière devant le
prince ou un magistrat, devant un sénateur ou un simple particulier;
et les jugements publics demandent un autre ton qu'une contestation
devant arbitres. En effet, autant, dans une affaire capitale, il
sied à un avocat de s'armer de sollicitude et de précaution, et de
mettre en jeu, pour ainsi dire, toutes les machines que la
rhétorique fournit pour l'amplification, autant cet appareil est
vain dans des causes et devant des juges de peu d'importance; et
l'on se moquerait avec raison d'un homme qui ayant à parler, assis,
devant un arbitre, sur une affaire de rien, s'écrierait comme
Cicéron : Non seulement je sens mon âme se troubler, mais je sens
aussi tout mon corps frémir d'horreur. Qui ne sait que la
gravité du sénat demande un genre d'éloquence, et que la légèreté du
peuple en demande un autre? Et cela ne doit pas étonner, puisque
chaque juge en particulier réclame un langage différent, suivant que
ce juge sera grave ou frivole, que ce sera un savant, un homme de
guerre, ou un campagnard; puisqu'on est quelquefois forcé d'abaisser
ou de réduire son langage, pour se mettre à la portée du juge, qui,
sans cela, ne pourrait comprendre ou embrasser ce qu'on lui dit. Il
faut également tenir compte du temps et du lieu. A l'égard du temps,
il est tantôt propice, tantôt fâcheux; tantôt libre, tantôt limité;
et l'orateur doit s'accommoder à tout cela. A l'égard du lieu, il
importe beaucoup de considérer si c'est un lieu public ou privé,
fréquenté ou solitaire, si c'est dans une ville étrangère ou dans la
nôtre, dans un camp ou au barreau; et toutes ces différences veulent
une forme et une mesure particulière d'éloquence. Il en est de cela
comme des autres actions de la vie, qui ne se font pas
indifféremment de la même manière au forum, au sénat, au champ de
Mars, au théâtre, et chez soi; et il est une infinité de choses qui,
quoique irrépréhensibles de leur nature, quelquefois même
nécessaires, passent pour des choses honteuses ailleurs que là où
l'usage les autorise.
J'ai déjà dit que les matières du
genre démonstratif, où l'on ne se propose que de plaire, comportent
beaucoup plus d'éclat et de parure que les matières délibératives et
judiciaires, où tout est actif et contentieux. J'ajouterai qu'il est
des causes dont la nature est telle, que certaines beautés oratoires
du premier ordre y seraient déplacées. Qui pourrait supporter qu'un
accusé en danger de perdre la vie, et ayant à se défendre devant son
vainqueur et son prince, s'amusât à prodiguer les métaphores, les
mots nouveaux ou surannés, les tournures recherchées, les périodes
nombreuses, les pensées brillantes, et toutes les fleurs des lieux
communs? L'accusé ne s'exposerait-il pas par là à perdre aux yeux de
son juge cet air d'anxiété si nécessaire à l'homme qui est en péril,
et à éloigner de lui cette faveur que l'innocence elle-même doit
rechercher, celle de la pitié ? Qui pourrait être touché du sort
d'un homme qu'il verrait, dans une situation aussi critique, aveuglé
par une vaine complaisance pour lui-même, faire un fastueux étalage
de son éloquence? Ne serait-on pas plutôt indigné de le voir, lui
accusé, courir après les mots, s'inquiéter de l'idée qu'on aura de
son esprit, et trouver le temps de faire de belles phrases? C'est ce
que M. Célius me paraît avoir admirablement fait entendre, et en peu
de mots, dans le plaidoyer qu'il prononça pour lui-même, accusé de
voies de fait : De peur, dit-il, qu'aucun de vous, ni aucun de
mes accusateurs, ne trouve quelque chose d'offensant dans l'air de
mon visage, ou de violent dans mes paroles, ou, ce qui serait trop
encore, de peu mesuré dans mes gestes, etc. Il y a même certains
plaidoyers qui consistent entièrement en satisfaction, déprécation,
ou confession. Or, est-ce avec de petits traits d'esprit qu'on fera
pleurer le juge? Est-ce avec des épiphonèmes et des enthymèmes qu'on
le fléchira? Est-ce que tout ce qu'on ajoutera au pur langage des
sentiments n'en détruira pas toute la force; et la sécurité de
l'accusé ne fera-t-elle pas tomber la pitié du juge? Supposons qu'un
père ait à demander justice du meurtre de son fils, ou d'un outrage
plus insupportable encore que la mort ? Ce père cherchera-t-il à
donner à son récit cette grâce de l'exposition qui naît de la pureté
et de la clarté du langage, content de présenter les choses, comme
elles se sont passées, d'une manière brève et significative?
distinguera-t-il ses preuves en les comptant sur ses doigts?
s'étudiera-t-il à distribuer avec netteté ses propositions et ses
divisions, et parlera-t-il sans passion, sans chaleur, comme cela se
fait le plus souvent dans cette partie du plaidoyer? Où était,
pendant ce temps, sa douleur? Où étaient ses larmes? D'où lui est
venu, pour prendre leur place, cette tranquille observation des
règles? Son plaidoyer ne sera-t-il pas plutôt d'un bout jusqu'à
l'autre un long gémissement et son visage ne sera-t-il pas toujours
empreint de la même tristesse, s'il veut faire passer sa douleur
jusque dans l'âme des juges? car, s'il s'en relâche un instant, il
tentera vainement de les y ramener. Ces convenances veulent être
observées particulièrement dans les déclamations; car rien de ce qui
regarde l'instruction de la jeunesse ne saurait me paraître étranger
à mon sujet. Et, en effet, dans les fictions de l'école, les
sentiments des personnages sont beaucoup plus variés, et ce n'est
pas comme avocats, mais comme parties, que nous les éprouvons :
outre qu'il est d'usage de supposer,par exemple, un malheureux qui
demande au sénat la permission de se donner la mort, soit à la suite
de quelque grande infortune, soit pour expier quelque crime. Or,
dans un sujet de cette nature, il est contraire à la convenance non
seulement de chanter, quoique ce défaut soit accrédité, ou de parler
d'un ton folâtre, mais même d'argumenter, à moins qu'on ne mêle le
sentiment au raisonnement, et encore de telle sorte que ce soit le
sentiment qui domine : car quiconque peut, en plaidant, suspendre sa
douleur, a bien l'air de pouvoir s'en débarrasser tout à fait. Je ne
sais même si la convenance, dont je parle, ne doit pas être encore
plus scrupuleusement observée à l'égard de ceux contre lesquels on
parle. Certainement ce qui doit être notre premier soin dans toute
accusation, c'est d'éviter de paraître avoir saisi avec empressement
l'occasion de se porter accusateur. Aussi, cette parole de Cassius
Sévérus ne me déplaît-elle pas médiocrement: Grands dieux, je
vis, et je vous en rends grâces, puisqu'il m'a été donné de voir
Asprenas accusé ! Ne semble-t-il pas que s'il l'a pris à partie,
c'est moins par des motifs fondés sur la justice ou la nécessité,
que pour le plaisir de se porter son accusateur? Indépendamment de
cette loi de convenance, qui est générale, certaines causes exigent
une modération particulière. Ainsi, un fils qui demandera
l'interdiction de son père devra gémir sur son état de maladie; et
réciproquement un père qui citera son fils en justice, quelque
graves reproches qu'il ait d'ailleurs à lui faire, ne laissera pas
de protester qu'il n'a cédé qu'à une douloureuse nécessité : non pas
en peu de mots, mais en donnant à toutes ses paroles un accent de
douleur qui semble partir du fond du coeur. Ainsi, un tuteur mis en
cause par son pupille ne s'emportera jamais contre lui, jusqu'à ne
laisser apercevoir aucune trace de tendresse dans ses
récriminations, ni aucun respect pour la mémoire sacrée du père.
J'ai dit, je crois, dans le septième livre, comment un fils doit
plaider contre son père qui le renonce, un mari contre sa femme qui
l'accuse de mauvais traitements; le quatrième livre, où j'expose les
règles de l'exorde, indique même dans quelles circonstances il
convient que ces personnes plaident leur cause elles-mêmes, ou se
servent du ministère d'un avocat.
Que les mots soient susceptibles de
convenance ou d'inconvenance, c'est ce dont personne ne doute. Il ne
me reste donc plus, sur cet article, qu'à enseigner un point, qui
est d'une extrême difficulté : c'est par quels moyens on peut, sans
blesser les bienséances, dire certaines choses qui sont fâcheuses de
leur nature, et qu'on aimerait mieux taire, si l'on en avait le
choix. Quoi de plus odieux, au premier aspect, et qui répugne plus à
entendre, qu'un fils plaidant lui-même, ou par la bouche d'un
avocat, contre sa mère? Et pourtant c'est quelquefois une nécessité,
comme on en peut juger par la cause de Cluentius Habitus; mais on ne
s'y prend pas toujours de la même manière que Cicéron contre Sassia
: non qu'il ne s'en soit pas très bien tiré, mais parce qu'il
importe de considérer en quoi et comment on offense une mère. Quant
à Sassia, comme elle en voulait ouvertement aux jours de son fils,
elle méritait qu'on lui résistât fortement. Il y avait néanmoins
deux points à ménager, et où Cicéron a fait preuve d'un tact
admirable : c'était, premièrement, de ne pas oublier le respect
qu'un fils doit à sa mère; ensuite, de démontrer avec l'exactitude
la plus minutieuse, en reprenant l'affaire d'un peu haut, que ce
qu'il allait dire contre Sassia était non seulement dicté par le
droit de la défense, mais indispensable à la cause. Il commença donc
par cette exposition, quoiqu'elle fût étrangère à la question qui
faisait le fond du procès, tant il était persuadé que, dans une
cause aussi délicate, il devait donner ses premiers soins à ce que
demande la convenance! Ainsi il détourna du fils l'odieux que ce nom
de mère pouvait jeter sur lui, pour le faire retomber sur la mère
elle-même. Cependant une mère peut quelquefois être en procès avec
son fils pour des intérêts moins importants, ou accompagnés de
sentiments moins hostiles. Alors le fils devra prendre un ton plus
doux et plus soumis; car, en se montrant prêt à donner satisfaction,
il diminuera l'odieux dont sa qualité le rendait l'objet, ou même il
le renverra à la partie adverse; et si tout manifeste en lui le
sentiment d'une douleur profonde, il fera croire à son innocence, et
la pitié succédera aisément au premier mouvement d'une prévention
fâcheuse. Il sera aussi très convenable de rejeter l'accusation sur
d'autres, et d'insinuer que la mère obéit à quelque instigation
étrangère, en protestant qu'on endurera tout, qu'on ne se permettra
aucune parole amère : en sorte que, n'eût-on même aucun sujet de
plainte, on ne laissera pas d'avoir en apparence le mérite de la
modération. Et même, en supposant que le fils ait quelque grief à
reprocher à sa mère, le devoir de l'avocat est de faire croire que,
s'il en parle, c'est contre le gré de son client, et seulement pour
ne pas trahir son ministère : de cette manière, l'un et l'autre
pourront s'attirer des louanges. Ce que je dis de la mère doit
s'entendre également du père; car je sais qu'après l'émancipation il
y a souvent eu des procès entre des pères et leurs enfants. A
l'égard des autres parents, ce qu'il faut avoir soin d'observer,
c'est de paraître ne jamais rien dire qu'à regret, que par
nécessité, et qu'avec modération; et cette réserve sera
proportionnée au degré de parenté. Un affranchi aura les mêmes
égards pour son patron; et, pour tout dire en un mot, ne plaidons
jamais contre ces personnes de la manière dont nous serions fâchés
qu'elles plaidassent contre nous.
Nous devons aussi quelquefois, par
déférence pour le rang de notre adversaire, nous justifier de notre
hardiesse, de peur qu'on ne la taxe d'impertinence, ou qu'on n'y
voie un air de fastueuse bravade. C'est pourquoi Cicéron, ayant des
choses très fortes à dire contre Cotta, et ne pouvant même défendre
autrement la cause de P. Oppius, s'excuse néanmoins, dans un long
préambule, sur la rigueur de ses devoirs. Quant aux inférieurs même,
surtout si ce sont des jeunes gens, il sied bien quelquefois de les
ménager, ou de frapper et guérir en même temps. Cicéron nous a donné
l'exemple de cette modération dans son plaidoyer pour Célius contre
Atratinus, où il semble moins le traiter comme un ennemi, que
l'avertir charitablement comme un fils : c'est qu'Atratinus était un
jeune homme qui avait de la naissance, et qu'un ressentiment assez
juste avait porté à accuser Célius. Au reste, quand nous n'avons en
vue que les juges ou les assistants dans le soin que nous prenons
d'observer les convenances, c'est chose assez facile; mais
l'embarras est plus grand quand nous appréhendons d'offenser
personnellement nos adversaires. Cicéron, plaidant pour Muréna, eut
à lutter contre cette difficulté, dans les personnes de M. Caton et
de Servius Sulpicius. Cependant, avec quelle délicatesse, en
accordant à celui-ci toutes les qualités, il lui dénie l'art de
réussir dans la demande du consulat! Sur quel autre point, en effet,
un homme de la naissance de Sulpicius, et d'un aussi grand mérite
comme jurisconsulte, pouvait-il souffrir avec moins de regret de
s'avouer vaincu? Avec quelle dignité il rend compte des motifs qui
l'ont déterminé à se charger de la défense de Muréna, lorsqu'il dit
que, s'il a favorisé les prétentions de Sulpicius contre l'élévation
de Muréna, ce n'est pas une raison pour s'associer à une accusation
capitale contre lui! Mais c'est surtout à l'égard de Caton qu'il
faut admirer sa dextérité. Après avoir professé la plus haute
admiration pour son caractère, il rejette, non sur lui, mais sur la
secte des stoïciens, ce qu'il avait contracté d'un peu dur en
certaines choses. On dirait qu'il s'agit moins entre eux d'une
contestation judiciaire, que d'une discussion philosophique. La
règle et le précepte le plus sùr, c'est donc, comme toujours,
l'exemple de Cicéron. Voulez-vous dénier un avantage à quelqu'un,
sans lui déplaire? accordez-lui tous les autres : dites seulement
qu'il est moins habile en cela que dans le reste ; et même, si cela
se peut, expliquez pourquoi, en disant, par exemple, qu'il est trop
opiniâtre, ou trop confiant, ou trop irascible, ou trop sujet à se
laisser influencer par autrui. En un mot, le remède commun à toutes
ces sortes de causes, c'est de faire paraître, dans tout le cours du
plaidoyer, des sentiments d'honnêteté et même de bonté; d'établir
qu'on a de justes motifs pour parler ainsi, et que non seulement on
agit dans un esprit de modération, mais qu'on ne cède qu'à la
nécessité. L'embarras contraire, mais dont on se tire plus aisément,
c'est d'avoir à louer certaines actions dans des hommes d'ailleurs
déshonorés, ou que nous haïssons; car, pour la chose en elle-même,
elle doit être louée dans quelque personne que ce soit. Cicéron a
plaidé pour Gabinius et P. Vatinius, qui avaient été ses plus
mortels ennemis, et contre lesquels il avait même écrit des
plaidoyers; mais il s'est justifié de cette contradiction en
déclarant qu'il s'inquiétait moins de l'opinion que de sa
conscience. Sa position était plus embarrassante dans l'affaire de
Cluentius, où il se trouvait dans la nécessité d'accuser Scamandre,
qu'il avait jadis défendu. Mais il éluda cette difficulté avec
beaucoup d'art, en s'excusant sur les instances de ceux qui lui
avaient amené Scamandre, et sur sa grande jeunesse ; car il se
serait bien plus décrédité en donnant à croire qu'il fût homme à se
charger inconsidérément de la défense d'un coupable, surtout dans
une cause aussi suspecte. La cause que nous défendons peut aussi
être telle que le juge y soit intéressé directement ou
indirectement. Dans ce cas, si la persuasion est une victoire
difficile, on a du moins le champ libre pour parler : car nous
ferons semblant de nous reposer avec sécurité sur la justice du
juge; nous le piquerons d'honneur, en lui faisant entendre que son
intégrité et sa religion éclateront d'autant plus, qu'il aura moins
cédé à son ressentiment ou à son intérêt. Nous agirons de même, si,
après en avoir appelé à un autre tribunal, nous sommes renvoyés
devant les mêmes juges, en ajoutant le prétexte de la nécessité si
la cause le comporte, ou en nous excusant sur une erreur, ou sur un
soupçon. Le plus sûr alors est de confesser sa faute, d'en témoigner
du repentir, d'en offrir satisfaction, et de mettre tout en œuvre
pour amener le juge à se faire scrupule d'écouter sa passion.
Il arrive aussi quelquefois qu'un juge
se trouve saisi pour la seconde fois d'une cause sur laquelle il
avait déjà prononcé. Alors nous aurons recours d'abord à un moyen,
qui est d'une application commune à toutes les causes de cette
espèce : nous dirons que, si nous avions à parler devant un autre
juge, nous n'entrerions pas dans la discussion de la première
sentence, parce qu'il n'appartient qu'à celui qui l'a rendue, de la
réformer. Ensuite nous dirons, autant que nous le permettra la
cause, qu'on ignorait certaines choses qu'on a sues depuis, ou que
des témoins manquaient, ou que les premiers avocats n'ont pas rempli
toute leur tâche; mais nous n'appuierons sur ce dernier point
qu'avec une extrême timidité, et au défaut d'autre motif. Que si
même nous avons à plaider devant de nouveaux juges, soit pour le
second jugement à rendre sur la liberté d'une personne, soit dans
les appels d'une section des centumvirs à une autre, il sera
toujours plus convenable de respecter, autant que possible,
l'honneur des premiers juges. C'est ce que j'ai amplement expliqué
dans le cinquième livre, au chapitre des preuves. Il peut arriver
enfin que nous ayons à blâmer dans autrui ce que nous avons fait
nous-mêmes. Ainsi Tubéron reproche à Ligarius d'avoir été en
Afrique; ainsi des gens condamnés pour brigue en accusent d'autres
du même crime, dans l'espérance de se voir réhabilités; ainsi, dans
les déclamations des écoles, un père est accusé de débauche par un
fils débauché. Je ne vois guère comment on peut se tirer de ces
contradictions avec bienséance, à moins de découvrir quelque
différence résultant de la personne, de l'âge, du temps, du motif,du
lieu, de l'intention. [11,1,80] Ainsi Tubéron dit qu'il avait passé
sa jeunesse auprès de son père, qui avait été envoyé en Afrique par
le sénat, non pour prendre part à la guerre, mais pour acheter du
blé, et qui, dès qu'il l'avait pu, s'était retiré des partis; que
Ligarius, au contraire, était resté; qu'une contestation de dignité
s'étant élevée entre César et Pompée, sans que ni l'un ni l'autre
eussent aucun mauvais dessein contre la république, Ligarius, qui
pouvait sans crime embrasser la cause de Pompée, avait mieux aimé
s'attacher à Juba et aux Africains, ennemis irréconciliables du
peuple romain. Du reste, rien n'est plus facile que d'attaquer dans
autrui une faute qu'on a commise soi-même, quand on commence par
s'avouer coupable; mais c'est le fait d'un délateur, et non d'un
avocat. Que si nous n'avons aucune excuse à alléguer, le repentir
seul peut donner quelque couleur à notre conduite; car, jusqu'à un
certain point, c'est faire preuve d'amendement que de prendre en
haine ses erreurs. Certaines personnes, en effet, peuvent trouver
des raisons d'excuse dans la nature même de l'action. Ainsi, un père
déshérite son fils né d'une courtisane, parce que ce fils a lui-même
épousé une courtisane. C'est un sujet de déclamation, mais qui peut
se rencontrer dans la réalité. Ce père pourra donc, sans
inconséquence, faire valoir plusieurs raisons : que c'est un désir
naturel à tous les pères de vouloir que leurs enfants soient plus
honnêtes qu'eux, ce qui est si vrai, qu'une prostituée même, s'il
lui naît une fille, veut que cette fille soit élevée dans des
sentiments de pudeur; que, pour lui (car il peut faire cet aveu), sa
condition était moins distinguée ; qu'il n'avait pas un père pour le
rappeler à son devoir ; que son fils aurait dû d'autant moins se
permettre cette union, que c'était renouveler l'opprobre de sa
famille, et reprocher tout à la fois à son père le mariage qu'il
avait fait, et à sa mère la nécessité de son premier état; qu'enfin
il léguait, en quelque sorte, à ses descendants l'exemple de
l'infamie. Il pourra même faire croire aisément qu'il y a dans cette
courtisane quelque flétrissure particulière, qu'un père ne saurait
supporter dans l'épouse de son fils. Je vois encore d'autres motifs,
mais je ne prétends pas faire une déclamation; je veux seulement
montrer qu'un orateur peut quelquefois se défendre avec succès sur
un mauvais terrain.
Mais où l'embarras est tout à fait
pénible, c'est lorsqu'il s'agit d'un de ces outrages qui révoltent
la nature, et qu'on ne peut exprimer sans rougir; je ne dis pas
seulement si c'est la victime qui se plaint elle-même, car que
peut-elle avoir de mieux à faire qu'à gémir, à verser des larmes, à
détester sa vie, et à laisser au juge le soin de deviner sa douleur?
mais l'avocat lui-même doit se pénétrer des mêmes sentiments, parce
que des outrages de cette nature causent plus de honte à ceux qui
les ont soufferts qu'à ceux qui les ont osés.
Dans la plupart des causes où
l'orateur prend le parti de la rigueur, il doit donner d'autres
couleurs à sa sévérité, comme l'a fait Cicéron au sujet des fils des
proscrits. Quoi de plus cruel, en effet, que d'interdire les charges
de la république à des hommes issus de pères et d'aïeux illustres?
C'est ce que confesse ce grand maître dans l'art de manier les
esprits; mais il proteste que le sort de l'État est tellement lié
aux lois de Sylla, que sans elles il ne saurait subsister. Aussi
parvint-il à faire croire qu'il agissait dans l'intérêt de ceux
contre lesquels il parlait.
J'ai déjà fait observer, en traitant
de la raillerie, combien il est vil d'insulter au malheur; et j'ai
en même temps recommandé de ne se permettre aucune sortie contre des
ordres, ou des nations, ou des peuples entiers. Cependant le devoir
de notre ministère nous oblige quelquefois à parler de certaines
classes d'hommes, comme les affranchis, les gens de guerre, les
publicains, ou autres. Il y a à cela un remède général, c'est de
montrer qu'on ne prend pas plaisir à manier ce qui blesse; de ne
point attaquer tout indistinctement, mais seulement ce qui est
attaquable, et de balancer le blâme par la louange. Dites que les
hommes de guerre sont avides, mais ajoutez que cela n'est pas
étonnant, parce qu'ils ne se croient jamais assez payés de leurs
dangers et de leur sang. Dites qu'ils sont querelleurs, mais dites
aussi qu'ils sont plus accoutumés à la guerre qu'à la paix.
S'agit-il de décréditer les affranchis? rien n'empêche de rendre
témoignage à l'activité qui les a tirés de l'esclavage. A l'égard
des nations étrangères, Cicéron a traité ce point tantôt d'une
manière, tantôt d'une autre. Ainsi, dans une cause où il voulait
décréditer la foi de quelques témoins grecs, il commence par
accorder aux Grecs le domaine de la science et des lettres, et par
faire ouvertement profession d'aimer cette nation; il affecte, au
contraire, du mépris pour les Sardes, et traite les Allobroges comme
des ennemis; et, eu égard à la circonstance, il ne disait rien qui
ne fût à sa place, rien contre la bienséance. On adoucit encore par
la modération dans les termes ce que les choses ont de trop âpre.
Par exemple, si un homme est dur, dites qu'il est trop sévère; s'il
est injuste, qu'il se trompe de bonne foi; s'il est opiniâtre, qu'il
tient trop à ses principes : en un mot, faites comme si vous vouliez
vaincre vos adversaires par le raisonnement : ce qui est une manière
très courtoise de combattre.
Disons en outre que tout ce qui est
excessif pèche contre la convenance, et qu'ainsi ce qui est
convenable en soi perd son prix, si l'on n'y met un certain
tempérament; mais c'est un point qu'il est plus facile de sentir que
d'exprimer, et dont l'observation dépend plus d'un certain tact que
de tous les préceptes. Pour déterminer le point de justesse au delà
duquel un seul mot est de trop, nous n'avons ni mesure ni poids,
parce qu'il en est de cela comme des aliments, dont les uns
rassasient plus que les autres.
Je crois devoir ajouter aussi, en peu
de mots, que, dans l'éloquence, les qualités les plus différentes
ont non seulement leurs partisans, mais souvent même sont goûtées
des mêmes personnes. Cicéron, par exemple, a écrit quelque part que
le signe de la perfection est de paraître facile à imiter, et de
ne pouvoir l'être ; et il dit ailleurs qu'il s'est étudié à
parler, non comme le premier venu espérerait de pouvoir le faire,
mais comme personne, au contraire, n'oserait l'espérer. Il peut
paraître contradictoire d'approuver ces deux sortes de langage, et
cependant rien n'est plus conséquent : la différence n'est que dans
le sujet. Car cette simplicité, et, pour ainsi dire, cette sécurité
d'un langage naturel, convient merveilleusement aux petites causes,
tandis que la magnificence d'un style pompeux sied mieux aux
grandes. Cicéron excelle dans les deux genres. Le premier paraît
facile aux ignorants; mais, au jugement des connaisseurs, ni l'un ni
l'autre ne l'est.
CHAP. II. La mémoire,
suivant quelques-uns, est un pur don de la nature, et nul doute que
la nature n'y soit pour beaucoup ; mais la mémoire, comme toute
autre chose, s'accroît par la culture. Or, toutes les études dont
nous avons parlé jusqu'ici seraient vaines, si les autres parties de
la rhétorique ne vivaient et ne se mouvaient en elle; car toute
science repose sur la mémoire, et l'on perdrait son temps a être
enseigné, si l'on ne pouvait retenir ce que l'on entend. C'est elle
qui tient sans cesse à nos ordres cette armée d'exemples, de lois,
de réponses, de dits et de faits, que l'orateur doit toujours avoir
en abondance, et, pour ainsi dire, sous la main. Aussi est-ce à
juste titre qu'elle est appelée le trésor de l'éloquence.
Mais comme un plaidoyer se compose
d'une infinité d'éléments, il ne suffit pas que la mémoire soit
fidèle, il faut encore qu'elle soit prompte à saisir; il ne suffit
pas de retenir l'ensemble de ce qu'on a écrit, en le lisant à
plusieurs reprises, il faut encore, dans ce qu'on n'a que médité,
retrouver les mêmes idées, les mêmes mots, le même arrangement; il
faut se souvenir de ce qui a été dit par la partie adverse, pour le
réfuter, non pas toujours dans le même ordre, mais dans le lieu le
plus convenable. Le dirai-je? le talent de l'improvisation n'est pas
autre chose qu'une grande mémoire. En effet, pendant que nous
parlons, nous avons à prévoir ce que nous dirons ensuite; et, comme
la pensée se porte toujours au delà du moment présent, tout ce
qu'elle rencontre en chemin, elle le donne en dépôt à la mémoire ;
et celle-ci fait l'office d'une main intermédiaire, qui transmet à
l'élocution ce qu'elle a reçu de l'invention.
Je ne crois pas devoir m'arrêter à
examiner la cause efficiente de la mémoire, quoique l'opinion la
plus commune soit que les choses extérieures s'impriment dans l'âme
comme un cachet sur la cire; et je ne pourrai jamais admettre que la
mémoire contracte, comme le corps, une lenteur ou une force qui
constitue une qualité habituelle. Je veux plutôt admirer sa nature
par rapport à l'âme. Quoi de plus inexplicable? Des idées, qu'un
long intervalle de temps semblait avoir séparées de nous,
reparaissent tout à coup, et se représentent non seulement quand
nous les rappelons, mais quelquefois aussi d'elles-mêmes; non
seulement quand nous sommes éveillés, mais même quand nous dormons.
Que dis-je? Les animaux, quoique privés d'intelligence, ne laissent
pas de se souvenir, de se reconnaître, et de regagner, après une
longue excursion, leur habitation accoutumée. Bizarrerie
surprenante! ce que nous venons de faire nous échappe, et de
vieilles impressions restent; nous oublions des choses d'hier, et
nous nous souvenons des actes de notre enfance; certaines idées se
cachent quand nous les cherchons, et se présentent à nous quand nous
y pensons le moins; enfin, la mémoire meurt et la mémoire renaît.
Cependant on ne saurait pas tout ce dont cette faculté est capable,
tout ce qu'il y a de divin en elle, si l'éloquence ne l'eût fait
paraître dans tout son jour. Car elle maintient l'ordre non
seulement dans les idées, mais encore dans les mots; et les mots
dont elle tient le fil se succèdent presque sans fin, à tel point
que, dans les plus longs plaidoyers, la patience de l'auditeur se
lasse plus tôt que la mémoire ne manque à l'orateur : ce qui prouve
qu'il y entre de l'art, et que la nature peut être secondée par la
méthode, puisque nous voyons que, avec de la science et de la
pratique, on fait ce que, sans science ni pratique, on ne peut pas
faire. Cependant je lis dans Platon que l'écriture nuit à la
mémoire, sans doute parce que, après avoir confié nos idées au
papier, nous cessons, pour ainsi dire, de les surveiller, et
qu'elles profitent de notre sécurité pour s'échapper. II est certain
que le plus sûr moyen de se souvenir d'une chose, c'est d'y avoir
l'esprit fortement appliqué, et de ne jamais la perdre de vue. Aussi
ce que nous écrivons plusieurs fois de suite, pour l'apprendre,
s'imprime dans notre mémoire par la seule habitude d'y penser.
Simonide passe pour avoir montré le
premier l'art de la mémoire; et voici ce qu'on raconte de lui. Il
avait, moyennant une somme convenue, composé, en l'honneur d'un
athlète qui avait remporté le prix du pugilat, une de ces pièces de
vers qu'il est d'usage de faire pour les vainqueurs. Quand l'ode fut
terminée, on refusa de lui payer la totalité de la somme, parce que,
suivant la coutume des poètes, il s'était étendu, par forme de
digression, sur les louanges de Castor et Pollux, à qui par
conséquent on le renvoyait pour le surplus. Ceux-ci s'acquittèrent
de leur dette, s'il faut en croire ce qu'on rapporte; car un grand
repas s'étant donné pour célébrer cette victoire, Simonide fut du
nombre des conviés; et, pendant qu'il était à table, on vint lui
dire que deux jeunes cavaliers le demandaient, et désiraient
ardemment de lui parler. Simonide sortit, et ne trouva personne;
mais l'issue fit voir qu'il n'avait pas eu affaire à des ingrats;
car à peine avait-il franchi le seuil de la porte, que la salle
s'écroula sur les convives, et les mutila si horriblement de la tête
aux pieds, que, lorsqu'il fut question de leur donner la sépulture,
leurs parents ne purent les reconnaître. Alors, dit-on, Simonide,
s'étant souvenu de l'ordre dans lequel chacun des convives était
placé, rendit leurs corps à leurs familles. Les grammairiens ne
s'accordent pas sur le nom du vainqueur chanté par Simonide, si
c'était Glaucon Carystius, ou Léocrate, ou Agatharque, ou Scopas ;
ils ne s'accordent pas davantage sur le lieu, si c'était à Pharsale,
comme Simonide lui-même semble le faire entendre quelque part, et
comme l'ont rapporté Apollodore; Ératosthène, Euphorion, et Euripyle
de Larisse; ou bien à Cranon, comme le, dit Apollas Callimaque, dont
l'opinion, pour avoir été adoptée par Cicéron, est aujourd'hui la
plus accréditée. Ce qu'on tient pour certain, c'est qu'un noble
Thessalien, nommé Scopas, périt dans ce festin. On ajoute que le
fils de sa sœur y périt aussi, avec la plupart des descendants d'un
autre Scopas plus ancien. Du reste, tout ce récit sur les Tyndarides
m'a bien l'air d'une fable, d'autant que Simonide n'en fait nulle
part la moindre mention; et, certes, il n'aurait pas gardé le
silence sur un événement aussi glorieux pour lui.
Quoi qu'il en soit, le fait semble
avoir donné lieu de remarquer que la mémoire pouvait être aidée par
le souvenir des localités, et c'est ce que chacun peut vérifier
d'après sa propre expérience. En effet, lorsque, après un certain
laps de temps, nous nous retrouvons dans un lieu que nous avions
quitté, non seulement nous le reconnaissons, mais nous nous
ressouvenons de ce que nous y avons fait : les personnes que nous y
avons vues, et quelquefois les pensées qui nous occupaient alors se
représentent à nous. Ainsi, pour la mémoire comme pour la plupart
des choses, l'art est né de l'expérience. Or, voici comme on le
pratique.
On choisit un lieu extrêmement
spacieux et diversifié, une grande maison, par exemple, distribuée
en plusieurs appartements. On se grave avec soin dans l'esprit tout
ce qu'elle contient de remarquable, afin que la pensée en puisse
parcourir toutes les parties sans hésitation ni délai. En cela,
l'essentiel est de ne point broncher devant les objets; car des
souvenirs, destinés à venir en aide à d'autres souvenirs, doivent
être plus que sûrs. Ensuite, pour se rappeler ce qu'on a écrit ou
simplement médité, on se sert de quelque signe, emprunté ou à la
matière qu'on a à traiter, s'il s'agit, par exemple, de navigation
ou de guerre, ou bien à quelque mot; car un mot suffit pour
redresser la mémoire, aussitôt qu'elle vient à broncher. S'agit-il
de navigation, le signe de reconnaissance sera une ancre; de guerre,
ce sera une arme quelconque. Puis, on procède ainsi : on assigne la
première pensée au vestibule, la seconde à la salle d'entrée, et
ainsi du reste, en parcourant les croisées, les chambres, les
cabinets, jusqu'aux statues et autres objets semblables. Cela fait,
quand il s'agit d'appliquer ce procédé à la mémoire, on passe en
revue chaque lieu à partir du premier, en redemandant à chaque image
l'idée qui lui a été confiée : en sorte que, si nombreuses que
soient les choses dont on ait à se souvenir, elles se donnent la
main et forment une espèce de choeur, qui prévient la confusion dans
laquelle on est exposé à tomber en se bornant à apprendre de
mémoire. Ce que j'ai dit d'une maison peut également s'appliquer à
des monuments publics, à une longue promenade (en faisant, par
exemple, le tour d'une ville), ou à des tableaux. On peut même se
créer des lieux imaginaires. On a donc besoin de lieux réels ou
fictifs, ainsi que d'images ou simulacres, qui sont toujours
arbitraires. Les images sont des signes qui servent à marquer ce que
nous voulons retenir, en sorte, comme le dit Cicéron, que les
lieux peuvent se comparer à la cire, et les simulacres aux lettres.
Mais je ferai mieux de rapporter ses propres expressions : Il
faut faire choix, dit-il, de lieux multiples, remarquables, bien
développés, peu distants les uns des autres; et d'images qui
expriment quelque action, qui soient vives, caractéristiques, telles
enfin qu'elles viennent au-devant de l'esprit, et le frappent
incontinent. Aussi ai-je lieu de m'étonner que Métrodore ait
trouvé trois cent soixante lieux dans les douze signes du zodiaque :
je ne vois là que la vanité et la jactance d'un homme qui, en se
glorifiant de sa mémoire, voulait en faire honneur à son art, plutôt
qu'à la nature.
Pour dire maintenant ce que je pense
de cette méthode, j'avouerai qu'elle peut être bonne quelquefois, si
l'on veut, par exemple, répéter une grande quantité de noms dans
l'ordre où on les a entendus; car alors nous plaçons tous ces noms
dans les lieux que nous avons observés, le mot table, par exemple,
dans le vestibule, le mot coussin dans la salle d'entrée, et ainsi
des autres; puis, repassant par le même chemin, nous les reprenons
où nous les avions placés. C'est sans doute à l'aide de cette
méthode que certaines personnes sont parvenues, comme on dit que le
fit Hortensius, à énumérer de mémoire, après une vente publique,
tous les objets vendus, avec les noms des acheteurs et le prix de
chaque article, aussi fidèlement que l'huissier l'eût pu faire avec
son registre. Mais ce procédé sera moins efficace, quand il s'agira
d'apprendre tout un plaidoyer; car les pensées n'ont pas, comme les
choses, des images propres : les images des pensées sont purement
arbitraires, bien que, jusqu'à un certain point, les lieux ne
laissent pas d'aider a retrouver les pensées. Mais comment
pourra-t-on, avec ce même procédé, retenir la contexture des mots
d'un plaidoyer qu'on a entendu prononcer? Je ne m'arrêterai pas à
faire remarquer qu'il y a des mots, et de ce nombre sont
certainement les conjonctions, qui ne peuvent être figurés par
aucune image. Car eussions-nous, comme les notaires, des images
déterminées pour chaque mot ; eussions-nous des lieux à l'infini,
pour y placer autant de mots qu'il y en a dans les cinq livres du
second plaidoyer contre Verrès; eussions-nous enfin la faculté de
nous souvenir de tout ce que nous aurions, pour ainsi dire, mis en
dépôt dans chaque lieu, le débit ne serait-il pas nécessairement
entravé par le double effort de la mémoire? Comment, en effet, le
tout pourra-t-il marcher sans désordre, s'il nous faut, à chaque
mot, nous reporter à chaque image et à chaque lieu? Laissons donc
cette méthode à Charmadas et à Métrodore, qui, selon Cicéron, l'ont
mise en pratique, et tenons-nous-en à des préceptes plus simples.
Si nous voulons confier à notre
mémoire un plaidoyer un peu long, il sera bon de I'apprendre par
parties; car rien ne paralyse plus cette faculté que de la
surcharger. Les parties ne doivent pas non plus être trop petites :
autrement, par un effet contraire, elles partageraient et
morcèleraient la mémoire. Je ne prescrirai pas de mesure déterminée;
mais, autant que possible, on embrassera le développement complet de
chaque proposition, à moins que cette proposition ne soit si longue,
qu'il faille encore la diviser. Il sera bon encore de diviser ces
morceaux en certains points fixes, où l'on s'arrêtera pour retourner
sur ses pas, afin que les mots (car c'est là ce qui coûte le plus,
et, après les mots, les différentes propositions) se succèdent et
s'enchaînent dans la mémoire comme dans le discours. Quant à ce que
nous aurons trop de peine à retenir, rien n'empêche d'y associer
quelque marque dont le souvenir serve à avertir et à réveiller, pour
ainsi dire, la mémoire. Il est même rare qu'un homme ait la mémoire
assez ingrate pour ne pas reconnaitre le signe qu'il a affecté à tel
ou tel endroit. Cependant, si sa pesanteur va jusque-là, c'est même
une raison d'y remédier par ce moyen, afin que les marques
aiguillonnent la mémoire. Il n'y aura donc pas d'inconvénient à user
du procédé mnémonique dont j'ai parlé, qui consiste à attacher des
signes à des pensées qui pourraient nous échapper : celui d'une
ancre, comme je l'ai déjà dit, si l'on a à parler de navigation;
d'un javelot, si l'on a à parler de guerre. Les signes sont, en
effet, d'un grand secours, et une idée en réveille une autre. C'est
ainsi qu'un anneau que nous changeons de doigt, ou auquel nous
attachons un fil, nous remet en mémoire le motif qui nous l'a fait
faire. Un moyen de rendre la mémoire encore plus sûre, c'est de
soutenir une idée par une autre. Ainsi, pour les noms, avons-nous à
retenir celui de Fabius, associons-y le souvenir de ce
temporiseur, qu'on ne saurait oublier, ou de quelqu'un de nos amis
qui s'appelle de même. Cela est plus aisé encore à l'égard de
certains noms, tels que Aper, Ursus, Naso, ou
Crispus : il suffit de se rappeler les choses auxquelles ils
font allusion. L'origine est quelquefois aussi un moyen de retenir
les dérivés, comme Cicéron, Verrius, Aurélius.
Mais rien ne facilite tant la mémoire, que d'apprendre sur les
tablettes mêmes où l'on a écrit; car, tout en récitant, il semble
qu'on lise : on suit, pour ainsi dire, la mémoire à la trace; on a,
en quelque sorte, sous les yeux, non seulement les pages, mais
presque les lignes. Bien plus, s'il y a eu quelque rature, quelque
addition ou changement, ce sont autant de signes qui nous empêchent
de nous égarer. Ce moyen a beaucoup d'analogie avec le procédé dont
j'ai parlé en commençant; et, si mon expérience ne m'a pas trompé,
je le crois plus simple et plus efficace. Apprendre mentalement est
un exercice qu'on n'a pas oublié, et qui serait fort bon, si
l'esprit, qui est alors, pour ainsi dire, oisif, n'était par là
sujet à de fréquentes distractions. Cr, on ne saurait remédier à cet
inconvénient que par la voix, qui, en tenant l'esprit attentif, aide
la mémoire par la double impression de la parole et de l'ouïe; mais
il faut que la voix soit basse, ou plutôt que ce ne soit qu'un
murmure. Pour ce qui est d'apprendre pendant qu'un autre lit, si,
d'un côté, on apprend moins vite, parce que la vue est un sens plus
vif que l'ouïe, de l'autre, on a cet avantage, qu'après avoir
entendu lire une ou deux fois, on peut aussitôt éprouver sa mémoire,
et lutter avec le lecteur: ce qui est, d'ailleurs, une épreuve bonne
à faire de temps en temps; car, lorsque la lecture qu'on nous fait
est continue, les choses qu'on sait le moins passent comme celles
qu'on sait le mieux ; tandis que, au moyen de l'épreuve dont je
parle, outre que l'esprit_ s'applique davantage, on ne perd pas son
temps à écouter ce qu'on sait déjà. De cette manière, on repasse
seulement les endroits qui avaient échappé, afin que, à force d'y
revenir, on se les imprime bien dans la mémoire; et même d'ordinaire
ce sont ceux-là que nous retenons le mieux, par la raison qu'ils
nous avaient échappé. Au surplus, pour apprendre par coeur comme
pour écrire, il faut une bonne santé, un estomac libre, et un esprit
dégagé de toute préoccupation.
Mais ce qui est un moyen très efficace
pour retenir ce qu'on a écrit, et un moyen presque unique pour
retenir ce qu'on a médité, excepté l'exercice, qui est le plus
puissant de tous, c'est la division et la composition.
Quiconque, en effet, aura bien divisé son discours, ne courra jamais
le risque d'intervertir l'ordre des choses. Il y a, en effet, pour
tout homme doué de jugement et de goût, un ordre déterminé à
observer non seulement dans la distribution des questions, mais dans
la manière de les traiter, qui assigne à chacune d'elles son rang,
le premier, le second, et ainsi de suite; et toutes ces questions
sont tellement liées les unes aux autres, qu'on ne peut rien en
retrancher ni rien y ajouter, sans qu'on ne s'en aperçoive aussitôt.
Scévola, après avoir perdu une partie de dames où il avait joué le
premier, repassa, en allant à la campagne, toute la disposition du
jeu, et, s'étant souvenu du coup qui l'avait fait perdre, revint
auprès de son adversaire, qui demeure d'accord que tout s'était
passé comme il le disait. Comment l'ordre aura-t-il moins d'effet
dans un discours, dont notre volonté aura distribué toutes les
parties, quand il peut tant dans une chose où la volonté d'autrui se
mêle à la nôtre? L'enchaînement d'une bonne composition guidera
aussi la mémoire; car, de même qu'on apprend plus facilement les
vers que la prose, de même on apprend mieux la prose lorsqu'elle est
bien liée, que lorsqu'elle est lâche et négligée. C'est ce qui
explique comment on parvient même à redire mot pour mot ce qui la
première fois semblait avoir été improvisé; et ma mémoire, qui n'est
que médiocre, y réussissait, lorsque l'arrivée de quelque personnage
qui méritait cet honneur me forçait à recommencer une partie de ma
déclamation. Je n'en impose pas sur ce fait : plusieurs l'ont vu, et
sont encore là pour l'attester.
Cependant, si l'on me demande en quoi
consiste véritablement l'art de la mémoire, je répondrai que c'est
dans l'exercice et le travail. Apprendre beaucoup,
méditer beaucoup, et, si on le peut, tous les jours, voilà ce qu'il
y a de plus efficace. Rien ne s'accroît autant par la culture, rien
ne diminue autant par la négligence. On ne saurait donc, comme je
l'ai recommandé, faire apprendre de trop bonne heure aux enfants
tout ce qu'ils pourront retenir; et, à quelque âge que ce soit,
quiconque voudra cultiver sa mémoire doit se résoudre à dévorer
d'abord l'ennui de repasser sans cesse ce qu'il a écrit, ce qu'il a
lu, et de remâcher, pour ainsi dire, les mêmes aliments. On peut
rendre néanmoins cette tâche plus légère, en ayant soin, dans le
commencement, d'apprendre peu, et des choses qui ne rebutent pas;
ensuite, on ajoutera chaque jour une ligne, et peu à peu, sans que
le surcroît se fasse sentir, on arrivera à des résultats
incroyables. On s'exercera d'abord sur les poètes, puis sur les
orateurs, enfin sur des écrivains dont la composition est moins
nombreuse et moins oratoire, tels que les jurisconsultes; car ce qui
sert d'exercice doit être plus difficile, afin que la chose en vue
de laquelle on s'exerce devienne plus aisée. C'est ainsi que les
athlètes s'exercent avec de lourds gantelets de plomb, quoique, dans
la lice, ils luttent les mains vides et nues. Je ne veux pas omettre
une remarque confirmée tous les jours par l'expérience : c'est que,
chez les esprits un peu lents, la mémoire est infidèle aux idées
récentes. Il est étonnant, et je ne saurais guère en donner la
raison, combien une nuit d'intervalle contribue à l'affermir, soit
parce qu'elle suspend ce travail, qui se nuisait à lui-même par ses
propres efforts, soit parce que la réminiscence, qui est la partie
la plus solide de la mémoire, digère, pour ainsi dire, ou mûrit ce
qu'elle a reçu; de sorte que les idées, qui d'abord ne pouvaient se
reproduire, se représentent dans leur ordre le lendemain, et que le
temps, qui est d'ordinaire une cause d'oubli, ne fait alors que
consolider la mémoire. Au contraire, ceux qui apprennent très vite
oublient de même ; et l'on dirait que leur mémoire, bornant sa tâche
au moment présent, et se croyant quitte envers eux, prend son congé
et se retire. Après tout, il n'est pas surprenant que ce qu'on a été
longtemps à faire entrer dans son esprit, y demeure plus
profondément imprimé.
Cette différence entre les esprits a
donné lieu à une question : Un orateur doit-il apprendre mot pour
mot son plaidoyer, ou s'en tenir seulement à la substance et à
l'ordre des choses? Or, c'est une question qu'il n'est guère
possible de résoudre d'une manière générale : car, si ma mémoire y
suffit, et si le temps ne me manque pas, je ne veux pas que la
moindre syllabe m'échappe: autrement, à quoi servirait d'écrire? Ce
qu'il faut donc gagner sur soi dès l'enfance, et faire tourner en
habitude à force d'exercice, c'est de ne rien accorder à sa paresse.
Aussi est-ce un grand défaut que d'avoir derrière soi un souffleur,
ou de jeter les yeux sur son papier : cela autorise la négligence,
en ce qu'il est naturel de croire qu'on est toujours maître de ce
qu'on ne craint pas de voir échapper. Mais qu'arrive-t-il? Le
mouvement de la plaidoirie s'interrompt, l'orateur s'arrête ou
sautille, ou, pour mieux dire, a l'air d'étudier une pièce
d'éloquence; et les choses les mieux écrites perdent toute leur
grâce, par cela seul qu'on voit qu'elles sont écrites. Au contraire,
la fidélité de la mémoire fait croire à la vivacité de notre esprit
: nos paroles ne semblent pas préparées, mais improvisées; ce qui
sert singulièrement et l'orateur et la cause, car le juge admire
davantage et craint moins ce qui ne lui paraît pas avoir été médité
pour le surprendre. Cela est si vrai, qu'une des principales
attentions qu'il faut avoir en plaidant, c'est de dissimuler
quelquefois dans la prononciation la contexture des périodes les
mieux ourdies, et de faire semblant de réfléchir et d'hésiter sur ce
que l'on sait le mieux. Quelle est, d'après cela, la meilleure des
deux méthodes? la comparaison ne laisse aucun doute.
Cependant, si la mémoire est
naturellement trop dure, ou si le temps manque, il est même nuisible
de s'attacher aux mots, puisque l'oubli d'un seul exposerait à
hésiter désagréablement, ou même à rester court. Il est beaucoup
plus sûr de se bien pénétrer des choses, et de se laisser le champ
libre pour la manière de les énoncer; car ce n'est qu'à regret qu'on
se détermine à perdre un mot de son choix, et l'on n'en trouve pas
toujours un autre pendant qu'on cherche celui qu'on avait écrit.
Mais cela même ne peut guère remédier au défaut de mémoire, à moins
qu'on n'ait acquis quelque habitude de l'improvisation. Pour ceux
qui n'ont ni l'une ni l'autre de ces deux ressources, je leur
conseille de renoncer tout à fait au barreau, et, s'ils ont quelque
talent pour les lettres, de l'employer plutôt à écrire. Mais cette
incapacité absolue ne peut être que fort rare.
Au reste, veut-on des exemples de ce
que peut la mémoire quand la nature et l'art concourent à sa
perfection : je citerai Thémistocle, qui, en moins d'un an, apprit
parfaitement la langue des Perses; Mithridate, qui possédait,
dit-on, vingt-deux langues, c'est-à-dire celles de toutes les
nations soumises à son empire; Crassus, ce riche Romain, qui, étant
préteur en Asie, se familiarisa si bien avec les cinq dialectes de
la langue grecque, qu'il prononçait sur les plaintes portées à son
tribunal dans l'idiome même du plaignant; Cyrus, qui, à ce qu'on
rapporte, savait les noms de tous ses soldats. On dit même que
Théodecte, après avoir entendu une seule fois autant de vers qu'on
voulait lui en réciter, les redisait sur-le-champ. On m'a assuré
qu'il y avait encore aujourd'hui de ces sortes de prodiges, mais il
ne m'a pas été donné d'en être le témoin ; cependant on fera bien
d'y croire, ne serait-ce que par la raison qu'en croyant on espère.
CHAP. III.
Prononciation et action, ces deux mots sont assez
généralement pris l'un pour l'autre ; mais le premier semble tirer
son nom de la voix, et le second, du geste. En effet, Cicéron, en
parlant de l'action, l'appelle tantôt le langage, tantôt l'éloquence
du corps. Cependant il lui donne deux parties, qui sont les
mêmes que celles de la prononciation, c'est-à-dire la voix et le
mouvement. On peut donc se servir indifféremment de l'une ou l'autre
appellation. Quant à la chose en elle-même, elle est d'une
merveilleuse efficacité dans l'oraison ; car ce qui se passe en nous
importe moins que la manière dont nous le produisons au dehors,
parce que chacun n'est ému que comme il entend. Aussi, de toutes les
preuves que l'orateur tire de sa conviction plus ou moins intime, il
n'en est pas une, quelque forte qu'elle soit, qui ne paraisse
faible, si elle n'est soutenue d'un certain ton affirmatif. Le feu
des sentiments les plus vifs languit et s'éteint, s'il n'est
alimenté par la voix, par le visage, par le corps
entier de celui qui parle. Encore avec cela serons-nous bienheureux,
si ce feu se communique aux juges ! Tant s'en faut que nous ayons
lieu d'espérer de les émouvoir, si nous nous montrons nonchalants et
froids ! Craignons plutôt que notre apathie ne finisse par les
gagner. Nous avons une preuve de la puissance de la prononciation
dans le jeu des comédiens, qui ajoutent tant de grâce aux pièces des
meilleurs poètes, que nous trouvons infiniment plus de plaisir à les
entendre qu'à les lire, et que même ils nous intéressent à des
pièces détestables, auxquelles nous ne daignerions pas accorder une
place dans nos bibliothèques, et qui ne laissent pas d'avoir
beaucoup de succès au théâtre. Que si, dans de pures fictions,
l'illusion produite par la prononciation est telle, que nous nous
passionnons jusqu'aux larmes ou à la colère, quelle force ne doit
pas lui prêter la réalité? Pour moi, je ne crains pas d'affirmer
qu'un discours médiocre, mais soutenu par le prestige de l'action,
fera plus d'effet que le plus beau discours, qui en sera dénué.
Ainsi, on demandait à Démosthène quelle était la première partie
de la rhétorique : C'est, répondit-il, l'action;
et comme on lui demandait encore quelle était la seconde, puis la
troisième, il répondit toujours : L'action, jusqu'à ce qu'on eût
cessé de le questionner : donnant, ce semble, à entendre que, selon
lui, ce n'était pas seulement la partie la plus considérable, mais
que c'était tout. Aussi, ayant pris pour maître le comédien
Andronicus, il profita si bien de ses leçons, qu'Eschine, voyant
l'admiration des Rhodiens pour l'oraison que cet orateur avait
prononcée dans l'affaire de la couronne, eut raison de leur dire :
Que serait-ce, si vous l'aviez entendu lui-même. Cicéron
croit également que c'est l'action qui domine particulièrement
dans l'orateur. C'est par l'action, selon lui, que Cn. Lentulus
se fit tant de réputation, plutôt que par l'éloquence proprement
dite ; que C. Gracchus, en déplorant la mort de son frère, arracha
des larmes à tout le peuple romain; qu'Antoine et Crassus obtinrent
de si grands succès, mais surtout Hortensius. Et ce qui me le
persuade à l'égard d'Hortensius, c'est que ses plaidoyers écrits
sont au-dessous de sa haute réputation, bien qu'on l'ait regardé
longtemps comme le premier des orateurs de son siècle; qu'ensuite il
ait été le rival de Cicéron; et qu'enfin, jusqu'à sa mort, il ait du
moins occupé le second rang. Il faut donc que, dans sa
prononciation, il ait eu quelque charme, que nous ne retrouvons pas
en le lisant. Et, en effet, puisque les mots ont une force
considérable par eux-mêmes, puisque la voix a pareillement une vertu
particulière qu'elle communique aux idées, puisqu'enfin le geste et
le mouvement du corps ont une certaine signification, il doit
nécessairement résulter du concours de toutes les qualités oratoires
quelque chose de parfait.
Cependant il y a des gens qui pensent
qu'une action toute brute, et telle que la produit l'impétuosité
instinctive de l'âme, est plus puissante, et la seule digne de
l'homme. Mais ces gens sont d'ordinaire les mêmes qui voudraient
bannir de l'éloquence tout soin, tout art, toute politesse, et
condamnent tout ce qui s'acquiert par l'étude, comme affecté et peu
naturel; ou ce sont ceux qui, par la grossièreté du langage et de la
prononciation elle-même, s'étudient à ressembler aux anciens, ainsi
que le faisait Cotta, au rapport de Cicéron. Mais laissons-les dans
cette heureuse persuasion, qu'il suffit de naître pour être orateur;
et que, de leur côté, ils excusent la peine que je prends, moi qui
suis convaincu que la perfection ne se rencontre que là où la nature
est secondée par l'art. Je conviens volontiers que le premier rôle
appartient à la nature. Car certainement il est impossible de bien
prononcer, si l'on manque de mémoire pour retenir ce qu'on a écrit,
ou de facilité et de présence d'esprit pour trouver sur-le-champ ce
qu'on doit dire; si enfin l'on est arrêté par des vices d'organe
incorrigibles. Le corps peut aussi être disgracié à tel point, que
l'art ne puisse remédier à la nature. Une belle prononciation est
même incompatible avec une petite voix; car si la voix est bonne et
ferme, on la manie comme on veut, tandis que, si elle est mauvaise
ou faible, il est bien des choses qu'on ne peut faire, comme
d'élever le ton, ou de faire des exclamations; et il en est d'autres
auxquelles on est forcé de recourir, comme de s'interrompre, de
dévier, de soulager son gosier écorché et ses poumons languissants
par un fausset désagréable. Mais je suppose ici un orateur qui est
en état de profiter de mes préceptes.
Or, l'action étant composée, comme je
l'ai dit, de deux parties, qui sont la voix et le geste,
et dont l'une frappe les yeux, l'autre les oreilles, deux sens par
lesquels toutes les affections passent pour entrer dans l'âme, il
est naturel de parler d'abord de la voix, d'autant que le geste doit
s'y conformer. A l'égard de la voix, il y a deux choses à observer :
sa nature et son usage. Sa nature se juge par sa
quantité et sa qualité. Sa quantité est chose assez
simple; car on peut dire, en général, de la voix, qu'elle est grande
ou petite, mais entre ces deux extrémités il y a plusieurs espèces
intermédiaires, et plusieurs degrés ascendants ou descendants : sa
qualité est plus variée ; car la voix est claire ou voilée, pleine
ou grêle, douce ou âpre, étroite ou large, dure ou flexible, sonore
ou obtuse. Enfin la respiration est longue ou courte. Il n'entre pas
nécessairement dans mon sujet de rechercher les causes de ces
variétés, si cela tient aux différences de la partie du corps qui
reçoit l'air, ou de celle qui lui sert de passage, comme le tuyau
d'un instrument de musique; si la qualité de la voix est naturelle
ou factice, si elle tire plus de force de la poitrine et des
poumons, que de la tête. En effet, le concours de ces trois parties
du corps est nécessaire, de même que, indépendamment de la bouche,
le nez, d'où s'échappe le superflu de la voix, doit également prêter
au son une issue libre et douce.
L'usage de la voix est encore
plus divers. Car, outre les trois divisions du son en aigu,
en grave, en moyen, on a besoin de modes tantôt forts
ou doux, tantôt élevés ou bas, comme aussi de mesures tantôt lentes,
tantôt rapides. Mais ces différences renferment encore d'autres
différences intermédiaires; et de même que le visage, quoique
composé d'un très petit nombre de traits, se diversifie à l'infini,
de même la voix, quoique sa variété ne comporte qu'un petit nombre
d'espèces qui aient un nom, ne laisse pas d'être propre en chaque
personne, et d'avoir une différence aussi saisissable pour l'oreille
que l'est celle des visages pour les yeux. Or, les qualités de la
voix, comme de toute autre chose, se perfectionnent par le soin, et
se détériorent faute de culture. Mais ce soin n'est pas le même pour
l'orateur que pour le musicien : toutefois, il y a plusieurs
conditions qui sont communes à l'un et à l'autre, comme, en premier
lieu, la force du corps, de sorte que la voix de l'orateur n'ait pas
l'accent grêle des eunuques, des femmes, ou des malades. Or, la
promenade, les frictions, la continence, et la frugalité,
contribuent beaucoup à développer cette force. [11,3,20] Il faut
aussi que le gosier soit intègre, c'est-à-dire tendre et lisse, sans
quoi la voix est brisée ou couverte, âpre ou saccadée; car, ainsi
que le même souffle fait rendre à une flûte des sons différents,
selon que les trous sont ouverts ou bouchés, ou que l'instrument est
sale ou fêlé, de même le gosier communique ses défauts à la voix :
enflé, il l'étrangle; obtus, il l'obscurcit; inégal, il l'écorche;
déchiré, il ressemble à un instrument cassé. L'air est aussi coupé
par tout ce qui s'oppose à son passage, comme un filet d'eau qui
vient à heurter un petit caillou : bien que l'eau reprenne son cours
un peu au delà, elle laisse un vide immédiatement après l'obstacle
qu'elle a rencontré. Trop d'humidité embarrasse la voix, comme trop
de sécheresse l'exténue. Or, il est inutile de dire que la fatigue
lui est contraire, et qu'elle agit sur elle comme sur le corps, qui
ne s'en ressent pas seulement dans le moment présent, mais encore
dans la suite. Mais si l'exercice est également nécessaire au
musicien et à l'orateur, attendu que l'exercice développe et
fortifie tout, le procédé n'est pas le même. Car il n'est pas
possible à un homme public de trouver assez de loisir pour se
promener à heures fixes, pour préparer sa voix en la faisant passer
par tous les tons, ou la remettre, pour ainsi dire, dans le fourreau
après le combat, obligé souvent de vaquer à plusieurs audiences. Il
ne doit pas non plus observer le même régime pour la nourriture,
parce qu'il n'a pas tant besoin d'une voix délicate et tendre, que
d'une voix forte et durable. En effet, pour le musicien, tous les
tons, mème les plus hauts, sont adoucis par le chant, tandis que
l'orateur est le plus souvent forcé de parler avec violence, avec
feu; de passer les nuits dans les veilles, d'avaler la fumée de sa
lampe, et d'endurer tout le jour des vêtements trempés de sueur.
N'accoutumons donc pas notre voix à des délicatesses qui la puissent
amollir, et ne là laissons pas s'imprégner d'une habitude qui ne
peut se concilier avec tous les tons de la prononciation oratoire.
Exerçons notre voix, mais conformément à l'usage que nous devons en
faire; qu'elle ne s'affaiblisse pas dans l'oisiveté du silence, mais
qu'elle s'affermisse par la pratique, qui, avec le temps, rend tout
facile.
Or, le mieux est de s'exercer à la
prononciation en récitant des morceaux qu'on aura appris par coeur ;
car, en improvisant, l'attention qu'on donne à la conception des
choses empêche de s'occuper de la voix ; et ces morceaux devront
être extrêmement variés, c'est-à-dire prêter tour à tour à la
clameur, à la dispute, au ton familier de la conversation, et à
toutes les inflexions propres à nous exercer sur tout à la fois. Ce
genre d'exercice suffit : autrement, on s'exposerait, à force de
soins, à rendre sa voix incapable de soutenir une forte épreuve. Il
en serait de l'orateur comme de ces athlètes accoutumés aux
exercices du gymmase : en dépit de leur bonne mine et de la force
qu'ils déploient dans leurs luttes, s'il leur fallait faire des
marches militaires, porter des fardeaux, veiller sous les armes,
vous les verriez bientôt défaillir, et redemander leurs frictions et
leurs sueurs à nu. On ne me pardonnerait pas de recommander, dans un
ouvrage comme celui–ci, d'éviter le soleil, le vent, le brouillard,
la sécheresse; car si nous avons à plaider au soleil, par un temps
venteux, humide ou chaud, abandonnerons-nous notre client? Quant à
ce que conseillent certaines personnes, de ne point parler en public
en sortant de table, ou quand on s'est gorgé de viandes, ou en état
d'ivresse, ou après avoir vomi, cela ne peut arriver qu'à un homme
qui n'est pas maitre de sa raison. Mais ce n'est pas à tort qu'on
recommande généralement de ménager beaucoup la voix des élèves dans
le temps où ils passent de l'enfance à l'adolescence, parce qu'alors
ils l'ont naturellement embarrassée : ce qui provient, selon moi,
non de la chaleur, comme quelques-uns l'ont cru (car il est un âge
où le sang est encore plus chaud), mais plutôt de l'humidité. Ce
qui, en effet, caractérise cet âge, c'est la dilatation. Les narines
même et la poitrine se gonflent; tout semble, pour ainsi dire,
germer, et, par conséquent aussi, tout est plus tendre et plus
frêle.
Pour revenir à mon sujet, quand la
voix sera entièrement développée, la meilleure manière de l'exercer
est, selon moi, celle qui a le plus de conformité avec la
plaidoirie, je veux dire de déclamer tous les jours, comme on le
ferait au barreau. Par là, non seulement la voix et les poumons se
fortifient, mais le corps s'accoutume à mettre ses mouvements en
harmonie avec les paroles. Or, les règles de la prononciation sont
les mêmes que celles de l'oraison. De même que celle-ci doit être
correcte, claire, ornée, convenable, celle-là de même sera correcte,
c'est-à-dire exempte de défauts, si l'accent est facile, net,
agréable, urbain, c'est-à-dire où l'on ne remarque rien de rustique
ni d'étranger ; et ce n'est pas sans raison qu'on dit de l'accent
qu'il est barbare ou grec; car l'homme se reconnaît à l'accent,
comme une pièce de monnaie à son timbre. De là naîtra ce qu'Ennius
loue dans Céthégus, lorsqu'il dit de lui qu'il avait un parler
charmant, bien différent de celui que Cicéron blâme dans quelques
orateurs, qui aboient, dit-il, au lieu de plaider. Car l'accent est
susceptible de plusieurs sortes de défauts, ainsi que je l'ai dit
quelque part dans mon premier livre, où je traite de ce qui regarde
la prononciation des enfants, ayant jugé qu'il était plus à propos
de faire mention de ces défauts à l'âge où il est possible d'y
remédier. Il faut aussi que, avant tout, la voix elle-même soit
saine, c'est-à-dire qu'elle n'ait aucun des défauts dont j'ai parlé
tout à l'heure; ensuite, qu'elle ne soit ni sourde, ni grossière, ni
effrayante, ni dure, ni roide, ni vague, ni grasse; qu'elle ne soit
ni grêle, ni vide, ni aigre, ni menue, ni molle, ni efféminée;
enfin, que la respiration ne soit ni courte, ni peu durable, ni
difficile à reprendre. La prononciation sera claire, si d'abord on a
soin d'articuler entièrement les mots, au lieu d'en manger une
partie, ou, comme font la plupart des orateurs, d'en laisser tomber
quelques syllabes : ils appuient sur les premières et glissent sur
les finales. Mais s'il est nécessaire de bien articuler les mots,
rien n'est plus désagréable et plus choquant que de faire sonner
toutes les lettres, comme si on les comptait; car très souvent,
lorsque deux voyelles se rencontrent, la première s'élide, et
quelquefois une consonne se perd dans la voyelle qui la suit. J'ai
donné des exemples de ces deux cas : multum ille et terris...
On évite aussi le concours de certaines lettres un peu dures : de là
pellexit, collegit, et d'autres mots, dont j'ai parlé
ailleurs. Aussi loue-t-on Catulus de la douceur avec laquelle il
prononçait les lettres. Secondement, il faut que l'oraison soit
distincte, c'est-à-dire que celui qui parle commence et s'arrête
où il faut. Il est nécessaire aussi d'observer quand il faut
soutenir et, pour ainsi dire, suspendre la période (ce que
les Grecs appellent ὑποδιαστολὴ ou ὑποστιγμὴ), et quand il faut la
déposer. Prenons pour exemple les premiers vers de l'Enéide :
Arma uirumque cano; ici il y a suspension, parce que ce
membre de phrase se lie au suivant, Troiae qui primus ab oris;
et ici encore nouvelle suspension : car, bien que ce ne soit pas la
même chose de venir d'un lieu et d'aller dans un lieu, ce n'est
pourtant pas le cas de distinguer, parce que l'une et l'autre action
est renfermée dans un même mot qui setrouve plus loin, uenit.
Italiam, troisième suspension, à cause de cette interjection,
fato profugus, qui fait une solution de continuité entre
Italiam et Lavinaque. Par la même raison, il faudra une
quatrième suspension après fato profugus, avant d'arriver à
ces derniers mots qui terminent le sens, Lavinaque uenit littora.
Cependant, ce repos, destiné à distinguer ce qui précède de ce qui
suit, doit être tantôt plus court, tantôt plus long, suivant qu'il
marque la fin d'une période ou la fin d'une pensée. Ainsi, après
avoir observé la distinction qu'exige, après lui, le mot littora,
je reprendrai haleine aussitôt; mais, quand je serai parvenu à ces
mots, atque altae moenia Romae, je ferai halte, et me
reposerai, non pas, à proprement parler, pour continuer, mais pour
retourner sur mes pas et faire une nouvelle course. Quelquefois on
s'arrête sans reprendre haleine, même dans des périodes, comme
celle-ci : In coetu uero populi romani, negotium publicum gerens,
magister equitum, etc. Cette période a plusieurs membres,
puisqu'elle renferme plusieurs pensées différentes; mais comme ces
membres sont les parties d'un seul et même tout, il ne faut en
marquer les intervalles que par des pauses fort courtes, qui
n'interrompent pas le tissu de la période. Quelquefois, au
contraire, il faut reprendre haleine, mais sans que cela s'aperçoive
et comme à la dérobée : autrement, cette pause maladroitement
dissimulée causerait autant d'obscurité qu'une distinction faite mal
à propos. On regardera peut-être cette partie de l'art du débit
comme un détail peu important : sans elle, cependant, toutes les
autres qualités oratoires seraient nulles.
La prononciation est ornée,
lorsqu'elle est secondée d'une voix facile, ample,
heureuse, flexible, ferme, douce,
durable, claire, pure, qui fend l'air et
s'arrête dans l'oreille, c'est-à-dire appropriée à l'ouïe, non
pas tant à cause de son volume qu'à cause de sa propriété; qui, en
outre, est maniable, susceptible au besoin de tous les sons et de
tous les tons, et semblable à un instrument complet. Mais ce n'est
pas tout : il faut aussi de forts poumons, et une respiration longue
et infatigable. Un ton extrêmement grave ou un ton extrêmement aigu
peut convenir au chant, jamais à la prononciation oratoire, parce
que le premier, peu clair et trop plein, ne peut imprimer aucun
mouvement à l'esprit; et le second, trop menu et trop clair, et par
conséquent peu naturel, ne peut comporter les inflexions de la
prononciation, ni se soutenir longtemps. Car il en est de la voix
comme des cordes d'un instrument : plus elle est relâchée, plus le
son en est grave et plein; au contraire, plus elle est tendue, plus
le son en est mince et aigu. Ainsi, trop basse, elle n'a point de
force; trop haute, elle risque de se rompre. Les tons moyens sont
donc préférables, sauf à les animer ou à les modérer selon le
besoin. En effet, pour bien prononcer, la première condition est l'égalité.
Autrement, on ne fera que sautiller : les intervalles, les longues
et les brèves, les tons graves et aigus, bas et élevés, tout sera
confondu, et, par le défaut d'accord dans des choses qui sont comme
les pieds du discours, la prononciation aura l'air de boiter. La
seconde condition est la variété, et là est toute la
prononciation. Qu'on ne croie pas que l'égalité et la variété soient
incompatibles; car à ces deux qualités correspondent deux défauts,
l'inégalité et l'uniformité. Or, outre qu'elle embellit la
prononciation et récrée l'oreille, la variété délasse encore celui
qui parle, par le changement même de sa peine. Ainsi, nous sommes
tantôt debout, tantôt assis, tantôt couchés, et tantôt nous
marchons, la même attitude devenant insupportable à la longue. Mais
ce qui est extrêmement important, c'est, comme je le dirai tout à
l'heure, de conformer notre voix à la nature des choses dont nous
parlons, et à l'état présent de notre esprit, pour qu'elle soit en
harmonie avec nos paroles. Évitons donc la monotonie qui consiste à
parler tout d'une haleine et toujours sur le même ton; et non
seulement gardons-nous de tout dire en criant, ce qui est d'un
insensé; ou d'un ton de conversation, ce qui manque de mouvement; ou
à voix basse, ce qui ôte toute portée aux plus véhémentes
intonations; mais sachons aussi varier les mêmes parties, les mêmes
sentiments, par certaines inflexions délicates, selon que le
demande, ou la dignité des paroles, ou la nature des pensées;
suivant que nous sommes à la fin ou au commencement d'une période,
ou que nous passons d'un membre à un autre. Imitons ces anciens
peintres, qui, bien qu'ils n'employassent qu'une seule couleur,
savaient donner plus de relief à certaines parties, à d'autres moins
: sans quoi ils n'auraient même pu rendre sensibles les distinctions
des membres. Rappelons-nous le commencement de la célèbre oraison de
Cicéron pour Milon. Ne voit-on pas que, presque à chaque incise, il
faut, pour ainsi dire, changer de visage, tout en présentant la même
face? Quoique j'appréhende qu'il ne soit honteux de témoigner de
la crainte en prenant la parole pour défendre un homme de coeur,
etc. Toute cette proposition a quelque chose de contraint et de
soumis, parce que c'est un exorde, et l'exorde d'un homme
embarrassé; cependant Cicéron a dû nécessairement prendre un ton
plus plein et plus élevé pour prononcer ces mots : pour défendre
un homme de coeur, que pour prononcer ceux-ci : Quoique
j'appréhende qu'il ne soit honteux de témoigner de la crainte.
Après avoir repris haleine pour continuer, il a dû s'enhardir, et
par un certain effort naturel, qui fait qu'on se rassure à mesure
qu'on avance, et par le sentiment de la magnanimité de Milon, qu'il
s'encourage à imiter, en disant : Quoiqu'il soit inconvenant,
lorsque Milon tremble plus pour la république que pour lui-même
... ajoutant, du ton d'un homme qui se fait une espèce de reproche :
de ne pouvoir apporter à sa défense une grandeur d'âme égale à la
sienne... puis, abordant ce qu'il y avait d'odieux dans les
formes du jugement : cependant l'appareil inouï de ce tribunal
nouveau effraye mes yeux... et, puisant dans ce grief un nouveau
motif d'assurance, il a dû achever sa phrase sans balbutier :
qui, de quelque côté qu'ils se tournent, ne retrouvent plus les
usages du barreau, ni les formes accoutumées de la justice.
Enfin, on sent que l'orateur a le champ libre, et peut donner un
plein essor à sa voix dans ces mots qui terminent la période :
car je ne vois plus votre tribunal environné de son assistance
ordinaire.
J'ai voulu faire voir par cette
citation que non seulement dans les membres d'une cause, mais encore
dans ses articulations, la prononciation doit être variée : sans
quoi tout présente une surface unie et de même couleur. Mais ne
forçons pas notre voix; car, outre que souvent ainsi on l'étouffe,
l'effort la rend moins claire, et quelquefois, comme si elle était
étranglée, elle s'échappe en un son que les Grecs appellent du même
nom que le chant des jeunes coqs. Ne confondons pas non plus ce que
nous disons par une trop grande volubilité, qui détruit toute
distinction, ne laisse pas à l'auditeur le temps d'être affecté, et
quelquefois même laisse inachevée la prononciation des mots.
Gardons-nous aussi d'une autre extrémité, je veux dire d'une
excessive lenteur, qui trahit la difficulté que nous éprouvons à
trouver ce que nous voulons dire, engourdit l'auditeur, et, ce qui
est à prendre en considération, fait que, pendant ce temps-là, l'eau
s'écoule et l'audience finit. Que la prononciation soit donc
prompte, sans précipitation; modérée, sans lenteur. Quant à la
respiration, qu'elle ne soit ni trop fréquente, ce qui rend le
discours saccadé; ni traînée en longueur, jusqu'à défaillir; car le
son de cette respiration poussée à bout est désagréable; et lorsque
l'orateur veut reprendre son haleine, semblable à un plongeur qui
sort de l'eau, il la reprend difficilement, longuement et à
contre-temps, parce qu'il le fait, non par un mouvement de sa
volonté, mais par nécessité. C'est pourquoi, lorsqu'on a une période
un peu longue à prononcer, il faut recueillir son haleine; et cela
sans trop s'arrêter, ni avec bruit, ni trop manifestement. Dans les
autres endroits, on pourra très bien respirer. Il faut néanmoins
s'exercer à avoir une respiration aussi longue que possible. Pour y
parvenir, Démosthène avait coutume de réciter tout d'une haleine, et
en montant, le plus de vers qu'il pouvait. Le même orateur, pour
parvenir à prononcer librement et correctement toute sorte de mots,
s'exerçait à parler chez lui en roulant de petits cailloux dans sa
bouche. Quelquefois la respiration est suffisamment longue, pleine
et claire, mais peu ferme; et par conséquent tremblante, comme ces
corps qui ont, en apparence, tout ce qui constitue la force et la
santé, mais que les muscles ne soutiennent pas : imperfection que
les Grecs appellent Βράγχον. Il y en a qui, au lieu de reprendre
naturellement leur haleine, aspirent l'air entre les intervalles des
dents avec un sifflement désagréable; d'autres qui, sans cesse
haletants et poussant de profonds soupirs, gémissent comme des bêtes
de somme qui succombent sous le faix : ce qu'ils affectent même,
pour paraître accablés sous l'abondance de leurs idées, et comme si
leur gosier ne pouvait suffire au torrent de leur éloquence. Chez
d'autres, la bouche embarrassée lutte, pour ainsi dire, avec les
mots. Pour ce qui est de tousser, de cracher à chaque instant, de
tirer du fond de ses poumons des flots de pituite, d'inonder les
voisins de salive, et de chasser l'air, comme une fumée, par les
narines; cene sont pas, à la vérité, des défauts de la voix, mais
comme c'est à cause de la voix qu'ils se produisent, j'ai pu en
parler ici plutôt qu'ailleurs. Mais, de tous ces défauts, il n'en
est aucun que je ne supporte plus patiemment que celui qui règne
aujourd'hui au barreau et dans les écoles, je veux dire la manie de
chanter. Je ne sais ce qu'on doit y blâmer le plus, de son mauvais
effet ou de son inconvenance. Car quoi de plus indigne d'un orateur
que cette modulation théâtrale, et quelquefois semblable au chant
folâtre des ivrognes ou de convives en débauche? Quoi de plus
contraire au but qu'on se propose, lorsqu'il s'agit d'exciter la
douleur, la colère, l'indignation, la pitié, non seulement que de
s'éloigner de ces sentiments, auxquels il faut amener les juges,
mais que de braver la sainteté du barreau jusqu'à y jouer aux dés?
Car Cicéron dit que les rhéteurs de Lycie et de Carie allaient
presque jusqu'à chanter dans les épilogues : pour nous, nous ne
nous en tenons pas même à un chant un peu sévère. Qui a jamais
chanté, je le demande, en se défendant, je ne dis pas contre une
accusation d'homicide, de sacrilège, ou de parricide, mais contre
une simple demande en reddition de compte? S'il faut absolument
passer condamnation sur cet usage, rien ne s'oppose à ce qu'on
s'accompagne avec la lyre ou la flûte, ou plutôt avec des cymbales,
dont le bruit a encore plus de conformité avec ce ridicule abus.
[11,3,60] Cependant nous nous y laissons entraîner volontiers, parce
qu'il n'est personne qui ne goûte ce qu'il chante, et qu'il est plus
aisé de chanter que de prononcer comme il faut. Ensuite il y a
certaines gens qui, dans les loisirs de leurs vices, et cherchant
partout le plaisir, ne viennent que pour entendre des sons qui
flattent leurs oreilles. Mais, va-t-on m'objecter, est-ce que
Cicéron ne dit pas qu'il y a dans la prononciation une sorte de
chant obscur? et ce chant n'a-t-il pas une certaine cause
naturelle?
Je ferai voir tout à l'heure quand et
jusqu'à quel point on peut se permettre cette inflexion, cette sorte
de chant, si l'on veut, mais de chant obscur, ce que la plupart ne
veulent pas comprendre : car il est temps d'expliquer ce que c'est
qu'une prononciation convenable. C'est certainement
celle qui est appropriée aux choses dont on parle. Or, rien ne
contribue tant à cet accord que le mouvement de l'âme, et la voix
résonne selon qu'elle est frappée. Mais comme il y a deux sortes de
sentiments, les uns vrais, les autres feints et imités, les vrais
éclatent naturellement, comme la douleur, la colère, l'indignation
mais leur expression manque d'art, et a besoin par conséquent de
règles et de direction. Les autres, au contraire, sont le produit de
l'art, et non de la nature : aussi, pour les bien exprimer, il faut
se les rendre, pour ainsi dire, personnels, par la puissance de la
sensibilité et de l'imagination. Alors la voix, comme interprète de
nos sentiments, fera passer dans l'âme des juges l'émotion qu'elle
aura prise dans la nôtre; car la voix est l'image de l'âme, et en
subit toutes les variations. Dans la joie, elle est pleine et pure,
et s'épanche avec une sorte de gaieté légère; dans la lutte, elle
s'élève, déploie toutes ses forces, et a, pour ainsi dire, toutes
ses cordes tendues; dans la colère, elle est farouche, âpre,
contrainte et entrecoupée, car l'haleine ne peut être longue
lorsqu'elle se répand outre mesure. S'agit-il de jeter de l'odieux
sur quelqu'un, elle est un peu lente, car ce n'est guère que dans
les inférieurs que la haine se rencontre. Mais veut-on flatter,
descendre à des aveux, donner satisfaction, prier, elle est douce et
soumise; veut-on conseiller, avertir, promettre, consoler, elle est
grave; la crainte et la pudeur la contractent. S'agit-il d'exhorter,
elle est véhémente; de disputer, elle est roulante; de témoigner de
la pitié, elle est, pour ainsi dire, penchée, plaintive, et même un
peu obscure à dessein. Mais dans les digressions elle est coulante,
claire et assurée; dans les récits et les discours familiers, elle
est droite, et tient le milieu entre le ton grave et l'aigu. Elle
s'élève ou s'abaisse avec l'âme tumultueuse ou calme, tantôt plus
haut, tantôt plus bas, selon le degré de passion qu'elle doit
exprimer.
J'ajournerai un peu mes préceptes sur
le ton que réclame chaque partie de l'oraison, parce que j'ai
auparavant à parler du geste, qui lui-même agit de concert avec la
voix, et obéit à l'âme conjointement avec elle.
Pour comprendre l'importance du geste
dans l'orateur, il suffit de considérer tout ce qu'il peut exprimer
sans le secours de la parole : car non seulement la main, mais un
signe de tête, manifestent notre volonté, et tiennent lieu de
langage chez les muets. Souvent la danse se fait entendre et touche,
sans être accompagnée de la voix; à la démarche d'une personne, à
l'air de son visage, on voit ce qu'elle a dans l'âme; enfin les
animaux, tout privés qu'ils sont de la parole, expriment la colère,
la joie, le désir de plaire, par les yeux et certains mouvements du
corps. Au reste, doit-on s'étonner que des signes qui, après tout,
sont animés, fassent tant d'impression sur l'âme, puisque la
peinture, oeuvre muette et immuable, agit si puissamment sur nous,
qu'elle semble quelquefois plus expressive que la parole? Au
contraire, si le geste et le visage ne s'accordent pas avec ce que
nous disons, si nous parlons gaiement d'une chose triste, si nous
disons oui de l'air dont on dit non, nous ôtons à nos paroles non
seulement toute autorité, mais encore toute créance.
Le geste et le mouvement contribuent
aussi à la grâce : aussi Démosthène avait-il coutume de composer son
action devant un grand miroir, tant il était persuadé que, bien que
le miroir réfléchisse les objets à gauche, il ne devait s'en
rapporter qu'à ses yeux pour l'effet qu'il voulait produire! Or, la
tête tient le premier rang dans l'action, comme dans les parties du
corps, soit pour ajouter à la grâce, soit pour ajouter à la
signification. La grâce exige d'abord qu'elle soit droite et dans
son aplomb naturel : car, baissée, elle donne un air d'abjection;
renversée en arrière, d'arrogance; penchée, d'indolence; roide et
immobile, elle accuse une certaine férocité. En second lieu, c'est
de l'action même qu'elle doit recevoir des mouvements, en sorte que,
d'accord avec le geste, elle suive la direction des mains et
l'oscillation du corps : car la tête se tourne toujours du côté du
geste, excepté quand il s'agit d'exprimer la réprobation, le refus,
ou l'horreur. Ainsi, en même temps que nous écartons de la main un
objet odieux, nous détournons la tête avec aversion, comme en
prononçant ce vers :
Détournez, justes dieux, ce malheur loin de nous!
ou celui-ci :
Je ne me juge pas digne d'un tel honneur.
La tête exprime une infinité de choses
: car, outre les mouvements qui lui sont ordinaires pour acquiescer,
refuser ou affirmer, elle en a encore de connus et de communs à tous
les hommes pour témoigner de la pudeur, de l'hésitation, de la
surprise, ou de l'indignation. Cependant les maîtres de l'art
scénique estiment eux-mêmes que c'est un défaut de ne gesticuler
qu'avec la tête. C'en est un aussi de la remuer trop souvent : à
plus forte raison n'appartient-il qu'à un fanatique de faire
tournoyer en l'air sa tête et sa chevelure.
Ce qui domine principalement dans la
tête, c'est le visage. Il implore, il menace, il flatte; il exprime
la tristesse ou la joie, la fierté ou la soumission. C'est sur le
visage que se fixent tous les regards, que se porte toute
l'attention, avant même que l'orateur n'ait ouvert la bouche; c'est
le visage qui décide quelquefois de l'amour ou de la haine. Enfin,
le visage fait entendre une foule de choses, et souvent en dit plus
que tous les discours. C'est pour cela qu'au théâtre les acteurs
composent, pour ainsi dire, jusqu'à leurs masques, et y font lire,
dans la tragédie, la tristesse d'Érope, la rage de Médée, la stupeur
d'Ajax, la frénésie d'Hercule. Et, dans la comédie, outre que le
masque annonce distinctement un esclave, un entremetteur, un
parasite, un paysan, un soldat, une courtisane, une servante, un
vieillard sévère ou indulgent, un jeune homme de bonnes moeurs ou
libertin, une matrone, une jeune fille, on donne encore au père, qui
remplit le principal personnage, un masque ou l'un des sourcils,
fièrement relevé, semble s'armer de colère, tandis que l'autre,
reposant paisiblement sur l'oeil, annonce la douceur; et l'acteur a
soin de montrer le côté du masque qui convient à la situation. Mais
ce qu'il y a de plus expressif dans le visage, ce sont les yeux;
c'est surtout dans les yeux que l'âme se reflète, à tel point que,
même sans qu'ils remuent, la joie les fait briller, et la tristesse
les couvre d'une sorte de nuage. La nature leur a aussi donné les
larmes, dont la source est dans l'âme, et qui s'échappent avec
impétuosité dans la douleur, ou coulent doucement dans la joie. Mais
que dirai-je des expressions variées que leur donne le mouvement?
Tour à tour animés, calmes, fiers, farouches, doux, terribles, ils
parlent tous les langages, au gré de l'orateur et de la cause.
Toutefois, n'affectons jamais de regarder avec des yeux effarés et
démesurément ouverts, ou abattus et mornes, ou stupides, ou agaçants
et mobiles, ou langoureux et comme voilés d'une teinte de volupté,
ou obliques et amoureux, ou qui demandent ou promettent quelque
chose. Car, pour ce qui est de les tenir couverts ou fermés en
parlant, ce ne peut être que le fait d'un homme entièrement dépourvu
d'expérience ou de sens. Les paupières et les joues ont aussi une
certaine part dans cette éloquence du corps, et particulièrement les
sourcils, puisqu'ils dessinent jusqu'à un certain point la forme des
yeux, et règnent, pour ainsi dire, sur le front, qu'ils contractent,
élèvent ou abaissent, à leur gré. Je ne vois rien qui agisse plus
sur cette partie du visage, si ce n'est le sang, qui reçoit son
mouvement des affections de l'âme. Ainsi, lorsque la honte maitrise
le front, le sang s'y porte, et le couvre de rougeur; dans la
crainte, au contraire, il s'enfuit, et laisse, en se retirant, la
pâleur sur la peau glacée; enfin, lorsqu'il est répandu dans un
juste tempérament, il produit cette sérénité qui tient le milieu
entre la rougeur et la pâleur.Pour en revenir aux sourcils, c'est un
défaut quand ils sont tout à fait immobiles, ou quand on les fait
trop jouer, ou quand leurs mouvements se contrarient, comme je le
disais tout à l'heure à propos d'un masque de théâtre, ou quand ces
mouvements ne s'accordent pas avec ce qu'on dit; car ils annoncent
la colère, quand ils se contractent; la tristesse, quand ils se
séparent; la joie, quand ils se relâchent; l'acquiescement ou le
refus, quand ils se haussent ou se baissent. [11,3,80] Je ne vois
guère ce que les narines et les lèvres pourraient exprimer avec
grâce, quoiqu'elles réussissent à marquer la dérision, le mépris et
le dégoût; car se plisser les narines, comme dit Horace, les
gonfler, les mouvoir, y porter sans cesse les doigts, les secouer
brusquement, pour en chasser l'air, les dilater à chaque instant, ou
les retrousser avec le creux de la main, tout cela est inconvenant,
puisque même on blâme, et avec raison, l'action de se moucher
souvent. C'est aussi un défaut d'avancer les lèvres, de les fendre,
de les serrer, de les dilater jusqu'à montrer les dents, de les
élargir presque jusqu'aux oreilles, de les replier dédaigneusement,
de les laisser pendre, et de ne donner passage à la voix que d'un
côté; surtout, de les lécher et de les mordre. Enfin, leur mouvement
doit même avoir peu de part à la prononciation; car on doit parler
de la bouche plutôt que des lèvres. Le cou doit être droit, mais
sans être roide ni renversé. Qu'il ne soit pas non plus ramassé ni
tendu, car ce sont deux défauts qui, quoique différents, sont
également choquants : s'il est tendu, il en résulte un état pénible
qui amoindrit et fatigue la voix; si le menton s'affaisse sur la
poitrine, la pression du gosier rend la voix moins claire et plus
grosse. Il sied rarement de hausser ou de serrer les épaules : cette
posture racourcit le cou, et donne au geste quelque chose de bas, de
servile, et même de faux : aussi, est-elle affectée particulièrement
à l'adulation, à l'étonnement et à la crainte. Avancer modérément le
bras en conservant les épaules dans leur état naturel, et en
déployant la main et les doigts, est un geste très convenable dans
les endroits où l'oraison est continue et rapide; mais, dans ceux où
elle a de l'éclat et de l'abondance, comme ici : Les rochers et
les déserts répondent à la voix du poète, le bras doit s'étendre
à droite et à gauche, en sorte que les paroles et le geste se
développent en même temps.
Quant aux mains, sans lesquelles
l'action serait faible et tronquée, le nombre des mouvements dont
elles sont susceptibles est incalculable, et égale presque celui des
mots; car si les autres parties du corps aident, comme auxiliaires,
à l'action de parler, les mains font plus, elles parlent, ou peu
s'en faut. Elles demandent, elles promettent, elles appellent, elles
congédient, elles menacent, elles supplient; elles expriment
l'horreur, la crainte, la joie, la tristesse, l'hésitation, l'aveu,
le repentir, la mesure, l'abondance, le nombre, le temps.
N'ont-elles pas le pouvoir d'exciter, de calmer, de supplier,
d'approuver, d'admirer, de témoigner de la pudeur? Ne tiennent-elles
pas lieu d'adverbes et de pronoms pour désigner les lieux et les
personnes? en sorte que, au milieu de cette prodigieuse diversité de
langues qui distinguent les peuples et les nations, elles me
paraissent former une espèce de langage commun à tous les hommes. En
tout ceci la main, en accompagnant la parole, agit naturellement;
mais elle a aussi d'autres gestes, par lesquels elle fait entendre
les choses en les imitant. Ainsi, pour exprimer que telle personne
est malade, elle contrefait le médecin qui lui tâte le pouls; ou,
pour exprimer que telle autre sait la musique, elle compose ses
doigts à la manière de ceux qui jouent de la lyre. Mais l'orateur ne
saurait trop fuir ce genre d'imitation, qui ne convient qu'à un
baladin, et c'est au sens bien plus qu'aux paroles qu'il doit
conformer son geste; ce que font même les acteurs qui mettent
quelque gravité dans leur jeu. Si donc je permets à un orateur de
tourner la main vers soi quand il parle de lui-même, ou de la
diriger vers celui qu'il veut désigner, et autres gestes semblables;
d'un autre côté, je ne puis souffrir qu'il copie certaines
attitudes, et qu'il mette en action tout ce qu'il dit. Et ce n'est
pas seulement à l'égard des mains qu'il faut observer ces
convenances, c'est à l'égard de toute espèce de geste, et de la
voix. Ainsi, dans cette période que j'ai déjà citée : On voyait
un préteur du peuple romain, chaussé à la grecque, etc., on ne
singera pas la posture de Verrès penché sur le sein d'une
courtisane; et dans cette autre : Un citoyen romain était battu
de verges sur la place publique de Messine, on n'imitera pas les
mouvements convulsifs d'un corps déchiré par le fouet, ni les
gémissements que la douleur arrache au patient. Je désapprouve même
tout à fait qu'un acteur, même dans le rôle d'un jeune homme, si
néanmoins, dans l'exposition, il a à rapporter le discours d'un
vieillard, comme dans le prologue de l'Hydria, ou d'une
femme, comme dans le Géorgus, affecte une voix tremblante ou
efféminée : tant il est vrai qu'il y a une certaine imitation
vicieuse, que doivent s'interdire ceux même dont tout l'art consiste
dans l'imitation! Pour en revenir à la main, un geste très commun,
c'est d'avoir le doigt du milieu plié contre le pouce, et les trois
autres déployés. Ce geste sied bien dans les exordes, lorsqu'il se
balance doucement, et sans mesurer trop d'intervalle, tandis que la
tête et les épaules suivent d'une manière presque insensible le
mouvement de la main. Dans la narration, il doit être plus déterminé
et en même temps un peu plus développé. Enfin, il doit être vif et
pressant dans les reproches et l'argumentation, qui demandent plus
d'essor et de liberté. Mais ce même geste devient vicieux quand il
se porte de côté et va chercher l'épaule gauche; et ce qui est pis
encore, c'est de faire comme quelques orateurs qui présentent le
bras transversalement et prononcent du coude. Quelquefois ce sont
les deux doigts du milieu qu'on avance sous le pouce, et ce geste
est encore plus pressant que l'autre : aussi, ne convient-il ni à
l'exorde ni à la narration. Mais lorsque les trois derniers doigts
sont fermés sous le pouce, le premier, celui dont, au rapport de
Cicéron, Crassus se servait si bien, s'allonge ordinairement ; et,
dans cet état, il sert à réprimander ou à indiquer, d'où lui est
venu son nom (index). Si la main est élevée et regarde l'épaule, un
peu incliné, il affirme ; tourné vers la terre et comme penché en
avant, il presse, insiste; quelquefois il signifie un nombre. Ce
même doigt, quand on pose légèrement sur son extrémité le doigt du
milieu et le pouce, en courbant un peu les deux derniers, mais le
plus petit moins que l'autre, ce même doigt, dis-je, est propre à la
discussion. Cependant l'argumentation paraît plus vive quand on
tient plutôt l'index par le milieu, en contractant les derniers
d'autant plus que les premiers descendent plus bas. Un autre geste
qui convient particulièrement à un langage modeste, c'est celui où,
les quatre premiers doigts faiblement rapprochés par l'extrémité, la
main se place non loin de la bouche ou de la poitrine, pour
descendre ensuite et s'éloigner à quelque distance, en se déployant.
C'est ainsi, ce me semble, que Démosthène dut commencer cet exorde
si timide, si humble, de son plaidoyer pour Ctésiphon, et que
Cicéron dut composer sa main quand il prononça ces mots : s'il y
a en moi quelque talent, etc. La main semble même proférer les
paroles, lorsque, par un mouvement un peu plus libre et plus
développé, l'orateur la rapproche de lui, les doigts pendants et
regardant la terre, et qu'il la déploie en la relevant vers la
bouche. Tantôt on présente les deux premiers doigts en les écartant,
mais sans insérer le pouce dans l'intervalle, et les deux derniers
doigts penchent en dedans, sans que les premiers soient allongés;
tantôt les deux derniers pressent le creux de la main vers la racine
du pouce, et celui-ci s'unit aux premiers vers le milieu; tantôt le
quatrième est courbé obliquement; tantôt enfin les quatre sont
relâchés plutôt que tendus, et le pouce est incliné en dedans; et,
dans cet état, la main se balance avec assez de grâce, en se
portant, les doigts en haut, vers le côté gauche, et, les doigts en
bas, vers le côté droit, soit pour indiquer ce qui est à droite ou à
gauche, soit pour distinguer les choses dont on parle. [11,3,100]
Quelquefois les mains un peu renversées, à la manière des personnes
qui font quelque voeu, se meuvent avec les épaules sans trop
s'écarter l'une de l'autre; et ce geste convient surtout à un
langage réservé, et presquetimide. Pour exprimer l'admiration, la
main, faiblement renversée, et formant une espèce de cercle avec les
doigts, se déploie et se replie alternativement. L'interrogation a
plusieurs gestes; mais le plus ordinaire, c'est de tourner la main
vers celui qu'on interroge, de quelque manière qu'elle soit
composée. Rapprocher l'index du pouce, et en appuyer l'extrémité sur
le milieu du côté droit de l'ongle du pouce, en relâchant les autres
doigts, est un geste qui convient bien pour approuver, pour narrer,
pour distinguer. Il est fort en usage aujourd'hui chez les Grecs;
avec cette différence qu'ils ferment les trois derniers doigts, et
qu'ils font ce geste des deux mains, toutes les fois qu'ils veulent
figurer aux yeux le cercle de leurs enthymèmes. La main prend un
mouvement doux et saccadé pour promettre et pour agréer; il est plus
vif lorsqu'on exhorte, et quelquefois lorsqu'on loue. Il y a un
geste fort commun, et qui tient plus à la nature qu'à l'art: c'est
de fermer et d'ouvrir la main alternativement et avec vitesse, quand
on parle avec véhémence. Lorsque la main, faisant un creux avec les
doigts, gesticule légèrement au-dessus de l'épaule, elle a l'air
d'encourager; mais il ne faut pas qu'elle s'agite avec tremblement,
quoique ce geste, emprunté aux écoles étrangères, semble autorisé
par l'usage : cela n'est bon qu'à la scène. Je ne sais pourquoi
certaines gens n'aiment pas que l'orateur rapproche la main de sa
poitrine, en réunissant les doigts par leurs extrémités; car nous
faisons naturellement ce geste pour exprimer un léger étonnement, ou
même cette sorte de terreur et de déprécation qui accompagne une
indignation subite. On peut même, et cela n'est pas sans grâce, sous
l'impression du repentir ou de la colère, serrer sa main contre son
coeur, enjoignant à ce geste quelques mots prononcés entre les
dents, comme eaux-ci : A quoi me résoudre? que faire? Pour ce
qui est de désigner quelqu'un avec le pouce renversé, c'est un geste
plus usité que bienséant.
En résumé, on compte six gestes,
auxquels on peut en ajouter un septième, c'est-à-dire celui qui
revient en cercle sur lui-même. Ce dernier est le seul qui soit
vicieux; des six autres, cinq s'emploient fort bien pour indiquer ce
qui est devant nous, à droite, à gauche, en haut, en bas ; quant au
sixième, c'est-à-dire à celui qu'on pourrait faire pour désigner ce
qui est par derrière, il n'a jamais lieu, ou l'on se borne à faire
semblant de repousser quelque chose en arrière. Quant au mouvement
de la main, il commence fort bien à gauche pour finir à droite, mais
il doit s'arrêter sans frapper l'air. Cependant, en marquant la fin
d'une phrase, la main tombe quelquefois pour se relever aussitôt, et
quelquefois elle rebondit, dans les mouvements saccadés qui
accompagnent la négation ou l'étonnement. Ici, les anciens maîtres
de la prononciation ajoutent fort sagement que le mouvement de la
main doit commencer et finir avec le sens. Autrement, en effet, ou
le geste précéderait la voix, ou continuerait après : ce qui serait
également choquant. Mais ces mêmes auteurs ont trop raffiné, en
proscrivant de mettre trois mots d'intervalle entre chaque geste ;
car cela ne s'observe pas, ni ne peut s'observer. Toutefois, ils ont
eu raison, s'ils ont voulu seulement, comme je le pense, qu'il y eût
une certaine mesure de lenteur ou de vitesse, soit pour que la main
ne restât pas trop longtemps oisive, soit pour que l'action ne fût
pas une suite non interrompue de mouvements rapides; ce qui est le
défaut de beaucoup d'orateurs. Mais voici un défaut où l'on tombe
plus souvent, par suite d'une erreur dont la raison est assez
spécieuse. Il y a dans la prose une secrète cadence, je dirais
presque une sorte de pieds, selon lesquels beaucoup de gens règlent
la chute de leurs mouvements. Ainsi, dans la période suivante :
Nouum crimen, C. Caesar, et ante hanc diem non auditum, propinquus
meus ad te Q. Tubero detulit, ils ont un premier battement pour
nouum crimen; un autre pour C. Caesar, un troisième pour
et ante hanc diem, un quatrième pour non auditum, un
cinquième pour propinquus meus, etc. Or, il arrive de là que
les jeunes gens, quand ils écrivent, composant intérieurement leurs
gestes par anticipation, subordonnent l'arrangement des mots à la
chute de la main : d'où résulte cet autre inconvénient, que le
geste, qui doit finir à droite, finit souvent à gauche. Le mieux
donc, puisque toute période est composée de certains membres assez
courts, après lesquels on peut, au besoin, reprendre haleine, c'est
d'y proportionner son geste. Ainsi, ces mots : Nouum crimen, C.
Caesar, ont jusqu'à un certain point un sens fini, puisqu'ils
sont suivis d'une conjonction ; ensuite ceux-ci : et ante hanc
diem non auditum, présentent un sens suffisamment développé.
Voilà ce qui doit régler le geste, surtout en commençant, et lorsque
l'action est encore calme et réservée. Mais, à mesure qu'elle
s'échauffera en suivant la marche toujours croissante du discours,
le geste deviendra plus fréquent : ici, la prononciation sera
rapide; là, elle sera lente : rapide, pour franchir, accumuler,
abonder, courir au but; lente, pour insister, inculquer, imprimer.
La lenteur convient plus au pathétique : ainsi Roscius était plus
vif, Ésope plus grave, parce que le premier jouait dans le comique,
et le second dans le tragique. Il faut observer la même règle pour
les mouvements du corps. Sur le théâtre, les fils de famille, les
vieillards, les gens de guerre, les matrones, ont une démarche
grave; tandis que les esclaves, les servantes, les parasites, les
pêcheurs, ont peu de tenue. Les maîtres de l'art défendent d'élever
la main plus haut que les yeux, et de la descendre plus bas que la
poitrine : à plus forte raison est-ce un défaut de la ramener du
sommet de la tête, ou de l'abaisser jusqu'à l'extrémité du ventre.
Si on l'avance vers l'épaule gauche, il faut qu'elle demeure en deçà
: au delà, le mouvement serait vicieux. Mais lorsque, en signe
d'aversion, nous chassons, pour ainsi dire, notre main du côté
gauche, il faut exhausser l'épaule du même côté, pour qu'elle suive
l'inclinaison de la tête, qui se porte du côté droit. La main gauche
n'est jamais gracieuse; mais souvent elle agit de concert avec la
main droite, soit qu'on déduise ses arguments sur ses doigts, soit
qu'on rejette ses deux mains vers la gauche, dans un mouvement
d'horreur, soit qu'on les porte en avant, ou qu'on les étende, l'une
du côté droit, l'autre du côté gauche, pour offrir satisfaction ou
pour supplier. Le geste auquel concourent les deux mains a aussi sa
diversité : tantôt on les abaisse, tantôt on les élève pour adorer,
tantôt on les tend devant soi pour indiquer ou pour invoquer, comme
dans cette apostrophe : Vous, tombeaux et bois sacrés des Albains!
et dans cette exclamation de Gracchus: Malheureux! où me
réfugier? Sera-ce au Capitole? il fume encore du sang de mon frère.
Sera-ce dans ma maison?.... Or, en pareil cas, le concours des
deux mains produit plus d'effet. Dans les choses de peu
d'importance, et dans tout ce qui demande de la tristesse ou de la
douceur, le mouvement des mains a peu d'expansion; dans les grands
sujets, ou quand il s'agit d'exprimer la joie ou l'indignation,
c'est le contraire.
J'ai à parler maintenant des défauts
où tombent même des avocats exercés. Car, pour les gestes d'un homme
qui demande à boire, ou qui menace du fouet, ou qui plie le pouce
pour indiquer le nombre 500, quoique quelques écrivains en aient
fait mention, je ne les ai jamais rencontrés chez les avocats même
les plus grossiers. Mais de déployer le bras jusqu'à laisser voir
l'aisselle, ou de l'étendre horizontalement dans toute sa longueur,
ou de n'oser détacher la main de son sein, ou de l'élever jusqu'au
plancher, ou de l'agiter comme un fléau, en gesticulant par delà
l'épaule gauche avec tant de violence qu'il n'y ait pas de sûreté à
se tenir derrière, ou de la ramener à gauche par un mouvement
circulaire, ou de heurter les voisins en la jetant çà et là, ou
d'éventer leurs coudes en les secouant de chaque côté, c'est, je le
sais, ce qui arrive souvent. Chez certains orateurs la main est
paresseuse, ou va et vient avec anxieté, ou bien a toujours l'air de
couper quelque chose. On en voit qui, en tenant leurs doigts
crochus, la jettent de haut en bas, ou, la retournant en sens
contraire, la lancent par-dessus leur tête. Quelques-uns affectent
la pose que les statuaires donnent ordinairement au pacificateur,
qu'ils représentent la tête inclinée sur l'épaule droite, le bras
étendu à la hauteur de l'oreille, la main déployée, et le pouce en
dehors. C'est dans cette attitude que se complaisent ceux qui se
vantent de parler haut la main. [11,3,120] On peut ajouter ceux qui
dardent, pour ainsi dire, leurs pensées, en brandissant leurs
doigts, ou qui lèvent la main d'un air de menace, ou qui, toutes les
fois qu'ils sont contents d'eux-mêmes, se dressent sur leurs pieds;
ce qui, à la vérité, est permis quelquefois, mais ce qu'ils rendent
vicieux, en élevant, autant qu'ils le peuvent, un doigt et même
deux, ou en arrangeant leurs mains comme s'ils avaient quelque chose
à porter. Outre ces défauts, il y en a d'autres qui tiennent plutôt
à la précipitation qu'à la nature, comme de se fâcher contre
soi-même à l'occasion d'un mot qu'on a de la peine à prononcer; de
tousser quand la mémoire vient à manquer, ou que la pensée ne
fournit plus rien, comme si l'on avait quelque empêchement dans la
gorge; de s'essuyer le nez en le retroussant; de se promener avant
d'avoir achevé ce que l'on avait commencé; de s'arrêter tout à coup,
et de mendier des applaudissements par son silence. Je ne finirais
pas, si je voulais énumérer tous ces défauts; car chacun a les
siens.
Il faut observer de ne point trop
avancer la poitrine ni le ventre, parce que cette attitude courbe la
partie postérieure du corps, et que toute posture où l'on se
renverse est indécente. Les flancs doivent aussi s'accorder avec le
geste; car le mouvement du corps entier entre pour quelque chose
dans l'action; et même, au jugement de Cicéron, il est plus
expressif que les mains elles-mêmes. Voici ce qu'il dit à ce sujet
dans son Orateur : Que l'orateur s'abstienne de remuer les
doigts, et de s'en servir pour marquer la cadence; que son action
vienne plutôt de l'ébranlement général du corps, et d'une certaine
flexibilité des reins qui n'ait rien que de mâle. Se frapper la
cuisse est un geste dont on croit que Cléon a le premier donné
l'exemple à Athènes; il est usité, il sied à l'indignation, et sert
à réveiller les auditeurs. Cicéron trouve que ce geste manquait à
Calidius : Jamais, dit-il, il ne se frappait le front ni la
cuisse. Pour le front, s'il est permis de contredire Cicéron, je
ne suis pas de son avis, puisque l'action de battre des mains ou de
se frapper la poitrine ne convient guère qu'aux comédiens. Rarement
aussi sied-il d'approcher la main de l'estomac en faisant le creux
avec les doigts réunis par leurs extrémités, lorsqu'on se parle à
soi-même, pour s'encourager, se faire quelque reproche, ou plaindre
son malheur; et, s'il y a lieu de le faire, on pourra même
entr'ouvrir sa robe.
A l'égard des pieds, il faut observer
deux choses : comment on les pose et comment on les meut. Se tenir
debout et immobile avec le pied droit en avant, ou avancer à la fois
la main droite et le pied droit, sont des attitudes vicieuses. Il
est quelquefois permis de s'appuyer sur le pied droit, mais pourvu
que la poitrine ne suive pas l'inclinaison du reste du corps :
encore cette posture est-elle plutôt celle d'un comédien que d'un
orateur. Si l'on s'appuie sur le pied gauche, il faut éviter de
lever le pied droit, ou de le tenir sur la pointe. Écarter trop les
jambes, quand on se tient debout, est une posture indécente, qui
même, pour peu qu'on s'agite, a quelque chose d'obscène. L'orateur
peut se porter en avant, mais il ne doit le faire qu'à propos, à peu
de distance, avec lenteur, et rarement. Il peut aussi faire quelques
pas, comme s'il se promenait, en attendant que l'auditeur ait mis
fin à ses applaudissements, quoique Cicéron recommande que les
allées et venues soient rares et surtout fort courtes. Pour ce qui
est de courir çà et là, et de faire l'homme affairé, comme Domitius
Afer le disait de Mallius Sura, cela est tout à fait ridicule. Aussi
Flavus Virginius demandait-il plaisamment, en parlant d'un rhéteur,
son antagoniste, combien il avait déclamé de milles. Je sais
qu'on recommande encore de ne pas tourner le dos aux juges en
marchant, mais d'avoir toujours les pieds et les yeux tournés vers
le tribunal. Cela n'est pas praticable dans les causes privées; mais
comme le lieu est peu spacieux, si on tourne le dos au juge, ce
n'est que pour quelques moments. On peut, d'ailleurs, éviter cet
inconvénient en se reculant tout doucement, et non en sautant en
arrière, comme font quelques orateurs, ce qui est tout à fait
ridicule. Le frappement du pied peut n'être pas déplacé, ainsi que
le remarque Cicéron, au commencement ou à la fin d'une discussion;
mais s'il est trop fréquent, il devient ridicule, et n'attire plus
l'attention du juge. On a encore mauvaise grâce à se balancer en se
tenant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Mais on ne saurait
trop fuir cette action molle, telle qu'était, au rapport de Cicéron,
celle de Titius, qui a donné son nom à un genre de danse. Il y a
aussi une certaine oscillation, qui n'est pas moins blâmable,
surtout lorsqu'elle est fréquente et rapide. C'était le défaut de
Curion le père, dont Julius se moqua, en demandant qui était cet
homme qui parlait dans un bateau. Sicinius le railla aussi fort
agréablement. Curion s'étant beaucoup dandiné, selon son habitude,
auprès de son collègue Octave, qui était enveloppé de linges et
couvert d'emplâtres, à cause de son état de maladie, Sicinius
s'approcha de ce dernier, et lui dit : Vous ne pourrez jamais
reconnaître assez le service que vous a rendu votre collègue; sans
lui, vous auriez été aujourd'hui mangé des mouches. Évitez aussi
l'habitude de hausser les épaules à tout moment. Démosthène avait ce
défaut, et, pour s'en corriger, dit-on, il parlait debout dans une
sorte de tribune fort étroite, d'où pendait une pique audessus de
son épaule, afin que si, dans la chaleur du débit, ce mouvement
venait à lui échapper, la piqûre du fer lui servît d'avertissement.
Si jamais il peut être nécessaire de marcher en parlant, ce n'est
que dans les causes publiques, à cause du grand nombre de juges, et
lorsque nous voulons nous faire bien comprendre de chacun d'eux en
particulier. Mais je ne puis souffrir ce que je vois faire à
quelques orateurs, qui, après avoir rejeté leur robe sur l'épaule et
en avoir relevé les plis jusqu'aux reins avec la main droite, se
promènent et devisent en gesticulant de la main gauche. Cela est
certainement peu modeste, puisqu'il est même inconvenant de relever
sa robe du côté gauche, lorsqu'on avance un peu la main droite.
C'est ici le lieu de faire remarquer que rien n'est plus contraire
au bon ton, pendant ces pauses qu'on est obligé de faire pour
laisser passer les applaudissements, que de parler à l'oreille de
quelqu'un, ou de plaisanter avec ses confrères, ou de jeter un coup
d'oeil à ses secrétaires, comme pour leur recommander la sportule.
Il est permis de se pencher vers le juge lorsqu'il s'agit de
l'instruire, surtout si ce dont on parle est un peu obscur; mais il
est injurieux de se coucher sur l'avocat de la partie adverse ; et
c'est le fait d'un homme mou, de se laisser tomber dans les bras de
ses clients et de se faire soutenir par eux, à moins qu'on ne
succombe véritablement de fatigue, comme de se faire souffler ou de
lire, pour soulager sa mémoire. Qu'arrive-t-il, en effet, de tout
cela? La plaidoirie languit, les sentiments se refroidissent, et le
juge est porté à croire qu'on a peu de respect pour lui. C'est
manquer de réserve, que de passer dans les bancs de la partie
adverse, et justifier la plaisanterie de Cassius Sévérus, qui,
voyant son adversaire venir à lui, demanda qu'on mît une barre entre
eux deux. D'ailleurs, si cette excursion se fait avec chaleur, le
retour est toujours froid.
Au reste, parmi les préceptes que je
viens de donner, il y en a plusieurs qui souffrent quelque
modification, quand on plaide devant les tribunaux supérieurs : car
le siége du juge étant plus élevé, l'orateur est alors forcé de
porter ses regards et ses bras plus haut. Cette différence n'est pas
la seule; mais chacun peut suppléer à ce que je passe sous silence.
J'en dis autant pour les avocats qui plaident assis, ce qui a lieu
d'ordinaire dans les petites causes. L'action y comporte moins de
mouvement, et se trouve même nécessitée à certains défauts. En
effet, comme l'orateur est assis à la gauche du juge, il est obligé
d'avancer le pied droit, et de diriger beaucoup de ses gestes vers
la gauche.
Je vois la plupart des avocats se
lever à la chute de chaque période; quelques-uns même se promener
ensuite pendant quelques moments. Cela est-il bienséant? je les en
fais juges : toujours est-il que ce n'est pas plaider assis. Pour ce
qui est de boire et de manger en plaidant, c'est une liberté qu'on
prenait autrefois assez communément, et qu'aujourd'hui on prend
encore quelquefois; mais je l'interdis absolument à mon orateur. Si
l'on ne peut supporter sans cela la fatigue d'un plaidoyer, ce n'est
pas un si grand malheur que de ne pas plaider, et cela vaudrait
beaucoup mieux que de respecter si peu sa profession et son
auditoire.
Quant à l'habillement, il n'y en a pas
de particulier pour l'orateur; mais comme il se remarque davantage
en lui, sa parure, comme celle de toutes les personnes de
distinction, doit être éclatante et mâle tout ensemble; car la
recherche et la négligence sont également répréhensibles dans la
toge, dans la chaussure, et dans les cheveux. Ce qui regarde le
vêtement de dessus n'est pas sans importance, et le temps y a
apporté îles changements. Les anciens ne connaissaient point les
plis : la mode en est venue plus tard, et ces plis furent d'abord
très-courts. Aussi, les orateurs de ce temps-là, qui tenaient leurs
bras cachés sous leur tunique, à la manière des Grecs, devaient
avoir nécessairement un geste différent du nôtre dans les exordes;
mais il s'agit des vêtements actuels. L'orateur qui n'a pas le droit
de porter le laticlave doit se ceindre de telle sorte, que la
tunique descende par devant un peu au-dessous des genoux, et par
derrière jusqu'au milieu des jarrets; plus bas, cela ne convient
qu'aux femmes, et, plus haut, qu'aux centurions. Les bandes de.
pourpre doivent descendre perpendiculairement. C'est un soin peu
important; mais pourtant, si on ne le prend pas, c'est une
négligence qui se fait quelquefois remarquer. Comme on ne met pas de
ceinture par-dessus le laticlave, il doit descendre un peu plus bas
que l'angusticlave. La toge doit être arrondie et bien taillée :
autrement, elle grimacera de tous côtés. Elle doit par devant se
terminer à mi-jambe, et par-derrière s'arrêter un peu moins bas,
dans la proportion de la ceinture. [11,3,140] Un pli fait très-bien
un peu au-dessus du bas de la toge, mais jamais au-dessous. Cette
espèce de plissure, qui prend par-dessous l'épaule droite et va
gagner l'épaule gauche, en forme de baudrier, ne doit être ni trop
serrée ni trop lâche. Le pan de robe, qui se met ensuite sur le
bras, doit flotter au-dessous, et, de cette façon, il aura plus de
grâce et tiendra mieux. Il faut aussi retrousser un peu la tunique,
afin qu'elle n'embarrasse pas les bras dans l'action; puis on
jettera un pli sur l'épaule, en le relevant par l'extrémité, ce qui
n'est pas sans grâce. Mais il faut éviter de se couvrir entièrement
l'épaule et le cou : autrement nos vétements paraîtraient trop
étroits, et nous feraient perdre cette dignité que donne une large
poitrine. Le bras droit ne doit être levé que juste ce qu'il faut
pour former un angle droit, et les deux bouts de la robe doivent
pendre de chaque côté du bras dans une égale longueur. Je ne veux
pas que l'orateur surcharge ses mains de bagues, ni surtout que ces
bagues passent le milieu du doigt. La meilleure attitude pour la
main, c'est d'avoir le pouce levé et les doigts un peu pliés, à
moins qu'elle ne tienne des tablettes; ce qu'il ne faut pas
affecter, car c'est avouer qu'on se défie de sa mémoire, et c'est
d'ailleurs un empêchement pour beaucoup de gestes. Les anciens
laissaient tomber leur toge jusque sur leurs pieds, à l'exemple des
Grecs; et ceux qui ont écrit sur le geste dans ce temps-là, comme
Plotius et Nigidius, en ont fait un précepte. Aussi je m'étonne
qu'un aussi savant homme que Pline, et dans un ouvrage où il a
poussé l'esprit d'investigation presque jusqu'à l'excès, ait avancé,
comme une chose certaine, que Cicéron laissait traîner sa robe pour
cacher ses varices, d'autant plus que cet usage se retrouve dans les
statues de personnages postérieurs à Cicéron. A l'égard des
capuchons, des bandelettes dont on s'enveloppe les jambes, et de
toutes autres délicatesses pareilles, il n'y a qu'une mauvaise santé
qui les puisse rendre excusables. Mais ce soin dans la manière de se
draper n'est bon qu'en commençant; car, à mesure qu'on avance, il
n'y faut pas regarder de si près; et, dès les premiers mots de la
narration, on peut laisser la robe tomber, comme d'elle-même, de
dessus l'épaule. Enfin, quand on est arrivé aux arguments et aux
lieux communs, il sied bien de relever sa robe sur l'épaule gauche,
d'abattre même les plis qui ne se dérouleraient pas d'eux-mêmes; et
il est aussi permis de se dégager de tout ce qui entoure, du côté
gauche, le cou et la partie supérieure de la poitrine. En effet,
tout s'échauffe, et, de même que la voix devient plus véhémente et
plus variée, il est bon que le vêtement participe aussi de cette
image de combat. Si donc il n'appartient qu'à un furieux de
s'envelopper la main gauche avec sa robe, ou de s'en faire une
ceinture; s'il y a trop d'abandon et de délicatesse à rejeter le pan
de sa robe pardessus l'épaule droite; s'il est enfin quelques autres
défauts encore plus contraires à la bienséance, rien n'empêche
cependant qu'on ne retrousse une partie de sa robe sous le bras
gauche. Cette attitude a quelque chose de résolu et de dégagé, qui
convient à la chaleur et à la vivacité de l'action. Mais quand le
plaidoyer touche à sa fin, secondé par d'heureux présages, alors des
vêtements en désordre, une robe qui semble se détacher du corps et
tomber de tous côtés, la sueur même et l'accablement, tout sied à
l'orateur. Comment donc a-t -il pu venir à l'esprit de Pline de lui
recommander d'avoir soin, en s'essuyant le front, de ne pas déranger
sa chevelure? Il est vrai que peu après, reprenant une gravité digne
de lui, il lui défend sévèrement de s'occuper de sa coiffure. Pour
moi, je crois que des cheveux mal en ordre ont quelque chose de
passionné, et qu'en cela, la distraction n'est rien moins que
nuisible à l'orateur. Il n'en est pas de même quand on commence à
parler, ou qu'on est encore peu avancé; car alors si la robe vient à
tomber, ne pas la relever est véritablement de la négligence, ou de
la paresse, ou de la maladresse.
Telles sent les beautés, tels sont les
défauts de la prononciation. Après s'être mis tout cela, devant les
yeux, l'orateur aura à considérer les personnes et les choses. Il
examinera d'abord qui il est, par-devant qui et en présence de qui
il doit parler. En effet, comme il y a un langage, il y a aussi une
action proportionnée à ceux qui parlent et à ceux devant qui on
parle. Aussi, le même ton, les mêmes gestes et la même démarche ne
conviendront pas également devant le prince, devant le sénat, devant
le peuple, et devant un magistrat, dans une cause privée et dans une
cause publique, dans une simple requête, et dans une accusation en
forme. Avec un peu d'attention, il est aisé de saisir ces
différences. Ensuite, l'orateur examinera le sujet qu'il traite et
le but qu'il se propose. A l'égard du sujet, il donne lieu à quatre
considérations. La première a pour objet la nature de la cause ; car
elle est triste ou gaie, périlleuse ou rassurante, importante, ou de
peu de conséquence; mais on ne doit jamais se préoccuper des détails
d'une cause, jusqu'à en oublier l'esprit général. La seconde regarde
les différentes parties de la cause, comme l'exorde, la narration,
l'argumentation, l'épilogue. La troisième a trait aux pensées, dans
l'expression desquelles tout doit 1 varier, suivant la nature des
choses et des sentiments. La quatrième doit s'attacher aux mots; car
si l'on pèche par excès, en voulant les exprimer tous par une action
conforme à l'idée qu'ils renferment, on ôte aussi à quelques-uns
toute leur force, si l'on n'en représente pas le sens. Ainsi dans
les éloges (j'excepte les oraisons funèbres), dans les remerciments,
dans les exhortations, et autres sujets de même espèce, l'action
doit être riche, magnifique, élevée. Dans les oraisons funèbres,
dans les consolations, dans la plupart des causes criminelles, elle
doit être triste et humble. Il faut de la gravité devant le sénat,
de la dignité devant le peuple, et un juste milieu dans les affaires
privées. Quant aux parties de la cause, et aux pensées et aux mots,
leur nature multiple demande une plus ample explication. Or,
l'orateur doit se proposer trois choses dans la prononciation : de
se concilier les juges, de les persuader, de les émouvoir, et (ce
qui est naturellement inséparable de ces trois fins) de leur plaire.
Il se les concilie d'ordinaire, soit par ses qualités morales,
lesquelles, je ne sais comment, se décèlent jusque dans sa voix et
dans ses gestes, soit par l'aménité du langage. Il les persuade par
un certain ton affirmatif, qui produit souvent plus d'effet que les
preuves mêmes. Si cela était vrai, dit Cicéron à Calidius,
le diriez-vous sur ce ton? et ailleurs : Tant s'en, faut que
nous fussions enflammés par vos paroles, qu'à peine pouvions–nous
nous défendre du sommeil. Que l'orateur sache donc montrer de
l'assurance et de la fermeté, surtout s'il a d'ailleurs quelque
autorité. Enfin, il les touchera, s'il sait bien exprimer les
passions, soit par la force du sentiment, soit par l'imitation.
Aussitôt donc que le juge, dans les
causes privées, ou que l'huissier, dans les causes publiques, nous
aura avertis de prendre la parole, levons-nous avec calme ; puis,
afin de nous présenter dans un état décent, et de nous ménager en
même tems quelques minutes de réflexion, arrêtons-nous un peu à
rajuster notre robe, ou même, s'il est nécessaire, à la remettre
entièrement, mais seulement dans les jugements ordinaires; car
devant le prince, ou les magistrats, ou les tribunaux du premier
ordre, cela n'est pas permis. Et même, lorsque nous nous serons
tournés vers le juge, et que le préteur nous aura accordé la
parfile, au lieu de s'en emparer brusquement, recueillons-nous un
instant; car rien n'est plus agréable à l'auditeur que ces
préparatifs de l'orateur, qui donnent d'ailleurs au juge lui-même le
temps de se composer. C'est ce qu'Homère nous enseigne, quand il dit
d'Ulysse, qu'il resta longtemps debout, les yeux fixés en terre,
et tenant son sceptre immobile, avant de donner cours au torrent de
son éloquence. Il est encore certains actes que les comédiens
appellent délais, et au moyen desquels on peut temporiser sans
blesser les convenances, comme de se frotter la tête, de regarder
ses mains, de faire craquer ses doigts, de feindre un grand effort,
de marquer son anxiété par des soupirs, et autres semblables, selon
qu'ils conviendront à chaque orateur; et cela, jusqu'à ce que le
juge veuille bien nous prêter attention. Il faut se tenir droit, les
pieds sur la même ligne et un peu écartés, ou, si l'on veut, le pied
gauche quelque peu en avant; les genoux d'aplomb, mais sans
contrainte; les épaules rassises; l'air sérieux, sans être morne, ni
stupéfait, ni languissant; les bras un peu détachés des flancs; la
main gauche dans la position que je lui ai déjà assignée; la droite
se déployant, au moment de commencer, à quelque distance du sein,
avec un geste plein de retenue, et comme attendant l'ordre de
commencer. [11,3,160] Car on ne saurait trop éviter certains
défauts, comme d'avoir les yeux attachés au plafond, de se frotter
le visage avec la main, et de le renfrogner; de le roidir pour se
donner un air d'assurance, ou de froncer les sourcils pour lui
imprimer quelque chose de farouche; de rejeter ses cheveux en
arrière, pour inspirer l'horreur et l'effroi; de paraître étudier ce
qu'on va dire, en agitant continuellement les doigts et en remuant
les lèvres, défaut très commun chez les Grecs; de cracher avec
bruit; d'allonger une jambe; de tenir une partie de sa robe avec la
main gauche; d'être tantôt en deux, tantôt roide, ou renversé, ou
courbé ; de hausser les épaules jusqu'à l'occiput, comme des
athlètes prêts à lutter.
Dans l'exorde, la prononciation doit
être ordinairement calme; car rien n'est plus propre que la réserve
à nous concilier les juges : je dis ordinairement, car il y a
plusieurs sortes d'exordes, ainsi que nous l'avons vu. Toutefois, un
son de voix tempéré, un geste qui n'a rien d'outré, la robe arrêtée
sur l'épaule, un mouvement doux dans le balancement du corps de
droite à gauche, le regard fixé sur le même point, voilà ce qui
convient la plupart du temps à l'exorde. La narration demande que la
main se porte plus en avant, que la robe soit tombante, le geste
distinct. La voix doit y être seulement un peu plus vive que dans la
conversation, et le ton presque toujours simple, comme dans ces
récits : Q. Ligarius, lorsqu'il n'y avait pas encore en Afrique
la moindre apparence de guerre, etc.; — A. Cluentius, qui
passait pour le père de celui qui est devant vous, etc. Mais
c'est autre chose quand le récit comporte de l'indignation, comme
ici : On voit une belle-mère épouser son gendre; ou de la
pitié : La place publique de Laodicée devient le théâtre d'un
spectacle dont l'horreur a ému toute la province d'Asie. Dans la
preuve, l'action doit être très variée; car, bien que pour proposer,
diviser, interroger, aller au-devant d'une contradiction (ce qui est
emprunter une proposition à la partie adverse), on ne s'éloigne
guère du ton de la conversation, cependant, même dans cette partie
du discours, on mêle quelquefois à la prononciation un air de
raillerie,et quelquefois on y contrefait la partie adverse. Quant à
l'argumentation, comme elle est presque toujours vive, animée,
pressante, elle veut un geste qui réponde aux paroles, c'est-à-dire
fort et rapide; car il est des points sur lesquels il faut
particulièrement insister, et où le mot serre de près le mot. La
plupart des digressions n'ont besoin que d'un ton coulant, doux et
relâché, comme l'enlèvement de Proserpine, la description de la
Sicile, l'éloge de Pompée; et l'on ne doit pas s'étonner que ce qui
est en dehors de la question demande moins de contention.
L'imitation des manières de la partie adverse est quelquefois
supportable, quand elle accompagne le blâme de sa conduite, comme
ici : "Il me semblait voir les uns entrer, les autres sortir,
ceux-là chanceler sous les vapeurs du vin", etc. On sent que, dans
cette description, une gesticulation conforme à la voix n'a rien de
choquant, pourvu qu'elle se renferme dans un mouvement gracieux des
bras de droite à gauche, auquel les flancs n'aient point de part.
Quand il s'agit d'enflammer le juge, la prononciation comporte
plusieurs degrés. Le ton le plus haut et le plus aigu est celui dont
Cicéron a dû prononcer ces mots : La guerre étant entreprise,
César, et même en grande partie achevée, etc. ; car il avait dit
auparavant : J'élèverai la voix autant que je le pourrai, pour
être entendu de tout le peuple romain. Un ton un peu plus bas,
et qui a déjà quelque chose d'agréable, convenait aux paroles
suivantes : Dites-nous, Tubéron, que faisait votre épée dans les
champs de Pharsale? Il en fallait un plus plein, plus lent, et
par conséquent plus doux, dans ce passage : Mais dans une
assemblée du peuple romain, etc. Ici, en effet, tout doit être
allongé; il faut traîner les syllabes, et ouvrir le gosier.
Cependant la phrase suivante demande un ton encore plus plein, et
doit couler à plein canal : Vous, tombeaux et bois sacrés des
Albains! Pour celle-ci : Les rochers et les déserts répondent
à la voix du poète, elle invite à prendre un ton qui tient un
peu du chant, et s'y abandonne insensiblement. Ce sont ces diverses
inflexions de voix que Démosthène et Eschine se reprochent
mutuellement, et qu'il ne faut pas pour cela condamner; car, en se
les reprochant, ils nous apprennent par là qu'ils en faisaient usage
l'un et l'autre. Et, en effet, ce ne fut sans doute pas sur un ton
simple que le premier jura par les mânes des guerriers morts à
Marathon, à Platée et à Salamine ; ni que le second déplora le
malheur de Thèbes. Enfin, il y a un ton tout différent de ceux-ci,
et qui est presque en dehors de l'organe : c'est un ton aigre outre
mesure, et même presque contra ire à la nature de la voix humaine,
auquel les Grecs ont donné un nom qui désigne l'amertume : Que ne
faites-vous taire ces gens, qui accusent votre folie, et témoignent
combien vos complices sont peu nombreux? mais ce n'est que dans
les premiers mots que se fait sentir cette aigreur dont je parle.
Quant à l'épilogue, s'il se borne à la récapitulation des faits, il
demande une certaine continuité de sons coupés; si l'on s'y propose
d'exciter les juges, on prendra un des tons que j'ai indiqués plus
haut; mais s'il s'agit de les apaiser, le ton sera soumis et doux ;
ou, si l'on veut émouvoir leur pitié, il faudra recourir alors à ces
inflexions tendres et plaintives qui sont si propres à amollir les
coeurs, et en même temps si naturelles; car, jusque dans les
funérailles, les veuves et les orphelins expriment leur douleur par
des cris qui ont quelque chose de musical. C'est aussi là que cette
voix sombre, telle que l'avait Antoine, au rapport de Cicéron, est
d'un si merveilleux effet, puisqu'elle a naturellement et par
elle-même ce qu'elle imite. Mais il y a deux sortes de pitié : l'une
mêlée d'indignation, comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de la
condamnation de Philodamus; l'autre, plus humble, et suppliante.
C'est pourquoi, bien qu'il y ait une sorte de chant obscur dans la
prononciation de ces paroles : Mais dans l'assemblée du peuple
romain, car Cicéron ne les a pas prononcées du ton d'un homme qui se
dispute; et de celles-ci : Et vous, tombeaux des Albains, car
ce n'est ni par exclamation ni par forme d'invocation que cela est
dit; cependant il a dû prendre une inflexion infiniment plus molle
et plus traînante dans les passages suivants : Malheureux que je
suis! — Que répondrai je à mes enfants? — Vous avez pu, Milon, me
rendre à ma patrie, etc.; et lorsque, obligé d'adjuger les biens
de Rabirius à vil prix, il s'écrie : O que le ministère de ma
voix est aujourd'hui triste et rigoureux! Il est aussi d'un très
bon effet, dans la péroraison, de confesser que l'on succombe sous
le poids de la douleur et de la fatigue, à l'exemple de Cicéron dans
son plaidoyer pour Milon : Mais il est temps de finir; car je
sens que les larmes étouffent ma voix ; et ici la prononciation
doit être conforme aux paroles. Il semble encore entrer dans les
devoirs de la péroraison de ranimer les accusés, de prendre leurs
enfants entre ses bras, d'introduire devant le tribunal leur famille
désolée, de déchirer ses vêtements, etc.; mais j'ai traité de tout
cela en son lieu. Et comme la prononciation est susceptible de la
même variété dans toutes les autres parties de l'oraison, il est
évident qu'elle doit être, comme je l'ai démontré, conforme aux
pensées. Il faut aussi qu'elle s'accorde avec les mots, comme je
l'ai dit en dernier, non pas toujours, mais quelquefois. Par
exemple, ces mots : l'infortuné, le pauvre malheureux, ne
demandent-ils pas une prononciation humble et contrainte; tandis que
des mots différents, comme courageux, véhément,
brigand, demandent une prononciation forte et animée? En effet,
cette concordance donne aux choses plus d'énergie et de propriété :
autrement, la voix ferait entendre une chose, et la pensée une
autre. Enfin, un même mot, suivant l'intonation qu'on lui donne,
sert à indiquer, à affirmer, à censurer, à nier, à interroger, à
exprimer l'étonnement, l'indignation, le sarcasme, le mépris. Par
exemple, le monosyllabe "tu se prononce d'une manière toute
différente dans ces passages de Virgile : Tu mihi quodcunque hoc
regni ; — Cantando tu ilium? — Tune ille Eneas? — Meque timoris
argue tu, Drance. Mais, pour ne pas m'arrêter ici plus
longtemps, j'invite le lecteur à faire passer le mot tu, ou
tout autre, par toutes les affections de l'âme, et il reconnaîtra la
vérité de ce que je dis.
Je n'ai plus qu'une remarque à ajouter
ici : c'est que, bien que la grâce soit la principale qualité de
l'action, souvent ce qui convient aux uns ne convient point aux
autres. Il y a dans la grâce un je ne sais quoi dont il n'est guère
possible de rendre raison; et, s'il est vrai de dire que le grand
secret soit de mettre de la grâce dans tout ce qu'on fait, aussi
est-il vrai que cette grâce ne saurait exister sans l'art, et que
l'art néanmoins ne suffit pas pour la procurer. C'est pour cela que,
chez quelques-uns, certaines qualités ne plaisent pas, et que, chez
d'autres, tout plaît, jusqu'à leurs défauts. Nous avons vu les deux
plus grands acteurs dans le genre comique, Démétrius et Stratoclès,
plaire par des qualités très différentes. Que le premier représentât
à merveille les dieux, les amants, les bons pères, les esclaves
fidèles, les matrones, et les vieilles prudes ; que l'autre ne jouât
pas moins bien les vieillards bilieux, les esclaves rusés, les
parasites, les entremetteurs, et tous les rôles qui demandent plus
de mouvement, je ne m'en étonne pas : leur naturel était différent;
la voix même de Démétrius était plus agréable, et celle de
Stratoclès plus mordante. Ce qui est encore plus digne d'attention,
c'est qu'ils avaient certaines manières propres à chacun d'eux, et
tout à fait incommunicables. Ainsi, agiter ses mains en l'air,
prolonger des exclamations d'un ton doux pour plaire aux
spectateurs, entrer en scène avec une robe où le vent semblait
s'engouffrer, gesticuler souvent du côté droit, tout cela ne pouvait
convenir qu'à Démétrius, en qui ce jeu était secondé par sa taille
et sa bonne mine. L'autre allait et venait sans cesse; il riait
quelquefois à contre-sens, non par ignorance de son rôle, mais pour
accorder quelque chose au goût du peuple; il portait la tête
enfoncée dans ses épaules, et une seule de toutes ces choses, qu'on
applaudissait en lui, aurait été sifflée dans un autre. Chacun doit
donc s'attacher à se connaître, et prendre conseil, pour composer
son action, non seulement des préceptes communs de l'art, mais
encore de son naturel. Cependant il n'est pas absolument impossible
que le même homme comporte tous les genres, ou du moins un grand
nombre.
Je terminerai cet article comme j'ai
terminé tous les autres, en recommandant de garder une juste mesure,
attendu qu'il ne s'agit pas ici d'un comédien, mais d'un orateur. On
ne s'attachera donc pas, dans le geste, à exprimer tout
minutieusement, de même qu'en parlant on n'affectera pas de marquer
scrupuleusement ce qui est désagréable, toutes les pauses, tous les
intervalles et toutes les modifications de l'âme, comme si, par
exemple, on avait à dire sur la scène : Que faire? n'y point
aller, quand c'est elle-même qui m'en prie? mais plutôt, si je
prenais une bonne fois le parti de ne plus souffrir désormais les
caprices injurieux de pareilles femmes? Car ici l'acteur, pour
exprimer son hésitation, doit s'arrêter presque à chaque mot, et
varier les inflexions de voix, les gestes, les signes de tète. Un
discours oratoire veut un autre goût et moins d'assaisonnement;
c'est qu'il consiste dans l'action, et non dans l'imitation. Aussi
n'a-t-on pas tort de blâmer la prononciation d'un orateur dont le
visage est toujours en mouvement, dont les gestes fatiguent par leur
continuité, et dont la voix change si souvent de ton, qu'elle semble
sautiller. C'est ce que nos anciens, et Lénas Popilius après eux,
ont appelé une action affairée, mot que je les approuve d'avoir
emprunté aux Grecs. Cicéron a donc raison, comme en tout, de donner
sur ce point les préceptes que j'ai cités plus haut, et qu'on lit
dans son traité intitulé "De l'orateur" : préceptes qu'il a
reproduits dans son dialogue intitulé "Brutus", en parlant de
Marc-Antoine. Cependant on exige aujourd'hui une action un peu plus
chargée de mouvements, et il est certaines parties où cela n'est pas
déplacé. Toutefois, il faut savoir se renfermer dans de justes
bornes, et prendre garde qu'en affectant les grâces du comédien, on
ne perde l'autorité que doit avoir la parole d'un homme probe et
grave.
NOTES
LIVRE ONZIÈME.
Ejus autem, quod ad animam pertinet, magis admirer naturam.
Saint Augustin a également fait, dans ses Confessions, une
brillante description de la mémoire, et renonce, comme Quintilien, à
expliquer la nature de cette merveilleuse faculté.
«
J'arrive, dit -il (liv. X, ch. VIII), à ces larges campagnes et à
ces vastes palais de ma mémoire, où sont renfermés les trésors de ce
nombre infini d'images qui sont entrées par les portes de mes sens.
C'est là que nous conservons aussi toutes nos pensées, en y
ajoutant, ou diminuant, ou changeant quelque chose de ce que nous
avons connu par les sens, et généralement tout ce qui y a été mis
comme en dépôt et en réserve, et que l'oubli n'a point encore effacé
et enseveli. C'est là où je demande que l'on me tire de ce trésor ce
que je désire; et soudain quelques-unes de ces espèces en sortent,
et se présentent à moi : d'autres se font chercher plus longtemps et
diffèrent davantage à venir, comme si on les tirait avec peine du
fond de quelques replis cachés : d'autres sortent en foule; et, bien
que ce ne soit pas celles que je cherche ni que je demande, elles se
produisent d'elles-mêmes, et semblent dire : N'est-ce pas nous que
vous cherchez? Mais je les repousse comme de la main de mon esprit
et les éloigne de ma mémoire, jusqu'à ce que la chose que je désire
se découvre, et sorte du lieu où elle était cachée, pour se
présenter à moi. Il y en a d'autres qui, sans interrompre leur
suite, viennent avec facilité dans le même ordre que je les demande;
et les premières faisant place aux autres se retirent pour revenir
toutes les fois que je le voudrai : ce qui arrive lorsque je récite
par cœur quelque chose. Dans ce même trésor de ma mémoire, je
conserve distinctement et sans aucune confusion toutes les espèces
qui, selon leurs divers genres, y sont entrées, chacune par la porte
qui leur est propre, comme la lumière, toutes les conteur et toutes
les ligures des corps par les yeux , tous les sons par les oreilles,
toutes les odeurs par le nez, toutes les saveurs par la bouche....
Qui serait celui qui pourrait dire de quelle sorte toutes ces images
et toutes ces espèces ont été formées , encore que l'on remarque
assez par quel sens elles ont été apportées, et données en garde à
la mémoire? Car, lorsque je suis dans l'obscurité et dans le
silence, je retire, si je veux, des couleurs de ma mémoire, et
distingue le noir d'avec le blanc, et ainsi tontes les autres
couleurs qu'il me plaît, sans que les sons se jettent à la traverse,
ni me viennent troubler lorsque je considère ce que j'ai appris par
la vue; et néanmoins ces sons sont aussi dans ma mémoire, et comme
cachés dans d'autres replis, puisque, si je veux qu'ils se
présentent à moi, ils le font aussitôt Que cette puissance de ma
mémoire est grande! ses plis et replis s'étendent à l'infini : et
qui est capable de les pénétrer jusqu'au fond? Néanmoins c'est une
faculté de mon âme et qui appartient à ma nature. Je ne puis donc
pas connaître ce que je suis ; et ainsi il parait que notre esprit
n'a pas assez d'étendue pour se comprendre soi-même.
»
(Traduction d'Arnauld d'Andilly.)
Est aiiquid in amictu. Le principal habillement des Romains se
nommait topa, toge, robe, comme le manteau, chez les Grecs, se
nommait pallium. La toge était tellement propre aux Romains,
qu'ils sont très souvent désignés par le seul mot togati :
Romanos rerum dominos
gentemgue togatam (Virg.)
La
couleur en était ordinairement blanche, albus, différente de
cette couleur qu'ils appelaient candidus, blanchi avec de la
craie. Lorsqu'ils se mettaient sur les rangs pour briguer quelque
charge , ils blanchissaient leur loge avec de la craie : de là est
venu le nuit candidatus. Perse (sat. V) appelle
l'ambition des Romains cretata ambitio. Ils mettaient en
outre sous leur robe une tunique de Iaint blanche : c'était un
vêtement de dessous, tant pour les hommes que pour les termes. Les
tuniques des hommes étaient fort courtes : on pourrait les comparer
à nos vestes.
Le
laticlave était le vêtement des sénateurs. Ce vêtement était ainsi
appelé, à cause de la bande couleur de pourpre, taillée en forme de
clou, clavus, dont il était orné. Comme cette bande était
moins large pour les chevaliers, leur vêtement était appelé
angusticlave, angustusclavus.