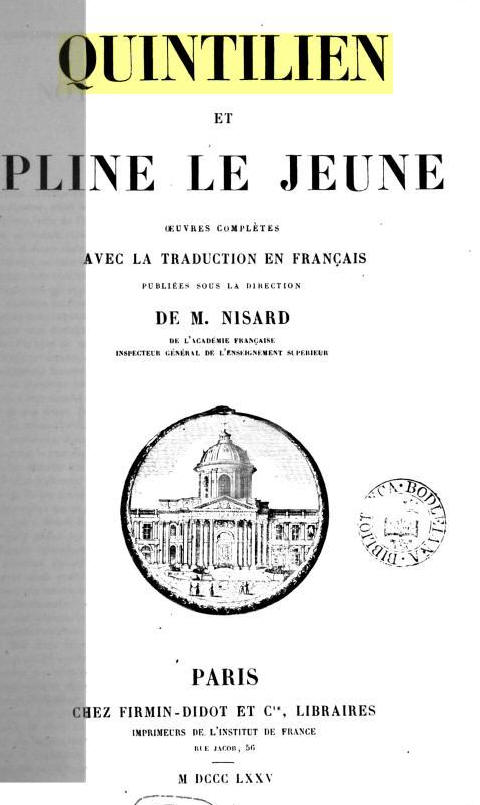|
LIVRE XII.
ARGUMENT.
AVANT-PROPOS. — Chap. I. Qu'on ne peut
être orateur, si l'on n'est homme de bien. — II. Que l'étude de la
philosophie est indispensable à l'orateur. — III. Que la
connaissance du droit civil est indispensable à l'orateur. — IV. Que
la connaissance de l'histoire est indispensable à l'orateur. -
V. Quels sont les instruments de l'orateur. — VI. Dans quel temps
l'orateur doit commencer à plaider. — VII. Ce que l'orateur doit
observer dans les causes qu'il entreprend. — VIII. Ce que l'orateur
doit observer dans les causes qu'il étudie. — IX. Ce que l'orateur
doit observer en plaidant. — X. Du genre d'éloquence qui convient à
l'orateur. — XI. Des occupations de l'orateur dans sa retraite.
Me voici arrivé à la partie sans
contredit la plus grave de mon traité. Si j'avais pu, dans
l'origine, me faire seulement une idée du fardeau dont je me sens
aujourd'hui accablé, j'aurais plus à temps consulté mes forces. Mais
je me suis vu d'abord lié par la honte de ne pas tenir ma promesse ;
ensuite, quoique le travail et la peine s'accrussent presque à
chaque pas, pour ne point perdre le fruit de ce que j'avais déjà
fait, je me suis armé de toutes les forces de ma volonté pour ne
point lâcher pied. C'est pour cela que maintenant encore, quoique ce
fardeau me pèse plus que jamais, comme j'entrevois le terme, je suis
résolu à succomber plutôt qu'à désespérer. Ce qui m'a d'ailleurs
abuse, c'est la nature assez humble des préceptes que j'eus à donner
en commençant; puis, abandonnant, pour ainsi dire, ma voile au
souffle de la brise, et m'étant engagé plus avant, sans cesser
néanmoins d'enseigner des choses connues et déjà traitées par la
plupart des rhéteurs, je ne me croyais pas encore éloigné du rivage,
et je me voyais entouré de navigateurs qui voguaient sur la foi des
mômes vents. Arrivé insensiblement dans cette région de l'éloquence
où se sont arrêtées les découvertes de l'art, et que très-peu de
rhéteurs ont explorée, je ne rencontrai plus que quelques rares
voyageurs qui eussent osé se hasarder aussi loin du port. Mais à
présent que l'orateur, dont j'avais entrepris l'éducation , a pris
congé des rhéteurs, qui n'ont plus rien à lui apprendre, pour se
livrer à son propre essor, ou pour chercher de plus puissants
secours dans le sanctuaire même de la sagesse, je commence à
reconnaître jusqu'où je me suis laissé emporter en pleine mer ; car
je ne vois plus de tous côtés que le ciel et l'eau. Un seul
navigateur m'apparaît dans ce vaste océan, c'est Cicéron; mais
lui-même, quoique monté sur un vaisseau de haut bord et si bien
équipé, je le vois qui replie ses voiles, cesse de ramer, et se
contente de traiter du genre d'éloquence qui convient à l'orateur
parfait. Ma témérité osera davantage : je vais tâcher, en outre , de
lui donner des mœurs et lui tracer des devoirs. Ainsi, quoique
incapable d'atteindre le grand homme qui me précède, mon sujet me
mènera plus loin que lui. Cependant l'ambition de bien faire est
toujours louable , et l'on peut oser plus sûrement, quand
l'entreprise porte avec soi son excuse.
CHAP. I. Je définis donc l'orateur,
comme l'a défini Caton, un homme de bien, habile dans l'art de
parler; mais surtout un homme de bien, qualité qu'il pose
en premier, et qui, de sa nature, est en effet préférable à la
seconde, et plus impor- 447
tante. Et cela doit être ainsi; car si le talent de la parole peut
devenir l'instrument de la méchanceté, rien n'est plus pernicieuxque
l'éloquence aux intérêts publics et privés : et moi-même qui, pour
ma part, ai contribué de tous mes efforts à perfectionner cette
faculté, je me serais rendu coupable du plus grand des crimes envers
la société, en forgeant des armes pour des brigands et uon pour des
soldats. Que dis-je, moi? la nature elle-même, qui, par le don de la
parole, a visiblement affecté de favoriser l'espèce humaine et de la
distinguer du reste des animaux, la nature elle-même eût été plutôt
une marâtre qu'une mère, si cette faculté n'eût été qu'une invention
destinée à seconder le crime, à opprimer l'innocence, et à faire la
guerre à la vérité. N'eût-il pas mieux valu naître muets et privés
de toute intelligence, que de convertir ces présents de la
Providence en un moyen de destruction mutuelle? Mais je vais plus
loin, et je prétends non-seulement que l'orateur doit être homme
de bien , mais qu'on ne peut pas même devenir orateur, si l'on
n'est homme de bien. Et en effet, accorderons-nous de l'intelligence
à ceux qui, maîtres de choisir entre le chemin de la vertu et celui
du vice, se déterminent pour le dernier? accorderons-nous de la
prudence à ceux qui, faute de prévoir les suites de leurs actions,
s'exposent eux-mêmes à tomber dans les mains terribles de la justice
humaine, qui rarement laissent échapper le coupable, ou à subir les
tourments toujours inévitables d'une mauvaise conscience? Que si,
comme l'enseignent les sages et comme on l'a toujours cru
communément, nul n'est méchant sans être en même temps
insensé, certainement un insensé ne deviendra jamais orateur.
Ajoutez que l'âme ne peut vaquer à la plus sublime des études, si
elle n'est affranchie de tout vice : premièrement, parce que le même
cœur ne peut comporter l'alliance du bien et du mal, et qu'il n'est
pas plus possible à un même esprit d'associer dans sa pensée ce
qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire, qu'il n'est possible
à un même homme d'être à la fois bon et méchant ; secondement, parce
que l'âme, appliquera un si grand objet, doit renoncer à tous les
autres soins, même aux plus innocents ; car ce n'est qu'autant
qu'elle sera libre, tout entière à elle-même, sans distraction, sans
préoccupation aucune, qu'elle pourra pleinement contempler son
œuvre. Si le soin de nos champs, si nos affaires domestiques, si la
chasse et les spectacles nuisent déjà beaucoup à nos études, puisque
le temps qu'on donne à une chose est perdu pour une autre ,,que
sera-ce si nous sommes eu proie à l'ambition, a la cupidité, à la
haine, ces passions tyranniques qui troublent noire sommeil et
jusqu'à nos songes ? Car rien n'est plus occupé, ni susceptible de
plus de formes , ni travaillé et déchiré de plus d'affections
diverses, que l'âme du méchant. Médite-t-il le mal? l'espérance, et
tous les soucis qui accompagnent les apprêts de son crime, le
tiraillent en tout sens. L'a-t-il commis? la crainte, le remords,
l'attente de tous les châtiments, le torturent sans relâche. Or,
quelle place peut-il rester, dans une âme ainsi troublée, pour les
lettres ou toute autre étude aussi pure? la même, sans doute, que
laisserait aux fleurs et aux fruits une terre couverte de ronces et
d'épines. Ce n'est pas tout : la frugalité est nécessaire pour
supporter les fatigues de l'étude : que peut-on attendre de la
débauche et de la dissolution? l'amour de la gloire est le plus
puissant aiguillon de ceux qui cultivent les lettres: le méchant
s'intéresse-t-il à la gloire? Qui ne sait
448 aussi que l'éloquence
oratoire consiste en grande partie à disserter sur l'équité et le
bien ? Or, comment un homme méchant et injuste parlera-t-il de ces
choses avec la dignité convenable? Enfin, pour trancher la plus
grande partie de la question, supposons (ce qui ne saurait jamais
être) que deux hommes, l'un très-méchant, l'autre très-vertueux,
aient autant d'esprit, d'étude et de savoir l'un que l'autre : qui
des deux sera réputé le meilleur orateur? sans contredit, celui qui
est le meilleur comme homme. Donc, on ne peut être à la fois un
méchant homme et un parfait orateur ; car une chose n'est point
parfaite, à laquelle on en peut opposer une meilleure. Mais, pour
que je ne paraisse pas, à la manière de l'école de Socrate,
m'assurer de la réponse par la question, je suppose quelqu'un
d'assez entêté contre la vérité pour oser soutenir qu'à partage égal
d'esprit, d'étude et de savoir, un méchant homme ne sera pas moins
bon orateur qu'un homme de bien : je vais convaincre cette personne
de son aveuglement. Certes, il est indubitable que le but que se
propose tout orateur est de persuader aux juges que ce qu'il avance
est vrai et honnête. Or, lequel y parviendra le plus aisément, de
l'homme de bien ou du méchant? sans contredit l'homme de bien; car
tout ce qu'il dira sera le plus souvent vrai et. honnête. Bien plus,
si, pour satisfaire à certains devoirs (ce qui peut arriver, comme
je le démontrerai tout à l'heure ), il entreprend de présenter comme
vrai ce qui ne l'est pas, on l'écoutera nécessairement avec plus de
confiance. Le méchant, au contraire, qui compte pour rien l'opinion
bonne ou mauvaise qu'on a de lui, et n'a pas même l'idée du bien, ne
prend pas d'ordinaire la peine de dissimuler. Ainsi, il avance
hardiment des propositions inconsidérées, il affirme sans scrupule.
Il résulte de laque, dans les choses qu'il lui est absolument
impossible d'établir, il révolte les juges par son opiniâtreté, sans
que sa peine aboutisse à rien. Car dans les causes qu'il plaide,
comme dans les autres actions de sa vie, le méchant a des espérances
que rien ne désappointe. Enfin, il arrive souvent qu'on ne le croit
pas, même lorsqu'il dit la vérité, et que le choix d'un pareil
avocat suffit pour décréditer une cause.
Je vais maintenant répondre aux
objections qu'il me semble voir s'élever de concert contre moi.
Quoi donc! est-ce que Démosthène n'était point orateur?
Cependant il passe pour avoir été un malhonnête homme. Et Cicéron
? Pourtant beaucoup de gens ont blâmé ses mœurs. Que faire? Je
sens que ma réponse va faire jeter les hauts cris, et demande des
précautions oratoires. Je dirai donc d'abord que Démosthène ne me
paraît pas tellement répréhensible dans ses mœurs, qu'il me faille
ajouter foi atout ce que ses ennemis ont accumulé contre lui,
surtout si je considère les nobles conseils qu'il donnait aux
Athéniens, et sa fin mémorable. Quant à Cicéron, je ne vois pas non
plus qu'il ait jamais cessé d'être animé des sentiments d'un
excellent citoyen. J'en ai pour preuves; son glorieux consulat, sa
rare intégrité dans l'administration d'une province, son refus de
faire partie du gouvernement des Vingt; enfin sa conduite dans les
guerres civiles, qui, de son temps, ont ébranlé les fondements de la
république, et au milieu desquelles ni l'espérance ni la crainte ne
lui firent déserter le meilleur parti, c'est-à-dire le parti de la
république. Il avait, dit-on, l'âme faible ; mais il a fort bien
répondu 449 à ce
reproche , en disant qu'il était timide, non quand il s'agissait
d'accepter le danger, mais quand il s'agissait de le prévenir;
ce qu'il a confirmé par la résignation sublime avec laquelle il a
accepté la mort même. Que si la vertu parfaite a manqué à ces deux
personnages, et qu'on me demande s'ils ont été des orateurs, je
répondrai comme les stoïciens, quand on leur demande si Zénon,
Cléanthe, Chrysippe, ont été des sages : que ce furent de grands
hommes, des hommes dignes de vénération; mais que, toutefois, ils
n'ont pas atteint à cette perfection dont la nature de l'homme est
capable. Ainsi Pythagore ne voulut pas prendre le nom de sage, comme
ses devanciers, mais seulement celui d'ami de la sagesse.
Quant à moi cependant, pour me conformer au langage commun, j'ai
souvent dit et je répéterai que Cicéron est un parfait orateur,
comme nous disons de nos amis, que ce sont des hommes de bien,
des hommes très éclairés, quoique ces titres n'appartiennent
qu'au vrai sage; mais quand il s'agira de parler proprement et selon
la loi même de la vérité, je chercherai cet orateur, que Cicéron
cherchait lof-même. Car, bien que j'avoue qu'il ait atteint le faite
de l'éloquence, et quoique je ne voie guère ce que l'on pourrait
ajouter en lui (peut-être même trouverai-je plus aisément ce que,
selon moi, il eût lui-même retranché encore; car la plupart des
savants ont porté de lui ce jugement, qu'il eut beaucoup de qualités
et quelques défauts ; et lui-même témoigne qu'il avait beaucoup
réprimé de l'exubérance de sa jeunesse), cependant, puisqu'il ne
s'est pas arrogé le titre de sage , lui qui ne se mésestimait
nullement; puisqu'il eût pu devenir encore plus éloquent s'il eût
vécu davantage, et dans des temps plus calmes et plus favorables à
l'étude, je puis croire, sans être soupçonné de rien vouloir ôter à
son mérite, qu'il lui a manqué ce point de perfection, auquel nul
n'a encore atteint, et dont, toutefois, personne n'a plus approché
que lui. Si je pensais autrement de ce grand homme, moins préoccupé
de la crainte de le déprécier, je pourrais soutenir mon opinion avec
plus d'avantage. Quoi! Marc-Antoine a déclaré, ce qui est bien plus
fort, qu'il n'avait jamais vu un homme éloquent; Cicéron lui-même
cherchait encore cet introuvable orateur, et s'est contenté de
l'imaginer, de s'en faire une idée; et moi, je n'oserais pas dire
que, dans l'immensité des siècles à venir, il peut se rencontrer
quelque chose de plus parfait que ce quia été? Je n'irai pas plus
loin, et je ne dirai rien de ceux qui, même sous le rapport de
l'éloquence, ont sévèrement jugé Démosthène et Cicéron, quoique
Démosthène ne soit pas encore parfait aux yeux de Cicéron, qui
l'accuse de dormir quelquefois, non plus que Cicéron aux yeux de
Brutus et de Calvus, qui du moins ont blâmé sa composition en
parlant à lui-même, et des deux Pollion, qui, dans plusieurs
endroits de leurs ouvrages, ont critiqué en lui, même avec aigreur,
certains défauts de style.
Mais je reprends ma thèse, et veux
bien accorder que, en dépit de la nature, il se soit rencontré un
homme à la fois méchant et fort disert : je ne lui en dénierai pas
moins le titre d'orateur, de même que je refuserai le nom de braves
à tous ceux qui sont prêts à faire un coup de main, parce que l'idée
du courage implique celle de vertu. Ne faut-il pas, à celui qui est
appelé à défendre une cause, une fidélité qui soit à l'épreuve de la
cupidité, de la faveur, de la 450
crainte ? et donnera-t-on le nom sacré d'orateur à un traître,
à un transfuge, à un prévaricateur? Que si un avocat médiocre ne
peut se passer de ce qu'on appelle vulgairement probité,
pourquoi cet orateur qui n'a jamais existe, mais qui peut exister,
serait-il dispensé d'être aussi parfait dans ses mœurs que dans son
éloquence? Car ce n'est pas ici un homme de barreau que je prétends
former, ni un marchand de paroles, ni même, pour adoucir
l'expression, un de ces avocats qui savent assez bien se tirer de la
défense d'un procès, et qu'on appelle communément diseurs de
causes; mais un homme qui joint à la nature d'un esprit
supérieur une connaissance profonde de tout ce que l'art et la
science ont de beau, un véritable présent fait à la terre, et
inconnu jusque-là aux générations de tous les âges; un homme unique,
accompli de tout point, sachant également et bien penser et bien
dire. Il suffira de la moindre partie de cet orateur pour protéger
l'innocence, pour réprimer l'audace du crime, ou pour défendre la
vérité contre le mensonge dans les questions pécuniaires. Là comme
ailleurs, n'en doutons pas, il se montrera supérieur ; mais c'est
dans les grandes occasions qu'il brillera de tout son éclat,
lorsqu'il lui faudra, par exemple,éclairer les délibérations du
sénat, on ramener dans une meilleure voie un peuple égaré. Virgile
ne semble-t-il pas avoir tracé le portrait d'un pareil orateur dans
ce personnage qu'il nous représente apaisant une populace mutinée,
qui lance déjà les brandons et les pierres :
Mais qu'à leurs yeux émus il se
présente un sage,
Son aspect imposant soudain calme l'orage :
On se tait, on l'écoute....
Voilà d'abord l'homme de bien ;
vient ensuite l'homme éloquent :
Et ses discours vainqueurs
Gouvernent les esprits et subjuguent les cœurs. (DEL)
Transportons le même orateur sur un
champ de bataille, et supposons qu'il lui faille haranguer une armée
en face de l'ennemi : ne tirera-til pas son éloquence du sein même
de la sagesse? Comment, en effet, dissiper, chez des hommes qui sont
sur le point d'en venir aux mains, tant de craintes qui les
assaillent à la fois, celles de la fatigue, de la douleur, de la
mort même, si, au lieu de ces tristes images, on ne leur présente
l'amour de la patrie, le devoir, et la gloire? Or, en pareil cas,
celui-là certainement persuadera mieux les autres, qui se sera
d'abord persuadé lui-même, car la dissimulation, en dépit de ses
efforts, finit toujours par se trahir ; et, quelque facilité qu'on
ait à s'exprimer, ou chancelle, on hésite, quand la bouche n'est pas
d'accord avec le cœur. Or, il est de toute nécessité que le méchant
parle autrement qu'il ne pense. Au contraire , l'homme de bien ne
sera jamais au dépourvu, soit pour discourir sur les choses
honnêtes, soit pour trouver les meilleurs moyens ; car il sera en
même temps un homme éclairé. Il est vrai que les bonnes choses sont
quelquefois destituées des agréments de l'art ; mais leur nature y
supplée suffisamment, et ce qui est honnête est toujours bien dit.
Attachons-nous donc dès la jeunesse, que dis-je? à tout âge, car il
n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire,
451 attachons-nous à
acquérir cette perfection ; travaillons-y de tous nos efforts, et
peut-être y parviendrons-nous. Car si la nature ne s'oppose pas à ce
qu'on soit vertueux et à ce qu'on soit éloquent, pourquoi ne se
trouverait-il pas quelqu'un qui pût devenir l'un et l'autre? Et
pourquoi désespérerait-on de devenir ce quelqu'un ? Que si nos
forces naturelles étaient insuffisantes pour cela, au moins
serions-nous meilleurs à proportion du progrès que nous aurions fait
dans la vertu et dans l'éloquence. Mais, surtout, ôtons-nous bien de
l'esprit que le plus beau privilège de l'homme, l'éloquence, puisse
s'allier avec la corruption du cœur. Le talent de la parole, quand
il échoit aux méchants, doit même être regardé comme un mal,
puisqu'il les rend encore plus méchants. Comme il se rencontrera
toujours des gens qui aiment mieux être éloquents que vertueux, je
crois les entendre dire : A quoi bon, en ce cas, tant d'art dans
l'éloquence? pourquoi nous avez-vous parlé vous-même des couleurs de
la rhétorique, de la manière de défendre des causes difficiles, des
causes même ou le fait est avoué? Cela ne prouve-t-il pas que
l'éloquence sert quelquefois à combattre la vérité ? Car un homme de
bien ne plaide que de bonnes causes, et celles-là se défendent assez
par elles-mêmes sans le secours de la science. Je commencerai par
justifier la rhétorique et moi-même, et je prouverai ensuite qu'un
\homme de bien peut quelquefois, sans trahir son devoir, défendre
des coupables. Je répondrai donc qu'il n'est pas inutile de
rechercher comment on soutient le mensonge et même l'injustice, ne
fût-ce que pour apprendre par là à les démasquer et à les combattre
plus aisément. C'est ainsi qu'on emploie plus judicieusement les
remèdes, quand on connaît ceux qui sont nuisibles. De ce que les
académiciens soutiennent alternativement le pour et le contre, il ne
s'ensuit pas que, hors de l'école, ils mettent en pratique
leur seconde thèse ; et ce Carnéade qui, dit-on, étant à Rome,
disputa contre la justice, en présence de Caton le Censeur, avec
autant de force qu'il l'avait fait la veille en la défendant,
n'était pas pour cela un homme injuste. En effet, la laideur du vice
rehausse par le contraste la beauté de la vertu, et l'équité gagne à
être mise en opposition avec l'iniquité; enfin , il est une infinité
de choses qui se prouvent par leurs contraires. L'orateur doit donc
connaître les desseins de son adversaire, comme un capitaine doit
connaître ceux de l'ennemi. Quant à ce que j'ai dit, et qui paraît
si scabreux au premier aspect, qu'un homme de bien peut quelquefois,
dans la défense d'une cause, chercher à dérober au juge la
connaissance de la vérité, il n'est pas impossible de rendre raison
de cette inconséquence. Que si l'on s'étonne de nie voir avancer une
pareille proposition (bien que je ne fasse qu'émettre une opinion
qui a été celle des hommes que l'antiquité a reconnus et vénérés
comme les maîtres de la sagesse), que l'on veuille bien considérer
que la plupart du temps la beauté ou la honte d'une action n'est pas
tant dans l'action même que dans le motif. En effet, si c'est
souvent un acte de vertu, que de tuer un homme; quelquefois même
d'héroïsme, que de sacrifier ses propres enfants ; s'il est permis
de faire certaines choses qui répugnent encore plus à dire, quand
l'intérêt public les commande, il ne s'agit plus de considérer
absolument la nature de la cause qu'un homme de bien défend, mais
aussi pourquoi et dans quel le intention il la défend. Et d'abord
personne ne peut me contester ce dont conviennent les plus rigides
stoïciens, qu'un homme de bien peut être dans le cas de mentir, même
pour une cause assez légère. Par exemple, pour décider
452 un enfant malade à
boire un breuvage amer, en lui fait mille petits mensonges, on le
séduit par mille promesses, qu'on n'a pas l'intention de tenir. A
plus forte raison doit-il être permis de mentir, dans la vue
d'empêcher un scélérat de commettre un meurtre, ou de tromper un
ennemi pour le salut de la patrie : en sorte que ce qui est
quelquefois répréhensible, même dans un esclave, est quelquefois
louable, même dans un sage. Cela posé, je vois qu'il peut se
présenter bien des circonstances où l'orateur peut entreprendre la
défense de telle cause, dont il ne se chargerait pas sans des motifs
honorables. Je ne mets pas au nombre de ces motifs les liens du sang
ou de l'amitié, car je raisonne ici plus sévèrement ; quoiqu'à vrai
dire , quand il s'agit d'un père, d'un frère, ou d'un ami, ce ne
soit pas un léger motif d'hésitation que d'avoir sous les yeux, d'un
côté les droits de la justice, et de l'autre ceux de la tendresse.
Mais confirmons cela par des exemples qui ne laissent aucun doute.
Quelqu'un est accusé pour avoir attenté à la vie d'un tyran.
L'orateur, tel que je l'ai défini, laisserait périr cet homme? ou
s'il entreprend sa défense, n'emploiera-t-il pas de fausses
couleurs, comme tous ceux qui plaident une mauvaise cause ?
Supposons même une action qui, quoique bonne en elle-même, ne
laissera pas d'être condamnée par le juge, si l'on ne parvient à le
convaincre que cette action n'a pas eu lieu : l'orateur
hésitera-t-il à user de ce moyen pour sauver, je ne dis pas
seulement un innocent, mais un citoyen recommandable? Supposons
encore une action, juste de sa nature, mais inutile à la république,
à cause de la conjoncture des temps : n'aura t-il pas recours à une
éloquence bonne en soi, mais qui, dans sa forme, n'aura rien qui la
distingue de la chicane ? Allons plus loin. II est incontestable que
s'il y avait lieu d'espérer qu'un criminel pal se corriger, ce qui
est, de l'aveu de tous, quelquefois possible, il ne soit plus
avantageux à la société de lui faire grâce que de le punir. Si donc
il est démontré à l'orateur que tel homme, jugement accusé, changera
de vie, ne fera-t-il pas tous ses efforts pour le sauver? Supposons
enfin qu'un général habile, et sans lequel la république ne peut
espérer de vaincre, soit sons le poids d'une accusation
manifestement fondée, l'intérêt commun ne lui suscitera-t-il pas un
défenseur? Fabricius, du moins, donna ouvertement son suffrage pour
le consulat à Cornélius Rufinus, qui était un mauvais citoyen, et de
plus son ennemi particulier ; mais la guerre était imminente, et il
savait que Rufinus était un bon capitaine : aussi, quelques
personnes s'étonnant de sa conduite, J'aime mieux, dit-il,
être pillé par un concitoyen, que vendu par l'ennemi. Si donc
Fabricius eût été orateur, pense-t-on qu'il n'eût pas défendu ce
même Rufinus, quoique manifestement coupable de péculat? Je pourrais
multiplier de semblables exemples, mais le premier venu de ceux que
j'ai cités doit suffire ; car mon dessein n'est pas d'encourager mon
orateur à plaider souvent de pareilles causes : j'ai voulu faire
voir que, nonobstant ces exceptions, cette définition reste vraie,
que l'orateur est un homme de bien, habile dans l'art de parler.
Il n'est pas moins nécessaire d'enseigner et d'apprendre comment se
traitent aussi les choses qui sont difficiles à prouver; car souvent
les meilleures causes elles-mêmes ressemblent aux mauvaises, et un
innocent, 453 mis en
accusation, peut avoir contre lui toutes; les apparences. D'où il
suit qu'il faut le défendre par les mêmes procédés que s'il était
coupable. Enfin, que de choses communes aux bonnes et aux mauvaises
causes ! les témoins, les lettres, les soupçons, les préjugés. Or,
ce qui est vraisemblable se prouve et se réfute de la même manière
que ce qui est vrai. C'est pourquoi l'orateur donnera à son
plaidoyer le tour qu'exigeront les circonstances, en conservant la
pureté d'intention , qui caractérise l'homme de bien.
CH. II. Donc, puisque l'orateur est
essentiellement homme de bien, et qu'un homme de bien ne peut
se concevoir sans la vertu; puisque la vertu, quoiqu'elle doive
quelques-uns de ses mouvements à la nature, a besoin d'être
perfectionnée par la science, le premier soin de l'orateur doit être
de cultiver ses mœurs par l'étude, et d'approfondir la connaissance
de l'honnête et du juste, sans laquelle nul ne peut être ni vertueux
ni éloquent : à moins qu'on ne se range à l'opinion de ceux qui
pensent que la nature seule fait les mœurs, et que les préceptes n'y
ajoutent rien, c'est-à-dire que nous avons besoin de maîtres pour
les arts manuels, même les plus vils; tandis que la vertu, cet
attribut qui nous rapproche le plus des dieux immortels, vient à
nous sans que nous prenions la peine de la chercher, et seulement
parce que nous sommes nés. Ainsi, on sera abstinent, sans savoir ce
que c'est qu'abstinence; courageux, sans s'être affranchi par la
raison de la crainte de la douleur et de ja mort, et des terreurs de
la superstition ; juste, sans avoir jamais examiné ce que c'est que
l'équité et le souverain bien, sans avoir jamais raisonné , dans
quelque savant entretien, sur les lois que la nature a imposées à
tous les hommes, ni sur celles qui sont particulières à certains
peuples, à certaines nations. Oh I que c'est faire peu de cas de
toutes ces questions, que de les juger si faciles ! Mais je laisse
ce point, qui ne saurait être douteux, si l'on a seulement la
moindre teinture des lettres ; et je passe à cette seconde
proposition : qu'on ne peut pas même être suffisamment habile dans
l'art de parler, si Ton n'a approfondi les secrets de la nature, ni
formé ses mœurs par les préceptes et la réflexion. Car ce n'est pas
en vain que L. Crassus, dans le troisième livre du traité De
oratore, soutient que tout ce qui regarde l'équité, la justice,
la vérité, le bien, et leurs contraires, est proprement du domaine
de l'orateur, et que les philosophes, tontes les fois qu'ils ont
recours à l'éloquence pour défendre ces principes, se servent des
armes de la rhétorique, et non des leurs. Le même Crassus avoue
cependant que maintenant c'est à la philosophie qu'il faut emprunter
ces armes, sans doute parce qu'il lui semble qu'elle en est plus
particulièrement en possession. C'est aussi ce qui a fait dire à
Cicéron, dans plusieurs de ses ouvrages et de ses lettres, que
l'éloquence coule des sources les plus profondes de la sagesse, et
que c'est pour cela que, pendant quelque temps, ce furent les mêmes
maitres qui enseignaient à bien vivre et à bien parler. C'est
pourquoi mes conseils n'ont point ici pour but de faire de l'orateur
un philosophe, puisqu'il n'y a pas de genre de vie plus éloigné des
devoirs du citoyen et de toutes les fonctions de l'orateur. Qui, en
effet, parmi les philosophes, a jamais fréquenté le barreau, ou
s'est fait quelque réputation dans les assemblées? Quel est celui
qui a jamais pris part à l'administration des affaires publiques,
quoique la politique ait été l'objet principal des préceptes de
454 la plupart d'entre
eux? Or, moi, je veux que mon orateur soit une sorte de sage Romain,
qui se montre véritablement homme d'État, nou par des disputes
ennemies du grand jour, mais par la pratique des affaires et par des
actions. Mais puisque l'étude de la sagesse, délaissée par ceux qui
se sont adonnés à l'étude de l'éloquence, a fui le théâtre de son
activité et la publicité du barreau , pour se retirer d'abord dans
les portiques et dans les gymnases, et de là dans l'ombre des
écoles, il faut bien que l'orateur, qui ne trouve pas chez les
maîtres d'éloquence ce qu'il lui est indispensable de connaître,
aille le chercher chez ceux qui en ont conservé le dépôt, et lise à
fond les auteurs qui traitent de la vertu, afin que sa vie soit
intimement unie à la science des choses divines et humaines. Et
combien ces choses ne paraîtraient-elles pas plus importantes et pi
us bel les, si elles étaient enseignées par ceux qui sauraient en
même temps parler le mieux? Puisse-t-il arriver un temps où cet
orateur parfait, tel que je le souhaite, revendique une étude que
les uns ont rendue odieuse par le nom superbe qu'ils lui ont donné,
les autres par les vices dont ils ont souillé ses fruits, et,
l'arrachant publiquement des mains qui l'ont usurpée, la réunisse à
l'éloquence, pour en être inséparable à jamais.
Or, la philosophie étant divisée en
trois parties, la physique, la morale et la logique,
eu est-il une, je le demande, qui ne soit liée naturellement aux
études de l'orateur? Car, pour commencer par la dernière, laquelle
est toute dans les mots, cela ne peut être douteux pour personne,
puisqu'on ne peut nier qu'il n'appartienne à l'orateur de connaître
les propriétés de chaque mot, d'éclaircir ce qui est équivoque, de
démêler ce qui est embrouillé, de discerner le faux du vrai, de
prouver et de réfuter : quoique, à vrai dire, les plaidoyers
n'admettent pas une argumentation aussi minutieuse et aussi concise
que les disputes philosophiques, par la raison que l'orateur doit
non-seulement instruire, mais émouvoir et plaire; ce qui demande de
l'entraînement , de la force et de la grâce. C'est ainsi qu'un
fleuve, qui roule de grosses eaux dans an lit large et profond,
coule avec plus d'impétuosité qu'un faible ruisseau, qui lutte
incessamment contre de petits cailloux. Et de même que les maîtres
de gymnastique enseignent à leurs élèves certains artifices qu'ils
appellent nombres, non dans le dessein que ceux-ci les
mettent tous en usage dans la lutte, où il s'agit, avant tout,
d'avoir de l'aplomb, de la fermeté et de l'ardeur, mais afin
qu'ayant à leur disposition une foule de ressources, ils aient
recours, tantôt à un mouvement, tantôt à un autre, suivant
l'occasion; de même, cette partie qu'on nomme dialectique, ou, si
l'on veut, contentieuse, est souvent utile pour définir et
circonscrire les choses, pour en marquer les différences, pour
éclaircir par des distinctions ce qui est ambigu, pour diviser,
enlacer, envelopper; mais, d'un autre côté, si elle domine
exclusivement dans un plaidoyer, elle empêchera l'éloquence de se
développer d'une manière plus efficace, et consumera, par sa
subtilité même, les forces de l'orateur, en les proportionnant à son
exiguïté. Aussi voit-on certains orateurs, d'une adresse admirable
dans la controverse, qui, une fois hors de leurs défilés, sont
incapables de se défendre sur un terrain
455 plus étendu ;
semblables à ces petits animaux qui échappent, par leur mobilité,
dans un espace étroit, et qu'on attrape aisément en plaine.
Quant à la morale , rien n'est
certainement plus approprié à l'orateur ; car, comme je l'ai dit
dans les livres précédents, au milieu de cette prodigieuse variété
de causes qui roulent tour à tour sur les états de conjecture, de
définition, de légalité, de translation, de syllogisme, d'antinomie
et d'amphibologie, il n'en est peut-être pas une où l'on n'ait à
traiter en quelque point de l'équité et du bien en général. Qui ne
sait d'ailleurs que la plupart des causes roulent entièrement sur la
qualité? Et, dans les délibérations, est-il un moyen de persuasion
en dehors de la question de l'honnête? Que dirai-je enfin du genre
démonstratif, qui consiste uniquement dans la louange et le blâme?
n'est-ce pas d'un bout à l'autre un traité sur la vertu et le vice?
l'orateur n'a-t-il pas à y parler sans cesse de la justice, du
courage, de l'abstinence, de la tempérance, de la piété? Or, l'homme
de bien, pour qui ces vertus ne seront pas de vains noms que
l'oreille aura fait passer sur la langue, mais qui, ayant médité
profondément sur leur nature, ne les aura pas moins dans le cœur que
dans la bouche , cet homme de bien les concevra sans effort, et ne
fera qu'exprimer ce qu'il pense. J'ai déjà dit ailleurs qu'une
question générale a plus d'étendue qu'une question spéciale, parce
que la partie est contenue dans le tout, et non le tout dans la
partie. Or, il est incontestable que les questions générales sont
particulièrement du ressort de la morale. Il est aussi beaucoup de
choses qui veulent être définies d'une manière propre et précise,
d'où naît l'état de cause qu'on nomme définitif; et, dans ce cas,
n'est-ce pas aux moralistes qu'il faut recourir? Enfin, toute
question de droit roule, ou sur la propriété des mots, ou sur
l'équité, ou sur l'interprétation conjecturale de l'intention : ce
qui tient en partie à la logique, en partie à la morale. Donc, tout
discours vraiment oratoire comporte naturellement toutes les
questions qui font la matière de ces deux parties de la philosophie;
car, pour cette loquacité, vide de ces connaissances philosophiques,
elle est nécessairement condamnée à errer au hasard et sans guides,
ou à n'en faire que de faux.
Quant à la physique, outre
qu'elle ouvre à l'orateur un champ d'autant plus vaste qu'il faut pi
us d'enthousiasme pour parler des choses divines que pour parler des
choses humaines, elle renferme encore toute la morale, sans
laquelle, comme je l'ai démontré, nulle oraison ne peut exister. En
effet, si le monde est régi par une providence, l'administration de
l'État doit être le partage des gens de bien ; si notre âme a une
origine céleste, nous de vous tendre à la vertu, et ne pas être
esclaves de ce qui flatte la nature terrestre du corps. Or,
l'orateur n'aura-t-il pas souvent à traiter ces grandes questions?
n'aura-t-il pas non plus à disserter sur les augures, les oracles,
et sur tout ce qui touche à la religion ; matières qui ont si
souvent donné lieu à de graves délibérations dans le sénat, puisque
l'orateur, tel que je l'ai défini, doit être en même temps un homme
d'État? Comment enfin concevoir l'éloquence dans un homme qui
ignorerait ce qui fait le plus d'honneur à l'intelligence humaine?
Quand ce que je dis ne serait pas évident par soi-même, on ne
pourrait néanmoins refuser de le croire, sur l'au-
456 torité des exemples.
Or, il est constant que Périctès, dont les historiens, dont les
anciens poètes comiques, genre d'auteurs peu suspect de flatterie,
s'accordent à dire que l'éloquence était d'une puissance incroyable,
quoiqu'il n'en soit parvenu aucun monument jusqu'à nous, il est
constant que Périclès avait été disciple du physicien Anaxagore; que
Démosthène, le prince des orateurs grecs, avait suivi les leçons de
Platon. Quanta Cicéron, il témoigne souvent lui-même qu'il doit bien
moins aux écoles des rhéteurs qu'aux jardins de l'Académie; et
certainement sa fécondité naturelle ne se fût pas épanchée avec
autant d'abondance, s'il eût renfermé son génie dans l'enceinte du
barreau, et qu'il ne lui eût donné d'autres bornes que celles de la
nature même.
Mais de là naît cette autre question :
Quelle est la secte la plus propre à enrichir l'éloquence ? A vrai
dire, le débat ne peut porter sur un grand nombre ; car,
premièrement, Épicure nous éconduit lui-même, en recommandant
de fuir à pleines voiles toute espèce de doctrine; et Aristippe,
qui place le souverain bien dans les plaisirs des sens, ne nous
exhorte certainement pas à braver les fatigues de l'étude. Quant à
Pyrrhon, quel rôle peut-il jouer ici, lui qui n'est pas bien
sûr qu'il y ait des juges à qui il s'adresse, ni un accusé qu'il
défend, ni un sénat où l'on délibère ? Quelques-uns croient
l'Académie très-utile, parce que la coutume de discuter le pour et
le contre a beaucoup d'analogie avec les exercices du barreau ; et
ils allèguent, à l'appui de leur opinion, que cette école peut
revendiquer la gloire d'avoir produit les hommes les plus éloquents.
Les péripatéticiens se targuent aussi d'un certain zèle pour
l'éloquence ; et, en effet, ce sont eux qui ont, en grande partie,
imaginé de soutenir des thèses par forme d'exercice. A l'égard des
stoïciens, si, d'un côté, ils sont forcés d'avouer que l'abondance
et le poli de l'éloquence ont manqué à la plupart de leurs maîtres,
de l'autre ils prétendent qu'on ne saurait prouver avec plus de
force ni conclure avec plus de subtilité.
Mais laissons ces querelles de
rivalité aux philosophes, qui, dans leur esprit d'exclusion, et
comme s'ils étaient engagés par serment, ou même enchaînés par une
sorte de vœu superstitieux, croiraient commettre un parjure ou un
sacrilège, en se départant du système qu'ils ont une fois adopté.
Quant à l'orateur, il n'a besoin de jurer par le nom d'aucun maître.
C'est une œuvre bien autrement élevée, bien autrement noble, qu'il
se propose, ou, pour mieux dire, qu'il brigue, lui qui tend à la
double perfection des mœurs et de l'éloquence. Aussi, pour bien
dire, il prendra pour modèles les hommes les plus éloquents; et,
pour bien vivre, il choisira les pins beaux préceptes et le chemin
qui mène le plus directement à la vertu ; il s'exercera sur toute
sorte de sujets, mais de préférence sur ceux qui sont de leur nature
les plus importants et les plus nobles. Or, est-il une matière plus
grave et plus abondante pour l'éloquence que d'avoir à parler de la
vertu, de la chose publique, de la providence, de l'origine des
âmes, de l'amitié? Quoi de plus propre à élever le cœur et le style,
que ces grandes questions : En quoi consistent les vrais biens, et
cette vraie liberté qui nous affranchit de la crainte, et des
passions, et des préjugés du vulgaire, et qui rend notre âme toute
ce leste? Mais l'orateur ne doit pas se renfermer dans ces hautes
spéculations; il doit surtout s'appliquer à connaître et à méditer
sans cesse les paroles et les 457
actions mémorables de l'antiquité. Et certes il n'en trouvera nulle
part en plus grand nombre, ni de plus dignes d'admiration, que dans
nos fastes nationaux. A quelle autre école apprendra-t-il mieux ce
que c'est que le courage, la justice, la bonne foi, la continence,
la frugalité, le mépris de la douleur et de la mort, qu'à celle des
Fabricius, des Curius, des Régulus, des Décius, des Mutius, et de
tant d'autres? Car autant les Grecs sont puissants en préceptes,
autant, ce qui est bien plus important, les Romains le sont en
exemples. Seulement, l'orateur ne verra pas dans ces exemples
l'avertissement de n'agir que dans la vue d'un intérêt domestique et
circonscrit, lui qui, persuadé qu'il ne suffît pas d'envisager le
temps qui nous touche et la vie présente, regarde la mémoire de tous
les siècles à venir comme la véritable carrière de la vertu et de la
gloire. C'est à cette source que je veux qu'il puise l'amour de la
justice, et cette indépendance qu'il doit montrer, soit au barreau,
soit au sénat ; car le titre d'orateur parfait n'appartiendra jamais
qu'à celui qui saura et osera parler le langage de la vertu.
CHAP. III. La connaissance du droit
civil est également indispensable à notre orateur, ainsi que
celle des coutumes et de la religion du pays, à l'administration
duquel il est appelé à prendre part. En effet, quel avis pourra-t-il
donner dans les délibérations publiques ou privées, s'il ignore tant
de choses, qui sont le principal fondement d'un État? Et comment
pourra-t-il prendre sans fraude le titre de défenseur, s'il est dans
la nécessité d'emprunter à autrui les armes les plus nécessaires
pour la défense d'une cause? Assez semblable à ceux qui récitent des
vers qu'ils n'ont pas faits, et réduit, en quelque sorte, au rôle
d'interprète, il demandera au juge de croire ce qu'il ne dit
lui-même que sur la foi d'autrui, et, tout en promettant assistance
aux plaideurs, il aura lui-même besoin d'être assisté. Admettons
qu'il puisse quelquefois se tirer d'affaire, si, avant de se
présenter devant le juge, il a pris soin de s'instruire du point de
droit auprès d'un jurisconsulte, comme il s'instruit des faits
auprès de son client : mais que fera-t-il dans ces questions qui
naissent souvent à l'improviste au milieu des débats? Ne le
verra-t-on pas promener honteusement ses regards autour de lui, et
interroger ces avocats du second ordre qui sont sur les bancs?
Pourra-t-il saisir avec assez d'exactitude ce qui n'aura que le
temps d'arriver à son oreille ? Pourrat-il l'affirmer avec
conviction, ou l'énoncer avec assurance pour ses clients? Je suppose
encore qu'il s'en tire dans le cours du plaidoyer ; mais que sera-ce
dans l'altercation, où il faut répondre à tout sur-le-champ, et où
l'on n'a pas le loisir de consulter ses voisins? Qu'arrivera-t-il,
si cet habile et indispensable jurisconsulte ne se trouve pas auprès
de lui, ou si son souffleur, peu compétent lui-même, lui donne
quelque fausse notion? car ce qu'il y a de plus fâcheux pour
l'ignorant, c'est de croire que celui-là sait, qui se mêle
officieusement de le redresser. Certes, je n'ignore pas nos usages,
et je n'ai point oublié qu'il existe au. barreau des hommes préposés
à une espèce d'arsenal pour fournir des armes aux combattants ; je
sais aussi qu'il en était de môme chez les Grecs, d'où est venu le
nom de praticiens donné à ces sortes d'auxiliaires : mais je
parle d'un orateur qui doit à son client non-seulement le bruit de
sa voix, mais encore tout ce qui peut contribuer au gain de sa
cause. Je veux donc qu'il ne soit pas plus inutile dans les
contestations préliminaires qui ont lieu , à heure fixe, devant le
préteur, qu'inhabile à 458
dresser des formules de témoignages. Qui peut mieux que lui, en
effet, préparer tout ce qu'il souhaite de trouver dans une cause
lorsqu'il la plaidera? à moins qu'on ne veuille accorder toutes les
qualités d'un bon général à un homme qui, sur le champ de bataille,
ferait preuve d'énergie, de courage et de tactique, mais qui, du
reste, ne saurait ni faire des recrues, ni réunir ses troupes, ni
les ranger en bataille, ni pourvoir aux approvisionnements, ni
prendre ses positions ; car, avant de faire la guerre, il faut
savoir la préparer. Or, il en est exactement de même de l'avocat,
s'il se repose sur autrui d'une foule de choses qui sont au nombre
des conditions de la victoire; et je l'excuse d'autant moins, que
ces choses, d'ailleurs indispensables, ne sont pas aussi difficiles
qu'elles peuvent le paraître, vues de loin. En effet, tout point de
droit est certain ou douteux : certain, il résulte d'une loi écrite,
ou de la coutume; douteux, il faut le peser suivant la règle de
l'équité. Le droit écrit, ou fondé sur la coutume du pays, ne
présente aucune difficulté : il s'agit là de connaître, et non
d'inventer. Quant aux points douteux, dont l'explication est du
ressort de la jurisprudence, ils consistent, ou dans
l'interprétation des mots, ou dans la distinction du juste et de
l'injuste : or, de connaître la force de chaque mot, c'est, ou ce
qui est commun à tous les hommes éclairés, ou ce qui appartient
proprement à l'orateur; et quant à l'équité, tout homme de bien la
porte dans son cœur. Or, si mon orateur est, avant tout, comme je.
l'ai défini, un homme vertueux et éclairé, une fois qu'il se sera
déterminé pour l'opinion la plus conforme à la vérité, il se mettra
peu en peine de différer d'avis avec quelques jurisconsultes,
d'autant plus que ceux-ci ont permission de n'être pas toujours
d'accord entre eux. Que s'il veut connaître ce que chacun d'eux a
pensé sur la même matière, il n'aura besoin que de les lire, et
c'est ce qu'il y a de moins pénible dans les études. Enfin, s'il est
vrai que la plupart de ceux qui se sont adonnés à l'étude du droit
ne l'ont fait qu'après s'être reconnus incapables de plaider, quelle
facilité ne doit pas trouver l'orateur à apprendre ce que savent des
hommes qui, de leur propre aveu, ne peuvent devenir orateurs? Ainsi
Caton joignait à une éloquence supérieure une profonde connaissance
du droit; on n'a jamais refusé à Scévola et à Servius Sulpicius le
talent de la parole ; et Cicéron, outre qu'en plaidant il ne fut
jamais pris au dépourvu sur le droit, avait même ébauché un traité
sur cette science : ce qui démontre qu'un orateur peut non-seulement
l'apprendre, mais encore l'enseigner. Qu'on se garde bien, au reste,
de blâmer ce que je recommande touchant l'étude de la philosophie et
du droit, sous prétexte qu'on en a vu plusieurs qui, dégoûtés du
travail qu'exigé l'éloquence, se sont arrêtés en route pour se
reposer dans une œuvre moins laborieuse. Les uns, en effet, contents
d'étudier les édits des préteurs ou les formules du droit civil, ont
mieux aime, comme dit Cicéron, être de simples praticiens, qui, en
paraissant s'attacher à ce qu'il y a de plus utile, ne cherchaient
que ce qu'il y avait de plus aisé ; les autres, superbes dans leur
paresse, après avoir essayé de l'éloquence, ont tout à coup composé
leur front et laissé croître leur barbe, et, comme pour faire
diversion au souvenir des rhé- 459
teurs, sont allés s'asseoir quelque temps dans les écoles des
soi-disant philosophes ; et cela, pour s'attirer de la considération
par un air de mépris pour le reste du genre humain, et par une
gravité étudiée dont ces hommes dissolus savaient se dédommager dans
leur intérieur. C'est que la philosophie peut se contrefaire, mais
jamais l'éloquence.
CH. IV. L'orateur doit aussi abonder
en exemples, tant anciens que modernes; et ce n'est pas assez
qu'il connaisse ce qui est consigné dans l'histoire, transmis, pour
ainsi dire, de main en main par la tradition orale, et ce qui se
passe de son temps ; il ne lui est pas permis de négliger les
fictions des poètes célèbres. Car si les exemples tirés de
l'histoire proprement dite tiennent lieu de témoignages et ont même
quelquefois la force de choses jugées, les autres ont, grâce à leur
antiquité, une sorte de sanction morale, ou son t du moins reçus
comme des préceptes que de grands hommes nous ont donnés sous le
voile de l'allégorie. Que l'orateur abonde donc en exemples. Delà
vient, eu effet, que les vieillards ont plus d'autorité, parce
qu'ils passent pour connaître et avoir vu plus de choses : ce que
témoigne souvent Homère ; mais on peut se procurer cette autorité
sans attendre la vieillesse, puisque la science de l'histoire a cela
de propre, que, sous le rapport de l'expérience, on semble avoir
vécu dans les siècles passés.
CH.. V. Je vais maintenant parler de
ces instruments ou moyens que, dans l'exorde de mon premier livre,
je me suis engagé à faire connaître : instruments non de l'art,
comme quelques-uns l'ont cru, mais de l'orateur lui-même. Ce
sont des armes qu'il doit toujours avoir en main, et savoir manier
habilement, pour seconder les autrès moyens que l'art et la nature
lui ont fournis, tels qu'une abondance facile de mots et de figures,
l'invention, la disposition, une mémoire sûre, et la grâce de
l'action. Or, de tous les instruments ou moyens dont je veux parler
ici, le plus puissant, c'est cette force d'âme qui ne se laisse pas
abattre par la crainte, ni intimider par les clameurs, ni dominer
par l'autorité des auditeurs au delà du juste respect qui leur est
dû. Car si, d'un côté, rien n'est plus détestable que les défauts
opposés, la présomption, la témérité, l'opiniâtreté, l'arrogance; de
l'autre, sans la fermeté, l'assurance et le courage, il ne faut rien
attendre de l'art, ni de l'étude, ni de l'expérience, qui deviennent
alors aussi inutiles que des armes entre les mains d'un homme timide
et faible. C'est à regret, sans doute, que je le dis, parce qu'où
pourrait mal interpréter ma pensée : la pudeur, qui est un défaut,
mais un défaut aimable et qui donne aisément naissance aux vertus,
la pudeur peut être nuisible, et a souvent été cause que des hommes,
pleins d'esprit et de savoir, ont laissé leurs talents s'éteindre
dans l'obscurité. Qu'au surplus, celui qui me lira sans savoir
encore distinguer la valeur de chaque mot comprenne bien que ce
n'est pas la probité que je condamne ici, mais la retenue, espèce de
crainte qui nous détourne de notre devoir, qui fait que nous nous
troublons, que nous nous repentons de ce que nous avons entrepris,
et que nous nous taisons tout à coup. Or, comment ne pas ranger au
nombre des défauts une affection de l'âme qui nous rend honteux de
bien faire? Ce n'est pas que je veuille, d'un autre côté, que
l'orateur se lève pour parler, sans témoigner aucune inquiétude,
sans changer de couleur, sans avoir le sentiment
460 du danger, car tout
cela est bon à feindre, quand même on ne l'éprouverait pas; mais il
faut que l'émotion soit l'effet de la connaissance et non de la
crainte de ce qu'on entreprend; qu'on soit ému, mais non consterné.
Or, le meilleur remède à la timidité dont je parle, c'est la
confiance ; et le front le moins aguerri est soutenu par le
témoignage d'une bonne conscience. Il est aussi, comme je l'ai dit
au commencement de cet ouvrage, des instruments naturels, que l'art
néanmoins peut seconder, tels que la voix, les poumons,
et la grâce; et ces avantages sont si considérables, que
souvent ils suffisent pour faire à certains orateurs une réputation
de talent. Notre époque a produit des orateurs plus diserts que
Trachalus : cependant, quand il parlait, il semblait effacer tous
ses contemporains, tant il captivait ses auditeurs par l'élévation
de sa taille, la vivacité de ses yeux, la majesté de son front, la
noblesse de son geste, et la beauté de sa voix, qui était, je ne dis
pas approchante du ton de la tragédie, comme le désire Cicéron, mais
supérieure à celle de tous les acteurs tragiques que j'aie jamais
entendus. Je me souviens du moins que, plaidant un jour devant le
premier des quatre tribunaux qui s'assemblent, suivant l'usage, dans
la basilique Julia, au milieu des clameurs dont retentissait toute
la salle, il se fit entendre et comprendre; et même, ce qui fut tout
à fait humiliant pour les avocats qui plaidaient devant les trois
autres tribunaux, il fut applaudi par tous les quatre à la fois.
Mais c'est un vœu que je fais, et une aussi heureuse nature est bien
rare. Si ou ne l'a pas, qu'on soit du moins capable de se faire
entendre de ceux devant qui on parle. Voilà ce que doit être
l'orateur, voilà ce qu'il doit savoir.
CHAP. VI. A l'égard du temps où l'on
peut commencer à plaider, nul doute qu'il ne se doive régler sur les
forces de chacun : aussi ne déterminerai-je point d'âge. Il est
constant, en effet, que Démosthène, à peine sorti de l'enfance,
plaida contre ses tuteurs; que Calvus, César, Pollion, n'avaient pas
encore l'âge requis pour la questure, que déjà ils s'étaient chargés
de causes fort importantes. Quelques-uns même, dit-on, parurent au
barreau encore revêtus de la robe prétexte ; et César Auguste, âgé
de douze ans, prononça devant les rostres l'éloge de son aïeule. Il
me semble néanmoins qu'il faut garder un certain milieu, et ne pas
se hâter d'exposer au grand jour un front novice, ni produire
prématurément ce qui n'a encore que de la crudité : car cette
témérité précoce fait naître le mépris du travail ; elle dépose dans
un jeune cœur le germe de l'effronterie, et, ce qui est partout
très-funeste, l'assurance devance les forces. D'un autre côté, il ne
faut pas reculer son début jusque dans la vieillesse; car chaque
jour on devient plus timide, chaque jour on s'exagère la difficulté
du premier pas; et, pendant qu'on délibère si l'on commencera, il
est déjà tard pour commencer. Il ne faut donc pas craindre de
produire le fruit de ces études lorsqu'il est vert et encore tendre,
et qu'on peut compter sur l'indulgence , sur l'intérêt qu'on prend
naturellement à la jeunesse, et que l'audace ne messied pas; lorsque
l'âge supplée ce qui manque à l'œuvre, et que les saillies échappées
à la jeunesse passent pour les indices d'un heureux naturel, comme
ce passage entier du plaidoyer de Cicéron pour Sextus Roscius :
Quoi de plus commun que l'air pour les vivants, la terre pour les
morts, la mer pour les naufragés, le rivage pour ceux qu'elle
rejette de son sein ? Il avait vingt-six ans lorsqu'il prononça
ces paroles aux grandes acclamations de ses auditeurs ; mais, dans
un âge plus avancé, il avoua que les années avaient calmé
461 l'effervescence de sa
jeunesse et clarifié ses idées. A vrai dire, quel que soit le fruit
qu'on retire des études du cabinet, il y a des progrès qui sont
attachés à la fréquentation du barreau : autre est le jour, autre
est l'aspect du danger réel ; et, prise séparément, la pratique fait
plus sans la théorie, que la théorie sans la pratique. Aussi,
lorsqu'il se présente au barreau de ces gens qui ont vieilli dans
les écoles, les voit-on, tout déconcertés par la nouveauté du
spectacle, chercher autour d'eux quelque chose qui leur rappelle
leurs exercices ordinaires. C'est que, là, le juge garde le silence,
tandis que l'adversaire nous étourdit par ses cris ; c'est que rien
de hasardé ne tombe sans être relevé, et que, si l'on avance une
proposition, il faut la prouver; c'est que souvent ce plaidoyer si
long, si péniblement élaboré, l'œuvre de tant de jours et de tant de
nuits, n'est pas à moitié prononcé, que l'eau cessant de couler nous
avertit tout à coup de finir; c'est que, dans certaines causes, il
faut laisser là l'emphase et les grands mots, et parler purement et
simplement : ce que ne savent point du tout ces gens si diserts.
Aussi en rencontre-t-on quelques-uns qui se croient trop éloquents
pour plaider. Au reste, le jeune orateur qui vient essayer au
barreau ses forces naissantes ne devra se charger d'abord que de
causes extrêmement faciles et favorables, à l'exemple du lionceau,
qui ne se repaît d'abord que d'une proie un peu tendre. Je ne veux
pas non plus qu'après avoir ainsi commencé, il continue sans
interruption, ni (nie son esprit, qui a encore besoin de nourriture,
s'arrête dans son développement; mais je veux qu'après avoir appris
ce que c'est que combat, et quelles sont les armes dont il a le plus
besoin, il retourne à l'étude, pour devenir, en quelque sorte, un
nouveau lutteur. Par là il se débarrassera, dans l'âge où l'on ose
plus aisément, de la timidité qui accompagne toujours les premiers
coups d'essai; et, en même temps, cette facilité d'oser n'ira pas
jusqu'au mépris de tout travail. Telle fut la méthode de Cicéron. Il
s'était déjà fait un grand nom parmi les avocats de son temps quand
il passa en Asie, où, entre autres maîtres d'éloquence et de
philosophie, il s'attacha particulièrement à Apollonius Molon, de
Rhodes, dont il avait déjà suivi les leçons à Rome, et se donna à
lui comme à refondre et à perfectionner. C'est ainsi qu'on arrive à
de beaux résultats, quand les préceptes et l'expérience se donnent
la main.
CH. VII. Lorsque l'orateur se sera
suffisamment préparé à toute espèce de combat, son premier soin aura
pour objet le choix des causes dont il doit se charger. Assurément,
en sa qualité d'homme de bien, il préférera toujours le rôle de
défenseur à celui d'accusateur. Cependant, il ne devra pas avoir le
nom d'accusateur tellement en horreur, que nulle considération
d'intérêt public ou privé ne puisse le déterminer à citer quelqu'un
en justice pour rendre compte de ses actions ; car les lois
elles-mêmes seraient impuissantes, si leur glaive ne passait dans
les mains d'un orateur éloquent; et s'il n'était pas permis de
réclamer le châtiment des crimes, peu s'en faudrait que les crimes
eux-mêmes ne fussent permis. Eu un mot, n'est-ce pas condamner les
bons, que d'accorder toute licence aux méchants? L'orateur ne
souffrira donc pas que les plaintes de nos alliés , ni la mort d'un
ami ou d'un parent, ni les conspirations tramées contre l'État,
demeurent sans vengeance, jaloux, non de faire punir des coupables,
mais de réprimer les vices et de corriger les mœurs; car ceux que la
raison ne 462 peut
ramener au bien ne sont contenus que par la crainte. C'est pourquoi
si vivre d'accusations et déférer des coupables à la justice dans la
seule vue d'une récompense, est une espèce de brigandage, d'un autre
côté c'est s'assimiler aux défenseurs de la patrie, que d'exterminer
de son sein le citoyen qui en est le fléau. Aussi, les personnages
les plus éminents de la république n'ont-ils pas décliné cette
partie des devoirs civils; et même, en accusant de mauvais citoyens,
des jeunes gens appartenant à d'illustres familles ont vu regarder
ces accusations comme des gages de patriotisme, parce qu'on
supposait qu'ils n'avaient pu être encouragés à haïr les méchants,
et à s'exposer à de mortelles inimitiés, que par le témoignage d'une
bonne conscience. Telle a été la conduite non-seulement d'Hortensius,
des Lucullus, de Sulpicius, de Cicéron, de César, et de plusieurs
autres, mais encore des deux Caton, dont l'un fut appelé sage,
et l'autre l'a été certainement, ou je ne sais qui le sera jamais.
L'orateur ne défendra pas non plus
tout le monde sans distinction , car son éloquence doit être un port
de salut pour les innocents, et non un refuge de pirates ; et ce qui
le décidera à entreprendre la défense de quelqu'un sera
principalement la nature de la cause. Toutefois, comme un seul homme
ne peut suffire à tous ceux dont la cause a quelque apparence de
droit ( et c'est assurément la bonne part des plaideurs), rien
n'empêche qu'il n'ait quelque égard aux recommandations et à la
qualité de ces plaideurs, c'est-à-dire qu'il ne cède a l'influence
de la vertu; car un homme de bien ne peut avoir pour amis intimes
que des gens de bien. Mais il devra se mettre en garde contre deux
sortes de vanité : l'une, de n'accorder son ministère qu'aux grands
contre les petits; l'autre, où il entre peut-être plus d'orgueil, de
ne plaider que pour les petits contre les grands ; car ce n'est pas
le rang qui fait que les causes sont justes ou injustes. S'il s'est
chargé d'une cause qui, au premier aspect, lui avait paru la
meilleure, et qu'ensuite, dans les débats, il en reconnaisse
l'iniquité, qu'il ne rougisse pas de l'abandonner, après avoir dit
la vérité à son client. En effet, si mon expérience ne me trompe
pas, le plus grand service à rendre à un plaideur , c'est de ne pas
flatter en lui de vaines espérances; aussi bien, le plaideur ne
mérite pas qu'un avocat se donne de la peine pour lui, des l'instant
qu'il méprise ses conseils ; et d'ailleurs il ne convient pas au
véritable orateur de défendre ce qu'il sait être injuste, bien qu'en
plaidant quelquefois le faux, il ne laisse pas d'agir honnêtement ,
s'il obéit à quelqu'un des motifs dont j'ai parlé.
L'orateur doit-il toujours plaider
gratuitement? c'est une question qu'il y aurait de l'irréflexion à
vouloir résoudre à la première vue. Sans doute il serait infiniment
plus honorable, plus digne des arts libéraux et du caractère que
nous exigeons de l'orateur, de ne pas vendre son ministère ni
rabaisser l'autorité d'un si grand bienfait : d'autant plus que la
plupart des choses peuvent sembler viles par cela seul qu'on y met
un prix. Un aveugle, comme on dit, verrait cela. Ainsi, tout orateur
qui aura de quoi se suffire (et il n'en faut pas tant) ne pourra se
faire payer, sans témoigner par là de la bassesse d'une âme sordide.
Mais si son patrimoine exige un supplément qui lui procure le
nécessaire, il 463
pourra, suivant les lois de tous les sages, souffrir qu'on
reconnaisse ses soins, puisque les disciples de Socrate se
cotisaient pour lui fournir de quoi vivre, et que Zénon, Cléanthe,
Chrysippe, acceptaient des récompenses de leurs disciples. Est-il,
en effet, un bien plus justement acquis que celui qui nous vient
d'un travail aussi honorable , et des mains de gens à qui on a rendu
un aussi grand service, et qui certainement en seraient indignes,
si, à leur tour, ils ne savaient le reconnaître? Un salaire est
donc, en ce cas, non seulement juste, mais nécessaire, puisque
l'orateur, étant forcé par la nature de sa profession de donner tout
son temps aux affaires d'autrui, se trouve dans l'impossibilité de
subvenir à ses besoins par un autre travail. Mais ici même il y a
une mesure à garder, et il importe beaucoup de considérer de qui
l'on reçoit, combien et jusques à quand il est
permis de continuer à recevoir. Loin de nous cet usage, plus digne
d'un pirate que d'un orateur, et qui doit répugner à un homme tant
soit peu honnête, de rançonner un plaideur à proportion du danger
qu'il court ! d'autant plus qu'en ne défendant que des gens de bien
et de bonnes causes, on n'a pas lieu de craindre d'avoir affaire à
des ingrats; et s'il s'en rencontre un, mieux vaut que la honte soit
de son côté. L'orateur donc ne voudra rien gagner au delà de ce qui
lui suffit; et, fût-il pauvre, il ne recevra rien à titre de
salaire, mais à titre d'échange, et sachant fort bien qu'il a donné
plus qu'il ne reçoit; car enfin, de ce qu'un bienfait de cette
nature ne saurait se vendre, il ne s'ensuit pas qu'il doive être
perdu. Enfin , quant à la reconnaissance, elle est plus
particulièrement imposée à celui qui est en reste.
CH. VIII. Vient ensuite la manière d'étudier
la cause , ce qui est le fondement de l'oraison ; car il n'est
point d'homme, si pauvre d'esprit qu'on le suppose, qui, après avoir
soigneusement étudié une affaire, ne soit au moins capable
d'instruire le juge. C'est pourtant un soin que prennent très-peu de
gens. Car, sans parler de ces avocats insouciants, à qui le fond du
procès importe peu, pourvu qu'ils trouvent l'occasion de crier, soit
en s'attaquant aux personnes sur des choses étrangères à la cause,
soit en se rabattant sur des lieux communs, il en est chez qui cette
négligence a pour cause une vanité prétentieuse. Les uns, sous
prétexte qu'ils sont surchargés d'occupations, et qu'ils ont
toujours à faire quelque autre chose de plus pressé, font venir le
plaideur chez eux la veille ou le .matin du jour de l'audience, et
se glorifient même quelquefois de n'avoir été instruits que sur les
bancs ; d'autres, pour faire parade de leur esprit et de leur
pénétration, affirment effrontément qu'ils possèdent et comprennent
l'affaire, avant presque de l'avoir entendue ; puis, après avoir
débité, aux acclamations de l'auditoire, force belles paroles qui
n'intéressent ni le juge ni le plaideur, ils sortent et traversent
la place publique, trempés d'une sueur triomphante, et escortés de
leurs admirateurs. Je ne puis supporter non plus la délicatesse de
ceux qui chargent leurs amis du soin d'étudier un procès , quoiqu'il
y ait à cela moins d'inconvénient, si ces amis ('étudient bien et
les en instruisent bien. Mais qui peut mieux l'étudier que celui qui
doit la plaider? Et comment espérer que ce fidéicommissaire, cette
espèce d'interprète qui fait l'office d'une main tierce, se fatigue
de gaieté de cœur à étudier une cause qu'il ne doit pas plaider,
quand celui qui doit la plaider n'en fait pas plus de cas? Mais ce
qui est une très-mauvaise coutume, c'est de se contenter de ces
mémoires, composés, ou par le plaideur, qui, en recourant à un
464 défenseur, accuse par
là son insuffisance, ou par un de ces avocats qui, en même temps
qu'ils se confessent hors d'état de plaider, font pourtant ce qu'il
y a de plus difficile quand on plaide; car celui qui peut juger ce
qu'il faut ou dire, ou dissimuler, ou éluder, ou modifier, ou
feindre, pourquoi ne serait-il pas orateur, puisqu'il a l'art, ce
qui est plus difficile, défaire un orateur? Or, le ministère de ces
avocats serait moins nuisible, s'ils se bornaient à rédiger les
faits comme ils se sont passés; mais ils se mêlent d'y ajouter ce
qu'on appelle le dessein, des couleurs, et quelquefois des choses
pires que la vérité, qu'ils veulent dissimuler. Cependant la plupart
des orateurs se feraient scrupule de rien changer à ces mémoires, et
ils les respectent religieusement comme des thèmes de déclamation.
Qu'arrive-t-il? Ils se trou vent pris en défaut; et, pour n'avoir
pas voulu s'instruire de la cause avec leurs clients, ils sont
réduits à l'apprendre de la bouche de leurs adversaires.
Donnons donc, avant tout, pleine
liberté aux plaideurs, et pour le temps et pour le lieu
; et exhortons-les nous-mêmes à nous exposer dans un récit improvisé
leur affaire aussi verbeusement et d'aussi haut qu'ils le voudront;
car il y a moins d'inconvénient à écouter ce qui est superflu, qu'à
ignorer ce qui est nécessaire ; et souvent l'orateur trouvera et le
mal et le remède dans des choses que le plaideur regardait comme
indifférentes. Un avocat ne doit pas non plus se lier à sa mémoire,
jusqu'à négliger de prendre des notes sur ce que son client lui aura
dit. Ce n'est pas assez de l'avoir entendu une fois, il faut le
forcer à redire une seconde fois, et môme plus, ce qu'il a déjà dit,
non-seulement parce qu'il a pu lui échapper quelque chose dans-un
premier récit, surtout si c'est un homme sans expérience des
affaires, comme il s'en rencontre beaucoup, mais encore pour
s'assurer s'il est d'accord avec lui même ; car la plupart des
plaideurs mentent ; et, comme s'ils avaient à plaider devant leur
avocat, ils lui parlent comme ils parleraient à leur juge. C'est
pourquoi il ne faut jamais trop les croire : il fiant, au contraire,
les retourner dans tous les sens, les dérouter, et les faire sortir,
en quelque sorte, de leur retraite. De même que les médecins ont
non-seulement à guérir les maux apparents, mais encore à découvrir
des maux cachés que souvent les malades eux-mêmes dissimulent, il
faut de même que l'avocat sache voir plus de choses qu'on ne lui en
montre. Ainsi, après avoir écouté avec toute la patience désirable,
il lui faudra passera un autre personnage; et, jouant le rôle de la
partie adverse, il fera à son client toutes les objections qu'on
peut imaginer contre, et que comporte la nature d'une pareille
altercation; il le pressera de questions, il le harcellera à
outrance; car c'est en cherchant partout, qu'on parvient quelquefois
à découvrir la vérité où l'on s'y attendait le moins. En un mot,
pour bien étudier une cause, la première condition est l'incrédulité
; car un plaideur répond de tout : à l'entendre, il aura pour lui la
voix du peuple entier, il produira des dépositions écrites et
scellées, son adversaire lui-même n'osera pas lui contester tel et
tel point: ce qui est une raison de plus pour examiner toutes les
pièces du procès. Mais il ne suffit pas d'y jeter un coup d'œil, il
faut les lire avec attention : très-souvent ces pièces ne
contiennent rien de ce qu'on promettait, ou elles disent moins, ou
il s'y trouve mêlé quelque chose de nuisible,
465 ou elles disent trop
et se accréditeraient par leur exagération. Enfin, vous en trouverez
souvent le lien rompu, ou le sceau, soit altéré, soit entier, mais
contrefait. Or, faute d'avoir examiné les pièces d'avance, on est
fort embarrassé à l'audience par ces découvertes imprévues; et il
est plus nuisible de ne pas satisfaire à ce qu'on a promis, que de
ne rien promettre du tout. On découvrira aussi une foule de détails
que les clients regardaient comme sans importance pour la cause, en
se donnant la peine de creuser toutes les sources d'où, comme je
l'ai dit en son lieu, les arguments se tirent. Autant il convient
peu de les chercher çà et là quand on plaide, et de les sonder une à
une, pour les raisons que j'ai données, autant il est indispensable,
en étudiant la cause, de scruter tout ce qui a rapport aux
personnes, aux temps, aux lieux, aux mœurs, aux pièces, et à toutes
ces circonstances d'où naissent les preuves qu'on appelle
artificielles, et qui nous font connaître aussi quels sont les
témoins à redouter et comment on doit combattre leurs dépositions;
car il importe beaucoup de savoir si l'accusé est en butte à
l'envie, à la haine, ou au mépris. L'envie s'attaque d'ordinaire aux
supérieurs, la haine aux égaux, et le mépris aux inférieurs.
Après avoir ainsi étudié la cause à
fond, et s'être mis devant les yeux tout ce qui peut lui être
favorable ou contraire, il reste à l'orateur à revêtir un troisième
personnage, celui de juge. Qu'il se figure donc que c'est devant lui
que la cause se plaide, et qu'il se persuade que ce qui le
toucherait, s'il avait à prononcer sur la même affaire, est aussi ce
qui ne peut manquer de faire impression sur quelque juge que ce
soit. De cette sorte, l'issue trompera rarement son attente, ou ce
sera la faute du juge.
CHAP. IX. A l'égard de ce qu'il
convient d'observer en plaidant, j'en ai traité dans presque tout le
cours de cet ouvrage. Cependant mon sujet exige que je touche ici
quelques considérations sur le même point, mais qui ne regardent pas
tant l'art de parler que les devoirs de celui qui plaide.
Avant tout, que l'impatient désir de
briller ne lui fasse pas oublier, comme à la plupart des orateurs,
l'intérêt de la cause. A la guerre, un capitaine n'a pas toujours à
conduire son armée par de belles plaines; il lui faut le plus
souvent gravir d'âpres collines, prendre d'assaut des villes situées
sur un roc escarpé, ou défendues par de puissants remparts. Ainsi
l'orateur pourra, dans l'occasion, se complaire à errer parmi les
fleurs, et, s'il combat en rase campagne, déployer fastueusement
toutes ses forces : mais s'il lui faut pénétrer dans les détours du
droit, et dans les retraites où se cache la vérité, il ne s'amusera
pas alors à cavalcader, ni à décocher des pensées vives et
brillantes ; mais, préparant son attaque par des travaux occultes,
il creusera des souterrains, disposera des embuscades, et aura
recours à tous les moyens qui peuvent dérober sa marche à l'ennemi.
Pendant que tout cela se fait, nul n'applaudit à l'orateur, mais le
résultat le dédommage amplement, et tout vient à point à qui sait
attendre. Car une fois que cette éloquence, toute d'apparat, a fait
explosion au milieu des applaudissements de ses vains admirateurs,
le vrai mérite se relève plus éclatant que jamais : les juges
laissent voir qui a su les toucher, le sentiment des doctes prévaut,
et l'on reconnaît que la véritable louange est celle qui se fait
entendre après que l'orateur s'est tu. Aussi était-ce l'usage, chez
les anciens 466 de
dissimuler l'éloquence, et Marc-Antoine en fait un précepte, fondé
sur ce que l'orateur trouve par là plus de créance, et que le juge
se met moins en garde contre ses pièges ; mais l'éloquence, telle
qu'elle était alors, pouvait se dissimuler : elle n'avait pas encore
cet éclat qui lui fait percer tous les voiles. Il faut donc au moins
dissimuler nos ruses, nos desseins, et tous ces artifices qui
manquent leur effet, s'ils se laissent apercevoir : jusque-là
l'éloquence peut se cacher, mais le choix des mots, la gravité des
pensées, la beauté des figures, ou manquent tout à fait, ou se
laissent npcrcevoir. Or, c'est précisément parce que ces qualités ne
peuvent rester cachées ; qu'il ne faut pas les montrer ; et s'il
faut opter entre l'intérêt de la cause qui ne comporte pas cet
éclat, et l'intérêt de l'orateur, qui a sa vanité à satisfaire, je
veux qu'on loue plutôt la cause que l'avocat. D'ailleurs, l'issue le
justifiera, et fera voir qu'il a très-bien plaidé une très-bonne
cause, en ce qu'il sera démontré que nul ne plaide plus mal que
celui qui plaît dans une cause qui déplaît, puisque ce qui plaît est
nécessairement emprunté et hors de la cause.
L'orateur ne dédaignera pas non plus
de plaider de petites causes, sous prétexte qu'elles sont au-dessous
de lui, ou qu'une matière peu libérale pourrait le déconsidérer. Le
devoir de notre profession suffit pour nous justifier; ensuite, nous
devons souhaiter que nos amis n'aient jamais que des procès de cette
nature; enfin, on a toujours assez bien parlé, quand on a satisfait
à son sujet. Cependant il se rencontre des avocats qui, lorsqu'ils
ont à plaider de ces sortes d'affaires, vont chercher hors du sujet
de quoi en plâtrer la maigreur, et, au défaut d'autres ressources,
en remplissent les vides par des invectives, à tort ou à raison, peu
importe, pourvu qu'ils y trouvent l'occasion de briller, et de se
faire interrompre par des acclamations. Pour moi, cette manière de
plaider me paraît tellement indigne de l'orateur parfait, que je ne
crois pas même qu'il veuille se permettre des personnalités
offensantes, lors même qu'elles seraient fondées, à moins que la
cause n'en fasse une nécessité ; car c'est assurément une éloquence
canine, comme dit Appius, que celle d'un avocat qui fait
profession de médire pour autrui. Aussi bien ceux qui exercent ce
métier doivent faire provision de patience pour supporter les
représailles; car souvent on leur rend la pareille, ou, pour le
moins, le plaideur porte la peine due à l'insolence de son
défenseur. Mais le châtiment n'est pas proportionné au degré de ce
vice, qui est tel, qu'il n'y a que l'occasion qui mette de la
différence entre un médisant et un malfaiteur. C'est un plaisir bas,
méchant, et que tout auditeur bien né ne peut que réprouver, mais
qui est souvent réclamé par des plaideurs, plus jaloux de se venger
que de se défendre. Or, en cela, comme en bien d'autres choses, il
faut se garder de faire leur volonté. Quel est l'homme, pour peu
qu'un sang libre coule dans ses veines, qui consente à s'armer de
l'injure au gré d'autrui ? Il en est cependant qui prennent plaisir
à attaquer même l'avocat de la partie adverse. Or, à moins que
celui-ci ne se le soit attiré, rien n'est plus contraire aux égards
qu'on se doit entre gens de la même profession. Ajoutez que cela est
non-seulement inutile à celui qui plaide , puisque l'offensé est en
droit de lui rendre la pareille, mais encore nuisible à la cause,
parce que, d'un adversaire, il se fera nécessairement un ennemi,
qui, quelle que soit sa faiblesse , saura lui faire payer son
insolence avec 467
usure. Mais ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que cette
modération, qui donne tant d'autorité et de crédit à l'orateur, est
entièrement perdue, dès qu'il oublie sa dignité pour vociférer comme
un furieux, et qu'il pense moins à éclairer la religion du juge qu'à
satisfaire l'animosité du plaideur. Il y a même une sorte de
franchise qui glisse quelquefois dans une témérité dangereuse et
pour la cause et pour l'orateur; et ce n'est pas sans raison que
Périclès souhaitait qu'il ne lui échappât jamais le moindre mot qui
pût choquer les Athéniens. Or, ce qu'il disait de ce peuple, je le
dis de tous ceux qui peuvent nuire également ; car le même mot, qui
ne paraît que fort quand ou le dit, devient impertinent quand il a
blessé.
Maintenant, comme chaque orateur a sa
manière de procéder, laquelle diffère presque toujours de celle des
autres, et que le travail de l'un passe pour pesanteur d'esprit,
tandis que la facilité de l'autre passe pour présomption, il ne me
paraît pas hors de propos d'indiquer ici le milieu dans lequel
l'orateur doit rester. Je veux qu'il prépare son plaidoyer avec tout
le soin possible; car c'est être non-seulement négligent, mais
malhonnête homme, mais perfide et traître, quand on s'est chargé
d'une cause, que de ne pas la plaider aussi bien qu'on aurait pu le
faire. Il ne doit donc pas même en entreprendre an delà du nombre
auquel il sent qu'il peut seulement suffire. Il écrira, autant que
sa cause le permettra , ce qu'il doit dire, et même, comme dit
Démosthène, il le gravera, si cela est possible : ce qui néanmoins
n'est praticable que dans les causes privées qui se plaident en une
seule fois, et dans les causes publiques, où le juge ajourne les
secondes plaidoiries. Mais lorsqu'il faut répondre sur-le-champ, on
ne peut pas avoir tout préparé ; et même ceux qui n'ont pas toute la
présence d'esprit désirable se trouvent embarrassés parce qu'ils ont
écrit, si l'adversaire leur fait des objections auxquelles ils ne
s'attendaient pas : car ce n'est qu'à regret qu'ils renoncent à ce
qu'ils ont préparé, et, tant que dure la plaidoirie, ils cherchent,
ils épient s'ils ne pourraient pas détacher quelque chose de leur
discours écrit, pour l'insérer dans ce qu'ils ont à improviser; et
quand ils le font, ces deux parties ne s'ajustent pas, et leur
mélange se trahit, non-seulement par le défaut de cohésion, comme
dans un ouvrage dont les pièces sont mal jointes, mais encore par la
bigarrure du style. Ainsi, ils n'ont ni l'entraînement de
l'improvisation , ni l'ordre d'un travail préparé, mais tous deux se
nuisent réciproquement. En effet, ce qui est écrit arrête l'esprit,
au lieu de le suivre. Il faut donc, dans ces sortes de plaidoiries,'
se tenir, comme disent les gens de la campagne, sur tout pied. Or,
comme tout plaidoyer consiste à avancer des propositions et à
réfuter celles de l'adversaire, nous pouvons écrire les premières,
et même la réfutation de ce que nous sommes certains qu'on nous
répondra, car il y a des réponses qu'on peut prévoir avec certitude.
Pour le reste, il est une préparation qu'on peut apporter à
l'audience, c'est d'avoir bien étudié la cause; il en est une autre
qu'on peut y prendre, c'est d'écouter attentivement ce que dit
l'adversaire. On peut, d'ailleurs, méditer à l'avance sur un grand
nombre de cas probables, et se tenir prêt à tout événement. Cela
même est plus sûr que d'écrire, en ce qu'il est plus facile
d'abandonner une pen- 468
sée ou delà transporter ailleurs. Mais, soit que la nécessité de
répondre sur-le-champ , ou que quelque autre raison l'oblige à
improviser, jamais l'orateur ne se croira dans l'impossibilité de
sortir d'embarras, quand l'art, l'étude et l'exercice lui auront
donné cette force, d'où naît la facilité. Toujours armé, toujours
prêt au combat, les paroles ne lui manqueront pas plus à l'audience
que dans les conversations journalières et domestiques. Jamais, dans
la crainte de demeurer court, il ne se soustraira à son devoir,
pourvu qu'il ait le temps de s'instruire de sa cause ; car, pour le
reste, il le saura toujours.
CHAP. X. Il me reste à parler du
genre d'éloquence qui convient a l'orateur parfait : c'est,
d'après l'ordre de ma première division, le troisième point que je
me suis engagé à traiter ; car j'ai promis de parler d'abord de l'art,
puis de l'artiste, et enfin de l'œuvre. Or, comme
l'oraison est l'œuvre, de la rhétorique et de l'orateur, et qu'elle
est susceptible de plusieurs formes, ainsi que je le ferai voir,
l'art et l'artiste ont part à toutes ces formes. Cependant elles
diffèrent beaucoup entre elles, non-seulement par l'espèce, comme
une statue diffère d'une autre statue, un tableau d'un autre
tableau, un plaidoyer d'un autre plaidoyer, mais encore par le genre
même, comme les statues toscanes diffèrent des statues grecques ,
comme l'éloquence asiatique de l'éloquence attique. De plus, ces
divers genres ont leurs partisans comme leurs auteurs. C'est ce qui
explique pourquoi dans l'éloquence, et peut-être même dans tous les
antres arts, la perfection est encore à attendre ; et cela,
non-seulement parce que l'un excelle dans une qualité, et l'autre
dans âne autre, mais aussi parce que la même forme ne plaît pas
également à tout le monde, soit à cause des temps et des lieux, soit
à cause du goût et des principes de chacun.
Les premiers peintres célèbres, dont
les ouvrages ne se recommandent pas seulement par leur antiquité,
sont, dit-on, Polygnote et Aglaophon. Quoiqu'ils
n'employassent qu'une seule couleur, leur peinture a encore
aujourd'hui des amateurs si zélés, qu'ils préfèrent ces ébauches
presque grossières, et où l'on ne peut guère qu'entrevoir les germes
de l'art, aux productions des plus grands maîtres qui les ont
suivis, mais sans autre raison, selon moi. que la prétention de
passer pour habiles connaisseurs. Après ces deux peintres, et à une
distance assez rapprochée, vinrent Zeuxis et Parrhasius,
qui vécurent tous deux vers le temps de la guerre du Péloponnèse,
car on trouve dans Xénophon un dialogue entre Socrate et Parrhasius
: ils firent faire un grand pas à l'art. On dit que le premier
inventa le mélange des lumières et des ombres, et que le second
excellait dans Tari de dessiner nettement les contours. Zeuxis, en
effet, donnait plus particulièrement ses soins aux membres du corps,
croyant en cela s'occuper de ce qu'il y a de plus important et de
plus noble, et s'attachant, dit-on, à suivre Homère, chez qui les
formes robustes caractérisent la beauté, même dans les femmes.
Parrhasius, au contraire, était si exact dans le dessin, qu'on
l'appelle encore aujourd'hui le législateur des peintres,
parce que ceux qui sont venus après lui se sont fait une loi de
représenter les dieux et les héros d'après ses traditions. Mais ce
fut vers le temps de Philippe, et jusqu'aux successeurs d'Alexandre,
que la peinture jeta le plus vif éclat, mais par des talents divers.
Ainsi Protogène brilla par le fini, Pamphile et
Mélanthe par la connaissance des règles, Antiphile par la
facilité, Théon de Samos par la force imitative delà
conception, Apelle par l'esprit, et surtout par cette grâce
dont il se glorifiait lui-même ; mais Euphranor
469 l'emportait sur tous
les autres, en ce qu'il possédait ces différentes qualités dans un
degré aussi (minent que les meilleurs maîtres, et qu'il était aussi
excellent statuaire qu'excellent peintre.
La même différence se remarque dans la
sculpture. Les statues de Callon et d'Hégésias sont
d'un style dur, et approchent de la manière toscane. Celles de
Calamis ont déjà moins de roideur, et l'on trouve dans Myron
un air encore plus aisé que dans Calamis. Polyclète surpasse
tous les statuaires par l'exactitude et la grâce, au jugement de la
plupart des connaisseurs, qui, tout n lui décernant la palme,
estiment que, s'il n'y n rien à retrancher en lui, il y aurait
néanmoins à ajouter, et que la plénitude de la force lui manque. En
effet, s'il a embelli la forme humaine j'usqu'à l'idéal, il est
resté au-dessous de la majesté divine ; on dit même que la gravité
de l'âge mûr effrayait son talent, qui n'osa guère exprimer que la
tendre jeunesse. Mais ce qui manqua à Polyclète, Phidias et
Alcamène l'eurent en partage. Toutefois, Phidias passe pour
avoir été plus habile à représenter les dieux que les hommes. II est
inimitable dans l'art de travailler l'ivoire, quand il n'aurait fait
que sa Minerve à Athènes, et son Jupiter Olympien en
Élide, dont la beauté semble avoir ajouté à la religion des peuples
: tant la majesté de l'œuvre égalait l'idée du dieu ! On assure que
Lysippe et Praxitèle ont le mieux reproduit la réalité
; car on reproche à Démétrius d'avoir porté en cela
l'exactitude jusqu'à l'excès, et d'avoir plus recherché la
ressemblance que la beauté.
Il en fut de même de l'éloquence : si
l'on en considère les espèces, on trouvera dans les esprits presque
autant de formes diverses que dans les corps. Mais, indépendamment
de ses espèces, elle a aussi ses genres. Le premier qui se présente
dans l'ordre du temps se ressent de la barbarie d'un âge grossier,
mais ne laisse pas de porter l'empreinte d'une grande vigueur
d'esprit. Tel est, par exemple, le genre de Lélius, de
Scipion l'Africain, du vieux Caton, et des Gracques,
que l'on peut appeler les Polygnotes et les Callons de
l'éloquence. Vient ensuite un genre moyen, représenté par L.
Crassus et Q. Hortensius. Enfin on vit fleurir, à des
époques assez rapprochées, une foule d'orateurs, dans chacun
desquels on remarque un caractère particulier. Ainsi, on admire la
force de César, la nature heureuse de Célius, la
délicatesse de Calidius, l'exactitude de Pollion, la
dignité de Messala, l'austérité de Calvus, la gravité
de Brutus, la finesse perçante de Sulpicius, et le
mordant de Cassius; et, parmi les orateurs de nos jours,
l'abondance de Sénèque, l'énergie d'Africanus, la
maturité d'Afer, l'agrément de Crispus, l'organe de
Trachalus, l'élégance de Secundus. Mais nous avons en
Cicéron, non pas seulement un Euphranor éminemment doué
de plusieurs espèces de qualités, mais un homme universel, qui
possède au plus haut degré toutes les qualités qui distinguent
chacun des autres. Cependant ses contemporains ont osé toucher à son
génie : ils lui ont reproché de l'enflure, un style asiatique et
redondant; ils trouvaient qu'il se répétait trop, que parfois ses
plaisanteries étaient froides, que sa composition était lâche,
désordonnée, et (loin de nous cette pensée!) presque efféminée. Ce
fut bien pis quand il eut
470 succombé sous le fer des triumvirs : tout ce qu'il
avait d'ennemis, d'envieux et de rivaux, et ceux qui trouvaient, eu
se déclarant contre lui, une occasion de flatter la puissance du
jour, se déchaînèrent à l'envi contre ce grand homme, qui n'était
plus là pour leur répondre. Singulière contradiction ! ce même
orateur que certaines gens trouvent sec et maigre, tout le mal que
ses ennemis eux-mêmes ont pu dire de lui, c'est qu'il prodiguait
trop les fleurs et l'esprit. Ces deux reproches sont également mal
fondés; mais, s'il ne s'agit que de mentir, le sujet du premier
reproche offre une occasion plus belle. Du reste, les plus acharnés
de ses détracteurs furent ceux qui avaient la prétention d'imiter le
style attique. Ils formaient une espèce de secte initiée à de
certains mystères, et le traitaient comme un barbare, un profane,
peu zélé pour les principes de leur doctrine. Aujourd'hui même
encore, des écrivains secs, décharnés, sans substance, et qui
décorent leur maigreur du nom de santé, bien qu'on ne puisse
imaginer deux choses plus incompatibles, ces écrivains, dis-je,
importunés de l'éclat de son éloquence, qui produit sur eux le même
effet que le soleil sur des yeux débiles, se cachent à l'ombre d'un
grand nom. Mais comme Cicéron leur a répondu fort au long, et dans
plusieurs endroits de ses ouvrages, je crois qu'en traitant après
lui la même matière, je ferai bien d'être court.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
distingue deux sortes de style, l'attique et l'asiatique
: l'un serré et plein, l'autre enflé et vide; l'un n'ayant rien de
superflu, l'autre manquant surtout de goût et de mesure. Quelques
grammairiens, au nombre desquels je trouve Santra, attribuent
cette différence à ce que, la langue grecque ne s'étant introduite
que peu à peu dans les villes de l'Asie qui avoisinaient la Grèce,
leurs habitants aspirèrent à la gloire de l'éloquence avant que. de
posséder suffisamment cette langue, de sorte que, faute de pouvoir
exprimer un grand nombre de leurs pensées par le mot propre, ils
furent forcés de recourir à de» circonlocutions, et en contractèrent
si bien l'habitude, qu'elle leur est restée. Pour moi, j'attribuerai
plutôt cette différence au génie même des orateurs et des auditeurs
: ainsi les Athéniens, peuple délié et tin, ne pouvaient supporter
rien d'enflé ni de surabondant, taudis que les Asiatiques,
naturellement vaniteux et pleins de jactance, ont porté leur
caractère jusque dans l'éloquence. Les inventeurs de cette division
y ont ajouté un troisième genre, le rhodien, qu'ils regardent comme
un genre intermédiaire et mixte. Il n'est, en effet, ni aussi serré
que l'attique, ni aussi abondant que l'asiatique; en sorte qu'il
semble tenir quelque chose et du pays où il est né, et de son
auteur. En effet, Eschine, qui avait choisi Rhodes pour le lieu de
son exil, y transporta la littérature d'Athènes; et cette
littérature, semblable à une plante qoi dégénère en changeant de-
climat, s'imprégna d'un goût étranger. Ainsi les Rhodiens ont une
certaine langueur, une certaine mollesse, qui ne manque pourtant pas
de consistance ; on ne peut pas comparer leur style à l'eau d'une
source limpide, il ne ressemble pas non plus à un torrent limoneux :
il offre plutôt l'image d'un lac paisible.
On ne peut donc douter que le genre
attique ne soit incomparablement le meilleur. Mais si les écrivains
attiques ont des qualités communes, c'est-à-dire un jugement solide
et un goût exquis, leur style se partage en plusieurs espèces C'est
pourquoi j'estime que ceux-là se trompent fort, qui ne reconnaissent
pour attiques que les orateurs qui ont un style délié, clair,
expressif; 471 qui se
contentent, pour ainsi dire, d'une certaine frugalité d'éloquence,
et ne sortent jamais la main de dessous le manteau. Car si cela est,
qui sera attique? Lysias? soit : d'autant que ses
partisans le vénèrent comme la mesure du style attique. Aussi bien,
si j'admets Lysias, n'est-ce pas déclarer que je suis prêt à
remonter jusqu'à Coccus et Andocide? Cependant je leur
demanderai si Isocrate a écrit dans le goût attique; car aucun
orateur ne ressemble moins à Lysias. Ils diront que non ; mais c'est
pourtant de son école que sont sortis les plus grands orateurs de la
Grèce. Cherchons quelque chose de plus semblable. Hypéride est-il
attique? Oui, certes : cependant il a encore plus que Lysias
sacrifié aux grâces. J'en omets beaucoup d'autres, Lycurgue,
Aristogiton, et leurs devanciers, Isée, Antiphon,
qui tous, comme les hommes proprement dits, sont semblables quant au
genre, et différents quanta l'espèce. Mais que dirai-je d'Eschine,
dont j'ai fait mention tout à l'heure? N'est-il pas plus large, plus
hardi, plus élevé que ceux que je viens de nommer? Et Démosthène,
combien n'est-il pas supérieur à tous ces orateurs grêles et
circonspects, pour la force, la sublimité, l'impétuosité, l'élégance
et l'harmonie? Ne sait-il pas s'élever avec son sujet, animer son
style -par des figures, et le semer de brillantes métaphores? Ne
sait-il pas donner une voix à tout, par la puissance de la
prosopopée? Et quand il jure par les mânes des défenseurs de la
république, morts à Marathon et à Salamine, ne révèle-t-il pas un
élève de Platon? Et ce Platon lui-même, l'appellerons-nous un
Asiatique, lui qu'on prendrait le plus souvent pour la pythonisse
inspirée? Que dirai-je enfin de Périclès? Me fera-t-on voir
la beauté maigre de Lysias dans cet orateur, dont les poêles
comiques, tout en le décriant, comparaient l'éloquence aux éclairs
et au tonnerre ? Pourquoi donc n'accorder le goût attique qu'à ceux
dont le style ressemble à un filet d'eau ruisselant sur un lit de
petits cailloux? Pourquoi dire que c'est là seulement qu'on respire
l'odeur du thym? Je crois, en vérité, que si ces gens rencontraient
dans l'Attique un terrain plus fertile et plus riche que le reste,
ils diraient que ce terrain n'est pas attique, sous prétexte qu'il
rend plus qu'il n'a reçu, et déroge à cette fidélité, du sol
athénien, sur laquelle Ménandre s'est égayé. Quoi donc ! s'il
s'élevait un orateur qui joignît aux grandes qualités de Démosthène
celles qui semblent lui avoir manqué, soit parce que la nature les
lui avait refusées, soit parce que les lois d'Athènes les lui
interdisaient, et que cet orateur remuât plus fortement les cœurs,
j'entendrais dire : Démosthène ne parlait pas ainsi? Et s'il
réussissait à charmer les oreilles par une composition plus
nombreuse que la sienne, ce qui ne me semble guère possible, mais
enfin, si cela se voyait, on dirait que cette composition n'est pas
attique? Ah! que ces partisans de l'atticisme veuillent bien se
faire une idée plus juste de ce nom, et se persuader que parler
attiquement, c'est parler parfaitement. Encore si c'étaient des
Grecs que je visse s'obstiner ainsi dans cette opinion , je le
supporterais plus volontiers ; mais les conditions de l'éloquence
latine ne sont pas les mêmes. Si, en effet, sous le rapport de
l'invention, de la disposition, du dessein, et des autres qualités
de ce genre, elle me paraît semblable à l'éloquence grecque, et en
quelque sorte sa fille, je trouve que, sous le rapport de
l'élocution, elle peut à peine prétendre à l'imiter. Et
472 d'abord la langue
latine est plus dure. Ainsi, nous manquons de deux lettres
très-agréables (θ et φ)
que possèdent les Grecs, l'une voyelle et l'autre consonne. Il n'en
est pas de plus douce chez les Grecs, auxquels nous les empruntons
toutes les fois que nous nous servons de leurs propres mots ; et
quand cela nous arrive, une grâce indéfinissable se répand aussitôt
sur notre langage. Écrivez, par exemple, Ephyris et
Zephyris avec nos lettres, ces deux mots produiront quelque
chose de sourd et de barbare, et, au lieu de ces aimables lettres,
vous en aurez de tristes et de rudes, que les Grecs ne connaissent
pas. En effet, la lettre φ, qui est la
sixième de notρe alphabet, appartient à peine
à la voix humaine, ou plutôt n'appartient à aucune voix, puisqu'elle
est le produit du sifflement de l'air entre les dents ; outre que,
suivie immédiatement d'une voyelle, elle se casse en quelque sorte,
et que si elle heurte une consonne, comme dans frangit, elle
la brise et en devient elle-même encore plus rude. Quant au digamma
éolien, quoique nous en ayons rejeté la forme, nous en conservons la
force, pour ainsi dire, malgré nous, lorsque nous prononçons
certains mots, tels que servus et cervus. Nous avons
encore la lettre g, qui rend les syllabes dures, utile seulement
pour unir les voyelles qui la suivent, comme quand nous écrivons
equos et equum, mais ailleurs superflue ; et encore même
ces deux voyelles rendent un son tout à fait inconnu aux Grecs, et
qu'on ne peut, par conséquent, représenter avec leurs caractères.
Ajoutez que la plupart de nos mots se terminent par une lettre, pour
ainsi dire, mugissante, par la lettre m. Au lieu de cette lettre,
qui n'existe pas chez les Grecs en tant que finale, ils ont le v,
qui, comme désinence, sonne agréablement , et qui, chez nous,
termine très-rarement un mot. Que dirai-je, enfin, de ces syllabes
qui, dans notre langue, s'appuient sur les lettres b et d d'une
manière si rude, que la plupart, sinon des plus anciens, mais des
anciens, ont essaye de les adoucir, non-seulement en disant
aversa pour abversa, mais en ajoutant un s à la
préposition ab, quoique la lettre s soit dissonante par elle-même?
Notre accentuation même est moins douce, tant à cause d'une certaine
roideur qu'à cause de son uniformité. En effet, dans nos mots, la
dernière syllabe n'est jamais relevée par un accent aigu, ni
tempérée par un accent circonflexe ; mais ils finissent toujours par
une ou deux syllabes graves. Aussi la langue grecque l'emporte
tellement sur la nôtre en agrément, que, toutes les fois que nos
poètes ont voulu donner de la douceur à leurs vers, ils les ont
embellis de mots grecs. Mais ce qui est beaucoup plus considérable,
c'est que pour une infinité de choses nous manquons de noms propres,
ce qui nous oblige à recourir à des métaphores et à des périphrases
; et qu'à l'égard des choses même qui ont une dénomination,
l'extrême pauvreté de notre langue fait que nous sommes forcés
très-souvent de répéter le même mot, tandis que les Grecs abondent
non-seulement en mots, mais en idiomes tout différente les uns des
autres.
Ainsi, quiconque exigera de flous la
grâce du langage attique, qu'il nous donne même douceur, même
richesse d'élocution. Que si ces avantages nous ont été refusés,
tachons d'accommoder nos pensées à notre langue telle qu'elle est,
et de ne pas allier des idées d'une extrême délicatesse à des mots
trop forts, pour ne pas dire trop épais, de peur que ces deux
qualités ne s'entre-détruisent par leur mélange. En effet, moins on
est secondé par la langue, plus il faut faire d'efforts du côté de
l'invention. Sachons tirer 473
des entrailles de notre sujet des pensées sublimes et variées ;
sachons remuer toutes les affections dfs cœurs, et répandre sur
notre style l'éclat des métaphores. Nous ne pouvons avoir la
délicatesse des Grecs : soyons plus forts; nous ne saurions
rivaliser avec eux pour la légèreté : compensons cette qualité par
le poids ; ils sont plus maîtres que nous de s'exprimer avec
propriété : surpassons-les par l'abondance. Chez les Grecs, le plus
frêle esquif sait trouver un port : nous autres Latins, voguons sur
de plus gros vaisseaux, qu'un vent plus fort enfle nos voiles ;
cependant ne tenons pas toujours la haute mer, car il est bon
quelquefois de côtoyer le rivage. Les Grecs abordent facilement à
travers les bas-fonds : moi, sans prendre trop le large, je saurai
trouver un lieu où ma barque ne puisse s'engraver. Si les Grecs
réussissent mieux dans les sujets qui demandent un style léger et
précis, ce en quoi seulement ils l'emportent sur nous, et ce qui
fait que nous ne pouvons leur disputer le prix dans la comédie, ce
n'est pas une raison pour renoncer entièrement à ce genre de style ;
mais faisons tous nos efforts pour nous en tirer le mieux que nous
pourrons. Or, nous pouvons les égaler pour la mesure et pour le
goût. Quant à la grâce de l'expression, puisqu'elle n'est point dans
le fond de notre langue, suppléons-y par des secours étrangers.
Est-ce que Cicéron n'a pas, dans les causes privées, la finesse, la
douceur, la clarté et la mesure désirables? ces qualités ne
brillent-elles pas dans M. Calidius? Scipion, Lélius, Caton,
n'ont-ils pas été, pour ainsi dire, les Attiques des Romains, sous
le rapport de l'élocution? Or, pourquoi ne se contenterait-on pas
d'arriver à un point au delà duquel il n'y a rien de mieux ?
On va plus loin : il en est qui
prétendent qu'il n'y a d'éloquence naturelle que celle qui se
rapproche le plus du langage dont nous usons tous les jours avec nos
amis, nos femmes, nos enfants, nos esclaves, et dans lequel nous
nous contentons d'exprimer nos volontés et nos sentiments, sans rien
empruntera l'art ni à l'étude; que tout ce qu'on y ajoute n'est
qu'affectation et vaine jactance ; que tout cela est contraire à la
vérité et n'a été inventé que pour briller avec des mots, qui, par
leur nature, n'ont pas d'autre emploi que de servir la pensée.
Ainsi, selon eux, la constitution des athlètes, quoique rendue plus
vigoureuse par l'exercice et un régime particulier de nourriture,
n'est pas naturelle, et leur beauté excède la loi de la forme
humaine. Car à quoi bon, disent-ils, recourir à des circonlocutions
et à des métaphores pour manifester sa pensée, c'est-à-dire employer
plus de mots qu'il n'en faut, ou des mots figurés, puisque chaque
chose a sa dénomination propre? Ils prétendent enfin que les hommes
ont, au commencement, parlé le pur langage de la nature; que peu à
peu ils ont imité celui des poètes, quoique avec plus de retenue,
mais abusés par la môme erreur, et regardant comme des qualités ce
qui est faux et impropre.
Il y a quelque chose de vrai dans
cette opinion : aussi ne faut-il pas trop s'éloigner, comme le font
certaines personnes, du langage propre et commun. Si pourtant, comme
je l'ai dit au chapitre de la 474
composition, un orateur ajoutait quelque chose de mieux au
nécessaire, qui est en soi ce qu'il y a de moins, ce serait à tort
qu'on lui reprocherait de sortir du vrai. Car, à mon avis, autre est
la nature d'un entretien familier, autre celle d'un discours
oratoire. Sans doute, si l'orateur n'avait qu'à indiquer les choses,
il n'aurait rien à chercher de plus que la propriété des mots ; mais
comme il doit encore plaire, toucher, et entraîner en divers sens la
volonté de l'auditeur, pourquoi n'emploierait-il pas les secours que
lui offre cette même nature? car cela est aussi naturel que de
fortifier son corps et sa santé par l'exercice. N'est-ce pas ce qui
fait que, dans tous les pays, il y a des hommes qui passent pour
plus éloquents que d'autres, et plus agréables dans leur langage?
Autrement tous seraient sur la même ligne, et le même langage
conviendrait à tous tandis que, au contraire, on est obligé, en
parlant, d'avoir égard à la différence des personnes. C'est par
cette raison que je ne suis pas tout à fait opposé à ceux qui
veulent qu'on fasse des concessions aux temps et aux oreilles qui
exigent quelque chose de plus brillant et de plus soigné. Ainsi je
ne pense pas que le style des écrivains antérieurs à Caton et aux
Gracques, ni même de ces derniers , doive servir de règle à
l'orateur ; et je vois que c'est ce qu'a fait Cicéron, qui, bien
qu'il rapportât tout à l'utile, savait y mêler l'agréable, et qui,
en faisant cela, disait qu'il ne laissait pas de plaider le fond de
la cause : et, en effet, il oubliait moins que jamais l'affaire de
son client, car il se rendait utile par cela seul qu'il plaisait. Je
ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter à l'agrément de son éloquence,
si ce n'est que, pour flatter le goût de notre siècle, nous
prodiguions un peu plus les pensées brillantes; et cela peut se
faire sans compromettre la cause ni affaiblir l'autorité de
l'orateur, lorsque ces pensées ne sont point trop multipliées, trop
continues, et ne se nuisent pas les unes aux autres. Voilà ce que
j'accorde; mais qu'on n'exige rien au delà. Je consens, dans le
siècle où nous sommes, que la robe de l'orateur ne soit pas d'une
étoffe grossière ; mais je ne la veux pas de sole; que ses cheveux
ne soient pas longs et négligés, mais qu'ils ne soient pas non plus
frisés par étages et tombant en anneaux : d'autant que, pour tout
homme qui ne s'habille pas dans la pensée du luxe et de la débauche,
te vêtement le plus décent est aussi le plus beau. Au reste, à
l'égard de ce qu'on appelle communément des pensées, ce qui était
inconnu aux anciens et particulièrement aux Grecs; à l'égard des
pensées, dis-je , et en cela je m'appuie sur l'autorité de Cicéron,
qui en a fait usage, pourvu qu'elles roulent sur des choses, et non
sur des mots, qu'elles ne soient point trop fréquentes, et qu'elles
tendent au gain de la cause, qui peut douter de leur utilité? Elles
frappent l'esprit, elles l'ébranlent souvent d'un seul coup, elles
s'y fixent profondément à cause de leur brièveté même, et persuadent
par le plaisir. Cependant certaines personnes tolèrent ces traits
vifs et lumineux dans la bouche de l'orateur, mais non sur le
papier. Aussi est-ce un point que je ne veux pas laisser passer sans
examen, eu ce que, selon plusieurs savants, autre chose est de
parler, autre chose d'écrire ; que c'est pour cela que des hommes
très-renommés pour l'oraison parlée n'ont laissé, après être
descendus de la tribune, aucun monument écrit à la postérité, comme
Périclès, comme Démade, tandis que d'autres qui
étaient très-éloquents la plume à la main, comme Socrate, n'étaient
plus les mêmes quand il s'agissait de parler en public. Ces savants
ajoutent qu'en parlant, la chaleur entraînante de l'o-
475 rateur, et des pensées
un peu hasardées, mais brillantes, produisent la plupart du temps
plus d'effet, parce qu'on n'a que des ignorants à émouvoir et à
persuader ; au lieu que ce qui est consacré dans des livres et
publié comme modèle doit être châtié et poli, et composé selon la
loi et la règle; parce qu'un livre est destiné à passer dans les
mains des doctes, et que ce sont les artistes eux-mêmes qui doivent
juger de l'art. Bien plus, ces maîtres subtils, qui ont su faire
partager leur opinion à bon nombre de gens aussi subtils qu'eux,
enseignent qu'il convient mieux d'employer l'exemple quand on
parle, et l'enthymème quand on écrit. Pour moi, j'estime que
bien parler et bien écrire sont une seule et môme
chose, et que l'oraison écrite n'est que le monument de l'oraison
parlée. Elle doit donc, ce me semble, avoir toutes les qualités de
l'oraison parlée, et même ses défauts ; car je sais qu'il en est qui
plaisent aux ignorants. En quoi différeront ces deux sortes
d'oraison? le voici. Donnez-moi un tribunal composé de sages, et je
retrancherai une foule de choses non-seulement des oraisons de
Cicéron, mais même de celles de Démosthène, qui est beaucoup plus
précis; car alors il ne s'agira plus d'émouvoir les passions, ni de
flatter les oreilles : auprès de tels juges, les exordes même seront
superflus, suivant Aristote. En effet, leur sagesse ne se laissera
pas séduire à ces artifices oratoires ; avec eux, il suffira
d'exposer le fait en termes propres et significatifs, et de bien
réunir les preuves. Mais comme ou a pour juges le peuple ou des gens
du peuple, et que ceux qui doivent prononcer sont le plus souvent
des hommes fort peu éclairés, quelquefois même de simples paysans,
il faut bien alors 475
employer tous les moyens que nous croyons propres à nous faire
atteindre le but que nous nous proposons, et cela non-seulement en
parlant, mais encore en écrivant, afin d'enseigner par là comment il
faut parler. Est-ce que Démosthène, ou Cicéron, aurait mal parlé
s'il eût parlé comme il a écrit? et connaissons-nous ces excellents
orateurs autrement que par leurs écrits? Ont-ils donc mieux parlé,
ou plus mal? Car si c'est plus mal, ils auraient dû parler comme ils
ont écrit ; si c'est mieux, ils auraient dû écrire comme ils ont
parlé. Quoi donc! l'orateur parlera-t-il toujours comme il écrit?
Oui, toujours, s'il le peut. Que s'il en est empêché par la brièveté
du temps que lui accorde le juge, il retranchera beaucoup de ce
qu'il aurait pu dire, mais l'oraison qu'il publiera contiendra tout
: seulement, ce qu'il aura dit pour se conformer à la nature des
juges, il le dérobera aux regards de la postérité, de peur qu'on ne
l'attribue à sa manière de voir, et non à la circonstance. En effet,
il importe beaucoup aussi de considérer quel langage exige la
disposition du juge, et c'est souvent sur l'expression de son visage
que l'orateur doit se régler, ainsi que l'enseigne Cicéron. Il faut
donc abonder dans ce qui parait lui plaire, et passer à côté de ce
qui lui déplairait ; il faut même faire choix du genre de langage
qui semble le plus propre à lui faciliter l'intelligence des choses;
et cela ne doit pas étonner, puisque, pour se faire comprendre des
témoins, on dénature quelquefois les mots. On demandait à un paysan,
appelé en témoignage, s'il connaissait Amphion : sur sa
réponse négative, l'avocat, en homme habile, lui ayant prononcé de
nouveau ce nom sans aspiration , et en faisant brève la seconde
syllabe, le 476 paysan
déclara le connaître parfaitement. Dans ces sortes de cas, on parle
quelquefois autrement qu'on n'écrit, puisqu'on n'est pas libre de
parler comme on doit écrire.
Il existe une seconde division qui a
aussi trois parties, et qui paraît également propre à bien
distinguer les différents genres d'éloquence. Le premier est le
genre délicat (en grec, ἰσχνόν) ; le
second, le genre grand et robuste (ἁδρὸν)
; le troisième, le genre mixte, ou, selon d'autres, fleuri (ἀνθηρὸν).
Du reste, cette division répond à peu près a celle des devoirs de
l'orateur, puisque le premier semble destiné à instruire, le
second à émouvoir, le troisième, quel que soit le nom qu'on
lui donne, à plaire, ou, ce qui est à peu près de la même
nature, à concilier, la finesse étant propre à instruire; la
douceur, à concilier; la gravité, à émouvoir.
Ainsi, le premier genre conviendra particulièrement à la narration
et à la preuve, bien qu'il ait assez de plénitude par lui-même pour
soutenir seul une oraison entière. Le genre mixte sera plus abondant
en métaphores et plus orné de figures ; il offrira de riantes
digressions , une composition heureusement assortie au sujet, des
pensées gracieuses ; mais il coulera tranquillement, comme une
rivière limpide que de vertes forêts ombragent des deux côtés. Quant
au troisième genre, semblable à un fleuve grossi par les orages,
qui, dans son cours impétueux, roule d'énormes pierres, s'indigne
contre les ponts, et ne connaît de rives que celles qu'il se
fait lui-même, il entraînera le juge malgré sa résistance, et le
forcera à le suivre partout où il lui plaira de l'emporter. C'est
alors que l'orateur réveille jusqu'aux morts, et évoque, par
exemple, Appius l'Aveugle ; c'est alors que la patrie elle-même fait
entendre une voix plaintive, et, au milieu du
sénat, interpelle un Cicéron contre un Catilina ; c'est alors que
l'orateur déploie la pompe des amplifications et la hardiesse des
hyperboles : Quelle Charybde égala jamais sa voracité? Non,
l'Océan lui-même, etc. Car ces traits sont connus de tous les
amis de l'éloquence; c'est alors qu'il fait descendre les dieux du
ciel pour combattre et parler avec lui : Vous, tombeaux! vous,
bois sacrés des Albains. etc.; c'est alors qu'il souffle la
colère, qu'il inspire la pitié, qu'il s'écrie : II vous vit, il
implora votre secours, il pleura; et que le juge, ému jusqu'au
fond du cœur, s'abandonne tout entier à l'orateur, sans lui demander
de quoi il s'agit.
Si donc il faut nécessairement choisir
un de ces trois genres, qui doute que ce dernier ne soit préférable,
étant d'ailleurs le plus puissant, et le mieux approprié aux grandes
causes? Ainsi Homère donne à Ménélas une éloquence dont le caractère
est une agréable brièveté, la propriété ou justesse des mots,
et la précision : ces qualités sont celles du premier genre.
Il dit que les paroles de Nestor découlent de sa bouche, plus
douces que le miel : que peut-on imaginer de plus délectable?
Mais quand il veut nous montrer, dans Ulysse, la perfection de
l'éloquence, il y ajoute la grandeur, et compare ses paroles,
pour l'abondance et l'impétuosité, à la neige tombant à gros
flocons dans la saison d'hiver; et alors nul mortel n'oserait
contester avec lui, et les hommes le considèrent comme un dieu.
C'est cette force et cette rapidité qu'Eupolis admire dans Périclès,
et qu'Aristophane compare aux éclairs et au tonnerre; c'est là ce
qui caractérise véritablement le talent de la parole. Mais
l'éloquence n'est pas rigoureusement renfermée dans ces trois formes
; car, de même 477
qu'entre le genre délicat et le genre fort il y a un troisième genre
qui tient le milieu, de même chacun de ces deux genres se subdivise
en plusieurs espèces, qui participent plus ou moins de sa nature. En
effet, le premier n'est pas tellement invariable qu'on ne puisse
trou ver quelque chose de plus nourri ou de plus maigre, comme on
peut trouver quelque chose de plus modéré et de plus véhément que le
genre véhément proprement dit. Enfin le genre tempéré peut être plus
fort ou plus délicat. C'est ainsi qu'on découvre des nuances presque
innombrables, qui diffèrent réellement entre elles par quelque
chose; de même que l'on reconnaît en général quatre vents qui
soufflent des quatre points cardinaux du monde, quoiqu'il y en ait
plusieurs espèces, pour ainsi dire, intermédiaires, et affectées à
certaines contrées et à certains fleuves. On retrouve dans la
musique la même gradation ascendante ou descendante : ainsi les
musiciens, qui ont donné cinq cordes, et partant cinq sons
fondamentaux à la lyre, en remplissent les intervalles d'un grand
nombre d'autres sons intermédiaires, qui ont aussi leurs intervalles
et leurs nuances ; de sorte que l'échelle musicale, quoique composée
seulement de cinq principaux sons, aune infinité de degrés.
L'éloquence a donc aussi plusieurs formes, plusieurs espèces : mais
ce serait une ineptie que de vouloir chercher celle que l'orateur
doit adopter, puisqu'il n'en est aucune qui n'ait son usage, pourvu
qu'elle soit bonne ; puisque tout ce qu'on appelle communément genre
d'éloquence est du ressort de l'orateur. Il les emploiera toutes,
suivant que l'exigera le besoin non-seulement de la cause, mais des
parties de la cause. Car, de même qu'il ne plaidera pas de la même
manière pour un accusé dont on demande la tête, pour une succession
litigieuse, pour des jugements provisionnels, pour des
consignations, pour un prêt; de môme qu'il observera des
distinctions en parlant devant le sénat, dans l'assemblée du peuple,
ou dans des délibérations particulières, et qu'il prendra en
considération la différence des personnes, des lieux et des temps;
ainsi, dans le même plaidoyer, il s'y prendra d'une manière pour
concilier les esprits, et d'une autre pour les irriter; il ne tirera
pas des mêmes sources la colère et la pitié ; il aura tel langage
pour instruire, et tel autre pour émouvoir; il ne donnera pas la
même couleur à l'exorde, à la narration, aux arguments, aux
digressions, à la péroraison. L'élocution du même orateur offrira
tour à tour la gravité, la sévérité, la vivacité, la véhémence,
l'emportement, l'abondance, l'amertume, la politesse, la modération
, la finesse, la flatterie, le calme, la douceur, la brièveté,
l'urbanité : il sera partout sinon semblable, du moins égal à
lui-même. C'est ainsi qu'il atteindra la fin principale de
l'éloquence, c'est-à-dire qu'il parlera utilement et efficacement
pour son but, et qu'il obtiendra à la fois les suffrages et des
hommes éclairés et du vulgaire. En effet, pour ce qui est de ce
genre vicieux et corrompu qui se comptait dans les licences et le
dérèglement du langage, ou folâtre autour de pensées puériles, ou
s'enfle outre mesure, ou s'égare dans des lieux déserts, à la
manière des bacchantes, ou se pare de petites fleurs qui
s'évanouissent au moindre souffle, ou prend le bord escarpé des
abîmes pour le faîte de la 478
grandeur, et les extravagances d'une imagination folle pour le noble
essor de la liberté, on se trompe fort, si l'on croit que ce genre
est le plus propre à nous attirer la faveur et les applaudissements
de la multitude. Qu'il plaise à beaucoup de gens, je ne le nie ni ne
m'en étonne; car l'éloquence, quelle qu'elle soit, flatte et captive
l'oreille, et toute voix a un charme naturel qui attire l'âme : les
groupes qui se forment sur nos places publiques et dans nos rues
n'ont pas d'autre cause. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait
une foule toujours prête à entourer un avocat quelconque. Or, qu'un
trait un peu recherché vienne à frapper les oreilles de ces
auditeurs ignorants, ce trait, quel qu'il soit, mais qu'ils
n'auraient pas trouvé, excite leur admiration ; et ils n'ont pas
tort d'admirer, car, après tout, ce n'est pas si aisé. Mais ces
beautés s'évanouissent et meurent, dès qu'on leur oppose d'autres
beautés plus vraies, de même, comme dit Ovide, qu'une laine,
teinte avec de l'algue marine, parait belle loin de l'éclat de la
pourpre : mais rapprochez-la seulement d'une laine teinte en couleur
de feu, elle sera écrasée par la comparaison. Or, si vous
soumettez cette éloquence fardée à un jugement un peu sévère, comme
on soumet une fausse couleur à l'action du soufre, ce qui vous avait
ébloui perdra bientôt son lustre mensonger, et n'offrira plus à vos
regards désenchantés qu'une pâleur hideuse. Laissons donc cette
éloquence briller en l'absence du soleil, comme ces insectes qui
luisent dans les ténèbres et paraissent de feu. En un mot, ce qui
est mauvais trouve, il est vrai, bon nombre d'admirateurs ; mais
personne ne blâme ce qui est bon.
L'orateur maniera tous les genres de
style dont j'ai parlé, non-seulement très-bien, mais encore avec la
plus grande facilité. En effet, qu'aurait de si merveilleux le
talent de la parole, si l'orateur était condamné, jusqu'à la fin de
sa carrière, à se consumer en malheureux efforts, à maigrir, à
sécher, pour retourner péniblement des mots, pour les peser et les
ajuster? Brillant, sublime et fécond, mon orateur commandera en
maître à ces flots d'éloquence qui viendront de toutes parts rouler
à ses pieds. Car on a cessé de gravir, quand on est parvenu au
sommet : la peine est pour ceux qui commencent à monter ; mais plus
on avance, plus la pente s'adoucit et plus le sol devient riant. Que
si, encouragé par cet attrait, vous avez assez de constance pour
achever votre ascension, alors vous verrez les fruits naître sous
vos pas, et s'offrir, pour ainsi dire, d'eux-mêmes. Seulement, ayez
soin de les cueillir tons les jours, sous peine de les voir se
dessécher. Toutefois, l'abondance elle-même a ses bornes, car, sans
mesure, rien n'est louable ni salutaire. L'élégance doit être mâle,
et l'invention veut être réglée par le jugement. Ainsi, notre
éloquente sera noble, sans être fastueuse; sublime, sans être
aventureuse: audacieuse, sans être téméraire; austère, sans être
triste; grave, sans être lourde ; riche, sans luxe ; agréable, sans
afféterie; magnifique, sans enflure ; et ainsi des autres qualités.
Tenir le milieu est ordinairement le plus sûr, parce que les deux
extrémités sont vicieuses.
CHAP. XI. Après avoir mis en pratique
toutes ces qualités, au barreau, dans les conseils, dans les
assemblées publiques, au sénat, enfin dans toutes les fonctions qui
sont d'un bon citoyen, l'orateur songera à faire une fin digne d'un
homme de bien, et du plus saint des ministères : non que jamais on
doive se lasser d'être utile, ni qu'un homme, doué de toutes les
vertus et de tous les talents, puisse prolonger trop longtemps la
plus noble des professions; mais parce qu'il sied aussi de prévenir
le moment où l'on ferait moins bien qu'on ne faisait. L'art
oratoire, 479 en effet
,ne consiste pas seulement dans la science, laquelle s'accroît avec
les années, mais encore dans la voix, dans les poumons, dans la
vigueur du corps ; mais quand ces facultés extérieures viennent à
succomber ou à chanceler sous le poids de l'âge ou des infirmités,
il est à craindre que le grand orateur ne laisse quelque chose à
désirer; que, fatigué, il ne soit exposé à demeurer court ; qu'il ne
s'aperçoive qu'il se fait peu entendre; qu'enfin il ne se cherche
lui-même et ne se retrouve plus. J'ai vu le plus grand, sans
contredit, de tous les orateurs que j'aie jamais connus, Domitius
Afer; je l'ai vu, dis-je, dans un âge très-avancé, déchoir
chaque jour de l'autorité qu'il s'était si justement acquise;
jusque-là que quand il plaidait, lui qui, de l'aveu de tout le
monde, avait été jadis le prince du barreau, les uns avaient
l'indignité de rire, les autres rougissaient ; ce qui donna occasion
de dire qu'il aimait mieux succomber que de cesser. Cependant
ces disgrâces d'Afer étaient les moins fâcheuses qu'on puisse
éprouver. Avant donc de tomber dans ces pièges de l'âge, l'orateur
doit sonner la retraite, et regagner le port tandis que son vaisseau
est encore entier. Et qu'on ne s'imagine pas qu'après cela les
fruits de ses études soient moins considérables; car ou il écrira
pour la postérité l'histoire de son temps, ou, comme L. Crassus se
proposait de le faire, au rapport de Cicéron , il donnera des
consultations sur le droit, ou il composera quelque traité de
rhétorique ; ou enfin il prêtera l'appui d'un digne organe aux plus
beaux préceptes de la morale. Sa maison, suivant l'usage des
anciens, sera le rendez-vous des jeunes gens, amis de la vertu et du
sa voir, qui viendront le consulter comme un oracle, sur les vrais
principes de l'art de bien dire. Il sera pour eux comme le père de
l'éloquence, et, ainsi qu'un vieux pilote, il les entretiendra des
rivages et des ports qu'il a visités ; il leur enseignera quels sont
les signes précurseurs de la tempête, et quelles sont les manœuvres
à pratiquer, selon que les vents sont favorables ou contraires; et,
en cela, le sentiment naturel de la bienveillance sera encore
réchauffé par l'amour de son ancienne profession. Personne, en
effet, n'aime à voir déchoir ce en quoi il a excellé. Quoi de plus
honorable, d'ailleurs, que d'enseigner ce qu'on sait le mieux? C'est
ainsi que Cicéron donna des leçons à Célius, qui lui avait été amené
par son père; c'est ainsi qu'il servait, en quelque sorte, de
précepteur à Pansa, à Hirtius, à Dolabella, en les exerçant chaque
jour, soit en parlant devant eux, soit en les écoutant. Je ne sais
même si, de tous les temps de la vie, le plus heureux pour un
orateur n'est pas celui où, retiré, et, pour ainsi dire, consacré, à
l'abri de l'envie, loin de tout débat, il voit sa réputation en
sûreté, jouit, de son vivant, de ce respect qu'on n'accorde
ordinairement qu'aux morts, et assiste, en quelque sorte, au
jugement de la postérité. Pour moi, j'ai la conscience d'avoir,
autant que me l'a permis ma faiblesse, et en toute sincérité, fait
part, à tous ceux qui daigneront me lire , de tout ce que je savais
avant de commencer ce traité, et de tout ce que j'ai pu apprendre en
le composant. Or, il suffit à un honnête homme d'avoir enseigné ce
qu'il savait.
Je crains cependant qu'on ne m'accuse,
ou de demander presque l'impossible, eu voulant que l'orateur soit à
la fois homme de bien et habile
480 dans l'art de parler, ou d'exiger de lui trop à la
fois, en voulant qu'à tant d'autres arts qu'il lui faut apprendre
dans son enfance, il joigne l'étude de la philosophie et la
connaissance du droit civil, sans compter les préceptes qui
regardent l'éloquence. Je crains enfin qu'après avoir regardé tout
cela comme indispensable pour former l'orateur parfait, on n'y voie
plus qu'un obstacle insurmontable, et qu'on ne désespère avant
d'avoir essayé. Mais d'abord, que l'on veuille bien considérer la
force de l'esprit de l'homme, et jusqu'où s'étend la puissance de sa
volonté, puisque des sciences moins importantes sans doute, mais
plus difficiles, nous ont appris à traverser les mers, à connaître
le cours et l'harmonie des astres, et à mesurer, ou peu s'en faut,
l'univers. Qu'ils envisagent ensuite la grandeur de l'objet qu'ils
se proposent, et que les plus rudes fatigues ne sont rien en
comparaison du prix réservé aux vainqueurs. Quand ils seront bien
pénétrés de ces idées, ils ne tarderont pas à se ranger à cette
opinion, que le chemin qui conduit à l'éloquence n'est point
impraticable, ou du moins aussi rude qu'on se l'imagine. Ainsi, pour
être homme de bien, ce qui constitue la première et la plus
importante qualité de l'orateur, il s'agit de le vouloir. Quiconque
aura sincèrement cette volonté s'initiera facilement aux préceptes
qui enseignent In vertu ; et ceux de ces préceptes qui sont les plus
essentiels ne sont ni tellement compliqués, ni tellement nombreux,
qu'on ne puisse, avec de l'application, les connaitre en très-peu
d'années. Ce qui rend nos travaux si longs, c'est notre répugnance ;
croyons à la vertu, et nous aurons bientôt appris à mener une vie
honnête et heureuse. En effet, la nature nous a faits pour le bien ;
et il est si facile à ceux qui le veulent, de le connaître, qu'en
vérité il y a plutôt lien de s'étonner qu'il y ait autant de
méchants. De même que l'eau convient aux poissons, la terre aux
animaux qui l'habitent, et l'air qui nous environne aux oiseaux, de
même il devrait certainement nous être plus facile de vivre selon la
nature que de contrarier ses lois. A l'égard des autres
connaissances , quand nous retrancherions de notre vie les années de
la vieillesse, pour n'y comprendre que celles de la jeunesse, il
nous resterait encore bien assez de temps pour les acquérir; car
tout s'abrège avec de l'ordre, de la méthode, et de la mesure. Mais
le mal vient d'abord des maîtres, qui détiennent volontiers les
élèves dont ils se sont emparés, tantôt par cupidité, pour prolonger
un misérable salaire, tantôt par vanité, pour faire croire que ce
qu'ils enseignent est très-difficile, tantôt par impéritie ou par
négligence. Ensuite la faute en est à nous, qui croyons qu'il vaut
mieux nous arrêter à ce que nous savons, que d'étudier ce que nous
ne savons pas encore. Car, pour dire un mot de ce qui regarde le
plus directement nos études, à quoi bon consumer un si grand nombre
d'années, comme, font tant de gens (je m'abstiens de parler de ceux
qui y sacrifient presque toute leur vie), à déclamer dans les
écoles, et à se donner tant de peine pout de pures fictions, tandis
qu'il leur suffirait de se faire, dans un court espace de temps, une
idée exacte des luttes véritables du barreau, et des lois de
l'éloquence? Ce n'est pas que je veuille qu'où cesse jamais de
s'exercer à parler, mais je ne veux pas qu'on vieillisse dans une
seule espèce d'exercice. Nous aurions pu connaître le monde, nous
instruire à fond de tout ce qui regarde la conduite de la vie, faire
notre apprentissage au barreau, et nous sommes encore sur les bancs!
481 Les conditions de
l'étude ne sont pas telles, qu'il faille tant d'années pour
apprendre. En effet, de tous les arts dont j'ai fait mention, il
n'en est pas un seul dont les règles ne soient ordinairement
renfermées en peu de livres : tant il est vrai qu'il n'est pas
besoin d'un temps et de leçons infinies ! le reste dépend de
l'habitude, qui donne bientôt des forces. Enfin, l'expérience
augmente chaque jour la somme de nos connaissances. Il est vrai
qu'il faut s'aider par la lecture de bien des livres, si l'on veut
trouver des exemples, pour les faits, dans les historiens, et, pour
le style, dans les orateurs. Il est indispensable aussi de lire les
différentes opinions des philosophes et des jurisconsultes, et mille
autres choses. Mais tout cela se peut, et le temps n'est court que
parce que nous le faisons tel. Combien peu , en effet, en
accordons-nous à l'étude ! De vains devoirs de civilité, des
conversations oiseuses, les spectacles, les plaisirs de la table,
voilà les occupations qui se partagent nos heures. Ajoutez à cela
les jeux de toute espèce, et le soin ridicule de la toilette. Enfin,
que les voyages, les parties de campagne, les calculs soucieux de
l'intérêt, le vin, et tous les genres de volupté, qui convient sans
cesse les passions et troublent les facultés de l'âme, nous en
emportent encore: les instants qui nous resteront ne seront pas même
propres au travail. Mais si toutes ces heures étaient consacrées à
l'étude, la vie serait assez longue et le temps plus que suffisant
pour apprendre, même en ne tenant compte que des jours; et les
nuits, qui, pour la plupart, durent plus que notre sommeil,
viendraient encore à notre aide. Mais, aujourd'hui, nous calculons,
non par les années d'étude, mais par les années de vie.
De ce que des géomètres, des
grammairiens et d'autres savants ont consumé toute leur vie, quelque
longue qu'elle ait été, dans l'étude d'un seul art, il ne s'ensuit
pas qu'il faille, en quelque sorte, plusieurs vies pour apprendre
plusieurs choses différentes; car ces savants n'ont pas étudié
jusque clans leur vieillesse, mais ils se sont contentés de la
connaissance de l'art spécial auquel ils s'étaient voués, et ils ont
épuisé tant d'années, non à pas à méditer sans cesse sur cet art,
mais à le pratiquer et à en jouir. Au reste, sans parler d''Homère,
chez lequel on trouve des préceptes ou du moins des vestiges non
douteux de tous les arts ; sans parler d'Hippias d'Elée, qui non
seulement tenait son rang parmi les savants, mais ne portait jamais
que des vêtements, des anneaux et des chaussures confectionnés de sa
propre main, et s'arrangea toujours de manière à pouvoir se passer
en toute chose du secours d'autrui, ne sait-on pas que Gorgias, dans
un âge très-avancé, invitait ses auditeurs à l'interroger sur tout
ce qu'ils voulaient? Quelle science digne des lettres a manqué à
Platon? Que de siècles d'étude ne semble-t-il pas avoir fallu à
Aristote, non-seulement pour embrasser la science de tout ce qui a
rapport à la philosophie et a l'éloquence, mais pour faire tant de
recherches sur l'histoire naturelle des animaux et des plantes? car
ils avaient eu à inventer ce que nous n'avons plu» qu'à apprendre, à
connaître. L'antiquité nous a pour vus de tant de maîtres et de tant
de modèles, qu'il semble qu'on ne pouvait naître dans un siècle plus
fortuné que le nôtre, puisque tous les âges précédents ont concouru
à son instruction. Voyez un Caton le Censeur, qui, tout
ensemble orateur, historien, jurisconsulte et savant agronome, au
milieu de tant d'expéditions militaires,
482 au milieu des longues
et violentes agitations de sa vie publique, dans un siècle grossier,
trouva encore assez de loisir, sur le déclin de l'âge, pour étudier
la langue grecque, comme pour servir de témoignage que l'homme peut
vieillir et apprendre toujours, quand il le veut bien ! Sur quoi
Varron n'a-t-il pas écrit? Quel instrument, quel moyen a manqué
à Cicéron pour l'éloquence? Enfin que dirai-je de plus, quand
un Cornélius Celsus, homme d'ailleurs d'un esprit médiocre, à
non-seulement écrit sur tous les arts dont j'ai parlé, mais encore
laissé des traités sur la stratégie, l'agriculture et la médecine?
digne sans doute, ne fût-ce que pour l'a voir entrepris, qu'on croie
de lui qu'il possédait toutes ces sciences.
Mais, dira-t-on, atteindre à la
consommation d'une aussi grande œuvre est chose trop difficile, et
personne n'y est parvenu. Et d'abord il suffit, pour nous encourager
à l'étude, qu'il ne soit pas dans l'ordre de la nature que ce qui ne
s'est pas fait encore ne puisse jamais se faire, puisque, au
contraire, nous voyons qu'il y a eu un temps où tout ce que nous
trouvons grand, admirable, s'est fait pour la première fois. En
effet, c'est à Démosthène et à Cicéron que l'éloquence doit sa
sublimité, comme la poésie doit la sienne à Homère et à Virgile :
enfin tout ce qui est beau et admiré n'a pas toujours été. Mais
quand même on désespérerait d'atteindre à la perfection (et pourquoi
désespérerait-on, si l'on ne manque ni d'esprit, ni de santé, ni de
talent, ni de maîtres?), encore est-il beau, comme dit Cicéron, de
s'asseoir au second ou nu troisième rang. Si l'on ne peut
obtenir la gloire d'Achille dans les combats, est-ce une raison de
mépriser celle d'Ajax ou de Diomède? et si l'on n'est pas un Homère,
on peut bien se contenter d'être un Tyrtée. Je dis plus : avec le
préjugé qu'il n'est pas possible de mieux faire que celui qui a bien
fait, celui-là même qui a bien fait n'aurait jamais été. Ainsi,
Virgile n'aurait point remporté le prix sur Lucrèce et Macer, ni
Cicéron sur Crassus et Hortensias, et toute rivalité serait
interdite aux âges futurs.
Mais j'admets qu'il n'y ait point
d'espoir de surpasser les grands maîtres, n'est-ce pas encore un
honneur assez grand de les suivre de près? Pollion et Messala, qui
commencèrent à plaider dans le temps que Cicéron était déjà le roi
du barreau, ont-ils été peu considérés de leurs contemporains, et
ont-ils transmis un nom sans gloire à la postérité? D'ailleurs, on
aurait rendu aux hommes un funeste service en perfectionnant les
arts, si cette perfection se montrait une fois, pour ne jamais
reparaître. Ajoutez à tout cela que le talent de la parole, même
médiocre, porte avec lui de grands fruits, et qu'à l'apprécier
seulement par le profit qu'on en retire, peu s'en faut qu'il ne
marche de pair avec la parfaite éloquence; et il ne me serait pas
difficile de prouver, par des exemples anciens ou modernes, que
jamais profession n'a procuré plus de richesses, d'honneurs, de
protections, ni de gloire présente et future, que celle d'orateur;
mais je croirais avilir les lettres, si, à l'exemple de ceux qui
disent eux-mêmes qu'ils recherchent la vertu, non pour la vertu,
mais pour le plaisir qui la suit, je conseillais de demander cette
récompense secondaire à une œuvre aussi belle, dont la pratique,
dont la jouissance suffit pour nous payer avec usure de nos études.
Que la majesté seule de l'éloquence remplisse notre cœur : car
l'éloquence est le plus 483
beau présent que les dieux immortels aient fait à l'homme ; sans
elle, tout est muet ; sans elle, tout est ténèbres et silence
pendant la vie et après la mort. Aussi ne nous lassons pas de tendre
à la perfection : c'est le moyen de parvenir au sommet, ou, au
moins, d'en laisser beaucoup au-dessous de soi.
Voilà, mon cher Victorius, en quoi
j'ai cru pouvoir contribuer, pour ma part, aux progrès de l'art
oratoire. J'ose espérer que la jeunesse studieuse en retirera, sinon
grande utilité, du moins, ce que j'ai eu particulièrement en vue,
bonne volonté.
LIVRE DOUZIÈME.
Juris quoque civilis neccesaria
huic viro scientia est. « Dans cette partie seulement les
Romains n'eurent point de modèles. Leur jurisprudence naquit de la
constitution même fondée par Romulus. Les patriciens, obligés, par
l'institution du patronage, d'expliquer la loi à leurs clients et de
les défendre dans leurs procès, furent les premiers jurisconsultes;
ils gardèrent cette prérogative quelque temps encore après que les
fastes et les formules de plaidoiries eurent été publiés par
Flavius et par Aelius Catus. Enfin T.
Coruncanius, premier grand pontife plébéien , ayant donné ses
consultations à tous les citoyens indistinctement, son exemple fut
suivi, et les consultations publiques (responsa prudentum}
s'ajoutèrent, sous le titre de jus receptum, aux anciennes
coutumes, .aux plébiscites, aux sénatus-consultes , aux édits des
préteurs et des édiles, qui composaient alors les deux parties du
droit (jus scriptum , jus non scriptum.) La législation se
compliquant, ainsi que les intérêts publics et particuliers, par
l'accroissement de la république, le droit devint une véritable
science , et le principal moyen de réputation et d'influence
politique. Auguste, pour se rendre maître des lois , s'empara des
consultations , et donna a un nombre déterminé de jurisconsultes le
privilège de répondre en son nom avec autorité décisive. Les autres
furent toujours consultés en particulier; leurs travaux eurent une
grande importance, et leurs écrits furent la règle des tribunaux.
L'ardeur de l'étude fit naître alors plusieurs sectes dont les
principales furent celle d'Antistius Labeo Nerva (les
Proculéiens ou Pégasiens) et celle d'Atéius Capito
(les Sabiniens ou Cassiens). La science se
perfectionna jusqu'au temps d'Adrien. Sons ce prince , les sectes
disparurent, les jurisconsultes recouvrèrent leur indépendance , la
première école pour l'enseignement du droit fut fondée à Rome , et
le premier code , l'Edit perpétuel, fut publié. Septime
reprit, comme Auguste, le privilège des consultations ; à cette
époque de despotisme, les sénatus-consultes furent entièrement
remplacés par les constitutions impériales (rescripta ,
mandata, decreta, edicta). La multitude toujours
croissante de ces ordonnances interprétatives embarrassa de plus en
plus la législation; l'étude du droit devint tout à la fois plus
indispensable, plus difficile et moins profitable. On ne s'occupa
plus des principes mêmes de la législation : ce fut assez de
parcourir l'immensité des lois et des écrits de jurisprudence.
Toutes les provinces eurent des écoles de droit; mais la plus
fameuse, celle de Béryte, fondée par Alexandre Sévère, ne fut
bientôt plus qu'une école de candidat! aux charges. Modestinus, sous
Gordien, ferma la liste des jurisconsultes célèbres; ses successeurs
ne firent autre chose qu'enseigner publiquement; et les seuls
travaux dignes de remarque après cette époque, les codes Grégorien
et Hermogénien, ne furent que des recueils de constitutions
impériales ». (Précis de l'histoire des empereurs romains pendant
les quatre premiers siècles, de M. Dumont}.
Primi,... clari pictores fuisse
dicuntur Polygnotus atque Aglaophon. Polygnote, de Thasos,
florissait vers l'an 416 avant J. C. Il fut chargé par les Athéniens
de décorer le Pœcile, de concert avec Micon, peintre contemporain.
Il embellit de ses ouvrages plusieurs autres édifices de la même
ville; il représenta, entre autres, dans le temple de Minerve,
Ulysse venant d'immoler les prétendants ; et, dans celui de Castor
et de Pollux. ces demi-dieux à pied et à cheval, ainsi que leur
union avec Ilaïré et Phébé, filles de Leucippe. Les Athéniens lui
accordèrent le droit de bourgeoisie, et le conseil des amphyctions
lui décerna le droit d'hospitalité gratuite dans toutes les villes
de la Grèce. Mais c'était à Delphes, dans le portique appelé le
Lesché, que se trouvaient les chefs-d'œuvre de Polygnote; il les
avait exécutés sur les murs mêmes de l'édifice : on y voyait les
scènes les plus terribles qui suivirent la prise de Troie : Hélène
entourée de Troyens blessés qui semblaient lui reprocher leurs maux,
et de Grecs qui admiraient sa beauté; Cassandre environnée de ses
farouches vainqueurs ; Priam gisant dans la poussière, etc.
Aglaophon, de Thasos, fut le père et
le maître de Polygnote, suivant Athénée. Ce fut Aglaophon qui
peignit Alcibiade et la courtisane Némée, assise sur ses genoux.
Plutarque attribue ce tableau à Aristophon.
Post Zeuxis atque Parrhasius.
Zeuxis naquit à Héraclée, dans la Grande-Grèce. Pline le place à la
4e année de la 96e olympiade, sans dire si cette année est celle de
sa naissance, de son âge moyen, ou de sa mort. Bayle remarque que
Zeuxis donnait ses tableaux en présent, quand Archélaüs 1er, roi de
Macédoine, approchait du terme de sa carrière, et que par conséquent
il devait être lui-même, à cette époque, riche et avancé en âge :
or, Archélaüs mourut vers l'an 400 avant J. C. Sa renommée fut
immense, et les anciens ne parlaient qu'avec enthousiasme de sa
figure d'Hélène. Il peignait, dit Suidas, inspiré par un esprit
divin.
Parrhasius, né à Éphèse, contemporain
et rival de Zeuxis, florissait vers l'an 420 avant J. C. Son tableau
allégorique représentant le peuple d'Athènes lui acquit une grande
célébrité. Entre autres ouvrages de ce peintre, on parle du portrait
d'un grand prêtre de Cybèle, dont l'exécution était tellement
parfaite, que Tibère l'avait fait placer dans sa propre chambre,
afin de pouvoir l'admirer à toute heure.
Nam cura Protogenes...
Prologène a fleuri vers l'an 336 avant J. C. Il était né à Caune,
ville de Carie, soumise aux Rhodiens. Les anciens admiraient comme
son chef-d'œuvre le tableau qui représentait lalysus, personnage
dont on a fait un dieu, un héros, un fleuve, une ville même, enfin
un chasseur. On rapporte que Démétrius Poliorcète, qui, dans le
siège de Rhodes, se préparait à brûler un faubourg qui lui fermait
les approches de la place, ayant été instruit que le tableau du
lalysus décorait un des édifices destinés à être livrés aux flammes,
aima mieux renoncer à son entreprise, que de se faire reprocher une
perte si déplorable pour les arts.
492 Ce tableau lui enlevé
à la Grèce et placé à Rome dans le temple de la Paix, où il périt
dans un incendie.
Ratlione Pamphilus ac Melanthius...
Pamphile, né en Macédoine, sous le règne de Philippe; eut Eupompe
pour maître, et Apelle pour disciple. Il avait une si grande idée de
son art, qu'il ne croyait pas qu'on y pût être habile sans l'étude
des belles-lettres et de la géométrie.
Mélanthe fut contemporain et
condisciple d'Apelle. Aristrate, tyran de Sicyone, s'était lait
peindre par Mélantlie, sur un char de victoire. Lorsque Aratus eut
rendu la liberté à Sicyone, on détruisit les images des tyrans, mais
le Triomphe d'Aristrate fut épargné.
Facilitale Antiphilus...
Antiphile, né eu Egypte, était contemporain d'Apelle. Un de ses plus
beaux ouvrages représentait un enfant occupé à souffler le feu : on
croyait voir la lumière s'accroître et se répandre dans la pièce ou
il se trouvait. Il avait inventé une ligure grotesque, qu'il avait
nommée Gryllus, nom qui resta depuis à ces espèces du
caricatures. Jaloux d'Apelle, qui était venu à la cour de Ptolémée,
il l'accusa d'être complice d'une conjuration tramée contre le roi
d'Egypte; mais l'innocence d'Apelle ayant été reconnue, Antiphile
fut jeté dans les fers pour le reste de ses jours.
Ingenio et gratta... Apelles est
prœstantissimus. Apelle naquit à Cos, et reçut le droit de cité
à Éphèse. Il florissait vers l'an 332 avant J. C. Ses nombreux
chefs-d'œuvre décorèrent les villes de la Grèce, de l'Archipel, de
l'Asie et de l'Egypte. On le nommait le prince des peintres, et,
depuis, la peinture fut appelée par excellence fart d'Apelle.
Alexandre la combla de ses faveurs, et nu voulut être peint que par
lui. Après la mort de ce prince, il se rendit à Alexandrie, à la
cour de Ptolémée. Faussement accusé par Antiphile, il vit ses jours
menacés, et fut chargé de fers; mais un des coupables le justifia.
De retour dans sa patrie, il peignit, en mémoire de cet événement,
son fameux tableau de la Calomnie. On lui attribue plusieurs mots
devenus proverbes, tels que : Ne, sutor, ultra crepidam; — nulla
dies sine linea.
Euphranorem admirandum facit.
Euphranor, peintre et sculpteur, florissait vers l'an 304 avant J.
C. On le surnomma l'isthmien, eu raison de la situation de Corinthe,
sa patrie. Cependant Pline le range parmi les peintres athéniens;
d'où l'on peut induire qu'il exerça ses talents à Athènes. Il était,
comme le dit Quintilien, admirable dans tous les genres, et ses
sculptures ont autant contribué à sa célébrité que ses ouvrages en
peinture.
Nom duriora, et Tuscaniscis proxima
Callon atque Hegesias, jam minus rigida Calamis, molliora adhuc
supra dictis Myron fecit. Callon, de l'ile d'Égine vivait 432
ans avant J. C. Il avait sculpté en bois, dans la citadelle de
Corinthe, une statue de Minerve Sténiades On voyait aussi
dans la ville d'Amyclée la statue de Proserpine avec un trépied en
bronze, de la main de Callon Pline et Pausanias comptent, parmi les
sculpteurs contemporains, Agélade, Phragmon, Gorgias, Lacon, Myron
Pythagoras, Scopas, Perclius , et Maenechme.
Hégias, ou Hégésias, fut contemporain
de Phidias et d'Alcamène. Ses statues les plus estimées étaient une
Minerve et un Purrhus; ensuite deux figures de Castor et Pollux, qui
furent transportée à Rome, et placées, suivant le témoignage de
Pline, devant le temple de Jupiter Tonnant, à peu près à la même
place où l'on a retrouvé les deux statues colossales qui se voient
aujourd'hui au Capitole.
Calamis florissait à Athènes vers l'an
420 avant notre ère. Il excellait surtout à représenter des chevaux,
comme le témoigne Properce dans le vers suivant :
Exactis Calamine mihi jactat equis.
Il ne réussissait pas moins dans les
statues humaines. Ses sculptures étaient eu grand nombre et
très-recherchées. Entre autres grands ouvrages, il avait exécuté un
colosse qu'on voyait dans une petite île de la cote d'Illyrie, où
s'était établie une colonie de Milésiens. Lucullus enleva ce
monument , et le consacra dans le Capitole. On avait aussi placé
dans les jardins de Servilius à Rome un Apollon, apporté d'Athènes,
et du même sculpteur. Il était encore excellent ciseleur : Pline
cite deux vases précieux, ouvrages de cet artiste, et que Germanicus
avait possédés.
Myron, que Pline fait contemporain de
Callon, est un les plus célèbres statuaires de l'antiquité. Le
Discobole était un de ses chefs-d'œuvre. Verrès avait enlevé du
temple d'Esculape, à Agrigente, un Apollon en bronze d'une grande
beauté, et sur la cuisse duquel le nom de Myron se trouvait incrusté
en lettres d'argent ; il avait également dérobé, à Mamerte, un
Hercule du même métal et du même artiste. Myron avait aussi fait cet
Apollon qu'Antoine enleva aux Éphésiens, et qu'Auguste leur rendit,
sur la foi d'un songe. Pline et Pausanias citent encore un grand
nombre d'ouvrages de Myron : il paraît néanmoins qu'il mourut dans
la pauvreté.
Diligentia ac decor in Polycleto.
Polyclète, statuaire et architecte, connu citez les modernes sons la
dénomination de Polyclète de Sicyone, et auteur de la statue
colossale de Junon, en ivoire et en or, consacrée dans le temple de
cette déesse, près la ville d'Argos, a joui, chez les anciens, d'une
célébrité égale à celle de Phidias et de Praxitèle. Cette
dénomination de Polyclète de Sicyone tire son origine de ce mot de
Pline, Polycletus Sycionius, Ageladœ discipulus. Il paraît
néanmoins qu'il était d*Argos, ainsi qu'un second Polyclète avec
lequel on l'a souvent confondu. Platon, qui était son contemporain,
l'appelle, dans son dialogue intitulé Protagoras, Polyctèle
l'Argien. La Junon d'Argos était assise sur un trône d'or, dans une
attitude majestueuse : la tête, la poitrine, les bras et les pieds
étaient en ivoire ; les draperies en or. elle était coiffée d'une
couronne, sur laquelle le sculpteur avait représenté les Heures et
les Grâces. D'une main elle tenait son sceptre, de l'autre elle
portait une grenade ; au sommet du sceptre était posé un coucou : le
manteau était orné de guirlandes formées de branches de vigne; ses
pieds reposaient sur une peau de lion. Mais, de tous les ouvrages de
Polyclète, aucun ne contribua au tant à sa réputation que celui qui
fut appelé le Canon, ou la règle de l'art. Winckelmann
présume que la figure appelé le Canon était le Doryphore.
Polyclète fut encore un très-habile architecte. Les anciens ne
citent que deux édifices construits sur ses dessins, mais c'est avec
de grands éloges. Un des deux était un bâtiment circulaire, en
marbre blanc, appelé le Tholus, élevé à Épidaure, près du
temple d'Esculape. L'autre était un théâtre situé dans l'enceinte
mime de ce temple, et constamment regardé comme un modèle de goût.
At quae Polycleto defuerunt,
Phidiae atque Alcameni dantur. Phidias naquit à Athènes. Deux
faits sont constants dans l'histoire chronologique de sa vie : le
premier, c'est que la statue de Minerve, qu'il éleva dans le
Parthénon, fut terminée la seconde année de la 85e olympiade, 438
ans avant J. C., et qu'il se représenta lui-même, dans les
bas-reliefs qui ornaient le bouclier de la déesse, sous les traits
d'un vieillard chauve; le second, c'est qu'il représenta, dans les
bas-reliefs du trône de Jupiter, à Olympie, le jeune Pantarcès
attachant sur son front la couronne qu'il avait remportée aux jeux
olympiques la première année de la 86e olympiade. La statue. de
Minerve dans le Parthénon d'Athènes, et celle de Jupiter, à Olympie,
sont les plus célèbres de ses ouvrages.
Alcamène, élève de Phidias,
était né, comme son maître, à Athènes. II décora sa ville natale de
plusieurs chefs-d'œuvre, parmi lesquels on citait la statue de
Vénus Aphrodite. L'un des plus beaux ouvrages de cet artiste
493 fut le fronton
postérieur du temple de Jupiter Olympien, dont Pausanias a laissé la
description.
Ad veritatem Lysippum ac Praxitelem
accessisse optime affirmant. Lysippe, de Sicyone, fut compris
dans cet édit célèbre par lequel Alexandre confiait au seul Apelle
le droit de peindre son image ; au seul Pyrgotèle, celui de la
graver sur les pierres précieuses; et au seul Lysippe, celui de
l'exécuter en bronze. Pline, Pausanias, Strabon, Vitruve, font une
longue énumération de ses ouvrages. On lui a attribué, mais sans
preuve, ces fameux chevaux de Venise qui décorèrent pendant quelques
années l'arc de triomphe de la place du Carrousel. Lysippe prenait
l'avis d'Apelle sur ses statues, et Apelle le consultait sur ses
tableaux.
Praxitèle, né, selon l'opinion la plus
commune, à Athènes, florissait vers l'an 330 avant J. C. Il n'est
personne, disait Varron, quelque peu d'instruction qu'il ait reçue,
qui ne connaisse Praxitèle. La Vénus de Cnide fut le chef
d'œuvre de ce sculpteur, et l'objet de l'admiration de toute
l'antiquité. « De toutes les extrémités de la terre, dit
Pline, on navigue vers Cnide, pour y voir la statue de Vénus.» Cette
statue était nue, et Praxitèle avait pris pour modèle la fameuse
Phryné, sa maitresse, d'après laquelle aussi Apelle avait peint sa
Vénus Anadyomène.
Nam Demetrius tanqwm nimius in ea
reprehenditur. Démétrius était d'Alopée, et a vécu vers l'an 348
avant J. C. L'ouvrage le plus remarquable de ce sculpteur était une
statue de Minerve, qu'on nomma la musicienne, parce que les
têtes de serpent qui environnaient sa gorge rendaient un son
semblable à celui d'un instrument, quand on les frappait.
Quare qui a Latinis exiget illam
gratiam sermonis attici, det mihi in eloquendo eandem jucunditatem.
On aurait tort d'induire de l'éloge que Quintilien fait ici de la
langue grecque, qu'il la regardait comme véritablement supérieure à
la langue latine. C'est ainsi que nous disons que la langue
italienne est plus propre au chant que la langue française, sans
avouer par là notre infériorité. On peut, au surplus, opposer à
Quintilien l'autorité de Cicéron : « J'ai toujours cru, dit-il, et
je m'en suis souvent expliqué, que non-seulement notre langue n'est
point pauvre, mais qu'elle est même plus riche que la langue
grecque. Car a ton jamais vu, pour ne pas citer mon propre exemple,
nos bons orateurs et nos bons poètes manquer de termes pour exprimer
leurs idées ou donner des grâces à leur langage? » Sed ita senlio,
et saepe disserui, latinam linguam non modo non inopem, ut vulgo
putarent, sed locupletiorem etiam esse, quam grœcam. Quando enim
nobis, vel dicam aut oratoribus bonis, aut poetis, ullus orationis
vel copiosœ, vel elegantis ornatus defuit? (Traité des vrais
biens et des vrais maux, liv. 1, 3) La plupart des hellénistes
modernes, dont les plus savants n'ont jamais pu parvenir qu'à
distinguer le sens des auteurs grecs, prétendent que la langue
grecque est la plus harmonieuse que les hommes aient jamais parlée.
Mais, de bonne foi. peut-on dire qu'Homère, Pindare, Thucydide,
produisent le même effet sur nous que Virgile, Horace, Tacite? Dans
Virgile, par exemple, il y a des pensées qui sont aussi lumineuses
pour notre esprit français, sous tous les rapports, que les plus
beaux vers de Racine. Goûtons-nous aussi pleinement les beautés
d'Homère et de Sophocle? Quoi qu'il en soit, on lira sans doute avec
plaisir un passage de M. de Maistre, qui, bien que tiré du traité
du Pape, n'est pas déplacé dans cette note : « Rien n'égale la
dignité de la langue latine. Elle fut parlée par le peuple-roi, qui
lui imprima ce caractère de grandeur unique dans l'histoire du
langage humain, et que les langues même les plus parfaites n'ont
jamais pu saisir. Le terme de majesté appartient aux Latins :
la Grèce l'ignore, et c'est par la majesté seule qu'elle demeura
au-dessous de Rome dans les lettres comme dans les camps. Née pour
commander, cette langue commande encore dans les livres de ceux qui
la parlèrent. C'est la langue des conquérant» romains et celle des
missionnaires de l'Église romaine. Ces hommes ne diffèrent que par
le but et le résultat de leur action. Pour les premiers, il
s'agissait d'asservir, d'humilier, de ravager le genre humain; les
seconds venaient l'éclairer, le rassainir et le sauver : mais
toujours il s'agissait de vaincre et de conquérir ; et de part et
d'autre c'est la même puissance :
.... Super et Garamantas et Indos
Proferet imperium.
« Trajan, qui fut le dernier effort de
la puissance romaine, ne put cependant porter sa langue que jusqu'à
l'Euphrate. Le pontife romain l'a fait entendre aux Indes, à la
Chine et au Japon. C'est la langue de la civilisation. Mêlée à celle
de nos pères les barbares, elle sut raffiner, assouplir, et, pour
ainsi dire, spiritualiser ces idiomes grossiers, qui sont devenus ce
que nous voyons. Armés de cette langue, les envoyés du pontife
romain allèrent eux-mêmes chercher ces peuples qui ne venaient plus
à eux. Ceux-ci l'entendirent parler le jour de leur baptême, et
depuis ils ne l'ont plus oubliée. Qu'on jette les yeux sur une
mappemonde , qu'on trace la ligne où cette langue universelle s'est
tue. : là sont les homes de la civilisation et de la fraternité
européennes; au delà vous ne trouverez que la parenté humaine, qui
se trouve heureusement partout. Le signe européen, c'est la langue
latine. Les médailles, les monnaies, les trophées, les tombeaux, les
annales primitives, les lois, les canons, tous les monuments parlent
latin : faut-il donc les effacer ou ne plus les entendre? Le dernier
siècle, qui s'acharna sur tout ce qu'il y a de sacré et de
vénérable, ne manqua pas de déclarer la guerre au latin. Les
Français, qui donnent le ton, oublièrent presque entièrement celte
langue; ils se sont oubliés eux-mêmes jusqu'à la faire disparaître
de leur monnaie, et ne paraissent pas encore s'apercevoir de ce
délit commis a la fois contre le bon sens européen, contre le goût
et contre la religion. Les Anglais même, quoique sagement obstinés
dans leurs usages, commencent aussi à imiter la France : ce qui leur
arrive plus souvent qu'on ne le croit et qu'ils ne le croient
eux-mêmes, si je ne me trompe. Contemplez les piédestaux de leurs
statues modernes : vous n'y trouverez plus le goût sévère qui grava
les épitaphes de Newton et de Christophe Wren. Au lieu de ce noble
laconisme, vous lirez des histoires en langue vulgaire. Le marbre,
condamné à bavarder, pleure la langue dont il tenait ce beau style
qui avait un nom entre tous les autres styles, et qui, de la pierre
où il s'était établi, s'élançait dans la mémoire de tous les hommes.
Après avoir été l'instrument de la civilisation.il ne manquait plus
au latin qu'un genre de gloire, qu'il s'acquit en devenant,
lorsqu'il en fut temps, la langue de la science. Les génies
créateurs l'adoptèrent pour communiquer au monde leurs grandes
pensées. Copernic, Kepler, Descartes, Newton, et cent autres
très-importants encore, quoique moins célèbres, ont écrit en latin.
Une foule innombrable d'historiens, de publicistes, de théologiens,
de médecins, d'antiquaires, etc., inondèrent l'Europe d'ouvrages
latins de tous les genres. De charmants poètes, des littérateurs du
premier ordre, rendirent à la langue de Rome ses formes antiques, et
la reportèrent à un degré de perfection qui ne cesse d'étonner les
hommes faits pour comparer les nouveaux écrivains à leurs modèles.
Toutes les autres langues, quoique cultivées et comprises , se
taisent cependant dans les monuments antiques , et très-probablement
pour toujours. »
Ideoque in agenda... ut Periclem,
ne Demadem. Toute l'antiquité a célébré l'éloquence de Périclès,
mais 494 nous ne
possédons aucun des discours de cet illustre Athénien : les trois
harangues que lui fait prononcer Thucydide n'appartiennent , selon
toute apparence, qu'à cet historien. La première est une exhortation
à la guerre contre les Lacédémoniens et les autres peuples du
Péloponnèse ; la seconde est l'éloge funèbre des guerriers morts
dans la première campagne ; elle a de la renommée , et a été souvent
traduite. La troisième est une apologie de sa conduite. Quintilien a
précédemment parlé d'un recueil d'oraisons de Périclès , où il ne
trouvait rien qui fut digne des éloges que lui décerne Cicéron.
Aussi pensait-il , avec d'autres , que Périclès n'avait pas laissé
de discours écrits. Quelques-uns , au contraire , ont soutenu ,
d'après un texte de Suidas, qu'il ne prononçait que des discours
écrits. Bayle rejette celle opinion. Au reste, ce qui est
indubitable, c'est que Périclès dut à son éloquence l'autorité
presque monarchique dont il a joui pendant quarante ans au sein d'un
État populaire.
Démade, célèbre démagogue athénien,
fut d'abord matelot ou marchand de poissons. Des talents naturels
l'ayant porté à la tribune, il acquit beaucoup de crédit sur le
peuple d'Athènes. Contemporain de Démosthène et de Phocion, il joua
un rôle politique, qui ne fut pas toujours honorable. Une lettre de
Démade à Perdiccas, par laquelle il l'exhortait à se mettre à la
tête des affaires, en disant que le sort de la Grèce ne tenait plus
qu'à un fil pourri, c'est-à-dire Antipaler, tomba entre les mains de
Cassandre, qui, ayant fait arrêter Démade et son fils, fit égorger
d'abord celui-ci en présence du père , qu'il fit mourir ensuite l'an
202 avant J. C.
Nam et Homerus.... Menelao dedit.
Voici le passage d'Homère dont parle Quintilien , et qu'il se plaît
à rappeler en plusieurs endroits ; c'est Antênor qui répond à
Hélène, sur la tour :
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν
ὕφαινον,
ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευε,
παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεὺς
στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
σκῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αὔτως.
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆΐ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ᾽ εἶδος ἰδόντες.
(Iliade, III, 212-24.)
« Lorsqu'ils haranguaient dans les
conseils, Ménélas parlait d'une manière succincte, mais pleine de
force; il n'abondait point en paroles et ne s'écartait pas du sujet,
quoiqu'il fût le plus jeune. Mais quand le prudent Ulysse se levait
à son tour, d'abord, comme un homme novice et sans art, il demeurait
les yeux baissés et attachés à la terre, et tenant son sceptre
immobile. On eût dit un homme stupide, ou qu'agite intérieurement
une sombre colère. Mais lorsque sa grande voix s'échappait de sa
poitrine, et que ses paroles sortaient de sa bouche, aussi
abondantes que les flocons de neige qui tombent dans la saison
d'hiver, alors personne n'eût osé se mesurer avec Ulysse, et,
oubliant son extérieur, nous l'admirions tous en silence. »
Quœ tandem ars digna litteris
Platoni defuit ? « La nature, dit M. de Gérando, avait réuni
dans Platon ses dons les plus heureux et en même tempe les plus
divers, comme si elle s'était complu à former en lui le plus beau
génie qu'elle ait présentée l'humanité. Il possédait au plus haut
degré les facultés qui président aux arts d'imagination : ce genre
d'inspiration qui puise dans la région de l'idéal le type de ses
productions, ce talent d'imitation qui fait revivre les objets après
les avoir observés, cette vivacité de sentiment qui les revêt de
couleurs brillantes, surtout ce goût d'harmonie, cette fidélité aux
proportions, ce tact exquis des convenances, qui distribue les
détails dans le plus pariait accord ; mais il possédait en même
temps cette faculté d'abstraire, qui est le privilège des
penseurs... Quand on a bien saisi le caractère de cet esprit
extraordinaire , on devine d'avance la doctrine à laquelle il a dû
donner le jour. La poésie, dès l'origine, avait dominé la
philosophie; en lui elles semblent s'être mariées et confondues. Il
a porté au plus haut point de perfection la poétique de cette
science, si on peut s'exprimer de la sorte : il a été l'Homère de la
philosophie. C'est le titre que lui donne Cicéron. »
Quot seculis Aristotetes didicit, etc., naturas omnes perquireret
? Aristote, en effet, parcourut le cercle entier des
connaissances humaines : logique, métaphysique, morale, rhétorique,
poésie, politique, physique, histoire naturelle, économie politique,
histoire. Toutefois il ne jouit pas dans l'antiquité, et de son
vivant surtout, de celle gloire qui, plus tard, fil de son nom un
culte et une superslition : soit parce que, fidèle aux habitudes des
premiers philosophes, il ne donnait pas en public tonte sa doctrine
; car ses leçons se divisaient en deux classes : les unes, celles où
tout le monde était admis, portaient sur les connaissances les plus
usuelles de la vie commune; les autres étaient secrètes, et
exclusivement destinées à ses élèves : d'où plus lard les ouvrages
d'Aristote ont été divisés en exotériques el acroamatiques; soit que
l'imagination des Grecs se prêtait moins aux déductions rigoureuses,
aux étroites classifications du philosophe de Stagire. Une autre
circonstance étouffa quelque temps la renommée el l'influence
d'Aristote. Après sa mort, ses écrits exotériques restèrent cent
quatre-vingt-dix ans cachés dans une cave. Ils ne furent transportés
à Athènes, d'où Sylla les envoya à Rome, qu'à l'époque de
Mithridate.
M. Censorius Cato, idem orator.
Caton le censeur avait composé un grand nombre d'ouvrages sur des
matières différentes. Son traité de Re rustica est le seul
qui soit parvenu jusqu'à nous. Les autres étaient des discours et
plaidoyers prononcés pendant le cours de sa longue vie et recueillis
dans sa vieillesse : les origines ou histoires et annales du
peuple romain, dont il nous reste quelques fragments ; un livre sur
l'art militaire ; un livre sur l'éducation des enfants; des
préceptes sur les mœurs, en prose et en vers; des apophtegmes; un
traité de médecine ; des lettres citées par Pline, Festus et
Priscianus.
Quantum enim poesis ab Homero et
Virgiiio, tantum fastigium acceptt eloquentia a Demosthene atque
Cicerone. Il est si rare de rencontrer quelque chose qui ne se
ressente pas de l'éloge banal qui pèse sur ces quatre grands noms,
que le lecteur nous saura gré d'y faire diversion par une critique
d'un ordre plus élevé, empruntée à M. de Lamennais (Esquisse
d'une philosophie, Iiv. 8 et 9.)
« L'épopée homérique marque l'époque
où l'homme, ayant acquis une pleine conscience de soi, se sentit
libre au sein de l'univers; et en même temps elle représente ses
modes d'activité, la religion, les lois, les coutumes, les mœurs, la
civilisation enfin, telle qu'elle se développa chez les Grecs sous
l'influence dorienne. Récemment descendus de leurs après montagnes,
tout près encore de l'état grossier, à moitié sauvage, de leurs
rudes ancêtres, ils offrent un mélange singulièrement poétique de
barbarie et d'héroïsme, de passions farouches et de tendresse naïve,
d'idées morales, imparfaites, confuses, et des sentiments les plus
délicats, des instincts les plus généreux. Leurs yeux, où tout à
l'heure étincelait la colère, se mouillent de sain-
495 tes larmes de la
pitié. Les liens de la famille et ceux de la sympathie ont formé
parmi eux la trame première, indestructible de la société. Le père,
la mère, l'époux, l'épouse, l'enfant, le frère, l'ami, tout a son
modèle d'une vérité, d'une beauté presque inimitable, dans cette
poésie simple el magnifique, qui tantôt vous émeut par la vi\e
peinture des tristesses et des joies, des craintes et des
espérances, des biens si fragiles, des maux si nombreux, des
infortunes si amères de la vie et de ses soudaines catastrophes ;
tantôt vous égare au milieu des doux enchantements de la nature,
dans les bois suspendus aux flancs des coteaux, le long d'un
ruisseau qui serpente à travers de riantes plaines, ou d'un torrent
qui tombe des rochers, en de frais vallons, en des champs couverts
de jaunes épis qui plient et se relèvent sous les nuages mobiles
chasses par les vents, et sur les rivages de la mer bruyante. Le
charme de la langue sonore, accentuée, sa merveilleuse richesse,
l'infinie variété de ses nuances, ajoute à ces prestiges un prestige
nouveau. Tour à tour rapide, majestueuse, sombre, heurtée,
gracieuse, suave, l'harmonie du vers peint à l'oreille ce qu'ex
priment les mots, soit que le père des dieux ébranle l'Olympe
d'un mouvement de ses sourcils, soit que le souffle du temps détache
de leur tige les générations humaines, comme des feuilles d'automne.
« Rome, après Lucrèce, n'a produit que
deux poètes vraiment dignes de ce nom, Virgile et Horace. Au temps
où ils vécurent, presque toutes les sources de la poésie primitive
étaient desséchées. Ils furent poètes de la seule manière dont on
puisse l'être lorsque la foi s'est éteinte et que les mœurs ont
perdu leur simplicité naïve, par le sentiment de la nature et de
l'humanité, joint dans l'un à la tendresse du cœur, dans l'autre à
la finesse pénétrante et à l'exquise délicatesse de la pensée. Le
tumulte des cités, leur bruit vide les importunait également. Alors
il s'élevait en eux des regrets d'une tristesse singulière,
d'impétueux désirs, pareils à ceux que l'instinct éveille dans
l'oiseau de passage, quand vient la saison du départ. Rêvant la paix
et les loisirs de sa petite maison de Sabine, le poète de Tibur
demandait la campagne, et ses ombrages, et son silence , pour y
boire l'oubli d'une vie agitée :
O rus, quando ego te aspiciam ?
quandoque licebit
Nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis,
Ducere sollicita jucunda oblicva vitae ?
Le cygne de Mantoue, fatigué de son
vol, aspirait à se reposer dans les fraîches vallées arrosées par
des fleuves limpides , sur les pentes de l'Hémus et du Taygète, cher
aux jeunes filles de la Laconie; aux bords du Sperchius, sous
l'épais feuillage des forêts :
Rura mihi et rigui placeant in
vallibus amnes ;
Flumina amem sylvasgue inglorius. O ubi campi,
Spernichaque, et virginibus bacchata Lacœnis
Taygeta ! O qui me gelidis in vallibuss Haemi
Sistat, et ingenti rumorum protegat umbra!
Et ce n'est pas seulement dans ses
poèmes champêtres que ce chantre harmonieux de la nature révèle
l'amour qu'elle lui inspirait : à chaque instant il se manifeste
dans son épopée même; et avec la peinture si vraie des passions les
plus vives, des plus purs sentiments, des plus douces sympathies qui
puissent unir les hommes, il en fait le charme principal.
« Démosthène semble avoir posé, dans
la Grèce encore libre, les bornes de l'art. Ce n'est pas que
d'autres n'aient eu des qualités qui lui manquaient; mais les plus
éminentes il les possédait toutes, et toutes à un degré qu'on n'a
point égalé. Quel que soit son sujet, il l'agrandit naturellement et
sans effort. A mesure qu'il se dessine, vous y voyez l'empreinte
d'une puissance extraordinaire : on dirait le torse d'Hercule. Dans
tous les membres de ce corps on sent couler une vie énergique. Ses
muscles tendus se gonflent et palpitent ; un souffle plus qu'humain
bruit profondément dans sa large poitrine. Le colosse se meut, lève
le bras, et, avant même qu'il ait frappé, nul ne doute un instant
que la victoire puisse être indécise. Ce qui domine dans Démosthène,
c'est une logique sévère, une dialectique vigoureuse, serrée, un
étroit enchaînement, d'où résulte un tout compacte et indissoluble.
Ne cherchez point en lui la souplesse élégante, la grâce flexible el
molle, l'insinuation craintive, la ruse qui s'enveloppe et fuit pour
revenir : il va droit à son but, renversant, brisant de son seul
poids tous les obstacles. Sa diction est nerveuse, concise, et
cependant périodique. Pas une phrase oiseuse dans le discours; pas
un mot oiseux dans la phrase. Il force la conviction, il entraîne à
sa suite l'auditeur maîtrisé, et, s'il hésite, ouvrant une soudaine
issue à la tempête qu'il retenait en soi, il l'emporte comme les
vents emportent une feuille sèche.
« L'éloquence ne fut guère à Rome,
quand le goût des lettres y pénétra, qu'une imitation de celle des
Grecs. Mais, en Grèce même, l'art oratoire avait dégénéré, comme
tous les autres arts. Réduit par les rhéteurs à des formes
matérielles, il manquait du vie interne, de spontanéité , de ce qui
sort de l'âme par un soudain et naturel mouvement. Ce n'était plus
qu'un arrangement artificiel de phrases, un assemblage de lieux
communs disposés selon des règles fondées en partie sur
l'observation, mais qui tendaient à substituer à l'inspiration
créatrice de simples procédés techniques. On put dès lors ouvrir des
écoles où l'éloquence était enseignée comme on enseigne la
géométrie, la grammaire , le dessin, la danse. Vers les derniers
temps de la république, les jeunes Romains allaient en foule
recueillir les leçons des maîtres célèbres, pour se préparer aux
fonctions publiques, liées presque toutes à l'exercice de la parole.
La grandeur des questions traitées dans le sénat ou en présence du
peuple, et les passions qu'elles suscitèrent, empêchèrent, malgré
les rhéteurs et leurs stériles préceptes, la véritable éloquence de
se perdre, aussi longtemps que la liberté subsista. Cependant on ne
laisse pas d'apercevoir dans les monuments de cet âge, et dans
Cicéron même, des traces de l'art factice né chez les Grecs à une
époque de décadence. Jamais ce grand orateur ne s'oublie lui-même,
ne s'efface ; jamais il n'est pleinement absorbé par son sujet. Il
ne veut pas seulement entraîner, convaincre, il veut encore plaire
et briller. .Même lorsqu'il se passionne, lorsque les flots de sa
parole débordent et se précipitent avec le plus d'impétuosité, on y
sent quelque chose d arrangé pour l'effet. Moins nerveux qu'élégant,
el toujours maître de soi, il ne s'abandonne qu'avec réserve dans la
mesure qu'il a résolue. Ne cherchez en lui ni la mâle simplicité de
Démosthène, ni sa logique rapide, ni son énergie concentrée. Il lui
faut plus d'espace, plus d'intermédiaires, plus de préparations. Sa
période se développe avec majesté, mais souvent aussi avec une
abondance trop verbeuse. Son discours a de l'ampleur et de l'éclat;
on aimerait que le tissu en fût plus serré. Toutefois, quoique l'on
puisse désirer en lui, Cicéron a le génie de l'éloquence. Il
persuade, touche, émeut; il a des accents pathétiques, il sait
exciter la pitié, soulever l'indignation. Admiré de ses
contemporains, leur jugement unanime, confirmé par celui delà
postérité, le place au premier rang des orateurs romains, et assure
à son nom une gloire immortelle. »
Hœc erant, Marcelle Viclori, quibus
proecepta dicendi pro virili parte adjuvari posse per nos videbantur.
Nous avons cru rendre hommage à un devancier, en terminant ces notes
par l'extrait suivant de l'excellente préface de l'abbé Gédoyn,
auteur de la première bonne traduction de Quintilien. « L'éloquence
romaine, après avoir été portée à la plus haute perfection par
plusieurs grands orateurs, mais surtout par Hortensius el par
Cicéron, éprouva bientôt le sort de toutes les choses humaines, qui
496 ne demeurent pas
longtemps au môme état, el qui ne sont jamais plus près de leur
déclin que lorsqu'elles semblent avoir atteint le point
d'accroissement et de grandeur qui leur Était réservé. Cependant
Messala et Pollion la soutinrent encore quelque temps. Mais après
eux on la vit pencher de plus eu plus vers sa ruine ; si bien que,
depuis te temps-là jusques à Quintilien qui en fut le restaurateur,
à peine peut-on compter deux ou trois orateurs qui se soient fait
quelque nom. Plusieurs auteurs ont recherché la cause d'une si
prompte décadence; et Quintilien lui-même composa un livre, qu'il
intitula Des causes de la corruption de l'éloquence, où, en
découvrant le mal, il tâchait d'y apporter le remède. Cet
ouvrage n'est point venu jusqu'à nous, celui qui porte un titre
semblable, et dont nous avons un très-beau fragment, n'étant, selon
toutes les apparences, ni de Quintilien, ni de Tacite. Pour moi,
quand je porte mon esprit sur les hommes de ce temps-là,
particulièrement sur ceux dont l'exemple devait entraîner les
autres, il me semble que je trouve dans leur propre caractère la
raison du changement qui se fit à l'éloquence. On changea de goût,
on changea aussi de manière; car l'un suit toujours de l'autre.
C'est une chose qui se dit communément, qu'il ne faut point disputer
des goûts : sans doute parce que cela est inutile, tout homme
trouvant son goût bon, et ne l'ayant même que parce qu'il le trouve
bon. Cependant on convient qu'il y a un bon et un mauvais goût. Si
donc le goût qui régnait du temps de Cicéron et de Virgile était
bon, il faut conclure que celui qui régna ensuite était mauvais,
puisqu'il était non-seulement différent, mais même contraire. Or, je
ne sais si celui qui contribua le plus à changer le goût de son
siècle ne fut point Ovide. C'était le plus bel esprit de son temps
et le plus galant. Jamais poète n'a fait des vers avec une facilité
si heureuse. Tous les sujets qu'il traitait, quelque stériles,
quelque bizarres même qu'ils fussent, devenaient riches, gracieux et
fleuris entre ses mains. Mais comme il avait infiniment d'esprit, il
en mettait partout jusques à l'excès. Se plaignait-il de ses
malheurs? il songeait bien plus à être ingénieux, qu'à s'attirer de
la compassion. Ecrivait-il des lettres amoureuses? c'étaient pensées
sur pensées, de l'esprit à chaque mot : par conséquent peu de
sentiment, peu de passion. Jusque-là on n'avait guère connu que la
belle et noble simplicité. Le genre d'écrire d'Ovide commença à se
faire goûter. Un défaut revêtu de tant de grâces se prend aisément
pour vertu. On l'imita donc. Mais ceux qui l'imitèrent n'ayant pas
l'esprit d'Ovide, et voulant pourtant en avoir en dépit de la
nature, gâtèrent tout par une affectation ridicule, qui est de tous
les vices le plus insupportable aux personnes qui ont du goût. Voilà
donc l'éloquence déjà corrompue par l'affectation ; car, quoique je
parle d'un poêle, c'est toujours l'éloquence sous une foi me
différente. D'un autre calé, Mécénas, favori d'Auguste, si célèbre
par la protection généreuse qu'il accordait aux gens de lettres, et
homme de lettres lui-même, ne laissa pas de nuire à l'éloquence. Il
était de ces voluptueux qui raffinent sur le plaisir et qui le
cherchent en tout. Son style, par une suite assez naturelle, se
ressentait de la mollesse de son âme. Il recherchait dans
l'arrangement des mots, et dans sa composition, une certaine cadence
molle, et je ne sais quels nombres qui flattaient agréablement
l'oreille, mais qui n'avaient nul soutien. On dit même qu'il
affectait ce badinage jusque dans les choses les plus sérieuses et
les plus tristes. Nous en avons une preuve dans quelques-unes de ses
paroles, que Quintilien nous a conservées, comme celles-ci : ne
exsequias quidem unus inter miserrimos viderent meas. Sur quoi
ce rhéteur dit : quod inter haec pessimum est, quia in re tristi
ludit cornpositio. Tel était le goût de Mécénas. Un ministre, un
favori n'a guère de vices qui ne soient contagieux. Souvent même on
les érige en vertus, pour les imiter plus librement. Pollion et
Messala, Virgile, Varius et Horace, «a sauvèrent de la contagion.
Mais il est à croire que ceux qui n'avaient pas la même supériorité
de génie voulurent plaire à leur protecteur, du moins par la
conformité de, leur style avec le sien. Voilà comme la mollesse et
l'afféterie infectèrent peu à peu l'éloquence.
« Tibère, successeur d'Auguste, fut,
comme on sait, un prince fort concerté, artificieux, cruel, de ces
politiques qui ne font rien sans dessein, et qui ne veulent point
être pénétrés. Avec un tel maître, les Romains eurent besoin d'une
dissimulation profonde. Ils s'accoutumèrent à déguiser leurs
pensées, à dire une chose pour en faire entendre une autre, au
hasard de n'être pas entendus. Cet art devint encore plus nécessaire
sous les empereurs suivants, Caligula, Claude, Néron; la plainte
ouverte était un crime qui ne demeurait point impuni. Cependant on
voulait se plaindre; et qu'y a-t-il de plus naturel aux malheureux?
Qu'arriva-t-il? on parla, pour ainsi dire, par énigmes. Les discours
ligures furent goûtés, et devinrent à la mode; j'entends ces
discours où l'on dit une chose, sans que l'on puisse vous accuser de
l'avoir dite. Ces ambiguïtés passèrent bientôt de la conversation
dans les écrits. Ainsi l'obscurité si contraire au beau style , à
l'éloquence, y fut introduite par le besoin que l'on en eut, et
gardée par l'habitude qui s'en contracta : témoin les ténèbres de
Perse, les obscures allégories de Pétrone, et la profondeur de
Tacite, qui est un excellent historien, mais qu'il faut souvent
deviner. Quoique l'éloquence fut déjà si différente de ce qu'elle
était peu auparavant, les Romains conservaient toujours de l'amour
et de l'inclination pour un si bel art. On eu tenait des écoles
publiques à Rome. On peut dire même qu'il n'y eut jamais tant de
maîtres qui tissent profession de l'enseigner. Ces maîtres étaient
ce que l'on appelait des déclamateurs ; et les discours d'éclat
qu'ils faisaient de temps un temps s'appelaient des déclamations. Ce
furent eux qui achevèrent de corrompre et de perdre l'éloquence.
Car, aux vices déjà établis, ils en ajoutèrent deux autres,
l'enflure et les pointes : au lieu d'exercer les jeunes gens sur des
sujets raisonnables, qui eussent pu les préparer aux fonctions du
barreau, ils ne leur en proposaient que d'extraordinaires et de
bizarres, qui n'avaient rien d'intéressant, rien d'utile. C'étaient
tantôt des réponses d'oracles, qui auraient à peine trouve croyance
dans les temps fabuleux, tantôt des lois imaginaires, sur lesquelles
ils bâtissaient des matières de controverse, qui ne pouvaient jamais
avoir d'application, parce que le fondement en était chimérique.
Eux-mêmes traitaient ces sujets avec toute l'emphase ou tous les
raffinements imaginables. Il ne faut que voir le portrait que nous
fait Pétrone d'un de ce déclamateurs, ou jeter les yeux sur les
dix-neuf déclamations que l'on attribue communément à Quintilien, et
qui sont si peu de lui que, dans ses livres de l'Institution de
l'orateur, il se déchaîne uns cesse contre l'esprit et le style de
ces misérables pièces. Malgré cela, ces déclamations imposaient à la
multitude, et surprenaient son admiration par des expressions
hardies, par des exagérations outrées, par une vaine pompe, enfin
par une prononciation bruyante et fastueuse; car U présomption fut
toujours compagne de l'ignorance. Le mal se communiqua bientôt et
aux écrivains et aux orateurs. La jeunesse romaine, formée par de si
mauvais maîtres, porta les manières de l'école au barreau, et les
retint par la force de l'habitude et des préjugés. Ce fut alors que
le mauvais goût s'empara de presque tous les esprits, et qu'il régna
avec une pleine et entière liberté. Un discours naturel et judicieux
trouva peu d'approbateurs On voulait des jeux de mots, des pointes
d'esprit, de ces obscurités mystérieuses qui laissent à l'auditeur
tout le plaisir de la pénétration ; ou bien on voulait un discours
qui fût brillant 497
d'un bout à l'autre ; on croyait chercher le grand et le
merveilleux, mais on ne songeait pas que celte grandeur était, dit
Quintilien, plutôt bouffissure que santé, plutôt enflure
qu'embonpoint. De là naquirent la Pharsale de Lucain, et les
Épigrammes île Martial. Non que ces deux écrivains soient à mépriser
; mais l'un est toujours monté, pour ainsi dire, sur des échasses ;
et tout faiseur d'épigrammes, je dis faiseur de profession, lors
même qu'il plaît, ne saurait guère manquer de déplaire en même temps
par l'affectation qui est inséparablement attachée à cette sorte
d'ouvrage.
« Je crois avoir touché les causes les
plus naturelles et les plus probables de la corruption du goût chez
les Romains. On en pourrait ajouter beaucoup d'autres; mais il y en
a une surtout que je ne dois pas oublier, c'est l'admiration aveugle
que l'on eut pour un écrivain de ce temps-là, qui ne la méritait
pas. Rien n'est si séduisant et si dangereux que l'esprit dans un
écrivain qui n'a point de goût : les traits de lumière dont brillent
ses écrits frappent tout le monde, et le défaut de goût n'est
remarqué que d'un petit nombre de gens sensés, qui ont puisé leurs
idées et leur goût dans les plus pures sources. Sénèque, devenu
l'unique objet de l'estime publique par une espèce d'illusion dont
il se voit des exemples presque en chaque siècle, est une preuve
singulière de l'empire que les qualités spécieuses prennent sur la
plupart des hommes. Cet auteur parut aux Romains comme un nouvel
astre qui venait les éclairer : aussitôt tout fut effacé devant lui.
Ce caractère moral et sentencieux, qu'il affectait, était
apparemment un caractère qu'ils n'avaient point encore un , et qui
eut pour eux le charme de la nouveauté. Ils ouvrirent les yeux à ses
perfections, car il en avait de grandes ; et ils les fermèrent à ses
défauts, qui, pour avoir une sorte d'agrément et de douceur, n'en
étaient pas moins des défauts : dulcibus abundabat vitiis,
dit Quintilien lui-même. En effet, avec beaucoup d'esprit, il
n'avait nul goût, nulle idée de la véritable éloquence ; son style
était un style décousu, où l'on ne trouvait ni nombre ni harmonie,
rien de périodique, rien de soutenu. Cependant Sénèque était entre
les mains de tout le monde ; on ne lisait, on n'admirait, on
n'imitait plus que Sénèque. Jamais auteur n'a joui d'une plus grande
réputation : pour s'en assurer la possession, il s'avisa de décrier
les anciens, et de traiter d'écrivains médiocres ces grands hommes,
par qui Rome s'était vue presque égale à Athènes. Il ne cessait de
se déchaîner contre ces grands modèles, dit Quintilien, parce qu'il
se doutait bien que sa manière d'écrire, qui était si différente de
la leur, ne pouvait jamais plaire tant que la leur plairait.
« Telle était l'éloquence romaine,
lorsque Quintilien forma le dessein de lui rendre son premier
lustre. Il combattit le mauvais goût de son siècle, prit la défense
des anciens, soutint hardiment qu'il était dangereux de vouloir
avoir plus d'esprit que Démosthène et que Cicéron, qu'Homère, que
Virgile, et qu'Horace : que ces vains ornements dont on était si
amoureux faisaient une éloquence fardée, qui n'avait plus rien de
naturel ; que l'affectation, l'obscurité, l'afféterie et l'enflure
étaient incompatibles avec le beau style. Lui-même il retraça aux
yeux des Romains l'image d'une éloquence mâle, noble et solide, qui
songe moins à plaire qu'à se rendre utile. Il la fit refleurir au
barreau par ses propres plaidoyers, qui en étaient les modèles
achevés. Le vrai mérite a des lois qui se font reconnaître tôt ou
tard. Quintilien fut écouté à son tour. On lui applaudit, on
l'admira, on revint au bon sens, à l'amour du naturel et du vrai. Le
public désabusé, en perdant plus de la moitié de l'estime qu'il
avait pour Sénèque, retint justement celle qu'il méritait, et qu'il
a eue depuis dans la postérité. Les Romains surent tant de gré à
Quintilien d'avoir fait revivre l'éloquence et le goût du siècle
d'Auguste, qu'ils l'engagèrent à enseigner un art qu'il possédait si
parfaitement, et lui assignèrent des appointements sur le trésor
public, honneur qu'ils n'avaient encore fait à personne. Les
fonctions du barreau étaient beaucoup plus brillantes et plus
nobles. Quintilien, en bon citoyen, les quitta sans peine, pour
prendre un emploi où il ne doutait pas qu'il ne fut beaucoup plus
utile au public. Il s'appliqua donc à former la jeunesse romaine, et
s'y prit de manière que l'on vit bientôt sortir de son école
plusieurs grands hommes qui tirent beaucoup d'honneur et à leur
maître et à leur siècle. Il est quelquefois dangereux de servir si
bien le public. On ne cesse pas quand on veut ; il faut se
sacrifier. Quintilien exerça son emploi vingt ans, mais avec tant de
réputation et de succès, que la plupart des écrivains de ce temps-là
et des siècles suivants, Romains ou autres, Pline, Martial, Juvénal,
Ausone et saint Jérôme, Apollinaris Sidonius, Cassiodore, ont parlé
de lui comme du plus grand rhéteur et de l'homme le plus éloquent
que l'on eût vu depuis Cicéron. Devenu vieux, et ne soupirant
qu'après le repos, il lui fut enfin permis de se retirer. Mais son
repos ne fut point oisif.
« Ce fut dans sa retraite qu'à la
sollicitation de ses amis il se mit à composer les douze livres de
l'Institution de l'Orateur, pour servir éternellement de
règle à ceux qui s'adonneraient à l'éloquence , et de préservatif
contre la mauvais goût, source de tous les vices qui l'environnent,
et qui entraînent enfin sa ruine. Cet ouvrage fut interrompu par des
malheurs domestiques, qu'il déplore dans l'avant-propos de son
sixième livre, et par l'honneur que lui fit l'empereur Domitien de
le donner pour précepteur à deux princes ses neveux, qui lui
tenaient lieu d'enfants. Ce sont ces douze livres de l'institution
de l'Orateur qui vont paraître en notre langue pour la première
fois; car l'ouvrage de l'abbé de Pure est à compter pour rien :
c'est ce qu'on en pout dire de mieux. Une traduction parfaite est
quelque chose de si difficile et de si rare, que je suis bien
éloigné de croire que la mienne porte ce caractère; mais si j'étais
parvenu à la rendre au moins passable, je croirais avoir beaucoup
fait. Car l'original, quoique généralement estimé, quoique chéri
particulièrement de nos magistrats les plus éclairés et des
personnes de goût, quoique regardé comme l'ouvrage le plus propre à
rendre un homme supérieur aux autres par les talents de l'esprit et
de la parole, est néanmoins fort peu lu : ce qui vient sans doute du
peu de connaissance que l'on en donne aux jeunes gens dans les
collèges. D'ailleurs nous naissons tous avec un secret orgueil qui
nous porte à croire dans la suite que, pour réussir en lait
d'ouvrages d'esprit et d'éloquence, il n'est pas besoin de tant de
préceptes, qu'il ne faut que du génie, du naturel et de
l'application. C'est surtout la manière dépenser aujourd'hui. On se
révolte contre les règles : le seul nom de précepte blesse notre
amour-propre; ou ne songe pas que ces règles, soit de poétique, soit
d'éloquence, ne tirent pas leur autorité de ceux qui nous les
donnent, mais de ceux qui les ont pratiquées avec succès; que ce
sont de pures observations sur ce qui a bien ou mal réussi aux
célèbres écrivains des siècles passés; et, pour tout dire en un mot,
que ce n'est autre chose que le fruit de l'expérience : qu'ainsi
vouloir faire un beau poème qui soit contre les règles de la
poétique d'Aristote ou d'Horace, c'est vouloir réussir en marchant
par une route directement opposée à celle qu'ont tenue les plus
grands poètes : ce qui n'est pas possible; car on arrive bien au
même terme par des chemins différents, mais non pas par des chemins
tout contraires. Cependant, si l'on y prend garde, on trouvera que
ces excellents traités de poétique et d'éloquence que nous ont
laissés ces grand» maîtres de l'antiquité, Cicéron, Denys
d'Halicarnasse, Quintilien, Longin, Aristote et Horace, ne sont pas
lus 498 aujourd'hui par
ceux qui se donnent pour orateurs ou pour poètes, mais par un petit
nombre de savants qui ne se mêlent ni de parler en public, ni de
poésies. C'est aussi, selon moi, ce qui fait la différence de la
plupart des écrivains de nos jours d'avec ceux dont nous ne pouvons
assez regretter la perle : je veux dire les Corneille, les Molière ,
les Racine, les Patru , les Pellisson, les Despréaux : tant d'autres
grands hommes que l'on a vus fleurir presque en même temps, et qui
faisaient leurs délices de la lecture de ces mômes anciens dont on
veut nous dégoûter aujourd'hui; car véritablement l'esprit est de
tous les temps : mais on peut se tromper au choix de la nourriture
qu'on lui donne ; le goût change, et l'amour des sciences se perd.
Maintenant nous présumons trop de nus forces, et, pour ne pas rougir
de notre ignorance, nous prenons le parti de condamner ce que nous
avons négligé d'apprendre. Pour revenir à Quintilien, présentement
qu'il est traduit en langue vulgaire, il y a lieu de croire qu'on le
lira, et que le grand sens et la beauté de l'original feront passer
la traduction, toute médiocre qu'elle est; mais il ne faut pas
compter que dans un ouvrage comme celui-ci tout soit également beau
ou utile. Il y a des choses qui se traitent seulement pour une plus
grande exactitude : celles-là rebutent souvent un lecteur quand il
les voit dans l'éloigné ment, et détachées du rapport qu'elle* ont
au temps où l'auteur écrivait. Si à présent, comme autrefois,
l'éloquence était un moyen sûr pour parvenir à de grandes fortunes,
aux dignités, aux honneurs, un écrivain qui nous en donnerait des
préceptes ne pourrait jamais être trop exact. Il faut donc se prêter
à la considération des temps et des lieux. Quintilien ne manque
guère l'occasion de combattre plusieurs abus qui régnaient parmi les
déclamateurs : cela l'oblige quelquefois à entrer dans des détails
qui nous paraissent bizarres. Mais cet détails n'en étaient pas
moins nécessaires. Il dit beaucoup de choses qui regardent
uniquement la langue latine, et dont il n'y a tout au plus qu'une
partie qui se puisse appliquer à la nôtre. C'est qu'il écrirait pour
les Romains, et non pas pour nous.
« Par cette raison, un savant homme
qui m'a communiqué ses lumières avec autant de politesse que de
bonté n'a pas fait difficulté de retrancher divers endroits de
Quintilien dans l'édition abrégée qu'il en a donnée au public. Il a
cru que cet auteur, qui est si propre à former l'esprit et les
moeurs de la jeunesse, en serait mieux goûté, s'il était débarrassé
de ce qu'il y a d'épineux. Pour moi, je n'ai pas dû prendre la même
liberté. Mais, bien loin d'être amoureux de tout ce qui se trouve
dans l'Institution de l'Orateur, j'avoue que, si j'avais osé,
j'aurais supprimé plusieurs choses. Cependant, comme l'auteur écrit
avec beaucoup d'art, il lui arrive rarement de traiter des matières
épineuses ou subtiles sans dédommager bientôt son lecteur, soit par
quelque trait de la plus vive éloquence, soit par des chapitres
entiers, où l'agréable et l'utile sont mêlés avec un égal
tempérament. Car, sans m'éloigner du dessein que j'ai pris dans
cette préface, d'éviter tout éloge fastueux et de ne parler de
Quintilien qu'historiquement, je crois pouvoir dire que peu
d'écrivains ont su comme lui le secret de plaire et d'instruire en
même temps. » |