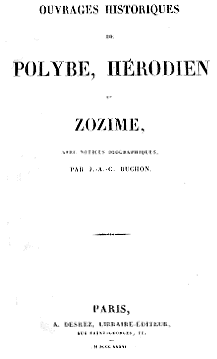|
|
ZOZIME HISTOIRE ROMAINE Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LIVRE CINQUIÈME.introduction - livre I - livre II - livre III - livre IV - livre VI Arcadius et Honorius demeurèrent, par la mort de Théodose, seuls possesseurs de la souveraine puissance; mais ils n’en retinrent que le nom, et en laissèrent tout l’effet en Orient à Rufin, en Occident à Stilicon, qui terminaient les différends, des particuliers par une autorité si absolue, que quiconque était assez riche pour acheter leur suffrage, ou assez heureux pour s’insinuer dans leurs bonnes grâces, ne manquait jamais de gagner sa cause. Les grandes terres dont on croit que la possession rend les hommes heureux, tombaient dans leurs familles, soit qu’on les leur abandonnât pour avoir leur protection, et pour se garantir d’une accusation calomnieuse, ou qu’on les leur vendit pour acheter une charge, ou pour entrer dans quelqu’un de ces partis qui ne tendent qu’à la ruine des villes. Toutes les richesses de l’empire venaient s’entasser dans leurs maisons, et celles qui avaient été les plus riches tombaient dans une honteuse pauvreté, par un renversement de tout ordre et par la corruption des mœurs. Les empereurs ne s’apercevaient point de ces désordres, et ils tenaient les moindres paroles de ces deux officiers comme une loi non écrite. Rufin ayant amassé des biens immenses, fut capable d’une si étrange extravagance que d’aspirer à l’empire en donnant sa fille en mariage à l’empereur. Il lui en fit parler par quelques officiers, dans la pensée que l’affaire était fort secrète, bien qu’elle fût déjà répandue parmi le peuple. L’excès de son orgueil, qui avait excité contre lui la haine publique, avait aussi donné quelque soupçon de cette prétention ambitieuse. Il se porta à une entreprise fort hardie, comme s’il eût eu dessein d’effacer des défauts médiocres par des crimes extraordinaires. Florence qui, sous le règne de Julien, avait été préfet du prétoire au-delà des Alpes, eut un fils nommé Lucien, qui se mit en grand crédit auprès de Rufin, en lui donnant des terres considérables. Il obtint, à sa recommandation, de l’empereur Arcadius la charge de comte d’Orient, qui est au dessus de toutes les autres. Il l’exerça avec une grande réputation de modération et d’équité, préférant toujours les lois et la justice à la qualité des personnes et à toute autre considération. Eucherius, oncle de l’empereur, lui ayant fait une demande déraisonnable, il la lui refusa; l’autre irrité de ce refus le noircit de faux crimes auprès de l’empereur; celui-ci en rejeta la faute sur Rufin, qui lui avait fait donner une charge trop considérable. Rufin, sous prétexte de cette plainte de l’empereur, alla à Antioche, et y étant entré durant la nuit, se saisit de Lucien, et l’obligea à rendre raison de sa conduite, bien qu’il ne fût accusé de personne, et le fit battre avec des balles de plomb. Quand il fut mort il commanda de l’emporter dans une litière hors de la ville, voulant par là faire croire que puisqu’il avait encore quelque reste de bien, il était encore en état de recevoir quelque grâce. La cruauté de cette exécution donna de l’indignation aux habitants; mais pour les apaiser, il fit bâtir une galerie qui est l’édifice le plus magnifique qu’il y ait à Antioche. Étant de retour à Constantinople, il travailla avec plus d’empressement que jamais pour conclure l’alliance qu’il souhaitait et pour donner sa fille à l’empereur. Mais la fortune fit naître contre son espérance un obstacle à sa prétention. Promotus avait laissé deux fils qui, durant la vie de Théodose, avaient été élevés avec ses enfants. L’un des deux avait chez lui une jeune personne d’une excellente beauté, qu’Eutrope, eunuque de l’empereur Arcadius, lui conseilla d’épouser. Ce prince ayant prêté l’oreille à son conseil, il lui montra le portrait de cette personne, et augmenta tellement la passion de l’empereur, qu’il résolut de l’épouser sans que Rufin sût rien de cette intrigue, et bien qu’au contraire il s’imaginât lui faire épouser sa fille, et devenir par cette alliance son associé à l’empire. L’eunuque voyant cela, et s’imaginant que le mariage arrangé par lui était une affaire conclue, ordonna au peuple de commencer les danses, et de se couronner de fleurs, selon ce qui se pratique au mariage des princes. Il tira du palais un manteau convenable à la majesté du trône avec tous les autres ornements de toilette, et les donna à porter aux serviteurs de l’empereur. Il traversa la ville avec ces présents, précédé par la foule. Le peuple ayant vu qu’on les portait à cette jeune fille qui demeurait chez Le fils de Promotus, il reconnut par là celle qui était destinée à l’empereur. Rufin déchu de son espérance chercha les moyens de ruiner Eutrope. Voilà l’état où étaient les affaires dans l’étendue de l’empire d’Arcadius.
Stilicon qui gouvernait l’empire en Occident, donna en mariage à
l’empereur Honorius une fille qu’il avait eue de Sérène, fille
d’Honorius, frère de Théodose. Ayant affermi son pouvoir par cette
alliance, il se rendit maître absolu de presque toutes les troupes.
Théodose étant mort après la défaite d’Eugène, Stilicon retint dans
l’armée dont il était maître tout ce qu’il y avait d’hommes
vaillants et aguerris, et renvoya en Orient toutes les personnes
inutiles et de rebut. Dès qu’il fut de retour en Italie, il médita de faire périr Rufin par le moyen que je vais dire. Il proposa à l’empereur Honorius d’envoyer quelques troupes à Arcadius, son frère, pour défendre ceux d’entre ses sujets qui étaient incommodée par les incursions des étrangers. Stilicon ayant eu la permission d’en disposer comme il le jugerait à propos, choisit les soldats qu’il voulait envoyer, et en donna le commandement à Gaina, à qui il déclara ce qu’il tramait contre Rufin. Lorsque ces troupes furent près de Constantinople, Gaina alla au devant pour avertir Arcadius de leur arrivée, et du sujet de leur marche, qui n’était autre que d’apporter du soulagement aux maux de l’empire. Arcadius ayant témoigné de la joie de ce secours, Gaina le supplia d’avoir la bonté de venir au devant, assurant que c’était un honneur que les empereurs avaient coutume de faire aux troupes. Arcadius lui ayant accordé sa prière, alla au devant de l’armée, en fut salué, et lui rendit les marques de son affection. Gaina ayant donné le signal à ses gens, ils se jetèrent sur Rufin, et le percèrent de leurs épées, celui-ci lui coupa une main, celui-là l’autre, un troisième lui coupa la tête, chantant des chansons de réjouissance comme on en chante après la victoire. Ils l’insultèrent avec tant d’outrage après sa mort, que de porter sa main par toute la ville, et de demander qu’on lui donnât un peu d’argent, chose dont il n’avait jamais pu se rassasier. Voilà le juste châtiment qu’il reçut des violences qu’il avait exercées contre les particuliers, et des malheurs qu’il avait attirée à l’état. Il ne se faisait plus rien à la cour que par l’ordre d’Eutrope, qui avait eu part à toute l’intrigue que Stilicon avait tramée contre Rufin. Il retint une partie de ses biens, et abandonna le reste à d’autres qui semblaient y avoir quelque droit. Il permit à la femme et à la fille de Rufin, qui s’étaient réfugiées dans une église de chrétiens de peur d’être massacrées comme lui, de se retirer en la ville de Jérusalem, qui a été autrefois habitée par les Juifs, et qui a été rebâtie par les Chrétiens, depuis le règne de Constantin. Elles y passèrent le reste de leur vie. Eutrope ayant dessein de se défaire de tout ce qu’il y avait de personnes considérables, pour être seul en crédit auprès de l’empereur, tendit un piège à Timasius, qui depuis le règne de Valens avait toujours été maître de la milice, et s’était rendu fort célèbre en plusieurs guerres. Voici comment il s’y conduisit. Bargus, vendeur de saucisses à Laodicée, ville de Syrie, sa patrie, ayant été surpris dans une mauvaise action, s’enfuit à Sardes, où il se fit bientôt connaître pour ce qu’il était. Timasius, étant allé à Sardes, et ayant vu que ce Bargus était plaisant, et propre à gagner par ses flatteries les bonnes grâces de tous ceux dont il approchait, le reçut dans sa familiarité, et lui donna le commandement d’une cohorte. Il le mena un peu après à Constantinople, ce qui fut désapprouvé par quelques officiers qui savaient qu’il en avait été autrefois banni pour ses crimes. Eutrope ayant jugé que ce Bargus serait fort propre pour intenter une fausse accusation contre Timasius, supposa à ce dernier un faux écrit, par lequel il paraissait qu’il avait aspiré à la souveraine puissance. L’empereur présidait, et Eutrope était présent à cause de sa charge de premier officier de la chambre de l’empereur. Chacun ayant témoigné de l’indignation de ce qu’un homme élevé à une si haute dignité que Timasius était accusé par un vendeur de saucisses, l’empereur se démit de l’affaire, et en donna la commission à Saturnin et à Procope. Le premier était un homme fort avancé en âge, qui avait passé par toutes les charges, un peu flatteur de son naturel, et qui dans toutes les causes avait coutume de favoriser ceux qui étaient en crédit auprès du prince. Le second avait été beau-père de l’empereur Valens. C’était un homme fier et intraitable, qui disait quelquefois trop librement la vérité, et qui en cette rencontre représenta vivement à Saturnin qu’on n’aurait pas dû recevoir l’accusation d’un homme aussi méprisable à Bargus, contre un magistrat aussi considérable que Timasius, ni souffrir qu’un bienfaiteur fût opprimé par la calomnie de son obligé. Mais cette liberté n’empêcha pas que l’avis de Saturnin ne fût suivi avec un applaudissement général, ni que Timasius ne fût relégué à Oasis, et n’y fût conduit par des gardes. C’est un lieu fort désagréable, et d’où il est malaisé.de se sauver; car le chemin par où l’on y va est un chemin sablonneux, désert et inhabité, et qui ne conserve aucun vestige de ceux qui y passent. Il a pourtant couru un bruit que Timasius avait été sauvé par Syagrius, son fils, et que celui-ci, après avoir fait enlever son père, avait évité de tomber entre les mains de ceux qui le cherchaient. Mais que cela soit véritable, ou ait été inventé par complaisance pour Eutrope, personne n’en a jamais rien su de certain, si ce n’est que ni Timasius ni Syagrius n’ont plus paru depuis. Bargus fut récompensé du commandement d’une cohorte, pour avoir délivré Eutrope des soupçons et des craintes que lui donnait le mérite de Timase. Il fut fort content d’avoir cette charge dont le revenu était considérable, et il se flattait de l’espérance de parvenir un jour à quelque autre plus relevée. Mais il ne songeait pas qu’Eutrope ne pouvait pas attendre qu’il eût plus de reconnaissance pour lui qu’il n’en avait eu pour Timasius. Aussitôt qu’il fut parti pour aller remplir sa charge, on conseilla à sa femme, avec qui il était en mauvaise intelligence, de présenter contre lui des mémoires à l’empereur. La nouvelle de cette accusation étant venue aux oreilles d’Eutrope, il fit arrêter Bargus qui fut convaincu et condamné. Il n’y eut personne qui n’admirât et qui ne bénit l’œil de la justice divine, à la vue duquel aucun crime ne peut échapper. Eutrope étant comme enivré par l’orgueil que donnent les richesses, et s’imaginant toucher les nues de la tète, entretenait des espions parmi toutes les nations, pour s’informer de tout ce qui s’y passait, et pour s’instruire de l’état des affaires et de la fortune des particuliers. Enfin il n’y avait rien dont il ne tirât du profit. S. jalousie et son avarice l’excitèrent à la ruine d’Abundantius. C’était un homme natif de Scythie, province de Thrace, qui avait porté les armes dès le règne de Gratien, qui avait obtenu de grandes charges de Théodose, et qui avait été désigné préteur et consul. Eutrope ayant donc résolu sa perte, obtint une lettre de l’empereur pour le reléguer à Sidon, en Phénicie, où il finit ses jours. Il n’y avait plus personne à Constantinople qui osât regarder Eutrope. Stilicon était maître des affaires en Occident. Eutrope désirant empêcher qu’il ne vint à Constantinople, conseilla à l’empereur d’assembler le sénat et de le déclarer ennemi de l’empire. Ce qui ayant été fait, il s’unit avec Gildon, comte d’Afrique, et par son moyen ôta l’Afrique à Honorius pour la donner à Arcadius. Stilicon ayant conçu autant de déplaisir que d’inquiétude de cette surprise, se servit d’un avantage que la fortune lui présenta. Gildon avait un frère nominé Masceldèle, auquel il tendait des pièges par une fureur barbare. Celui-ci s’enfuit en Italie, et raconta à Stilicon les mauvais traitements que son frère lui avait faits. Stilicon lui donna des vaisseaux et des troupes, avec lesquelles ayant attaqué son frère à l’improviste, il remporta un tel avantage que Gildon s’étrangla pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. Masceldèle remit l’Afrique sous l’obéissance d’Honorius, et retourna victorieux en Italie. Bien que Stilicon eût de la jalousie d’un si glorieux exploit de Masoeldèle, il la dissimulait. Passant néanmoins un jour un pont dans un faubourg, ses gardes, au signal qui leur avait été donné, jetèrent Maceldèle dans la rivière, où il fut noyé, et Stilicon n’en fit que rire. La haine qui était entre Stilicon et Eutrope éclata alors ouvertement, et ils commencèrent aussi à se jouer plus insolemment que jamais de la misère des peuples. Stilicon avait donné Marie, sa fille, en mariage à l’empereur Honorius, et Eutrope exerçait sur l’empereur Arcadius le pouvoir despotique que l’on exerce sur les animaux. S’il y avait un héritage considérable dans l’étendue de l’empire, il fallait qu'un de ces deux ministres en devint maître. L'or et l'argent roulaient de leurs mains de toutes parts ; et ils y coulaient principalement par le canal des calomniateurs dont ils avaient répandu un grand nombre dans toutes les parties de l'empire. Les plus considérables du sénat ne voyaient qu'avec douleur cet état si déplorable de l'empire. Gaina en était plus sensiblement touché que nul autre, tant parce qu'il se croyait privé des honneurs qui étaient dus à un chef de son âge, et des présents que son avarice recherchait, que parce qu'il avait de la jalousie de voir que tous les biens fondissent dans la maison d'Eutrope. Il communiqua ses sentiments à Tribigilde, homme intrépide et prêt à affronter les plus terribles dangers. Il commandait en Phrygie non des Romains, mais des étrangers à cheval. Il partit donc de Constantinople sous prétexte d'aller visiter ses troupes, et s'étant mis à leur tête, il fit un horrible dégât, sans épargner hommes, femmes ni enfants. Avant ramassé une quantité incroyable de goujats et d'autres gens semblables, il fit trembler toute l'Asie. L’Asie était pleine de confusion, chacun s'enfuyant vers la mer avec ses proches pour se réfugier dans les îles. Les côtes d'Asie n'avaient jamais été menacées d'un péril si présent. L'empereur étant trop stupide pour se mettre en peine d'apporter du soulagement a cette misère publique, en laissa le soin à Eutrope, qui choisit Gaina et Léon pour leur donner le commandement des troupes. Il envoya ce dernier en Asie pour donner la chasse aux Barbares qui y faisaient le dégât, et il envoya Gaina par la Thrace et par les détroits de l’Hellespont, pour repousser les ennemis s'il trouvait qu'ils fissent du désordre en ces pays-là. Léon n'avait aucune qualité qui le rendît capable de commander des troupes, et n'avait rien de recommandable que l'amitié dont Eutrope l'honorait. Ces deux généraux avant été choisis de la sorte, ils menèrent chacun leurs troupes du coté où elles étaient destinées. Gaina ayant rappelé dans sa mémoire les conditions dont il était convenu avec Tribigilde, et ayant considéré que le temps était venu d'y satisfaire, manda à Tribigilde qu'il menât ses troupes du côté de l’Hellespont. Il est certain que si ce Gaina avait dissimulé les mauvais desseins qu'il avait conçus contre le bien de l'empire, et qu'il fût parti sans bruit de Constantinople avec les étrangers qu'il commandait, il serait venu à bout de tout ce qu'il avait projeté, se serait rendu maître de l'Asie et de la meilleure partie de l'Orient. Mais parce que la fortune voulait alors maintenir quelques villes sous l'obéissance de l'empire, Gaina, transporté par la fureur qui est comme naturelle aux Barbares, partit de Constantinople avec presque toutes les forces de l'état. Avant d'arriver à Héraclée, il manda à Tribigilde ce qu'il devait faire. Tribigilde ne voulut pas aller vers l’Hellespont de peur de rencontrer les troupes qui étaient de ce côté-là; mais il fit le dégât en Phrygie, avança jusqu'en Pisidie et emporta sans aucune résistance tout ce qu'il trouva. Gaina n'eut garde de se mettre en peine d'arrêter ces violences, ni de soulager ceux qui les souffraient, parce que quand Tribigilde les commettait, il ne faisait rien que ce dont ils étaient convenus ensemble Quant à Léon il se tenait aux environs de l'Hellespont, sans oser en venir aux mains avec Tribigilde, et il disait qu'il avait peur que Tribigilde n'envoyât une partie de ses troupes par des chemins détournés pour faire le dégât sur les terres qui sont aux environs de l’Hellespont. Ainsi Tribigilde, ne trouvant point de résistance, prenait loufes les villes qu’il lui plaisait d’attaquer, et tuait les habitants et les soldats. Il n’y avait point alors d’étrangers qui combattissent pour la défense de l’empire; au contraire, dès que le combat était commencé, ils se joignaient à ceux de leur pays et se déclaraient contre les Romains. Gaina faisait semblant d’être fâché des disgrâces de l’empire, et d’admirer les stratagèmes de Tribigilde qu’il disait être plus à craindre pour sa prudence que pour ses forces. Il entra en Asie sans y rien faire, se contentant de regarder comme un spectateur oisif ce qui y avait été fait, de rire de la ruine des villes et de la campagne, d'attendre l'arrivée de Tribigilde, de lui envoyer secrètement des troupes pour favoriser ses desseins, sans cependant se déclarer pour son parti. Si, lorsque Tribigilde entra en Phrygie, il eût été droit en Lydie au lieu d’aller en Pisidie, il lui eût été aisé, non seulement de s’en rendre maître, mais aussi de l’Ionie, de passer ensuite dans les îles, de courir tout l’Orient, et de ravager l’Égypte. Mais ce dessein-là ne lui étant pas venu à l’esprit, il aima mieux mener son armée dans la Pamphylie qui touche d’un côté à la Pisidie. Il y trouva des chemins fort mauvais et presque inaccessibles à la cavalerie. Comme il ne paraissait point d’armée qui s’opposât au progrès de ses armes, un certain Valentin, qui demeurait à Selge, ville de Pamphylie, assise sur une hauteur, qui avait quelque notion des lettres et des armes, ayant amassé une troupe de paysans et de valets, accoutumés à se battre contre les voleurs qui couraient dans leur voisinage, il les plaça sur une hauteur qui commande le passage d’où ils pouvaient voir sans être vus. Lorsque Tribigilde eut passé avec ses gens les chemins unis de la Pamphylie, et qu’il fut descendu dans les endroits creux, au dessus desquels étaient les gens de Valentin, ceux-ci jetèrent avec leurs frondes des pierres aussi grosses ou même plus grosses que le poing. Tribigilde n’avait aucun moyen de se sauver, car il avait d’un côté un étang et des marais, et de l’autre un passage si étroit qu’à peine suffisait-il pour deux hommes. Les gens du pays appellent ce passage-là un limaçon, parce qu’il est d’une figure ronde et qu’il ressemble en quelque sorte à la coquille dont le limaçon se couvre. Il était gardé par Florentius avec un nombre suffisant de gens de guerre. Les Barbares perdirent beaucoup de monde dans un lieu si étroit, où ils étaient accablés par la multitude et par la grosseur des pierres qu’on jetait incessamment sur eux. Plusieurs ne sachant que faire, poussèrent leurs chevaux dans l’étang et y périrent. Tribigilde monta avec trois cents hommes par le passage étroit, et ayant gagné Florentius, par argent, il se sauva et laissa périr le reste de ses troupes. Mais après avoir évité ce danger il en trouva d’autres qui ne furent pas moins terribles, car les habitants de toutes les villes s’étant armés à la hâte, l’enfermèrent avec les trois cents compagnons de sa fuite, entre le fleuve Mélas et le fleuve Eurymédon, dont l’un coule au dessus de Sida, et l’autre arrose Aspende. Ne sachant plus que faire, il avertit secrètement Gaina de l’état de ses affaires. Celui-ci étant fâché de ce qui était arrivé, et ne s’étant pas encore déclaré pour la révolte, envoya Léon son lieutenant au secours de la Pamphylie, avec ordre de se joindre à Valentin pour s’opposer au passage de Tribigilde. Bien que Léon fût brutal de son naturel et fort adonné à la débauche, il ne laissa pas d’exécuter ses ordres. Gaina, qui appréhendait que si Tribigilde était enveloppé, et qu’il n’eût pas des forces suffisantes pour se défendre, il ne fût accablé, envoya plusieurs bandes d’étrangers qu’il avait avec lui, les unes après les autres, pour harceler l’armée romaine, et pour donner moyen à Tribigilde de s’échapper. Ces troupes étrangères attaquèrent sans cesse l’armée romaine jusqu’à ce qu’elles l’eussent défaite, tué Léon et désolé tout le pays désert. Ainsi les choses réussirent de la manière que Gaina le souhaitait; car Tribigilde s’étant enfui de Pamphylie, fit de plus grands désordres en Phrygie qu’il n’en avait jamais fait auparavant. Quant à Gaina, il releva avec des paroles si avantageuses les exploits de Tribigilde, qu’il fit appréhender à l’empereur, à la cour, et au sénat qu’il ne mit tout à feu et à sang aux environs de l’Hellespont, à moins qu’on ne lui accordât sa demande. Gaina tâchait encore alors de cacher à l’empereur ses sentiments, et de faire réussir ses desseins par le moyen des conditions que l’on accorderait à Tribigilde. Le mépris qu’on faisait de lui ne lui était pas si insupportable que l’élévation prodigieuse d’Eutrope, qui, ayant été fait consul, en avait retenu le titre longtemps, et était parvenu à la dignité de patrice. Ce fut principalement cette jalousie qui le détermina à la révolte. En ayant donc formé le dessein, il résolut de commencer par se défaire d’Eutrope. Pour cet effet, étant encore en Phrygie, il manda à l’empereur qu’il désespérait de résister à Tribigilde, et qu’il ne voyait point d’autre moyen de délivrer l’Asie de ses incursions dont elle était tourmentée que de lui accorder la demande qu’il faisait qu’on lui mit Eutrope entre les mains, comme l’unique auteur de toutes les misères publiques, pout en faire ce qu’il lui plairait. A cette nouvelle, Arcadius mande Eutrope et le prive de sa charge. Eutrope se réfugie dans une église de chrétiens qui jouissait du droit d’asile. Comme Gaina pressait avec instance la mort d’Eutrope, et qu’il protestait que Tribigilde ne s’apaiserait jamais qu’on ne lui eût donné cette satisfaction, on viola l’asile, en arrachant Eutrope de l’église, et en le reléguant en Chypre où on le fit garder exactement. Comme Gaina insistait qu’on le fit mourir, ceux qui disposaient des affaires, sous l’autorité de l’empereur, éludèrent, par une subtilité fort grossière, le serment qu’ils lui avaient fait de lui conserver la vie. Car, comme s’ils eussent seulement juré de ne la lui point ôter à Constantinople, ils le firent venir de Chypre à Calcédoine, où il fut exécuté à mort. La fortune n’a jamais agi avec tant d’extravagance qu’envers lui, en l’élevant d’un côté au plus haut comble de grandeur qu’elle ait élevé aucun eunuque, et en l’opprimant de l’autre, sous prétexte de la haine que lui portaient les ennemis de l’empire. Au reste, bien que les entreprises de Gaina fussent toutes manifestes et toutes publiques, il les croyait fort secrètes et fort cachées. Comme il surpassait Tribigilde en dignité et en puissance, et qu’il était maître de ses sentiments, il fit, sous son nom, un traité avec l’empereur, et après avoir engagé l’un et l’autre par serment, il s’en retourna par la Phrygie et par la Lydie. Tribigilde le suivit, et passa à la tête de ses troupes proche de Sardes, capitale de Lydie, sans oser seulement la regarder. Quand il eut joint Gaina à Thyatire, il se repentit de n’avoir pas pillé Sardes qu’il aurait pu prendre sans peine. Ainsi il résolut d’y retourner avec Gaina, et d’attaquer cette ville. Ils seraient venus à bout de cette résolution s’il n’était survenu une pluie extraordinaire qui détrempa la terre et grossit les rivières. Quand ils se furent séparés, Gaina alla vers la Bithynie, et Tribigilde vers l’Hellespont, chacun exposant en proie à l’avarice des soldats tout ce qui se présentait devant eux. Lorsque l’un fut à Calcédoine, et l’autre vers Lampsaque, Constantinople et l’empire même se trouvèrent réduits à la dernière extrémité. Gaina demanda que l’empereur le vint trouver, refusant de conférer avec tout autre qu’avec lui. L’empereur en étant demeuré d’accord, la conférence se fit hors de Calcédoine; dans un lieu bâti en l’honneur de la pieuse Euphémie, martyre, en considération du culte que l’on rend au Christ. Gaina et Tribigilde étant passés d’Asie en Europe, demandèrent qu’on leur livrât les premiers de l’empire pour les faire mourir, savoir: Aurélien qui était consul en cette année-là, Saturnin qui l’avait été, et Jean, dépositaire de tous les secrets d’Arcadius, et qu’on croyait être père du fils qui était attribué à ce prince. Quelque tyrannique que fût cette demande, il la fallut accorder. Lorsque Gaina eut ces trois hommes-là entre les mains, il se contenta de leur effleurer la peau avec la pointe de son épée, et de les envoyer en exil. Etant allé en Thrace, suivi de Tribigilde, il donna à l’Asie le loisir de respirer. Quand il fut à Constantinople, il en fit sortir les soldats romains et même les compagnies des gardes, et donna un ordre secret aux étrangers de l’attaquer. Il en partit après cela, sous prétexte de prendre un peu de repos et de se délasser de ses fatigues, et se retira en un lien distant de quarante stades de la ville, à dessein d’y retourner, lorsque les étrangers auraient commencé l’attaque. Il s’en serait sans doute rendu maître, si l’ardeur extraordinaire dont il était transporté lui eût permis d’attendre une occasion favorable pour l’exécution de son dessein. Mais s’étant trop hâté de s’approcher des murailles, ceux qui les gardaient crièrent au secours. Tous les habitants ayant couru aux armes, avec un tumulte et une confusion aussi étranges que si la ville eût déjà été prise, ils assommèrent les Barbares, et étant moulés au haut des murailles, ils tirèrent sur les troupes de Gaina, et les obligèrent à se retirer. La ville ayant été préservée de la sorte, sept mille étrangers qui étaient enfermés dedans se réfugièrent dans une église des chrétiens qui est proche du palais. Mais l’empereur commanda de les y tuer, ne jugeant pas que la sainteté dût servir d’asile à leur attentat. Personne n’osa néanmoins entreprendre de les retirer de ce lieu, de peur que le désespoir ne les portât à une vigoureuse défense. On trouva plus à propos de découvrir l’église, à l’endroit qui répond au dessus de l’autel, et de jeter du feu de haut en bas; ce qui ayant été fait, les Barbares furent brûlés. Ceux qui étaient les plus attachés à la religion chrétienne jugeaient que c’était une grande profanation qu’on avait faite. Gaina, ayant manqué une entreprise si importante, déclara ouvertement la guerre à l’empire, et fit le dégât en Thrace. Il trouva que les villes étaient fermées de bonnes murailles, et défendues par des garnisons, et par des habitants qui s’étaient aguerris par la nécessité que les incursions continuelles des Barbares leur avaient imposée de manier sans cesse les armes. Il n’y avait plus que de l’herbe à la campagne, les bestiaux, les grains et les fruits ayant été enfermés dans les villes. Ainsi Gaina fut obligé de quitter la Thrace pour aller dans la Chersonèse, et pour retourner en Asie par les détroits de l’Hellespont. Pendant qu’il était dans cette disposition l’empereur et le sénat choisirent d’un commun accord Fravitus pour commander les troupes qu’on destinait contre lui. Ce Fravitus était étranger de naissance, mais il était Grec d’inclination, et païen de religion et de mœurs. Il avait déjà eu de grands emplois dans les armées, et avait purgé l’Orient, depuis la Cilicie jusqu’à la Palestine, des courses des voleurs. Ayant donc pris le commandement des troupes, il se mit à garder les détroits de l’Hellespont, pour empêcher que les Barbares n’entrassent en Asie. Pendant que Gaina se préparait de son côté à la guerre, Fravitus ne tenait pas ses soldats oisifs, mais il les exerçait de telle sorte qu’ils ne respiraient plus que le combat, et qu’ils se plaignaient de ce que les ennemis tardaient. Il faisait nuit et jour la revue de son arasée, et veillait incessamment sur la contenance des ennemis; il prenait aussi soin de sa flotte, ayant plusieurs vaisseaux qu’on appelle libournes, du nom du pays où l’on a commencé à en fabriquer de cette sorte. Ils ne sont pas moins légers que les bâtiments qui ont cinquante rames, bien qu’ils le soient beaucoup moins que ceux qui ont trois rangs de rameurs; on n’en fait plus de cette fabrique. Polybe n’a pas laissé de décrire la mesure des bâtiments à six rangs de rameurs dont les Romains et les Carthaginois se servaient lorsqu’ils étaient en guerre les uns contre les autres. Au reste Gaina s’étant ouvert de force un passage par la grande muraille dans la Chersonèse, plaça ses troupes le long du rivage de Thrace qui est opposé aux villes de Pares, de Lampsaque et d’Abydos, et aux autres lieux qui, en s’approchant de la mer, la resserrent. Quant au général de l’armée romaine, quand eut passé ces places-là de l’Asie avec ses vaisseaux, il épia la contenance des ennemis. Gaina s’ennuyant de demeurer si longtemps en un lieu où il ne trouvait pas les choses nécessaires à sa subsistance, fit couper des bois dans la Chersonèse, et en ayant fait des bateaux, mit dessus les chevaux et les hommes, et laissa couler les bateaux au fil de l’eau, car on ne pouvait les conduire ni avec des rames ni avec un gouvernail, parce qu’ils étaient faits à la hâte sans aucun art. Gaina demeura sur le rivage, se promettant la victoire, et se persuadant que les Romains n’avaient point de forces comparables aux siennes. Notre général ayant découvert ce dessein-là avec sa pénétration ordinaire, fit avancer ses vaisseaux en mer, et dès qu’il vit ces bateaux que les Barbares avaient faits à la hâte qui suivaient le courant, il alla au devant du premier, et l’ayant poussé avec son vaisseau dont la proue était garnie d’airain, et ayant en même temps tiré force traits contre les hommes qui étaient dessus, il le fit couler à fond. Les capitaines des autres vaisseaux, imitant l’exemple du général, tirèrent sur ceux qui leur étaient opposés, et ceux qui ne périrent pas par leurs traits furent emportés par la mer, de sorte qu’il n’y eut presque personne qui pût échapper. Gaina, affligé de cette perte, décampa de la Chersonèse, et se retira en Thrace. Fravitus ne le voulut point poursuivre, et se contentant de l’avantage que la fortune 1w avait accordé, il rassembla ses troupes. Tout le monde l’en blâma, comme s’il eût eu dessein d’épargner ses compatriotes, mais se fiant au témoignage de sa conscience, et étant animé de la noble fierté que lui donnait sa victoire, il prit la liberté de l’attribuer en présence de l’empereur à la protection des dieux qu’il adorait, sans rougir de faire profession publique de la religion de ses pères, et de déclarer hautement qu’il ne pouvait suivre en ce point l’opinion de la multitude. L’empereur le reçut très civilement, et le fit consul. Gaina ayant ainsi perdu une grande partie de ses troupes, se retira avec le reste vers le Danube, et parce que la Thrace était ruinée par les fréquentes irruptions qu’elle avait souffertes, il enleva tout ce qu’il trouva ailleurs. Comme il appréhendait d’être poursuivi par une autre armée, et qu’il se défiait des Romains qui étaient dans la sienne, il les fit massacrer dans le temps qu’ils ne se doutaient de rien, et passa le Danube, à dessein de s’en retourner en son pays. Cependant Uldes, prince des Huns, jugeant qu’il y avait du danger à souffrir qu’un étranger s’établit avec ses troupes au-delà du Danube, et croyant que ce serait rendre un service agréable à l’empereur que de l’empêcher, se prépara à le combattre. Gaina ne pouvant retourner sur les terres de l’empire, ni éviter la rencontre des Huns, prit les armes pour les recevoir. Il y eut plusieurs combats où Gaina, après avoir perdu une grande partie de ses troupes, fut enfin tué lui-même en se défendant vaillamment. Uldes envoya sa tête à Arcadius, en reçut récompense, et contracta avec lui une alliance très étroite. L’empereur n’ayant pas assez de prudence pour rétablir un bon ordre dans l’état, une troupe d’esclaves fugitifs et de soldats déserteurs qui prirent le nom des Huns commencèrent à courir et à piller la Thrace, jusqu’à ce que Fravitus en ayant taillé en pièces la plus grande partie, procura quelque repos aux habitants [1]…………………………. Ils prirent terre en Epire, et voulant assurer leur salut que la grandeur de leur crime rendait fort douteux, ils laissèrent échapper ceux qu’ils tenaient entre leurs mains. On dit que quelques-uns se rachetèrent par argent. Mais enfin, s’étant sauvés de la sorte contre leur espérance, ils revinrent à Constantinople, et se présentèrent à l’empereur et au sénat. Cela contribua beaucoup à accroître la haine que l’impératrice portait depuis longtemps à Jean, évêque des chrétiens, qui déclamait contre elle dans les discours qu’il faisait au peuple. Cette princesse, exerçant un pouvoir absolu, souleva contre lui les autres évêques, et les perla à le déposer, et entre autres Théophile, évêque d’Alexandrie en Egypte, qui s’était le premier déclaré contre l’ancienne religion. Jean ayant été appelé en jugement, et ayant reconnu qu’on ne procédait pas envers lui avec équité, se retira volontairement de Constantinople. Le peuple, que cet homme tournait comme il lui plaisait, remplit la ville de tumulte, et les moines s’emparèrent de la grande église. Ce sont des hommes qui renoncent au mariage, qui remplissent les villes et les campagnes de communautés nombreuses, qui ne portent point les armes et qui ne rendent aucun service à l’état. S’étant toujours multipliés depuis leur premier établissement, ils ont acquis de grandes terres, sous prétexte de nourrir les pauvres, et ont en effet réduit tout le monde à la pauvreté. S’étant donc emparé de l’église, et en ayant gardé l’entrée, le peuple et les gens de guerre demandèrent la permission de réprimer leur insolence, et l’ayant obtenue, ils fondirent sur eux et en tuèrent un si grand nombre que l’église fut remplie de corps morts. Ils poursuivirent ensuite les autres, et n’épargnèrent aucun de ceux qui étaient vêtus de noir, soit qu’ils portassent le deuil, ou qu’ils eussent pris cet habit pour quelque autre raison. Jean étant venu dans la ville, y suscita de grands troubles. Les dénonciateurs se mirent alors en plus grand crédit que jamais. Ils étaient incessamment à la suite des eunuques de la cour, et dès qu’il était mort un homme riche, ils donnaient avis qu’il n’avait point laissé d’enfants, ni de parents proches; et à l’heure même on faisait paraître des lettres par lesquelles l’empereur se saisissait de sa succession. Les sénateurs enlevaient son bien en présence des enfants et des autres héritiers légitimes, dont les plaintes n’étaient point écoutées. Il n’y avait dans toutes les villes que des sujets de tristesse et de douleur. Le prince n’ayant point d’esprit, et la princesse étant enflée d’un orgueil insupportable, et se laissant conduire par des eunuques et femmes dont rien ne pouvait rassasier l’avidité, les plus gens de bien s’ennuyaient de vivre, et souhaitaient de mourir. Il survint encore un autre péril plus fâcheux, comme si les maux que je viens de décrire n’eussent pas suffi pour nous accabler. Jean étant revenu de son exil, et ayant continué à soulever le peuple contre l’impératrice, quand il vit qu’il fallait nécessairement qu’il quittât son siège et la ville, il monta sur un vaisseau. Ceux qui favorisaient son parti prirent résolution de mettre le feu à la ville, pour empêcher qu’on n’eût un autre évêque en sa place. Ils mirent le feu à l’église durant la nuit, et en étant sortis avant le jour, on vit paraître l’embrasement sans savoir d’où il procédait. Il consuma l’église, les maisons voisines, et surtout celles du côté desquelles le vent soufflait. Il gagna aussi le lieu où le sénat avait coutume de s’assembler vis-à-vis du palais, qui était embelli d’une infinité d’ornements, de statues des meilleurs artistes, et de marbres de diverses couleurs dont on ne tire plus de semblables des carrières. On dit aussi qu’on y voyait les images des muses qui avaient été autrefois sur l’Hélicon, et qui ayant été conservées au temps de Constantin, auquel on faisait la guerre aux choses saintes, avaient été mises dans ce lieu-là. Le dégât que le feu en fit fut un présage de l’ignorance où le peuple allait tomber. Il arriva dans le même temps un miracle qu’il ne serait pas juste d’oublier. Devant la porte du lieu où je viens de dire que s’assemblait le sénat, il y avait des images de Jupiter et de Minerve sur des bases de pierre telles que nous les voyons aujourd’hui. On dit qu’une de ces images est celle de Jupiter, de Dodone, et que l’autre est celle de Minerve de Linde. Le feu ayant embrasé ce palais, le plomb de la couverture tomba fondu sur ces images, avec une partie des pierres qui n’avaient pu résister à l’activité du feu. Le peuple croyait que ces images avaient été réduites en cendres, aussi bien que les plus excellents ornements de ce superbe édifice. Mais quand on eut ôté toutes les ruines, et qu’on eut nettoyé le lieu pour le rebâtir, on trouva les images qui étaient seules demeurées entières au milieu de l’embrasement, ce qui fit concevoir aux plus honnêtes gens et aux plus habiles d’heureuses espérances de la prospérité d’une ville dont les Dieux prenaient si visiblement la protection. Il en arrivera néanmoins ce qu’il leur plaira. Comme chacun était extraordinairement affligé du malheur de la ville, dont on ne voyait point d’autre sujet que l’ombre d’un âne, selon le proverbe, ceux qui avaient l’honneur d’approcher du prince songeaient aux moyens de rebâtir les maisons qui avaient été brûlées. Mais en même temps ils apprirent que les Isauriens, qui habitent au dessus de la Pamphylie et de la Cnide, dans les endroits les plus inaccessibles du mont Taurus, s’étaient divisés en plusieurs bandes, et avaient commencé le dégât dans le pays qui est au dessous. Ils n’étaient pas assez forts pour assiéger des villes fermées de murailles ; mais ils attaquaient les bourgs et enlevaient ce qui se présentait devant eux. Les ravages que Tribigilde avait faits dans ce pays avec les étrangers le rendaient plus exposé aux courses et aux violences des Isauriens dont je parle. Arbazace ayant été envoyé pour secourir la Pamphylie autant qu’il lui serait possible, poursuivit ces brigands jusque dans leurs montagnes, prit de leurs bourgs, tua un grand nombre de leurs gens, et les aurait entièrement défaits et procuré une pleine liberté aux villes, s’il n’avait trop aimé son plaisir, et préféré son intérêt particulier au bien commun de l’état. Ayant été mandé pour rendre compte de cette trahison, il s’attendait qu’on lui ferait son procès. Mais il se tira d’affaire en donnant à l’impératrice une partie de ce qu’il avait pris sur les Isauriens, et employa le reste à ses débauches. Ces peuples-là n’avalent jusque ici commis que des brigandages, sans avoir osé en venir à une guerre ouverte. Quand Alaric se fut retiré du Péloponnèse et du pays que le fleuve Archéloüs arrose, il attendit dans l’Epire où habitent les Molosses, les Thesprotes et d’autres peuples, le temps d’exécuter ce dont il était convenu avec Stilicon. Celui-ci, ayant reconnu la haine dont ceux qui gouvernaient l’empire sous le nom d’Arcadius étaient animés contre lui, résolut de mettre l’Illyrie sous la domination d’Honorius par le moyen d’Alaric, et n’était plus en peine que de trouver une occasion favorable pour l’exécution de ce dessein. Pendant qu’ils étaient dans cette disposition, Rodogaise se prépara à entrer en Italie, à la tête d’une armée composée de quatre cent mille hommes, tant Gaulois que Germains. Toute l’Italie étant étonnée d’un si épouvantable armement, et Rome même tremblant à la vue d’un si extrême péril, Stilicon ramassa les troupes qui étaient dans Pavie, ville de Ligurie, divisées en trente compagnies, outre un renfort qu’il obtint des Alains et des Huns, ses alliés, passa le premier le Danube, fondit sur les ennemis, et les tailla en pièces, à la réserve d’un petit nombre qu’il enrôla parmi ses troupes. Ayant, par un exploit si célèbre, délivré l’Italie du danger dont elle était menacée, il s’en retourna comme en triomphe et couronné par la main de ses soldats. Quand il fut à Ravenne, ville ancienne et métropole de Flaminie, bâtie autrefois par les Thessaliens, et appelée Rhéné, non pour avoir été fondée par Rémus, frère de Romains, comme Olympiodore de Thèbes le dit après Quadratus, qui l’avait écrit dans l’histoire de l’empereur Marcus, mais parce qu’elle est tout entourée d’eau, il commença à se préparer à passer en Illyrie avec ses troupes pour soustraire avec Alaric cette province à l’obéissance d’Arcadius, et pour la mettre sous celle d’Honorius. Mais il trouva deux obstacles à ce dessein. L’un fut le bruit de la mort d’Alaric, et l’autre une lettre d’Honorius, par laquelle il mandait que Constantin était parti de la Grande-Bretagne, et était entré dans les pays qui sont au-delà des Alpes, où il avait commencé à usurper l’autorité souveraine. Le bruit de la mort d’Alaric demeura douteux jusqu’à ce que quelques personnes arrivèrent qui en confirmèrent la fausseté. Mais la nouvelle de la proclamation de Constantin fut toujours constante. Le voyage d’Illyrie ayant été rompu de la sorte, Stilicon alla à Rome pour y délibérer sur ce qu’il y avait à dire. Sur la fin de l’automne, Bassus et Philippe y furent désignés consuls. L’empereur Honorius ayant perdu l’impératrice Marie, sa femme, souhaitait d’épouser, Thermantie, sa sœur. Stilicon s’opposait à ce mariage, et Sérène le pressait par une raison particulière. Lorsque l’empereur Honorius épousa Marie, Sérène sa mère, voyant qu’elle n’était pas encore en âge de puberté, et voyant que la marier en cet âge-là c’était faire un injure à la nature, ne pouvant d’ailleurs différer la célébration, s’adressa à une femme capable de trouver des expédients en semblables occasions, et fit en sorte par son moyen que sa fille fût mariée à l’empereur, mais qu’il ne pût ni ne voulût consommer le mariage. Marie étant morte sans être devenue femme, Sérène, qui souhaitait avec passion de conserver son rang et son autorité, sollicitait puissamment ce mariage. Elle en vint à bout: mais Thermantie mourut bientôt après, et mourut fille aussi bien que sa sœur. Stilicon reçut nouvelle qu’Alaric était parti de l’Epire, et qu’ayant passé les détroits qui séparent la Pannonie de la Vénétie, il s’était campé à Emone, ville assise entre la Haute-Pannonie et la Noricie. Je n’oublierai pas en cet endroit l’histoire de la fondation de cette ville. On dit que lorsque les Argonautes furent poursuivis par Aétès, ils arrivèrent à l’embouchure du Danube, et qu’ayant taché de monter à force de rames et à la faveux du vent contre le courant de ce fleuve, quand ils furent arrivés à ce lien-là, ils y bâtirent la ville, pour servir de monument de leur arrivée dans le pays; qu’ayant mis leur vaisseau nommé Argo sur une machine, et que l’ayant tiré jusqu’à la mer l’espace de quatre cents stades, ils abordèrent aux rivages de Thessalie. Voilà ce que le poète Pisandre en a écrit dans le poème des Noces héroïques. Alaric étant parti d’Emone, et ayant passé le fleuve Acilis et monté l’Apennin, il entra dans la Noricie. Cette montagne sert de frontière à la Pannonie, et n’a qu’un passage fort étroit pour aller dans la Noricie, lequel une poignée d’hommes peuvent aisément garder contre une grande multitude. Alaric l’ayant néanmoins surmonté, envoya de la Noricie des ambassadeurs à Stilicon, pour lui demander de l’argent en récompense, tant de ce qu’il était demeuré dans l’Epire à sa persuasion, que de ce qu’il avait fait le voyage de la Noricie et d’Italie. Stilicon ayant laissé les ambassadeurs à Ravenne, alla à Rome pour conférer avec l’empereur et avec le sénat. Les sénateurs s’étant assemblés dans le palais, on délibéra si l’on ferait la guerre ou non. La pluralité des avis fut de la faire. Stilicon et quelques autres qui ne parlaient que par complaisance pour lui, furent d’avis de faire la paix avec Alaric. Ceux qui étaient d’avis de la guerre demandèrent à Stilicon pourquoi il voulait faire une paix honteuse. Il répondit que c’était parce qu’Alaric était demeuré longtemps dans l’Epire, pour l’intérêt de l’empereur, afin de faire la guerre conjointement avec lui en Orient et de soumettre l’Illyrie à l’obéissance d’Honorius, ce qui aurait été exécuté si la lettre de ce prince ne les eût empêchés d’entreprendre l’expédition. Il montra la lettre d’Honorius pour confirmer ce qu’il disait, et ajouta que Sérène, sous prétexte d’entretenir la bonne intelligence entre les deux empereurs, avait été cause qu’un si louable projet n’avait pu réussir. Les raisons de Stilicon ayant été approuvées, le sénat fut d’avis de payer à Alaric quatre mille livres d’or pour avoir la paix avec lui, bien que plusieurs opinassent de la sorte par crainte plutôt que par persuasion. Lampadius, aussi illustre par sa dignité que par sa naissance, dit en sa langue: « Ce n’est pas là une paix, c’est un pacte par lequel on se soumet à la servitude. » Mais dès que l’assemblée se fut levée, il se réfugia dans une église de chrétiens qui était proche, de peur que la liberté dont il avait usé ne lui fût funeste. Stilicon ayant conclu de la sorte la paix avec Alaric, se prépara à partir pour mettre à exécution les desseins qu’il avait dans l’esprit. L’empereur témoigna vouloir aller à Ravenne, pour voir l’armée et pour la haranguer, bien qu’en cela il suivit moins son inclination que le conseil de Sérène, qui était bien aise qu’il fût en sûreté, au cas qu’Alaric se rendit maître de Rome, et qui veillait avec d’autant plus de soin à la conservation de ce prince, qu’elle était persuadée que la sienne propre en dépendait. Stilicon, qui n’approuvait point du tout ce voyage, fit ce qu’il put pour le traverser; mais l’empereur s’étant opiniâtré à le faire, Sarus, étranger qui commandait dans Ravenne une compagnie composée de soldats de sa nation, excita par l’ordre de Stilicon un tumulte hors de la ville, non pour troubler les affaires, mais pour détourner l’empereur d’y entrer. Comme l’empereur persistait dans son sentiment, Justinien, célèbre avocat de Rome, et qui avait été fait assesseur par Stilicon, pénétra par la subtilité de son esprit le motif de ce voyage, et jugea que les soldats qui étaient à Pavie, et qui n’aimaient point Stilicon, ne manqueraient pas de le mettre en grand danger, le prince y arrivant, et ne cessa de lui conseiller de faire tout œ qu’il pourrait pour détourner l’empereur de cette entreprise. Mais ayant reconnu que l’empereur ne se rendait point aux raisons de Stilicon, il se retira de peur d’être enveloppé dans sa ruine, à cause de l’amitié dont il était uni avec lui. La nouvelle de la mort de l’empereur Arcadius avait déjà été apportée à Rome; mais comme elle semblait encore incertaine, elle fut confirmée depuis le départ d’Honorius. Stilicon étant à Ravenne, l’empereur, qui était à Bologne, ville d’Emilie, distante de soixante dix mille de cette ville, manda Stilicon pour réprimer l’insolence des soldats qui avaient fait une sédition durant le voyage. Stilicon ayant assemblé l’armée, dit non seulement que l’empereur leur commandait de se tenir en repos, mais qu’il voulait qu’ils fussent décimés Ces menaces les étonnèrent si fort, qu’ils le conjurèrent avec larmes d’implorer pour eux la clémence de l’empereur, ce qu’il leur promit de faire; et il le fit en effet de telle aorte qua l’empereur leur pardonne. Stilicon avait dessein d’aller en Orient pour mettre ordre aux affaires de Théodore, fils d’Arcadius, qui, dans la faiblesse de son âge, avait besoin de la conduite d’un tuteur. L’empereur avait aussi dessein d’y aller pour le même sujet; mais Stilicon, n’en étant point d’avis, l’on détourna sous prétexte d’éviter les frais d’un si long voyage. Il lui représenta aussi qu’il n’y avait point d’apparence qu’il abandonnâtt Rome et l’Italie dans le temps que Constantin s’armait à Arles, après avoir couru et subjugué toutes les Gaules; que bien que cette affaire-là pût demander toute seule la présence et les soins de l’empereur, l’arrivée d’Alaric le demandait aussi, ce perfide qui ne manquerait jamais d’envahir l’Italie avec les étrangers qu’il commandait, s’il la trouvait dépourvue de troupes; que le meilleur conseil et le plus utile à l’état était d’envoyer Alaric contre l’usurpateur, avec partie des troupes étrangères et avec les troupes romaines commandées par leurs chefs, et que pour lui il irait porter en Orient les ordres de l’empereur. Honorius ayant enfin approuvé cet avis, fit expédier des lettres qu’il écrivait à l’empereur d’Orient et à Alaric, et partit de Bologne, cette résolution ayant été prise, Stilicon ne se mit en aucun devoir de l’exécuter. Il ne partit point pour l’Orient, il n’envoya pas même à Ravenne une partie des gens de guerre qui étaient à Pavie, de peur qu’ils ne vissent l’empereur en passant, et qu’ils ne l’aigrissent contre lui. Il faut pourtant avouer que ce n’était par aucune mauvaise intention, ni contre le prince, ni contre l’armée, que Stilicon agissait de la sorte.
Olympius, natif des environs du Pont-Euxin, qui avait une charge
considérable à la cour, qui cachait un grand fond de méchanceté sous
l’apparence de la piété d’un chrétien, et qui, en contrefaisant
l’homme de bien, était entré dans h familiarité particulière de
l’empereur, lui tint plusieurs discours capables de lui donner de
dangereuses impressions contre Stilicon, et de lui faire croire
qu’il n’avait tramé ce voyage d’Orient que pour se défaire du jeune
Théodose, et pour élever Eucherius, son fils, sur le trône. Voilà ce
qu’il lui disait, selon l’occasion, durant le voyage. Pendant qu’il roulait ces pensées dans son esprit, et qu’il était dans l’irrésolution, les étrangers se pressèrent d’exécuter la résolution qui avait été prise. Mais n’en ayant pu venir à bout, ils demeurèrent en repos jusqu’à ce que l’empereur eût déclaré plus ouvertement son sentiment touchant Stilicon. Sarus, qui surpassait les autres chefs des troupes alliées en force de corps et en dignité, s’étant mis à la tête de ceux qu’il commandait, tua pendant la nuit dans leurs lits les Huns qui gardaient Stilicon, pilla son bagage, se rendit maître de sa tente, et attendit ce qui arriverait. Stilicon ne se tenant pas trop assuré de la fidélité des étrangers qui étaient auprès de lui, parce qu’ils n’étaient pas d’accord entre eux-mêmes, se retira à Ravenne, et défendit de les recevoir dans les villes par où il passa, et où étaient leurs femmes et enfants. Olympius, qui s’était rendu maître de l’esprit de l’empereur, envoya une lettre de ce prince aux soldats de Ravenne, par laquelle il leur était commandé de se saisir de Stilicon, et de le garder sans lui mettre les fers. Stilicon ayant eu avis de cet ordre, se retira la nuit dans une église de chrétiens. Ses domestiques et les gens qui étaient auprès de lui prirent les armes, et attendirent l’événement de cette affaire. A la pointe du jour, les soldats entrèrent dans l’église, et jurèrent en présence de l’évêque qu’ils n’avaient point ordre de tuer Stilicon, mais seulement de le garder. Quand il fut sorti de l’église, sur la foi de ce serment, et qu’il fut entre les mains des soldats, celui qui avait apporté la première lettre en présenta une seconde, par laquelle il était condamné à la mort, pour les crimes qu’il avait commis contre l’état. Il fut mené à l’heure même au supplice, et Euchérius, son fils, s’enfuit vers Rome. Ses domestiques, ses amis et les étrangers attachés à son service, se mirent en devoir de le sauver; mais il les en empêcha avec menaces, et se laissa tuer. Il fut sans doute le plus modéré de tous ceux qui, de son temps, parvinrent à une grande puissance. Bien qu’il eût épousé la nièce du vieux Théodose, qu’il eût eu la tutelle de ses deux fils, et qu’il eût commandé vingt-trois ans les armées, il ne vendit jamais aucune charge, et ne détourna jamais les fonds destinés au paiement des gens de guerre, pour l’appliquer à son profit particulier. N’ayant qu’un fils, il ne l’éleva pas à une plus haute dignité qu’à celle de tribun des notaires. Or, de peur que les curieux n’ignorent le temps de sa mort, je dirai qu’elle arriva le vingt-troisième jour du mois d’août, sous le consulat de Bassus et de Philippe, sous lequel mourut aussi l’empereur Arcadius. Après sa mort, Olympius disposa avec un pouvoir absolu de toutes choses. Il prit la charge de maître, et fit conférer les autres par l’empereur à ceux qu’il eut agréable de lui nommer. On fit une recherche exacte des amis et des partisans de Stilicon. On se saisit entre autres de Deutère, un des premiers officiers de la chambre, et de Pierre, tribun des notaires, et on les mit à la question. Mais quand on vit qu’ils ne confessaient rien ni contre Stilicon, ni contre eux-mêmes, Olympius commanda de les frapper de coups de bâton jusqu’à la mort. Plusieurs autres ayant été arrêtés et mis à la question pour apprendre de leur bouche si Stilicon avait aspiré à l’empire, on se désista enfin de cette poursuite quand on vit qu’elle était inutile, et qu’elle ne produisait aucune lumière. L’empereur Honorius réduisit Thermantie, sa femme, à une condition privée, et la rendit à sa mère, sans qu’elle fût chargée pour cela d’aucun soupçon. Il commanda aussi de chercher Eucher, fils de Stilicon, et de le faire mourir. Mais ceux qui le cherchaient l’ayant trouvé dans une église de Rome, n’osèrent toucher à sa personne par respect pour la sainteté du lieu. Héliocrate, comte des largesses, porta à Rome une lettre de l’empereur, par laquelle il était ordonné que les biens de ceux qui avaient exercé quelque charge au temps de Stilicon seraient confisqués. Et comme si tant de maux n’eussent pas suffi pour contenter la rage du mauvais génie qui tourmentait les hommes durant l’absence ou durant le silence des dieux, il en survint encore un autre. Les soldats qui étaient en garnison dans les villes, ayant appris la mort de Stilicon, se jetèrent en même temps sur les femmes et sur les en fans des étrangers; les massacrèrent, et pillèrent leurs biens. Les parents de ceux qui avaient été tués s’étant assemblés et ayant pris Dieu à témoin de l’impiété et de la perfidie des Romains, se joignirent à Alaric dans le dessein d’attaquer Rome. Bien qu’ils fussent plus de trente mille qui l’excitaient à la guerre, il était toujours disposé à entretenir la paix par respect pour le traité qu’il avait fait du vivant de Stilicon. Il envoya des ambassadeurs à cet effet, et demanda en otage Aetius et Jason, dont l’un était fils de Jovius, et l’autre de Gaudence. Il offrit de son côté de donner des otages parmi les plus qualifiés de son parti, et de mener son armée de Norique en Pannonie. L’empereur rejeta ces conditions. Il est certain que pour bien pourvoir à ses affaires il devait faire de deux choses l’une, ou renvoyer la guerre à un autre temps et obtenir une trêve à l’aide d’un peu d’argent, ou, s’il voulait faire la guerre, ramasser toutes ses troupes et fermer les passages. De plus, il devait investir Sarus des fonctions de général, parce que c’était un homme qui, par son expérience et par sa valeur, était capable de jeter la terreur dans le cœur de ses ennemis, et qui, d’ailleurs, avait un assez bon nombre de troupes étrangères pour leur résister. Mais Honorius, en refusant la paix, en méprisant l’amitié de Sarus, en négligeant d’amasser ses troupes, en mettant toute son espérance dans les projets et dans les vœux d’Olympius, attira tous les malheurs dont l’empire fut accablé. Il choisit des généraux qui ne pouvaient exciter que le mépris des ennemis. Il donna le commandement de la cavalerie à Turpillion, celui de l’infanterie à Varanus, et celui des ailes des domestiques à Vigilantius, ce qui fit désespérer à plusieurs du salut de l’Italie, dont ils croyaient voir déjà la ruine de leurs propres yeux. Alaric, se moquant des préparatifs d’Honorius, commença à attaquer Rome, et de peur de faire une entreprise aussi importante que celle-là sans pourvoir auparavant aux moyens de l’exécuter, il rappela de la haute Pannonie Ataulphe, son beau-frère, avec les Huns et les Goths qu’il commandait. Mais sans attendre qu’il fût arrivé, il courut aux environs d’Aquilée et des autres villes qui sont au-delà du Pô, comme Concordia, Altine, Crémone, et ayant passé ce fleuve en se jouant comme dans une fête et sans rencontrer d’ennemis, il alla à un fort près Boulogne, nommé Oecubaria. Il traversa ensuite l’Emilie, alla à Rimini, ville de la Flaminie, et passa jusques au Picentin, pays situé à l’extrémité du golfe ionique. Marchant après cela vers Rome, il pilla toutes les villes et tous les châteaux qu’il trouva sur son passage; et si les eunuques Arsace et Térentius n’eussent prévenu son arrivée par la fuite, il les eût pris et eût sauvé Eucher, fils de Stilicon, qu’ils avaient entre les mains. Mais ayant exécuté les ordres qu’ils avaient reçus de rendre Thermantie à sa mère et de mener Eucher à Rome, pour le faire mourir, et ne pouvant s’en retourner par le chemin par où ils étaient venus, ils montèrent sur mer et se rendirent près de l’empereur, vers les Gaules. Ce prince, croyant que l’intérêt de l’état demandait qu’il les récompensât du service qu’ils lui avaient rendu, donna à Térentius la charge de premier officier de sa chambre, et à Arsace la première dignité au-dessous. Ayant condamné à la mort Batanaire, commandant des troupes d’Afrique, beau-frère de Stilicon, il donna sa charge à Héraclien, qui avait tué Stilicon de sa propre main. Alaric ayant formé le siège de Rome, le sénat soupçonna Séréna d’avoir fait venir les troupes étrangères, et fut d’avis, avec Placidie, sœur utérine de l’empereur, de la faire mettre à mort, dans la croyance qu’Alaric lèverait le siège lorsqu’il ne pourrait plus espérer de prendre la ville par son intelligence. Ce soupçon-là était cependant très faux, et Séréna n’avait jamais pensé à la trahison qu’on lui imputait. Mais elle devait porter la peine de l’impiété qu’elle avait autrefois commise. Lorsque Théodose l’ancien était allé à Rome après avoir détruit la tyrannie d’Eugène, et qu’il avait exposé le culte des dieux au mépris des hommes, en refusant de faire la dépense des sacrifices, les prêtres et les prêtresses avaient été chassés hors des temples. Alors Séréna, se raillant des choses saintes, était entrée dans le temple de la mère des dieux, et ayant vu qu’elle avait un fort beau collier, l’avait pris et l’avait attaché à son cou. La plus ancienne des vestales, qui était demeurée, ayant eu le courage de lui reprocher en face son impiété, elle se moqua d’elle et la fit chasser par ceux de sa suite. La vestale fit des imprécations en descendant, et souhaita que la peine due à ses sacrilèges retombât sur elle, sur son mari et sur ses enfants. Séréna ne fit que rire de ces menaces, et sortit du temple avec le collier. Il lui sembla plusieurs fois depuis, soit en veillant ou en dormant, qu’on la menaçait de mort. Plusieurs auf.res personnes eurent aussi de semblables visions. Mais enfin la justice divine la poursuivit de telle sorte qu’elle ne put éviter le châtiment, bien qu’elle en fût avertie, et elle fut étranglée par la même partie de son corps qu’elle avait parée du collier de la déesse. On dit que Stilicon fut puni d’une pareille impiété. Ayant un jour commandé d’arracher des lames d’or qui étaient aux portes du Capitole, ceux qui exécutaient cet ordre y trouvèrent ces paroles écrites : « Elles sont réservées pour un misérable prince. » Ce qui fut accompli, puisqu’il mourut misérablement. Au reste, la mort de Séréna ne détourna pas Alaric du siège de Rome. Au contraire, quand il eut entouré les murailles et qu’il se fut rendu maître du Tibre et du port, il empêcha l’entrée des vivres. Les Romains attendaient de jour en jour du secours de Ravenne. Mais ce secours n’étant point arrivé, ils furent obligés de ménager leurs vivres et de ne cuire chaque jour que la moitié d’autant de pain qu’ils en cuisaient auparavant, et ensuite de n’en cuire que le tiers. Lorsque les provisions furent consommées, la peste succéda à la famine. Comme on ne pouvait emporter les corps morts hors de la ville, parce que les ennemis en tenaient les portes fermées, il fallut les enterrer dedans, et la puanteur qu’ils exhalaient aurait été capable de faire périr les habitants quand ils ne seraient pas morts de faim. Il est vrai pourtant que Léta, femme de l’empereur Gratien, et Pissamène, sa mère, qui, par la libéralité de Théodose, tiraient pour leur table une grande somme de l’épargne, eurent la bonté de fournir des vivres à plusieurs personnes. Mais lorsque la disette fut si extrême que les habitants étaient presque réduits à se manger les uns les autres, après avoir essayé auparavant de se nourrir de choses qu’on ne peut toucher qu’avec horreur ils résolurent d’envoyer une ambassade à Alaric pour lui demander la paix à des conditions raisonnables ou pour protester qu’ils étaient prêts plus que jamais à le combattre, et que s’étant accoutumés depuis le siège à manier les armes, ils seraient en état de se faire redouter. On choisit pour cette ambassade Basilius, gouverneur de province, originaire d’Espagne, et Jean, le premier des notaires, qu’on appelle tribuns, ami particulier d’Alaric. On doutait encore alors si c’était lui ou un autre qui assiégeait Rome, et le bruit courait que c’était un autre officier du parti de Stilicon qui l’avait amené devant la ville. Quand ils furent arrivés devant lui, ils eurent honte que les Romains eussent ignoré si longtemps un fait de cette importance, et lui proposèrent le sujet de leur ambassade de la part du sénat. Alaric ayant écouté leurs discours et surtout leur assertion que le peuple, ayant les armes en main, était prêt à lui livrer bataille, répondit qu’il était plus aisé de couper le foin quand il est épais que quand il est rare, et il se prit à éclater de rire. Quand ils furent entrés en conférence sur la paix, il leur tint des discours pleins d’une arrogance digne d’un Barbare, protestant qu’il ne lèverait point le siège qu’on ne lui eût donné tout l’or et tout l’argent qui étaient dans la ville, et tous les meubles et les esclaves étrangers qu’il y trouverait. Un des ambassadeurs lui ayant demandé ce qu’il laisserait aux habitants s’il leur ôtait toutes ces choses: « Je leur laisserai la vie, » lui répondit-il. Après cette réponse, ils demandèrent permission d’aller conférer avec ceux qui les avaient envoyés, et l’ayant obtenue ils leur rapportèrent ce qui avait été avancé de part et d’autre. Alors les habitants ne doutant plus que ce ne fût Alaric qui les assiégeait, et se voyant destitués de tous les moyens de se conserver, se ressouvinrent du secours que leurs pères avaient autrefois reçu durant les troubles, et dont ils avaient été privés depuis qu’ils avaient renoncé à l’ancienne religion. Sur ces entrefaites Pompeianus, préfet de la ville, rencontra quelques personnes venues de Toscane qui lui dirent que la ville de Neveia s’était délivrée d’un pareil péril par des sacrifiées et qu’ayant attiré du ciel les éclairs et le tonnerre elle avait chassé ses ennemis. Après avoir parlé avec elles il observa les cérémonies prescrites par les livres des pontifes; et parce que la religion contraire avait déjà prévalu, il crut, pour plus grande sûreté, devoir communiquer l’affaire à l’évêque Innocent, avant de rien entreprendre. L’évêque préférant la conservation de la ville à sa propre opinion, leur permit secrètement d’observer leurs cérémonies de la manière qu’ils les entendaient. Ces personnes venues de Toscane ayant déclaré qu’on ne pouvait rien faire qui servît à la délivrance de la ville qu’en offrant des sacrifices scion l’ancienne coutume, le sénat monta au Capitole, et y observa aussi bien que dans les places et dans les marchés les cérémonies accoutumées. Mais personne du peuple n’ayant osé y assister, on renvoya les Toscans, et on chercha les moyens d’apaiser la colère du Barbare. On lui envoya donc une seconde ambassade, où après de longues conférences on convint enfin que la ville paierait cinq mille livres d’or, trente mille d’argent, et qu’elle donnerait quatre mille tuniques de soie, trois mille toisons teintes en écarlate, et trois mille livres de poivre. Mais parce qu’il n’y avait point alors d’argent dans le trésor public, il fallut nécessairement que les sénateurs contribuassent à proportion de leur bien. Palladus fut choisi pour régler cette contribution. Mais soit qu’ils eussent caché une partie de leurs biens, ou que les exactions avides et continues des empereurs les eussent réduits à la pauvreté, il ne put amasser la somme entière. Pour comble de malheur, le mauvais génie qui présidait aux affaires de ce siècle porta ceux qui étaient chargés de lever cette somme à prendre les ornements des temples et des images des dieux pour la compléter. Ce qui n’était rien autre chose que de jeter dans le déshonneur et dans le mépris les images dont le culte avait rendu Rome florissante pendant tant de siècles. De peur que quelque chose ne manquât à la ruine de l’empire, on fondit aussi quelques images d’or et d’argent, et entre autres celle de la Vertu, ce qui fit juger à ceux qui étaient savants dans les mystères de l’ancienne religion que ce qui restait de vertu et de force parmi les Romains serait bientôt tout-à-fait éteint. L’argent qu’on avait promis ayant été amassé de la sorte, on envoya dire à l’empereur qu’Alaric, non content de cela, demandait encore en otage les enfants des meilleures familles, moyennant quoi il promettait non seulement d'entretenir la paix avec les Romains, mais aussi de se joindre à eux pour faire la guerre à leurs ennemis. L'Empereur ayant consenti à ces conditions, on donna l'argent à Alaric qui permit aux habitants de sortir durant trois jours pour acheter des vivres, et pour faire mener des grains du port à la ville. Ainsi ils eurent un peu de loisir de respirer. Les uns vendirent ce qui leur restait pour acheter ce qui leur était nécessaire. Les autres, au lieu de vendre pour acheter, eurent par échange ce dont ils avaient besoin. Après cela les Barbares se retirèrent de devant Rome, et se campèrent en Toscane. Il sortit de Rome en divers jours une si prodigieuse quantité d'esclaves qui s'allèrent joindre à eux qu'on ne croit pas qu'il y en eût moins de quarante mille. Quelques Barbares, courant de côté et d'autre, attaquèrent des Romains qui venaient d'acheter des vivres au port. Ce qu'Alaric ayant appris, il eut soin de faire punir les auteurs de celte violence, à laquelle il ne voulait prendre aucune part. Il semblait qu'on commençât à sentir quelque relâche en ce temps-là, auquel Honorius était consul pour la huitième fois en Occident et Théodose pour la troisième en Orient. Constantin envoya alors des eunuques à Honorius pour s'excuser d'avoir accepté l'empire, en assurant que ce n'était pas de lui-même qu'il s'y était porté, mais qu'il y avait été contraint violemment par les soldats. L'empereur ayant considéré qu'il ne lui serait pas aisé de faire une nouvelle guerre dans le temps que les étrangers qu'Alaric commandait n'étaient pas fort éloignés, et ayant d'ailleurs fait réflexion que Véronien et Didime ses parents étaient entre les mains de cet usurpateur de l'autorité souveraine, lui accorda sa demande, et lui envoya une robe impériale. Mais c'était en vain qu'il prenait ce soin-là de ses parents, car ils avaient déjà été massacrés.
La paix
n'étant pas tout-à-fait conclue avec Alaric parce que l'empereur ne
lui avait point donné d'otages, ni satisfait aux autres conditions
qui avaient été stipulées, le sénat envoya Cecilianus, Attalus, et
Maximianus en ambassade à Ravenne pour se plaindre des mauvais
traitements que les Romains avaient soufferts et de la perte d'un si
grand nombre de leurs citoyens qui étaient morts durant le siège.
Mais Olympius intrigua contre eux de telle qu'ils ne purent réussir.
Ces ambassadeurs avant donc été renvoyés sans qu'ils eussent rien
obtenu, l'empereur ôta le gouvernement de Rome à Théodore pour le
donner à Cecilianus, chargea Attalus du soin des finances. Les affaires de Rome étant en aussi mauvais état que jamais, l'empereur trouva à propos de tirer six mille soldats de Dalmatie pour leur confier la garde de Rome. C'étaient les plus vaillants hommes qu'il y eût dans l'armée. Ils étaient commandés par Valens. Celui-ci toujours disposé à affronter les plus terribles dangers, crut indigne de lui de prendre les chemins qui étaient libres, attendait leur passage, et les fit tous tailler en pièces à la réserve de cent ou environ qui se sauvèrent avec lui; car ayant rencontré Attalus qui avait été envoyé par le sénat vers l'empereur, il se joignit à lui, et se sauva. Quand Attalus fut arrivé à Rome, où les maux, bien loin de diminuer, croissaient de jour en jour, il délivra Héliocrate de la charge que l'empereur lui avait donnée par l'avis d’Olympius, de porter à l'épargne les biens des proscrits. Comme c'était un homme modéré, il crut que c'était une impiété d'insulter à des misérables, et il leur permettait de détourner ce qu'ils pouvaient. Il fut mené à Ravenne pour y être puni de sa douceur, et la dureté du siècle l'y eût fait sans doute mettre à mort s'il ne se fût réfugié dans une église de chrétiens. Maximilianus étant tombé entre les mains des ennemis, Marinianus, son père, le racheta pour trente mille pièces d'or. Car comme l'empereur différait de conclure la paix, et de satisfaire aux conditions, il n’y avait plus de sûreté à sortir de Rome. Le sénat envoya à l’empereur des ambassadeurs, touchant la paix, parmi lesquels était l’évêque de Rome, et quelques personnes choisies par Alaric pour les garantir des violences des gens de guerre qui étaient sur les chemins. L’empereur, ayant appris durant le voyage de ces ambassadeurs, qu’Ataulphe traversait avec peu de troupes, par l’ordre d’Alaric, l’endroit des Alpes qui sépare la Pannonie de la Vénétie, dépêcha contre eux toute la cavalerie et toute l’infanterie qui était en garnison dans les villes, et Olympius avec trois cents Huns. Ceux-ci ayant rencontré les ennemis, ………………………[2] Ils en tuèrent onze cents, et retournèrent à Ravenne sans avoir perdu que dix-sept hommes. Les eunuques de la cour ayant accusé Olympius devant l’empereur des malheurs qui étaient arrivés à l’empire, le firent priver de sa charge. Comme il appréhendait de recevoir de plus mauvais traitements, il s’enfuit en Dalmatie. L’empereur envoya Attalus à Rome pour en être gouverneur; et parce qu’il avait peur qu’on ne détournât quelque chose de ce qui appartenait au trésor, il envoi a Démétrius pour exercer la charge qu’Attalus avait remplie auparavant. Il fit divers changements d’officiers, et surtout donna à Généride le commandement de toutes les troupes qui étaient en garnison dans la haute Pannonie, dans les deux Noriques, dans la Rétie et jusqu’aux Alpes.
Bien
que ce Généride fût un étranger, il ne laissait pas d’être un modèle
accompli de vertu, et d’être tout-à-fait supérieur à l’avarice. Il
était demeuré étroitement attaché à la religion de ses pères.
Lorsqu’on publia une loi par laquelle il était défendu à ceux qui
n’étaient pas chrétiens de porter la ceinture, il mit bas la sienne,
et demeura dans sa maison. L’empereur lui ayant depuis commandé de
venir au palais en son rang avec les autres officiers, il répondit
qu’il y avait une loi qui lui défendait de se tenir au rang des
officiers et de porter la ceinture. L’empereur lui ayant répondu que
la loi était faite pour les autres, et non pour lui qui s’était
exposé à tant de hasards pour le bien de l’état, il persista à
refuser un honneur qu’il ne pouvait accepter sans faire injure aux
autres, jusqu’à ce que l’empereur, pressé par la honte et par la
nécessité, abolit entièrement la loi, et permit d’exercer les
charges à ceux qui ne voulaient point changer de religion. Les soldats, s’étant révoltés à Ravenne, s’emparèrent du port, et crièrent en désordre qu’ils suppliaient l’empereur de les venir trouver. Mais ce prince s’étant caché par l’appréhension du péril, Jove, préfet du prétoire et patrice, parut en sa place, et faisant semblant d’ignorer d’où procédait la sédition, bien qu’on l’accusât d’en être l’auteur avec Ellebique, général de la cavalerie du palais, il leur demanda pour quel sujet ils se soulevaient de la sorte. Les soldats ayant répondu qu’il fallait qu’on leur livrât les capitaines Turpillion et Vigilantius, Térentius, officier de la chambre, et Arsace, l’empereur, qui appréhendait les suites de la sédition, condamna les deux capitaines au bannissement. Ils furent mis à l’heure même sur un vaisseau, et tués par ceux qui les emmenaient, en exécution d’un ordre secret que Jove avait donné, par la crainte qu’ils ne reconnussent le piège qu’il leur avait tendu, et qu’ils n’aigrissent l’empereur contre lui. Quant à Térentius, il fut relégué en Orient, et Arsace à Milan. L’empereur donna la charge de Térentius à Eusèbe, celle de Turpillion à Valence, et celle de Vigilantius à Ellebique. La sédition ayant été apaisée de la sorte, love, préfet du prétoire, qui avait pris en main toute l’autorité, envoya une ambassade à Alaric pour le prier de venir conférer avec lui près de Ravenne touchant la paix. Alaric s’étant rendu à cet effet à Rimini qui n’est qu’à trente milles de Ravenne, Jove s’y rendit en diligence comme son ancien ami. Alaric demanda une somme d’argent chaque année, une certaine quantité de vivres, et la liberté d’habiter la Vénétie, les deux Noriques et la Dalmatie. Jove fit écrire ces conditions en présence d’Alaric, et les envoya à l’empereur avec une lettre qu’il lui écrivit en particulier et par laquelle il lui proposait de créer Alaric maître de l’une et de l’autre milice, afin qu’étant un peu adouci par cette gratification, il se relâchât des conditions qu’il prétendait. L’empereur, ayant lu la lettre de Jove, blâma sa témérité, et lui fit réponse que c’était à lui qui était préfet du prétoire, et qui avait connaissance des revenus de l’empire, de régler la quantité de la pension et des vivres qu’Alaric demandait, mais que quant à lui il n’accorderait point de charge à Alaric ni à aucun de sa nation. Jove ouvrit la lettre et la lut en présence d’Alaric, qui, ne pouvant modérer sa colère, commanda à ses troupes de marcher vers Rome pour venger l’injure faite à sa nation et à sa personne par le refus des charges et des emplois. Jove, étonné de cette réponse, retourna à Ravenne, et pour s’excuser auprès de l’empereur, il lui fit jurer qu’il ne ferait point la paix avec Alaric, le jura lui-même en touchant la tête d’Honorius, et les autres commandants le jurèrent de la nième sorte. L’empereur manda mille Huns à son secours, leur fit apporter des vivres de Dalmatie, amassa des troupes de toutes parts, et fit observer la marche d’Alaric. Celui-ci, fâché d’être contraint d’attaquer Rome, envoya des évêques à Honorius pour le supplier de ne pas permettre qu’une ville qui avait commandé mille ans à une grande partie de l’univers fût ruinée par les armes des étrangers, et que tant de superbes édifices fussent réduits en cendre: qu’il fit plutôt la paix à des conditions raisonnables, attendu qu’il ne demandait plus ni les dignités, ni les provinces qu’il avait demandées par le passé, mais seulement les deux Noriques assises le long du Danube, d’où à cause des autres Barbares l’on ne tirait pas grand tribut; que pour les vivres, il remettait à sa prudence de lui en fournir par an telle quantité qu’il jugerait à propos; qu’il se désistait de la demande qu’il avait faite d’une pension, et qu’il offrait de conclure une ligue par laquelle il s’obligerait à porter les armes contre tous les ennemis de l’empire.
Tout le
monde ayant admiré la modération d’Alaric, Jove et ceux qui avaient
le plus de crédit auprès de l’empereur répondirent qu’on ne pouvait
accorder ces conditions à cause du serment par lequel ou s’était
obligé à ne point traiter avec lui; que si le serment avait été fait
au nom de Dieu, on pourrait espérer qu’il pardonnât le parjure, mais
qu’ayant été fait par la tête de l’empereur. Il n’était pas permis
de le violer. Voilà quelle était la précaution de ces gens
abandonnés du ciel, qui avaient alors entre les mains l’autorité du
gouvernement. |
|