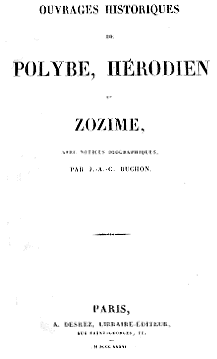|
|
ZOZIME HISTOIRE ROMAINE Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LIVRE QUATRIÈME.introduction - livre I - livre II - livre III - livre V J’ai représenté dans le livre précédent tout ce qui est arrivé jusqu’à la mort de Jovien, après laquelle Valentinien fut choisi pour gouverner l’empire. Ce dernier étant tombé malade en chemin, et sa maladie ayant augmenté la disposition qu’il avait à la colère et à la cruauté, il s’imagina faussement que les amis de Julien l’avaient empoisonné. Quelques personnes de qualité furent accusées, et les accusations furent examinées avec beaucoup de prudence et beaucoup d’adresse par Saluste, qui était encore alors préfet de prétoire. Sa maladie lui ayant donné un peu de relâche, il partit de Nicée pour se rendre à Constantinople. Quand il y fut arrivé, les plus intimes de ses amis et les principaux officier, de l’armée le supplièrent d’avoir la bonté d’associer quelqu’un à l’empire, de peur que s’il survenait quelque changement inopiné, ils ne tombassent en des malheurs semblables à ceux qu’ils avaient éprouvés après la mort de Julien. Il leur accorda leur prière, et après une mûre délibération, il choisit Valens, son frère, dans la croyance qu’il lui serait plus fidèle qu’aucun autre, et l’associa à l’empire. Lorsqu’ils furent arrivés tous deux à Constantinople, quelques-uns, qui cherchaient l’occasion de perdre les amis de Julien, ne cessèrent de publier qu’ils tramaient une conspiration, et de pousser le peuple à les accuser du même crime. Ces faux bruits augmentèrent la haine que les empereurs avaient déjà conçue contre les amis de Julien, et les portèrent à les mettre en justice sans aucune apparence de raison. Valentinien était dans une extrême colère contre le philosophe Maxime, en haine de ce que, sous le règne de Julien, il l’avait accusé d’avoir blessé l’honneur des dieux en faveur de la religion chrétienne. Mais le soin qu’ils furent obligés de prendre alors des villes et des arisées les détourna du dessein de se venger. Ils s’appliquèrent principalement à choisir des officiers auxquels ils pussent confier le gouvernement des provinces et la garde du palais. Presque tous les gouverneurs et les officiers qui avaient été établis par Julien furent déposés, et entre autres Saluste, préfet du prétoire. Il n’y eut qu’Arinthée et Victor qui furent assez heureux pour être conservés dans leurs charges. Là principales dignités furent obtenues par ceux qui les recherchèrent avec plus d’empressement et avec plus d’ambition que les autres. On observa néanmoins la justice en ce qu’on punit sur le champ tous ceux contre lesquels on trouva qu’il y avait des plaintes raisonnables. Après cela Valentinien jugea à propos de partager l’empire avec son frère, et lui ayant assigné l’Orient, l’Egypte, la Bithynie, et la Thrace, il prit pour lui l’Illyrie, l’Italie, les pays qui sont au-delà des Alpes, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Afrique. Ce partage ayant été fait de la sorte, Valentinien s’appliqua sérieusement à bien gouverner, à établir de bons magistrats, à lever exactement les impositions publiques, et à les employer aux nécessités des gens de guerre. Voulant faire des lois, il commença par défendre à sacrifier durant la nuit, prétendant arrêter par là le cours des impiétés qui se commettaient. Mais Prétextat, proconsul de Grèce, homme recommandable par toutes sortes de vertus, déclara hautement que si cette loi avait lieu, elle rendrait la vie insupportable à tous les païens. C’est pourquoi l’empereur s’en désista, et permit de célébrer les saints mystères selon l’ancienne coutume. Les Barbares qui habitent au-delà du Rhin, et qui s’étaient tenus trop heureux de vivre en repos sous le règne de Julien, par l’appréhension qu’ils avaient de sa puissance, se soulevèrent aussitôt qu’ils surent sa mort, et prirent les armes. Comme Valentinien avait quelque expérience de la guerre, il ne manqua pas de préparer à l’heure même sa cavalerie, son infanterie et ses troupes années à la légère, et de veiller à la défense des places qui sont sur le Rhin. Mais Valens ayant été élevé tout d’un coup sur le trône, après avoir toujours mené une vie éloignée du bruit, et se sentant trop faible pour soutenir le poids de l’empire, ne savait comment se démêler des affaires. Les Perses enflés du traité avantageux qu’ils avaient fait avec Jovien, et par lequel ils étaient demeurés maîtres de Nisibe, firent des courses qui l’obligèrent de quitter Constantinople. Dans le temps qu’il en partait, Procope se souleva. Julien lui avait confié, comme à son parent, la conduite d’une partie de ses troupes, et lui avait commandé de marcher avec Sébastien par l’Adiabène, et de le venir joindre par un autre chemin que celui qu’il avait pris, afin de fondre conjointement sur l’ennemi. Il lui avait aussi accordé la robe impériale par un motif fort secret. La face des affaires ayant été changée par l’ordre du ciel, et Jovien ayant été élevé sur le trône, Procope lui vint rapporter cette robe impériale, lui découvrit le motif par lequel elle lui avait été donnée, et le supplia de lui permettre de vivre en repos, sans ce mêler d’autre chose que de cultiver ses terres et de gouverner sa famille. Ayant obtenu cette permission, il se retira avec sa femme et ses enfants à Césarée, ville de Cappadoce, où il possédait de grands biens. Quand Valentinien et Valens eurent été proclamés empereur, ils envoyèrent des gens de guerre pour s’assurer de lui, comme d’un homme qui leur était suspect depuis longtemps. Il se mit entre leurs mains pour aller où il leur plairait, et leur demanda seulement la grâce de pouvoir parler à sa femme, et de dire adieu à ses enfants. Quand ils la lui eurent accordée, il leur fit apprêter un festin, et lorsqu’ils furent pleins de vin, il s’enfuit vers le Pont-Euxin où il monta sur un vaisseau, et se sauva dans la Chersonèse Taurique. Il demeura là quelque tempe; mais après avoir reconnu que les habitants étaient des perfides, il appréhenda qu’ils ne le livrassent à ses ennemis. Il se mit donc avec sa famille sur un vaisseau marchand, et arriva de nuit à Constantinople, et logea chez un de ses anciens amis, considéra l’état où était la vile depuis le départ de l’empereur, et résolut d’usurper la souveraine puissance. Quand il eut pris cette résolution, voici le moyen qu’il trouva de l’exécuter. Il y avait un eunuque nommé Eugène, qui ayant été chassé depuis peu de la cour, était mal intentionné envers les empereurs. Procope ayant contracté liaison avec lui, et ayant reconnu qu’il avait du bien, lui déclara son dessein. Eugène promit de le seconder et de fournir pour cela de l’argent quand il serait nécessaire. La première chose qu’ils firent, fut de corrompre par argent deux compagnies qui étaient en garnison dans la ville. Ils donnèrent outre cela des amies à des esclaves, et amassèrent sans grande peine force peuple, plusieurs s’offrant d’eux-mêmes, et ayant fait entrer leurs troupes dans la ville durant la nuit, ils surprirent fort tout le monde, chacun étant étonné, en sortant de sa maison, de voir Procope devenu tout d’un coup empereur, comme ceux qui le deviennent sur les théâtres. La surprise avait rendu la confusion si étrange, que personne n’était capable de prendre aucun conseil. Procope crut que, pour faire réussir son entreprise, il fallait qu’elle demeurât encore quelque temps cachée. C’est pourquoi s’étant saisi de Césure, gouverneur de la ville, et de Nébridius, préfet du prétoire, il les garda séparément, de peur qu’ils ne communiquassent ensemble, et les obligea d’écrire aux provinces ce qu’il voulut. Après cela, il se rendit en palais dans un magnifique équipage, monta sur te trône, remplit tout le monde de promesses et d’espérance. Comme il n’y avait pas longtemps que les troupes avaient été partagées entre les deux empereurs, et qu’elles marchaient encore pour se rendre aux quartiers qui leur avaient été assignés, il tâcha de les attirer par argent à son parti, ce qui ne lui fut point difficile. Ayant donc formé un corps d’araire, il le donna à Marcel, avec ordre d’aller attaquer Sérénien et la cavalerie qu’il commandait. Cette cavalerie s’étant retirée à Cyzique, Marcel l’y assiège par mer et par terre, et réduisit la ville, prit Sérénien en Lydie, où il s’était enfui, et le fit mourir. Après un si heureux commencement, Procope se vit bientôt fortifié d’un si grand nombre de gens de guerre, tant Romains qu’étrangers, qui se rangeaient à l’envi sous ses enseignes, qu’il fut en état de combattre ici deux empereurs. D’ailleurs, l’avantage qu’il avait d’être parent de Julien, et la réputation qu’il avait autrefois acquise dans ses armées, fortifièrent extrêmement son parti. De plus il députa des personnes fort considérables au prince qui commande les Scythes au-delà du Danube, de qui il reçut en secours de dix mille hommes, outre force étrangers qui s’offrirent d’eux-mêmes à lui. Comme il ne jugeait pas à propos d’attaquer en même temps les deux empereurs, il se contenta de combattre le plus proche, se réservant de prendre ensuite une autre résolution. Valens apprit en Galatie ce soulèvement et en fut aussi épouvanté qu'on le puisse être. Mais Arbition l'ayant un peu rassuré, il assembla ses troupes, et manda à Valentinien, son frère, l'entreprise de Procope. Mais celui-ci se mit d'autant moins en peine de l'assister qu'il le méprisait pour n'avoir pu conserver la portion de l'empire qu'il lui avait confiée. Valens donna donc la conduite de cette guerre à Arbition. Celui-ci voyant que les deux armées étaient comme prêtes à en venir aux mains, eut l'adresse de débaucher quantité de soldats de Procope et de découvrir ses desseins par leur moyen. Les deux armées s'étant rencontrées vers Thyatire, peu s'en fallut que celle de Procope ne remportât la victoire, et ne lui assurât la possession de l'autorité souveraine, Hormisdas, Perse, fils d'Hormisdas, ayant eu quelque avantage. Mais Gomaire, qui commandait une autre partie des troupes de Procope, et qui favorisait secrètement le parti de Valens, le proclama empereur et obligea les soldats à se déclarer pour lui. Ce prince, après la victoire, étant allé à Sardes, et de là en Phrygie, et ayant trouvé Procope dans la ville de Nacolie, et Haplon, capitaine du parti de Procope, l'ayant trahi, il remporta la victoire, prit son ennemi, et peu après Marcel, et les fit tous deux mourir. Ayant trouvé chez Marcel une robe impériale que Procope lui avait donnée, il fit une recherche exacte de ceux qui avaient appuyé le parti de l'usurpateur de l'autorité souveraine, et de ceux qui en ayant eu connaissance ne l'avaient point découvert. Il les traita tous avec la dernière rigueur sans aucune formalité de justice, sacrifiant à sa colère les innocents aussi bien que les coupables, et les punissant en haine de l'amitié ou de l'alliance dont ils avaient été unis avec son ennemi. Pendant que la portion de l'empire que Valens possédait était dans cet état, Valentinien courait un extrême péril au-delà des Alpes. Les Germains ne furent pas sitôt délivrés par la mort de Julien de la crainte de sa puissance, que se souvenant des mauvais traitements qu'ils avaient soufferts pendant qu'il était césar, ils reprirent leur fierté ordinaire, et recommencèrent à ravager les terres de l'empire. Valentinien s'étant présenté pour réprimer leur insolence, il y eut un combat fort rude qui fut terminé par la fuite des Romains. L'empereur demeura ferme au milieu du danger, et supporta constamment cette disgrâce. Ayant depuis recherché les auteurs de cette déroule, il trouva que les Bataves en étaient coupables; et ayant assemblé l'armée comme pour leur faire des propositions avantageuses au bien de l'état, il prononça un discours fort grave, par lequel il couvrit d'une confusion éternelle ceux qui avaient les premiers lâché le pied, et à la fin il commanda aux Bataves de mettre bas les armes, pour être vendus comme des esclaves à ceux qui voudraient en acheter. A cette parole toute l'armée se prosterna contre terre, le suppliant de leur épargner cette infamie, et lui promettant que les Bataves se porteraient avec tant de cœur en la première rencontre, qu'il les reconnaîtrait dignes de la grandeur du nom romain. Valentinien leur ayant commandé d'exécuter leur promesse ils se levèrent, prirent leurs armes, sortirent hors du camp, firent passer au fil de l'épée un si grand nombre de Barbares, que fort peu s'en retournèrent en leurs pays. Telle fut la fin de ta guerre de Germanie. Valens s'étant défait d'un grand nombre de personnes depuis la mort de Procope, et ayant confisqué le bien d'un autre nombre encore plus grand, fut détourné par une irruption soudaine des Scythes de continuer l'entreprise qu'il avait commencée contre les Perses. Ayant envoyé contre eux des troupes assez nombreuses, non seulement il arrêta leurs progrès, mais aussi il les obligea de rendre les armes, et les ayant dispersés dans les villes qu'il avait sur le Danube, il les y fit garder sans leur faire mettre les fers. C'étaient ceux-là même que le prince des Scythes avait envoyés au secours de Procope. Les ayant fait redemander à Valens par ses ambassadeurs, et lui ayant fait remontrer qu'il n'avait pu les refuser à celui qui était alors en possession de la souveraine puissance, ce prince ne fit point d'autre réponse, sinon qu’il ne les avait jamais demandés, qu’ils n’étaient pas venus pour son service, et qu’ils avaient été pris en combattant contre lui. Ce différent fut cause de la guerre contre les Scythes. Valens sachant qu’ils avaient dessein de faire irruption sur ces terres, et qu’ils s’assemblaient en diligence pour cet effet, commanda dans Marcianopole, ville célèbre de Thrace où il était, de ranger son armée sur le bord du Danube, et eut soin qu’il ne lui manquât rien, et qu’elle fit continuellement exercice. Il donna à Auxone la charge de préfet du prétoire que Salluste, qui en avait été pourvu une seconde fois, ne pouvait plus exercer à cause de son grand âge. Quelque pressante que fût la nécessité de cette guerre, Auxone leva les impositions avec une parfaite équité, sans permettre que personne souffrit la moindre injustice. Il fit conduire quantité de provisions par le Pont-Euxin jusqu’aux embouchures du Danube, et de là dans les villes, pour les distribuer aux gens de guerre lorsqu’ils en auraient besoin. Au commencement du printemps, l’empereur partit de Marcianopole, et ayant passé le Danube à la tête de son armée, il attaqua les Barbares. Au lieu de combattre de pied ferme, ils se cachèrent dans les forêts et dans les marais, d’où ils firent des irruptions. L’empereur ayant amassé tous les goujats et tous ceux qui gardaient le bagage, leur promit une somme d’argent pour la tête de chaque Scythe qu’ils auraient tué. A l’heure même ils entrèrent tous dans les bois et dans les marais par l’espérance du gain, et ayant tué un grand nombre de Barbares, ils en apportèrent les têtes, et en reçurent le prix. Ceux qui restèrent demandèrent la paix; et elle leur fut accordée à des conditions honorables à l’empire, et sous la promesse qu’ils ne passeraient plus le Danube, et que les Romains retiendraient tout ce qui leur avait autrefois appartenu. La paix ayant été conclue de la sorte, l’empereur revint à Constantinople, où il donna à Modeste la charge de préfet du prétoire vacante par la mort d’Auxone, et se prépara à la guerre contre les Perses. Valentinien ayant heureusement terminé dans le même temps la guerre contre les Germains, crut devoir pourvoir à la sûreté des Gaules. Ayant donc assemblé un grand nombre de jeunes gens, tant parmi les étrangers qui habitent sur le bord du Rhin que parmi les paysans ses sujets, il les enrôla, et leur fit si bien apprendre les manœuvres, que l’appréhension de leur valeur retint de telle sorte les Barbares, qu’en neuf ans ils ne firent aucune irruption sur nos terres. Dans le même temps, un certain Valentinien, qui avait été relégué dans la Grande-Bretagne pour quelques crimes, aspira à la tyrannie, et fut privé de ses prétentions et de la vie. Valentinien fut attaqué d’une maladie dont peu s’en fallut qu’il ne mourût. Quand il fut guéri, il associa à l’empire, à la prière de grands de sa cour, Gratien, son fils, jeune homme sans expérience. Pendant que les affaires étaient en cet état dans l’Occident, Valens se préparait toujours à la guerre contre les Perses. Mais comme il n’avançait que lentement, il eut le loisir de pourvoir aux besoins de plusieurs villes qui lui envoyèrent leurs députés, et de leur accorder les demandes qu’il trouva justes. Il passa l’hiver à Antioche, alla à Hiérapole au commencement du printemps, et retour de l’hiver suivant à Antioche, où il trouva des affaires toutes nouvelles. Il y avait parmi ses secrétaires un jeune homme nommé Théodore, issu d’une famille fort noble, assez bien élevé, mais qui dans la chaleur de sa jeunesse prêtait trop indiscrètement l’oreille aux discours de certains flatteurs. Ces gens-là lui ayant persuadé qu’ils avaient connaissance de l’avenir, il leur demanda qui régnerait après Valens. Ces imposteurs ayant consulté leur trépied, et y ayant vu un W, un E, un O et un D, l’assurèrent que ces lettres marquaient son nom, et qu’il parviendrait à l’empire. Étant donc flatté de ces folles espérances, et consultant perpétuellement des devins, il fut déféré à l’empereur et puni comme il le méritait. Cette affaire fut suivie d’une autre. Fortunatien, intendant des finances, condamna à la question un de ses officiers accusé de manie. Celui-ci ayant découvert quelques-uns de ses complices, parmi lesquels il y avait des justiciables de Modeste, préfet du prétoire, ce magistrat prit connaissance de l’affaire, et instruisit généralement contre tous les accusés. L’empereur en entra dans une si furieuse colère, qu’il conçut d’injustes soupçons contre ceux qui faisaient profession des sciences et des belles-lettres, et contre les premiers de sa cour, comme s’ils eussent conspiré contre lui. On n’entendait partout que des gémissements et des plaintes. Les prisons étaient remplies de personnes innocentes. Il y avait plus de monde qui fuyait la persécution, qu’il n’en restait dans les villes. Les soldats qui conduisaient les prisonniers avouaient qu’ils étaient en trop petit nombre pour les garder. Les dénonciateurs n’étaient point punis des accusations calomnieuses, et après avoir été convaincus d’avoir voulu opprimer l’innocence, ils avaient la liberté de se retirer. Les accusés étaient condamnés sans preuve à perdre la vie ou les biens, et à laisser leurs femmes et leurs enfants dans la dernière misère. Enfin on ne travaillait qu’à remplir l’épargne par toute sorte de crimes. Entre les philosophes célèbres, Maxime fut le premier mis à mort. Hilaire de Phrygie le fut ensuite, pour avoir expliqué trop clairement un oracle. Puis Simonide, Patrice de Libye, et Andronique de Carie, qui étaient tous trois fort habiles, et qui ne furent condamnés que par l’envie qu’on portait à leur mérite et à leur vertu. La confusion était si générale et si horrible, que les dénonciateurs entraient dans les maisons à la tête d’une troupe de gens perdus, et mettaient ceux qu’il leur plaisait entre les mains des exécuteurs, pour les faire mourir sans connaissance de cause. Festus, que l’empereur avait envoyé en Asie en qualité de proconsul, et à qui il n’avait donné cet emploi qu’en considération de sa cruauté, afin qu’il n’épargnât aucun homme remarquable par son savoir, mit, pour ainsi dire, le comble à la misère publique. Ce détestable consul réussit selon son intention. Car ce furieux magistrat ayant fait une exacte recherche des savants, les fit mourir sans aucune formalité de justice, à la réserve de ceux qui, pour sauver leur vie, abandonnèrent leurs maisons. Voilà un fidèle récit des malheurs que l’indiscrétion de Théodore attira sur les villes. Valentinien ayant fait la guerre en Germanie avec quelque succès, en devint plus fâcheux à ses sujets, les surchargeant d’impôts, qu’il levait avec une dureté inouïe, sous prétexte que l’épargne était épuisée par les dépenses qu’il avait fallu faire pour entretenir les gens de guerre. Sa cruauté s’accrut de telle sorte, à mesure que s’accrut la haine publique qu’il avait excitée par ces violences, que bien loin de vouloir prendre connaissance des injustices que les magistrats faisaient par avarice, il avait une maligne jalousie contre ceux qui s’acquittaient de leurs charges avec une intégrité exemplaire. Enfin il parut tout autre qu’il n’avait été au commencement de son règne. Les Africains ne pouvant plus souffrir les exactions que Romain, maître de la milice, faisait en leur pays, revêtirent Firmus de la robe impériale, et le proclamèrent empereur. Dès que Valentinien en eut appris la nouvelle, il fit passer en Afrique les troupes de Pannonie et de Moesie. Elles ne furent pas si tôt parties, que les Sarmates et les Quades qui étaient irrités depuis longtemps contre Célestins, de ce qu’ayant trompé leur prince par de faux serments, il l’avait tué en sortant de table, coururent et pillèrent les bords du Danube. La Pannonie fut ainsi comme exposée en proie, et autant incommodée par les soldats qui la devaient garder, que par les étrangers. La Moesie fut conservée par la valeur de Théodose, par laquelle il parvint depuis à l’empire, comme nous le verrons dans la suite. Valentinien ne pouvant souffrir l’insolence des Sarmates et des Quades, partit des Gaules, et alla en Illyrie, à dessein de leur faire la guerre. Il donna le commandement de son armée à Mérobaude, qui semblait surpasser tous les autres en expérience. Les Quades lui ayant envoyé une ambassade fort insolente, il en conçut une si furieuse colère, que le sang lui étant sorti par la bouche en abondance, et lui ayant ôté la parole, il mourut, en la douzième année de son règne, et le neuvième mois de son entrée en Illyrie. Après sa mort, le tonnerre tomba à Sirmium et y brûla le palais et le marché, ce qui fut pris par les habiles interprètes de ces sortes de détartres pour un malheureux présage. Il y eut dans le même temps des tremblements de terre qui ébranlèrent l’île de Crète, le Péloponnèse, la Grèce, et qui renversèrent quantité de villes, excepté Athènes et le pays attique, qui furent préservés par la raison que je vais dire. Le pontife Nestorius fut averti en songe de rendre des honneurs publics à Achille, et que ce culte serait le salut de la ville. Ayant communiqué ce songe aux magistrats, ils s’en moquèrent comme de la vision d’un vieillard, de qui le grand âge avait affaibli l’esprit. Nestorius ayant songé seul au moyen de suivre l’avis qu’il avait reçu, et ayant obéi à l’inspiration des dieux, façonna une image d’Achille de petite dimension et la mit sous la statue de Minerve placée dans l’appartement des vierges. Toutes les fois donc qu’il sacrifia à cette déesse, il sacrifia aussi à ce héros, par la protection duquel la ville d’Athènes et le pays attique furent préservés des tremblements de terre. La vérité de ce récit est confirmée par l’hymne que le philosophe Syrianus a composée en l’honneur d’Achille. J’ai bien voulu faire cette digression, dans la pensée qu’elle n’était pas éloignée de mon sujet. Après la mort de Valentinien, Mérobaude et Équitius, chefs de L’armée, considérant que Valens et Gratien étaient fort éloignés, l’un étant en Orient, et l’autre à l’extrémité des Gaules, où il avait été laissé par son père, et appréhendant que les Barbares qui habitent au-delà du Danube ne fissent des irruptions en l’absence des légitimes souverains, amenèrent au camp Valentinien le jeune, que l’empereur avait eu de sa seconde femme, auparavant veuve de Magnence, le revêtirent de la robe impériale et le conduisirent au palais, bien qu’il n’eût que cinq ans. Ils partagèrent l’empire entre Gratien et le jeune Valentinien, qui d’eux-mêmes n’étaient encore capables d’aucunes affaires, et donnèrent au premier les Gaules, l’Espagne et la Grande-Bretagne, et à l’autre l’Italie, l’Illyrie et l’Afrique. Valens était entouré de guerres de toutes parts. Les Isauriens, qu’on appelle tantôt Pisides, tantôt Solymes, tantôt Ciliciens montagnards, et dont nous parlerons plus amplement en son lieu, incommodaient extrêmement les villes de Lycie et de Pamphylie, et bien qu’ils ne pussent forcer les murailles, ils en ravageaient le territoire et les dépendances. L’empereur qui était encore alors à Antioche, ayant envoyé des troupes capables, à son avis, de les repousser, ils se retirèrent en diligence sur les montagnes les plus escarpées, sans que nos soldats eussent ni le courage de les poursuivre, ni aucun moyen de soulager les villes qu’ils avaient pillées. Dans le même temps, une nation qui avait été inconnue jusqu’alors parut tout d’un coup, et attaqua les Scythes qui habitent au-delà du Danube. On les appelait Huns, soit qu’il faille les nommer Scythes Basilides, ou bien que ce soient ceux qu’Hérodote dit habiter le long du Danube, et être camus et peu vaillants; soit qu’ils aient passé d’Asie en Europe, car j’ai trouvé écrit dans quelques histoires que le Bosphore Cimmérien ayant été comme changé en terre par la quantité du limon que le Tanaïs traîne après lui, il leur donna un passage. Enfin, de quelque sorte que la chose soit arrivée, il est constant qu’ils partirent avec leurs chevaux, leurs femmes, leurs enfants et leur équipage, et qu’ils attaquèrent les Scythes qui habitent au delà du Danube. Ils ne savaient point combattre de pied ferme; car comment l’auraient-ils su, puisqu’à peine savaient-ils marcher, et qu’ils étaient tellement accoutumés à passer les jours et les nuits sur leurs chevaux, qu’ils y demeuraient durant leur sommeil. Faisant donc, tantôt des incursions et tantôt des retraites, et tirant incessamment, ils tuèrent une si prodigieuse quantité de Scythes, que ceux qui restèrent furent obligés de leur abandonner leurs maisons et de s’enfuir au bord du Danube, en tendant les mains et en suppliant l’empereur de les recevoir au nombre de ses alliés. Les gouverneurs des places ayant différé de leur faire réponse, jusqu’à ce qu’ils eussent appris son intention, il manda de les recevoir, après qu’on les aurait désarmés. Les officiers, au lieu de suivre cet ordre, ne firent rien autre chose que de choisir les plus belle femmes, et les enfants les mieux faits pour s’en servir dans leurs débauches, ou des hommes propres à les servir dans leurs maisons ou à labourer la terre. Les autres, ayant passé secrètement la rivière avec leurs armes, oublièrent à l’heure même leurs prières et leurs promesses, et se mirent à courir la Thrace, la Pannonie, la Macédoine et la Thessalie. L’empereur Valens était occupé contre les Perses, lorsqu’il reçut cette fâcheuse nouvelle. Il partit incontinent d’Antioche pour se rendre à Constantinople, et pour aller de là en Thrace combattre ces Scythes fugitifs et infidèles. Comme l’armée commençait à marcher, elle rencontra un prodige: c’était un corps immobile couché le long du chemin, qui paraissait brisé de coups, depuis la tête jusqu’aux pieds, mais qui avait les yeux ouverts, et qui regardait ceux qui s’approchaient de lui. Plusieurs lui ayant demandé qui il était, et qui l’avait traité de la sorte, il ne répondit rien, ce qui leur ayant semblé fort étrange, ils le montrèrent à l’empereur qui lui fit les mêmes demandes, sans pouvoir tirer de réponse. On ne pouvait croire, ni qu’il eût un reste de vie, parce qu’il était sans mouvement, ni qu’il fût mort, parce qu’il avait l’usage des yeux. Enfin il disparut tout d’un coup, et laissa les assistants dans l’étonnement. Ceux qui savent ce que ces prodiges signifient, s’imaginèrent que c’était une image de l’état pitoyable où l’empire allait être réduit, jusqu’à ce qu’il périt par la méchante administration des princes. On ne reconnaîtra que trop que cette conjecture était véritable, quand on prendra la peine d’examiner attentivement ce qui arriva depuis.
Valens,
voyant que les Scythes ravageaient toute la Thrace, résolut
d’envoyer d’abord contre eux la meilleure cavalerie qu’il avait
amenée d’Orient. Leur ayant donc donné le mot du guet, il les fit
partir par bandes séparées. Ceux-ci ayant trouvé des Scythes
dispersés de côté et d’autre, en tuèrent plusieurs, dont ils
apportaient chaque jour les tètes à Constantinople. Les Scythes
ayant reconnu qu’il leur était difficile de surmonter la vitesse des
chevaux des Sarrasins, et de parer les coups de lance eurent recours
au stratagème de se cacher dans les endroits creux, pour ne les
attaquer que quand ils seraient trois contre un. Mais les Sarrasins
se servirent si heureusement de la vitesse et de l’adresse de leurs
chevaux, pour se retirer lorsqu’ils se trouvèrent les plus faibles
en nombre, et pour aller à la charge lorsqu’ils en eurent
l’occasion, que les Scythes, désespérant de se défendre, aimèrent
presque mieux repasser le Danube, et se rendre aux Huns que de périr
par les armes des Sarrasins. Leur retraite des environs de
Constantinople donna moyen à l’empereur de faire avancer son armée.
Pendant qu’il songeait aux moyens de continuer la guerre contre une
si formidable multitude de Barbares, et que d’ailleurs il ne savait
comment s’opposer à l’injustice des officiers, n’osant les déposer
en un temps si plein de troubles, et n’en ayant point de meilleurs à
mettre en leur place, Sébastien ennuyé de voir que les empereurs
d’Occident n’étaient capables dans leur jeunesse d’aucune bonne
résolution, et qu’ils se laissaient conduire par des eunuques,
quitta l’Occident, et vint à Constantinople. Valens qui connaissait
son mérite, tant en la guerre qu’en toute sorte d’autres affaires,
le fit général de ses troupes. Sébastien considérant la vie
licencieuse des officiers, et la lâcheté des soldats, qui n’étaient
propres qu’à fuir, et à trembler comme des femmes, demanda la
permission d’en choisir deux mille, dans la croyance qu’il lui
serait plus aisé de remettre ce petit nombre dans la discipline, que
de gouverner une multitude mal réglée. L’ayant obtenu de l’empereur,
il choisit, non ceux qui avaient été levés dans la crainte, et qui
étaient accoutumés à la fuite, mais des jeunes gens nouvellement
enrôlés qui faisaient espérer par leur bonne mine et par leur
ardeur, qu’ils exécuteraient courageusement tout ce qu’on leur
voudrait commander. Il en fit ensuite une exacte revue, et s’efforça
de réparer par l’exercice le défaut de leur nature. Il était libéral
de louanges et de récompenses envers ceux qui obéissaient à ses
ordres, et se montrait sévère et inexorable envers ceux qui les
méprisaient. Ayant ainsi formé ses soldats, il les mit à couvert
dans les villes, et tendit incessamment des pièges aux Barbares qui
ravageaient la campagne, en trouvant tantôt quelques-uns chargés de
butin, il les tuait et le leur arrachait d’entre les mains; tantôt
en surprenant d’autres dans le bain, ou pleins de vin, il les
faisait passer au fil de l’épée. Ayant ainsi diminué le nombre des
Barbares par son adresse, et contraint les autres, par la terreur de
ses armes, de s’abstenir de piller, il s’attira la jalousie qui
produisit la haine, et celle-ci excita des calomnies par lesquelles
ceux qui avaient été privés de leurs charges le noircirent auprès de
l’empereur, et aigrirent contre lui les eunuques de sa cour. Dans le
temps que l’empereur avait commencé de prêter l’oreille à ces faux
rapports, Sébastien lui manda qu’il demeurât où il était, sans
avancer outre, parce qu’il était très difficile de faire une guerre
ouverte à une si prodigieuse multitude, et qu’il était plus à propos
de temporiser, et de les harceler par des attaques imprévues,
jusqu’à ce qu’ils se rendissent faute de vivres, ou qu’ils
abandonnassent nos terres, et qu’ils se soumissent aux Huns, plutôt
que de mourir de faim. Le parti contraire à celui de Sébastien ayant
conseillé à l’empereur de donner une bataille générale, et lui ayant
promis une victoire signalée, le mauvais avis l’emporta par un effet
du pouvoir de la fortune qui travaillait à la ruine de l’empire, et
Valens ayant fait avancer ses troupes en désordre, les Barbares
s’avancèrent hardiment et les défirent. Valens s’enfuit avec peu de
gens dans un bourg qui n’était point fermé de murailles. Les
Barbares entourèrent de toutes parts cette retraite de bois à
laquelle ils mirent le feu, et brûlèrent ainsi l’empereur avec ceux
de sa suite et tous les habitants, sans que personne pût arriver
jusqu’à lui pour le secourir. Dans cet état désastreux des affaires,
Victor, général de la cavalerie Romaine, se sauva en Macédoine et
Thessalie, puis en Moesie et en Pannonie, où il apprit à Gratien la
mort de Valens, et la perte de son armée. Théodose reçut à Thessalonique quantité de personnes qui y abordèrent des divers endroits pour les affaires publiques ou pour leurs nécessités particulières, et après les avoir expédiées il les renvoya. Des troupes nombreuses de Scythes, de Goths, de Taifales, et d’autres nations ayant traversé le Danube et pillé les territoires de quelques villes de l’empire, pour chercher du soulagement à la famine dont elles étaient pressées, depuis qu’elles avaient été chassées de leur pays par les Huns, il se prépara de tout son pouvoir à la guerre. Comme la Thrace était occupée par les nations dont je viens de parler, et que les garnisons des places de la province n’osaient, je ne dirai pas tenir la campagne, mais se montrer seulement au haut des murailles, Modarès, issu du sang des rois des Scythes, qui s’était rendu depuis longtemps aux Romains, et qui leur avait donné de si grandes preuves de sa fidélité qu’il ait parvenu à la charge de maître de la milice, monta, sans que les Barbares s’en aperçussent, sur une hauteur plate et longue qui commandait la plaine qui s’étendait au dessous. Ayant appris de ses espions que les ennemis consumaient les vivres qu’ils avaient pris à la campagne et dans les places non fortifiées, et qu’ils étaient pleins de vin, il commanda à ses soldats de prendre leurs boucliers et leurs épées, sans se charger d’autres armes plus pesantes, ce qui ayant été fait, ils fondirent sur les Barbares, et en peu d’heures ils en tuèrent un grand nombre, les uns sans qu’ils le sentissent, les autres dans le moment nième qu’ils commençaient à se sentir, en revenant de leur assoupissement. Lorsqu’ils eurent tué tous les hommes, ils les dépouillèrent. Ils prirent après cela les femmes et les enfants, avec quatre mille chariots, sans un nombre innombrable de valets qui suivaient à pied, et qui montaient quelquefois dessus pour se délasser. L’armée s’étant si heureusement servie de cette occasion qui avait été présentée par le hasard, la Thrace fut délivrée du péril qui la menaçait, et rétablie dans une agréable tranquillité, par la perte inopinée des nations qui avaient troublé son repos. Il s’en fallut peu que d’un autre côté l’Orient ne fût entièrement ruiné. Les Huns s’étant emparés, de la manière que nous l’avons dit, des terres qui sont au-delà du Danube, les Scythes ne pouvant résister à une si terrible inondation, supplièrent Valens, qui régnait alors, de les recevoir en Thrace comme ses alliés et ses sujets, et lui promirent de lui obéir en tout ce qu’il aurait pour agréable de leur commander. Valens gagné par ces promesses les reçut, et s’imaginant qu’il aurait un gage assuré de leur fidélité en la personne de leurs enfants, il les envoya en Orient sous la conduite de Julius, sur l’adresse duquel il se reposa du soin de les garder et de les instruire. Julius les dispersa en plusieurs villes, de peur que s’ils demeuraient dans le même lien ils ne fussent capables de faire quelque entreprise contre le bien de l’état. Ces jeunes étrangers étant devenus grands, apprirent les mauvais traitements que leurs compatriotes avaient reçus en Thrace, et se mandèrent secrètement les uns aux autres la résolution qu’ils avalent prise de se venger. Julius appréhendant qu’ils n’exécutassent leur dessein, et ne sachant que faire pour le détourner, ne jugea pas à propos d’en donner avis à Théodose, tant parce qu’il était alors en Macédoine, que parce qu’il était nouvellement parvenu à l’empire, et que ce n’était pas de lui mais de Valens qu’il avait reçu l’ordre de veiller sur la conduite de cette jeunesse étrangère. Il en écrivit donc au sénat de Constantinople, et le sénat lui ayant laissé la liberté d’en disposer de la manière qu’il croirait la plus avantageuse au bien de l’état, voici ce qu’il fit pour détourner le danger dont les villes étaient menacées. Il assembla les principaux chefs, prit leur serment, et leur découvrit son dessein. Il fit à l’heure même publier par toutes les villes que l’empereur voulait attacher les Barbares à son service, et leur donner de l’argent et des terres, et qu’à cet effet ils se rendissent à certain jour dans les Métropoles. Les Barbares s’adoucirent un peu à cette nouvelle, et trompés par l’espérance ils perdirent l’envie qu’ils avaient de se soulever, et se rendirent en foule aux lieux qui leur avaient été marqués. Les soldats s’emparèrent des maisons qui répondaient aux places publiques, et jetèrent, du haut des toits, des traits et des pierres sur ces étrangers, à mesure qu’ils entrèrent, jusqu’à ce qu’ils les eussent tous tués, et jusqu’à ce que par leur mort ils eussent délivré les villes de la crainte de leur révolte. Voilà le stratagème dont Julius et les autres commandants usèrent pour mettre fin aux pertes et aux disgrâces de l’Orient et de la Thrace. L’empereur Théodose était cependant à Thessalonique, où il donnait un libre accès à ceux qui voulaient s’approcher de lui. Mais comme il recherchait ses plaisirs avec trop de passion, dès le commencement de son règne il renversa l’ordre qui avait été établi parmi les officiers, et multiplia leurs charges. Au lieu qu’il n’y avait auparavant qu’un général de la cavalerie et un de l’infanterie, il en fit cinq, surchargea le public des fonds de leur paie, et exposa les soldats en proie à l’avarice et à la violence de leurs commandants. Chacun de ses officiers croyant posséder le commandement sur toute l’armée, cherchait à faire des gains injustes. L’empereur Théodose ne multiplia pas seulement les grandes charges, mais il multiplia aussi au moins de la moitié les charges inférieures, comme celles des tribuns, tellement que les soldats ne touchaient plus rien de ce qui leur appartenait des deniers publics. Voilà ce qui regarde sa négligence et son avarice. Il introduisit le luxe de la table, et rechercha une si prodigieuse diversité de mets, que pour les apprêter il fallut avoir use infinité de nouveaux officiers, dont on ne saurait rapporter les noms sans entreprendre un long ouvrage. Il n’est pas besoin de parler de la multitude incroyable des eunuques qui le servaient, et dont les mieux faits avaient pris un si grand empire sur son esprit, qu’ils le tournaient comme il leur plaisait, et qu’ils choisissaient les gouverneurs des provinces, puisque nous verrons dans la suite que ce désordre fut une des principales causes de la ruine de l’état. Après avoir épuisé les finances par des libéralités indiscrètes envers des personnes qui ne les méritaient pas, il fut obligé d’exposer les charges en vente, et de les donner à ceux qui avaient le plus d’argent, au lieu de ne les donner qu’à ceux qui avaient le plus de réputation ou de probité. On voyait les marques des dignités entre les mains des banquiers, des partisans et d’autres personnes infâmes. Cette mauvaise administration réduisit en peu de temps les bonnes troupes à un petit nombre, et les villes à une extrême pauvreté. Les magistrats opprimaient par des calomnies ceux qui n’avaient pas de quoi contenter leur avarice, et publiaient hautement qu’il fallait qu’ils se remboursassent du prix de leurs charges. Les particuliers ne pouvaient avoir recours qu’à Dieu qu’ils priaient de les délivrer de leur misère et de l’injustice des officiers, car ils avaient encore alors la liberté d’entrer dans les temples, et d’y faire l’exercice public de la religion de leurs pères. L’empereur Théodose, voyant que les armées étaient fort diminuées, permit aux Barbares qui habitent au-delà du Danube de le venir trouver, et leur promit de les enrôler parmi ses troupes. Ils vinrent en grand nombre à dessein d’attaquer les Romains, s’ils se trouvaient les plus forts, et de les assujettir à leur puissance. L’empereur considérant qu’ils surpassaient ses soldats en nombre, et qu’il serait malaisé de leur résister, s’ils entreprenaient de violer les conditions sous lesquelles ils avaient été reçus, résolut d’en envoyer une partie en Égypte, et de rappeler d’Égypte une partie des garnisons, dont ils rempliraient la place. Cet échange ayant été fait de la sorte, les troupes rappelées d’Égypte ne firent aucun désordre, et payèrent tout ce qu’elles prirent, au lieu que les Barbares ne payèrent rien, et enlevèrent les vivres dans les marchés avec la dernière insolence. Les uns et les autres se rencontrèrent à Philadelphie, ville de Lydie, où les Égyptiens qui étaient en moindre nombre que les Barbares observaient exactement l’ordre qui leur avait été donné par leurs chefs, et où les Barbares prétendaient avoir droit d’en user d’une autre manière. Un marchand ayant demandé le prix de sa marchandise, un Barbare, au lieu de la payer, lui donna un coup d’épée; le marchand ayant crié au secours, celui qui se présenta pour le secourir fut blessé aussi bien que lui. Les Égyptiens, touchés de pitié prièrent les Barbares de s’abstenir de ces violences qui convenaient mal à des personnes qui témoignaient vouloir-vivre selon les lois romaines. Mais au lieu de déférer à leurs prières, ils firent main basse sur eux, et alors les Égyptiens n’étant plus maîtres de leur colère, fondirent sur ces Barbares, en tuèrent plus de deux cents, dont quelques-uns tombèrent dans un égout. Les Égyptiens leur ayant fait connaître par cet exploit que s’ils n’étaient plus modérés il se trouverait assez de gens qui réprimeraient leur insolence, ils se séparèrent et continuèrent leur chemin. Les Barbares étaient commandés par Hormisdas, fils de cet Hormisdas qui avait fait la guerre sous Julien contre les Perses. Quand les Égyptiens furent arrivés en Macédoine, et qu’ils se furent joints aux troupes du pays, on n’apporta point d’ordre pour les distinguer, et on n’eut aucun égard à l’état qui avait été dressé de l’armée. On permettait aux soldats de retourner en leur pays, et d’en envoyer d’autres en leur place, puis de revenir. Les Barbares ayant appris par l’intelligence qu’ils entretenaient avec les transfuges la confusion qui régnait parmi les troupes romaines, crurent qu’ils n’auraient jamais d’occasion aussi avantageuse que celle-là de les attaquer. Ayant donc traversé la rivière sans peine, et s’étant avancés jusqu’en Macédoine, à la faveur des transfuges qui travaillaient à leur rendre le passage libre, ils aperçurent durant l’obscurité de la nuit l’empereur qui marchait contre eux à la tête de son armée, et ils le reconnurent par la quantité des feux qui étaient allumés dans son camp, et en furent assurés par le témoignage des transfuges qui les en avertirent. Ils coururent droit vers la tente de l’empereur, à la lueur du feu. Les transfuges s’étant joints à eux, il n’y eut presque que les Romains qui combattirent; mais comme ils étaient fort inférieurs en nombre, ils donnèrent moyen à l’empereur de se retirer, et moururent en combattant vaillamment, après avoir tué plusieurs des ennemis. Si les Barbares eussent bien usé de leur victoire, et qu’ils eussent vigoureusement poursuivi les fuyards, ils les auraient pris. Mais s’étant contentés d’avoir vaincu, et de s’être rendus maîtres de la Macédoine et de la Thessalie, ils ne firent aucun mauvais traitement aux villes, dans l’espérance de les charger d’impositions. L’empereur n’eut pas si tôt appris leur retour en leur pays, qu’il mit des garnisons dans toutes les places, et qu’il revint à Constantinople, d’où il écrivit à Gratien, pour l’informer de tout ce qui était arrivé, et pour lui représenter la nécessité qu’il y avait d’apporter de prompts remèdes aux pressants maux de l’empire. Quant à lui, il envoya lever les impôts dans la Macédoine et dans la Thessalie, avec la même rigueur que s’il ne fût arrivé aucune disgrâce aux villes de ces deux provinces. La dureté des partisans enlevait tout ce qui avait été laissé par la compassion des étrangers. On employa non seulement tout l’argent, mais les ornements des femmes, les habits, et jusqu’aux chemises pour payer les impôts. Il n’y avait ni ville ni campagne qui ne retentît des gémissements et des cris des misérables qui imploraient le secours des Barbares contre la cruauté de leurs citoyens. Pendant que la Thessalie et la Macédoine étaient dans ce déplorable état, l’empereur Théodose rentrait en triomphe à Constantinople, sans être touché des misères publiques, et sans prendre d’autre soin que de faire en sorte que l’excès du luxe répondît à la grandeur de la ville. L’empereur Gratien, fort surpris de ce que Théodose lui avait mandé, envoya une armée assez nombreuse, sous la conduite de Bandon et d’Arbogaste, chefs francs, fort affectionnés aux Romains, fort dégagés d’intérêts, et fort recommandables par leur prudence et par leur valeur. Ils ne furent pas sitôt arrivés en Macédoine et en Thessalie, que les Scythes qui y faisaient le dégât, ayant reconnu leur adresse et leur vigueur, se retirèrent dans la Thrace qu’ils avaient ravagée auparavant. Mais ne sachant plus de quel côté se tourner, ils curent recours à leur premier artifice, et surprirent encore l’empereur Théodose par les mêmes ruses qu’ils avaient déjà employées pour le tromper. Ils lui envoyèrent des transfuges qui lui promirent de demeurer fort fidèles dans son alliance et fort soumis à ses ordres. Lorsqu’il eut prêté l’oreille à leurs promesses, et qu’il les eut reçus sans que l’expérience du passé le rendît capable de reconnaître ce qui lui était le plus avantageux, plusieurs autres accoururent en foule de la même sorte, et ainsi la stupidité du prince remit les affaires de l’empire sous la tyrannie des étrangers. Cette stupidité était entretenue par une longue habitude de luxe et de débauche. En effet, tout ce qui peut le plus corrompre les mœurs était en si grand crédit dans la cour de ce prince, qu’il passait pour le comble de la félicité, au jugement de ceux qui flattaient ses inclinations et qui imitaient sa conduite. La corruption du siècle fut si étrange, qu’il se trouva des personnes qui envièrent l’extravagance des bouffons, des danseurs et des musiciens. On faisait cependant la guerre aux temples, dans les villes et à la campagne. Il y avait du danger à croire qu’il y a des dieux et à lever les yeux au ciel pour les adorer. Pendant que Théodose gouvernait de la sorte, Gratien envoya Vitalien en Illyrie pour y commander les troupes. C’était un homme qui n’était nullement capable de rétablir les affaires. Peu après deux bandes de Germains, qui habitent au-delà du Rhin, dont l’une était commandée par Fritigerne, et l’autre par Allothe et par Safrace, incommodèrent si fort les Gaules, que l’empereur Gratien, pour être délivré de leurs violences, leur permit de s’emparer de la Pannonie et de la Moesie supérieure. Ces peuples étant donc montés sur le Danube, à dessein de passer par la Pannonie, d’aller en Epire et de subjuguer la Grèce, crurent devoir amasser quantité de provisions et attaquer Atanaric, prince des Scythes, pour ne laisser derrière eux aucun ennemi. L’ayant donc attaqué, ils le chassèrent sans peine du lieu qu’il occupait. Quand il eut été chassé de la sorte, il se réfugia vers Théodose qui venait d’être guéri d’une maladie dangereuse; celui-ci vint au devant de lui hors de Constantinople pour le recevoir, et lui fit après sa mort, qui survint incontinent, des funérailles si superbes, que les Scythes, étonnés d’une magnificence si extraordinaire, s’en retournèrent en leur pays sans exercer aucun acte d’hostilité contre les Romains, et que ceux qui étaient venus avec Atanaric gardèrent longtemps les bords du Danube pour empêcher les incursions des autres peuples. Théodose eut dans le même temps d’autres succès assez heureux. Il remporta quelques avantages sur les Scyres et sur les Carpodaces qui s’étaient joints à quelques Huns, et les contraignit de repasser le Danube; de sorte que les soldats commencèrent à reprendre un peu de cœur et les paysans à cultiver leurs terres en repos. Promotus, qui commandait l’infanterie de Thrace, étant allé au devant d’Oedothée qui avait amassé une multitude prodigieuse d’habitants des bords du Danube et d’autres peuples plus éloignés, les défit de telle sorte, que plusieurs furent noyés dans le fleuve, et qu’il fut impossible de compter ceux qui moururent dans la plaine. L’état de la Thrace étant tel que je viens de le représenter, Gratien fut accueilli de fâcheux accidents. Ayant suivi les conseils de ceux qui ont accoutumé de corrompre les mœurs des princes, il reçut les Alains et d’autres étrangers, les mit parmi ses troupes, leur fit des présents, et les considéra si fort, que ses soldats en conçurent de la jalousie et de la haine, et commencèrent à se soulever, et principalement ceux qui étaient en Grande-Bretagne, qui de leur naturel étaient plus portés à la colère et à la révolte que les autres. Maxime, espagnol de nation, qui, ayant autrefois servi en Angleterre avec Théodose, avait dépit de le voir sur le trône, et d’être demeuré dans sa première condition, accrut la haine des gens de guerre contre lui, se fit proclamer empereur, et ayant couvert l’Océan de vaisseaux s’approcha de l’embouchure du Rhin. Les soldats entretenus le long de ce fleuve dans la Germanie et dans les provinces voisines ayant approuvé sa proclamation, Gratien se présenta pour le combattre. Les deux armées firent des escarmouches durant cinq jours: mais Gratien ayant vu que la cavalerie des Maures, et les autres à leur exemple, prenaient le parti de Maxime, s’enfuit avec trois cents cavaliers vers les Alpes et de là vers la Rétie, le Noric, la Pannonie, et la Moesie supérieure. Maxime l’envoya poursuivre par Andragathe, natif des environs du Pont-Euxin, qu’il tenait pour son ami. Celui-ci l’ayant rencontré comme il était près de passer un pont à Sigidun, le prit, le tua, et assura par sa mort l’empire à Maxime. Je ne dois pas omettre de faire ici un récit qui a beaucoup de rapport avec mon sujet. Les pontifes tiennent le premier rang parmi les prêtres de Rome. Le mot de pontife signifie la même chose que faiseur de pont. Voici l’occasion qui le mit en usage. Lorsqu’il n’y avait point de temples et que les hommes ne savaient encore rien du culte des images, on commença à en faire en Thessalie, et on les mit sur le pont du Pénée, et depuis cela les prêtres ont été appelés pontifes. Les Romains ont tiré ce nom-là des Grecs, et pour son excellence, ils l’ont donné à leurs princes. Numa en fut honoré le premier et les autres rois depuis lui. Ensuite Auguste, et ceux qui lui ont succédé à l’empire. En prenant possession de la souveraine puissance, ils la prenaient aussi de la souveraine sacrificature. Constantin même, bien qu’il eût renoncé à la véritable piété pour faire profession de la religion des chrétiens, et depuis lui Valentinien et Valens reçurent cet honneur avec joie. Mais Gratien l’ayant refusé, et ayant rendu la robe aux pontifes, le premier d’entre eux dit : Puisque Gratien ne veut pas être pontife, Maxime le sera bientôt. Voilà quelle fut la fin du règne de Gratien. Maxime croyant avoir solidement établi les fondements de sa puissance envoya une ambassade à Théodose, non pour s’excuser de la manière dont il avait agi envers Gratien, mais pour lui faire des propositions qui ne lui devaient pas être fort agréables. Il choisit pour cet emploi le premier officier de sa chambre, qui n’était pas un eunuque (Maxime n’ayant garde de confier cette charge à des personnes si méprisables), mais un homme grave, qui avait été élevé avec lui dès leur jeunesse. Il lui demanda son amitié, et d’être reconnu en Orient pour empereur, offrant de faire avec lui une ligue contre tous les ennemis de l’empire, sinon il lui déclarait la guerre. Théodose cacha dans le fond de son cœur le dessein de faire la guerre à Maxime, et ne laissa pas de consentir qu’il fût reconnu pour empereur, et que sa statue fût mise auprès de la sienne. Lors même qu’il envoya en Egypte Cynégius, préfet du prétoire, avec ordre de fermer les temples et de défendre tous les exercices de la religion, il lui commanda d’élever la statue de Maxime dans Alexandrie, et de le proclamer empereur devant tout le peuple. Cynégius exécuta fidèlement les ordres qu’il avait reçus, ferma les temples d’Alexandrie, de l’Egypte, et de l’Orient, défendit les sacrifices et tout le cuite de la religion de nos pères. Nous verrons dans la suite ce qui arriva depuis à l’empire. Il parut en ce temps-là des Scythes appelés Grothinges, qui avaient été inconnus jusque alors. Ces peuples s’étant assemblés en grand nombre, et ne manquant ni d’armes ni de courage, s’avancèrent jusqu’au bord du Danube, et demandèrent qu’on leur permit de le traverser. Promotus, qui commandait les troupes de ce pays-là, les rangea sur le bord, pour en défendre le passage. Non content de cela, il choisit des personnes fidèles qui savaient la langue de ces barbares, pour aller offrir de leur livrer le général de l’armée romaine, moyennant une grande récompense. Les Barbares ayant répondu qu’il n’était pas en leur pouvoir de donner ce qu’ils demandaient; ceux que Promotus avaient envoyés, pour trouver plus de créance, et pour ne se pas rendre suspects, persistèrent quelque temps dans leurs demandes, puis s’étant un peu relâchés, ils convinrent enfin du prix de la trahison, dont partie leur fut payée sur-le-champ, et le reste leur fut promis après la victoire. Lorsque le temps de l’exécution fut pris, ils avertirent le général de l’armée romaine que les Barbares devaient passer le fleuve la nuit suivante. Ayant donc mis en effet leurs meilleures troupes sur quantité de petits vaisseaux, ils commandèrent aux plus avancés de passer les premiers et d’attaquer les Romains pendant qu’ils étaient encore accablés de sommeil, ils donnèrent ordre à d’autres qui étaient au second rang, de passer ensuite pour soutenir les premiers, et enfin à ceux qui étaient moins capables de servir, devenir prendre part à la victoire, bien qu’ils n’en eussent point eu au péril du combat. Promotus ayant appris le dessein des ennemis de la bouche de ceux qu’il avait envoyés vers eux sous prétexte de le trahir, rangea ses vaisseaux de telle sorte que les proues étaient opposés aux proues. Il mit trois vaisseaux de front, et étendit si fort sa flotte en long, qu’elle occupait vingt stades du bord, et boucha par ce moyen le passage à ceux qui étaient vis-à-vis de lui, et étant allé au devant des autres, il les coula à fond. Comme la lune ne rendait aucune lumière, et que les Barbares ne savaient rien de la disposition de la flotte romaine, ils montèrent sur leurs bateaux sans faire de bruit. A l’heure même, ceux qui les avaient trahis ayant averti Promotus, et le signal ayant été donné, ou fit avancer les grands navires, qui faisaient couler à fond tous ces bateaux, sans qu’aucun des soldats qui tombaient dans l’eau se pût sauver, à cause de la pesanteur de ses armes. Les bateaux qui évitèrent les Romains qui voguaient, rencontrèrent ceux qui étaient rangés le long du rivage, et en furent chargés de traits, sans qu’il y eût de moyen de les forcer. Le carnage fut plus grand en ce combat qu’en aucun autre dont on ait jamais entendu parler. On vit le fleuve tout rempli de corps morts et d’armes qui peuvent nager sur l’eau. Ceux qui purent gagner le bord à la nage, y périrent par le fer. La fleur de l’armée des Barbares ayant été enlevée, les soldats se chargèrent du butin et prirent quantité d’enfants, de femmes et de meubles. Promotus ayant su que l’empereur Théodose était proche, souhaita de l’avoir pour témoin de sa victoire. Théodose ayant admiré la multitude des prisonniers et du butin, mit les prisonniers en liberté et leur fit des présents, à dessein d’attirer par cette libéralité les étrangers à son parti, et de se servir d’eux dans la guerre qu’il méditait contre Maxime. Promotus demeura en Thrace, veilla à la garde de ses places, et se prépara secrètement à la guerre dont je viens de parler. Je ne dois pas omettre un événement assez semblable qui arriva dans le même temps. Il y a dans la Scythie, province de Thrace, une ville appelée Tomis, dont Gérontius, homme fort considérable par la force extraordinaire de son corps et par ses talents remarquables dans la guerre, commandait la garnison. Il y avait, hors de la ville, de jeunes étrangers, qui avaient été choisis entre d’autres par l’empereur pour leur adresse et pour leur bonne mine, et qui ne reconnurent ses bienfaits que par le mépris qu’ils firent du gouverneur et des soldats. Gérontius ayant reconnu qu’ils tramaient le dessein d’attaquer la ville, communiqua aux soldats de sa garnison la résolution qu’il avait prise de faire une sortie pour réprimer leur insolence. Mais ayant trouvé que bien loin d’oser attaquer les Barbares, ils tremblaient en leur présence, il sortit seul avec un petit nombre de ses gardes. Les Barbares se moquant de la témérité avec laquelle il s’exposait à un péril si évident, envoyèrent contre lui les plus vaillants qu’il y eût parmi eux. Il attaqua le premier qui se présenta devant lui, jeta la main sur son bouclier, combattit vaillamment jusqu’à ce qu’un de ses gardes abattit l’épaule du Barbare, et le fit tomber de son cheval. Gérontius en attaqua d’autres à l’heure même, et les étonna par sa hardiesse. Les soldats de la garnison qui avaient été d’abord comme interdits par la crainte, ayant vu du haut des murailles la valeur de leur gouverneur reprirent courage, et, se souvenant de la vertu romaine, fondirent sur les Barbares et en tuèrent un grand nombre. Ceux qui purent fuir se réfugièrent dans une maison à laquelle les chrétiens rendent un grand honneur, et qu’ils prennent pour un asile. Gérontius espérait recevoir la récompense qui était due à la valeur par laquelle il avait délivré la Scythie de la crainte des Barbares. Mais Théodose irrité de la défaite de ces gens qu’il avait comblés de bienfaits, quoiqu’ils eussent ravagé l’empire, commanda d’arrêter Gérontius, et lui fit un crime de sa valeur et de sa victoire. Gérontius lui représenta pour sa justification les brigandages et les cruautés que ces étrangers avaient exercées; mais l’empereur, bien loin de se rendre à ses raisons, repartit qu’il ne s’était défait d’eux que par le désir de profiter des présents qu’il leur avait faits. Gérontius ayant prouvé qu’au lieu de profiter de ces présents, il avait porté à l’épargne les colliers, les carcans d’or, et les autres ornements dont l’empereur les avait gratifiés, tout ce qu’il put faire fut d’abandonner son bien aux eunuques de la cour, et d’éviter par ce moyen le péril dont il était menacé. Il ne reçut point d’autre récompense de l’affection qu’il avait témoignée au bien de l’état. La corruption de l’esprit et des mœurs étant aussi grande sous le règne de Théodose que je l’ai décrite, les bonnes choses y étant généralement méprisées, le luxe et les débauches y étant montés à un excès tout-à-fait insupportable, les habitants d’Antioche, capitale de Syrie, ne pouvant plus souffrir les impositions qui croissaient de jour en jour, se soulevèrent, abattirent les statues de l’empereur, de l’impératrice, avec des railleries dignes des mauvais traitements qu’ils ressentaient, mais peut-être trop piquantes et trop satiriques. L’empereur ayant donné des marques de sa colère, les décurions de la ville jugèrent à propos d’envoyer des députés pour l’apaiser et pour lui faire des excuses de l’emportement du peuple. Ils choisirent pour cet effet Libanius, dont les ouvrages publient assez le mérite, et Hilaire, recommandable par l’éminence de sa science. Ce célèbre orateur fit un excellent discours sur le sujet de la sédition en présence de l’empereur et du sénat, et parla avec tant d’éloquence, que non seulement il obtint la grâce des coupables, mais qu’il reçut ordre de ce prince de faire un autre discours sur la générosité avec laquelle il oubliait cette injure. Hilaire reçut de son côté les éloges qui étaient dus à son mérite, et fut honoré de la charge de gouverneur de la Palestine. Les affaires étant en cet état en Orient, en Thrace et en Illyrie, Maxime non content de commander aux peuples qui avaient obéi à Gratien, méditait de priver le jeune Valentinien de tout ou au moins d’une partie de ce qu’il possédait. Il se préparait pour cet effet à passer les Alpes, et à aller en Italie. Mais parce que les chemins sont fort étroits, et qu’après avoir monté des montagnes presque inaccessibles, on trouve des lacs où il est périlleux de mener des troupes, il ne se bâtait pas de faire une entreprise si difficile. Valentinien lui ayant fait proposer la paix, et lui ayant envoyé d’Aquilée. où il était, Domnin, Syrien de nation, le plus fidèle de ses sujets, le plus puissant et le plus expérimenté de la cour, Maxime lui fit tant d’honneurs, et le combla de tant de présents, qu’il lui persuada que Valentinien n’avait point de meilleur ami que lui. Il acheva de tromper en lui donnant une partie de ses troupes pour repousser les Barbares qui menaçaient la Pannonie,
Domnin
étant parti fort satisfait des présents et du renfort qu’il avait
reçus, rendit, sans y penser, le passage des Alpes plus aisé à
Maxime; car celui-ci l’ayant suivi avec toute son armée, et ayant
envoyé devant des gens pour empêcher qu’il ne sût qu’il marchait sur
ses pas, il s’avança en diligence par les montagnes et par les lacs,
entra en Italie, et mena son armée à Aquilée. Etant abordés à Thessalonique, après une longue et ennuyeuse navigation, ils envoyèrent supplier Théodose de venger au moins alors, bien que trop tard, les injures faites à la famille de Valentinien. Théodose surpris de cette nouvelle se réveilla un peu du sommeil de ses débauches, et ayant tenu conseil, résolut d’aller avec quelques uns du sénat à Thessalonique. Quand il y fut, il y tint un autre conseil plus grand que le premier, où la résolution fut prise de toutes les voix de poursuivre Maxime, et où il fut jugé qu’il était indigne de vivre depuis qu’il avait fait mourir Gratien pour usurper sa couronne, et depuis que, continuant ses crimes, dont il trouvait le succès heureux, il avait privé Valentinien, Son frère, de ses états. Théodose ne put approuver cet avis, tant à cause de la lâcheté de son naturel, que de la mollesse à laquelle il s’était accoutumé, et pour justifier l’éloignement qu’il avait de la guerre, il usa du prétexte de représenter que la guerre civile ne manque jamais d’avoir des suites funestes, et que de quelque côté qu’elle frappe, elle ne porte point de coups qui ne soient mortels. Il ajouta qu’il fallait envoyer une ambassade à Maxime, que s’il voulait rendre ce qu’il avait usurpé, et entretenir la paix, Valentinien partagerait avec lui l’empire comme auparavant, sinon qu’on prendrait les armes contre l’usurpateur. Aucun du sénat n’osa réfuter cette proposition, qui semblait avantageuse au bien de l’état. Mais Justine, qui était habile dans les affaires, et qui ne manquait pas d’adresse pour trouver des expédients, sachant que Théodose était fort amoureux de son naturel, mit devant lui Galla, sa fille, qui était une personne d’une excellente beauté, et s’étant jetée à ses genoux, et les ayant embrassés, le supplia de ne pas laisser impunie la mort de Gratien, qui lui avait mis la couronne sur la tête, ni de L’abandonner dans le désespoir où elle était. En faisant cette prière, elle lui montra sa fille qui fondait en larmes, et qui déplorait son malheur. Théodose fut touché par ses discours, et témoigna par ses regards qu’il était touché de la beauté de Galla. Il remit l’affaire à un autre temps, et leur dit qu’elles eussent bonne espérance. Sa passion pour Galla étant accrue, il la demanda en mariage à Justine, sa femme Placide étant morte auparavant. Elle ne promit de la lui donner qu’à la charge qu’il entreprendrait la guerre contre Maxime pour venger la mort de Gratien, et pour rétablir Valentinien sur le trône. Ayant donc épousé Galla, il se prépara sérieusement à la guerre, à laquelle il était incessamment poussé par sa femme, et augmenta la paie des soldats pour exciter leur courage. Il se corrigea si fort de la trop grande inclination qu’il avait eue pour l’oisiveté et pour le plaisir, que pourvoyant non seulement au présent mais encore à l’avenir, il donna ordre à tout ce qu’on devait faire après son départ, et en son absence. Cynégius, préfet du prétoire, étant mort en retournant d’Egypte, il songea à remplir sa place, et après y avoir fait une mûre réflexion, il choisit Tatien qui avait autrefois été honoré de plusieurs autres charges par l’empereur Valence. Lui ayant donc envoyé les marques de cette dignité, il donna encore le gouvernement de la ville à Proclus, son fils. Il acquit sans doute beaucoup de réputation en choisissant des hommes si capables de se bien acquitter de ces emplois pendant qu’il serait occupé à la guerre. Il donna le commandement de la cavalerie à Promotus, et celui de l’infanterie à Timasius. Comme il était près de partir, et qu’il semblait avoir donné tous les ordres qu’on pouvait désirer pour faire réussir son entreprise, il apprit que les Barbares qui étaient mêlés parmi les troupes romaines avaient été sollicités par des présents de la part de Maxime, et qu’ils tramaient une trahison. Leur dessein ayant été découvert de la sorte, ils s’enfuirent vers les lacs et les forêts de la Macédoine, et se cachèrent aux endroits les plus épais des bois. Ils furent cherchés si exactement, qu’ayant été trouvés, ils furent taillés en pièces. L’empereur, délivré de l’inquiétude qu’ils lui avaient donnée, marcha à la tête de ses troupes contre Maxime avec une vigueur incroyable. Il mit Justine sur un vaisseau avec son fils et sa fille, et les envoya à Rome dans la croyance qu’ils y seraient d’autant plus favorablement reçus, que Maxime y était fort odieux. Il avait dessein de traverser la haute Pannonie, et d’aller par le pas des Alpes surprendre son ennemi à Aquilée. Maxime ayant eu avis que la mère de Valentinien traversait, avec ses enfants, le golfe Ionique, envoya Andragathius les poursuivre avec des vaisseaux légers, mais il manqua son coup étant arrivé trop tard. Il courut ensuite ces mers-là avec quantité de navires dans la croyance que Théodose se préparait à un combat naval. Mais il était cependant en Pannonie, et ayant pris le pas de l’Apennin, il arriva à l’improviste à Aquilée, en força les portes, et y surprit Maxime qui distribuait de l’argent à son armée. Quand on l’eut dépouillé de la robe impériale, on l’amena devant Théodose, qui, lui ayant reproché ses crimes en peu de paroles, le livra à l’exécuteur. Telle fut la fin de la vie et de la tyrannie de Maxime, qui s’était vainement imaginé que la ruse dont il avait usé contre Valentinien le mettrait dans une possession paisible de l’autorité souveraine en Occident. Théodose ayant appris qu’il avait laissé Victor, son fils, au-delà des Alpes avec le titre de césar, envoya Arbogaste, qui ruina à l’heure même la puissance de ce jeune prince, et le fit mourir. Andragathe ayant appris sa mort au golfe Ionique où il était, et prévoyant les malheurs qui lui arriveraient, s’il tombait dans les mains de ses ennemis, aima mieux se jeter dans la mer que de les attendre. Théodose rendit à Valentinien tout ce que son père avait posséda dans l’empire, en quoi il parut avoir toute la reconnaissance qu’il devait pour son bienfaiteur. Il enrôla parmi ses troupes tout ce qu’il y avait de bons soldats qui avaient servi sous Maxime, et permit à Valentinien de gouverner l’Italie et les Gaules comme il le jugerait à propos. Justine, sa mère, le soulageait autant qu’elle pouvait, et suppléait par sa prudence au défaut de son âge.
Lorsque
Théodose retourna à Thessalonique, il trouva la Macédoine pleine de
troubles. Les Barbares qui s’étaient cachés dans les forêts et dans
les marais, de peur de tomber entre les mains des Romains, prirent
l’occasion de la guerre civile pour faire irruption en Macédoine et
en Thessalie. Mais au bruit de la victoire et du retour de
l’empereur, ils retournèrent se cacher dans leurs forêts d’où ils
sortaient fort souvent pour courir et pour piller, de sorte que
l’empereur s’imaginait que c’étaient des fantômes plutôt que des
hommes. Il ne découvrit à personne l’inquiétude que ces courses lui
donnaient. Mais ayant pris avec lui cinq cavaliers, qui menaient
chacun trois ou quatre chevaux en main pour en changer quand il lui
plairait. Il alla à la campagne sans être connu, et quand il avait
besoin de vivres il en prenait chez les paysans. Etant un jour
descendu dans la maison d’une vieille, il lui demanda à boire. Cette
vieille l’ayant reçu fort civilement, et lui ayant présenté du vin
et le peu qu’elle avait, il demanda à coucher chez elle. Comme il
était couché il aperçut un homme dans un coin, qui ne disait mot, et
qui semblait avoir dessein de se cacher, de quoi s’étant étonné, il
appela la vieille et lui demanda qui il était. Elle lui répondit
qu’elle n’en savait rien, qu’elle savait seulement que depuis qu’on
avait reçu la nouvelle de l’arrivée de l’empereur Théodose avec son
armée, cet homme avait toujours logé chez elle, et l’avait payée
chaque jour, qu’il était sorti tous les matins et était allé où il
lui avait plu, et qu’étant revenu les soirs il avait soupé, et
s’était couché comme il le voyait. L’empereur n’ayant pas cru devoir
négliger ce discours sans en approfondir la vérité, se saisit de
l’homme et lui demande qui il était. Comme il ne voulait rien
répondre, on le fit fustiger, et la douleur des coups ne pouvant
tirer aucune parole de sa bouche, l’empereur commanda aux cavaliers
de le piquer avec la pointe de leurs épées, et de lui déclarer qu’il
était Théodose. Alors il déclara qu’il était l’espion des Barbares,
qui étaient cachés dans les marais, et qu’il les avertissait des
lieux et des personnes qu’ils devaient attaquer. Théodose lui fit à
l’heure même couper la tête, et ayant joint son armée qui était
proche, il l’amena à l’endroit où il savait qu’étaient les ennemis,
et ayant fondu sur eux, il les tua presque tous; les uns après les
avoir tirés hors du marais, et les autres dans l’eau même. Lorsqu’ils eurent bien mangé et qu’ils furent autant accablés de vin que de travail, ils s’endormirent d’un profond sommeil; de quoi ceux qui s’étaient échappés d’entre les Barbares ayant eu avis, ils prirent les armes, fondirent sur eux, les percèrent de leurs lances, de leurs épées et de tout ce qui peut donner la mort. L’empereur aurait été tué lui-même, si quelques-uns, qui n’avaient pas encore dîné, n’étaient accourus à sa tente, pour l’avertir de ce qui se passait. Théodose et ses gens, étonnés de cette nouvelle, crurent devoir pourvoir à leur salut par la fuite. Comme ils fuyaient, Promotus, que l’empereur avait mandé, vint au devant d’eux, et leur dit qu’ils missent l’empereur en sûreté, et qu’il aurait soin de châtier l’insolence des Barbares. Au même instant il fondit sur eux pendant qu’ils tuaient les Romains endormis, et en tailla un si grand nombre en pièces, qu’il en resta fort peu pour s’aller cacher dans les marais. Voilà ce qui arriva à Théodose, en retournant de la guerre, contre Maxime. Bien que la victoire qu’il avait remportée lui donnât de la joie et de l’orgueil, les insultes qu’il avait souffertes des Barbares, dans les forêts et dans les marais, Lui donnaient du chagrin et du dégoût; de sorte qu’il résolut de mettre bas les armes, et de se décharger sur Promotus du soin de la guerre. Il reprit après cela sa manière de vivre ordinaire, et se plongea, comme auparavant, dans les voluptés et dans les plaisirs, passant les jours entiers tantôt à faire de magnifiques festins, tantôt à voir les jeux et les combats dans l’amphithéâtre et dans le cirque. J’avoue que je me suis souvent étonné de l’inégalité de son humeur, et de la violence avec laquelle il se portait en divers temps à des choses tout opposées. Etant lâche de son naturel, il se plongeait dans l’oisiveté, s’il n’en était empêché, ou par la rencontre de quelque fâcheux accident, ou par l’appréhension du danger. Quand il survenait une nécessité pressante qui menaçait l’état de troubles, il se réveillait de son assoupissement, et renonçant aux plaisirs. Il supportait les fatigues en homme de cœur. Dès que le péril était passé, Il retournait à son inclination, et reprenait ses divertissements accoutumés. Rufin, Gaulois de nation, maître des offices, était l’officier le plus considérable de son règne. Aussi lui confiait-il tout, sans se charger d’aucun soin. Timasius et Promotus ressentaient un dépit inconcevable de ne tenir que le second rang, après avoir essuyé tant de hasards pour le salut de l’empereur. Rufin, enflé de sa fortune, lâcha un jour, dans un conseil public, une parole insolente contre Promotus, qui ne la pouvant souffrir lui donna un soufflet. Rufin alla se plaindre, en montrant son visage à l’empereur, qui entra dans une si furieuse colère, qu’il dit que si les ennemis de Rufin ne se réconciliaient avec lui, ils reconnaîtraient qu’il était empereur. Rufin reconnaissant que l’excès de son ambition et de la trop grande élévation de sa fortune le rendaient odieux à tout le monde, conseilla à Théodose d’éloigner Promotus de la cour, et de l’occuper à faire faire les exercices aux gens de guerre. Cette résolution ayant été prise, Rufin mit des étrangers en embuscade, pour l’assassiner quand il irait en Thrace. Ainsi mourut misérablement ce grand homme, qui avait toujours été au dessus de l’intérêt, qui avait fidèlement servi le prince, et qui n’était coupable que d’avoir bien voulu servir sous un gouvernement si impie et si infâme. Il n’y eut point d’honnêtes gens à qui une action si cruelle ne donnât de l’indignation; et cependant Rufin en fut récompensé du consulat, comme si c’eût été une action fort louable. On suscita des affaires très injustes à Tatien et à Proculus son fils, bien qu’ils n’eussent jamais offensé Rufin en aucune chose, si ce n’est en s’acquittant de leurs charges, l’un de celle de préfet du prétoire, et l’autre de celle de gouverneur de la ville, avec une parfaite intégrité. Pour venir plus aisément à bout des détestables desseins qu’on avait formés contre eux, on ôta à Tatien sa charge qu’on donna à Rufin, et on intenta une accusation contre lui. Non seulement Rufin présidait à ce jugement, mais encore il en avait toute l’autorité, bien qu’il y eût en apparence d’autres juges avec lui. Proculus s’étant enfui pour éviter ce piège, Rufin appréhendant qu’il ne lui fit des affaires fâcheuses par son adresse, trompa le père par des caresses et par des serments, et porta l’empereur à dissiper ses justes soupçons par de vaines espérances, et à l’obliger à rappeler son fils. Il ne fut pas si tôt de retour qu’il fut enfermé dans une étroite prison. Tatien fut renvoyé en son pays. On tint plusieurs séances pour examiner le procès de Proculus; et enfin, ainsi que Rufin et les autres juges étaient convenus ensemble, il fut condamné à perdre la vie dans le faubourg de Sicé. L’empereur ayant eu avis de l’arrêt, envoya la grâce au condamné; mais celui qui la portait tarda si fort par le commandement de Rufin, qu’il n’arriva qu’après l’exécution. On apprit dans le même temps la mort de l’empereur Valentinien, de laquelle je marquerai les circonstances. Arbogaste, Franc de nation, à qui Gratien avait donné la lieutenance de Baudon, prit après sa mort sa charge de la milice, sans le consentement de l’empereur. L’estime qu’il avait acquise dans l’esprit des gens de guerre par sa valeur, par ses talents, et par le mépris qu’il faisait de la fortune, le mit dans un grand crédit. Il avait pris la liberté de s’opposer aux volontés de l’empereur, et d’empêcher ce qui lui semblait contraire à l’ordre et à la justice. Valentinien à qui cette liberté ne plaisait pas, avait de fréquentes contestations avec lui mais toujours inutilement, parce qu’Arbogaste était assuré de l’affection des gens de guerre. Enfin Valentinien ne pouvant plus souffrir l’assujettissement où il était à son égard, le voyant s’approcher un jour du trône où il était assis, après l’avoir regardé d’un œil de courroux, lui présenta un ordre qui le privait de sa dignité. Celui-ci l’ayant lu, dit: « Vous ne m’avez point donné ma charge et vous ne me la pourrez ôter. » Cela dit, il déchira l’ordre, en jeta les morceaux et sortit. Ils n’entretinrent plus depuis ce temps-là de défiance secrète comme auparavant : mais ils en vinrent à une inimitié déclarée. Valentinien écrivait souvent à Théodose pour l’informer des entreprises d’Arbogaste, et pour le supplier de lui donner du secours, protestant qu’à moins de cela il serait contraint de l’aller trouver. Arbogaste ayant longtemps songé à ce qu’il devait faire, prit la résolution que je vais dire. Il y avait un homme nommé Eugène, qui avait été élevé à la cour, et qui était d’un si grand mérite dans les lettres, qu’il enseignait l’éloquence. Rihomer qui avait une estime singulière de sa politesse et de son talent, se recommanda à Arbogaste, et le supplia de l’honorer de sa protection, l’assurant qu’il trouverait en sa personne un serviteur fort affectionné et fort utile. Rihomer étant depuis allé trouver Théodose, et s’étant établi en Orient, Arbogaste et Eugène contractèrent une étroite familiarité par de fréquentes conversations; Arbogaste n’avait point de secret pour lui, ni d’affaires qu’il ne lui communiquât. Jugeant donc alors que l’éminence de sa doctrine, la pureté de ses mœurs, et ses autres excellentes qualités, le rendaient digne de la souveraine puissance, il lui découvrit le dessein qu’il avait de la lui mettre entre les mains. Eugène ayant refusé ses offres avec quelque émotion, Arbogaste usa de tant de caresses pour l’apaiser, et de tant de raisons pour le porter à accepter un présent si précieux que la fortune lui voulait faire, qu’il obtint enfin son consentement. Quand il l’eut, il crut qu’avant d’entreprendre de l’élever sur le trône, il devait se défaire de Valentinien. Etant donc allé à Vienne dans les Gaules, il le trouve qui se divertissait avec des gens de guerre, le long des murailles, se jette sur lui, le blesse, et le tue. Personne n’ayant osé se plaindre d’une exécution si hardie, par le respect qu’on avait pour la dignité et pour le mérite d’Arbogaste, et par la vénération que les gens de guerre avaient pour l’inclination généreuse qui l’avait toujours mis si fort au dessus de l’intérêt, il proclama Eugène empereur, et assura que ses vertus donnaient lieu d’attendre de lui un heureux gouvernement. Quand Théodose eut reçu cette nouvelle, Galla, sa femme, remplit le palais de gémissements et de plaintes. Il en eut lui-même beaucoup de regret et d’inquiétude, considérant qu’il avait perdu un collègue qui était jeune et son allié, au lieu qu’il trouvait d’autres hommes qui d’un côté ne l’aimaient point, et qui de l’autre étaient invincibles, tant à cause de la hardiesse et de la valeur d’Arbogaste, que de l’érudition et de la vertu d’Eugène. Après avoir roulé longtemps ces pensées-là dans son esprit, il résolut d’exposer au sort des armes la fortune de l’empire, et se prépara sérieusement à la guerre. Il avait dessein de donner le commandement de la cavalerie à Rihomer, dont il avait éprouvé la valeur en plusieurs occasions: mais Rihomer étant mort dans le temps même, il fut obligé d’en choisir un autre. Pendant qu’il délibérait sur le choix, il lui vint une ambassade de la part d’Eugène, pour savoir s’il voulait approuver ou désapprouver sa proclamation. L’ambassadeur était Rufin, natif d’Athènes, qui n’apporta aucune lettre d’Arbogaste, ni ne fit aucune mention de lui. Comme l’empereur méditait sur la réponse qu’il avait à faire, voici ce qui lui survint. Dès qu’il parvint à l’empire, il fit amitié et alliance avec des étrangers, et l’entretint depuis par des présents. Il rendit toujours des honneurs particuliers aux chefs de chaque canton de ces nations, et leur fit souvent des festins. Un jour qu’ils étaient à table il s’émut contestation entre eux, les uns prétendant qu’il était expédient de mépriser les serments par lesquels ils avaient juré l’alliance des Romains; et les autres soutenant au contraire qu’ils étaient obligés de les observer. C’était Priulfe qui voulait violer la foi, et qui exhortait les autres à la violer, et c’était Franstius qui la voulait garder. Ils eurent longtemps cette contestation ensemble, sans qu’elle éclatât. Mais un jour qu’ils étaient à table chez l’empereur, et qu’ils étaient échauffés par le vin, ils découvrirent leurs sentiments sur ce sujet, et entrèrent en grande colère les uns contre les autres. L’empereur ayant rompu l’assemblée, ils se transportèrent si fort hors d’eux-mêmes en sortant du palais, que Fraustius ne se possédant plus, tira son épée, et tua Priulfe. Les soldats de celui-ci, s’étant voulu mettre en devoir de venger sa mort, les gardes de l’empereur se mirent entre eux, et les empêchèrent. L’empereur ne se mit pas fort en peine de ce différend, et les laissa battre, sans se soucier de les séparer. Il trompa les ambassadeurs par des présents et par des paroles qui, en apparence, étaient pleines de modération; mais aussitôt qu’ils furent partis, il se prépara à la guerre. Or, étant persuadé, comme d’une vérité constante, qu’il n’y arien de si important que de choisir de bons officiers, il donna le commandement de l’armée à Timasius, et après lui à Stilicon, mari de Serena, fille du frère de l’empereur Théodose; celui des confédérés à Gaina et à Saulus, qui avaient encore pour collègue Bacurius, natif d’Arménie, homme d’une grande probité et qui ne manquait point de talents dans l’art de la guerre. Après avoir choisi ces officiers, comme il se préparait à partir, il perdit l’impératrice, sa femme, qui mourut au milieu des douleurs de l’enfantement. Il prit un jour pour la pleurer, selon la loi qui est marquée par Homère, marcha à la tête de son armée, et laissa en sa place Arcadius, son fils, qu’il avait déjà déclaré empereur. Mais parce qu’il était encore jeune et qu’il ne pouvait pas avoir une prudence consommée, il lui donna Rufin, préfet du prétoire, pour exercer sous son nom tout ce qui dépend de l’autorité souveraine. Il emmena avec lui son plus jeune fils, passa à travers divers pays, et s’étant emparé du pas des Alpes, contre sa propre espérance, jeta par sa présence la frayeur dans le cœur d’Eugène. Il crut devoir faire commencer le combat aux étrangers, et pour cet effet il commanda à Gaina de mener ses troupes. Il en commanda d’autres ensuite, avec les troupes étrangères qu’il conduisait. Eugène ayant aussi fait avancer son armée, il arriva au commencement du combat une si grande éclipse de soleil, que pendant très longtemps on pensa que le jour avait fait place à la nuit. Le carnage fut si furieux durant cette obscurité que la plupart des confédérés furent taillés en pièce avec Bacurius, qui était toujours à leur tête pour les animer. Quelques-uns se sauvèrent par la fuite. Lorsque la nuit eut séparé les deux partis, Eugène, fort réjoui de sa victoire, distribua des récompenses à ceux qui s’étaient signalés dans le combat, et commanda de manger, comme si, après un tel échec, la guerre eût été entièrement terminée. Dès que l’aurore parut, Théodose ayant appris que les ennemis mangeaient encore, fondit sur eux avec tout ce qu’il avait de troupes, et les tua presque tous sans qu’ils le sentissent. Il avança jusqu’à l’endroit où était Eugène, tua plusieurs de ceux qui s mirent en défense, et prit les autres et Eugène lui-même. On lui coupa la tête; on la mit au haut d’une lance, et on la porta par l’armée, pour faire connaître à ceux qui soutenaient encore son parti que, puisque l’usurpateur était mort, ils se devaient soumettre à leur prince légitime. Ceux qui s’étaient sauvés du combat accoururent vers Théodose, le proclamèrent empereur, demandèrent leur grâce et l’obtinrent. Arbogaste étant trop fier pour vouloir tenir la vie de la bonté de Théodose, s’enfuit sur les montagnes, où ayant appris qu’on le cherchait, il s’appuya sur son épée et se tua, pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. Les armes de Théodose ayant eu un succès si favorable, il alla à Rome, où il déclara Honorius, son fils, empereur, et Stilicon général des troupes de ce pays-là, et tuteur du jeune prince. Ayant ensuite assemblé le sénat, qui demeurait ferme dans la religion de ses pères, et qui ne s’était jamais joint à ceux qui méprisent les Dieux, il fit un discours pour les exhorter à renoncer à leur vieille erreur, comme il l’appelait, et à embrasser la foi chrétienne, par laquelle les hommes sont lavés de toutes leurs taches et délivrés de tous leurs crimes. Personne ne s’étant rendu à ses persuasions, et personne n’ayant voulu préférer un nouvel établissement à un culte qui était aussi ancien que la ville, et qui l’avait rendue florissant l’espace de mille deux cents ans, pour en prendre un autre dont on ne savait quel serait le fruit, il dit que le public était chargé des frais des sacrifices, qu’il ne voulait plus faire une dépense dont il n’approuvait pas le sujet, et que les fonds qu’elle consommait lui étaient nécessaires pour subvenir aux besoins des gens de guerre. Le sénat repartit que les sacrifices ne pouvaient être faits de la manière qu’ils le devaient, à moins que la dépense n’en fût faite par le public. Mais nonobstant ses remontrances, ils furent abolis et toutes les traditions anciennes négligées, ce qui fut cause de la décadence de l’empire, de l’invasion des Barbares, de a désolation des provinces, de ce changement si déplorable de la force de l’empire, qu’on ne peut seulement pies reconnaître le lieu où étaient autrefois les villes les plus célèbres. Le récit que nous ferons du détail des affaires découvrira plus clairement la vérité de ce que j’avance.
Théodose ayant donné à Honorius, son fils, l’Italie, l’Espagne, les
Gaules, l’Afrique, partit pour retourner à Constantinople, et mourut
en chemin de maladie; son corps fut embaumé et mis à Constantinople
dans le tombeau des princes ses prédécesseurs. |
|