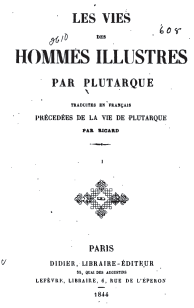
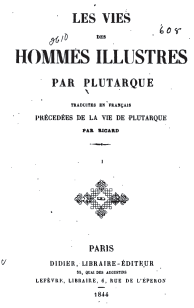
VIE DE PLUTARQUE
PAR D. RICARD.
I. La vie des gens de lettres est surtout dans leurs ouvrages. Leur but et leur occupation sont d'être utiles. — II. Fidélité de Plutarque à remplir cette destination. — III. Son origine. Obscurité de la ville de Chéronée. Célébrité qu'il lui a donnée. — IV. Incertitude de l'année de sa naissance. — V. Décri général des peuples de la Béotie. Exception de plusieurs grands hommes, et en particulier de Plutarque. — VI. Sa famille, une des plus honnêtes de Chéronée. Vertus et talents de ses parents et de ses frères. — VII. Sa première éducation à Chéronée. Il va la perfectionner à Athènes. Il s'y instruit des opinions de toutes les écoles, et s'attache de préférence aux principes de Platon et de Pythagore. — VIII. Il y a pour maître Ammonius. Il obtient le droit de bourgeoisie à Athènes, et voyage en Egypte. — IX. Son mérite bientôt connu à Chéronée, le fait nommer aux charges publiques. Principes d'après lesquels il s'y conduisait. — X. Quoique revêtu de dignités importantes, il ne dédaignait pas les moindres emplois. Trajan lui confère la dignité consulaire. On doute qu'il ait été le précepteur de ce prince. — XI. Il quitte Athènes pour aller séjourner quelque temps à Rome, où il fait des conférences publiques. Estime et considération dont il jouit. — XII. Conjectures sur le temps qu'il y a passé. — XIII. Son mariage avec Timoxène. Mérite singulier de sa femme. — XIV. Nombre et noms de ses enfants. Mort de sa fille Timoxène, à l'âge de deux ans. Son courage à supporter cette perte. Éloge de cet enfant. — XV. Sa tendresse pour ses enfants. Sa bonté pour ses esclaves. Sa sensibilité même pour les animaux. — XVI. Occasion ou il dément ce caractère, par le sang-froid avec lequel il fait châtier en sa présence un de ses esclaves. — XVII. Sa fortune et son état à Chéronée. — XVIII. Incertitude de l'époque de sa mort, et du temps qu'il a véeu. — XIX. Son caractère moral. Exactitude et douceur de ses principes. —XX. Deux occasions où il ne soutient pas l'impartialité qui lui est ordinaire. La première dans son jugement sur Hérodote. — XXI. La seconde dans ses Traités contre les stoïciens. Son antipathie pour ces philosophes, et son injustice à leur égard. — XXII. Son opposition à la secte d'Épicure, plus juste et mieux fondée. — XXIII. On le justifie sur l'accusation d'une excessive crédulité dans les faits qu'il rapporte. — XXIV. Sur le reproche de superstition. — XXV. Prétexte de cette inculpation. — XXVI. Ses idées pures et sublimes sur la divinité. — XXVII. Elles ne l'ont pas empêché de persévérer jusqu'à sa mort dans le paganisme. — XXVIII. Division de ses ouvrages philosophiques en dix classes. la plus intéressante est celle des écrits de pure morale. — XXIX. Mérite 22 de ce genre d'ouvrages. — XXX. Idée sommaire de chacun. — XXXI. Importance de ses traites de politique. — XXXII. Sagesse de ses préceptes. — XXXIII. Les ouvrages de physique et de métaphysique sont la partie la plus faible de cette collection. — XXXIV. Exception pour le Traité de la face qui paraît sur la lune. Jugement des Traités sur les animaux. — XXXV. Ses questions platoniques. Son Timée. Ses écrits contre les épicuriens. — XXXVI. Intérêt de ses ouvrages mythologiques, et en particulier du Traité d'Isis et d'Osiris. — XXXVII. Ses ouvrages de littérature sur les Romains, sur Alexandre et sur les Athéniens, paraissent être le fruit de sa jeunesse. Idée du Traité sur la musique. — XXXVIII. Ses Questions romaines et ses Questions grecques font connaître des usages particuliers des Romains et des Grecs. — XXXIX. Ses Mélanges ou ses Propos de table sont le plus instructif et le plus amusant de ses ouvrages. — XL. Les parallèles d'histoires grecques et romaines, et les Vies des dix orateurs grecs, qui se trouvent parmi les écrits de Plutarque ne sont pas de lui. Idée de ces deux ouvrages. — XLI. Ses écrits en partie historiques et en partie moraux. Le Démon de Socrate et le Traité de l'Amour offrent beaucoup d'intérêt. — XLII. Les recueils d'apophtegmes, d'anecdotes et de bons mots ne passent pas généralement pour être de lui. Ses Actions courageuses des femmes. — XLIII. Éloge de ce recueil précieux des ouvrages de Plutarque.
I. L'histoire des hommes de lettres est presque tout entière dans leurs ouvrages. Il en est peu qui aient joué sur la scène du monde un rôle assez important pour que leur vie puisse fournir de ces actions brillantes qui piquent la curiosité du lecteur, et lui inspirent un grand intérêt. Démosthène et Cicéron chez les anciens ; parmi nous, le chancelier de l'Hospital, le cardinal de Polignac, et surtout l'illustre Daguesseau, sont du petit nombre de ceux qui, joignant à des emplois distingués le goût des sciences et des lettres, ont trouvé dans le commerce des Muses un délassement honorable aux fonctions pénibles de la législation et de la politique. Les autres, voués par état à des occupations sédentaires et tranquilles, n'offrent dans l'égalité de leur conduite rien de frappant, rien d'extraordinaire. L'imagination n'y est pas émue par le spectacle imposant de victoires et de triomphes, par le récit pompeux d'exploits et de conquêtes ; mais aussi le cœur n'y est pas affligé par le tableau de ces désastres affreux, de ces révolutions funestes qui marquent tous les pas des conquérants, et laissent sur la terre, pour des siècles entiers, les traces sanglantes de leur passage. Semblable a un fleuve paisible dont le cours égal et uniforme fertilise tous les lieux qu'il arrose, leur vie coule sans bruit 23 et sans éclat au milieu de leurs contemporains qui les négligent. Ce n'est souvent qu'après leur mort que la Renommée, en publiant leurs travaux, appelle à leur tombeau la postérité, qui acquitte sa propre dette et celle du siècle qui l'a précédée. Livré tout entier au soin précieux d'éclairer ses semblables, moins occupé du désir de la gloire que du besoin d'être utile, le véritable homme de lettres ne songe, eu cultivant sa raison, qu'à faire partager aux autres les fruits de son étude, qu'à leur tracer des règles de conduite qui soient pour eux comme ces signaux qu'on élève dans des chemins difficiles, pour indiquer au voyageur la route qu'il doit suivre.
II. Il est peu d'écrivains de l'antiquité qui aient rempli celte destination glorieuse avec autant de constance et de succès que le philosophe estimable dont je me propose de faire connaître la vie et les travaux. Le désir de s'instruire fut sa principale et presque son unique passion : dans cette vue, il consacra sa vie entière à l'étude de la morale, et composa ce grand nombre d'ouvrages auxquels la vie d'un homme ne parait pas avoir pu suffire, et qui forment un cours complet de philosophie pratique. Encore le temps nous en a-t-il envié une grande partie ; et il nous reste à peine la moitié de ceux qu'il avait écrits. Tant était infatigable le zèle de cet esprit laborieux pour répandre cette sorte d'instruction dont il était remplit ! tant était impérieux en lui le besoin d'éclairer ses semblables !
III. Plutarque nous apprend lui-même, en plusieurs endroits de ses ouvrages, qu'il était né à Chéronée (01), petite ville de la Grèce, aux contins de la Béotie et de la Phocide. Longtemps célèbre par son ancienne origine (02), elle tomba ensuite dans une telle obscurité, qu'à peine on trouve son nom dans l'histoire, jusqu'au temps de Philippe de Macédoine, qui remporta près de cette ville une victoire fameuse sur les Corinthiens, les Thébains et les Athéniens réunis. Mais, malgré l'état de faiblesse où elle était sous les triumvirs, malgré sa dépopulation sous l'empire de Trajan, Plutarque se glorifie souvent d'y être né. Il conserva toujours pour sa patrie l'attachement le plus vif; il en préféra le séjour à celui des villes les plus considérables, à celui de Rome même, et il lui consacra l'emploi de ses loisirs et de ses talents. Le privilège d'un homme célèbre est de faire partager sa gloire 24 à tout ce qui l'approche. Chéronée, à peine connue dans l'histoire avant Plutarque, n'est ignorée aujourd'hui d'aucun de ceux qui ont lu les ouvrages de cet illustre écrivain; et le nom de sa patrie est allé avec le sien à l'immortalité.
IV. Ou ne peut assigner l'année de la naissance de Plutarque ; les anciens qui ont parlé de lui n'en ont pas fixé la date, et ne citent que le temps de sa célébrité. Il résulte de leurs divers témoignages que Plutarque commençait à être connu dès le temps de Néron, et qu'il a vécu au moins jusque sous Trajan. Ruaud, dans la Vie de cet écrivain, a voulu déterminer d'une manière plus précise l'année de sa naissance; et d'après un passage de Plutarque, qui sert de base à son sentiment, il l'a fait remonter aux dernières années de l'empire de Claude, à l'an quarante-neuf ou cinquante de J.-C. Mais cette opinion a ses difficultés, et nous sommes réduits sur ce point à des conjectures incertaines.
V. Personne n'ignore combien les peuples de la Béotie étaient décriés dans toute la Grèce pour leur stupidité; elle était passée en proverbe à Rome même, et jusqu'au temps d'Horace. Ce poète, en parlant du peu de goût avec lequel Alexandre jugeait les ouvrages de poésie: « Vous auriez juré, dit-il, que ce prince avait respiré, en naissant, l'air épais de la Béotie (03). » Leurs écrivains eux-mêmes en convenaient (04), et en attribuaient la cause à leur voracité. Il est vrai que Plutarque, en rappelant ce reproche, convient aussi que dès le temps même de Socrate il commençait à s'affaiblir. Pindare, en effet, avait déjà dû faire une exception marquée à ce caractère stupide commun aux Béotiens ; après lui Épaminondas avait prouvé que le sol de la Béotie pouvait produire de grands hommes ; enfin Plutarque, par l'universalité de ses connaissances, par la bonté de son esprit, par l'excellence de sa morale, avait dû faire oublier ce proverbe outrageant, et rétablir la réputation des Béotiens. Le portrait avantageux qu'il fait, dans ses ouvrages, de son père, de son aïeul et de ses frères, montre encore que l'agrément, la politesse et le bon ton n'étaient pas étrangers au climat de la Béotie.
VI. Sa famille, une des plus honnêtes de Chéronée, était distinguée de toutes les autres par son ancienneté, par ses richesses, et par les chargea qu'elle y avait exercées. Son bisaïeul, nommé Nicarque, 25 vivait du temps de la bataille d'Aclium. Lamprias, son aïeul, était d'un esprit agréable, à en juger par ce que Plutarque rapporte de lui. « Il n'avait jamais, dit-il, l'esprit plus fécond et plus inventif que quand il avait bu. Il se comparait alors à l'encens que la chaleur fait évaporer, et qui exhale une odeur suave (05). » Plutarque, qui parle souvent de son père, des bonnes qualités de son esprit et de son cœur, ne nous a nulle part fait connaître son nom ; mais on peut juger de son esprit par les discours que Plutarque lui fait tenir dans ses Propos de table (06) ; et de sa prudence, par les conseils qu'il donne à son fils, au retour d'une députation au proconsul, dont il avait été chargé par ses concitoyens. Plutarque, l'aîné de sa famille, eut deux frères, nommés, l'un Timon, et l'autre Lamprias. Il les introduit souvent dans ses ouvrages, et leurs discours prouvent qu'ils avaient une érudition aussi agréable que variée. Plutarque leur rend témoignage qu'ils étaient fort instruits l'un et l'autre, et qu'ils vivaient avec lui à Athènes dans le commerce des savants. On y voit aussi qu'il régnait entre les trois frères une amitié et une confiance qui font honneur à leur caractère. Il paraît cependant que Plutarque aimait davantage Timon, dont la douceur et l'aménité avaient beaucoup plus d'analogie avec son caractère que la vivacité et la pétulance de Lamprias. « De toutes les faveurs dont la fortune m'a comblé, dit-il dans son Traité de l'amour fraternel, il n'en est pas qui me soit plus chère que la bienveillance constante de mon frère Timon : c'est ce que savent tous ceux de qui nous sommes connus. » Le silence qu'il garde sur Lamprias fait présumer qu'il n'était pas alors en vie ; car il n'aurait pas oublié, dans cette circonstance, un frère qui lui était cher, quoique peut-être aimé moins tendrement que Timon. Il eut aussi des sœurs. Suidas dit que Sextus, de Chéronée, était neveu de Plutarque par sa sœur. On croit que c'est lui que sa science et sa vertu firent choisir pour enseigner les lettres grecques à l'empereur Antonin, qui lui rend, dans ses Réflexions, le témoignage le plus honorable (07).
VII. Plutarque passa les premières années de sa vie à Chéronée avec ses frères, et y reçut une éducation distinguée. La multitude et la diversité des sujets qu'il a traités dans ses ouvrages montrent l'étendue et la variété de ses connaissances. Mais la petite ville de Chéronée ne lui offrait pas assez de ressources pour donner à son esprit, avide 26 de savoir, toute la culture dont il avait besoin. Athènes était depuis longtemps la mère des sciences et des arts : c'était là que se rendaient, de toutes les parties de la Grèce, les hommes jaloux de nourrir leur esprit de tout ce que la littérature grecque avait de plus intéressant, et de s'instruire dans toutes les parties de la philosophie. Les Romains eux-mêmes allaient y prendre les leçons des hommes célèbres qu'elle renfermait dans son sein ; et si Rome était devenue par ses conquêtes la capitale de l'univers, elle avait été forcée de laisser à Athènes le titre plus glorieux et plus flatteur de capitale du monde littéraire. Ce fut dans cette ville fameuse que Plutarque alla passer les derniers temps de sa jeunesse, pour achever de s'y former par le commerce .des savants et dans les écoles des philosophes. II s'instruisit à fond des principes de leurs différentes sectes ; mais il s'attacha particulièrement à celle de l'Académie, et embrassa les dogmes et la morale du plus célèbre disciple de Socrate, celui qu'il appelle toujours le divin Platon. Mais ce choix ne fut pas tellement exclusif, qu'il n'adoptât en certains points les opinions des autres écoles ; et on pourrait croire, avec le traducteur anglais, que, loin de s'astreindre à jurer sur les paroles d'aucun de ses maîtres (08), il devint citoyen du monde philosophique. Modeste et réservé avec l'Académie, dans ses affirmations ; disciple du Lycée, dans les recherches de la science naturelle et dans les subtilités de la dialectique ; instruit par les stoïciens dans la foi d'une providence qui s'étend à tous les hommes, et dans les principes d'une morale ferme et sévère, mais qu'il sut ramener à des idées plus raisonnables et moins exagérées, il emprunta de toutes les écoles ce qui lui parut juste et vrai. Mais après la doctrine de Platon, à laquelle il parut toujours donner la préférence, il n'en est pas dont les dogmes lui aient plu davantage que celle de Pythagore. Partout il parle du philosophe de Samos avec une estime et une affection toutes particulières : il vante la douceur et l'humanité de ses principes, il les expose, en plusieurs endroits de ses ouvrages, avec ce zèle et cette chaleur qui décèlent sa prédilection pour ses sentiments, et pour son dogme favori de la métempsycose.
VIII. Nous savons par lui-même qu'il prit à Athènes les leçons d'Ammonius d'Alexandrie, philosophe célèbre dont Plutarque a souvent parlé, et qu'il introduit comme interlocuteur dans plusieurs de ses ou- 27 vrages. Il avait même écrit sa Vie ; mais comme elle est perdue, on n'a sur le compte de ce philosophe, dans ce qui nous reste de Plutarque, que des choses vagues et obscures. Il paraît seulement qu'Ammonius avait fait un long séjour à Athènes, et qu'il y jouissait d'une grande considération, puisqu'il y exerça jusqu'à trois fois la charge de préteur, la première de cette ville (09). On ne peut douter, d'après cela, qu'Ammonius n'eût reçu à Athènes le droit de bourgeoisie : sans cela il n'est pas vraisemblable que les Athéniens eussent conféré à un étranger, à un Égyptien, une charge de cette importance. Plutarque avait obtenu lui-même ce privilège, et était inscrit comme citoyen dans la tribu Léonlide (10) ; mais il ne dit pas si ce fut pendant qu'il y achevait ses études, ou dans quelqu'un des voyages qu'il y lit depuis son retour de Rome. On ne sait pas non plu» si, avant que d'avoir pris à Athènes les leçons d'Ammonius, il ne l'avait pas eu déjà pour maitre à Alexandrie. Ce qu'il nous apprend lui-même, c'est qu'il avait séjourné dans cette ville, alors célèbre par son goût pour les sciences et les arts. « A mon retour d'Alexandrie, dit-il, il n'y eut aucun de mes amis qui ne voulût me donner à manger (11). » Apres une assertion si formelle, il est étonnant que M. Dacier assure que, dans tout ce qui nous reste de Plutarque, on ne trouve rien dont on puisse conjecturer qu'il eût voyagé en Egypte; que tout ce qu'il rapporte des mœurs, des coutumes et des sentiments des Égyptiens, il ne l'avait tiré que des livres qu'il avait lus. Le traducteur anglais, qui dit aussi, apparemment sur la foi de M. Dacier, qu'il n'y a rien dans Plutarque de relatif à ce voyage, convient cependant que la connaissance profonde qu'il montre, dans son Traité d'Isis et d'Osiris, sur les mystères religieux des Égyptiens, suppose qu'il avait voyagé dans leur pays, et qu'elle ne peut être le fruit de ses seules lectures. Mais l'époque de ce voyage est incertaine.
IX. Le mérite de Plutarque fut connu de bonne heure à Chéronée, et le fit choisir, dans sa jeunesse, pour être envoyé, lui second, en ambassade vers le proconsul. Son collègue étant resté en chemin, Plutarque continua seul sa route, et remplit sa commission. A son retour, comme il se disposait à rendre compte de son ambassade, son père l'avertit de ne pas tout s'attribuer à lui seul, en disant : Je suis allé, 28 j'ai parlé ; mais d'associer toujours son collègue au récit qu'il ferait de sa députation. Il reçut, dans la suite, de nouveaux témoignages de la confiance de ses concitoyens, qui le nommèrent archonte éponyme (12). On appelait ainsi, à Athènes et dans les autres villes de la Grèce, le premier des archontes ou magistrats, parce que l'année était datée de son nom. On voit, par les médailles anciennes, que les villes grecques d'Asie marquaient la suite des années par les noms des archontes éponymes; qu'elles les inséraient dans leurs fastes, sur les monuments, et dans les actes publics (13). On peut juger de la conduite qu'il tenait dans l'exercice de ses fonctions, par les règles qu'il trace à un administrateur dans ses Préceptes politiques, et qui ne sont vraisemblablement que l'exposé de ce qu'il faisait lui-même. Il veut qu'il ne soit ni fier ni présomptueux ; que sa maison, toujours ouverte, laisse à tous les citoyens un accès facile, et soit un asile assuré pour tous ceux qui ont besoin de lui ; qu'il fasse paraître son humanité, non seulement en s'employant pour leurs affaires, mais encore en partageant leurs chagrins et leur joie ; qu'il donne aux particuliers des conseils salutaires ; qu'il défende leurs causes sans intérêt, et travaille avec douceur à réconcilier les époux et les amis ; qu'il n'emploie pas la moindre partie du jour au barreau et au conseil, pour attirer à lui, le reste du temps, les affaires et les négociations utiles ; mais que, l'esprit toujours tendu aux affaires publiques, il regarde l'administration, non comme un prétexte d'oisiveté, mais comme un ministère et un travail continuels. Un de ses premiers devoirs, dit encore Plutarque, est de faire régner entre les citoyens l'accord et la bonne intelligence; de bannir du milieu d'eux les disputes, les dissensions et les inimitiés; de leur faire comprendre qu'en pardonnant les injures on se montre bien supérieur à ceux qui veulent tout ravir de force ; qu'on l'emporte sur eux, non seulement par la douceur et la bonté, mais encore par le courage et la grandeur d'âme ; qu'enfin c'est bien souvent par des querelles qu'occasionnent des intérêts particuliers que les séditions s'allument dans les villes, comme les plus grands incendies commencent presque toujours par une lampe qu'on aura oublié d'éteindre, ou par de la paille qu'on laisse brûler. Heureuses les villes dont les magistrats sont remplis de ces sentiments et se conduisent par ces principes !
29 X. Son respect connu pour la religion, son zèle à en observer les cérémonies et les sacrifices, lui liront conférer la grande prêtrise d'Apollon : ministère honorable qu'il exerça pendant un grand nombre d'années, et, à ce qu'il paraît, jusqu'à la fin de sa vie. Une de ses fonctions était de présider aux jeux qui se célébraient à chaque pythiade (14) en l'honneur de ce Dieu. La dignité et l'importance de ce sacerdoce ne l'empêchèrent pas de se charger, dans sa petite ville, d'emplois tien moins relevés ; et il ne croyait pas se rabaisser en s'occupant des plus petits détails de la police extérieure. « Je prête à rire aux étrangers qui viennent à Chéronée, nous dit-il lui-même, lorsqu'ils me voient souvent en public, occupé de pareils soins... Mais je réponds à ceux qui me blâment d'aller voir mesurer de la brique, charger de la chaux et des pierres : Ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour ma patrie. Il y aurait peut-être de la bassesse à un homme d'état de s'occuper pour lui-même de ces sortes de soins ; mais quand il le fait pour le publie, loin d'avoir à en rougir, il s'honore, en donnant son attention aux moindres choses (15).» On a dit que Plutarque avait été honoré par Trajan de la dignité consulaire ; ce qui ne doit s'entendre que d'un consulat honoraire, tel qu'il était d'usage de le conférer dans ces temps-là. On joint à cette première distinction celle de l'intendance de la Grèce et de l'Illyrie, dont cet empereur avait, dit-on, assujetti les magistrats à ne rien faire que de l'avis de Plutarque. Quelques auteurs nient ce fait, fondés sur le silence de ce philosophe, qui n'en a rien dit dans ceux de ces ouvrages qui nous restent, quoiqu'il ait eu plusieurs occasions naturelles d'en parler. Le soin qu'il a de ne laisser ignorer aucun des emplois qu'il avait exercés dans sa patrie fait croire qu'il n'aurait pas manqué d'en témoigner dans ses écrits sa reconnaissance à Trajan. Ceux qui veulent qu'il ait été précepteur de ce prince ne trouvent, ni dans Plutarque lui-même, ni dans les anciens qui ont parlé de lui, rien qui autorise leur opinion ; et ce silence paraît une preuve sans réplique à ceux qui sont d'un avis contraire. Peut-être concilierait-on ces deux sentiments opposés, en disant que si Plutarque n'a pas été 30 l'instituteur de Trajan, ce qui en effet n'est pas aisé à prouver, il a pu, pendant son séjour à Rome, donner à ce prince, qui aimait à s'instruire, des leçons particulières de philosophie et de politique, soit avant qu'il montât sur le trône, soit depuis qu'il fut parvenu à l'empire. Quoi qu'il en soit, cette marque de confiance, glorieuse pour le philosophe, n'aurait pas fait moins d'honneur au choix du prince.
XI. Le séjour d'Athènes offrait à un homme de lettres bien des charmes propres à l'y attacher. La gloire dont jouissait encore cette ville célèbre ; le voisinage d'Eleusis, consacré par les plus grands mystères de la Grèce, objet si touchant pour une âme religieuse ; les bords charmants de l'Ilissus, dont Platon a fait une peinture si délicieuse ; surtout ses liaisons intimes avec les savants illustres dont cette ville était le rendez-vous ; tout semblait devoir l'y fixer. Mais, d'un autre côté, la réputation de Rome, sa grandeur, sa magnificence, le titre de capitale du monde, et, plus que tout sans doute, le désir de connaître par lui-même l'histoire et les mœurs des Romains célèbres, que vraisemblablement il avait déjà formé le dessein de comparer avec les grands hommes de la Grèce, le déterminèrent à y aller faire quelque séjour. L'époque de ce voyage est incertaine ; mais l'opinion la plus probable la fixe aux dernières années de l'empire de Vespasien, vers l'an 79 de J.-C. Il s'y rendit bientôt célèbre par ses connaissances, par sa vaste érudition, par les conférences publiques qu'il y faisait sur toutes les parties de la philosophie et de la littérature. II paraît que ces dissertations ont été comme le premier fond des divers Traités qu'il composa depuis, et qui forment la collection nombreuse de ses Oeuvres Morales. Parmi les Romains illustres qui fréquentaient ses leçons, et qui conçurent pour lui un attachement durable, on distingue Sossius Sénécion, qui fut quatre fois consul, celui à qui il a dédié les Vies des grands Hommes; et Arulénus Rusticus, homme d'une grande naissance et d'un mérite plus grand encore, que Domitien fit mourir par l'envie qu'il portait à sa vertu. Plutarque rapporte un trait qui prouve la considération que ce sénateur avait pour lui, et l'empressement avec lequel on écoutait ses leçons : « Un jour, dit-il, que je parlais en public à Rome, Rusticus était au nombre des auditeurs. Au milieu de la conférence, un soldat vint lui apporter une lettre de l'empereur (16). Il se fit à l'ins- 31 stant un grand silence, et moi-même je m'interrompis, afin de lui laisser lire ses dépêches; mais il n'en voulut rien faire, et il n'ouvrit sa lettre que lorsque la leçon fut finie et les auditeurs retirés ; ce qui lui attira l'admiration de tout le monde (17). »
XII. On ne sait pas s'il fit un long séjour à Rome. Un des auteurs qui ont écrit sa Vie (18) croît qu'il y passa quarante ans, et que ce fut dans ce long espace de temps qu'il acquit cette grande connaissance de l'histoire et des coutumes des Romains consignées dans les Vies des grands Hommes, dans les Questions romaines, et dans quelques autres de ses ouvrages : mais il paraît Impossible qu'il ait séjourné si longtemps à Rome. Il se retira d'assez lionne heure dans sa patrie, et y fit sa résidence ordinaire le reste de sa vie. Il dit lui-même qu'il était né dans une petite ville, et que, pour l'empêcher de devenir plus petite, il aimait à s'y tenir. Il avait passé tout le temps de sa jeunesse à Chéronée ou à Athènes, et ne devait pas avoir moins de trente ans lorsqu'il alla pour la première fois à Rome ; il en aurait donc eu soixante-dix lorsqu'il serait venu se fixer à Chéronée, et il n'aurait pu dire alors qu'il aimait à se tenir dans sa petite ville, puisqu'il ne s'y serait retiré que vers la fin de sa vie. D'ailleurs, il nous apprend, dans la Vie de Démosthène, que, détourné par des affaires publiques et particulières, il n'eut pas le temps, pendant son séjour à Rome, de s'appliquer à l'étude de la langue latine, et d'en acquérir une profonde connaissance. S'il eût passé quarante ans de sa vie dans cette ville, il eût été difficile, même avec les affaires les plus multipliées et les plus importantes, qu'il ne se fût pas instruit à fond d'une langue qu'il aurait entendu parler si longtemps : mais il n'avait pas besoin d'un si long séjour pour apprendre l'histoire, les mœurs et les coutumes des Romains ; il devait en avoir déjà une première connaissance. Cette histoire était, depuis plusieurs siècles, trop liée avec celle de la Grèce, pour que son étude n'entrât pas dans l'éducation de toutes les personnes honnêtes. M. Dacier croit donc que tout le temps de son séjour ne passa pas vingt-deux ou vingt-trois ans, et que même dans cet intervalle il fit quelques voyages en Grèce. Ce sentiment est bien plus vraisemblable. S'il ne fût retourné dans sa patrie que vers l'âge de soixante-dix ans. il n'aurait guère été en état de vaquer aux emplois de police dont il y fut chargé, et il n'aurait pas 32 dit, qu'ayant déjà exercé pendant plusieurs pythiades le ministère de prêtre d'Apollon, il était encore très en état d'en remplir les fonctions sans fatigue.
XIII. On croit que ce fut dans un de ses voyages de Rome en Grèce qu'il se maria ; mais on ne sait pas à quel âge. Corsini, sur des motifs assez légers, conjecture qu'il avait alors cinquante ans : j'ai peine à croire qu'il eût attendu si tard à se marier ; et je pourrais en trouver des preuves dans les écrits mêmes de Plutarque, si cette question méritait d'être approfondie. Il épousa une femme de Chéronée, nommée Timoxène, fille d'un Aristion dont il est parlé dans les Propos de table (19). » Le mariage est une des circonstances qui influent le plus sur la destinée des hommes ; il décide presque toujours du reste de leur vie. Plutarque eut le rare avantage de trouver dans Timoxène toutes les qualités de l'esprit et du cœur qui pouvaient le rendre heureux : le portrait qu'il en fait lui-même, après plusieurs années de mariage, montre qu'elle joignait à une âme élevée, à un caractère ferme et supérieur à toutes les faiblesses de son sexe, une douceur, une modestie, une simplicité qui lui conciliaient tous les cœurs. S'il est vrai, comme M. Dacier le pense, que Plutarque, dans ses Préceptes du Mariage, n'ait fait que retracer ce qui se pratiquait dans sa maison, on peut dire qu'il réunissait tous les avantages que les hommes désirent le plus : la gloire solide qui suit les grands talents, et les jouissances douces et pures qui sont attachées aux vertus domestiques. Quels témoignages de tendresse il donne à sa femme dans un de ses ouvrages (20) ! avec quelle satisfaction et quelle complaisance il parle de ses vertus ! Un tel attachement de la part du mari ne permet pas de douter qu'il ne trouvât dans sa femme cette réciprocité de confiance et d'amour qui faisait leur bonheur mutuel.
XIV. Une heureuse fécondité vint augmenter encore les charmes de leur union. Ils eurent d'abord quatre fils, que Plutarque nous a tous fait connaître dans ses écrits : Autobule, l'aîné des quatre ; Charon, qui mourut dans son enfance ; Lamprias et Plutarque, qui lui survécurent, et dont le premier nous a laissé le catalogue de tous les ouvrages de son père. Corsini lui donne un cinquième fils, qu'il croît avoir été l'aîné ; mais il ne dit pas sur quelle autorité il fonde ce sentiment, et je ne vois rien dans Plutarque qui puisse l'autoriser.
Après ces quatre fils, Timoxène lui donna une fille qu'ils avaient l'un et l'autre longtemps désirée, et qu'ils eurent le malheur de perdre à l'âge de deux ans. Cette mort les affligea vivement ; mais ils la soutinrent l'un et l'autre avec un courage égal. La lettre que Plutarque, alors absent, écrivit à sa femme pour la consoler, est à la fois un monument de la fermeté de leur âme et de la bonté de leur cœur. Il y fait un portrait intéressant du bon naturel que cet enfant avait annoncé dès l'âge le plus tendre : mais il faut le voir tracé de la main même de Plutarque ; il y a peint son propre caractère. « Vous, savez, écrit-il à sa femme, que cette fille... m'était d'autant plus chère que j'avais pu lui faire porter votre nom. Outre l'amour naturel qu'on a pour ses enfants, un nouveau motif de regrets pour nous, c'est la satisfaction qu'elle nous donnait déjà ; c'est son caractère bon et ingénu, éloigné de toute colère et de toute aigreur. Elle avait une douceur admirable et une rare amabilité : le retour dont elle payait les témoignages d'amitié qu'on lui donnait, et son empressement à plaire, me causaient à moi-même le plus vif plaisir, et me faisaient connaître la bonté de son âme. Elle voulait que sa nourrice donnât le sein, non seulement aux enfants qu'elle aimait, mais encore aux jouets dont clic s'amusait ; appelant ainsi, par un sentiment d'humanité, à sa table particulière toutes les choses qui lui donnaient du plaisir, et voulant leur faire part de ce qu'elle avait de « meilleur (21). »
XV. Ce n'est pas la seule occasion où Plutarque ait montré sa tendresse paternelle ; on en voit d'autres preuves dans le ton affectueux qu'il prend avec ses fils lorsqu'il s'entretient avec eux. Remplissant avec tant de fidélité tous les autres devoirs que la nature et le sang lui inspiraient : bon fils, bon frère et bon mari, aurait-il pu négliger un sentiment si profondément gravé dans le cœur de tous les hommes, et qu'il est si doux de satisfaire ? Son Traité sur l'éducation des enfants en est une preuve sensible : c'est un de ses meilleurs ouvrages, par la sagesse, par l'humanité des préceptes qu'il contient ; et quoiqu'en ce genre, comme en tout autre, il soit beaucoup plus aisé de bien dire que de bien faire, il a traité ce sujet important de manière à nous convaincre que le cœur lui a dicté, plus encore que l'esprit, les règles qu'il trace pour porter les enfants au bien. Elles 34 respirent la douceur, la bonté, l'indulgence; et l'on peut conjecturer qu'il n'a fait qu'exposer dans cet ouvrage le plan qu'il suivait pour l'éducation de ses enfants. En général, tout ce qu'on connaît de Plutarque nous donne l'idée la plus avantageuse de l'excellence de son caractère, de sa sagesse, de sa modération, de la paix qui régnait dans son intérieur, et de son affection pour tout ce qui l'entourait. Il poussait cette sensibilité jusqu'à ne pas vouloir se défaire des animaux qui avaient vieilli à son service, et qu'il laissait mourir paisiblement dans leurs étables. « A plus forte raison, dit-il dans la Vie de Caton le Censeur, me garderais-je de renvoyer un vieux domestique, de le chasser de ma maison, comme de sa patrie, de l'arracher à ses habitudes, à sa manière de vivre, d'autant qu'il serait aussi inutile à celui qui l'achèterait, qu'à moi qui l'aurais vendu. »
XVI. Mais cette douceur et cette humanité, qui honorent son cœur, n'empêchaient ni la fermeté dont il avait besoin pour tenir ses esclaves dans l'ordre, ni même la sévérité dont il usait quelquefois contre ceux qui s'en étaient écartés. Aulu-Gelle en rapporte un trait qu'il tenait du philosophe Taurus, contemporain et ami de Plutarque, et dans lequel il démentit ce caractère de bonté dont il faisait profession : « II avait un esclave d'un naturel méchant, et qui avait quelque teinture de philosophie. Un jour que cet homme avait fait une faute considérable, son maître ordonna qu'on le châtiât. Pendant qu'on le frappait, il se mit à jeter des cris, en se plaignant de l'injustice du châtiment qu'on lui faisait souffrir. Comme on continuait toujours, il change de ton, et, au lieu de se plaindre, il fait à son maître les plus sérieuses réprimandes ; il lui dit qu'il se pare faussement du nom de philosophe ; qu'après avoir souvent parlé contre la colère, il se livre à cette passion honteuse, dément par sa conduite les préceptes qu'il a donnés dans ses écrits, et fait déchirer à coups de fouet, sous ses yeux, un malheureux esclave. — Comment, coquin ! lui répondit Plutarque avec beaucoup de tranquillité, à quoi juges-tu que je sois en colère ? Ma voix, mon visage, ma couleur, portent-ils l'empreinte de cette passion ? mes yeux et ma bouche marquent-ils que je sois hors de moi-même ? m'entends-tu pousser des cris de fureur, et dire des paroles dont je puisse avoir à me repentir? En disant ces mois, il se tourne vers celui qui châtiait l'esclave : Mon ami, lui dit-il, pendant que nous disputons lui et moi, continue ton 35 office. » Pn pourra soupçonner, dans ces derniers mots, une ironie cruelle, qui démentirait le caractère humain qu'on attribue à Plutarque. Car l'homme qu'on punit peut tien ne pas mériter de pardon ; mais, dès qu'il souffre, il ne doit pas être l'objet de la raillerie. M. Dacier trouve dans cette tranquillité tout ce qu'on pourrait attendre de la fureur la plus marquée, et croit que son humanité aurait du souffrir d'assister lui-même à cette punition. Il est certain qu'on voit avec peine Plutarque être témoin d'une pareille exécution, et y conserver autant de sang-froid. Il paraît cependant que, naturellement doux envers ses esclaves, ce fut pour céder aux représentations de sa femme et de ses amis, qui blâmaient sa trop grande douceur, qu'il commença à s'aigrir contre leurs fautes, et à les faire punir sur-le-champ ; mais ensuite, ayant reconnu, comme il nous l'apprend lui-même (22), qu'il valait encore mieux que son indulgence les rendit pires, plutôt que de se pervertir lui-même, et que la douceur réformait plus efficacement que la punition, il réuni, à la bonté de soit naturel.
XVII. Il jouissait d'une fortune assez considérable, et, tenait un grand état à Chéronée. On ne peut en douter après ce qu'il écrit à sa femme dans cette lettre de consolation que nous avons déjà citée. « Ne vous arrêtez pas, lui dit-il, aux larmes et aux gémissements de ceux qui viennent, par l'effet d'une mauvaise habitude, partager votre douleur. Pensez plutôt combien ils vous envient vos enfants, votre maison et votre genre de vie. Tandis que tant .d'autres accepteraient votre condition, même avec le malheur que nous venons d'éprouver, serait-il raisonnable que vous en parussiez mécontente, et que, dans l'impatience que vous causerait un seul accident fâcheux, vous fussiez insensible à tous les avantages qui vous restent ? » On doit juger encore de l'aisance dans laquelle il vivait, par le bonheur qu'il eut de ne jamais emprunter. Dans un traité qui a pour titre : Qu'il ne faut pas emprunter à usure, après avoir peint avec force la rapacité des usuriers, il ajoute : « Ne croyez pas, quand je parle ainsi, que j'aie des motifs personnels de vengeance contre les usuriers ; ils n'ont jamais emmené mes bœufs ni mes chevaux. » Cette heureuse indépendance pouvait bien être aussi l'effet de la sagesse de son administration domestique, plus encore que celui 36 de sa richesse. Car on a vu, dans tous les temps, les gens les plus riches se rendre les esclaves des usuriers, et en devenir souvent les victimes. Au contraire, une honorable économie fournit à une dépense considérable, et donne même de grands moyens de bienfaisance, en faisant retrouver dans la frugalité ce qui manque du côté de la fortune (23).
XVIII. Nous n'avons pas plus de certitude sur l'année de la mort de Plutarque que sur celle de sa naissance. Les anciens gardent le silence sur ce point, et les opinions des modernes sont partagées : les uns le font mourir dans les premières années du règne d'Adrien, vers l'an 120 de J.-C.; d'autres, sur la fin de ce règne, l'an 134 de notre ère. Il y en a qui reculent sa mort jusqu'au règne d'Antonin, ce qui lui donnerait quatre-vingt-neuf ou quatre-vingt-dix ans de vie. Quelques-uns ne le font vivre que soixante-douze ou soixante-quinze ans ; mais tous n'appuient leurs sentiments que sur des probabilités et des conjectures fort incertaines, qu'il est facile de détruire et non de remplacer par de meilleures. Je n'entrerai pas dans cette discussion, qui, ne pouvant mener à rien de certain, aurait peu d'intérêt pour le lecteur. Je dirai seulement que le nombre prodigieux d'ouvrages que Plutarque a composés, et comme historien et comme philosophe, fait croire qu'il a poussé loin sa carrière. Quoiqu'il écrivît avec une facilité qui a nui à la perfection de ses ouvrages, il en est un grand nombre qui ont demandé des recherches longues et pénibles, et qui n'ont pu être que le fruit lent du travail et des années.
XIX. Il entre nécessairement dans l'histoire d'un homme de lettres de faire connaître le mérite et l'utilité de ses ouvrages. J'ai déjà jugé Plutarque comme historien ; il me reste à l'apprécier comme philosophe. Il n'a, sous ce dernier rapport, ni la même réputation, ni le même mérite. Quels droits cependant n'a pas à notre estime un écrivain laborieux qui fit un emploi si utile de ses talents et de ses connaissances ? Né dans un siècle où la philosophie ne comptait plus guère parmi ses disciples, ou que des athées, ennemis déclarés de toute religion et de toute morale, ou des esprits exagérés dans leurs principes, qui poussaient jusqu'à une rigueur désespérante la règle des devoirs, il suit éviter avec prudence ce double écueil. Il conserva 37 toujours la modération dans la sagesse, qualité si rare et si difficile (24). Il n'enseigna qu'une philosophie douce et raisonnable, indulgente avec fermeté, conciliante sans mollesse, invariable dans les principes, mais accommodante sur les défauts, qui ne transige jamais avec les passions, mais qui ménage l'homme faible pour gagner sa confiance, et le mener à la vertu par la persuasion. Tous ses écrits respirent une morale bienfaisante, amie de l'humanité, uniquement dirigée vers le bonheur des hommes, et qui leur en montre la vraie route en leur faisant voir leur intérêt dans la fuite du mal et dans l'amour du bien. On ne peut les lire sans se sentir mal avec ses vices, sans rougir de ses passions, sans désirer de devenir meilleur. Il n'est, sans exception, aucun philosophe de l'antiquité dont les principes soient généralement plus vrais, les maximes plus raisonnables, les règles de conduite plus sages, plus utilement ramenées à la pratique de nos devoirs ; et si l'on excepte son sentiment sur le suicide, qu'il parait approuver, sa morale n'a rien que la raison la plus sévère ne puisse. approuver.
XX. Une des qualités qui le distinguent le plus, c'est un esprit judicieux, impartial, ami du vrai, et équitable dans ses jugements ; mais ce caractère, qu'il a constamment soutenu dans les Vies des grands Hommes, se trouve bien démenti dans deux de ses ouvrages de morale, où l'on ne reconnaît plus sa sagesse ni sa modération, et qui prouvent à quel excès les meilleurs esprits peuvent se laisser emporter quand une fois la prévention les égare. La première occasion où il s'est montré si différent de lui-même, c'est dans le jugement qu'il a porté de l'Histoire d'Hérodote, non sous le rapport de la composition et du style, car à cet égard il en fait le plus grand éloge ; mais sur le fond même, qu'il taxe de mensonge et de fausseté, et sur le caractère de l'historien, qu'il accuse d'une méchanceté réfléchie. On pourrait dire, pour diminuer le tort de Plutarque, qu'un jugement si contraire à la vérité avait pris sa source dans un motif honnête : ce fut l'amour de sa patrie qui le rendit injuste. Mais ce sentiment, tout vertueux qu'il est, ne saurait excuser l'excessive partialité qui éclate dans tout son ouvrage, et qui lui a fait distiller toute son amertume contre l'historien le plus digne de notre estime. Hérodote, dans le récit de la bataille de Platée, avait dit que les Béotiens, après avoir fait alliance 38 avec Xerxès, s'étaient battus contre les Grecs confédérés, avec autant d'acharnement que les Barbares eux-mêmes. Plutarque, trop sensible au déshonneur que ce récit faisait rejaillir sur ses ancêtres, a voulu les venger, non en s'inscrivant en faux contre des faits trop connus de toute la Grèce pour oser les contredire, mais en suivant une route différente; il entreprend une critique générale de l'ouvrage de cet historien, et s'efforce de rendre suspect de partialité, de mauvaise foi, de méchanceté, l'écrivain le plus exact et le plus équitable. Il voulait par là affaiblir le témoignage qu'Hérodote avait rendu contre les Béotiens ; et il n'a pas senti qu'il ne faisait que réveiller l'attention de ses lecteurs sur la trahison de ses ancêtres, et confirmer un témoignage qu'il ne pouvait convaincre de fausseté. Ce qui prouve jusqu'à quel point la prévention l'aveugle, c'est qu'il est tombé dans les défauts qu'il reproche à Hérodote. Il ne loue d'abord les qualités de son style que pour enfoncer plus avant les traits amers de sa censure. Il prétend que le naturel et l'agrément de sa diction ne sont qu'un masque trompeur qui cache les intentions les plus coupables et les plus perfides. Je n'entrerai pas ici dans la justification du père de l'histoire; . je l'ai fait ailleurs avec beaucoup d'étendue, et j'y renvoie mes lecteurs (25).
XXI. Un second trait de l'injustice de Plutarque, c'est sa partialité contre les stoïciens. J'ai déjà dit qu'il avait embrassé la secte de l'Académie ; et il s'y était attaché avec ce zèle qu'inspire ordinairement aux âmes vertueuses la persuasion qu'elles possèdent la vérité. Plutarque le poussa jusqu'à l'intolérance d'opinions à l'égard de quelques autres sectes. Il avait voué surtout l'opposition, je dirai presque l'antipathie la plus déclarée aux philosophes du Portique, plus encore qu'à leur école. Non content de combattre leurs principes, il cherche à couvrir leurs personnes de ridicule et de mépris, à les faire passer pour des profanateurs de la vraie philosophie, qui semblaient avoir 39 pris à tâche de renverser les notions communes de la raison et du bon sens que la nature a mises dans tous les hommes. Il faut bien se garder de juger des stoïciens d'après les écrits que Plutarque a publiés contre eux. Ce n'est pas un exposé de leur doctrine qu'il y présente, pour la combattre ensuite par les armes du raisonnement : il choisit dans les nombreux ouvrages sortis de leur école les endroits les plus faibles ; il rapproche les passages contradictoires de ces philosophes ; et c'est d'après un choix si partial qu'il leur reproche d'être en contradiction avec eux-mêmes, et de détruire tous les principes que nous tenons de la nature. Mais l'antiquité n'a pas si mal pensé de cette école célèbre, qui a produit tant de grands hommes, tant d'écrivains distingués. Cicéron en particulier loue la beauté de leur morale et la sagesse de leurs maximes. En convenant qu'ils ont quelquefois outré leurs principes, il les excuse par cette réflexion judicieuse, que le désir de la perfection a été la source de cette excessive sévérité dont ils faisaient profession. Sachant que les hommes sont toujours portés à retrancher de leurs devoirs et à les mesurer sur leur faiblesse, ils avaient passé le but, afin qu'en faisant de plus grands efforts pour y atteindre, on parvint au moins au terme qui en approcherait le plus.
XXII. Une autre secte de philosophes que Plutarque n'a pas attaquée avec moins de zèle, ce sont les disciples d'Épicure ; mais on ne peut lui reprocher ici ni la même partialité, ni la même injustice. Quoique plusieurs écrivains de l'antiquité aient donné de grands éloges à la conduite et à la doctrine d'Épicure, d'autres auteurs non moins dignes de foi l'ont peint comme un libertin d'esprit et de cœur, qui n'eut ni religion ni vertu, Il paraît difficile, d'après des témoignages si opposés, d'avoir une opinion fixe sur le fondateur de l'épicurisme ; mais ils suffisent pour ne pas accuser Plutarque de prévention, dans la guerre qu'il a livrée à sa morale et à ses dogmes : d'ailleurs c'est presque toujours dans les écrits d'Épicure qu'il prend la matière de ses accusations et de sa censure. Ceux qui veulent justifier ce philosophe entendent des plaisirs de l'âme, cette volupté dans laquelle il faisait consister le bonheur. Mais les maximes que Diogène Laërte nous a conservées de lui dans sa vie, et qu'Epicure donnait pour autant de sentences et de dogmes, ne permettent pas , ce semble, de douter qu'il n'eût dans ses principes et dans sa morale les opinions les plus capables de scandaliser tous ceux qui conservaient 40 quelque respect pour la religion et pour les mœurs. Je n'en citerai qu'une seule pour mettre les lecteurs à portée d'en juger. « Si tout ce qui flatte les hommes dans leurs plaisirs arrachait en même temps de leur esprit la terreur qu'ils conçoivent des choses qui sont au-dessus d'eux, la crainte des dieux, et ces alarmes que donne la pensée de la mort, et qu'ils y trouvassent le secret de savoir désirer ce qui leur est nécessaire pour bien vivre, j'aurais tort de les reprendre, puisqu'ils seraient au comble de tous les plaisirs, et que rien ne « trouverait en aucune manière la tranquillité de leur situation. »
Quoi qu'il en soit du personnel d'Épicure, il est certain que ses disciples étaient justement décriés pour leur morale et pour leur conduite; que du temps de Plutarque ils en étaient venus au point de tenir école ouverte d'impiété, de traiter de fable toutes les opinions religieuses que les autres philosophes enseignaient ; et comme c'est contre eux que Plutarque dirigeait ses attaques, bien plus que contre Epicure, qui était mort depuis quatre cents ans, on ne saurait blâmer le zèle ardent avec lequel il les a combattus.
XXIII. Entre les divers reproches qu'on fait à Plutarque, il en est deux que je ne puis, comme historien de sa vie, me dispenser de discuter. On l'accuse de crédulité et de superstition. On fonde la première imputation sur sa facilité à croire et à raconter des faits qui paraissent impossibles ou hors de toute vraisemblance. Par exemple, il rapporte que Pyrrhus, d'un coup de son cimeterre, fendit en deux un cavalier armé de pied en cap, et que les deux moitiés de son corps tombèrent chacune de leur côté. On regarde un pareil fait d'armes comme au-dessus des forces humaines : c'est le jugement que tout le monde en portera au premier coup d'œil. Cependant l'avantage que la position du lieu pouvait donner à Pyrrhus sur son ennemi, la trempe de son arme, la force qu'avait acquise un prince naturellement robuste, et endurci de bonne heure par les plus rudes exercices, toutes ces considérations ne rendent-elles pas le fait vraisemblable ? Ne voyons-nous pas encore aujourd'hui des hommes faire des traits de force qui ne paraissent pas croyables ? Et dans ces temps-là les hommes, les guerriers surtout, recevaient une éducation bien différente de la nôtre, et qui pouvait doubler, tripler même leurs forces naturelles. La manière dont Plutarque raconte la délivrance de Rome par Camille, au moment où elle était, pour ainsi dire, dars la balance avec l'or de sa ran- 41 çon, a paru encore, à ces mêmes critiques, tenir trop du merveilleux pour n'en pas suspecter la vérité. Ce qui autorise ce soupçon, c'est que Polybe, historien exact et judicieux, rapporte que pendant que les Gaulois tenaient le Capitole assiégé, ils apprirent l'invasion des Vénitiens dans leur pays, firent la paix, et se retirèrent. Il est certain que, dans le récit de Plutarque, tous les événements tiennent moins de la simplicité d'une narration historique, que du merveilleux d'un poème. Mais est-ce la seule occasion où les faits les plus surprenants, les plus inattendus, ont eu cependant une certitude incontestable? D'ailleurs, ici Plutarque a pour garant Tite-Live, qui raconte ces événements avec les mêmes circonstances. Je ne vois pas comment Polybe, né en Grèce, aurait pu être mieux instruit sur les faits de l'histoire romaine que Tite-Live, né en Italie, et qui, pour remplir un plan aussi vaste que le sien, avait dû consulter les monuments les plus anciens, et puiser dans toutes les sources. M. Dacier avait déjà justifié Plutarque de cette injuste accusation.
XXIV. Le reproche de superstition, plus grave en soi, n'est pas mieux fondé. Plutarque, dit-on, raconte avec une exactitude puérile les prodiges les plus incroyables et les plus absurdes ; il voit dans les événements les plus simples des signes de la protection ou de la vengeance des dieux. Mais un historien exact ne doit-il pas rapporter tout ce qui peut faire connaître l'esprit des peuples dont il écrit l'histoire? Et quoi de plus propre à donner cette connaissance que l'opinion qu'ils avaient de ces prodiges, dont l'existence n'était pas douteuse pour eux, et qu'ils attribuaient à la divinité? Plutarque les raconte tels qu'il les a trouvés dans les historiens qui l'ont précédé. Doit-on en conclure qu'il y ajoutait foi, quand il n'accompagne son récit d'aucune réflexion qui le prouve ? que dis-je, quand souvent même il y joint des réflexions judicieuses qui montrent quelles étaient à cet égard sa sagesse et sa retenue ? Je pourrais citer plusieurs passages où il s'exprime avec beaucoup de force sur cette crainte superstitieuse que la vue de certains phénomènes excite dans l'âme de ceux qui en ignorent les causes ; je me contente d'indiquer au lecteur ce qu'il observe à ce sujet dans la Vie de Périclès, chap. VI. D'ailleurs, plusieurs de ces prétendus prodiges sont reconnus aujourd'hui pour des effets naturels, peu ordinaires à la vérité, et que les anciens ne regardaient comme des miracles que parce qu'ils ne pouvaient en 42 assigner les causes. Ces pluies de sang, dont ils étaient si effrayés, arrivent encore quelquefois, et ne sont autre chose que des insectes rouges fort petits, ou des vapeurs de la même couleur, qui retombent sur la terre. Le vulgaire peu instruit les prend pour des gouttes de sang, et les regarde comme un prodige qui lui paraît du plus sinistre présage. Aristote, qui n'était ni un ignorant ni un esprit superstitieux, parle, au rapport de Plutarque, d'une pierre tombée du haut des airs, et n'assigne aucune cause de cette chute. Pour justifier pleinement Plutarque de cette accusation injuste, il suffit de lire son Traité contre la superstition. Il est impossible de mieux faire sentir les dangers de cette crainte avilissante, de peindre avec plus de force le malheur des âmes superstitieuses, les angoisses, les terreurs qui les agitent, et ne leur laissent pas un seul instant de repos. Ceux qui accusent Plutarque ne combattraient pas la superstition avec des armes plus puissantes, et n'en parleraient pas aussi sagement que lui.
XXV. Quel a donc pu être le motif ou le prétexte de ce reproche si souvent répété de nos jours ? Il n'est pas difficile à connaître quand on a lu ses ouvrages. Plutarque était religieux ; il respectait, il honorait les dieux ; il remplissait fidèlement tous les devoirs que la raison naturelle prescrit à l'homme à l'égard du Dieu qu'elle lui fait connaître comme l'auteur de tous les biens. Il a parlé de la divinité en des termes si magnifiques et si sublimes, qu'on est tenté de croire qu'il connaissait nos livres saints, et que c'est à cette source pure qu'il a puisé ces grandes idées qu'on ne trouve dans aucun autre philosophe de l'antiquité, sans en excepter Platon lui-même, quelquefois si étonnant par les traits de lumière qu'il laisse échapper sur ce sujet. Voilà la vrai cause de ce dépit secret qui arme nos sophistes modernes contre un philosophe estimable, à qui ils ne pardonnent pas ses sentiments religieux. Un nouveau grief contre lui, c'est qu'après avoir vivement combattu la superstition, il a encore moins ménagé l'athéisme. De son temps, la Grèce était inondée d'un déluge de sophistes qui, sous le nom fastueux de philosophes, étaient les ennemis de la véritable sagesse, et faisaient gloire de leur impiété ; ils s'efforçaient d'anéantir toute idée de la divinité, pour détruire avec elle toute morale et toute justice : Plutarque osa les attaquer avec courage, et opposer à ce torrent dévastateur la fermeté et la sagesse de ses principes : il compara les athées avec les superstitieux, et fit voir que l'athéisme 43 n'est pas un moindre mal que la superstition ; qu'il est même plus dangereux dans ses suites, plus funeste par son influence sur les corps politiques, à qui le frein de la religion est si nécessaire pour contenir la multitude, qui ne trouve dans les lois qu'une faible barrière à ses passions, quand la pensée de la divinité ne vient pas la frapper d'une crainte salutaire, et commander à sa conscience. S'étonnera-t-on, après cela, que nos sophistes traitent Plutarque d'esprit faible et superstitieux ?
XXVI. J'ai dit que ce philosophe avait eu sur la divinité des idées plus pures qu'aucun des autres philosophes les plus éclairés. C'est, ce me semble, une partie intégrante de sa vie, que de faire connaitre ses sentiments sur un point si important. « Dieu, dit-il, est nécessairement, et son existence est hors du temps. Il est Immuable dans son éternité; il ne connaît pas la succession des temps... seul il EST ; son existence est l'éternité; et, par la raison qu'il EST, il EST , véritablement. On ne peut pas dire de lui qu'il a été, qu'il sera, qu'il a eu un commencement, et qu'il aura une fin... il n'y a pas plusieurs dieux; il n'y en a qu'un seul ; et ce Dieu n'est pas, comme chacun de nous, un composé de mille passions différentes... ce qui EST par essence ne peut être qu'un ; et ce qui est un ne peut pas ne point exister. S'il y avait plusieurs dieux, l'existence en serait différente, et cette diversité produirait ce qui n'a pas une véritable existence... Afin de nous former ici-bas, comme dans la plus belle des visions, une juste idée de ce Dieu, donnons l'essor à nos esprits, et élevons nos pensées au-dessus de tout ce que la nature , renferme... Quant aux émanations de ce Dieu hors de lui-même, à ces changements par lesquels il devient feu . .terre, mer, animal ou plante... c'est une impiété que de l'entendre. » Ce passage, et quelques autres qui se trouvent dans Plutarque et dans plusieurs anciens philosophes, me paraissent faits pour décider la question qui a divisé et qui divise encore les savants sur l'idée précise que les sages du paganisme avaient de la divinité. Les uns font de tous ces philosophes autant d'athées qui ne connaissaient d'autre Dieu que la nature, que la matière éternelle, qui, s'étant organisée par sa propre force, avait formé les êtres divers qui composent le monde. D'autres sont persuadés que la plupart des philosophes admettaient un Dieu intelligent, distingué essentiellement de la matière; qu'à la vérité ils 44 reconnaissaient comme principe des êtres des substances matérielles, telles que l'eau, l'air et le feu ; mais que par là ils n'entendaient que le principe passif et secondaire, que la cause matérielle dont les êtres ont été formés par la cause intelligente et spirituelle, principe unique et universel de tout ce qui existe. Il me semble que ce dernier sentiment est le seul admissible; et je ne vois pas comment on pourrait expliquer autrement, soit le passage de Plutarque qu'on vient de lire, soit ceux qu'on trouve dans plusieurs autres philosophes. Enfin, ce qui me paraît devoir trancher la question, c'est l'autorité même de saint Paul, qui reproche à ces philosophes qu'ayant connu par les ouvrages visibles de Dieu ses perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ont retenu la vérité dans l'injustice, en sorte qu'il sont inexcusables (26).
XXVII. Mais, dira-t-on peut-être, si Plutarque avait eu des idées si justes et si grandes de la divinité, serait-il resté toujours attaché aux erreurs de la philosophie païenne? n'aurait-il pas renoncé au culte absurde du polythéisme, pour faire ouvertement profession du dogme de l'unité d'un Dieu ? Il est sans doute étonnant qu'après la connaissance qu'il manifeste de la vraie nature de Dieu dans le passage que nous avons cité, il ait persévéré jusqu'à la fin de sa vie dans l'attachement à un culte aussi déraisonnable que celui de l'idolâtrie ; car, quoiqu'on ignore le genre de sa mort, il paraît, par le récit d'Artémidore (27), qu'il n'avait pas renoncé au paganisme. Cet auteur, qui florissait peu de temps après Plutarque, raconte que ce philosophe crut voir Mercure qui le conduisait au ciel ; et que le lendemain, pendant son sommeil, quelqu'un lui interpréta ce songe, et lui dit qu'il serait très heureux ; que monter au ciel, c'était le signe d'une grande félicité. Il tomba bientôt dans une maladie grave, et mourut peu de jours après. La manière dont il parle des juifs; les interprétations absurdes qu'il donne de plusieurs rites judaïques, qu'il confond avec le culte que les païens rendaient à Bacchus ; les calomnies qu'il répète, après d'autres auteurs, contre un peuple dont l'origine, la religion et les usages leur étaient si peu connus, prouvent que les idées exactes qu'il avait sur la divinité n'avaient pas influé sur ses autres opinions, et qu'il était toujours resté païen, au moins dans la pratique. Cette contradiction entre les principes et la conduite n'est pas rare, même 45 dans des philosophes. D'ailleurs, il faut, pour faire profession de la vérité, lors même qu'on la connaît, d'autres secours que ceux de la raison ; mais on ne peut trop regretter l'aveuglement d'un philosophe qui, par sa gravité, ses connaissances et ses mœurs, est peut-être celui qui a le plus approché de la morale chrétienne. De là les vers célèbres d'un évêque grec, cités par Corsini (28), lequel demandait à Dieu que s'il avait résolu de retirer des enfers quelques-uns des infidèles qui y étaient retenus, il accordât à ses prières le salut de Platon et de Plutarque, comme étant ceux qui avaient le plus approché de ses lois divines. Socrate et Cicéron ont été l'objet de semblables vœux.
XXVIII. Plutarque, en s'attachant de préférence à la morale, n'avait pas négligé les autres branches de la philosophie. On voit, par ses ouvrages, qu'il avait embrassé et même approfondi toutes les parties de cette science si étendue et si utile. La grande variété des objets qu'il a traités en forme naturellement des classes différentes. On peut les diviser, l° en ouvrages purement moraux; 2° en ouvrages de politique ; 3° en ouvrages de physique et de métaphysique ; 4° en traités de mythologie ; 5° en sujets de littérature ; 6° d'autres roulent sur les mœurs et les usages des anciens; 7° il y en a qui traitent de toutes sortes d'objets, et que j'appelle des mélanges ; 6° quelques-uns sont purement historiques ; 9° il y en a qui sont en partie historiques, en partie moraux; 10° d'autres enfin sont des recueils d'anecdotes et de bons mots. On voit, par cette division, que rien n'était étranger à Plutarque ; que son étonnante érudition avait tout embrassé, et qu'il possédait l'universalité des connaissances qu'on pouvait acquérir de son temps. Les traités de pure morale sont en général d'une lecture facile : ce sont aussi les plus intéressants, les plus agréablement écrits, ceux où la beauté de son âme se montre tout entière : ils annoncent une grande connaissance du cœur humain, dont ils développent jusqu'aux moindres replis; ils abondent en réflexions judicieuses, en pensées profondes, qui, comme il le dit lui-même d'un autre, sont trempées dans le bon sens. C'est peut-être le plus beau monument que la raison ait élevé à la vertu.
XXIX. Quoique tous les écrits de cette première classe aient un mérite réel, il y en a plusieurs qui doivent être distingués , et qui 46 réunissent à un degré éminent les qualités que je viens de marquer. De ce nombre est le Traité sur l'Education, où, dans un court espace, il a rassemblé tout ce qu'on peut dire de plus sensé, de plus judicieux sur cette importante matière. Celui où il donne des règles pour lire avec fruit les poètes semblerait d'abord devoir appartenir à la littérature : mais il a envisagé son sujet du côté de la morale, et, outre qu'il fait connaître la grande érudition de son auteur, il montre surtout comment il rapportait tout à la science des mœurs, et comment il savait y ramener les objets qui en paraissaient le plus éloignés. On pourrait regarder comme inutile de donner des préceptes sur la manière dont on doit écouter : ce sujet, qui paraît stérile au premier coup d'œil, devient, sous la main de Plutarque, un champ fécond des conseils les plus utiles à la jeunesse, et exprimés de la manière la plus agréable. Le Traité sur le discernement entre le flatteur et l'ami est admirable par la sagacité avec laquelle ce philosophe démêle les artifices du premier, et par les sages préservatifs qu'il donne pour se garantir des dangers de la flatterie, cette peste des mœurs. Mais celui qui a pour objet de juger des progrès qu'on a faits dans la vertu est le plus étonnant de tous par la sublimité et l'excellence de sa morale, par les règles sévères qu'il établit pour se connaître soi-même et pour juger ses actions. Il a aussi le mérite d'être un des mieux écrits, d'abonder en belles pensées, en riches comparaisons, en métaphores hardies, en images agréables. Sa Consolation à Apollonius sur la mort d'un fils moissonné à la fleur de son âge est un modèle de sensibilité, de douceur et de grâce ; de cette manière délicate avec laquelle on doit toucher à des blessures qui s'aigrissent ordinairement par les remèdes mêmes qu'on y applique. J'ai déjà fait connaître la lettre de Consolation à sa femme sur la mort de sa fille.
XXX. Dans les Préceptes de mariage, il a tracé les devoirs de cet état sous des emblèmes et des images ingénieux, et dans un style plein de douceur et d'aménité, qualités qu'il conseille aux époux, s'ils veulent que cette union fasse leur bonheur mutuel. Ses Préceptes de santé pourraient être regardés comme un ouvrage de médecine ; mais, par la manière dont il a envisagé son sujet, il appartient principalement à la morale ; il est d'ailleurs intéressant sous l'un et l'autre rapport. J'ai déjà dit avec quelle force de pinceau il avait tracé les caractères et les effets de la superstition : son Banquet des sept 47 Sages est une idée heureuse ; mais il ne l'a pas remplie avec l'intérêt que semblait promettre la réputation des convives. Les matières qu'ils traitent n'ont pas toute l'importance qu'ils y attachent ; et celles qui seraient plus intéressantes n'y sont qu'effleurées : il contient cependant des maximes très sages de politique et de morale. Un de ses meilleurs traités est celui de la Tranquillité de l'Ame; il respire ce calme, cette paix d'une âme toujours ferme, toujours égale , toujours invincible, dans la prospérité comme dans les revers de la fortune. Sénèque a traité le même sujet ; mais quelle froideur, quelle sécheresse, au lieu de cette douceur, de cette aimable sensibilité qui règne dans celui de Plutarque ! Parmi les ouvrages de cette classe, la plus nombreuse de toutes, il n'est pas de sujet plus important, ni qui soit mieux traité sous tous les rapports, que celui où il entreprend de justifier les délais que la justice divine apporte à la punition des coupables. Il est plein d'une excellente philosophie, puisée dans les meilleures sources. La variété qu'y répandent les traits d'histoire dont il l'a semé, les exemples dont il est enrichi, les images et les ornements du style qui rouvrent de fleurs une discussion épineuse et délicate, et qui prêtent une nouvelle force à des raisonnements sans réplique, en font incontestablement un des plus beaux écrits de Plutarque. Il est suivi d'un fragment précieux sur l'Immortalité de l'âme, que Stobée nous a conservé, et qui paraît appartenir aux Traités sur l'Ame que Plutarque avait composes, et qui sont perdus. Les deux Discours contre l'usage des viandes sentent un peu la déclamation : il examine cette question, non en physiologiste qui aurait cherché dans la conformation du corps humain, dans les effets physiques de cet usage, des motifs pour en détourner les hommes ; mais en moraliste qui n'y considère que ce qu'a de barbare cette coutume, et qui emploie des idées énergiques, des expressions fortes pour en inspirer l'horreur. Ses Traités sur l'enseignement de la vertu, sur la Vertu morale dont il fait connaître les divers caractères , sur la Colère, sur la Démangeaison de parler, l'Amour fraternel, la Curiosité, l'Amour des pères et des mères pour leurs enfants ; sur les Malheurs du Vice, sur l'Utilité qu'on peut retirer de ses ennemis, sur les Inconvénients des amitiés trop multipliées; sur l'Avarice, la fausse Honte, l'Envie et la Haine; sur la manière d« se louer toi-même sans exciter l'envie. 48 sur l'Exil et l'Usure, contiennent tous des préceptes pleins de sagesse , toujours ramenés à la pratique de nos devoirs, le seul but que la morale doive se proposer, et dont Plutarque ne s'écarte jamais.
XXXI. Les divers Traités de politique forment une des classes les plus intéressantes. Le premier a pour objet d'établir qu'un philosophe doit surtout converser avec les princes. Il entend par philosophes des hommes aussi modestes qu'éclairés, qui n'auraient d'autre ambition que celle d'aider les rois de leurs conseils, et de contribuer par leurs lumières au bonheur des peuples. Il leur trace la conduite qu'ils doivent tenir pour être utiles aux princes, sans se nuire à eux-mêmes, et sans se laisser corrompre par l'air contagieux qu'on respire dans les cours. Dans le second, il fait voir qu'un prince doit être instruit : on n'exige pas de lui, sans doute, qu'il soit versé dans les sciences et dans les arts ; il suffit qu'il en ait une légère teinture pour pouvoir en parler, et s'en occuper même quelquefois agréablement ; mais la grande science qu'il lui importe d'acquérir, l'art sublime auquel il doit se former, c'est celui de gouverner sagement ses peuples et de tout rapporter à cette fin unique. La justice est la première vertu et le premier devoir des rois : c'est par elle qu'ils font luire aux yeux des mortels les rayons de la divinité, dont ils sont sur la terre les images vivantes. Il examine dans le troisième si un vieillard doit s'occuper d'administration publique : il paraît, par ce qu'il y dit de lui-même, qu'il le composa dans sa vieillesse ; et c'est une preuve qu'il conservait encore, à ce dernier âge , une raison saine, une justesse de vues et une vigueur d'esprit qui confirment la décision affirmative qu'il a donnée sur cette question. A la vérité, ce n'est pas quand on est vieux qu'il faut entrer dans l'administration ; mais un vieillard peut et doit même en continuer l'exercice : il y est plus propre que les jeunes gens, parce qu'il inspire plus de confiance, et que, dans des temps difficiles, il est plus capable de rassurer par sa sagesse les esprits alarmés. D'ailleurs, à un âge où ils ne peuvent plus goûter que les jouissances pures qui naissent des occupations honnêtes, est-il rien qui leur procure plus sûrement ces plaisirs, que les soins importants d'une administration publique, où ils ont sans cesse des occasions d'éprouver les sentiments délicieux que la vertu fait goûter ?
XXXII. Le but de Plutarque, dans ses Préceptes politiques , n'est 49 pas de tracer, comme l'on fait Platon, Aristote et Cicéron, un plan de république, ou un recueil de lois : il donne seulement des conseils à un jeune homme de la ville de Sardes, pour se conduire sagement et avec fruit dans l'administration où l'avait engagé le désir d'être utile à sa patrie. Il lui apprend d'abord dans quelle disposition il doit y entrer, les vues qu'il doit s'y proposer, les qualités nécessaires pour y gagner la confiance des peuples, les écueils dont il a à se préserver, les moyens ou de prévenir l'envie ou de la désarmer. A ces qualités, qui tiennent au talent de l'administrateur, il joint le tableau des vertus qui doivent le caractériser : c'est un désintéressement à toute épreuve, un esprit calme qui ne se laisse jamais entraîner par une ambition funeste; une sage modération qui, loin d'aspirer à de trop grands honneurs, préfère des distinctions et des récompenses moins brillantes, mais plus solides. Les préceptes pleins de sagesse que ce traité contient sont continuellement appuyés d'exemples qui leur donnent plus de poids, et qui soutiennent l'attention, qu'une longue suite de préceptes, dans un sujet sérieux, aurait pu fatiguer. Le dernier de ces Traités est un très court opuscule sur les trois principales sortes de gouvernement, la monarchie, l'oligarchie , c'est-à-dire le gouvernement d'un petit nombre de nobles ou de riches, et la démocratie. Ce n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus étendu ; ce qui nous en reste ne contient que la définition du mot gouvernement, avec ses diverses acceptions, et sa division en trois espèces. Il admet la bonté des deux dernières ; mais, d'après Platon, il donne la préférence au gouvernement monarchique, comme à celui qui peut seul porter la vertu à sa plus grande perfection, sans jamais sacrifier l'intérêt public à la force ou à la faveur. Tel est, en effet, le sentiment de Platon (29) ; et Aristote (30), malgré son penchant à le contredire, est ici de son avis. Cette opinion doit paraître extraordinaire dans des hommes qui étaient nés ou qui vivaient sous des gouvernements républicains. Le Fragment sur la Noblesse mérite, par son étendue, que j'en fasse mention. Le traité était divisé en deux parties, dont la première contient les témoignages opposés de divers écrivains sur les avantages et les inconvénients de cet établissement. La seconde entrait dans l'examen des raisons pour et contre l'institution de la noblesse : cette seconde partie est perdue ; et c'était la plus 50 intéressante, puisqu'elle traitait le fond de la question. Mais dans ce qui nous en reste, Plutarque a laissé assez entrevoir son opinion, pour nous faire juger qu'il croyait la noblesse utile aux sociétés politiques. Il s'élève contre l'injustice de certains sophistes qui, fermant les yeux à l'évidence, prétendent que la noblesse des ancêtres ne contribue en rien au mérite de leurs descendants ; il leur oppose les témoignages d'une foule d'écrivains, poètes, historiens et philosophes, qui tous ont fait le plus grand cas de cette institution politique, et lui ont attribué les plus heureux effets.
XXXIII. La physique et la métaphysique sont la partie faible de cette vaste collection. Les ouvrages qui roulent sur ces deux sciences, et en particulier sur la seconde, outre les défauts qui tiennent au siècle de Plutarque, où elles n'avaient pas fait encore de grands progrès , sont en général mal digérés, écrits sans intérêt, et avec peu de méthode et de clarté : c'est un chemin hérissé d'épines, et dont la fatigue n'est pas compensée par l'avantage de trouver de temps en temps quelques fleurs à cueillir. Ils ont cependant le mérite de nous faire connaître, sur un grand nombre de matières, les opinions des anciens, que nous ignorerions sans les ouvrages de Plutarque. Son Traité sur le Destin, cette question si longtemps agitée par les anciens philosophes, et toujours indécise, est d'autant plus obscur qu'il nous est parvenu très incomplet. Celui où il expose les Opinions des philosophes sur les principales questions de la physique est une compilation si mal faite, si sèche et si aride de ce que les anciens ont pensé sur chaque matière, que je ne crois pas qu'elle soit de Plutarque, comme je l'ai montré dans les observations qui précèdent cet ouvrage. Ses Questions naturelles, ses Recherches sur la cause du froid, contiennent des erreurs qu'il faut imputer à la science même, qui était encore fort peu avancée. Cependant quelques-unes de ces questions sont intéressantes par leur objet, et offrent des solutions satisfaisantes. L'opuscule où il examine Quel est le plus utile du feu ou de l'eau, n'est qu'une déclamation assez froide, dans laquelle il se livre à son imagination, et se perd dans des idées générales qui n'ont aucun appui solide. D'ailleurs, cette manière de soutenir le pour et le contre sur un même sujet, comme il le fait dans cet ouvrage, où il plaide d'abord pour l'eau et ensuite pour le feu, est, ce me semble, moins propre à former, comme on le croit, l'esprit et le raisonne- 51 ment, qu'à leur donner du faux et du travers, à leur faire contracter l'habitude d'une dialectique pointilleuse qui obscurcit plutôt la vérité qu'elle ne sert à la faire connaître.
XXXIV. Le Traité de la face qui paraît sur la lune renferme quelques questions d'astronomie ; mais, dans sa plus grande partie, il roule sur la physique. C'est un des plus curieux de Plutarque ; il est plein d'érudition : il contient une foule de bonnes observations sur la nature et la substance du globe lunaire; et l'on y voit exposées avec beaucoup de justesse et de netteté les vraies causes des taches obscures que la lune présente, et qui forment cette espèce de face humaine qui paraît sur le disque de cette planète. Son ouvrage sur l'Industrie des animaux aurait été plus utile et plus intéressant, s'il eût recherché en physicien la nature du principe qui fait agir les animaux, et qu'il l'eût comparé avec les effets que produit cette cause intérieure et inconnue de leurs actions : mais, après avoir dit peu de chose sur ce sujet, il se borne à examiner quels animaux sont les plus industrieux, de ceux qui vivent sur la terre, ou de ceux qui peuplent les eaux. La cause des uns et des autres est plaidée contradictoirement, et l'arbitre choisi pour prononcer laisse le procès indécis. Les preuves apportées par les deux défenseurs ne sont guère que des observations sur la finesse et les ruses des animaux, avec une foule de petits contes, dont quelques-uns doivent passer pour apocryphes. Dans le traité suivant, qui roule sur la même matière , il veut prouver que les biles ont l'usage de la raison. Il a donné à celui-ci une forme plus piquante, quoiqu'un peu exagérée; il a mis en scène, d'un côté, Ulysse, le plus prudent des héros grecs; et de l'autre, un de ses compagnons que les poisons de Circé avaient changés en bêtes. Il a choisi celui qui avait été métamorphosé en pourceau, pour rendre le contraste plus frappant; et il lui fait faire des raisonnements très philosophiques sur la nature des passions qui déshonorent l'espèce humaine, et qui sont la plupart inconnues aux animaux. Il en conclut que les bêtes sont, aussi bien que les hommes, douées d'intelligence et de raison. Ce rapprochement des animaux et des hommes peut bien fournir aux philosophes quelques considérations utiles pour faire rougir ces derniers de l'abus qu'ils font de leur raison ; mais on ne peut en prendre un prétexte de dégrader le plus beau don que le Créateur ait fait à l'homme, et qui met un intervalle immense entre 52 celui-ci et les animaux, même en admettant l'immatérialité du principe qui fait agir ces derniers.
XXXV. Ses Questions platoniques ont pour objet d'expliquer certains termes métaphysiques employés par Platon, et quelques effets physiques que ce philosophe rapporte sans en assigner les causes. Les Questions métaphysiques sont toujours obscures, par la dialectique serrée qui les accompagne ; et celles qui roulent sur la physique se sentent du peu de progrès que cette science avait fait du temps de Plutarque. De tous les ouvrages de cette troisième classe, et même de tous ceux qui nous restent de lui, le plus difficile, sans contredit, est son Traité sur la création de l'Ame, d'après le Timée de Platon : son objet est de développer les principes par lesquels ce philosophe a voulu expliquer la formation de ce qu'il appelait l'âme du monde. La doctrine des nombres harmoniques de Pythagore, sur laquelle est fondé le système de Platon, jette dans son ouvrage une telle obscurité, qu'il est souvent inintelligible. Les anciens eux-mêmes en ont jugé ainsi. « Cela est plus obscur que les nombres de Platon, écrivait Cicéron à Atticus (31). » Le commentaire de Plutarque n'est ni moins obscur, ni moins hérissé d'épines que l'ouvrage qu'il se propose d'éclaircir. Je ne répéterai pas ici ce j'ai dit de ses Traités contre les Stoïciens et contre les disciples d'Epicure. J'ajouterai seulement que ses derniers écrits tiennent en partie à la morale, puisqu'il y fait voir qu'on ne peut vivre agréablement quand on suit la doctrine d'Épicure ; mais la plus grande partie est employée à discuter les principes physiques des épicuriens. Dans le second, où il attaque en particulier un épicurien nommé Colotes, qui avait parlé avec beaucoup de mépris des philosophes les plus respectables et censuré vivement leur doctrine, Plutarque prend leur défense, et en justifie les principes et la morale. Il a mis dans cette discussion un peu trop d'emportement et d'aigreur; mais il compense ce défaut par l'exactitude de ses raisonnements, par une morale pure, par un grand amour pour la vertu, par le désir le plus vrai du bonheur des hommes, par tous les sentiments honnêtes qui éclatent dans ces deux ouvrages. Ils sont suivis d'un opuscule où il examine si les épicuriens ont raison de dire qu'il faut cacher sa vie, c'est-à-dire vivre dans l'obscurité. Il soutient le contraire ; et, par des considérations morales, prises de l'in- 53 térêt particulier de l'homme et du bien commun de la société, il montre qu'il est utile d'être connu, et de servir la patrie par ses talents. Je ne parle point du Traité des fleuves et des montagnes, la plus misérable de toutes les compilations, qui n'est qu'un tissu des récits les plus absurdes et les plus incroyables, rapportés sur le témoignage des auteurs les plus suspects, dont plusieurs peut-être n'ont jamais existé. Cet ouvrage est absolument indigne de Plutarque, et on ne saurait sans injustice le lui attribuer.
XXXVI. Les ouvrages mythologiques ne sont pas la classe la moins intéressante de cette collection. Les Recherches sur l'inscription Ei du temple de Delphes paraissent au premier coup d'œil un sujet peu important; mais Plutarque y a mis beaucoup d'intérêt par le grand nombre d'objets qu'il y a fait entrer. Il y discute des points d'histoire, de mythologie, de physique, de géométrie et de métaphysique. J'ai cité plus haut (32) l'interprétation qu'il donne de ce mot Ei, qu'il explique par ceux-ci, vous êtes un; explication qui contient la métaphysique la plus pure et la plus lumineuse. Il examine dans le second Traité, Pourquoi la Pythie ne rendait plus ses oracles en vers mais cette question en occupe à peine la moitié ; le reste est employé à des digressions qu'amène la curiosité des étrangers à qui les prêtres de Delphes montrent les statues et les ornements du temple. Ces digressions cependant ne sont pas tout à fait étrangères au sujet, et ont le mérite d'y semer de la variété. La cause de la cessation des oracles est le sujet du troisième ; question importante qui a été agitée par les anciens et par les modernes, et qui, parmi ces derniers, a donné lieu à des écrits contradictoires : mais cette question ne remplit que la très petite partie du dialogue ; il y recherche beaucoup plus les causes de la divination et l'enthousiasme prophétique. Il est vrai qu'il a su lier ces deux objets, en montrant qu'ils tiennent en partie l'un et l'autre à des causes physiques sujettes à des vicissitudes qui ont pu faire cesser quelques oracles. Il y a fait entrer des digressions un peu longues ; et celle qui regarde la pluralité des mondes, outre qu'elle est fort abstraite, ne tient que de loin à ce sujet. Malgré cela, le dialogue est en général d'un grand intérêt, et par l'importance du sujet, et par la variété des objets qui y sont discutés. Le plus considérable de ses ouvrages de mythologie, et un des plus curieux de 54 tous ceux que ce philosophe a composés, c'est son Traité d'Isis et d'Osiris, dans lequel il se propose d'expliquer la fable égyptienne de ces deux divinités, et de faire connaître les opinions différentes des anciens sur ce sujet. Il n'a rien négligé pour s'instruire de tout ce qui pouvait jeter du jour sur une matière obscure et peu connue : il a consulté tous les monuments ; il a porté même ses recherches plus loin que l'Egypte ; il a puisé dans la doctrine des autres peuples orientaux des objets de comparaison qui donnent plus de poids à ses explications. Il les rapporte toutes à cette opinion des deux principes du bien et du mal, répandue dans l'Orient et adoptée par les Grecs ; système favori de Plutarque, et qu'avaient introduit dans les écoles des philosophes la vue des désordres physiques et moraux qui troublent l'harmonie de l'univers, et la crainte que Dieu ne parût être l'auteur du mal. Ce traité est le monument le plus précieux et le plus complet que l'antiquité nous ait transmis sur cette matière.
XXXVII. Les ouvrages de littérature sont, pour la plupart, à ce que je crois, les premiers fruits de sa jeunesse : ce sont de ces essais par lesquels les anciens, dans la Grèce et à Rome, commençaient à essayer leurs forces et à former leur talent. Plutarque a choisi des sujets brillants, qui prêtaient à l'éloquence et ouvraient un vaste champ à son imagination. Il établit dans l'un que la grandeur des Romains a été plutôt l'ouvrage de la fortune que celui de la vertu. Dans les deux. suivants il veut, au contraire, montrer qu'Alexandre n'a pas dû, comme les Romains, sa grande puissance à la faveur de cette divinité, mais à sa seule vertu . il lui prête les motifs les plus purs et les plus philosophiques dans la conquête des nations barbares; à l'en croire, ce prince était moins jaloux de les soumettre à son empire, que de les civiliser et de les acquérir à la sagesse. Dans ces trois discours, Plutarque s'est trop livré à l'ardeur et au feu de son imagination; il a trop écouté la prévention nationale, et cette pente que les Grecs avaient à s'attribuer la supériorité sur tous les autres peuples. Mais son âge doit faire excuser ses défauts; il a jugé dans la suite de ces mêmes objets d'une manière plus judicieuse et plus sensée. Son Discours sur les Athéniens est encore un des fruits de sa jeunesse, dont il faut porter le même jugement. Il y met en parallèle les guerriers qu'Athènes a produits, avec les historiens, les orateurs et les poètes qui ont fleuri dans son sein ; et il conclut de cette comparaison 55 que les exploits de ses généraux ont beaucoup plus contribué que les ouvrages de ses écrivains à sa gloire et à sa puissance. Quoique l'imagination domine moins dans ce discours que dans les trois précédents, elle l'égare encore quelquefois, et l'emporte au delà du vrai. J'ai parlé de sa Comparaison d'Aristophane avec Ménandre, et de son Traité sur la malignité d'Hérodote, que je mets dans cette classe, parce qu'il y examine quelles sont les qualités qui forment le bon historien, et la manière dont il doit écrire l'histoire. Je place encore ici le Traité sur la Musique, qui semblerait devoir faire une classe à part, mais qui appartient à la littérature, parce qu'il est moins dogmatique qu'historique, et qu'il consiste plus en recherches sur l'histoire de cet art, qu'en discussions savantes sur ses principes et sur sa théorie. Son but principal est de faire connaître l'origine et les inventeurs de la musique ; ceux à qui elle a dû ses progrès et sa gloire ; les moyens qu'ils ont employés, les causes qui ont amené sa décadence et sa corruption ; enfin les avantages qu'on peut tirer de cet art pour former les mœurs, quand on sait en faire un bon usage et le renfermer dans de justes bornes. Cet ouvrage est curieux et Intéressant, par la connaissance qu'il nous donne d'un très grand nombre de poètes-musiciens de la plus haute antiquité, et de faits peu connus dont il a conservé le souvenir.
XXXVIII. Le tableau des mœurs et des coutumes des anciens peuples est un des sujets qui nous attachent le plus. Cet intérêt est plus vif encore quand il s'agit de ces nations qui ont occupé avec tant d'éclat la scène du monde. Nous trouvons un singulier plaisir à connaître leurs usages domestiques, leurs cérémonies religieuses, les actions de leur vie privée ; nous croyons alors être leurs contemporains, et vivre au milieu d'eux. Plutarque nous a laissé deux Traités de ce genre, l'un sur les usages des Romains, l'autre sur ceux des Grecs. Il s'est beaucoup plus étendu sur les premiers, sans doute parce qu'il écrivait pour les Grecs, à qui les mœurs romaines étaient moins connues. Le long séjour qu'il avait fait à Rome, et l'entreprise qu'il avait formée d'écrire la vie des plus célèbres Romains, l'avalent mis à portée d'étudier avec soin leurs usages. Aussi lui avons-nous l'obligation de nous avoir conservé beaucoup de pratiques usitées chez les Romains et même chez les Grecs, que nous ignorerions sans lui. Ce qui rend ces deux ouvrages plus curieux, c'est que, non con- 56 tent de rapporter les faits, il en recherche l'origine, et s'applique à en découvrir les causes physiques, morales ou politiques. Il est vrai qu'il n'est pas toujours heureux dans celles qu'il adopte sur les coutumes des Romains ; mais alors on a pour se garantir de l'erreur les auteurs de cette nation, dont on doit naturellement préférer le témoignage à celui de Plutarque.
XXXIX. De tous ceux de ses ouvrages que le temps a respectés, il n'en est pas de plus instructif et de plus amusant que ses Propos de table ou ses Mélanges : il nous en a laissé neuf livres, dont le quatrième est imparfait. La multitude et la variété des sujets qu'il y traite, la sagacité avec laquelle il discute des questions, souvent assez subtiles, sur des points de physique, de médecine, de morale, de politique, d'histoire, d'antiquités et de littérature, en font un recueil très varié, très piquant, et prouvent autant l'agrément de son esprit que l'étendue de ses connaissances. A la vérité, il se trompe souvent sur les questions de physique, comme je l'ai déjà observé ; mais ces erreurs sont rachetées par une foule de connaissances dont cet ouvrage nous offre un dépôt précieux, et qui seraient perdues pour nous, s'il n'eût pris soin de nous les conserver. Le ton de liberté, d'enjouement et de bonhomie qui règne entre les convives, presque tous parents ou amis, donne un tableau fidèle de ces mœurs antiques et naïves dont la peinture nous affecte vivement. La simplicité avec laquelle ils s'entretiennent ensemble s'allie à un ton de politesse et de savoir qui plaît et qui attache, car il ne faut pas croire que la gravité des objets qu'ils traitaient mit dans leurs repas de la tristesse et de l'ennui : cette froide pédanterie qui effarouche les ris et les grâces ne s'y montrait jamais ; et la liberté de la table, que rien ne gênait chez eux, leur inspirait cette douce gaieté qui assaisonne les entretiens les plus solides du sel piquant d'une plaisanterie agréable.
XL. Les deux Traités historiques qui se trouvent dans la collection des Oeuvres Morales ne sont certainement pas de Plutarque. Les Parallèles d'Histoires grecques et romaines ne peuvent être l'ouvrage que d'un écrivain obscur et inepte, qui a voulu accréditer une production informe, à la faveur d'un nom illustre. Il est vraisemblable, comme l'a pensé un savant académicien (33), que l'auteur de cette misérable compilation a eu pour but de prouver la vérité de plusieurs 57 faits de l'histoire grecque qui pouvaient paraître fabuleux, par d'autres traits de l'histoire romaine qu'on regardait comme constants. Il le soupçonne, et, je crois, avec raison, d'avoir mêlé beaucoup de faux dans ce qui appartenait à l'histoire grecque, afin de ne laisser, par rapport aux actions extraordinaires, aucun avantage aux Romains. Mais tout prouve qu'on peut nier avec fondement la vérité de tous les faits qu'il attribue seul aux Grecs ; et les historiens qu'il cite sont si peu connus, qu'on peut douter très légitimement qu'ils aient jamais existé. Le second de ces ouvrages comprend la Vie des dix plus anciens orateurs d'Athènes, Antiphon, Andocidès, Lysias, Isocrate Isée, Eschine, Lycurgue, Démosthène, Hypéridès et Dinarque. Ce serait faire un tort réel à la mémoire de Plutarque, que de mettre un pareil ouvrage sur son compte. On n'y voit ni critique, ni goût ; les faits y sont entassés sans ordre et sans discernement; l'auteur y tombe fréquemment dans des redites fastidieuses et des contradictions choquantes, soit avec lui-même, soit avec les historiens les plus dignes de foi. Plutarque, il est vrai, avait composé les Vies de ces dix orateurs; on n'en peut douter d'après le catalogue de son fils Lamprias ; mais elles ne subsistent plus; et c'est peut-être cette mauvaise compilation, faite vraisemblablement d'après ce premier ouvrage, qui aura d'abord fait négliger et perdre enfin l'original pour conserver cette faible copie.
XLI. Les deux Traités, en partie historiques et en partie moraux, sont ceux du Démon de Socrate et de l'Amour. Dans le premier, qui semble promettre des recherches sur ce que Socrate appelait son démon ou son esprit familier, il en est dit très peu de chose ; et le véritable sujet de cet ouvrage est le récit fait par Caphisias, frère d'Epaminondas , à un Athénien, de la conspiration qui ût rentrer dans Thèbes Pélopidas et les autres bannis, et de la défaite des tyrans que les Lacédémoniens y avaient établis. Mais, au lieu d'une simple narration, Plutarque a fait de cet événement un drame plein d'intérêt, où les acteurs paraissent successivement sur la scène, et, à travers plusieurs incidents et plusieurs obstacles, conduisent enfin l'action à un heureux dénouement. La question du démon de Socrate n1y est placée que comme un épisode que le hasard semble amener. II rapporte les diverses opinions que les anciens avaient sur la nature de ce génie, et ne décide pour aucune. Apulée, qui a fait aussi un Traité sur le dé- 58 mon de Socrate, prononce sans balancer que c'était un de ces génies ou esprits que les anciens supposaient attachés aux hommes pour les éclairer et les conduire. Le Traité sur l'Amour est un monument élevé par Plutarque à la gloire des femmes, et en particulier à celle d'une Gauloise célèbre nommée Eponine, femme de Sabinus, dont l'histoire est connue de tout le monde. Une femme riche et de grande naissance voulait épouser un jeune nomme aimable et plein de mérite. Les obstacles qu'elle trouvait à un mariage disproportionné pour l'âge et la fortune lui firent concevoir le projet hardi de l'enlever, el de l'épouser sur-le-champ ; ce qui fut exécuté. L'inclination d'Isménodore pour ce jeune homme amène à parler de l'amour, et à distinguer l'attachement qui nait d'un sentiment honnête, d'avec la cupidité qui n'a pour but que le plaisir. On fait connaître les caractères de l'amour, le bonheur de la tendresse conjugale, le plus intime, le plus fort de tous les sentiments. Comme on avait avancé que les femmes n'étaient pas capables d'un véritable amour, Plutarque les venge de cette imputation, et montre qu'un attachement vertueux est aussi bien le partage de l'union conjugale que de l'amitié. Il le prouve par l'exemple de la tendresse courageuse d'Eponine pour son mari. Ce Traité intéressant est suivi de cinq aventures tragiques dont l'amour a été l'occasion, et qui prouvent que cette passion, si douce en apparence, est capable de porter ceux qui s'y livrent aux cruautés les plus révoltantes.
XLII. Dans la dernière classe, qui comprend les recueils d'anecdotes, de maximes et de bons mots, sont d'abord les Apophtegmes ou Paroles mémorables des rois et des capitaines célèbres; ouvrage que quelques critiques ont cru n'être pas de Plutarque, et que d'autres, en particulier Erasme, jugent digne de lui. Un des grands avantages de ce recueil, c'est, selon l'auteur lui-même, qu'il sert à faire mieux connaître que les actions, le caractère et les mœurs de ceux dont on rapporte les paroles. Il ne faut pas croire néanmoins que ces paroles aient toutes un égal degré de bonté; plusieurs manquent de noblesse, et ne répondent pas à l'idée que l'histoire nous donne des grands hommes qui les ont proférées. Plutarque a recueilli en particulier les Apophtegmes des Lacédémoniens et ceux de leurs femmes, et y a joint un Abrégé des institutions des Spartiates. Plusieurs critiques refusent encore plus formellement de reconnaître Plutarque pour le père d'une production écrite avec beaucoup de négligence, où 59 l'on trouve peu de jugement et de goût. Quelle apparence, par exemple, disent-Ils, que Plutarque, après avoir exposé eu détail, dans la Vie de Lycurgue, les institutions de ce législateur, en eût fait un Traité séparé, moins complet, dont le commencement est tronqué, et où l'auteur n'est pas toujours d'accord avec ce qui en est rapporté dans la Vie de Lycurgue.? Ces raisons sont plausibles; cependant ces mêmes critiques conviennent que ces deux opuscules peuvent être mis avec fruit entre les mains des jeunes gens , à cause du grand nombre de faits historiques et des leçons de morale qu'ils renferment. Le dernier ouvrage de cette classe contient une suite d'anecdotes beaucoup plus étendues que celles des recueils précédents. Plutarque s'y propose de montrer, par un genre de preuves qui paraissent sans réplique, celles des faits, que les femmes ne le cèdent pas aux hommes en vertu. Pour prévenir l'objection qu'on aurait pu lui faire, s'il s'était borné à quelques femmes isolées choisies avec soin dans toutes les nations, il a pris la plupart de ses exemples dans les faits dont les héroïnes ont été toutes les femmes d'une même ville ou d'un même pays. Au reste, ici le mot Vertu ne se prend pas dans le sens rigoureux qu'on lui donne. Ces actions ne sont pas toutes bonnes et honnêtes : ce sont, pour la plupart, des traits de courage et de hardiesse qui annoncent une fermeté et une force d'esprit peu communes.
XLIII. Dans cette collection si vaste des Oeuvres morales de Plutarque, il n'y a donc guère que sept ou huit Traités dont on ne le reconnaisse pas généralement pour auteur. Il y en a deux dont la supposition est universellement avouée : ce sont les Parallèles d'histoires grecques et romaines, et le Traité des fleuves et des montagnes. Quelques critiques ont imprimé la même tache d'illégitimité aux Discours sur les Romains et sur Alexandre, aux Recueils des Apophtegmes et des Institutions lacédémoniennes, que d'autres reconnaissent pour légitimes. C'est peu dans un si grand nombre d'ouvrages. Tous les Traités de pure morale sont incontestablement de Plutarque : c'est la plus belle portion de ce riche héritage qu'il nous atransmis.et qui fait tant d'honneur au bon esprit, aux vastes connaissances, aux sages principes d'un écrivain que je ne balance pas à regarder comme un des philosophes de l'antiquité qui ont le plus honoré ce titre respectable, et qui s'en est montré encore plus digne par ses vertus que par ses talents.
60 SUPPLÉMENT A LA VIE DE PLUTARQUE.
Un homme de lettres connu par plusieurs bons ouvrages, et en particulier par un savant Traité sur les Mystères du paganisme, m'a fait connaître une inscription grecque rapportée par Mélèce , auteur d'une Géographie ancienne et nouvelle, écrite en grec, qui dit avoir trouvé cette inscription à Chéronée en Béotie, patrie de Plutarque, près de la fontaine publique. Elle avait été gravée à l'honneur de Sextus Claudius Autobule, sixième descendant de Plutarque, dont nous publions les Vies. L'ouvrage de Mélèce a été imprimé à Venise en 1728. Voici cette inscription, qui n'a pu échapper tout entière aux injures du temps :

Cette inscription est tellement mutilée, qu'il est impossible de la rétablir : le commencement, qui a été moins maltraité, atteste que le descendant de Plutarque, qui en est l'objet, faisait paraître les plus grandes vertus dans toute sa conduite et dans tous ses discours. Dans ce qui suit, on lui donne le titre de philosophe ; on parle de son âge, dont le nombre d'années, marqué en chiffres, est en partie effacé, et ne saurait être suppléé. Le reste parle de sa grand'mère maternelle, nommée Callicléia ; et on peut conjecturer, par les dernières lignes, que c'étaient ses parents et ses sœurs qui avaient fait graver ce monument. Le témoignage qu'on y rend aux vertus et aux talents d'Autobule fait voir que le mérite et la sagesse étaient héréditaires dans la famille de Plutarque ; qu'ils s'y soutenaient encore avec éclat jusque dans la sixième génération, et maintenaient la réputation et la gloire du philosophe de Chéronée. L'histoire nous parle aussi d'un Sextus né dans la même ville, et neveu de Plutarque par sa sœur, philosophe distingué, qui vivait dans le second siècle de l'ère chrétienne, que sa science et sa vertu firent choisir pour enseigner les lettres grecques à l'empereur Antonin. Nous en avons parlé plus haut, chapitre VI.
Le Dom d'Autobule était commun dans la famille de notre philosophe ; on voit, par l'inscription qui vient d'être rapportée, que le père de celui pour qui elle avait été gravée portait le même nom 61 que son père. Nous avons déjà dit que l'aîné des quatre flls qu'il avait eus de sa femme Timoxène s'appelait aussi Autobule. Il est souvent question de lui dans les ouvrages de son père, qui, plein de tendresse pour ses enfants, aimait à les prendre pour interlocuteurs de ses dialogues, et à leur fournir l'occasion de mettre au jour les connaissances qu'ils avaient acquises sous sa discipline. Car rien n'empêche de croire qu'ils ont réellement tenu les discours que Plutarque met dans leur bouche ; il est vraisemblable du moins qu'ils étaient capables de les tenir : on n'y trouve rien qui soit au-dessus de l'instruction que devaient avoir des jeunes gens de leur âge, nés avec des dispositions heureuses ,'et qui avaient reçu une excellente éducation.
Autobule est un des interlocuteurs du Dialogue sur l'Amour, dans lequel il rend compte à un de ses amis des entretiens qui s'étaient tenus sur cette matière, dans la ville de Thespies en Béotie, pendant la fête qu'on y célébrait en l'honneur de ce dieu ; ces entretiens avaient eu lieu peu de temps après le mariage de Plutarque, et bien avant la naissance de son fils aîné. Plutarque, comme nous l'apprenons par ce dialogue, était allé à Thespies pendant cette fête, pour y sacrifier à l'Amour, à l'occasion d'une dispute qu'il avait eue avec les parents de sa femme, mais dont il ne dit pas le sujet; Timoxène l'y avait accompagné, et elle devait y faire la prière et le sacrifice.
Dans le Dialogue sur l'Amour, Autobule n'est guère que l'historien fidèle de ce qui s'était passé à Thespies ; il rapporte les conversations qui s'y étaient tenues, et qu'il avait souvent entendu répéter à son père. Dans le Traité qui a pour objet de faire connaître l'industrie des animaux de terre et de mer, et de rechercher laquelle de ces deux espèces mérite la préférence, il montre de l'érudition et des connaissances. A l'occasion d'un éloge qu'on avait fait de la chasse, il expose le danger de cet exercice, quand il est porté jusqu'à la passion. Il y trouve l'inconvénient de rendre l'homme dur et insensible ; l'habitude de répandre le sang des animaux le familiarise avec le meurtre, et l'accoutume à voir couler avec moins de peine le sang des hommes. Il s'autorise, pour justifier son opinion, du précepte des pythagoriciens, qui voulaient que la douceur envers les bêtes nous rendit humains à l'égard de nos semblables. De là il passe à l'examen d'un principe des stoïciens sur la nature des êtres. Ces philosophes 62 soutenaient qu'il n'y avait rien dans la nature qui n'eût son contraire ; qu'ainsi, afin que la nature ne fût défectueuse par aucun endroit, il fallait que certains animaux eussent la raison en partage, et que d'autres en fussent privés. Autobule combat et le principe, et l'argument sur lequel il est fondé. Il établit que la faculté de sentir, qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître dans tous les animaux, suppose en eux la mémoire et le raisonnement ; qu'on voit sensiblement qu'ils sont susceptibles de joie, de colère, et en général de toutes les passions auxquelles nous sommes sujets.
On lui objecte que la nature n'ayant pas donné aux animaux la un pour laquelle la raison nous a été accordée, il est vraisemblable qu'elle leur a aussi refusé la raison. Il répond qu'à la vérité la raison est plus faible dans les animaux que dans les hommes ; mais qu'elle n'en est pas moins une raison véritable. Il distingue la raison simple, telle que la nature l'a donnée à tous les êtres animés, et la droite raison, la raison parfaite, qui est le partage de l'homme seul, et qui est fortifiée par l'instruction et l'étude. Autobule donne à son opinion d'autres développements qui ne sont pas toujours bien surs, mais qui prouvent dans ce jeune homme de la sagacité et de la finesse d'esprit.
Il est parlé des noces d'Autobule dans le quatrième livre des Symposiaques ou Propos de table, question III, où Plutarque, à l'occasion de ces noces, recherche pour quelle raison on invite à ces sortes de repas un grand nombre de convives. Autobule joue aussi lui-même un rôle plus intéressant dans le huitième livre de ce même ouvrage, question II, où l'on examine en quel sens Platon a dit que Dieu agit toujours en géomètre. Le fils de Plutarque traite en homme instruit cette question assez relevée.
J'ai cru que mes lecteurs verraient
avec quelque intérêt l'inscription que j'ai rapportée, et les faits
relatifs à Plutarque et à ses fils, qu'elle m'a donné lieu de
rappeler. Je les ai regardés comme un supplément qui complétait ce
que j'ai dit de lui dans sa Vie, et qui devait naturellement trouver
place dans cette traduction de ses ouvrages. Je ne puis trop
témoigner ma reconnaissance au savant estimable qui m'a mis à portée
de rendre ce nouveau témoignage à la mémoire d'un historien et d'un
philosophe qui jouit d'une si grande réputation, et dont la gloire
duit m'intéresser à plus d'un titre.
01 Elle est nommée Arné par Homère, Iliad., liv. II, v. 507; pur Pausanias, liv.IX, chap, xi.; par Stephanus, de Urb.in Arne.
02 .Lycophron, Cassand., v. 644
03. Ep., liv. II ep. 1.
04. Pind., Olymp. VI.
05. Symp., liv. I, q. 3.
06. Liv. 1, q. 2.
07. Liv. I
08. Nullius addictus jurare in verba magistri, Hor., Ép., liv. I, ép. I.
09. Symp., liv. IX, q. I, et liv. VIII, q. 5.
10. Symp., liv. I, q. 10.
11. Symp, liv. V, q. 5.
12. Symp., liv. II, q. 10.
13. Acad. des Inscript., tome XVIII, p. 152.
14. La pythiade était, comme l'olympiade, un espace de quatre années ; elle marquait l'époque des jeux Pythiens, qui se célébraient au commencement d« chaque cinquième année, et la troisième des olympiades.
15. Précept. polit.
16. Il y a apparence que c'est Vespasien.
17. Traité de la Curiosité.
18. Ruauld.
19. Liv. VII, q. 3.
20. Consolation sur la mort de sa fille.
21. Consolation sur la mort de sa fille.
22. Traité de la Colère.
23. Quod deest ex reditu, frugalitate suppletur. PLINE LE JEUNE.
24. Retinuit, quod est difficillimum, sapientiae modum. TACIT.
25. Voyez les observations qui précèdent le Traité sur la malignité d'Hérodote, dans ma traduction des Oeuvres Morales. On trouvera dans le même volume des observations sur la comparaison que Plutarque a faite d'Aristophane et de Ménandre, dans laquelle, en donnant avec raison la préférence à ce dernier, il n'a pas à beaucoup près, rendu justice au premier, moins digne d'estime, à la vérité, par son caractère moral, mais qui, par son talent poétique, a mérité les suffrages de l'antiquité la plus éclairée. Et c'est sous ce dernier rapport que Plutarque a comparé ces deux poètes.
26. Epît. aux Rom., I, 18-21
27. Onirocr., liv. IV.
28. In vit. Plut.
29. In Republica.
30. Liv. III de sa Polit., chap. xiv et suiv.
31. Epist., lib. VII, ep. 13.
32. Chap. XXVI, pag. 25.
33. M. l'abbé Sallier, Acad. des Inscript., tom. VI, page 52 et suiv.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Ἡ ἑτέρα συστοιχία. Allerum autem ordinem appellat, ordinem pulchri (par conséquent l'ordre du désirable), in quem secundum Pythagoricos substantia, lumen, triangulus, impar, et cœtera his enumerata rediguntur. Alex. Sepulv., p. 295 ; Schol., p. 804. Voyez aussi Philopon, fol. 50, b.
41. Aristote explique incidemment comment son essence simple se distingue de l'unité primitive de Platoniciens.
42. Voyez liv. V, 5, 1.1, p. 158 sqq.
43. Ἤρηται.
44.« La vie des dieux immortels est toute félicité; quant aux hommes, ils ne connaissent le bonheur qu'en tant qu'il y a dans leurs facultés quelque chose qui leur est commun avec les dieux. Mais aucun autre animal que l'homme ne goûte le bonheur dans sa vie, parce que aucun autre animal n'a avec les dieux cette communauté de nature.» Aristot., Ethic. Nicom. X, 8 ; Bekker, p. 1178.
45. Scilicet Pythagoricis non ut Platoni placuerat primum omnium principium bonum ipsum, bonum per se esse ; sed contra, in uno numerorum fonte et omnium principio, impar et par, finitum et infinitum, bonum denique et malum, quasi unum idemque conflata conjungi; contraria nonnisi in rerumnatura prodire. De Speusippo, utrum contraria e primo rerum principio prorsus excluserit, an, in eo quoque Pythagoricos secutus, conjunxerit, nihil Aristoteles. Verisimillimum tamen idem Speusippo ac Pyttagoricis placuisse. Quippe ut hi, sic ille, a plantis et animalibus exemplum sumebat, quibus semina, unde initium habent, pulchri bonique causœ sunt. F. Ravaisson, Speusipp., III, p. 7, 8. — Au lieu de Speusippe, Themistius, ou plutôt ses traducteurs donnent, par erreur, Leucippe. Themist., fol. 16; Schol., p. 806.
46. II ne faut pas conclure de cet argument, comme le lait observer M. Ravaisson, Essai, t.1, p. 567, en note, que, dans la pensée d'Aristote, le premier moteur doive avoir une puissance infinie, mais au contraire qu'il lui faudrait de la puissance s'il avait de l'étendue, mais dans ce cas seulement. La puissance n'appartient qu'à ce qui existe, comme l'âme, en une matière, ἔνυλον, et par conséquent en une étendue.
47. Voyez la note à la fin du volume.
48. Les commentateurs dont nous nous servons expliquent ainsi ce passage : Chaque planète avait un ciel à part, composé de sphères concentriques, dont les mouvements, se modifiant l'un l'autre, formaient les mouvements de la planète. Le soleil et la lune avaient chacun trois sphères : la première était celle des étoiles fixes, elle tournait d'Orient en Occident en vingt-quatre heures et rendait raison du mouvement diurne. On n'avait pas encore découvert, dit St. Thomas, le mouvement d'Occident en Orient qui est propre à ces étoiles. La deuxième sphère passait par le milieu du zodiaque ; c'est le mouvement longitudinal du soleil, par lequel il tourne autour du pôle de l'écliptique en 365 jours 1/4, suivant le calcul d'Eudoxe. Enfin la troisième sphère tournait sur son axe perpendiculaire à un cercle incliné à l'écliptique ; elle écartait, par conséquent, le soleil de son mouvement longitudinal, en l'emportant dans la latitude du zodiaque ; et, en effet, le soleil dévie de la route longitudinale, et s'éloigne plus ou moins des pôles de l'écliptique, ce qui produit les saisons. Enfin celte déviation est plus prononcée dans la lune que dans le soleil, ce qu'Aristote exprime en disant, que l'axe de la troisième sphère de la lune est perpendiculaire à un cercle incliné à l'écliptique sous un plus grand angle; ou, plus simplement, que l'axe de la troisième sphère de la lune a plus d'inclinaison que celui de la troisième sphère du soleil. Note de M. Cousin.
49. Suivant St. Thomas, la troisième sphère ayant ses pôles au milieu du zodiaque, aurait donné aux planètes trop de latitude; la quatrième sphère est destinée à corriger l'influence de la troisième, et c'est pour cela que son axe est incliné au cercle du milieu, c'est-à-dire au plus grand cercle de la troisième sphère. Pour comprendre cette expression du plus grand cercle, il faut se figurer la sphère divise'e en cercles non concentriques, et alors, en effet, le cercle du cercle du milieu sera le plus grand cercle. Mais dans quel sens faut-il faire la division ? Est-ce parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la troisième sphère ? C'est ce que St. Thomas ne dit pas. Note de M. Cousin.
50. Tous les commentateurs s'accordent à expliquer la nécessité de ces nouvelles sphères par les raisons suivantes : Chaque planète a le mouvement diurne, et ce mouvement est représenté dans chaque système par une sphère. Cette sphère est contenue dans les autres sphères, et influe sur leur mouvement. Or, comme chacune des autres sphères a un mouvement qui lui est propre, si elles reçoivent en outre et se transmettent mutuellement une autre impulsion, il en résultera que leur vitesse sera augmentée, et que la plus éloignée du centre se mouvra beaucoup plus rapidement que les autres. Mais les sphères extrêmes des différents systèmes sont presque en contact les unes avec les autres ; la sphère extrême d'un premier astre communiquera donc ce mouvement trop précipité à la sphère extrême du système voisin, cette sphère à la sphère voisine du même système, celle-ci à une autre, de manière à accélérer le mouvement diurne, et à produire ainsi une perturbation complète. Il fallait remédier à cet inconvénient et corriger cette influence accélératrice par une influence contraire ; de là l'intercalation entre les sphères d'un même système, de nouvelles sphères dont le mouvement est en sens inverse ; et comme la sphère la plus éloignée et la sphère la plus rapprochée du centre doivent avoir le même vitesse, ces sphères intermédiaires égalent le nombre des autres sphères, moins une. Note de M. Cousin.
51. La lune.
52. « Ἐντελέχια, ce qui a en soi sa fin, qui, par conséquent, ne relève que de soi-même, et constitue une unité indivisible.» Note de M, Cousin.
53. Il s'agit toujours dans ce passage de l'intelligence de Dieu, du νοῦς proprement dit.
54. « Il ne faut pas se figurer les dieux dormant comme Endymion. » Ethic. Nicom., X, 8; Bekker, p. 1178.
55. Ἔστιν ἡ νόησις νοήσεως νόησις.
56.La matière, sujet commun des deux contraires.
57. Système de Platon.
58.Système pythagoricien.
59.Voyez liv. III, 4,1.1, p. 89 sqq.
60. Liv. III, 4, ubi supra.
61.Hésiode, les anciens Théologiens, etc.
62.L'École d'Ëlée.
63.Voyez plus bas, liv. XIV,
64. Homère, Iliade, II, B., 204.
65. Buhle, Vater, L. Ideler.
66. Dans son commentaire sur le De Caelo, Simplicius cite et developpe, à propos du chap. 7 du liv. II, le passage qui nous occupe.