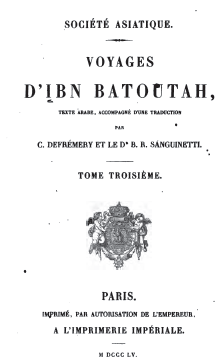
IBN BATOUTAH (رحلات ابن بطوطة)
VOYAGES - LIVRE III.
Traduction française : C. DEFREMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
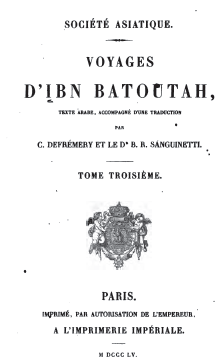
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SOCIÉTÉ ASIATIQUE.
VOYAGES
D'IBN BATOUTAH,
TEXTE ARABE, ACCOMPAGNÉ D'UNE TRADUCTION,
PAR
C. DEFRÉMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
TOME TROISIÈME.
(DEUXIÈME TIRAGE.)

PARIS.
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.
M DCCC LXXVII.
En quittant Sera, capitale du Kiptchak, où nous l'avons laissé à la fin du précédent volume, Ibn Batoutah se rendit à Sérâïtchik, ou, comme il l'appelle, Seratchoûk, puis à Khârezm, capitale de la province du même nom, et plus célèbre chez les géographes orientaux sous les noms de Djordjânieh et d'Ourguendj. La description qu'il en trace nous donne une haute idée de la richesse et de la prospérité de cette ville, alors gouvernée par un vice-roi dépendant du souverain du Kiptchak. Ibn Batoutah y remarqua une coutume qu'il n'avait vu observer nulle part ailleurs, et qui lui parut digne d'éloges. Cette coutume consistait à obliger les habitants, sous peine de la bastonnade et d'une amende, à assister aux offices célébrés en commun dans les mosquées. On sait, par des historiens persans modernes et des voyageurs européens, que le même usage existait encore à Boukhara il y a moins de quarante ans.[1] D'un autre côté, après l'occupation de Djidda, en Arabie, par les Wahhabites, en 1807, ces sectaires établirent des espèces d'appariteurs ou exempts, chargés de forcer les fidèles à se rendre au temple.[2]
De Kharezm, notre voyageur se transporta à Boukhara, en passant par la ville d'Alcât ou Gâth, ancienne capitale du Khârezm. On sait qu'en l'espace de cinquante-six ans, de 1220 à 1276, Boukhara avait été trois fois mise au pillage par des armées mongoles. Aussi, quand Ibn Batoutah la visita, ses mosquées, ses collèges et ses marchés étaient ruinés, à l'exception d'un petit nombre. Les habitants, dont Ibn Haukal, au xe siècle, faisait un si magnifique éloge, nous sont représentés, par Ibn Batoutah, comme en butte au mépris général, à cause de leur réputation de partialité, de fausseté et d'impudence.
Le voyageur partit de Boukhara afin de se rendre au camp du sultan de la Transoxiane, 'Alâ eddîn Thermachîrîn. Il nous donne sur ce prince, sur ses deux prédécesseurs immédiats, ainsi que sur deux de ses successeurs, des détails d'autant plus précieux, que l'histoire de la dynastie issue de Djaghataï, second fils de Djenghiz khân, est encore assez imparfaitement connue. Toutefois, nous devons avouer que le récit d'Ibn Batoutah ne s'accorde pas toujours, pour la filiation des princes qu'il cite, ni pour l'époque qu'il semble leur assigner, avec le récit des auteurs plus récents, compulsés par Deguignes et G. d'Ohsson, ni avec celui plus détaillé de Khondémir.[3] Mais ces différences ont pour objet des points de détail sur lesquels les historiens persans eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, et dont la discussion nous entraînerait d'ailleurs trop loin.
Après avoir pris congé du sultan Thermachîrîn, Ibn Batoutah se dirigea vers la célèbre ville de Samarkand, qui conservait encore quelques restes de son ancienne magnificence. Il visita ensuite la ville de Termedh, traversa le Djeïhoun ou Oxus, et entra dans le Khoraçan. Il décrit successivement les villes de Balkh et de Hérat, et consacre plusieurs pages à l'histoire du roi de cette dernière, Mo’izz eddîn Hoçaïn Kurt[4]. Il intercale dans ce chapitre un récit assez détaillé de l'origine de la puissance des Serbédâriens, nom que se donna une troupe d'aventuriers qui, à la faveur des troubles excités dans le Khoraçan par la mort du sultan Abou Sa'id Behadour khân (736=1335-1336), parvinrent à se créer une principauté indépendante, dont l'existence n'atteignit pas un demi-siècle. D'après Khondémir, le nom des Serbédâriens venait de ce que le fondateur de cette dynastie, Abd Arrezzâk, voulant exciter ses compatriotes à le soutenir dans sa révolte contre le vizir du Khoraçan, leur dit ces paroles : « Un grand tumulte a pris naissance dans ce pays; si nous agissons mollement, nous serons tués : il vaut donc mille fois mieux voir avec courage nos têtes exposées sur un gibet (ser ber dâr), que de périr lâchement.[5] » Ibn Batoutah raconte avec quelque détail la bataille que Wédjîh eddîn Maç’oud, le second des princes serbédâriens, perdit contre le roi de Hérat. Il dit que cette action eut lieu après sa sortie de l'Inde, en l'année 748 (1347), et dans la plaine de Bouchendj. Mais, d'après les historiens persans, la bataille fut livrée le 13 de séfer 743 (18 juillet 1342), à deux parasanges de Zâveh. Selon Mir Zéhîr eddîn Méra'chy, le combat dura trois jours et trois nuits; et cependant, d'après des témoins oculaires, il n'y périt que sept mille hommes.[6] Ibn Batoutah partit de Hérat pour la ville de Djam, plus connue actuellement sous le nom de Turbeti Djâmi; de là il se rendit à Thous et à Mechhed, la ville sainte des Chiites, et la capitale actuelle du Khoraçan; puis à Sarakhs, à Zâveh ou Turbeti Haïdéry et à Neïçâboûr ou Nichapour, alors encore très florissante, et dont les collèges étaient fréquentés par beaucoup d'étudiants. De Neïçâboûr, notre voyageur partit pour Besthâm, d'où il se mit en route, à ce qu'il dit, par le chemin de Hendokhîr (Andekhoûd?), pour Kondoûs et Baghlân. Mais cette partie de son itinéraire paraît fort embrouillée. Il est tout à fait improbable qu'en quittant Nichapour, le voyageur, dont le dessein était de passer aux Indes, soit allé à Besthâm, située à plus de quatre-vingts lieues de la première ville, vers l'ouest. Il est plus vraisemblable que l'ordre suivi par Ibn Batoutah, après son départ de Djam, fut celui-ci : 1° Zâveh, 2° Besthâm, 3° Nichapour, 4° Thous et Mechhed, 5° Sarakhs, 6° Hendokhîr. On doit supposer aussi qu'Ibn Batoutah aura omis de mentionner quelques localités qu'il a dû visiter, sur sa route, entre Zâveh et Besthâm, et entre cette dernière ville et Nichapour. Enfin, il est certain que notre auteur a commis une erreur, en mettant la contrée montagneuse appelée Kouhistan entre Balkh et Hérat. Peut-être a-t-il voulu parler du Ghardjistân, situé, en effet, au sud-est de la première de ces villes, et au nord-est de la seconde. Quant au Kouhistan, ce n'est qu'après avoir quitté Hérat, qu'Ibn Batoutah a pu le traverser, puisque cette vaste province commençait à l'ouest de Hérat, et s'étendait dans la direction de Hamadan et de Boroudjird. Dans une acception plus resserrée, le mot Kouhistan désignait, un territoire compris entre Hérat et Nichapour, et dont la capitale était Kâïn.[7]
Ibn Batoutah et ses compagnons séjournèrent environ quarante jouis près du village de Kondoûs, tant afin de refaire leurs chameaux et leurs chevaux au milieu des gras pâturages de ce canton, que pour attendre que l'arrivée des chaleurs et la fonte partielle des neiges leur permissent de traverser plus facilement l'Hindou Coûch. Après s'être remis en marche, ils arrivèrent dans un grand bourg situé près de l'emplacement occupé jadis par la ville d'Ander (Andérâb). Ils rencontrèrent, sur l'Hindou Coûch, une source thermale, avec l'eau de laquelle ils se lavèrent la figure; mais leur peau fut excoriée, et ils souffrirent beaucoup. Il est assez curieux de retrouver les mêmes effets produits par une source d'eau thermale située à l'extrémité orientale de la Sibérie, près de la Tavatoma.[8] Nos voyageurs s'arrêtèrent dans un endroit appelé Pendj Hîr, nom qu'Ibn Batoutah explique par « les cinq montagnes. » En effet, on sait que pendj, en persan, signifie « cinq » ; quant à hîr, c'est une altération d'un mot sanscrit qui signifie « montagne », et d'où les Persans ont fait guer ou guéry. Mais Ibn Batoutah a eu grand tort de confondre la rivière de Pendj Hîr, un des affluents du Kaboul Dériâ, avec celle de Badakhchân ou Gueuktcheh (la bleuâtre), qui se jette dans l'Oxus, et dont il a été déjà fait mention incidemment (t. II).
Depuis Kondoûs jusqu'à Perwân, Ibn Batoutah paraît avoir suivi la même route que celle que prirent, au mois d'avril 1838, le docteur Lord et le lieutenant John Wood, en revenant de leur beau voyage au nord de l'Hindou Coûch.[9] Les deux explorateurs anglais rencontrèrent aussi, à vingt-trois milles d'Andérâb, deux sources d'eau thermale. La montagne de Péchai, dont parle notre auteur, est, sans doute, la même que celle dont il est fait mention dans ce passage des Mémoires du sultan Baber : « Entre Perwân et la haute montagne (l'Hindou Coûch), il y a sept défilés plus petits, que les habitants de la contrée appellent « les Sept Jeunes » ou « Petits » (Heft-petché). Lorsque l'on arrive du côté d'Andérâb, deux chemins se réunissent au-dessous du principal défilé, et conduisent à Perwân par le chemin des Sept Jeunes. C'est là une route très difficile.[10] »
A partir du passage de l'Hindou Coûch, Ibn Batoutah se trouvait dans la contrée actuellement connue sous le nom d'Afghanistan, mais qui relevait alors du sultan de la Transoxiane. A Perwân, ville située sur la rivière de Pendjhîr, et appelée, par les géographes arabes, Perwân,[11] il rencontra le lieutenant de ce souverain. De là il se rendit au grand bourg de Tcharkh, nommé par les voyageurs modernes Tcharikar; puis à Ghazna, la célèbre capitale de l'empire Ghaznévide, et à Kaboul. Enfin, il gagna les bords du Sind, non sans avoir eu à résister aux attaques des Afghans, qu'il déjoua toutefois assez facilement.
Ici commence la seconde partie de la relation originale d'Ibn Batoutah, et finit la partie publiée de la version portugaise du P. Moura.[12] Les personnes qui ne possèdent pas la connaissance de l'arabe n'ont donc pu, jusqu'à présent, juger du mérite de cette portion de l'ouvrage qu'à l'aide de la traduction de M. Lee, faite sur un abrégé. Or quoique, pour ce qui regarde la péninsule en deçà du Gange, cet abrégé soit beaucoup moins défectueux que pour ce qui concerne d'autres pays, tels que l'Asie Mineure, le Kiptchak, et surtout le Hedjaz et l'Arabie centrale, si étrangement passés sous silence par l'abréviateur, il est loin, surtout pour les détails historiques, de pouvoir remplacer l'original.[13] Cependant, deux juges bien compétents ont rendu pleine justice à l'intérêt que présente cette seconde partie de l'ouvrage, même dans l'abrégé. « Il est fort à regretter, dit feu Sir H. M. Elliot, que nous ne possédions pas un exemplaire complet du livre de ce voyageur entreprenant….. L'époque où Ibn Batoutah visita l'Inde (A. D. 1332-1342) est fort intéressante, et nous fait regretter davantage que les détails géographiques aient été rendus avec autant de confusion par l'abréviateur.[14] »
Le savant et judicieux historien de l'Inde, Mountstuart Elphinstone, après avoir tracé le récit du règne de Mohammed ibn Toghlok chah, ajoute ces paroles : « Beaucoup de particularités concernant ce règne sont rapportées par Ibn Batoutah, natif de Tanger, qui voyagea dans toute l'Asie, et visita la cour de Mohammed vers l'année 1341, et qui n'a pu avoir aucun intérêt à farder la vérité, puisqu'il a écrit après son retour en Afrique. Il confirme, dans toute leur étendue, les récits des indigènes touchant les talents et les crimes du roi, et trace, de sa magnificence mêlée de ruine, un tableau absolument tel qu'on peut se le figurer, quand il s'agit d'un pareil souverain[15] ».
Notre intention n'est point de suivre pas à pas Ibn Batoutah dans la partie de son récit qui concerne l'Inde; une pareille tâche nous entraînerait fort au delà des bornes qui nous sont prescrites; elle n'aurait pas, d'ailleurs, une bien grande utilité au point de vue géographique, puisque, dans ce volume, nous ne faisons que conduire notre auteur jusqu'à Dihly, et qu'on n'y trouvera mentionnées qu'un assez petit nombre de localités. C'est surtout par ce qui regarde les régions centrales de la péninsule et les villes du littoral, que la relation de l'Inde, par Ibn Batoutah, se recommande aux géographes; et ces différents morceaux sont réservés pour le prochain volume. L’intérêt de celui-ci est plus principalement historique. Nous devons donc nous attacher à signaler et à éclaircir, autant qu'il est en nous, les principaux points des annales de l'Inde dont il y est question.
Ibn Batoutah dit que,
dans une grande et belle ville, située sur le bord oriental du Sind,
et qu'il appelle Djénâny, il rencontra une peuplade nommée les
Sâmirah, qui formait la population de cette localité. Il ajoute
qu'elle y était fixée depuis l'époque de la conquête de cette ville,
du temps de Heddjâdj (vers le commencement du
viiie
siècle de J. C). Cette réflexion de notre auteur paraîtrait indiquer
qu'il regardait la tribu en question comme d'origine musulmane. Mais
des détails qu'il donne plus loin sur quelques coutumes singulières
observées par elle, prouvent qu'elle appartenait, au moins pour la
majeure partie, à la religion brahmanique. Or Firichtah raconte que
la portion inférieure de la vallée de l’Indus obéit, pendant un
siècle, à une famille de Zémîndâr, ou « tenanciers hindous, »
nommés les Soûmarah,  .[16]
Il dit plus loin que Nasir eddîn Kabâtchah, le premier souverain
musulman du Sind, après la mort de Kothb eddîn Aïbec, affaiblit
tellement les Soûmarah, dont les uns étaient musulmans[17]
et les autres infidèles, qu'il ne resta plus entre leurs mains que
la ville de Tatta
.[16]
Il dit plus loin que Nasir eddîn Kabâtchah, le premier souverain
musulman du Sind, après la mort de Kothb eddîn Aïbec, affaiblit
tellement les Soûmarah, dont les uns étaient musulmans[17]
et les autres infidèles, qu'il ne resta plus entre leurs mains que
la ville de Tatta  , les
jungles et les places frontières. Aussi se résignèrent-ils à se
livrer à l'agriculture et au soin des troupeaux, et vécurent-ils
dans la retraite. Mais, après Nasir eddîn Kabâtchah (mort en 623=
1225), ils ressaisirent par degrés le pouvoir, et arrachèrent le
Sind aux sultans de Dihly. Firichtah parle d'un radjah de Tatta, qui
s'appelait Habéchy, et qui appartenait à la peuplade des Soûmarah.
Plus loin, il atteste que les Zémîndârs du Sind étaient divisés en
deux troupes appelées, l'une Soûmarah, et l'autre Satmah
(alias Samma ou Soumana) ; qu'à la fin du règne
de Mohammed Ibn Toghlok, grâce aux efforts et a l'aide des
musulmans, la puissance passa de la famille des Soûmarah à celle des
Satmah, qui donnait à son chef le nom de Djam. Enfin, dans son récit
du règne de Mohammed ibn Toghlok, Firichtah rapporte que la peuplade
des Soûmarah, laquelle habitait Tatta, avait donné asile à un
rebelle. Un auteur persan du
xviie siècle a mentionné une secte hindoue dont le
nom et les usages offrent de grands rapports avec ceux des Sâmirah,
dont parle notre auteur.[18]
, les
jungles et les places frontières. Aussi se résignèrent-ils à se
livrer à l'agriculture et au soin des troupeaux, et vécurent-ils
dans la retraite. Mais, après Nasir eddîn Kabâtchah (mort en 623=
1225), ils ressaisirent par degrés le pouvoir, et arrachèrent le
Sind aux sultans de Dihly. Firichtah parle d'un radjah de Tatta, qui
s'appelait Habéchy, et qui appartenait à la peuplade des Soûmarah.
Plus loin, il atteste que les Zémîndârs du Sind étaient divisés en
deux troupes appelées, l'une Soûmarah, et l'autre Satmah
(alias Samma ou Soumana) ; qu'à la fin du règne
de Mohammed Ibn Toghlok, grâce aux efforts et a l'aide des
musulmans, la puissance passa de la famille des Soûmarah à celle des
Satmah, qui donnait à son chef le nom de Djam. Enfin, dans son récit
du règne de Mohammed ibn Toghlok, Firichtah rapporte que la peuplade
des Soûmarah, laquelle habitait Tatta, avait donné asile à un
rebelle. Un auteur persan du
xviie siècle a mentionné une secte hindoue dont le
nom et les usages offrent de grands rapports avec ceux des Sâmirah,
dont parle notre auteur.[18]
A l'article de Dihly, dont il donne une description fort détaillée et pleine d'intérêt, Ibn Batoutah dit que cette ville fut prise par les musulmans dans l'année 584 (1188 de J. C). Plus loin, il répète la même date, en citant comme son garant le kadi suprême de l'Inde, à l'époque où il s'y trouvait.
Il ajoute même qu'il l'a vue retracée sur le mihrâb (chœur ou autel) de la grande mosquée de Dihly. Mais nous devons faire observer qu'un auteur persan qui vivait dans la première moitié du xiiie siècle, et dont le témoignage a été admis par Firichtah, atteste que Dihly a été conquise par Kothb eddîn Aïbec, en l'année 588 seulement (1192 de J. C.[19]).
Ibn Batoutah consacre plus de cinquante pages à retracer l'histoire des souverains de Dihly, depuis Kothb eddîn Aïbec, jusqu'à Mohammed ibn Toghlok chah, sous le règne duquel il visita l'Inde. Nous avons eu soin de comparer son récit avec ceux de l'auteur des Thabakâti Nâssiry, de Khondémir (dans son Habib assiyer) et de Firichtah, et nous l'avons généralement trouvé d'accord avec ces écrivains. Mais comme il ne donne pas une seule date, et qu'on pourrait être embarrassé, dans la lecture de cette partie de son ouvrage, par ce défaut d'indications chronologiques, nous croyons devoir insérer ici un tableau offrant l'époque de l'avènement de tous les empereurs de Dihly antérieurs à Mohammed ibn Toghlok.[20]
|
DATES |
N°. |
NOMS DES PRINCES. |
|
DE L'AVENEMENT |
||
|
588(1193). |
1 |
Schihâb eddîn (ou Mo’izz eddîn) Mohammed ben Sam, le Ghouride, roi de Ghazna, s'empare de Dihly par le moyen de son ancien esclave, |
|
603 (mars 1206). |
2 |
Kothb eddîn Aïbec, qui gouverne cette ville en qualité de vice-roi jusqu'à la mort de son maître, et, postérieurement à cette époque, comme souverain indépendant. |
|
607 (1210-1211). |
3 |
Arâm chah, fils d'Aïbec. |
|
607. |
4 |
Chems eddîn Altmich, gendre d'Aïbec. |
|
633 (1236). |
5 |
Rocn eddîn Firouz chah, fils d'Altmich. |
|
634 (nov. 1236). |
6 |
La sultane Radhiyab, fille d'Altmich. |
|
637 (avril 1240). |
7 |
Mo’izz eddin Behrâm chah, fils d' Altmich. |
|
639 (1241-1242). |
8 |
Alâ eddîn Maç’oud chah, fils de Firouz chah. |
|
644 (juin 1246). |
9 |
Nasir eddîn Mahmoud, fils d'Altmich, à qui furent dédiées les Thabakâti Nâssiry. |
|
|
||
|
664 (février 1266). |
10 |
Ghiâth eddîn Balaban, gendre d'Altmich. |
|
685 [fin de] (commencement de 1286) |
11 |
Mo’izz eddîn Keï Kobâd, petit-fils du précédent. |
|
687 [fin de]. Selon Firichtah. t. I, p.153, l. dern., ou plutôt de 688 (premiers jours de janv. 1290) |
12 |
Djélal eddîn Firouz chah Khildjy. |
|
695 (1296). |
13 |
Rocn eddîn Ibrahim, son fils. |
|
695 (1296). |
14 |
'Alâ eddîn Mohammed chah, neveu et gendre de Djélal eddîn. |
|
715 (janvier 1316). |
15 |
Schihâb eddîn 'Omar, fils d'Alâ eddîn. |
|
716 (avril 1316). |
16 |
Kothb eddîn Mobârec chah, fils d'Alâ eddîn. |
|
720 (1320). |
17 |
Nasir eddîn Khosrow. |
|
720 (1320). |
18 |
Ghiâth eddîn Toghlok chah meurt en 725 (1325). |
Des dix-huit souverains inscrits sur cette liste, trois (le 3e, le 7e et le 8e) ont été omis par Ibn Batoutah. Notre voyageur n'a pas fait mention non plus d'un enfant de trois ans, fils de Mo’izz eddîn Keï Kobâd, et qui fut placé sur le trône, sous le nom de Chems eddîn Keïoumors, lorsque son père se vit atteint de paralysie.[21] Nous ne croyons pas nécessaire d'indiquer les différences de détail qui existent entre le récit d'Ibn Batoutah, et ceux des historiens persans, la plupart plus récents.[22] Outre que ces différences ne sont généralement pas d'une grande importance, elles ont été en partie signalées par M. Lee, dans ses notes.[23] Le même savant a eu soin de faire remarquer d'autres points sur lesquels notre auteur est parfaitement d'accord avec Firichtah. Il nous serait facile de multiplier ces rapprochements. Mais nous croyons qu'il suffît, pour faire sentir toute l'importance du récit d'Ibn Batoutah, de rappeler que celui-ci a puisé ses renseignements sur les lieux mêmes, et qu'il cite comme son principal garant le grand juge de l'Hindoustan. D'ailleurs, il est probable que, pour ce qui concerne les événements accomplis depuis la mort du sultan Balaban, c'est-à-dire pendant la période d'environ un demi-siècle qui précéda son entrée dans l'Inde, Ibn Batoutah a pu en recueillir les détails de la bouche de témoins oculaires. Il lui arrive plus d'une fois de rapporter les propres paroles de témoins de cette espèce. Un détail qui peut prouver combien notre auteur a été, en général, exactement informé, c'est ce qu'il ajoute à propos de l'entrevue qui eut lieu entre le sultan Mo’izz eddîn et son père, Nasir eddîn, à savoir, qu'elle fut appelée la rencontre ou conjonction des deux astres heureux, et que les poètes la célébrèrent en foule. Or Firichtah, qui place, il est vrai, cette entrevue sur le fleuve Sérou (Sareyou ou Goggrah), et non sur le Gange, et qui la met deux années après l'époque que semble indiquer Ibn Batoutah, cite un poème qui fut composé à cette occasion par le célèbre émir Khosrow Dihléwy, et qui porte le titre de Mesnéwy de la conjonction des deux astres heureux.[24]
Si, pour les temps antérieurs à l'avènement de Mohammed ibn Toghlok chah, le récit d'Ibn Batoutah, quoique intéressant et souvent plus détaillé que ceux des historiens dont les ouvrages sont à notre disposition, ne peut passer cependant que pour un écho fidèle des bruits qui avaient cours parmi les personnes instruites, à l'époque où il visita l'Inde, il en est tout autrement d'une grande portion de ce qu'il nous apprend touchant le règne de ce second empereur de la dynastie toghlokide. Notre voyageur a passé plusieurs années dans les Etats, ou même à la cour de ce souverain; les importantes fonctions de judicature dont il fut investi par lui le mirent en relation avec la plupart des personnages influents de l'empire; enfin, il accompagna le camp impérial dans plus d'une circonstance mémorable. On ne peut donc refuser à la plus grande partie de ce qu'il nous raconte sur les actions de ce prince, la confiance due à tout témoin fidèle et désintéressé.
Ibn Batoutah a prévu le sentiment d'incrédulité que pourraient exciter certains de ses récits touchant la munificence extraordinaire de Mohammed. Mais il a eu soin, à deux reprises, de protester de sa véracité, et cela dans les termes les plus forts, les plus énergiques. D'ailleurs ce qu'il dit à ce sujet est pleinement confirmé, tant par les témoignages de Khondémir et de Firichtah, que par celui d'un historien arabe contemporain, dont nous avons parlé dans la préface du premier volume. On remarquera même que l'auteur du Méçâlic alabsâr, écrivain judicieux et exact, mais qui, n'ayant jamais visité l'Inde, tenait ses renseignements de voyageurs et de marchands, peut-être portés à l'exagération, se montre beaucoup moins modéré qu'Ibn Batoutah dans les chiffres qu'il assigne aux largesses du sultan, et dans les descriptions qu'il trace de la magnificence de ce souverain.[25]
Nous nous bornerons à deux ou trois remarques pour ce qui concerne cette portion de l'ouvrage. Ibn Batoutah atteste qu'il a été présent à la rentrée de Mohammed dans sa capitale, au retour de quelques voyages; que, dans ces circonstances, trois ou quatre petites batistes, dressées sur des éléphants, lançaient aux assistants des pièces d'argent et d'or, que ceux-ci ramassaient. « Cela, ajoute notre auteur, commença au moment de l'entrée du sultan dans la ville, et dura jusqu'à son arrivée au château ». Une telle prodigalité peut paraître bien extraordinaire; et cependant Khondémir affirme, d'après Dhiyaï Berny, auteur contemporain de Mohammed, que le jour où ce prince fit son entrée à Dihly, six semaines après son avènement au trône, ses trésoriers ayant chargé, d'après ses ordres, de robustes éléphants, de pièces d'or et d'argent, répandirent celles-ci sur l'assistance, et cela durant tout l'espace compris depuis la porte de Dihly jusqu'à celle du palais impérial.[26] Firichtah, qui répète ces détails, ajoute de plus qu'on jetait ces pièces de monnaie jusque sur les toits des maisons.
Il est question dans Ibn Batoutah d'espions domestiques, que le souverain de l'Inde avait coutume de placer près de chaque émir, quel que fût son rang. Firichtah nous apprend, en effet, que tel était l'usage d'un des prédécesseurs de Mohammed ibn Toghlok. « Le sultan Alâ eddîn, dit l'historien persan, établit des espions, de sorte que tout le bien et le mal commis par les habitants de la ville et du pays lui était parfaitement connu. Ce fut au point, que les conversations que les émirs et les hommes distingués de Dihly tenaient, la nuit, dans leurs maisons, avec leurs femmes et leurs enfants, l'empereur en avait connaissance dès le matin suivant.[27] Quand un de ces personnages paraissait en sa présence, Alâ eddîn lui remettait un écrit comprenant les propos de la nuit[28] ».
On remarquera dans ce volume un long et piquant récit des aventures d'un descendant de l’avant-dernier khalife abbâside de Bagdad, et du traitement magnifique qu'il éprouva de la part du sultan de l’Inde. Ici encore les assertions de notre auteur sont pleinement confirmées par Firichtah, dans lequel nous lisons ce qui suit : « Makhdoûm Zâdeh,[29] de Bagdad, lequel, en apparence, était de la famille d'Abbâs, étant arrivé dans l'Inde, l'empereur sortit à sa rencontre jusqu'à la petite ville de Pâlem, lui donna deux cent mille tengah, un district, le kiosque de Sîri, tout le revenu des terres comprises dans l'enceinte delà citadelle, et, enfin, plusieurs jardins. Toutes les fois que Makhdoûm Zâdeh venait le voir, le sultan descendait de son trône, et après être allé quelques pas au-devant de lui, il le faisait asseoir à son côté sur ce trône, et lui témoignait la plus grande politesse ».
Un reproche que l'on est en droit d'adresser à Ibn Batoutah, c'est d'avoir raconté à peu près au hasard, et sans suivre la succession chronologique des événements, les révoltes et les calamités auxquelles l'Inde fut en proie sous le règne de Mohammed. Ce manque d'ordre est d'autant plus regrettable, que nulle part on ne trouve de date qui vienne aider le lecteur à se reconnaître au milieu de ce récit, d'ailleurs si curieux. Pour remédier, autant que possible, à ce défaut, nous avons cru devoir retracer dans un résumé chronologique, les faits les plus importants du règne de Mohammed, depuis son avènement, jusqu'à l'époque où Ibn Batoutah quitta l’Inde pour la dernière fois, à la fin de l'année 767 de l'hégire (commencement d'avril 1347).
Mois de rebi' premier 725 (février-mars 1325). Avènement de Mohammed.
727. (1326-1327). Mohammed se rend à Diouguir, et forme le dessein de prendre cette ville pour capitale, en place de Dihly. (Khondémir, t. III, fol. 110 r°.)
Fin de 737 (novembre 1327). Mélik Behram Abiah, gouverneur de Moultân, et plus connu sous le nom de Cachloû khân, se révolte. (Khondémir, ibidem; Firichtah, t. I, p. 243.[30])
Même année. Thermachîrîn khân, souverain de l'Oloûs de Djaghataï, envahit l’Hindoustan et s'avance jusqu'aux portes de Dihly. Mohammed achète de lui la paix; mais la crainte de cet ennemi le retient trois ans dans Dihly. (Khondémir, ibidem; Firichtah, t. I, p. 338.)
738 (1337-1338). Mohammed envoie, dans les montagnes de Karâtchil,
que l'on appelle autrement Hémadjil
 (Himalaya),
une armée de cent mille cavaliers, commandée par le fils de sa sœur,
Khosrow Mélik. (Firichtah, t. I, p. 239 à 241.)
(Himalaya),
une armée de cent mille cavaliers, commandée par le fils de sa sœur,
Khosrow Mélik. (Firichtah, t. I, p. 239 à 241.)
Date
inconnue. Béhâ eddîn Guerchâsp, cousin germain du sultan et
gouverneur de la province de Sâghar
 dans le
Dekkan, se révolte; il est défait par Khodjah Djihan et se réfugie
près du radja de Canbîla, dans le Carnatic; puis près de Bilâl Déo,
radja de Déhoûresmend (Dwarsamoudra), qui le livre au vainqueur.
(Firichtah, t. I, p. 241 ; Khondémir, fol. 110 r°.)
dans le
Dekkan, se révolte; il est défait par Khodjah Djihan et se réfugie
près du radja de Canbîla, dans le Carnatic; puis près de Bilâl Déo,
radja de Déhoûresmend (Dwarsamoudra), qui le livre au vainqueur.
(Firichtah, t. I, p. 241 ; Khondémir, fol. 110 r°.)
739 (1338-1339). Mélik Fakhr eddîn, serviteur de Mélik Bidâr Kadr khân Khildjy, gouverneur de Lacnaouly, se révolte dans le Bengale, tue Kadr khân, s'empare de Lacnaouty, de Sonargânou et de Chittagong. (Firichtah, t. I, p. 244; t. II, p. 574, 575, Khondémir, fol. 110 r°.)
... Seyed Ahçan, père de Seyed Ibrahim Kharîlhah Dâr, se révolte dans le Ma'bar. (Firichtah, t. I, p. 244; Khondémir, fol. 110 v°.)
742 (1341-1342). Le sultan se dirige vers le Ma'bar, après être arrivé à Diouguir ou Daoulet Abad, il renvoie Khodjah Djihan à Dihly et part pour le Ma'bar, par le chemin du Tiling, afin de combattre le rebelle. Il séjourne dix jours à Warangol; une épidémie se met parmi ses troupes ; lui-même tombe malade et retourne à Daoulet Abad, puis à Dihly, qu'il trouve en proie à la plus extrême famine. (Firichtah, ibidem; Khondémir, fol. 110 v°.)
Chahoû l'Afghan se révolte à Moultân et tue Bihzâd, vice-roi de cette ville. (Firichtah, t. I, p. 245.)
743 (1342-1343). Mélik Djender (probablement le Kuldjund d'Ibn Batoutah), chef des Gakers, arbore l'étendard de la révolte et tue le gouverneur de Lahore, Mélik Tatar khân. Le sultan fait marcher contre lui Khodjah Djihan, qui le met en déroute. (Firichtah, ibidem.)
Le sultan reconnaît la suprématie du khalife abbâside résidant en Egypte. (Firichtah, t. I, p. 246; Khondémir, fol. 110 v°.)[31]
Mélik 'Aïn Almolc Moltâny, gouverneur d'Oude et de Zhafer Abad se révolte avec ses frères. (Firichtah, t. I, p. 248, 249; Ibn Batoutah, ci-dessous.) Firichtah place cette rébellion dans l'année 746; mais il est évident, d'après le récit de Khondémir (fol. 110 v°), comparé avec celui d'Ibn Batoutah, que la révolte d'Ain Almolc a dû arriver quelques années plus tôt, sans doute en 742.
744 (1343-1344) Hadj Sa'id Hormouzy (Sarsary, d'après Khondémir) arrive d'Egypte, en compagnie de l'ambassadeur que le sultan y avait envoyé, et apporte à ce souverain un diplôme d'investiture et un vêtement d'honneur. (Firichtah, ibidem; Khondémir, fol. 110 v.)
745 (1344-1345). Nosrah khân, qui avait affermé toute la province de Bider pour cent lacs de Tengâh, se révolte et se fortifie dans la citadelle de Bîder. Kothloûgh khân est envoyé de Diouguir contre lui, prend le château par capitulation et expédie le rebelle au sultan. (Firichtah, t. I, p. 247.)
746 (1345-1346) 'Aly chah tue, en trahison, le gouverneur de Colbergah; puis il se rend à Bîder, en tue le vice-roi et s'empare de la province. Kolhlough khân marche contre lui, le défait, l'assiège dans Bider et le prend par capitulation. Le sultan exile le rebelle et ses frères à Ghiznin ; et, comme ils en revinrent sans permission, il les fait mettre à mort. (Firich. t. I, p. 247, 248; Ibn Batoutah, ci-dessous.)
Même année. Le sultan reçoit, à Dihly, Hadji Redjeb (Hadji Sa’id, d'après Khondémir) et le cheikh des cheikhs de l'Egypte, qui lui apportent un diplôme du khalife, un vêtement qui avait été porté par ce prince et un étendard. (Firichtah, t. I, p. 249; Khondémir, fol. 111 r°; Ibn Batoutah, t. I.)
Le sultan envoie comme gouverneur, dans le Malwa, 'Afiz Khammâr, « qui était au nombre des gens les plus vils » (Firich. t. I, p. 250). 'Aziz, étant arrivé à Dhâr, invite à un festin les émirs de Sadeh ou « centeniers », et en tue, par trahison, près de soixante et dix. (Firichtah, t. I, p. 251 ; Khondémir, fol. 111 r°.)
Le sultan confie à Mokbil, esclave d'Ahmed ibn Ayâz Khodjah Djihan, le vizirat du Guzarate. (Firichtah, t. I, p. 251.)
A la fin du mois de ramadhan 745=commencement de février 1345 (Khondémir, fol. 111 r°), Mélik Mokbil se met en route pour Dihly, par le chemin de Dévy et de Baroda, avec des trésors et des chevaux destinés au sultan. Les émirs centeniers du Guzarate lui enlèvent le tout, et il s'enfuit à Nehrwâleh. (Firichtah, t. I, p. 252.)
A la nouvelle de cet outrage, le sultan part pour le Guzarate, à la fin de l'année susdite[32] ; il s'arrête dans la petite ville de Sultanpour, à quinze kosses de Dihly, et y apprend la défaite et la mort d'Aziz Khammâr. (Firichtah, t. I, p. 252.)
A son arrivée près de la montagne d'Abhou, qui forme la limite du Guzarate, il envoie contre les rebelles le cheikh Mo’izz eddîn, un des principaux émirs. Celui-ci est rejoint, près de Déwy, par Mélik Mokbil ; et tous deux livrent aux révoltés un combat dans lequel ils remportent la victoire. (Firichtah, t. I, p. 253.)
Le sultan s'établit temporairement à Bahroutch, et perçoit avec la dernière sévérité les tributs arriérés de cette ville, de Cambaie et des autres cantons du Guzarate. Il envoie à Daoulet Abad deux émissaires chargés d'arrêter et de mettre à mort les perturbateurs, émirs centeniers ou autres; puis il se ravise et ordonne de lui expédier ces individus, sous l'escorte de quinze cents cavaliers. Mais les prisonniers, parmi lesquels se trouvait Haçan Gângoû, redoutant la sévérité du monarque, fondent sur leur escorte, tuent un de ses chefs, retournent à Daoulet Abad, et y assiègent Nizâm eddîn 'Alim Almolc, frère de Kothough khân. Ils débauchent la garnison, s'emparent de la ville, et mettent à mort les officiers impériaux, à l'exception de Nizâm eddîn. (Firich. t. I, p. 253, 254, 521, 522; Khondémîr, fol. 111 r°.)
Les émirs centeniers du Guzarate, qui, depuis leur défaite, se tenaient cachés, se joignent tous aux rebelles de Daoulet Abad. Ils reconnaissent pour roi l'émir Ismâ’îl l'Afghan, qui était chef de deux mille hommes, et lui donnent le nom de Nasir eddîn. Le sultan, ayant appris ces nouvelles, part en toute hâte de Bahroûtch, et arrive devant Daoulet Abad. Les révoltés, au nombre de trente mille cavaliers, Afghans, Mongols, Radjpouts, Dekhanis, en viennent aux mains avec lui, et mettent ses deux ailes en déroute. Mais le chef de leur avant-garde ayant été tué, près de quatre mille de leurs cavaliers prennent tout à coup la fuite. La nuit interrompt le combat, et le souverain des rebelles en profite pour se retirer dans la citadelle de Daoulet Abad, où il est assiégé par Mohammed, qui s'établit dans le kiosque impérial de la ville. Le siège durait depuis près de trois mois et avait déjà coûté la vie à beaucoup de monde, quand une nouvelle rébellion, survenue dans le Guzarate, force le sultan à quitter Daoulet Abad, en y laissant, toutefois, un corps d'armée, commandé par Khodhâwend Zâdeh Kiwâm eddîn. (Firichtah, t. I, p. 254, 255, 523, 524; Khondémir, fol. 111 r°.)
La lecture de ce tableau, où les événements racontés par Ibn Batoutah sont indiqués à leur place respective, permettra de mieux saisir l'enchaînement des faits, en même temps qu'elle montrera combien notre auteur s'accorde généralement avec Khondémir et Firichtah. Il nous a semblé que c'était là l'épreuve la plus décisive à laquelle on pût soumettre l'exactitude du voyageur africain. Ce résumé chronologique présente deux ou trois circonstances dont Ibn Batoutah n'a pas parlé, telles sont, par exemple, l'invasion de l'Inde par Thermachîrîn, antérieure, il est vrai, d'au moins sept à huit ans à l'arrivée d'Ibn Batoutah dans cette contrée, et la révolte du Bengale, sous Mélik Fakhr eddîn, en l'année 739 (1338-1339). En revanche, notre auteur offre plusieurs faits, dont ni Khondémir, ni Firichtah n'ont fait mention. Il nous suffira de signaler ce qui a rapport au prince du Bengale, Ghiâth eddîn Behadour Bourah. Firichtah n'a mentionné ce roi ni dans l'Histoire des empereurs de Dihly, ni dans la portion de son ouvrage qu'il a consacrée spécialement à l'histoire du Bengale. Et cependant des passages des Thabakâti acbary et du Tarikh-i Firouz châhy, ainsi qu'une monnaie d'argent, frappée à Sonârgânou, en l'année 728 (1827-13a8), prouvent que Ghiâth eddîn Behadour chah gouvernait alors le Bengale, sous la suzeraineté de Mohammed ibn Toghlok chah.[33]
On remarquera que, pour les derniers événements compris dans le précis chronologique, le récit d'Ibn Batoutah s'accorde moins parfaitement que pour ce qui précède avec ceux de Khondémir et de Firichtah. Cela n'a rien qui doive nous étonner : en effet, Ibn Batoutah n'a pu avoir connaissance de ces faits que par ouï-dire, pendant les courtes relâches qu'il fit dans les ports de Caoulem et de Calicut, à son retour de la Chine. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait point connu, dans toutes leurs circonstances, des événements qui s'étaient passés dans d'autres portions de l'Inde, telles que le Guzarate et le Dekkan, et dont quelques-uns d'ailleurs n'étaient pas encore entièrement terminés, lorsqu'il dit adieu pour la dernière fois à la péninsule indienne.[34]
Nous n'avons pas plus craint, pour ce volume que pour les précédents, de soumettre à un examen sévère le récit de notre voyageur, et d'en faire connaître les parties faibles. Nous croyons qu’Ibn Batoutah n'y perdra rien aux yeux des juges éclairés et impartiaux. Nous espérons que ceux-ci voudront bien nous tenir compte des soins longs et minutieux que nous n'avons cessé de prendre pour éclaircir, autant qu'il était en nous, les difficultés que présentait cette portion de l'ouvrage.

Après être partis de Sera, nous marchâmes pendant dix jours et arrivâmes à la ville de Serâtchoûk. Le mot tchoûk (tchik) signifiant petit, c’est comme si l’on disait le Petit-Sera. Cette ville est située sur le bord d’un fleuve immense, que l’on appelle Oloû Soû (l’Oural ou Yaïk), ce qui signifie la Grande Eau. Il est traversé par un pont de bateaux semblable à celui de Bagdad. C’est ici que nous cessâmes de voyager avec des chevaux traînant des chariots ; nous les vendîmes moyennant quatre dinars d’argent par tête, et moins encore, à cause de leur état d’épuisement et de leur peu de valeur dans cette ville. Nous louâmes des chameaux pour tirer les chariots. On voit à Serâtchoûk une zaouïa appartenant à un pieux personnage turc avancé en âge, que l’on appelle Athâ, c’est-à-dire Père. Il nous y donna l’hospitalité et fit des vœux en notre faveur. Le kadi nous traita aussi ; mais j’ignore son nom.
Après notre départ de Serâtchoûk, nous marchâmes, durant trente jours, d’une marche rapide, ne nous arrêtant que deux heures chaque jour, l’une vers dix heures de la matinée, et la seconde au coucher du soleil. Chacune de ces stations durait seulement le temps nécessaire pour faire cuire le doughy (espèce de millet) et pour le boire. Or il est cuit après un seul bouillon. Ces peuples ont de la viande salée et séchée au soleil, qu’ils étendent par-dessus cette boisson ; enfin, ils versent sur le tout du lait aigri. Chaque homme mange et dort seulement dans son chariot durant le temps de la marche. J’avais dans mon ’arabah trois jeunes filles. C’est la coutume des voyageurs d’user de vitesse en franchissant ce désert, à cause du peu d’herbage qu’il produit : les chameaux qui le traversent périssent pour la plupart, et ceux qui survivent ne servent de nouveau que l’année suivante, lorsqu’ils ont repris de l’embonpoint. L’eau, dans ce désert, se trouve dans des endroits placés des intervalles déterminés, à deux ou trois jours de distance l’un de l’autre ; elle est fournie par la pluie ou par des puits creusés dans le gravier.
Lorsque nous eûmes traversé ce désert, ainsi que nous l’avons dit, nous arrivâmes à Khârezm. C’est la plus grande et la plus belle ville des Turcs ; elle possède de jolis marchés, de vastes rues, de nombreux édifices, et se recommande par des beautés remarquables. Ses habitants sont si nombreux qu’elle tremble, pour ainsi dire, sous leur poids, et qu’ils la font ressembler, par leurs ondulations, à une mer agitée. Je m’y promenai à cheval pendant un jour, et j’entrai dans le marché. Lorsque j’arrivai au milieu et que j’atteignis l’endroit où l’on se serrait le plus, et que l’on appelle chaour (est-ce le mot persan choûr, « commotion, agitation, tumulte », et aussi « marché des chevaux » ?), je ne pus dépasser ce lieu, à cause de la foule qui s’y pressait. Je voulus revenir sur mes pas ; cela me fut également impossible, et par le même motif. Je demeurai confondu, et je ne parvins à m’en retourner qu’après de grands efforts. Quelqu’un me dit que ce marché était peu fréquenté le vendredi, parce qu’on ferme ce jour-là le marché de la Kaïçârieh (bazar), et d’autres marchés. Je montai à cheval le vendredi, et je me dirigeai vers la mosquée cathédrale et le collège.
Cette ville fait partie des États du sultan Uzbek, qui y a placé un puissant émir nommé Kothloûdomoûr. C’est cet émir qui a construit le collège et ses dépendances ; la mosquée a été bâtie par sa femme, la pieuse princesse Torâbec. On voit à Khârezm un hôpital, auquel est attaché un médecin syrien connu sous le nom d’Assahioûny, qui est un adjectif relatif dérivé de Sahioûn nom d’une ville de Syrie.
Je n’ai pas vu, dans tout l’univers, d’hommes meilleurs que les habitants de Khârezm ni qui aient des âmes plus généreuses ou qui chérissent davantage les étrangers. Ils observent, dans leurs prières, une coutume louable que je n’ai point remarquée chez d’autres peuples : cette coutume consiste en ce que chaque muezzin des mosquées de Khârezm fait le tour des maisons occupées par des voisins de sa mosquée, afin d’avertir ceux-ci d’assister à la prière. L’imâm frappe, en présence de toute la communauté, quiconque a manqué à la prière faite en commun ; il y a un nerf de bœuf, suspendu dans chaque mosquée, pour servir à cet usage. Outre ce châtiment, le délinquant doit payer une amende de cinq dinars, qui est appliquée aux dépenses de la mosquée, ou employée à nourrir les fakirs et les malheureux. On prétend que cette coutume est en vigueur chez eux depuis les temps anciens.
Auprès de Khârezm coule le fleuve Djeïhoun (Oxus), un des quatre fleuves qui sortent du Paradis. Il gèle dans la saison froide, comme le fleuve Itil (Volga). On marche alors sur la glace qui le recouvre, et il demeure gelé durant cinq mois. Souvent des imprudents ont osé le passer au moment où il commençait à dégeler, et ils ont péri. Durant l’été on navigue sur l’Oxus, dans des bateaux, jusqu’à Termedh, et l’on rapporte de cette ville du froment et de l’orge. Cette navigation prend dix jours à quiconque descend le fleuve.
Dans le voisinage de Khârezm se trouve un ermitage, bâti auprès du mausolée du cheikh Nedjm eddîn Alcobra,[35] qui était au nombre des plus saints personnages. On y sert de la nourriture aux voyageurs. Le supérieur de cet ermitage est le professeur Seïf eddîn, fils d’Açabah, un des principaux habitants de Khârezm. Dans cette ville se trouve encore un ermitage dont le supérieur est le pieux, le dévot Djélal eddîn Assamarkandy, un des hommes les plus pieux qui existent ; il nous y traita.
Près de Khârezm, on voit le tombeau de l’imâm très savant Abou’lkâcim Mahmoud, fils d’Omar azzamakhchary, au-dessus duquel s’élève un dôme. Zamakhchar est une bourgade à quatre milles de distance de Khârezm.
Lorsque j’arrivai à Khârezm, je logeai en dehors de cette ville. Un de mes compagnons alla trouver le kadi Sadr eddîn Abou Hafs’Omar albecry, Celui-ci m’envoya son substitut Nour alislâm, « la lumière de l’islamisme », qui me donna le salut, et retourna ensuite près de son chef. Le kadi vint en personne, accompagné de plusieurs de ses adhérents, et me salua. C’était un tout jeune homme, mais déjà vieux par ses œuvres ; il avait deux substituts dont l’un était le susdit Nour alislâm et l’autre Nour eddîn Alkermâny, un des principaux jurisconsultes. Ce personnage se montre hardi dans ses décisions et ferme dans la dévotion.
Lorsque j’eus mon entrevue avec le kadi, il me dit :« Cette ville est remplie d’une population extrêmement dense, et vous ne réussirez pas facilement à y entrer de jour. Nour alislâm viendra vous trouver, pour que vous fassiez votre entrée avec lui à la fin de la nuit. » Nous agîmes ainsi, et nous logeâmes dans un collège tout neuf, où il ne se trouvait encore personne.
Après la prière du matin, le kadi vint nous visiter, accompagné de plusieurs des principaux de la ville, parmi lesquels Mewlânâ Homân eddîn, Mewlânâ Zeïn eddîn Almokaddécy, Mewlânâ Ridha eddîn Iahia, Mewlânâ Fadhl allah Arridhawy, Mewlânâ Djélal eddîn Al’imâdy et Mewlânâ Chems eddîn Assindjary, chapelain de l’émir de Khârezm. Ces hommes étaient vertueux et doués de qualités fort louables. Le principal dogme de leur croyance est l’I’tizâl (doctrine des Moutazilites, cf. t. II), mais ils ne le laissent pas voir, parce que le sultan Uzbek et son vice-roi en cette ville, Kothloûdomoûr, sont orthodoxes.
Durant le temps de mon séjour à Khârezm, je priais le vendredi avec le kadi Abou Hafs ’Omar, et dans sa mosquée. Lorsque j’avais fini de prier, je me rendais avec lui dans sa maison, qui est voisine de la mosquée. J’entrais en sa compagnie dans son salon, qui est un des plus magnifiques que l’on puisse voir. Il était décoré de superbes tapis ; ses murs étaient tendus de drap ; on y avait pratiqué de nombreuses niches, dans chacune desquelles se trouvaient des vases d’argent doré et des vases de verre de l’Irak. C’est la coutume des habitants de ce pays d’en user ainsi dans leurs demeures. On apportait ensuite des mets en grande quantité, car le kadi est au nombre des hommes aisés et opulents et qui vivent très bien. Il est l’allié de l’émir Kothloûdomoûr, ayant épousé la sœur de sa femme, nommée Djîdjâ Agha.
On trouve à Kharezm plusieurs prédicateurs, dont le principal est Mewlânâ Zeïn eddîn Almokaddecy. On y voit aussi le khathîb Mewlânâ Hoçâm eddîn Almecchâthy, l’éloquent prédicateur, et un des quatre meilleurs orateurs que j’aie entendu dans tout l’univers.
L’émir de Khârezm est le grand émir Kothloûdomoûr, dont le nom signifie le Fer béni ; car kothloû veut dire béni, et domoûr est l’équivalent du mot fer. Cet émir est fils de la tante maternelle du sultan illustre Mohammed Uzbek ; il est le principal de ses émirs et son vice-roi dans le Khoraçan. Son fils, Haroun Bec, a épousé la fille du sultan et de la reine Thaïthogly, dont il a été question ci-dessus. Sa femme, la khatoun Torâbec, s’est signalée par d’illustres actes de générosité. Lorsque le kadi vint me voir pour me saluer, ainsi que je l’ai raconté, il me dit : « L’émir a appris ton arrivée, mais il a un reste de maladie qui l’empêche de te visiter, » Je montais à cheval avec le kadi, pour rendre visite à l’émir. Nous arrivâmes à son palais, et nous entrâmes dans un grand michwer, dont la plupart des appartements étaient en bois. De là nous passâmes dans une petite salle d’audience où se trouvait un dôme de bois doré dont les parois étaient tendues de drap de diverses couleurs et le plafond recouvert d’une étoffe de soie brochée d’or. L’émir était assis sur un tapis de soie étendu pour son usage particulier ; il tenait ses pieds couverts, à cause de la goutte dont il souffrait, et qui est une maladie fort répandue parmi les Turcs. Je lui donnai le salut, et il me fit asseoir à son côté.
Le kadi et les docteurs s’assirent aussi. L’émir m’interrogea touchant son souverain, le roi Mohammed Uzbek, la Khatoun Beïaloûn, le père de cette princesse et la ville de Constantinople. Je satisfis à toutes ses questions. On apporta ensuite des tables, sur lesquelles se trouvaient des mets, c’est-à-dire des poulets rôtis, des grues, des pigeonneaux, du pain pétri avec du beurre, et que l’on appelle alculidja (en persan culitcheh, pain de forme ronde), du biscuit et des sucreries. Ensuite on apporta d’autres tables couvertes de fruits, savoir des grenades épluchées,[36] dans des vases d’or ou d’argent, avec des cuillers d’or. Quelques-uns de ces fruits étaient dans des vases de verre de l’Irak, avec des cuillers de bois. Il y avait aussi des raisins et de melons superbes.
Parmi les coutumes de cet émir est la suivante : le kadi vient chaque jour à sa salle d’audience et s’assied, dans un endroit destiné à cet usage, avec les docteurs de la loi et ses secrétaires. Un des principaux émirs s’assied en face de lui, avec huit des grands émirs ou cheikhs turcs, qui sont appelés alarghodji (yârghoudji, ou arbitres). Les habitants de la ville viennent soumettre leurs procès à la décision de ce tribunal. Les causes qui sont du ressort de la loi religieuse sont jugées par le kadi ; les autres le sont par ces émirs. Leurs jugements sont justes et fermes ; car ils ne sont pas soupçonnés d’avoir de l’inclination pour l’une des parties, et ne se laissent pas gagner par des présents.
Lorsque nous fûmes de retour au collège, après l’entrevue avec l’émir, il nous envoya du riz, de la farine, des moutons, du beurre, des épices et plusieurs charges de bois à brûler. On ignore l’usage du charbon dans toute cette contrée, ainsi que dans l’Inde, le Khoraçan et la Perse. Quant à la Chine, on y brûle des pierres, qui s’enflamment comme le charbon. Lorsqu’elles sont converties en cendres, on les pétrit avec de l’eau, puis on les fait sécher au soleil, et on s’en sert une seconde fois pour faire la cuisine, jusqu’à ce qu’elles soient tout à fait consumées.
Je faisais ma prière un certain vendredi, selon ma coutume, dans la mosquée du kadi Abou Hafs. Il me dit : « L’émir a ordonné de te payer une somme de cinq cents dirhems, et de préparer à ton intention un festin qui coûtât cinq cents autres pièces d’argent, et auquel assisteraient les cheikhs, les docteurs et les principaux de la ville. Lorsqu’il eut donné cet ordre, je lui dis : « Ô émir, tu feras préparer un repas dans lequel les assistants mangeront seulement une ou deux bouchées ! Si tu assignes à cet étranger toute la somme, ce sera plus utile pour lui. » Il répondit « J’agirai ainsi », et il a commandé de te payer les mille dirhems entiers. » L’émir les envoya, avec son chapelain Chems eddîn Assindjary, dans une bourse portée par son page. Le change de cette somme en or du Maghreb équivaut à trois cents dinars.
J’avais acheté ce jour-là un cheval noir, pour trente-cinq dinars d’argent, et je le montai pour aller à la mosquée. J’en payai le prix sur cette somme de mille dirhems.[37] A la suite de cet événement, je me vis possesseur d’un si grand nombre de chevaux que je n’ose le répéter ici, de peur d’être accusé de mensonge. Ma position ne cessa de s’améliorer, jusqu’à mon entrée dans l’Inde. Je possédais beaucoup de chevaux ; mais je préférais ce cheval noir et je l’attachais devant tous les autres. Il vécut trois années entières à mon service, et après sa mort, ma situation changea.
La Khatoun Djîdjâ Agha, femme du kadi, m’envoya cent dinars d’argent. Sa sœur Torâbec, femme de l’émir, donna en mon honneur un festin, dans l’ermitage fondé par elle, et y réunit les docteurs et les chefs de la ville. Dans cet édifice, on prépare de la nourriture pour les voyageurs. La princesse m’envoya une pelisse de martre-zibeline et un cheval de prix. Elle est au nombre des femmes les plus distinguées, les plus vertueuses et les plus généreuses. (Puisse Dieu la récompenser par ses bienfaits !)
Lorsque je quittai le festin que cette princesse avait donné en mon honneur et que je sortis de l’ermitage, une femme s’offrit à ma vue, sur la porte de cet édifice. Elle était couverte de vêtements malpropres et avait la tête voilée. Des femmes, dont j’ai oublié le nombre, l’accompagnaient. Elle me salua ; je lui rendis son salut, sans m’arrêter et sans faire autrement attention à elle. Lorsque je fus sorti, un certain individu me rejoignit et me dit : « La femme qui t’a salué est la khatoun. » Je fus honteux de ma conduite, et je voulus retourner sur mes pas, afin de rejoindre la princesse, mais je vis qu’elle s’était éloignée. Je lui fis parvenir mes salutations par un de ses serviteurs, et je m’excusai de ma manière d’agir envers elle, sur ce que je ne la connaissais pas.
Le melon de Khârezm n’a pas son pareil dans tout l’univers, tant à l’est qu’à l’ouest, si l’on en excepte celui de Boukhara. Le melon d’Ispahan vient immédiatement après celui-ci. L’écorce du premier est verte et le dedans est rouge ; son goût est extrêmement doux, mais sa chair est ferme. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est qu’on le coupe par tranches, qu’on le fait sécher au soleil, qu’on le place dans des paniers, ainsi qu’on en use chez nous avec les figues sèches et les figues de Malaga ; et, dans cet état, on le transporte de Khârezm à l’extrémité de l’Inde et de la Chine. Il n’y a pas, parmi tous les fruits secs, un fruit plus agréable au goût. Pendant le temps de mon séjour à Dihly, dans l’Inde, toutes les fois que des voyageurs arrivaient, j’envoyais quelqu’un pour m’acheter, de ces gens-là, des tranches de melon. Le roi de l’Inde, lorsqu’on lui apportait de ces melons, m’en envoyait, parce qu’il connaissait mon goût pour cet aliment. C’est la coutume de ce prince de donner en présent aux étrangers des fruits de leur pays, et de les favoriser de cette manière.
Un chérif, du nombre des habitants de Kerbela, m’avait accompagné de Sera à Khârezm. Il s’appelait ’Aly, fils de Mansour, et exerçait la profession de marchand. Je le chargeais d’acheter pour moi des vêtements et d’autres objets. Il m’achetait un habit pour dix dinars, et me disait : « Je l’ai payé huit pièces d’or. » Il portait à mon compte huit dinars, et payait de sa bourse les deux autres. J’ignorai sa conduite jusqu’à ce qu’elle me fût révélée par d’autres personnes. Outre cela, le chérif m’avait prêté plusieurs dinars. Lorsque je reçus le présent de l’émir de Khârezm, je lui rendis ce qu’il m’avait prêté, et je voulus ensuite lui faire un cadeau, en retour de ses belles actions. Il le refusa et jura qu’il ne l’accepterait pas. Je voulus donner le présent à un jeune esclave qui lui appartenait et que l’on appelait Câfoûr ; mais il m’adjura de n’en rien faire. Ce chérif était le plus généreux habitant des deux Iraks que j’eusse encore vu. Il résolut de se rendre avec moi dans l’Inde ; mais, dans la suite, plusieurs de ses concitoyens arrivèrent à Khârezm, afin de faire un voyage en Chine ; et il forma le projet de les accompagner. Je lui fis des représentations à ce sujet ; mais il me répondit : « Ces habitants de ma ville natale retourneront auprès de ma famille et de mes proches, et rapporteront que j’ai fait un voyage dans l’Inde pour mendier. Ce serait un sujet de blâme pour moi d’agir ainsi, et je ne le ferai pas. » En conséquence, il partit avec eux pour la Chine. J’appris par la suite, durant mon séjour dans l’Inde, que cet homme, lorsqu’il fut arrivé dans la ville d’Almalyk, située à l’extrémité de la principauté de Mavérannahr et à l’endroit où commence la Chine, s’y arrêta, et envoya à la Chine un jeune esclave, à lui appartenant, avec ce qu’il possédait de marchandises. L’esclave tarda à revenir. Sur ces entrefaites, un marchand arriva de la patrie du chérif à Almalyk et se logea dans le même caravansérail que lui. Le chérif le pria de lui prêter quelque argent, en attendant le retour de son esclave. Le marchand refusa ; ensuite il ajouta à la honte de la conduite qu’il avait tenue en manquant de secourir le chérif, celle de vouloir encore lui faire supporter la location de l’endroit du khân où il logeait lui-même. Le chérif apprit cela ; il en fut mécontent, entra dans son appartement et se coupa la gorge. On survint dans un instant où il lui restait encore un souffle de vie, et l’on soupçonna de l’avoir tué un esclave qui lui appartenait. Mais il dit aux assistants : « Ne lui faites pas de mal ; c’est moi qui me suis traité ainsi » ; et il mourut le même jour. Puisse Dieu lui faire miséricorde !
Ce chérif m’a raconté le fait suivant, comme lui étant arrivé. Il reçut un jour un prêt, d’un certain marchand de Damas, six mille dirhems. Ce marchand le rencontra dans la ville de Hamâh, en Syrie, et lui réclama son argent. Or il avait vendu à terme les marchandises qu’il avait achetées avec cette somme. Il fut honteux de ne pouvoir payer son créancier, entra dans sa maison, attacha son turban au toit, et voulut s’étrangler. Mais, la mort ayant tardé à l’atteindre, il se rappela un changeur de ses amis, l’alla trouver et lui exposa son embarras. Le changeur lui prêta une somme avec laquelle il paya le marchand.
Lorsque je voulus partir de Khârezm, je louai des chameaux et j’achetai une double litière. J’avais pour contrepoids, dans un des côtés de cette litière, ’Afîf eddîn Attaouzéry. Mes serviteurs montèrent quelques-uns de mes chevaux, et nous couvrîmes les autres avec des housses, à cause du froid. Nous entrâmes dans le désert qui s’étend entre Khârezm et Boukhara, et qui a dix-huit journées d’étendue.[38] Pendant ce temps, on marche dans des sables entièrement inhabités, si l’on en excepte une seule ville. Je fis mes adieux à l’émir Kothloûdomoûr, qui me fit don d’un habit d’honneur, ainsi que le kadi. Ce dernier sortit de la ville avec les docteurs pour me dire adieu. Nous marchâmes pendant quatre jours, et nous arrivâmes à la ville d’Alcât. Il n’y a pas sur le chemin de Khârezm à Boukhara d’autre lieu habité que cette ville ; elle est petite, mais belle. Nous logeâmes en dehors, près d’un étang qui avait été gelé par la rigueur du froid, et sur lequel les enfants jouaient et glissaient. Le kadi d’Alcât, appelé Sadr acchéri’ah, « le chef de la loi », apprit mon arrivée. Je l’avais précédemment rencontré dans la maison du kadi de Khârezm. Il vint me saluer avec les étudiants et le cheikh de la ville, le vertueux et dévot Mahmoud alkhaïwaky. Le kadi me proposa de visiter l’émir d’Alcât ; mais le cheikh Mahmoud lui dit : « Il convient que l’étranger reçoive la visite, au lieu de la faire ; si nous avons quelque grandeur d’âme, nous irons trouver l’émir et nous l’amènerons. » Ils agirent de la sorte. L’émir, ses officiers et ses serviteurs arrivèrent au bout d’une heure, et nous saluâmes ce chef. Notre intention était de nous hâter dans notre voyage. Mais il nous pria de nous arrêter, et donna un festin dans lequel il réunit les docteurs de la loi, les chefs de l’armée, etc. Des poètes y récitèrent les louanges de l’émir. Ce prince me fit présent d’un vêtement et d’un cheval de prix. Nous suivîmes la route connue sous le nom de Sibâïeh[39] (Senbâïeh ?, cf. Edrisi, II, p. 187-8).
Dans ce désert, on marche l’espace de six journées sans rencontrer d’eau. Au bout de ce temps, nous arrivâmes à la ville de Wabkéneh (Wakfend des voyageurs modernes), éloignée d’un jour de marche de Boukhara. C’est une belle ville qui possède des rivières et des jardins. On y conserve des raisins d’une année à l’autre, et ses habitants cultivent un fruit qu’ils appellent al’alloû (alâloû « la prune »). Ils le font sécher, et on le transporte dans l’Inde et à la Chine ; on verse de l’eau par-dessus et l’on boit ce breuvage. Le goût de ce fruit est doux lorsqu’il est encore vert ; mais, quand il est séché, il contracte une saveur légèrement acide ; sa partie pulpeuse est abondante. Je n’ai pas vu son pareil dans l’Andalousie, ni dans le Maghreb, ni en Syrie.
Nous marchâmes ensuite, pendant toute une journée, au milieu de jardins contigus les uns aux autres, de rivières, d’arbres et de champs cultivés, et nous arrivâmes à la ville de Boukhara, qui a donné naissance au chef des mohaddith (compilateurs ou professeurs de traditions), Abou Abd Allah Mohammed, fils d’Ismâ’îl albokhâry. Cette ville a été la capitale des pays situés au-delà du fleuve Djeïhoun. Le maudit Tenkîz. Le Tatar, l’aïeul des rois de l’Irak, l’a dévastée. Actuellement ses mosquées, ses collèges et ses marchés sont ruinés, à l’exception d’un petit nombre. Ses habitants sont méprisés ; leur témoignage n’est pas reçu à Khârezm, ni ailleurs, à cause de leur réputation de partialité, de fausseté et d’impudence. Il n’y a plus aujourd’hui à Boukhara d’homme qui possède quelques connaissances, ou qui se soucie d’en acquérir.
Tenkîz khân (Gengis khân) était forgeron, dans le pays de Khithâ (Chine septentrionale). Il avait une âme généreuse, un corps vigoureux, une stature élevée. Il réunissait ses compagnons et leur donnait à manger. Une bande d’individus se rassemblèrent auprès de lui, et le mirent à leur tête. Il s’empara de son pays natal, il devint puissant, ses forces augmentèrent, et son pouvoir fut immense. Il fit la conquête du royaume de Khithâ, puis de la Chine, et ses troupes prirent un accroissement considérable. Il conquit les pays de Khoten, de Câchkhar (Kachgar) et d’Almalyk. Djélal eddîn Sindjar, fils de Khârezm chah, était roi du Khârezm, du Khoraçan et du Mavérâ’nnahi et possédait une puissance considérable. En conséquence, Tenkîz le craignit, s’abstint de l’attaquer et n’exerça aucun acte d’hostilité contre lui.
Or il arriva que Tenkîz envoya des marchands avec des productions de la Chine et du Khithâ, telles qu’étoffes de soie et autres, dans la ville d’Othrâr, la dernière place des États de Djélal eddîn. Le lieutenant de ce prince à Othrâr lui annonça l’arrivée de ces marchands et lui fit demander quelle conduite il devait tenir envers eux. Le roi lui écrivit de s’emparer de leurs richesses, de leur infliger un châtiment exemplaire, de les mutiler et de les renvoyer ensuite dans leur pays ; car Dieu avait décidé d’affliger et d’éprouver les habitants des contrées de l’Orient, en leur inspirant une résolution imprudente, un dessein méchant et de mauvais augure.
Lorsque le gouverneur d’Othrâr se fut conduit de la sorte, Tenkîz se mit en marche, à la tête d’une armée innombrable, pour envahir les pays musulmans. Quand ledit gouverneur reçut l’avis de son approche, il envoya des espions, afin qu’ils lui apportassent des nouvelles de l’ennemi. On raconte que l’un d’eux entra dans le camp d’un des émirs de Tenkîz, sous le déguisement d’un mendiant, et ne trouva personne qui lui donnât à manger. Il s’arrêta près d’un Tatar ; mais il ne vit chez cet homme aucune provision, et n’en reçut pas le moindre aliment. Lorsque le soir fut arrivé, le Tatar prit des tripes, ou intestins desséchés qu’il conservait, les humecta avec de l’eau, fit une saignée à son cheval, remplit ces boyaux du sang qui coulait de cette saignée, les lia et les fit rôtir ; ce mets fut toute sa nourriture. L’espion, étant retourné à Othrâr, informa le gouverneur de cette ville de ce qui regardait les ennemis, et lui déclara que personne n’était assez puissant pour les combattre. Le gouverneur demanda du secours à son souverain Djélal eddîn. Ce prince le secourut par une armée de soixante et dix mille hommes, sans compter les troupes qu’il avait précédemment. Lorsque l’on en vint aux mains, Tenkîz les mit en déroute ; il entra de vive force dans la ville d’Othrâr, tua les hommes et fit prisonniers les enfants. Djélal eddîn marcha en personne contre lui ; et ils se livrèrent des combats si sanglants qu’on n’en avait pas encore vus de pareils sous l’islamisme. Enfin Tenkîz s’empara du Mavérannahr, détruisit Boukhara, Samarkand et Termedh, et passa le fleuve, c’est-à-dire le Djeïhoûn, se dirigeant vers Balkh, dont il fit la conquête. Puis il marcha sur Bamian, qu’il prit également ; enfin, il s’avança au loin dans le Khoraçan et dans l’Irak ’Adjem. Les musulmans se soulevèrent contre lui à Balkh et dans le Mavérannahr. Il revint sur eux, entra de vive force dans Balkh, et ne la quitta qu’après en avoir fait un monceau de ruines (Coran, ii, 261, etc.); il fit ensuite de même à Termedh. Cette ville fut dévastée, et elle n’est jamais redevenue florissante depuis lors mais on a bâti, à deux milles de là, un ville que l’on appelle aujourd’hui Termedh. Tenkîz massacra les habitants de Bamian, et la ruina de fond en comble, excepté le minaret de sa mosquée djâmi. Il pardonna aux habitants de Boukhara et de Samarkand ; puis il retourna dans l’Irak. La puissance des Tatars ne cessa de faire des progrès au point qu’ils entrèrent de vive force dans la capitale de l’islamisme et dans le séjour du khalifat, c’est-à-dire à Baghdâd, et qu’ils égorgèrent le khalife Mosta’cim Billah, l’Abbâside.
Voici ce que dit Ibn Djozaï : « Notre cheikh, le kadi des kadis, Abou’l Bérécât, fils du pèlerin (Ibn alhâddj), m’a fait le récit suivant “J’ai entendu dire ce qui suit au prédicateur Abou ’Abd Allah, fils de Rachid : Je rencontrai à La Mecque Nour eddîn, fils d’Azzeddjâdj, un des savants de l’Irak, accompagné du fils de son frère. Nous conversâmes ensemble et il me dit : Il a péri dans la catastrophe causée par les Tatars, dans l’Irak, vingt-quatre mille savants. Il ne reste plus de toute cette classe que moi et cet homme, désignant du geste le fils de son frère.” »
Mais revenons au récit de notre voyageur.
Nous logeâmes, dit-il, dans le faubourg de Boukhara, nommé Feth Abad, « le séjour de la victoire », où se trouve le tombeau du cheikh, du savant, du pieux et dévot Seïf eddîn albâkharzy ; cet homme était au nombre des principaux saints. L’ermitage qui porte son nom, et où nous descendîmes, est considérable. Il jouit de legs importants, à l’aide desquels on donne à manger à tout-venant. Le supérieur de cet ermitage est un descendant de Bâkharzy ; c’est le pèlerin, le voyageur Yahia albâkharzy. Ce cheikh me traita dans sa maison, et y réunit les principaux habitants de la ville. Les lecteurs du Coran firent une lecture avec de belles voix ; le prédicateur fit un sermon, et on chanta des chansons turques et persanes, d’après une méthode excellente Nous passâmes en cet endroit une nuit admirable, et qui peut compter parmi les plus merveilleuses. J’y rencontrai le jurisconsulte, le savant et vertueux Sadr accherî’ah, le Chef de la loi, qui était arrivé de Hérat ; c’était un homme pieux et excellent. Je visitai à Boukhara le tombeau du savant imâm Abou ’Abd Allah albokhâry, professeur des musulmans et auteur du recueil (de traditions) intitulé : Aldjâmi’ssahîh, « la collection véridique ». Sur ce tombeau se trouve cette inscription : « Ceci est la tombe de Mohammed, fils d’Ismâ’îl albokhâry, qui a composé tels et tels ouvrages. » C’est ainsi qu’on lit, sur les tombes des savants de Boukhara, leurs noms et les titres de leurs écrits. J’avais copié un grand nombre de ces épitaphes ; mais je les ai perdues avec d’autres objets, lorsque les infidèles de l’Inde me dépouillèrent sur mer.
Nous partîmes de Boukhara, afin de nous rendre au camp du sultan pieux et honoré Alâ eddîn Thermachîrîn, dont il sera question ci-après. Nous passâmes par Nakhcheb, ville dont le cheikh Abou Torâb annakhchéby a emprunté son surnom. C’est une petite cité, entourée de jardins et de canaux. Nous logeâmes hors de ses murs, dans une maison appartenant à son gouverneur. J’avais avec moi une jeune esclave qui était enceinte et près de son terme ; j’avais résolu de la conduire à Samarkand, pour qu’elle y fit ses couches. Or il se trouva qu’elle était dans une litière qui fut chargée sur un chameau. Nos camarades partirent de nuit et cette esclave les accompagna, avec les provisions et d’autres objets à moi appartenant. Pour moi, je restai près de Nakhcheb, afin de me mettre en route de jour, avec quelques autres de mes compagnons. Les premiers suivirent un chemin différent de celui que nous prîmes. Nous arrivâmes le soir du même jour au camp du sultan. Nous étions affamés, et nous descendîmes dans un endroit éloigné du marché ; un de nos camarades acheta de quoi apaiser notre faim. Un marchand nous prêta une tente où nous passâmes la nuit. Nos compagnons partirent le lendemain à la recherche des chameaux et du reste de la troupe ; ils les trouvèrent dans la soirée, et les amenèrent avec eux. Le sultan était alors absent du camp pour une partie de chasse. Je visitai son lieutenant, l’émir Takbogha ; il me logea dans le voisinage de sa mosquée et me donna une kharghâ ; c’est une espèce de tente, que nous avons décrite ci-dessus. J’établis la jeune esclave dans cette kharghâ ; et elle y accoucha dans la même nuit. On m’informa que l’enfant était du sexe masculin, mais il n’en était pas ainsi : ce ne fut qu’après l’akîkah (brebis que l’on sacrifie quand un enfant est rasé pour la première fois, ce qui a lieu d’ordinaire le septième jour après sa naissance) qu’un de mes compagnons m’apprit que l’enfant était une fille. Je fis venir les esclaves femelles, et je les interrogeai ; elles me confirmèrent la vérité du fait. Cette fille était née sous une heureuse étoile ; depuis sa naissance, j’éprouvai toutes sortes de joies et de satisfactions. Elle mourut deux mois après mon arrivée dans l’Inde, ainsi que je le raconterai ci-dessous.
Je visitai dans ce camp le cheikh, le jurisconsulte, le dévot Mewlânâ Hoçâm eddîn alyâghi (le sens de ce dernier mot, en turc, est le rebelle), qui est un habitant d’Othrâr, et le cheikh Haçan, beau-frère du sultan.
C’est le sultan honoré ’Alâ eddîn Thermachîrîn qui est un prince très puissant. Il possède des armées nombreuses, un royaume considérable et un pouvoir étendu ; il exerce l’autorité avec justice. Ses provinces sont situées entre celles de quatre des plus puissants souverains de l’univers : le roi de la Chine, le roi de l’Inde, le roi de l’Irak et le roi Uzbek. Ces quatre princes lui font des présents, et lui témoignent de la considération et du respect. Il est parvenu à la royauté après son frère Iltchacathaï. Ce dernier était infidèle, et il était monté sur le trône après son frère aîné Kebec. Kebec était aussi infidèle ; mais il était juste dans l’exercice de son autorité, rendait justice aux opprimés, et traitait les musulmans avec égard et considération.
On raconte que ce roi Kebec, s’entretenant un jour avec le jurisconsulte et prédicateur Bedr eddîn al meldâny, lui dit : « Tu prétends que Dieu a mentionné toutes choses dans son livre respectable (c’est-à-dire le Coran) ? » Le docteur répondit : « Oui, certes. — Où donc se trouve mon nom dans ce livre ? » Le fakîh repartit : « Dans ce verset (lxxxii, 8) : « (ton maître généreux), qui t’a façonné (rakkebec) d’après la forme qu’il a voulue. » Cela plut à Kebec ; il s’écria : Iakhchy, ce qui, en turc, veut dire excellent ; il témoigna à cet homme une grande considération, et accrut celle qu’il montrait aux musulmans.
Parmi les jugements rendus par Kebec, on raconte le suivant. Une femme vint se plaindre à lui d’un des émirs ; elle exposa qu’elle était pauvre et chargée d’enfants, qu’elle possédait du lait, avec le prix duquel elle comptait les nourrir ; mais que cet émir le lui avait enlevé de force et l’avait bu. Kebec lui dit : « Je le ferai fendre en deux ; si le lait sort de son ventre, il sera mort justement ; sinon je te ferai fendre en deux après lui. » La femme dit : « Je lui abandonne mes droits sur ce lait, et je ne lui réclame plus rien. » Kebec fit couper en deux cet émir, et le lait coula de son ventre.
Mais revenons au sultan Thermachîrîn.
Lorsque j’eus passé quelques jours dans le camp, que les Turcs appellent ordou, je m’en allai un jour, pour faire la prière de l’aurore dans la mosquée, selon ma coutume. Quand j’eus fini ma prière, un des assistants me dit que le sultan se trouvait dans la mosquée. Après que ce prince se fut levé de son tapis à prier, je m’avançai pour le saluer. Le cheikh Haçan et le légiste Hoçâm eddîn Alyâghi se levèrent, et instruisirent le sultan de ma situation et de mon arrivée depuis quelques jours. Il me dit en turc : Khoch mîsen, yakhchi mîsen, kothloû eïoûsen. Le sens de khoch mîsen est : « Es-tu bien portant ? » Yakhchi mîsen signifie : « Tu es un homme excellent » ; enfin, kothloû eïoûsen signifie : « Ton arrivée est bénie (?) ».
Le sultan était couvert en ce moment d’une tunique de kodsy, ou étoffe de Jérusalem, de couleur verte ; il portait sur sa tête une calotte de pareille étoffe. Il retourna à pied à sa salle d’audience ; ses sujets se présentaient devant lui sur la route, pour lui exposer leurs griefs. Il s’arrêtait pour chaque plaignant, grand ou petit, homme ou femme ; ensuite il m’envoya chercher. J’arrivai près de lui et je le trouvai dans une tente, en dehors de laquelle les hommes se tenaient, à droite et à gauche. Tous les émirs étaient assis sur des sièges ; leurs serviteurs se tenaient debout derrière et devant eux. Tous les soldats étaient assis sur plusieurs rangs ; devant chacun d’eux se trouvaient ses armes ; ils étaient alors de garde, et devaient rester en cet endroit jusqu’à quatre heures de l’après-midi ; d’autres devaient venir les relever et rester jusqu’à la fin de la nuit. On avait placé en ce lieu des tentures d’étoffe de coton, sous lesquelles ces hommes étaient abrités.
Lorsque je fus introduit près du roi, dans la tente, je le trouvai assis sur un siège semblable à une chaire à prêcher, et recouvert de soie brochée d’or. Le dedans de la tente était doublé d’étoffe de soie dorée ; une couronne incrustée de perles et de pierres précieuses était suspendue, à la hauteur d’une coudée, au-dessus de la tête du sultan. Les principaux émirs étaient assis sur des sièges, à la droite et à la gauche du prince. Des fils de rois, portant dans leurs mains des émouchoirs, se tenaient devant lui. Près de la porte de la tente étaient postés le lieutenant du souverain, le vizir, le chambellan et le secrétaire de l’alâmah (espèce de parafe), que les Turcs appellent al thamgha (al signifie rouge, et thamgha parafe). Tous les quatre se levèrent devant moi, lorsque j’entrai, et m’accompagnèrent à l’intérieur. Je saluai le sultan, et il m’interrogea touchant La Mecque, Médine, Jérusalem, Hébron (Médinet alkhalil), Damas, l’Égypte, Almélic annâcir, les deux Iraks, leur souverain et la Perse. Le secrétaire de l’alâmah nous servait de truchement. Ensuite le muezzin appela les fidèles à la prière de midi, et nous nous en retournâmes.
Nous assistions aux prières, en compagnie du sultan, et cela pendant des journées d’un froid excessif et mortel. Le sultan ne négligeait pas de faire la prière de l’aurore ni celle du soir avec les fidèles. Il s’asseyait pour réciter les louanges de Dieu, en langue turque, après la prière de l’aurore jusqu’au lever du soleil. Tous ceux qui se trouvaient dans la mosquée s’approchaient de lui ; il leur prenait la main et la leur pressait. Ils agissent de même à la prière de l’après-midi. Lorsqu’on apportait au sultan un présent de raisins secs ou de dattes (or les dattes sont rares chez eux et ils les recherchent fort), il en donnait de sa propre main à tous ceux qui se trouvaient dans la mosquée.
Parmi les actions généreuses de ce roi, je citerai la suivante : j’assistai un jour à la prière de l’après-midi, et le sultan ne s’y trouva pas. Un de ses pages vint avec un tapis, qu’il étendit en face du mihrâb (place de l’imâm), où le prince avait coutume de prier. Il dit à l’imâm Hoçâm eddîn Alyâghi : « Notre maître veut que tu l’attendes un instant pour faire la prière, jusqu’à ce qu’il ait achevé ses ablutions. » L’imâm se leva et dit en persan : « Le namâz, c’est-à-dire la prière, est-il pour Dieu ou pour Thermachîrîn ? » Puis il ordonna au muezzin de réciter le second appel à la prière (ikâmah). Le sultan arriva lorsqu’on avait déjà terminé deux rec’ah ou génuflexions de la prière. Il fit les deux dernières rec’ah derrière tout le monde, et cela dans l’endroit où les fidèles déposent leurs sandales, près de la porte de la mosquée ; après quoi, la prière publique fut achevée, et il accomplit seul les deux rec’ah qu’il avait passées. Puis il se leva, s’avança en riant vers l’imâm, afin de lui prendre la main, et s’assit en face du mihrâb. Le cheikh et imâm était à son côté, et moi j’étais à côté de l’imâm. Le prince me dit : « Quand tu seras retourné dans ton pays, racontes-y qu’un fakir persan agit de la sorte avec le sultan des Turcs. »
Ce cheikh prêchait les fidèles tous les vendredis ; il ordonnait au sultan d’agir conformément à la loi, et lui défendait de commettre des actes illégaux ou tyranniques. Il lui parlait avec dureté ; le sultan se taisait et pleurait. Le cheikh n’acceptait aucun présent du prince, ne mangeait même pas à sa table, et ne revêtait pas d’habits donnés par lui ; en un mot, c’était un des plus vertueux serviteurs de Dieu. Je voyais souvent sur lui une tunique d’étoffe de coton, doublée et piquée de coton, toute usée et toute déchirée. Sur sa tête il portait un haut bonnet de feutre, dont le pareil pouvait valoir un kîrâth (petite pièce de monnaie), et il n’avait pas d’imâmah (pièce de mousseline que l’on roule autour de la calotte ; turban). Je lui dis un jour : « Ô mon seigneur, qu’est-ce que cette tunique dont tu es vêtu ? Certes elle n’est pas belle. » Il me répondit : « O mon fils, cette tunique ne m’appartient pas, mais elle appartient à ma fille. » Je le priai d’accepter quelques-uns de mes vêtements. Il me dit : « J’ai fait vœu à Dieu, il y a cinquante ans, de ne rien recevoir de personne ; si j’acceptais un don de quelqu’un, ce serait de toi. »
Lorsque j’eus résolu de partir, après avoir séjourné près de ce sultan durant cinquante-quatre jours, il me donna sept cents dinars, et une pelisse de zibeline qui valait cent dinars, et que je lui demandai, à cause du froid. Lorsque je la lui eus demandée, il prit mes manches et se mit à me la passer de sa propre main, marquant ainsi son humilité, sa vertu et la bonté de son caractère.[40] Il me donna deux chevaux et deux chameaux. Quand je voulus lui faire mes adieux, je le rencontrai au milieu du chemin, se dirigeant vers une réserve de chasse. La journée était excessivement froide ; en vérité, je ne pus proférer une seule parole, à cause de la violence du froid. Il comprit cela, sourit et me tendit la main ; après quoi, je m’en retournai.
Deux ans après mon arrivée dans l’Inde, nous apprîmes que les principaux de ses sujets et de ses émirs s’étaient réunis dans la plus éloignée de ses provinces qui avoisinent la Chine. C’est là que se trouvait la plus grande partie de ses troupes. Ils prêtèrent serment à un de ses cousins nommé Bouzoun Oghly ; or tous les fils de rois sont appelés par les Turcs oghly. Bouzoun était musulman ; mais c’était un homme impie et méchant. Les Tartares le reconnurent pour roi et déposèrent Thermachîrîn, parce que ce dernier avait agi contrairement aux préceptes de leur aïeul commun, le maudit Tenkîz, celui-là même qui a dévasté les contrées musulmanes, et dont il a été question ci-dessus. Tenkîz avait composé un livre contenant ses lois, et qui est appelé, chez ces peuples, Aliaçâk. Il est d’obligation pour les Tartares de déposer tout prince qui désobéit aux prescriptions de ce livre. Parmi ses préceptes, il y en a un qui leur commande de se réunir une fois tous les ans. On appelle ce jour Thoï, c’est-à-dire jour de festin. Les descendants de Tenkîz et les émirs viennent à cette réunion de tous les points de l’empire. Les khatouns et les principaux officiers de l’armée y assistent aussi. Si le sultan a changé quelque chose aux prescriptions de Tenkîz, les chefs des Tartares s’approchent de lui et lui disent : « Tu as fait tel et tel changement et tu t’es conduit ainsi. Il est donc devenu nécessaire de te déposer. » Ils le prennent par la main, le font descendre de dessus son trône et y placent un autre descendant de Tenkîz. Si un des principaux émirs a commis une faute dans son gouvernement, ils prononcent contre lui la peine qu’il a méritée.
Le sultan Thermachîrîn avait mis fin aux jugements prononcés ce jour-là, et abrogé la coutume de cette réunion. Les Tartares supportèrent avec beaucoup de peine cette conduite du sultan. Ils lui reprochaient aussi d’avoir séjourné quatre ans de suite dans la portion des États contigu au Khoraçan, et de n’être pas venu dans la portion qui touche à la Chine. Il est d’usage que le roi se rende chaque année dans ces régions, qu’il y examine leur situation et l’état des troupes qui s’y trouvent ; car c’est de là que leurs rois sont originaires. Leur capitale est la ville d’Almalyk.
Lorsque les Tartares eurent prêté serment à Bouzoun, il se mit en marche avec une armée considérable. Thermachîrîn craignit quelque complot de la part de ses émirs, ne se fia point à eux, et monta à cheval, accompagné de quinze cavaliers seulement, afin de gagner la province de Ghazna, qui faisait partie de son empire. Le vice-roi de cette province était le principal de ses émirs et son confident, Boronthaïh. Cet émir aime l’islamisme et les musulmans ; il a construit dans son gouvernement environ quarante ermitages, où l’on distribue des aliments aux voyageurs. Il commande à une armée nombreuse. Je n’ai pas rencontré parmi tous les mortels que j’ai vus dans toute l’étendue de l’univers, un homme d’une stature plus élevée que la sienne.
Lorsque Thermachîrîn eut traversé le fleuve Djeïhoun, et qu’il eut pris le chemin de Balkh, il fut vu d’un Turc, au service de Ianki, fils de son frère Kebec. Or le sultan Thermachîrîn avait tué son frère Kebec, dont il a été question plus haut. Le fils de ce prince, Ianki, restait à Balkh. Lorsque le Turc l’informa de la rencontre de son oncle, il dit : « Il ne s’est enfui qu’à cause de quelque affaire grave qui lui sera survenue. » il montai cheval avec ses officiers, se saisit de Thermachîrîn et l’emprisonna.
Cependant Bouzoun arriva à Samarkand et à Boukhara dont les habitants le reconnurent pour souverain. Ianki lui amena Thermachîrîn. On raconte que quand ce prince fut arrivé à Nécef, près de Samarkand, il y fut mis à mort et y fut enseveli, et que le cheikh Chems eddîn Guerden Burîdâ est le gardien de son mausolée. On dit aussi que Thermachîrîn ne fut pas tué, ainsi que nous le raconterons ci-dessous. Guerden (en persan) signifie « cou » et Burîdâ (burîdeh) « coupé ». Ce cheikh fut appelé de ce nom à cause d’une blessure qu’il avait reçue au cou ; je l’ai rencontré dans l’Inde et je parlerai de lui ci-après.
Lorsque Bouzoun fut devenu roi, le fils du sultan Thermachîrîn, Béchâï Oghoul (ou mieux Oghly, d’après un manuscrit), sa sœur et le mari de celle-ci, Firouz s’enfuirent à la cour du roi de l’Inde. Il les traita avec considération et leur assigna un logement splendide, à cause de l’amitié et de l’échange de lettres et de présents qui existaient entre lui et Thermachîrîn, à qui il donnait le titre de frère. Dans la suite, un individu arriva du Sind et prétendit être Thermachîrîn. Les hommes furent d’opinions différentes touchant ce qui le regardait. ’Imad almulc Sertîz, affranchi du roi de l’Inde et vice-roi du Sind, apprit cela. Il était appelé Mélik’ Arz, « le roi des revues », car c’était devant lui que les troupes de l’Inde passaient en revue, et il en avait le commandement. Il résidait à Moultân, capitale du Sind. Il envoya près de cet individu quelques Turcs qui avaient connu Thermachîrîn. Ils revinrent et dirent à Sertîz que cet homme était vraiment Thermachîrîn. Sur ce rapport, Sertîz ordonna d’élever pour lui une sérâdjeh ou afrâdj, c’est-à-dire « une tente ». Elle fut dressée en dehors de la ville. Sertîz fit, pour recevoir cet individu, les préparatifs que l’on fait ordinairement pour les princes. Il sortit à sa rencontre, mit pied à terre devant lui, le salua et le conduisit respectueusement à la sérâdjeh, où cet homme entra à cheval, selon la coutume des rois. Personne ne douta que ce ne fût Thermachîrîn. Il envoya annoncer son arrivée au roi de l’Inde. Le roi lui dépêcha des émirs, afin qu’ils allassent au-devant de lui avec les mets de l’hospitalité.
Il y avait au service du roi de l’Inde un médecin qui avait précédemment servi Thermachîrîn, et qui était devenu le premier des médecins de l’Inde. Il dit au roi : « J’irai trouver cet homme, et je saurai si ses prétentions sont fondées. J’ai soigné un abcès que Thermachîrîn avait au-dessous du genou, et dont la marque est restée visible ; je saurai la vérité par ce moyen. » Ce médecin alla donc trouver le nouveau venu, et se joignit aux émirs qui étaient chargés de le recevoir. Il fut admis en sa présence et resta assidûment près de lui à la faveur de leur ancienne connaissance ; enfin, un jour après, il palpa ses jambes et découvrit la cicatrice. Cet homme lui fit des reproches et lui dit : « Tu veux regarder l’abcès que tu as guéri ; en voici la place. » En même temps il lui fit voir la cicatrice. Le médecin connut par là, à n’en plus douter, que cet homme était Thermachîrîn. Il retourna près du roi de l’Inde et lui annonça la nouvelle.
Quelque temps après, le vizir Khodjah Djihan Ahmed, fils d’Aïâs, et le chef des émirs, Kothloû Khân, qui avait été précepteur du sultan de l’Inde dans son enfance, allèrent trouver ce roi et lui dirent : « Ô seigneur du monde, ce sultan Thermachîrîn es arrivé ; il est véritable que cet hommes est bien le sultan. Il y a ici environ quarante mille de ses sujets, son fils et son gendre. As-tu bien examiné ce qui arrivera s’ils se joignent à lui ? » Ce discours fit une vive impression sur le sultan, et il ordonna d’amener Thermachîrîn en toute hâte. Lorsque ce prince parut devant le sultan, il reçut l’ordre de lui témoigner son respect, comme tout le monde, et fut traité sans considération. Le sultan lui dit : Yâ mâder gâny, « Ô fils d’une prostituée ! » (ce qui est un reproche déshonorant), comme tu mens ! Tu dis que tu es Thermachîrîn ; cependant ce prince a été tué et voici le gardien de son mausolée. Par Dieu, sans la crainte de commettre un crime, certes, je te tuerais ! Qu’on lui donne, ajouta-t-il cinq mille dinars, qu’on le mène à la maison de Béchâï Oghoul et de sa sœur, les deux enfants de Thermachîrîn, et qu’on leur dise : « Cet imposteur prétend être votre père. » Cet homme alla donc trouver le prince et sa sœur ; ils le reconnurent et il passa la nuit près d’eux, surveillé par des gardiens. Le lendemain matin, il fut tiré de cette maison ; le prince et la princesse craignirent qu’on ne les fît périr, à cause de cet homme. En conséquence, ils le désavouèrent pour leur père. Il fut exilé de l’Inde et du Sind, et prit le chemin de Kîdj et du Mecrân. Les habitants des provinces situées sur sa route lui témoignaient du respect, lui donnaient l’hospitalité et lui faisaient des présents. Il arriva enfin à Chiraz. Le prince de cette ville, Abou Ishâk, le traita avec considération et lui assigna une somme suffisante pour son entretien. Lorsque j’entrai dans Chiraz, à mon retour de l’Inde, on me dit que cet homme y était encore. Je désirais le voir ; mais je ne le fis pas, parce qu’il demeurait dans une maison où personne ne le visitait sans la permission du sultan Abou Ishâk, et que je craignis les conséquences de cette visite. Dans la suite je me repentis de ne l’avoir pas vu.
Mais revenons à Bouzoun.
Lorsque ce prince se fut emparé de la royauté, il tourmenta les musulmans, traita injustement ses sujets, et permit aux chrétiens et aux juifs de réparer leurs temples. Les musulmans se plaignirent de cela, et attendirent impatiemment que quelque revers vînt atteindre Bouzoun. La conduite tyrannique de ce prince arriva à la connaissance de Khalil, fils du sultan Yaçaoûn, celui-là même qui avait été vaincu dans sa tentative pour s’emparer du Khoraçan. Il se rendit près du roi de Hérat, qui était le sultan Hoçaïn, fils du sultan Ghiâth eddîn alghoûry, lui révéla ses projets et le pria de l’aider d’hommes et d’argent, à condition qu’il partagerait avec lui son royaume, lorsqu’il en aurait fait la conquête. Le roi Hoçaïn fit partir avec lui une armée considérable. Entre Hérat et Termedh, il y a neuf jours de distance. Lorsque les émirs musulmans apprirent l’arrivée de Khalil, ils lui firent leur soumission et lui témoignèrent leur désir de combattre les infidèles. Le premier qui vint le trouver fut ’Alâ almulc Khodhâwend Zâdeh, prince de Termedh. C’était un émir puissant, un descendant de Mahomet par Hoçaïn. Il joignit Khalil avec quatre mille musulmans. Khalil fut joyeux de son arrivée, l’investit du vizirat et lui confia l’exercice de l’autorité. ’Alâ almulc était au nombre des hommes les plus braves. D’autres émirs vinrent de toutes parts se réunir à Khalil, qui engagea le combat contre Bouzoun. Les troupes de celui-ci passèrent du côté de Khalil, et lui livrèrent Bouzoun chargé de chaînes. Khalil le fit étrangler avec des cordes d’arc ; car c’est la coutume de ces peuples de ne faire périr les fils des rois que par strangulation.
Le royaume tout entier fut soumis à Khalil. Il passa ses troupes en revue à Samarkand. Elles montaient à quatre-vingt mille hommes, couverts de cuirasses et dont les chevaux étaient bardés de fer. Il congédia l’armée avec laquelle il était venu de Hérat et marcha vers le pays d’Almalyk. Les Tartares mirent à leur tête un des leurs, et rencontrèrent Khalil à la distance de trois journées de marche d’Almalyk, dans le voisinage de Tharâz. Le combat fut chaud, et les deux armées tinrent ferme. L’émir Khodhâwend Zâdeh, vizir de Khalil, fit, à la tête de vingt mille musulmans, une charge à laquelle les Tartares ne purent résister. Ils furent mis en déroute et eurent un grand nombre de morts. Khalil s’arrêta trois jours à Almalyk, et en sortit pour exterminer ceux des Tartares qui avaient survécu. Ils se soumirent à lui. Alors il s’avança jusqu’à la frontière du Khithâ et de la Chine et conquit les villes de Karakoroum et de Bichbâligh. Le sultan de la Chine envoya contre lui des troupes, mais dans la suite la paix fut conclue entre eux. La puissance de Khalil devint considérable, et les autres rois le craignirent ; il montra de l’équité, plaça des troupes à Almalyk, y laissa son vizir Khodhâwend Zâdeh, et retourna à Samarkand et à Boukhara.
Par la suite, les Turcs voulurent exciter du désordre : ils calomnièrent le vizir près de Khalil, prétendant qu’il avait l’intention de se révolter et disait qu’il était plus digne du trône que Khalil, à cause de sa parenté avec le Prophète, de sa libéralité et de sa bravoure. Khalil envoya un vice-roi à Almalyk, en remplacement du vizir, et ordonna à celui-ci de venir le trouver avec un petit nombre de personnes. Dès qu’il fut arrivé, il le tua sans plus ample information. Ce meurtre fut la cause de la ruine de son royaume. Lorsque l’autorité de Khalil fut devenue considérable, il se révolta contre le prince de Hérat, qui l’avait fait hériter du trône, et lui avait fourni des troupes et de l’argent. Il lui écrivit de faire la prière en son nom, dans le royaume de Hérat, et de frapper à son coin la monnaie d’or et d’argent. Cette conduite mécontenta fort Mélik Hoçaïn ; il fit à Khalil une réponse très grossière. Khalil se prépara à le combattre. Mais les troupes musulmanes ne le secoururent pas et le jugèrent rebelle à son bienfaiteur. Cette nouvelle parvint à Mélik Hoçaïn. Il fit marcher son armée sous le commandement de son cousin germain Mélik Wernâ. Les deux armées en vinrent aux mains. Khalil fut mis en déroute, fait prisonnier et mené à Mélik Hoçaïn. Ce prince lui accorda la vie, le logea dans un palais, lui donna une jeune esclave et lui assigna une pension. C’est dans cet état que je le laissai, à la fin de l’année 747 (de J.C. avril 1347), lors de ma sortie de l’Inde.
Mais revenons à notre propos.
Lorsque j’eus fait mes adieux au sultan Thermachîrîn, je me dirigeai vers la ville de Samarkand, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle est bâtie sur le bord d’une rivière nommée rivière des Foulons, et couverte de machines hydrauliques, qui arrosent des jardins. C’est près de cette rivière que se rassemblent les habitants de la ville, après la prière de quatre heures du soir, pour se divertir et se promener. Ils y ont des estrades et des sièges pour s’asseoir, et des boutiques où l’on vend des fruits et d’autres aliments. Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l’élévation de l’esprit des habitants de Samarkand. La plupart sont ruinés, et une grande partie de la ville a été aussi dévastée. Elle n’a ni muraille ni portes. Des jardins se trouvent compris dans l’intérieur de la ville. Les habitants de Samarkand possèdent des qualités généreuses, et ont de l’amitié pour les étrangers ; ils valent mieux que ceux de Boukhara.
Près de Samarkand est le tombeau de Kotham, fils d’Abbâs, fils d’Abd almotthalib, qui fut tué lors de la conquête de cette ville par les musulmans. Les habitants de Samarkand sortent chaque nuit du dimanche au lundi et du jeudi au vendredi, pour visiter ce tombeau. Les Tartares y viennent aussi en pèlerinage, lui vouent des offrandes considérables, et y apportent des bœufs, des moutons, des dirhems et des dinars. Tout cela est dépensé pour traiter les voyageurs et pour l’entretien des serviteurs de l’ermitage et du tombeau béni. Au-dessus de ce monument est un dôme élevé sur quatre pilastres à chaque pilastre sont jointes deux colonnes de marbre il y en a de vertes, de noires, de blanches et de rouges. Les murailles du dôme sont de marbre nuancé de diverses couleurs, peint et doré ; et son toit est en plomb. Le tombeau est recouvert de planches d’ébène incrustées d’or et de pierreries, et revêtues d’argent aux angles. Au-dessus de lui sont suspendues trois lampes d’argent. Les tapis du dôme sont de laine et de coton. En dehors coule un grand fleuve, qui traverse l’ermitage voisin, et sur les bords duquel il y a des arbres, des ceps de vigne et des jasmins. Dans l’ermitage se trouvent des habitations où logent les voyageurs. Les Tartares, durant le temps de leur idolâtrie, n’ont rien changé à l’état de cet endroit béni ; au contraire, ils regardaient sa possession comme d’un heureux augure, à cause des miracles dont ils y étaient témoins.
L’inspecteur général, de ce sépulcre béni et de ce qui lui est contigu, lorsque nous y logeâmes, était l’émir Ghiâth eddîn Mohammed, fils d’Abd alkâdir, fils d’Abd el-Aziz, fils de Yousef, fils du khalife Almostancir Billah, l’Abbâside. Le sultan Thermachîrîn l’éleva à cette dignité, lorsqu’il arriva de l’Irak à sa cour ; mais il se trouve actuellement près du roi de l’Inde, et il sera fait mention de lui ci-après. Je vis à Samarkand le kadi de cette ville, appelé, chez les Tartares, Sadr aldjihân, « le chef du monde ». C’était un homme vertueux et doué de belles qualités. Il se rendit dans l’Inde après moi, mais il fut surpris par la mort dans la ville de Moultân, capitale du Sind.
Lorsque ce kadi fut mort à Moultân, le secrétaire chargé d’annoncer au roi les nouvelles lui écrivit cet événement, et lui apprit que ce personnage était venu dans l’intention de visiter sa cour, mais que la mort l’en avait empêché. A cette nouvelle, le roi ordonna d’envoyer à ses enfants je ne me rappelle plus combien de milliers de dinars, et de compter à ses serviteurs ce qu’il leur aurait donné, s’ils étaient arrivés à la cour du vivant de leur maître et avec lui. Le roi de l’Inde a, dans chaque ville de ses États, un correspondant qui lui écrit tout ce qui se passe dans cette ville et lui annonce tous les étrangers qui y arrivent. Dès l’arrivée d’un de ceux-ci, on écrit de quel pays il vient ; on prend note de son nom, de son signalement, des ses vêtements, de ses compagnons, du nombre de ses chevaux et de ses serviteurs, de quelle manière il s’assied et mange ; en un mot, de toute sa manière d’être, de ses occupations et des qualités ou des défauts qu’on remarque en lui. Le voyageur ne parvient à la cour que quand le roi connaît tout ce qui le regarde, et les largesses que le prince lui fait sont proportionnées à son mérite.
Nous partîmes de Samarkand et nous traversâmes la ville de Nécef,[41] à laquelle doit son surnom Abou Hafs ’Omar Annécéfy, auteur du livre intitulé Almanzhoûmah, « le poème », et traitant des questions controversées entre les quatre fakîhs.
Ensuite nous arrivâmes à la ville de Termedh, qui a donné naissance à l’imâm Abou ’Iça Mohammed, fils d’Iça, fils de Soûrah attermedhy, auteur du Aldjâmi’ alkebîr, « la grande collection », qui traite des traditions. C’est une grande ville, bien construite, pourvue de beaux marchés, traversée par des rivières, et où l’on voit de nombreux jardins. Des raisins et surtout des coings, d’une qualité supérieure, y sont fort abondants, ainsi que la viande et le lait. Les habitants lavent leur tête dans des bains chauds avec du lait, en place de terre glaise. Il y a chez le propriétaire de chaque bain de grands vases remplis de lait. Lorsque quelqu’un entre dans le bain, il en prend dans un petit vase et se lave la tête avec ce lait, qui rafraîchit les cheveux et les rend lisses. Les habitants de l’Inde emploient pour leurs cheveux l’huile de sésame, qu’ils appellent assîrâdj (chîrâdj). Après quoi, ils lavent leur tête avec de la terre glaise. Cela fait du bien au corps, rend les cheveux lisses et les fait pousser. C’est par ce moyen que la barbe des habitants de l’Inde et des gens qui demeurent parmi eux devient longue.
L’ancienne ville de Termedh était bâtie sur le bord du Djeïhoun. Lorsque Tenkîz l’eut ruinée, la ville actuelle fut construite à deux milles du fleuve. Nous y logeâmes, dans l’ermitage du vertueux cheikh ’Azîzân, un des principaux cheikhs et des plus généreux, qui possède beaucoup d’argent, ainsi que des maisons et des jardins, dont il dépense le produit à recevoir les voyageurs. Je joignis, avant mon arrivée dans cette ville, son prince ’Alâ el-Mulc Khodhâwend Zâdeh. Il y envoya l’ordre de me fournir les provisions dues à un hôte. On nous les apportait chaque jour, pendant le temps de notre résidence à Termedh. Je rencontrai aussi le kadi de cette ville, Kiwâm eddîn, qui était en route, afin de voir le sultan Thermachîrîn, et de lui demander la permission de faire un voyage dans l’Inde. Le récit de mon entrevue avec lui et avec ses deux frères, Dhiâ eddîn et Borhân eddîn, à Moultân, et du voyage que nous fîmes tous ensemble dans l’Inde, sera donné ci-dessous. Il sera fait aussi mention, s’il plaît à Dieu, de ses deux autres frères, ’Imad eddîn et Seïf eddîn, de ma rencontre avec eux à la cour du roi de l’Inde, de ses deux fils, de leur arrivée près du même souverain, après le meurtre de leur père, de leur mariage avec les deux filles du vizir Khodjah Djihan, et de tout ce qui arriva à cette occasion.
Nous passâmes ensuite le fleuve Djeïhoun, pour entrer dans le Khoraçan, et, à compter de notre départ de Termedh et du passage du fleuve, nous marchâmes un jour et demi, dans un désert et des sables où il n’y a aucune habitation, jusqu’à la ville de Balkh, qui est en ruine et inhabitée. Quiconque la voit la pense florissante, à cause de la solidité de sa construction. Elle a été jadis considérable et étendue. Les vestiges de ses mosquées et de ses collèges subsistent encore, ainsi que les peintures de ses édifices, tracées avec de la couleur d’azur. Le vulgaire attribue la production de la pierre d’azur (lapis-lazuli) à la province de Khoraçan ; mais on la tire des montagnes de Badakhchân, qui ont donné leur nom au rubis badakhchy, ou, comme l’appelle le vulgaire, Al-balakhch, « rubis balais ». Cette contrée sera mentionnée ci-après, s’il plaît à Dieu.
Le maudit Tenkîz a dévasté Balkh et a démoli environ le tiers de sa [principale] mosquée, à cause d’un trésor qui, à ce qu’on lui avait rapporté, était caché sous une colonne de ce temple. C’est une des plus belles et des plus vastes mosquées du monde. La mosquée de Ribâth alfeth (Rabat), dans le Maghreb, lui ressemble par la grandeur de ses colonnes ; mais celle de Balkh est plus belle sous les autres rapports.
Un homme versé dans la science de l’histoire m’a raconté que la mosquée de Balkh a été construite par une femme, dont le mari, appelé Daoud, fils d’Aly, était émir ou gouverneur de Balkh pour les Abbâsides. Il advint que le khalife se mit un jour en colère contre les habitants de Balkh, à cause d’une action qu’ils avaient commise. Il envoya dans leur ville quelqu’un chargé de leur faire payer une amende considérable. Lorsque cet officier fut arrivé à Balkh, les femmes et les enfants de la ville se rendirent près de cette femme dont il a été question plus haut comme ayant construit la mosquée, et qui était l’épouse de leur émir. Ils se plaignirent à elle de leur situation et de l’amende qui leur était imposée. Elle envoya à l’émir, qui était venu pour lever sur eux cette taxe, un vêtement brodé de perles, à elle appartenant, et dont la valeur surpassait la somme que l’émir avait reçu l’ordre de leur faire payer. Elle lui dit, en même temps : « Porte ce vêtement au khalife, car je le donne comme une offrande en faveur des habitants de Balkh, à cause de leur triste situation. » Cet émir alla trouver le khalife, jeta le vêtement devant lui et lui raconta ce qui s’était passé. Le khalife fut honteux, et dit : « Est-ce que cette femme sera plus généreuse que nous ? » Il ordonna à l’émir de dispenser de l’amende les habitants de Balkh, et de retourner dans cette ville, afin de rendre à la femme du gouverneur son vêtement. En outre, il remit aux Balkhiens le tribut d’une année. L’émir revint à Balkh, se rendit à la demeure de la femme du gouverneur, lui répéta ce qu’avait dit le khalife, et lui rendit le vêtement. Elle lui dit : « Est-ce que l’œil du khalife a fixé cet habillement ? » Il répondit : « Oui. — En ce cas, reprit-elle, je ne revêtirai point un habit sur lequel est tombé le regard d’un homme qui n’est pas au nombre de ceux dont le mariage avec moi est défendu (père, frère, fils, etc.). » Elle ordonna de le vendre, et c’est avec le prix qu’on en retira que furent bâtis la mosquée, l’ermitage et un caravansérail situé vis-à-vis de la mosquée, et construit avec les pierres appelées keddhâns, « moellons ». Ce dernier est encore en bon état. Il resta un tiers du prix du vêtement ; et on raconte que cette femme ordonna d’ensevelir cette somme sous une des colonnes de la mosquée, afin qu’on pût s’en servir en cas de besoin.
Tenkîz fut instruit de cette histoire ; il ordonna de renverser les colonnes de la mosquée. Environ le tiers fut abattu ; mais on ne trouva rien. Le reste fut laissé dans son premier état.
A l’extérieur de Balkh se trouve un tombeau, qu’on dit être celui d’Occâchah, fils de Mihçan alaçady, compagnon de Mahomet, celui-là même qui entrera dans le Paradis sans avoir de compte à rendre au jour du jugement (c’est là une tradition. Cf. Nawawi, éd. Wüstenfeld, p. 428). Au-dessus de ce tombeau s’élève un ermitage vénéré, dans lequel nous logeâmes. Près de l’ermitage on voit un superbe étang, ombragé d’un grand noyer, à l’abri duquel les voyageurs s’arrêtent pendant l’été. Le cheikh de cet ermitage est appelé Alhâddj Khord, c’est-à-dire « le petit pèlerin ». C’est un homme vertueux. Il monta à cheval avec nous, et nous fit voir les mausolées de la ville, parmi lesquels on remarque celui de Hizkîl (Ezéchiel), le prophète, qui est surmonté d’un beau dôme. Nous visitâmes aussi à Balkh un grand nombre de tombeaux d’hommes de bien, que je ne me rappelle plus à présent. Nous nous arrêtâmes près de la maison d’Ibrahim, fils d’Adhem. C’est une maison considérable, construite en pierres de couleur blanche et semblables au moellon. Les grains de l’ermitage y étaient déposés, et elle avait été fermée à cause de cela ; nous n’y entrâmes donc pas. Elle est située dans le voisinage de la mosquée principale.
Nous partîmes de Balkh, et nous marchâmes pendant sept jours dans les montagnes du Kouhistân. On y trouve des villages nombreux, bien peuplés, arrosés d’eaux courantes et plantés d’arbres verdoyants, dont la plupart sont des figuiers. Il y a un grand nombre d’ermitages, habités par des hommes pieux qui se sont voués au service de la divinité. Au bout de cet espace de temps, nous arrivâmes à la ville de Hérat, la plus grande des cités encore florissantes dans le Khoraçan. Il y a quatre grandes villes dans cette province : deux florissantes, Hérat et Neïçâboûr, et deux en ruines, Balkh et Merv. Hérat est fort étendue et très peuplée ; ses habitants sont vertueux, chastes et dévots ; ils professent la doctrine de l’imâm Abou Hanîfah. Leur ville est exempte de désordre.
C’est le sultan illustre Hoçaïn, fils du sultan Ghiâth eddîn Alghoûry ; il est doué d’une bravoure reconnue, et il a obtenu la faveur divine et la félicité. Sur deux champs de bataille, il a reçu du secours et de l’assistance de Dieu des preuves bien capables d’exciter l’admiration. La première fois, ce fut lors de la rencontre de son armée avec le sultan Khalil, qui s’était révolté contre lui et qui finit par devenir son prisonnier. La seconde bataille, dans laquelle il fut également favorisé de Dieu, fut celle qu’il livra en personne à Maç’oud, sultan des râfidhites ou hérétiques, et qui se termina par la ruine de la puissance de Maç’oud, par sa fuite et par la perte de son royaume (ou de ses trésors, d’après une autre leçon). Le sultan Hoçaïn monta sur le trône après la mort de son frère, nommé Alhâfizh, qui lui-même avait succédé à leur père Ghiâth eddîn.
Il y avait dans le Khoraçan deux hommes, appelés l’un Maç’oud et l’autre Mohammed, et qui avaient cinq compagnons audacieux. Ils étaient connus dans l’Irak sous le nom de Chotthâr, « brigands, voleurs » ; dans le Khoraçan, sous celui de Serbedârs ; et enfin, dans le Maghreb, sous celui de Sokoûrah, « oiseaux de proie, vautours ».
Tous sept convinrent de se livrer au désordre et au brigandage, et de piller l’argent des habitants. Le bruit de leurs excès se répandit ; ils établirent leur séjour sur une montagne inexpugnable, située au voisinage de la ville de Beïhak, appelée aussi Sebzevar. Ils se plaçaient en embuscade pendant le jour, en sortaient le soir et durant la nuit, fondaient sur les villages, coupaient les communications et s’emparaient des richesses des habitants. Les méchants et les malfaiteurs, leurs pareils, vinrent en foule se joindre à eux ; leur nombre devint considérable, leur puissance augmenta, et les hommes les craignaient. Ils fondirent sur la ville de Beïhak et la prirent ; puis ils s’emparèrent d’autres villes, acquirent de l’opulence, rassemblèrent des troupes et se procurèrent des chevaux. Maç’oud prit le titre de sultan. Les esclaves s’enfuyaient de la maison de leurs maîtres et se retiraient près de lui. Chacun de ces esclaves fugitifs recevait de lui un cheval et de l’argent ; et, s’il montrait de la bravoure, Maç’oud le nommait chef d’un détachement. Son armée devint nombreuse et sa puissance considérable. Tous ses partisans embrassèrent la doctrine des shiites, et entreprirent d’extirper les sunnites du Khoraçan et de soumettre cette province tout entière aux dogmes râfidhites. Il y avait à Mechhed Thous un cheikh râfidhite nommé Haçan, qui était considéré par eux comme un homme pieux. Il les assista dans leur entreprise et ils le proclamèrent khalife ; il leur ordonna d’agir avec équité. Ils firent paraître une si grande probité que des dinars et des dirhems tombaient à terre, dans leur camp, et que personne ne les ramassait, jusqu’à ce que leur propriétaire survînt et les ramassât. Ils s’emparèrent de Neïçâboûr. Le sultan Thoghaïtomoûr envoya contre eux des troupes, mais ils les mirent en déroute. Le sultan fit alors marcher son lieutenant, Arghoun Chah, qui fut vaincu et fait prisonnier. Ils le traitèrent avec bonté. Thoghaïtomoûr les combattit en personne, à la tête de cinquante mille Tartares ; mais ils le défirent, s’emparèrent de plusieurs villes, entre autres de Sarakhs, de Zâveh, de Thous, une des principales places du Khoraçan. Ils établirent leur khalife dans le mechhed « mausolée » d’Aly, fils de Mouça Arridha. Ils prirent aussi la ville de Djam et campèrent tout auprès, avec l’intention de marcher contre Hérat, dont ils n’étaient qu’à six journées de distance.
Lorsque cette nouvelle parvint à Mélik Hoçaïn, il rassembla les émirs, les troupes et les habitants de la ville, et leur demanda s’ils étaient d’avis d’attendre l’ennemi en dedans des murs, ou de marcher à sa rencontre et d’engager le combat. L’avis général fut de sortir contre l’ennemi. Les habitants de Hérat forment une seule et même tribu appelée Ghouriens. On dit qu’ils sont originaires du canton de Ghaour, en Syrie, et que de là vient leur nom. Tous firent leurs préparatifs, et se réunirent de toutes parts, car ils étaient domiciliés dans les villages et dans la plaine de Badghîs. Cette plaine a une étendue de quatre journées ; son gazon reste toujours vert, et c’est là que paissent les bêtes de somme et les chevaux des Ghouriens. La plupart des arbres qui l’ombragent sont des pistachiers, dont les fruits s’exportent dans l’Irak.
Les habitants de la ville de Simnân secoururent ceux de Hérat. Ils marchèrent tous ensemble contre les râfidhites, au nombre de cent vingt mille, tant cavaliers que fantassins. Le roi Hoçaïn les commandait. Les râfidhites se réunirent au nombre de cent cinquante mille cavaliers, et la rencontre eut lieu dans la plaine de Boûchendj. Les deux armées tinrent ferme d’abord ; mais ensuite les râfidhites eurent le dessous, et leur sultan, Maç’oud, prit la fuite. Leur khalife, Haçan, tint bon avec vingt mille hommes, jusqu’à ce qu’il fût tué, ainsi que la plupart de ses soldats ; environ quatre mille autres furent faits prisonniers. Quelqu’un qui assista à cette bataille m’a conté que l’action commença vers neuf heures de la matinée et que la fuite des Serbédâriens eut lieu peu de temps après midi. Après l’heure de midi, le roi Hoçaïn mit pied à terre et pria. On lui apporta ensuite de la nourriture. Lui et les principaux de ses compagnons mangèrent, tandis que les autres décapitaient les prisonniers.
Après cette grande victoire, Hoçaïn retourna dans sa capitale. Dieu se servit des mains de ce prince pour faire triompher les Sunnites et éteindre le feu du désordre. Cette rencontre eut lieu après ma sortie de l’Inde, en l’année 748 (1347).
Un homme, du nombre des dévots, des gens de bien et de mérite, nommé Mewlânâ Nizâm eddîn,[42] avait passé sa jeunesse à Hérat. Les habitants de cette ville l’aimaient et avaient recours à ses avis. Il les prêchait et leur adressait des exhortations. Ils convinrent avec lui de redresser les actes illicites. Le prédicateur de la ville, nommé Mélik Wernâ, cousin germain du roi Hoçaïn et marié à la veuve de son père, se ligua avec eux pour cet objet. Il était au nombre des hommes les plus beaux, tant au physique qu’au moral ; le roi le craignait, et nous rapporterons ci-dessous son histoire. Dès que ces individus apprenaient un acte défendu par la loi, lors même qu’il avait été commis par le roi, ils le réformaient.
On m’a raconté qu’ils reçurent un jour avis qu’un acte illicite s’était passé dans le palais de Mélik Hoçaïn ; ils se réunirent, afin de le redresser. Le roi se fortifia contre eux dans l’enceinte de son palais. Ils se rassemblèrent alors près de la porte de cet édifice, au nombre de six mille hommes. Le roi eut peur d’eux ; il fit venir le jurisconsulte et les grands de la ville. Or il venait de boire du vin ; ils exécutèrent sur lui, dans son palais, la peine prescrite par la loi et s’en retournèrent.
Le roi Hoçaïn craignait les Turcs, habitants du désert voisin de la ville de Hérat, qui avaient pour roi Thoghaïtomoûr, dont il a été fait mention ci-dessus, et qui étaient au nombre d’environ cinquante mille hommes. Il leur faisait des présents chaque année et les caressait. C’était ainsi qu’a agissait avant sa victoire sur les râfidhites ; mais, après qu’il eut vaincu ces hérétiques, il traita les Turcs comme ses sujets. Ils avaient coutume de venir à Hérat, et souvent ils y buvaient du vin ; ou bien un d’eux y venait étant ivre. Or Nizâm eddîn punissait, d’après les termes de la loi, ceux des Turcs qu’il rencontrait ivres. Ces Turcs sont des gens braves et audacieux ; ils ne cessent d’attaquer à l’improviste les villes de l’Inde et de faire des captifs ou de massacrer leurs habitants. Souvent ils faisaient prisonnière quelque musulmane, qui habitait dans l’Inde parmi les infidèles. Lorsqu’ils amenaient leurs captives dans le Khoraçan, Nizâm eddîn les délivrait de leurs mains. Le signe distinctif des femmes musulmanes, dans l’Inde, consiste à ne pas se percer les oreilles, tandis que les femmes infidèles percent les leurs. Il advint un jour qu’un émir turc, nommé Tomouralthi, fit prisonnière une femme et la pressa vivement de satisfaire ses désirs ; elle s’écria qu’elle était musulmane. Aussitôt le docteur la retira des mains de l’émir. Celui-ci en fut fortement blessé ; il monta à cheval, accompagné de plusieurs milliers de ses soldats, fondit sur les chevaux de Hérat, qui se trouvaient dans leurs pâturages ordinaires, dans la plaine de Badghîs, et les emmena, ne laissant aux habitants de Hérat aucune bête qu’ils pussent monter ou traire. Les Turcs se retirèrent, avec ces animaux, sur une montagne voisine où l’on ne pouvait les forcer. Le sultan et ses soldats ne trouvèrent pas de montures pour les poursuivre.
Hoçaïn envoya aux Turcs un député, pour les inviter à restituer le bétail et les chevaux qu’ils avaient pris et leur rappeler le traité qui existait entre eux. Ils répondirent qu’ils ne rendraient pas leur butin avant qu’on ne leur eût livré le jurisconsulte Nizâm eddîn. Le sultan repartit : « Il n’y a pas moyen de consentir à cela. » Le cheikh Abou Ahmed aldjesty,[43] petit-fils du cheikh Maudoud aldjesty, occupait dans le Khoraçan un rang élevé, et ses discours étaient respectés des habitants. Il monta à cheval, entouré d’un cortège de disciples et d’esclaves, également à cheval, et dit (au sultan) : « Je conduirai le docteur Nizâm eddîn près des Turcs, afin qu’ils soient apaisés par cette démarche ; puis, je le ramènerai. » Les habitants étaient disposés à se conformer à ses discours, et le docteur Nizâm eddîn vit qu’ils étaient d’accord là-dessus. Il monta à cheval, avec le cheikh Abou Ahmed, et se rendit près des Turcs. Tomouralthi se leva à son approche et lui dit : « Tu m’as pris ma femme » ; en même temps, il le frappa d’un coup de massue et lui brisa la cervelle. Nizâm eddîn tomba mort. Le cheikh Abou Ahmed fut tout interdit, et s’en retourna dans sa ville. Les Turcs rendirent le bétail et les chevaux qu’ils avaient pris.
Au bout d’un certain temps, ce Turc, qui avait tué le docteur, se rendit à Hérat. Plusieurs des disciples du fakîh le rencontrèrent, et s’avancèrent vers lui comme pour le saluer ; mais ils avaient sous leurs vêtements des épées, avec lesquelles ils le tuèrent ; ses camarades prirent la fuite. Quelque temps après, le roi Hoçaïn envoya en ambassade auprès du roi du Sedjestan son cousin germain Mélik Werna, qui avait été l’associé du docteur Nizâm eddîn, dans le redressement des actes prohibés par la loi. Lorsque ce prince fut arrivé dans le Sedjestan, le roi lui envoya l’ordre d’y rester et de ne pas revenir à sa cour. Mais il se dirigea vers l’Inde, et je le rencontrai, lorsque je sortis de ce pays, dans la ville de Sîwécitân (Sehwan), dans le Sind. C’était un homme distingué ; il avait un goût inné pour l’exercice de l’autorité, la chasse, la fauconnerie, les chevaux, les esclaves, les serviteurs, les vêtements précieux et dignes des rois. Or la situation de quiconque a de semblables goûts dans l’Inde n’est pas heureuse. Quant à lui, le roi de l’Inde le nomma gouverneur d’une petite ville. Un habitant de Hérat, établi dans l’Inde, le tua dans cette ville, à cause d’une jeune esclave. On dit que le roi de l’Inde aposta son meurtrier, par suite des machinations du roi Hoçaïn, et que ce fut à cause de cela que Hoçaïn rendit hommage au roi de l’Inde, après la mort de Mélik Wernâ. Le roi de l’Inde lui fit des présents et lui donna la ville de Bacâr (Bhakar), dans le Sind, dont le revenu monte chaque année à cinquante mille dinars d’or.
Mais revenons à notre sujet.
Nous partîmes de Hérat pour la ville de Djârn. C’est une ville de moyenne importance, mais jolie et possédant des jardins, des arbres, de nombreuses sources et des rivières. La plupart de ses arbres sont des mûriers, et la soie y abonde. On attribue la construction de cette ville au pieux et dévot Schihâb eddîn Ahmed aldjâm, dont nous raconterons l’histoire ci-après. Son petit-fils était le cheikh Ahmed, connu sous le nom de Zâdeh (fils, en persan), qui fut tué par le roi de l’Inde, et aux enfants duquel Djam appartient actuellement ; car cette cité est indépendante de l’autorité du sultan, et ces individus y jouissent d’une grande opulence. Quelqu’un en qui j’ai confiance m’a raconté que le sultan Abou Sa’id, roi de l’Irak, ayant fait un voyage dans le Khoraçan, campa près de cette ville, où se trouvait l’ermitage du cheikh. Celui-ci lui donna un festin magnifique ; il distribua à chaque tente du camp royal un mouton, donna un mouton par quatre hommes, et fournit à chaque bête employée dans le camp, cheval, mulet ou âne, sa provende pour une nuit. Il ne resta pas dans tout le camp un seul animal qui n’eût reçut sa part de l’hospitalité du cheikh.
On raconte que c’était un homme de plaisir et fort adonné à la boisson. Il avait environ soixante camarades de débauche, qui avaient coutume de se réunir chaque jour dans la demeure de l’un d’eux. Le tour de chacun revenait donc au bout de deux mois. Ils persévérèrent quelque temps dans cette conduite. Enfin, un jour, le tour du cheikh Schihâb eddîn arriva. Mais la nuit même qui précéda ce jour, il résolut de faire pénitence et de se réconcilier avec Dieu ; mais il se dit en lui-même : « Si je dis à mes compagnons qu’avant qu’ils fussent réunis chez moi j’avais fait pénitence, ils penseront que c’est par impuissance de les traiter. » Il fit donc servir les choses que ses pareils faisaient servir auparavant, tant mets que boissons, et fit mettre le vin dans les outres. Ses camarades arrivèrent, et lorsqu’ils furent disposés à boire, ils ouvrirent une outre. Un d’eux y goûta, et il trouva que la liqueur qu’elle contenait avait un goût douceâtre. Ensuite on ouvrit une seconde outre, puis une troisième, et on les trouva toutes dans le même état. Les convives interpellèrent le cheikh à ce sujet. Il leur confessa franchement ses pensées secrètes, leur fit connaître sa pénitence et leur dit : « Par Dieu, ceci n’est pas autre chose que le vin que vous buviez auparavant ! » Ils firent tous pénitence, bâtirent cet ermitage et s’y retirèrent pour adorer Dieu. Beaucoup de miracles et de visions extatiques se montrèrent à ce cheikh.
Nous partîmes de Djam pour Thous, une des plus illustres et des plus grandes villes du Khoraçan. Elle a été la patrie du célèbre imâm Abou Hamid alghazzâly, dont on y voit encore le tombeau. Nous allâmes de Thous à la ville du Mausolée d’Arridha (Mechhed Arrhida). Ce dernier est ’Aly, fils de Mouça alcâzhim, fils de Djafar assâdik, fils de Mohammed albâkir, fils d’Aly Zain al’âbidîn, fils d’Alhoçaïn le martyr, fils du prince des croyants ’Aly, fils d’Abou Thâlib Mechhed est aussi une grande et vaste ville, abondante en fruits, en eaux et en moulins. Atthâhir Mohammed Chah y habitait. Thahir (littéralement « le pur ») a la même signification chez ce peuple que Nakîb (chef des Alides) chez les Égyptiens, les Syriens, les Irakiens. Les Indiens, les Sindis, les Turkistanais disent, en place de ces mots : « Le seigneur illustre. » Mechhed était encore habité par le kadi, le chérif Djélal eddîn, que je rencontrai ensuite dan l’Inde, ainsi que par le chérif ’Aly et ses deux fils, Emir Hindou et Daoulet Chah qui m’accompagnèrent depuis Termedh jusque dans l’Hindoustan. C’étaient des hommes vertueux.
Le mausolée vénéré est surmonté d’un dôme élevé, et se trouve compris dans un ermitage. Dans le voisinage de celui-ci, il y a un collège et une mosquée. Tous ces bâtiments sont d’une construction élégante, et leurs murailles sont revêtues de faïence colorée. Sur le tombeau est une estrade de planches, recouvertes de feuilles d’argent, et au-dessus de ce tombeau sont suspendues des lampes du même métal. Le seuil de la porte du dôme est en argent. La porte elle-même est cachée par un voile de soie brochée d’or, Le plancher est couvert de plusieurs sortes de tapis. Vis-à-vis de ce tombeau on voit celui du prince des croyants, Haroun Errachid, surmonté d’une estrade sur laquelle on place des candélabres, que les habitants du Maghreb appelle alhicec et alménâïr. Lorsqu’un râfidhite entre dans le mausolée pour le visiter, il frappe de son pied le tombeau de Rachid et bénit, au contraire, le nom de Ridha.
Nous partîmes pour la ville de Sarakhs, qui a donné naissance au vertueux cheikh Lokman assarakhsy. De Sarakhs, nous allâmes à Zâveh, patrie du vertueux, cheikh Kothb eddîn Haïder, qui a donné son nom à la congrégation des fakirs Haïdéry, lesquels placent des anneaux de fer à leurs mains, à leur cou, à leurs oreilles et même à leur verge, de sorte qu’ils ne peuvent avoir commerce avec une femme. Étant partis de Zâveh, nous arrivâmes à la ville de Neïçaboûr, une des quatre capitales du Khoraçan. Elle est appelée le Petit Damas, à cause de la quantité de ses fruits, de ses jardins et de ses eaux, ainsi qu’à cause de sa beauté. Quatre canaux la traversent, et ses marchés sont beaux et vastes. Sa mosquée est admirable ; elle est située au milieu du marché, et touche à quatre collèges, arrosés par une eau abondante et habités par beaucoup d’étudiants, qui apprennent la jurisprudence et la manière de lire le Coran. Ces quatre collèges sont au nombre des plus beaux de la province. Mais les medrécehs du Khoraçan, des deux Iraks, de Damas, de Baghdâd et de Misr, quoiqu’elles atteignent le comble de la solidité et de l’élégance, sont toutes inférieures à la medréceh bâtie près de la citadelle de la résidence royale de Fez par notre maître, le prince des croyants Almotéwekkil ’Ala Allah (celui qui met sa confiance en Dieu), le champion dans la voie de Dieu, le plus savant des rois, la plus belle perle du collier des khalifes équitables, Abou ’Inân ; que Dieu le fasse prospérer et rende son armée victorieuse ! Ce dernier collège n’a point d’égal en étendue ni en élévation ; les habitants de l’Orient ne sauraient reproduire les ornements en plâtre qui s’y trouvent.
On fabrique à Neïçâboûr des étoffes de soie, telles que le nekh, le kemkhâ (velours) et autres que l’on exporte dans l’Inde. Dans cette ville se trouve l’ermitage du cheikh, de l’imâm savant, du pôle (Alkothb), du dévot Kothb eddîn Anneïçâboûry, un des prédicateurs et des pieux imâms. Je logeai chez lui ; il me reçut très bien et me traita avec considération. Je fus témoin de prodiges et de miracles merveilleux opérés par lui.
J’avais acheté à Neïçâboûr un jeune esclave turc. Le cheikh le vit avec moi et me dit : « Ce page ne te convient pas ; revends-le. » Je lui répondis : « C’est bien. » Et je revendis l’esclave, le lendemain même, à un marchand. Puis je fis mes adieux au cheikh et je partis. Lorsque je fus arrivé dans la ville de Besthâm, un de mes amis m’écrivit de Neïçâboûr et me raconta que l’esclave en question avait tué un enfant turc, et avait été tué en expiation de ce meurtre. Cela est un miracle évident de la part de ce cheikh.
De Neïçâboûr je me rendis à Besthâm, qui a donné naissance au cheikh, au célèbre contemplatif Abou Yézid albesthâmy, dont on y voit le tombeau, renfermé sous le même dôme que le corps d’un des enfants de Djafar Assâdik. On trouve encore à Besthâm le tombeau du vertueux cheikh, de l’ami de Dieu, Abou’l Haçan alkharrakâny. Je logeai en cette ville dans l’ermitage du cheikh Abou Yézid albesthâmy. Je partis de Besthâm, par le chemin de Hendokhîr,[44] pour Kondoûs et Baghlan, villages habités par des cheikhs et des hommes de bien, et où se trouvent des jardins et des rivières. Nous logeâmes à Kondoûs près d’une rivière, sur les bords de laquelle s’élève un ermitage appartenant à un supérieur de fakirs, originaire d’Égypte et nommé Chîr Siâh, c’est-à-dire « le lion noir ». Le gouverneur de ce canton nous y traita. C’était un natif de Moçoul, qui habitait un grand jardin dans le voisinage. Nous séjournâmes environ quarante jours près de ce village, afin de refaire nos chameaux et nos chevaux ; car il y a là d’excellents pâturages et un gazon abondant. On y jouit d’une sûreté parfaite, grâce à la sévérité des jugements rendus par l’émir Boronthaïh. Nous avons déjà dit que la peine prononcée par les lois des Turcs contre celui qui dérobe un cheval consiste à faire rendre au voleur l’animal volé et neuf autres en sus. S’il ne les possède pas, on lui enlève, en leur place, ses enfants. Mais, s’il n’a pas d’enfants, on l’égorge comme une brebis. Les Turcs laissent leurs bêtes de somme absolument sans gardien, après que chacun a marqué sur la cuisse les bêtes qui lui appartiennent. Nous en usâmes de même dans ce canton. Il advint que nous nous mîmes en quête de nos chevaux, dix jours après de notre arrivée ; il nous en manquait trois. Mais au bout de quinze jours les Tartares nous les ramenèrent à notre demeure, de peur de subir les peines portées par la loi. Nous attachions chaque soir deux chevaux vis-à-vis de nos tentes, afin de pouvoir nous en servir la nuit, si le besoin l’exigeait. Une certaine nuit nous perdîmes ces deux chevaux, et nous quittâmes bientôt après le pays. Au bout de vingt-deux jours, on nous les ramena sur le chemin.
Un autre motif de notre séjour, ce fut la crainte de la neige ; car il y a au milieu de la route une montagne nommée Hindou Coûch, c’est-à-dire « qui tue les Indous », parce que beaucoup d’entre les esclaves mâles et femelles que l’on emmène de l’Inde meurent dans cette montagne, à cause de la violence du froid et de la quantité de neige. Elle s’étend l’espace d’un jour de marche tout entier. Nous attendîmes jusqu’à l’arrivée des chaleurs. Nous commençâmes à traverser cette montagne, à la fin de la nuit, et nous ne cessâmes de marcher jusqu’au soir du jour suivant. Nous étendions des pièces de feutre devant les chameaux, afin qu’ils n’enfonçassent pas dans la neige, Après nous être mis en route, nous arrivâmes à un endroit nommé Ander (Anderâb), et où a jadis existé une ville dont les vestiges ont disparu. Nous logeâmes dans un grand bourg où se trouvait un ermitage appartenant à un homme de bien, nommé Mohammed almehrouy, chez lequel nous descendîmes. Il nous traita avec considération, et lorsque nous lavions nos mains, après le repas, il buvait l’eau qui nous avait servi à cet usage, à cause de la bonne opinion qu’il avait de nous, et de son extrême bienveillance à notre égard. Il nous accompagna jusqu’à ce que nous eussions gravi la montagne de Hindou Coûch. Nous trouvâmes sur cette montagne une source d’eau chaude, avec laquelle nous nous lavâmes la figure. Notre peau fut excoriée et nous souffrîmes beaucoup. Nous nous arrêtâmes dans un endroit nommé Bendj Hîr. Bendj (Pendj) signifie « cinq », et hîr « montagne ». Le nom de Bendj Hîr veut donc dire « cinq montagnes ». Il y avait jadis là une ville belle et peuplée, sur un fleuve considérable et dont les eaux sont de couleur bleue, comme celles de la mer. Il descend des montagnes de Badakhchân, où l’on trouve le rubis que l’on appelle balakhch, « rubis balais ». Tenkîz, roi des Tartares, a ruiné cette contrée, et depuis lors elle n’est pas redevenue florissante. C’est là que se trouve le mausolée du cheikh Sa’id almekky, lequel est vénéré de ces peuples. Nous arrivâmes ensuite à la montagne de Péchâï, où se trouve l’ermitage du vertueux cheikh Athâ Aouliâ. Atha veut dire en turc, « père » ; quant au mot Aouliâ, il appartient à la langue arabe ; le nom Athâ Aouliâ signifie donc « le père des amis de Dieu ». On appelle aussi cet individu Sîçad Sâléh. Sîçad veut dire, en persan, « trois cents », et sâléh signifie « année ». En effet, les habitants de cet endroit prétendent que le cheikh est âgé de trois cent cinquante ans. Ils ont pour lui une grande vénération et viennent, pour le visiter, des villes et des villages voisins. Les sultans et les princesses se rendent près de lui. Il nous traita avec considération et nous donna un repas ; nous campâmes sur le bord d’une rivière, près de son ermitage, et nous lui rendîmes visite. Je le saluai et il m’embrassa ; sa peau était lisse, et je n’en ai pas vu de plus douce. Quiconque le voit s’imagine qu’il n’est âgé que de cinquante ans. Il m’a dit que tous les cent ans il lui poussait de nouveaux cheveux et de nouvelles dents, et qu’il avait vu Abou Rohm, celui-là même dont le tombeau se trouve à Moultân, dans le Sind. Je lui demandai de me réciter une tradition, et il me raconta des anecdotes. Mais je conçus des doutes touchant ce qui le concernait, et Dieu sait le mieux s’il est sincère.
Nous partîmes ensuite pour Perwân, où je rencontrai l’émir Boronthaïh. Il me fit du bien, me témoigna de la considération, et écrivit à ses préposés dans la ville de Ghazna de me traiter avec honneur. Il a déjà été question de lui et de la haute stature qu’il avait reçue en partage. Il avait près de lui une troupe de cheikhs et de fakirs, qui habitaient des ermitages.
De Perwân nous allâmes à Tcharkh ; c’est un grand bourg, qui possède de nombreux jardins et dont les fruits sont excellents. Nous y arrivâmes pendant l’été et nous y trouvâmes une troupe de fakirs et d’étudiants ; nous y fîmes la prière du vendredi. Le chef de la localité, Mohammed altcharkhy, nous donna un repas. Dans la suite, je le revis dans l’Inde.
De Tcharkh nous partîmes pour Ghazna, capitale du sultan belliqueux Mahmoud, fils de Sébuktéguin, dont le nom est célèbre. Il était au nombre des plus grands souverains, et avait le surnom de Yamin Eddaulèh. Il fit de fréquentes incursions dans l’Inde, et y conquit des villes et des châteaux forts. Son tombeau se trouve dans cette ville ; il est surmonté d’un ermitage. La majeure partie de Ghazna est dévastée, et il n’en subsiste plus qu’une petite portion ; mais cette ville a jadis été considérable. Son climat est très froid; ses habitants en sortent pendant l’hiver et retirent à Kandahar, ville grande et riche, située à trois journées de distance de Ghazna, mais que je ne visitai pas. Nous logeâmes hors de Ghazna, dans une bourgade située sur une rivière qui coule sous la citadelle. L’émir de la ville, Merdec Agha, nous traita avec égard. Merdec signifie « le petit » (« petit homme » en persan), et agha veut dire « celui dont l’origine est illustre » (en mongol, Aka signifiait l’aîné, le chef de famille).
Nous partîmes ensuite pour Kaboul ; c’était jadis une ville importante ; mais ce n’est plus qu’un village, habité par une tribu de Persans, appelés Afghâns. Ils occupent des montagnes et des défilés et jouissent d’une puissance considérable ; la plupart sont des brigands. Leur principale montagne s’appelle Coûh Soleïman. On raconte que le prophète Soleïman (Salomon) gravit cette montagne, et regarda de son sommet l’Inde, qui était alors remplie de ténèbres. Il revint sur ses pas, sans entrer dans ce pays, et la montagne fut appelée d’après lui. C’est là qu’habite le roi des Afghâns. A Kaboul se trouve l’ermitage du cheikh Ismâ’îl l’Afghân, disciple du cheikh ’Abbâs, un des principaux saints.
De Kaboul, nous allâmes à Kermâch, forteresse située entre deux montagnes, et dont les Afghâns se servent pour exercer le brigandage. Nous les combattîmes en passant près du château. Ils étaient placés sur la pente de la montagne ; mais nous leur lançâmes des flèches et ils prirent la fuite. Notre caravane était peu chargée de bagages, mais elle était accompagnée d’environ quatre mille chevaux. J’avais des chameaux, par la faute desquels je fus séparé de la caravane. J’avais avec moi plusieurs individus, parmi lesquels se trouvaient des Afghâns. Nous jetâmes une portion de nos provisions, et nous abandonnâmes sur la route les charges des chameaux qui étaient fatigués. Nos chevaux retournèrent les prendre le lendemain, et les emportèrent. Nous rejoignîmes la caravane, après la dernière prière du soir, et nous passâmes la nuit à la station de Chech Naghâr, le dernier endroit habité sur les confins du pays des Turcs.
Nous entrâmes ensuite dans le grand désert, qui s’étend l’espace de quinze journées de marche. On n’y voyage que dans une seule saison, après que les pluies sont tombées dans le Sind et l’Inde, c’est-à-dire au commencement du mois de juillet. Dans ce désert souffle le vent empoisonné et mortel qui fait tomber les corps en putréfaction, de sorte que les membres se séparent après la mort. Nous avons dit ci-dessus que ce vent souffle aussi dans le désert, entre Hormouz et Chiraz. Une grande caravane, dans laquelle se trouvait Khodhâwend Zâdeh, kadi de Termedh, nous avait précédés. Il lui mourut beaucoup de chameaux et de chevaux ; mais, par la grâce de Dieu, notre caravane arriva saine et sauve à Bendj Ab, c’est-à-dire au fleuve du Sind. Bendj (Pendj) signifie « cinq », et Âb eau. Le sens de ces deux mots est donc les Cinq Rivières. Elles se jettent dans le grand fleuve, et arrosent cette contrée. Nous en reparlerons, s’il plaît à Dieu. Nous arrivâmes près de ce fleuve, à la fin de dhou’lhiddjeh, et nous vîmes briller cette même nuit la nouvelle lune de moharrem de l’année 734. De cet endroit, les préposés aux nouvelles écrivirent dans l’Inde pour y transmettre l’avis de notre arrivée, et firent connaître au souverain de ce pays ce qui nous concernait.
C’est ici que finit le récit de ce premier voyage. Louange à Dieu, maître des mortels.
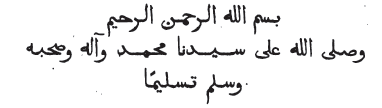
Voici ce que dit le cheikh Abou ’Abd Allah Mohammed, fils d’Abd Allah, fils de Mohammed, fils d’Ibrahim Allewâty atthandjy, connu sous le nom d’Ibn Batoutah. (Que Dieu lui fasse miséricorde !)
Lorsque fut arrivé le premier jour du mois divin de moharrem, commencement de l’année 734 (12 septembre 1333), nous parvînmes près du fleuve Sind, le même que l’on désigne sous le nom de Pendj-âb, nom qui signifie « les cinq rivières ». Ce fleuve est un des plus grands qui existent ; il déborde dans la saison des chaleurs, et les habitants de la contrée ensemencent la terre après son inondation, ainsi que font les habitants de l’Égypte, lors du débordement du Nil. C’est à partir de ce fleuve que commencent les États du sultan vénéré, Mohammed Chah, roi de l’Inde et du Sind.
Quand nous arrivâmes près du fleuve, les préposés aux nouvelles vinrent nous trouver et écrivirent l’avis de notre arrivée à Kothb almulc, gouverneur de la ville de Moultân. A cette époque, le chef des émirs du Sind était un esclave du sultan, appelé Sertîz, qui est l’inspecteur des autres esclaves[45] et devant lequel les troupes du sultan passent en revue. Le nom de cet individu signifie Celui qui a la tête vive ; car ser (en persan) veut dire « tête », et tîz « vif, impétueux ». Il se trouvait, au moment de notre arrivée, dans la ville de Siwécitân, située dans le Sind, à dix jours de marche de Moultân. Entre la province du Sind et la résidence du sultan, qui est la ville de Dilhy, il y a cinquante journées de marche. Lorsque les préposés aux nouvelles écrivent du Sind au sultan, la lettre lui parvient en l’espace de cinq jours, grâce au bérîd ou à la poste.
Le bérîd, dans l’Inde, est de deux espèces. Quant à la poste aux chevaux, on l’appelle oulâk. Elle a lieu au moyen de chevaux appartenant au sultan et stationnés tous les quatre milles. Pour la poste aux piétons, voici en quoi elle consiste : chaque mille est partagé en trois distances égales que l’on appelle addâouah, ce qui veut dire le tiers d’un mille. Quant au mille, il se nomme, chez les Indiens, al-coroûh. Or, à chaque tiers de mille, il y a une bourgade bien peuplée, à l’extérieur de laquelle se trouvent trois tentes où se tiennent assis des hommes tout prêts à partir. Ces gens ont serré leur ceinture, et près de chacun se trouve un fouet long de deux coudées, et terminé à sa partie supérieure par des sonnettes de cuivre. Lorsque le courrier sort de la ville, il tient sa lettre entre ses doigts et, dans l’autre main, le fouet garni de sonnettes. Il part donc, courant de toutes ses forces. Quand les gens placés dans les pavillons entendent le bruit des sonnettes, ils font leurs préparatifs pour recevoir le courrier, et, à son arrivée près d’eux, un d’entre eux prend la lettre de sa main et part avec la plus grande vitesse. Il agite son fouet jusqu’à ce qu’il soit arrivé à l’autre dâouah. Ces courriers ne cessent d’agir ainsi jusqu’à ce que la lettre soit parvenue à sa destination.
Cette espèce de poste est plus prompte que la poste aux chevaux, et l’on transporte souvent par son moyen ceux des fruits du Khoraçan qui sont recherchés dans l’Inde. On les dépose dans des plats, et on les transporte en courant jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au sultan. C’est encore ainsi que l’on transporte les principaux criminels ; on place chacun de ceux-ci sur un siège que les courriers chargent sur leur tête et avec lequel ils marchent en courant. Enfin, c’est de la même manière que l’on transporte l’eau destinée à être bue par le sultan, lorsqu’il se trouve à Daoulet Abad. On lui porte de l’eau puisée dans le fleuve Gange, où les Indiens se rendent en pèlerinage, ce fleuve est à quarante journées de cette ville.
Lorsque les « nouvellistes » écrivent au sultan pour l’informer de l’arrivée de quelqu’un dans ses États, il prend une pleine connaissance de la lettre. Ceux qui l’écrivent y mettent tout leur soin, faisant connaître au prince qu’il est arrivé un homme, conformé de telle manière et vêtu de telle sorte. Ils enregistrent le nombre de ses compagnons, de ses esclaves, de ses serviteurs et de ses bêtes de somme ; ils décrivent comment il en use dans la marche et dans le repos, et racontent toutes ses dépenses. Ils ne négligent aucun de ces détails. Lorsque le voyageur arrive au Moultân, qui est la capitale du Sind, il y séjourne jusqu’à ce qu’on reçoive un ordre du sultan touchant sa venue à la cour et le traitement qui lui sera fait. Un individu est honoré, en ce pays, selon ce qu’on observe de ses actions, de ses dépenses et de ses sentiments, puisque l’on ignore quel est son mérite et quels sont ces ancêtres.
C’est la coutume du roi de l’Inde, du sultan Abou’l Modjâhid Mohammed chah, d’honorer les étrangers, de les aimer et de les distinguer d’une manière toute particulière, en leur accordant des gouvernements ou d’éminentes dignités. La plupart de ses courtisans, de ses chambellans, de ses vizirs, de ses kadis et de ses beaux-frères, sont des étrangers. Il a publié un ordre portant que ceux-ci, dans ses États, fussent appelés du titre d’illustres : ce mot est devenu pour eux un nom propre.
Aucun étranger admis à la cour de ce roi ne peut se passer de lui offrir un cadeau et de le lui présenter, en guise d’intercesseur auprès de lui. Le sultan l’en récompense par un présent plusieurs fois aussi considérable. Nous raconterons beaucoup de choses touchant les dons qui lui ont été offerts par des étrangers. Lorsque ses sujets furent accoutumés à lui voir tenir cette conduite, les marchands qui habitaient le Sind et l’Inde se mirent à donner en prêt à chaque individu se rendant à la cour du sultan des milliers de dinars. Ils lui fournissaient ce qu’il voulait offrir au souverain, ou bien il employait cette somme comme il l’entendait pour son propre usage, en chevaux de selle, en chameaux et en effets. Ces marchands le servaient de leur argent et de leurs personnes, et se tenaient debout devant lui comme des domestiques. Quand il arrivait près du sultan, celui-ci lui faisait un présent considérable. Alors il payait les sommes qu’il devait aux marchands, et s’acquittait envers eux. De la sorte, leur négoce était achalandé et leurs profits étaient considérables. Aussi cette conduite est-elle devenue pour eux une coutume constante.
Lorsque je fus arrivé dans le Sind, je suivis cette méthode, et j’achetai à des marchands des chevaux, des chameaux, des esclaves, etc. Précédemment, j’avais acquis à Ghazna, d’un marchand de l’Irak, originaire de Tékrit et nommé Mohammed Addoûry, environ trente chevaux et un chameau qui portait une charge de flèches, car cet article figure au nombre des présents que l’on offre au sultan, Le susdit marchand partit pour le Khoraçan, puis il revint dans l’Inde et y reçut de moi ce que je lui devais ; par mon moyen il fit un profit considérable, et devint un des plus riches marchands. Après de nombreuses années, je le rencontrai dans la ville d’Alep, lorsque les infidèles m’eurent dépouillé de ce que je possédais ; mais je n’en obtins aucun bienfait.
Quand nous eûmes franchi le fleuve du Sind, connu sous le nom de Pendjab, nous entrâmes dans un marais planté de roseaux, afin de suivre le chemin qui le traversait par le milieu. Un carcaddan en sortit sous nos yeux. Voici la description de cet animal : il est de couleur noire, a le corps grand, la tête grosse et d’un volume excessif ; c’est pourquoi on en fait le sujet d’un proverbe, et l’on dit : « Le rhinocéros, tête sans corps. » Il est plus petit que l’éléphant, mais sa tête est plusieurs fois aussi forte que celle de cet animal. Il a entre les yeux une seule corne, de la longueur d’environ trois coudées et de la largeur d’environ un empan. Lorsque l’animal dont il est ici question sortit du marais à notre vue, un cavalier voulut l’attaquer ; le carcaddan frappa de sa corne la monture de ce cavalier, lui traversa la cuisse et le renversa, après quoi il rentra parmi les roseaux et nous ne pûmes nous en emparer. J’ai vu un rhinocéros une seconde fois, pendant le même voyage, après la prière de l’asr ; il était occupé à se repaître de plantes. Lorsque nous nous dirigeâmes vers lui, il s’enfuit. J’en vis un encore une fois, tandis que je me trouvais avec le roi de l’Inde. Nous entrâmes dans un bosquet de roseaux ; le sultan était monté sur un éléphant, et nous-mêmes avions pour montures plusieurs de ces animaux ; les piétons et les cavaliers pénétrèrent parmi les roseaux, firent lever le carcaddan, le tuèrent et poussèrent sa tête vers le camp.
Cependant, nous marchâmes pendant deux jours, après avoir passé le fleuve du Sind, et nous arrivâmes à la ville de Djénâny, grande et belle place située sur le bord de ce même fleuve. Elle possède des marchés élégants, et sa population appartient à une peuplade appelée les Sâmirah, qui l’habite depuis longtemps et dont, les ancêtres s’y sont établis lors de la conquête, du temps de Heddjâdj, fils de Yousef, selon ce que racontent les chroniqueurs à propos de la conquête du Sind. Le cheikh, l’imâm savant, pratiquant les bonnes œuvres, pieux et dévot, Rocn eddîn, fils du cheikh, du vertueux docteur Chems eddîn, fils du cheikh, de l’imâm pieux et dévot, Béhâ eddîn Zacariâ le Koraïchite (c’est un des trois personnages que le cheikh, le saint et vertueux Borhân eddîn ala’radj m’avait prédit, dans la ville d’Alexandrie, que je rencontrerais dans le cours de mon voyage, et, en effet, je les rencontrai ; Dieu en soit loué !) ; ce cheikh, dis-je, m’a raconté que le premier de ses ancêtres s’appelait Mohammed, fils de Kâcim, le Koraïchite, qu’il assista à la conquête du Sind avec l’armée qu’envoya pour cet objet Heddjâdj, fils de Yousef, pendant qu’il était émir de l’Irak ; qu’il y fixa son séjour et que sa postérité devint considérable.
Quant à cette peuplade connue sous le nom de Sâmirah, elle ne mange avec personne, et qui que ce soit ne doit regarder ses membres lorsqu’ils mangent ; ils ne s’allient pas par mariage avec quelqu’un faisant partie d’une autre tribu et personne non plus ne s’allie avec eux. Ils avaient alors un émir nommé Ounâr, dont nous raconterons l’histoire.
Après être partis de la ville de Djénâny, nous marchâmes jusqu’à ce que nous fussions arrivés à celle de Siwécitân (Sehwan), grande cité, entourée d’un désert de sable où l’on ne trouve d’autre arbre que l’oumm ghaïlân (espèce d’acacia). On ne cultive rien sur le bord du fleuve qui l’arrose, si ce n’est des pastèques. La nourriture des habitants consiste en sorgho (millet) et en pois, que l’on y appelle mochonc et avec lesquels on fabrique le pain. On y trouve beaucoup de poisson et de lait de buffle. Les habitants mangent le scinque, qui est un petit animal semblable au caméléon, que les Maghrébins nomment petit serpent de jardin, sauf qu’il n’a pas de queue. Je les ais vus creuser le sable, en retirer cet animal lui fendre le ventre, jeter les intestins et le remplir de curcuma, qu’ils appellent zerd-choûbeh (tchobeh), ce qui signifie « le bois jaune ». Cette plante remplace chez eux le safran. Lorsque je vis ce petit animal que mangeaient les Indous, je le regardai comme une chose impure et je n’en mangeai pas.
Nous entrâmes dans Siwécitân au fort de l’été, et la chaleur y était très grande. Aussi mes compagnons s’asseyaient-ils tout nus ; chacun plaçait à sa ceinture un pagne, et sur ses épaules un autre pagne trempé dans l’eau. Bien peu de temps s’écoulait avant que cette étoffe ne fût séchée, et alors on la mouillait de nouveau, et ainsi de suite. Je vis à Siwécitân son prédicateur, nommé Accheïbâny ; il me fit voir une lettre du prince des croyants, le khalife ’Omar, fils d’Abd El-Aziz, adressée au premier de ses ancêtres, pour l’investir des fonctions de prédicateur en cette ville. Sa famille se les est transmises par héritage, depuis cette époque jusqu’à présent.
Voici la teneur de cette lettre : « Ceci est l’ordre qu’a promulgué le serviteur de Dieu, le prince des croyants, ’Omar, fils d’Abd El-Aziz, en faveur d’un tel. » La date est l’année 99 (de l’hégire ; 717-718 de J.C.). Selon ce que m’a raconté le prédicateur susdit, sur ce diplôme est écrite, de la main du prince des croyants, ’Omar, fils d’Abd El-Aziz, la phrase suivante : « La louange appartient à Dieu seul. »
Je rencontrai aussi à Siwécitân le vénérable cheikh Mohammed Albaghdâdy, qui habitait l’ermitage bâti près du tombeau du vertueux cheikh ’Othman Almérendy. On raconte que l’âge de cet individu dépasse cent quarante années, et qu’il a été présent au meurtre d’Almosta’cim Billah, le dernier des khalifes abbâsides, lequel fut tué par le mécréant Holâoun (Houlagou), fils (petit-fils) de Tenkîz, le Tartare, Quant au cheikh, malgré son grand âge, il était encore robuste et allait et venait à pied.
Dans cette ville habitaient l’émir Ounâr assâmiry, dont il a été fait mention, et l’émir Khaïçar arroûmy, tous deux au service du sultan, et ayant avec eux environ mille huit cents cavaliers. Un Indien idolâtre, nommé Ratan, y demeurait aussi. C’était un homme habile dans le calcul et l’écriture ; il alla trouver le roi de l’Inde, en compagnie d’un émir ; le souverain le goûta, lui donna le titre de chef du Sind, l’établit gouverneur de cette contrée et lui accorda en fief la ville de Siwécitân et ses dépendances. Enfin, il le gratifia des honneurs, c’est-à-dire de timbales et de drapeaux, ainsi qu’il en donne aux principaux émirs. Lorsque Ratan fut de retour dans le Sind, Ounâr, Khaïçar, etc., virent avec peine la prééminence obtenue sur eux par un idolâtre. En conséquence, ils résolurent de l’assassiner, et, quelques jours s’étant écoulés depuis son arrivée, ils lui conseillèrent de se transporter dans la banlieue de la ville, afin d’examiner la situation où elle se trouvait. Il sortit avec eux ; mais, lorsqu’il fit nuit, ils excitèrent du tumulte dans le camp, prétendant qu’un lion avait fait irruption. Ils se dirigèrent vers la tente de l’idolâtre, le tuèrent et revinrent en ville, où ils s’emparèrent de l’argent qui appartenait au sultan, et qui s’élevait à douze lacs. Le lac est une somme de cent mille dinars (d’argent) ; cette somme équivaut à dix mille dinars d’or, monnaie de l’Inde, et le dinar de l’Inde vaut deux dinars et demi, en monnaie du Maghreb. Les insurgés mirent à leur tête le susdit Ounâr, qu’ils appelèrent Mélik Firouz, et qui partagea l’argent entre les soldats. Mais ensuite il craignit pour sa sûreté, à cause de l’éloignement où il se trouvait de sa tribu. Il sortit de la ville, avec ceux de ses proches qui étaient près de lui, et se dirigea vers sa peuplade. Le reste de l’armée choisit alors pour chef Khaïçar arroûmy.
Ces nouvelles parvinrent à ’Imâd Almulc Sertîz, esclave du sultan, qui était alors émir des émirs du Sind et résidait à Moultân. Il rassembla des troupes, et se mit en marche, tant par terre que sur le fleuve du Sind. Entre Moultân et Siwécitân, il y a dix journées de marche. Kaïçar sortit à la rencontre de Sertîz, et un combat s’engagea. Khaïçar et ses compagnons furent mis en déroute de la manière la plus honteuse, et se fortifièrent dans la ville. Sertîz les assiégea et dressa contre eux des mangonneaux ou balistes ; le siège étant devenu très pénible pour eux, ils demandèrent à capituler au bout de quarante jours, à partir de celui où Sertîz avait campé vis-à-vis d’eux. Il leur accorda la vie sauve ; mais, lorsqu’ils furent venus le trouver, il usa de perfidie envers eux, prit leurs richesses et ordonna de les mettre à mort. Chaque jour, il en faisait décapiter plusieurs, en faisait fendre d’autres par le milieu du corps, écorcher d’autres ordonnait de remplir de paille la peau de ceux-ci et la pendait au-dessus de la muraille. La majeure partie de celle-ci était couverte de ces peaux, mises en croix, qui frappaient d’épouvante quiconque les regardait. Quant aux têtes, Sertîz les réunit au milieu de la ville, et elles y formèrent une sorte de monticule.
Ce fut après cette bataille que je m’arrêtai dans la ville de Siwécitân, où je me logeai dans un grand collège. Je dormais sur la terrasse de l’édifice, et, lorsque je me réveillais la nuit, je voyais ces peaux suspendues ; mon corps se contractait à ce spectacle, et mon âme ne fut pas satisfaite du séjour de ce collège. Aussi je l’abandonnai. Le docteur distingué et juste ’Alâ Almulc AlKhoraçany, surnommé Facîh eddîn, anciennement kadi de Hérat, étant venu trouver le roi de l’Inde, celui-ci le nomma gouverneur de la ville de Lâhary et de ses dépendances, dans le Sind. Il assista à cette expédition, avec ’Imâd Almulc Sertîz, et en compagnie de ses troupes. Je résolus de me rendre avec lui dans la ville de Lâhary. Il avait quinze bateaux, en compagnie desquels il s’avança sur le fleuve Sind, et qui portaient ses bagages. Je partis donc dans sa société.
Le docteur ’Alâ Almulc avait, parmi ses navires, un bâtiment appelé alahhaourah, et qui était de l’espèce nommée chez nous tartane, sauf qu’il était plus large et plus court. Il y avait au milieu de ce bâtiment une cabine de bois, à laquelle on arrivait par des degrés, et qui était surmontée d’un emplacement disposé pour que l’émir pût s’y asseoir. Les officiers de ce seigneur s’asseyaient vis-à-vis de lui, et ses esclaves se tenaient debout, à droite et à gauche. L’équipage, composé d’environ quarante individus, était occupé à ramer. Cette ahaourah était entourée, à sa droite et à sa gauche, par quatre navires, dont deux renfermaient les honneurs de l’émir, c’est-à-dire les drapeaux, les timbales, les trompettes, les clairons et les flûtes, que l’on appelle (au Maghreb) ghaïthah, et les deux autres portaient les chanteurs. Les timbales et les trompettes se faisaient entendre d’abord, puis les chanteurs faisaient leur partie, et ils ne cessaient d’agir ainsi depuis le commencement du jour jusqu’au moment du déjeuner. Lorsque cet instant arrivait, les bateaux se réunissaient et se serraient les uns contre les autres ; on plaçait entre eux des échelles, et les musiciens se rendaient sur l’ahaourah de l’émir. Ils chantaient jusqu’à ce qu’il eût fini de manger ; après quoi ils mangeaient, et lorsque le repas était terminé, ils retournaient à leur vaisseau. Alors on commençait à marcher, selon l’ordre accoutumé, jusqu’à la nuit, et, lorsqu’elle était arrivée, on plantait le camp sur la rive du fleuve, l’émir descendait dans ses tentes, la table était dressée, et la majeure partie de l’escorte assistait au festin. Quand on avait fait la dernière prière du soir, les sentinelles montaient la garde pendant la nuit, à tour de rôle et tout en conversant entre elles. Lorsque les gens d’une escouade avaient achevé leur faction, un d’entre eux criait à haute voix : « O seigneur roi, tant d’heures de la nuit sont écoulées. » Alors les gens d’une autre escouade veillaient ; et, quand ils avaient fini leur faction, leur hérault proclamait combien d’heures étaient passées. Lorsqu’arrivait le matin, on sonnait de la trompette et l’on battait les timbales, on récitait la prière de l’aurore et l’on apportait de la nourriture. Quand on avait cessé de manger, on commençait à marcher. Si l’émir veut voyager sur le fleuve, il s’embarque dans l’ordre que nous avons décrit ; mais, s’il veut marcher par terre, on fait résonner les timbales et les trompettes ; les chambellans s’avancent, suivis des fantassins qui précèdent l’émir. Les chambellans sont eux-mêmes devancés par six cavaliers, dont trois portent au cou des timbales, et les trois autres sont munis de flûtes. Lorsqu’ils approchent d’une bourgade ou d’un terrain élevé ces musiciens font retentir leurs timbales et leurs flûtes ; puis les timbales et les trompettes du corps d’armée se font entendre. Les chambellans ont à leur droite et à leur gauche des musiciens qui chantent à tour de rôle. On campe lorsqu’arrive le moment du déjeuner.
Je voyageai pendant cinq jours en compagnie d’Alâ Almulc, et nous arrivâmes au siège de son gouvernement, c’est-à-dire à la ville de Lâhary (Larry-Bender), belle place située sur le rivage de l’océan, et près de laquelle le fleuve du Sind se jette dans la mer. Deux mers ont donc leur confluent près d’elle ; elle possède un grand port, où abordent des gens du Yémen, du Fars, etc. Aussi ses contributions sont considérables et ses revenus importants. L’émir ’Alâ Almulc, dont il a été question, m’a raconté que le revenu de cette ville se montait à soixante lacs par an. Or nous avons dit combien valait le lac. L’émir prélève là-dessus la moitié de la dixième partie.[46] C’est sur ce pied-là que le sultan confie les provinces à ses préposés ; ils en retirent pour eux-mêmes la moitié de la dîme, ou le vingtième du revenu.
Je montai un jour à cheval, en compagnie d’Alâ Almulc, et nous arrivâmes dans une plaine située à la distance de sept milles de Lâhary, et que l’on appelait Târnâ. Je vis là une quantité incalculable de pierres qui ressemblaient à des figures d’hommes et d’animaux ; beaucoup avaient subi des altérations, et les traits des objets qu’elles représentaient étaient effacés il n’y restait plus que la figure d’une tête ou d’un pied ou de quelque autre partie du corps. Parmi les pierres, il y en avait aussi qui représentaient des grains, tels que le blé, les pois chiches, les fèves, les lentilles. Il y avait là des traces d’un mur et des parois de maisons. Nous vîmes ensuite les vestiges d’une maison, où se trouvait une cellule construite en pierres de taille, au milieu de laquelle s’élevait une estrade, également en pierres taillées, avec une telle précision qu’elles paraissaient ne former qu’une seule pierre. Cette estrade supportait une figure d’homme, mais dont la tête était fort allongée, la bouche placée sur un des côtés du visage et les mains derrière le dos, comme celles d’un captif. On voyait là des flaques d’eau extrêmement puantes, et une des parois portait une inscription en caractères indiens. ’Alâ Almulc me raconta que les historiens prétendent qu’il y avait en cet endroit une ville considérable, dont les habitants, ayant commis beaucoup de désordres, furent changés en pierres, et que c’est leur roi qui figure sur l’estrade, dans la maison dont nous avons parlé ; aussi cette maison est-elle encore appelée la demeure du roi. On assure que l’inscription indienne qui se voit sur une des murailles renferme la date de la destruction des habitants de cette ville : cela est arrivé il y a mille ans ou environ.
Je passai cinq jours à Lâhary, en compagnie d’Alâ Almulc ; après quoi il me fournit généreusement des provisions de route, et je le quittai pour me rendre à la ville de Bacâr. On nomme ainsi une belle cité, que traverse un canal dérivé du fleuve Sind. Au milieu de ce canal se trouve un superbe ermitage, où l’on sert à manger aux voyageurs. Il a été construit par Cachloû Khân, pendant qu’il était gouverneur du Sind. Or il sera plus loin question de ce personnage. Je vis à Bacâr le jurisconsulte, l’imâm Sadr eddîn Alhanefy, ainsi que le kadi de la ville, nommé Abou Hanîfah. Je rencontrai à Bacâr le cheikh pieux et dévot, Chems eddîn Mohammed acchîrâzy, qui était au nombre des hommes vénérables par leur grand âge : il me dit que son âge dépassait cent vingt ans. De cette ville, je me rendis à celle d’Oûdjah (Outch), grande place située sur le fleuve Sind ; elle possède de beaux marchés et est très bien bâtie. Elle avait alors pour émir le roi distingué et noble Djélal eddîn Alkîdjy, qui figurait parmi les hommes braves et généreux. Il mourut dans cette ville, des suites d’une chute de cheval.
Une amitié se forma entre moi et ce noble roi, Djélal eddîn, et notre intimité et notre affection furent affermies. Nous nous rencontrâmes dans la capitale, Dihly. Lorsque le sultan partit pour Daoulet Abâd, ainsi que nous le raconterons, et qu’il m’ordonna de rester dans la capitale, Djélal eddîn me dit : « Tu as besoin, pour ton entretien, d’une somme considérable, et l’absence du sultan sera longue. Accepte donc ma bourgade, et perçois-en le produit jusqu’à mon retour. » C’est ce que je fis, et j’en perçus environ cinq mille dinars. Que Dieu lui accorde sa plus belle récompense !
Je vis à Oûdjah le cheikh dévot, pieux et noble, Kothb eddîn Haïder, l’alide, qui me fit revêtir le froc. C’était un des plus grands hommes de bien, et je ne cessai de garder l’habit dont il me revêtit, jusqu’à ce que les Indiens idolâtres m’eussent dépouillé sur mer.
D’Oûdjah, je me rendis à la ville de Moultân, qui est la capitale du Sind et la résidence de l’émir suprême de cette province. Sur le chemin qui y conduit, et à dix milles avant d’y arriver, se trouve le fleuve connu sous le nom de Khosrow Abâd. Il est au nombre des grands fleuves, et on ne le passe qu’en bateau. On y examine de la manière la plus sévère les marchandises des passagers et l’on fouille leurs bagages. C’était la coutume, lors de notre arrivée à Moultân, que l’on prît le quart de tout ce qu’apportaient les marchands. On percevait, pour chaque cheval, un droit de sept dinars ; mais deux années après notre arrivée dans l’Inde le sultan abolit ces taxes et ordonna que l’on n’exigeât plus des voyageurs que la dîme aumônière (deux et demi pour cent) et l’impôt du dixième. Cela eut lieu à l’époque où il prêta serment au khalife Abou’l Abbâs, l’Abbâside.
Lorsque nous commençâmes à traverser la rivière et que les bagages furent examinés, la visite de mon bagage me parut une chose pénible à supporter, car il ne renfermait rien de précieux, et cependant il paraissait considérable aux yeux du public. Il me répugnait qu’on en prît connaissance. Ce fut par la grâce de Dieu que survint un des principaux officiers de la part de Kothb Almulc, prince de Moultân. Il donna l’ordre de ne pas me soumettre à un examen ni à des recherches. Il en fut ainsi, et je remerciai Dieu des grâces qu’il avait daigné m’accorder. Nous passâmes la nuit sur le bord du fleuve, et le matin le roi du bérîd ou de la poste vint nous trouver. On l’appelait Dihkân, et il était originaire de Samarkand. C’était lui qui écrivait au sultan les nouvelles de la ville et de son district, lui annonçant ce qui y survenait et quels individus y arrivaient. Je fus questionné par lui et j’entrai en sa société chez l’émir de Moultân.
Le prince de Moultân était Kothb Almulc, un des principaux chefs et des plus distingués. Lorsque j’entrai chez lui, il se leva, me prit la main et me fit asseoir à son côté. Je lui offris un esclave, un cheval, ainsi qu’une certaine quantité de raisins secs et d’amandes. C’est un des plus grands cadeaux qu’on puisse faire aux gens de ce pays, car il ne s’en trouve pas chez eux ; seulement on en importe du Khoraçan. L’émir était assis sur une grande estrade, recouverte de tapis ; près de lui se trouvait le kadi appelé Sâlâr, et le prédicateur, dont je ne me rappelle pas le nom. Il avait, à sa droite et à sa gauche, les chefs des troupes, et les guerriers se tenaient debout derrière lui ; les troupes passaient en revue devant lui ; il y avait là un grand nombre d’arcs. Lorsqu’arrive quelqu’un qui désire être enrôlé dans l’armée en qualité d’archer, on lui donne un de ces arcs, afin qu’il le tende. Ces arcs sont plus ou moins roides, et la solde de l’archer est proportionnée à la force qu’il montre à les tendre. Pour celui qui désire être inscrit comme cavalier, il y a là une cible ; il fait courir son cheval et frappe la cible de sa lance. Il y a également un anneau suspendu à un mur peu élevé ; le cavalier pousse sa monture jusqu’à ce qu’il arrive vis-à-vis de l’anneau, et, s’il l’enlève avec sa lance, il est considéré comme un excellent homme de cheval. Pour celui qui veut être enregistré à la fois comme archer et cavalier, on place sur la terre une boule. Cet individu fait courir son cheval et vise la boule ; sa solde est proportionnée à l’habileté qu’il montre à toucher le but.
Lorsque nous fûmes entrés chez l’émir et que nous l’eûmes salué, ainsi que nous l’avons dit, il ordonna de nous loger dans une maison située hors de la ville, et appartenant aux disciples du pieux cheikh Rocn eddîn dont il a été question ci-dessus. C’est la coutume de ces gens-là de n’héberger personne, jusqu’à ce qu’ils en reçoivent l’ordre du sultan.
Je citerai : Khodhâwend Zâdeh Kiwâm eddîn, kadi de Termedh, qui arriva avec sa femme et ses enfants ; il fut ensuite rejoint à Moultân par ses frères, ’Imad eddîn, Dhiâ eddîn et Borhân eddîn ; Mobârec chah, un des principaux personnages de Samarkand ; Aroun Boghâ, un des principaux habitants de Boukhara ; Mélik Zâdeh, fils de la sœur de Khodhâwend Zâdeh ; Bedr eddîn alfassâl. Chacun de ces individus avait avec lui ses compagnons, ses serviteurs et ses adhérents.
Lorsqu’il se fut écoulé deux mois depuis notre arrivée à Moultân, un des chambellans du sultan, Chems eddîn alboûchendjy arriva, ainsi qu’AlMélik Mohammed alherawy, le cotouâl (chef de la police). Le sultan les envoyait à la rencontre de Khodhâwend Zâdeh. Ils étaient accompagnés de trois eunuques députés par Almakhdoûmah Djihân, mère du sultan, à la rencontre de la femme du susdit Khodhâwend Zâdeh. Ces gens-là apportaient des vêtements d’honneur pour les deux époux et pour leurs enfants. Ils avaient mission de fournir des provisions de route aux hôtes nouvellement arrivés. Ils vinrent me trouver tous ensemble et me demandèrent dans quel but j’étais venu. Je les informai que c’était pour me fixer au service du Seigneur du monde, c’est-à-dire le sultan, car on le désigne ainsi dans ses États. Ce prince avait ordonné qu’on ne laissât pénétrer dans l’Inde aucune personne venant du Khoraçan, à moins que ce ne fût pour y demeurer. Lorsque j’eus fait savoir à ces individus que j’arrivais dans l’intention de séjourner, ils mandèrent le kadi et les notaires, et firent écrire un engagement en mon nom et en celui de mes compagnons qui voulaient demeurer. Quelques-uns de mes camarades refusèrent de prendre cet engagement.
Nous nous préparâmes à nous mettre en route pour la capitale. Il y a entre elle et Moultân une distance de quarante journées, où l’on traverse constamment un pays habité. Le chambellan et le camarade qui avait été envoyé avec lui expédièrent les choses nécessaires pour héberger Kiwâm eddîn, et emmenèrent de Moultân environ vingt cuisiniers. Le chambellan se transportait d’avance, durant la nuit, à chaque station et faisait préparer les aliments, etc. Khodhâwend Zâdeh n’arrivait que quand le repas était prêt. Chacun des hôtes que nous avons mentionnés campait séparément dans ses tentes et avec ses compagnons. Souvent ils assistaient au repas qui était préparé pour Khodhâwend Zâdeh. Quant à moi, je n’y assistai qu’une seule fois. Voici l’ordre suivi dans ce repas : on sert d’abord le pain, qui est une espèce de gâteau et ressemble à des galettes ; on coupe la viande rôtie en grands morceaux, de sorte qu’une brebis forme quatre ou six morceaux, et l’on en place un devant chaque convive. On sert aussi des pains ronds, préparés avec du beurre et qui ressemblent au pain commun de notre pays. On met au milieu de ces pains la friandise que l’on appelle sâboûnïah, et l’on couvre chacun d’eux avec un gâteau sucré que l’on appelle khichty, mot qui signifie briqueté. Ce dernier est fait de farine, de sucre, de beurre. On sert ensuite, dans des écuelles de porcelaine, la viande accommodée au beurre, aux oignons et au gingembre vert ; puis un mets que l’on nomme samoûcec (samoûceh), et qui consiste en viande hachée, cuite avec des amandes, des noix, des pistaches, des oignons et des épices, et que l’on place dans l’intérieur d’un gâteau frit dans le beurre. On met devant chaque personne quatre ou cinq morceaux de cela. Puis on sert le riz cuit au beurre et surmonté de poulets ; puis les petites bouchées du kâdhi (espèce de gateau), que ces gens-là appellent alhâchimy ; enfin, les kâhiriyah. Le chambellan se tient debout près de la table, avant de manger ; il s’incline, en signe d’hommage, vers le côté où se trouve le sultan, et tous ceux qui sont présents pour le même objet en font autant. L’hommage, chez les Indiens, consiste à incliner la tête en avant comme pendant la prière. Lorsqu’ils ont fait cela, ils s’asseyent pour manger ; on apporte des coupes d’or, d’argent et de verre, remplies de l’eau du sucre candi, c’est-à-dire de sirop délayé dans de l’eau. On appelle cette liqueur du sorbet et on la boit avant de manger. Ensuite, le chambellan prononce ces mots : « Au nom de Dieu. » Alors on commence à manger et, lorsqu’on a fini, des cruches de bière sont apportées. Quand elles sont bues, on apporte le bétel et la noix d’arec, dont il a été question précédemment. Après qu’on a pris le bétel et la noix d’arec, le chambellan prononce les mots : « Au nom de Dieu. » On se lève, on fait une salutation semblable à la première et on s’en retourne.
Nous voyageâmes, après être partis de la ville de Moultân, notre cortège observant ce même ordre que nous venons de décrire, jusqu’à ce que nous fussions arrivés dans l’Inde proprement dite. La première ville dans laquelle nous entrâmes était celle d’Aboûher, où commencent les provinces indiennes. Elle est petite ; mais belle, et bien peuplée et pourvue de rivières et d’arbres. On ne trouve là aucun arbre de notre pays, excepté le nebek (lotus) ; mais, dans l’Inde, il est d’un volume considérable et chacun de ses fruits est aussi gros qu’une noix de galle et fort doux. Les Indiens ont beaucoup d’arbres dont aucun n’existe dans notre pays ni dans quelque autre.
Nous citerons :
Le manguier, arbre qui ressemble aux orangers, si ce n’est qu’il est plus grand et plus feuillu ; aucun autre arbre ne donne autant d’ombrage ; mais cet ombrage est malsain (littéralement, lourd) et quiconque dort sous son abri est pris de fièvre. Le fruit du manguier a la grosseur d’une grosse poire. Lorsqu’il est encore vert, avant sa parfaite maturité, on prend les fruits tombés de l’arbre, on les saupoudre de sel et on les fait confire, comme le citron doux et le limon dans notre pays. Les Indiens confisent de même le gingembre vert et le poivre en grappes ; ils mangent ces conserves avec leurs aliments, prenant après chaque bouchée un peu des ces objets salés. Lorsque la mangue est mûre, en automne, elle devient très jaune et on la mange comme une pomme. Quelques-uns la coupent avec un couteau et d’autres la sucent lentement. Ce fruit est doux, mais un peu d’acidité se mêle à sa douceur. Il a un gros noyau, que l’on sème à l’instar des pépins de l’oranger, ou d’autres fruits, et d’où proviennent les arbres.
Le checky et le berky (Jacquier, cf. Perrin, Voyage dans l’Indoustan, I, 57, 58). On donne ce nom à des arbres qui durent fort longtemps (littéralement, anciens, du temps d’Âd); leurs feuilles ressemblent à celles du noyer et leurs fruits sortent du tronc même de l’arbre. Ceux des fruits qui sont voisins de la terre forment le berky ; leur douceur est plus grande et leur goût plus agréable que ceux du cheky. Ce qui se trouve plus haut est la portion appelée cheky, dont le fruit est pareil à de grandes courges et l’écorce à une peau de bœuf. Lorsqu’il est devenu jaune, en automne, on le cueille, on le fend et l’on trouve dans chaque fruit de cent à deux cents grains ressemblant à des cornichons. Entre chaque grain, il y a une pellicule de couleur jaunâtre ; chacun a un noyau à l’instar d’une grande fève. Lorsque ce noyau est rôti ou bouilli, son goût est analogue à celui de la fève, laquelle n’existe pas dans l’Inde. On conserve ces noyaux dans une terre rougeâtre et ils durent jusqu’à l’année suivante. Le cheky et le berky sont les meilleurs fruits de l’Inde.
Le tendoû, qui est le fruit de l’ébénier ; chacun de ces fruits est aussi gros qu’un abricot, dont ils ont aussi la couleur. Ils sont extrêmement doux.
Le tchoumoûn (djambou, cf. t. II). Les arbres de cette espèce vivent fort longtemps et leur fruit ressemble à l’olive. Il est de couleur noire et n’a qu’un noyau comme l’olive.
L’orange douce, qui est très abondante chez les Indiens. Quant à l’orange acide, elle est rare. Il y a une troisième espèce d’orange, qui tient le milieu entre la douce et l’acide. Son fruit est de la grosseur du citron doux ; il est fort agréable, et je me plaisais à en manger.
Le mehwâ (bassia latifolia), arbre qui dure fort longtemps et dont les feuilles ressemblent à celles du noyer, sauf qu’elles sont mélangées de rouge et de jaune. Son fruit a la forme d’une petite poire et est fort doux. A la partie supérieure de chaque fruit se trouve un petit grain, de la grosseur d’un grain de raisin et creux ; son goût ressemble à celui du raisin, mais en manger beaucoup cause un mal de tête. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que ces grains, lorsqu’ils sont séchés au soleil, ont le goût de la figue. J’en mangeais en place de ce fruit, qui ne se rencontre pas dans l’Inde. Les Indiens appellent ces grains angoûr, mot qui, dans leur langue, a le sens de raisin (angoûr est un mot persan). Ce dernier fruit est très rare dans l’Inde,[47] et on ne l’y trouve que dans quelques endroits de Dihly, et dans d’autres localités. Le mewhâ porte des fruits deux fois dans une année, et avec ses noyaux on fabrique de l’huile dont on se sert pour l’éclairage.
Parmi les fruits des Indiens, on en distingue encore un qu’ils appellent cacîra (cacîrou, scrirpus kysoor, Rox.). On l’extrait de la terre ; il est très doux et ressemble à la châtaigne.
On trouve dans l’Inde, parmi les fruits qui croissent dans notre pays, le grenadier, qui porte des fruits deux fois l’an. J’en ai vu, dans les îles Maldives, qui ne cessaient de produire. Les Indiens l’appellent anâr, mot qui, je pense, a donné naissance à la dénomination de djulnâr, car djul (gul), en persan, signifie une fleur et anâr la grenade.
Les Indiens ensemencent la terre deux fois chaque année. Quand la pluie tombe, dans l’été, ils sèment les grains d’automne, qu’ils récoltent au bout de soixante jours. Parmi ces grains d’automne, on remarque : 1° le kudhroû, qui est une espèce de millet. C’est de tous les grains celui qui se trouve chez eux le plus abondamment. 2° Le kâl, qui ressemble à l’anly (millet). 3° Le châmâkh (panicum colonum), dont les grains sont plus petits que ceux du kâl. Souvent ce châmâkh croît sans culture. C’est la nourriture des dévots, de ceux qui font profession d’abstinence, des pauvres et des malheureux, lesquels sortent pour recueillir ceux de ces grains qui ont poussé sans culture. Chacun d’eux tient dans sa main gauche un grand panier, et dans sa droite un fouet, avec lequel il frappe les grains, qui tombent dans le panier. Ils ramassent ainsi de quoi se nourrir toute l’année. Le grain du châmâkh est fort petit. Lorsqu’on l’a recueilli, on le place au soleil, puis on le broie dans des mortiers de bois ; son écorce s’envole, et il ne reste qu’une farine blanche, avec laquelle on prépare une épaisse bouillie que l’on mélange avec du lait de buffle. Cette bouillie est plus agréable que le pain fabriqué avec la même farine ; j’en mangeais souvent, dans l’Inde, et elle me plaisait. 4° Le mâch (phaseolus max, L.), qui est une espèce de pois. 5° Le mondj (le mungo de Clusius). C’est une espèce de mâch ; mais ses grains sont allongés et sa couleur est d’un vert clair. On fait cuire le mondj avec du riz et on le mange assaisonné de beurre. C’est ce que l’on appelle kichry,[48] et c’est avec ces mets que l’on déjeune chaque jour. Il est, pour les Indiens, ce qu’est dans le Maghreb la harîrah (farine cuite avec du lait ou de la graisse). 6°Le loûbia, qui est une espèce de fève. Le moût, qui ressemble au kudhroû sauf que ses grains sont plus petits. Il fait partie, chez les Indiens, de la provende des animaux, et ceux-ci deviennent gras en le mangeant. L’orge n’a pas, chez ce peuple, de propriétés fortifiantes ; aussi la provende des bestiaux se compose-t-elle seulement de ce moût ou de pois chiches, qu’on leur fait manger, après les avoir concassés et humectés avec de l’eau. On donne aux animaux, en place de fourrage vert, des feuilles de mâch, après que l’on a fait boire du beurre fondu à la bête durant dix jours, sur le pied de trois ou quatre rathls (livres) par jour. Durant ce temps on ne monte pas sur elle. On lui donne ensuite à manger, ainsi que nous l’avons dit, des feuilles de mâch durant un mois environ.
Les grains dont nous avons fait mention sont ceux d’automne. Lorsqu’on les a moissonnés, soixante jours après les avoir semés, on fait les semailles pour le printemps. Les grains que l’on recueille en cette saison sont : le froment, l’orge, les pois chiches, les lentilles. On les sème dans la même terre où ont lieu les semailles de l’automne, car l’Inde est douée d’un sol généreux et excellent.
Quant au riz, les Indiens le sèment trois fois chaque année, et c’est un de leurs principaux grains. Ils cultivent encore le sésame et la canne à sucre, en même temps que les plantes automnales dont nous avons fait mention.
Mais revenons à notre propos. Je dirai que nous marchâmes, après être partis d’Abouher, dans une plaine d’une vaste étendue, aux extrémités de laquelle se trouvent des montagnes inaccessibles, habitées par les Indiens idolâtres, qui souvent commettent des brigandages. Les habitants de l’Inde sont pour la plupart idolâtres ; parmi eux, il y en a qui se sont soumis à payer tribut aux musulmans et demeurent dans des bourgades. Ils ont à leur tête un magistrat musulman, placé par le percepteur ou l’eunuque dans le fief duquel la bourgade se trouve comprise. D’autres sont rebelles et résistent, retranchés dans les montagnes et exerçant le brigandage.
Lorsque nous voulûmes partir de la ville d’Abouher, le gros de la troupe en sortit au commencement du jour, et j’y restai jusqu’à midi avec quelques-uns de mes compagnons ; puis nous partîmes, au nombre de vingt-deux cavaliers, les uns arabes, les autres étrangers. Quatre-vingts idolâtres à pied, plus deux cavaliers, nous assaillirent dans la plaine. Mes camarades étaient doués de courage et de fermeté ; nous résistâmes donc très vigoureusement aux assaillants, nous tuâmes un de leurs cavaliers et prîmes son cheval. Quant aux gens de pied, nous en tuâmes environ douze. Une flèche m’atteignit et une seconde atteignit mon cheval. Dieu daigna me préserver de tout mal ; car les traits lancés par les Indiens n’ont pas de force. Cependant, un de nos compagnons eut un cheval blessé ; nous l’indemnisâmes au moyen du cheval pris à l’idolâtre, et nous égorgeâmes ainsi l’animal blessé, qui fut mangé par les Turcs de notre troupe.
Nous portâmes les têtes des morts au château fort d’Abou Baqhar, et nous les y suspendîmes à la muraille. Ce fut au milieu de la nuit que nous arrivâmes au susdit château d’Abou Baqhar.
Deux jours après en être partis, nous parvînmes à la ville d’Adjoûdéhen (Adjodin), petite place appartenant au pieux cheikh Farid eddîn albedhâoûny, celui-là même que le cheikh pieux, le saint Borhân eddîn alar’adj m’avait prédit, à Alexandrie, que je rencontrerais. Cela arriva : Dieu en soit loué ! Farid eddîn a été le précepteur du roi de l’Inde, qui lui a fait cadeau de cette ville. Ce cheikh est affligé de folie (ou en butte aux tentations du diable); Dieu nous en préserve ! Il ne prend la main de personne, et n’approche même de qui que ce soit. Lorsque son vêtement a touché celui de quelqu’un, il le lave. J’entrai dans son ermitage, je le vis et je lui offris les salutations du cheikh Borhân eddîn ; il fut étonné et me dit : « Je ne suis pas digne de cela. » Je rencontrai ses deux excellents fils, savoir : 1° Mo’izz eddîn, qui était l’aîné, et qui, après la mort de son père, lui succéda dans la dignité du cheikh ; et 2° ’Alem eddîn. Je visitai le tombeau de son aïeul, le pôle, le vertueux Farid eddîn albédhâoûny,[49] qui tirait son surnom de la ville de Bédhâoûn, capitale du pays de Sanbal. Lorsque je voulus quitter Adjoûdehen, ’Alem eddîn me dit : « Il faut absolument que tu voies mon père. » Je le vis donc, dans un moment où il se trouvait sur sa terrasse. Il portait des vêtements blancs, et un gros turban garni d’un appendice qui retombait sur le côté. Il fit des vœux en ma faveur, et m’envoya du sucre ordinaire et du sucre candi.
Au moment où je revenais de voir ce cheikh, j’aperçus des gens qui couraient en toute hâte hors de notre campement, accompagnés de quelques-uns de mes camarades. Je leur demandai ce qui était arrivé ; ils m’annoncèrent qu’un Indien idolâtre était mort, qu’un brasier avait été allumé pour consumer son cadavre, et que sa femme se brûlerait en même temps que lui. Lorsque tous deux furent brûlés, mes compagnons revinrent et me racontèrent que la femme avait tenu le mort embrassé, jusqu’à ce qu’elle fût consumée avec lui. Par la suite, je voyais dans l’Inde des femmes idolâtres, toutes parées et montées sur un cheval ; la population, tant musulmane qu’idolâtre, les suivait ; les timbales et les trompettes résonnaient devant elles. Elles étaient accompagnées des brahmanes, qui sont les chefs des Indous. Lorsque cela se passe dans les États du sultan, ils demandent à ce prince la permission de brûler la femme du mort. Il leur accorde cette autorisation, et alors ils procèdent au brûlement de la veuve.
Au bout d’un certain temps, il arriva que je me trouvai dans une ville dont la plupart des habitants étaient des idolâtres. Cette ville est nommée Amdjery et son prince était un musulman de la tribu des Sâmirah du Sind. Dans son voisinage habitaient les idolâtres rebelles. Un certain jour, ils commirent des brigandages, et l’émir musulman se mit en marche pour les combattre. Ses sujets, tant musulmans qu’infidèles, marchèrent avec lui, et un combat acharné s’engagea, dans lequel périrent sept des derniers, dont trois étaient mariés ; leurs femmes convinrent entre elles de se brûler. Le brûlement de la femme, après la mort de son mari, est, chez les Indiens, un acte recommandé, mais non obligatoire. Si une veuve se brûle, les personnes de sa famille en retirent de la gloire, et sont célébrées pour leur fidélité à remplir leurs engagements. Quant à celle qui ne se livre pas aux flammes, elle revêt des habits grossiers et demeure chez ses parents, en proie à la misère et à l’abjection, à cause de son manque de fidélité ; mais on ne la force pas à se brûler.
Or donc, quand les trois femmes que nous avons mentionnées furent convenues de se brûler, elles passèrent les trois jours qui devaient précéder ce sacrifice dans les chansons, les réjouissances et les festins, comme si elles avaient voulu faire leurs adieux à ce monde. De toutes parts les autres femmes venaient les trouver. Le matin du quatrième jour, on amena à chacune de ces trois femmes un cheval, sur lequel chacune monta, toute parée et parfumée. Dans la main droite elles tenaient une noix de cocotier, avec laquelle elles jouaient ; et dans la gauche, un miroir, où elles regardaient leur figure. Les brahmanes les entouraient, et elles étaient accompagnées de leurs proches. Devant elles, on battait des timbales et l’on sonnait de la trompette et du clairon. Chacun des infidèles leur disait : « Transmettez mes salutations à mon père, ou à mon frère, ou à ma mère, ou à mon ami. » A quoi elles répondaient, en leur souriant : « Très bien. »
Je montai à cheval, avec mes compagnons, afin de voir de quelle manière ces femmes se comporteraient durant la cérémonie de leur brûlement. Nous marchâmes avec elles l’espace d’environ trois milles, et nous arrivâmes dans un endroit obscur, abondamment pourvu d’eau et d’arbres, et couvert d’un ombrage épais. Au milieu des arbres s’élevaient quatre pavillons, dans chacun desquels était une idole de pierre. Entre les pavillons se trouvait le bassin d’eau, au-dessus duquel l’ombre était extrêmement dense et les arbres fort pressés, de sorte que le soleil ne pouvait pénétrer au travers. On eût dit que ce lieu était une des vallées de l’enfer ; que Dieu nous en préserve !
Quand j’arrivai à ces tentes, les trois femmes mirent pied à terre près du bassin, s’y plongèrent, dépouillèrent les habits et les bijoux qu’elles portaient, et en firent des aumônes. On apporta à chacune d’elles une grossière étoffe de coton non façonnée, dont elles lièrent une partie sur leurs hanches et le reste sur leur tête et leurs épaules. Cependant, des feux avaient été allumés, près de ce bassin, dans un endroit déprimé, et l’on y avait répandu de l’huile de cundjut (cundjud), c’est-à-dire de sésame qui accrut l’intensité des flammes. Il y avait là environ quinze hommes, tenant dans leurs mains des fagots de bois mince. Avec eux s’en trouvaient dix autres, portant dans leurs mains de grandes planches. Les joueurs de timbales et de trompettes se tenaient debout, attendant la venue de la femme. La vue du feu était cachée par une couverture que des hommes tenaient dans leurs mains, de peur que la malheureuse ne fût effrayée en l’apercevant. Je vis une de ces femmes qui, au moment où elle arriva près de cette couverture, l’arracha violemment des mains des gens qui la soutenaient, et leur dit, en souriant, des paroles persanes dont le sens était : « Est-ce que vous m’effrayerez avec le feu ? Je sais bien que c’est du feu ; laissez-moi. » Puis elle réunit ses mains au-dessus de sa tête, comme pour saluer le feu, et elle s’y jeta elle-même. Au même instant, les timbales, les clairons et les trompettes retentirent, et les hommes lancèrent sur elle le bois qu’ils portaient dans leurs mains. D’autres placèrent des planches par-dessus la victime, de crainte qu’elle ne se remuât. Des cris s’élevèrent, et la clameur devint considérable. Lorsque je vis ce spectacle, je fus sur le point de tomber de cheval. Heureusement, mes compagnons vinrent à moi avec de l’eau, ils me lavèrent le visage, et je m’en retournai.
Les habitants de l’Inde en usent de même en ce qui touche la submersion. Beaucoup d’entre eux se noient volontairement dans le Gange, où ils se rendent en pèlerinage. On y jette les cendres des personnes qui se sont brûlées. Les Indiens prétendent qu’il sort du Paradis. Lorsque l’un d’eux arrive sur ses bords avec le dessein de s’y noyer, il dit aux personnes présentes : « Ne vous imaginez pas que je me noie à cause de quelque chose qui me soit survenue ici-bas, ou faute d’argent. Mon seul but est de m’approcher de Coçâï. » Car tel est, dans leur langue, le nom de Dieu (Krishna). Puis il se noie. Lorsqu’il est mort, les assistants le retirent de l’eau, le brûlent, et jettent ses cendres dans le même fleuve.
Mais revenons à notre premier propos. Or donc nous partîmes de la ville d’Adjoûdehen, et, après une marche de quatre jours, nous arrivâmes à la ville de Sarsaty (Saraswati), qui est une place grande et fertile en riz. Ce riz est excellent, et on en exporte à la ville impériale de Dihly. Les revenus de Sarsaty sont très considérables. Le chambellan Chems eddîn Alboûchendjy m’en a appris le chiffre ; mais je l’ai oublié.
De Sarsaty, nous nous rendîmes à la ville de Hânsy, qui est au nombre des cités les plus belles, les mieux construites et les plus peuplées. Elle est entourée d’une forte muraille dont le fondateur est, à ce que l’on prétend, un des principaux souverains idolâtres, appelé Toûrah, et touchant lequel les Indiens racontent des anecdotes et des histoires. C’est de cette ville que sont natifs Kamal eddîn Sadr Aldjihân, grand kadi de l’Inde ; son frère Kothloû khân, précepteur du sultan, et leurs deux frères Nizâm eddîn et Chems eddîn. Ce dernier s’est consacré au service de Dieu et a fixé son séjour à La Mecque, où il est mort.
Nous partîmes de Hânsy et arrivâmes, au bout de deux jours, à Maç’oud Abad, à dix milles de la résidence impériale de Dihly. Nous y passâmes trois jours. Hânsy et Maç’oud Abad appartiennent à Almélic Almo’azzham (le roi honoré), Hoûchendj, fils d’Almélic Kamal Gurg, dont il sera fait mention ci-dessous. Or le mot gurg signifie, en persan, le loup.
Le sultan de l’Inde, vers la capitale duquel nous nous dirigions, était alors absent de Dihly, et se trouvait dans le canton de Canodje, ville qui est séparée de la capitale par une distance de dix journées de marche. Mais il y avait alors à Dihly la sultane mère, appelée Almakhdoûmah Djihan. Le mot djihân, en persan, signifie la même chose que dounia en arabe (c’est-à-dire « le monde »). Le vizir du sultan, Khodjah Djihan, nommé aussi Ahmed, fils d’Ayâs, et qui était originaire de l’Asie Mineure, se trouvait également dans la capitale. Il envoya ses officiers au-devant de nous, et désigna, pour venir à la rencontre de chacun de nous en particulier, des personnages d’un rang analogue au nôtre. Parmi ceux qu’il choisit ainsi pour m’accueillir se trouvaient le cheikh Albesthâmy, le chérif Almâzenderâny, chambellan des étrangers, et le jurisconsulte ’Alâ eddîn Almoltâny, connu sous le nom de Konnarah. Cependant, il écrivit au sultan, pour lui annoncer notre arrivée, et expédia la lettre par l’addâouah, qui est la poste des courriers à pied, comme nous l’avons dit plus haut.
La lettre étant parvenue au sultan, le vizir reçut sa réponse durant les trois jours que nous passâmes à Maç’oud Abâd. Au bout de ce temps, les kadis, les docteurs et les cheikhs sortirent à notre rencontre, ainsi que plusieurs émirs. Les Indiens nomment ceux-ci Mélic « rois » ; et, dans tous les cas où les habitants de l’Égypte et d’autres contrées diraient l’émir, eux disent le roi. Le cheikh Zhahîr eddîn azzendjâny, qui jouit d’un rang élevé auprès du sultan, sortit aussi à notre rencontre.
Nous partîmes ensuite de Maç’oud Abad, et nous campâmes dans le voisinage d’une bourgade appelée Pâlem, qui appartient au seigneur, au chérif Nacir eddîn Mothahher Alaouhéry, un des commensaux du sultan, et une des personnes qui jouissent auprès de lui d’une entière faveur. Le lendemain, nous arrivâmes à la résidence impériale de Dihly, capitale de l’Inde, qui est une ville très illustre, considérable, réunissant la beauté et la force. Elle est entourée d’une muraille telle qu’on n’en connaît pas de semblable dans tout l’univers. C’est la plus grande ville de l’Inde, et même de toutes les contrées soumises à l’islamisme dans l’Orient.
Cette ville est d’une grande étendue, et possède une nombreuse population. Elle se compose actuellement de quatre villes voisines et contiguës, savoir :
1° Dihly proprement dite, qui est la vieille cité, construite par les idolâtres, et dont la conquête eut lieu l’année 584 1188 de J. C.).
2° Sîry, aussi nommée le séjour du khalifat : c’est celle que le sultan donna à Ghiâth eddîn, petit-fils du khalife abbâside Almostancir, lorsqu’il vint le trouver. C’est là qu’habitaient le sultan ’Alâ eddîn et son fils Kothb eddîn, dont nous parlerons ci-après.
3° Toghlok Abâd, ainsi appelée du nom de son fondateur, le sultan Toghlok, père du sultan de l’Inde, à la cour de qui nous nous rendions. Voici quel fut le motif pour lequel il la bâtit : un certain jour qu’il se tenait debout en présence du sultan Kothb eddîn, il lui dit : « O maître du monde, il conviendrait que tu élevasses ici une ville. » Le sultan lui répondit, par manière de plaisanterie : « Lorsque tu seras empereur, bâtis-la donc. » Il arriva, par la volonté de Dieu, que cet homme devint sultan ; il construisit alors la ville en question et l’appela de son nom.
4° Djihan pénâh (le refuge du monde), qui est destinée particulièrement à servir de demeure au sultan Mohammed chah, actuellement roi de l’Inde, et que nous venions trouver. C’est lui qui la bâtit ; il avait eu l’intention de relier entre elles ces quatre villes par un seul et même mur ; il en édifia une partie, et renonça à élever le reste, à cause des grandes dépenses qu’aurait exigées sa construction.
Le mur qui entoure la ville de Dihly n’a pas son pareil. Il a onze coudées de largeur, et l’on y a pratiqué des chambres où demeurent des gardes de nuit et les personnes préposées à la surveillance des portes. Il se trouve aussi dans ces chambres des magasins de vivres que l’on appelle anbâr « greniers », des magasins pour les munitions de guerre, et d’autres consacrés à la garde des mangonneaux et des ra’âdâh (littéral. « tonnante » ; nom d’une machine employée dans les sièges). Les grains s’y conservent pendant longtemps sans altération et sans être exposés au moindre dégât. J’ai vu du riz que l’on retirait d’un de ces magasins ; la couleur en était devenue très noire ; mais il avait un goût agréable. J’ai vu aussi du millet que l’on retirait de cet endroit. Toutes ces provisions avaient été amassées par le sultan Balaban, quatre-vingt-dix ans auparavant. Les cavaliers et les fantassins peuvent marcher, à l’intérieur de ce mur, d’un bout de la ville à l’autre. On y a percé des fenêtres qui ouvrent du côté de la ville, et par lesquelles pénètre la lumière. La partie inférieure de cette muraille est construite en pierre, et la partie supérieure en briques. Les tours sont en grand nombre et très rapprochées l’une de l’autre.
La ville de Dihly à vingt-huit portes, ou comme les appellent les Indiens, derwâzehs. Parmi ces portes, on distingue : 1° celle de Bedhâoun, qui est la principale ; 2° celle de Mindawy, où se trouve le marché aux grains[50] ; 3° celle de Djoul, près de laquelle sont situés les vergers ; 4° celle de Chah, le Roi, ainsi appelée d’après un individu de ce nom ; 5° celle de Pâlem, nom par lequel on désigne une bourgade dont nous avons déjà parlé ; 6° celle de Nedjîb, qui doit son nom à un personnage ainsi appelé ; 7° celle de Kamal, qui se trouve dans le même cas ; 8° celle de Ghazna, ainsi nommée d’après la ville de Ghazna, située sur la frontière du Khoraçan : c’est en dehors de cette porte que sont situés le lieu où l’on célèbre la prière de la Rupture du jeûne, et plusieurs des cimetières ; 9° la porte d’Albedjâliçah,[51] l’extérieur de laquelle s’étendent les cimetières de Dihly. C’est là le nom d’un beau cimetière, où l’on construit des chapelles funéraires. Il y a inévitablement près de chaque tombeau un mihrâb, lors même que ce sépulcre est privé de chapelle funéraire. On plante dans ces cimetières des arbustes à fleurs, tels que la tubéreuse, le reïboûl (jasminum zambac?), l’églantier, etc. Dans ce pays-là, il ne cesse pas d’y avoir des fleurs, dans quelque saison que ce soit.
La mosquée principale de Dihly est d’une grande étendue : ses murailles, son toit et son pavé sont en pierres blanches très admirablement taillées et très artistement reliées entre elles avec du plomb. Il n’entre pas dans sa construction une seule planche. Elle a treize dômes de pierre, et sa chaire est aussi bâtie en pierre ; elle a quatre cours. C’est au milieu de la mosquée que l’on voit une énorme colonne fabriquée avec un métal inconnu. Un des savants indiens m’a dit qu’elle s’appelle Heft-djoûch, c’est-à-dire « les sept métaux », et qu’elle est composée d’autant de métaux différents. On a poli cette colonne sur une étendue égale à la longueur de l’index, et cet endroit poli brille d’un grand éclat. Le fer ne laisse aucune trace sur cette colonne. Sa longueur est de trente coudées ; nous enroulâmes autour d’elle la toile d’un turban, et la portion de cette toile qui en fait le tour était de huit coudées.
Près de la porte orientale de la mosquée, il y a deux très grandes idoles de cuivre, étendues à terre, et réunies ensemble par des pierres. Tout individu qui entre dans la mosquée ou qui en sort les foule aux pieds. L’emplacement de cette mosquée était un boudkhânah, c’est-à-dire un temple d’idoles ; mais, après la conquête de Dihly, il fut converti en mosquée. Dans la cour septentrionale de la mosquée se trouve le minaret, qui n’a pas son pareil dans toutes les contrées musulmanes. Il est construit en pierres rouges, à la différence de celles qui composent le reste de l’édifice, lesquelles sont blanches ; de plus, les premières sont sculptées. Ce minaret est fort élevé ; la flèche qui le termine est en marbre blanc de lait, et ses pommes sont d’or pur. L’entrée en est si large que les éléphants peuvent y monter. Quelqu’un en qui j’ai confiance m’a raconté avoir vu, à l’époque de la construction de ce minaret, un éléphant qui grimpait jusqu’en haut avec des pierres. C’est l’ouvrage du sultan Mo’izz eddîn, fils de Nacir eddîn, fils du sultan Ghiâth eddîn Balaban. Le sultan Kothb eddîn voulut bâtir, dans la cour occidentale, un minaret encore plus grand ; il en construisit environ le tiers, et mourut avant de l’avoir achevé. Le sultan Mohammed se proposa de le terminer ; mais il renonça à ce dessein, comme étant de mauvais augure. Le minaret en question est une des merveilles du monde, par sa grandeur et la largeur de son escalier, qui est telle que trois éléphants y montent de front. Le tiers qui en a été bâti égale en hauteur la totalité du minaret que nous avons dit être placé dans la cour du nord. J’y montai un jour et j’aperçus la plupart des maisons de la ville, et je trouvai les murailles de celle-ci bien basses, malgré toute leur élévation. Les hommes placés au bas du minaret ne me paraissaient que des petits enfants. Il semble, à quiconque le considère d’en bas, que sa hauteur ne soit pas si considérable, à cause de la grandeur de sa masse et de sa largeur.
Le sultan Kothb eddîn avait formé aussi le projet de bâtir une mosquée cathédrale à Sîry, surnommé le séjour du khalifat ; mais il n’en termina que le mur faisant face à La Mecque et le mihrâb. Cette portion est construite en pierres blanches, noires, rouges et vertes ; et, si l’édifice avait été achevé, il n’aurait pas eu son pareil dans le monde. Le sultan Mohammed se proposa de le finir, et envoya des gens versés dans l’art de bâtir, afin qu’ils évaluassent à combien s’élèverait la dépense. Ils prétendirent qu’on dépenserait, pour son achèvement, trente-cinq lacs. Le sultan y renonça, trouvant cette dépense trop considérable. Un de ses familiers m’a raconté qu’il ne se désista pas de son projet pour ce motif-là, mais qu’il en regarda l’exécution comme de mauvais augure, vu que le sultan Kothb eddîn avait été tué avant de terminer cet édifice.
En dehors de cette ville se voit le grand bassin appelé du nom du sultan Chems eddîn Lalmich (Altmich), et où les habitants de Dihly s’approvisionnent d’eau à boire. Il est situé dans le voisinage du lieu où se fait la prière des grandes fêtes (moçallâ). Il est alimenté par l’eau des pluies ; sa longueur est d’environ deux milles, et sa largeur moindre de moitié. Sa face occidentale, du côté du moçallâ, est construite en pierres disposées en forme d’estrades, les unes plus hautes que les autres ; au-dessous de chacune sont des degrés, à l’aide desquels on descend jusqu’à l’eau. A côté de chaque estrade est un dôme de pierre, où se trouvent des sièges pour les gens qui veulent se divertir et s’amuser. Au milieu de l’étang s’élève un grand dôme en pierres sculptées et haut de deux étages. Lorsque l’eau est abondante dans le bassin, on ne peut atteindre cet édifice, si ce n’est avec des barques. Quand, au contraire, il y a peu d’eau, les gens y entrent. A l’intérieur est une mosquée, et la plupart du temps on y trouve des fakirs voués au service de Dieu et qui ne mettent leur confiance qu’en lui. Lorsque l’eau est tarie dans cet étang, on y cultive des cannes à sucre, des citrouilles, des concombres, des pastèques et des melons. Ces derniers sont extrêmement doux, mais d’un petit volume.
Entre Dihly et le séjour de khalifat se trouve le bassin impérial, lequel est plus grand que celui du sultan Chems eddîn. Sur ses côtés s’élèvent environ quarante dômes ; les joueurs d’instruments habitent tout autour, et l’emplacement qu’ils occupent s’appelle Tharb-Abad, « le séjour de l’allégresse ». Ils ont là un marché qui est un des plus grands qui existent, une mosquée cathédrale et un grand nombre d’autres mosquées. On m’a raconté que, durant le mois de ramadhan, les chanteuses qui habitent en cet endroit récitent en commun, dans ces mosquées, la prière dite térâwîh. Des imâms président à cette prière, et elles y assistent en grand nombre. Les chanteurs en usent de même. J’ai vu les musiciens à la noce de l’émir Seïf eddîn Ghadâ, fils de Mohanna ; chacun d’eux avait sous ses genoux un tapis à prier, et quand il entendait l’appel à la prière, il se levait, faisait ses ablutions et priait.
On remarque parmi ces endroits :
1° Le tombeau du pieux cheikh Kothb eddîn Bakhtiar Alca’ky, Ce tombeau est l’objet de bénédictions manifestes, et jouit d’une grande vénération. Le motif pour lequel ce cheikh fut surnommé Alca’ky, c’est que, quand des gens chargés de dettes venaient le trouver pour se plaindre de leur pauvreté ou de leur indigence, ou quand avaient recours à lui des individus ayant des filles et ne pouvant trouver de quoi leur fournir un trousseau au moment de les faire conduire près de leurs époux, le cheikh donnait à ceux qui s’adressaient à lui un biscuit d’or ou d’argent : c’est pourquoi il fut connu par le surnom d’Alca’ky, ou l’Homme aux biscuits.
2° Le mausolée du vertueux docteur Nour eddîn Alcorlâny.
3° Le sépulcre du docteur ’Al eddîn Alkermâny, ainsi appelé d’après la province de Kermân. Ce tombeau jouit de bénédictions manifestes et brille de la plus vive lumière. L’endroit qu’il occupe indique la kiblah, ou la direction du lieu de la prière, et il s’y trouve un grand nombre de sépultures de saints personnages. Que Dieu nous fasse profiter de leurs mérites.
Nous citerons parmi eux :
1° Le cheikh pieux et savant Mahmoud Alcobbâ (le bossu) il est au nombre des principaux saints, et le vulgaire prétend qu’il dispose de richesses surnaturelles, car il n’en possède point d’apparentes, et cependant il donne à manger à tout-venant, et distribue de l’or, de l’argent et des habits. Il a accompli de nombreux miracles, et s’est ainsi rendu célèbre. Je l’ai vu à plusieurs reprises, et j’ai eu part à ses bénédictions.
2° Le cheikh pieux et savant ’Alâ eddîn Annîly. On dirait que ce surnom lui vient du nom du Nil, le fleuve de l’Égypte. Dieu sait le mieux ce qu’il en est. (Nîly peut signifier aussi « le marchand d’indigo » ou désigner une personne originaire d’Annîl, petite ville de l’Irak au-dessous de Hillah). Il a été un des disciples du cheikh savant et vertueux Nizâm eddîn Albédhâoûny. Il prêche les fidèles tous les vendredis, et un grand nombre d’entre eux font pénitence en sa présence, rasent leur tête, se lamentent à l’envi les uns des autres, et quelques-uns même s’évanouissent.
Je l’ai vu un certain jour pendant qu’il prêchait. Le lecteur du Coran lut, en sa présence, ces versets : « O hommes, craignez votre Seigneur. Certes, que le tremblement de terre, à l’heure de la résurrection, sera quelque chose de terrible ? Le jour où vous le verrez, chaque nourrice oubliera son nourrisson, et chaque femme enceinte avortera. On verra les hommes ivres. Non, ils ne seront pas ivres ; mais le châtiment infligé par Dieu est terrible ; il les étourdira. (Coran, xxii, v. 1 et 2) » Le docteur ’Alâ eddîn répéta ces paroles, et un fakir, placé dans un des coins de la mosquée, poussa un grand cri. Le cheikh répéta le verset ; le fakir cria une seconde fois et tomba mort. Je fus au nombre de ceux qui prièrent sur son corps et qui assistèrent à ses obsèques.
3° Le cheikh pieux et savant Sadr eddîn Alcohrâny, qui jeûnait continuellement, et restait debout durant la nuit ; il avait renoncé à tous les biens de ce monde, et les avait repoussés loin de lui. Son vêtement consistait en un manteau court sans manches. Le sultan et les grands de l’État le visitaient, mais souvent il se dérobait à leurs visites. Le sultan désira lui constituer en fief des villages, avec le revenu desquels il pût donner à manger aux pauvres et aux étrangers ; mais il refusa. Dans une des visites qu’il lui fit, l’empereur lui apporta dix mille dinars, qu’il n’accepta pas. On raconte qu’il ne rompt le jeûne qu’au bout de trois jours ; qu’on lui fit des représentations à ce sujet, et qu’il répondit : « Je ne romprai le jeûne que quand j’y serai forcé par une mort imminente. »
4° L’imâm pieux, savant et dévot, tempérant, humble, la perle de son époque, la merveille de son siècle, Kamal eddîn ’Abd Allah Alghâry, ainsi surnommé d’après une caverne (ghâr) qu’il habitait proche de Dihly, dans le voisinage de la zaouïa du cheikh Nizâm eddîn Albédhâouny. Je l’ai visité à trois différentes reprises dans cette caverne.
J’avais un jeune esclave qui s’enfuit et que je retrouvai en la possession d’un Turc. Je résolus de le retirer des mains de celui-ci ; mais le cheikh me dit : « Cet esclave ne te convient point ; ne le reprends pas. » Or le Turc était disposé à un accommodement. Je m’arrangeai avec lui, moyennant cent dinars qu’il me paya, et je lui laissai l’esclave. Six mois s’étant écoulés, ce dernier tua son maître. On l’amena au sultan, qui prescrivit de le livrer aux enfants de la victime, lesquels le massacrèrent. Lorsque j’eus été témoin de ce miracle de la part du cheikh, je me retirais près de lui, et me consacrai à son service, renonçant au monde, et donnant tout ce que je possédais aux pauvres et aux malheureux. Je séjournai près de lui un certain temps, et je le voyais jeûner dix et vingt jours de suite, et rester debout la plus grande partie de la nuit. Je ne cessai de demeurer avec lui, jusqu’à ce que le sultan m’envoyât chercher. Je me rattachai alors au monde (Puisse Dieu m’accorder une bonne fin !) Si Dieu le veut, je raconterai cela par la suite, ainsi que les détails de mon retour au siècle.
Le jurisconsulte, l’imâm très savant, le grand kadi de l’Inde et du Sind, Kamal eddîn Mohammed, fils de Borhân eddîn, de Ghazna, surnommé Sadr Aldjihân, m’a raconté que la ville de Dihly fut conquise sur les infidèles dans l’année 584 (1188). J’ai lu cette même date écrite sur le mihrâb de la grande mosquée de cette ville.
Le personnage déjà nommé m’a appris aussi que Dihly fut prise par l’émir Kothb eddîn Aïbec, qui était surnommé Sipâh Sâlâr, ce qui signifie général des armées. C’était un des esclaves du sultan vénéré Schihâb eddîn Mohammed, fils de Sâm le Ghouride, roi de Ghazna et du Khoraçan et qui s’était emparé du royaume d’Ibrahim, fils (lisez petit-fils) du sultan belliqueux Mahmoud ibn Sébuktéguin, lequel commença la conquête de l’Inde.
Le susdit sultan Schihâb eddîn avait envoyé l’émir Kothb eddîn avec une armée considérable. Dieu lui ouvrit la ville de Lahaour (Lahore), où il fixa sa résidence. Son pouvoir devint considérable ; il fut calomnié près du sultan, et les familiers de ce prince lui inspirèrent l’idée qu’il voulait se déclarer souverain de l’Inde, et qu’il était déjà en pleine révolte. Cette nouvelle parvint à Kothb eddîn ; il partit en toute hâte, arriva de nuit à Ghazna, et se présenta devant le sultan, à l’insu de ceux qui l’avaient dénoncé à ce monarque. Le lendemain, Schihâb eddîn s’assit sur son trône, et fit asseoir en dessous Aïbec, de sorte qu’il ne fut pas visible. Les commensaux et les courtisans qui l’avaient calomnié arrivèrent, et lorsqu’ils eurent tous pris place le sultan les questionna touchant Aïbec. Ils lui répétèrent que ce général s’était révolté, et dirent : « Nous savons avec certitude qu’il prétend à la royauté. » Alors le sultan frappa de son pied le trône, battit des mains et s’écria : « O Aïbec ! » « Me voici », répondit celui-ci, et il se montra à ses dénonciateurs. Ceux-ci furent confondus, et, dans leur effroi, ils s’empressèrent de baiser la terre. Le sultan leur dit : « Je vous pardonne cette faute ; mais prenez garde de recommencer à parler contre Aïbec. » Puis il ordonna à celui-ci de retourner dans l’Inde. Aïbec obéit, et prit la ville de Dihly et d’autres encore. La religion musulmane a été florissante dans ce pays-là jusqu’à présent. Quant à Kothb eddîn, il y séjourna jusqu’à ce qu’il mourût.
Ce prince fut le premier qui régna dans la ville de Dihly avec un pouvoir indépendant. Avant son avènement au trône, il avait été l’esclave de l’émir Kothb eddîn Aïbec, le général de son armée et son lieutenant. Quand Kothb eddîn fut mort, il se rendit maître de l’autorité souveraine, et convoqua la population, afin qu’elle lui prêtât serment. Les jurisconsultes vinrent le trouver, ayant à leur tête le grand kadi alors en fonctions, Wedjîh eddîn Alcâçâny. Ils entrèrent dans la pièce où il était et s’assirent devant lui. Quant au kadi, il s’assit à son côté, selon la coutume. Le sultan comprit de quoi ils voulaient l’entretenir ; il souleva le coin du tapis sur lequel il était accroupi, et leur présenta un acte qui comprenait son affranchissement. Le kadi et les jurisconsultes le lurent et prêtèrent tous à Lalmich le serment d’obéissance ; il devint donc souverain absolu, et son règne dura vingt ans. Il était juste, pieux et vertueux. Parmi ses actions mémorables, il convient de citer son zèle à redresser les torts et à rendre justice aux opprimés. Il ordonna que quiconque avait éprouvé une injustice revêtît un habit de couleur. Or tous les habitants de l’Inde portent des vêtements blancs. Toutes les fois qu’il donnait audience à ses sujets ou qu’il se promenait à cheval, s’il voyait quelqu’un vêtu d’un habit de couleur, il examinait sa plainte, et s’occupait à lui rendre justice contre son oppresseur. Mais il se lassa d’agir ainsi, et se dit : « Quelques hommes souffrent des injustices pendant la nuit ; je veux en hâter le redressement. » En conséquence, il éleva à la porte de son palais deux lions de marbre, placés sur deux tours qui se trouvaient en cet endroit. Ces lions avaient au cou une chaîne de fer où pendait une grosse sonnette. L’homme opprimé venait de nuit et agitait la sonnette ; le sultan entendait le bruit, examinait l’affaire sur-le-champ et donnait satisfaction au plaignant.
A sa mort, le sultan Chems eddîn laissa trois fils : Rocn eddîn, qui lui succéda ; Mo’izz eddîn et Nacir eddîn ; et une fille appelée Radhiyah, laquelle était sœur germaine de Mo’izz eddîn. Rocn eddîn régna après lui, ainsi que nous l’avons dit.
Lorsque Rocn eddîn eut été reconnu sultan, après la mort de son père, il inaugura son règne par un traitement injuste envers son frère Mo’izz eddîn, qu’il fit périr. Radhiyah était sœur germaine de ce malheureux prince, et elle reprocha sa mort à Rocn eddîn. Celui-ci médita de l’assassiner. Un certain vendredi, il sortit du palais pour assister à la prière. Radhiyah monta sur la terrasse du vieux palais attenant à la grande mosquée, et que l’on appelait Daoulet-Khâneh, « la maison du bonheur ». Elle était revêtue des habits que portaient ceux qui avaient éprouvé des injustices.
Dans ce costume, elle se présenta au peuple, et lui parla de dessus la terrasse. « Mon frère, lui dit-elle, a tué son frère, et veut aussi me faire périr. » Puis elle rappela le règne de son père et les bienfaits qu’il avait prodigués au peuple. Là-dessus, les assistants se portèrent en tumulte vers le sultan Rocn eddîn, qui se trouvait alors dans la mosquée, se saisirent de lui, et l’amenèrent à Radhiyah. Celle-ci leur dit : « Le meurtrier sera tué » ; et ils le massacrèrent, en représailles du meurtre de son frère. Le frère de ces deux princes, Nacir eddîn, était encore dans l’enfance : aussi le peuple s’accorda-t-il à reconnaître comme souveraine Radhiyah.
Lorsque Rocn eddîn eut été tué, les troupes convinrent de placer sur le trône sa sœur Radhiyah. Elles la proclamèrent souveraine ; et cette princesse régna avec une autorité absolue, durant quatre années. Elle montait à cheval à la manière des hommes, armée d’un arc et d’un carquois, entourée de courtisans, et elle ne voilait pas son visage. Dans la suite, elle fut soupçonnée d’avoir commerce avec un des ses esclaves, abyssin de naissance, et le peuple décida de la déposer et de lui donner un époux. En conséquence, elle fut déposée et mariée à un de ses proches, et son frère Nacir eddîn devint maître de l’autorité.
Après la déposition de Radhiyah, son frère cadet Nacir eddîn monta sur le trône et posséda quelque temps l’autorité souveraine ; ensuite, Radhiyah et son mari se révoltèrent contre lui, montèrent à cheval, accompagnés de leurs esclaves et des malfaiteurs qui voulurent les suivre, et se préparèrent à le combattre. Nacir eddîn sortit de Dihly avec son esclave et lieutenant Ghiâth eddîn Balaban, celui-là même qui devint maître du royaume après lui. Le combat s’engagea, l’armée de Radhiyah fut mise en déroute, et elle-même prit la fuite ; elle fut surprise par la faim et accablée de fatigue ; en conséquence, elle se dirigea vers un laboureur qu’elle vit occupé à cultiver la terre, et lui demanda quelque chose à manger. Il lui donna un morceau de pain, qu’elle dévora, après quoi le sommeil s’empara d’elle. Or Radhiyah était revêtue d’un habit d’homme ; lorsqu’elle fut endormie, le laboureur la considéra, et vit, sous ses vêtements, une tunique brodée d’or et de perles ; il s’aperçut que c’était une femme, la tua, la dépouilla, chassa son cheval, et l’ensevelit dans le champ qui lui appartenait. Puis il prit une partie des vêtements de la princesse, et se rendit au marché, afin de les vendre. Les marchands conçurent des soupçons à son égard, et l’amenèrent au chihneh, c’est-à-dire au magistrat de police, qui lui fit infliger la bastonnade. Le misérable confessa qu’il avait tué Radhiyah et indiqua à ses gardiens le lieu où il l’avait ensevelie. Ils déterrèrent son corps, le lavèrent et l’enveloppèrent dans un linceul ; puis il fut remis en terre au même endroit, et l’on construisit une chapelle funéraire. Son tombeau est actuellement visité par des pèlerins, et regardé comme un lieu de sanctification. Il est situé sur le bord du grand fleuve appelé Djoûn (la Yamouna ou Djomna), une parasange de la ville de Dihly.
Après le meurtre de sa sœur, Nacir eddîn resta seul maître du royaume, et régna paisiblement durant vingt ans. C’était un souverain pieux ; il copiait des exemplaires du livre illustre (le Coran), les vendait, et se nourrissait avec le prix qu’il en retirait. Le kadi Kamal eddîn m’a fait voir un Coran copié de sa main, artistement et élégamment écrit. Dans la suite, son lieutenant Ghiâth eddîn Balaban le tua et régna après lui. Ce Balaban eut une aventure extraordinaire que nous raconterons.
Lorsque Balaban eut tué son maître, le sultan Nacir eddîn, il régna, avec un pouvoir absolu, pendant vingt années, avant lesquelles il avait été le lieutenant de son prédécesseur durant un pareil espace de temps. Il fut au nombre des meilleurs sultans, juste, doux et vertueux. Une de ses actions généreuses, c’est qu’il fit bâtir une maison à laquelle il donna le nom de Séjour de la sûreté. Tous les débiteurs qui y entraient voyaient acquitter leur dette, et quiconque s’y réfugiait par crainte y était en sûreté. Si quelqu’un s’y retirait après avoir tué une autre personne, le sultan désintéressait à sa place les amis du mort ; et si c’était quelque délinquant, il donnait satisfaction à ceux qui le poursuivaient. C’est dans cette maison qu’il fut enseveli, et j’y ai visité son tombeau.
On raconte qu’un fakir de Boukhara y vit ce Balaban, qui était de petite taille et d’un extérieur chétif et méprisable. Il lui dit : « O petit Turc ! », ce qui était une expression indiquant du mépris. Balaban répondit : « Me voici, ô mon maître. » Cette parole plut au fakir. « Achète pour moi, reprit-il, de ces grenades », et il lui montrait des grenades qui étaient exposées en vente sur le marché. « Très bien », répliqua Balaban ; et tirant quelques oboles, qui étaient tout ce qu’il possédait, il acheta plusieurs de ces grenades. Lorsque le fakir les eut reçues, il lui dit : « Nous te donnerons le royaume de l’Inde. » Balaban baisa sa propre main (c’est là une manière de saluer) et répondit : « J’accepte et je suis content. » Cette parole se fixa dans son esprit. Cependant, il arriva que le sultan Chems eddîn Lalmich envoya un marchand, afin qu’il lui achetât des esclaves à Samarkand, à Boukhara et à Termedh. Cet individu fit l’acquisition de cent esclaves, parmi lesquels se trouvait Balaban. Lorsqu’il se présenta avec eux devant le sultan, tous plurent à ce prince, hormis Balaban, à cause de ce que nous avons dit de son extérieur méprisable. « Je n’accepte pas celui-ci », s’écria-t-il. L’esclave lui dit : « O maître du monde, pour qui as-tu acheté ces serviteurs ? » L’empereur se mit à rire et répondit : « Je les ai achetés pour moi-même. » Balaban reprit : « Achète-moi pour l’amour de Dieu. — Très bien », répliqua le sultan ; il l’accepta, et le mit au nombre de ses esclaves.
Balaban fut traité avec mépris et placé parmi les porteurs d’eau. Les gens versés dans la connaissance de l’astrologie disaient au sultan Chems eddîn : « Un de tes esclaves enlèvera le royaume à ton fils et s’en emparera. » Ils ne cessaient de lui répéter cela ; mais il ne faisait pas attention à leurs discours, à cause de sa piété et de sa justice. Enfin on rapporta cette prédiction à la grande princesse, mère des enfants du sultan, et elle la lui répéta. Cela fit alors impression sur son esprit ; il manda les astrologues et leur dit : « Reconnaîtrez-vous, lorsque vous le verrez, l’esclave qui doit enlever le royaume à mon fils ? » Ils répondirent : « Oui, nous avons un indice qui nous le fera connaître. » Le sultan ordonna de faire paraître ses esclaves, et s’assit pour les passer en revue. Ils parurent devant lui, classe par classe ; les astrologues les regardaient et disaient : « Nous ne le voyons pas encore. » Cependant, une heure de l’après-midi arriva, et les porteurs d’eau se dirent les uns aux autres : « Nous avons faim ; rassemblons quelques pièces de monnaie, et envoyons un de nous au marché afin qu’il nous achète de quoi manger. » Ils réunirent donc des drachmes, et firent partir avec elles Balaban ; car il n’y avait parmi eux personne qui fût méprisé plus que lui. Il ne trouva pas dans le marché ce que voulaient ses camarades ; en conséquence, il se dirigea vers un autre marché ; mais il tarda, et lorsque ce fut le tour des porteurs d’eau d’être passés en revue, il n’était pas encore revenu. Ses camarades prirent son outre et son pot à l’eau, les placèrent sur l’épaule d’un jeune garçon, et présentèrent celui-ci comme si c’était Balaban. Lorsqu’on appela le nom de Balaban, le jeune garçon passa devant les astrologues, et la revue fut terminée sans qu’ils vissent la figure qu’ils cherchaient. Balaban arriva après l’achèvement de la revue, car Dieu voulait que son destin s’accomplît.
Par la suite, les nobles qualités de l’esclave se révélèrent, et il fut fait chef des porteurs d’eau ; puis il entra dans l’armée, et devint ensuite émir. Le sultan Nacir eddîn, avant de parvenir au trône, épousa sa fille, et lorsqu’il fut devenu maître du royaume, il le fit son lieutenant. Balaban remplit les fonctions de cette charge pendant vingt années ; après quoi, il tua son souverain et demeura maître de l’empire durant vingt autres années, ainsi qu’il a été dit plus haut. Il eut deux fils, dont l’un était le khân martyr, son successeur désigné et vice-roi dans le Sind, où il résidait dans la ville de Moultân. Il fut tué dans une guerre qu’il eut à soutenir contre les Tatars, et laissa deux fils, Keï Kobâd et Keï Khosrow. Le second fils du sultan Balaban était appelé Nacir eddîn et était vice-roi pour son père dans les provinces de Lacnaouty (Gour, l’ancienne capitale du Bengale) et de Bengale.
Lorsque le khân martyr eut succombé pour la foi, le sultan Balaban déclara héritier du trône le fils du défunt, Keï Khosrow, et le préféra à son propre fils Nacir eddîn. Celui-ci avait lui-même un fils qui habitait à Dihly, près de son aïeul, et qui était appelé Mo’izz eddîn. C’est ce dernier qui, après la mort de son aïeul, et, du vivant même de son père, devint maître du trône, avec des circonstances extraordinaires, que nous raconterons.
Le sultan Ghiâth eddîn mourut durant la nuit, tandis que son fils Nacir eddîn se trouvait dans la province de Lacnaouty, et après avoir déclaré pour son successeur son petit-fils Keï Khosrow, ainsi que nous l’avons raconté. Or le chef des émirs, lieutenant du sultan Ghiâth eddîn, était l’ennemi du jeune prince, et il machina contre celui-ci une ruse qui lui réussit. En effet, il écrivit un acte dans lequel il contrefit l’écriture des principaux émirs, leur faisant attester qu’ils avaient prêté serment d’obéissance à Mo’izz eddîn, petit-fils du sultan Balaban ; puis il se présenta devant Keï Khosrow, comme s’il avait été plein de sincérité envers lui, et lui dit : « Les émirs ont prêté serment à ton cousin, et je crains pour toi leurs mauvais desseins. » Keï Khosrow lui répondit : « Quel remède y a-t-il ? — Sauver ta vie en fuyant dans le Sind », reprit le chef des émirs. « Mais comment sortir de la ville, repartit le jeune prince, puisque les portes sont fermées ? — Les clefs sont entre mes mains, répliqua l’émir, et je t’ouvrirai. » Keï Khosrow le remercia de cette promesse et lui baisa la main. « A présent, monte à cheval », lui dit l’émir. En conséquence, le jeune prince monta à cheval, accompagné de ses familiers et de ses esclaves ; le grand émir lui ouvrit la porte, le fit sortir, et la ferma aussitôt après qu’il eût quitté Dihly.
Alors il demanda à être admis près de Mo’izz eddîn et lui prêta serment. Mo’izz lui dit : « Comment pourrais-je être le sultan, puisque le titre d’héritier présomptif appartient à mon cousin ? » Le chef des émirs lui fit connaître la ruse qu’il avait machinée contre celui-ci, et le moyen par lequel il l’avait fait sortir de la ville. Mo’izz eddîn le remercia de sa conduite, se rendit avec lui au palais du roi, et manda les émirs et les courtisans, qui lui prêtèrent serment durant la nuit. Le matin étant arrivé, le reste de la population fit de même, et le pouvoir de Mo’izz eddîn fut parfaitement affermi. Son père était encore en vie, et se trouvait dans le pays de Bengale et de Lacnaouty. La nouvelle de ce qui s’était passé lui étant parvenue, il dit : « Je suis l’héritier du royaume ; comment donc mon fils en deviendrait-il maître et le posséderait-il avec une autorité absolue, tandis que je suis encore vivant ? » Il se mit en marche avec ses troupes, se dirigeant vers la capitale de Dihly ; son fils se mit aussi en campagne, à la tête de son armée, dans le dessein de le repousser de cette ville. Ils se rencontrèrent près de la ville de Carâ (Corrah), située sur le rivage du fleuve Gange, celui-là même où les Indiens vont en pèlerinage. Nacir eddîn campa sur la rive, du côté qui touche Carâ, et son fils, le sultan Mo’izz eddîn, campa sur le côté opposé, de sorte que le fleuve se trouvait entre eux. Ils résolurent de combattre l’un contre l’autre ; mais Dieu voulut épargner le sang des musulmans et répandit dans le cour de Nacir eddîn des sentiments de miséricorde envers son fils. En conséquence, il se dit en lui-même : « Lorsque mon fils régnera, ce sera un honneur pour moi ; il est donc plus juste que je désire cela. » En même temps, Dieu jeta dans le cœur du sultan Mo’izz eddîn des sentiments de soumission envers son père. Chacun des deux princes monta sur un bateau, sans être accompagné de ses troupes, et ils se rencontrèrent au milieu du fleuve. Le sultan baisa le pied de son père, et lui fit des excuses. Celui-ci lui dit : « Je te donne mon royaume et je t’en confie le gouvernement. » Là-dessus il lui prêta serment de fidélité, et voulut s’en retourner dans les provinces qu’il possédait ; mais son fils lui dit : « Il faut absolument que tu viennes dans mes États. » Le père et le fils se dirigèrent ensemble vers Dihly et entrèrent dans le palais ; le premier fit asseoir Mo’izz eddîn sur le trône et se tint debout devant lui. L’entrevue qui avait eu lieu entre eux sur le fleuve fut appelée la rencontre (conjonction) des deux astres heureux, à cause des résultats qu’elle eut, en épargnant le sang (des sujets), en faisant que le père et le fils s’offrissent l’un à l’autre le royaume et qu’ils s’abstinssent de combattre. Les poètes célébrèrent en foule cet événement.
Nacir eddîn retourna dans ses États et y mourut, au bout de quelques années, y laissant plusieurs enfants, parmi lesquels Ghiâth eddîn Behadour, le même que le sultan Toghlok fit prisonnier, et que son fils Mohammed relâcha après sa mort. Cependant, la royauté resta encore en la possession paisible de Mo’izz eddîn durant quatre années, qui furent semblables à des jours de fête. J’ai entendu une personne qui avait vécu de ce temps-là en décrire les félicités, le bon marché des denrées à cette époque, la libéralité et la munificence de Mo’izz eddîn. Ce fut ce prince qui construisit le minaret de la cour septentrionale de la grande mosquée de Dihly, lequel n’a pas son pareil dans tout l’univers. Un habitant de l’Inde m’a raconté que Mo’izz eddîn était fort adonné au commerce des femmes et à la boisson ; qu’il lui survint une maladie dont la guérison défia les efforts des médecins, et qu’un de ses côtés fut desséché (paralysé). Alors se souleva contre lui son lieutenant Djélal eddîn Firouz chah Alkhaldjy (Khildjy).
Lorsque le sultan Mo’izz eddîn eut été atteint d’hémiplégie, ainsi que nous l’avons raconté, son lieutenant Djélal eddîn se révolta contre lui, se transporta hors de la ville et campa sur une colline qui se trouvait en cet endroit, à côté d’une chapelle funéraire appelée la chapelle d’Aldjeïchâny. Mo’izz eddîn envoya des émirs pour le combattre ; mais tous ceux qu’il expédiait dans ce but prêtaient serment de fidélité à Djélal eddîn et s’enrôlaient dans son armée. Le chef rebelle entra ensuite dans la ville et assiégea le sultan dans son palais durant trois jours. Quelqu’un qui a été témoin de ce fait m’a raconté que le sultan Mo’izz eddîn souffrit alors de la faim, et ne trouva rien à manger. Un chérif, d’entre ses voisins, lui envoya de quoi apaiser sa faim ; mais l’émir rebelle entra à l’improviste dans le palais, et Mo’izz eddîn fut tué.
Djélal eddîn lui succéda ; c’était un homme doux et vertueux, et sa douceur le fit périr victime d’un assassinat, ainsi que nous le raconterons. Il resta paisiblement maître de la royauté durant plusieurs années et construisit le palais qui porte son nom. C’est ce même édifice que le sultan Mohammed donna à son beau-frère, l’émir Ghadâ, fils de Mohannâ, lorsqu’il lui fit épouser sa sœur, événement qui sera raconté ci-après.
Le sultan Djélal eddîn avait un fils nommé Rocn eddîn et un neveu appelé ’Alâ eddîn, qu’il maria à sa fille, et à qui il donna le gouvernement de la ville de Carâ et celui de Mânicboûr (Manicpoûr), avec son territoire, Ce dernier est un des plus fertiles de l’Inde, il abonde en froment, en riz et en sucre, et l’on y fabrique des étoffes très fines, que l’on exporte à Dihly, dont Mânicboûr est éloignée de dix-huit journées. La femme d’Alâ eddîn le tourmentait et il ne cessait de s’en plaindre à son oncle (et beau-père), le sultan Djélal eddîn ; si bien que la discorde s’éleva entre eux à ce sujet. Alâ eddîn était un homme perspicace, brave et souvent victorieux, et le désir de la royauté s’était fixé dans son âme ; mais il n’avait d’autres richesses que celles qu’il gagnait à la pointe de son épée, et au moyen des dépouilles des infidèles. Il lui arriva un jour de partir pour faire la guerre sainte, dans le pays de Doueïghîr (Déoghir ou Daoulet Abad), que l’on appelle aussi le pays de Catacah, et dont nous ferons mention ci-après. Doueïghîr est la capitale des pays de Malwa et de Marhata (Marahashtra ou pays des Mahrates) et son souverain était le plus puissant des souverains infidèles. Dans cette expédition, la monture d’Alâ eddîn fit un faux pas contre une pierre et s’abattit avec son cavalier. Celui-ci entendit une sorte de tintement produit par la pierre ; il ordonna de creuser en cet endroit et trouva sous la pierre un trésor considérable qu’il partagea entre ses camarades. Puis il arriva à Doueïghîr, dont le sultan se soumit, lui rendit la ville sans combat et lui fit de grands présents. Il retourna à la ville de Carâ, et n’envoya à son oncle aucune portion des dépouilles. Des individus excitèrent son oncle contre lui, et le sultan le manda ; mais il refusa de se rendre à sa cour. Le sultan Djélal eddîn dit alors : « J’irai le trouver et je l’amènerai, car il me tient lieu de fils. » En conséquence, il se mit en marche avec son armée, et franchit les étapes jusqu’à ce qu’il campât sur la rive voisine de la ville de Carâ, à l’endroit même où dressa son camp le sultan Mo’izz eddîn, lorsqu’il marcha à la rencontre de son père Nacir eddîn. Il s’embarqua sur le fleuve, afin de se rendre près de son neveu. Celui-ci monta aussi sur un navire, dans le dessein de faire périr le sultan, et il dit à ses compagnons : « Lorsque je l’embrasserai, tuez-le. » Quand les deux princes se rencontrèrent au milieu du fleuve, le neveu embrassa son oncle, et ses camarades tuèrent celui-ci, ainsi qu’Alâ eddîn le leur avait recommandé. Le meurtrier s’empara du royaume et disposa des troupes de sa victime.
Lorsqu’il eut tué son oncle, il devint maître du royaume, et la majeure partie des troupes de Djélal eddîn passèrent de son côté. Le reste retourna à Dihly, et se réunit auprès de Rocn eddîn. Celui-ci sortit pour repousser le meurtrier ; mais, tous ses soldats s’étant retirés près du sultan ’Alâ eddîn, il s’enfuit dans le Sind. ’Alâ eddîn entra dans le palais royal, et jouit paisiblement du pouvoir durant vingt années. Il fut au nombre des meilleurs sultans, et les habitants de l’Inde le vantent beaucoup. Il examinait en personne les affaires de ses sujets, s’enquérait du prix des denrées et faisait venir chaque jour pour cela le mohtecib, ou inspecteur des marchés que les Indiens appellent réîs, ou chef. On raconte qu’il l’interrogea un jour touchant le motif de la cherté de la viande. L’inspecteur l’informa que cela provenait du taux élevé de l’impôt établi sur les bœufs. Il ordonna d’abolir cette taxe et d’amener devant lui les marchands ; puis il leur donna de l’argent et leur dit : « Achetez avec cela des bœufs et des brebis et vendez-les ; le prix qu’ils produiront reviendra au fisc, et vous recevrez un salaire pour la vente. » Cela fut exécuté, et le sultan fit de même pour les étoffes que l’on apportait de Daoulet Abâd. Lorsque les grains atteignaient un prix élevé, il ouvrait les magasins de l’État et en vendait le contenu, jusqu’à ce que cette denrée fût à bon marché. On raconte que la valeur des grains s’éleva une certaine fois, et qu’il ordonna de les vendre à un prix qu’il fixa ; les gens refusèrent de les livrer pour ce prix-là. Il prescrivit alors que personne n’achetât d’autres grains que ceux du magasin du gouvernement, et il en vendit au peuple durant six mois. Les accapareurs craignirent alors que leurs provisions ne fussent infestées par les calandres, et ils demandèrent qu’il leur fût permis de vendre. Le sultan le leur permit, à condition qu’ils vendraient à un prix moindre que celui qu’ils avaient auparavant refusé.
’Alâ eddîn ne montait pas à cheval pour se rendre à la prière du vendredi, ni dans une fête solennelle, ni dans aucune autre occasion ; voici quel était le motif de cette abstention. Il avait un neveu appelé Soleïman chah, qu’il aimait et à qui il montrait des égards. Il monta un jour à cheval pour aller à la chasse, accompagné de ce neveu. Celui-ci conçut le dessein de traiter son oncle comme ce dernier avait lui-même traité son oncle Djélal eddîn, c’est-à-dire de l’assassiner. En conséquence, lorsque le sultan mit pied à terre pour déjeuner, il lui lança une flèche et le renversa ; mais un de ses esclaves le couvrit d’un bouclier.[52] Son neveu s’approcha, afin de l’achever ; mais, les esclaves lui ayant dit que le prince était mort, il les crut et remonta à cheval et entra dans la partie du palais où se trouvaient les femmes. Cependant le sultan ’Alâ eddîn revint de son évanouissement, il monta à cheval, et ses troupes se rassemblèrent auprès de lui. Son neveu s’enfuit ; mais il fut atteint, et amené devant lui ; il le tua, et depuis lors il cessa de monter à cheval.
’Alâ eddîn avait des fils dont les noms suivent : 1° Khidhr khân, 2° Châdy khân, 3° Abou Bekr khân, 4° Mobârec khân, appelé aussi Kothb eddîn, qui devint roi, et 5° Schihâb eddîn. Kothb eddîn était mal traité de son père, et jouissait près de lui de très peu de considération. Le sultan avait donné à tous ses frères les honneurs, c’est-à-dire des étendards et des timbales, et ne lui avait rien accordé. Cependant, il lui dit un jour : « Il faut absolument que je te donne la même chose qu’à tes frères. » Kothb eddîn lui répondit : « C’est Dieu qui me l’accordera. » Cette parole effraya son père, qui le redouta. Le sultan fut ensuite atteint de la maladie dont il mourut. Or la femme dont il avait eu son fils Khidhr khân s’appelait Mâh Hakk (le mot mâh, dans la langue de ces peuples, signifie la lune), avait un frère nommé Sindjar, avec lequel elle convint d’élever au trône Khidhr khân. Mélik Naïb, le principal des émirs du sultan, et que l’on appelait Alalfy, parce que ce souverain l’avait acheté pour mille (alf) tangah, c’est-à-dire pour deux mille cinq cents dinars du Maghreb, Mélik Naïb, dis-je, eut connaissance de cet accord, et le dénonça au sultan. Celui-ci dit à ses familiers : « Quand Sindjar entrera dans la chambre où je me trouve, je lui donnerai un habit ; et lorsqu’il s’en revêtira, saisissez-le par les manches, renversez-le contre terre et égorgez-le. » Cela fut exécuté de point en point.
Khidhr khân était alors absent, et se trouvait dans un endroit appelé Sandabat (Sonpat), à la distance d’une journée de Dihly, où il s’était rendu pour un pèlerinage aux tombeaux de plusieurs martyrs ensevelis en cet endroit car il s’était engagé par un vœu à parcourir cette distance à pied et à prier pour la santé de son père. Lorsqu’il apprit que celui-ci avait tué son oncle maternel, il en conçut un très vif chagrin, déchira le collet de son habit, ainsi que les Indiens ont coutume de le faire lorsqu’il leur est mort quelqu’un qui leur est cher. Son père, ayant eu connaissance de sa conduite, en fut mécontent, et, lorsque Khidhr khân parut en sa présence, il le réprimanda, le blâma, ordonna de lui mettre les fers aux mains et aux pieds, et le livra à Mélik Naïb, dont il a été question ci-dessus, avec l’ordre de le conduire à la forteresse de Gâlyoûr, appelée aussi Gouyâlior (Gualior). C’est une forteresse isolée, au milieu des idolâtres indous ; elle est inexpugnable et se trouve éloignée de dix journées de Dihly ; j’y ai demeuré quelque temps. Quand Mélik Naïb eut mené le prince dans ce château fort, il le remit au cotouâl, c’est-à-dire au commandant, et aux mofred, qui sont les mêmes que les zimâmy (soldats inscrits sur la liste, zimâm, de l’armée) et leur dit : « Ne vous dites pas que cet individu est le fils du sultan, et qu’il faut le traiter avec honneur ; c’est l’ennemi le plus acharné qu’ait l’empereur : gardez-le donc comme on garde un ennemi. »
Dans la suite, la maladie du sultan ayant redoublé, il dit à Mélik Naïb : « Envoie quelqu’un pour ramener mon fils Khidhr khân, afin que je le déclare mon successeur. » Mélik Naïb répondit : « Très bien », mais il remit de jour en jour l’exécution de cet ordre, et, toutes les fois que son maître l’interrogeait à ce sujet, il répondait : « Voici qu’il arrive. » Il continua d’agir ainsi jusqu’à ce que le sultan mourût.
Lorsque le sultan ’Alâ eddîn fut mort, Mélik Naïb fit asseoir sur le trône du royaume son fils cadet Schihâb eddîn. Le peuple prêta serment d’obéissance à ce prince ; mais Mélik Naïb le tint sous sa tutelle, priva de la vue Abou Bekr khân et Châdy khân, et les envoya à Gâlyoûr. Il ordonna d’aveugler leur frère Khidhr khân, qui était emprisonné dans le même endroit. Ils furent mis en prison, ainsi que Kothb eddîn ; mais le ministre épargna la vue de ce dernier. Le sultan ’Alâ eddîn avait deux esclaves, qui étaient au nombre de ses plus familiers courtisans ; l’un s’appelait Béchir et l’autre Mobacchir (ces noms signifient tous deux messagers de bonheur). La grande princesse, veuve d’Alâ eddîn et fille du sultan Mo’izz eddîn, les manda, leur rappela les bienfaits qu’ils avaient reçus de leur ancien maître, et dit : « Cet eunuque, Naïb Mélik, a fait à mes enfants ce que vous savez, et il veut encore tuer Kothb eddîn. » Ils lui répondirent « Tu verras ce que nous ferons. » Or c’était leur coutume de passer la nuit près de Naïb Mélik et d’entrer chez lui tout armés. Ils vinrent le trouver la nuit suivante, au moment où il se tenait dans une chambre construite en planches et tendue de drap. Les Indiens appellent un appartement de cette espèce Alkhoremkah (Khorrem gâh, endroit délicieux); le vizir y dormait, sur la terrasse du palais, pendant la saison des pluies. Il advint, par hasard, qu’il prit l’épée que portait un des deux conjurés, la brandit et la lui remit. L’esclave l’en frappa, et son compagnon lui porta un second coup ; puis ils lui coupèrent la tête, la portèrent à la prison de Kothb eddîn, la jetèrent aux pieds de celui-ci et le délivrèrent de captivité. Le prince alla trouver son frère Schihâb eddîn, et resta près de lui plusieurs jours, comme s’il eût été son lieutenant. Ensuite, il se décida à le déposer, et mit son dessein à exécution.
Ce prince déposa son frère Schihâb eddîn, lui coupa un doigt et l’envoya à Gâlyoûr, où il fut emprisonné avec ses frères. Le royaume appartint en paix à Kothb eddîn, qui sortit alors de la capitale, Dihly, pour se rendre à Daoulet Abad, à quarante journées de là. Le chemin entre ces deux villes est bordé d’arbres, tels que le saule et autres, de sorte que celui qui y marche peut se croire dans un jardin. Pour chaque mille de distance, il y a trois dâouahs, c’est-à-dire maisons de poste, dont nous avons décrit l’organisation, et dans chacune de ces stations on trouve tout ce dont le voyageur a besoin, de la même manière que s’il parcourait un marché pendant une distance de quarante journées. C’est ainsi que le chemin se continue durant six mois de marche, jusqu’à ce qu’il atteigne les pays de Tiling (Telingana) et de Ma’bar (le lieu du passage, nom que les Arabes donnaient à la côte de Coromandel). A chaque station se trouve un palais pour le sultan et un ermitage pour les voyageurs, et le pauvre n’a pas besoin d’emporter sur ce chemin des provisions de route.
Lorsque le sultan Kothb eddîn fut parti pour cette expédition, quelques émirs convinrent entre eux de se révolter contre lui, et de mettre sur le trône un fils de son frère Khidhr khân, le prisonnier. Cet enfant était âgé d’environ dix années, et il se trouvait près du sultan. Celui-ci, ayant appris le projet des émirs, prit son neveu, le saisit par les pieds et lui frappa la tête contre des pierres jusqu’à ce que sa cervelle fût dispersée ; puis il envoya un émir, appelé Mélik chah, à Gâlyoûr, où se trouvaient le père et les oncles de cet enfant, et lui ordonna de les tuer tous. Le kadi Zeïn eddîn Mobârec, kadi de ce château fort, m’a fait le récit suivant : « Mélik chah arriva près de nous un matin, pendant que je me trouvais près de Khidhr khân, dans sa prison. Lorsque le captif apprit son arrivée, il eut peur et changea de couleur. L’émir étant entré : “Pourquoi es-tu venu ?” Il répondit : “Pour une affaire qui intéresse le seigneur du monde.— Ma vie est-elle en sûreté ? demanda le prince.— Oui”, répliqua l’émir. Là-dessus il sortit, manda le cotouâl ou chef de la forteresse, et les mofreds, c’est-à-dire les zimâmys, qui étaient au nombre de trois cents, m’envoya chercher, ainsi que les notaires, et produisit l’ordre du sultan. Les hommes de la garnison le lurent, se rendirent près de Schihâb eddîn, le sultan déposé, et lui coupèrent le cou. Il fut plein de fermeté et ne montra pas de frayeur. Ensuite on décapita Abou Bekr et Châdy khân. Lorsqu’on se présenta pour décoller Khidhr khân, il fut frappé de crainte et de stupeur. Sa mère se trouvait avec lui ; mais les exécuteurs fermèrent la porte sur elle et le tuèrent ; puis ils traînèrent les quatre cadavres dans une fosse, sans les envelopper dans des linceuls ni les laver. On les en retira au bout de plusieurs années, et on les ensevelit dans les sépulcres de leurs ancêtres. » La mère de Khidhr khân vécut encore quelque temps, et je l’ai vue à La Mecque, dans l’année 728 (1327).
Le château de Gâlyoûr, dont il vient d’être question, est situé sur la cime d’une haute montagne et paraît, pour ainsi dire, taillé dans le roc même ; il n’a vis-à-vis de lui aucune autre montagne ; il renferme des citernes, et environ vingt puits entourés de murs lui sont annexés. Sur ces murs sont dressés des mangonneaux et des ra’adahs. On monte à la forteresse par un chemin spacieux, que gravissent les éléphants et les chevaux. Près de la porte du château se trouve la figure d’un éléphant, sculpté en pierre et surmonté de la figure d’un cornac. Lorsqu’on l’aperçoit de loin, on ne doute pas que ce ne soit un éléphant véritable. Au bas de la forteresse est une belle ville, bâtie entièrement en pierres de taille blanches, les mosquées comme les maisons ; on n’y voit pas de bois, à l’exception des portes. Il en est de même du palais du roi, des dômes et des salons. La plupart des trafiquants de cette ville sont des idolâtres, et il s’y trouve six cents cavaliers de l’armée du sultan, qui ne cessent de combattre les infidèles, car cette place en est entourée.
Lorsque Kothb eddîn eut assassiné ses frères, qu’il fut devenu seul maître du pouvoir, et qu’il ne resta personne qui le combattît ou se révoltât contre lui, Dieu suscita contre lui son serviteur favori, le plus puissant de ses émirs, le plus élevé en dignité, Nacir eddîn Khosrow khân. Cet homme l’attaqua à l’improviste, le tua, et demeura maître absolu de son royaume ; mais ce ne fut pas pour longtemps. Dieu suscita aussi contre lui quelqu’un qui le tua après l’avoir détrôné, et cette personne fut le sultan Toghlok, ainsi qu’il sera ci-après raconté et retracé en détail, si Dieu le veut.
Khosrow khân était un des principaux émirs de Kothb eddîn, il était brave et avait une belle figure. Il avait conquis le pays de Djandîry (Tchandîry) et celui d’Alma’bar (la côte de Coromandel), qui sont au nombre des régions les plus fertiles de l’Inde, et sont éloignés de Dihly d’une distance de six mois de marche. Kothb eddîn l’aimait beaucoup et lui avait accordé sa prédilection ; cette conduite fut cause qu’il reçut la mort des mains de cet homme. Kothb eddîn avait eu pour précepteur un nommé Kadi khân Sadr Aldjihân, qui était le principal de ses émirs et avait le titre de kélîd dâr, c’est-à-dire de gardien des clefs du palais. Cet officier avait coutume de passer toutes les nuits à la porte du sultan, avec les hommes de la garde ; ceux-ci sont au nombre de mille, qui veillent à tour de rôle toutes les quatre nuits. Ils sont rangés sur deux files, dans l’intervalle compris entre les portes du palais, et chacun a devant soi ses armes. Personne n’entre qu’en passant entre ces deux files. Quand la nuit est achevée, les gens de la garde du jour arrivent. Les soldats de ce corps ont des chefs et des écrivains, qui font des rondes parmi eux et notent ceux qui sont absents ou présents.
Or le précepteur du sultan, Kadi khân, haïssait la conduite de Khosrow khân et était mécontent de ce qu’il voyait, savoir sa prédilection pour les Indiens idolâtres, son penchant pour eux et son origine semblable à la leur. Il ne cessait de rappeler cela au sultan, qui ne l’écoutait pas, lui répondait : « Laisse-le », et ne voulait pas agir, à cause du dessein que Dieu avait formé de le faire périr par les mains de cet homme. Un certain jour Khosrow khân dit au sultan : « Plusieurs Indiens désirent embrasser l’islamisme. » Or c’est une des coutumes en vigueur dans ce pays, quand un individu veut se faire musulman, qu’on l’introduise près du sultan, qui le revêt d’un bel habit et lui donne un collier et des bracelets d’or, d’une valeur proportionnée à son rang. Le sultan dit à Khosrow : « Amène-les-moi. — Ces gens-là, répondit l’émir, seraient honteux d’entrer chez toi en plein jour, à cause de leurs proches et de leurs coreligionnaires.— Amène-les-moi donc de nuit », reprit le sultan.
Khosrow khân rassembla une troupe d’Indiens choisis parmi les plus braves et les plus considérables, et au nombre desquels était son frère Khân khânân. On se trouvait alors au temps des chaleurs, et le sultan dormait sur la terrasse du palais, n’ayant auprès de lui que plusieurs eunuques. Lorsque les Indiens, armés de toutes pièces, eurent franchi les quatre portes du palais, et qu’ils arrivèrent à la cinquième, où se trouvait Kadi khân, cet officier suspecta leur conduite et soupçonna quelque mauvais dessein. En conséquence, il les empêcha d’entrer et dit : « Il faut absolument que j’entende de la bouche du souverain du monde la permission de les introduire ; alors ils seront admis. » Ces hommes, se voyant ainsi arrêtés, se jetèrent sur lui et le tuèrent. Le bruit que cette dispute excita près de la porte devint considérable, et le sultan s’écria : « Qu’est-ce que cela ? » Khosrow khân répondit : « Ce sont les Indiens qui viennent pour se convertir. Kadi khân les a empêchés d’entrer, et le tumulte a augmenté. » Le sultan eut peur et se leva avec l’intention de se retirer dans l’intérieur du palais ; mais la porte était fermée et les eunuques se trouvaient près de là. Le prince frappa à la porte. Khosrow khân le saisit dans ses bras par derrière ; mais le monarque, étant plus fort que lui, le terrassa. Les Indiens survinrent alors, et Khosrow khân leur dit : « Le voici sur moi, ; tuez-le. » Ils le massacrèrent, coupèrent sa tête et la jetèrent de la terrasse du palais dans la cour.
Khosrow khân manda aussitôt les émirs et les rois, qui ne savaient pas encore ce qui était survenu. Chaque fois qu’une troupe entrait, elle le trouvait assis sur le trône royal ; on lui prêta serment, et, lorsque le matin fut arrivé, il fit publier son avènement, expédia des rescrits ou ordres dans toutes les provinces, et envoya un habit d’honneur à chaque émir. Ils se soumirent tous à lui et lui obéirent, à l’exception de Toghlok chah, père du sultan Mohammed chah, qui était alors gouverneur de Dibâlboûr, dans le Sind. Quand il reçut le vêtement d’honneur que lui octroyait Khosrow khân, il le jeta à terre et s’assit dessus. Khosrow fit marcher contre lui son frère Khân khânân, « le khan des khans », mais Toghlok le mit en déroute, et finit ensuite par le tuer, ainsi que nous le raconterons dans l’histoire du règne de Toghlok.
Lorsque Khosrow khân fut devenu roi, il accorda sa prédilection aux Indiens et publia des ordres répréhensibles, tels qu’un édit par lequel il défendait d’égorger des bœufs conformément à la coutume des Indiens idolâtres ; car ils ne permettent pas de les tuer. Le châtiment de quiconque en égorge un, chez ce peuple consiste à être cousu dans la peau de l’animal et brûlé. Ils honorent les bœufs et boivent leur urine, pour se sanctifier et obtenir leur guérison lorsqu’ils sont malades, et ils enduisent avec la fiente de ces animaux leurs maisons, tant au-dedans qu’au-dehors. Une pareille conduite fut une des causes qui rendirent Khosrow khân odieux aux musulmans, et les firent pencher en faveur de Toghlok. Le règne du premier ne dura pas longtemps, et les jours de sa royauté ne se prolongèrent pas, ainsi que nous le raconterons.
Le cheikh et imâm pieux, savant, bienfaisant et dévot Rocn eddîn, fils du pieux cheikh Chems eddîn Abou ’Abd Allah, fils du saint, de l’imâm savant et dévot Behâ eddîn Zacariâ alkorachy almoultâny, m’a fait le récit suivant, dans son ermitage de la ville de Moultân. Le sultan Toghlok était au nombre de ces Turcs connus sous le nom de Karaounah (Journal Asiatique, t. II de 1844 ; d’Ohsson, Hist. des Mongols, t. IV) et qui habitent dans les montagnes situées entre le Sind et le pays des Turcs. Il était dans une situation misérable, et se rendit dans le Sind comme serviteur d’un certain marchand dont il était golwâny, c’est-à-dire palefrenier (djélaoubân?). Cela se passait sous le règne du sultan ’Alâ eddîn, et le gouverneur du Sind était alors son frère Oûloû khân. Toghlok s’engagea à son service et fut attaché à sa personne, et Oûloû khân l’enrôla parmi les biâdeh (piyadêh), c’est-à-dire les gens de pied. Par la suite, sa bravoure se fit connaître, et il fut inscrit parmi les cavaliers ; puis il devint un des petits émirs, et Oûloû khân le fit chef de ses écuries. Enfin, il fut un des grands émirs et reçut le titre d’Almélic alghâzy, le roi belliqueux. J’ai vu l’inscription qui suit sur la tribune grillée de la grande mosquée de Moultân, dont il a ordonné la construction : « J’ai combattu es Tartares vingt-neuf fois, et je les ai mis en déroute. C’est alors que j’ai été surnommé le roi belliqueux. »
Lorsque Kothb eddîn fut devenu roi, il nomma Toghlok gouverneur de la ville de Dibâlboûr et de son district, et fit à son fils, celui-là même qui est à présent sultan de l’Inde, chef des écuries impériales. On le nommait Djaounah, le Soleil, et quand il fut roi, il se fit appeler Mohammed chah. Kothb eddîn ayant été tué et Khosrow khân lui ayant succédé, ce dernier confirma Djaounah dans le poste de chef des écuries. Lorsque Toghlok voulut se révolter, il avait trois cents camarades en qui il mettait sa confiance, les jours de bataille. Il écrivit à Cachloû khân, qui se trouvait alors à Moultân, à trois journées de distance de Dibâlboûr, pour lui demander du secours, lui rappelant les bienfaits de Kothb eddîn et l’excitant à poursuivre la vengeance du meurtre de ce prince. Le fils de Cachloû khân résidait à Dihly. En conséquence, il répondit à Toghlok : « Si mon fils était près de moi, certes, je t’aiderais dans tes desseins. » Toghlok écrivit à son fils Mohammed chah, pour lui faire connaître ce qu’il avait résolu, et lui ordonner de s’enfuir et de revenir le trouver, en se faisant accompagner du fils de Cachloû khân. Le jeune émir machina une ruse contre Khosrow khân, et elle lui réussit, ainsi qu’il désirait. Or il dit au sultan : « Les chevaux sont devenus gras et ont pris de l’embonpoint, ils ont besoin du yarâk, c’est-à-dire du dégraissement (ou entraînement). En conséquence, Khosrow khân lui permit de les entraîner. Le chef des écuries montait chaque jour à cheval, avec ses subordonnés, se promenait d’une à trois heures, avec les animaux confiés à ses soins ; il alla même jusqu’à rester sorti quatre heures, si bien qu’un jour il était encore absent à midi passé, ce qui est le moment où les Indiens prennent leur repas. Le sultan ordonna qu’on partît à cheval pour le chercher ; mais on n’en trouva aucune nouvelle, et il rejoignit son père, emmenant avec lui le fils de Cachloû khân.
Alors Toghlok, se déclarant ouvertement rebelle, rassembla des troupes, et Cachloû khân marcha avec lui, accompagné de ses soldats. Le sultan envoya pour les combattre son frère Khân khânân ; mais ils lui firent essuyer la déroute le plus complète, et son armée passa de leur côté. Khân khânân se retira près de son frère, ses officiers furent tués et ses trésors pris. Toghlok se dirigea vers Dihly. Khosrow khân sortit à sa rencontre avec son armée, et campa près de la capitale, dans un lieu appelé Acya Abad (Acya Bâd), c’est-à-dire « le moulin à vent ». Il ordonna d’ouvrir ses trésors, et donna de l’argent par bourses et non au poids, ni par sommes déterminées. La bataille s’engagea entre lui et Toghlok, et les indiens combattirent avec la plus grande ardeur. Les troupes de Toghlok furent mises en déroute, son camp fut pillé, et il resta au milieu de ses trois cents compagnons les plus anciens. Il leur dit : « Où fuir ? Partout où nous serons atteints, nous serons tués. » Les soldats de Khosrow khân s’occupèrent à piller, et se dispersèrent, et il n’en demeura près de lui qu’un petit nombre. Toghlok et ses camarades se dirigèrent vers l’endroit où il se trouvait. La présence du sultan dans ce pays-là est connue au moyen du parasol que l’on élève au-dessus de sa tête, et que l’on appelle en Égypte le dais et l’oiseau. Dans cette dernière contrée, on l’arbore dans les fêtes solennelles ; quant à l’Inde et à la Chine, il y accompagne toujours le sultan, soit en voyage, soit dans sa résidence habituelle.
Or, quand Toghlok et ses compagnons se furent dirigés vers Khosrow, le combat se ralluma entre eux et les Indous ; les soldats du sultan furent mis en déroute, et il ne resta personne près de lui. Il prit la fuite, descendit de cheval, jeta ses vêtements et ses armes, demeura en chemise, et laissa pendre ses cheveux entre ses épaules, ainsi que font les fakirs de l’Inde ; puis il entra dans un verger situé près de là. Le peuple se réunit près de Toghlok, qui prit le chemin de la ville. Le gouverneur lui en apporta les clefs ; il entra dans le palais et se logea dans une de ses ailes ; puis il dit à Cachloû khân : « Sois sultan. — Sois-le plutôt », répondit Cachloû khân. Tous deux se disputèrent ; enfin Cachloû khân dit à Toghlok : « Si tu refuses d’être sultan, ton fils deviendra maître du pouvoir. » Toghlok eut de la répugnance pour cette proposition ; il accepta alors l’autorité et s’assit sur le trône royal. Les grands et les gens du commun lui prêtèrent serment.
Au bout de trois jours, Khosrow khân, toujours caché dans le même verger, fut vivement pressé par la faim. Il sortit de cet asile et se mit à en faire le tour. Il rencontra le gardien de ce verger, et lui demanda quelque aliment. Cet homme n’en ayant aucun à sa disposition, Khosrow lui donna son anneau, en lui disant : « Va et mets-le en gage, pour te procurer de la nourriture. » Lorsque cet individu se fut rendu au marché avec l’anneau, les gens conçurent des soupçons à son égard et le conduisirent au chihneh, ou magistrat de police. Celui-ci l’introduisit près du sultan Toghlok, auquel il fit connaître qui lui avait remis la bague. Toghlok envoya son fils Mohammed, afin qu’il ramenât Khosrow. Mohammed se saisit de celui-ci et le conduisit près de son père, monté sur un tatoû, c’est-à-dire un cheval de bât. Lorsque Khosrow fut en présence de Toghlok, il lui dit : « Je suis affamé, donne-moi à manger. » Le nouveau sultan ordonna qu’on lui servît du sorbet, puis des aliments, puis de la bière, et, enfin, du bétel. Quand il eut mangé, il se leva et dit : « Ô Toghlok, conduis-toi envers moi à la manière des rois et ne me déshonore pas ! — Cela t’est accordé », répondit Toghlok, et il ordonna de lui couper le cou, ce qui fut exécuté dans l’endroit même où Khosrow avait tué Kothb eddîn. Sa tête et son corps furent jetés du haut de la terrasse, ainsi qu’il avait fait de la tête de son prédécesseur. Toghlok commanda ensuite de laver le cadavre et de l’envelopper dans un linceul ; après quoi on l’ensevelit dans le mausolée qu’il s’était construit. La royauté appartint en paix pendant quatre ans à Toghlok, qui était un prince juste et vertueux.
Lorsque Toghlok fut établi fermement dans la capitale, il envoya son fils Mohammed pour faire la conquête du pays de Tiling situé à trois mois de marche de Dihly. Il fit partir avec lui une armée considérable, dans laquelle se trouvaient les principaux émirs, tels que le roi (Almélic) Témoûr, le roi Tikîn, Mélik Câfoûr Almuhurdâr, « le gardien du sceau », Mélik Beïram, etc.. Quand Mohammed fut arrivé dans la contrée de Tiling, il voulut se révolter. Or il avait pour commensal un homme, du nombre de jurisconsultes et des poètes, que l’on appelait ’Obaïd. Il lui ordonna de répandre le bruit que le sultan Toghlok était mort ; car il s’imaginait que les gens lui prêteraient en toute hâte le serment de fidélité, dès qu’ils entendraient cette nouvelle. Lorsque ce bruit eut été porté à la connaissance des soldats, les émirs n’y ajoutèrent pas foi ; chacun d’eux fit battre sa timbale et se révolta. Il ne demeura personne près de Mohammed, et les chefs voulurent le tuer. Mélik Témoûr les en empêcha et le protégea. Il s’enfuit près de son père, avec dix cavaliers, qu’il surnomma iârân mouâfik, c’est-à-dire « les compagnons sincères ». Son père lui donna des sommes d’argent et des troupes, et lui commanda de retourner dans le Tiling, et il obéit. Mais le sultan connut quel avait été son dessein ; il tua le légiste ’Obaïd et ordonna de mettre à mort Mélik Câfoûr, le muhurdâr. On ficha en terre un pieu de tente, aiguisé à son extrémité supérieure, et on l’enfonça dans le cou de Câfoûr, jusqu’à ce que la pointe sortît par un des côtés de ce malheureux, qui avait la tête en bas, et fut laissé dans cet état. Les autres émirs s’enfuirent près du sultan Chems eddîn, fils du sultan Nacir eddîn, fils du sultan Ghiâth eddîn Balaban, et se fixèrent à sa cour.
Les émirs fugitifs séjournèrent près du sultan Chems eddîn. Dans la suite, celui-ci mourut, léguant le trône à son fils Schihâb eddîn. Ce prince succéda à son père ; mais son frère cadet, Ghiâth eddîn Behadour Boûrah (ce dernier mot signifie, dans la langue indienne, le noir), le vainquit, s’empara du royaume, et tua son frère Kothloû khân, ainsi que la plupart de ses autres frères. Deux de ceux-ci, le sultan Schihâb eddîn et Nacir eddîn, s’enfuirent près de Toghlok, qui se mit en marche avec eux, afin de combattre le fratricide.[53] Il laissa dans son royaume son fils Mohammed en qualité de vice-roi, et s’avança en hâte vers le pays de Lacnaouty. Il s’en rendit maître, fit prisonnier son sultan Ghiâth eddîn Behadour et reprit avec ce captif le chemin de sa capitale.
Il y avait alors à Dihly le saint Nizâm eddîn Albedhâouny, et Mohammed chah, fils du sultan, ne cessait de lui rendre des visites, de témoigner de la considération à ses serviteurs et d’implorer ses prières Or le cheikh était sujet à des extases qui s’emparaient de tout son être. Le fils du sultan dit à ses serviteurs : « Quand le cheikh sera dans cette extase qui se rend maîtresse de lui, faites-le-moi savoir. » Lorsque son accès le prit, on en prévint le prince, qui se rendit près de lui. Dès que le cheikh le vit, il s’écria : « Nous lui donnons la royauté ! » Ensuite il mourut pendant l’absence du sultan, et le fils de ce prince, Mohammed, porta sa bière sur son épaule. Cette nouvelle parvint à son père, il se défia de lui et lui adressa des menaces. Différents actes avaient déjà inspiré des soupçons à Toghlok contre son fils il le voyait de mauvais œil acheter un grand nombre d’esclaves, donner des présents magnifiques et se concilier les cœurs ; mais alors sa colère contre lui augmenta. On rapporta au sultan que les astrologues prétendaient qu’il n’entrerait pas dans la ville de Dihly, au retour de ce voyage. Il se répandit contre eux en menaces.
Lorsqu’il fut revenu de son expédition et qu’il approcha de la capitale, il ordonna à son fils de lui bâtir un palais, ou, comme ce peuple l’appelle, un kiosque, près d’une rivière qui coule en cet endroit et que l’on nomme Afghân Poûr. Mohammed l’édifia en trois jours, et le construisit pour la majeure partie en bois. Il était élevé au-dessus du sol et reposait sur des colonnes de bois. Mohammed le disposa avec art et dans des proportions que fut chargé de faire observer AlMélik Zâdeh, connu dans la suite par le titre de Khodjah djihân. Le vrai nom de cet individu était Ahmed fils d’Ayâs ; il devint le principal vizir du sultan Mohammed, et il était alors inspecteur des bâtiments. L’invention qu’imaginèrent ces deux personnages en construisant le kiosque consista à le bâtir de telle sorte qu’il tombât et s’écroulât dès que les éléphants en approcheraient d’un certain côté. Le sultan s’arrêta dans cet édifice, et fit servir à manger au peuple, qui se dispersa ensuite. Son fils lui demanda la permission de faire passer devant lui les éléphants, couverts de leurs harnais de parade. Le sultan le lui permit.
Le cheikh Rocn eddîn m’a raconté qu’il se trouvait alors près du sultan, et qu’ils avaient avec eux le fils de ce dernier, son enfant de prédilection, Mahmoud. Sur ces entrefaites, Mohammed revint et dit au cheikh : « O maître ! voici le moment de la prière de l’après-midi ; descends et prie. — Je descendis, continue le cheikh, et l’on amena les éléphants d’un même côté, ainsi que le prince et son confident avaient imaginé de le faire. Lorsque ces animaux marchèrent de ce côté, le kiosque s’écroula sur le sultan et son fils Mahmoud. J’entendis le bruit, dit toujours le cheikh, et je revins sur mes pas sans avoir fait ma prière. Je vis que le kiosque était renversé. Le fils du sultan, Mohammed, ordonna d’apporter des pioches et des pelles, afin de creuser la terre et de chercher après son père. Mais il fit signe qu’on tardât d’obéir, et on n’apporta les outils qu’après le coucher du soleil. On se mit alors à creuser et l’on découvrit le sultan, qui avait courbé le dos au-dessus de son fils, afin de le préserver de la mort. Quelques-uns prétendirent que Toghlok fut retiré mort, d’autres, au contraire, qu’il était encore en vie, qu’on l’acheva et qu’on le transporta de nuit dans le mausolée qu’il s’était construit près de la ville appelée, d’après lui, Toghlok Abad, et où il fut enterré »
Nous avons raconté pour quel motif il avait bâti cette ville, où se trouvaient ses trésors et ses palais. C’est là qu’était le palais immense qu’il recouvrit de tuiles dorées. Au moment où le soleil se levait, ces tuiles resplendissaient d’une vive lumière, et d’un éclat qui empêchait l’œil de les regarder longtemps. Toghlok déposa dans cette ville de Toghlok Abad des trésors considérables. On raconte qu’il construisit un bassin, où il versa de l’or fondu, de manière à en former un seul morceau. Son fils Mohammed chah dépensa tout cela lorsqu’il fut monté sur le trône.
Ce fut aux habiles mesures observées par le vizir Khodjah djihân, en construisant le kiosque qui s’écroula sur Toghlok, ainsi que nous l’avons rapporté, qu’il dut la considération dont il jouissait auprès de Mohammed et la prédilection que celui-ci lui témoignait. Personne, soit vizir ou autre, n’approchait de lui sous le rapport de l’estime où le tenait le sultan, et n’atteignait le rang dont il était en possession près de ce prince.
Lorsque le sultan Toghlok fut mort, son fils Mohammed s’empara du royaume, sans rencontrer d’adversaire ni de rebelle. Nous avons dit ci-dessus que son nom était Djaounah ; mais, quand il fut devenu roi, il se fit appeler Mohammed et fut surnommé Abou’l Modjâhid (le père de celui qui fait la guerre aux infidèles). Tout ce que j’ai rapporté touchant l’histoire des sultans de l’Inde, j’en ai été informé et je l’ai appris, au moins pour la plus grande partie, de la bouche du cheikh Kamal eddîn, fils de Borhân eddîn, de Ghazna, kadi des kadis. Quant aux aventures de ce roi-ci, la plupart sont au nombre de ce que j’ai vu durant mon séjour dans ses États.
Mohammed est de tous les hommes celui qui aime davantage à faire des cadeaux et aussi à répandre le sang. Sa porte voit toujours près d’elle quelque fakir qui devient riche, ou quelque être vivant qui est mis à mort. Ses traits de générosité et de bravoure, et ses exemples de cruauté et de violence envers les coupables, ont obtenu de la célébrité parmi le peuple. Malgré cela, il est le plus humble des hommes et celui qui montre le plus d’équité ; les cérémonies de la religion sont observées à sa cour ; il est très sévère en ce qui regarde la prière et le châtiment qui suit son inexécution. Il est au nombre des rois dont la félicité est grande, et dont les heureux succès dépassent ce qui est ordinaire ; mais sa qualité dominante, c’est la générosité. Nous raconterons, parmi les traits de sa libéralité, des merveilles dont les semblables n’ont été rapportées d’aucun des princes qui l’ont précédé. J’atteste Dieu, ses anges et ses prophètes que tout ce que je dirai de sa munificence extraordinaire est la vérité sûre. Il me suffit de Dieu pour témoin. Je sais qu’une portion de ce que je raconterai en ce genre ne sera pas admise dans l’esprit de beaucoup d’individus, et qu’ils la comprendront parmi ce qui est impossible dans l’ordre habituel des choses. Mais, quand il s’agit d’un événement que j’ai vu de mes yeux, dont j’ai connu la réalité, dans lequel j’ai pris une grande part, je ne puis faire autrement que de dire la vérité. D’ailleurs, la majeure partie de ces faits est rendue constante par la tradition orale dans les pays de l’Orient.
Le palais du sultan, à Dihly, est appelé Dâr Sera et a un grand nombre de portes. A la première se tiennent une troupe d’hommes préposés à sa garde ; les joueurs de clairon, de trompette et de fifre sont assis en cet endroit, et quand il arrive un émir ou un grand personnage ils jouent de leur instrument et disent, dans les intervalles de ce concert : « Un tel est venu, un tel est venu. » Il en est de même à la seconde et à la troisième porte. En dehors de la première, il y a des estrades, sur lesquelles s’asseyent les bourreaux qui sont chargés de tuer les gens. C’est la coutume chez ce peuple, toutes les fois que le sultan a ordonné de tuer un homme, qu’il soit massacré à la porte de la salle d’audience et que son corps y reste trois jours. Entre les deux portes, la première et la seconde, il y a un grand vestibule, de chaque côté duquel sont des estrades en pierre de taille, où s’asseyent les hommes de faction parmi les gardiens des portes. Quant à la seconde de ces deux portes, les portiers chargés de sa garde y prennent place. Entre elle et la troisième, il y a une grande estrade où siège le nakîb en chef (chef suprême de tous les chérifs); il a devant lui une massue d’or, qu’il prend dans sa main, et sur sa tête il porte une tiare d’or incrustée de pierreries et surmontée de plumes de paon. Les nakîbs se tiennent devant lui, coiffés chacun d’une calotte dorée, les reins serrés par une riche ceinture, et tenant dans la main un fouet, dont la poignée est d’or ou d’argent.
Cette seconde porte aboutit à une très grande salle d’audience où s’asseyent les sujets. Quant à la troisième porte, elle est pourvue d’estrades, où se placent les écrivains de la porte. Une des coutumes de ce peuple, c’est que personne n’entre par cette porte, à moins que le sultan ne l’ait désigné pour cela. Il fixe, pour chaque individu, un certain nombre de ses compagnons et de ses gens qui entrent avec lui. Toutes les fois que quelqu’un se présente à cette porte, les secrétaires écrivent : « Un tel est venu à la première heure ou à la seconde », et ainsi de suite, jusqu’à la fin du jour. Le sultan prend connaissance de ce rapport après la dernière prière du soir. Les écrivains tiennent note aussi de tout ce qui arrive à la porte ; des fils de rois. Ont été désignés pour transmettre au sultan tout ce qu’ils écrivent.
Une autre coutume des Indiens, c’est que quiconque s’abstient de paraître au palais du sultan pendant trois jours et plus, soit qu’il ait une excuse ou non, ne passe pas cette porte par la suite, si ce n’est avec la permission du souverain. S’il a quelque excuse, telle qu’une maladie ou un autre empêchement, il fait offrir au souverain un cadeau choisi parmi les objets qu’il lui convient de présenter à ce monarque. C’est ainsi qu’en usent également ceux qui arrivent de voyage. Le légiste offre un Coran, des livres et des dons semblables ; le fakir, un tapis à prier, un chapelet, un cure-dents ou des objets du même genre. Les émirs et leurs pareils présentent des chevaux, des chameaux et des armes.
Cette troisième porte aboutit à la salle d’audience, vaste et immense, que l’on appelle Hezâr Ousthoûn (sutoûn), ce qui veut dire « les mille colonnes ». Ces colonnes sont de bois vernissé, et elles supportent une toiture de planches, peintes de la manière la plus admirable. Les gens s’asseyent au-dessous, et c’est dans cette salle que le sultan donne ses audiences solennelles.
La plupart de ses audiences ont lieu après la prière de quatre heures du soir ; mais souvent il en donne au commencement de la journée. Il siège sur une estrade tendue d’étoffes de couleur blanche et surmontée d’un trône ; un grand coussin est placé derrière son dos ; il a à sa droite un autre coussin et un troisième à sa gauche. Il s’assied à la manière de l’homme qui veut réciter le téchehhud, ou profession de foi musulmane, pendant la prière (cf. d’Ohsson, II, 83, 84). C’est ainsi que s’asseyent tous les habitants de l’Inde. Quand le sultan est assis, le vizir se tient debout devant lui, les secrétaires se placent derrière le vizir, et les chambellans derrière les secrétaires. Le chef suprême des chambellans est Firouz Mélik, cousin germain du sultan et son lieutenant. C’est celui des chambellans qui approche le plus près du sultan. Après lui vient le chambellan particulier, qui est lui-même suivi de son substitut, de l’intendant du palais et de son lieutenant, de deux dignitaires appelés l’un la gloire et l’autre le chef des chambellans, et des personnes placées sous leurs ordres.
Les nakîbs, au nombre d’environ cent, viennent après les chambellans. Lorsque le sultan s’assied, les uns et les autres crient de leur voix la plus forte : « Au nom de Dieu. » Ensuite se place debout, derrière le sultan, le grand roi Kaboûlah, tenant dans sa main un émouchoir avec lequel il chasse les mouches. Cent silahdârs (écuyers, armigeri) se tiennent debout à la droite du sultan, et un pareil nombre à sa gauche. Ils ont dans leurs mains des boucliers, des épées et des arcs. A droite et à gauche, sur toute la longueur de la salle d’audience, sont placés : le kadi des kadis ; le prédicateur en chef ; les autres kadis ; les principaux légistes ; les principaux descendants de Mahomet ; les cheikhs, les frères et beaux-frères du sultan ; les principaux émirs ; les chefs des illustres, c’est-à-dire des étrangers ; les généraux.
On amène ensuite soixante chevaux, sellés et bridés avec les harnais impériaux ; parmi eux il y en a qui portent les insignes du khalifat ce sont ceux dont les brides et les sangles sont de soie noire et dorée ; il y en a qui ont les mêmes objets en soie blanche et dorée ; le sultan, seul, monte des chevaux ainsi équipés. On tient la moitié de ces chevaux à droite et l’autre moitié à gauche, de manière que le sultan puisse les voir. Puis on amène cinquante éléphants décorés d’étoffes de soie et d’or ; leurs défenses sont recouvertes de fer, afin qu’elles soient plus propres à tuer les coupables. Sur le cou de chaque éléphant se tient son cornac, ayant à la main une sorte de hache d’armes de fer, avec laquelle il châtie sa bête et la fait se diriger selon ce qu’on exige d’elle. Chaque éléphant a sur son dos une espèce de grande boîte, qui peut contenir vingt combattants, plus ou moins, d’après la grosseur de l’animal et la grandeur de son corps. Quatre étendards sont fixés aux angles de cette boîte. Ces éléphants sont dressés à saluer le sultan et à incliner leurs têtes, et, lorsqu’ils saluent, les chambellans disent à haute voix : « Au nom de Dieu ! » On les fait aussi se tenir, moitié à droite, moitié à gauche, derrière les personnes qui sont debout.
Tous ceux qui arrivent, d’entre les gens désignés pour rester debout, soit à droite, soit à gauche, font une salutation près du lieu où se tiennent les chambellans. Ceux-ci disent : « Au nom de Dieu ! » et l’élévation du ton de leur voix est proportionnée à la grandeur de la renommée de celui qui salue. Lorsqu’il a fléchi le genou, il retourne à sa place, à la droite ou à la gauche, et ne la dépasse jamais. Si c’est un Indien idolâtre qui salue, les chambellans et les nakîbs lui disent : « Que Dieu te guide ! » Les esclaves du sultan se tiennent debout derrière tout le monde, ayant dans leurs mains des boucliers et des épées, et il n’est possible à personne de se mêler parmi eux, si ce n’est en passant devant les chambellans qui sont debout devant l’empereur.
S’il se trouve à la porte quelqu’un qui vienne pour offrir au sultan un présent, les chambellans entrent chez ce prince dans l’ordre hiérarchique. L’émir chambellan les précède, son substitut marche derrière lui ; puis viennent le chambellan particulier et son substitut, l’intendant du palais et son suppléant, le chef des chambellans et le principal chambellan. Ils font une salutation dans trois endroits différents, et annoncent au sultan quelle est la personne qui attend à la porte. Lorsqu’il leur a ordonné de l’amener, ils placent le présent qu’elle apporte dans les mains d’individus qui doivent se tenir debout avec le cadeau devant l’assistance, afin que le sultan puisse le voir. Le prince mande alors celui qui l’offre, et ce dernier salue trois fois avant d’arriver devant lui ; puis il fait une salutation près de l’endroit où se tiennent les chambellans. Si c’est un homme considérable, il se tient debout sur la même ligne que l’émir chambellan ; sinon, il se met derrière lui. Le sultan lui adresse lui-même la parole de la manière la plus gracieuse et lui souhaite la bienvenue. Si cet homme est du nombre de ceux qui méritent de la considération, le sultan lui prend la main ou il l’embrasse et demande quelque portion de son présent. On l’expose devant lui et, s’il se compose d’armes ou d’étoffes, il les tourne dans tous les sens et témoigne son approbation, afin de raffermir l’esprit du donateur, de l’enhardir et de lui montrer de la sollicitude. Il lui accorde un vêtement d’honneur et lui assigne une somme d’argent pour se laver la tête, selon la coutume des Indiens en pareille circonstance, le tout en proportion de ce que mérite le donateur.
Lorsque les agents arrivent portant les dons et les richesses amassées au moyen d’impôts des différentes provinces, ils font des vases d’or et d’argent, tels que des bassins, des aiguières et autres. Ils font aussi, en or et en argent, des morceaux qui ont la forme de briques et qu’on appelle khicht (nom persan qui signifie « brique », etc.). Les farrâchs ou valets, qui sont les esclaves du sultan, se tiennent debout en un seul rang, et ils ont à la main les présents, chacun d’eux portant une pièce séparée. Après cela, on fait avancer les éléphants, s’il s’en trouve dans le cadeau, puis les chevaux sellés et bridés, ensuite les mulets, et enfin les chameaux chargés des tributs.
Je vis une fois le vizir Khodjah Djihan offrir un présent au sultan, qui revenait de Daoulet Abad. Il alla à sa rencontre jusqu’à l’extérieur de la ville de Biyânah et fit porter le cadeau devant le monarque dans l’ordre que nous avons décrit. Parmi les objets offerts dans cette circonstance, je remarquai un vase de porcelaine rempli de rubis, un autre rempli d’émeraudes et un troisième plein de perles magnifiques. Cela se passait en présence de Hadji Câoun, cousin germain du sultan Abou Sa’id, roi de l’Irak. Le souverain de l’Inde lui donna une partie de ce cadeau, comme nous le dirons plus tard en détail, s’il plaît au Dieu très haut.
Le soir qui précède la fête, le sultan fait cadeau de vêtements aux rois ou grands dignitaires, aux favoris, aux chefs du royaume, aux personnages illustres ou étrangers, aux secrétaires, aux chambellans, aux officiers, aux gouverneurs, de même qu’aux serviteurs et aux messagers. Au matin de la fête, on orne tous les éléphants avec de la soie, de l’or et des pierres précieuses. Seize de ces animaux ne sont montés par personne, et ils sont seulement réservés pour le sultan. On élève sur ceux-ci seize tchetrs ou parasols de soie, incrustés de pierres précieuses, et dont les manches sont en or pur. Chacun de ces éléphants porte, de plus, un coussin de soie, enrichi de pierres précieuses. Le souverain monte un de ces éléphants, et l’on porte devant lui la ghâchiyah, c’est-à-dire la housse qui recouvre la selle du sultan ; elle est incrustée des pierres les plus précieuses.
Devant le monarque marchent à pied ses serviteurs et ses esclaves, chacun d’eux ayant sur la tête une calotte d’or, et autour des hanches une ceinture également d’or, que quelques-uns enrichissent de pierres précieuses. Les officiers, au nombre d’environ trois cents, marchent aussi à pied devant le sultan ; ils portent sur leur tête un bonnet haut en or, ont autour des reins une ceinture d’or, et à leur main un fouet, dont le manche est en or. On remarque, montés sur des éléphants : le grand juge Sadr Aldjihân Kamal eddîn Alghaznéouy, le grand juge Sadr Aldjihân Nasir eddîn Alkhârezmy, et tous les autres juges ; il en est ainsi des principaux personnages illustres, parmi les Khoraçaniens, les Irakiens, les Syriens, les Égyptiens et les Barbaresques. Tous ceux-ci sont pareillement montés sur des éléphants. Il est à noter que tous les étrangers sont nommés Khoraçaniens par les peuples de l’Inde. Les muezzins montent aussi sur des éléphants, et ne cessent de crier : « Dieu est tout-puissant ! »
Telle est la disposition qu’on observe quand le sultan sort de la porte du château. Il est attendu par toutes les troupes, chaque commandant étant à la tête de son corps, séparé des autres, et ayant avec lui ses tambours et ses drapeaux. Le souverain s’avance, précédé par les gens à pied que nous avons mentionnés ; devant ceux-ci marchent les juges et les muezzins, qui proclament les louanges de l’Être suprême. Derrière le sultan se voient ses mérâtibs (dignités, insignes, etc.) : ce sont les drapeaux, les tambours, les cors, les trompettes et les hautbois. Viennent après cela toutes les personnes qui sont dans son intimité ; à leur suite, le frère du monarque Mobârec khân, avec ses insignes et ses troupes ; puis le neveu du sultan, Behram khân, avec ses insignes et ses troupes ; le cousin du sultan, le roi Firouz, avec ses insignes et ses troupes ; le vizir, avec ses insignes et ses troupes ; le roi Modjîr, fils de Dhoû’rrédja, avec ses insignes et ses troupes le grand roi Kaboûlah, avec ses insignes et ses troupes. Celui-ci est fort estimé du sultan ; il occupe un rang très élevé et possède d’immenses richesses. J’ai été informé par le personnage qui tient ses registres, ou son intendant, et qui est connu sous la dénomination de l’Homme de confiance du royaume, ’Alâ eddîn ’Aly almisry, appelé aussi Ibn Acchérâbichy, ou le fils du marchand de bonnets (du mot persan serpoûch, qui signifie « bonnet », etc.) que la dépense de Kaboûlah, de ses serviteurs, ainsi que le total de leurs salaires, s’élevait à trente-six lacs par an, c’est-à-dire trente-six fois cent mille dinars d’argent, ou trois millions six cent mille pièces d’argent. Après Kaboûlah viennent dans le cortège le roi Nocbïah, avec ses insignes et ses troupes ; le roi Boghrah, avec ses insignes et ses troupes ; le roi Mokhliss, avec ses insignes et ses troupes, et le roi Kothb almoulc avec ses insignes et ses troupes. Tous les individus que nous venons de nommer sont les principaux émirs, qui ne quittent jamais le sultan. Ils montent à cheval avec lui le jour de la fête, avec leurs insignes, tandis que les autres émirs en sont privés. Toutes les personnes qui montent à cheval dans cette solennité sont revêtues de leurs cuirasses, et leurs montures sont caparaçonnées. La plupart de ces gens sont des esclaves du monarque.
Lorsque le sultan est arrivé à la porte de l’oratoire, il s’arrête, et ordonne aux juges, aux principaux émirs et aux plus notables des personnages illustres d’entrer. Il descend après cela de sa monture, et l’imâm prie et prêche. S’il s’agit de la fête des sacrifices (l’autre est celle de la rupture du jeûne), le sultan amène un chameau et l’égorge avec une lance courte, qu’on appelle dans l’Inde (du mot persan) nîzeh, il a soin de recouvrir ses habits d’une serviette de soie, pour se garantir du sang. Cette cérémonie accomplie, il remonte sur l’éléphant et retourne à son palais.
Le jour de la fête on recouvre tout le château de tapis et on l’orne de la manière la plus somptueuse. On élève, sur tout l’espace du lieu de l’audience, la bârgah, qui ressemble à une immense tente. Elle est soutenue par de nombreuses et grosses colonnes, et est entourée de tous côtés par des coupoles ou pavillons. On forme des arbres artificiels avec de la soie de différentes couleurs, et où les fleurs sont aussi imitées. On les distribue en trois rangées dans toute la salle d’audience, et l’on place partout, entre ces arbres, des estrades d’or, surmontées d’un coussin recouvert de sa housse. Le trône magnifique est dressé sur le devant de la salle ; il est entièrement en or pur, et les pieds en sont incrustés de pierres précieuses ; il a de hauteur vingt-trois empans, et de targur, moitié environ. Il est composé de plusieurs pièces, qui se joignent ensemble et forment un tout. Chacune de ces pièces est portée par plusieurs hommes, à cause de la pesanteur de l’or. On place sur le trône le coussin, et l’on élève sur la tête du sultan le parasol incrusté de pierres précieuses. Quand le monarque monte sur son trône, les chambellans et les officiers crient à haute voix : « Au nom de Dieu ! » Alors les assistants s’avancent pour saluer le souverain, en commençant par les juges, les prédicateurs, les savants, les nobles et les cheikhs ; puis viennent les frères du sultan, ses proches parents, ses beaux-frères ou alliés et les personnages illustres. Ensuite le vizir, les commandants des troupes, les cheikhs des esclaves et les notables de l’armée. Ils saluent tous séparément, l’un après l’autre, sans presse et sans foule.
C’est l’usage, au jour de la fête, que chaque personne qui a été gratifiée du revenu de quelque village apporte des pièces d’or, enveloppées dans un lambeau d’étoffe, sur lequel elle écrit son nom, et qu’elle jette dans un bassin d’or, préparé à cet effet. On amasse ainsi une somme considérable, que le sultan donne à qui lui plaît. Les salutations accomplies, on dispose les mets pour les assistants, suivant le rang de chacun de ceux-ci.
On monte dans ce jour la grande cassolette, qui ressemble à une tour ; elle est en or pur et composée de diverses pièces qu’on joint à volonté. Il faut plusieurs hommes pour transporter chacune de ses parties. Dans son intérieur se trouvent trois cellules où entrent les hommes chargés de répandre les parfums ; ils allument le bois appelé kamâry ainsi que le kâkouly (sorte d’aloès), l’ambre gris et le benjoin, de façon que la vapeur de ces matières remplit toute la salle d’audience. De jeunes garçons tiennent à la main des barils d’or et d’argent, remplis d’eau de roses, et d’eau de fleurs d’oranger, qu’ils répandent à profusion sur les assistants.
Le trône et la cassolette dont nous avons parlé ne sont tirés du trésor qu’à l’occasion des deux grandes fêtes seulement. Les jours des autres solennités, le sultan s’assied sur un trône d’or inférieur au premier. On dresse alors un salle d’audience éloignée, pourvue de trois portes, et le sultan prend place à l’intérieur. A la première porte se tient debout ’Imad almoulc Sertîz, à la seconde le roi Nocbïah, et à la troisième Youçouf Boghrah. A droite et à gauche se tiennent debout les chefs des esclaves écuyers ou porte-épées ; la foule se tient pareillement debout, suivant le rang de chacun.
L’inspecteur de cette salle d’audience est le roi Thaghaï, qui porte à la main une baguette d’or : son substitut en porte une d’argent, et, tous les deux, ils placent les assistants et forment les files. Le vizir et les secrétaires sont debout, ainsi que les chambellans et les officiers.
Puis viennent les musiciennes et les danseuses, et d’abord les filles des rois indiens infidèles (les Hindous) qu’on a fait captives dans cette année-là. Elles chantent et dansent, et le sultan les donne aux émirs et aux personnages illustres. Après elles, arrivent les autres filles des infidèles, qui chantent aussi et dansent, et que le sultan donne à ses frères, à ses proches parents, à ses beaux-frères et aux fils des rois. Cette séance se tient après la prière de l’après-midi. Le souverain tient une autre séance le lendemain de la fête, à la même heure, et en suivant les mêmes dispositions. Les chanteuses viennent, elles chantent et dansent, et il les donne aux chefs des esclaves. Le troisième jour, il marie ses proches parents, qui reçoivent ses bienfaits ; le quatrième, il affranchit des hommes esclaves ; le cinquième, il affranchit des femmes esclaves ; le sixième, il marie ensemble des hommes et des femmes esclaves ; enfin le septième jour, il distribue de nombreuses aumônes.
Lorsque le souverain est de retour de ses voyages, on orne les éléphants, et l’on élève sur seize d’entre eux seize parasols, dont les uns sont brochés d’or, et les autres enrichis de pierres précieuses. On porte devant lui la ghâchiyah, qui est la housse servant à recouvrir la selle, et qui est incrustée des pierreries les plus fines. On construit des coupoles de bois partagées en plusieurs étages, et on les recouvre d’étoffes de soie. Dans chaque étage, on voit les jeunes esclaves chanteuses, revêtues de très beaux habillements et de parures fort jolies ; quelques-unes parmi elles dansent. Dans le centre de toutes ces coupoles, il y a un réservoir immense, fait avec des peaux, et rempli d’essence de roses ou de sirop dissous dans de l’eau. Tout le monde, sans exception, peut en boire, les nationaux comme les étrangers. Ceux qui en prennent reçoivent en même temps les feuilles de bétel et la noix d’arec. L’espace qui sépare les pavillons est recouvert d’étoffes de soie, que foule la monture du sultan. Les murailles des rues par lesquelles le souverain doit passer sont ornées aussi d’étoffes de soie, depuis la porte de la ville jusqu’à celle du château. Devant le monarque marchent ses esclaves, au nombre de plusieurs milliers ; la foule et les soldats sont par-derrière.
J’ai été présent quelquefois à son entrée dans la capitale, revenant de voyage. On avait dressé trois ou quatre petites balistes (littéralement, « petites machines tonnantes ; petits tonnerres »)sur les éléphants. Elles lançaient sur les assistants des pièces d’argent et d’or que ceux-ci ramassaient. Cela commença au moment de l’entrée du sultan dans la ville, et dura jusqu’à son arrivée au château.
Il y a deux sortes de repas dans le palais du sultan : celui des grands et celui du public. Quant au premier, c’est le repas où mange le souverain ; et il a l’habitude de faire cela dans la salle d’audience, en compagnie des personnes présentes. Ce sont : les émirs les plus intimes, l’émir chambellan, cousin du monarque, Imâd almoulc Sertîz, et l’émir madjlis, ou chef d’assemblée. Outre ceux-ci, le sultan invite les individus qu’il veut anoblir ou honorer, parmi les personnages illustres ou les principaux émirs, qui mangent ainsi avec lui. Il arrive quelquefois qu’il veut aussi honorer une des personnes qui se trouvent présentes. Alors il prend un plat avec sa main, il y place un pain et le passe à cette personne. Celle-ci le prend, le tient dans sa main gauche, et s’incline, en touchant la terre avec sa main droite. Souvent le souverain envoie quelque mets de ce repas à un individu absent de l’audience. Celui-ci, en le recevant fait sa révérence, à l’instar de l’individu présent, et mange ce mets avec les gens qui se trouvent en sa compagnie. J’ai assisté bien des fois à ce repas privé, et j’ai vu que le nombre de ceux qui y prenaient part était d’environ vingt hommes.
Les mets que l’on sert au public sont apportés des cuisines, et précédés par les principaux officiers, qui crient : « Au nom de Dieu ! » Ceux-ci ont en tête leur chef, lequel tient dans sa main une massue d’or, et son substitut, qui en tient une d’argent. Lorsqu’ils ont franchi la quatrième porte, et que ceux qui se trouvent dans la salle d’audience ont ainsi entendu leurs voix, ils se lèvent tous ensemble, et personne, si ce n’est le sultan, ne reste assis. Quand les mets sont posés à terre, les officiers se placent sur une seule ligne, le commandant à leur tête, qui parle à l’éloge du sultan, et fait son panégyrique. Il s’incline profondément après cela, tous les officiers l’imitent, de même que tous les assistants, sans exception, grands et petits. L’usage est que, dès qu’un individu entend la voix du chef des officiers dans cette circonstance, il s’arrête debout, s’il marchait, et garde sa place, s’il était debout et arrêté. Personne ne bouge, ni ne quitte sa place, jusqu’à ce que ledit personnage ait fini son discours. Après cela, son substitut parle d’une façon analogue à la sienne ; puis il s’incline, et il est imité en ceci par les officiers et le public, qui saluent ainsi une seconde fois. Alors tout le monde s’assied.
Les secrétaires, placés à la porte, écrivent pour informer le sultan de l’arrivée des aliments, bien que celui-ci le sache déjà. On donne le billet à un enfant choisi parmi les fils des rois, et qui est chargé spécialement de cette besogne ; il le remet au souverain, lequel, après l’avoir lu, nomme ceux des principaux commandants qu’il charge de présider à l’arrangement des assistants et à leur nourriture. Celle-ci consiste en pains, ressemblant plutôt à des gâteaux ; en viandes rôties ; en pains ronds, fendus et remplis de pâte douce ; en riz, en poulets, et en une sorte de hachis de viande. Nous avons parlé précédemment de toutes ces choses et expliqué leur distribution.
En tête du banquet se placent les juges, les prédicateurs, les jurisconsultes, les nobles et les cheikhs. Viennent après eux les parents du sultan, les principaux commandants et tout le public. Personne ne s’assied qu’à l’endroit qui lui a été destiné ; de sorte qu’il n’y a parmi eux jamais de presse. Les assistants étant placés, arrivent les chorbdârs, qui sont les échansons ; ils tiennent à la main des vases d’or, d’argent, d’airain et de verre remplis de sucre candi dissous dans l’eau : on boit cela avant de manger, et ensuite les chambellans s’écrient : « Au nom de Dieu ! » On commence alors le repas. Devant chaque personne, on place de tous les mets dont se compose le festin ; chacun les mange séparément, et nul n’est servi dans le même plat avec un autre individu. Le repas fini, on apporte une espèce de bière dans des pots d’étain, et, le public l’ayant bue, les chambellans disent encore : « Au nom de Dieu ! » On introduit les plats contenant le bétel et la noix d’arec ; on donne à chacun une pincée de celle-ci concassée, ainsi que quinze feuilles de bétel réunies ensemble et liées avec un fil de soie rouge. Les assistants ayant pris le bétel, les chambellans disent de nouveau : « Au nom de Dieu ! » Tout le monde se lève à ce moment, le commandant qui a présidé au repas salue ; le public en fait autant, et se retire. Cette sorte de festin a lieu deux fois par jour : la première, avant midi, et la seconde, après la prière de l’après-midi.
Je me propose de mentionner seulement les faits de ce genre auxquels j’ai été présent, dont j’ai été témoin, et que j’ai ainsi vus de mes propres yeux. Le Dieu très haut connaît la vérité des choses que je vais raconter, et l’on n’a pas besoin, outre cela, d’un autre témoignage. D’ailleurs, tout ce que je vais dire est bien divulgué et assez notoire. Les pays qui sont peu éloignés de l’Inde, tels que le Yaman, le Khoraçan et la Perse, sont remplis d’anecdotes sur ce prince, et leurs habitants les connaissent fort bien ; ils n’ignorent pas surtout sa bienfaisance envers les étrangers, qu’il préfère aux indigènes, qu’il honore, qu’il favorise largement, qu’il comble de bienfaits, auxquels il donne des emplois élevés et fait de riches présents. Un de ses bienfaits à l’égard des étrangers, c’est qu’il les nomme a’izzahs, ou « gens illustres », et défend qu’on les appelle étrangers. Il prétend qu’appeler un individu du nom d’étranger c’est lui déchirer le cœur et troubler son esprit. Je vais maintenant citer, s’il plaît à Dieu, un petit nombre de ses largesses et de ses dons magnifiques.
Ce Schihâb eddîn était un ami du roi des marchands Alcâzéroûny, surnommé Perouîz, auquel le sultan avait donné en fief la ville de Cambaie, et promis la charge de vizir. Alors Perouîz envoya dire à son ami Schihâb eddîn de venir le rejoindre, et celui-ci arrivé, avec un présent qu’il avait préparé pour le sultan, et qui était composé des objets suivants ; une petite maison en drap découpé enrichi de feuilles d’or, une grande tente analogue à la maisonnette, une petite tente avec ses accessoires, et une tente de repos, le tout en drap orné, enfin beaucoup de mulets. A l’arrivée de Schihâb eddîn avec son cadeau, son ami le roi des marchands allait partir pour la capitale. Il apportait les sommes qu’il avait amassées au moyen des impôts du pays qu’il gouvernait, et un cadeau pour le souverain.
Le vizir Khodjah Djihan, ayant appris que le sultan avait promis à Perouîz le vizirat, en devint jaloux et en fut troublé. Les pays de Cambaie et du Guzarate étaient, avant ce temps-là, sous la dépendance du vizir ; leurs populations étaient attachées à celui-ci, dévouées entièrement à lui et promptes à le servir. La plupart de ces peuples étaient des infidèles, et une partie d’entre eux des rebelles qui se défendaient dans les montagnes. Le vizir leur suggéra de tomber sur le roi des marchands lorsqu’il se dirigerait vers la capitale. En effet, quand Perouîz sortit avec ses trésors et ses biens, Schihâb eddîn, portant son cadeau, l’accompagna, et ils campèrent un jour avant midi, suivant leur habitude. Les troupes qui les escortaient se dispersèrent, et le plus grand nombre se mit à dormir. Les infidèles tombèrent sur eux dans ce moment en force considérable, ils tuèrent le roi des marchands, pillèrent ses biens et ses trésors, ainsi que le présent de Schihâb eddîn. Celui-ci put seulement sauver sa propre personne.
Les rapporteurs de nouvelles écrivirent au sultan ce qui s’était passé, et celui-ci ordonna de gratifier Schihâb eddîn d’une somme de trente mille pièces d’or, à prendre sur les revenus du pays de Nehrouâlah, et qu’il eût à retourner ensuite dans sa patrie. On lui présenta ce trésor ; mais il refusa de l’accepter, en disant que son seul but était de voir le sultan et de baiser la terre en sa présence. Le sultan en fut informé ; il approuva ce désir, et commanda que Schihâb eddîn se rendît à Dihly, avec toutes sortes d’honneurs.
Or il arriva qu’il fut introduit pour la première fois chez le souverain le jour même de notre introduction près de celui-ci, qui nous donna à tous des robes d’honneur, ordonna de nous loger, et fit un riche présent à Schihâb eddîn. Quelque temps après, le sultan donna ordre qu’on me payât six mille tengahs ou pièces d’or, ainsi que nous le raconterons ; et il demanda ce jour-là où était Schihâb eddîn. Alors Bêhâ eddîn, fils d’Alfalaky (l’astrologue), lui répondit : « O maître du monde, némîdânem » ; ce qui veut dire : « Je ne sais pas. » Puis il ajouta : « Chunîdem zehmet dâred », dont le sens est : « J’ai entendu dire qu’il est malade. » Le sultan reprit : « Berev hemîn zémân der khazâneh iec leki tengahi zer biguiri ve pîch oû bebérî tâ dili oû khoûch chéved. » Le sens de ceci est : « Va à l’instant dans le trésor, prends-y cent mille pièces d’or, et porte-les à Schihâb eddîn, afin que son cœur soit satisfait. » Bêhâ eddîn exécuta cet ordre, et le sultan commanda que Schihâb eddîn achetât avec cette somme les marchandises de l’Inde qu’il préférait, et que personne n’eût à acheter la moindre chose, jusqu’au moment où celui-ci aurait fait toutes ses provisions. Il mit à sa disposition trois bâtiments fournis de tous leurs agrès, de la paye des matelots et de leurs vivres, pour s’en servir dans son voyage. Schihâb eddîn partit, et débarqua dans l’île de Hormouz, où il fit bâtir une maison magnifique. Je l’ai vue plus tard, mais j’ai vu aussi Schihâb eddîn, qui avait perdu toute sa fortune, et qui se trouvait à Chiraz, sollicitant quelque chose de son souverain Abou Ishak. Telle est la fin ordinaire des trésors acquis dans l’Inde. Il est rare qu’un individu quitte ce pays avec les biens qu’il a amassés ; si cela lui arrive, et s’il se rend dans une autre contrée, Dieu lui envoie un malheur qui engloutit tous ses biens. C’est ainsi que la chose se passa à l’égard de ce Schihâb eddîn ; il fut dépouillé de tout son avoir, dans la guerre civile qui éclata entre le roi de Hormouz et ses deux neveux ; et il quitta le pays après que toutes ses richesses eurent été pillées.
Le sultan avait envoyé un présent au calife Abou’l Abbâs qui se trouvait en Égypte, le priant de lui expédier une ordonnance qui reconnaîtrait son autorité sur les pays de l’Inde et du Sind. C’était là l’effet de son profond attachement pour le califat. Abou’l Abbâs fit partir ce que sollicitait le sultan, en compagnie du grand cheikh de l’Égypte, Rocn eddîn. Quand celui-ci arriva près du souverain de l’Inde, il en fut excessivement honoré, et reçut de lui un riche cadeau. Toutes les fois que Rocn eddîn entrait chez le sultan, ce dernier se levait et le comblait de marques de vénération ; puis il le congédia, en lui donnant des richesses considérables, parmi lesquelles il y avait un certain nombre de plaques pour les pieds des chevaux, ainsi que leurs clous, le tout en or pur et massif. Il lui dit : « Lorsque tu débarqueras, tu mettras ceci aux sabots de tes chevaux, en place de fers. » Rocn eddîn partit pour Cambaie, afin d’y prendre la mer, jusqu’au Yémen ; mais dans ce moment eurent lieu la révolte du juge Djélal eddîn et la saisie qu’il opéra sur les biens du fils d’Alcaoulémy ; et on prit aussi ce qui appartenait au grand cheikh. Celui-ci, et le fils d’Alcaoulémy, s’enfuirent tous les deux près du sultan, qui, voyant Rocn eddîn, lui dit (en langue persane) en plaisantant : « Amédi kih zer béri bâ diguéri sanam khouri zer nébéri ve ser nihi » ; ce qui signifie : « Tu es venu pour emporter de l’or et le dépenser avec les belles ; mais tu n’auras pas d’or, et tu laisseras ici ta tête. » Le prince lui dit cela pour s’amuser ; puis il reprit : « Sois tranquille ; car je vais marcher contre les rebelles, et je te donnerai plusieurs fois autant que ce qu’ils t’ont enlevé. » Après mon départ de l’Inde, j’ai su que le sultan lui avait tenu parole, qu’il lui avait remplacé tout ce qu’il avait perdu, et que Rocn eddîn était arrivé en Égypte avec ses biens.
Ce jurisconsulte prédicateur était venu trouver le sultan, et il était resté près de lui une année, jouissant de ses faveurs ; puis il désira retourner dans sa patrie, et il en obtint la permission. Le sultan ne l’avait pas encore entendu parler ni prêcher ; mais, avant de partir pour un voyage qu’il allait entreprendre dans la contrée de Ma’bar, il voulut l’entendre. Il ordonna, en conséquence, qu’on lui préparât une chaire de bois de sandal blanc, appelé almohâssiry. On l’orna avec des plaques et des clous d’or, et l’on adapta à sa partie supérieure un rubis magnifique. On revêtit Nasir eddîn d’une robe abbâside, noire, brodée d’or, enrichie de pierres précieuses, et on le coiffa d’un turban, analogue à la robe. La chaire fut placée dans l’intérieur de la sérâtcheh, ou petit palais, autrement dite afrâdj, Le sultan s’assit sur son trône, ayant ses principaux favoris à droite et à gauche. Les juges, les jurisconsultes et les chefs prirent leurs places. Nasir eddîn prononça un sermon éloquent ; il avertit, il exhorta ; mais il n’y avait aucun mérite extraordinaire dans ce qu’il fit ; seulement la fortune le servit. Quand il fut descendu de la chaire, le sultan se leva, alla vers lui, l’embrassa, et le fit monter sur un éléphant. Il ordonna à tous les assistants, et j’étais du nombre, de marcher à pied devant Nasir eddîn pour se rendre au petit palais qu’on avait élevé exprès pour lui, vis-à-vis celui du souverain. Ce petit palais était en soie de différentes couleurs ; la grande tente était aussi en soie, de même que la petite. Nous nous assîmes avec Nasir eddîn, et vîmes dans un coin de la sérâtcheh les ustensiles en or que le sultan lui avait donnés. Il y avait : un grand poêle, dans l’intérieur duquel pouvait tenir un homme assis ; deux chaudières ; des plats en grand nombre ; plusieurs pots ; une cruche ; une témîcendeh (?); enfin, une table à manger, avec quatre pieds, et un support ou pupitre pour les livres. Tout cela était en or pur. Il arriva que ’Imad eddîn assimnâny retira deux des pieux de la sérâtcheh, dont l’un était en cuivre, l’autre en étain ; on supposa alors qu’ils étaient en or et en argent ; mais, en réalité, ils étaient faits avec les métaux que nous avons mentionnés. Ajoutons que, lors de l’arrivée de Nasir eddîn près du sultan, celui-ci lui donna cent mille dinars d’argent, et des centaines d’esclaves, dont il affranchit une partie, et prit l’autre avec lui.
Cet ’Abdelaziz était un jurisconsulte traditionnaire, qui avait étudié à Damas, sous Taky eddîn, fils de Taïmiyyah ; sous Borhân eddîn, fils d’Albarcah ; Djémal eddîn almizzy ; Chams eddîn addhahaby, et autres encore. Il se rendit ensuite près du sultan de l’Inde, qui le combla de bienfaits, et l’honora beaucoup. Un jour, il arriva que le jurisconsulte exposa au souverain un certain nombre de traditions sur le mérite d’Abbâs et de son fils, ainsi que des récits concernant les vertus des califes, leurs descendants. Le sultan fut très satisfait de cela, à cause de son attachement pour la maison d’Abbâs. Il baisa les pieds du légiste, et ordonna qu’on apportât une soucoupe d’or, dans laquelle il y avait deux mille tengahs, qu’il versa sur lui de sa propre main, en lui disant : « Cette somme est à toi, de même que la soucoupe. » Mais nous avons déjà fait mention de cette anecdote dans le volume précédent.
Le jurisconsulte Chams eddîn alandocâny était philosophe, et poète inné. Il loua le sultan dans un petit poème en langue persane, dont le nombre de vers était de vingt-sept distiques. Le souverain lui donna mille dinars d’argent pour chacun de ceux-ci. C’est beaucoup plus que ce qu’on raconte à ce sujet des anciens, qui donnaient, dit-on, mille drachmes pour chaque vers. Ceci ne fait que le dixième du prix qu’en a payé le sultan.
’Adhoud eddîn était un jurisconsulte et un imâm distingué ; son mérite était grand, ainsi que sa renommée, laquelle était fort répandue dans les contrées qu’il habitait. Le sultan fut informé de ses actes et entendit parler de ses vertus. Or il lui envoya dans son pays, le Chéouancâreh, dix mille dinars d’argent ; mais il ne le vit jamais, et ce jurisconsulte n’alla pas le visiter.
Quand le sultan connut l’histoire de Madjd eddîn, juge à Chiraz, ce kadi savant, intègre, et auteur de miracles célèbres, il lui envoya à Chiraz dix mille dinars en argent, portés par le cheikh Zâdeh de Damas. Nous avons déjà retracé, dans la première partie de ces voyages, les aventures de Madjd eddîn, et nous en reparlerons de nouveau plus loin.
Borhân eddîn était un imam prédicateur d’une grande libéralité : il prodiguait son bien, de façon que souvent il faisait des dettes, pour être libéral envers les autres. Lorsque son histoire parvint au sultan, celui-ci lui expédia quarante mille dinars, et le sollicita de se rendre dans sa capitale. L’imam accepta la somme d’argent, avec laquelle il paya ses dettes ; puis il se rendit dans le pays de Khatha (le nord de la Chine), et il refusa d’aller vers le souverain de l’Inde. Il dit à ce propos : « Je n’irai point chez un sultan devant lequel les savants se tiennent debout. »
Hadji Câoun était cousin germain du sultan Aboû Sa’id, roi de l’Irak (ou de la Perse) ; et son frère Mouça était roi d’une petite partie de ce dernier pays. Ce Hadji Câoun alla rendre une visite au souverain de l’Inde, qui le traita avec de grands honneurs, et lui fit des cadeaux magnifiques. Je le vis une fois au moment où le vizir Khodjah Djihân avait apporté un cadeau pour le sultan, dont faisaient partie trois soucoupes remplies, l’une de rubis, l’autre d’émeraudes, et la troisième, de perles. Hadji Câoun, qui était présent, reçut du monarque une portion considérable de ce don ; et plus tard, des richesses énormes. Il partit ensuite, se dirigeant vers l’Irak ; mais à son arrivée il trouva que son frère Mouça était mort, et que le khân Soleïman régnait à sa place. Il réclama l’héritage de son frère, se déclara roi, et les troupes lui prêtèrent serment. Alors il se rendit dans le Farsistân, et fit halte près de la ville de Chéouancâreh, où se trouvait l’imâm ’Adhoud eddîn, dont nous avons parlé précédemment. Quand il fut campé à l’extérieur de la ville, les cheikhs qui l’habitaient tardèrent environ une heure à se rendre auprès de lui. Il sortirent ensuite, et Câoun leur dit : « Qu’est-ce qui vous a empêchés de venir plus vite pour me prêter hommage ? » Ils s’excusèrent ; mais il n’admit point leurs justifications, et il dit (en turc) aux soldats qui l’accompagnaient : Kilidj tchikâr, c’est-à-dire : « Dégainez les sabres. » Ceux-ci obéirent, et ils coupèrent les cous des cheikhs, qui étaient fort nombreux.
Les émirs qui se trouvaient dans le voisinage de cette ville, ayant été informés de cet événement, en furent indignés, et écrivirent à Chams eddîn assimnâny, un des principaux émirs et jurisconsultes, pour lui faire savoir ce qui s’était passé contre les gens de Chéouancâreh. Ils imploraient de lui des secours pour combattre Câoun, et Chams eddîn sortit à la tête de ses troupes. Les habitants se réunirent, désireux de venger le meurtre des cheikhs qui avaient été tués par Hadji Câoun. Ils attaquèrent son armée pendant la nuit, et la mirent en fuite. Câoun se trouvait dans le château de la ville, qu’ils entourèrent ; il s’était caché dans les lieux d’aisances ; mais ils le découvrirent et lui tranchèrent la tête. Ils envoyèrent celle-ci à Soleïman Khân, et répandirent les membres dans plusieurs contrées, afin d’assouvir ainsi leur vengeance contre Hadji Câoun.
L’émir Ghiâth eddîn Mohammed, fils d’Abd alkâlihr, fils de Youçouf, fils d’Abd al’azzîz, fils du calife Almostansir billah, al’abbâçy, albaghdâdy, avait été trouver le sultan ’Alâ eddîn Thermachîrîn, roi de la Transoxiane. Celui-ci le traita avec beaucoup d’honneur, et lui donna un ermitage construit sur le tombeau de Kotham, fils d’Al’abbâs, où Ghiâth eddîn demeura plusieurs années. Lorsqu’il entendit parler, plus tard, de l’affection que le sultan de l’Inde avait pour la famille d’Abbâs, et de sa persistance à reconnaître ses droits, il désira se rendre auprès de lui, et il lui expédia, à cet effet, deux envoyés. L’un d’eux était son ancien ami Mohammed, fils d’Abou Accharafy alharbâouy ; l’autre était Mohammed alhamadâny assoûfy ; ils se rendirent près du sultan. Or il arriva que Nasir eddîn attermedhy, dont nous avons parlé plus haut, avait fait la rencontre de Ghiâth eddîn à Bagdad, et que les habitants de cette ville lui avaient certifié l’authenticité de la généalogie dudit Ghiâth eddîn. A son tour, Nasir eddîn porta témoignage, à ce sujet, chez le souverain de l’Inde. Quand les deux ambassadeurs furent arrivés, le sultan leur donna cinq mille dinars ; en outre, il leur consigna trente mille dinars, destinés à être remis à Ghiâth eddîn, et à servir pour ses frais de route jusqu’à Dihly. De plus, il lui écrivit une lettre de sa propre main, où il lui témoignait du respect, et le sollicitait de venir le trouver. Il partit, en effet, dès qu’il reçut cette missive.
Lorsque Ghiâth eddîn fut parvenu dans le Sind, et que les donneurs de nouvelles le firent savoir au sultan, celui-ci envoya des personnes chargées, selon l’habitude, d’aller à sa rencontre. Quand il fut arrivé à Sarsati, le sultan envoya, pour le recevoir, Sadr Aldjihân, le kadi en chef, nommé Kamal eddîn alghaznéouy, ainsi qu’une foule de jurisconsultes ; puis il fit partir, dans ce même but, les émirs ; et quand Ghiâth eddîn fit halte à Maç’oud Abad, à l’extérieur de la capitale, il sortit en personne à sa rencontre. Alors Ghiâth eddîn mit pied à terre, et le sultan en fit autant ; le premier s’inclina profondément, et le sultan lui rendit le salut de la même manière. Ghiâth eddîn apportait un cadeau dont faisaient partie des habillements. Le sultan prit un de ceux-ci, le mit sur son épaule, et s’inclina de la même façon qu’on le pratique à son égard. On amena les chevaux, le sultan en prit un dans sa main, le conduisit à Ghiâth eddîn, qu’il conjura de monter ; il tint lui-même l’étrier. Le souverain monta à cheval et chemina à côté de Ghiâth eddîn ; un seul parasol les recouvrait tous les deux. Il prit dans sa main le bétel et l’offrit à Ghiâth eddîn : ce fut là la marque la plus grande de considération qu’il lui donna ; car il ne fait cela pour personne. Le monarque lui dit : « Si je n’avais pas déjà prêté serment au calife Aboû’l’abbâs, je te le prêterais à toi, » Ghiâth eddîn répondit : « Moi aussi j’ai prêté le même serment. » Puis il ajouta : « Mahomet a dit : “Celui qui vivifie une terre déserte et inculte en devient le maître.” Et c’est toi qui nous as fait revivre. » Le sultan répliqua de la manière la plus agréable et la plus bienveillante ; et, quand ils furent arrivés à la tente ou petit palais préparé pour le souverain, celui-ci y fit descendre Ghiâth eddîn, et l’on en éleva un autre pour lui. Ils passèrent tous les deux une nuit à l’extérieur de la capitale.
Le lendemain, ils firent leur entrée dans celle-ci, et le sultan fit descendre Ghiâth eddîn dans la ville nommée Sîri, et aussi le séjour du califat, dans le château bâti par ’Alâ eddîn alkhâldjy, et par son fils Kothb eddîn, Il ordonna à tous les émirs de l’y accompagner ; et il avait fait préparer dans ce château tous les ustensiles d’or et d’argent dont son hôte pouvait avoir besoin. On y remarquait un grand vase tout en or, pour se laver. Le sultan envoya à Ghiâth eddîn quatre cent mille dinars, selon l’usage, pour la toilette de sa tête ; une foule de jeunes garçons, de serviteurs, et de femmes esclaves ; et il lui assigna, pour sa dépense journalière, la somme de trois cents dinars. Il lui envoya en sus un certain nombre de tables, fournies d’aliments, provenant du repas privé. Il lui donna en fief toute la ville de Sîri et toutes ses maisons, ainsi que les jardins et les champs du magasin, ou trésor, adjacents à la ville. Il lui donna encore cent villages, et lui conféra l’autorité sur les lieux qui sont placés près de Dihly, du côté du levant. Il lui fit cadeau de trente mules, avec leurs selles dorées, et commanda que leur fourrage fût fourni par le trésor. Le souverain ordonna à Ghiâth eddîn de ne pas descendre de sa monture, lorsque celui-ci irait le visiter dans son palais ; si ce n’est pourtant dans un lieu réservé où personne, excepté le sultan, ne doit entrer à cheval. Enfin, il commanda à tous, grands et petit, de rendre hommage à Ghiâth eddîn, comme ils le faisaient à sa propre personne. Quand Ghiâth eddîn entrait chez le sultan, celui-ci descendait de son trône, et s’il était assis sur un fauteuil, il se levait. Ils se saluaient l’un l’autre, et s’asseyaient sur le même tapis. Lorsque Ghiâth eddîn se levait, le sultan en faisait autant, et ils se saluaient ; s’il désirait de se rendre à l’extérieur de la salle d’audience, on y plaçait pour lui un tapis, où il s’asseyait le temps qu’il voulait, et il partait ensuite. Ghiâth eddîn agissait ainsi deux fois dans la journée.
Pendant le temps où le fils du calife se trouvait à Dihly, le vizir arriva du Bengale ; et le sultan donna ordre aux principaux commandants de sortir à sa rencontre. Il en fit autant lui-même, et honora excessivement son vizir. On éleva dans la ville plusieurs coupoles ou pavillons, comme on le pratique à l’arrivée du souverain. Le fils du calife, les jurisconsultes, les juges et les notables se rendirent tous à la rencontre du vizir. Quand le sultan retourna à son palais, il dit à celui-ci : « Va chez le makhdoûm zâdeh. » C’est ainsi qu’il appelait le fils du calife ; et le sens de ces mots est « le fils du maître ». Le vizir se rendit donc au palais de Ghiâth eddîn ; il lui fit cadeau de deux mille tengahs ou pièces d’or, et de beaucoup de vêtements. L’émir Kaboûlah et plusieurs autres des principaux commandants étaient présents. Moi-même je m’y trouvais.
Le roi de Ghazna, appelé Behram, s’était rendu auprès du sultan ; et il existait entre lui et le fils du calife une inimitié ancienne. Le souverain ordonna de loger Behram dans une des maisons de la ville de Sîri, qu’il avait donnée au fils du calife, et de lui bâtir un palais dans ladite ville. Quand le fils du calife sut cela, il se mit en colère, il se rendit au château du sultan, s’assit sur le tapis qui lui servait habituellement, et envoya chercher le vizir. Il lui parla en ces termes : « Salue de ma part le maître du monde, et dis-lui que tous les trésors qu’il m’a donnés se trouvent intacts dans mon hôtel, je n’ai disposé de rien ; au contraire, ils ont augmenté de beaucoup chez moi. Je ne resterai pas plus longtemps avec vous. » Il se leva et partit. Alors le vizir demanda à un des compagnons de Ghiâth eddîn la cause d’un tel discours ; et il sut que c’était l’ordre que le sultan avait donné de construire un palais à Sîri, pour le roi de Ghazna.
Le vizir se rendit chez le souverain et l’informa de cet événement. Ce dernier monta à cheval sans perdre un instant, et se rendit chez le fils du calife, accompagné par dix de ses gens. Il se fit annoncer, descendit de cheval à l’extérieur du palais, dans le lieu où le public met pied à terre, vit Ghiâth eddîn et lui fit ses excuses. Celui-ci les agréa ; mais le sultan lui dit : « Pour Dieu, je ne saurai point que tu es satisfait de moi qu’après que tu auras placé ton pied sur mon cou. » Ghiâth eddîn lui répondit : « Je ne ferai pas une telle chose, quand bien même je devrais mourir. » Le sultan reprit : « J’en jure par ma tête, il faut absolument que tu fasses cela. » Il posa sa tête sur le sol ; le grand roi Kaboûlah prit avec sa main le pied du fils du calife et le plaça sur le cou du souverain, qui se leva alors et dit : « Je sais maintenant que tu es satisfait de moi, et je suis tranquille. » Ceci est une histoire singulière, et l’on n’en connaît pas la pareille de la part d’un autre roi.
Je me trouvais un jour de fête avec ce Ghiâth eddîn, au moment où le grand roi Kaboûlah lui apporta, au nom du sultan, trois vêtements d’honneur fort amples. En place des nœuds ou boutons en soie qui servent à les fermer, on y avait mis des boutons de perles, du volume d’une grosse noisette. Kaboûlah attendit à la porte du palais la sortie du fils du calife, et le revêtit desdits habillements. En somme, les dons que ce personnage a reçus du sultan de l’Inde ne peuvent être ni comptés ni déterminés. Malgré tout cela, le fils du calife est la plus avare des créatures de Dieu ; et l’on connaît de lui, à ce sujet, des aventures étonnantes, qu’il peut être agréable d’entendre. On pourrait dire qu’il occupe, parmi les avares, le rang que le sultan tient parmi les généreux. Nous allons raconter quelques-unes de ces aventures.
Des rapports d’amitié existaient entre moi et le fils du calife ; j’allais souvent chez lui, et lorsque je partis, je lui laissai même un de mes fils, du nom d’Ahmed. Maintenant je ne sais pas ce qu’ils sont devenus l’un et l’autre. Je dis un jour au fils du calife : « Pourquoi manges-tu tout seul, et ne réunis-tu point tes compagnons pour le repas ? Il me répondit : « Le cœur me manque de les voir en si grand nombre, et tous manger mon pain ! » Ainsi, il se nourrissait isolément, il donnait à son ami Mohammed, fils d’Abou Accharafy, une partie des aliments pour les personnes qu’il voulait, et s’emparait du reste.
J’allais et venais dans sa demeure, ainsi que je l’ai dit, et je voyais au soir le vestibule du palais qu’il habitait, tout à fait obscur ; aucune lampe ne l’éclairait. Souvent j’ai aperçu Ghiâth eddîn ramassant dans son jardin de petites branches de bois à brûler, dont il avait déjà rempli des magasins. Je lui fis quelques observations sur cela ; mais il me répondit : « On en a besoin. » il employait ses compagnons, ses mamlouks, ainsi que les jeunes garçons, au service du jardin et de ses bâtisses ; il avait l’habitude de dire : « Je ne serais pas satisfait de les voir manger mes aliments sans servir à rien. » Une fois j’avais une dette, pour laquelle on me poursuivait ; il me dit plus tard : « J’en jure par Dieu, j’avais l’intention d’acquitter la dette en ta faveur ; mais mon âme (ma cupidité) ne me l’a pas permis, et ne m’a pas encouragé à cette action. »
Un jour, il me raconta ce qui suit : « Je sortis, dit-il, de Bagdad, en compagnie de trois autres individus (l’un de ceux-ci était son ami Mohammed, fils d’Abou Accharafy) ; nous étions à pied et n’avions avec nous aucune provision. Nous nous arrêtâmes près d’une source d’eau, ou fontaine, dans un village, et l’un de nous trouva une drachme dans la source. Nous dîmes : « Que ferons-nous de cette petite pièce d’argent ? » Nous nous décidâmes à acheter du pain avec cela, et envoyâmes un de nous quatre pour faire cette emplette ; mais le boulanger du village se refusa de lui vendre du pain seulement ; il voulut débiter du pain pour la valeur d’un carat et de la paille pour le même prix. Il acheta donc le pain et la paille ; nous jetâmes celle-ci, puisque nous n’avions point de bête de somme qui pût la manger, et nous partageâmes le pain par bouchée. Tu vois aujourd’hui dans quelles conditions de fortune je me trouve ! » Je lui dis : « Il faut que tu loues Dieu pour les faveurs qu’il t’a prodiguées, que tu honores les fakirs et les pauvres, et que tu fasses l’aumône. » Il répondit : « Ceci m’est impossible. » Je ne l’ai jamais vu user d’aucune libéralité, ni pratiquer le moindre bienfait. Que Dieu nous garde de l’avarice !
A mon retour de l’Inde, je me trouvais un jour à Bagdad et j’étais assis à la porte du collège, ou école, appelée Almostansiriyah, qui avait été fondée par l’aïeul de Ghiâth eddîn, c’est-à-dire par le prince des croyants, Almostansir. Je vis un malheureux jeune homme, courant derrière un individu qui sortait du collège, et l’un des étudiants me dit : « Ce jeune homme que tu vois, c’est le fils de l’émir Mohammed, lequel se trouve dans l’Inde, et qui est le petit-fils du calife Almostansir. » Alors je l’appelai et lui dis : « J’arrive de l’Inde, et je puis te donner des nouvelles de ton père. » Il me répondit : « J’en ai reçu ces jours-ci. » Il me quitta et continua de courir après l’individu. Je demandai qui était celui-ci, et l’on me dit que c’était l’inspecteur des legs pieux ; que le jeune homme était imâm ou directeur spirituel dans une mosquée ; qu’il recevait pour cela la récompense d’une seule drachme par jour, et qu’il réclamait de cet homme ses honoraires. Je fus très étonné de cet événement. Pour Dieu, si son père lui avait seulement envoyé une des perles qui se trouvent dans les robes d’honneurs qu’il a reçues du sultan de l’Inde, il aurait enrichi ce jeune garçon. Que Dieu nous garde d’un pareil état de choses !
Quand cet émir arriva chez le sultan, il fut très bien reçu, et fut logé dans le château du sultan défunt, Djélal eddîn, à l’intérieur de Dihly. Ce château est appelé Cohc La’l, ce qui signifie « le château rouge » (ou couleur de rubis). Il est très grand, avec une salle d’audience fort vaste, et un vestibule immense. Près de la porte se voit une coupole qui domine sur cette salle d’audience, ainsi que sur une seconde, par laquelle on entre dans le palais. Le sultan Djélal eddîn avait l’habitude de s’asseoir dans le pavillon, et l’on jouait au mail devant lui dans cette salle d’audience. J’entrai dans ce palais à l’arrivée de Saïf eddîn, et je le trouvai tout rempli de mobilier, de lits, de tapis, etc. ; mais tout cela était déchiré et ne pouvait plus servir. Il faut savoir que l’usage est, dans l’Inde, de laisser le château du sultan, à sa mort, avec tout ce qu’il contient ; on n’y touche pas. Son successeur fait bâtir pour lui un autre palais. En entrant dans ledit château, je le parcourus en tous sens, et montai sur le point le plus élevé. Ce fut là pour moi un enseignement qui fit couler mes larmes. Il y avait en ma compagnie le jurisconsulte, le médecin littérateur, Djémal eddîn almaghréby, originaire de Grenade, né à Bougie, et fixé dans l’Inde, où il était arrivé avec son père, et où il avait plusieurs enfants. A la vue de ce château, il me récita ce distique (où l’on remarque dans le texte, des jeux de mots):
Interroge la terre, si tu veux avoir des nouvelles de leurs sultans ; car les chefs sublimes ne sont plus que des os.
Ce fut dans ce château qu’eut lieu le festin du mariage de Saïf eddîn, comme nous le dirons ci-après. Le souverain de l’Inde aimait beaucoup les Arabes, il les honorait et reconnaissait leurs mérites. Lorsqu’il reçut la visite de cet émir, il lui prodigua les cadeaux et le combla de bienfaits. Une fois, en recevant les présents du grand roi Albâyazîdy, du pays de Mânicpoûr, le sultan donna à Saïf eddîn onze chevaux de race ; une autre fois, dix chevaux, avec leurs selles dorées et les brides également dorées. Après cela, il le maria avec sa propre sœur, Firouz Khondah (l’heureuse maîtresse).
Quand le sultan eût ordonné de célébrer le mariage de sa sœur avec l’émir Ghada, il désigna, pour diriger tout ce qui regardait le festin et ses dépenses, le roi Fath Allah, nommé Cheounéouîs ; il me désigna pour assister l’émir Ghada, et passer avec lui les jours de la noce. Le roi Fath Allah fit apporter de grandes tentes, avec lesquelles il ombragea les deux salles d’audience, dans le Château Rouge ci-dessus mentionné. On éleva dans l’une et dans l’autre une coupole extrêmement vaste, dont le plancher fut recouvert de fort beaux tapis. Le chef des musiciens, Chams eddîn attibrîzy, arriva, accompagné de chanteurs des deux sexes, ainsi que de danseuses. Toutes les femmes étaient des esclaves du sultan. On vit arriver aussi les cuisiniers, les boulangers, les rôtisseurs, les pâtissiers, les échansons et les porteurs de bétel. On égorgea les bestiaux et les volailles, et l’on donna à manger au public durant quinze jours. Les chefs les plus distingués et les personnages illustres se trouvaient présents nuit et jour. Deux nuits avant celle où devait avoir lieu la cérémonie de la conduite de la nouvelle mariée à la demeure de son époux, les princesses (khatouns) se rendirent du palais du sultan au Château Rouge. Elles l’ornèrent, le recouvrirent des plus jolis tapis et firent venir l’émir Saïf eddîn. Il était Arabe, étranger, sans parenté ; elles l’entourèrent et le firent asseoir sur un coussin destiné pour lui. Le sultan avait commandé que sa belle-mère, la mère de son frère Mobârec khân, tînt la place de la mère de l’émir Ghada ; qu’une autre dame, parmi les khatouns, tînt celle de sa sœur ; une troisième, celle de sa tante paternelle ; et une quatrième, la place de sa tante maternelle : de sorte qu’il pût se croire au milieu de sa famille. Quand ces dames eurent fait asseoir l’émir Ghada sur son coussin, elles teignirent ses mains et ses pieds en rouge avec de la poudre de hinnâ. Quelques-unes d’entre elles restèrent debout en sa présence ; elles chantèrent et dansèrent. Elles se retirèrent après cela, et se rendirent au château de la mariée. L’émir Ghada resta avec ses principaux compagnons.
Le sultan nomma une troupe d’émirs qui devaient tenir le parti de l’émir Ghada, et une autre, pour tenir celui de la nouvelle mariée. L’usage est, dans l’Inde, que ceux qui représentent la femme, se placent à la porte de l’appartement où doit se consommer le mariage. L’époux arrive avec sa suite ; mais ils n’entrent que s’ils remportent la victoire sur les autres. Dans le cas où ils ne réussissent point, il leur faut donner plusieurs milliers de pièces d’or à ceux qui sont du côté de la mariée. Au soir, on apporta à l’émir Ghada une robe de soie bleue, chamarrée d’or et de pierres précieuses ; celles-ci étaient en si grande quantité qu’elles ne permettaient pas de distinguer la couleur du vêtement. Il reçut aussi une calotte analogue à l’habit ; et je n’ai jamais connu un habillement plus beau que celui dont je parle. J’ai pourtant vu les robes que le sultan a données à ses autres beaux-frères ou alliés, tels que le fils du roi des rois, ’Imad eddîn assimnâny ; le fils du roi des savants ; le fils du cheikh de l’islamisme, et le fils de Sadr Djihan albokhâry. Parmi toutes ces robes, aucune ne pouvait soutenir le parallèle avec la robe donnée par le sultan à Ghada.
L’émir Saïf eddîn monta à cheval avec ses camarades et ses esclaves ; tous avaient dans la main un bâton, préparé d’avance. On avait fait une sorte de couronne avec des jasmins, des roses musquées et des reïboûls (fleurs de couleur blanche, dont il sera encore question plus loin). Elle était pourvue d’un voile, qui recouvrait la figure et la poitrine de celui qui la ceignait. On l’apporta à l’émir, afin qu’il la plaçât sur sa tête ; mais il refusa. Il était, en effet, un Arabe du désert, et ne connaissait rien aux habitudes des empires et des villes. Je le priai et le conjurai tant qu’il mit la couronne sur sa tête. Il se rendit à bâb assarf, qu’on appelle aussi bâb alharam (la porte du harem, ou du gynécée, etc.), et où se trouvaient les champions de la mariée. Il les attaqua, à la tête de ses gens, à la vraie manière des Arabes, renversant tous ceux qui s’opposèrent à eux. Ils obtinrent une victoire complète ; car la troupe de la nouvelle mariée ne put point soutenir un pareil choc. Quand le sultan sut cela, il en fut très satisfait.
L’émir Ghada fit son entrée dans la salle d’audience, où la mariée se trouvait, assise sur une estrade élevée, ornée de brocart et incrustée de pierres précieuses. Tout ces vaste local était rempli de femmes ; les musiciennes avaient rapporté plusieurs sortes d’instruments de musique ; elles étaient toutes debout, par respect et par vénération pour le marié. Celui-ci entra à cheval, jusqu’à ce qu’il fût proche de l’estrade ; alors il mit pied à terre et salua profondément près du premier degré de cette estrade. L’épouse se leva et resta debout, jusqu’à ce qu’il fût monté ; elle lui offrit le bétel de sa propre main ; il le prit, et s’assit un degré au-dessous de celui où elle s’était levée. On répandit des pièces d’or parmi les compagnons de Ghada qui étaient présents, et les femmes les ramassèrent. Dans ce moment-là, les chanteuses chantaient, et l’on jouait des tambours, des cors et des trompettes à l’extérieur de la porte. L’émir se leva, prit la main de son épouse et descendit, suivi par elle. Il monta à cheval, foulant de la sorte les tapis et les nattes. On jeta des pièces d’or sur lui et sur ses camarades et on plaça la mariée dans un palanquin, que les esclaves portèrent sur leurs épaules jusqu’au château de l’émir. Les princesses allaient devant elle à cheval, et les autres dames à pied. Lorsque le cortège passait devant la demeure d’un chef ou d’un grand, celui-ci sortait à sa rencontre, et répandait parmi la foule des pièces d’or et d’argent, suivant sa volonté. Cela dura jusqu’à l’arrivée de la mariée au Château Rouge.
Le lendemain, l’épouse de Ghada envoya à tous les compagnons de son mari des vêtements, des dinars et des drachmes. Le sultan leur donna à chacun un cheval sellé et bridé, ainsi qu’une bourse remplie d’argent, et contenant depuis deux cents dinars jusqu’à mille dinars. Le roi Fath Allah fit cadeau aux princesses de vêtements de soie de différentes couleurs et de bourses remplies d’argent ; il agit ainsi avec les musiciens des deux sexes et avec les danseuses. Il est d’usage, dans l’Inde, que personne, excepté le directeur de la noce, ne donne rien aux musiciens ni aux danseuses. On servit à manger au public ce jour-là, et la noce fut terminée. Le sultan ordonna de donner à l’émir Ghada les contrées de Mâlouah, Guzarate, Cambaie et Nehrouâlah. Il nomma le susdit Fath Allah son substitut dans le gouvernement de ces pays, et honora excessivement son beau-frère. Mais ce Ghada était un Arabe stupide, et ne méritait pas toutes ces distinctions ; la grossièreté des gens du désert était son trait dominant, et elle l’entraîna dans l’adversité vingt jours après son mariage.
Vingt jours après ses noces, il arriva que Ghada se rendit au palais du sultan et désira entrer. Le chef des perdehdârs, qui sont les principaux huissiers, lui défendit l’entrée ; mais il ne l’écouta point et voulut s’introduire de force. Alors l’huissier le saisit par sa dabboûkah, c’est-à-dire sa tresse de cheveux, et le tira en arrière. L’émir, indigné, le frappa, avec un bâton qui se trouvait là, au point de le blesser et de faire couler son sang. Le personnage battu était un des principaux émirs ; son père était appelé « le kadi de Ghazna » ; il était de la postérité du sultan Mahmoud, fils de Sébuktéguin, et le souverain de l’Inde, en lui adressant la parole, le nommait toujours « mon père ». Il nommait son fils, dont il est ici question, « mon frère ». Celui-ci entra tout ensanglanté chez le sultan, et l’informa de ce qu’avait fait l’émir Ghada. Le monarque réfléchit un instant, puis il dit : « Le juge décidera de la chose entre vous deux ; c’est là un crime que le sultan ne peut pardonner à aucun de ses sujets, et qui mérite la mort. Je consens pourtant à user de tolérance, à cause que le criminel est un étranger. » Le juge Kamal eddîn se trouvait présent dans la salle d’audience, et le sultan donna ordre au roi Tatar de se rendre, avec les deux parties, chez ce juge. Tatar avait fait le pèlerinage de La Mecque ; il était resté encore quelque temps dans cette ville, ainsi qu’à Médine, et parlait bien l’arabe. Se trouvant chez le juge avec les susdits personnages, il dit à l’émir Ghada : « Est-ce que tu as frappé le chambellan ? Ou bien dis : « Non. » Son but était de lui suggérer un argument de défense ; mais Saïf eddîn était un ignorant vulgaire, et il répondit : « Oui, je l’ai frappé. » Le père du personnage battu se présenta, et il voulait arranger l’affaire entre les deux parties ; mais Saïf eddîn ne s’y prêta point.
Le juge donna ordre qu’on le mît en prison cette nuit-là. Pour Dieu, son épouse ne lui envoya même pas un tapis pour dormir, et n’en demanda pas de nouvelles, par crainte du sultan. Ses camarades eurent peur aussi, et mirent en sûreté leurs biens. Je voulais l’aller visiter dans sa prison ; mais je rencontrai alors un émir qui me dit, en entendant cela : « Tu as donc oublié ce qui t’est arrivé ? » Il me rappela à la mémoire un événement qui me concernait, au sujet de ma visite au cheikh Schihâb eddîn, fils du cheikh d’Aldjâm, et comme quoi le sultan voulait me faire mourir, à cause de cette action. Nous en reparlerons plus tard. Je revins donc sur mes pas, et n’allai pas trouver l’émir Ghada. Celui-ci sortit de prison le lendemain vers midi ; le sultan le laissa dans l’abandon, le négligea, lui retira le gouvernement qu’il lui avait conféré, et voulut même le chasser.
Le souverain avait un beau-frère appelé Moghîth, fils du roi des rois. La sœur du sultan se plaignit de lui à son frère jusqu’à ce qu’elle mourût. Ses femmes esclaves ont assuré que sa mort fut la suite de violences exercées sur elle par son mari. La généalogie de ce dernier laissait quelque chose à désirer, et le sultan écrivit de sa propre main ces mots : « Qu’on exile l’enfant trouvé. » Il faisait allusion à son beau-frère. Il écrivit après cela : « Qu’on exile aussi Moûch khor. » Ceci veut dire le Mangeur de rats ; et il entendait parler de l’émir Ghada ; car les Arabes du désert mangent le yarboû’, « rat des champs, gerboise », qui est une sorte de rat. Le monarque ordonna de leur faire quitter le pays à tous les deux ; en conséquence, les officiers se rendirent près de Ghada pour le faire partir.
Il voulut alors entrer dans sa demeure pour dire adieu à sa femme ; les officiers se mirent successivement à sa recherche, et il sortit tout en pleurs. Ce fut dans ce moment que je me rendis au palais du sultan, et que j’y passai la nuit. Un des chefs me demanda ce que je voulais, et je lui répondis que mon intention était de parler en faveur de l’émir Saïf eddîn, afin qu’il fût rappelé, et non chassé. Il me dit que c’était chose impossible ; mais je repris : « Pour Dieu, je ne quitterai pas le palais du souverain, quand bien même j’y devrais rester cent nuits, jusqu’à ce que Saïf eddîn soit rappelé. » Le sultan, ayant été informé de ces paroles, ordonna de le faire revenir, et il lui commanda de rester en quelque sorte au service de l’émir, nommé le roi Kaboûlah Allâhoûry. En effet, il resta attaché à lui pendant quatre années ; il montait à cheval avec Kaboûlah et voyageait avec lui. Il finit ainsi par devenir lettré et bien élevé. Alors le sultan le replaça dans le degré d’honneur où il était d’abord ; il lui donna en fief plusieurs contrées, le mit à la tête des troupes et le combla de dignités.
A l’arrivé de Khodhâwend Zâdeh, le sultan lui fit de nombreux cadeaux, le combla de bienfaits et l’honora excessivement. Plus tard, il maria ses deux fils avec deux filles du vizir Khodjah Djihan, qui se trouvait alors absent. Le souverain se rendit dans la maison de son vizir pendant la nuit ; il assista au contrat de mariage en qualité, pour ainsi dire, de substitut du vizir, et resta debout jusqu’à ce que le kadi en chef eût fait mention du don nuptial. Les juges, les émirs et les cheikhs étaient assis. Le sultan prit avec ses mains les étoffes et les bourses d’argent, qu’il plaça devant le kadi et devant les deux fils de Khodhâwend Zâdeh. En ce moment les émirs se levèrent, ne voulant pas que le monarque mît lui-même ces objets en leur présence ; mais il leur dit de rester assis ; il ordonna à l’un des principaux émirs de le remplacer, et se retira.
Un des grands parmi les Indiens prétendit que le souverain avait fait mourir son frère sans motif légitime, et le cita devant le juge. Le sultan se rendit à pied, sans armes, au tribunal ; il salua, s’inclina, monta au prétoire, et se tint debout devant le kadi. Il avait déjà prévenu celui-ci, bien avant ce temps, qu’il n’eût pas à se lever pour lui, ni à bouger de sa place, lorsqu’il lui arrivait de se rendre au lieu de ses audiences. Le juge décida que le souverain était tenu de satisfaire la partie adverse, pour le sang qu’il avait répandu, et la sentence fut exécutée.
Une fois il arriva qu’un individu de religion musulmane prétendit avoir, sur le sultan, une certaine créance. Ils débattirent cette affaire en présence du juge, qui prononça un arrêt contre le souverain, portant qu’il devait payer la somme d’argent ; et il la paya.
Un enfant du nombre des fils de rois accusa le sultan de l’avoir frappé sans cause, et le cita devant le kadi. Celui-ci décida que le souverain était obligé d’indemniser le plaignant au moyen d’une somme d’argent, s’il voulait bien s’en contenter ; sinon, qu’il pouvait lui infliger la peine du talion. Je vis alors le sultan qui revenait pour son audience ; il manda l’enfant, et lui dit, en lui présentant un bâton : « Par ma tête, il faut que tu me frappes, de même que j’ai fait envers toi. » L’enfant prit le bâton, et donna vingt et un coups, en sorte que je vis son bonnet lui tomber de la tête.
Le sultan était très sévère pour l’exécution des prières ; il commandait de les célébrer en commun dans les temples, et punissait fortement ceux qui négligeaient de s’y rendre. Il fit mourir en un seul jour, pour cette faute, neuf individus, dont l’un était un chanteur. Il y avait des gens exprès, qu’il envoyait dans les marchés, et qui étaient chargés de punir ceux qui s’y trouvaient au moment de la prière. On alla même jusqu’à châtier les satâïriyoûns (littéralement, ceux qui couvrent, qui protègent, etc.) lorsqu’ils manquaient la prière. Ce sont ceux qui tiennent les montures des serviteurs à la porte de la salle d’audience. Le souverain ordonna qu’on exigeât du peuple la connaissance des préceptes sur les notions sacrées, sur la prière, ainsi que celle des statuts de l’islamisme. On les interrogeait sur ces points, et ceux qui ne les savaient pas bien étaient punis. Le peuple étudiait ces choses dans la salle d’audience, dans les marchés, et les mettait par écrit.
Le sultan était rigoureux dans l’observation de la justice : parmi ses pratiques à ce sujet, il faut noter ce qui suit. Il chargea son frère Mobârec khân de siéger dans la salle d’audience, en compagnie du kadi en chef Kamal eddîn, sous une coupole élevée, garnie de tapis. Le juge avait une estrade toute recouverte de coussins, comme celle du sultan ; et le frère de celui-ci prenait place à la droite du kadi. Quand il arrivait qu’un des grands parmi les émirs avait une dette, et qu’il se refusait à la payer à son créancier, les suppôts du frère du sultan l’amenaient en présence du juge, qui le forçait d’agir avec justice.
L’année quarante et un (741 de l’hégire, 1340-1341 de J. C.), le sultan ordonna d’abolir les droits pesant sur les marchandises dans tous ses pays et de se borner à percevoir du peuple la dîme aumônière et la taxe nommée le dixième. Tous les lundis et jeudis, il siégeait en personne, pour examiner les actes d’oppression, dans une place située devant la salle d’audience. A cette occasion, il n’était assisté que des personnages suivants : Émir Hâdjib (prince chambellan), Khâss Hâdjib (chambellan intime), Sayyid alhoddjâb (chef des chambellans) et Cheref alhoddjâb (la noblesse ou la gloire des chambellans). On n’empêchait aucun individu, ayant une plainte à porter de se présenter devant le monarque. Celui-ci avait désigné quatre des principaux émirs pour s’asseoir à chacune des quatre portes de la salle d’audience, et prendre les requêtes de la main des plaignants. Le quatrième était le fils de son oncle paternel, le roi Firouz. Si le personnage assis à la première porte prenait le placet du plaignant, c’était bien ; sinon, il était pris par celui de la deuxième, ou de la troisième, ou de la quatrième porte. Dans le cas où aucun d’eux ne voulait le recevoir, le plaignant se rendait près de Sadr aldjihân, kadi des Mamlouks ; si ce dernier ne voulait pas non plus prendre le placet, l’individu qui le portait allait se plaindre au sultan. Quand le souverain s’était bien assuré que le plaignant avait présenté sa requête à l’un desdits personnages, et qu’il n’avait pas consenti à s’en charger, il le réprimandait. Tous les placets qu’on recueillait les autres jours étaient soumis à l’examen du sultan après la dernière prière du soir.
Lorsque la sécheresse domina dans l’Inde et dans le Sind, et que la pénurie fut telle que la mesure de blé appelée mann valait six pièces d’or, le souverain ordonna de distribuer à tous les habitants de Dihly la nourriture pour six mois, tirée du magasin de la couronne. On devait donner à chacun, grand ou petit, né libre ou esclave, la quantité d’un rithl et demi (un kilo environ) par jour, poids de Barbarie. Les jurisconsultes et les juges se mirent à enregistrer les populations des différentes rues ; ils firent venir ces gens, et l’on donna à chaque personne les provisions de bouche qui devaient servir à sa nourriture pendant six mois.
Le sultan de l’Inde, malgré ce que nous avons raconté sur son humilité, sa justice, sa bonté pour les pauvres et sa générosité extraordinaire, était très enclin à répandre le sang. Il arrivait rarement qu’à la porte de son palais il n’y eût pas quelqu’un de tué. J’ai vu bien souvent faire mourir des gens à sa porte, et y abandonner leur corps. Un jour, je me rendis à son château, et voilà que mon cheval eut peur ; je regardai devant moi et je vis sur le sol une masse blanchâtre. Je dis : « Qu’est-ce que cela ? » Un de mes compagnons répondit : « C’est le tronc d’un homme dont on a fait trois morceaux ! » Ce souverain punissait les petites fautes, comme les grandes ; il n’épargnait ni savant, ni juste, ni noble. Tous les jours on amenait dans la salle d’audience des centaines d’individus enchaînés, les bras attachés au cou, et les pieds garrottés. Les uns étaient tués, les autres torturés, ou bien battus. Son habitude était de faire venir tous les jours dans la salle d’audience, excepté le vendredi, tous ceux qui se trouvaient en prison. Ce dernier jour était pour eux une journée de répit ; ils l’employaient à se nettoyer, et se tenaient tranquilles. Que Dieu nous garde du malheur !
Le sultan avait un frère du nom de Maç’oud khân, dont la mère était fille du sultan ’Alâ eddîn. Ce Maç’oud était une des plus belles créatures que j’aie jamais vues dans ce monde. Le monarque le soupçonna de vouloir s’insurger contre lui ; il l’interrogea à ce propos, et Maç’oud confessa, par crainte des tourments. En effet, toute personne qui nie les accusations de cette sorte, que le sultan formule contre elle, est de nécessité mise à la torture, et la plupart des gens préfèrent mourir que d’être torturés. Le souverain fit trancher la tête de son frère au milieu de la place, et le corps resta trois jours abandonné dans le même endroit, suivant l’usage. La mère de Maç’oud avait été lapidée deux années auparavant, juste en ce lieu ; car elle avait avoué le crime de débauche ou d’adultère. Celui qui l’a condamnée à être lapidée ç’a été le juge Kamal eddîn.
Une fois, le sultan avait destiné une portion de l’armée, commandée par le roi Youçouf Borghrah, pour aller combattre les infidèles hindous sur des montagnes adjacentes au district de Dihly. Youçouf sortit, ainsi que la presque totalité de sa troupe ; mais une partie de ses soldats restèrent en arrière. Il écrivit au souverain, pour l’informer de cet événement, et celui-ci ordonna de parcourir la ville et de saisir tous les individus qu’on rencontrerait, parmi ceux qui étaient restés en arrière. On s’empara de trois cent cinquante de ceux-ci ; le monarque donna ordre de les tuer tous ; et il fut obéi.
Le cheikh Schihâb eddîn était fils du cheikh Aldjâm alKhoraçany, dont l’aïeul avait donné son nom à la ville de Djâm, située dans le Khoraçan, comme nous l’avons déjà raconté, Schihâb eddîn était un des principaux cheikhs, un des plus probes et des plus vertueux ; il avait l’habitude de jeûner quatorze jours de suite. Les deux sultans Kothb eddîn et Toghlok le vénéraient, le visitaient et imploraient sa bénédiction. Quand le sultan Mohammed fut investi du pouvoir, il voulut faire remplir au cheikh quelque charge dans l’État ; mais celui-ci refusa. C’était l’usage chez ce souverain d’employer les jurisconsultes, les cheikhs et les hommes pieux ; il se fondait sur ce que les premiers princes musulmans — que Dieu soit satisfait d’eux ! — ne donnaient les places qu’aux savants et aux hommes probes. Il s’entretint à ce sujet avec Schihâb eddîn, à l’occasion d’une audience publique ; celui-ci refusa et résista. Le sultan en fut indigné, et il commanda au jurisconsulte vénéré, le cheikh Dhiyâ eddîn assimnâny d’arracher la barbe de Schihâb eddîn. Dhiyâ eddîn ne le voulut pas, et il dit : « Je ne ferais jamais cela. » Alors le souverain donna l’ordre d’arracher à tous les deux les poils de leur barbe ; ce qui eut lieu.
Le sultan relégua Dhiyâ eddîn dans la province de Tiling ; et plus tard il le nomma juge à Ouarangal où il mourut. Il exila Schihâb eddîn à Daoulet Abad, et l’y laissa pendant sept années ; puis il le fit revenir, il l’honora et le vénéra. Il le mit à la tête du Dîouân almostakhradj, « le bureau du produit de l’extorsion », c’est-à-dire celui des reliquats ou arriérés des agents, qu’on leur extorque par la bastonnade et par les tourments. Le souverain considéra de plus en plus Schihâb eddîn ; il ordonna aux émirs d’aller lui rendre hommage dans sa demeure, et de suivre ses conseils. Nul n’était au-dessus de lui dans le palais du sultan.
Lorsque le souverain se rendit à sa résidence située au bord du Gange, qu’il y bâtit le château appelé Sarg Douâr, « la porte du ciel », ce qui veut dire « semblable au Paradis », et qu’il commanda au peuple de construire des demeures fixes en cet endroit, le cheikh Schihâb eddîn sollicita de lui la permission de continuer à rester dans la capitale. Le sultan lui assigna pour séjour un lieu inculte et abandonné, à six milles de distance de Dihly. Schihâb eddîn y creusa une vaste grotte, dans l’intérieur de laquelle il construisit des cellules, des magasins, un four et un bain ; il fit venir l’eau du fleuve Djoumna ; il cultiva cette terre, et il amassa des sommes considérables au moyen de ses produits ; car, dans ces années-là, on souffrit de la sécheresse. Il demeura en cet endroit deux ans et demi, le temps que dura l’absence du sultan. Les esclaves de Schihâb eddîn labouraient le sol pendant le jour ; ils entraient la nuit dans la caverne, et la fermaient sur eux et sur les troupeaux, par crainte des voleurs hindous, qui habitaient sur une montagne voisine et inaccessible.
Quand le sultan retourna dans la capitale, le cheikh alla à sa rencontre, et ils se virent à sept milles de Dihly. Le souverain l’honora, l’embrassa dès qu’il l’aperçut, et Schihâb eddîn retourna ensuite à sa grotte. Le monarque l’envoya quérir quelque temps après cela ; mais il refusa de se rendre près de lui. Alors le sultan lui expédia Mokhlis almolc, annodhrbâry (littéralement, celui qui répand ou qui porte les avertissements, etc.) qui était un des principaux rois. Il parla à Schihâb eddîn avec beaucoup de douceur, et lui dit de faire attention à la colère du monarque. Le cheikh répondit : « Je ne servirai jamais un tyran. » Mokhlis almolc retourna auprès du sultan et l’informa de ce qui s’était passé ; il reçut l’ordre d’amener le cheikh, ce qu’il fit. Le sultan parla ainsi à Schihâb eddîn : « C’est toi qui as dit que je suis un tyran ? » Il répondit : « Oui, tu es un tyran ; et parmi tes actes de tyrannie sont tels et tels faits. » Il en compta plusieurs au nombre desquels il y avait la dévastation de la ville de Dihly, et l’ordre d’en sortir intimé à tous les habitants.
Le sultan tira son sabre, il le passa à Sadr aldjihân, et dit : « Confirme ceci, que je suis un tyran, et coupe mon cou avec ce glaive. » Schihâb eddîn reprit : « Celui qui porterait témoignage sur cela serait sans doute tué ; mais tu as conscience toi-même de tes propres torts. » Le monarque ordonna de livrer le cheikh au roi Nocbïah, chef des porte-encriers ou secrétaires, qui lui mit quatre liens aux pieds, et lui attacha les mains au cou. Il resta dans cette situation quatorze jours de suite, sans manger ni boire ; tous les jours on le conduisait dans la salle d’audience ; on réunissait les légistes et les cheikhs, qui lui disaient : « Rétracte ton assertion. » Schihâb eddîn répondait : « Je ne la retirerai pas, et je désire d’être mis dans le chœur des martyrs. » Le quatorzième jour, le sultan lui envoya de la nourriture, au moyen de Mokhlis almolc ; mais le cheikh ne voulut pas manger, et dit : « Mes biens ne sont plus sur cette terre ; retourne près de lui (le sultan) avec tes aliments. » Celui-ci ayant été informé de ces paroles, ordonna immédiatement qu’on fît avaler au cheikh cinq istârs (ou statères du grec στατήρ) de matière fécale, ce qui correspond à deux livres et demie, poids de Barbarie. Les individus chargés de ces sortes de choses, et ce sont des gens choisis parmi les Indiens infidèles, prirent cette ordure, qu’ils firent dissoudre dans l’eau ; ils couchèrent le cheikh sur son dos, lui ouvrirent la bouche avec des tenailles, et lui firent boire ce mélange. Le lendemain, on le conduisit à la maison du kadi Sadr aldjihân. On rassembla les jurisconsultes et les cheikhs, ainsi que les notables d’entre les personnages illustres ; tous le prêchèrent et lui demandèrent de revenir sur son propos. Il refusa de se rétracter, et on lui coupa le cou. Que Dieu ait pitié de lui !
Dans les années de la disette, le sultan avait commandé de creuser des puits à l’extérieur de la capitale, et de semer des céréales dans ces endroits. Il fournit aux gens les grains, ainsi que tout l’argent nécessaire pour les semailles, et exigea que celles-ci fussent faites au profit des magasins du Trésor public. Le jurisconsulte ’Afîf eddîn, ayant entendu parler de cette chose, dit : « On n’obtiendra pas de cette semence l’effet qu’on désire. » Il fut dénoncé au souverain, qui le fit mettre en prison, et lui dit : « Pourquoi te mêles-tu des affaires de l’État ? » Un peu plus tard, il le relâcha, et le légiste se rendit vers sa demeure.
Il rencontra par hasard, chemin faisant, deux jurisconsultes de ses amis, qui lui dirent : « Que Dieu soit loué, à cause de ta délivrance ! » Il répondit : « Louons l’Être suprême qui nous a sauvés des mains des méchants. (Coran, xxiii, 29) » Ils se séparèrent ; mais ils n’étaient pas encore arrivés à leurs logements que le sultan était déjà instruit de leur discours. D’après son ordre, on les amena tous les trois en sa présence ; alors il dit (à ses suppôts) : « Partez avec celui-ci (en désignant ’Afîf eddîn), et coupez-lui le cou, à la manière des baudriers. » Cela veut dire qu’on tranche la tête avec un bras et une portion de la poitrine. Il ajouta : « Et coupez le cou aux deux autres. » Ceux-ci dirent au souverain : « Pour ’Afîf eddîn, il mérite d’être châtié à cause de son propos ; mais nous, pour quel crime nous fais-tu mourir ? » Le monarque répondit : « Vous avez entendu son discours et ne l’avez pas désapprouvé ; c’est donc comme si vous aviez été de son avis. » Ils furent tués tous les trois. Que Dieu ait pitié d’eux !
Le sultan ordonna à ces deux jurisconsultes du Sind de se rendre dans une certaine province, en compagnie d’un commandant qu’il avait désigné. Il leur dit : « Je mets entre vos mains les affaires de la province et des sujets ; cet émir sera avec vous uniquement pour agir suivant vos ordres. » Ils répondirent : « Il vaut mieux que nous soyons comme deux témoins à son égard, et que nous lui montrions le chemin de la justice, afin qu’il le suive. » Alors le souverain reprit : « Certes, votre but est de manger, de dissiper mes biens, et d’attribuer cela à ce Turc, qui n’a aucune connaissance. » Les deux légistes répliquèrent : « Que Dieu nous en garde ! ô maître du monde ; nous ne cherchons pas une telle chose. » Mais le sultan répéta : « Vous n’avez pas d’autre pensée. » (Puis il dit à ses gens :) « Emmenez-les chez le cheikh Zâdeh annohâouendy. » Celui-ci est chargé d’administrer les châtiments.
Quand ils furent en sa présence, il leur dit : « Le sultan veut vous faire mourir ; or avouez ce dont il vous accuse, et ne vous faites pas torturer. » Ils répondirent : « Pour Dieu, nous n’avons jamais cherché que ce que nous avons exprimé. » Zâdeh reprit, en s’adressant à ses sbires : « Faites-leur goûter quelque chose. » Il voulait dire : « en fait de tourments ». En conséquence, on les coucha sur leur dos (littéralement, sur leurs occiputs), on plaça sur leur poitrine une plaque de fer rougie au feu, qu’on retira quelques instants après, et qui mit à nu ou détruisit leurs chairs. Alors on prit de l’urine et des cendres qu’on appliqua sur les plaies ; et à ce moment les deux victimes confessèrent que leur but était celui qu’avait indiqué le sultan ; qu’ils étaient deux criminels méritant la mort ; qu’ils n’avaient aucun droit à la vie, ni aucune réclamation à élever pour leur sang, dans ce monde pas plus que dans l’autre. Ils écrivirent cela de leur propre main, et reconnurent leur écrit devant le kadi. Celui-ci légalisa le procès-verbal, portant que leur confession avait eu lieu sans répugnance et sans coaction. S’ils avaient dit : « Nous avons été contraints », ils auraient été infailliblement tourmentés de plus belle. Ils pensèrent donc qu’avoir le cou coupé sans délai valait mieux pour eux que mourir par une torture douloureuse ils furent tués. Que Dieu ait pitié d’eux !
Le cheikh Zâdeh, appelé Hoûd, était petit-fils du cheikh pieux et saint Rocn eddîn, fils de Béhâ eddîn, fils d’Abou Zacariyyâ almoltâny, Son aïeul, le cheikh Rocn eddîn, était vénéré du sultan ; et il en était ainsi du frère de Rocn eddîn, nommé ’Imâd eddîn, qui ressemblait beaucoup au sultan, et qui fut tué le jour de la bataille contre Cachloû khân, comme nous le dirons plus bas. Lorsque ’Imad eddîn fut mort, le souverain donna à son frère Rocn eddîn cent villages, pour qu’il tirât sa subsistance, et qu’il nourrît les passants dans son ermitage. A sa mort, le cheikh Rocn eddîn nomma son successeur dans l’ermitage son petit-fils, le cheikh Hoûd ; mais son neveu, le fils du frère de Rocn eddîn, s’y opposa, en disant qu’il avait plus de droits que l’autre à l’héritage de son oncle. Il se rendit avec Hoûd chez le sultan, qui était à Daoulet Abad ; et entre cette ville et Moltân, il y a quatre-vingts jours de marche. Le souverain accorda à Hoûd la place de cheikh, ou supérieur de l’ermitage, selon le testament de Rocn eddîn : Hoûd était alors d’un âge mûr, tandis que le neveu de Rocn eddîn était un jeune homme. Le sultan honora beaucoup le cheikh Hoûd ; il ordonna de le recevoir comme un hôte, dans toutes les stations où il descendrait ; il prescrivit aux habitants de sortir à sa rencontre dans toutes les villes par où il passerait, dans son voyage jusqu’à Moultân, et de lui préparer un festin.
Quand l’ordre parvint à la capitale, les jurisconsultes, les juges, les docteurs et les notables sortirent à la rencontre de Hoûd. J’étais du nombre ; nous le vîmes, assis dans un palanquin porté par des hommes, tandis que ses chevaux étaient conduits à la main. Nous le saluâmes ; mais, pour ma part, je désapprouvai son action de rester dans le palanquin, et dis : « Il aurait dû monter à cheval, et marcher parallèlement aux juges et aux docteurs, qui sont sortis pour le recevoir. » Ayant appris mon discours, Hoûd monta à cheval, et il s’excusa en alléguant qu’il ne l’avait point fait d’abord à cause d’une incommodité dont il souffrait. Il fit son entrée à Dihly, et on lui offrit un festin, pour lequel on dépensa des sommes considérables du trésor du sultan. Les kadis, les cheikhs, les légistes et les personnages illustres s’y trouvaient ; on étendit les nappes, et l’on apporta les mets du banquet, suivant l’usage. On distribua des sommes d’argent à tous les individus présents, en proportion du rang de chacun : le grand juge eut cinq cents dinars, et moi j’en touchai deux cent cinquante. Telle est l’habitude, chez les Indiens, lors des festins impériaux.
Le cheikh Hoûd partit pour son pays, en compagnie du cheikh Nour eddîn acchîrâzy, que le sultan envoyait avec lui, pour le faire asseoir sur le tapis à prière de son aïeul dans la zaouïa et pour lui offrir un banquet en ce lieu aux frais du monarque. Il se fixa dans cet ermitage et y passa plusieurs années. Puis il arriva qu’Imad almolc, commandant du Sind, écrivit au sultan que le cheikh Hoûd, ainsi que sa parenté, s’occupait à amasser des richesses, pour les dépenser ensuite dans les plaisirs de ce monde, et qu’ils ne donnaient à manger à personne dans l’ermitage. Le souverain ordonna d’exiger d’eux la restitution de ces biens. En conséquence, ’Imad almolc en emprisonna quelques-uns, en fit frapper d’autres ; il leur extorquait chaque jour vingt mille pièces d’or, et cela durant quelque temps ; il finit par prendre tout ce qu’ils possédaient. On leur trouva beaucoup d’argent et de choses précieuses ; on cite, entre autres, une paire de sandales incrustées de perles et de rubis, qui furent vendues pour sept mille pièces d’or. On dit qu’elles appartenaient à la fille du cheikh Hoûd ; d’autres prétendent qu’elles étaient à une de ses concubines.
Lorsque le cheikh fut fatigué de toutes ces vexations, il s’enfuit, et désira de se rendre dans le pays des Turcs ; mais il fut pris. ’Imâd almolc en informa le sultan, qui prescrivit de le lui envoyer, de même que celui qui l’avait arrêté, tous les deux comme des prisonniers. Quand ils furent arrivés près du souverain, il mit en liberté l’individu qui avait saisi le cheikh Hoûd, et dit à celui-ci : « Où voulais-tu fuir ? » Le cheikh s’excusa comme il put ; mais le sultan lui répondit : « Tu voulais aller chez les Turcs ; tu voulais leur dire que tu es le fils du cheikh Béhâ eddîn Zacariyyâ ; que le sultan de l’Inde t’a fait telle et telle chose ; et tu pensais venir ensuite me combattre en compagnie de ces Turcs. » (Il ajouta en s’adressant à ses gardes :) « Coupez-lui le cou. » Il fut tué. Que Dieu ait pitié de lui !
Le pieux cheikh Chams eddîn, fils de Tadj al’ârifîn (le diadème des contemplatifs), habitait la ville de Cowil, s’occupant tout à fait d’actes de dévotion ; et c’était un homme de grand mérite. Une fois le sultan entra dans cette cité, et l’envoya quérir ; mais il ne se rendit pas chez le souverain. Celui-ci se dirigea lui-même vers sa demeure ; puis, quand il en approcha, il rebroussa chemin, et ne vit pas le cheikh.
Plus tard, il arriva qu’un émir se révolta contre le sultan dans une province, et que les peuples lui prêtèrent serment. On rapporta au souverain que, dans une réunion chez le cheikh Chams eddîn, on avait parlé de cet émir, que le cheikh avait fait son éloge, et dit qu’il méritait de régner. Le sultan envoya près du cheikh un commandant, qui lui mit des liens aux pieds, et agit ainsi avec ses fils, avec le juge de Cowil et son inspecteur des marchés ; car on avait su que ces deux derniers personnages se trouvaient présents dans l’assemblée où il avait été question de l’émir insurgé, et où son éloge avait été fait par le cheikh Chams eddîn. Le souverain les fit mettre tous en prison, après avoir toutefois privé de la vue le juge et l’inspecteur des marchés. Quant au cheikh, il mourut dans la prison ; le juge et l’inspecteur en sortaient tous les jours, accompagnés par un geôlier ; ils demandaient l’aumône aux passants, et étaient reconduits dans leur cachot.
Le sultan avait été averti que les fils du cheikh avaient eu des rapports avec les Indiens infidèles, ainsi qu’avec les rebelles hindous, et avaient contracté amitié avec eux. A la mort de leur père, il les fit sortir de prison et leur dit : « Vous n’agirez plus comme vous l’avez fait. » Ils répondirent : « Et qu’avons-nous fait ? » Le sultan se mit en colère et ordonna de les tuer ; ce qui eut lieu.
Il fit venir après cela le juge susmentionné, et lui dit :« Fais-moi connaître ceux qui (dans Cowil) pensent comme les individus qui viennent d’être exécutés et agissent comme ils l’ont fait. » Le kadi dicta les noms d’un grand nombre de personnes, parmi les grands du pays. Lorsque le monarque vit cela, il dit : « Cet hommes désire la destruction de la ville. » (Et, s’adressant à ses satellites, il ajouta) « Coupez-lui le cou. » Ils le lui coupèrent. Que Dieu ait pitié de lui !
Le cheikh ’Aly alhaïdary habitait la ville de Cambaie, sur le littoral de l’Inde ; c’était un homme d’un grand mérite, d’une réputation immense, et il était célèbre dans les pays, même les plus éloignés. Les négociants qui voyageaient sur mer lui vouaient de nombreuses offrandes, et à leur arrivée ils s’empressaient d’aller saluer ce cheikh, qui savait découvrir leur secrets, et leur disait la bonne aventure. Il arrivait souvent que l’un d’eux lui avait promis une offrande, et que depuis il avait regretté son vœu. Quand il se présentait devant le cheikh pour le saluer, celui-ci lui rappelait sa promesse, et lui ordonnait d’y satisfaire. Pareille chose s’est passée un grand nombre de fois, et le cheikh ’Aly est renommé sous ce rapport.
Lorsque le kadi Djélal eddîn alafghâny et sa peuplade s’insurgèrent dans ces contrées, on avertit le sultan que le cheikh Alhaïdary avait prié pour le juge susnommé ; qu’il lui avait donné sa propre calotte, et on assurait même qu’il lui avait prêté serment. Le souverain ayant marché en personne contre les rebelles, Djélal eddîn s’enfuit. Alors le sultan partit, et laissa en sa place, à Cambaie, Chéref almolc, émir bakht, qui est un de ceux qui arrivèrent avec nous chez le monarque de l’Inde. Il lui commanda d’ouvrir une enquête sur les gens qui s’étaient révoltés, et lui adjoignit des jurisconsultes pour l’aider dans les jugements à intervenir.
Émir bakht se fit amener le cheikh ’Aly alhaïdary ; il fut établi que ce dernier avait fait cadeau de sa calotte au juge rebelle, et qu’il avait fait des vœux pour lui. En conséquence, il fut condamné à mourir ; mais, quand le bourreau voulut le frapper, il n’y réussit pas. Le peuple fut fort émerveillé de ce fait, et il pensa qu’on pardonnerait au condamné, à cause de cela ; mais l’émir ordonna à un autre bourreau de lui couper le cou, ce qui fut fait. Que Dieu ait pitié de ce cheikh !
Thoûghân alferghâny et son frère étaient deux grands de la ville de Ferghana qui étaient venus trouver le sultan de l’Inde. Il les accueillit fort bien, il leur fit de riches présents, et ils restèrent près de lui assez longtemps. Plus tard, ils désirèrent retourner dans leur pays, et voulurent prendre la fuite. Un de leurs compagnons les dénonça au souverain, qui ordonna de les fendre en deux par le milieu du corps ; ce qui fut exécuté. On donna à leur dénonciateur tout ce qu’ils possédaient ; car tel est l’usage dans ces pays de l’Inde. Quand un individu en accuse un autre, que sa déclaration est trouvée fondée et qu’on tue l’accusé, les biens de celui-ci sont livrés au délateur.
Le fils du roi ou prévôt des marchands était un tout petit jeune homme, sans barbe. Lorsque arrivèrent l’hostilité de ’Aïn almolc, la révolte et sa guerre contre le souverain, comme nous le raconterons, le rebelle s’empara de ce fils du roi des marchands, qui se trouva ainsi par force au milieu de ses fauteurs. ’Aïn almolc ayant été mis en fuite, et puis saisi, de même que ses compagnons, on trouva parmi ceux-ci le fils du roi des marchands et son beau-frère ou allié, le fils de Kothb almolc. Le sultan ordonna de les attacher tous les deux par leurs mains à une poutre, et les fils des rois leur lancèrent des flèches, jusqu’à ce qu’ils fussent morts.
Alors le chambellan Khodjah Émir ’Aly attibrîzy dit au grand juge Kamal eddîn : « Ce jeune homme ne méritait pas la mort. » Le sultan sut cela, et lui fit cette observation : « Pourquoi n’as-tu pas dit cette chose avant sa mort ? » Puis il le condamna à recevoir environ deux cents coups de fouet, il le fit mettre en prison, et donna tout ce qu’il possédait au chef des bourreaux. Le lendemain, je vis celui-ci, qui avait revêtu les habits d’Émir ’Aly, s’était coiffé de son bonnet, et était monté sur son cheval, de sorte que je le pris pour Émir ’Aly en personne. Ce dernier resta plusieurs mois dans le cachot ; il fut ensuite relâché, et le sultan lui rendit la place qu’il occupait avant sa disgrâce. Il se fâcha contre lui une seconde fois, et le relégua dans le Khoraçan. Émir ’Aly se fixa à Hérat, et écrivit au sultan, pour implorer ses faveurs. Le souverain lui répondit au dos de sa lettre, en termes (persans) : Eguer bâz âmédi bâz(âï) ; ce qui veut dire : « Si tu t’es repenti, reviens. » Il retourna en effet chez le souverain de l’Inde.
Le sultan avait chargé le grand prédicateur de Dihly de surveiller pendant le voyage le trésor des pierres précieuses. Or il arriva que des voleurs hindous se jetèrent une nuit sur ce trésor et en emportèrent une partie. Pour cette cause, le souverain ordonna de frapper le prédicateur, de telle sorte qu’il en mourut. Que Dieu ait pitié de lui !
Un des plus graves reproches qu’on fait à ce sultan, c’est d’avoir forcé tous les habitants de Dihly à quitter leurs demeures. Le motif en fut que ceux-ci écrivaient des billets contenant des injures et des invectives contre le souverain ; ils les cachetaient, et traçaient sur ces billets les mots suivants : « Par la tête du maître du monde (le sultan), personne, excepté lui, ne doit lire cet écrit. » Ils jetaient ces papiers nuitamment dans la salle d’audience, et lorsque le monarque en brisait le cachet il y trouvait des injures et des invectives à son adresse. Il se décida à ruiner Dihly ; il acheta des habitants toutes leurs maisons et leurs auberges, il leur en paya le prix, et leur ordonna de se rendre à Daoulet Abad. Ceux-ci ne voulurent d’abord pas obéir ; mais le crieur ou héraut du monarque proclama qu’après trois jours nul n’eût à se trouver dans l’intérieur de Dihly.
La plupart des habitants partirent, et quelques-uns se cachèrent dans les maisons ; le souverain ordonna de rechercher minutieusement ceux qui étaient restés. Ses esclaves trouvèrent dans les rues de la ville deux hommes, dont l’un était paralytique et l’autre aveugle. Ils les amenèrent devant le souverain, qui fit lancer le perclus au moyen d’une baliste, et commanda que l’on traînât l’aveugle depuis Dihly jusqu’à Daoulet Abad, c’est-à-dire l’espace de quarante jours de marche. Ce malheureux tomba en morceaux durant le voyage, et il ne parvint de lui à Daoulet Abad qu’une seule jambe. Tous les habitants de Dihly sortirent, ils abandonnèrent leurs bagages, leurs marchandises, et la ville resta tout à fait déserte. (littéral. détruite de fond en comble, Coran, ii, 261 ; xviii, 40 ; xxii, 44)
Une personne qui m’inspire de la confiance m’a assuré que le sultan monta un soir sur la terrasse de son château, qu’il promena son regard sur la ville de Dihly, où il n’y avait ni feu, ni fumée, ni flambeau, et qu’il dit : « Maintenant, mon cœur est satisfait et mon esprit est tranquille. » Plus tard, il écrivit aux habitants de différentes provinces de se rendre à Dihly pour la repeupler. Ils ruinèrent leurs pays, mais ne peuplèrent point Dihly, tant cette ville est vaste, immense ; elle est, en effet, une des plus grandes cités de l’univers. A notre entrée dans cette capitale, nous la trouvâmes dans l’état auquel on vient de faire allusion ; elle était vide, abandonnée et sa population très clairsemée.
Or nous avons mentionné assez au long les vertus de ce souverain, de même que ses vices. Parlons maintenant, sommairement, des combats et des événements qui se passèrent sous son règne.
Lorsque le sultan fut investi du pouvoir, à la mort de son père, et que les peuples lui eurent prêté le serment d’obéissance, il fit venir le sultan Ghiâth eddîn Behadour Boûrah, que le sultan Toghlok avait fait captif. Il lui pardonna, brisa ses liens, lui fit de nombreux cadeaux en argent, chevaux, éléphants, et le renvoya dans son royaume (le Bengale). Il expédia avec lui le fils de son frère, Ibrahim khân ; il convint avec Behadour Boûrah qu’ils posséderaient ledit royaume par égales moitiés ; que leurs noms figureraient ensemble sur les monnaies ; que la prière serait faite en leur nom commun, et que Ghiâth eddîn enverrait son fils Mohammed, dit Berbâth, comme otage près du souverain de l’Inde.
Ghiâth eddîn partit, et observa toutes les promesses qu’il avait faites ; seulement, il n’envoya pas son fils, comme il avait été stipulé. Il prétendit que ce dernier s’y était refusé, et, dans son discours, il blessa les convenances. Le souverain de l’Inde fit marcher au secours du fils de son frère, Ibrahim khân, des troupes dont le commandant était Doldji attatary. Elles combattirent Ghiâth eddîn et le tuèrent ; elles le dépouillèrent de sa peau, qu’on rembourra de paille, et qu’on promena ensuite dans les provinces.
Le sultan Toghlok avait un neveu, fils de sa sœur, appelé Béhâ eddîn Cuchtasb (Hystaspe), qu’il avait nommé commandant d’une province. Quand son oncle fut mort, il refusa de prêter serment à son fils ; c’était un brave guerrier, un héros. Le souverain envoya contre lui des troupes, à la tête desquelles se trouvaient de puissants émirs, comme le roi Modjîr, ainsi que le vizir Khodjah Djihan, qui était le commandant en chef. Les cavaliers des deux côtés s’attaquèrent, le combat fut acharné et les deux armées montrèrent un grand courage. Enfin les troupes du sultan l’emportèrent, et Béhâ eddîn s’enfuit chez un des rois hindous nommé le râï Canbîlah, raïa ou râdja. Le mot raï, chez ces peuples, de même que chez les chrétiens, veut dire roi(l’auteur fait sans doute allusion aux Espagnols et à leur terme rey). Quant à Canbîlah, c’est le nom du pays que le raïa habitait. Ce prince possédait des contrées situées sur des montagnes inaccessibles ; et c’était un des principaux sultans des infidèles.
Lorsque Béhâ eddîn se dirigea vers ce souverain, il fut poursuivi par les soldats du monarque de l’Inde, qui cernèrent ces contrées. Le prince infidèle ayant aperçu dans quel danger il se trouvait, puisque les grains qu’il tenait en réserve étaient épuisés et qu’il pouvait craindre qu’on ne s’emparât par force de sa personne, dit à Béhâ eddîn : « Tu vois où nous en sommes ; je suis décidé à périr, en compagnie de ma famille et de tous ceux qui voudront m’imiter. Va chez le sultan un tel (il lui nomma un prince hindou) et reste avec celui-ci, il te défendra. » Il envoya quelqu’un avec lui pour l’y conduire ; puis il commanda de préparer un grand feu, qu’on alluma. Alors il brûla ses effets et dit à ses femmes et à ses filles : « Je veux mourir, et celles d’entre vous qui voudront agir comme moi, qu’elles le fassent. » On vit chacune de ces femmes se laver, se frotter le corps avec le bois de sandal nommé almokâssiry, baiser la terre devant le râï de Canbîlah, et se jeter dans le bûcher ; elles périrent toutes. Les femmes de ses émirs, de ses vizirs, et des grands de son État les imitèrent ; d’autres femmes encore agirent de même.
Le râï se lava à son tour, se frotta avec le sandal et revêtit ses armes, mais ne mit pas de cuirasse. Ceux de ses gens qui voulurent mourir avec lui suivirent en tout point son exemple. Ils sortirent à la rencontre des troupes du sultan et combattirent jusqu’à ce qu’ils fussent tous morts. La ville fut envahie, ses habitants furent faits captifs, et l’on prit onze fils du raï de Canbîlah, qu’on amena au sultan, et qui se firent musulmans. Le souverain les créa émirs et les honora beaucoup, tant à cause de leur naissance illustre qu’en considération de la conduite de leur père. Je vis chez le sultan, parmi ces frères, Nasr, Bakhtyâr et Almuhurdâr, « le gardien du sceau ». Celui-ci tient la bague dont on cachette l’eau que doit boire le monarque (sans doute l’eau du Gange) ; son surnom est Abou Moslim, et nous étions camarades et amis.
Après la mort du râï de Canbîlah, les troupes du sultan se dirigèrent vers le pays de l’infidèle chez qui Béhâ eddîn s’était réfugié, et elles l’entourèrent. Ce prince dit : « Je ne puis pas faire comme râï Canbîlah. » Il saisit Béhâ eddîn et le livra à l’armée du souverain de l’Inde. On lui mit des liens aux jambes, on lui attacha les bras au cou, et on le conduisit devant le sultan. Ce dernier ordonna de l’introduire chez les femmes, ses parentes ; celles-ci l’injurièrent et lui crachèrent à la figure. Puis il commanda de l’écorcher tout vivant ; or on le dépouilla de sa peau, on fit cuire sa chair avec du riz, et on l’envoya à ses enfants et à sa femme. On mit les restes dans un grand plat, et on les jeta aux éléphants pour qu’ils les mangeassent ; mais ils n’en firent rien. Le sultan ordonna de remplir la peau avec de la paille, de l’associer avec la dépouille de Behadour Boûrah, et de les promener toutes les deux dans les provinces.
Quand elles furent arrivées dans le Sind, dont le commandant en chef était alors Cachloû khân, celui-ci donna ordre de les enterrer. Le sultan le sut, il en fut fâché, et se décida à le faire périr. L’émir Cachloû khân fut l’ami du sultan Toghlok, et celui qui l’aida à se saisir du pouvoir. Le sultan Mohammed le vénérait et lui adressait la parole en l’appelant : « Mon oncle » ; il sortait toujours à sa rencontre, lorsque cet émir arrivait de son pays pour lui rendre visite.
Dès que le sultan fut instruit de la conduite de Cachloû khân au sujet de l’inhumation des deux peaux, il l’envoya chercher. Cachloû khân comprit tout de suite que le souverain voulait le châtier ; par conséquent il ne se rendit pas à son invitation, il se révolta, distribua de l’argent, réunit des troupes, expédia des émissaires chez les Turcs, les Afghans et les Khorâçâniens, qui accoururent en très grande quantité près de lui. Son armée se trouva ainsi égale à celle du sultan, ou même elle était supérieure en nombre. Le souverain de l’Inde sortit en personne pour le combattre, et ils se rencontrèrent à deux journées de Moultân, dans la plaine déserte d’Aboûher. Le sultan agit avec beaucoup de prudence lors de la bataille, et il fit mettre à sa place, sous le parasol, le cheikh ’Imad eddîn, frère utérin du cheikh Rocn eddîn almoltâny, car il ressemblait au sultan. Je tiens ces détails de Rocn eddîn lui-même. Au plus fort de la mêlée, le sultan s’isola à la tête de quatre mille hommes, tandis que les troupes de son adversaire ne cherchaient qu’à s’emparer du parasol, pensant bien que le souverain était placé sous ce dernier. En effet, elles tuèrent ’Imad eddîn, et l’on crut dans l’armée que c’était le sultan qui avait péri. Les soldats de Cachloû khân ne pensèrent plus qu’à piller, et s’éloignèrent ainsi de leur chef, qui resta avec très peu de monde. Alors le sultan l’attaqua, le tua, coupa sa tête, et quand les troupes de Cachloû khân surent cela elles prirent la fuite.
Le monarque entra dans la ville de Moultân ; il fit saisir son kadi Karim eddîn et prescrivit de l’écorcher vif ; il se fit apporter la tête de Cachloû khân et ordonna de la suspendre à sa porte. Lorsque j’arrivai à Moltân, je la vis ainsi attachée. Le sultan donna au cheikh Rocn eddîn, frère d’Imad eddîn, ainsi qu’au fils de celui-ci, Sadr eddîn, cent villages, à titre de bienfait et afin qu’ils en tirassent leur nourriture. Il les obligea à donner à manger aux voyageurs, dans leur ermitage, qui portait le nom de leur aïeul, c’est-à-dire dans la zaouïa de Béhâ eddîn Zacariyyâ. Le souverain ordonna à son vizir, Khodjah Djihan, de se rendre à la ville de Kamâlpoûr, dont les habitants s’étaient soulevés. C’est une grande cité, située au bord de la mer. Un jurisconsulte, qui dit avoir été présent à l’entrée du vizir dans cette ville, m’a raconté ce qui suit : Khodjah Djihan fit venir devant lui le kadi de la ville et son prédicateur ; il commanda de les écorcher tout vivants. Ils lui dirent : « Donne-nous la mort immédiatement, sans ce supplice. » Il répondit : « Par quelle cause avez-vous mérité de périr ? » Les deux condamnés reprirent : « Par notre désobéissance aux ordres du souverain. » Le vizir dit alors « Et comment pourrais-je transgresser son commandement, qui est de vous faire subir ce genre de mort ? » Puis il dit à ceux chargés de les dépouiller de leur peau : « Creusez des trous sous leur figure par lesquels ils puissent aspirer de l’air. » Or, dans ces pays de l’Inde, quand on écorche les hommes, on les jette la face contre terre. Que Dieu nous préserve d’un pareil supplice ! Après tous ces actes de rigueur, les provinces du Sind furent pacifiées, et le sultan retourna dans sa capitale.
C’est une montagne très vaste, de la longueur de trois mois de marche ; et elle est distante de dix jours de Dihly. Son sultan était un des plus puissants princes hindous, et le souverain de l’Inde avait envoyé, pour le combattre, le roi Nocbïah, chef des porte-encriers, qui avait avec lui cent mille cavaliers et beaucoup d’infanterie. Il s’empara de la ville de Djidiah, située au pied de la montagne, ainsi que des lieux environnants ; il fit des captifs, il saccagea et brûla. Les infidèles fuirent sur le haut de la montagne ; ils abandonnèrent leur contrée, leurs troupeaux et les trésors de leur roi. Cette montagne n’a qu’un seul chemin ; au bas il y a une vallée, et au-dessus la montagne même ; les cavaliers ne peuvent passer qu’un à un. Les troupes musulmanes du sultan de l’Inde montèrent par ce chemin, et prirent possession de la ville de Ouarangal, qui se trouve sur la partie élevée de la montagne. Elles saisirent tout ce qu’elle contenait, et écrivirent au monarque qu’elles étaient victorieuses. Celui-ci leur envoya un kadi et un prédicateur, et leur ordonna de rester dans la contrée.
Au moment des grandes pluies, l’armée fut envahie par les maladies, qui l’affaiblirent considérablement. Les chevaux moururent, et les arcs se détendirent, de sorte que les émirs sollicitèrent du sultan de l’Inde la permission de quitter le pays montagneux pendant toute la saison pluvieuse, de descendre au bas de la montagne, et de reprendre ensuite leurs positions dès que les pluies auraient cessé. Le sultan y ayant consenti, le commandant Nocbïah prit tous les biens qu’il avait réunis, soit en provisions, soit en métaux et pierres précieuses, et les distribua aux troupes pour les emporter jusqu’à la partie inférieure de la montagne. Lorsque les infidèles surent que les musulmans se retiraient, ils les attendirent dans les gorges de la montagne et occupèrent avant eux le défilé. Ils coupèrent en morceaux des arbres très vieux ou séculaires, qu’ils jetaient du haut de la montagne, et qui faisaient périr tous ceux qu’ils touchaient. La plupart de ces gens moururent, et le reste fut pris ; les Hindous se saisirent des trésors, des marchandises, des chevaux et des armes. Il ne se sauva de toute l’armée musulmane que trois chefs, savoir : le commandant Nocbïah, Bedr eddîn ou le roi Daoulet chah, et un troisième personnage, dont je ne saurais me rappeler le nom.
Ce malheur affligea beaucoup l’armée de l’Inde et l’affaiblit d’une manière évidente ; peu de temps après, le sultan fit la paix avec les habitants de la montagne, à la condition qu’ils lui paieraient une certaine redevance. Ces peuples possèdent, en effet, du territoire au pied de la montagne, et ils ne pourraient le cultiver sans la permission du souverain de l’Inde.
Le sultan avant nommé le chérif Djélal eddîn Ahçan chah commandant du pays de Ma’bar (du passage, le sud-est de la péninsule), qui est éloigné de Dihly l’espace de six mois de marche. Djélal eddîn se rebella, usurpa le pouvoir, tua les lieutenants et les agents du souverain, et frappa en son propre nom des monnaies d’or et d’argent. Sur un des côtés des dinars, il avait gravé les mots suivants : « La progéniture de Thâ-hâ et Yâ-sîn (ces lettres, qui constituent les titres de deux chapitres du Coran, le XXe et le XXVIe, sont du nombre des épithètes qu’on donne à Mahomet), le père des fakirs et des indigents, l’illustration du monde et de la religion. » Et sur l’autre face : « Celui qui met sa confiance dans le secours du Miséricordieux ; Ahçan chah sultan. »
Le monarque, ayant eu connaissance de cette révolte, partit pour la combattre. Il descendit dans un lieu nommé Cochc zer, ce qui veut dire « le château d’or », et il y resta huit jours pour s’occuper des besoins du peuple. Ce fut alors qu’on lui amena le neveu du vizir Khodjah Djihan, ainsi que trois ou quatre émirs, tous ayant des liens aux pieds et les mains attachées au cou. Le sultan avait envoyé ce vizir avant l’avant-garde, et il était arrivé à la ville de Zhihâr (Dhâr), éloignée de Dihly l’espace de vingt-quatre jours de marche, où il s’arrêta quelque temps. Le fils de sa sœur était un brave, un guerrier intrépide ; il s’était entendu, avec les chefs qu’on avait saisis en même temps que lui, pour tuer son oncle et pour fuir chez le chérif insurgé dans la province de Ma’bar, emportant les trésors et les provisions. Ils avaient décidé d’attaquer le vizir au moment où il sortirait pour se rendre à la prière du vendredi ; mais un individu qu’ils avaient instruit de leur plan les dénonça. Il s’appelait le roi Nossrah, le chambellan ; et il dit au vizir que le signe qui ferait découvrir leur projet c’était qu’ils portaient des cuirasses sous leurs habits. Le vizir les fit amener devant lui, et les trouva dans l’état qu’on vient de dire ; il les expédia au sultan.
Je me trouvais en présence du souverain lorsque ces conjurés arrivèrent. L’un d’eux était de haute taille, barbu, mais il tremblait et lisait le chapitre Yâ-Sîn du Coran (le XXVIe, c’est la prière des agonisants). D’après l’ordre du sultan, on jeta les émirs en question aux éléphants, qui sont dressés pour tuer les hommes, et l’on renvoya le fils de la sœur du vizir à son oncle, pour qu’il lui donnât la mort. Il le tua, en effet, comme nous le dirons plus bas.
Ces éléphants qui tuent les hommes ont leurs défenses revêtues de fers pointus, lesquels ressemblent au soc de la charrue qui laboure la terre ; et leurs bords sont comme des couteaux. Le cornac monte sur l’éléphant, et lorsqu’on jette un individu devant l’animal, celui-ci l’enlace de sa trompe, le lance dans l’espace, le saisit dans l’air avec ses deux défenses, le jette à ses pieds, et place une de ses jambes de devant sur la poitrine de la victime. Puis il en fait ce que commande son conducteur, suivant l’ordre du sultan. Si ce dernier veut que le condamné soit coupé en pièces, l’éléphant le fait au moyen des fers dont on vient de parler ; si le sultan veut qu’on l’abandonne, l’animal le laisse à terre ; alors on le dépouille de sa peau. C’est ainsi qu’on a agi avec les personnages que nous avons vus. Je sortis du palais du sultan à la nuit close, et je vis les chiens qui dévoraient leurs chairs. On les avait écorchés, et leurs peaux avaient été remplies de paille. Que Dieu nous préserve d’un pareil supplice !
Quand le sultan fut prêt pour cette expédition : il m’ordonna de rester à Dihly, comme nous le dirons plus loin. Il voyagea jusqu’à ce qu’il fût arrivé à Daoulet Abad ; alors l’émir Halâdjoûn se souleva dans sa province et se rebella. A ce moment, le vizir Khodjah Djihan se trouvait aussi dans la capitale, afin d’enrôler les troupes et de réunir les armées.
Lorsque le sultan fut arrivé à Daoulet Abad et qu’il se trouva ainsi fort éloigné de la contrée gouvernée par l’émir Halâdjoûn, celui-ci se révolta dans la ville de Lahore et prétendit au pouvoir. Il fut assisté en cela par l’émir Kuldjund, qui devint son vizir. La nouvelle parvint à Dihly, au vizir Khodjah Djihan ; ce dernier fit des recrues, rassembla les troupes, enrôla les Khorâçâniens et prit les gens de tous les employés du sultan qui étaient fixés dans la capitale. C’est ainsi qu’il s’empara de tous mes compagnons, car je demeurais à Dihly. Le souverain envoya au vizir, pour l’aider, deux chefs principaux, dont l’un était Keïrân, roi saffdâr, c’est-à-dire « celui qui aligne les soldats » ; l’autre, le roi Témoûr, le chorbdâr, ce qui veut dire « l’échanson ». Halâdjoûn sortit avec des troupes, et le combat eut lieu au bord d’un grand fleuve. Le rebelle fut battu, il s’enfuit, et beaucoup de ses soldats furent noyés dans la rivière. Le vizir entra dans la ville de Lahore ; il fit écorcher bon nombre de ses habitants, et il en tua d’autres par divers genres de mort. Celui qui dirigeait ces massacres était Mohammed, fils de Nadjîb, lieutenant du vizir, et connu sous le nom de roi Edjder, « monstre, dragon » ; il était aussi appelé le seg du sultan ; et ce mot, chez les peuples de l’Inde, signifie chien. C’était un tyran des plus inhumains, et le souverain l’appelait « le lion des marchés ». Souvent il mordait les criminels avec ses dents, par avidité de sang et par haine. Le vizir envoya dans la forteresse de Gâlïoûr (Gualior) environ trois cents femmes d’insurgés. Elles y furent emprisonnées, et j’y en ai vu moi-même un certain nombre. Un jurisconsulte avait une épouse parmi elles ; il allait la trouver, de sorte qu’elle enfanta et devint mère dans la prison.
Le souverain était arrivé dans le pays de Tiling, se dirigeant vers la province de Ma’bar, pour combattre le chérif insurgé. Il descendit dans la ville de Badracoût, capitale du Tiling et distante de trois mois de marche du Ma’bar. C’est alors que la peste se déclara dans son armée, dont la plus grande partie périt. Les esclaves et les mamlouks moururent, de même que les principaux émirs, tels que le roi Daoulet chah, à qui le sultan adressait la parole en lui disant : « O oncle », et l’émir ’Abdallah alharaouy. Déjà, dans la première partie de ces voyages, on aura vu l’histoire de ce dernier émir. C’est celui à qui le sultan ordonna de prendre dans le trésor tout l’argent qu’il pourrait en emporter en une seule fois. Il attacha à ses bras treize sacoches pleines d’or et les enleva.
Quand le monarque vit la calamité qui avait attaqué les troupes, il retourna à Daoulet Abad. Les provinces s’insurgèrent, l’anarchie domina dans les contrées, et peu s’en fallut que le pouvoir ne s’échappât de ses mains. Cependant, la Providence avait décrété que son bonheur serait raffermi.
Dans son retour à Daoulet Abad, le souverain fut indisposé pendant le voyage ; le bruit courut parmi les peuples qu’il était mort ; cette nouvelle se propagea et fut cause de graves séditions. Le roi Hoûchendj, fils du roi Kamal eddîn Gurg, se trouvait à Daoulet Abad, et il avait promis au sultan de ne jamais prêter le serment d’obéissance à aucun autre que lui, tant que le sultan vivrait, et même après sa mort. Quand il entendit parler de la mort du souverain, il s’enfuit chez un prince infidèle nommé Burabrah, qui habite des montagnes inaccessibles, entre Daoulet Abad et Coûken Tânah. Le monarque fut informé de sa fuite ; et, comme il craignit la naissance d’une sédition, il se hâta d’arriver à Daoulet Abad ; il suivit Hoûchendj à la piste et le cerna avec de la cavalerie. Il envoya dire au prince hindou de le lui livrer ; mais ce dernier refusa, en disant : « Je ne livrerai pas mon hôte, quand bien même le résultat devrait être à mon égard pareil à ce qui est arrivé au roi de Canbîlah. » Cependant, Hoûchendj eut peur pour lui-même ; il expédia un message au sultan, et ils convinrent que celui-ci retournerait à Daoulet Abad ; que Kothloû khân, précepteur du sultan, resterait pour que Hoûchendj reçût de lui des sûretés, et se rendît chez Kothloû khân avec un sauf-conduit. Le sultan partit, et Hoûchendj s’aboucha avec le précepteur, qui lui promit que le monarque ne le tuerait pas et n’abaisserait en rien son rang. Alors il sortit avec ses biens, sa famille, ses gens, et alla trouver le sultan ; celui-ci se réjouit de son arrivée, il le contenta et le revêtit d’une robe d’honneur.
Kothloû khân était un homme de parole ; on se confiait à lui, et l’on avait foi dans l’accomplissement de ses promesses. Il jouissait d’un grand crédit chez le sultan, qui le vénérait ; toutes les fois qu’il entrait près du souverain, celui-ci se levait pour l’honorer. C’est à cause de cela que Kothloû khân ne paraissait en présence du souverain que lorsqu’il était invité par lui, afin de lui épargner la fatigue de se lever. Ce précepteur aimait à faire beaucoup d’aumônes et de libéralités ; il était avide d’accomplir des bienfaits, tant envers les fakirs qu’envers les indigents.
Le chérif Ibrahim, nommé Kharîtheh dâr, c’est-à-dire le Dépositaire du papier et des roseaux à écrire dans le palais du sultan, était gouverneur du pays de Hansi et de Sarsati quand le souverain partit pour le Ma’bar. Son père, le chérif Ahçan chah, était précisément celui qui s’était insurgé dans ce dernier pays. Lorsque Ibrahim entendit annoncer la mort du sultan, il désira beaucoup de s’emparer du pouvoir ; il était brave, généreux, et avait une belle figure. J’étais marié avec sa sœur, nommée Hoûrnaçab ; elle était très pieuse, veillait toute la nuit, et s’occupait sans cesse à prier le Dieu très haut, Elle eut de moi une fille, et je ne sais pas ce qu’elles sont devenues l’une et l’autre. La mère pouvait lire, mais elle n’avait pas appris à écrire. Au moment où Ibrahim se proposait de se révolter, il arriva qu’un des émirs du Sind passa dans le pays avec des trésors qu’il transportait à Dihly. Ibrahim lui dit : « La route est dangereuse, car elle est infestée par les brigands ; reste ici jusqu’à ce qu’elle soit praticable, et je te ferai parvenir en lieu de sûreté. » Son but était de bien s’assurer de la mort du souverain, et de disposer ensuite des sommes dont cet émir était porteur. Quand il eut connu que le sultan vivait, il laissa partir ledit émir, dont le nom était Dhiyâ almolc, fils de Chams almolc.
Lorsqu’après une absence de deux ans et demi le sultan retourna dans sa capitale, Ibrahim alla le trouver. Un de ses pages le dénonça au souverain et lui apprit ce que son maître avait eu le dessein de faire. Le sultan eut d’abord envie de le tuer immédiatement ; mais il prit un peu patience à cause de son affection pour le coupable. Un jour il arriva qu’on apporta devant le souverain une gazelle égorgée ; celui-ci l’examina et dit : « Cet animal n’a pas été convenablement jugulé ; or, jetez-le. » Ibrahim la regarda à son tour et dit : « Cette gazelle est tuée suivant toutes les règles, et je la mangerai. » Le monarque, ayant appris ce propos, le désapprouva et s’en servit comme d’un prétexte pour faire saisir Ibrahim. On lui mit des liens aux pieds, on lui attacha les mains au cou, et on le força à confesser ce dont on l’accusait, savoir : que son intention avait été de s’emparer des trésors que portait avec lui Dhiyâ almolc, lorsqu’il passa par Hansi. Ibrahim comprit que le sultan voulait se défaire de lui, à cause de la révolte de son père, et qu’aucune justification ne lui servirait. Il craignit d’être torturé, il préféra la mort et avoua immédiatement l’accusation. Il fut condamné à être coupé en deux moitiés par le milieu du corps, et, après l’exécution, il fut abandonné sur la place.
La coutume qu’on observe dans l’Inde, c’est que, toutes les fois que le souverain a ordonné de faire mourir quelqu’un, on le laisse exposé, pendant trois jours après sa mort, dans le lieu du supplice ; puis il est enlevé par une bande d’infidèles chargés de cet office, qui portent ce corps dans une fosse creusée à l’extérieur de la ville et l’y jettent. Ils ont pour habitude de demeurer toujours à l’entour du fossé, afin d’empêcher que les parents de la victime ne viennent et ne l’enlèvent. Souvent il arrive que l’un de ceux-ci donne de l’argent à ces infidèles, qui se détournent alors du cadavre, jusqu’à ce qu’il l’ait inhumé. C’est ce qu’on pratiqua à l’égard du chérif Ibrahim. Que le Dieu très haut ait pitié de lui !
Lorsque le sultan revint du Tiling, il laissa pour son lieutenant dans ce pays Tadj almolc Nosrah khân un de ses anciens courtisans. Celui-ci, ayant entendu les nouvelles de la mort du souverain, fit célébrer ses obsèques, s’empara du pouvoir et reçut le serment des peuples dans la capitale, Badracoût. Dès que le sultan apprit ces choses, il expédia son précepteur, Kothloû khân, à la tête de troupes nombreuses. Un combat terrible eut lieu, dans lequel périrent des multitudes tout entières ; ensuite Kothloû khân cerna son adversaire dans la ville. Badracoût était fortifiée ; mais le siège apporta beaucoup de dommage à ses habitants, et Kothloû khân commença à ouvrir une brèche. Alors Nosrah khân se rendit avec un sauf-conduit chez le commandant ennemi, qui lui assura la vie et l’envoya près du sultan. Il pardonna aussi aux citadins et aux troupes.
La disette ayant dominé dans différentes provinces, le sultan partit avec ses troupes pour s’établir au bord du Gange, à dix journées de Dihly. C’est la rivière où les indiens ont pour habitude de se rendre en pèlerinage. Cette fois, le souverain donna l’ordre aux gens de sa suite de bâtir solidement, au bord du fleuve. Jusque-là, ils faisaient des cabanes avec des plantes sèches, et où le feu, se mettant souvent, causait de grands dommages. On en était venu à creuser des cavernes sous le sol ; et quand un incendie éclatait on jetait les effets dans ces trous profonds, qu’on bouchait avec de la terre. J’arrivai dans ces jours au campement du souverain ; les contrées qui se trouvent à l’occident du Gange, et où le monarque demeurait, étaient affligées par la famine, tandis que celles situées à l’orient jouissaient d’une grande abondance. Ces dernières étaient alors gouvernées par ’Aïn almolc, fils de Mâhir, et parmi leurs villes principales nous citerons : ’Aoudh (Oude), Zafar Abad et Lucnaou. L’émir ’Aïn almolc envoyait chaque jour cinquante mille manns, ou mesures, en blé, riz et pois chiches, pour la nourriture des bêtes de somme. Le sultan avait commandé de conduire les éléphants, la plupart des chevaux et des mulets, dans les pays placés au levant, qui étaient fertiles, afin qu’ils pussent y paître ; il avait chargé ’Aïn almolc d’en avoir soin. Cet émir avait quatre frères : Chahr Allah, Nasr Allah, Fadhl Allah, et un quatrième dont j’ai oublié le nom. Ils convinrent tous, avec ’Aïn almolc, de se saisir des éléphants et des bêtes de somme du sultan, de prêter le serment d’obéissance à ’Aïn almolc et de se soulever contre le monarque de l’Inde. ’Aïn almolc s’enfuit nuitamment vers ses frères, et peu s’en fallut que leur plan ne réussît.
C’est ici le lieu de noter que le souverain de l’Inde a pour habitude de placer près de chaque émir, soit grand, soit petit, un de ses mamlouks, qui fait l’office d’espion au détriment de l’émir et instruit le sultan de tout ce qui concerne son maître. Il a soin aussi d’établir dans les maisons des femmes esclaves qui remplissent un rôle analogue, toujours au préjudice des émirs. Il a encore des femmes qu’il nomme les balayeuses, qui entrent dans les diverses maisons sans permission, et auxquelles les esclaves ci-dessus racontent ce qu’elles connaissent. Les balayeuses rapportent cela au roi des donneurs de nouvelles, et celui-ci en informe le sultan. On raconte à ce sujet qu’un émir était une fois couché avec sa femme, et qu’il voulait avoir commerce avec elle ; mais que celle-ci le conjura, « par la tête du sultan », de ne pas le faire ; il n’en tint pas compte. Dès le matin, le sultan l’envoya quérir ; il lui raconta exactement ce qui s’était passé, et cette circonstance fut cause de la perte de l’émir.
Le monarque avait un mamlouk nommé le fils de Malik chah, qui était chargé d’espionner le susdit ’Aïn almolc. Il fit part au sultan que cet émir avait pris la fuite et avait traversé le fleuve. Alors le sultan se repentit de ce qu’il avait fait (Coran, vii, 148)et pensa que sa perte était imminente ; car les chevaux, les éléphants, les céréales étaient tous entre les mains de ’Aïn almolc, tandis que ses propres troupes se trouvaient éparpillées. Il voulait retourner à Dihly, afin de rassembler des armées, et de revenir ensuite pour combattre le rebelle. C’est sur ce sujet qu’il tint conseil avec les grands de l’État. Les émirs du Khoraçan, ainsi que tous les étrangers, étaient ceux qui craignaient le plus ’Aïn almolc, parce qu’il était Indien. Or les indigènes haïssaient beaucoup les étrangers, à cause de la faveur dont ceux-ci jouissaient près du sultan. Ces émirs désapprouvèrent le plan du souverain, et lui dirent : « O Maître du monde ! si tu retournes dans ta capitale, le rebelle le saura ; sa condition deviendra meilleure ; il lèvera des troupes ; tous ceux qui cherchent les troubles et qui ne demandent que les guerres civiles accourront près de lui. Il vaut donc mieux l’attaquer promptement, avant que son pouvoir s’affermisse. » Le premier qui parla en ces termes, ce fut Nasir eddîn Mothahher alaouhéry ; tous les émirs l’appuyèrent.
Le sultan suivit leur conseil ; il écrivit cette nuit-là même aux commandants et aux troupes qui se trouvaient dans les lieux environnants ; et ils arrivèrent sans délai. Il fit usage à cette occasion d’un joli stratagème, savoir : lorsqu’il devait arriver à son quartier cent cavaliers, par exemple, il en expédiait à leur rencontre, pendant la nuit, plusieurs milliers ; et ils entraient tous ensemble dans le camp ; comme si la totalité eût été un nouveau secours pour lui. On chemina le long du fleuve, car le souverain voulait avoir derrière lui la ville de Canoge pour pouvoir s’y appuyer et s’y défendre à cause de sa force et de sa solidité ; il y avait trois jours de marche du lieu où l’on était alors à cette ville. Le sultan ordonna le départ pour la première étape ; il disposa l’armée en ordre de bataille, et quand on fit halte il la mit sur une seule ligne. Chaque soldat avait devant lui ses armes, à son côté son cheval, et avec lui une petite tente où il mangeait et se lavait, pour retourner tout de suite après à son poste. Le grand quartier était loin des troupes ; mais, durant ces trois jours, le souverain n’est pas entré dans une tente, et il ne s’est mis à l’ombre nulle part.
Je me trouvais un de ces trois jours sous la tente, en compagnie de mes femmes esclaves. Un de mes eunuques, nommé Sunbul, m’appela, et m’invita à me hâter. Quand je sortis, il me dit : « Le sultan vient d’ordonner qu’on fasse mourir quiconque sera trouvé avec sa femme ou avec sa concubine. » Les émirs intercédèrent près du souverain, il commanda que, dès ce moment, il ne restât plus dans le camp une seule femme ; et que toutes les personnes du sexe fussent transportées dans un château des environs, à trois milles de distance et appelé Canbîl. En effet, on ne vit plus de femmes dans le campement, pas même avec le sultan.
Nous passâmes cette première nuit en ordre de bataille ; le lendemain, l’empereur divisa son armée en petits corps ; il donna à chacun de ceux-ci des éléphants couverts de leurs cuirasses et surmontés de tours, sur lesquelles se tenaient des combattants. Tous les soldats endossèrent leur armure ; ils se préparèrent au combat et passèrent la seconde nuit sous les armes. Au troisième jour, le sultan fut informé que le rebelle ’Aïn almolc avait traversé le fleuve ; il éprouva de grandes craintes à ce sujet, et soupçonna que son adversaire n’avait agi de la sorte qu’après s’être concerté avec les émirs, qui se trouvaient alors près de leur souverain. Il ordonna à l’instant de distribuer les chevaux de race à ses courtisans, et j’en reçus ma part.
J’avais un ami appelé Emir émirân, le Grand Emir, Alcarmâny, qui était au nombre des braves, et à qui je donnai un de ces chevaux, d’un poil grisâtre. Lorsqu’il voulut le mettre en mouvement, le cheval s’emporta, sans qu’il pût le retenir, et le jeta de dessus son dos. Il mourut de sa chute. Que le Dieu très haut ait pitié de lui !
Le monarque fit hâter la marche, et l’on parvint le soir à la ville de Canoge ; il avait eu peur que le rebelle n’arrivât avant lui devant cette cité.
Il passa cette nuit à disposer lui-même les troupes ; il nous inspecta aussi, et nous faisions partie de l’avant-garde, où se trouvait le fils de son oncle paternel, le roi Firouz. Il y avait également avec nous l’émir Ghada, fils de Mohanna, le sayyid Nasir eddîn Mothahher et les chefs du Khoraçan. Le sultan nous mit au nombre de ses courtisans et nous dit : « Vous m’êtes très chers ; il ne faut pas que vous me quittiez jamais. » Cependant, le résultat fut à l’avantage du souverain de l’Inde. En effet, ’Aïn almolc attaqua, sur la fin de la nuit, notre avant-garde, où était le vizir Khodjah Djihan. Un grand tumulte eut lieu alors, mais le sultan ordonna que personne ne quittât son poste et que tous combattissent avec le sabre exclusivement. Les soldats tirèrent donc leurs glaives ; ils tombèrent sur les ennemis et le combat fut acharné. Le mot d’ordre des troupes du sultan était Dihly et Ghazna ; quand on rencontrait un cavalier, on lui criait : « Dihly » ; s’il répondait « Ghazna », on connaissait que c’était un ami, et sinon on le combattait. Le but du rebelle avait été de faire main basse sur le quartier du souverain ; mais le guide se trompa et se dirigea avec ’Aïn almolc vers le lieu où se trouvait le vizir. Le rebelle coupa la tête du conducteur. Dans l’armée du vizir étaient les Persans, les Turcs et les Khorâçâniens, qui tous étaient ennemis des Indiens ; en conséquence, ils combattirent vigoureusement. Les troupes de l’insurgé comptaient environ cinquante mille hommes, qui furent mis en fuite vers le point du jour.
Le roi Ibrahim, appelé Albendjy attatary, avait reçu en fief du sultan la contrée de Sundîlah, qui est un gros village du pays gouverné par ’Aïn almolc ; il se révolta avec ce dernier, et devint son lieutenant. D’un autre côté, Daoud, fils de Kothb almolc, et le fils du roi des marchands avaient été chargés de conduire les éléphants et les chevaux de l’empereur de Dihly. Ils s’unirent aussi avec le rebelle, qui nomma Daoud son chambellan. Au moment où l’ennemi attaqua le quartier du vizir, ce Daoud proférait des injures contre le sultan, et il l’invectivait d’une manière indigne ; le souverain entendit tout et reconnut sa voix. Lors de la fuite, ’Aïn almolc dit à son lieutenant Ibrahim attatary : « Quel est ton avis, ô roi Ibrahim ? La plus grande partie de l’armée est en déroute, et les plus courageux eux-mêmes s’enfuient. Ne penses-tu pas qu’il soit temps de nous sauver ? » Alors Ibrahim dit à ses compagnons, dans leur langage : « Quand ’Aïn almolc voudra fuir, je saisirai sa tresse de cheveux ; à l’instant vous frapperez son cheval, afin que l’émir tombe par terre ; nous l’arrêterons, nous le mènerons au sultan, pour que cela soit une expiation de la faute que j’ai commise de me révolter avec lui contre le souverain, et une cause de ma future délivrance. » En effet, ’Aïn almolc se disposant à s’enfuir, Ibrahim lui cria : « Où vas-tu, ô sultan ’Alâ eddîn ? » Car tel était son surnom. Il le prit par sa natte de cheveux ; ses gens blessèrent le cheval du rebelle, qui tomba, et Ibrahim se jeta sur ’Aïn almolc et le saisit. Les camarades du vizir s’empressèrent de le réclamer, mais Ibrahim ne voulut pas le livrer, et dit : « Je ne quitterai pas ’Aïn almolc jusqu’à ce que je l’aie conduit en présence du vizir, ou bien je mourrai auparavant. » Ils le laissèrent, et Ibrahim mena l’émir à Khodjah Djihan.
Au matin, j’étais occupé à regarder les éléphants et les drapeaux qu’on amenait devant le sultan, lorsqu’un individu de l’Irak vint à moi et me dit : « On a déjà saisi ’Aïn almolc, qui se trouve maintenant au pouvoir du vizir. » Je ne le crus pas ; mais, peu d’instants après, je vis arriver le roi Témoûr, l’échanson ; il me prit la main et me dit : « Réjouis-toi, on s’est emparé de ’Aïn almolc, et il se trouve chez le vizir. » Sur ces entrefaites, le souverain se dirigea vers le quartier du rebelle, sur le Gange ; nous étions avec lui, et les soldats pillèrent tout ce qui s’y rencontrait. Une grande partie des troupes de ’Aïn almolc se précipitèrent dans le fleuve et se noyèrent. On prit Daoud, fils de Kothb almolc, le fils du roi des marchands et un grand nombre de gens avec eux ; on s’empara des trésors, des chevaux et des effets. L’empereur campa près du passage du fleuve, et le vizir conduisit ’Aïn almolc au souverain. On avait fait monter l’émir rebelle sur un taureau, et il était tout nu, sauf les parties génitales, qui étaient recouvertes d’un lambeau d’étoffe attaché par une corde, dont les bouts étaient passés au cou du captif. Celui-ci resta à la porte de la tente, ou serâtcheh, le vizir entra, et le souverain lui offrit aussitôt le sorbet, à cause de sa bienveillance pour lui. Les fils des rois se portèrent près de ’Aïn almolc ; ils l’injurièrent, lui crachèrent à la figure et souffletèrent ses camarades. Le sultan lui expédia le grand roi (Kaboûlah), qui lui dit : « Quelle abominable action as-tu commise ? » ’Aïn almolc ne répondit rien. Le souverain donna l’ordre qu’on revêtît le prisonnier avec les habits que portent les conducteurs des bêtes de somme ; qu’on lui mît quatre chaînes aux pieds ; qu’on attachât ses mains à son cou, et qu’on le livrât à la garde du vizir Khodjah Djihan.
Les frères de ’Aïn almolc passèrent le fleuve en fuyards, et ils arrivèrent à la ville de ’Aoudh. Ils prirent leurs femmes, leurs enfants, tous les biens qu’ils purent ramasser, et dirent à l’épouse de leur frère prisonnier : « Sauve-toi avec nous, en compagnie de tes fils. » Elle répondit : « Ne dois-je pas faire comme les femmes des Hindous qui brûlent leur corps avec leurs maris ? Moi aussi, je veux mourir si mon époux meurt, et vivre s’il vit. » Ses beaux-frères la laissèrent ; le sultan ayant eu connaissance de son discours, ce fut là une cause de bonheur pour cette femme, car il eut compassion d’elle. Le jeune homme, Sohaïl, atteignit Nasr Allah, un desdits frères ; il le tua et apporta sa tête au souverain ; il amena aussi la mère de ’Aïn almolc, sa sœur et sa femme. Elles furent livrées au vizir, et logées dans un pavillon près de celui de ’Aïn almolc. Ce dernier allait les y trouver, restait souvent avec elles et retournait ensuite à sa prison.
Dans l’après-midi du jour de la déroute, l’empereur ordonna de mettre en liberté la multitude qui suivait ’Aïn almolc, comme les conducteurs des bêtes de somme, les petits marchands, les serviteurs et autres gens sans importance. On lui amena le roi Ibrahim albendjy, dont il a été fait mention ci-dessus ; alors le chef de l’armée, le roi Nouâ, dit : « O Maître du monde, tue celui-ci, car c’est un des rebelles. » Le vizir répondit : « Il a déjà racheté sa vie au moyen du principal insurgé. » Le sultan lui pardonna et le fit partir pour son pays (la Transoxiane). Au soir, le sultan s’assit dans la Tour de bois, et on lui présenta soixante-deux individus d’entre les principaux compagnons de ’Aïn almolc. On fit venir les éléphants, on les leur jeta ; ces animaux se mirent à les couper en pièces avec les fers placés sur leurs défenses, à en lancer quelques-uns dans l’air et à les attraper au vol. Pendant ce temps, on donnait du cor de chasse, on sonnait de la trompette et on battait du tambour ; ’Aïn almolc était là debout, il voyait leur massacre ; on lui jetait même quelques portions des victimes. Après quoi on le reconduisit dans sa prison.
Le souverain resta plusieurs jours près du passage du fleuve, à cause du nombre considérable des gens et de la petite quantité des embarcations. Il fit traverser ses effets et ses trésors sur les éléphants ; il fit distribuer de ces animaux à ses courtisans, afin qu’ils fissent passer leurs bagages. Je reçus un éléphant, qui me servit à transporter tous mes effets. Ensuite, le souverain se dirigea avec nous vers la ville de Bahrâïdj, qui est belle et située au bord du Serou ; c’est un grand fleuve, au courant très rapide. Le sultan le passa dans le but de faire un pèlerinage au tombeau du pieux cheikh, du héros sâlâr, « général », ’Oûd, qui fit la conquête de la plupart de ces contrées.[54] On raconte sur lui des histoires merveilleuses, et on lui attribue des expéditions célèbres. La foule se précipita pour traverser l’eau ; on se pressa beaucoup, de sorte qu’il y eut un grand navire qui coula à fond. Il contenait environ trois cents personnes, dont une seule se sauva c’était un Arabe, compagnon de l’émir Ghada. Nous étions montés sur un petit bâtiment, et le Dieu très haut nous délivra. L’Arabe qui échappa au danger de se noyer s’appelait Salim, « sain et sauf », et c’est là un singulier hasard. Il voulait s’embarquer sur notre navire ; mais, quand il arriva, nous étions déjà partis ; alors il prit place sur celui qui fut submergé. Au moment où il sortit du péril, le public crut qu’il était avec nous ; le bruit s’en répandit parmi nos compagnons, comme parmi les autres gens, et ils s’imaginèrent que nous étions tous noyés. Lorsqu’ils nous virent, après cela, ils se réjouirent fort de notre salut.
Nous visitâmes la tombe du pieux personnage nommé ci-dessus ; elle est située dans une coupole, où nous ne pûmes pas pénétrer, tant la foule était considérable. Ce fut pendant ce voyage que nous entrâmes dans une forêt de roseaux et que nous fûmes attaqués par un rhinocéros. On le tua, et l’on nous apporta sa tête ; celle-ci était plusieurs fois aussi grosse que celle de l’éléphant, quoique l’animal fût plus petit qu’un éléphant. Mais nous avons déjà, dans ce qui précède, fait mention du rhinocéros.
Le sultan, ayant remporté la victoire sur ’Aïn almolc, comme nous l’avons raconté, retourna à Dihly, après une absence de deux années et demie. Il pardonna à ’Aïn almolc, ainsi qu’à Nosrah khân, qui s’étaient soulevés dans le pays de Tiling, et il les investit tous les deux d’un même emploi l’inspection des jardins du souverain. Il leur fournit des habillements, des montures ; il fixa leur consommation journalière en farine et en viande.
Après cela on reçut la nouvelle qu’un compagnon de Kothloû khân, le nommé ’Aly chah Ker, s’était révolté contre le sultan ; le mot ker signifie sourdaud. C’était un guerrier intrépide ; il était beau et vertueux ; il s’empara de Badracoût et en fit la capitale de son royaume. On envoya des troupes contre lui et le sultan commanda à son précepteur d’aller le combattre. Celui-ci partit à la tête d’une nombreuse armée ; il fit le siège de Badracoût, et ouvrit des brèches dans ses tours. Le péril étant devenu grave pour ’Aly chah, il demanda un sauf-conduit, que Kothloû khân lui accorda ; puis il l’expédia au souverain avec des entraves aux pieds. Ce dernier lui pardonna et le relégua dans la ville de Ghazna, du côté de Khoraçan, où il resta un certain espace de temps. Plus tard, il fut pris du désir de se retrouver dans sa patrie et voulut y retourner, car Dieu avait décrété sa perte. Il fut arrêté dans la province du Sind, et on le conduisit en présence du sultan, qui lui dit : « Tu es venu uniquement pour exciter le désordre une seconde fois. » Il lui fit couper la tête.
Le souverain s’était fâché contre l’émir bakht surnommé Cheref almolc, un de ceux qui arrivèrent avec nous près de lui. Il réduisit sa pension de quarante mille à mille (dinars?) seulement, et l’envoya à Dihly, le mettant à la disposition du vizir. Sur ces entrefaites, l’émir ’Abdallah alharaouy mourut de la peste à Tiling ; ses biens se trouvaient chez ses amis à Dihly, et ceux-ci s’entendirent avec l’émir bakht pour prendre ensemble la fuite. Quand le vizir sortit de la capitale à la rencontre du sultan, ils s’échappèrent, en effet, en compagnie de l’émir bakht et de ses camarades, et ils arrivèrent dans le Sind en sept jours, tandis que la route ordinaire est de quarante journées. Ils conduisaient avec eux des chevaux de main, et ils avaient l’intention de passer l’Indus à la nage ; seulement, l’émir bakht, son fils et ceux qui ne savaient pas bien nager devaient le traverser dans une sorte de batelet en joncs, qu’ils se proposaient de faire. Déjà ils avaient préparé des cordes de soie pour cet objet.
Lorsqu’ils parvinrent au fleuve, ils craignirent d’en effectuer le trajet, comme ils avaient médité, et ils envoyèrent à Djélal eddîn, gouverneur de la ville d’Outchah, deux d’entre eux, qui lui dirent : « Il y a ici des marchands qui désirent passer la rivière, et ils t’envoient en cadeau cette selle, afin que tu leur facilites le trajet. » L’émir Djélal eddîn révoqua en doute qu’un tel présent fût offert par de simples marchands, et il ordonna de saisir les deux individus. L’un d’eux s’échappa ; il alla trouver Cheref almolc et ses compagnons, et les informa de ce qui s’était passé. Ils étaient tous endormis par suite des fatigues qu’ils avaient endurées et de leurs veilles prolongées ; ils montèrent à cheval très effrayés et prirent la fuite.
De son côté, Djélal eddîn fit frapper l’homme qu’on avait arrêté, lequel confessa tout ce qui concernait Cheref almolc. Le gouverneur expédia son lieutenant avec des troupes à la recherche de celui-ci et de ses compagnons ; on trouva qu’ils s’étaient enfuis, et l’on suivit leurs traces. Quand le détachement les atteignit, ils se mirent à lancer des flèches ; Thâhir, fils de Cheref almolc, en tira une, qui blessa au bras ledit subdélégué de l’émir Djélal eddîn. Enfin on en vint à bout, et on les conduisit en présence du gouverneur, qui leur fit mettre des entraves aux pieds, leur fit attacher les mains au cou et écrivit au vizir sur cet événement. Khodjah Djihan lui répondit de les envoyer à Dihly ; et quand ils y furent arrivés on les mit en prison. Thâhir mourut dans le cachot ; Cheref almolc fut condamné par le sultan à recevoir chaque jour cent coups de fouet ; et cela dura un certain espace de temps.
Ensuite le souverain lui pardonna et l’envoya dans la province de Tchendîri avec l’émir Nizâm eddîn, Mir Nadjlah. Il fut réduit à monter sur des bœufs, n’ayant point un seul cheval à sa disposition, et il passa ainsi quelques années. Mir Nadjlah alla trouver l’empereur de Dihly, ayant en sa compagnie Cheref almolc ; et à cette occasion celui-ci fut nommé Tchâchnéguîr, « dégustateur ». C’est l’officier qui découpe les viandes en présence du sultan et qui apporte les mets. Plus tard, le souverain l’honora de plus en plus et l’éleva en dignité ; ce fut au point que, Cheref almolc étant indisposé, le sultan lui rendit visite ; il ordonna d’établir l’équivalent de son poids en or, et il le lui donna. Nous avons déjà raconté cette histoire dans la première partie de ces voyages. Enfin le sultan maria sa sœur avec Cheref almolc, et concéda à celui-ci la province de Tchendîri, ce même pays où il avait été forcé de monter des bœufs, étant au service de l’émir Nizâm eddîn. Louons Dieu, qui change les cœurs et qui modifie la situation des hommes !
Châh Afghân s’était soulevé contre le souverain, dans le pays de Moultân, en la province du Sind. Il avait tué l’émir de cette contrée, qui était appelé Bihzâd, « bien né, heureux », et il prétendait devenir sultan. L’empereur de Dihly se prépara à le combattre ; le rebelle comprit qu’il ne pouvait pas lui tenir tête, et s’enfuit. Il se rendit chez sa peuplade, les Afghâns, qui habitent des montagnes difficiles et inaccessibles. Le sultan fut irrité contre lui, et il écrivit à ses employés de saisir tous les Afghâns qu’ils trouveraient dans ses États. Cela fut cause de la révolte du juge Djélal eddîn.
Le juge Djélal eddîn et une troupe d’Afghâns étaient établis dans le voisinage des deux villes, Cambaie et Boloûdhrah. Quand le souverain écrivit à ses agents d’arrêter les Afghâns, il manda au roi Mokbil, lieutenant du vizir dans les provinces de Guzarate et de Nahrouâlah, de trouver un stratagème pour saisir le kadi Djélal eddîn et ses compagnons. La contrée de Boloûdhrah avait été donnée en fief au roi des médecins ou des savants, qui était marié avec la belle-mère du souverain, veuve de son père Toghlok. Elle avait eu de ce dernier une fille, qui était celle-là même qu’avait épousée l’émir Ghada. Le roi des savants se trouvait alors en compagnie de Mokbil, car son pays était sous l’inspection de celui-ci. Lorsqu’ils furent arrivés dans la province de Guzarate, Mokbil lui dit de lui amener le juge Djélal eddîn et ses camarades. Le roi des savants, étant arrivé dans son fief, les avertit en secret, car ils étaient au nombre de ses concitoyens. Il leur dit que Mokbil les demandait pour les arrêter, et leur conseilla de ne se rendre à son appel que bien armés.
Ils allèrent chez Mokbil, au nombre d’environ trois cents cavaliers couverts de cuirasses, et lui dirent : « Nous n’entrerons que tous ensemble. » Il vit alors qu’il ne pouvait pas réussir à s’emparer d’eux tant qu’ils seraient réunis ; il en eut peur, leur ordonna de repartir et fit semblant de les protéger. Mais ils se soulevèrent contre lui ; ils entrèrent dans Cambaie, pillèrent le trésor du sultan, les biens des particuliers et ceux du fils d’Alkaoulémy, le marchand. C’est le personnage qui fonda à Alexandrie un beau collège, et nous en parlerons tout à l’heure. Le roi Mokbil se présenta pour combattre les insurgés, et il fut mis en fuite d’une manière honteuse. Le roi ’Aziz, dit le négociant en vins, et le roi Djihan arrivèrent, après avoir fait des préparatifs, avec sept mille cavaliers ; ils furent aussi mis en déroute.
Les gens turbulents et les criminels, informés de ces événements, accoururent se joindre aux Afghâns. Le juge Djélal eddîn se déclara sultan, et reçut le serment de ses compagnons ; l’empereur de Dihly envoya des troupes contre lui, mais il les battit. Il y avait à Daoulet Abad une multitude d’Afghâns, qui se révoltèrent à leur tour.
Le fils du roi Mell habitait Daoulet Abad avec une troupe d’Afghans, et le souverain écrivit à son lieutenant dans cette ville, qui était Nizâm eddîn, frère de son précepteur Kothloû khân, de les saisir tous, sans exception. Il lui envoya de nombreuses charges de liens et de chaînes, et lui expédia en même temps les habillements d’hiver. L’usage du souverain de l’Inde est de donner à chaque commandant d’une ville et aux chefs de son armée deux vêtements par an : un pour l’hiver et un pour l’été. Quand ces robes d’honneur arrivent, l’émir et les troupes sortent pour les recevoir ; dès qu’ils aperçoivent celui qui les apporte, ils descendent de leurs montures ; chacun d’eux reçoit son vêtement, le place sur son épaule et s’incline du côté où se trouve le sultan. Celui-ci écrivit à Nizâm eddîn ces paroles : « Lorsque les Afghans sortiront et mettront pied à terre pour recevoir les robes qui leur sont destinées, arrête-les dans ce même moment. »
Un des cavaliers qui arrivaient avec les robes d’honneur se rendit chez les Afghans et les instruisit du dessein qu’on avait formé à leur égard. Par conséquent, Nizâm eddîn fut au nombre de ceux qui usent d’un stratagème, lequel tourna contre eux. Il monta à cheval, en compagnie des Afghâns, et quand ils rencontrèrent les habillements, il mit pied à terre. Ce fut alors que les Afghâns chargèrent sur lui et sur ses compagnons, qu’ils tuèrent beaucoup de ceux-ci, et qu’ils l’arrêtèrent. Ils envahirent la ville, saisirent les trésors et mirent à leur tête Nasir eddîn, fils du roi Mell. Les fauteurs de troubles accoururent vers eux et leur puissance augmenta.
Lorsque l’empereur de Dihly sut ce que les Afghans avaient fait à Cambaie et à Daoulet Abad, il se mit en campagne lui-même et se décida à commencer par Cambaie, pour retourner ensuite à Daoulet Abad. Il fit partir le grand roi Albâïazîdy, son parent par alliance, ou beau-frère, à la tête de quatre mille hommes d’avant-garde, qui furent attaqués par les troupes du juge Djélal eddîn et mis en fuite. Ils furent ensuite assiégés à Boloûdhrah, et l’on combattit même dans cette cité. Dans l’armée du juge Djélal eddîn, il y avait un cheikh nommé Djaloûl qui était un brave ; il ne cessait de tomber sur les soldats, de les tuer, et de demander le combat singulier ; mais personne ne se hasardait à se mesurer en duel avec lui. Un jour il lança son cheval, qui s’abattit dans une fosse ; Djaloûl tomba, il fut tué, et l’on trouva sur lui deux cuirasses. On envoya sa tête au sultan ; on crucifia son corps sur la muraille de Boloûdhrah, et l’on porta de ville en ville ses mains ainsi que ses pieds.
A l’arrivée du souverain avec les troupes, le juge Djélal eddîn ne put plus résister, et il prit la fuite avec ses compagnons. Ils abandonnèrent leurs biens et leurs enfants ; tout cela fut saisi, et l’on entra dans la ville de Cambaie, Le sultan y resta quelques jours, puis il partit et y laissa son beau-frère, Cheref almolc, émir bakht. Nous avons déjà parlé de ce personnage ; nous avons fait connaître l’histoire de sa fuite, de son arrestation dans le Sind et de son emprisonnement ; nous avons raconté les humiliations qu’il a endurées et les honneurs qui les ont suivies. Le monarque lui ordonna de rechercher ceux qui étaient du parti de Djélal eddîn, et il laissa avec lui des jurisconsultes, afin qu’il jugeât d’après leurs décisions. Cette circonstance amena la condamnation à mort du cheikh ’Aly alhaïdary, comme il a été dit plus haut.
Le juge Djélal eddîn, s’étant enfui, alla se joindre à Nasir eddîn,
fils du roi Mell, à Daoulet Abad, et s’enrôla parmi ses partisans.
Le sultan se dirigea en personne contre eux ; ils étaient au nombre
d’environ quarante mille, Afghâns, Turcs, Indiens et esclaves ; ils
jurèrent ensemble qu’ils ne prendraient point la fuite et qu’ils se
battraient contre le souverain. Celui-ci commença le combat, et l’on
n’éleva pas d’abord le parasol, insigne du sultan ; mais, dans
l’ardeur de la bataille, on le hissa. Quand les rebelles le virent,
ils furent interdits et fuirent d’une manière honteuse. Le fils du
roi Mell et le kadi Djélal eddîn se réfugièrent, en compagnie d’à
peu près quatre cents de leurs adhérents les plus distingués, dans
la forteresse de Douaïguîr (ou Dïoûguîr
 ), que
nous mentionnerons plus loin, et qui est une des plus inaccessibles
du monde. Le sultan resta à Daoulet Abad, ville dont Douaïguîr est
le château fort. Il envoya dire aux insurgés de se rendre à
discrétion ; mais ceux-ci ne consentaient à quitter leur place qu’à
la condition d’une amnistie ; le sultan ne voulut pas la leur
promettre. Il leur fit parvenir des aliments, par une sorte de
dédain pour eux, et continua à demeurer à Daoulet Abad. Ici
finissent les informations que je puis donner à ce sujet.
), que
nous mentionnerons plus loin, et qui est une des plus inaccessibles
du monde. Le sultan resta à Daoulet Abad, ville dont Douaïguîr est
le château fort. Il envoya dire aux insurgés de se rendre à
discrétion ; mais ceux-ci ne consentaient à quitter leur place qu’à
la condition d’une amnistie ; le sultan ne voulut pas la leur
promettre. Il leur fit parvenir des aliments, par une sorte de
dédain pour eux, et continua à demeurer à Daoulet Abad. Ici
finissent les informations que je puis donner à ce sujet.
Ce que nous allons raconter s’est passé avant le soulèvement et la rébellion du kadi Djélal eddîn. Or le personnage nommé Tadj eddîn, fils d’Alcaoulémy, était un des principaux négociants ; il était venu du pays des Turcs pour rendre visite au sultan de l’Inde et pour lui porter des cadeaux magnifiques. Parmi ces présents, il y avait des mamlouks, des chameaux, des marchandises, des armes et des étoffes. L’empereur fut très satisfait de son procédé et lui donna douze lacs, ou douze fois cent mille dinars d’argent ; on dit que la valeur de tout ce qu’il avait apporté au souverain ne dépassait pas un seul lac, ou cent mille pièces d’argent. Il lui donna à gouverner la ville de Cambaie, qui était sous l’inspection du roi Mokbil, lieutenant du vizir.
Une fois arrivé à Cambaie, Tadj eddîn envoya des bâtiments dans le Malabar, l’île de Ceylan, etc. ; il reçut, par les navires, des dons et des cadeaux magnifiques, de sorte que sa position devint très considérable. Quand le moment fut venu d’expédier dans la capitale les tributs desdites contrées, le roi Mokbil lui fit dire de les livrer à cet effet, suivant l’usage, ainsi que les présents et les trésors qu’il avait préparés. Le fils d’Alcaoulémy refusa en disant : « Je les amènerai en personne, ou bien je les ferai porter par mes serviteurs. Ni le vizir ni son lieutenant n’ont de pouvoir sur moi. » Il se faisait ainsi illusion à cause des honneurs et des présents qu’il avait reçus de l’empereur. Mokbil écrivit au vizir sur cette affaire ; il en eut pour réponse, au dos de sa lettre, ce qui suit : « Si tu es impuissant pour nous faire obéir dans nos contrées, quitte-les et reviens près de nous. » Ayant lu ces lignes, Mokbil se mit à la tête de ses troupes et de ses mamlouks, et il combattit contre le fils d’Alcaoulémy, à l’extérieur de Cambaie. Ce dernier fut mis en fuite, et un certain nombre d’hommes furent tués de part et d’autre.
Le fils d’Alcaoulémy se cacha dans la maison du patron de navire, Ilïâs, un des principaux négociants. Mokbil entra dans Cambaie, et fit couper la tête aux chefs de l’armée de son adversaire. Il envoya un sauf-conduit à celui-ci, à la condition qu’il garderait seulement son propre bien et qu’il abandonnerait les trésors et les cadeaux dus au sultan, ainsi que les revenus de la ville. Mokbil fit partir toutes ces richesses, sous la conduite de ses serviteurs, pour les présenter au souverain, et il écrivit, se plaignant du fils d’Alcaoulémy. Celui-ci, de son côté, écrivit aussi au sultan, pour se plaindre du roi Mokbil. L’empereur de Dihly leur envoya le roi des savants, pour qu’il décidât leur querelle. Ce fut immédiatement après ces faits qu’eurent lieu la révolte du juge Djélal eddîn et le pillage des biens du fils d’Alcaoulémy, qui prit la fuite en compagnie de quelques-uns de ses mamlouks, et qui se rendit chez le sultan.
Dans l’espace de temps où le souverain était absent de sa capitale, s’étant dirigé vers la province de Ma’bar, la disette eut lieu, et elle fut considérable. Le mann, ou la mesure de froment, valait soixante drachmes et davantage ; la gêne fut générale, la situation très grave. Un jour, je sortis de la ville à la rencontre du vizir, et je vis trois femmes qui coupaient en morceaux la peau d’un cheval, lequel était mort depuis plusieurs mois, et qui les mangeaient. D’ailleurs, on faisait cuire les peaux et on les vendait dans les marchés. Lorsqu’on égorgeait des bœufs, la foule s’empressait d’en recueillir le sang pour s’en nourrir. Des étudiants du Khoraçan m’ont raconté qu’ils entrèrent dans une ville appelée Icroûhah, entre Hânci et Sarsati, et qu’ils la trouvèrent abandonnée. Ils s’introduisirent dans une maison pour y passer la nuit, et ils virent dans une chambre un individu qui avait allumé du feu et qui tenait avec ses doigts un pied humain ; il le fit rôtir sur ce feu et le mangea. Que Dieu nous garde d’une pareille action !
La famine étant insupportable, le sultan ordonna de distribuer à toute la population de Dihly des vivres pour six mois. Les juges, les secrétaires et les commandants parcouraient les rues et les marchés ; ils prenaient note des habitants et donnaient à chacun les provisions pour la moitié d’une année, sur le pied d’une livre et demie du Maghreb par jour pour chaque personne. A cette époque, je fournissais de la nourriture aux pauvres avec les mets que je faisais préparer dans la chapelle sépulcrale du sultan Kothb eddîn, ainsi que nous le dirons plus bas ; et la multitude se soutenait de cette façon. Que le Dieu très haut nous tienne compte des soins que nous avons pris dans un tel but !
Puisque nous avons suffisamment parlé des aventures du sultan, et des événements qui se passèrent sous son règne, revenons à ce qui nous concerne de plus près dans ces faits. Nous raconterons donc d’abord notre arrivée à Dihly, les vicissitudes de notre situation, jusqu’au moment où nous quittâmes le service du souverain ; nous dirons ensuite comme quoi nous nous séparâmes du sultan, pour aller, comme son ambassadeur, en Chine, et enfin nous ferons mention du retour dans notre patrie, s’il plaît à l’Être suprême.
A notre arrivée dans la capitale, nous nous rendîmes à la demeure du sultan et entrâmes par le première porte, puis par la deuxième et la troisième. Ici nous trouvâmes les nakîbs ou officiers, dont nous avons déjà parlé. Quand ils nous virent, leur chef nous précéda dans une salle d’audience magnifique et très vaste, où nous trouvâmes le vizir Khodjah Djihan, qui nous attendait. Le premier de nous qui entra fut Dhiyâ eddîn Khodhâwend Zâdeh, que suivirent d’abord son frère Kïouâm eddîn et le frère des deux précédents, ’Imad eddîn ; je vins après eux, et fus suivi par Borhân eddîn, autre frère des trois susnommés, puis par l’émir Mobârec assarnarkandy, par le Turc Aroun Boghâ, Mélik Zâdeh, fils de la sœur de Khodhâwend Zâdeh, enfin, par Badr eddîn alfassâl (c’est-à-dire « le flatteur », et aussi « le critique, l’accusateur »).
Ayant franchi la troisième porte, nous aperçûmes la grande salle de réception appelée Hézâr ostoûn, ce qui veut dire Mille Colonnes ; c’est là que le monarque tient ses audiences publiques. Alors le vizir s’inclina au point que sa tête toucha presque le sol ; nous saluâmes en nous prosternant, et nous touchâmes la terre avec nos doigts. Le lieu vers lequel nous nous inclinions était celui où se trouvait le trône du sultan, et tous ceux qui étaient avec moi saluèrent de ladite manière. Cette cérémonie étant accomplie, les officiers crièrent à haute voix « Au nom de Dieu ! », et nous sortîmes.
La mère du sultan est nommée la Maîtresse de l’univers, et c’est une des femmes les plus vertueuses ; elle est très charitable, et a fondé beaucoup d’ermitages qui donnent à manger aux voyageurs ; elle est aveugle, et voici l’origine de cette infirmité. Lorsque son fils commença à régner, elle reçut la visite de toutes les princesses, ainsi que des filles des grands dignitaires et des émirs, mises d’une manière pompeuse. Elles s’inclinèrent devant la mère du sultan, qui était assise sur un trône d’or, incrusté de pierres précieuses. Ce fut alors qu’elle perdit subitement la vue ; on la traita de plusieurs manières, mais ce fut sans profit. Son fils a pour elle un respect extraordinaire : un exemple de cela, c’est qu’une fois sa mère voyagea avec lui et qu’il fut de retour un certain espace de temps avant elle. Quand elle arriva, il alla à sa rencontre, descendit de son cheval, baisa le pied de sa mère, laquelle se trouvait dans une litière, où tout le monde pouvait l’apercevoir.
Pour revenir à notre sujet, lorsque nous sortîmes du palais du sultan, le vizir se rendit avec nous à Bâb assarf, que les Indiens nomment la Porte du harem ; c’est l’habitation de la Maîtresse de l’univers. Arrivés à sa porte, nous quittâmes nos montures ; chacun de nous, suivant ses moyens, avait apporté un cadeau pour la princesse. Le grand juge des mamlouks, Kamal eddîn, fils de Borhân eddîn, était entré avec nous ; il salua en s’inclinant, quand il fut arrivé à la porte ; le vizir en fit autant, et nous les imitâmes. Le secrétaire, placé à la porte de la princesse, prit note de nos présents ; une troupe de pages ou eunuques, sortirent, et leurs chefs se dirigèrent vers le vizir, avec lequel ils parlèrent en secret ; ils retournèrent dans le château, ils revinrent vers le vizir et ils se rendirent encore une fois dans le château. Nous étions debout pendant tout ce temps ; mais ensuite on nous fit asseoir sur un banc.
On apporta des mets dans des vases d’or, que les Indiens appellent suïun, et qui ressemblent à nos chaudrons ; ils sont pourvus de supports d’or, sur lesquels on les pose, et qui sont nommés subuc. On apporta aussi des coupes pour boire, des plats et des aiguières, le tout en or. Les aliments furent disposés sur deux nappes ou tables, à deux rangs chacune ; à la tête de chaque rangée se trouvait le principal personnage parmi les individus présents. Quand nous nous avançâmes pour manger, les chambellans et les officiers s’inclinèrent et nous leur rendîmes le salut. On servit le sorbet, que nous bûmes, et les chambellans dirent : « Au nom de Dieu ! » Nous mangeâmes, et puis on distribua une sorte de bière, ainsi que du bétel, et les chambellans s’écrièrent : « Au nom de Dieu ! » Nous nous inclinâmes tous. Alors on nous dit de nous rendre dans un endroit qu’on nous indiqua, et l’on nous donna des robes d’honneur en soie chamarrées d’or. Nous fûmes conduits à la porte du palais, où nous nous inclinâmes ; les chambellans dirent : « Au nom de Dieu ! » Le vizir se tint debout et nous fîmes comme lui. On tira de l’intérieur du château un coffre contenant des habillements non cousus. Il y en avait en soie, en lin, en coton, et nous en reçûmes chacun notre part. Après, on apporta un grand plat en or, contenant des fruits secs, puis un autre avec du sirop, et un troisième, où était du bétel.
L’usage est que celui à qui l’on présente ces objets prenne le plat d’une main, qu’il le place sur son épaule et qu’il incline l’autre main jusqu’à terre. Le vizir saisit le plat dans sa main, dans le but de me montrer comment je devais faire ; cela fut une preuve de complaisance, de modestie et de bonté de sa part. Que Dieu l’en récompense ! Je fis comme lui. Nous nous dirigeâmes enfin vers la maison qu’on avait préparée pour nous loger, dans la ville de Dihly, et près de Derouâzeh Bâlem, « la porte de Bâlem ou Pâlem ». On nous y envoya tout ce qui se rattache à la réception d’un hôte.
Lorsque j’arrivai à la maison préparée pour moi, j’y trouvai tout ce qui était nécessaire, en coussins, tapis, nattes, ustensiles et lit pour dormir. Les lits, dans l’Inde, sont très légers, un seul homme en porte un, et chaque voyageur doit avoir son lit avec soi, que son esclave charge sur sa tête. Il consiste en quatre pieds coniques, sur lesquels on pose quatre bâtons ; entre ceux-ci on a tissé une sorte de filet en soie ou en coton, Quand une personne s’y couche, elle n’a pas besoin d’autre chose pour le rendre souple, étant assez moelleux de sa nature. Je reçus, en outre, deux courtes-pointes, deux oreillers et une grande couverture ouatée, le tout en soie. Les indiens font des housses blanches en lin ou en coton pour recouvrir les courtes-pointes et les couvertures ; toutes les fois que ces doublures sont sales, ils les lavent, et ce qui est dans l’intérieur reste garanti. La première nuit, on nous amena deux individus dont l’un était le meunier, que ces gens appellent alkharrâs ; l’autre était le boucher, qu’ils nomment alkassâb, et l’on nous dit : « Prenez de celui-ci tant et tant de farine, et de cet autre tant et tant de viande. » Il s’agit de poids, que je ne saurais mentionner dans ce moment. L’usage de ces peuples est de fournir la même quantité en poids de viande et de farine ; et tout ce que nous venons de dire formait le repas de l’hospitalité, qui nous était offert par la mère du sultan. Puis nous arriva celui offert au nom du sultan, comme nous le raconterons.
Le lendemain, nous nous rendîmes à cheval au palais du sultan et saluâmes le vizir, qui me donna deux sacs d’argent contenant chacun mille dinars en drachmes, et qui me dit : hâdhih ser chusti. La signification de ces mots est : « voici pour laver ta tête » ; il me fit aussi cadeau d’une robe tissée avec des poils de chèvre très fins ; il inscrivit sur un registre le nombre de tous mes compagnons, de mes serviteurs et de mes esclaves, dont on fit quatre catégories. La première reçut deux cents dinars par personne ; la deuxième, cent cinquante ; la troisième, cent ; la quatrième catégorie, soixante et quinze dinars par personne. Le nombre total était de quarante individus environ, et le montant de la somme qu’ils touchèrent fut de quatre mille dinars et plus. Après cela, on fixa la quantité des vivres que nous donnait le souverain, savoir mille livres indiennes de farine, dont le tiers de mîrâ ou fleur de farine, et les deux tiers avec du son, c’est-à-dire grossièrement moulue (littéral. concassée); mille livres de viande ; un nombre considérable de livres de sucre, de beurre fondu, de salîf (?)et de noix d’arec, qu’à présent je ne me rappelle pas ; enfin mille feuilles de bétel. La livre indienne en fait vingt de Barbarie et vingt-cinq d’Égypte. Les provisions d’hospitalité reçues par Khodhâwend Zâdeh furent : quatre mille livres de farine, autant de viande, et tout le reste en proportion.
Un mois et demi après être arrivé à Dihly, je perdis une fille âgée d’un peu moins d’une année. La nouvelle en parvint au vizir, qui ordonna de l’inhumer dans un ermitage qu’il avait fondé au-dehors de la porte nommée Derouâzeh Bâlem, tout près du tombeau de notre cheikh Ibrahim alkoûnéouy : nous l’y enterrâmes. Le vizir écrivit au sultan à ce sujet, et il en reçut une réponse le soir du second jour. Pourtant, il y avait entre le lieu où le sultan se trouvait alors à la chasse et la capitale la distance de dix jours de marche.
Il est d’usage, chez les Indiens, de se rendre au tombeau du mort le matin du troisième jour après son enterrement. Ils placent tout autour de la tombe des tapis, des étoffes de soie, et, sur la sépulture même, des fleurs, qu’on trouve dans l’Inde pendant toutes les saisons. Ce sont, par exemple, des jasmins, des tubéreuses ou fleurs jaunes (amica nocturna), des reïboûls, dont la couleur est blanche, et des roses musquées ou églantines. Celles-ci sont de deux sortes ; les unes sont blanches et les autres jaunes. Ils ornent aussi le tombeau de branches d’orangers et de citronniers avec leurs fruits ; si ces derniers manquent, ils en attachent avec des fils. On répand sur la sépulture des fruits secs, des noix de coco ; les hommes se rassemblent, on apporte des exemplaires du Coran, et ils lisent. Quand ils ont fini cette lecture, on sert le sirop dissous dans l’eau, dont le public boit ; puis on verse sur chacun de l’essence de roses en profusion. Enfin on distribue le bétel, et les assistants se retirent.
Au matin du troisième jour depuis l’enterrement de cette petite fille, je sortis de bonne heure, suivant l’habitude en pareil cas, et préparai tout ce que je pus des choses susmentionnées. Je trouvai que le vizir avait déjà donné l’ordre de disposer tous ces objets, et qu’il avait fait élever une grande tente sur le tombeau. Étaient présents : le chambellan Chams eddîn alfoûchendjy, que nous rencontrâmes dans le Sind ; le kadi Nizâm eddîn alacrouâny, et une multitude de personnes parmi les grands de la ville. Lorsque j’arrivai, lesdits personnages avaient déjà pris leurs places, le chambellan étant à leur tête, et ils lisaient le Coran. Je m’assis avec mes camarades tout à côté de la sépulture ; et, quand on eut fini de lire, les lecteurs du Coran récitèrent quelques versets avec leurs belles voix. Le juge se leva, il fit l’oraison funèbre de l’enfant décédée, et ensuite l’éloge du souverain. L’assistance ayant entendu son nom, tout le monde fut debout et s’inclina ; on s’assit de nouveau, et le juge fit une très belle prière. Le chambellan et ses compagnons prirent des barils d’eau de rose, et ils en répandirent sur les individus présents ; ils distribuèrent à la ronde des coupes pleines d’une boisson préparée avec le sucre candi, et après cela le bétel. Enfin, on apporta onze robes d’honneur, pour moi et pour mes compagnons.
Le chambellan monta à cheval, et nous en fîmes autant avec lui, pour nous rendre au palais du sultan, où nous nous inclinâmes devant le trône, selon l’usage. Je retournai chez moi, et, à peine arrivé, on m’apporta des mets de la part de la mère du souverain ; il y avait de quoi remplir ma maison et les logements de mes camarades. Ceux-ci mangèrent tous ; il en fut ainsi des pauvres ; pourtant, il resta les pains ronds, les pâtisseries et le sucre candi. Ces restes servirent encore durant plusieurs jours, et tout cela fut fait par ordre du sultan.
Quelque temps après, les pages de la Maîtresse de l’univers vinrent de son palais chez moi avec un palanquin[55] ; c’est une sorte de litière qui sert pour transporter les femmes, et très souvent aussi les hommes. Il ressemble à un trône, ou lit d’apparat, et sa partie supérieure est en tresses de soie ou de coton, surmontées d’un bois (ou bâton pour passer les rideaux) pareil à celui qui se trouve chez nous sur les parasols. Ce bois est recourbé, et il est fait avec la canne de l’Inde (bambou), pleine et compacte. Huit hommes, divisés en deux moitiés, sont occupés tour à tour à porter un de ces palanquins quatre se reposent, et quatre le portent sur leurs épaules. Ces véhicules, dans l’Inde, font le même office que les ânes en Égypte ; la plupart des gens vont et viennent par leur moyen. Celui qui possède des esclaves se fait voiturer par eux ; celui qui n’en a pas loue des hommes pour le porter. On trouve toujours un petit nombre de ceux-ci dans la ville, qui stationnent dans les marchés, à la porte du sultan, et même aux portes des citadins, pour se louer. Les palanquins qui sont à l’usage des femmes sont recouverts d’un rideau de soie ; ainsi était celui que les pages ou eunuques avaient amené du palais de la mère du sultan.
Ils y firent monter mon esclave, c’est-à-dire la mère de la petite fille défunte ; je la fis accompagner par une esclave turque, que j’envoyai en cadeau (à la mère du sultan). L’esclave mère de l’enfant ci-dessus resta absente avec eux une nuit ; elle rentra le lendemain. Les pages lui avaient donné mille dinars en drachmes, des bracelets d’or enrichis de pierres précieuses, un croissant en or, orné aussi de pierres fines, une chemise de lin brodée d’or, une robe de soie chamarrée d’or, et un coffre avec des vêtements. Quand je vis toutes ces choses, je les donnai à mes compagnons, et aux marchands mes créanciers, comme une garantie personnelle et une sauvegarde de mon honneur ; car les nouvellistes écrivaient au sultan tout ce qui me concernait.
Lors de mon séjour à Dihly, le sultan ordonna de m’assigner un certain nombre de villages, du revenu de cinq milles dinars par an. Le vizir et les membres du conseil me les conférèrent, et je partis pour ces localités. Elles se composaient d’un village nommé Badali, d’un autre appelé Baçahi, et de la moitié d’un troisième, connu sous le nom de Balarah. Ils étaient à seize coroûhs ou milles de Dihly, dans le sadi (centaine) appelé le sadi de Hindoubut (l’idole hindoue) : ces peuples donnent le nom de sadi à la réunion de cent villages. Les territoires dépendants de la capitale sont divisés en centaines, dont chacune a un djeouthari, qui est le cheikh ou chef des Hindous, et un motassarif ou administrateur, chargé d’en percevoir les impôts.
Il venait d’arriver dans la ville de Dihly, au temps dont je parle, des captives faites parmi les infidèles, et le vizir m’en envoya dix. Je donnai une de ces filles esclaves à celui qui me les amena, et il ne fut pas satisfait ; mes compagnons en prirent trois toutes jeunes, et je ne sais pas ce que les autres sont devenues. Les femmes captives n’ont presque aucune valeur dans l’Inde, car elles sont sales et ne connaissent rien aux convenances des villes. Celles mêmes qui ont été instruites sont à très bon marché, et personne n’a besoin d’acheter des captives. Les infidèles occupent dans ce pays un territoire et des localités adjacents à ceux qui appartiennent aux musulmans qui les ont vaincus. Mais ces Hindous se fortifient dans les montagnes et les lieux âpres ; ils possèdent, de plus, des forêts de roseaux, lesquels ne sont pas creux, qui grossissent beaucoup, s’entrelacent les uns avec les autres, sont à l’épreuve du feu, et extrêmement solides. Les infidèles habitent ces forêts, qui sont pour eux comme des murailles ; ils gardent dans l’intérieur les bestiaux et les grains ; ils recueillent l’eau de pluie. On ne peut en venir à bout à moins d’avoir des troupes bien aguerries, et renfermant beaucoup de ces gens qui entrent dans les bois, et coupent les joncs avec des instruments préparés pour un tel but.
La solennité de la Rupture du jeûne arriva et le souverain n’était pas encore de retour à Dihly. Au jour de la fête, le prédicateur monta un éléphant, sur le dos duquel on avait adapté pour lui une sorte de trône ; à ses quatre angles, on avait fiché quatre étendards, et le prédicateur avait revêtu des habits noirs. Les muezzins montèrent aussi sur des éléphants, et chantèrent devant lui : « Dieu est tout-puissant. » Les jurisconsultes et les juges de la ville étaient également à cheval, chacun d’eux portant avec soi une aumône, qu’il devait faire lors de la sortie vers l’oratoire. Sur ce dernier, on avait élevé une grande tente de coton, ornée de tapis. Le public accourut, louant le Dieu très haut ; le prédicateur pria avec la multitude, il prononça le prône, et puis les assistants retournèrent à leurs demeures. Nous nous rendîmes au palais du sultan, où l’on servit le repas, auquel furent présents les grands dignitaires, les commandants et les personnages illustres : ceux-ci sont (nous l’avons déjà dit) les étrangers. On mangea, et l’on se retira.
Le quatrième jour du mois de chawwâl, le sultan arriva au château de Tilbat, à sept milles de la capitale. Nous reçûmes du vizir l’ordre d’aller à sa rencontre, et nous partîmes. Chaque personne apportait avec elle son cadeau pour le souverain, soit en chevaux, soit en chameaux, ou en fruits du Khoraçan, en sabres égyptiens, en mamlouks et en brebis, tirées du pays des Turcs. Nous arrivâmes à la porte dudit château, où les visiteurs s’étaient tous rassemblés ; on les introduisait chez le monarque, suivant leur rang, et on leur donnait des robes d’honneur en lin, chamarrées d’or. Quand ce fut mon tour, j’entrai et vis le sultan assis sur un fauteuil ; je le pris pour un des chambellans, jusqu’à ce que j’aperçusse avec lui le roi des confidents intimes, Nasir eddîn alcâfy alharaouy, que j’avais connu au temps de l’absence du souverain. Le chambellan s’inclina, et je fis comme lui ; émir Hâdjib vint à ma rencontre, et c’est le fils de l’oncle du sultan, appelé Firouz ; je m’inclinai une seconde fois, à son exemple. Alors le roi des confidents intimes me dit : « Au nom de Dieu, notre maître Badr eddîn ! » On me nommait de la sorte dans l’Inde ; et quant aux mots « notre maître », c’est un titre que les Indiens donnent à tout individu lettré.
Je m’approchai du sultan, qui prit ma main, la serra, continua à la tenir, et me parla de la manière la plus affable. Il me dit en persan : « La bénédiction est descendue, ton arrivée est heureuse, sois tranquille ; je serai envers toi si miséricordieux, je te donnerai tant de richesses, que tes compatriotes le sauront et viendront te trouver. » Puis il me demanda de quel pays j’étais, et je répondis : « Du Maghreb. » Il reprit : « De la contrée d’Abdalmoûmin ? », et je répliquai affirmativement. Toutes les fois qu’il me disait une bonne parole, je lui baisais la main, ce que je fis jusqu’à sept fois. Il me revêtit d’un robe d’honneur, et je me retirai.
Toutes les personnes présentes se réunirent, et on leur servit un festin. A leur tête étaient : le grand kadi Sadr aldjihan Nasir eddîn alkhârezmy, un des plus grands jurisconsultes ; le grand kadi des mamlouks, Sadr aldjihân, Kamal eddîn alghaznéouy ; ’Imad almolc, aridh almamâlîc inspecteur des mamlouks ; le roi Djélal eddîn alkîdjy, ainsi qu’une troupe de chambellans et d’émirs. Il y avait aussi à ce repas Khodhâwend Zâdeh Ghiâth eddîn, fils de l’oncle paternel de Khodhâwend Zâdeh Kïouâm eddîn, juge à Termedh, qui était arrivé avec moi. Le sultan l’honorait beaucoup et l’appelait « mon frère » ; il était venu souvent de son pays (la Transoxiane), pour rendre visite au souverain de l’Inde. Les nouveaux arrivés qui reçurent des vêtements d’honneur dans cette circonstance sont :
Khodhâwend Zâdeh Kïwâm eddîn ;
Ses trois frères, Dhiyâ eddîn, ’Imad eddîn et Borhân eddîn ;
Le fils de sa sœur, émir bakht, fils du Sayyid Tadj eddîn, dont l’aïeul, Ouâdjih eddîn, était vizir du Khoraçan, et l’oncle maternel, ’Alâ eddîn, émir de l’Inde, et aussi vizir ;
L’émir Hibet Allah, fils d’Alfalaky attibrîzy, dont le père était substitut du vizir dans l’Irak, et celui-là même qui avait fondé à Tibrîz l’école appelée, de son nom, Alfalakiyyah ;
Le roi Kéraï, de la postérité de Behram Djoûr, compagnon de Chosroès : c’est un habitant de la montagne Badhakhchân, d’où l’on tire cette sorte de rubis nommé balakhch, ainsi que la pierre précieuse bleue appelée lapis-lazuli ;
L’émir Mobârec chah assamarkandy ;
Aroun Boghâ albokhâry ;
Mélik Zâdeh attirmidhy ;
Schihâb eddîn alcâzéroûny, le marchand qui avait apporté de Tibrîz des cadeaux pour le sultan, et qui fut pillé en route.
Le lendemain de notre sortie à la rencontre du sultan, chacun de nous reçut un cheval des écuries impériales, avec une selle et une bride, couvertes d’ornements. Le souverain monta à cheval pour faire son entrée dans sa capitale ; nous en fîmes autant, marchant dans son avant-garde avec Sadr aldjihân. On para les éléphants devant le monarque, on mit sur eux les étendards, ainsi que seize parasols, dont quelques-uns étaient chamarrés d’or, et d’autres embellis avec de l’or et des pierreries. Sur la tête du sultan, on éleva aussi un parasol de ce genre, et l’on porta devant le souverain la ghâchiyah, qui est une housse pour recouvrir la selle, incrustée d’or et de diamants. On plaça des petites balistes sur quelques éléphants, et quand le sultan fut arrivé près de la ville on lança, au moyen de ces machines, des pièces d’or et d’argent mêlées. Les gens à pied qui étaient devant le sultan, et d’autres personnes présentes dans la foule, ramassaient ces monnaies. Cela continua jusqu’à ce qu’on entrât dans le château ; des milliers d’individus marchaient à pied devant le souverain. On construisit des coupoles en bois, recouvertes d’étoffes de soie ; elles renfermaient les chanteuses, suivant ce que nous avons déjà raconté à ce sujet.
Le vendredi, deuxième jour après l’arrivée du souverain à Dihly, nous nous rendîmes à la porte de la grande salle d’audience, et nous assîmes sur les bancs de la troisième porte : l’ordre pour être introduits ne nous était pas encore parvenu. Le chambellan Chams eddîn alfoûchendjy sortit ; il dit aux secrétaires d’écrire nos noms, il leur permit de nous faire entrer, ainsi que quelques-uns de nos camarades, et fixa à huit le nombre de ceux qui devaient être introduits avec moi nous entrâmes donc, en compagnie de ces derniers. On apporta des sacs d’argent et le kabbân, c’est-à-dire « la balance » ; le grand juge et les secrétaires s’assirent ; ils appelèrent les hommes illustres, ou les étrangers, qui étaient à la sorte, et assignèrent à chacun d’eux sa part de ces bourses d’argent. Je touchai cinq mille dinars, et la somme totale était de cent mille dinars, que la mère du sultan distribuait en aumônes, à l’occasion du retour de son fils. Pour ce jour-là, nous nous retirâmes.
Plus tard, le souverain nous fit appeler pour nous faire manger en sa présence ; il nous demanda de nos nouvelles, et nous parla de la façon la plus affectueuse. Il nous dit une fois : « Vous nous avez honoré par votre visite dans ce pays, et nous ne saurions assez vous récompenser. Celui d’entre vous qui est vieux sera considéré comme mon père ; celui dont l’âge est mûr, comme mon frère ; et celui qui est jeune, je le regarderai comme mon fils. Il n’y a rien dans mon royaume de plus précieux que cette capitale, et je vous la donne. » Nous le remerciâmes et fîmes des vœux pour lui, Ensuite il nous accorda des pensions, et il m’assigna douze mille dinars par an ; il ajouta deux villages aux trois qu’il m’avait conférés auparavant : ce furent ceux nommés Djaouzah et Malicpoûr.
Un jour le sultan nous envoya Khodhâwend Zâdeh Ghiâth eddîn et Kothb almolc, gouverneur du Sind, qui nous parlèrent ainsi qu’il suit « Le Maître du monde vous fait dire ceci : « Celui parmi vous qui est en état de remplir les fonctions de vizir, de secrétaire, de commandant, de juge, de professeur ou de supérieur dans un ermitage, etc. (moi, le sultan), je les lui procurerai. » Tout le monde se tut, car ils voulaient tous acquérir des richesses et retourner ensuite dans leurs pays. L’émir bakht, fils du seigneur Tadj eddîn, dont nous avons déjà fait mention, prit la parole et dit : « Pour le vizirat, c’est précisément mon héritage ; et quant aux fonctions de secrétaire, c’est mon occupation : je ne connais pas autre chose. » Hibet Allah, fils d’Alfalaky, parla dans des termes analogues ; alors Khodhâwend Zâdeh s’adressa à moi, en langue arabe, et dit : « Quelle est ta réponse, à toi, ô mon sayyid ? », seigneur. Les gens de ce pays n’appellent jamais un Arabe que du nom de seigneur ; ainsi fait le sultan lui-même pour honorer la nation arabe. Je dis : « Les fonctions de ministre d’État ni celles de secrétaire, ne sont faites pour moi ; mais, quant à la dignité de juge et de cheikh ou supérieur, c’est là mon occupation et celle de mes ancêtres. Pour ce qui concerne la charge de commandant, vous savez bien que les barbares n’ont adopté l’islamisme que forcés par les sabres des Arabes. »
Lorsque le sultan connut mes paroles, il les approuva ; il se trouvait à ce moment-là dans la partie du château appelée Mille Colonnes, et il mangeait. Il nous envoya quérir, nous mangeâmes en sa présence et en sa compagnie ; puis nous nous retirâmes à l’extérieur de la grande salle d’audience des Mille Colonnes ; mes compagnons s’assirent, et je partis à cause d’un furoncle qui m’empêchait de m’asseoir. Le souverain nous demanda une seconde fois ; mes camarades entrèrent et ils m’excusèrent auprès de lui. Je revins après la prière de l’après-midi, et j’accomplis dans la salle d’audience les deux prières du coucher du soleil et de la nuit close.
Le chambellan sortit et nous appela ; Khodhâwend Zâdeh Dhiyâ eddîn entra, et c’était l’aîné des trois frères mentionnés plus haut. Le sultan le nomma émir dâd, « commandant de la justice », ce qui désigne un des principaux émirs. Il siégeait dans le tribunal du juge, et se faisait amener les personnes qui avaient quelque droit à faire valoir contre un commandant ou un grand. Le souverain fixa son traitement pour cet emploi à cinquante milles dinars par an ; il lui assigna des prairies du revenu de cette somme, et lui donna cinquante mille dinars comptant. Il le revêtit d’une robe d’honneur de soie chamarrée d’or et appelée la figure du chîr, ou du lion, car elle portait sur le devant, ainsi que dans le dos, la représentation d’un lion. On avait cousu dans l’intérieur du vêtement un billet qui faisait connaître la quantité de l’or employé pour ses broderies. Le sultan lui fit donner aussi un cheval de la première race ; or on connaît dans l’Inde quatre races de chevaux. Les selles, dans ce pays, sont semblables aux selles égyptiennes, et elles sont, en grande partie, recouvertes d’argent doré ou vermeil.
Le second qui entra ce fut l’émir bakht ; le sultan lui ordonna de s’asseoir avec le vizir sur le coussin de celui-ci, et d’examiner les comptes des bureaux. Il fixa ses honoraires à quarante mille dinars par années, lui assigna des prés jusqu’à concurrence de ce revenu, et lui donna en argent comptant quarante mille dinars. En outre, il lui fit donner un cheval sellé et bridé, une robe d’honneur pareille à celle qu’avait reçue Dhiyâ eddîn, et le surnomma Cheref almolc, « la gloire du royaume ». Hibet allah, fils d’Alfalaky, entra le troisième chez le sultan, qui le nomma raçoûl dâr, c’est-à-dire « le chambellan chargé des ambassades ou missions ». Son traitement fut fixé à vingt-quatre mille dinars par an, on lui assigna des prairies de ce revenu annuel, on lui donna en sus vingt-quatre mille dinars à toucher de la main à la main, un cheval sellé et bridé, ainsi qu’un vêtement d’honneur. Le souverain le surnomma béhâ almolc, « la splendeur du royaume ».
J’entrai à mon tour, et trouvai le sultan sur la terrasse du château, appuyé contre le trône ; le vizir Khodjah Djihan était devant lui, et le grand roi Kaboûlah était debout en présence du monarque. Quand j’eus salué celui-ci, Kaboûlah me dit : « Incline-toi et prête hommage, car le Maître du monde t’a nommé juge de la capitale du royaume, à Dihly. Il a fixé tes honoraires à douze mille dinars par année et t’a assigné des champs de ce rapport. Il a ordonné de te payer douze mille dinars en argent comptant, que tu pourras toucher demain au trésor, s’il plaît à Dieu. Il te donne un cheval avec sa selle et sa bride, ainsi qu’un vêtement de mahârîby. » On appelle de la sorte la robe qui porte sur le devant et au dos la figure d’un mihrâb (ou autel ; au pluriel mahârîb). Je m’inclinai profondément. Kaboûlah prit ma main et me conduisit vers le sultan, qui me dit : « Ne crois pas que la judicature à Dihly soit chose de peu d’importance ; c’est, au contraire, chez nous, l’emploi le plus considérable. » Pour moi, je comprenais fort bien son discours, mais je ne savais pas répondre convenablement dans la même langue. Le sultan, de son côté, comprenait l’arabe, mais il ne pouvait pas le parler couramment.
Je répondis au souverain : « Ô notre maître, moi je professe ou suis le rite de Malik, et les habitants de Dihly sont hanéfites ; de plus je ne sais pas leur langue. » il reprit : « J’ai déjà choisi pour tes substituts Béhâ eddîn almoltâny et Kamal eddîn albidjnaoury ; ils délibéreront avec toi, et tu légaliseras les actes ; tu tiendras près de moi la place d’un fils. » Je répliquai : « Ou bien plutôt celle de votre serviteur et de votre esclave. » Alors le sultan dit en arabe : « Au contraire, tu es notre seigneur et notre maître. » Cela fut un effet de son humilité, de sa bonté et de sa complaisance. Il dit ensuite à Cheref almolc émir bakht : « Dans le cas où ce que je lui ai assigné ne lui suffirait pas, car il est un homme de beaucoup de dépense, je lui donnerai en sus un ermitage, s’il peut prendre sur lui de veiller à ce qui concerne les fakirs. » Il ajouta : « Dis-lui cela en arabe. » Le sultan pensait que l’émir bakht parlait bien l’arabe, mais la chose n’était pas ainsi ; le souverain l’ayant compris, lui dit : Birew oué iecdjâ bikhouspî oué ân hicâïah ber oû bogouï oué tefhîm bocunî tâ ferdâ in châ allâh pîch men bïyâî oué djéouâbi oû bogouï. Voici le sens de ces paroles : « Partez pour ce soir et dormez dans un même endroit ; fais-lui comprendre (ô émir bakht) cette conversation ; demain, si Dieu le veut, tu te rendras chez moi et me feras connaître sa réponse. » Nous partîmes alors ; tout cela s’était passé dans le premier tiers de la nuit et l’on avait déjà sonné la retraite.
C’est l’usage, dans l’Inde, que personne ne sorte après qu’on a battu la retraite. Nous attendîmes donc la sortie du vizir pour cheminer en sa compagnie. Les portes de Dihly étaient fermées, et nous passâmes la nuit chez le sayyid Aboû’l Haçan al’ibâdy al’irâky, dans la rue nommée Sérâpoûrkhân. Ce cheikh faisait du commerce pour le compte du sultan ; il achetait pour lui des armes et des marchandises dans l’Irak et le Khoraçan. Le jour suivant, le souverain nous fit demander ; nous reçûmes l’argent, les chevaux, les robes d’honneur. Chacun de nous prit le sac des dinars, le mit sur son épaule, entra ainsi chez le sultan et s’inclina. On nous amena les chevaux, nous baisâmes leurs sabots, après qu’on les eut recouverts avec des morceaux d’étoffe, et conduisîmes nous-mêmes ces animaux à la porte du palais du sultan, où nous les montâmes. Toutes ces cérémonies sont des coutumes observées chez les indiens. Nous nous retirâmes : l’empereur fit donner à mes gens deux mille dinars et dix vêtements. Il ne donna rien aux compagnons des autres personnages ; mais les miens avaient une prestance et un extérieur qui plurent au sultan. Ils s’inclinèrent devant lui, et il les remercia.
Je me trouvais un jour dans la partie du château consacrée aux audiences, et c’était quelque temps après que j’eus été investi de la dignité de juge et que j’eus reçus les bienfaits du sultan. J’étais assis sous un arbre, et il y avait à mon côté notre maître Nasir eddîn attirmidhy, le savant prédicateur. Un chambellan sortit, appela notre maître Nasir eddîn, qui entra chez le souverain. Il en reçut un vêtement d’honneur et un Coran orné de pierres précieuses. Ensuite un chambellan vint à moi, et dit : « Donne-moi quelque chose, et je te procurerai un khatth khord de douze mille (dinars) que le maître du monde a ordonné de te payer. » Je ne le crus point et pensai qu’il voulait me tromper ; mais il insista sur son propos, et l’un de mes compagnons dit : « Moi, je lui donnerai. » Il lui donna deux ou trois dinars, et le chambellan apporta un khatth khord, ce qui veut dire « le petit écrit », du contenu qu’il avait dit, et avec son visa. Il portait ceci : « Le Maître du monde ordonne qu’on paye sur le trésor très copieux à un tel telle somme, par les soins d’un tel, c’est-à-dire par suite de sa notification ou de son visa. »
Celui qui transmet l’ordre écrit son nom ; trois émirs y mettent leurs signatures, et ce sont : le grand khân Kothloû khân, précepteur du souverain ; le kharîthehdâr qui a en dépôt les rames de papier et les roseaux pour écrire ; l’émir Nocbïah addéouâdâr, « le porte-encrier » ; c’est celui qui a la garde des encriers. Quand tous ceux-ci ont mis leur griffe sur le brevet, on l’envoie aux bureaux du vizirat, où les secrétaires en prennent copie ; puis on l’enregistre dans les bureaux du contrôle ou des visas, et dans ceux de l’inspection. On expédie le perouâneh, « la patente, le diplôme », qui est l’ordre du vizir au trésorier de débourser la somme. Celui-ci en prend note dans ses bureaux ; tous les jours il écrit un résumé, ou rapport succinct, des sommes que le sultan a commandé de payer ce jour-là, et il le lui présente. Lorsque le prince veut que son don soit acquitté immédiatement, il donne ses ordres en conséquence, et quand il désire qu’on attende il fait suspendre. Toutefois, le paiement se fait toujours, quand bien même ce serait longtemps après que le bienfait a été promis. Je n’ai touché ces douze mille (dinars) que six mois plus tard, et avec d’autres fonds, ainsi que je le dirai ci-dessous.
Il est d’usage, chez les Indiens, de défalquer constamment un dixième des sommes dont le sultan gratifie quelqu’un. Celui à qui le souverain a promis, par exemple, cent mille dinars, n’en reçoit que quatre-vingt-dix mille ; celui en faveur duquel il a ordonné de payer dix mille dinars n’en touche que neuf mille.
J’ai raconté que je m’étais endetté envers des marchands d’une somme que j’avais dépensée pendant mon voyage, ou qui m’avait servi à acheter le cadeau pour le sultan de l’Inde, et aussi à payer les frais de mon séjour à Dihly. Quand ces marchands voulurent retourner dans leur pays, ils insistèrent près de moi pour rentrer dans leurs créances. Alors je fis l’éloge du souverain dans une longue pièce de vers, dont le commencement est ainsi qu’il suit :
Nous sommes venus vers toi, ô prince des croyants vénéré ; et pour cela nous avons traversé avec célérité plus d’un désert.
Je suis arrivé comme un pèlerin dans le lieu de ton illustration ; ta demeure est un asile bien digne d’être visité.
S’il y avait au-dessus du soleil une place pour la gloire, son élévation mériterait que tu en fusses l’imam ;
Car tu es le chef illustre, l’unique, dont le naturel est d’être pur et sincère, soit qu’il parle, soit qu’il agisse.
Or j’ai un besoin dont j’espère la satisfaction de ta grande libéralité, et mon but est une chose facile auprès de ta noblesse.
Dois-je le mentionner, ou bien la crainte de Votre Majesté doit-elle me le défendre ?
Cependant (que Dieu fasse vivre le souverain !), il vaudra mieux que je le fasse connaître.
Hâte-toi de payer les dettes de celui qui est venu dans ton pays pour te rendre visite ; certes les créanciers pressent.
Je présentai mon poème au sultan, qui était assis sur un fauteuil ; il mit le papier sur son genou, et en prit une des extrémités avec sa main, pendant que je tenais l’autre bout. Je lisais, et à mesure que je finissais un distique, je disais au juge des juges, Kamal eddîn alghaznéouy : « Expliquez-en le sens au Maître du monde. » Il le faisait, et cela plaisait au sultan, car les Indiens aiment la poésie arabe. Lorsque je fus arrivé au passage : « Hâte-toi de payer les dettes de celui qui est venu, etc. », le souverain dit : Marhamah, « miséricorde », ou, en d’autre terme : « J’ai compassion de toi. » Alors les chambellans me prirent par la main, ils voulaient me conduire à leur place pour que je saluasse selon l’usage ; mais le sultan reprit : « Laissez-le jusqu’à ce qu’il ait fini sa lecture. » Je la terminai, et saluai profondément ; les assistants me congratulèrent à cette occasion. Quelque temps après, j’écrivis une supplique, qu’on appelle dans l’Inde ’ardh dâcht « pétition écrite » ; je la passai à Kothb almolc, gouverneur du Sind, qui la remit au sultan, lequel lui dit : « Va chez Khodjah Djihan, et dis-lui de ma part de payer ses dettes » (celles de notre voyageur). Il y alla, l’informa de la volonté du sultan, et le vizir répondit : « Oui, c’est bien. » Quelques jours se passèrent, et sur ces entrefaites le souverain dit au vizir de se rendre à Daoulet Abad. Dans cet intervalle de temps, le monarque lui-même partit pour la chasse, comme le vizir pour son voyage, et je ne pus toucher la moindre somme, si ce n’est plus tard. Or je vais mentionner avec détail la cause du retard survenu dans le paiement de cet argent.
Lorsque mes créanciers voulurent partir de Dihly, je leur dis : « Au moment où je me rendrai au palais du sultan, attaquez-moi, suivant l’usage de ce pays. » En effet, je savais que dès l’instant où le souverain apprendrait cela il les paierait. C’est une habitude, dans l’Inde, que le créancier d’un personnage protégé par le sultan, lorsqu’il veut être payé, attende son débiteur à la porte du palais du monarque, et qu’il lui dise, quand il veut entrer, ce qui suit : « Deroûhaï assolthân, ô ennemi de l’empereur, je jure par la tête du sultan que tu n’entreras point, jusqu’à ce que tu m’aies payé. » Il ne peut pas quitter sa place qu’il n’ait satisfait son créancier, ou qu’il n’ait obtenu de lui un délai. Un jour, il arriva que le souverain sortit pour visiter le tombeau de son père, et qu’il descendit là dans un château. Je dis à mes marchands : « Voici le moment favorable. » Lorsque je voulus entrer, il étaient à la porte du château et me dirent : « Deroûhaï assolthân, tu n’entreras pas que tu n’aies payé ce que tu nous dois. » Les secrétaires placés à la porte écrivirent cela au souverain. Là-dessus sortit du palais hâdjib kissah, « le chambellan des requêtes », Chams eddîn, un des plus grands jurisconsultes, qui demanda aux marchands pour quels motifs ils m’avaient attaqué ; ils répondirent qu’ils étaient mes créanciers. Chams eddîn retourna chez le monarque, il l’informa de cette circonstance, et celui-ci ordonna d’interroger les marchands sur le montant de la dette ; ils lui dirent que c’était cinquante-cinq mille dinars. Le chambellan le dit au souverain, qui lui commanda de se rendre près des créanciers, et de leur parler en ces termes : « Le Maître du monde vous fait dire ceci : “La somme est chez moi, je vous ferai rendre justice, et n’exigez plus rien maintenant de votre débiteur.” »
Le sultan chargea ’Imad eddîn assimnâny et Khodhâwend Zâdeh Ghiâth eddîn de siéger dans la salle des Mille Colonnes pour examiner et vérifier les obligations ou les reçus que lesdits créanciers leur apporteraient. Cela fait, l’un et l’autre rendirent compte au souverain que les pièces étaient en règle ; ce dernier sourit, et dit en plaisantant : « Je sais que le débiteur est un juge ; il aura bien arrangé son affaire. » Il dit ensuite à Khodhâwend Zâdeh de me payer cette somme avec l’argent du Trésor ; mais ce fonctionnaire exigea de moi un don d’avance, et refusa d’écrire le khatth khord, ou mandat. Je lui envoyai deux cents tengahs ; il ne fut pas satisfait et les renvoya ; un de ses serviteurs me dit de sa part qu’il en voulait cinq cents ; mais je refusai. Je racontai ces choses à ’Amid almolc, fils d’Imad eddîn assimnâny, qui en informa son père ; cela vint aussi à la connaissance du vizir, qui était un ennemi personnel de Khodhâwend Zâdeh. Or il en parla au sultan, et il lui fit connaître beaucoup d’actes répréhensibles de Khodhâwend Zâdeh ; de sorte que le souverain changea de sentiments à l’égard de ce dernier, et ordonna de le mettre aux arrêts dans la ville. Il ajouta : « Pour quelle raison un tel lui a-t-il versé cette somme ? Ainsi, qu’on suspende tout paiement jusqu’à ce que l’on sache si Khodhâwend Zâdeh donne quelque chose lorsque j’ai défendu de le faire, ou refuse de payer ce que j’ai donné. » Tel fut le motif du retard que subit l’acquittement de ma dette.
Lorsque l’empereur se rendit à la chasse, je partis avec lui sans aucun délai. J’avais déjà préparé tout ce qui était nécessaire, me conformant aux habitudes du peuple de l’Inde. J’avais acheté une sérâtcheh, petit palais, tentes, appelée aussi afrâdj, et qu’on peut librement dresser dans ce pays-là. Tout grand personnage doit en être pourvu ; celle du sultan se distingue des autres, car elle est rouge, tandis que les sérâtchehs des sujets sont blanches, et brodées de bleu. Je fis emplette du saïouân, toile, tente, duquel on se sert pour ombrager l’intérieur de la sérâtcheh, et qu’on élève sur deux grands piliers. Le tout est porté sur les épaules par des hommes qui sont nommés alcaïouâniyahs. C’est l’usage, dans l’Inde, que chaque voyageur loue de ces caïouâniyahs dont nous venons de parler. Il doit louer aussi des gens qui fournissent l’herbe pour la pâture des bêtes de somme, car les Indiens ne leur donnent point à manger de la paille. Il doit louer encore des cohâroûn (gahârs?), qui portent les ustensiles de cuisine ; des individus pour le porter lui-même dans le palanquin, duquel nous avons parlé précédemment, et pour transporter celui-ci quand il est vide ; des farrâchs, « valets », qui dressent les tentes, y étendent des tapis, et chargent les fardeaux sur les chameaux ; enfin, des déouâdaouiyahs, ou coureurs, dont l’office est de marcher devant le voyageur, et de tenir à la main les flambeaux dans la nuit. Je me procurai, pour ma part, tout ce qu’il me fallait de gens, et fis parade de vigueur et de décision ; je sortis le jour même du départ du souverain, tandis que les autres personnes de sa suite restèrent encore à Dihly deux ou trois jours après qu’il fut parti.
Le jour de sa sortie, le sultan monta sur un éléphant, lorsque la prière de l’après-midi fut accomplie. Il fit cela dans le but d’examiner où en étaient les gens [de la cour], et de connaître ceux qui s’étaient hâtés de sortir et ceux qui avaient tardé. Il s’assit d’abord à l’extérieur des tentes, sur un fauteuil ; j’arrivai, je saluai, et me tins debout à ma place, sur la droite. Le souverain m’envoya le grand roi Kaboûlah serdjâmadâr, « gardien en chef de la garde-robe », ou celui qui est occupé à écarter de lui les mouches, et m’ordonna de m’asseoir, par une faveur particulière. Personne, excepté moi, ne s’assit à cette occasion. On amena l’éléphant, contre lequel on appuya une échelle, et le sultan le monta. On mit le parasol sur la tête du monarque, qui partit en compagnie de ses intimes ; il circula une heure, puis il revint aux tentes.
Il est d’usage, quand le sultan monte à cheval, que les commandants en fassent tous autant, en foule, chacun d’eux à la tête de ses troupes, avec ses drapeaux, ses tambours, ses trompettes et ses hautbois. Tout cela est nommé dans l’Inde almérâtib, « degrés, dignités, insignes ». Devant le sultan ne marchent à cheval que les chambellans, les musiciens, les timbaliers qui portent au cou de petites timbales, et les joueurs de hautbois. Il y a à la droite du souverain environ quinze hommes, et à sa gauche un pareil nombre. Ce sont les grands juges, le vizir, quelques commandants principaux, et quelques-uns des personnages illustres, ou étrangers ; je me trouvais, moi, parmi ceux qui étaient à droite. En avant du sultan sont ceux qui vont à pied, et les guides ; derrière lui, ses drapeaux, qui sont en soie chamarrée d’or, les tambours portés par des chameaux ; puis viennent ses mamlouks, les personnes de son intimité, enfin les commandants et la multitude.
Personne ne sait où l’on fera halte. Quand le sultan passe dans un lieu où il lui plaît de camper, il ordonne qu’on s’arrête, et nul ne dresse sa tente avant celle du souverain. Alors les individus chargés du campement font descendre chacun à sa place convenable. Sur ces entrefaites, le monarque s’établit près d’une rivière ou entre des arbres, où on lui apporte de la viande de brebis, des poulets gras, des grues et autre gibier. Les fils des grands dignitaires arrivent, tenant tous à la main une broche ; ils allument le feu et font rôtir ces viandes. On prépare pour le monarque une petite tente, et les favoris qui sont avec lui s’asseyent à l’extérieur ; on apporte les mets, et le sultan fait venir qui lui convient pour manger avec lui.
Un jour que l’empereur était dans sa petite tente, il demanda qui se trouvait au-dehors. Le seigneur Nasir eddîn Mothahher alaouhéry, un de ses commensaux, lui dit : « Il y a là un tel, le Barbaresque, qui n’est pas content. — Pourquoi cela ? » demanda le sultan. Mothahher répondit : « A cause de la dette qu’il a, et parce que ses créanciers insistent pour être payés. Le Maître du monde avait ordonné au vizir de lui payer cette somme, mais il partit sans le faire. S’il plaisait à notre maître de prescrire aux créanciers d’attendre l’arrivée du vizir, ou bien de donner l’ordre pour qu’ils fussent satisfaits ? » Le roi Daoulet chah était présent, et le sultan l’appelait « mon oncle ». Il dit : « Ô Maître du monde ! toute la journée ce Barbaresque nous parle en arabe, et je ne sais pas ce que cela signifie. O toi, mon maître, Nasir eddîn, sais-tu ce qu’il dit ? » Son but était de lui faire répéter ces choses. Il répondit : « Il parle au sujet des dettes qu’il a contractées. » Le sultan reprit : « Lorsque nous serons rentrés à Dihly, va toi-même, ô oûmâr, au Trésor, et donne cette somme à l’Arabe. » Le mot oûmâr signifie « oncle paternel ». Khodhâwend Zâdeh était aussi présent, et il dit : « O Maître du monde, ce voyageur dépense considérablement, et je l’ai vu dans notre pays, chez le sultan Thermachîrîn. » Après cette conversation, le souverain me fit venir pour manger avec lui, et je ne savais rien de ce qui s’était passé. Quand je sortis, le seigneur Nasir eddîn me dit : « Remercie le roi Daoulet chah. » Celui-ci me dit de son côté : « Remercie Khodhâwend Zâdeh. »
Un de ces jours pendant lesquels nous étions à la chasse avec le sultan, celui-ci monta à cheval dans le campement ; son chemin était de passer par l’endroit où j’étais logé. Je me trouvais avec lui à l’aile droite, mes camarades faisaient partie de l’arrière-garde ou escorte. Près de ma sérâtcheh, j’avais de petites tentes, à côté desquelles mes compagnons s’arrêtèrent et saluèrent le monarque. Il envoya ’Imad almolc et le roi Daoulet chah pour savoir à qui appartenaient les tentes et la sérâtcheh. On leur dit : « A un tel », et ils rapportèrent ce détail au sultan, qui sourit. Le jour d’après, l’ordre me fut signifié de retourner dans la capitale, de même que Nasir eddîn Mothahher alaouhéry, le fils du juge du Caire, et le roi Sabîh. On nous donna à tous des robes d’honneur, et nous retournâmes à Dihly.
Pendant la chasse, le sultan me demanda un jour si le roi Nasir montait sur des chameaux. Je répondis : « Oui, il monte les mahârys au temps du pèlerinage, et il va en dix jours du Caire à La Mecque. Mais ces chameaux ne sont pas de la même espèce que ceux qu’on trouve dans ce pays-ci. » J’ajoutai que j’avais avec moi un de ces chameaux mahârys. Lorsque je fus retourné à Dihly, j’envoyai chercher un Arabe du Caire, lequel me fit avec de la poix le modèle de la selle qui sert pour les mahârys. Je montrai cela à un menuisier, et il fabriqua la selle fort bien ; je la recouvris avec du drap, j’y adaptai des étriers, je mis sur le chameau une belle couverture, et lui fis une bride de soie. Parmi mes gens, il y avait un individu du Yémen qui excellait à faire les pâtisseries ; il en fabriqua qui ressemblaient aux dattes, etc.
J’envoyai le chameau, ainsi que les pâtes douces, au souverain, et dis à celui qui les emmenait de livrer le tout aux mains du roi Daoulet chah, pour lequel j’expédiai aussi un cheval et deux chameaux. Quand il reçut ces présents, il entra chez le sultan, et lui dit : « O Maître du monde, j’ai vu une merveille. — Qu’est-ce ? », demanda le souverain. L’autre répondit : « Un tel a envoyé un chameau qui porte une selle. » Le sultan donna ordre de le faire avancer, et l’on fit entrer le chameau dans l’intérieur de la sérâtcheh. Le souverain en fut charmé, et il dit à mon messager de le monter, ce qu’il accomplit, en le faisant marcher devant le sultan. Celui-ci fit donner deux cents dinars en argent et un vêtement. Cet homme revint chez moi, il m’informa de tout, et cela me réjouit beaucoup. Après le retour du sultan dans sa capitale, je lui donnai deux autres chameaux.
Dès que le piéton qui avait conduit le chameau fut de retour près de moi, et qu’il m’eut informé de ce qui lui était arrivé, je fabriquai deux selles, que je recouvris de lames d’argent dorées, sur le devant ainsi qu’à leur partie de derrière, et je plaçai par-dessus une étoffe de drap. Je fis un licou orné de plaques d’argent, et préparai pour les deux quadrupèdes deux housses en étoffe de soie fine, doublées en damas ; enfin, je leur adaptai aux jambes des anneaux d’argent. Je pris, en outre, onze plats profonds, que je remplis de sucreries ; chacun de ces plats fut recouvert d’une serviette de soie.
Quand le souverain fut revenu de la chasse, et qu’il siégea, le lendemain de son arrivée, dans le lieu de ses audiences publiques, j’allai le trouver de bonne heure avec les chameaux (et les plats de sucreries). Il ordonna de faire entrer ces quadrupèdes, qui marchèrent et coururent devant lui ; alors l’ornement de la jambe d’un de ces animaux s’envola, et le sultan dit à Béhâ eddîn, fils d’Alfalaky : Pâïel ouardâry, ce qui signifie : « Ramasse l’anneau de la jambe » ; il obéit immédiatement. Ensuite, le sultan jeta les yeux sur les plats mentionnés ci-dessus, et demanda : Tchih dâri der ân thabaqha halouâ est ? Cela veut dire : « Qu’as-tu dans ces plats ? Est-ce de la pâte douce ? » Je répondis par l’affirmative, et il dit au jurisconsulte et prédicateur Nasir eddîn attirmidhy : « Je n’ai jamais mangé, ni même jamais vu de pâtisserie pareille à celle qu’il nous a envoyée pendant que nous étions au camp. » Il ordonna ensuite d’emporter ces sucreries dans le lieu de ses séances privées, ce qui fut exécuté. Puis il s’y rendit en personne, et m’y invita ; il fit apporter des aliments, et je mangeai (avec les autres assistants).
Le souverain m’interrogea au sujet d’une espèce de ces pâtisseries que je lui avais expédiées la première fois. Je lui répondis : « O Maître du monde, ces pâtes douces sont de plusieurs sortes, et je ne sais pas de quelle variété Votre Majesté recherche le nom. » Il dit : « Apportez ces athbâks (pluriel de thabak)», plats, assiettes, c’est le nom qu’on donne dans ce pays-là à ce que nous appelons, nous, thaïfoûrs (pluriel thaïâfîr), assiette creuse, plat, gamelle. On les mit devant lui, et on les découvrit ; le sultan dit : « Je te demandais le nom de ceci », et il prit dans la main le plat qui contenait cette pâtisserie. Je lui répondis : « On l’appelle la pâtisserie ronde ou orbiculaire. » Il en saisit une autre sorte, et dit : « Quel est le nom de celle-ci ? » Je repris : « On la nomme les petites bouchées du juge. » Il y avait en présence du souverain un négociant qui est un des cheikhs de Bagdad, connu sous le nom d’Assâmarry, et soi-disant de la postérité d’Abbâs, dont le Dieu très haut soit satisfait ; il est très riche, et le sultan l’appelle « mon père ». Cet homme éprouva un sentiment d’envie à mon égard, il voulut me faire honte, et dit : « Ces pâtisseries ne sont point les petites bouchées du juge, mais les voici. » Il saisit un morceau de celles nommées pénis du cheval. Il y avait, vis-à-vis de ce cheikh, le roi des favoris, Nasir eddîn alcâfy alharaouy, qui le plaisantait souvent devant le souverain, et qui s’écria : « Ô khodjah, « négociant, etc. » tu mens, et le juge dit vrai. » Le sultan dit : « Comment cela ? » L’autre reprit : « O Maître du monde, celui-ci est le juge, et ces pâtisseries sont ses petites bouchées, car c’est lui qui les a apportées. » Le monarque sourit, et répliqua : « Tu as raison. »
Après le repas, nous mangeâmes les pâtes douces, puis nous bûmes la bière, prîmes le bétel, et nous retirâmes. Peu d’instants se passèrent, et je vis arriver vers moi le trésorier, qui me dit : « Envoie tes compagnons pour toucher l’argent. » Je les envoyai, puis je retournai chez moi après le coucher du soleil, et trouvai la somme à la maison. C’étaient trois sacs, contenant ensemble six mille deux cent trente-trois tengahs, c’est-à-dire le change des cinquante-cinq mille dinars (d’argent) dont j’étais endetté, et des douze mille que le sultan avait ordonné de me payer précédemment, déduction faite toutefois du dixième, suivant l’usage de l’Inde. La valeur de la pièce appelée tengah est de deux dinars et demi, en or du Maghreb.
Le neuvième jour de djoumada premier, le sultan partit de Dihly pour se rendre dans la contrée de Ma’bar, et pour combattre le rebelle de ce côté. Je m’étais déjà acquitté envers mes créanciers, je m’étais préparé pour le voyage, et avais déjà payé le salaire pour neuf mois aux porteurs des ustensiles de cuisine, aux valets, aux porteurs des tentes et à ceux qui tiennent les flambeaux. Nous avons parlé précédemment de tous ces individus. Mais l’ordre me fut signifié de rester dans la capitale, ainsi que plusieurs autres personnages ; le chambellan prit de nous un engagement écrit à ce sujet, pour s’en servir comme de preuve. Tel est l’usage dans l’Inde, par crainte que l’individu averti ne nie avoir reçu l’ordre. Le sultan me fit donner six mille dinars en drachmes, et au fils du juge du Caire, dix mille. Il en fut de même pour tous les personnages illustres (les étrangers), qui durent rester à Dihly ; quant aux nationaux, ils ne touchèrent rien. Le souverain m’ordonna d’être toujours l’inspecteur de la tombe du sultan Kothb eddîn, dont nous avons déjà parlé. Il vénérait ce sépulcre d’une manière inouïe, car il avait été serviteur de Kothb eddîn. Je l’ai vu, dans ses visites à ce tombeau, prendre les babouches du mort, les baiser et les mettre sur sa tête. C’est une habitude, parmi les Indiens, de placer les pantoufles du défunt sur un coussin près de la sépulture. Toutes les fois que le sultan venait à ce tombeau, il s’inclinait et rendait hommage, comme il faisait à Kothb eddîn lorsqu’il vivait. Il respectait beaucoup aussi la femme de ce dernier, et l’appelait « ma sœur » ; il la mit en compagnie de ses femmes, et la maria plus tard au fils du juge du Caire, qu’il favorisa à cause d’elle ; il allait rendre visite à cette dame tous les vendredis.
Quand l’empereur fut sorti, il nous envoya chercher pour nous faire ses adieux. Le fils du juge du Caire se leva, et dit : « Je ne dirai pas adieu au Maître du monde, ni ne me séparerai de lui. » Cela lui porta bonheur plus tard. Or, le sultan répondit : « Va, et prépare-toi pour le voyage. » Je m’avançai après lui, pour les salutations du départ ; j’aimais rester, mais les suites ne furent pas heureuses pour moi. Le souverain me dit : « Quels sont tes besoins ? » Je tirai de la poche une note, où étaient consignées six demandes ; le sultan m’ordonna de parler en arabe, et je dis : « Le Maître du monde m’a donné la charge de juge, et je n’ai pas encore siégé comme tel ; je ne veux pas conserver le titre sans les fonctions. » Il me commanda de les exercer, aidé par les deux substituts. Puis il me dit : « Voyons, et après ? » Je repris : « Que ferai-je avec la chapelle sépulcrale du sultan Kothb eddîn ? J’y ai donné des appointements à quatre cent soixante personnes, tandis que le revenu des biens légués en sa faveur ne suffit pas pour couvrir ces dépenses, ni pour payer la nourriture de ces gens. » Il dit au vizir : Pendjâh hazâr, ce qui signifie « cinquante mille » ; et il ajouta : « Il te faut absolument la récolte par anticipation. » Cela voulait dire : « Donne-lui cent mille mann ou mesures des fruits de la terre, savoir : de blé et de riz, afin qu’il les dépense cette année-ci, en attendant les productions du sol affecté au sépulcre. » Le mann équivaut à vingt livres de Barbarie.
Le souverain me dit : « Quoi encore ? » Je répondis : « Mes compagnons ont été emprisonnés à cause des villages que Votre Majesté m’a donnés, et que j’ai échangés contre autre chose. Or les employés du Conseil, ou du Trésor, ont exigé soit le prix que j’en ai reçu, soit la présentation d’un ordre du Maître du monde qui me dispense de ce paiement. » Le sultan demanda : « Quelle somme as-tu touchée ? » Je répondis : « Cinq mille dinars. » Il répliqua : « Je t’en fais cadeau. » Ensuite je dis : « La maison que Votre Majesté a daigné consacrer à mon usage a besoin d’être réparée. » Il dit au vizir : ’Imâret cunîd, ou, en d’autres termes : « Réparez-la. » Il reprit : Dîguer némand ? dont le sens est : « Te reste-t-il encore quelque chose à dire ? » Je répondis négativement. (On voit que le voyageur ne fait que quatre demandes sur les six qu’il annonce. N’y aurait-il pas une lacune dans le récit ?) Le souverain me dit : Ouassïyet dîguer hest, « Il est une autre recommandation » ; et c’était ce qui suit : « Je te recommande de ne pas contracter de dettes, afin que tu ne sois point poursuivi : tu ne trouverais pas toujours quelqu’un pour faire parvenir ton affaire à mon oreille. Règle tes dépenses sur ce que je t’ai alloué ; car le Dieu très haut a dit : « N’attache pas ta main à ton cou, mais ne l’ouvre pas non plus de toute sa largeur. (Coran, xvii, 31) Mangez et buvez, mais ne soyez pas trop prodigues. Et ceux qui, dans leurs dépenses, ne sont ni prodigues ni avares (ce sont les vrais serviteurs du Miséricordieux) : en effet, il existe un juste milieu entre ces deux excès. (Coran, xxv, 67) » Quand j’eus entendu ces paroles, je voulus baiser les pieds du monarque, qui s’y opposa ; il toucha ma tête avec sa main, j’embrassai celle-ci, et me retirai.
Je retournai à la capitale et m’occupai à faire réparer ma maison ; je dépensai quatre mille dinars, dont six cents me furent payés par le conseil d’État, et je déboursai le reste ; je fis bâtir une mosquée vis-à-vis de ma maison. Je m’occupai aussi des arrangements pour le tombeau du sultan Kothb eddîn. Le souverain avait ordonné de bâtir sur ce sépulcre une coupole s’élevant dans l’air à la hauteur de cent coudées, et, par conséquent, plus haute de vingt coudées que celle qui se trouve sur la tombe de Kazan, roi de l’Irak. Le sultan avait encore donné l’ordre d’acheter trente villages pour les constituer en legs pieux en faveur de cette sépulture. Il les mit entre mes mains, à la condition que je percevrais pour moi le dixième de leur revenu, suivant l’usage.
Les peuples de l’Inde suivent des coutumes, au sujet de leurs morts, analogues à celles que ceux-ci observaient de leur vivant. On amène des éléphants et des chevaux qu’on attache à la porte de la chapelle sépulcrale, qui est parée. J’agis d’après cela dans les mesures que j’adoptai concernant le tombeau qui m’était confié. J’y établis cent cinquante lecteurs du Coran, qui sont appelés par les Indiens alkhatmiyoûn, « ceux qui lisent le Coran d’un bout à l’autre » ; quatre-vingts étudiants et huit répétiteurs ces derniers sont nommés dans l’Inde almocarriroûn ; un professeur, quatre-vingts soufis ou moines, un imâm, des muezzins, des lecteurs aux belles voix, des panégyristes, des écrivains qui prennent note de ceux qui s’absentent, et des introducteurs ou chambellans. Tous les personnages que nous venons de citer sont connus dans ce pays sous le nom d’alarbâb, « les seigneurs ».
Je pris des arrangements avec une autre classe de gens qui sont appelés alhâchiyah, « les domestiques ». Ce sont les valets, les cuisiniers, les coureurs, les porteurs d’eau, ceux qui versent le sorbet, ceux qui présentent le bétel, les porte-épées, ou écuyers, les porte-javelots, ceux qui portent les parasols, ceux qui versent l’eau pour laver les mains, les huissiers et les nakîbs, ou officiers. La totalité de ces individus, à qui je donnais des appointements, était de quatre cent soixante personnes. Le sultan avait commandé qu’on employât chaque jour en nourriture, dans ce monument funéraire, douze mesures de farine et une égale quantité en poids de viande. Je jugeai que cela était trop peu, et que, d’un autre côté, les grains que le souverain m’avait alloués étaient considérables. J’employai donc chaque jour trente-cinq mesures de farine, et un poids pareil de viande, ainsi que des quantités proportionnées de sucre, sucre candi, beurre et bétel. De cette manière je nourrissais non seulement les gens employés, mais aussi les allants et venants. La disette était alors très grande et la population était soulagée par ces distributions d’aliments, dont la nouvelle se répandit au loin.
Le roi Sabîh alla trouver le sultan à Daoulet Abad, et, le souverain lui ayant demandé des nouvelles de la capitale, il lui répondit : « S’il y avait à Dihly seulement deux individus dans le genre d’un tel (notre voyageur), on ne serait pas affligé par la famine. » Le sultan fut charmé d’entendre un tel propos, et m’envoya un vêtement d’honneur de sa propre garde-robe. Dans les grandes solennités, je consommais cent mesures de farine et une quantité analogue de viande. Je donnais à manger aux fakirs et aux pauvres ; quant aux gens soldés ou pensionnaires, on plaçait devant chacun d’eux sa portion. Nous allons bientôt raconter l’usage des Indiens à ce sujet. Les solennités auxquelles nous venons de faire allusion sont les deux fêtes, le jour de la noble naissance (celle de Mahomet), le jour d’Achoûrâ (le dixième du mois de moharram), la nuit du milieu du mois de chaban et le jour de la mort du sultan Kothb eddîn.
C’est l’usage dans l’Inde, de même que dans le pays de Sera, de placer un buffet, une fois que le repas prié est fini, devant chaque noble, jurisconsulte, cheikh ou juge. Ce buffet ressemble à un berceau d’enfant ; il est pourvu de quatre pieds, et sa partie supérieure est nattée avec des feuilles sèches de palmier, de coco et autres analogues. On met sur ce meuble des gâteaux, un mouton rôti, quatre pains ronds pétris avec du beurre, remplis de la pâtisserie nommée sâboûniyah (littéralement, « savonneuse » ; elle est faite avec de l’huile de sésame, de l’amidon, des amandes et du miel) et recouverts avec quatre morceaux de la pâte douce qui a la forme d’une brique. On place aussi, sur ledit buffet, un petit disque en cuir contenant des sucreries et du hachis, et l’on recouvre le meuble avec une étoffe de coton toute neuve. Les personnes qui sont d’un rang un peu inférieur à celles que nous venons de nommer ne reçoivent devant elles qu’un demi-mouton, qu’on appelle zallah (c’est-à-dire « vivres qu’on emporte »), ainsi que la moitié des autres provisions. Les gens dont la condition est encore au-dessous des derniers individus cités n’ont que le quart de ce qu’obtiennent ceux nommés en premier lieu. Les domestiques de chacun de ces personnages enlèvent ce qu’on a mis devant lui.
La première fois que je vis mettre en pratique cette habitude, ce fut dans la ville de Sera, capitale du sultan Ouzbek. Je défendis à mes gens de prendre ce qu’on avait déposé devant moi, car je n’étais pas accoutumé à une pareille chose. On envoie aussi, de cette façon, des mets du festin dans les maisons des grands personnages.
Le vizir m’avait déjà livré dix mille mesures de céréales sur les grains que le sultan lui avait commandé de me fournir pour l’ermitage, et il m’avait donné une assignation pour recevoir le restant à Hazâr Amroûhâ. Cette localité avait pour gouverneur, chargé de la perception des impôts, ’Aziz alkhammâr (négociant en vins), et pour commandant Chams eddîn albadhakhchâny. J’envoyai mes employés, qui prirent une partie des grains, et qui se plaignirent des extorsions d’Aziz alkhammâr. Alors je sortis moi-même pour exiger tout ce qui me revenait ; entre Dihly et ledit district, il y a trois jours de marche, et l’on était au moment des grandes pluies, Je pris avec moi environ trente de mes compagnons, ainsi que deux frères, excellents chanteurs, qui étaient chargés de me divertir par leurs mélodies durant le voyage.
Nous arrivâmes à la ville de Bidjnaour, où je trouvai trois autres frères, également chanteurs ; je les pris aussi avec moi. Tantôt c’étaient eux qui chantaient et tantôt c’étaient les deux premiers. Puis nous arrivâmes à Amroûhâ, qui est une jolie petite ville. Les employés du fisc vinrent à ma rencontre, ainsi que le juge, le chérif émir ’Aly, et le cheikh de l’ermitage ; les deux derniers me servirent ensemble un magnifique repas d’hospitalité. ’Aziz alkhammâr se trouvait dans un lieu nommé Afghânpoûr, près du fleuve Serou (?), qui nous séparait. Il n’y a point de bac, et nous en fîmes un avec des planches et des débris de plantes ; nous y plaçâmes nos bagages et passâmes la rivière le lendemain. Nadjîb, frère d’Aziz, arriva avec plusieurs compagnons et dressa pour nous une sérâtcheh (des tentes). Son frère, le gouverneur, vint ensuite me trouver ; il était fameux pour sa tyrannie. Il avait dans son district mille cinq cents villages, qui rapportaient par année soixante fois cent mille dinars d’argent ; un vingtième de cette somme était pour lui.
Une des merveilles du fleuve près duquel nous descendîmes, c’est que personne ne boit de son eau ni n’en abreuve les bêtes de somme pendant toute la saison des pluies. Nous restâmes trois jours dans le voisinage, et aucun de nous n’en puisa seulement une gorgée ; c’est à peine si nous osions nous approcher de ce fleuve. La raison est qu’il descend d’une des montagnes Karâtchîl (Himalaya), où se trouvent des minières d’or, et qu’il passe sur des reptiles venimeux (suivant un seul manuscrit, des herbes vénéneuses), tous ceux qui ont bu alors de son eau en sont morts. La montagne ci-dessus s’étend en longueur l’espace de trois mois de marche, et au bas se trouve le pays de Tibet, qui possède les gazelles donnant le musc. Nous avons déjà raconté ce qui est arrivé sur cette montagne à l’armée des musulmans. Ce fut près de cette rivière que je reçus la visite d’une troupe de fakirs de la secte de Haïdar. Ils dansèrent au son de la musique ; ils allumèrent des feux et s’y roulèrent sans en éprouver de mal. Nous avons aussi raconté toutes ces choses.
Il s’était élevé une dispute entre le commandant de cette contrée, Chams eddîn albadhakhchâny, et son gouverneur, ’Aziz alkhammâr. Le premier vint pour combattre ’Aziz, qui se défendit contre lui dans sa propre maison. La plainte de l’un d’eux parvint au vizir à Dihly, qui écrivit à moi, ainsi qu’à deux autres personnages dont il va être question, d’examiner cette affaire, puis de saisir et d’envoyer dans la capitale comme prisonnier celui des deux qui avait tort. Ces personnages étaient le roi Chah, commandant des mamlouks à Amroûhâ, où il y en avait quatre mille appartenant au sultan ; et Schihâb eddîn arroûmy. Nous nous réunîmes tous dans ma demeure. ’Aziz formula contre Chams eddîn plusieurs griefs, parmi lesquels il y avait ceci : qu’un domestique de Chams eddîn, appelé Ridha almotâny, était entré dans le logement du trésorier dudit ’Azîz, qu’il y avait bu du vin et volé cinq mille dinars dans la caisse du trésorier. J’interrogeai Ridha sur ces inculpations ; il répondit qu’il n’avait pas bu de vin depuis son départ de Moultân, à savoir huit ans avant cet instant-là. Alors je repris : « Tu en as donc bu à Moultân ? » Il répliqua : « Oui, certes. » Je lui fis donner quatre-vingts coups de cravache, et le fis mettre en prison au sujet de l’accusation de vol, par suite de ses mauvais antécédents.
Je partis d’Amroûhâ, après avoir été absent de Dihly environ deux mois ; chaque jour j’égorgeais un bœuf pour mes compagnons. Ceux-ci restèrent encore, afin d’amener les grains pour lesquels j’avais une assignation sur ’Aziz, et dont le transport était à sa charge. Par conséquent, il en distribua aux habitants des villages qui étaient sous son inspection trente mille mesures, à charger sur trois mille bœufs. La bête de somme des Indiens, c’est le bœuf ; c’est lui qui porte leurs fardeaux dans les voyages. Ce serait une grande honte chez eux de monter des ânes, lesquels, d’ailleurs, sont dans l’Inde d’une fort petite taille ; ils y sont nommés lâchehs. Lorsque ces gens veulent faire voir quelqu’un après qu’il a été frappé de verges, ils le font monter sur un âne.
Lors de son départ, le seigneur Nasir eddîn alaouhéry avait laissé en dépôt chez moi mille et soixante tengahs ; j’en disposai. A mon retour de Dihly, je trouvai qu’il avait transféré cette créance à Khodhâwend Zâdeh Kiwâm eddîn, qui était arrivé en cette ville comme substitut du vizir ; j’eus honte de lui avouer que j’avais dépensé cet argent, et lui en remis le tiers environ. Je restai chez moi plusieurs jours de suite sans sortir, et le bruit se répandit que j’étais indisposé. Nasir eddîn alkhârezmy Sadr aldjihân vint me visiter, et, en me voyant, il me dit : « Tu n’es pas malade. » Je lui répondis : « Ce qui me tourmente est une maladie morale. ». Il reprit : « Fais-la-moi connaître. » Je répliquai : « Envoie-moi ton délégué, le cheikh de l’islamisme, et je l’en informerai. » Ce dernier étant venu, je l’instruisis de ma position, qu’il fit savoir à Sadr aldjihân. Celui-ci alors m’envoya mille dinars d’argent, et je lui en devais déjà autant.
Bientôt après on me demanda d’acquitter le restant de la dette ci-dessus à Kiouâm eddîn, et je me dis, à part moi : « Il n’y a que le susnommé Sadr aldjihân qui puisse me tirer de là, car il est très riche. » Or je lui envoyai ce qui suit : un cheval sellé dont le prix, uni à celui de la selle, était de seize cents dinars ; un second cheval qui valait, avec sa selle, huit cents dinars ; deux mulets, valant douze cents dinars ; un carquois d’argent, et deux sabres, dont les fourreaux étaient recouverts d’argent. Je lui dis : « Vois ce que vaut le tout, et envoie-m’en le prix. » Il garda toutes ces choses, les estima trois mille dinars, m’en expédia mille et retint les deux mille que je lui devais. J’en fus très mécontent, et en eus la fièvre ; mais je me dis en moi-même : « Si je me plains de cela au vizir, je serai déshonoré. » Je pris cinq chevaux, deux femmes esclaves et deux mamlouks, que j’envoyai au roi Moghlîth eddîn Mohammed, fils du roi des rois ’Imad eddîn assimnâny ; c’était un jeune homme. Il me rendit tout cela, me fit tenir deux cents tengahs et multiplia ses bienfaits : je pus ainsi payer la somme que je devais. Quelle différence entre l’action de celui-ci et l’action de l’autre personnage ! (littéralement : entre l’action de Mohammed et de Mohammed !)
Lorsque le sultan se dirigea vers la contrée de Ma’bar, il arriva à Tiling, et l’épidémie se déclara dans son armée. Il retourna à Daoulet Abad, puis atteignit le fleuve Gange, descendit près de celui-ci, et ordonna à ses gens de se bâtir des habitations solides dans cet endroit. Ce fut dans ce temps-là que je me rendis à son camp, et qu’arriva ce que nous avons exposé touchant la révolte d’Aïn almolc, Je ne quittai point le souverain pendant tout cet intervalle ; je reçus de lui ma part de chevaux de race, quand il les distribua à ses courtisans ; je fus mis par lui au nombre de ces derniers ; j’assistai avec le monarque au combat contre ’Aïn almolc et à la prise de ce rebelle. Enfin je passai, en compagnie du sultan, le Gange ainsi que le fleuve Serou, pour visiter le tombeau du pieux guerrier Sâlâr ’Oud (Maç’oud), comme il a été déjà dit en détail. Quand le souverain retourna à sa capitale, Dihly, j’y entrai avec lui.
La cause de la colère du sultan contre moi fut que j’allai un jour pour visiter le cheikh Schihâb eddîn, fils du cheikh Aldjâm, dans la grotte qu’il avait creusée hors de Dihly. Je n’avais d’autre but que la vue de cette caverne ; mais, lorsque le souverain eut emprisonné ce cheikh, il demanda à ses fils de lui faire connaître les gens qui l’avaient visité. Ceux-ci nommèrent plusieurs personnes, au nombre desquelles j’étais. Le sultan ordonna alors à quatre de ses esclaves de ne plus me quitter jamais dans le lieu des audiences ; et, d’habitude, quand il agit ainsi envers quelque personnage, il est bien rare que ce dernier puisse se sauver. Le premier jour que ces esclaves me gardaient à vue était un vendredi ; le Dieu très haut m’inspira de réciter ses paroles : « Dieu nous suffit, et quel protecteur excellent ((Coran, iii, 167) ». Je répétai la phrase, dans cette même journée, trente-trois mille fois, et je passai la nuit dans l’endroit des audiences. Je jeûnai cinq jours de suite ; chaque jour je lisais tout le Coran, et ne rompais le jeûne qu’en buvant uniquement un peu d’eau. La sixième journée je mangeai, puis je jeûnai encore quatre jours successifs, et je fus délivré après la mort du cheikh. Rendons-en grâces au Dieu très haut !
Quelque temps plus tard, je renonçai au service du souverain, et je m’attachai assidûment au cheikh, au savant imâm, à l’adorateur de Dieu, l’ascète, l’humble, le pieux, le sans pareil dans son siècle, le phénix de son époque Kamal eddîn ’Abad Allah alghâry. C’était un saint qui a fait beaucoup de miracles, et j’ai déjà mentionné ceux que j’ai vus par moi-même, la première fois que j’ai parlé de lui. Je me vouai entièrement au service de ce cheikh, et donnai ce que je possédais aux moines et aux pauvres. Le saint personnage jeûnait dix jours sans interruption, et quelquefois aussi vingt jours ; je voulais jeûner comme lui ; mais il me le défendit, et me conseilla d’avoir soin de moi dans les exercices de la dévotion. Il disait : « Certes, celui qui veut aller vite et devancer les autres ne fait pas de chemin, et ne sauve point de monture. » (Cf. Schultens, Meidani Proverbiorum arabicorum pars, p. 278) J’aperçus en moi-même un certain sentiment de négligence, à cause de quelque objet qui me restait. Je me séparai donc de tout ce qui m’appartenait, précieux ou non ; je donnai à un fakir les vêtements qui me recouvraient, et je mis les siens. Je restai cinq mois avec ce cheikh ; pendant ce temps, le sultan était absent de Dihly, et dans la contrée du Sind.
Lorsque le souverain sut que je m’étais retiré du monde, il me fit demander ; il se trouvait alors dans le pays de Sîouacitân (Sihwan). Je me rendis auprès de lui dans le costume des moines, il me parla de la manière la plus affectueuse et la plus affable. Il m’invita à reprendre mes fonctions ; mais je refusai, et le priai de me permettre de voyager vers la province de Hedjaz ; il m’accorda cette permission. Je quittai le sultan et me logeai dans un ermitage qui prend son nom du roi Bachir ; c’était dans les derniers jours du mois de djoumada second, de l’année quarante-deux (742 de l’hégire = décembre 1341 de J. C.). J’y passai, tout adonné aux pratiques de dévotion, le mois de redjeb et les dix premiers jours de chaban. Je parvins à jeûner cinq jours de suite, après lesquels je ne mangeai qu’un peu de riz, sans assaisonnement. Tous les jours je lisais le Coran, et dormais le temps que Dieu voulait. Quand je prenais des aliments, ils me faisaient mal, et quand je m’en abstenais, je trouvais le repos. Quarante jours se passèrent de la sorte, et puis le sultan m’envoya chercher une seconde fois.
Après que j’eus passé quarante jours dans l’ermitage, le sultan m’envoya des chevaux sellés, des esclaves des deux sexes, des habits et de l’argent pour la dépense ; je revêtis ces habits et allai trouver le souverain. J’avais une tunique courte de coton bleu, doublée, que je portai constamment tout le temps de mes exercices de dévotion. Lorsque je l’ôtai pour endosser les habillements envoyés par le sultan, j’éprouvai une sorte de répugnance pour mon action, et toutes les fois que je jetais les yeux sur cette tunique je voyais comme une lumière dans mon cœur. Je conservai près de moi cet habit, jusqu’au moment où il me fut volé en mer par les infidèles.
Étant arrivé chez le sultan, il m’honora plus encore qu’il n’avait l’habitude de le faire, et il me dit : « Je t’ai envoyé chercher afin que tu partes comme mon ambassadeur près du roi de la Chine ; car je connais ton amour pour les courses et les voyages. » Il me fournit tout ce dont j’avais besoin, et il désigna, pour partir avec moi, les personnes qui seront nommées plus tard.
******************************
Maintenant que nos lecteurs ont sous les yeux la plus grande partie des détails qu'Ibn Batoutah donne sur l'Inde, nous croyons le moment arrivé de leur faire connaître un passage des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun qui regarde notre auteur, et qui a trait, en quelque sorte, aux faits consignés dans ce volume. Nous en donnerons le texte d'après deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, et nous y joindrons la traduction, laquelle sera suivie de quelques courtes remarques.
TRADUCTION.
« Sous le règne du sultan Abou 'Inân, un des princes des Benoû Merîn, il arriva au Maghreb, ou Afrique occidentale, un docteur de Tanger, appelé Ibn Batoutah, lequel avait voyagé dans l'Orient durant les vingt années qui venaient de s'écouler. Il avait parcouru les contrées de l'Irak, ou de la Perse, le Yémen, l'Inde, et il était entré à Dihly, capitale du dernier pays. Le souverain de l'Inde alors vivant, le sultan Mohammed Chah, le reçut avec beaucoup de distinction, et l'employa en qualité de juge du rite de Malik dans son empire. Ensuite, le voyageur revint en Occident et fut admis en présence du souverain Abou 'Inân. Il se mit à raconter les circonstances de ses voyages, les merveilles qu'il avait vues dans le» différentes régions de la terre, et il parlait surtout du gouvernement de l'empereur de Dihly. A ce sujet, il avançait des faits qui semblaient bien étranges à ceux qui les entendaient. Il disait, entre autres choses, ce qui suit : « 1° que le roi de l'Inde, lorsqu'il entreprenait un voyage, comptait les habitants de sa capitale, hommes, femmes et enfants, et leur faisait distribuer à tous des vivres pour six mois, à titre de présent de sa part ; et 2° qu'au moment de son retour, il faisait son entrée dans la ville en un joui1 solennel ou de cérémonie ; que le peuple se rendait en masse à sa rencontre dans la plaine qui avoisine la cité, et qu'il entourait le monarque; que, devant celui-ci, et parmi cette foule, on dressait sur des chameaux des batistes, au moyen desquelles on lançait sur les sujets des sacs de pièces d'argent et d'or, et que cela durait jusqu'à ce que l'empereur fût entré dans son palais. » Les individus qui écoutaient à la cour de telles anecdotes, et d'autres analogues, se disaient tout bas à l'oreille que c'étaient des mensonges, et que celui qui les racontait était un imposteur.
« Dans ce temps-la, je rencontrai un jour le vizir du sultan, le personnage nommé Faris, fils de Ouedrâr, et dont la célébrité est immense. Je causai avec lui sur ces mêmes matières, et lui fis part des soupçons que m'inspiraient les récits d'Ibn Batoutah, attendu que généralement on les traitait d'impostures. Le vizir Faris me répondit : « Garde-toi bien de nier de pareilles choses concernant d'autres pays, par la raison que tu ne les a pas vues ; car tu serais alors sur la même ligne que le fils du vizir, qui grandit et fut élevé dans la prison. » Ce discours faisait allusion au cas d'un vizir qui fut incarcéré par son souverain, et qui resta dans le cachot un grand nombre d'années, pendant lesquelles son fils s'y développa et y fut éduqué. Quand l'enfant atteignit l'âge de l'adolescence et de la raison, il se mit à faire des demandes sur les chairs d'animaux dont il se nourrissait; et lorsque son père lui disait : « Ceci est de la viande de moutons », il répliquait : « Qu'est-ce que les moutons? » Son père alors les lui décrivait au moyen de leurs signes et de leurs qualités distinctives ; et le fils reprenait : « O mon père, tu vois bien que ces animaux ressemblent aux rats. » Le père niait cela, il le réprimandait et lui disait : « Quelle différence n'y a-t-il pas entre les moutons et les rats! » Pareille chose arrivait pour la viande des bœufs et des chameaux; car le garçon n'avait vu, dans son cachot, rien que des souris ou des rats, et il pensait que les autres animaux étaient tous de la même espèce que ces derniers.
« C'est là ce qui se passe trop souvent chez les hommes quand il s'agit de choses nouvelles. Ils sont aussi atteints de la manie de les exagérer, afin d'exciter l'admiration, ainsi que nous l'avons expose au commencement de l'ouvrage. Or donc, que l'homme ait recours à ses règles ou principes, qu'il s'observe soi-même avec soin, qu'il sache distinguer ce qui est possible de ce qui est impossible, par son intelligence éclairée et son naturel droit. Il admettra tout ce qui entre dans la zone ou le cercle de la possibilité, et ce qui est en dehors, il le rejettera. Nous n'entendons point parler ici de la possibilité intellectuelle absolue, car son cercle embrasse ce qu'il y a de plus vaste, et elle n'assigne aucunes limites entre les événements; mais nous voulons seulement indiquer ce qui est possible, en tenant compte de la matière même, ou de la substance, ou de la nature de la chose. Lorsque nous considérons l'origine de telle chose, son espèce, sa différence (avec d'autres), ou ses attributs, ainsi que l'étendue de sa grandeur et de sa force, nous prononçons notre jugement sur ses rapports ou états, suivant toutes ces circonstances, et nous concluons en disant que tout ce qui sort de sa sphère est impossible. Or, dis : « O Dieu, mon maître, augmente ma science ! » (Coran, xx, 113.) Nous nous bornerons à faire observer: 1° que la seconde partie de ce fragment réfute et détruit les doutes élevés dans la première ; 2° que ces doutes portent sur les relations verbales attribuées à Ibn Batoutah, lesquelles différent sur plusieurs points importants du récit que nous possédons, et qui seul doit nous occuper ; 3° enfin, que tout ce que notre voyageur a dit jusqu'ici sur l'Inde, se trouve suffisamment confirmé par les ouvrages d'historiens renommés, tels que Firichtah, Khondémir, etc. Il mérite donc toute confiance.
[1] Sir John Malcolm, Hist. de la Perse, trad. fr. t. III, p. 358; Meyendorff, Voyage d’Orenbourg à Boukhara, p. 281, 282.
[2] Voyages d'Ali Bey, t. III, p. 6, 7.
[3] Histoire des khans mongols du Turkestan et de la Transoxiane, trad. du persan par C. Defrémery. Paris, Impr. imp. 1853, in-8°, p. 93 et suiv.
[4] Nous devons faire observer qu'Ibn Batoutah a omis de mentionner (p. 64) le règne de Chems eddîn Mohammed, frère aîné d'Alhâfiz et d'Hoçaïn. Il est vrai que ce règne ne dura que deux mois, selon d'Herbelot et Deguignes (Histoire générale des Huns, etc. t. I, p. 416), ou dix mois, d'après Khondémir (Habib Assiyer, ms. de Gentil, t. III, f° 128 v°).
[5] Voyez le chapitre du Habib Assiyer intitulé : Histoire de la domination des rois Serbédâr sur le pays de Sebzévâr, chapitre dont le savant académicien de Saint-Pétersbourg M. Bernhard Dorn a récemment publié le texte, avec une traduction allemande et des notes (Die Geschichte Tabaristan’s und der Serbedar nach Chondemir, 1850, grand in-4°, p. 143 et suiv.) ; cf. encore Sehir eddins Geschichte von Tabaristan, Rujan und Masanderan, persischer Text, herausgegeben von B. Dorn; Saint-Pétersbourg, 1850, in-8°, p. 103 et suiv, jusqu'à 111. —D'Herbelot (Biblioth. orient, verbo Sarbédar) et, d'après lui, Deguignes (Hist. des Huns, t. I, p. 412), donnent une origine un peu différente à la dénomination de Serbédâr.
[6] Hist. de Timur Bec, par Cheref eddîn Ali, trad. de Pétis de la Croix, t. I, p. 6 et 7; Schir eddin's Geschichte, etc. loc. laud. Khondémir, apud Dorn, loc. laud. p. 146 et 149; et ms. de Gentil, t. III, fol. 129 r°, lignes 1 et 2.
[7] Voyez
l'Histoire des Mongols de la
Perse, p. 176, 177, note, et la Géographie
d'Edricy, trad. fr. t. II, p. 183, où on lit Faner.
![]() ,
au lieu de
,
au lieu de ![]() ; et
The geographical works of Sadik
Isfahani, p. 40.
; et
The geographical works of Sadik
Isfahani, p. 40.
[8] Journal historique du voyage de M. de Lesseps, Paris, 1790, in-8°, t. II, p. 137, 139.
[9] A personal narrative of a journey to the source of the river Oxus, etc. London, 1841, in-8°, p. 408 et suiv.
[10] Leyden’s and Erskine's Baber, p. 139.
[11] Cf. Edward Thomas, On the coins of the kings of Ghazni, London, 1848, in-8°, p. 31. M. Lee a supposé à tort que cette place pouvait être celle de Bédâoun, mentionnée par Firichtah, et dont il sera question ci-après. Bédâoun est, comme on sait, située dans le Rohilconde.
[12] Nous avons fait voir, dans la préface de notre premier volume, combien le travail du religieux portugais laissait à désirer, sous le double rapport de l'intelligence du texte et de la transcription des noms propres d'hommes et de lieux, et combien il présentait de suppressions. Nous osons espérer que notre version, plus complète, plus étudiée, et dont, grâce à l'adjonction du texte, les orientalistes peuvent facilement contrôler l'exactitude, remplacera dorénavant celle de notre devancier.
[13] On se fera une idée de la différence qui existe entre les deux rédactions, quand on saura que ce qui, dans le présent volume, occupe trois cent cinquante-six pages, n'en remplit, dans le volume de M. Lee, que cinquante-deux, sur lesquelles il faut en déduire huit pour un extrait d'un ouvrage persan relatif à l'histoire de la forteresse de Gualior, et au moins deux fois autant pour les notes du traducteur, parmi lesquelles il y en a de fort utiles, mais aussi d'inexactes. L'abrégé traduit par M. Lee paraît avoir été rédigé avec beaucoup de négligence. En effet, on y voit l'histoire du cheikh Hoûd (et non Hâd, comme on lit, p. 146 de M. Lee) mêlée, de la manière la plus étrange, avec celle de Behâ eddîn Guchtasp (ou Guerchasp), cousin germain du sultan de l'Inde. (Cf. ci-dessous, p. 302 à 307 et 318 à 321.) La rébellion d'Aïn Almolc est aussi racontée de la façon la plus incomplète et la plus inexacte. (Voyez Lee, p.147.)
[14] Supplément to the Glossary of Indian terms, by H. M. Elliot, Agra, 1845, in-8°, p. 79, note.
[15] History of India, t. II, p. 66.
[16] Firichtah, édit. lithogr. Bombay, 1831, in-fol. t. II, p. 609, lig. 3 et suiv. (Cf. M. Reinaud, Mémoire géographique, historique et scientifique sur l’Inde, p. 256.)
[17] L'émir Ounâr Assâmiry, dont parle notre auteur, avait aussi embrassé l'islamisme. Plus loin Ibn Batoutah mentionne un prince musulman appartenant à la tribu des Sâmirah du Sind.
[18] On peut voir ce passage du Dabistân, cité et traduit dan» une note de M. Lee, p. 100.
[19] Thabakâti Nâssiry, ms. persan 13, Gentil, fol. 291 r° et 300 v°; Firichtah, t. I, p. 102, lig. 5, et 106, ligne 15.
[20] Pour
dresser le tableau suivant, nous avons fait usage des trois
historiens persans cités plus haut; nous avons de plus mis à
profit un savant travail de M. Edward Thomas (On
the coins of the patan
sultans of Hindustan, London, 1847, avec
un supplément, ibidem, 1852), qui a rectifié, à
l'aide des médailles, plusieurs des dates données par
Firichtah. (Voy. surtout les p. 41, 45, 122 et 129.) Nous
devons faire observer que, dans son premier travail (p. 37,
note), M. Thomas a fait dire à Ibn Batoutah une chose qui ne
se trouve pas dans notre auteur. Il s'agit de la mort de
Nasir eddîn, fils de Balaban et gouverneur du Bengale, mort
que, d'après M. Thomas, qui cite comme garant le travail de
M. Lee (p. 116), Ibn Batoutah aurait placée en 689. Or il
n'est question de rien de pareil ni dans la relation
originale, ni dans l'abrégé. On y lit seulement qu'à
l'époque de la mort de Balaban, son fils Nasir eddîn se
trouvait dans la province de Lacnaouty. M. Thomas paraît
avoir été induit en erreur par ce qu'on lit plus loin dans
la traduction de M. Lee, à savoir, que Nasir eddîn mourut
deux ans après son entrevue avec son fils Mouizz eddîn. Mais
les mss. de la relation originale portent
 « des
années », et non
« des
années », et non  , « deux
années» (voyez ci-dessous).
, « deux
années» (voyez ci-dessous).
[21] Khondémir, t. III, fol. 103 r°; Firichlah, t. I, p. 152, 153.
[22] Alminhâdj ibn Sirâdj Aldjoûzdjâny, auteur des Thabakâti Nâssiry, écrivait en 1269; Khondémir mourut en 1534, et Firichtah vivait encore en 1626.
[23] Nous devons faire observer que je fils de Chems eddîn Altmich, qui fut mis à mort par l'ordre de son frère Rocn eddin, s'appelait Kothb eddîn et non Mouizz eddîn, comme le dit Ibn Batoutah. (Cf. les Thabakâti Nâssiry, fol. 325 r° et Firichtah, t. I, p. 116, ligne avant-dernière.)
[24] T. I, p. 148, 149; Cf. Khondémir, t. III, fol. 102 v°. Le même ouvrage d'émir Khosrow est encore cité sous ce même titre, dans un passage du Khilâcet attéwârikh, transcrit par M. Ed. Thomas, op. supr. laud., p. 127, l. 5.
[25] Voyez les Notices et extraits des mss., t. XIII, p. 181 à 210 et 217 à 221.
[26] Habib asiiyer, t. III, fol. 109 v°, 110 r°. Cf. Firichtah t. I, p 236.
[27] Nous ne pouvons nous empêcher de faire observer qu'un fait particulier, raconté par Ibn Batoutah dans le passage cité plus haut, semble confirmer d'avance cette assertion de l'historien persan, postérieur de plus de deux siècles et demi à notre voyageur.
[28] Firichtah, t. I, p. 190, ligne 2 et suiv.
[29] On voit dans Ibn Batoutah que tel était le titre honorifique de ce personnage.
[30] Firichtah retarde cet événement jusqu'après l'échec qui atteignit l'armée indienne dans son expédition au delà de l'Himalaya, en l'année 738 (1337-1338). Ici, comme plus bas, nous avons suivi de préférence la chronologie de Khondémir, auteur plus ancien, et, en général, plus exact. M. Ed. Thomas a déjà fait observer, à propos de l'époque où Diouguir fut choisi comme capitale par Mohammed ibn Toghlok, combien peu les dates données par Firichtah méritent de confiance. (Op. sup. laud. p. 61, n. 18. Cf. ibid. p. 74, note.)
[31] Il est démontré, par une monnaie d'or du sultan Mohammed, décrite par M. Thomas, p. 50, n° 85, que cet événement doit être plus ancien d'au moins une année.
[32] Telle est la date donnée par Khondémir, fol. 111 r°.Firichtah indique celle de 748, qui est contredite par ce qu'on lit dans une autre portion de l'ouvrage de cet auteur. En effet, on y voit (p. 525) que l'intronisation de Haçan Gângoû Behmény, comme roi de Colberga, laquelle arriva deux années au moins après ces événements, eut lieu le 24 rebi second 748 (4 août 1347).
[33] Voyez Ed. Thomas, op: supr. laud., supplément, p. 134, 135.
[34] Voyez ce qu'il dit du siège de la citadelle de Daoulet Abad.
[35] Le surnom d'Al cobra, donné au cheikh Nedjm eddîn, ayant besoin d'explication, nous croyons devoir traduire la notice très détaillée et assez curieuse que Khondémir a consacrée à ce cheikh dans sa grande histoire universelle écrite en persan, et intitulée : Habib Assiyer ou « l'Ami des biographies ».
Le nom du cheikh Nedjm eddîn était Ahmed, fils d'Omar alkhiwaky (ou de Khiwa), et son surnom, Cobra. Ce saint personnage fut désigné par ce surnom parce que, pendant ses études, il remportait l'avantage sur tous ceux de ses condisciples avec qui il engageait des discussions. Ce fut pour cette raison qu'on l'appela « le dernier jugement », thammehi cobra. Dans la suite, et par le grand usage qu'on fit de ce surnom, on rejeta le mot thammehi et l'on se contenta de dire cobra. D'autres personnes pensent que le surnom de Nedjm eddîn était cobera, pluriel rompu ou irrégulier de cabir, c'est- à-dire qu'il était « l'astre des grands ». Mais la première explication est la vraie. Voilà ce qu'on lit dans l'histoire d'Alyaféy.
Le nom de cheikh wély térâch « le cheikh qui sculpte des amis de Dieu ou des saints », est aussi un surnom de ce saint personnage. On le lui a attribué parce que, quelle que fût la personne sur laquelle son regard tombait, elle parvenait au rang de saint,
Hémistiche. — Lorsqu'un chien a été regardé par Nedjm eddîn, il devient le chef des autres chiens.
Le prénom du cheikh Nedjm eddîn était Abou'l Djonnâb. L'émir Iqbal Seistâny rapporte ce qui suit dans l'opuscule (riçâleh.) renfermant les paroles du cheikh Rocn eddîn Alâ eddaulah Simnâny : « Dans sa jeunesse, le cheikh Nedjm eddîn se rendit de Kharezm à Hamadan, afin d'étudier les traditions. Lorsqu'il eut obtenu des savants de cette ville la permission de transmettre les traditions, il passa à Alexandrie. Ayant aussi obtenu la licence (idjâzah) du mohaddith « traditionnaire » d'Alexandrie, Abou Thâhir Ahmed Assilafy, au moment de son retour, il vit une nuit en songe le saint Prophète et lui demanda un prénom. Le Prophète lui indiqua celui d'Abou'ldjonnâb. Le cheikh lui demanda : « Est-ce Abou'l-djonâb sans techdîd, » Le Prophète répondit : « Non, c'est Abou'l-djonnâb avec un techdîd.» Lorsque le cheikh fut éveillé, il comprit, par le sens de ce surnom, qu'il lui fallait s'abstenir des biens de ce monde (djonnâb signifie « qui marche à coté de..., qui s'écarte de quelque chose »). En conséquence, après s'être dépouillé en cet endroit même de tout attachement mondain, il commença à voyager à la recherche d'un directeur à qui il pût remettre sa conduite.
Lorsqu'il fut arrivé dans le Khouzistan, il tomba malade dans le monastère du cheikh Ismâ’îl Kasry. Par l'heureuse influence de la sollicitude du cheikh, il fut délivré de cette maladie ; étant devenu disciple de Kasry, il s'adonna à la vie contemplative, et passa quelque temps en cet endroit. Une nuit, cette réflexion se présenta à son esprit: « Ma science dans les dogmes extérieurs (ou exotériques, zhâhir) est plus grande que celle du cheikh Ismâ’îl; j'ai obtenu également ma part du sens caché (ou allégorique, bâthin) de la loi. » Cette opinion s'étant manifestée au cheikh Ismâ’îl, le lendemain matin, il manda notre saint personnage et lui dit: « Lève-toi et entreprends un voyage, car il te faut aller trouver le cheikh Ammar (ibn) Yâcir. » Le cheikh Nedjm eddîn vit bien que le cheikh Ismâ’îl avait eu connaissance de ce qui lui avait passé par l'esprit; mais il ne dit rien et se rendit près du cheikh 'Ammar. Après qu'il y eut été adonné pendant quelque temps à la vie contemplative, une nuit la même réflexion se présenta à son esprit. Le matin suivant, le cheikh 'Ammar lui dit : « Nedjm eddîn, lève-toi et rends-toi au vieux Caire (Misr), auprès du cheikh Roûzbéhân, afin qu'il chasse de ta tête cet amour-propre avec un soufflet. » On rapporte que le Cheikh Nedjm eddîn fit le récit suivant :
« Lorsque j'arrivai à Misr, je vis le cheikh Roûzbéhân à la porte de son monastère, où il faisait ses ablutions avec un peu d'eau. Je dis en moi-même : « Apparemment, le cheikh ignore qu'il n'est pas permis de faire ses ablutions avec une aussi petite quantité d'eau. » Lorsque le cheikh eut terminé ses purifications, il secoua la main sur sa figure; à cause des gouttes d'eau lustrale, qui atteignirent mon visage, je tombai en extase. Le cheikh étant entré dans le monastère, je l'y suivis. Pendant qu'il était occupé à rendre grâces à Dieu, je me tins debout; ayant été ravi en extase, je crus voir que le jour de la résurrection était arrivé, que l'on saisissait les hommes et qu'on les jetait dans le feu. Au bord du brasier, un vieillard se tenait assis sur le sommet d'une colline. Tous ceux qui disaient : « Je lui suis attaché », il les faisait passer. Tout à coup, on me prit aussi et l’on m'entraina vers le feu; mais, dès que j'eus dit : « Je suis un de ses adhérents », on me relâcha. En conséquence, je montai sur cette colline, et je vis que le vieillard en question était le cheikh Roûzbéhân; je m'approchai de lui et je tombai à ses pieds. Il m'appliqua un si violent soufflet sur l'occiput, que je fus renversé sur la face et il me dit : « Désormais ne blâme plus les gens de bien.» Après cela, je revins de mon extase, je vis que le cheikh avait terminé sa prière, je m'avançai et frottai mon visage sur ses pieds. Le cheikh m'appliqua indubitablement un second soufflet sur l'occiput, et prononça la même parole. Par ce motif, la présomption disparut de mon caractère ; le cheikh Roûzbéhân me renvoya près du cheikh 'Ammar Yâcir et lui écrivit : « Envoie-moi tout le cuivre que tu as, pour que je le change en or pur et que je te le renvoie ensuite. » Le cheikh Nedjm eddîn ayant passé quelque temps près du cheik 'Ammar, obtint son congé lorsqu'il eut atteint la perfection dans la vie contemplative. Il se rendit à Kharezm, et s'y livra à la direction spirituelle des musulmans.
On rapporte qu'à l'époque où l'armée mongole se dirigea vers Kharezm, Djenghiz khân et ses enfants, qui avaient connaissance du haut rang du cheikh Nedjm eddîn dans la religion musulmane, lui envoyèrent à plusieurs reprises un émissaire et le prièrent de sortir de Djordjanieh, afin qu'aucun dommage n'atteignît sa personne bénie. Mais le cheikh n'accueillit pas cette demande et répondit : « Nous avons vécu au milieu de ces hommes pendant qu'ils étaient tranquilles et en repos, comment nous serait-il permis de vouloir nous séparer d'eux au moment où l'affliction et la peine les atteignent? » Lorsque cette armée terrible arriva près de Kharezm, le cheikh Nedjm eddîn donna au cheikh Sa'd eddîn Hamawy, au cheikh Ridha eddîn 'Aly Lâlâ, et à quelques autres de ses principaux compagnons, au nombre de plus de soixante personnes, la permission de sortir de cette ville. Ils lui dirent : « Qu'arrivera-t-il si le cheikh fait des vœux pour que cette affliction soit écartée des contrées musulmanes ? » Le cheikh répondit : « C'est un arrêt irrévocable de la providence; on ne peut y remédier par des prières. » Ces hommes lui dirent alors : « Il est donc convenable que le cheikh nous accompagne dans ce voyage. » Il répliqua : « Je n'ai pas la permission de sortir ; je serai martyr dans cet endroit. » Ses disciples, lui ayant fait leurs adieux, se dispersèrent dans toutes les directions.
Le jour où les Mongols entrèrent dans la ville, le cheikh manda plusieurs personnes qui étaient restées près de lui et leur dit : « Levez-vous au nom de Dieu, et combattez dans la voie de Dieu. » Il se leva alors, se couvrit de son froc, serra sa ceinture, remplit sa poitrine de pierres et prit dans sa main une javeline. Dans cet équipage, il marcha contre les Mongols et leur jeta des pierres, jusqu'à ce que celles qu'il avait prises dans son sein fussent épuisées. Les soldats de Djenghiz khân ayant fait pleuvoir les flèches sur ce saint personnage y un trait l'atteignit à la poitrine. Lorsqu'il eut retiré cette flèche de la plaie, l'oiseau de son âme prit son vol vers les jardins du paradis. On dit que le cheikh Nedjm eddîn, au moment de son martyre, avait saisi un Mongol par les cheveux de devant (pertchem). Lorsqu'il fut renversé à terre, dix personnes ne purent tirer cet homme de ses mains. A la fin, on coupa les cheveux de l'infidèle. C'est par allusion à ce fait que Méwlanâ Djélal eddîn Roûmy (cf. Voyages d’Ibn Batoutah, t. II) a dit:
« Nous sommes au nombre de ces hommes considérés qui prennent la coupe, et non de ces pauvres malheureux qui embrassent une taille mince ; de ces hommes qui, d'une main, se versent (litt. boivent) le vin pur de la foi, et, de l’autre, saisissent les cheveux de l'infidèle.
Le martyre du cheikh Nedjm eddîn arriva dans le courant de l'année 618 (1231 de J. C).
(Ms. persan de la Bibl. impér., fonds Gentil, n° 69, t. III, fol. 12 v°, 13 r°. Cf. Djâmi, Vies des Soufis, ms. persan n° 112, fol. 139 v°, 140 r°; les Notices des manuscrits, t. XII, p. 416, note, ou on lit Abou'l Khibâb ou Khabbâb, au lieu d'Abou'l Djonnâb; et Mirkhond, Vie de Djenghiz khân, texte persan, Paris, Didot, 1841, p, 138, 139.)
[36] Dans ce passage, le sens semble être celui de « servi en grains » ; probablement, l'auteur a voulu dire que, non seulement les grenades étaient servies tout ouvertes, mais que chaque grain avait été retiré de la cellule qui le renfermait.
[37] On voit, par ce passage, que les mille dirhems dont parle Ibn Batoutah étaient ce que notre auteur appelle ailleurs dinars dirhems ou dinars d'argent. Quatre de ces pièces de monnaie équivalaient à un dinar d'or du Maghreb. Quant aux véritables drachmes du Kiptchak, on a vu plus haut qu'il en fallait cinquante ou soixante pour faire un dinar du Maghreb. Ibn Batoutah dit plus loin que le dinar de l'Inde (ou tengah) équivalait à deux dinars et demi de son pays.
[38] Telle est la leçon que fournissent nos quatre manuscrits, ainsi que l'abrégé dont M. Kosegarten a publié des extraits (Commentatio, p. 15). Mais le total des distances qui séparaient Khârezm d'Alcât, Alcât de Wabkéneh, et ce dernier endroit de Boukhara, ne donne que onze jours.
[39] Au lieu de Sibâieh, le ms. 908 porte Siâçak. Le ms. 911 présente ici une lacune de près de deux lignes. Outre les deux passages d'Edrisi que nous avons indiqués entre parenthèses, on en trouve, dans ce géographe, un troisième où il est question de la même localité, seulement elle y est nommée Senkâ, ou Sekâïah.
[40] On pourrait lire à la seconde forme : « il prit mes manches et baisa la main avec laquelle il les avait touchées, etc. ». On sait qu'actuellement encore les Turcs, surtout quand ils parlent à un supérieur, portent fréquemment la main sur la bouche et ensuite sur le front, ce qui est regardé comme un témoignage de respect et de soumission. On se salue aussi en appuyant la main droite sur la bouche. (Cf. l'extrait de Frescobaldi, donné dans notre premier volume et ci-dessus l'histoire de Balaban.) Le ms. 908 porte « retourner une chose, la manier ».
[41] Ibn Batoutah distingue ici Nécef de Nakhcheb, dont il a parlé plus haut, tandis que tous les géographes orientaux considèrent ces deux noms comme désignant une seule et même ville. (Voyez Yakout, Kitab almochtaric, édit Wüstenfeld, p. 391, lig. 9; Soyoûthy, Lobb allobâb, édit. Veth, p. 261, 262, et le Merâcid alitthilâ, édit Juynboll, t. III, p. 203.) Sadik Isfahâny affirme que Nécef est le nom persan de Nakhcheb. Il ajoute que cette ville est aussi appelée Karchy par les Turcs : « Dans la langue mongole, Karchy signifie, dit-il, un palais; car Kébek khan, souverain du Mavérannahr, construisit un grand palais dans cet endroit, et la ville a dû son nom de Karchy à cet édifice. » ( The geographical works of Sadik Isfahani, p. 50, 51; cf. ibid., p. 143; l'Histoire de Timourbec, t. I, p. 3, note, et p. 95; la Bibliothèque orientale, verbo Nekhscheb, et le sultan Baber, cité dans le Journal des Savants, juin 1848, p. 339.) C'est à deux lieues de Karchy, vers l'occident, que s'élevait le palais de Zendjîr Seraï, une des résidences favorites de Tamerlan. (Histoire de Timurbec, t. I, p. 358.)
[42] L'historien Khondémir a consacré à ce personnage une notice que nous croyons devoir traduire presque en entier, parce qu'elle confirme, en le complétant sur quelques points, le récit d'Ibn Batoutah : « La crème des hommes pieux, Mewlânâ Nizâm eddîn Abd arrabim al-khâfy habitait la ville de Hérat, sous le règne de Mélik Mouizz eddîn Hoçaïn ; il s'occupait continuellement à ordonner ce qui était permis par la loi et à défendre ce qu'elle prohibait, Sâlâr (le général), qui était au nombre des principaux, émirs, montrait une sollicitude parfaite pour corroborer et faire exécuter les efforts et les ordres de Mewlânâ. Mélik Hoçaïn avait aussi une grande considération pour ce saint personnage; bien plus, il regardait ses ordres comme des lois décisives…………..
« Il a été raconté, par des hommes dignes de confiance, qu'au commencement du règne de Mélik Hoçaïn Curt, un grand nombre de Turcs Ghozz ou d'autres tribus turques habitaient Badghîs, et que, s'étant soustraits à l'observation des règles fondamentales de la loi musulmane, ils se livraient à l'injustice et à l'erreur. En conséquence, Mewlânâ Nithâm eddîn écrivit un fetva par lequel il les déclarait hérétiques. Les chefs de cette troupe ayant été informés de cela, conduisirent une armée considérable aux portes de Hérat, dans le courant de l'année 738 (1337-8 de J. C). Comme le roi (Mo'izz eddîn Hoçaïn) n'avait pas le pouvoir de résister à cette armée, il se fortifia dans la ville. Les ennemis lui envoyèrent un message ainsi conçu : « Notre but, en allumant le feu du combat et de l'inimitié, est de tuer une personne qui nous regarde comme des infidèles. Si donc les habitants de Hérat ne veulent pas perdre leurs richesses et leurs vies, il faut qu'ils chassent cette personne. » Comme la situation des habitants de Hérat était désespérée, on écrivit un fetva portant qu'un dommage, particulier était permis quand il s'agissait de l'avantage général. Pendant que Mewlânâ prêchait le peuple, on remit cet écrit entre ses mains. Mewlânâ, ayant eu connaissance de l'état des choses, descendit aussitôt de la chaire, et, après avoir fait ses ablutions et revêtu on habit propre, il sortit de la ville. Les ennemis le prirent en dehors de la rue royale (derbi mélic), le tuèrent et l'ensevelirent dans l'allée d'arbres (khiâbân). Puis, ayant levé le siège de Hérat, ils retournèrent dans leurs demeures. » (Habib assiyer, t. III, p. 130 r° et v°.)
[43] Ici et à la ligne suivante, le ms. 910 porte Alhaçany, au lieu de Aldjesty. Sous la date de l'année 719 (1319), Khondémir (ibid., fol. 62 v°) mentionne un Khodjah Ahmed Djichty, que l'émir Bectoût et Yaçaoûr envoyèrent, à plusieurs reprises, auprès du prince de Hérat, Mélik Ghiâth eddîn, pour en obtenir la reddition des richesses et des hommes qu'il avait enlevés de Badghîs pendant leur absence. Le baron C. d'Ohsson, qui a raconté le même événement d'après d'autres sources, appelle ce personnage le cheikh ulislâm Abou Ahmed et le Khodjah Abou Ahmed (Histoire des Mongols, t. IV, p. 626, 627). Quoique deux de nos mss. et celui du Père Moura portent Aldjesty, il faut lire Aldjichty ou, d'après l'orthographe persane, Altchichty. Cet adjectif relatif, que l'on chercherait vainement dans le Lobb allobâb, de Soyoûthy, vient de Tchicht, nom d'une localité située, d'après Firichtah, dans le voisinage de Hérat. (Tarikh i Firichtah, t. II, p. 712). Cet endroit est marqué, sous le nom de Chwadja Tschicht, sur deux des excellentes cartes dressées par H. Henri Kiepert pour le grand ouvrage de Ritter (Berlin, 1852). Il est devenu, par la suite, le nom patronymique d'une famille de séides ou descendants de Mahomet, famille qui a donné naissance à plusieurs fameux soufis ou contemplatifs, mentionnés par Djâmi et Firichtah.) Voyez encore le Nouveau journal asiatique, t. VIII, p. 193 à 198 et p. 314). Quant au cheikh Maoudoûd altchichty, que cite Ibn Batoutah, il mourut, selon Djâmi (ms. persan 112, fol. 109 v°), en l'année 527 de l'hégire (1132-33 de J. C). Par conséquent, le mot hajid doit se prendre ici dans le sens de « descendant », et non dans sa signification littérale de « petit-fils ».
[44] Ce nom de lieu est évidemment altéré. Peut-être faut-il lire Andékhoûdh, nom d'une ville bien connue, située entre Balkh et Merv, à deux journées au nord-est d'Achboûrkân ou Chuburkân, selon Ibn Haukal. (Cf. S. de Sacy, Mémoire sur deux provinces de la Perse orientale. Paris, 1813, in-8°, p. 39, 40.) Le nom d’Andékhoûdh a été défiguré dans Edrisi (t. I, p. 470) en Zakkar. Actuellement on prononce Andkhou.
[45] Au lieu de « les esclaves », que portent les mss. 907 et 910, peut-être vaut-il mieux lire « les provinces », avec les mss. 909 et 911. En effet, on voit par de nombreux passages de Firichtah, qu'il existait dans l'Inde, vers l’époque d’Ibn Batoutah, une dignité dont le titulaire était appelé « l’inspecteur des provinces, ou « l'inspecteur du royaume ». Dans un des passages cités plus haut, l'historien persan mentionne « les fonctions de substitut de l'inspecteur du Guzarate ». Le général Brigg nous paraît avoir rendu peu exactement le titre d'aridh almamâlic par « the officer through whom petitions are presented ». (History of the rise of the mahomedan power in India, t. I.) Sous les princes Ghourides, il existait un fonctionnaire appelé « le chef du bureau des revues », devant lequel devaient se présenter les soldats qui désiraient prendre du service. (Voyez les Thabakâti Néoiry, ms. persan 13, Gentil, fol. 304 v°.) C'est, sans doute, de cet officier qu'il est question dans Ibn Batoutah, sous le titre de Mélik 'Arz ou « le roi des revues ». Khondémir (ms. 69 Gentil, fol. 109 v°, l. 1) dit que la dignité d'inspecteur de l'armée, fut confiée au neveu de Toghlok chah, Mélik Béha eddîn. Ailleurs (fol. 103 r°) il parle de l'inspecteur de l'armée. Nous verrons encore citer plus loin, par Ibn Batoutah, Imad al molc, Aridh almamâlic, ou « l’inspecteur des Mamlouks », car c'est ainsi que nous avons cru devoir lire, au lieu de 'ourdh, que porte le ms. 907, et qui ne pourrait signifier que « le côté, le flanc des Mamlouks ». Dans ce dernier endroit et ailleurs, il est question du grand kadi des Mamlouks, Sadr aldjihân Kamal eddîn al-ghaznéouy. Peut-être encore vaudrait-il mieux lire ici Almamdlic « les provinces, l'empire », au lieu d’Almamâlic « les Mamlouks ». Ce qui peut porter à préférer la première leçon, c'est que, dans un précédent passage d'Ibn Batoutah, on voit le même personnage désigné par le titre de « grand kadi de l'Inde et du Sind ». Un écrivain fort exact, qui vivait en même temps qu'Ibn Batoutah, s'exprime ainsi : « le sadr djihân, c'est-à-dire le kadi alkodhât, à l'époque où nous écrivons, se nomme Kamal eddîn, fils de Borhân eddîn. Ce magistrat porte également le titre de Sadr alislâm; c'est le principal personnage chargé de rendre la justice. » (Meçalik alabsâr, dans les Notices et extraits, t. XIII, p. 185.) Khondémir atteste (fol. 102 r°) que l'auteur des Thabakâti Nâciry, ayant obtenu le surnom honorifique de Sadr-Djihan, exerça quelque temps les fonctions de kadi des provinces de l'Hindoustan.
[46] Les mots, litt. « de dix un », signifient « la dîme, la dixième partie », On lit dans les Thabakâti Nâciry : « Il partagea tout entier, en deux portions égales, le trésor de Ghiznin, qui, a cause des immenses richesses qu'il contenait, n'aurait regardé les choses précieuses du trésor de Kâroûn (Coré) que comme la dixième partie de son propre revenu.» (Ma. persan de la Bibliothèque impériale, fonds Gentil, n° 13, fol. 295 r°.) On, trouve ce qui suit dans une relation manuscrite de la Perse, composée, il y a bientôt deux siècles, à propos des béraat ou « assignations distribuées aux militaires », et dont ils devaient percevoir le montant sur le revenu de tel ou tel village : «Il faut à lettre veüe payer cet officier, et, de plus, lui donner le dehiek, de dix un, le traiter à poulet et mouton, orge, paille à ses chevaux, autrement le baston ne manque pas.» (Estât de la Perse, ms. de la Bibl. impér., n° 10534/5, p. 39)
[47] Il existe ici un blanc dans les quatre mss. ; seulement le n° 911 présent une lettre qui est, sans doute, une abréviation et sert à indiquer que cette lacune se trouvait dans l'original. Nous avons suppléé par conjecture. Du reste, le raisin n'est pas aussi rare dans l'Inde que semble le dire ici notre auteur. Plus loin, Ibn Batoutah atteste que l'on en trouvait à Daoulet Abad, et que la vigne y portait deux récoltes chaque année. (Ms. 907, fol. 56 r°.) Un savant géographe arabe, contemporain d'Ibn Batoutah, fait l'observation suivante à propos de l'Inde : « Les figues et les raisins sont les fruits qu'on y trouve en moindre quantité.» (Meçâlic Alabsâr, dans le recueil des Notices et extraits, t XIII, p. 175.)
[48] Voici de quelle manière le n° 910 fixe la prononciation du mot kichry : « On sait que l'orthographe usitée dans l'Inde est kitchry. — Quant au mot aimant, que l'on rencontre deux lignes plus bas, c'est le terme hindoustani, que Shakespeare traduit par « vetches, lentils ». Firichtah le mentionne et on lit dans Khondémir : « le moût qui est un grain ressemblant au mâch » (phaseolus Max). (Habib assiyer, ms. déjà cité, t. III, fol. 106 v°.)
[49] La leçon Farid est évidemment la bonne, car il s'agit ici du célèbre dévot musulman, Farid eddîn Chéker Guendj, sur lequel on peut consulter Firichtah (texte persan, t. II, p. 725-739), et le Nouveau journal asiatique (t. VIII, p. 318, 319). Ce personnage finit ses jours à Adjodin, autrement appelée Patan, et y fut enterré; mais, d'après Firichtah, il était né dans une petite ville voisine de Moultân, et que cet auteur appelle Ghoûtavâl, (dans le Journ. asiat., loc. laud., on lit Ghanawal). Ibn Batoutah paraît donc s'être trompé, quanta la localité qu'il indique comme le lieu natal de Farid eddîn. Probablement, il aura confondu celui-ci avec son disciple Nizâm eddîn Aoulia, lequel, d'après Firichtah (ibid., p. 740; cf. Journ. asiat., ibid., p. 323), naquit effectivement à Bédâoun. Ibn Batoutah mentionne plus loin (p. 158, 160 et 211) ce dernier sous le nom de Nizâm eddîn Albédhâouny.
[50] Les voyelles du mot sont ainsi marquées dans le ms. 907, mais nous n'oserions en garantir l'exactitude. D'après Shakespeare, qui cite pour son garant Adam, en ajoutant un signe de doute, le mot mandwi, signifierait « une espèce de grain ». Il ressort de trois passages de Firichtah, que le terme désignait « un marché aux grains », ce qui est parfaitement d'accord avec le texte d'Ibn Batoutah. Voici les propres paroles de l'historien persan : « Il nomma inspecteur du marché aux grains, que l'on appelle, dans la langue indienne, mandouy, le Mélik Kaboul »; chaque jour on mettait sous les yeux du sultan le tarif des grains, et on lui faisait connaître en détail toutes les transactions commerciales qui avaient quelque rapport avec le mandouy. Si un léger relâchement se glissait dans l'exécution des règles établies, les délinquants et les agents du mandouy étaient punis du dernier supplice. » « Chacun achetait du grain au mandouy. »
[51] On voit plus loin que Bédjâliçah était le nom d'une station peu éloignée de Canodje. (Ms. 907, fol. 53 r°.) Il nous paraît convenable, d'après cela, de modifier un peu notre traduction, dans laquelle nous avions supposé que la porte de Dihly, dite d'Albédjâliçah, devait son nom au cimetière situé dans le voisinage. Il nous semblait, en effet, qu'il devait en être de cette porte comme de celles de Mandouy et de Djoul (de gul « fleur », en persan), qui avaient emprunté leur nom, la première au marché aux grains, la seconde aux vergers ou jardins, dont elles étaient voisines. Il est plus probable que la porte qui fait l'objet de cette note était nommée porte d'Albédjâliçah, parce qu'elle était située dans la direction de la localité de ce nom. Nous ne sommes, d'ailleurs, pas éloignés de croire que, dans le texte d'Ibn Batoutah, il y a quelque chose d'omis. Dans cette hypothèse, il faudrait ainsi traduire : « 9° la porte d'Albédjâliçah, à l'extérieur de laquelle s'étend un des cimetières de Dihly. C'est un beau, etc. »
[52] Au lieu de « avec un bouclier », qui est la leçon de trois de nos mss., le ms. 910 porte « avec un manteau ».
[53] Ibn Batoutah paraît ici en contradiction avec Firichtah, d'après lequel Nasir eddîn, fils du sultan Ghiâth eddîn Balaban, était encore sur le trône du Bengale lorsque Toghlok Chah entreprit son expédition contre cette province. Voici en quels termes s'exprime l'historien persan : « Lorsque Toghlok Chah arriva à Tarhat, le sultan Nasir eddîn, fils de l'empereur Ghiâth eddîn Balaban, qui, grâce à ton caractère pacifique, avait conservé son fief sans aucun changement sous le règne des souverains Khildjys, et qui vivait retiré à Lacnaouty, n'étant pas assez fort pour lui résister, se soumit aux ordres du destin. Il vint trouver le sultan Toghlok à Tarhat, et lui offrit de nombreux présents... Toghlok Chah lui conféra un parasol, et le confirma dans la possession de Lacnaouty à titre de fief, comme auparavant. Il lui confia aussi la garde de Sonârgânou (Sounergong) et des districts du Bengale. » (Édition lithographiée, t I, p. 234; cf. Khondémir, t. III, fol. 109 v°).
[54] Ce Maç'oûd alghâzi, ou « le guerrier », était un membre de la famille du sultan Mahmoud, le Ghaznévide; et il périt l'an 557 (1162) dans une guerre contre les Hindous. (Cf. Firichtah, tome I, page 249.) Sâlâr 'Oud est encore nommé plus loin dans ce volume, et nous mettons alors, entre parenthèses, Maç’oud.
[55] Le mot paraît avoir ici, et surtout en un autre passage, qu'on trouvera consigné dans le quatrième volume de cet ouvrage, le sens de « parasol » ou « dais ». Chez les Africains, il signifie aussi « cabestan »; et dans l'idiome hindoustani, il désigne « un palanquin ».