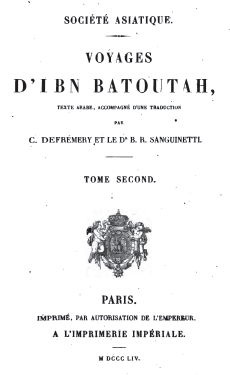
IBN BATOUTAH (رحلات ابن بطوطة)
VOYAGES - LIVRE II.
Traduction française : C. DEFREMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
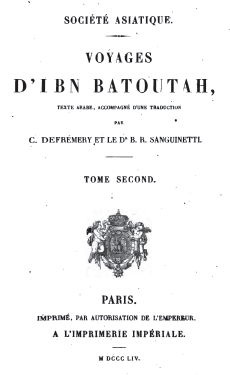
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SOCIÉTÉ ASIATIQUE.
VOYAGES
D'IBN BATOUTAH,
TEXTE ARABE, ACCOMPAGNÉ D'UNE TRADUCTION,
PAR
C. DEFREMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
TOME DEUXIEME.
(DEUXIÈME TIRAGE.)

PARIS.
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.
M DCCC LXXVII.
A la fin du tome premier de cette publication, nous avons laissé Ibn Batoutah sur le point de quitter la ville de Mechhed 'Aly, située dans le canton de Nedjef. Le présent volume commence par la description des célèbres' villes de Wâcith et de Bassora; puis il nous montre le voyageur s'embarquant sur le golfe Persique, pour passer dans les provinces méridionales de la Perse. La relation entre ici dans les détails les plus circonstanciés sur le Luristan, la partie sud de l'Irak persique et le Fars, ou Perse proprement dite. L'auteur entremêle au récit de ses courses des anecdotes historiques sur les princes du Luristan et de Chiraz. Cette portion de l'ouvrage offre un vif intérêt pour l'histoire orientale. On remarquera surtout un récit détaillé des tentatives que fit le sultan des Mongols de la Perse, Mohammed Khodhâbendeh (Oldjâïtoû), pour porter ses sujets à embrasser la doctrine des Chiites ou sectateurs d'Aly. Ibn Batoutah nous apprend quelle résistance opposèrent aux volontés du sultan les populations de Bagdad, de Chiraz et d'Ispahan. C'est un point d'autant plus digne d'attention, qu'il a échappé aux recherches du savant historien des Mongols, feu M. le baron d'Ohsson.[1] Mais la vérité nous ordonne de faire observer que, contrairement à ce que dit notre voyageur, l'émir Mahmoud chah Indjoû, qu'Ibn Batoutah appelle Mohammed, ne mourut pas sous le règne du sultan Abou Sa’id : il fut mis à mort par Arpâ khân, successeur de ce prince. (Voyez Mirkhond, t. V, manuscrit persan de la Bibliothèque impériale, fonds Gentil, n°55. fol. 118 recto; et cf. d'Ohsson, op. supra laud. t. IV, p. 721.)
Après avoir visité à Cazéroûn le mausolée du cheikh Abou Ishâk, notre auteur rentra dans l'Irak par la célèbre ville de Coûfah, d'où il se rendit à Hillah, située près de l'emplacement de Babylone, et dont toute la population était composée de sectateurs des douze imams; puis à Kerbela, où repose le corps du troisième imâm; enfin, il arriva à Bagdad, qui était alors la résidence d'un simple émir mongol. Cette ancienne capitale des khalifes arrête longtemps Ibn Batoutah; il en décrit complaisamment les collèges, les mosquées, les mausolées, les bains, et elle lui fournit le sujet d'une intéressante digression historique, consacrée au sultan des Mongols de la Perse alors régnant, Abou Sa’id Behadour khân. Ibn Batoutah quitte Bagdad avec le camp du sultan; puis il fait une excursion à Tabriz ou Tauris; mais ce double voyage, qui dura cependant vingt jours, ne lui a laissé d'autre souvenir que celui de l'ordre qui était observé par le souverain mongol dans ses marches et ses campements.
Le pèlerinage que notre auteur avait fait à la Mecque n'avait pas suffi à satisfaire l'active dévotion d'un aussi pieux musulman et d'un aussi infatigable voyageur : il résolut donc de retourner dans le Hedjaz; mais pour mettre à profit le temps qui devait encore s'écouler avant le départ de la caravane de Bagdad, il visita le Djézireh, le Diârbecr et la partie septentrionale de l'Irak. Son second pèlerinage terminé, Ibn Batoutah s'établit à la Mecque, dans le collège dit Mozafférien, afin de s'y livrer aux exercices de piété; il accomplit encore trois autres fois les cérémonies du pèlerinage, et quitta enfin la Mecque, après un séjour de trois ans, pour parcourir le Yémen. Il s'embarque à Djouddah (Djidda), sur le golfe Arabique ou mer Rouge. La tempête l'ayant forcé de relâcher dans un port appelé Râs Dawâïr (le cap des Tourbillons), situé sur le littoral africain, entre 'Aïdhâb et Sawâkin, il se rend, en l'espace de deux jours, dans cette dernière localité.
A Sawâkin, Ibn Batoutah reprend la mer, et après une traversée de six jours, il arrive au port de Hali, qu'il aurait peut-être dû distinguer de la ville du même nom, située à quelque distance dans l'intérieur des terres, et connue sous la dénomination de Hali Ibn Yakoub. Notre voyageur ne parle que de celle-ci. On pourrait lui reprocher encore une légère erreur (partagée, du reste, par Aboulféda[2]), en induisant de son récit qu'il regardait Sardjah ou Chardja comme un port de mer, tandis que, d'après Niebuhr, cette localité est assez éloignée du rivage.[3] On doit observer, toutefois, comme une atténuation de cette inexactitude, que, d'après des explorateurs récents, la mer ne cesserait pas de se retirer vers l'ouest, sur la côte du Téhamah ou partie maritime du Yémen.
Ibn Batoutah décrit avec complaisance la ville de Zebîd, une des principales places du Yémen ; il mentionne ensuite les villes de Djoblah et de Ta'izz, dont la dernière était alors la résidence du roi de cette contrée, et il consacre plusieurs pages à retracer le cérémonial suivi par ce souverain dans ses audiences. De Zebîd il se rend à Sanaa, l'ancienne capitale du Yémen, puis à Aden, dont le port était alors très fréquenté par les marchands indiens. C'est là qu'il s'embarqua pour la ville de Zeïla', située sur la côte de l'Abyssinie, et d'où il entreprit cette excursion à Makdachaou (Magadoxo), à Mombase et à Quiloa, dont nous avons déjà parlé dans la préface du premier volume.
A Quiloa, Ibn Batoutah s'embarque pour la ville de Zafar, à laquelle il attribue un surnom que nous n'avons rencontré dans aucun autre ouvrage, celui d'Alhoumoûdh (aux plantes amères). D'après notre auteur, Zafar était située à l'extrémité du Yémen. Mais c'est donner à cette province une trop grande extension du côté de l'est, et Zafar était, en réalité, placée dans la province de Mahrah, souvent comprise elle-même dans celle de Hadramaout. Ce qu'ajoute notre voyageur, touchant la distance de seize journées de marche qui séparait Zafar de Hadramaout, doit s'appliquer à la ville de Chibâm, encore actuellement capitale du Hadramaout, et qui, à ce titre, et d'après un usage très répandu dans les pays musulmans, a pu être désignée par le nom de cette province. Selon Ibn Batoutah, les habitants de Zafar nourrissaient leurs bêtes de somme et leurs brebis avec des sardines, lesquelles, en ce pays, sont extrêmement grasses. Edrisi dit de même[4] que la population du Mahrah donnait à manger aux bestiaux des poissons séchés au soleil.
On remarquera sans doute le long article consacré à Zafar par notre voyageur : Ibn Batoutah y passe successivement en revue les diverses productions de la contrée, telles que la banane, le bétel et le coco. Il s'étend surtout avec complaisance sur ce dernier fruit, et décrit les divers usages auxquels on l'employait. A Zafar, Ibn Batoutah reprend la mer sur un petit navire, appartenant à un individu originaire de l'île de Massîrah (Moseirah). Il touche d'abord à Hâcic, dans la baie de Khouriân et Mouriân, Curia Muria des anciens navigateurs. Cette portion du récit d'Ibn Batoutah doit être comparée avec la relation d'un marin anglais, le capitaine S. B. Haines, qui a récemment exploré les côtes sud et est de l'Arabie. Nous devons faire observer, toutefois, que notre auteur est cité d'une manière peu exacte dans ce passage de l'intéressant mémoire de M. Haines : « La population voisine de la mer (à Râs Nous, à la pointe sud-ouest de la baie de Curia Muria), est peu considérable; certainement sur cette partie de la côte nous ne trouvâmes qu'un petit nombre de malheureux, à moitié affamés, qui s'intitulent serviteurs de Nébi Saleh Ibn Houd, office auquel ils paraissent attacher une importance considérable, et dont ils sont très orgueilleux; leur pauvreté peut être expliquée par ce fait, qu'ils dépendent principalement, pour leur subsistance, de la générosité des voyageurs. Ce sont de misérables créatures, presque nues, et vivant dans des huttes basses, déforme circulaire, construites peu solidement en pierres, et couvertes d'herbes marines et de branches de petits ambres, dépouillées de leurs feuilles. Leurs huttes répondent exactement â la description qu'en a donnée Ibn Batoutah au xive siècle.[5] »
Après être resté un jour en vue de l'île de Massîrah, le navire à bord duquel était monté notre voyageur reprend sa marche et arrive à Sour, le premier port de l'Oman. De cette rade Ibn Batoutah se rend par terre à Kalhât, situé à quelques heures de distance. Ibn Batoutah ne fait commencer l'Oman qu'à six journées de marche de Kalhât ; mais on voit qu'il n'a voulu parler que du canton proprement appelé de ce nom. L'illustre géographe allemand Carl Ritter, qui n'a cependant connu ce chapitre de notre auteur que d'après la traduction du docteur Lee, faite sur un abrégé souvent fort sec, a hautement apprécié l'importance de ce morceau. « Ibn Batoutah, dit-il, est le seul, parmi les anciens géographes arabes, qui ait fourni, comme témoin oculaire, une relation de l'Oman. Les anciens auteurs ne disent presque rien de ce pays, ou bien ils n'ont laissé à ce sujet que des données insuffisantes.[6] »
Du temps de notre voyageur, Kalhât, ainsi que la majeure partie de l’Oman, était soumise au roi de Hormouz. Ce fait, attesté à deux reprises différentes par Ibn Batoutah, est confirmé par Marco Polo, qui s'exprime ainsi, à propos des habitants de Calatu ou Kalhât : « Il sunt sout Cormos e toutes les foies « que le Mélik de Cormose a ghere con autre ; plus puissant de lui, il s'en vient à ceste cité, parce que moût est fort et en fort leu, si que il ne doute puis de null.[7] »
De l'Oman, Ibn Batoutah part pour le royaume de Hormouz. Il visite l'île de ce nom, auparavant appelée Djéraoun; puis, passant sur le continent, il parcourt le désert du Lâristân, et arrive à Cawrestân, puis à Lâr, où régnait un sultan d'origine turcomane, à Khondjopâl, aussi appelée Hondjopâl, et enfin à Sîrâf, port de mer, autrefois très fréquenté par les navires de Bassora, de l'Inde et de la Chine, mais depuis délaissé pour les ports de Kîch et de Hormouz. Les pêcheries de perles du golfe Persique, les plus célèbres de tout l'Orient, étant situées près des îles Bahreïn, vis-à-vis de Sîrâf, notre auteur n'a garde d'oublier de les décrire. Mais il tombe dans une exagération palpable, lorsqu'il nous assure que, parmi les plongeurs, il s'en trouvait qui pouvaient rester sous l'eau durant plus de deux heures. Il paraît, d'après le témoignage de voyageurs dignes de foi, que la durée du temps pendant lequel les pêcheurs de perles du golfe Persique demeurent sous l'eau, n'excède pas soixante et dix à cent secondes. Tout au plus pourrait-on le porter à cinq minutes, avec M. Morier.
De Sîrâf, Ibn Batoutah passe à Bahreïn, sur la côte d'Arabie; il se rend ensuite à Alkathîf, à Hedjer, appelé aussi Alhaça, et enfin à la ville de Hadjr, dont il fait, ainsi que le célèbre géographe Yakout,[8] la capitale du Yemâmah. Il accompagna l'émir de cette dernière ville à la Mecque, et après avoir accompli de nouveau les cérémonies du pèlerinage, il va s'embarquer à Djouddah pour 'Aïdhâb. Mais la tempête l'ayant derechef poussé vers le port de Râs Dawâïr, il part de cet endroit, par la voie de terre, avec des Bodjâh (les Ababdeh actuels, les Blemmyes de l'antiquité), et après une marche de neuf jours, il arrive à 'Aïdhab. De cette ville il se rend au Caire, d'où il repart pour la Syrie par le chemin de Bilbeïs, et il revoit Hébron, Jérusalem, Acre, Tripoli, Djabala et Lâdhikiyah. Il s'embarque en ce dernier port sur un grand vaisseau appartenant à des Génois, et qui le dépose à 'Alâïa, sur la côte méridionale de l'Asie Mineure.
Notre dessein n'est pas de nous étendre ici sur la partie de cette relation consacrée à l'Asie Mineure; nous en avons déjà dit quelques mots dans la préface du premier volume, en faisant remarquer combien les assertions d'Ibn Batoutah s'accordent avec celles de deux géographes et historiens arabes, ses contemporains. Mais le chapitre de notre voyageur relatif à la péninsule anatolique, offre un genre d'intérêt tout particulier, et que nous devons au moins signaler brièvement : c'est de donner un tableau détaillé et à peu près complet des nombreuses principautés, fort inégales en étendue et en puissance, qui se partagèrent les débris de l'empire des Seldjoukides d'Iconium. De ces divers états, les uns s'agrandissent aux dépens des empereurs grecs de Constantinople, les autres aux dépens des sultans mongols de la Perse, contre lesquels ils cherchent un appui dans les mamlouks de l'Egypte. L'autorité des uns se trouve bornée à quelques villes ou forteresses, et ne se soutient que par la piraterie et la rapine ; la puissance des autres s'étend sur des provinces entières, et leur capitale lutte de splendeur et de richesse avec celle des souverains du Caire. Au milieu de toutes ces principautés, on en remarque une, qui, extrêmement faible à son début, ne tarde pas à se fortifier par quelques succès remportés sur les Grecs, et qui, absorbant successivement tous les états rivaux, finit par franchir les bornes de l'Asie Mineure et par donner des lois au Bosphore, au Danube et à la mer Egée.
Après avoir parcouru l'Asie Mineure presque dans tous les sens, notre voyageur s'embarque sur la mer Noire, à Sinope, pour passer dans la Russie méridionale, alors désignée sous le nom de Kiptchak, et soumise a une dynastie issue du fils aîné de Gengis Khân. Le chapitre d'Ibn Batoutah qui traite de cette vaste contrée offre une foule de particularités curieuses, relatives aux villes de Caffa, de Mâdjar, de Séraï, etc.; au commerce d'exportation des chevaux du Kiptchak dans l'Inde; à la grande considération que les Mongols, depuis le khân jusqu'au plus petit marchand, témoignaient à leurs femmes; au cérémonial de la cour du khân, aux khatoun (princesses); aux aliments et aux boissons en usage chez les Mongols. Ces derniers avaient conservé, dans un pays si éloigné de leur terre natale, les habitudes errantes de leurs ancêtres. Lorsque Ibn Batoutah nous décrit l'aspect d'un camp tartare en mouvement, ou, comme il l'appelle, d'une grande ville qui se meut avec sa population, ses mosquées et ses marchés, l'on se rappelle aussitôt les beaux vers qu'Horace a consacrés aux anciens habitants des mêmes régions :
Campestres melius Scythae,
Quorum plaustra vagas rite trahunt domos,
Vivunt.
Le prince qui régnait sur le Kiptchak, à l'époque du voyage d'Ibn Batoutah, avait épousé, selon celui-ci, une fille de l'empereur de Constantinople. L'histoire byzantine et les histoires des Mongols de la Perse, du Kiptchak, de même que des premiers sultans ottomans, offrent plus d'un exemple d'alliances de ce genre. C'est ainsi qu'en l'année 1265, Abaka, khân des Mongols de la Perse, épousa une fille naturelle de Michel Paléologue, nommée Marie, laquelle avait auparavant été promise à Houlagou, père d'Abaka.[9] Dans l'année 1304 l'empereur Andronic Paléologue, le vieux, offrit à Ghazan la main d'une jeune princesse, qui passait à Constantinople pour sa fille naturelle,[10] espérant par là se faire de ce prince un appui contre les Turcs de l'Asie Mineure. Il y a plus : Marie, sœur germaine du même empereur, fut mariée, dans l'année 1308, à Mohammed Khodhâbendeh, frère et successeur de Ghazan ; et cette princesse fut appelée, chez les Mongols, Tespina (de δέσποινα, maîtresse) khatoun, et reçut le yort ou apanage qu'avait eu la précédente Tespina, épouse d'Abaka.[11] Une autre Marie, fille naturelle d'Andronic, épousa peu de temps après Toghtagou ou Toûktâ, khân des Mongols du Kiptchak et prédécesseur d'Uzbek khân.[12]
D'après le continuateur de Lebeau « les empereurs s'étaient mis dans l'usage d'élever dans leurs palais de jeunes filles distinguées par leur beauté, mais pour la plupart d'une naissance obscure. C'était, pour ainsi dire, de cet arsenal que ces princes tiraient les armes dont ils se servaient avec le plus de succès contre les Tartares. Quelques-unes de ces filles offertes en mariage à leurs chefs, qui les prenaient toutes pour des princesses, devenaient souvent le prix de la paix.[13] » Quoi qu'il en soit de la réalité des liens qui unissaient la femme grecque d'Uzbek khân à la famille impériale de Byzance, cette princesse, étant devenue enceinte, obtînt de son époux la permission de se rendre à Constantinople pour y faire ses couches, et notre auteur fut autorisé à l'accompagner. La relation du voyage d'Ibn Batoutah à Constantinople, morceau qui termine presque le présent volume, offre de sérieuses difficultés. Ce voyage doit avoir eu lieu vers la fin de l'année 734 de l'hégire, c'est-à-dire vers le mois d'août 1334. En effet, Ibn Batoutah atteste qu'il accomplit, pour la cinquième fois, les cérémonies du pèlerinage à la Mecque dans l'année 732 (1332), et il fournit un synchronisme irréfragable, en ajoutant que, dans cette même année, le sultan Almélic Annâcir fit pour la dernière fois le pèlerinage.[14] On voit, par deux endroits de la relation de l'Asie Mineure, que l'auteur se trouvait en cette contrée dans les mois-de ramadhan et de dhou’lhidjdjeh de l'année suivante. Enfin, nous savons qu'à la fin du mois de ramadhan 734 (mai 1334), il était dans le camp du sultan Uzbek, et qu'il partit pour Constantinople le 10 de chawwâl (14 juin 1336). Cependant, au commencement de la seconde partie de sa relation, Ibn Batoutah dit positivement (ms. 910, fol. 81 v°) qu'il arriva près du fleuve Sind le premier jour du mois de moharrem 734 (12 septembre 1333). Cela est de toute impossibilité, puisque, sans parler des dates qui contredisent cette dernière, on ne saurait admettre qu'une seule année eût suffi au voyageur pour traverser de nouveau l'Egypte et la Syrie, explorer l'Asie Mineure, le Kiptchak, Constantinople, la Transoxiane, le Khoraçan et l'Afghanistan. D'un autre côté, les détails qu'Ibn Batoutah nous donne sur le prince grec qu'il appelle le roi George (Djirdjîs), et qu'il représente comme ayant abdiqué le trône, en faveur de son fils, pour se retirer dans un monastère, ne peuvent s'appliquer, avec quelque vraisemblance, qu'à Andronic II Paléologue. Et l'on sait que ce prince, qui avait adopté comme nom de religion celui d'Antoine,[15] mourut dans la nuit du 12 au 13 février 1332.[16]
Nous n'avons pas la prétention de résoudre cette difficulté chronologique, mais nous devions au moins la signaler. Nous n'essayerons pas davantage de discuter tous les points de la relation du voyage d'Ibn Batoutah à Constantinople qui peuvent donner matière à des rectifications ou à des commentaires; cela nous entraînerait bien au delà des limites qui nous sont assignées, et nous ferait sortir de notre simple rôle d'éditeurs et de traducteurs. C'est aux savants qui ont fait de l'histoire et de la géographie byzantines une étude particulière, qu'il appartient d'éclaircir et de corriger ce que renferme d'obscur ou d'inexact cette portion du récit d'Ibn Batoutah. Il est bien démontré pour nous que le voyageur de Tanger a réellement visité Constantinople ; mais ou sa mémoire l'a trahi, ou il a cru trop facilement les détails qui lui étaient donnés par des interprètes ignorants ou de mauvaise foi. C'est ainsi seulement que l'on peut s'expliquer ce qu'il nous raconte des prétendues visites que le pape aurait faites chaque année à l'église de Sainte-Sophie, et des honneurs que ce pontife aurait reçus de l'empereur A son arrivée, et durant tout le temps de son séjour.
Le chapitre consacré par Ibn Batoutah à la description de Constantinople nous présente un fait très singulier pour quiconque connaît l'esprit d'intolérance dont se piquent les musulmans rigides : nulle part l'auteur n'y laisse percer le moindre sentiment d'animosité contre les chrétiens. Il justifie ainsi l'éloge qu'un écrivain de mérite lui accordait récemment, d'être à la vérité un sunnite sévère, mais de ne pas éprouver de haine religieuse bien violente.[17] Il est toutefois un passage de ce volume qui pourrait contredire cette opinion favorable, touchant l'esprit de tolérance de notre auteur. C'est celui où il raconte si complaisamment la conduite injurieuse, autant que ridicule, qu'il tint envers le médecin juif du sultan de Birgui ou Birgheh. Mais il ne faut pas perdre de vue, d'abord, que ce médecin avait osé s'asseoir au-dessus des lecteurs du Coran, et ensuite que notre auteur était originaire d'un pays où les juifs ont toujours été, et sont encore actuellement traités d'une manière plus vexatoire et plus outrageante que partout ailleurs. Qu'il nous suffise de rappeler les persécutions et les humiliations auxquelles ils furent exposés dans l'empire de Maroc, sous les Almohades et les Mérinides,[18] et les avanies dont ils sont encore journellement abreuvés au Maroc. A Tétuan, ville où la communauté juive forme le tiers ou le quart de la population, elle est reléguée dans un quartier dont les portes sont fermées chaque soir, et dont les gardiens sont musulmans. Elle est obligée de fournir gratuitement tout ce dont le pacha a besoin pour sa maison. Enfin, les juifs sont tenus d'ôter leurs souliers pour passer devant une mosquée, devant un marabout, ou pour entier dans la cour de justice appelée michouer.[19]
Nous n'avons pas essayé de dissimuler les objections de détail que l'on pourrait élever contre quelques-unes des assertions de notre auteur contenues dans ce volume. Mais nous persistons à croire, avec des juges plus autorisés que nous,[20] à la bonne foi et à la sincérité d'Ibn Batoutah. Nous pensons enfin qu'aucun lecteur éclairé n'hésitera à répéter, en l'appliquant à notre voyageur, l'éloge que le savant Beckmann accordait jadis à un voyageur italien du xve siècle :
« Les historiens trouveront certainement dans cette relation quelques grains d'or pur qui n'ont pas encore été triés, et beaucoup de détails propres à répandre du jour sur la géographie et l'histoire du moyen âge.[21] »
Lorsque nous eûmes accompli la visite (du sépulcre) du prince des croyants, Aly, sur qui soit le salut! la caravane partit pour Bagdad, et moi je me dirigeai vers Basrah (Bassora), en compagnie d'une troupe nombreuse d'Arabes khafâdjah. Ce sont les habitants de ces contrées, ils ont une grande puissance et une bravoure considérable, et il n'y a pas moyen de voyager dans ce pays, si ce n'est avec eux. Je louai un chameau par l'intermédiaire du chef de cette caravane, Châmir, fils de Darrâdj alkhafâdjy. Nous sortîmes de Mechhed Aly, et campâmes ensuite à Khawarnak : c'est le lieu où résidèrent Anno'mân, fils d'Almondhir, et ses pères, les rois, fils de Ma-essamâ (eau du ciel) : Il est habité, et l'on y voit des restes de coupoles immenses, dans une vaste plaine, et sur un canal qui sort de l'Euphrate. Après être partis de cet endroit, nous fîmes halte dans un lieu appelé l'Édifice de Wâthik. Il contient des vestiges d'une bourgade détruite, et d'une mosquée ruinée, dont il ne reste plus que le minaret. Nous quittâmes ce lieu et marchâmes, le long de l'Euphrate, dans une région connue sous le nom d'Idhâr. C’est une forêt de roseaux entourée d'eau, et qui est habitée par des Arabes connus par leurs excès. Ce sont des brigands de la secte d'Aly ; ils attaquèrent une troupe de fakirs qui étaient restés en arrière de notre caravane, les dépouillèrent même de leurs sandales, et leur prirent jusqu'à leurs coupes pour boire. Ils se fortifient dans ce marécage, et s'y défendent contre ceux qui les poursuivent. Il y a là beaucoup de bêtes féroces. Nous fîmes trois étapes par cette contrée appelée Idhâr, et nous arrivâmes à la ville de Wâcith.
Elle est fort belle et possède beaucoup de vergers et d'arbres; elle renferme des hommes illustres, dont la présence est une source de biens, et les lieux où ils se rassemblent offrent un sujet de méditation. Ses habitants sont d'entre les meilleurs de l'Irak : je me trompe, ils sont absolument les meilleurs. La plupart savent par cœur le noble Coran, et le lisent parfaitement, avec une méthode correcte. C'est ici que se rendent ceux de l'Irak qui veulent apprendre cette doctrine; et dans la caravane avec laquelle nous arrivâmes, il y avait une troupe de personnes qui venaient pour apprendre à bien lire le Coran, sous les cheikhs de Wâcith. Dans cette ville, il y a un magnifique collège, toujours plein, où sont environ trois cents cellules, qu'occupent les étrangers qui y viennent pour s'instruire dans le Coran. Il a été construit par le docteur Taky eddîn, fils d'Abd almohsin Alwâcithy, qui est un des principaux habitants de la ville et un de ses jurisconsultes. Il donne à chaque disciple un habillement complet tous les ans, il pourvoit aussi à sa dépense journalière, et il siège lui-même, ainsi que ses frères et ses camarades, dans ce collège, pour enseigner le Coran. Je l'ai vu, il m'a donné l'hospitalité, et m'a fourni une provision de dattes pour la route, et une somme d'argent.
Quand nous fûmes arrivés à la ville de Wâcith, la caravane resta trois jours en dehors de la ville pour trafiquer. Il me vint à l'esprit de faire un pèlerinage au tombeau du saint Abou’l’abbâs Ahmed arrifâ'iy, qui se trouve dans un bourg appelé Oumm 'Obéidah, à la distance d'une journée de Wâcith. Je demandai au cheikh Taky eddîn d'envoyer quelqu'un pour m'y conduire. Il fit donc partir avec moi trois Arabes des Bènou Asad, qui sont les habitants de cette contrée, et il me donna pour monture un de ses chevaux. Je partis sur le midi, et je passai cette nuit-là dans un enclos des Bènou Asad. Nous arrivâmes, vers le milieu du second jour, au Riwâk (portique, palais, etc.), qui est un grand monastère où se trouvent des milliers de fakirs. Nous vîmes que le cheikh Ahmed Coûdjec (le petit Ahmed) venait d'y arriver; il est le petit-fils de l'ami de Dieu, Abou’l’abbâs arrifâ'iy, que nous allions visiter, et il avait quitté le lieu de sa résidence, dans l'Asie Mineure, pour (aire un pèlerinage au sépulcre de son aïeul. C'est à lui qu'était échue la dignité de supérieur du Riwâk. Après la prière de trois heures, on battit les timbales, ainsi que les tambours de basque, et ces pauvres moines se mirent à danser. Plus tard, ils firent la prière du coucher du soleil, et apportèrent ensuite le repas, qui consiste en pain de.riz, en poisson, en lait et en dattes. Tous mangèrent, après quoi ils firent la dernière prière du soir, et se mirent à chanter les louanges de Dieu, tandis que le cheikh Ahmed était assis sur le tapis à prier de son aïeul susmentionné. Ensuite ils se livrèrent à l'exercice de la danse, avec accompagnement de musique. Ils avaient préparé des charges de bois qu'ils allumèrent, puis ils entrèrent, en dansant, au milieu du feu. Quelques-uns d'entre eux s'y roulaient; d'autres en mettaient dans leur bouche, jusqu'à ce que le brasier fût complètement éteint. Telle est leur coutume, et c'est par là que cette corporation ahmédite se distingue particulièrement. Il y en a parmi eux qui prennent un grand serpent, et lui mordent la tête à belles dents, jusqu'à ce qu'ils la coupent.
J'étais une fois dans un lieu appelé Afkânboûr, dans le district de Hazâr amrouhâ, qui se trouve à la distance de cinq journées de marche de Dihly, métropole de l'Inde. Nous campâmes près d'un fleuve nommé Nahr asseroûr (selon un manuscrit, assehrou) ; et cela se passait à l'époque du checâl (berchecâl ?), mot qui, chez ces peuples, veut dire pluie. Celle-ci tombe au commencement de l'été; et le torrent descendait des montagnes Karâdjîl dans le susdit fleuve. Tout être qui boit de son eau, homme ou bête, meurt, à cause que la pluie tombe sur des herbes vénéneuses. Or nous restâmes quatre jours près de ce fleuve, et personne ne s'en approcha. Une troupe de fakirs vinrent me trouver dans ce lieu ; ils portaient des colliers et des bracelets de fer, et ils avaient pour chef un nègre dont le teint était très foncé. Ils faisaient partie de la corporation des Haïdarites, et ils passèrent une nuit avec nous. Leur supérieur me demanda du bois, afin de l'allumer pendant leur danse, et j'ordonnai au gouverneur de la contrée de leur en fournir. C'était Aziz, connu sous le nom d'Alkhammâr (marchand de vin), que nous mentionnerons plus loin. Il en envoya environ dix charges, auxquelles les religieux mirent le feu, après la dernière prière du soir. Quand le bois fut converti en charbons ardents, ils se mirent à danser avec accompagnement de musique; ils entrèrent dans le feu en dansant, et ils s'y roulèrent. Leur chef vint me demander une tunique, et je lui en donnai une très fine. Il s'en revêtit, se roula dans le feu, et frappa la braise avec ses manches, jusqu'à ce que le feu cessât de flamber et s'éteignît. Il m'apporta alors la tunique, sur laquelle la flamme n'avait laissé absolument aucune trace, et j'en fus bien émerveillé.
Lorsque j'eus visité le cheikh Abou’l’abbâs arrifâ'iy (que Dieu nous soit en aide par son intermédiaire !), je retournai à la ville de Wâcith, et je vis que la caravane dont je faisais partie s'était déjà mise en route ; je l'atteignis en chemin, et nous campâmes près d'un dépôt d'eau appelé Hadhîb.
Plus loin, nous fîmes halte à la vallée de Kora' (ou des chevaux), où il n'y a point d'eau, et, après cela, à un lieu nommé Almochaïreb (le petit abreuvoir). Nous partîmes de ce lieu et descendîmes dans les environs de Basrah; enfin, ayant repris notre marche, nous entrâmes, pendant la matinée, dans la ville de Basrah.
Nous nous logeâmes dans le couvent de Malik, fils de Dinar. J'avais aperçu, en approchant, à la distance de deux milles environ de la ville, un édifice élevé, semblable à un château fort Je demandai ce que c'était, et on me répondit que c'était la mosquée d'Aly, fils d'Abou Thâlib. Ainsi, Basrah occupait anciennement une si vaste enceinte et couvrait un si grand espace, que cette mosquée était au milieu; tandis qu'à présent il y a deux milles entre elle et la ville. Il y a aussi deux milles entre cette mosquée et l'ancienne muraille qui entourait Basrah; de sorte que la mosquée se trouve à mi-chemin entre la ville et la muraille. Basrah est une des principales villes de l'Irak, et célèbre en tout pays; elle occupe un vaste terrain; elle possède des avenues admirables, beaucoup de vergers et des fruits excellents. Sa part de beauté et d'abondance a été grande, car c'est le lieu de réunion de deux mers, l'une d'eau salée, et l'autre d'eau douce. Il n'y a pas dans le monde entier de lieu plus riche en palmiers que cette ville. Les dattes se vendent, dans son marché, à raison d'un dirhem les quatorze livres de l'Irak; et le dirhem du pays équivaut au tiers de la petite pièce d'argent appelée nokrah. Le kadi de Basrah, Hoddjat eddîn, m'envoya un panier de dattes qu'un homme avait de la peine à porter. Je voulus les vendre, et j'en retirai neuf dirhems. Le portefaix en prit trois, comme salaire du transport de la corbeille depuis mon logis jusqu'au marché. On fait à Basrah, avec les dattes, un miel qu'on appelle saïlân (découlement) ; il est excellent et a le goût du sirop. La ville est composée de trois quartiers : 1° celui de Hodhaïl, dont le chef est le cheikh illustre Alâ eddîn, fils d'Alathir, un des hommes généreux et distingués. Il me donna l'hospitalité, et m'envoya des vêtements et de l'argent. 2° Le quartier des Bènou Harim, qui a pour chef le seigneur, le chérif, Madjd eddîn Mouça alhaçany, possesseur de vertus et de qualités généreuses. Il me traita, et m'envoya des dattes, du saïlân et de l'argent. 3° Celui des Persans, dont le chef est Djémal eddîn, fils d'Alloûky.
Les habitants de Basrah sont doués d'un caractère généreux ; ils montrent de la familiarité aux étrangers et leur rendent ce qui leur est dû; de sorte qu'aucun étranger ne s'ennuie au milieu d'eux. Ils font la prière du vendredi dans la mosquée du prince des croyants, Aly, que j'ai déjà mentionnée. On la ferme après cela, pour n'y revenir que le vendredi suivant. C'est une des plus belles mosquées qui existent ; sa cour est très vaste et pavée avec des cailloux rouges, qu'on apporte de la Vallée des bêtes féroces (ou lions, assibâ). On y conserve le noble exemplaire du Coran où Othman lisait lorsqu'il fut assassiné. La décomposition du sang a laissé une marque dans la page où se trouvent ces paroles divines : « Or, Dieu te suffira (ô Mahomet) contre eux (les juifs et les chrétiens); il entend et sait tout. » (Coran, ii, 131.)
J'assistai une fois, dans cette mosquée, à la prière du vendredi ; et lorsque te prédicateur se leva et se mit à réciter le sermon, il fit des fautes nombreuses et évidentes. Cela me surprit, et j'en parlai au kadi Hoddjat eddîn. Il me répondit : « Dans cette ville, il ne reste plus personne qui ait quelque connaissance de la grammaire. » C'est un enseignement pour quiconque réfléchit là-dessus, et louons Dieu, qui change les choses et retourne la face des affaires! En effet, cette ville de Basrah, dont les habitants avaient obtenu la prééminence dans la grammaire, laquelle y a pris son origine et y a reçu ses développements; cette ville, qui a donné le jour au chef de cette science, à celui dont personne ne conteste la primauté; cette ville, dis-je, n'a plus un prédicateur qui prononce le sermon du vendredi d'après les règles de la grammaire !
Cette mosquée a sept minarets, dont l'un s'agite, suivant l'opinion des habitants, quand on invoque Aly, fils d'Abou Thâlib. J'y montai du haut de la terrasse de la mosquée, et un individu de Basrah m'accompagna. Je vis à un de ses angles une poignée de bois, clouée dans la tour, et ressemblant au manche de l'instrument à lisser (ou lissoir) du maçon. Celui qui était avec moi mit sa main sur elle et dit : « Par la tête du prince des croyants Aly, agite-toi (ô tour) ! » Il secoua la poignée, et le minaret s'agita. Je plaçai, à mon tour, la main sur elle, et je dis à cet individu : « Et moi je dirai : Par la tête d'Abou Bekr, successeur de l'envoyé de Dieu, agite-toi! » Je secouai la poignée, et la tour s'agita : on fut étonné de cela. Les habitants de Basrah suivent la doctrine de la tradition et des musulmans orthodoxes; et celui qui ferait chez eux ce que j'ai fait n'aurait rien à craindre. Mais la chose ne se passerait pas ainsi à Mechhed Aly, à Mechhed Alhoçaïn, à Hillah, à Bahreïn, Koumm, Kâchân, Sâwah, Âwah et Thous: celui qui ferait ce que j'ai fait à Basrah serait perdu, car les habitants de ces lieux sont des hérétiques outrés.
Ibn Djozay dit : « J'ai vu, dans la ville de Berchânah (Purchena), dans la vallée Almansoûrah, en Espagne, que Dieu la garde! une tour qui s'agite sans que l'on nomme aucun des califes ni autres. C'est le minaret de la mosquée principale de la ville, et sa construction n'est point ancienne; elle est, pour ainsi dire, la plus belle tour que tu puisses voir, par la beauté de sa forme, la justesse de ses proportions et sa hauteur; elle ne penche d'aucun côté, et ne dévie pas de la ligne perpendiculaire. Je montai une fois sur cette tour, en compagnie d'un certain nombre de personnes, dont quelques-unes saisirent les divers côtés de sa corniche et la secouèrent : la tour s'agita. Gela continua jusqu'à ce que je leur eusse fait signe de cesser. Mais revenons au récit. »
On y remarque : 1° le mausolée de Thalhah, fils d'Obeïd Allah, un des dix premiers compagnons du Prophète. Il est situé dans l'intérieur de la ville, et surmonté d'un dôme; à son côté existe une mosquée, ainsi qu'une zaouïa, qui fournit à manger à tout venant. Les habitants de Basrah ont ce sépulcre en grande vénération, et il la mérite.
2° Celui de Zobaïr, fils d'Alawwâm, apôtre de l'envoyé de Dieu, et fils de sa tante paternelle. Il se trouve à l'extérieur de Basrah, et n'est pas surmonté d'une coupole; mais il contient une mosquée, et une zaouïa qui fournit la nourriture aux voyageurs.
3° Le tombeau de Halima, de la tribu de Sa'd, mère-nourrice de l'envoyé de Dieu. Près d'elle repose son fils, frère de lait du Prophète.
4° Le tombeau d'Abou Bekrah, compagnon de Mahomet ; il est surmonté d'une coupole.
5° Le tombeau d'Ânas, fils de Malik, serviteur de l'envoyé de Dieu. Il est à six milles de la ville, dans le voisinage de la vallée Assibâ'; et l'on ne peut le visiter, si ce n'est en nombreuse société, à cause de la multitude des bêtes féroces et de l'absence des créatures humaines.
6° Celui de Haçan, fils d'Abou’ Haçan albasry, chef de la génération qui a suivi immédiatement celle de Mahomet (Attâbi'oûn).
7° Celui de Mohammed, fils de Sîrin.
8° Celui de Mohammed, fils de Wâci'.
9° Celui d'Otbah, l'esclave.
10° Celui de Malik, fils de Dinar.
11° Celui de Habib, le Persan.
Et enfin : 13° celui de Sahl, fils d'Abd Allah, de Toster.
Sur chacun de ces tombeaux, il y a une pierre tumulaire, où se trouve gravé le nom de la personne qui y est renfermée, ainsi que la date de son décès. Tous (un seul excepté) se trouvent en dedans de l'ancienne muraille, et ils sont (la plupart) aujourd'hui à environ trois milles de la ville. En outre de ceux-ci, Basrah renferme les sépultures d'une grande quantité de compagnons du Prophète et de leurs successeurs immédiats, qui sont morts martyrs de la foi dans la journée du chameau (bataille dans laquelle Aïcha, montée sur un chameau, excitait au combat les ennemis d'Aly). Le commandant de Basrah, quand j'arrivai dans cette ville, était Rocn eddîn, le Persan, de Taurîz (Tibrîz). Il me traita en qualité d'hôte, et fut bienfaisant à mon égard. La ville de Basrah se trouve au bord de l'Euphrate et du Tigre réunis, et près de celle-ci le flux et le reflux des eaux se fait sentir, comme dans le fleuve de Salé (Séla), en Mauritanie (Maroc), etc. Le canal d'eau salée qui sort de la mer de Perse est à dix milles de la ville. Au moment du flux, l'eau salée l'emporte sur l'eau douce, et lors du reflux, le contraire arrive ; et comme les gens de Basrah prennent de cette eau pour leurs maisons, on dit que leur eau est saumâtre.
Ibn Djozay ajoute ici : « C'est à cause de cela que l'air de Basrah n'est pas bon, et que le teint de ses habitants est jaune, maladif. Ceci est passé en proverbe. En effet, un poète de mes amis, à qui je présentai un citron, composa ces vers : »
Ah! quel citron vois-je devant nous, qui montre bien la condition d'un être attristé!
Comme si Dieu avait revêtu du manteau de la maladie les libertins, ainsi que les habitants de Basrah.
Revenons au récit. Je m'embarquai près de Basrah pour Obollah, dans un somboûk, c'est-à-dire un petit bateau. Entre ces deux endroits, il y a la distance de dix milles, qu'on parcourt en vue de vergers qui se suivent les uns les autres, et de palmiers touffus, tant à droite qu'à gauche. Des marchands se tiennent à l'ombre des arbres, et vendent du pain, du poisson, des dattes, du lait et des fruits. Entre Basrah et Obollah se voit l'oratoire de Sahl, fils d'Abd Allah, de Toster. Lorsque ceux qui voyagent sur les navires se trouvent en face de cet endroit, ils boivent de l'eau puisée dans le fleuve, et font une prière, regardant comme une source de bénédiction l'hommage rendu à ce saint. Les marins s'enrichissent dans ce pays, et ce sont des gens droits.
Obollah était autrefois une grande ville, fréquentée par les trafiquants de l'Inde et de la Perse; mais elle a été détruite, et elle n'est plus maintenant qu'un bourg, où se voient des vestiges de châteaux, etc. qui annoncent son ancienne splendeur. Nous nous embarquâmes ensuite sur le golfe, qui sort de la mer de Perse,[22] dans un petit navire appartenant à un habitant d'Obollah, nommé Moghâmis. C'était après le coucher du soleil, et nous arrivâmes le matin à Abadan, qui est un gros village dans un terrain salin et inculte. Il possède beaucoup de mosquées, des oratoires et des couvents pour les hommes pieux. Entre Abadan et le rivage, il y a trois milles.
Ibn Djozay observe ici : « Abadan était anciennement une ville; mais le sol y est ingrat, et ne fournit pas de céréales. Celles-ci y sont importées; l'eau aussi y est en petite quantité. Un poète a dit à son égard : »
Qui fera savoir en Espagne, que je suis parvenu jusqu'à Abadan, à l'extrémité de la terre.
C'est le lieu le plus désolé que j'aie vu ; mais j'y cherchais ce qu'on mentionne (ou quelque chose à mentionner) à son sujet, parmi les gens.
Le pain est un cadeau que les habitants d'Abadan se font mutuellement, et la mesure d'eau s'y achète.
Revenons, à la relation du voyage. Sur le rivage de la mer, aux environs d'Abadan, se trouve un ermitage attribué à Khidhr et à Élie, sur lesquels soit le salut ! et vis-à-vis est une zaouïa qu'habitent quatre religieux, avec leurs enfants. Ils desservent ensemble l'ermitage et la zaouïa, et vivent des libéralités du public. Tous ceux qui passent par ce lieu leur font l'aumône. Les habitants de cette zaouïa m'informèrent de la présence à Abadan d'un dévot de grand mérite, vivant toujours seul. Il se rendait à ce rivage une fois par mois; il y péchait de quoi se nourrir pendant cet espace de temps, et on ne le voyait plus que le mois suivant. Il agissait ainsi depuis nombre d'années. Quand nous fûmes arrivés à Abadan, je n'eus d'autre soin que de le chercher. Mes camarades se mirent à prier dans les mosquées et les oratoires, et je partis à sa découverte. Je me rendis à une mosquée ruinée, et je l'y trouvai occupé à prier; je m'assis à son côté, et il abrégea sa prière. Quand il eut terminé, il me prit par la main et me dit : « Que Dieu te fasse obtenir ton désir dans ce monde et dans l'autre! » J'ai déjà obtenu, grâces au ciel, ce que je désirais ici-bas, qui était de parcourir la terre, et j'ai atteint, en cela, ce que nul autre n'a atteint, du moins à ma connaissance. Reste l'autre vie; mais l'espoir est grand dans la miséricorde de Dieu, dans son pardon, et dans la réalisation des vœux formés pour l'entrée dans le paradis.
Quand j'eus rejoint mes compagnons, je les instruisis de ce qui s'était passé avec ce personnage, et je leur indiquai le lieu où il était. Ils s'en allèrent vers lui, mais ne le trouvèrent point, et ne purent en avoir la moindre nouvelle; ils furent très étonnés de sa conduite. Nous retournâmes au soir à la zaouïa, et nous y passâmes la nuit. Un des quatre religieux entra chez nous, après la dernière prière du soir ; il avait l'habitude d'aller à Abadan tous les soirs, pour allumer les lampes dans les mosquées, et revenait ensuite à sa zaouïa. Il avait rencontré ce soir-là, à Abadan, le pieux personnage en question, qui lui avait donné un poisson frais, en disant : « Remets-le à l'hôte arrivé aujourd'hui. » Le religieux nous dit donc en entrant : « Qui, parmi vous, a vu le cheikh aujourd'hui ? » Je répondis : « Moi, je l'ai vu. » Il reprit : « Il te fait dire que ceci est pour ton repas d'hospitalité. » Je remerciai Dieu de cela. Le religieux nous fit cuire ce poisson, dont nous mangeâmes tous, et je n'en ai jamais goûté de meilleur. Il me vint dans la pensée de m'attacher, pour le restant de mes jours, au service de ce cheikh ; mais mon esprit obstiné (à voyager) me détourna de cette détermination.
Ensuite nous nous embarquâmes sur la mer dès l'aurore, dans l'intention de nous rendre à la ville de Mâtchoûl. Parmi les coutumes que j'ai adoptées dans mes voyages, est celle de ne pas revenir, autant que possible, par un chemin que j'ai déjà suivi. Or je désirais aller à Baghdâd, dans l'Irak. Un habitant de Basrah me conseilla de me mettre en route pour le pays des Loûrs, puis pour l'Irak al'adjem, et enfin pour l'Irak al'arab. J'agis d'après son conseil. Nous arrivâmes, au bout de quatre jours, dans la ville de Mâtchoûl (Machôur), place peu considérable, située sur le rivage de ce golfe (le golfe Persique), qui, comme nous l'avons dit plus haut, est formé par la mer de Perse (ou Océan indien). Le territoire de Mâtchoûl est d'une nature saline, et ne produit ni arbres ni plantes. Cette ville possède un grand marché, parmi les plus grands qui existent. Je ne m'arrêtai à Mâtchoûl qu'un seul jour; puis je louai une monture à ces individus qui transportent des grains de Râmiz à Mâtchoûl. Nous marchâmes, durant trois jours, dans une plaine habitée par des Kurdes, qui logent sous des tentes de crin; et l'on dit que ces Kurdes tirent leur origine des Arabes. Nous arrivâmes ensuite à la ville de Râmiz (Ram-Hormouz), qui est une belle cité, fertile en fruits et baignée par des rivières. Nous y logeâmes chez le kadi Hoçâm eddîn Mahmoud. Je rencontrai auprès de lui un homme savant, pieux et vertueux. Il était d'origine indienne; on l'appelait Béhâ eddîn, et son nom était Ismâ’îl. Il descendait du cheikh Béhâ eddîn Abou Zaccaria almoltâny, et avait étudié sous les cheikhs de Tibriz et autres villes. Je séjournai dans la ville de Râmiz une seule nuit. Après en être partis, nous marchâmes, durant trois jours, dans une plaine où se trouvaient des villages habités par des Kurdes. Il y a dans chaque station un ermitage, où le voyageur trouve du pain, de la viande et des sucreries. Leurs sucreries sont faites de sirop de raisin mélangé avec de la farine et du beurre. Dans chaque ermitage, il y a un cheikh, un imâm, un muezzin, un serviteur pour les pauvres, et des esclaves des deux sexes, chargés de faire cuire les mets.
J'arrivai ensuite à la ville de Toster, située à l'extrémité de la partie plane des États de l'Atabek, et à la naissance des montagnes. C'est une ville grande, belle et florissante. On y voit de superbes vergers et des jardins incomparables. Cette cité se recommande par des qualités excellentes et par des marchés très fréquentés. Elle est de construction ancienne: Khalid, fils de Walid, en fit la conquête, et c'est la patrie de Sahl, fils d'Abd Allah. Le fleuve Bleu (Annahr alazrak, c'est-à-dire le Caroûn) fait le tour de Toster. C'est un fleuve admirable, extrêmement limpide et très froid pendant le temps des chaleurs. Je n'ai pas vu d'autre rivière dont les eaux soient aussi bleues, si ce n'est celle de Balakhchân (ou Gueuktcheh, la bleuâtre). Toster possède une porte destinée aux voyageurs (qui arrivent par terre).On l'appelle Derwâzeh Disboûl;[23] car derwâzeh, dans ce pays, est synonyme de bâb (porte, en arabe). Toster a d'autres portes qui conduisent au fleuve. Sur les deux rives de celui-ci se trouvent des vergers et des roues hydrauliques, et la rivière est profonde. A la porte des voyageurs, on a établi sur le Nahr alazrak un pont de bateaux, semblable à celui de Bagdad et à celui de Hillah. La remarque suivante appartient à Ibn Djozay : « C'est au sujet de ce fleuve qu'un poète a dit : »
Regarde le château d'eau de Toster, et admire la manière dont il réunit les eaux, afin d'arroser abondamment la contrée environnante.
Il ressemble au roi d'un peuple dont les tributs ont été recueillis, et qui les partage aussitôt entre ses soldats.
Les fruits abondent à Toster, et l'on s'y procure facilement toutes les commodités de la vie. Ses marchés n'ont pas leurs pareils en beauté.
A l'extérieur de Toster se trouve un mausolée vénéré, auquel les habitants de ces régions se rendent en pèlerinage, et envers lequel ils s'engagent par des vœux. On y voit un ermitage où résident plusieurs fakirs, qui prétendent que ce mausolée est celui de Zeïn el'âbidîn, Aly, fils de Hoceïn, fils d'Aly, fils d'Abou Thâlib. Je descendis, à Toster, dans la medréceh du cheikh, de l'imâm pieux et savant, Cherf eddîn Mouça, fils du cheikh pieux, du savant imâm Sadr eddîn Soleïman, de la postérité de Sahl, fils d'Abd Allah. Ce cheikh est doué de qualités généreuses et de grands mérites, réunissant à la fois la science, la piété, la vertu et la bienfaisance. Il possède une medréceh et un ermitage, dont les serviteurs sont quatre jeunes esclaves, qui appartiennent au cheikh : Sunbul, Câfoûr, Djewher et Soroûr. L'un d'eux est préposé à l'administration des legs pieux faits à l'ermitage. Le second s'occupe des dépenses nécessaires de chaque jour. Le troisième a dans ses attributions le service de la table dressée pour les arrivants, et c'est lui qui leur fait servir de la nourriture. Le quatrième a la surveillance des cuisiniers, des porteurs d'eau et des valets de chambre. Je séjournai près de ce cheikh pendant seize jours; je n'ai rien vu de plus surprenant que le bon ordre établi par lui, ni de table plus abondamment fournie que la sienne. On servait devant chaque convive ce qui aurait suffi à quatre personnes : du riz poivré et cuit dans le beurre, des poulets frits, du pain, de la viande et des sucreries.
Le cheikh est au nombre des hommes les plus beaux et les plus vertueux. Il prêche les fidèles après la prière du vendredi, dans la mosquée djâmi. Lorsque j'eus assisté aux réunions qu'il tint pour prêcher, les prédicateurs que j'avais vus auparavant dans le Hedjaz, la Syrie et l'Egypte, furent rabaissés à mes yeux : je n'ai point rencontré son pareil. Je me trouvais un jour auprès de lui dans un verger qui lui appartenait, sur le bord du fleuve. Les jurisconsultes et les grands de la ville étaient réunis en cet endroit, et les fakirs y étaient venus de tous les côtés. Il fit manger tout ce monde, puis il récita avec eux la prière de midi; il remplit l'office de khathîb et prêcha, après que les lecteurs du Coran eurent fait une lecture devant lui, avec des intonations qui arrachaient des larmes, et des modulations qui remuaient l'âme. Le cheikh prononça une khothba (discours) pleine de gravité et de dignité. Il y excella dans les diverses branches de la science, comme d'interpréter le Coran, de citer les hadiths (traditions) du Prophète, et de disserter sur leurs différentes significations.
Ensuite on lui jeta de toutes parts des morceaux de papier, car c'est la coutume des Persans d'écrire des questions sur des morceaux de papier, et de les jeter au prédicateur, qui y fait une réponse. Lorsqu'on lui eut lancé les billets, il les rassembla dans sa main et commença d'y répondre successivement, dans le style le plus remarquable et le plus beau. Sur ces entrefaites, le temps de la prière de l'asr arriva. Le cheikh la récita avec les assistants, qui s'en retournèrent après cela. Le salon de ce personnage fut, ce jour-là, un lieu sanctifié par la science, la prédication et les bénédictions ; les gens repentants s'y présentèrent à l'envi l'un de l'autre. Il prit d'eux des engagements, et coupa leurs cheveux sur le devant de la tête. Ces individus consistaient en quinze étudiants, qui étaient venus de Basrah pour cet objet, et en dix hommes du peuple de Toster.
Lorsque je fus entré dans cette ville, la fièvre me prit. Cette maladie attaque quiconque pénètre dans cette contrée durant la saison chaude, ainsi qu'à Damas et dans d'autres villes, abondantes en eau et en fruits. La fièvre atteignit aussi mes compagnons. Un cheikh d'entre eux, nommé Yahia alkhorâçâny, vint à mourir. Le cheikh (Cherf eddîn Mouça) se chargea de le faire inhumer, avec toutes les cérémonies nécessaires, et fit la prière sur son corps. Je laissai à Toster un de mes compagnons qui s'appelait Béhâ eddîn Alkhotény. Il mourut après mon départ. Pendant ma maladie, j'avais du dégoût pour les mets qui étaient préparés pour moi dans la medréceh du cheikh. Le fakîh Chems eddîn Assindy, un des étudiants de cette école, me cita un mets. Je désirai en manger, et, à cet effet, je remis au fakîh des dirhems (ou pièces d'argent). Il fit cuire pour moi ce plat dans le marché, il me l'apporta et j'en mangeai. Le cheikh, ayant appris cela, en fut mécontent, vint me voir et me dit : « Comment ! tu agis ainsi, et tu fais cuire des aliments dans le marché! Pourquoi n'as-tu pas ordonné aux khâdims de préparer ce que tu désirais? » Puis il les fit tous venir et leur dit : « Tout ce qu'il vous demandera en mets et en sucre, ou autres objets, apportez-le lui, et faites-lui cuire ce qu'il voudra. » Il leur fit à cet égard les recommandations les plus expresses.
Nous partîmes de Toster, et nous voyageâmes durant trois jours dans des montagnes élevées. A chaque station se trouvait un ermitage, ainsi qu'il a été dit précédemment. Nous arrivâmes à la ville d'Îdhedj, appelée aussi Mâl alémîr (propriété de l'émir). C'est la résidence du sultan, l'atabek. A mon arrivée dans cette ville, j'allai loger chez le cheikh des cheikhs, le savant, le vertueux Nour eddîn Alkermâny, à qui appartenait l'inspection sur tous les ermitages; or les Persans appellent ces édifices medréceh. Le sultan a pour lui de la considération et lui rend visite; les grands de l'État et les principaux de la capitale le visitent aussi matin et soir. Ce personnage me reçut avec honneur, me traita comme son hôte, et me logea dans un ermitage qui porte le nom d'Addînawéry, où je demeurai durant plusieurs jours. Mon arrivée eut lieu pendant l’été: nous faisions les prières de la nuit, puis nous dormions sur le toit (c'est-à-dire la terrasse), et nous descendions dans l'ermitage après le lever du soleil. Il y avait avec moi douze fakirs, parmi lesquels un imâm, deux lecteurs du Coran, fort habiles, et un khâdim ; nous observions l'ordre le plus parfait.
Le roi d'Îdhedj, à l'époque de mon entrée dans cette ville, était le sultan, l'atabek Afrâciâb (lisez : Nosret eddîn Ahmed, fils de Yousef chah. Car Afrâciâb ne monta sur le trône qu'en 1339; Ahmed mourut en 1332, après un règne de trente-huit ans), fils du sultan, atabek Ahmed. Atabek est chez eux un titre commun à tous les rois qui gouvernent cette contrée. Ce pays est appelé pays des Loûrs. Ce sultan en devint le souverain, après la mort de son frère l'atabek Yousef, qui avait succédé à son père l'atabek Ahmed. Ce dernier était un roi pieux. J'ai entendu raconter, par des habitants de ses Etats, dignes de confiance, qu'il fit construire dans son royaume quatre cent soixante ermitages : sur ce nombre, il y en avait quarante-quatre à Îdhedj. Il partagea les tributs de ses États en trois parties égales : la première était consacrée à l'entretien des ermitages et des medréceh; la seconde à la solde, des troupes; enfin, la troisième était destinée à ses dépenses et à celles de sa famille, de ses esclaves et de ses serviteurs. Il envoyait chaque année, sur ce dernier tiers, un présent au roi de l'Irak, et souvent il se rendait en personne auprès de lui. J'ai vu que les monuments de sa piété se trouvaient, pour la plupart, dans des montagnes élevées. Les chemins y ont été creusés dans les rochers, et les pierres les plus dures, et ils ont été tellement aplanis et élargis, que les bêtes de somme les gravissent avec leurs fardeaux. La longueur de ces montagnes est de dix-sept journées de marche, sur une largeur de dix journées. Elles sont élevées, contiguës les unes aux autres, et coupées par des rivières. Les arbres qui y croissent sont des chênes, avec la farine (les glands) desquels on fabrique du pain. A chaque station se trouve un ermitage, que l'on appelle medréceh. Lorsque le voyageur arrive à une de ces medréceh, on lui apporte une quantité suffisante de nourriture pour lui, et du fourrage pour sa monture, soit qu'il en fasse la demande ou qu'il ne la fasse pas. C'est la coutume chez eux que le serviteur de la medréceh vienne, qu'il compte les personnes qui y sont descendues, et qu'il donne à chacune deux pains ronds, de la viande et des sucreries; tout cela provenant des legs pieux faits par le sultan. Le sultan, l’atabek Ahmed, était un homme pieux et dévot, ainsi que nous l'avons mentionné; il revêtait sous ses habits, et immédiatement par-dessus sa peau, un vêtement de crin.
Le sultan, l'atabek Ahmed, alla une fois trouver le roi de l'Irak, Abou Sa’id. Quelqu'un des courtisans de ce prince lui dit : « L'atabek entre auprès de toi, couvert d'une cuirasse »; car il pensait que le vêtement de crin que l'atabek portait sous ses habits était une cuirasse. Afin de connaître la vérité du fait, Abou Sa’id ordonna à ses courtisans de s'assurer de cela, en feignant de la familiarité. L'atabek se présenta un jour devant lui. L'émir Djoûbân, le plus grand des émirs de l'Irak; l'émir Souweïtah (Sounataï), émir du Diâr-becr, et le cheikh Haçan, celui-là même qui est actuellement sultan de l'Irak, s'approchèrent de l'atabek et palpèrent ses vêtements, comme s'ils voulaient plaisanter et rire avec lui. Ils trouvèrent, sous ses habits, le vêtement de crin. Le sultan Abou Sa’id, l'ayant vu, s'avança vers l'atabek, l'embrassa, le fit asseoir à son côté et lui dit en turc : Sen âthâ, c'est-à-dire, « tu es mon père ». Il lui fit, en retour de son présent, un cadeau plusieurs fois aussi considérable, et lui remit un yarlîgh (diplôme) portant que ni le sultan, ni ses enfants, n'exigeraient dorénavant de l'atabek aucun présent. L'atabek mourut dans la même année. Son fils l'atabek Yousef régna dix ans, et fut remplacé par son frère Afrâcïâb. Lorsque je fus entré à Îdhedj, je voulus voir ce sultan ; mais cela ne me réussit pas, parce qu'il ne sortait que le vendredi, à cause de son assiduité à boire du vin. Il avait un fils unique, qui était son successeur désigné, et qui tomba malade sur ces entrefaites. Un certain soir, un de ses serviteurs vint me trouver, et m'interrogea touchant ma position. Je la lui fis connaître ; après quoi il se retira. Cet homme revint après la prière du coucher du soleil, apportant avec lui deux grands plats, dont l'un était rempli de mets et l'autre de fruits, et en outre, une bourse pleine de pièces d'argent. Il était accompagné de musiciens avec leurs instruments, et il leur dit : « Faites de la musique, afin que les fakirs dansent et qu'ils prient pour le fils du sultan. » Je lui dis : « Certes mes compagnons ne connaissent ni la musique ni la danse. » Nous fîmes des vœux en faveur du sultan et de son fils, et je partageai les dirhems entre les fakirs. Lorsque la moitié de la nuit fut écoulée, nous entendîmes des cris et des lamentations, car le susdit malade était mort.
Le lendemain matin, le cheikh de l'ermitage et quelques habitants de la ville entrèrent dans ma chambre, et me dirent : « Les grands de la ville, kadis, fakîhs, chérifs et émirs, se sont rendus au palais du sultan, pour lui adresser des compliments de condoléance, et il convient que tu y ailles dans leur compagnie ». Je refusai de faire cela; mais ils me pressèrent, et je ne pus me dispenser de partir. Je me mis donc en marche avec eux. Je trouvai le michwer (salle d'audience) du palais du sultan rempli d'hommes et d'enfants, soit esclaves, soit fils de princes, vizirs et soldats. Tous avaient revêtu des tapis grossiers de diverses couleurs, des housses de chevaux, et avaient couvert leur tête de poussière et de paille. Quelques-uns avaient même coupé leurs cheveux sur le devant de la tête. Ils étaient partagés en deux troupes; l'une placée à l'extrémité supérieure du michwer, et l'autre à son extrémité inférieure. Ces deux troupes s'avançaient l'une vers l'autre, chaque individu frappant sa poitrine avec ses mains et s'écriant (en persan) : Khondcârima, dont le sens est « mon seigneur ! » Je vis en cette circonstance quelque chose d'affreux, et un spectacle honteux, tel que je n'en ai pas vu de semblable.
Parmi les aventures surprenantes, est celle qui m'arriva ce jour-là. J'entrai dans la salle, et je vis les kadis, les khatibs et les chérifs appuyés contre les murs du michwer, qui était tout à fait plein. Les uns pleuraient, les autres faisaient semblant de pleurer, et quelques-uns tenaient leurs yeux fixés sur la terre. Ils avaient tous revêtu, par-dessus leurs habits, des vêtements de coton grossier et non blanchi ; ces derniers n'étaient pas convenablement cousus; leur envers était tourné à l'extérieur, et l'endroit, du côté de la peau. Sur la tête de chacun des assistants était un morceau de khirkah (froc de derviche) ou un voile noir. Telle est leur coutume, jusqu'à l'expiration des quarante jours qui suivent les funérailles, car cette époque est le terme du deuil chez eux. Le sultan envoie alors à tous ceux qui ont agi ainsi un vêtement complet.
Lorsque je vis tous les côtés du michwer remplis de monde, je regardai à droite et à gauche, cherchant un endroit où je pusse m'asseoir. J'aperçus une estrade, élevée d'un empan au-dessus de terre. A l'un de ses angles était assis un homme, qui se tenait séparé de tous les autres assistants; il était couvert d'un vêtement de laine, semblable au feutre que les gens peu aisés revêtent, dans ce pays-là, les jours de pluie ou de neige, et quand ils sont en voyage. Je m'avançai jusqu'auprès de lui. Mes compagnons se séparèrent de moi, lorsqu'ils virent que je m'approchais de cet individu, et témoignèrent l'étonnement que leur inspirait mon action. J'ignorais complètement ce qu'il était ; je montai sur l'estrade et je le saluai. Il me rendit mon salut, et se souleva de terre, comme s'il voulait se lever: on appelle cela, dans ce pays, nisf alkiyâm, c'est-à-dire, se lever à moitié. Je m'assis à l'angle opposé, puis je regardai les assistants; ils tenaient tous leurs regards fixés sur moi, ce dont je fus étonné. Je vis les fakîhs, les cheikhs et les chérifs adossés contre le mur, sous l'estrade. Un des kadis me fit signe de descendre à son côté. Je ne le fis pas; mais je soupçonnai alors que mon voisin était le sultan.
Au bout d'une heure, le cheikh des cheikhs, Nour eddîn Alkermâny, dont j'ai fait mention ci-dessus, arriva, monta sur l'estrade et salua cet homme. Celui-ci se leva à son approche; le cheikh s'assit entre lui et moi, et je sus alors que c'était le sultan. On apporta ensuite la bière entre des citronniers, des limoniers, des orangers, dont les rameaux étaient tout couverts de fruits. Les arbres étaient portés dans le cortège; la bière marchait ainsi, comme au milieu d'un verger, précédée de lanternes et de bougies, fixées à de longues lances. On fit la prière sur elle ; puis les assistants l'accompagnèrent au lieu de la sépulture des rois, situé dans un endroit nommé Hélâfihân, à quatre milles de la ville. Là se trouve un grand collège, que le fleuve traverse, et qui renferme une mosquée où l'on fait la prière du vendredi. A l'extérieur est un bain, et un grand verger entoure bette medréceh. On y prépare de la nourriture pour les voyageurs. Je ne pus accompagner le cortège au lieu de l'enterrement, à cause de la distance, et je retournai à la medréceh.
Quelques jours après, le sultan m'envoya son messager, qui m'avait apporté précédemment les mets de l'hospitalité, afin de m'inviter à l'aller trouver. Je me rendis, avec cet homme, à une porte nommée la porte du Cyprès (Bâb asserou); nous montâmes de nombreux degrés, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à un salon où il n'y avait pas de tapis, à cause du deuil dans lequel on était alors. Le sultan était assis sur un coussin, et il avait devant lui deux vases couverts, dont l'un était d'or, et l'autre d'argent. Il y avait dans le salon un petit tapis vert, de ceux sur lesquels on se place pour faire la prière. Il fut étendu pour moi près du prince, et je m'assis dessus; il n'y avait dans la salle que son hâdjib (chambellan), le fakîh Mahmoud, et un de ses commensaux dont j'ignore le nom.
L'atabek m'interrogea touchant mon état et mon pays; il me questionna au sujet de Mélik Nacir (le sultan d'Egypte) et de la province du Hedjaz. Je lui répondis sur ces matières. Ensuite arriva un grand fakîh, qui était le reïs (chef) des fakîhs de cette contrée. Le sultan me dit : « Cet homme est notre maître (mewlânâ) Fadhîl. » On n'adresse la parole aux fakîhs, dans toute la Perse, qu'en leur donnant le titre de mewlânâ : c'est ainsi qu'ils sont appelés par le sultan et par les autres personnes. Le sultan commença à faire l'éloge de ce fakîh ; il me sembla que ce prince était vaincu par l'ivresse; et j'avais précédemment appris son habitude de se livrer à la boisson. Ensuite il me dit en arabe, langue qu'il parlait avec élégance : « Parle donc. » Je lui dis : « Si tu m'écoutais, je te dirais: Tu es un des enfants du sultan atabek Ahmed, célèbre par sa piété et sa dévotion; il n'y a rien à te reprocher dans ta manière de gouverner, excepté cela »; et je montrai avec le doigt les deux vases. Il fut honteux de ces paroles et garda le silence. Je voulus m'en retourner, mais il m'ordonna de m'asseoir, et me dit : « C'est une marque de la miséricorde divine, que d'être réuni avec tes pareils. » Ensuite je vis qu'il se penchait de côté et d'autre et désirait dormir, et je me retirai.
J'avais laissé mes sandales à la porte, et je ne les y trouvai pas. Le fakîh Mahmoud descendit pour les chercher. Le fakîh Fadhîl remonta, afin de les chercher dans le salon; il les y trouva dans une niche, et me les apporta. Sa bonté me rendit confus, et je lui fis des excuses. Il baisa alors mes sandales, les plaça sur sa tête (en signe de respect), et me dit : « Que Dieu te bénisse! ce que tu as dit à notre sultan, personne autre que toi ne pourrait le lui dire; j'espère que cela fera impression sur lui. »
Quelques jours après je partis de la capitale d'Îdhedj ; je m'arrêtai dans la medréceh des sultans, où se trouvent leurs tombeaux, et j'y passai plusieurs jours. Le sultan m'envoya un certain nombre de dinars, et fit cadeau d'une pareille somme à mes compagnons. Nous voyageâmes durant dix jours dans le pays du sultan, au milieu de montagnes élevées; chaque nuit nous nous arrêtions dans une medréceh, où se trouvait de la nourriture. Quelques-uns de ces collèges sont situés dans des lieux cultivés, et d'autres dans des endroits incultes; mais on y apporte tout ce qui est nécessaire. Le dixième jour, nous descendîmes dans une medréceh nommée Guirîwâ'rrokh, et qui marque la fin des Etats de l'atabek. Nous voyageâmes ensuite dans une plaine abondamment arrosée, qui fait partie du gouvernement d'Ispahan, et nous arrivâmes à la ville d'Uchturcân. C'est une belle cité, bien pourvue d'eaux et de vergers; elle possède une mosquée admirable, traversée par un fleuve. Nous partîmes d'Uchturcân pour Fîroûzân, dont le nom ressemble au duel du mot Firouz. C'est une petite ville qui a des rivières, des arbres et des vergers. Nous y arrivâmes après la prière de l'asr, et nous vîmes que les habitants en étaient sortis, pour suivre une bière au lieu de la sépulture; ils avaient allumé des lanternes devant et derrière cette bière; ils la suivaient avec des fifres, et étaient accompagnés par des individus qui chantaient toutes sortes de chansons, propres à exciter l'allégresse. Nous fûmes étonnés de leur conduite. Nous demeurâmes une nuit à Fîroûzân, et nous passâmes le lendemain par une bourgade appelée Neblân : c'est un endroit considérable situé sur une grande rivière, près de laquelle se trouve une mosquée extrêmement belle. On y monte par des degrés, et elle est entourée de vergers.
Nous marchâmes ce jour-là entre des vergers, des ruisseaux et de beaux villages, où se trouvent un grand nombre de tours à pigeons. Nous arrivâmes après l'asr à la ville d'Isfahân, ou Ispahan, dans l'Irak 'Adjem : c'est une ville des plus grandes et des plus belles; mais sa partie la plus considérable est maintenant en ruines, à cause des discordes qui existent entre les Sunnites et les Râfidhites (c'est-à-dire les Chiites). Ces discordes ont continué jusqu'à présent; les deux sectes ne cessent pas de se combattre. On trouve à Ispahan des fruits en grande abondance. Parmi ceux-ci on remarque des abricots qui n'ont pas leurs pareils, et que l'on appelle du nom de Kamar eddîn; les habitants les font sécher et les conservent ; on en rompt le noyau, qui renferme une amande douce. On distingue encore des coings, qui n'ont pas leurs semblables pour la bonté et pour la grosseur; des raisins excellents et des melons d'une qualité admirable. Ces derniers n'ont pas leurs pareils dans tout l'univers, si l'on excepte le melon de Boukhara et de Kharezm ; leur écorce est verte et leur chair rouge; on les conserve, de même que les figues sèches dans le Maghreb, et ils sont d'une extrême douceur. Quiconque n'est pas accoutumé à en manger, est relâché les premières fois qu'il en goûte, et c'est ce qui m'arriva, lorsque j'en mangeai à Ispahan.
Les habitants d'Ispahan ont une belle figure; leur couleur est blanche, brillante, mélangée de rouge. Leur qualité dominante est la bravoure; ils sont, en outre, généreux, et déploient une grande émulation dans les repas qu'ils se donnent les uns aux autres. On raconte d'eux, à ce propos, des histoires étonnantes. Souvent l'un d'eux invite son camarade et lui dit : « Viens avec moi manger du nân et du mâs »; c'est-à-dire du pain et du lait aigre caillé (nân, dans leur langue, signifie du pain, alkhobz, et mâz [ou plutôt mâst] du lait caillé, alleben) ; mais lorsque cet homme l'aura suivi, il lui fera goûter toutes sortes de mets recherchés, s'efforçant de le vaincre par ce luxe. Les gens de chaque profession mettent à leur tête un chef choisi parmi eux, et qu'ils appellent kélou. Les principaux de la ville en usent de même, sans être gens de métier; il y a, par exemple, la troupe des jeunes gens non mariés. Ces confréries cherchent à se surpasser l'une l'autre. Quelques-uns de leurs membres en traitent d'autres, afin de montrer ce dont ils sont capables, et déploient la plus grande recherche dans la préparation des aliments, etc. On m'a rapporté que plusieurs d'entre eux traitèrent une autre réunion, et firent cuire leurs mets au feu des bougies; les autres leur rendirent un repas, et firent cuire leur plats avec de la soie.
Je logeai à Ispahan dans un ermitage dont on attribue la construction au cheikh Aly, fils de Sahl, disciple de Djoneïd. Cet édifice est tenu en grande vénération; les habitants de ces contrées s'y rendent, et regardent ce pèlerinage comme une source de bénédictions. On y trouve de la nourriture pour les voyageurs, et il possède un bain admirable, pavé de marbre, et dont les murailles sont revêtues de faïence de Kâchân. Il a été fondé dans des vues de bienfaisance; et l'on n'exige aucune rétribution de personne pour y entrer. Le cheikh de cet ermitage est le pieux, le dévot, le vertueux Kothb eddîn Hoceïn, fils du pieux cheikh Wély Allah (l'ami de Dieu), Chems eddîn Mohammed, fils de Mahmoud, fils d'Aly, connu par le surnom d'Arredjâ. Son frère était le savant, le mufti Schihâb eddîn Ahmed. Je séjournai auprès du cheikh Kothb eddîn, dans cet ermitage, durant quatorze jours. Je vis des preuves de son zèle dans la dévotion, de son amitié pour les fakirs et les malheureux, et de son humilité envers eux, qui me frappèrent d'admiration. Il me témoigna la plus grande considération et me traita avec beaucoup d'hospitalité. Il me fit présent d'un beau vêtement; et au moment même de mon arrivée dans l'ermitage, il m'envoya des mets, et trois melons de l'espèce que j'ai décrite il n'y a qu'un instant; je n'en avais point encore vu, ni mangé.
Il me visita un jour dans l'endroit de l'ermitage où j'étais logé, et qui dominait sur un verger appartenant au cheikh. Les vêtements de celui-ci avaient été lavés ce même jour, et se trouvaient étendus dans le verger. Je vis parmi ceux-ci une tunique (djobbeh), blanche et doublée, que l'on appelle chez les Persans hezermîkhy (vêtement de derviche). Cette robe me plut, et je dis en moi-même : « Je désirerais un pareil habit. » Lorsque le cheikh fut entré dans ma chambre, il jeta les yeux dans la direction du jardin, et dit à quelqu'un de ses serviteurs : « Apportez-moi ce vêtement hezermîkhy. » On le lui apporta, et il me le fit revêtir. Je me jetai à ses pieds, afin de les embrasser, et je le priai de me coiffer du bonnet qu'il portait sur sa tête, et de me permettre de conférer cet honneur, qu'il avait reçu de son père, qui lui-même le tenait de ses aïeux. En conséquence, il me coiffa de ce bonnet le 14 de djoumada second de l'année 727 (7 mai 1327), dans son ermitage susmentionné. Il en avait été revêtu par son père Chems eddîn, et celui-ci l'avait été par son père Tadj eddîn Mahmoud, qui lui-même avait reçu l'investiture de son père Schihâb eddîn Aly arredjâ. Aly avait été revêtu du bonnet par l'imâm Schihâb eddîn Abou Hafss Omar, fils de Mohammed, fils d'Abd Allah assohrawerdy. Omar en avait été coiffé par le grand cheikh Dhïâ eddîn Abou'nnedjîb assohrawerdy, qui l'avait été par son oncle paternel, l'imâm Wahîd eddîn Omar. Celui-ci avait reçu cet honneur de son père Mohammed, fils d'Abd Allah, connu sous le nom d'Omaweïh, qui l'avait lui-même reçu du cheikh Akhou Feredj azzendjâny; Akhou Feredj l'avait reçu du cheikh Ahmed addînawery, qui le devait à l'imâm Memchâd addînawéry; ce dernier avait été revêtu de cet insigne par le cheikh contemplatif Aly, fils de Sahl, le soufi, qui en avait été revêtu par Abou’lkâcim aldjoneïd. Aldjoneïd en avait lui-même été revêtu par Seriy assakathy; Seriy l'avait reçu de Daoud atthâïy, et celui-ci, de Haçan, fils d'Abou’ Haçan albasry. Enfin, Haçan albasry le tenait du prince des croyants Aly, fils d'Abou Thâlib.
« C'est ainsi, observe Ibn Djozay, que le cheikh Abou Abd Allah rapporte la transmission de cet insigne. Mais il est bien connu que Seriy assakathy fut le compagnon de Ma ‘rouf alcarkhy, que celui-ci fut le compagnon de Daoud atthâïy, et qu'entre ce dernier et Haçan il y eut Habib al'adjemy. Il est admis seulement qu'Akhou Feredj azzendjâny fat le compagnon d'Abou’l’abbâs annehâwendy, et qu'Annehâwendy fut celui d'Abou Abd Allah, fils de Khafif, lequel fut celui d'Abou Mohammed Roweïm, qui fut compagnon d'Abou'lkâcim aldjoneïd. Quant à Mohammed, fils d'Abd Allah Omaweïh, c'est lui qui fut le compagnon du cheikh Ahmed addînawery, le Noir; et il n'y eut personne entre eux deux. Or Dieu sait le mieux ce qu'il en est. Celui qui fut le compagnon d'Akhou Feredj azzendjâny, c'est Abd Allah, fils de Mohammed, fils d'Abd Allah, et père d'Abou'nnedjîb. » Revenons au récit.
Nous partîmes d'Ispahan, dans le dessein de visiter le cheikh Medjd eddîn, à Chiraz ; il y a entre ces deux villes une distance de dix journées de marche. Nous arrivâmes à la ville de Kelîl, située à trois journées de marche d'Ispahan. C'est une petite ville qui possède des rivières, des jardins et des arbres à fruits. J'ai vu vendre, dans son marché, des pommes pour un dirhem les quinze rothl irâkis; leur dirhem est le tiers du nokrah. Nous logeâmes à Kelîl, dans un ermitage construit par un grand personnage de l'endroit, connu sous le nom de Khodjah Câfy. Cet homme possédait une fortune considérable, que Dieu l'aida à dépenser en bonnes actions, telles que l'aumône, la construction d'ermitages et le don d'aliments aux voyageurs. Nous marchâmes pendant deux jours,[25] après être partis de Kelîl, et nous arrivâmes dans une grande bourgade, nommée Sormâ. Il y a un ermitage où se trouve de la nourriture pour les voyageurs, et qui a été construit par ce même Khodjah Câfy.
Nous partîmes de cet endroit pour Yezdokhâs (Iezd Khast), petite ville solidement bâtie, et dont le marché est très beau ; sa mosquée djâmi est admirable ; elle est construite en pierre, et couverte de même. La ville s'élève sur le bord d'un fossé, ou se trouvent ses vergers et ses fontaines. A l'extérieur de la ville est un caravansérail où logent les voyageurs; il est muni d'une porte de fer et parfaitement fortifié. Dans l'intérieur de cet édifice se trouvent des boutiques, où l'on vend tout ce dont les voyageurs ont besoin. Ce caravansérail a été bâti par l'émir Mohammed chah Indjoû, père du sultan Abou Ishâk, roi de Chiraz. On fabrique à Yezdokhâs le fromage dit yezdokhâcy, qui n'a pas son pareil en bonté. Le poids de chaque fromage est depuis deux jusqu'à quatre oûkiyah (onces).
Nous partîmes de Yezdokhâs par le chemin de Decht-erroûm (la plaine des Romains), qui est une plaine habitée par des Turcs; puis nous marchâmes vers Mâiyn. C'est une petite ville abondante en rivières et en vergers; on y trouve de beaux marchés, et la plupart de ses arbres sont des noyers. Nous en partîmes pour Chiraz, cité solidement bâtie, d'une vaste étendue, d'une grande célébrité et d'un rang élevé parmi les villes. Elle possède d'agréables vergers, des rivières qui se répandent au loin, des marchés admirables, de nobles rues; elle a une nombreuse population; elle est construite avec beaucoup de goût, et admirablement disposée. Les gens de chaque métier ont un marché particulier, de sorte que les hommes des diverses professions occupent des places distinctes. Les habitants de Chiraz sont d'une belle figure et portent des vêtements propres. Il n'y a pas dans l'Orient une ville qui approche de la ville de Damas, par la beauté de ses marchés, de ses vergers et de ses rivières, et l'extérieur avantageux de ses habitants, si ce n'est Chiraz. Cette dernière place est située dans une plaine; des vergers l'entourent de tous les côtés, et cinq rivières la traversent, parmi lesquelles se trouve celle nommée Rocnâbâd. C'est une rivière dont l'eau est agréable à boire, extrêmement froide en été et chaude en hiver; elle coule d'une source située au bas d'une montagne voisine, que l'on appelle Alkolaï'ah (le petit château).
La mosquée principale de Chiraz est nommée Almesdjid al'atîk (la vieille mosquée) ; c'est une des plus grandes et des mieux bâties que l'on puisse voir. Sa cour est vaste et pavée de marbre; on la lave chaque nuit durant le temps des chaleurs. Les principaux habitants de la ville s'y réunissent tous les soirs, et y font les prières du coucher du soleil et de l’îchâ (de la nuit). Au nord de cette mosquée est une porte, nommée porte de Haçan, qui aboutit au marché aux fruits ; c'est un des plus admirables marchés qu'il soit possible de voir, et je confesse qu'il surpasse celui de la porte de la Poste (Bâb albérîd), à Damas.
Les habitants de Chiraz sont des gens de bien, pieux et chastes, et les femmes en particulier se distinguent sous ce rapport Elles portent des bottines et sortent couvertes de manteaux et de voiles; ainsi l'on ne voit aucune partie de leur corps. Elles répandent des aumônes et des bienfaits. Ce qu'il y a d'étonnant chez elles, c'est qu'elles se rassemblent dans la grande mosquée, pour écouter le prédicateur, tous les lundis, les jeudis et les vendredis. Souvent il y en a mille et deux mille réunies ; dans leurs mains elles tiennent des éventails, pour se rafraîchir, à cause de la chaleur. Je n'ai vu dans aucune ville de réunion de femmes aussi nombreuse. Lorsque j'entrai dans Chiraz, je n'eus d'autre pensée que d'aller trouver le cheikh, le kadi, l'imâm, le pôle des amis de Dieu, la merveille de son siècle, l'auteur de miracles évidents, Medjd eddîn Ismaïl, fils de Mohammed, fils de Khodkadâd : le sens de Khodkâdâd est Don de Dieu ou Dieudonné. J'arrivai à la medréceh Medjdiieh, qui lui doit son nom, et où il a sa demeure : cette medréceh a été construite par lui. J'allai le visiter, avec trois camarades, et je trouvai les fakîhs et les principaux habitants de la ville, qui l'attendaient. Il sortit à l'heure de la prière de l'asr, accompagné de Mohibb eddîn et Alâ eddîn, tous deux fils de son frère utérin Roûh eddîn. L'un d'eux se tenait à sa droite et l'autre à sa gauche ; et ils le suppléaient dans les fonctions de kadi, à cause de la faiblesse de sa vue et de son grand âge. Je le saluai ; il m'embrassa, et me tint par la main, jusqu'à ce qu'il fût arrivé auprès de son tapis à prier. Alors il me lâcha, et me fit signe de prier à ses côtés; ce que je fis. Il récita la prière de l'asr ; ensuite on lut en sa présence dans le Meçâbih et dans le Chewârik alanwâr, par Sâghâny. Ses deux suppléants lui firent connaître les contestations qui leur avaient été déférées. Les grands de la ville s'avancèrent alors pour le saluer, car telle est leur coutume avec lui, matin et soir. Cette cérémonie terminée, le cheikh m'interrogea touchant mon état et les circonstances de mon arrivée, et me fit des questions relatives au Maghreb, à l'Egypte, à la Syrie et au Hedjaz. Je l'instruisis de ce qui regardait ces divers objets.
Il donna à ses serviteurs des ordres, d'après lesquels ils me logèrent dans une très petite chambre à coucher, située dans l'intérieur du collège. Le lendemain un envoyé du roi de l'Irak, le sultan Abou Sa’id, arriva près du cheikh : c'était Nacir eddîn Addarkandy, un des principaux émirs, et originaire du Khoraçan. Lorsqu'il approcha du cheikh ; il ôta de dessus sa tête sa chéchia (calotte), que les Persans appellent culâ (bonnet), baisa le pied du kadi, et s'assit devant lui, tenant son oreille avec sa main. C'est ainsi qu'en usent les commandants tatars en présence de leurs souverains. Cet émir était arrivé avec environ cinq cents cavaliers, ses esclaves, ses serviteurs et ses compagnons. Il campa hors de la ville; puis il vint trouver le kadi, avec cinq personnes, et entra seul dans son salon, par politesse.
Le roi de l'Irak, le sultan Mohammed Khodhâbendeh, avait eu près de, lui, pendant qu'il était encore adonné à l'idolâtrie, un jurisconsulte de la secte des Râfidhites, partisans des douze imams, que l'on appelait Djémal eddîn, fils de Mothahher. Lorsque ce sultan eut embrassé l'islamisme, et que les Tatars eurent fait de même, à son exemple, il témoigna une plus grande considération à ce fakîh. Celui-ci lui vanta la doctrine des Râfidhites, et sa supériorité sur les autres croyances; il lui exposa l'histoire des compagnons de Mahomet et du khalifat, et établit à ses yeux qu'Abou Bekr et Omar étaient deux vizirs du Prophète de Dieu; qu'Aly était son cousin germain et son gendre, et qu'en conséquence, il était légitime héritier du khalifat. Il comparait cela, auprès du sultan, avec l'idée, familière à ce prince, que le royaume dont il était en possession n'était qu'un héritage venu de ses ancêtres et de ses proches; en quoi il était aidé par le peu de temps qui s'était écoulé depuis la conversion du sultan, et par son ignorance des règles fondamentales de l'islamisme. Le sultan ordonna de pousser les hommes à embrasser la doctrine des Râfidhites, et envoya des lettres à cet effet dans les deux Irâks, le Fars, l'Azerbaïdjan, Ispahan, le Kermân et le Khoraçan; et il expédia des ambassadeurs dans les diverses villes. Les premières cités où cet ordre arriva, ce furent Bagdad, Chiraz et Ispahan. Quant aux habitants de Bagdad, les gens de la porte du Dôme (Bâb alazadj), qui sont sunnites (musulmans orthodoxes), et qui, pour la plupart, suivent les dogmes de l'imam Ahmed, fils de Hanbal, refusèrent d'obéir et dirent : « Nous ne prêterons pas l'oreille à cela, et nous n'obéirons pas. » Ils se rendirent en armes, le vendredi, à la mosquée djâmi, où se trouvait le député du sultan. Lorsque le khathîb fut monté sur la chaire, ces hommes se dirigèrent vers lui, au nombre d'environ douze mille, tous armés; ils étaient les défenseurs de Bagdad, et ses habitants les plus marquants. Ils jurèrent au khathîb que s'il changeait la khotbah (prône) accoutumée, ou qu'il y ajoutât ou en retranchât quelque chose, ils le tueraient, ainsi que l'envoyé du roi, et se soumettraient ensuite à la volonté de Dieu. Le sultan avait ordonné que les noms des khalifes et des autres compagnons (de Mahomet) fussent supprimés de la khothba, et qu'on ne mentionnât que le nom d'Aly et de ses sectateurs, comme Ammar. Mais le khathîb eut peur d'être tué, et fit la khothba à la manière ordinaire.
Les habitants de Chiraz et d’Ispahan agirent comme ceux de Bagdad. Les députés revinrent auprès du roi et l'instruisirent de ce qui s'était passé; il ordonna de lui amener les kadis de ces trois villes. Le premier d'entre eux qui fut amené était Medjd eddîn, kadi de Chiraz. Le sultan se trouvait alors dans un endroit appelé Karâbâgh, et dans lequel il avait l'habitude de passer l'été. Lorsque le kadi fut arrivé, le sultan ordonna de le jeter à des chiens qui se trouvaient dans son palais. C'étaient des animaux d'une forte taille, au cou desquels pendaient des chaînes, et « rai étaient dressés à dévorer les hommes. Lorsqu'on amenait quelqu'un pour le livrer aux chiens, on plaçait ce malheureux dans une vaste plaine, où il restait libre et sans entraves; ensuite ces chiens étaient lancés sur lui ; il s'enfuyait devant eux, mais il n'avait aucun asile : les bêtes l'atteignaient, le mettaient en pièces et dévoraient sa chair. Lorsque les chiens furent lâchés sur le kadi Medjd eddîn et qu'ils arrivèrent auprès de lui, ils le caressèrent, remuèrent la queue devant lui et ne lui firent aucun mal.
Cette nouvelle parvint au sultan; il sortit de son palais, les pieds nus, se prosterna à ceux du kadi, afin de les baiser, prit sa main, et le revêtit de tous les habits qu'il portait. C'est le plus grand honneur que le sultan puisse faire chez ce peuple. Lorsqu'il a ainsi gratifié une personne de ses vêtements, c'est pour cet individu, pour ses fils et tous ses descendants, une distinction dont ils héritent, tant que durent ces hardes, ou qu'il en reste seulement une portion. La pièce du costume qui est le plus considérée en pareil cas, c'est le caleçon. Lorsque le sultan eut revêtu de ses habits le kadi Medjd eddîn, il le prit par la main, le fit entrer dans son palais, et ordonna à ses femmes de le traiter avec respect, et de regarder sa présence comme une bénédiction. Le sultan renonça à la doctrine des Râfidhites, et écrivit dans ses provinces, afin d'ordonner que les habitants persévérassent dans la croyance orthodoxe des sunnites. Il fit des dons magnifiques au kadi, et le renvoya dans son pays, comblé de marques d'honneur et de considération. Il lui donna, entre autres présents, cent des villages de Djemkân. C'est une vallée (littéralement un fossé), entre deux montagnes, dont la longueur est de vingt-quatre parasanges, et qui est traversée par une grande rivière. Les villages sont rangés des deux côtés du fleuve, et c'est le plus bel endroit du territoire de Chiraz. Parmi ses grandes bourgades, qui égalent des villes, est celle de Meïmen, qui appartient an même kadi. Au nombre des merveilles de ce lieu, nommé Djemkân, est la suivante: la moitié de cet endroit, qui est contiguë à Chiraz, et qui a une étendue de douze parasanges, est extrêmement froide; la neige y tombe, et la plupart des arbres qui y croissent sont des noyers; mais l'autre moitié, contiguë au pays de Hondj ou Bâl (plus loin, Ibn Batoutah lit Khondjopâl) et au pays de Lâr, sur le chemin de Hormouz, est très chaude, et le palmier y croît. Je vis une seconde fois le kadi Medjd eddîn, à l'époque où je sortis de l'Inde. Je me dirigeai vers lui, de la ville de Hormouz, afin d'obtenir le bonheur de le voir. Cela arriva en l'année 748 (748 = 1347). Entre Hormouz et Chiraz, il y a une distance de trente-cinq journées de marche. Je visitai ce kadi, qui était alors dans l'impuissance de marcher, et je le saluai. Il me reconnut, se leva à mon approche et m'embrassa. Ma main tomba sur son coude, et je sentis sa peau collée à l’os, sans qu'aucune parcelle de chair l’en séparât. Il me logea dans la medréceh, et dans le même endroit où il m'avait logé la première fois. Je le visitai un certain jour, et je trouvai le roi de Chiraz, le sultan Abou Isbik, dont nous ferons bientôt mention, assis devant loi, tenant son oreille dans sa main ; car ce geste est, chez ces gens, le comble de la politesse, et les sujets le font, lorsqu'ils sont assis devant leur roi. (Cf. ci-dessus).
J'allai une autre fois voir le kadi à la medréceh; j'en trouvai la porte fermée, et je m'enquis du motif de cette circonstance. On m'apprit que la mère du sultan et sa sœur avaient eu ensemble une contestation, au sujet d'un héritage, et qu'il les avait renvoyées au kadi Medjd eddîn. En conséquence, elles vinrent le trouver dans la medréceh, et plaidèrent devant lui leur affaire. Il prononça entre elles un jugement conforme à la loi. Les habitants de Chiraz n'appellent pas Medjd eddîn kadi, mais ils lui donnent le titre de mewlânâ a'zham (notre grand maître). C'est ainsi que l'on écrit dans les actes judiciaires et les contrats qui exigent qu'il y soit fait mention de son nom. La dernière fois que je vis le kadi, ce fut dans le mois de rebi' second 748 (juillet 1347). L'éclat de ses vertus rejaillit alors sur moi, et ses bénédictions se manifestèrent en ma faveur. Que Dieu nous soit utile par son moyen, et par celui de ses semblables!
Le sultan de Chiraz, lorsque j'arrivai dans cette ville, était le roi excellent (almelic alfâdhil) Abou Ishâk, fils de Mohammed chah Indjoû. Son père l'avait nommé ainsi en l'honneur du cheikh Abou Ishâk alcâzeroûny. C'est un des meilleurs sultans que l'on puisse voir; il a une belle figure, un extérieur avantageux, et sa conduite n'est pas moins belle. Son âme est généreuse, son caractère remarquable; il est humble, et sa puissance est grande, de même que son royaume. Son armée excède le nombre de cinquante mille hommes, tant Turcs que Persans. Ceux qui lui sont le plus attachés et qui l'approchent de plus près, sont les habitants d'Ispahan. Il n'a aucune confiance dans ceux de Chiraz ; il ne les prend pas à son service, et ne les admet pas dans sa familiarité. Il ne permet à aucun d'eux de porter des armes, parce que ce sont des gens braves, très courageux et pleins d'audace envers leurs rois. Celui d'entre eux dans les mains duquel on trouve des armes est châtié. J'ai vu un jour un homme que les djândârs, c'est-à-dire, les gens du guet, traînaient devant le hâkim (officier de police), après lui avoir mis une chaîne au cou. Je m'informai de l'aventure de cet homme, et j'appris qu'on avait trouvé dans sa main un arc, pendant la nuit. Le sultan a jugé à propos de traiter avec sévérité les habitants de Chiraz, et de donner la préférence sur eux à ceux d'Ispahan, parce qu'il redoute les premiers.
Son père, Mohammed chah Indjoû, était gouverneur de Chiraz, au nom du roi de l'Irak. Il tenait une bonne conduite, et était chéri des habitants de cette ville. Lorsqu'il fut mort, le sultan Abou Sa'id nomma vice-roi à sa place le cheikh Hoceïn, fils de Djoubân, émir des émirs, dont il sera parlé ci-après ; et envoya avec lui des troupes considérables. Ce seigneur arriva à Chiraz, s'en empara et perçut les tributs. Or celle-ci est une des principales villes du monde sous le rapport des revenus. Alhâddj (le pèlerin) Kiwâm eddîn Atthamghadjy, préposé à la perception des contributions à Chiraz, m'a raconté qu'il avait affermé les impôts pour dix mille dinars d'argent par jour. Cette somme, changée en or du Maghreb, ferait deux mille cinq cents dinars d'or.
L'émir Hoceïn séjourna quelque temps à Chiraz, puis il voulut aller trouver le roi de l'Irak; mais auparavant, il fit arrêter Abou Ishâk, fils de Mohammed chah Indjoû, ses deux frères Rocn eddîn et Maçoud bec, et sa mère Thâch khatoun, et prétendit les emmener dans l'Irak, afin qu'on les forçât de livrer les richesses de leur père. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu du marché de Chiraz, Thâch khatoun releva le voile dont elle s'était couvert le visage, de peur qu'on ne la vit dans cet état, car c'est d'ailleurs la coutume des femmes turques de ne pas se couvrir la figure. Elle appela à son aide les habitants de Chiraz, et leur dit : « Est-ce que je serai ainsi enlevée d'au milieu de vous, ô citoyens de Chiraz, moi, qui suis une telle, femme d'un tel ? » Un charpentier, nommé Pehléwân Mahmoud, que j'ai vu dans le marché de Chiraz, lors de mon arrivée en cette ville, se leva et dit : « Nous ne la laisserons pas sortir de notre ville, et nous n'y consentirons pas. » Les habitants l'imitèrent dans ses discours. La populace excita du tumulte, prit les armes et tua beaucoup de soldats; puis elle pilla les produits des tributs, et délivra la princesse et ses enfants.
L'émir Hoceïn et ses adhérents prirent la fuite, et le premier, ainsi abandonné, alla trouver le sultan Abou Sa'id. Celui-ci lui donna une armée nombreuse, lui commandant de retourner à Chiraz, et d'exercer l'autorité sur les habitants de cette ville, selon son bon plaisir. Lorsque les Chiraziens apprirent cette nouvelle, ils virent bien qu'ils n'étaient pas assez forts pour résister à Hoceïn. Ils allèrent trouver le kadi Medjd eddîn et le prièrent de prévenir l'effusion du sang, et de ménager, de part et d'autre, un traité de paix. Ce personnage sortit de la ville au-devant de l'émir. Hoceïn descendit de cheval à son approche, et le salua. La paix fut conclue, et l'émir campa ce même jour en dehors de Chiraz; le lendemain matin, les habitants sortirent à sa rencontre dans le plus bel ordre; ils décorèrent la ville et allumèrent de nombreux flambeaux. L'émir fit une entrée pompeuse, et tint envers les Chiraziens la conduite la plus louable.
Lorsque le sultan Abou Sa'id fut mort, que sa postérité fut éteinte, et que chaque émir se fut emparé de ce qui était entre ses mains, l'émir Hoceïn craignit pour sa vie les entreprises des habitants de Chiraz, et sortit de leur ville. Le sultan Abou Ishâk s'en rendit maître, ainsi que d'Ispahan et de la province du Fars, ce qui comprend l'étendue d'un mois et demi de marche. Sa puissance devint considérable, et son ambition médita la conquête des villes voisines. Il commença par la plus rapprochée, qui était la ville de Yezd, cité belle, propre, décorée de superbes marchés, possédant des fleuves considérables et des arbres verdoyants. Ses habitants sont des marchands, et font profession de la doctrine de Châfi'y. Abou Ishâk assiégea Yezd et s'en rendit maître. L'émir Mozaffer chah, fils de l'émir Mohammed chah, fils de Mozaffer, se fortifia dans un château fort, à six milles de Yezd. C'était une place inexpugnable, entourée de tous côtés par des sables. Abou Ishâk l'y assiégea.
L'émir Mozaffer chah montra une bravoure au-dessus de l'ordinaire, et telle qu'on n'en a pas entendu mentionner de pareille. Il faisait des attaques nocturnes contre le camp du sultan Abou Ishâk, tuait à souhait, déchirait les tentes et les pavillons, et retournait dans sa forteresse, sans qu'Abou Ishâk pût l'atteindre. Mozaffer chah fondit une nuit sur les tentes du sultan, y tua plusieurs personnes, prit dix des meilleurs chevaux d'Abou Ishâk, et revint dans son château. Le sultan ordonna que cinq mille cavaliers montassent à cheval toutes les nuits, et dressassent des embuscades à Mozaffer chah. Cela fut exécuté ; le prince assiégé fit une sortie, selon sa coutume, avec cent de ses compagnons, et fondit sur le camp ennemi. Les troupes placées en embuscade l'entourèrent, et le reste de l'armée arriva successivement. Mozaffer chah les combattit, et se retira sain et sauf dans sa forteresse. Un seul de ses compagnons fut atteint, et on le conduisit au sultan. Celui-ci le revêtit d'une robe d'honneur, le relâcha, et envoya avec lui un sauf-conduit pour Mozaffer, afin que ce prince vînt le trouver. Mozaffer refusa; mais ensuite des négociations s'engagèrent entre eux, et une grande amitié pour Mozaffer prit naissance dans le cœur du sultan Abou Ishâk, à cause des actes de bravoure dont il avait été témoin de la part de ce prince. Il dit : « Je veux le voir; après quoi, je m'en retournerai. » En conséquence, il se posta près du château. Mozaffer se plaça à la porte de la citadelle, et salua Abou Ishâk. Le sultan lui dit : « Descends, sur la foi de mon sauf-conduit. » Mozaffer répliqua : « J'ai fait serment à Dieu de ne pas t'aller trouver, jusqu'à ce que tu sois entré dans mon château ; alors j'irai. » Abou Ishâk répondit : « Je ferai cela; » il entra dans la place, accompagné seulement de dix de ses courtisans. Lorsqu'il fut arrivé à la porte du château, Mozaffer mit pied à terre, baisa son étrier, marcha devant lui, et l'introduisit dans sa maison. Abou Ishâk y mangea des mets qui avaient été préparés pour Mozaffer. Après cela, celui-ci se rendit à cheval avec Abou Ishâk, dans le camp de ce prince. Le sultan le fit asseoir à son côté, le revêtit de ses propres habits, et lui donna une somme considérable. Il hit convenu entre eux que la khothba serait faite au nom du sultan Abou Ishâk, et que la province appartiendrait à Mozaffer et à son père. Le sultan retourna dans ses États.
Abou Ishâk ambitionna un jour la gloire de construire un portique pareil à celui de Chosroès (Kesra), et ordonna aux habitants de Chiraz de s'occuper à en creuser les fondements. Ils commencèrent ce travail. Les gens de chaque profession luttaient d'émulation avec ceux des autres métiers. La chose alla si loin, qu'ils firent des paniers de cuir pour transporter la terre, et qu'ils les recouvrirent d'étoffes de soie brochées d'or. Ils montrèrent un pareil luxe pour les housses et les bissacs des bêtes de somme. Quelques-uns d'entre eux fabriquèrent des pioches d'argent, et allumèrent de nombreuses bougies. Au moment du travail, ils revêtaient leurs plus beaux habits, et attachaient des tabliers de soie à leur ceinture. Le sultan assistait à leurs travaux, du haut d'un belvédère qui lui appartenait. J'ai vu cette construction, qui était déjà élevée au-dessus de terre d'environ trois coudées. Lorsque les fondements furent bâtis, les habitants de la ville furent exemptés d'y travailler, et des ouvriers les remplacèrent, moyennant un salaire. Des milliers de ceux-ci furent rassemblés pour cette besogne. J'ai entendu dire, par le gouverneur de la ville, que la majeure partie des tributs de Chiraz était dépensée pour cette construction. La personne préposée à ces travaux était l’émir Djélal eddîn ibn Alfeleky attawrîzy, un des grands de Chiraz, et dont le père avait été substitut du vizir du sultan Abou Sa'id, appelé Aly chah Djilân. Cet émir Djélal eddîn Alfeleky a un frère distingué, appelé Hibet Allah, et surnommé Béhâ almoulc.qui arriva à la cour du roi de l'Inde en même temps que moi. Cherf almoulc, émir de Bakht, nous accompagnait. Le roi de l'Inde nous revêtit tous de robes d'honneur, plaça chacun de nous dans le poste auquel il était propre, et nous assigna un traitement fixe et des gratifications, ainsi que nous le rapporterons ci-après.
Le sultan Abou Ishâk désirait être comparé au susdit roi de l'Inde, sous le rapport de la générosité et de la magnificence de ses dons, « Mais quelle distance n'y a-t-il pas entre les Pléiades et la terre ! » La plus grande libéralité d'Abou Ishâk dont nous ayons connaissance, c'est qu'il donna au cheikh Zâdeh alkhorâçâny, qui vint à sa cour en qualité d'ambassadeur du roi de Hérat, soixante et dix mille dinars. Quant au roi de l'Inde, il ne cesse d'en donner plusieurs fois autant à des personnes innombrables, originaires du Khoraçan, ou autres.
Parmi les actions étonnantes du roi de l'Inde envers des Khorâçâniens est la suivante : un des fakîhs du Khoraçan, natif de Hérat, mais habitant à Kharezm, et appelé l'émir Abd Allah, vint trouver ce prince. La khatoun (princesse) Torâbec, femme de l'émir Kothloûdomoûr, prince de Kharezm, l'avait envoyé, avec un présent, auprès du roi de l'Inde. Ce souverain accepta le cadeau, et le reconnut par un don valant plusieurs fois autant, qu'il envoya à la princesse. L'ambassadeur de celle-ci, l'émir déjà nommé, préféra demeurer auprès du roi, qui le mit au nombre de ses commensaux. Un certain jour, le roi lui dit : « Entre dans le trésor, et emportes-en la quantité d'or dont tu pourras te charger. » Cet homme retourna à sa maison ; puis il se rendit au trésor avec treize sacoches, dans chacune desquelles il plaça tout ce qu'elle pouvait contenir. Il lia chaque sacoche à l'un de ses membres (or il était doué d'une grande force), et se mit en devoir de transporter ce fardeau. Mais lorsqu'il fut sorti du trésor, il tomba et ne put se relever. Le sultan ordonna de peser ce qu'il emportait. Cette somme pesait treize menn, poids de Dihli. Chaque menn équivalait à vingt-cinq rothls (livres) égyptiens. Le roi lui commanda de prendre tout cela ; il le prit et l'emporta.
L'émir Bakht, surnommé Cherf almoulc alkhorâçâny, dont il a été fait mention il n'y a qu'un instant, fut indisposé dans la capitale du roi de l’Inde. Le roi alla lui rendre visité. Lorsqu'il entra dans la chambre du malade, celui-ci voulut se lever; mais il l'adjura de ne pas descendre de son ket (c'est ainsi que l'on appelle le lit, asserîr). On plaça pour le sultan un siège, que l'on nomme almorah, et sur lequel il s'assit ; puis il demanda de l'or et une balance, et on lui apporta l'un et l'autre. Alors le prince ordonna au malade de s'asseoir dans un des plateaux de la balance. L'émir lui dit : « O maître du monde, si j'avais prévu que tu fisses cela, certes, j'aurais revêtu un grand nombre d'habits. » Le roi répliqua: « Revêts donc maintenant tous les habits que tu possèdes. » L'émir prit des vêtements qui lui servaient à se préserver du froid, et qui étaient ouatés. Puis il s'assit dans un plateau de la balance ; et l'or fut placé dans l'autre, jusqu'à ce que son poids l'emportât sur celui de l'individu. Le roi dit à l'émir : « Prends cela et fais-en des aumônes pour préserver ta vie. » Puis il sortit.
Le fakîh Abd Alaziz Alardéwily arriva auprès du roi de l'Inde. Cet homme avait enseigné la science des traditions à Damas, et il connaissait à fond cette matière. Le roi lui assigna un traitement quotidien de cent dinars d'argent, équivalant à vingt-cinq dinars d'or. Le fakîh se présenta un jour à l'audience du prince, et celui-ci l'interrogea touchant un hadith. Il lui cita promptement de nombreuses traditions sur le même sujet. Sa mémoire étonna le sultan, il lui jura sur sa tête qu'il ne le laisserait pas sortir de son salon, jusqu'à ce qu'il eût fait envers lui ce qu'il jugerait à propos. Puis il descendit de son siège, baisa les pieds du fakîh, et ordonna d'apporter un plat d'or, qui ressemblait à un petit thaïfour (plat creux, gamelle); il y fit jeter mille dinars d'or, prit le plat de sa propre main, répandit les ducats sur le fakîh et lui dit : « Ils t'appartiennent, ainsi que le plat. »
Un homme du Khoraçan, nommé Ibn achcheikh Abd er-Rahman alisferâïny, dont le père s'était établi à Bagdad, arriva un jour à la cour du sultan. Celui-ci lui donna cinquante mille dinars d'argent, des chevaux, des esclaves et des khil'ahs. Nous raconterons beaucoup d'histoires relatives à ce roi, lorsque nous traiterons de l'Inde. Nous avons rapporté ce qui précède, uniquement à cause de ce que nous avons allégué, à savoir que le sultan Abou Ishâk désirait être comparé à ce roi, sous le rapport de la générosité. Or, bien qu'il soit un prince généreux et distingué, il n'atteint pas le rang du roi de l'Inde, en fait de générosité et de libéralité.
On voit dans cette ville : d'abord le mausolée d'Ahmed, fils de Mouça et frère d'Arridha Aly, fils de Mouça, fils de Djafar, fils de Mohammed, fils d'Aly, fils de Hoçaïn, fils d'Aly, fils d'Abou Thâlib. C'est un sépulcre vénéré des habitants de Chiraz : ils sont heureux par ses mérites, et recherchent la faveur de Dieu, grâce à la sainteté de ce monument. Thâch khatoun, mère du sultan Abou Ishâk, a construit auprès du mausolée une grande medréceh et un ermitage, où l'on trouve des aliments pour les voyageurs ; il y a aussi des lecteurs du Coran, qui lisent continuellement ce livre près du mausolée. La khatoun a coutume de venir à cette chapelle sépulcrale, le soir du dimanche au lundi de chaque semaine. Les kadis, les fakîhs et les chérifs se réunissent dans cette même soirée. Or Chiraz est une des villes qui possèdent le plus de chérifs ; et j'ai appris de personnes dignes de confiance, que ceux d'entre eux qui reçoivent des pensions à Chiraz sont au nombre de plus de quatorze cents, tant petits que grands. Leur nakîb (chef) est Adhoud eddîn Alhoçaïny. Lors donc que cette assemblée est réunie dans le mausolée béni, on lit d'un bout à l'autre le Coran dans des exemplaires de ce livre. De leur côté, les lecteurs du Coran le récitent avec leurs belles voix. On apporte des mets, des fruits, des sucreries; et lorsque l'assistance a fini de manger, le prédicateur prêche. Tout cela a lieu après la prière de midi et avant celle de la nuit (entre midi et neuf heures du soir environ). Pendant ce temps, la khatoun se tient dans une chambre haute, dominant la mosquée, et munie d'usé jalousie. Ensuite on bat les timbales, et l'on sonne du clairon et de la trompette près de la porte de la chapelle, ainsi que l'on fait aux portes des rois.
Parmi les autres mausolées de Chiraz est celui de l'imâm, du pôle, du saint, Abou Abd Allah, fils de Khafîf, connu dans cette ville sous le nom du Cheikh. Cet homme était, de son vivant, le modèle de tout le Fars, et son mausolée est vénéré. Les dévots le visitent matin et soir, et se sanctifient par son moyen. J'ai vu le kadi Medjd eddîn venir le visiter et le baiser. La khatoun se rend à cette chapelle chaque nuit du jeudi au vendredi. On a construit auprès de cet édifice un ermitage et une medréceh. Les kadis, les fakîhs s'y réunissent, et s'y conduisent comme dans le mausolée d'Ahmed, fils de Mouça. J'ai visité ces deux endroits. Le mausolée de l'émir Mohammed chah Indjoû, père du sultan Abou Ishâk, est contigu à ce tombeau. Le cheikh Abou Abd Allah Mohammed, fils de Khafîf, jouit d'un rang élevé, d'une grande réputation parmi les amis de Dieu (les saints). C'est lui qui enseigna le chemin de la montagne de Serendîb, dans l'île de Ceylan, qui fait partie de l'Inde.
On raconte qu'il se dirigea un jour vers la montagne de Serendîb, accompagné d'environ trente fakirs. La faim les surprit sur la route de la montagne, dans un endroit où il ne se trouvait aucune habitation, et ils s'égarèrent de leur chemin. Ils demandèrent au cheikh de leur permettre de prendre un des petits éléphants, qui sont en très grand nombre en ce lieu, et qui de là sont transportés dans la capitale du roi de l'Inde. Il leur défendit de faire cela; mais la faim les vainquit, ils transgressèrent l’ordre du cheikh, prirent un de ces petits éléphants, lui coupèrent la gorge et mangèrent de sa chair ; le cheikh refusa d'en goûter. Lorsqu'ils furent endormis, dans la nuit suivante, les éléphants se réunirent de tous côtés, et vinrent dans l'endroit où ils se trouvaient. Ils flairaient chacun d'eux et le tuaient ensuite, jusqu'à ce qu'ils les eussent tous exterminés. Ils flairèrent aussi le cheikh et ne lui firent aucun mal. Un de ces éléphants le prit, en roulant sa trompe autour de lui, le jeta sur son dos et le conduisit dans l'endroit où se trouvaient les habitations. Lorsque les gens de ce canton virent le cheikh, ils furent surpris et allèrent à sa rencontre, afin de connaître son histoire. Quand il fut arrivé près d'eux, l'éléphant le prit avec sa trompe de dessus son dos, et le déposa sur la terre, de manière que ces individus le vissent. Ils s'approchèrent de lui, regardant sa présence comme un moyen de se sanctifier, et le conduisirent à leur roi, à qui ils firent connaître son aventure. C'étaient des infidèles, chez lesquels il resta durant plusieurs jours. Cet endroit est situé près d'un fleuve (khaour), appelé de Khaïzorân (ou des bambous). Khaour signifie la même chose que nahr (fleuve; et de plus, l'embouchure d'un fleuve. Cf. Albîroûny, apud Reinaud, Fragments relatifs à l'Inde, p. 119). C’est en ce lieu que se trouvent les pêcheries des perles, (litt. pierres précieuses). On raconte que le cheikh, ayant un jour plongé en présence du roi de ces idolâtres, sortit de l'eau, tenant ses mains fermées, et dit au roi : « Choisis le contenu d'une de mes mains. » Le roi choisit ce qui se trouvait dans la main droite, et le cheikh le lui jeta. C'étaient trois rubis sans pareils, qui sont encore en la possession des rois de ce pays, et sont placés sur la couronne. Ces princes se transmettent ces joyaux par héritage.
Je suis entré dans cette île de Ceylan; les habitants persistent dans leur idolâtrie, mais ils vénèrent les fakirs musulmans, leur donnent l'hospitalité dans leurs maisons et leur servent de la nourriture, tandis qu'ils sont dans leurs demeures, au milieu de leurs femmes et de leurs enfants. Ils en usent ainsi contrairement aux autres infidèles de l'Inde. Ceux-ci n'approchent pas des musulmans, et ne leur servent point à manger ou à boire dans leurs vases, quoiqu'ils ne les vexent ni ne les offensent. Nous étions obligés de faire cuire pour nous de la viande par quelqu'un d'entre ces gens. Ils l'apportaient dans leurs marmites, et s'asseyaient à quelque distance de' nous. Ils apportaient aussi des feuilles de bananier, sar lesquelles ils plaçaient le riz, qui forme leur nourriture, ils répandaient sur ce riz du couchân (cf. ci-après, à l'article de Makdachaou), qui sert d'assaisonnement, et s'en allaient. Nous mangions de cet aliment, et ce qui en restait était dévoré par les chiens et les oiseaux. Si un petit enfant, n'ayant peint encore l'âge de raison, mangeait de ces restes, ils le battaient « t lui faisaient avaler de la bouse de vache, ce qui, selon leur erOyance, purifie de cette souillure.
Parmi les mausolées de Chiraz, on remarque encore celui du pieux cheikh, Kothb eddîn Roûz Djihan alkabaly, un des principaux saints, ou amis de Dieu. Son tombeau se trouve dans une mosquée djâmi, où l'on fait la khothba. C'est dans cette mosquée que prie le kadi Medjd eddîn, dont il a été fait mention plus haut. Dans la même mosquée, j'ai entendu expliquer par ce cheikh le Mosned de l'imam Abou Abd Allah Mohammed, fils d'Idris achchâfi'y. Il disait que ce livre lui avait été enseigné par Wezîrah, fille d'Omar, fils d'Al-moneddja. Wezîrah disait avoir été instruite par Abou Abd Allah alhoceïn, fils d’Abou Bekr, fils d'Almobârec azzobeïdy. Celui-ci citait comme son maître Abou Zer'ah Thâhir, fils de Mohammed, fils de Thâhir almokaddecy, qui avait eu pour professeur Aboul Haçan almekky, fils de Mohammed, fils de Mansour, fils d'Allân al'ourdhy. Almekky nommait pour son maître le kadi Abou Bekr Ahmed, fils d'Alhaçan al-harachy, lequel alléguait Abou'l'abbis, fils de Yakoub al-açamm (le sourd), qui citait Arréby', fils de Soleïman almorâdy, enfin, ce dernier avait entendu professer l'imâm Abou Abd Allah achchâfi'y. J'ai entendu également dans cette mosquée expliquer, par le kadi Medjd eddîn, les Méchârik alanwâr (les Orients des lumières), composés par l'imâm Radhy eddîn Abou'l fadhâïl alhaçan, fils de Mohammed, fils de Haçan assaghâny. Il avait obtenu le droit d'enseigner cet ouvrage, du cheikh Djélal eddîn Abou Hâchîm Mohammed, fils de Mohammed, fils d'Ahmed alhâchimy al-coûfy, qui l'avait entendu lire par l'imâm Nizâm eddîn Mahmoud, fils de Mohammed, fils d'Omar alherawy, qui lui-même tenait ce droit de l'auteur de l'ouvrage.
On remarque encore à Chiraz le mausolée du pieux cheikh Zercoûb (en persan, batteur d'or), près duquel se trouve un ermitage, où l'on donné à manger aux pauvres et aux voyageurs. Tous ces monuments sont situés dans l'intérieur de la ville, ainsi que la plupart des tombeaux des habitants.
Si, par exemple, le fils ou la femme d'un de ceux-ci vient à mourir, il prépare un sépulcre dans une des chambres de sa maison, et y ensevelit le défunt. Il recouvre le plancher de l'appartement de nattes et de tapis, place de nombreuses bougies près de la tète du mort et de ses pieds, et adapte à la chambre une porte et une grille en fer, du côté de la rue. C'est par là qu'entrent les lecteurs du Coran, qui lisent ce livre avec des voix superbes. Il n'y a pas, dans toute la terre habitée, de gens qui aient de plus belles voix pour lire le Coran, que les citoyens de Chiraz. Les habitants de la maison mortuaire prennent soin du mausolée, le couvrent de tapis et y entretiennent des lampes allumées. C'est comme si la personne morte n'était pas absente : on m'a rapporté que ces gens-là font cuire chaque jour la portion du défunt, et la distribuent comme une aumône à son intention.
Je passai un jour dans un des marchés de Chiraz, et j'y vis une mosquée élégamment construite et bien pavée. On y apercevait des Corans enfermés dans des bourses de soie, et placés sur une estrade. Au côté septentrional de la mosquée était un ermitage, où se trouvait une jalousie qui s'ouvrait sur le marché. Un cheikh, d'une jolie figure et couvert de beaux vêtements, se tenait en cet endroit, et avait devant lui un Coran, dans lequel il lisait. Je le saluai et m'assis à son côté; et il m'interrogea touchant mon arrivée. Je répondis à sa demande, et le questionnai au sujet de cette mosquée. Il m'apprit qu'il l'avait fondée, et qu'il y avait joint, par un wakf (fondation pieuse), des propriétés considérables, pour servir à l'entretien de lecteurs du Coran, et d’autres personnes. Quant à cet ermitage dans lequel j'étais assis près de lui, c'était le lieu destiné à sa sépulture, si Dieu le faisait mourir dans cette ville. Ensuite il souleva un tapis placé sous ses pieds, et il y avait là son tombeau, qui était recouvert de planches. Il me fit voir une caisse qui se trouvait du côté opposé et me dit : « Dans ce coffre sont mon linceul, les aromates destinés à parfumer mon corps, ainsi que des pièces d'argent, pour le prix desquelles j'ai loué mes services à un homme pieux, afin de lui creuser un puits. Il m'a compté ces dirhems, et je les ai mis de côté, pour qu'ils servent aux frais de mon enterrement. Le surplus sera distribué en aumônes. » J'admirai sa conduite, et je voulus m'en retourner; mais il m'adjura de rester et me traita dans cet endroit.
Parmi les mausolées situés hors de Chiraz, est le tombeau du vertueux cheikh connu sous le nom de Saadi. C'était le premier poète de son temps en langue persane, et il a souvent déployé beaucoup de talent dans ses compositions en arabe. De ce tombeau dépend un bel ermitage, que Saadi a élevé en cet endroit, et dans l'intérieur duquel se trouve un joli jardin. Cet ermitage est situé dans le voisinage de.la source du grand fleuve, connu sous le nom de Rocn Abad. Le cheikh avait construit en ce lieu de petits bassins, de marbre, pour laver les vêtements. Les citoyens de Chiraz sortent de la. ville, afin de visiter ce mausolée; ils mangent des mets (préparés dans l'ermitage), et lavent leurs habits dans ce fleuve; puis ils s'en retournent C'est ainsi que j'en usai près de cet endroit. Que Dieu ait pitié de ce cheikh !
Dans les environs de cet ermitage il s'en trouve un autre, auquel est contigu un collège. Ces deux derniers sont construits près du tombeau de Chems eddîn Assemnâny, un des émirs versés dans la jurisprudence. Il a été enseveli en cet endroit, d'après ses dernières volontés.
Parmi les principaux fakîhs de la ville de Chiraz, est le chérif Medjîd eddîn, dont la libéralité est étonnante. Souvent il a donné en présent tout ce qu'il possédait, et jusqu'aux vêtements qu'il portait sur lui; il revêtait alors un habit tout rapiécé. Les grands de la ville venaient le voir, le trouvaient en cet état, et lui donnaient d'autres habits. La pension journalière qu'il reçoit du sultan se monte à cinquante dinars d'argent.
Je sortis de Chiraz afin de visiter le tombeau du pieux cheikh Abou Ishâk alcâzéroûny, à Câzéroûn. Cette ville est située à deux journées de marche de Chiraz. Nous campâmes le premier jour dans le pays des Choûl, tribu persane qui habite le désert, et qui renferme des gens pieux.
Je me trouvais un jour dans une des mosquées de Chiraz, et je m'étais assis, afin de lire le Coran, après la prière de midi. Il me vint à l'esprit que si j'en avais un exemplaire, j'y ferais une lecture. Sur ces entrefaites, un jeune homme entra et me dit à haute voix : « Prends. » Je levai la tête de son côté; il jeta dans mon giron un Coran et s'éloigna. Je le lus d'un bout à l'autre, dans le cours de la même journée ; après quoi j'attendis ce jeune homme, afin de lui rendre son livre; mais il ne revint pas. Je fis des questions touchant cet individu, et l'on me dit: « C'est Bohloûl, le Choûl. » Depuis lors je ne l'ai plus revu.
Nous arrivâmes à Câzéroûn le soir du second jour; nous nous dirigeâmes vers l'ermitage du cheikh Abou Ishâk (que Dieu nous soit en aide par son moyen !), et nous y passâmes la nuit. Les habitants de ce monument ont coutume de servir aux voyageurs, quels qu'ils soient, du hachis (herîceh) fait avec de la viande mélangée de blé et de beurre ; on le mange avec de la galette. Ils ne laissent pas partir l'individu qui arrive dans leur résidence, avant qu'il ne soit resté leur bête pendant trois jours, et qu'il n'ait fiait connaître ses besoins au cheikh qui réside dans l'ermitage ; et celui-ci les répète aux fakirs attachés à la zaouïa. Ils sont au nombre de plus de cent, parmi lesquels il y a des hommes mariés et des célibataires isolés. Ces individus lisent alors le Coran tout entier, ils récitent des prières; et font des vœux, en faveur de l'étranger, auprès du sépulcre du cheikh Abou Ishâk. Les besoins du voyageur sont ainsi satisfaits par la permission de Dieu.
Le cheikh Abou Ishâk est vénéré des habitants de l'Inde et de la Chine. Les voyageurs qui naviguent sur la mer de la Chine ont, coutume; lorsque le vent leur est contraire et qu'ils craignent les pirates, de faire un vœu à Abou Ishâk. Chacun d'eux s'oblige, par écrit, à acquitter le montant de son vœu. Lorsqu'ils sont arrivés en lieu de sûreté, les desservants de l'ermitage montent dans, le vaisseau, se; font remettre la liste des objets promis en offrande, et reçoivent de chacun la somme ou l'objet qu'il a voué au saint. Il n'y a pas, par conséquent, de vaisseau qui arrive de la Chine ou de l'Inde, sans qu'il s'y trouve des milliers de dinars. Des fondés de pouvoir se présentent de la part du desservant de l'ermitage, et reçoivent cette somme. Parmi les fakirs, il y en a qui viennent implorer l'aumône du cheikh. On écrit, pour, le solliciteur, un ordre de lui payer telle somme. Cet ordre est muni du paraphe du cheikh, gravé sur un cachet d'argent. On enduit le cachet de couleur rouge, et on l'applique sar le billet; la trace du sceau demeure sur cette cédule. Voici quelle en est la teneur : « Que celui qui a fait un vœu au cheikh Abou Ishâk donne, sur le montant de ce vœu, telle somme à tel individu. » L'ordre est pour mille pièces d'argent, ou pour cent, ou pour une somme entres les deux, ou pour une somme inférieure, d'après le mérite du fakir. Lorsque le fakir, muni d'un pareil billet, rencontre un individu qui s'est engagé par un vœu envers le cheikh, il reçoit le montant de ce vœu, et il écrit sur le dos del’ordre, pour la décharge de cet homme, une apostille énonçant combien il a touché. Le roi de l'Inde s'obligea un jour, par un vœu, à payer au cheikh Abou Ishâk la somme de dix mille dinars. La nouvelle de ce fait étant parvenue aux fakirs de l'ermitage, l'un d'eux se rendit dans l'Inde, reçut l'argent, et s'en retourna à la zaouïa avec tous ces dinars.
Nous partîmes de Câzéroûn pour la ville de Zeïdin (les deux Zeïd), appelée ainsi parce que les tombeaux de deux compagnons de Mahomet, Zeïd, fils de Thâbit, et Zeïd, fils d'Arkam, tous deux Ansâriens, se trouvent en cet endroit. C'est une belle ville, bien pourvue de vergers et d'eau. Elle possède de superbes marchés et des mosquées magnifiques. Ses habitants sont honnêtes, pleins de piété et de bonne foi. Un d'entre eux était le kadi Nour eddîn Azzeïdâny; il se rendit dans l'Inde, et fut investi de la dignité de juge à Dhibet Almahl (les Maldives), qui font partie de cette contrée. Dhibet Almahl est le nom d'un grand nombre d'iles, dont le roi était Djélal eddîn, fils de Salâk eddîn Sâlih ; le kadi épousa la sœur de ce roi. Quant à ce dernier, son histoire sera rapportée ci-après, ainsi que celle de sa fille Khadidjah, qui hérita de la royauté de ces îles après lui. Le kadi Nour eddîn mourut aux Maldives.
Nous partîmes de Zeïdân pour Howaïzâ (Hawiza), petite ville habitée par des Persans. Entre celle-ci et Basrah, il y a la distance de quatre jours de marche. Il faut un jour de plus pour aller de Howaïzâ à Coûfah. Au nombre des natifs de Howaïzâ, se trouve le cheikh pieux et dévot Djémal eddîn Alhowaïzâïy, cheikh du monastère de Sa’id asso'adâ, au Caire. Nous marchâmes de Howaïzâ vers Coûfah, par un désert où il ne se trouvait pas d'eau, excepté dans un seul endroit qui est appelé Attharfâouy, et que nous atteignîmes le troisième jour. Le second jour après notre départ de ce dernier lieu, nous arrivâmes à la ville de Coûfah.
C'est une des métropoles de l'Irak, et elle est distinguée parmi celles-ci par un mérite supérieur; c'est le lieu où ont séjourné les compagnons de Mahomet et leurs successeurs immédiats; et ce fut l'habitation des savants et des hommes pieux. Elle a été la résidence d'Aly, fils d'Abou Thâlib, commandant des fidèles. Mais elle est maintenant en grande partie ruinée, parce que les mains de l'iniquité se sont étendues vers elle. Le désordre qui y règne provient des Arabes khafâdjah, qui demeurent près de Coûfah, et qui pratiquent le brigandage sur son chemin.
Cette ville n'a pas de murailles; elle est construite eu briques, et ses marchés sont beaux. On y vend principalement des dattes et des poissons. Sa mosquée cathédrale la plus considérable est une grande et noble mosquée, qui contient sept nefs supportées par des colonnes de grosses pierres de taille, placées l'une sur l'autre, et liées avec du plomb fondu à leur hauteur est immense. La mosquée possède de nobles restes, et parmi ceux-ci une cellule en face du mihrâb, à droite de celui qui regarde la kiblah; l'on dit qu'Abraham, sur qui soit la bénédiction de Dieu! avait un oratoire dans cet endroit. Tout à coté se voit un autel, entouré de planches de bois de teck; il est élevé, et c'est le mihrâb d'Aly, fils d'Abou Thâlib. C'est dans ce lieu que le scélérat Ibn Moldjam l'a frappé, et le public s'empresse d'y venir prier.
Dans l'angle, au bout de cette nef, il existe une petite chapelle, entourée aussi de bois de teck, et l'on dit que c'est la place où la fournaise déborda (ou l'orifice bouillonna), lors du déluge de Noé (Coran, xi, 42). Derrière elle, à l'extérieur de la mosquée, est une habitation qu'on croit être celle de Noé, et vis-à-vis, une cellule qu'on dit avoir été l'oratoire d’Idris (Enoch). A côté se voit un vaste espace qui longe la paroi méridionale de la mosquée, et que l'on regarde comme le lieu où a été fabriquée l'arche de Noé. Au fond de cet espace se trouve l'hôtel d'Aly, fils d'Abou Thàlib, et la chambre où on le lava, après sa mort. Tout près de là, on remarque un édifice que l'on dit aussi avoir été la maison de Noé. Mais Dieu sait le mieux la vérité de tout cela.
Du côté oriental de la mosquée djâmi se trouve une cellule haute, à laquelle on monte. Elle renferme la tombe de Moslim, fils d'Akîl, fils d'Abou Thâlib; tout près de là, mais en dehors de la mosquée, se voit le sépulcre d'Aticah et de Socaïnah, filles de Hoçaïn. Quant au château du gouvernement, à Coûfah, qu'avait bâti Sa'd, fils d'Abou Ouakkâs, il n'en reste que les fondements. L'Euphrate est situé à une demi-parasange de cette ville, du côté de l'orient. Il est bordé d'enclos de palmiers touffus et entrelacés. J’ai vu au couchant du cimetière de Coûfah un endroit extrêmement noir sur une plaine blanche. L'on m'a informé que c'est le tombeau du scélérat Ibn Moldjam, et que la population de Coûfah s'y rend tous les ans avec beaucoup de bois, et allume du feu sur son sépulcre pendant sept jours. Dans le voisinage se trouve une coupole, et j'ai su que c'était la tombe d'Almokhtâr (l'Élu), fils d'Abou 'Obeïd.
Nous partîmes de Coûfah et fîmes halte à Bir Mallâhah (le puits de la Saline). C'est une belle ville, entre des vergers de palmiers; mais je descendis à l'extérieur de la cité et ne voulus point y entrer, car les habitants sont hérétiques. Nous la quittâmes dès le matin et campâmes à la ville de Hillah, qui est grande et longe l'Euphrate, lequel se trouve au levant. Elle possède de beaux marchés qui réunissent les denrées d'un produit avantageux, et les divers métiers; elle renferme une population nombreuse, et des enclos de palmiers la bordent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de sorte que les maisons sont situées entre ceux-ci. On y voit un grand pont, construit sur des bateaux réunis, et rangés entre les deux rives. Des chaînes de fer les entourent des deux côtés, et sont fixées, à chaque bord, à une grande poutre, solidement établie sur le rivage.
Les habitants de cette ville sont tous de la secte des douze imâms. Ils se divisent en deux populations, dont l'une est connue sous le nom de Kurdes, et l'autre sous celui de Gens des deux djâmi[26] (c'est-à-dire de Hillah). La discorde règne continuellement entre eux, et le combat ne cesse jamais. Près du marché principal se voit une mosquée, sur la porte de laquelle est un rideau de soie, baissé. On l'appelle le Sanctuaire du maître de l'époque (le dernier imâm). C'est la coutume que chaque jour cent hommes d'entre les habitants de la ville, revêtus de leurs armes, et tenant à la main leurs sabres dégainés, se rassemblent et se rendent chez le commandant de la place, après la prière de l'asr. Ils reçoivent de lui un cheval sellé et bridé, ou bien une mule avec son harnais; puis ils jouent des tambours, des trompettes et des clairons devant la bête, que cinquante hommes précèdent, et qui est suivie par un pareil nombre. Il y en a aussi qui marchent des deux côtés, à la droite de l'animal et à sa gauche. Ils se dirigent ainsi vers le sanctuaire du maître de l'époque, ils s'arrêtent à la porte, et s'écrient : « Au nom de Dieu, ô maître de l'époque, au nom de Dieu, sors; car la corruption est apparue et l'injustice est grande! C'est le moment pour toi de sortir, afin que Dieu distingue par ton moyen ce qui est vrai de ce qui est faux. » Ils continuent d'agir de cette manière, tout en jouant des clairons, des tambours et des trompettes, jusqu'à la prière du coucher du soleil. Ces gens prétendent que Mohammed, fils d'Alhaçan al'ascary, est entré dans cette mosquée et s'y est caché; mais qu'il en sortira. C'est l'imâm qu'ils attendent.
Après la mort du sultan Abou Sa’id, la ville de Hillah avait été conquise par l'émir Ahmed, fils de Romaïthah, fils d’Abou Nemy, prince de la Mecque. Il la posséda quelques années, et tint une excellente conduite; aussi les habitants de l'Irak le louaient. Plus tard, il fut vaincu par le cheikh Haçan, sultan de l'Irak, qui le soumit à la torture, le tua, et s'empara de ses biens et de ses trésors.
Nous partîmes de Hillah et nous allâmes à la ville de Kerbela, lieu de sépulture d'Alhoçaïn, fils d'Aly. La place est petite, entourée d'enclos plantés de palmiers, et arrosée par l'eau de l'Euphrate. Le saint mausolée est dans l'intérieur de la ville, et à côté de celui-ci sont un grand collège et une illustre zaouïa, qui distribue de la nourriture à tout venant. A la porte du mausolée se tiennent les chambellans et les gardiens, et personne n'entre sans leur permission. L'on baise le noble seuil, qui est d'argent. Au-dessus de la sainte tombe, se voient des lampes d'or et d'argent, et aux portes, des rideaux de soie. Les habitants de cette ville se divisent en deux groupes : les uns sont appelés Fils de Rakhîc, et les autres Fils de Fâïz. Il existe entre eux une guerre perpétuelle, quoique tous soient imâmiens et qu'ils tirent leur origine du même père. C'est à cause de leurs querelles que la ville est ruinée.
Nous arrivâmes ensuite à la ville de Bagdad, demeure de la paix, capitale de l'islamisme, qui possède un noble pouvoir, un mérite éminent, séjour des khalifes, et siège des savants.
Voici ce que dit Abou'l Hoçaïn, fils de Djobaïr : « Bien que cette ville illustre n'ait pas cessé d'être la demeure du khalifat abbâside, et le lieu de concours pour la prière des imâms Koraïchites, ses traces sont pourtant détruites, et il ne reste debout que son nom. Elle est, par rapport à son état, avant que les malheurs fondissent sur elle, et que les yeux des calamités se tournassent vers elle, elle est, dis-je, comme un vestige oblitéré, ou pareille à un spectre qui s'évanouit. Elle ne possède aucune beauté capable d'arrêter les regards, ou d'inviter l'homme pressé à la négligence de ses occupations et à l'examen, si ce n'est le fleuve, le Tigre, qui se trouve entre son levant et son couchant (c'est-à-dire entre le quartier oriental de Bagdad et le quartier occidental), comme un miroir brillant entre deux bordures, ou un collier de perles entre deux seins. Elle s'abreuve de son eau et ne souffre pas de la soif; elle se regarde dans ce miroir poli qui ne se ternit pas (litt. ne se rouille pas) ; et la beauté féminine fleurit grâce à son atmosphère et à son eau. » Ibn Djozay ajoute : « L'on dirait vraiment qu'Abou Tammâm Habib, fils d'Aous, a connu le terme où devait aboutir cette ville, lorsqu'il a écrit à son sujet : »
Le messager de la mort s'était déjà levé contre la ville de Baghdâd; or, que celui qui la pleure verse des larmes sur elle à cause de la dévastation du temps!
Elle était placée sar le courant de son fleuve et la guerre était allumée ; mais par une bonté toute spéciale, le feu sera éteint dans ses districts.
On espérait à son égard un retour heureux de la fortune; et maintenant, te désespoir a fait disparaître celui qui espérait pour elle.
Il en est ainsi de la vieille femme dont la jeunesse s'est enfuie, et qu'abandonne une beauté qui d'abord l'avait favorisée.
« Les gens ont composé des poésies à l'éloge de Bagdad, ils ont mentionné ses beautés, et ils ont été prolixes. Car, ils ont trouvé le sujet digne qu'on s'y arrêtât, ils ont été longs, et ils ont bien parlé. — Voici ce qu'a écrit l'imâm, le kadi, Abou Mohammed 'Abd Alouahhâb, fils d'Aly, fils de Nasr, le mâlikite, de Bagdad. Ce sont des vers, que feu mon père m'a récités plus d'une fois.
La température excellente de Bagdad m'excite à demeurer au sein de cette ville, bien que les destinées y mettent obstacle.
Et comment la quitterais-je maintenant, vu qu'elle réunit un doux climat et un ravissant attrait? (Cf. t. I.)
Le même poète dit encore sur Bagdad : »
Que la paix soit sur Bagdad, dans chaque demeure ! et cette ville mérite en effet de ma part un salut redoublé.
Par Dieu! je ne l'ai point quittée par haine pour elle, et je connais fort bien les bords de ses deux quartiers.
Mais, toute vaste qu'elle est, elle a été trop étroite pour moi, et les destins n'y ont pas été favorables.
Elle ressemblait à un ami dont l'approche m'était agréable, mais dont les belles qualités s'éloignaient de lui et devenaient rebelles.
Il dit encore, transporté de colère contre cette ville, les vers qui suivent, et que feu mon père m'a déclamés plu sieurs fois :
Bagdad est une demeure, vaste pour les personnes riches, mais pour les pauvres, c'est l'habitation de la gêne et de l'angoisse.
J'errais égaré dans ses rues, comme si j'eusse été un exemplaire du Coran dans la maison d'un athée.
Voici, du sujet de Bagdad, des vers du kadi Abou'l Haçan Aly, fils d'Annabîh, qui font partie d'un poème » (il s'agit ici probablement de sa chamelle) :
Elle a contemplé dans l'Irak une pleine lune brillante, puis elle a traversé des ténèbres et a plongé dans la chaleur du midi.
Elle a trouvé bon le parfum des zéphyrs à Bagdad; et, si ce n'avait été la fatigue, elle se serait sans doute envolée.
Elle s'est rappelée, parmi les prairies de Carkh (un faubourg de Bagdad), un verger toujours vert, et une eau toujours limpide.
Elle a cueilli des fleurs sur les collines du Mohawwil (petite ville et lieu de plaisance à une parasange de Bagdad), et elle a admiré une splendeur sur les terrasses du Tadj (salle célèbre, en forme de portique, dans le palais des khalifes, à Bagdad).
Voici enfin ce que dit une des femmes de Bagdad, au sujet de cette ville :
Un soupir sur ce Bagdad, sur son Irak, sur ses faons (les jeunes filles) et sur la magie de leurs prunelles!
Leur cirque est près de l'Euphrate (ou mieux, le Tigre), et ils offrent des faces dont les beautés, â l'instar des nouvelles lunes, brillent au-dessus de leurs colliers.
Ils se carrent dans le plaisir, comme si le sentiment naturel de l'amour virginal était une de leurs qualités.
Puissé-je leur servir de rançon! car tout ce qu'on voit de beau dans tous les temps, doit sa splendeur à l'éclat de leur soleil brillant.
Mais revenons au récit.
Bagdad possède deux ponts, formés à peu près de la manière que nous avons décrite au sujet de celui de la ville de Hillah. Le public les traverse nuit et jour, les hommes comme les femmes; et ils trouvent en cela un agrément continuel. Cette ville renferme onze de ces mosquées dans lesquelles on récite la khothba, et on célèbre la prière du vendredi. Il y en a huit dans la partie occidentale de Bagdad, et trois dans la portion orientale. Quant aux autres mosquées ou chapelles, elles sont fort nombreuses, et il en est de même des collèges; mais ceux-ci sont ruinés. Les bains sont en grande quantité et des plus jolis; la plupart sont enduits à l'extérieur, y compris la terrasse, avec de la poix; de sorte que quiconque regarde cet enduit croit que c'est du marbre noir. On tire cette poix d'une source située entre Coûfah et Basrah, et qui en fait couler continuellement.
Elle s'amasse, comme de l'argile, aux bords de la source, d'où on l'enlève avec des pelles, et on l'exporte à Bagdad. Dans chaque établissement de bains se voient beaucoup de cabinets, dont le sol est recouvert de poix. Il en est ainsi de la moitié de la muraille qui touche la terre; la moitié supérieure est enduite de plâtre, d'un blanc pur. Ainsi, les deux contraires y sont réunis, et leurs beautés sont placées en présence l'une de l'autre. A l'intérieur de chacun de ces cabinets, il existe un bassin de marbre avec deux robinets, dont l'un laisse couler de l'eau chaude et le second, de l'eau froide. Il n'entre qu'une seule personne à la fois dans ces cabinets, et nul ne l'accompagne, à moins qu'elle ne le désire. Dans un coin de toutes ces cellules, il y a aussi un autre bassin pour se laver; il est pourvu également de deux robinets qui laissent couler de l'eau chaude et de l'eau froide. On donne à tous ceux qui entrent trois serviettes, l'une pour se couvrir les parties sexuelles en entrant, l'autre pour se couvrir en sortant, et la troisième pour s'essuyer le corps.
Je n'ai point vu pareil arrangement dans une autre ville que Bagdad. Seulement quelques pays s'en rapprochent à cet égard.
Le coté occidental de cette ville est celui qui a été fondé le premier, et il est maintenant en grande partie ruiné. Malgré cela, il en reste encore treize quartiers, dont chacun ressemble à une ville, et contient deux ou trois bains; huit de ces quartiers possèdent des mosquées principales. L'un de ceux-ci est celui nommé le quartier de la porte de Basrah, et l'on y voit la mosquée djâmi du khalife Abou Djafar al-mansoûr. L'hôpital est situé entre le quartier de la porte de Basrah et celui du Châri' (la grande, route), sur le Tigre. C'est un vaste château ruiné, dont il reste des vestiges.
On remarque dans ce côté occidental de la ville les mausolées suivants :
1° Le tombeau de Ma'roûf alcarkhy, qui se trouve dans le quartier de la porte de Basrah.
2° Un mausolée soigneusement construit, sur le chemin de la porte de Basrah. Il contient une tombe, avec une vaste convexité, et sur laquelle se lit l'épitaphe suivante : « C'est ici le sépulcre d'Aoun, un des fils d'Aly, fils d'Abou Thâlib. »
3° Le sépulcre de Mouça alcâzhim (celui qui se tait, qui réprime sa colère), fils de Djafar assâdik et père d'Aly, fils de Mouça arridha ; et l'on voit encore à côté de celui-ci le sépulcre d'Aldjaouâd (Mohammed, le neuvième imam). Tous les deux sont dans l'intérieur d'un même mausolée, et sur eux se voit une estrade recouverte de bois, lequel est plaqué de lames d'argent.
Ce côté oriental de Bagdad abonde en places, et offre une disposition magnifique. Le plus grand de ces marchés est celui appelé du mardi, et où tous les métiers ont leur lieu séparé. Au milieu se voit le collège Annizhâmiyah, qui est admirable, et dont la beauté a donné naissance à des proverbes. Au bout du marché se trouve le collège Almostansiriyah, attribué au commandant des croyants Almostansir billah Abou Djafar, fils du commandant des croyants Azzhâhir, fils du commandant des croyants Annâcir. Il renferme les quatre rites orthodoxes, et chaque secte a son pavillon séparé, où se trouvent la mosquée et le lieu de la classe. La leçon du professeur a lieu sous une petite coupole de bois, et sur une chaire recouverte de tapis. Le professeur s'assied et montre du calme et de la gravité. Il est revêtu d'habits noirs et coiffé d'un turban. A sa droite, ainsi qu'à sa gauche, se tiennent deux répétiteurs, qui redisent tout ce qu'il dicte. C'est de cette manière que se passent toutes les assemblées des quatre sectes orthodoxes. A l'intérieur du collège il y a un bain pour les élèves et une maison pour les ablutions.
On compte dans ce côté oriental de la ville trois mosquées cathédrales : l’une est celle appelée la Mosquée djâmi du khalife, qui est adjacente aux palais des khalifes et à leurs habitations. C'est une grande mosquée principale, où sont des fontaines et des lieux de purifications en grand nombre, soit pour faire les ablutions, soit pour se laver. J'y ai rencontré le cheikh, le savant et pieux imâm, l'appui de l'Irak, Sirâdj eddîn, Abou Hafs Omar, fils d'Aly, fils d'Omar alkazouîny, et je lui ai entendu expliquer tout le Mosned d'Abou Mohammed Abd Allah, fils d'Abd er-Rahman, fils d'Alfadhl, fils de Behram addârimy. Cela avait lieu dans le mois de redjeb, l'unique, de l'année sept cent vingt-sept (juin 1327 de J. C). Il dit :
« Nous avons été instruit sur ce sujet par la pieuse cheikhah, pleine d'autorité, maîtresse des rois, Fatima, fille du juste Tadj eddîn Abou’ Haçan Aly, fils d'Aly, fils d'Abou'lbedr.
« Et elle s'est ainsi exprimée :
« Nous avons été instruite par le cheikh Abou Bekr Mohammed, fils de Maç'oud, fils de Behroûz le bon (atthayyib) almârestâny. »
« Ce dernier dit :
« Celui qui nous à instruit a été Abou'louakt, Abd al-awwal, fils de Chô'aïb assindjary assoûfy. »
« Celui-ci dit à son tour :
« Nous avons entendu l'imam Abou’ Haçan, Abd er-Rahman, fils de Mohammed, fils d'Almozhaffar addâoudy. »
« Celui-ci dit :
« Nous avons pris les leçons d'Abou Mohammed Abd Allah, fils d'Ahmed, fils de Hamoûyah assarakhsy. »
« Le dernier personnage que nous avons nommé les avait reçues d'Abou 'Amrân Iça, fils d'Omar, fils d'Al'abbâs assamarkandy; celui-ci, enfin, d'Abou Mohammed Abd Allah, fils d'Abd er-Rahman, fils d'Alfadhl addârimy. »
La seconde mosquée cathédrale (de la partie de Bagdad placée au levant du Tigre) est celle nommée la Mosquée djâmi du sultan; elle est située au dehors de la ville, et contiguë à des châteaux qu'on appelle les Châteaux du sultan.
La troisième porte le nom de Djâmi arrossâfah; et il y a environ un mille entre celle-ci et la mosquée du sultan.
Les tombes des khalifes abbâsides sont à Rossâfah, et sur chaque sépulcre est écrit le nom de celui qu'il renferme. Nous mentionnerons les suivants :
1° Almahdy, 2° Alhâdy, 3° Alamîn, 4° Almo'tassim, 5° Alouâthik, 6° Almotewakkil, 7° Almontassir, 8° Almosta'în,9°Almo,tazz, 10° Almohtady, 11° Almo'tamid, 12° Al-mo'tadhid, 13° Almoctafy, 14° Almoktadir, 15° Alkâhir, 16° Arrâdhy, 17° Almottaky, 18° Almostacfy, 19° Almothî', 20° Atthâi', 21° Alkâïm, 22° Alkâdir (chronologiquement parlant, celui-ci aurait dû être nommé avant le précédent), 23°Almostazhhir, 24° Almostarchid, 25°Arrâchid, 26° Almoktafy, 27° Almostandjid, 28° Almostadhy, 29° Annâssir, 30° Azzhâhir, 31° Almostansir, 32° Almosta'ssim. Celui-ci est le dernier de tous, car c'est sous lui que les Tartares sont entrés à Baghdâd, le sabre à la main, et ils l'ont égorgé quelques jours après leur entrée dans la ville. Depuis lors le nom du khalifat abbâside a cessé pour Baghdâd, et ce fut dans l'année 654 (lisez 656 = 1258 de J. C). Dans le voisinage de Rossâfah est la tombe de l'imâm Abou Hanîfah, sur laquelle se votent une grande coupole et une zaouïa, où l'on donne à manger à tous ceux qui se présentent. Il n'y a pas maintenant, dans toute la ville de Bagdad, d'autre zaouïa que celle-ci qui fournisse de la nourriture. Louons l'Eternel, qui ruine les choses et qui les change! Tout près de là se voit aussi le tombeau de l'imâm Abou Abd Allah Ahmed, fils de Hanbal. Il n'a point de coupole, et l’on raconte qu'à plusieurs reprises on en avait dressé une sur son sépulcre, mais qu'elle fut toujours détruite par le décret de Dieu très haut. Cette tombe est en grande vénération près des habitants de Bagdad, dont la plupart suivent le rite dudit imâm. A peu de distance se trouvent les tombeaux d'Abou Bekr achchibly, un des imâms de la secte des soufis, de Sariy assakathy, de Bichr alhâfy, et de Daoud atthâiy, et, enfin, celui d'Abou'lkâcim aldjonaïd. Que Dieu leur soit favorable!
Les gens de Bagdad ont un jour consacré, toutes les semaines, pour la visite d'un de ces cheikhs, et un autre jour pour la visite de celui qui le suit, et ainsi des autres, jusqu'à la fin de la semaine. Dans cette ville, il y a une grande quantité de sépultures de personnages pieux et de savants. Que Dieu soit satisfait d'eux tous!
Enfin, ce côté oriental de la ville n'a point de fruits, mais on lui en apporte du côté occidental, où se trouvent les jardins et les vergers.
Mon arrivée à Bagdad coïncida avec le séjour du roi de l'Irak dans cette ville. Je le mentionnerai donc en cet endroit.
C'est l'illustre sultan Abou Sa'id Behadour khân (khân, chez les Mongols, signifie roi), fils du sultan illustre Mohammed Khodhâbendeh. Ce dernier est celui des rois tatars qui embrassa l'islamisme; mais l'on n'est pas d'accord touchant la véritable prononciation de son nom: il y en a qui prétendent que ce nom est Khodhâbendeh. Quant au mot bendeh, il n'y a pas de désaccord à son sujet. Selon cette opinion, le nom du sultan signifie l’esclave de Dieu ; car Khodhâ, en persan, est le nom de Dieu, et bendeh veut dire esclave, on serviteur, ou quelque chose d'analogue. Mais on dit aussi que le vrai nom du sultan était Kherbendeh. Le sens de kher, en langue persane, est âne. D'après cela, le mot kherbendeh signifierait le valet de l'âne. La contradiction qui existe entre les deux versions sera tranchée, en reconnaissant que la dernière est la plus répandue; mais que le roi la changea contre la première dénomination, par zèle religieux. Le motif pour lequel il fut appelé du dernier de ces deux noms, c'est, dit-on, que les Tatars donnent à leur nouveau-né le nom de la première personne qui entre dans la maison, après sa naissance. Lorsque ce sultan vint au monde, la première personne qui entra était un muletier, que les Tatars appellent kherbendeh : c'est pourquoi le petit prince fut appelé de ce nom. Le frère de Kherbendeh était Kazghan, que le vulgaire nomme Kazan. Kazghan désigne un chaudron; On dit que ce prince reçut ce nom, parce que, lors de sa naissance, une jeune esclave vint à entrer portant un chaudron.
C'est ce Khodhâbendeh qui fit profession de l'islamisme. Nous avons conté ci-dessus son histoire, et comment, lorsqu'il se fut converti à la foi musulmane, il voulut porter ses sujets à embrasser la doctrine râfidhite. Nous avons aussi exposé l'aventure qui lui arriva avec le kadi Medjd eddîn. Lorsque ce prince fut mort, son fils Abou Sa'id Behadour khân monta sur le trône. C'était un roi excellent et généreux, et il commença à régner étant encore dans l'enfance. Quand je le vis à Bagdad, c'était un adolescent, la plus belle des créatures de Dieu dans son aspect, et il n'y avait aucun duvet sur ses joues. Son vizir était alors l'émir Ghiâth eddîn Mohammed, fils du Khodjah Rachid. Le père de ce vizir était un juif émigré, que le sultan Mohammed Khodhâbendeh, père d'Abou Sa'id, avait pris pour ministre. Je vis un jour ce dernier souverain et son vizir, dans une barque (harrâkah), sur le Tigre; elle porte à Bagdad le nom de chabbârah, et c'est une sorte de seloûrah. (Cf. Fleischer, De glossis habichtianis, p. 71.) Le sultan avait devant lui Dimachk Khodjah, fils de l'émir Djoûbân, qui exerçait sur Abou Sa'id un pouvoir despotique. A sa droite et à sa gauche voguaient deux barques, remplies de joueurs d'instruments et de chanteurs.
Voici un des actes de générosité que j'ai vu accomplir par le sultan ce jour-là : plusieurs aveugles se présentèrent devant lui et se plaignirent de leur misérable position; il assigna à chacun d'eux un vêtement, un esclave pour le conduire, avec une somme pour son entretien.
Lorsque le sultan Abou Sa'id monta sur le trône, étant tout jeune, ainsi que je l'ai dit, l'émir des émirs, Djoûban ; s'empara du pouvoir, et lui interdit la disposition de toute chose, si bien qu'il ne possédait de la royauté que le nom. On raconte qu'Abou Sa’id eut besoin d'une somme d'argent pendant une certaine fête; mais il n'avait pas pu réussir à se la procurer. Il s'adressa alors à un marchand, qui lui donna tout l'argent qu'il voulut. Abou Sa'id ne cessa de rester dans cet état de sujétion, jusqu'à ce qu'un jour une des femmes de son père, Dounya khatoun, vint le trouver et lui dît : « Si nous étions les hommes, nous ne laisserions pas Djoûbàn et son fils, dans la situation où ils se trouvent. » Il lui demanda ce qu'elle voulait dire par ces paroles. Elle lui répondit : « L'insolence de Dimachk Khodjah, fils de Djoûban, est parvenue à ce point, qu'il ose avoir commerce avec les femmes de son père. Il a passé la nuit dernière avec Thaghy khatoun, et m'a envoyé dire : « Je passerai là prochaine nuit avec toi. » La prudence te commande de rassembler les émirs et les troupes. Lorsqu'il sera, monté secrètement à la forteresse pour y passer la nuit, tu pourras le faire arrêter. Dieu mettra ordre à l'affaire de son père. » Djoûbân était alors dans le Khoraçan. La colère s'empara d'Abou Sa'id, et il employa la nuit à prendre ses mesures. Lorsqu'il sut que Dimachk Khodjah était dans le château, il ordonna aux émirs et aux troupes de l'entourer de tous côtés. Le lendemain matin, Dimachk sortit, accompagné d'un soldat nommé Alhâddj almisry (le pèlerin égyptien). Il trouva une chaîne tendue en travers de la porte du château et fermée d'un cadenas. Il ne lui fut donc pas possible de sortir à cheval. Alhâddj almisry frappa la chaîne avec son épée et la coupa. Ils sortirent alors tous deux; mais les troupes les entourèrent. Un des émirs attachés à la personne du sultan, nommé Misr Khodjah, et un eunuque nommé Loulou, atteignirent Dimachk Khodjah, le tuèrent et apportèrent sa tète au roi Abou Sa'id. On la jeta sous les pieds de son cheval, car ces gens ont coutume d'agir ainsi avec les têtes de leurs principaux ennemis.
Le sultan ordonna de piller la maison de Dimachk, et de tuer ceux de ses serviteurs et de ses esclaves qui résisteraient. Cette nouvelle parvint à Djoûbân, dans le Khoraçan. Il avait près de lui ses fils, émir Haçan, qui était l’aîné, Thâlich et Djelaou khan. Ce dernier était le plus jeune, et neveu du sultan Abou Sa'id : sa mère Sâthy beg, étant fille du sultan Khodhâbendeh. Djoûbân avait aussi près de lui les troupes des Tatars et leurs auxiliaires. Tous s'accordèrent à combattre le sultan Abou Sa'id, et marchèrent contre lui ; mais, lorsque les deux années furent en présence l’une de l'autre, les Tatars s'enfuirent près de leur sultan et abandonnèrent Djoûbân. Quand celui-ci vit cela, il rétrograda, prit la fuite vers le désert du Sedjestan et s'y enfonça. Il se détermina ensuite à se retirer près du roi de Herat ; Ghiâth eddîn, à implorer son secours, et à se fortifier dans sa ville capitale; car il avait jadis accordé, des bienfaits à ce dernier. Ses fils Haçan et Thâlich ne furent pas d'accord avec lui à ce sujet, et lui dirent : « Il ne sera pas fidèle à sa promesse; car il a trahi Firouz chah (Nauroûz), lorsque celui-ci se fut réfugié près de lui, et il l’a mis à mort. » Djoûbân refusa de renoncer à son dessein de se retirer prés de Ghiâth eddîn. Ses deux fils aînés l'abandonnèrent, et il se mit en marche, accompagné de son fils cadet Djelaou khân. Ghiâth eddîn sortit à sa rencontre, mit pied à terre devant lui, et le fit entrer dans la ville, sous la foi d'un sauf-conduit. Mais quelques jours après, il le trahit, le tua, ainsi que son fils et envoya leurs têtes au sultan Abou Sa'id. Quant à Haçan et à Thâlich, ils se dirigèrent vers Khârezm et vers le sultan Mohammed Uzbek. Celui-ci les reçut avec honneur et leur donna l'hospitalité ; mais ces deux individus commirent plus tard des actes qui rendirent leur mort nécessaire, et Uzbek les fit périr.
Djoûbân avait un quatrième fils, nommé Demur Thâch (pierre de fer), qui s'enfuit en Egypte, Mélik Nacir le traita généreusement, et lui donna Alexandrie. Demur Thâch refusa de l'accepter, et dit : « Je désire seulement des troupes pour combattre Abou Sa'id. » Lorsque Melik Nacir lui envoyait un vêtement, il en donnait au porteur un plus beau, pour ravaler Mélik Nacir. Il commit des actions qui exigèrent sa mort. En conséquence, le roi le tua, et envoya sa tète à Abou Sa'id. Nous avons raconté ci-dessus son histoire et celle de Karâ-Sonkoûr (cf. t. I).
Lorsque Djoûbân eut été tué, l'on amena son corps et celui de son fils; on fit avec eux la station sur l'Arafat et on les porta à Méstine, afin de les ensevelir dans le mausolée que Djoûbân avait fait construire dans le voisinage de la mosquée du prophète de Dieu; mais on en fut empêché, et on les enterra dans le Bakî', cimetière de Médine. C'est Djoûbân qui conduisit de l’eau à la Mecque.
Lorsque le sultan Abou Sa'id fut devenu seul maître de l'autorité, il voulut épouser la fille de Djoûbân, appelée Baghdâd khatoun, et qui était au nombre des plus belles femmes. Elle était mariée au cheikh Haçan, celui-là même qui s’empara du royaume, après la mort du sultan Abou Sa'id dont il était le cousin germain, par sa mère. Abou Sa'id donna des ordres, en conséquence desquels Haçan renonça à sa propre femme. Abou Sa'id l'épousa, et elle devint la mieux traitée de ses femmes. Celles-ci jouissent chez les Turcs et les Tatars d'un sort très heureux. Lorsqu'ils écrivent un ordre, ils y insèrent ces mots : « Par l'ordre du sultan et des khatoun. » Chaque khatoun possède quelques villes, quelques provinces et des revenus considérables. Lorsqu'elle voyage avec le sultan, elle loge dans un quartier séparé.
Baghdâd khatoun s’empara de l'esprit d'Abou Sa’id, et il lui donna la préférence sur toutes ses autres femmes. Elle demeura dans cet état presque tout le reste de la vie du sultan; mais ce prince, ayant épousé plus tard une femme appelée Dilchâd, il l'aima d'un violent amour, et négligea Baghdâd khatoun. Or celle-ci en fut jalouse, et empoisonna Abou Sa'id au moyen d'un linge, avec, lequel elle le frotta après l'acte conjugal. Il mourut, sa postérité s'éteignit, et ses émirs s'emparèrent des provinces, ainsi que je le raconterai.
Lorsque les émirs surent que c'était Baghdâd khatoun qui avait empoisonné Abou Sa'id, ils convinrent de la mettre à mort. L'eunuque grec, Khodjah Loulou, qui était un des principaux et des plus anciens émirs, s'empressa de mettre cette sentence à exécution. Il vint trouver Baghdâd khatoun pendant qu'elle était dans le bain, la frappa d'un coup de sa massue et la tua. Son corps resta étendu pendant plusieurs jours dans cette même place, les parties sexuelles recouvertes d'un morceau de tapis. Le cheikh Haçan s'empara du royaume de l'Irak arabe, et épousa Dilchâd, veuve du sultan Abou Sa'id, de même que celui-ci avait épousé sa femme.
Parmi ceux-là : 1° le cheikh Haçan, fils de la tante paternelle du sultan, et que nous venons de mentionner, se rendit maître de tout l'Irak arabe.
2° Ibrahim chah, fils de l'émir Sounîtah (Sounataï), s'empara de Mossoul et du Diârbecr.
3° L'émir Artena s'empara du pays des Turcomans, connu sous le nom de pays de Roum.
4° Haçan Khodjah, fils de Demurthâch, fils de Djoûbân, s'empara de Tabriz, de Sulthâniyah, de Hamadan, de Kom, de Kâchân, de Rey, de Werâmin, de Farghân (Wercân) et de Garadj.
5° L'émir Toghaïtomour se rendit maître d'une portion du Khoraçan.
6° L'émir Hoçaïn, fils de l'émir Ghiâth eddîn, s'empara de Hérat et de la plus grande partie du Khoraçan.
7° Mélik Dinar se rendit maitre des pays de Mecrân et de Kidj.
8° Mohammed chah, fils de Mozaffer, s'empara de Yezd, de Kermân et de Warkoû.
9° Mélik Kothb eddîn Temehten (Tehemten) s'empara de Hormouz, de Kich, de Kathîf, de Bahreïn et de Kalhât.
10° Le sultan Abou Ishâk, dont il a été fait mention précédemment, s'empara de Chiraz, d'Ispahan et du royaume de Fars, le tout comprenant une étendue de quarante-cinq jours de marche.
11° Enfin, le sultan Afrâciâb, l'atabek, dont il a été aussi fait mention ci-dessus, se rendit maître d’Îdhedj et d'autres contrées.
Mais revenons à notre propos. Je sortis de Bagdad avec la suite du sultan Abou Sa’id. Mon but, dans cette excursion, était d'observer l'ordre suivi par le roi de l'Irak dans ses marches et ses campements, et sa manière de voyager. La coutume des Mongols consiste à se mettre en route des le point du jour, et à camper vers l'heure de la matinée qui précède le moment où le soleil atteint sa plus grande hauteur. Voici l'ordre qu'ils observent : chaque émir arrive, avec ses soldats, ses timbales et ses étendards, et s'arrête dans un endroit qu'il ne dépasse pas, et qui lui a été assigné d'avance, soit à l'aile droite, soit à l'aile gauche. Lorsque tous sont arrivés et que leurs rangs sont au grand complet, le roi monte à cheval. Les timbales, les trompettes et les clairons destinés à annoncer l'heure du départ retentissent; chaque émir s'avance, salue le roi et retourne à son poste; puis les chambellans et les nakîbs, (officiers principaux) se présentent devant le roi Ils sont suivis des musiciens, au nombre d'environ cent, vêtus de beaux habits, et à cheval sur des montures appartenant au sultan. Devant les musiciens sont dix cavaliers, portant des timbales suspendues à leurs cous, et cinq cavaliers, lesquels portent des sornây ou flûtes (c'est l'instrument qui est appelé chez nous alghaïthah). Ils frappent ces timbales et jouent de ces flûtes; puis ils cessent, et dix des musiciens chantent leur partie. Lorsqu'ils l'ont terminée, les timbales et les flûtes se font entendre de nouveau; puis elles se taisent, dix autres musiciens chantent leur concert, et ainsi de suite, jusqu'à ce que dix actes soient terminés. C'est alors que l'armée campe.
Pendant le temps de la marche, les principaux émirs, au nombre d'environ cinquante, se tiennent à la droite-et à la gauche du sultan. Les porte-drapeaux, les timbaliers, les clairons et les trompettes suivent ce prince; puis viennent les esclaves du sultan, puis les émirs, chacun d'après son rang. Chaque émir possède des étendards, des timbales et des trompettes. L'émir djandar (ou émir du guet; cf. ci-dessus) est chargé de faire observer toutes ces dispositions, et il a sous ses ordres un nombreux détachement Le châtiment de celui qui reste en arrière de sa troupe et de son corps consiste à lui ôter sa chaussure, à la remplir de sable, et à la suspendre au col du coupable. Celui-ci marche à pied, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au lieu de la station. Alors on l'amène à l'émir, on le jette le ventre contre terre, et on le frappe de vingt-cinq coups de fouet sur le dos, soit qu'il jouisse d'un rang élevé, soit qu'il occupe une position infime; car on ne dispense personne d'obéir à cette loi.
Lorsque les troupes arrivent au lieu du campement, le sultan et ses mamlouks se logent dans un quartier séparé. Chacune des khatoun ou épouses du sultan loge aussi à part ; et elle a son imâm et ses muezzins, ses lecteurs du Coran, et un marché spécial pour l'approvisionnement de son quartier. Les vizirs, les câtibs et les employés campent séparément, et chaque émir campe aussi de son côté. Ils se rendent tous ensemble à l'audience du sultan, après l'asr, et en reviennent après la dernière prière du soir. On porte devant eux des lanternes.
Lorsque le départ a lieu, on bat la grande timbale, puis celle de la principale khatoun, qui occupe le rang de reine, puis les timbales des autres khatoun, puis celle du vizir, et enfin, les timbales des émirs toutes ensemble. Ensuite l'émir commandant l'avant-garde monte à cheval, avec son corps, et il est suivi des khatoun. Après elles viennent les bagages du sultan et son train, et les bagages des khatoun. A leur suite marche un autre émir, avec son détachement, pour empêcher les gens.de pénétrer entre les bagages et les khatoun ; vient enfin tout le reste de l'armée.
Je voyageai avec ce camp durant dix jours, puis j'accompagnai l'émir 'Alâ eddîn Mohammed à la ville de Tibrîz.
Ce personnage était au nombre des principaux émirs. Nous arrivâmes à Tibrîz, après une marche de dix jours, et nous logeâmes, en dehors de cette ville, dans un lieu nommé Châm, et où se trouve le tombeau de Kazan (Gazan), roi de l'Irak. Auprès de ce tombeau s'élèvent une belle medréceh et un ermitage où les voyageurs trouvent de la nourriture, consistant en pain, en viande, en riz accommodé avec du beurre, et en sucreries. L'émir me logea dans cet ermitage, situé entre des fleuves qui répandent au loin leurs eaux, et au milieu d'arbres touffus.
Le lendemain j'entrai dans la ville par une porte connue sous le nom de porte de Bagdad. Nous arrivâmes à un grand marché nommé marché de Kazan, et qui est un des plus beaux que j'aie vus dans l'univers : chaque métier y occupe une place séparée. Je traversai le marché des joailliers, et mon œil fut ébloui par toutes les espèces de pierres précieuses que je vis. Elles étaient entre les mains de beaux esclaves, revêtus de superbes habits, et portant en guise de ceintures des mouchoirs de soie. Ils se tenaient debout devant les marchands, leurs patrons, et offraient des joyaux aux femmes des Turcs, qui en achetaient un grand nombre, et cherchaient à se surpasser l'une l'autre dans cette dépense. Je vis, à cause de tout cela, un tumulte considérable. (Puisse Dieu nous préserver du pareil!)
Nous entrâmes ensuite dans le marché de l'ambre gris et du musc, et nous vîmes le même tumulte que j'ai mentionné tout à l'heure, ou même un plus grand. Puis nous arrivâmes à la mosquée djâmi fondée par le vizir Aly chah, connu par le nom de Djîlân. En dehors de cette mosquée, à droite de la personne qui regarderait la kiblah (le coté du sud), est une medréceh, et à la gauche se trouve un ermitage. La cour de cette mosquée est pavée de marbre, et les murs en sont revêtus de kâchâny (carreaux de faïence colorés), qui ressemble au zelîdj. Une rivière la traverse; il s'y trouve plusieurs espèces d'arbres, des ceps de vigne et des jasmins. On a coutume de lire chaque jour, dans la cour de cette mosquée, après la prière de l'asr, la sourate YS. (xxxvi du Coran), celle de la Victoire (xlviii), et la sourate 'Amma (lxxviii) ; les habitants de cette ville se rassemblent pour cet objet.
Nous passâmes une nuit à Tibrîz; mais, le jour suivant, l'émir Alâ eddîn reçut du sultan Abou Saïd l'ordre d'aller te rejoindre. Je partis avec l'émir, et je ne vis à Tabriz aucun des 'ouléma. Nous voyageâmes jusqu'à ce que nous eussions atteint le quartier du sultan. L'émir lui apprit ma présence dans le camp, et m'introduisit auprès de lui. Le sultan m'interrogea touchant mon pays, et me fit don d'un vêtement et d'une monture. L'émir lui fit savoir que je voulais entreprendre le voyage du noble Hedjaz, et alors il m'assigna des provisions et une chamelle ; pour la route que je devais faire, ainsi qu'une litière. Il écrivit dans ce sens en ma faveur à l'émir de Baghdâd, Khodjah Ma'roûf. Je retournai à Bagdad, où je reçus tout ce que le sultan m'avait assigné. Gomme il restait plus de deux mois jusqu'au temps du départ de la caravane, je jugeai à propos de faire une excursion à Mossoul et dans le Diârbecr, afin de voir ce pays, et de retourner ensuite à Baghdâd, à l'époque du voyage de la caravane, pour me diriger vers le noble Hedjaz.
Je sortis de Bagdad, et me dirigeai vers une station près du Dodjaïl (petit Tigre), fleuve qui est dérivé du Tigre, et qui fournit de l'eau à beaucoup de villages. Après deux jours de marche, nous descendîmes dans un gros bourg, nommé Harbah, qui est fertile et vaste. Nous continuâmes notre voyage et campâmes en un lieu au bord du Tigre, à côté d'un château appelé Alma'choûk (l'objet aimé). Il est bâti près du Tigre, et au côté oriental de ce château se trouve la ville de Sorra man raâ (quiconque l'a vue a été réjoui). On la nomme aussi Sâmarra et Sâmrâh. Le sens de cette dernière dénomination, en persan, est : « le chemin de Sâm », car râh veut dire chemin. (Sâm est le nom d'un héros iranien, aïeul du fameux Roustem.) La ruine s'est emparée de cette ville, de sorte qu'il n'en reste debout qu'une fort petite portion. Le climat en est tempéré, et la beauté admirable, malgré ses malheurs et la destruction de ses vestiges. On y trouve, comme à Hillah, un mausolée consacré au maître de l'époque. (Cf. ci-dessus.)
Nous quittâmes cette ville, et après avoir voyagé une journée, nous arrivâmes à Tecrît. C'est une grande ville, ayant de vastes dépendances, de jolis marchés, beaucoup de mosquées, et les habitants se distinguent par la bonté du caractère. Le Tigre coule au nord de cette ville, et elle possède un château fort au bord de ce fleuve. Tecrît est de construction ancienne, et une muraille fait le tour de cette belle cité.
Nous partîmes de ce lieu, et après avoir voyagé deux jours, nous atteignîmes un village appelé Al'akr, situé au bord du Tigre. Dans sa partie supérieure existe une colline, où était autrefois un château, et dans le bas est une hôtellerie, nommée, le Khân de fer, qui possède des tours, et dont la construction est très soignée. Depuis ici jusqu'à Mossoul, les villages et les champs en culture se suivent sans interruption.
Nous continuâmes à voyager, et campâmes dans un endroit nommé Alkayyârah, proche du Tigre. Ici se voit un terrain noir, dans lequel sont des sources qui fournissent de la poix. On pratique pour celle-ci des réservoirs, dans lesquels elle se rassemble. Tu dirais de l'argile sur la surface de la terre, mais d'une couleur très noire, brillante, molle, et d'une bonne odeur. Autour de ces sources se voit un vaste étang noir, surmonté d'une sorte de mousse (ou écume) ténue, qu'il rejette sur ses bords et qui devient aussi de la poix. Près de ce lieu, il existe une source considérable, et lorsqu'on veut en retirer de la poix, on allume du feu sur cette source. Celui-ci absorbe l'humeur aqueuse que contient la poix, et après cela on la coupe en morceaux et on l'emporte. Nous avons déjà mentionné la source placée entre Coûfah et Basrah, et qui est du même genre.
Nous marchâmes deux jours depuis lesdites fontaines, puis nous arrivâmes à Mossoul (Maoussil). C'est une ville ancienne, et qui abonde en biens; la forteresse, appelée Alhadbâ (la bossue), est d'une grande importance, et célèbre par son caractère d'inexpugnabilité. Celle-ci possède une muraille d'une construction solide, et munie de tours élevées. Les habitations du sultan sont contiguës à la forteresse; et entre celles-ci et la ville il existe un chemin large et allongé, qui s'étend depuis le haut de la ville jusqu'à sa partie inférieure. Mossoul est entouré de deux murs solides, ayant des tours nombreuses et rapprochées les unes des autres. Dans l'intérieur de la muraille sont des chambres placées l'une sur l’autre, et faisant le tour du mur. On a pu les percer ainsi, à cause de l'épaisseur des dites murailles. Parmi les murs des différentes villes, je n'en ai point vu de pareils, à l'exception de celui qui se trouve dans la ville de Dihly, capitale du roi de l'Inde.
Mossoul possède un grand faubourg, qui contient des mosquées, des bains, des hôtelleries et des marchés. On y voit, sur le bord du Tigre, une mosquée cathédrale, entourée de balustrades de fer, et à laquelle sont contigus des bancs, extrêmement jolis et solides, qui dominent le Tigre. Devant la mosquée se trouve un hôpital.
Dans l'intérieur de la ville sont deux mosquées principales, dont l'une est ancienne et l'antre, récente. Dans la cour de celle-ci se trouve une coupole, qui renferme un bassin de marbre octogone, supporté par une colonne de marbre. L'eau en sort avec force et impétuosité, et elle s'élève à la hauteur de la taille d'un homme ordinaire. Puis elle retombe, et offre ainsi un beau spectacle. Le bazar de Mossoul est joli, il est garni de portes de fer, et entouré par des estrades et par des chambres, placées l'une sur l'autre, et d'une construction élégante.
Dans cette ville se voit le mausolée de Djirdjîs, le prophète, sur qui soit le salut! (Elie, ou saint Georges.) Il contient une chapelle, et le tombeau se trouve dans un angle de celle-ci, à la droite du visiteur. Elle est située dans l'intervalle compris entre la nouvelle mosquée djâmi et la porte du pont. Nous pûmes visiter la tombe et prier dans sa chapelle, grâce au Dieu très haut.
On voit aussi dans ce lieu la colline de Jonas, sur qui soit le salut! et, environ à un mille de distance, la fontaine qui porte son nom. On dit qu'il commanda à son peuple de s'y purifier; qu'après cela ils montèrent tous sur ladite colline, qu'il pria et qu'ils prièrent aussi, de sorte que Dieu détourna de leurs têtes le châtiment. Proche de la hauteur est un gros bourg, qu'avoisine une grande ruine, et l'on prétend que celle-ci est l'emplacement de la ville connue sous le nom de Nînaoua (Ninive), ville de Jonas. L'on aperçoit les vestiges du mur qui l'entourait, ainsi que les places de ses portes. Sur la colline sont un grand édifice et un couvent, où se trouvent des cellules nombreuses, des appartements, des lieux pour les purifications, et des fontaines; le tout renfermé par une seule et même porte. Au milieu du couvent se voit une cellule avec un rideau de soie, et ayant une porte incrustée d'or et de pierreries. On dit que c'est l'endroit où se tenait Jonas, et l'on ajoute, que le chœur de la mosquée, qui se trouve dans le couvent, était la cellule où il priait Dieu. Les habitants de Mossoul vont visiter ce couvent toutes les nuits du jeudi au vendredi, et ils y font leurs dévotions. Ils se distinguent par leurs nobles qualités, l'affabilité de leurs discours et par leur mérite; ils aiment les étrangers, et ont pour eux de la prévenance;
L'émir de cette ville, lorsque j'y arrivai, était le vertueux Sayyid, le chérif 'Alâ eddîn 'Aly, fils de Chams eddîn Mohammed, surnommé Haïder (lion). C'est un homme généreux et distingué; il me logea dans son hôtel, et paya ma dépense tout le temps que je demeurai chez lui. Il est, en somme, l'auteur d'aumônes et de bienfaits célèbres. Le sultan Abou Sa’id l'honorait beaucoup, et lui avait confié cette ville et ce qui l'avoisine. Il monte souvent à cheval, entouré d'une nombreuse escorte de ses mamlouks et de ses troupes. Les chefs des habitants de la ville et les grands personnages viennent le saluer matin et soir, et il est doué de bravoure et de majesté. Son fils, au moment où l'on écrit ceci, se trouve dans la capitale Fès, séjour des étrangers, domicile de celui qui est sous l'influence de la crainte, et lieu où les foules déposent leurs bagages. Que Dieu augmente sa beauté et sa splendeur, au moyen de la prospérité du règne de notre maître, le commandant des croyants; et qu'il garde ses côtés et ses environs!
Nous sortîmes, de Mossoul, et fîmes halte dans un village nommé 'Aïn arrassad, il est placé près d'un fleuve, sur lequel se voit un pont de pierre, et il possède une grande hôtellerie. Nous continuâmes notre marche, et descendîmes dans un village dit Almowaïlihah (la joliette), et puis dans la fille de Djezîret Ibn Omar. Elle est grande, belle; entourée par le fleuve (le Tigre), et c'est 'pour cela qu'on l'a nommée Djézireh (île). La majeure partie est ruinée; mais elle possède un beau marché et une mosquée ancienne, construite en pierres, d'un travail solide. Le mur de cette ville est aussi en pierres. Ses habitants sont d'excellentes gens, et ils aiment les étrangers. Le jour de notre arrivée dans cette ville, nous vîmes la montagne Aldjoûdy, qui est mentionnée dans le Coran, et sur laquelle s'arrêta l'arche de Noé, sur qui soit le salut! (Coran, xi, 46). C'est une montagne élevée et de forme allongée.
Nous marchâmes ensuite deux jours, et arrivâmes à Nassîbîn (Nisibe). Cette ville est ancienne, de moyenne grandeur, et en grande partie ruinée. Elle est située dans une large et vaste plaine, où se voient des eaux courantes, des vergers touffus, des arbres disposés avec ordre, et beaucoup de fruits. On fabrique dans cette ville de l'eau de roses, qui n'a pas sa pareille en senteur et en bonté. Un fleuve (le Hirmâs) entoure Nassibîn et se recourbe sur lui, à l'instar d'un bracelet. Il tire son origine de différentes sources qui se trouvent dans une montagne, proche de la ville. Puis il se divise en plusieurs parties et pénètre dans ses jardins. Un de ses canaux entre dans la cité, il en parcourt les rues et les habitations, traverse la cour de sa mosquée principale ; et se déverse dans deux bassins, dont l'un est au milieu de la cour, et l'autre près de la porte orientale. Cette ville est pourvue d'un hôpital et de deux collèges. Les habitants sont des gens probes, religieux, sincères et sûrs. Abou Nouwâs a eu bien raison de parler ainsi qu'il le fait dans le distique suivant:
Nassîbîn a été autrefois agréable pour moi, et je lui ai été agréable. Ah! plut au ciel que mon lot dans ce monde ce fût Nassîbîn !
Voici ce que fait observer Ibn Djozay : « On attribue à la ville de Nassîbîn de la mauvaise eau et un air malsain. Un poète a dit à son sujet : »
J'ai été émerveillé de Nassîbîn, et de ce qui, dans son séjour, amène les maladies.
Les roses, dans son enceinte, manquent de rougeur, à cause d'un mal qui se voit jusque sur les joues. (On ne trouve à Nassîbîn que des roses blanches. Cf. Aboulféda, Géographie, p. 283.)
Nous partîmes ensuite pour la ville de Sindjar ; elle est grande, possède beaucoup de fruits et d'arbres, des sources abondantes et des rivières. Elle est bâtie au pied d'une montagne, et elle ressemble à Damas pour la quantité de ses canaux et de ses jardins. Sa mosquée cathédrale jouit d'une grande réputation de sainteté, et l'on assure que la prière y est exaucée. Un canal entoure ce temple et le traverse. Les habitants de Sindjar sont des Kurdes, doués de valeur et de générosité. Parmi les personnages que j'ai rencontrés dans cette ville, je mentionnerai le pieux cheikh, le dévot et ascète 'Abd Allafa alcurdy, un des docteurs principaux et auteur de prodiges. On raconte qu'il ne rompt pas le jeûne si ce n'est après quarante jours, et cela seulement au moyen de la moitié d'un pain d'orge. Je l'ai rencontré dans un couvent, sur la cime de la montagne de Sindjar, il fit des vœux en ma faveur, et me pourvut de pièces d'argent que je ne cessai de garder jusqu'à ce que je fusse pillé par les infidèles de l'Inde.
Nous nous rendîmes ensuite à la ville de Dara. Elle est ancienne et vaste ; son aspect est brillant (littéral, blanc), et elle a une forteresse très élevée; mais, à présent, elle n'est plus qu'une ruine, et elle est privée d'habitants. Au dehors de cette ville est un bourg bien peuplé, et c'est là que nous descendîmes.
Nous partîmes, et arrivâmes ensuite à la ville de Mârridîn. Elle est vaste, et située au pied d'une montagne; c'est une des plus belles villes de l'islamisme, des plus admirables, et des plus fortes, et une de celles qui possèdent les places les plus jolies. On y fabrique, des étoffes qui prennent le nom de la ville, et qui sont faites avec la laine nommée almer'izz (nom qu'on donne aux poils de chèvre les plus fins). Cette ville est pourvue d'une forteresse très haute, qui est au nombre des plus célèbres châteaux forts, et qui se trouve sur le sommet de la montagne.
Ibn Djozay ajoute : « Cette forteresse de Mâridîn est appelée Achchahbâ (la grise), et c'est d'elle qu'a voulu parler le poète de l'Irak, Safiy eddîn 'Abd el-Aziz, fils de Sarâya alhilly, dans les vers qui suivent, extraits de son poème du genre simth (ou mouçammath) :
Or, quitte les habitations d'Alhillah, la vaste,
Et détourne-toi avec les chameaux, de la ville de Bagdad.
Et ne t'arrête point à Mossoul, la ville bossue :
Certes, la flamme de la forteresse Chahbâ
Brûle le démon des vicissitudes du sort.
(D'après le Merâcid, la ville de Mossoul est appelée Hadbà, ou bossue, parce qu'elle est placée sur le Tigre, à l'instar d'une gibbosité. Nous avons vu plus haut que Hadbâ est aussi le nom de la forteresse de Mossoul.)
« La citadelle d'Alep est aussi appelée Achchahbâ. Et cette poésie, du genre mouçammath, est admirable; l'auteur l’a composée à la louange du roi victorieux (Almansoûr), sultan de Mâridîn. C'était un prince généreux, d'une grande renommée; il régna dans cette ville près de cinquante années, atteignit l'époque de Kazan, le roi des Tatars, et s'allia au sultan Khodhâbendeh, en lui donnant sa fille Dounia khatoun. » (Cf. ci-dessus.)
C'était le roi Sâlih, fils du roi Mansour (que nous venons de nommer). Il a hérité du royaume de son père, et il a accompli des actes de libéralité qui sont célèbres. Il n'y a point dans l'Irak, la Syrie et l'Egypte, de personnage plus généreux que lui. Les poètes et les fakirs vont le trouver, et il leur donne des présents magnifiques, marchant ainsi sur les traces de son père. Il fut visité par Abou 'Abd Allah Mohammed, fils de Djâbir alandalocy almerouy, surnommé Alcafif, qui fit son éloge, et il lui donna vingt mille dirhems. Il fait beaucoup d'aumônes, et entretient les collèges et les zaouïas qui fournissent de la nourriture aux étrangers. Son vizir est un homme d'un rang élevé, savoir : le savant imâm, la perle du siècle, le phénix de l'époque, Djémal eddîn Assindjâry. Il a professé dans la ville de Tibrîz, et s'est mis en relation avec les principaux oulémas. Son kadi suprême est le parfait imâm Borhân eddîn Almaoussily, qui rapporte sa généalogie au saint cheikh Fath Al-maoussily. Ce kadi est pieux, modeste et vertueux; il porte an grossier habillement de laine, dont le prix n'arrive pas à dix dirhems. Son turban est à peu près du même genre. La plupart du temps il prononce ses jugements dans la cour de la mosquée, qui est hors du collège, et dans laquelle il fait ses dévotions. Quand une personne qui ne le connaît point le voit, elle pense que c'est quelque serviteur du kadi et un de ses aides.
On m’a raconté qu'une femme se rendit près de ce juge, pendant qu'il se trouvait hors de la mosquée. Or elle ne le connaissait pas; elle lui dit : « O cheikh, où siège le kadi? » Il lui répondit : « Que lui veux-tu? » Elle reprit : « Certes, mon mari m'a battue; de plus, il a une seconde épouse et ne fait point la part égale entre nous, en ce qui concerne la cohabitation nocturne. Je l'avais cité devant le kadi; mais il a fait défaut. Pour moi, je suis pauvre et n'ai rien à donner aux gens du kadi, afin qu'ils l'amènent à son tribunal. » Il dit : « Et où est située la demeure de ton mari? » La femme répondit : « Dans le village des Matelots, hors de la ville. » Il reprit : « J'irai avec toi chez lui. » La femme dit : « Par Dieu, je n'ai rien à te donner! » Et il répliqua : « Et moi, je n'accepterai rien de toi. » Puis il ajouta : « Dirige-toi vers le village, et attends-moi à l'extérieur, car je te suivrai. » Elle partit, ainsi qu'il le lui avait ordonné, et l'attendit. Le kadi arriva, sans que personne fût avec lui, car c'était son habitude de ne se laisser suivre par aucun individu. La femme entra avec le juge dans le logement de son mari, et lorsque ce dernier l'aperçut, il dit : « Quel est ce malheureux cheikh qui t'accompagne? » Le kadi répartit : « Oui, par Dieu, je suis tel que tu le dis ; mais contente ta femme. » Leur entretien s'étant prolongé, des personnes survinrent, qui reconnurent le juge et le saluèrent. Alors le mari eut peur et fut couvert de confusion. Mais le juge lui dit : « Ne crains rien, « et répare le tort que tu as envers ta femme. » Le mari donna satisfaction à son épouse; le kadi leur fournit la somme nécessaire à la dépense de ce jour-là, et il partit. J'ai vu ce kadi, qui me donna l'hospitalité dans sa maison. Je me remis en route pour retourner à Bagdad, et arrivai à la ville de Mossoul, que nous avons déjà mentionnée. Je trouvai hors de ses murailles sa caravane, qui se dirigeait vers Bagdad. Parmi les pèlerins, il y avait une femme, pieuse, servante de Dieu, appelée « la Dame dévote », et qui descendait des khalifes. Elle avait fait plusieurs fois le voyage de la Mecque, et elle jeûnait assidûment Je la saluai » et me mis sous sa protection. Elle était accompagnée d'une troupe de fakirs qui la servaient; mais elle mourut dans ce voyage: que Dieu ait compassion d'elle! Et son décès eut lieu à Zaroûd, où elle fut enterrée.
Nous arrivâmes à Bagdad, où je rencontrai les pèlerins au milieu des préparatifs du départ. J'allai trouver le gouverneur de la ville, Ma'roùf Khodjah, et je réclamai de lui l'exécution de ce que le sultan avait prescrit en ma faveur. Il m'assigna la moitié d'une double litière et les provisions de route, ainsi que l'eau, nécessaires pour quatre personnes. Il écrivit pour moi (un ordre mentionnant) tout cela, et envoya chercher le commandant de la caravane, qui était Albahluwân Mohammed alhaouîh, et me recommanda à lui. Notre connaissance remontait à une époque précédente; mais il en accrut l'intimité. Je ne cessai, en effet, d'être sous sa protection, et toujours il me comblait de bienfaits, et faisait plus encore en ma faveur qu'on ne lui avait ordonné. A notre sortie de Coûfah, je fus atteint de dévoiement, et l'on me descendait de la litière un grand nombre de fois chaque jour. L'émir s'informait de mon état, et faisait des recommandations en ma faveur. Ma maladie continua jusqu'à mon arrivée à la Mecque, sanctuaire de Dieu très haut. (Que Dieu augmente sa noblesse et sa considération !) J'accomplis les tournées que le pèlerin doit faire en entrant dans la Mecque, autour de la maison sainte. (Que Dieu l'exalte!) J'étais tellement faible que je dus satisfaire, étant assis, aux prières prescrites par la loi et accomplir les tournées, ainsi que la course entre Safâ et Marwah, monté sur le cheval audit émir Alhaouîh. Cette année-là nous fîmes la station à Arafat, le lundi ; et lors de la descente à Mina, je me sentis soulagé de mon mal, qui bientôt cessa totalement. Le pèlerinage fini, je m'établis à la Mecque, pour toute Tannée, afin de m'y livrer aux exercices de piété.
Il y avait dans cette ville l'émir 'Alâ eddîn, fils de Hilal, inspecteur ou intendant des bureaux (ou des revenus de l'État. Cf. l’Histoire des sultans mamlouks, t. I), dont le séjour avait pour but la restauration de l'hôtel des ablutions, situé hors (du marché) des droguistes, près de la porte des Bènou Cheïbah. Cette même année, un bon nombre de grands personnages égyptiens s'établirent à la Mecque, dans des vues pieuses. Nous nommerons :
1° Tadj eddîn, fils d'Alkeouîc;
2° Nour eddîn Alkâdhi;
3° Zeïn eddîn, fils d'Alassîl;
4° Le fils d'Alkhalîly;
5° Nacir eddîn Alaciouthy;
Je demeurai toute l'année dans le collège Mozafférien, et Dieu me guérit de ma maladie. La vie que je menais était des plus agréables : j'étais tout occupé des processions autour de la Kaaba, du service de Dieu, et de la visite des lieux saints. Dans le cours de l'année arrivèrent les pèlerins de la haute Egypte. Il y avait avec eux :
1° Le pieux cheikh Nadjm eddîn Alosfoûny, dont c'était le premier pèlerinage;
2° et 3° Les deux frères 'Alâ eddîn Aly, et Sirâdj eddîn Omar, fils du pieux kadi Nadjm eddîn Albâlicy, juge au Caire; et d'autres personnages que nous passerons sous silence.
Au milieu du mois de dhou’lka’deh arriva l'émir Seïf eddîn Yelmelec, qui était un personnage éminent. Beaucoup d'habitants de Tanger, ma ville natale (que Dieu la garde!), l'accompagnaient.
Citons les suivants :
1° Le docteur de la loi, Abou 'Abd Allah Mohammed, fils du juge Abou’l’abbâs, fils du juge et prédicateur Abou’lkâcim aldjourâouy;
2° Le légiste Abou 'Abd Allah, fils d'Athâ Allah (Dieu Donné);
3° Le docteur Abou Mohammed 'Abd Allah alhadhary;
4° Le fakîh Abou 'Abd Allah almursy;
5° Abou’l’abbâs, fila du fakîh Abou 'Aly albalensy;
6° Abou Mohammed, fils d'Alkâbilah (l'accoucheuse);
7° Abou’ Haçan albiyâry;
8° Abou’l’abbâs, fils de Tâfoût;
9° Abou'ssabr (le père de la patience) Ayyoub alfâk-khâr (te potier) ;
10° Ahmed, fils de Haccâmah.
Parmi les habitants de Kasr almadjàz (le château du Passage, près de Tanger) qui arrivèrent avec ledit émir, il y avait : le jurisconsulte Abou Seïd 'Abderrahmane, fils du kadi Abou’l’abbâs, fils de Kholoûf; et parmi ceux d'Alkasr alkebir (le grand château ; c'est la même localité que la ville nommée Kasr 'Abd alkerîm, et Kasr ketâmah, dans le Maroc. Cf. Aboulféda. Géographie, p. 133) :
1° Le fakîh Abou Mohammed, fils de Moslim;
2° Abou Ishâk Ibrahim, fils de Yahia;
3° Le fils du précédent;
Cette même année arrivèrent aussi à la Mecque :
1° L'émir Seïf eddîn Tokoûz Domoûr, un des officiers attachés spécialement au service du sultan d'Egypte (khâssekis);
2° L'émir Mouça, fils de Karaman ;
3° Le kadi Fakhr eddîn, inspecteur de l'armée et secrétaire des mamlouks;
4° Attâdj Abou Ishâk;
5° La dame Hadak, nourrice du roi Annâcir.
Ils firent tous des aumônes copieuses au temple illustre, surtout le kadi Fakhr eddîn. Notre station à 'Arafat eut lieu cette année un vendredi, et c'était l'an vingt-huitième (728 de l'hégire, 1327-1328 de J. C). Quand le pèlerinage fut accompli, je restai à la Mecque, occupé d'exercices de dévotion, l'année vingt-neuf (729 de l'hégire, 1328-1329 de J. C). Cette année-ci arrivèrent de l'Irak, en compagnie de l'émir Mohammed alhaouîh :
1° Ahmed, fils de l'émir Romaïthah;
2° Mobârec, fils de l'émir 'Athîfah;
3° Le cheikh Zâdeh alharbâouy;
4° Le cheikh Dânïâl (Daniel).
Ils apportèrent des aumônes magnifiques pour les modjâouirs et les Mecquois, de la part du sultan Abou Sa’id, roi de l'Irak. Son nom fut mentionné cette année-là dans le prône du vendredi, après celui du roi Nacir, et l'on fit des vœux pour lui, du haut de la coupole du Zamzam. On nomma après lui le sultan du Yémen, le roi champion de l'islamisme, Nour eddîn. L'émir 'Athîfah n'avait point adhéré à cela, et il envoya son frère utérin, Mansour, pour en informer le roi Nacir; mais Romaïthah donna ordre de le faire rétrograder, ce qui eut lieu. 'Athîfah le fit partir une seconde fois, mais pair la route de Djouddah, et il put ainsi instruire de tout cela le roi Nacir.
Cette année-là, qui était l'an vingt-neuf (729 de l'hégire, 1328-1329 de J.C.), nous fîmes la station d'Arafat un mardi; et après le pèlerinage, je continuai de rester assidûment près du temple de la Mecque l'année trente (730 de l'hégire, 1329-1330 de J.C.). Pendant les fêtes du pèlerinage de cette dernière année, la discorde éclata entre l'émir de la Mecque, 'Athîfâh, et Aïdemoûr, émir djandâr (commandant des gardes du sultan) Annâciry. La cause de cela fut que des marchands du Yémen furent volés, et qu'ils se plaignirent de ce fait à Aïdemoûr. Celui-ci dit à Mobârec, fils de l'émir 'Athîfah : « Amène ces voleurs! » Il répondit : « Je ne les connais point; comment donc pourrions-nous les amener? D'ailleurs, les habitants du Yémen sont sous notre domination, et tu n'as pas de pouvoir sur eux. Si l'on a volé quelque chose à un Egyptien ou à un Syrien, fais-moi des réclamations sur cela. » Aïdemour l'outragea et lui dit : « O entremetteur (proxénète) ! est-ce ainsi que tu me parles? » Il le frappa sur la poitrine, de sorte que Mobârec tomba, et son turban se détacha de sa tête. Le prince se mit en colère, et ses esclaves aussi se fâchèrent contre Aïdemour. Celui-ci monta à cheval pour rejoindre sa troupe, mais Mobârec et ses esclaves l'atteignirent et le tuèrent, ainsi que son fils. La guerre civile éclata à la Mecque, où se trouvait l'émir Ahmed, fils de l'oncle paternel du roi Nacir. Les Turcs lancèrent des flèches, et tuèrent une femme, accusée d'avoir excité au combat les habitants de la Mecque. Tous les Turcs qui faisaient partie de la caravane montèrent à cheval, ainsi que leur commandant Khâss Turc. Alors le juge, les prélats et les modjâouirs allèrent au-devant d'eux, portant au-dessus de leur tête des exemplaires du Coran, et réclamèrent la paix. Les pèlerins entrèrent à la Mecque, y prirent ce qui leur appartenait, et partirent pour l'Egypte.
Ces nouvelles étant parvenues au roi Nacir, il en fut attristé, et envoya des troupes à la Mecque. L'émir 'Athîfah, ainsi que son fils Mobârec, s'enfuirent; son frère Romaïthah et ses fils se retirèrent à Wâdi Nakhlah. Quand l'armée fut arrivée à la Mecque, l'émir Romaïthah expédia un de ses enfants, afin d'obtenir un sauf-conduit pour lui et ses fils. On le leur accorda, et alors Romaïthah se rendit près du commandant, tenant dans la main son linceul (en signe de soumission à la volonté du vainqueur). Il fut revêtu d'une robe d'honneur, et on lui livra la ville de la Mecque. Les troupes retournèrent au Caire : car le feu roi Nacir était doux et très humain.
Je quittai la Mecque à cette époque-là, me dirigeant vers le Yémen, et j'arrivai à Haddah, qui est à moitié chemin entre la Mecque et Djouddah. Puis j'atteignis cette dernière ville, qui est ancienne, et située sur le bord de la mer; l'on dit que Djouddah a été fondée par les Persans. A l'extérieur de cette cité il y a des citernes antiques, et dans la ville même des puits pour l'eau, creusés dans la pierre dure. Ils sont très rapprochés l'un de l'autre, et l'on ne peut pas les compter, tant leur nombre est considérable. L'année dont il s'agit manqua de pluie, et l'on transportait l'eau à Djouddah, de la distance d'une journée. Les pèlerins en demandaient aux habitants des maisons.
Parmi les choses étranges qui me sont arrivées à Djouddah, se trouve ceci : un mendiant aveugle, conduit par un jeune garçon, s'arrêta à ma porte, demandant de l'eau. Il me salua, m'appela par mon nom, et prit ma main, quoique je ne l'eusse jamais connu et qu'il ne me connût pas non plus; je fus étonné de cela. Ensuite il saisit mon doigt avec sa main, et il dit : « Où est alfatkhah? » c'est-à-dire la bague. Or, au moment de ma sortie de la Mecque, un pauvre était venu à moi, et m'avait demandé l'aumône. Je n'avais alors rien sur moi, et je lui livrai mon anneau. Lorsque cet aveugle m'en demanda des nouvelles, je lui répondis : » Je l'ai donné à un fakir. » Il répliqua : « Va à sa recherche, car il y a sur cet objet une inscription qui contient un des grands secrets. » Je fus très stupéfait de l'action de cet homme, et de ce qu'il savait à ce sujet. Mais Dieu sait le mieux ce qui le concerne !
A Djouddah il y a une mosquée principale, célèbre par son caractère de sainteté; on la nomme la mosquée djâmi de l'Ebène, et la prière y est exaucée. Le commandant de la ville était Abou Yakoub, fils d'Abd arrazzâk; son kadi et aussi son khathîb était le docteur 'Abd Allah, de la Mecque, et sectateur de Châfi'y. Quand arrivait le vendredi, et que les gens se rendaient au temple pour la prière, le muezzin venait, et comptait les personnes de Djouddah qui étaient présentes. Si elles complétaient le chiffre quarante, alors le prédicateur prononçait le sermon, et faisait avec elles la prière du vendredi. Dans le cas contraire, il récitait quatre fois la prière de midi, ne tenant aucun compte de ceux qui n'étaient point de Djouddah, quelque grand que fût leur nombre. (Cf. ci-après, à l'article Nazoua, dans l’Oman.)
Nous nous embarquâmes dans cette ville sur un bâtiment appelé djalbah (grande barque ou gondole, faite de planches jointes avec des cordes de fibres de cocotier; gelve des voyageurs modernes), et qui appartenait à Rachid eddîn Alalfy alyamany, originaire de l'Abyssinie. Le chérif Mansour, fils d'Abou Nemy, monta sur un autre bâtiment de ce genre, et me pria d'aller avec lui. Je ne le fis pas, car il avait embarqué des chameaux sur son navire, et je fus effrayé de cela, vu que je n'avais point, jusqu'à ce moment, traversé la mer. Il y avait alors à Djouddah une troupe d'habitants du Yémen qui avaient déjà déposé leurs provisions de route et leurs effets dans les navires, et qui étaient prêts pour le voyage.
Lorsque nous prîmes la mer, le chérif Mansour ordonna à un de ses esclaves de lui apporter une 'adîlah (mesure, ou sac) de farine, c'est-à-dire la moitié d'une charge, ainsi qu'un pot de beurre, à enlever l’un et l'autre des navires des gens du Yémen. Il le fît, et apporta ces objets au chérif; Les marchands vinrent à moi tout en pleurs; ils me dirent que dans le milieu de l'adîlah il y avait dix mille dirhems en argent, et me prièrent de demander à Mansour sa restitution, et qu'il en prit une autre en échange. J'allai le trouver et lui parlai à ce sujet, en lui disant que, dans le centre de cette 'adîlah, il y avait quelque chose appartenant aux marchands. Il répondit : « Si c'est du vin (sacar), je ne le leur rendrai pas; mais si c'est autre chose, ce sera pour eux. » On rouvrit, et l'on trouva les pièces d'argent, que Mansour leur rendit. Il me dit alors : « Si c'eût été 'Adjlân, il ne les aurait point rendues. » Celui-ci est le fils de son frère Romaïthah; il était entré peu de jours auparavant dans la maison d'un marchand de Damas, qui se rendait dans le Yémen, et il avait enlevé la majeure partie de ce qui s'y trouvait. 'Adjlân est maintenant émir de la Mecque ; il a redressé sa conduite, et a fait paraître de l'équité et de la vertu.
Nous voyageâmes sur cette mer pendant deux jours avec un vent favorable; puis il changea, et nous détourna de la route que nous suivions. Les vagues de la mer entrèrent au milieu de nous dans le navire; l'agitation fut grande parmi les passagers, et nos frayeurs ne cessèrent que quand nous abordâmes à un port appelé Ras Dawâïr (cap des Tourbillons), entre 'Aïdhâb et Sawâkin. Nous descendîmes à terre, et trouvâmes sur le rivage une cabane de roseaux, ayant la forme d'une mosquée. Il y avait à l'intérieur une quantité considérable de coquilles d'œufs d'autruches, remplies d'eau. Nous en bûmes, et nous nous en servîmes pour cuisiner.
Je vis dans ce port une chose étonnante : c'est un golfe, à l'instar d'un torrent, formé par la mer. Les gens prenaient leur vêtement, qu'ils tenaient par les extrémités, et ils le retiraient de cet endroit rempli de poissons. Chacun de ceux-ci était de la longueur d'une coudée ; et ils les nomment alboûry (les muges). Ils en font bouillir une grande quantité, et rôtissent le reste. Une troupe de Bodjâh vint à nous; ce sont les habitants de cette contrée; ils ont le teint noir, sont vêtus de couvertures jaunes, et ceignent leur tête de bandeaux rouges de la largeur d'un doigt. Ils sont forts et braves ; leurs armes sont la lance et le sabre; ils ont des chameaux qu'ils nomment sohb (roux), et qu'ils montent avec des selles. Nous leur louâmes des chameaux, et partîmes avec eux par une plaine abondante en gazelles. Les Bodjâh ne les mangent point, de sorte qu'elles s'apprivoisent avec l'homme et ne s'enfuient point à son approche. Après deux jours de marche, nous arrivâmes à un campement d'Arabes appelés les Fils de Câhil ; ils sont mélangés avec les Bodjâh, et connaissent leur langue. Ce jour même nous atteignîmes l'île de Sawâkin.
Elle est à environ six milles du continent, et n'a point d'eau potable, ni de grains, ni d'arbres. On y apporte l'eau dans des bateaux, et il y a des citernes pour recueillir l'eau de pluie. C'est une île vaste, où l'on trouve de la viande d'autruche, de gazelle et d'onagre; elle a beaucoup de chèvres, ainsi que du laitage et du beurre, dont on exporte une partie à la Mecque. La seule céréale qu'on y récolte, c'est le djordjoûr, c'est-à-dire une sorte de millet, dont le grain est très gros ; on en exporte aussi à la Mecque.
C'était, au temps de mon arrivée dans cette île, le chérif Zeïd, fils d'Abou Nemy. Son père a été émir de la Mecque, ainsi que ses deux frères, après ce dernier. Ce sont 'Athîfah et Romaïthah, que nous avons mentionnés plus haut. La domination de cette île lui appartient, comme préposé des Bodjâh, qui sont ses alliés par sa mère. Il a avec lui une troupe formée de Bodjâh, de fils de Câhil, et d'Arabes Djohaïnah.
Nous nous embarquâmes à l'île de Sawâkin pour le pays du Yémen. L'on ne voyage pas la nuit sur cette mer, à cause de la quantité de ses écueils, mais seulement depuis le lever du soleil jusqu'au soir; alors on jette l'ancre, l'on descend à terre, et le lendemain matin on remonte sur le bâtiment. Ces gens appellent robbân (pilote ou capitaine) le chef du navire, qui se tient toujours à la proue de celui-ci pour avertir l'homme du gouvernail de l'approche des écueils; ils nomment ces derniers annabât (les plantes). Six jours après notre départ de l'Ile de Sawâkin, nous arrivâmes à la ville de Hali.
Elle est connue sous le nom de Hali d’Ibn Yakoub : c'était un des sultans du Yémen, et il demeura anciennement dans cette ville. Elle est vaste, d'une belle construction, et habitée par deux peuplades d'Arabes, qui sont les Bènou Hamm et les Bènou Kinânah. La mosquée principale de cette ville est une des plus jolies mosquées djâmi, et l'on y trouve une multitude de fakirs entièrement livrés au culte de Dieu.
Parmi eux on remarque le pieux cheikh, le serviteur de Dieu, l'ascète Kaboulah alhindy, un des plus grands dévots. Son vêtement consiste en une robe rapiécée, et un bonnet de feutre. Il a une cellule attenante à la mosquée, et dont le sol est recouvert de sable, sans natte ni tapis d'aucune sorte. Je n'y ai vu, lorsque je le visitai, rien autre chose qu'une aiguière pour les lotions, et un tapis de table, en feuilles de palmier, sur lequel étaient des morceaux secs de pain d'orge, et une petite soucoupe contenant du sel et des origans (plantes aromatiques). Quand quelqu'un venait le voir, il commençait par lui offrir cela, et il informait de cet événement ses camarades, et chacun apportait ce qu'il avait, sans aucune difficulté. Lorsqu'ils ont fait la prière de l'après-midi, ils se réunissent pour célébrer les louanges de Dieu devant le cheikh, jusqu'au moment de la prière du coucher du soleil. Après celle-ci, chacun d'eux garde sa place pour se livrer aux prières surérogatoires, jusqu'à l'instant de la dernière prière du soir. Ensuite ils célèbrent de nouveau les louanges de Dieu, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Ils se séparent après cela, et ils reviennent à la mosquée au commencement de la troisième partie de la nuit, et veillent jusqu'au point du jour. Alors ils célèbrent les louanges de Dieu, jusqu'au moment de la prière du lever du soleil, après quoi ils se retirent. Il y en a quelques-uns qui restent dans la mosquée jusqu'après l'accomplissement de la prière de l'avant-midi. Telle est toujours leur manière d'agir. J'avais désiré passer avec eux le restant de ma vie, mais je n'ai pas reçu cette faveur. Dieu très haut m'accordera en échange sa grâce et son aide !
Son sultan est Amir, fils de Dhouwaïb, un des Bènou Kinânah. Il est au nombre des hommes de mérite, lettrés et poètes. Je voyageai en sa compagnie depuis la Mecque jusqu'à Djouddah, et il avait fait le pèlerinage l’an trente (730 de l'hégire, 1329-1330 de J. C). Quand je fus arrivé dans sa capitale, il me donna l'hospitalité, me traita honorablement, et je fus son hôte pendant plusieurs jours ; puis je pris la mer sur un navire qui lui appartenait, et arrivai à la ville de Sardjah (ou Chardjah).
C'est une petite ville habitée par une troupe des fils d'Allahba, qui sont une peuplade de négociants du Yémen, dont la plupart habitent Sa'dâ (Sa’dah). Ils sont remplis de mérite et de générosité; ils donnent à manger aux voyageurs, assistent les pèlerins, les embarquent sur leurs bâtiments, et les approvisionnent pour la route avec leur argent. Ils sont connus sous ce rapport, et sont célèbres pour cela. Que Dieu augmente leurs richesses, qu'il multiplie ses faveurs envers eux, et les aide à faire le bien ! Il n'y a point dans aucun pays de personnage qui les égale en cela, excepté le cheikh Bedr eddîn Annakkâs, demeurant dans la ville de Kahmah (petite cité dans le Yémen). Il accomplit de pareilles actions mémorables et de semblables bienfaits. Nous restâmes une seule nuit à Sardjah, jouissant de l'hospitalité des gens susmentionnés. Puis nous nous rendîmes au Port-Neuf, sans y mettre pied à terre, ensuite au Havre des Portes, et enfin à la ville de Zebîd.
C'est une grande cité du Yémen, à quarante parasanges de Sanaa, et la plus considérable du pays, après celle-ci, tant pour son étendue que pour la richesse de ses habitants. Elle possède de vastes jardins, beaucoup d'eau et de fruits, tels que bananes et autres. Zebîd n'est point situé sur le littoral, mais dans l'intérieur des terres. C'est une des capitales du pays de Yémen; elle est grande, très peuplée, et pourvue de palmiers, de vergers et d'eau. Zebîd est la plus belle ville du Yémen et la plus jolie ; ses habitants se distinguent par leur naturel affable, la bonté de leur caractère, l'élégance de leurs formes, et les femmes y sont douées d'une beauté très éclatante. Cette ville est située dans la vallée d'Alhossaîb, au sujet de laquelle on raconte, dans quelques traditions, que le Prophète avait dit à Mo'âdh (fils de Djabal), dans ses recommandations : « O Mo'âdh, quand tu seras arrivé à la vallée du Hossaïb, hâte ta marche » (pour éviter les séductions de ses belles femmes).
Les habitants de cette ville célèbrent les samedis des palmiers, lesquels sont bien connus. Ils sortent, en effet chaque samedi, à l'époque du commencement de la maturité, et lors de la complète maturité des dattes, et se rendent dans les enclos de palmiers. Il ne reste dans la ville aucun de ses habitants ni des étrangers. Les musiciens sortent aussi, et il en est de même des marchands, qui vont débiter les fruits et les sucreries. Les femmes quittent la ville, portées par des chameaux dans des litières. Outre la beauté parfaite que nous avons mentionnée, elles possèdent de belles qualités et des vertus. Elles honorent l'étranger, et ne refusent point de se marier avec lui, comme le font les femmes de notre pays. Quand ce dernier veut partir, sa femme sort avec lui, et lui dit adieu. S'ils ont un enfant, elle en prend soin, et fournit à ses besoins, jusqu'au retour de son père. Elle ne lui réclame rien, ni pour sa dépense journalière, ni pour ses vêtements, ni pour autre chose, pendant le temps de son absence. Lorsqu'il réside dans le pays, elle se contente de bien peu de chose pour les frais de nourriture et d'habillement. Mais les femmes de cette contrée ne quittent jamais leur patrie. Si l'on donnait à l'une d'elles ce qu'il y a de plus précieux pour la déterminer à quitter son pays, elle ne le ferait sans doute pas.
Les savants de cette contrée et ses légistes sont des gens probes, religieux, sûrs, vertueux, et d'un excellent naturel. J'ai vu dans la ville de Zebîd le savant et pieux cheikh Abou Mohammed assan'âny; le fakîh, le soufi contemplatif, Abou’l’abbâs alabïâny, et le jurisconsulte traditionnaire Abou 'Aly azzebîdy. Je me mis sous leur protection : ils m'honorèrent, me donnèrent l'hospitalité, et j'entrai dans leurs vergers. Je fis connaissance chez l'un d'eux avec le légiste, le juge et savant Abou Zeïd 'Abd er-Rahman assoûfy, un des hommes distingués du Yémen. On mentionna devant lui le serviteur de Dieu, l'ascète et l'humble Ahmed, fils d'Al'odjaïl alyamany, qui était du nombre des grands personnages, et de ceux qui font des prodiges.
On raconte que les docteurs de la secte des Zeïdites et leurs grands personnages allèrent une fois rendre visite au cheikh Ahmed, fils d'Al'odjaïl, qui s'assit pour les recevoir en dehors de la zaouïa. Ses disciples allèrent à leur rencontre, mais le cheikh ne quitta pas sa place, Les Zeïdites le saluèrent, il leur toucha la main, et leur dit : « Soyez les bienvenus! » On se mit à discourir sur la matière de la prédestination, et les sectaires avancèrent qu'il n'y avait pas de fatalité, et que celui qui agissait était le créateur de ses actions. Le cheikh répondit : « Si la chose est telle que vous le dites, levez-vous donc de la place où vous êtes ! » Ils le voulurent faire, sans pouvoir y réussir. Alors le cheikh les laissa dans cet état » et entra dans la zaouïa. Ils restèrent ainsi, mais la chaleur les incommoda; ils furent tourmentés par l'ardeur du soleil, et gémirent de ce qui leur était arrivé. Alors les compagnons du cheikh allèrent le trouver, et lui dirent : « Ces gens sont venus à résipiscence envers Dieu, et ont abandonné leur secte impie. » Le cheikh sortit, et, prenant leurs mains, il leur fit promettre de revenir à la vérité, et de quitter leur doctrine perverse. Il les fit, après cela, entrer dans sa zaouïa, ou ils restèrent ses hôtes pendant trois jours, à l'expiration desquels ils retournèrent dans leur pays.
J'allai visiter la tombe de ce saint personnage, qui se trouve dans un village nommé Ghaçânah, au dehors de Zebîd. Or, je rencontrai son fils, le pieux Abou'l Walid Ismâ’îl, qui me donna l'hospitalité, et chez lequel je passai la nuit. Je fis mon pèlerinage au tombeau du cheikh, et restai avec son fils pendant trois jours ; puis je partis en sa compagnie pour visiter le jurisconsulte Abou’ Haçan azzeïla'y. Celui-ci est au nombre des hommes les plus pieux, et commande les pèlerins du Yémen, lorsqu'ils vont à la Mecque en pèlerinage. Les habitants de ces contrées, ainsi que les Bédouins, l'estiment et l'honorent beaucoup. Nous arrivâmes à Djoblah, qui est une jolie petite ville, pourvue de palmiers, de fruits et de canaux. Quand le fakîh Abou’ Haçan azzeïla'y fut informé de l'arrivée du cheikh Abou'l Walid, il vint à sa rencontre, et le fit descendre dans sa zaouïa. Je le saluai, en compagnie d'Abou'l Walid, et nous restâmes chez lui pendant trois jours, avec le traitement le plus agréable.
Puis nous partîmes, mais Abou’ Haçan envoya avec nous un fakir, et nous nous dirigeâmes vers la ville de Ta'izz, résidence du roi du Yémen. C'est une des plus belles et des plus grandes villes du pays; et ses habitants sont orgueilleux, insolents et durs, comme cela a lieu, le plus souvent, dans les villes où demeurent les rois. Ta'izz a trois quartiers; l'un est occupé par le sultan, ses mamlouks, ses domestiques, et par les grands de l'Etat. Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Le second est habité par les commandants et les troupes, et il s'appelle 'Odaïnah. Dans le troisième réside la généralité du peuple; l'on y voit le grand marché, et il se nomme Almohâleb.
C'est le sultan belliqueux Nour eddîn 'Aly, fils du sultan secouru de Dieu, Hizbar eddîn (le lion de la religion) Daoud, fils du sultan victorieux Yousef, fils d'Aly, fils de Raçoûl (l'envoyé). Son aïeul a été célèbre sous ce dernier nom, car un des khalifes abbâsides l'envoya dans le Yémen en qualité d'émir, et plus tard ses enfants jouirent de la royauté, d'une manière indépendante. Le sultan actuel suit un ordre admirable, tant dans ses audiences que lorsqu'il monte à cheval. Quand j'arrivai dans cette ville de Ta'izz, en compagnie du fakir que le cheikh, le jurisconsulte Abou’ Haçan azzeïla'y, avait envoyé avec moi, nous allâmes ensemble chez le grand juge, l'imâm traditionnaire Safy eddîn Atthabary almekky. Nous le saluâmes; il nous accueillit fort bien, et nous reçûmes l'hospitalité chez lui pendant trois jours. Le quatrième, qui était un jeudi, jour dans lequel le sultan donne une audience générale, le grand juge m'y conduisit, et je saluai le prince.
La manière de lui adresser le salut consiste à toucher la terre avec le doigt indicateur, puis à le porter sur la tête, et à dire : « Que Dieu fasse durer ta puissance! » Je fis comme le kadi, et celui-ci s'assit à la droite du roi, qui m'ordonna de m'asseoir devant lui. Alors il m'interrogea touchant mon pays, sur notre maître le commandant des musulmans, le très généreux Abou Sa’id; que Dieu soit satisfait de lui ! sur le roi d'Egypte, celui de l'Irak, et le roi du Loûr. Je répondis à toutes les questions qu'il me fit à leur égard. Son vizir était en sa présence, et il lui ordonna de m'honorer et de me donner l'hospitalité.
Voici l'ordre suivi dans les audiences de ce roi : il s'assied sur une estrade, recouverte et ornée d'étoffes de soie, et il a à sa droite et à sa gauche les militaires. Ceux qui sont à côté de lui, ce sont les porteurs de sabres et de boucliers, puis viennent les archers, et devant ceux-ci, à droite et à gauche, le chambellan, les grands de l'État et le secrétaire intime. L'émir Djandâr est aussi devant le monarque, et enfin les châouchs (ou tchâouchs, vulg. chiaoux, huissiers), qui sont au nombre de ses gardes, ils se tiennent debout à distance. Lorsque le sultan prend sa place, ils crient tous : « Au nom de Dieu ! » et quand il se lève, ils répètent la même exclamation, de sorte que tous ceux qui se trouvent dans la salle d'audience connaissent l'instant où il quitte sa place, de même que celui où il s'assied. Une fois le sultan assis, tous ceux qui ont l'habitude de le venir saluer entrent et saluent le monarque; puis chacun d'eux se tient à l'endroit qui lui est destiné, à droite on à gauche; personne ne quitte sa place, et aucun ne s'assied, à moins que le sultan ne le lui ordonne. Dans ce cas, celui-ci dit à l'émir Djandâr (chef des gardiens du palais) : « Commande à un tel de s'asseoir. » Alors ce dernier s'avance à une petite distance du lieu où il se tenait debout, et s'assied sur un tapis, placé devant ceux qui sont debout, à droite et à gauche.
On apporte ensuite les mets, qui sont de deux sortes : ceux destinés à la généralité des assistants et ceux réservés à quelques individus particuliers. Les derniers sont pour le sultan, le grand juge, les principaux chérifs et jurisconsultes et pour les hôtes. Les autres servent pour le restant des chérifs, des jurisconsultes et des juges, pour les cheikhs, les émirs, et les notables de l'armée. La place de chacun à table est déterminée ; personne ne la quitte ni ne foule les autres. Tel est exactement aussi l'ordre qu'observe le roi de l'Inde dans ses repas ; et je ne sais point si les sultans de l'Inde l'ont pris de ceux du Yémen, ou bien si ces derniers l'ont emprunté des sultans de l'Inde. Je restai plusieurs jours l'hôte du sultan du Yémen, qui me combla de bienfaits et me pourvut d'une monture ; puis je partis, me dirigeant vers la ville de Sanaa.
C'est l'ancienne capitale du pays de Yémen, grande cité, d'une belle construction, bâtie de briques et de plâtre ; elle est abondamment pourvue d'arbres, de fruits et de grains; son climat est tempéré et son eau excellente. Une chose étonnante, c'est que la pluie, dans les pays de l'Inde, du Yémen et de l'Abyssinie, ne tombe que dans le temps des grandes chaleurs, et que, le plus souvent, elle tombe dans cette saison tous les jours après midi. C'est pour cela que les voyageurs se hâtent, vers ce moment, d'arriver à la station, afin de ne pas être atteints par la pluie. Les habitants des villes se retirent dans leurs demeures, car les pluies, dans ces contrées, sont des ondées très copieuses. Sanaa est entièrement pavée, et, lorsqu'il pleut, l'eau lave et nettoie toutes ses rues. La mosquée djâmi de cette ville est au nombre des plus belles mosquées et elle contient la tombe d'un des prophètes, sur qui soit le salut!
Je partis pour la ville d'Aden, le port du pays de Yémen, situé au bord du grand Océan; les montagnes l'environnent, et l'on n'y peut entrer que par un seul côté. C'est une grande ville, mais elle ne possède ni grains, ni arbres, ni eau douce. Elle a seulement des citernes pour recevoir l'eau de pluie, car l'eau potable se trouve loin de la ville. Souvent les Arabes défendent d'en puiser, et se mettent entre les eaux et les habitants de la ville, jusqu'à ce que ceux-ci se soient accommodés avec eux, au moyen d'argent et d'étoffes. La chaleur est grande à Aden. Cette ville est le port où abordent les Indiens; de gros vaisseaux y arrivent de Cambaie, Tânah (Tanna), Cawlem (Coulam), Kâlikoûth (Calicut), Fandarâïnah, Châliyât, Mandjaroûr (Mangalore), Fâkanwar, Hinaour (actuellement Onor), Sindâbour, etc. Des négociants de l'Inde demeurent dans cette ville, ainsi que des négociants égyptiens. Les habitants d'Aden se partagent en marchands, portefaix et pécheurs. Parmi les premiers, il y en a qui possèdent de grandes richesses, et quelquefois un seul négociant est propriétaire d'un grand navire avec tout ce qu'il contient, sans qu'aucune autre personne soit associée avec lui, tant il est riche par lui-même. L'on remarque à ce sujet, chez ces négociants, de l'ostentation et de l'orgueil.
L'on m'a raconté qu'un de ces négociants envoya un de ses esclaves pour lui acheter un bélier, et qu'un autre négociant expédia aussi un esclave à lui pour le même objet; or il arriva, par hasard, qu'il n'y avait dans le marché, ce jour-là, qu'un seul bélier. Les deux esclaves enchérirent pour l'avoir, en sorte que son prix se monta à quatre cents dinars; et l'un d'eux l'acheta en disant : « Certes, le capital que je possède est de quatre cents dinars ; si mon maître me rembourse la dépense faite pour le bélier, tant mieux; sinon je le payerai de mon argent, je me serai défendu et je l'aurai emporté sur mon compétiteur. » Il s'en alla chez son maître avec le bélier, et, quand le négociant fut informé de l'événement, il donna la liberté à l'esclave et lui fit cadeau de mille dinars. L'autre esclave retourna frustré chez son maître ; celui-ci le battit, lui prit tout son pécule et le chassa de sa présence.
Je logeai à Aden chez un négociant appelé Nacir eddîn Alfary. Environ vingt négociants assistaient tous les soirs à son repas, et le nombre de ses esclaves et de ses domestiques était encore plus considérable que celui des convives. Malgré tout ce que nous venons de dire, les habitants d'Aden sont des gens religieux, humbles, probes et doués de qualités généreuses. Ils sont favorables aux étrangers, font du bien aux pauvres et payent ce qu'on doit à Dieu, c'est-à-dire la dîme aumônière, ainsi qu'il est ordonné.
Je vis dans cette ville son kadi, le pieux Salim, fils d'Abd Allah Albindy, dont le père avait été un esclave portefaix. Quant à Salim, il s'adonna à la science, il y acquit le rang de chef et de maître, et c'est un des meilleurs kadis et des plus distingués. Je fus son hôte pendant plusieurs jours.
Après être parti d'Aden, je voyageai par mer durant quatre jours et j'arrivai à la ville de Zeïla'. C'est la capitale des Berberah, peuplade de noirs qui suit la doctrine de Châfi'y. Leur pays forme un désert, qui s'étend l'espace de deux mois de marche, à commencer de Zeïla' et en finissant par Makdachaou. Leurs bêtes de somme sont des chameaux, et ils possèdent aussi des moutons, célèbres par leur graisse. Les habitants de Zeïla' ont le teint noir, et la plupart sont hérétiques.
Zeïla' est une grande cité, qui possède un marché considérable; mais c'est la ville la plus sale qui existe, la plus triste et la plus puante. Le motif de cette infection, c'est la grande quantité de poisson que l'on y apporte, ainsi que le sang des chameaux que l'on égorge dans les rues. A notre arrivée à Zeïla', nous préférâmes passer la nuit en mer, quoiqu'elle fût très agitée, plutôt que dans la ville, à cause de la malpropreté de celle-ci.
Après être partis de Zeïla', nous voyageâmes sur mer pendant quinze jours, et arrivâmes à Makdachaou, ville extrêmement vaste. Les habitants ont un grand nombre de chameaux, et ils en égorgent plusieurs centaines chaque jour. Ils ont aussi beaucoup de moutons, et sont de riches marchands. C'est à Makdachaou que l'on fabrique les étoffes qui tirent leur nom de celui de cette ville, et qui n'ont pas leurs pareilles. De Makdachaou on les exporte en Egypte et ailleurs. Parmi les coutumes des habitants de cette ville est la suivante : lorsqu'un vaisseau arrive dans le port, il est abordé par des sonboûks, c'est-à-dire de petits bateaux. Chaque sonboûk renferme plusieurs jeunes habitants de Makdachaou, dont chacun apporte un plat couvert, contenant de la nourriture. Il le présente à un des marchands du vaisseau, en s'écriant : « Cet homme est mon hôte »; et tous agissent de la même manière. Aucun trafiquant ne descend du vaisseau, que pour se rendre à la maison de son hôte d'entre ces jeunes gens, sauf toutefois le marchand qui est déjà venu fréquemment dans la ville, et en connaît bien les habitants. Dans ce cas, il descend où il lui plaît. Lorsqu'un commerçant est arrivé chez son hôte, celui-ci vend pour lui ce qu'il a apporté et lui fait ses achats. Si l'on achète de ce marchand quelque objet pour un prix au-dessous de sa valeur, ou qu'on lui vende autre chose hors de la présence de son hôte, un pareil marché est frappé de réprobation aux yeux des habitants de Makdachaou. Ceux-ci trouvent de l'avantage à se conduire ainsi.
Lorsque les jeunes gens furent montés à bord du vaisseau où je me trouvais, un d'entre eux s'approcha de moi. Mes compagnons lui dirent : « Cet individu n'est pas un marchand, mais un jurisconsulte. » Alors le jeune homme appela ses compagnons et leur dit : « Ce personnage est l'hôte du kadi. » Parmi eux se trouvait un des employés du kadi, qui lui fit connaître cela. Le magistrat se rendit sur le rivage de la mer, accompagné d'un certain nombre de thâlibs (étudiants); il me dépêcha un de ceux-ci. Je descendis à terre avec mes camarades, et saluai le kadi et son cortège. Il me dit : « Au nom de Dieu, allons saluer le cheikh. » — « Quel est donc ce cheikh, répondis-je ? » — « C'est le sultan, répliqua-t-il. » Car ce peuple a l'habitude d'appeler le sultan, cheikh. Je répondis au kadi : « Lorsque j'aurai pris mon logement, j'irai trouver le cheikh. » Mais il répartit : « C'est la coutume, quand il arrive un légiste, ou un chérif, ou un homme pieux, qu'il ne se repose qu'après avoir vu le sultan ». Je me conformai donc à leur demande, en allant avec eux trouver le souverain.
Ainsi que nous l'avons dit, le sultan de Makdachaou n'est appelé par ses sujets que du titre de cheikh. Il a nom Abou-Bekr, fils du cheikh Omar, et est d'origine berbérienne ; il parle l'idiome makdachain, mais il connaît la langue arabe. C'est la coutume, quand arrive un vaisseau, que le sonboûk du sultan se rende à son bord, pour demander d'où vient ce navire, quel est son propriétaire et son roubbân, c'est-à-dire son pilote ou capitaine, quelle est sa cargaison et quels marchands ou autres individus se trouvent à bord. Lorsque l'équipage du sonboûk a pris connaissance de tout cela, l'on en donne avis au sultan, qui loge près de lui les personnes dignes d'un pareil honneur.
Quand je fus arrivé au palais du sultan, avec le kadi susmentionné, qui s'appelait Ibn Borhân eddîn et était originaire d'Egypte, un eunuque en sortit et salua le juge, qui lui dit : « Remets le dépôt qui t'est confié, et apprends à notre maître le cheikh que cet homme-ci est arrivé du Hedjaz. » L'eunuque s'acquitta de son message et revint, portant un plat dans lequel se trouvaient des feuilles de bétel et des noix d'arec (faoufel). Il me donna dix feuilles du premier, avec un peu de faoufel, et en donna la même quantité au kadi ; ensuite il partagea entre mes camarades et les disciples du kadi ce qui restait dans le plat. Puis il apporta une cruche d'eau de roses de Damas, et en versa sur moi et sur le kadi, en disant : « Notre maître ordonne que cet étranger soit logé dans la maison des thâlibs. » C'était une maison destinée à traiter ceux-ci. Le kadi m'ayant pris par la main, nous allâmes à cette maison, qui est située dans le voisinage de celle du cheikh, décorée de tapis et pourvue de tous les objets nécessaires. Plus tard ledit eunuque apporta de la maison du cheikh un repas; il était accompagné d'un des vizirs, chargé de prendre soin des hôtes, et qui nous dit : « Notre maître vous salue et vous fait dire que vous êtes les bienvenus »; après quoi il servit le repas et nous mangeâmes. La nourriture de ce peuple consiste en riz cuit avec du beurre, qu'ils servent dans un grand plat de bois, et par-dessus lequel ils placent des écuelles de coûchân, qui est un ragoût composé de poulets, de viande, de poisson et de légumes. Ils font cuire les bananes, avant leur maturité, dans du lait frais, et ils les servent dans une écuelle. Ils versent le lait caillé dans une autre écuelle, et mettent par-dessus des limons confits et des grappes de poivre confit dans le vinaigre et la saumure, du gingembre vert et des mangues, qui ressemblent à des pommes, sauf qu'elles ont un noyau. Lorsque la mangue est parvenue à sa maturité, elle est extrêmement douce et se mange comme un fruit; mais avant cela, elle est acide comme le limon, et on la confit dans du vinaigre. Quand les habitants de Makdachaou ont mangé une bouchée de riz, ils avalent de ces salaisons et de ces conserves au vinaigre. Un seul de ces individus mange autant que plusieurs de nous : c'est là leur habitude; ils sont d'une extrême corpulence et d'un excessif embonpoint.
Lorsque nous eûmes mangé, le kadi s'en retourna. Nous demeurâmes en cet endroit pendant trois j ours, et on nous apportait à manger trois fois dans la journée, car telle est leur coutume. Le quatrième jour, qui était un vendredi, le kadi, les étudiants et un des vizirs du cheikh vinrent me trouver, et me présentèrent un vêtement. Leur habillement consiste en un pagne de filoselle, que les hommes s'attachent au milieu du corps, en place de caleçon, qu'ils ne connaissent pas; en une tunique de toile de lin d'Egypte, avec une bordure; en une fardjîyeh (robe flottante) de kodsy (étoffe de Jérusalem), doublée, et en un turban d'étoffe d'Egypte, avec une bordure. On apporta pour mes compagnons des habits convenables.
Nous nous rendîmes à la mosquée principale, et nous y priâmes derrière la tribune grillée. Lorsque le cheikh sortit de cet endroit, je le saluai avec le kadi. Il répondit par des vœux en notre faveur, et conversa avec le kadi dans l'idiome de la contrée; puis il me dit en arabe : « Tu es le bienvenu, tu as honoré notre pays et tu nous as réjouis. » Il sortit dans la cour de la mosquée, et s'arrêta près du tombeau de son père, qui se trouve en cet endroit; il y fit une lecture dans le Coran et une prière, après quoi les vizirs, les émirs et les chefs des troupes arrivèrent et saluèrent le sultan. On suit, dans cette cérémonie, la même coutume qu'observent les habitants du Yémen. Celui qui salue place son index sur la terre, puis il le pose sur sa tête, en disant : « Que Dieu perpétue ta gloire ! »
Après cela, le cheikh franchit la porte de la mosquée, revêtit ses sandales, et ordonna au kadi et à moi d'en faire autant. Il se dirigea à pied vers sa demeure, qui était située dans le voisinage du temple, et tous les assistants marchaient nu-pieds. On portait au-dessus de la tête du cheikh quatre dais de soie de couleur, dont chacun était surmonté d'une figure d'oiseau en or. Son vêtement consistait ce jour-là en une robe flottante de kodsy vert, qui recouvrait de beaux et amples habits de fabrique égyptienne. Il était ceint d'un pagne de soie et coiffé d'un turban volumineux. On frappa devant lui les timbales et l’on sonna des trompettes et des clairons. Les chefs des troupes le précédaient et le suivaient; le kadi, les jurisconsultes et les chérifs l'accompagnaient. Ce fut dans cet appareil qu'il entra dans sa salle d'audience. Les vizirs, les émirs et les chefs des troupes s'assirent sur une estrade, située en cet endroit. On étendit pour le kadi un tapis, sur lequel nul autre que lui ne prit place. Les fakîhs et les chérifs accompagnaient ce magistrat. Ils restèrent ainsi jusqu'à la prière de trois à quatre heures de l'après-midi. Lorsqu'ils eurent célébré cette prière en société du cheikh, tous les soldats se présentèrent et se placèrent sur plusieurs files, conformément à leurs grades respectifs; après quoi l'on fit résonner les timbales, les clairons, les trompettes et les fiâtes. Pendant qu'on joue de ces instruments, personne ne bouge et ne remue de sa place, et quiconque se trouve alors en mouvement s'arrête, sans avancer ni reculer. Lorsqu'on eut fini de jouer de la musique militaire, les assistants saluèrent avec leurs doigts, ainsi que nous l'avons dit, et s'en retournèrent. Telle est leur coutume chaque vendredi.
Lorsqu'arrive le samedi, les habitants se présentent à la porte du cheikh, et s'asseyent sur des estrades, en dehors de la maison. Le kadi, les fakîhs, les chérifs, les gens pieux, les personnes respectables, et les pèlerins, entrent dans la seconde salle, et s'asseyent sur des estrades en bois, destinées à cet usage. Le kadi se tient sur une estrade séparée, et chaque classe a son estrade particulière, que personne ne partage avec elle. Le cheikh s'assied ensuite dans son salon, et envoie chercher le kadi, qui prend place à sa gauche, après quoi les légistes entrent, et leurs chefs s'asseyent devant le sultan; les autres saluent et s'en retournent. Les chérifs entrent alors, et les principaux d'entre eux s'asseyent devant lui; les autres saluent et s'en retournent. Mais s'ils sont les hôtes du cheikh, ils s'asseyent à sa droite. Le même cérémonial est observé par les personnes respectables et les pèlerins, puis par les vizirs, puis par les émirs, et enfin par les chefs des troupes, chacune de ces classes succédant aune autre. On apporte des aliments; le kadi, les chérifs, et ceux qui sont assis dans le salon, mangent en présence du cheikh, qui partage ce festin avec eux. Lorsqu'il veut honorer un de ses principaux émirs, il l'envoie chercher et le fait manger en leur compagnie ; les autres individus prennent leur repas dans le réfectoire. Ils observent en cela le même ordre qu'ils ont suivi lors de leur admission près du cheikh.
Celui-ci rentre ensuite dans sa demeure; le kadi, les vizirs, le secrétaire intime, et quatre d'entre les principaux émirs, s'asseyent, afin de juger les procès et les plaintes. Ce qui a rapport aux prescriptions de la loi est décidé par le kadi ; les autres causes sont jugées par les membres du conseil, c'est-à-dire les vizirs et les émirs. Lorsqu'une affaire exige que l'on consulte le sultan, on lui écrit à ce sujet, et il envoie sur-le-champ sa réponse, tracée sur le dos du billet, conformément à ce que décide sa prudence.
Telle est la coutume que ces peuples observent continuellement. Je m'embarquai sur la mer dans la ville de Makdachaou, me dirigeant vers le pays des Saouâhil (les rivages) et la ville de Couloua (Quiloa), dans le pays des Zendjs. Nous arrivâmes à Manbaça, grande île, à une distance de deux journées de navigation de la terre des Saouâhil.[27] Cette île ne possède aucune dépendance sur le continent, et ses arbres sont des bananiers, des limoniers et des citronniers. Ses habitants recueillent aussi un fruit qu'ils appellent djammoûn (djambou, Eugenia Jambu), et qui ressemble à l'olive; il a un noyau pareil à celui de l'olive, mais le goût de ce fruit est d'une extrême douceur. Ils ne se livrent pas à la culture, et on leur apporte des grains des Saouâhil. La majeure partie de leur nourriture consiste en bananes et en poisson. Ils professent la doctrine de Chàfi'y, sont pieux, chastes et vertueux; leurs mosquées sont construites très solidement en bois. Près de chaque porte de ces mosquées se trouvent un ou deux puits, de la profondeur d'une ou deux coudées; on y puise l'eau avec une écuelle de bois, à laquelle est fixé un bâton mince, de la longueur d'une coudée. La terre, à l'entour de la mosquée et du puits, est tout unie. Quiconque veut entrer dans la mosquée, commence par se laver les pieds ; il y a près de la porte un morceau de natte très grossier, avec lequel il les essuie. Celui qui désire faire les lotions, tient la coupe entre ses cuisses, verse l'eau sur ses mains, et fait son ablution. Tout le monde ici marche nu-pieds.
Nous passâmes une nuit dans cette île; après quoi nous reprîmes la mer pour nous rendre à Couloua, grande ville située sur le littoral, et dont les habitants sont pour la plupart des Zendjs, d'un teint extrêmement noir. Ils ont à la figure des incisions, semblables à celles qu'ont les Lîmiîn de Djenâdah. Un marchand m'a dit que la ville de Sofàlah est située à la distance d'un demi-mois de marche de Couloua, et qu'entre Sofâlah et Yoûfi (Noua), dans le pays des Lîmiîn,[28] il y a un mois de marche. De Yoûfi, on apporte à Sofâlah de la poudre d'or. Couloua est au nombre des villes les plus belles et les mieux construites; elle est entièrement bâtie en bois; la toiture de ses maisons est en dîs (sorte de jonc, ampelodesmos lenax), et les pluies y sont abondantes. Ses habitants sont adonnés au djihâd (la guerre sainte), car ils occupent un pays contigu à celui des Zendjs infidèles. Leurs qualités dominantes sont la piété et la dévotion, et ils professent la doctrine de Châfi'y.
Lorsque j'entrai dans cette ville, elle avait pour sultan Abou'l Mozaffer Haçan, surnommé également Abou'lmewâhib, à cause de la multitude de ses dons (mewâhib) et de ses actes de générosité. Il faisait de fréquentes incursions dans le pays des Zendjs, les attaquait et leur enlevait du butin, dont il prélevait la cinquième partie, qu'il dépensait de la manière fixée dans le Coran. Il déposait la part des proches du Prophète dans une caisse séparée, et lorsque des chérifs venaient le trouver, il la leur remettait. Ceux-ci se rendaient près de lui de l'Irak, du Hedjaz et d'autres contrées. J'en ai trouvé à sa cour plusieurs du Hedjaz, parmi lesquels Mohammed, fils de Djammâz; Mansour, fils de Lebîdah, fils d'Abou Nemy, et Mohammed, fils de Chomaïlah, fils d'Abou Nemy. J'ai vu à Makdachaou Tabl, fils de Cobaïch, fils de Djammâz, qui voulait aussi se rendre près de lui. Ce sultan est extrêmement humble, il s'assied et mange avec les fakirs, et vénère les hommes pieux et nobles.
Je me trouvais près de lui un vendredi, au moment où il venait de sortir de la prière, pour retourner à sa maison. Un fakir du Yémen se présenta devant lui, et lui dit : « ô Abou'lmewâhib! » — « Me voici, répondit-il; ô fakir! quel est ton besoin ? » — « Donne-moi ces vêtements qui te couvrent. »— « très bien, jeté les donnerai. » — « Sur l'heure. » — « Oui, certes, à l'instant. » Il retourna a la mosquée, entra dans la maison du prédicateur, ôta ses vêtements, en prit d'autres, et dit au fakir : « Entre, et prends-les. » Le fakir entra, les prit, les lia dans une serviette, les plaça sur sa tête, et s'en retourna. Les assistants comblèrent le sultan d'actions de grâces, à cause de l'humilité et de la générosité qu'il avait montrées. Son fils et successeur désigné reprit cet habit au fakir, et lui donna en échange dix esclaves. Le sultan ayant appris combien ses sujets louaient son action, ordonna de remettre au fakir dix autres esclaves et deux charges d'ivoire ; car la majeure partie des présents, dans ce pays, consiste en ivoire, et l'on donne rarement de l'or. Lorsque ce sultan vertueux et libéral fut mort, son frère Daoud devint roi, et tint une conduite tout opposée. Quand un pauvre venait le trouver, il lui disait : « Celui qui donnait est mort, et n'a rien laissé à donner. » Les visiteurs séjournaient à sa cour un grand nombre de mois, et seulement alors il leur donnait très peu de chose; si bien qu'aucun individu ne vint plus le trouver.
Nous nous embarquâmes à Couloua pour la ville de Zafar alhoumoûdh (Zafar aux plantes salines et amères). Le mot Zafar est indéclinable, et sa dernière lettre est toujours accompagnée de la voyelle kesrah (i, Zhafâri). Elle est située à l'extrémité du Yémen, sur le littoral de la mer des Indes, et l'on en exporte dans l'Inde des chevaux de prix. La traversée dure un mois plein, si le vent est favorable; et pour ma part, j'ai fait une fois en vingt-huit jours le voyage entre Kâlikoûth, ville de l'Inde, et Zafar. Le vent était propice, et nous ne cessâmes pas d'avancer nuit et jour. La distance qu'il y a par terre entre Zafar et Aden est d'un mois, à travers le désert. Entre Zafar et Hadramaout il y a seize jours, et entre la même ville et Oman, vingt jours de marche. La ville de Zafar se trouve dans une campagne déserte, sans village ni dépendances. Le marché est situé hors de la ville, dans un faubourg appelé Hardjâ et c'est un des plus sales marchés, des plus puants et des plus abondants en mouches, à cause de la grande quantité de fruits et de poissons que l'on y vend. Ces derniers consistent, pour la plupart, en sardines, qui sont dans ce pays extrêmement grasses. Une chose étonnante, c'est que les bêtes de somme s'y nourrissent de ces sardines, et il en est ainsi des brebis. Je n'ai point vu pareille chose dans aucune autre contrée. Presque tous les débitants du marché sont des femmes esclaves, qui sont habillées de noir.
La principale culture des habitants de Zafar consiste en millet (dhourah), qu'ils arrosent au moyen de puits très profonds. Pour cela, ils préparent un énorme seau, auquel ils adaptent plusieurs cordes, à chacune desquelles s'attache, par la ceinture, un esclave mâle ou femelle. Ils tirent le seau le long d'une grosse pièce de bois, placée en haut du puits, et le renversent dans une citerne, qui sert pour arroser. Ils ont aussi une sorte de blé, qu'ils nomment 'alas, mais qui, en vérité, est une espèce d’orge. Le riz est importé de l'Inde dans ce pays, et il constitue la principale nourriture de ses habitants. Les dirhems de cette ville sont un alliage de cuivre et d'étain, et n'ont pas cours ailleurs. Les habitants sont des marchands, et vivent exclusivement du trafic.
Ils ont cette habitude, quand un navire arrive, soit de l'Inde, soit d'un autre pays, que les esclaves du sultan se dirigent vers le rivage, qu'ils montent sur un bateau, et se rendent à bord de ce bâtiment. Ils portent avec eux des habillements complets, pour le maître du navire ou son préposé, pour le robbân, qui est le capitaine, et pour le kirâny, c'est-à-dire le scribe du bâtiment. On amène aussi pour ces individus trois chevaux, sur lesquels ils montent. On bat devant eux les tambours, et l’on sonne les clairons, depuis le bord de la mer jusqu'au palais du sultan, et ils vont saluer le vizir et le commandant des gardes. On envoie le repas d'hospitalité pendant trois jours à tous ceux qui se trouvent sur le navire; après cela, ils mangent dans le palais du sultan. Ces gens agissent ainsi pour se concilier l'esprit des maîtres des bâtiments.
Les habitants de Zafar sont modestes, doués d'un bon naturel, vertueux, et ils aiment les étrangers. Leurs vêtements sont en coton, qui est importé de l'Inde, et ils attachent des pagnes à leur ceinture, en place de caleçon. La plupart se ceignent seulement d'une serviette au milieu du corps, et en mettent une autre sur le dos, à cause de la grande chaleur, fis se lavent plusieurs fois dans la journée. La ville possède beaucoup de mosquées, dans chacune desquelles il y a de nombreux cabinets pour les purifications. On fabrique à Zafar de très belles étoffes de soie, de coton et de lin. La maladie qui attaque le plus souvent les gens de cette ville, hommes et femmes, c'est l'éléphantiasis; elle consiste en un gonflement des deux pieds. Le plus grand nombre des hommes sont tourmentés par des hernies; que Dieu nous en préserve! Une des belles habitudes de cette population consiste à se tenir mutuellement par la main dans la mosquée, immédiatement après la prière du matin, et celle de trois heures. Ceux qui sont au premier rang s'appuient sur le côté qui regarde la Mecque, et ceux qui les suivent leur prennent la main. Ils agissent encore ainsi après la prière du vendredi, se tenant tous ensemble par les mains.
Un des avantages particuliers, et une des merveilles de cette ville, c'est que, toutes les fois qu'un personnage se dirige vers elle, avec de mauvais desseins, sa fraude se retourne contre lui-même, et un obstacle s'élève entre lui et la place. On m'a raconté que le sultan Kothb eddîn Temehten (Tehemten, « puissant »), fils de Touran chah, seigneur de Hormouz, l'attaqua une fois par terre et par mer; mais que Dieu très haut déchaîna contre lui un vent violent. Ses vaisseaux furent brisés ; il renonça alors au siège de la ville, et fit la paix avec son roi. On m'a pareillement rapporté qu'Almélic almodjâhid (le roi belliqueux), sultan du Yémen, avait désigné un de ses cousins, avec une armée nombreuse, dans le but d'arracher Zafar des mains de son roi, qui était aussi un de ses cousins. Lorsque le susdit commandant sortit de sa maison, un mur tomba sur lui et sur plusieurs de ses compagnons, et ils périrent tous. Le roi abandonna alors son projet, il ne donna aucune suite au siège de Zafar, et cessa de prétendre à cette cité.
Une autre chose merveilleuse, c'est que les habitants de cette ville sont ceux des hommes qui ressemblent le plus, dans leurs usages, aux gens du Maghreb. Je logeai, par exemple, dans la maison du prédicateur de la mosquée principale, lequel était Îça, fils d'Aly, homme jouissant d'une grande considération, et doué d'une âme généreuse. Il avait des femmes esclaves, nommées à l'instar de celles de la Mauritanie. L'une s'appelait Bokhaït (petit bonheur), l'autre Zâd almâl (provisions de richesse), noms que je n'avais entendu prononcer dans aucun autre pays. Presque tous les habitants de Zafar portent la tête découverte et sans turban. Dans chacune de leurs maisons il y a une natte de feuilles de palmier, suspendue dans l'intérieur du logement, et sur laquelle le chef de famille se place pour prier, et cela précisément à la manière des Occidentaux. Enfin, ils se nourrissent de millet. Cette similitude entre les deux peuples confirme l'opinion d'après laquelle les Sanhâdjah et autres tribus de la Mauritanie tirent leur origine de Himyar, famille du Yémen.
Dans le voisinage de Zafar, et entre ses vergers, se voit la zaouïa du pieux cheikh, le serviteur de Dieu, Abou Mohammed, fils d'Abou Bekr, fils d'Îça, originaire de cette ville. Elle jouit d'une grande vénération chez ces peuples, qui s'y rendent matin et soir, et se mettent sous sa protection. Quand l'individu qui cherche un refuge y est entré, le sultan n'a plus de pouvoir sur lui. J'y ai vu une personne, qu'on m'affirma être là retirée depuis plusieurs années, sans que le souverain lui eût fait subir aucun mauvais traitement. Dans le temps de mon séjour à Zafar, le secrétaire du sultan se mit sous la protection de cette zaouïa, et y resta jusqu'à ce que la bonne harmonie eût été rétablie entre eux deux. J'ai été dans cette zaouïa, et j'y ai passé une nuit, sous l'hospitalité des deux cheikhs, Abou'l'abbâs Ahmed et Abou 'Abd Allah Mohammed, fils, l'un et l'autre, du cheikh Abou Bekr susmentionné, et j'ai reconnu chez tous deux un grand mérite. Quand nous eûmes lavé nos mains, après le repas, Abou'l'abbâs prit l'eau qui nous avait servi pour cet usage, et en but. Il envoya une servante avec le restant à sa femme et à ses enfants, qui le burent. C'est ainsi que ces individus agissent à l'égard des visiteurs dont ils conçoivent une opinion favorable. De cette façon même, je reçus l'hospitalité du kadi de Zafar, le pieux Abou Hâchim 'Abd Almélic azzebîdy. Il me servait en personne, il lavait mes mains, et ne chargeait nul autre de ces soins.
A peu de distance de ladite zaouïa est la chapelle sépulcrale des prédécesseurs du sultan Almélic almoghîth (le roi qui porte secours). Elle est en grande vénération dans ce pays; et c'est là que se réfugient, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, ceux qui cherchent à obtenir quelque chose. Les troupes ont l'habitude de se mettre sous la protection de ce monument, lorsque le mois s'est écoulé sans qu'elles aient reçu leur solde; et elles y restent jusqu'à ce qu'elles l'obtiennent.
A une demi-journée de distance de Zafar se trouvent les Ahkâf (collines de sables, déserts), qui ont été jadis les demeures du peuple d'Âd. On y voit une zaouïa, et une mosquée au bord de la mer, entourée par un village qu'habitent les pêcheurs de poissons. Dans la zaouïa est un tombeau, avec l'épitaphe suivante : « Ceci est le sépulcre de Hoûd, fils d'Abir, sur qui soient la meilleure bénédiction et le salut! » J'ai déjà dit (voyez t. I) qu'il y a dans la mosquée de Damas un endroit avec cette inscription : « Ceci est le sépulcre de Hoûd, fils d'Abir. » Mais le plus probable, c'est que sa tombe est dans ces monticules de sable, car c'était là son pays ; et Dieu sait le mieux la vérité ! Zafar possède des vergers où sont beaucoup de bananes d'une forte dimension. On a pesé devant moi un de ces fruits, qui se trouvait avoir le poids de douze onces; il est d'un goût agréable, et très sucré. On y voit aussi le bétel, de même que le coco, qui est connu sous le nom de noix de l'Inde. On ne trouve ces deux dernières productions que dans l'Inde et dans cette ville de Zafar, à cause de sa ressemblance avec l'Inde, et de son voisinage de ce pays. Il est toutefois juste de dire que, dans la ville de Zebîd, on remarque dans le jardin du sultan de petits cocotiers. Et puisque nous venons de parler du bétel et du coco, nous allons décrire ces deux plantes et mentionner leurs propriétés.
Le bétel est un arbre qu'on plante à l'instar des ceps de vigne, et on lui prépare des berceaux avec des cannes, ainsi qu'on le pratique pour la vigne; ou bien on le plante dans le voisinage des cocotiers, et le bétel grimpe sur ceux-ci, comme le font encore les ceps de vigne et l'arbre à poivre. Le bétel ne donne pas de fruit, et ce sont ses feuilles que l'on recherche. Elles ressemblent à celles de la ronce; leur meilleure partie est la partie jaune, et on les cueille tous les jours. Les Indiens font un très grand cas du bétel. Quand un individu se rend dans la maison d'un de ses amis, et que celui-ci lui présente cinq feuilles de cet arbre, c'est comme s'il lui donnait le monde et tout ce qu'il renferme; surtout si celui qui les donne est un prince ou un grand personnage. Ce cadeau, chez les Indiens, est plus prisé en lui-même, et montre mieux l'honneur que l'on veut faire à quelqu'un, qu'un don d'argent et d'or.
La manière de s'en servir consiste à prendre avant le bétel de la noix faoufel, qui ressemble à la noix muscade, et à la briser, jusqu'à ce qu'elle soit réduite en petits fragments. Alors on les met dans la bouche et on les mâche.
On prend après cela les feuilles du bétel, sur lesquelles on met unie très petite quantité de chaux, et on les mâche avec le faoufel (noix d'arec). Il a la propriété de parfumer l'haleine, de chasser ainsi les mauvaises odeurs de la bouche, d'aider à la digestion des aliments, et d'empêcher que l'eau bue à jeun ne soit nuisible. Son emploi porte à la gaieté, de même qu'aux plaisirs de l'amour. On le place la nuit au chevet du lit, et lorsqu'un individu se réveille, ou est réveillé par sa femme ou sa concubine, il en prend, et chasse par ce moyen la mauvaise odeur de sa bouche. L'on m'a raconté que les jeunes filles, esclaves du sultan et des princes dans l'Inde, ne mangent que du bétel. Nous parlerons de cela quand il sera question de l'Inde.
C’est la noix de l'Inde, fruit d'un arbre des plus singuliers, quanta son état, et des plus admirables pour ses particularités. Il ressemble au palmier, et il n'y a pas d'autre différence entre les-deux, si ce n'est que l'un produit des noix, et l'autre des dattes. La noix du cocotier ressemble à la tête de l'homme, car on y aperçoit des ouvertures semblables aux deux yeux, et à la bouche. Quand elle est verte, son intérieur est pareil au cerveau de l'homme; et tout autour de la noix on voit des filaments qui offrent l'image des cheveux. Les habitants de Zafar, et autres contrées, font avec ces fibres des cordes, qui leur servent à joindre (littéral. à coudre) les planches des navires, en place de clous de fer, et ils en font aussi des câbles pour les bâtiments. Il y a de ces noix, et surtout celles qui croissent dans les îles Maldives, qui ont la dimension de la tête d'un homme.
On prétend dans ces pays qu'un des médecins de l'Inde était, à une époque reculée, attaché à un roi de cette contrée, et en très grande considération près de lui; mais que ce dernier avait un vizir, entre lequel et le médecin régnait une inimitié réciproque. Celui-ci dit un jour au roi : « Si l'on coupait la tête de ce vizir, et qu'ensuite on l'enterrât, il en sortirait un palmier, qui produirait de magnifiques dattes, lesquelles seraient d'une grande utilité aux Indiens, et autres peuples du monde. » Le roi lui répondit : « Et s'il ne sort pas de la tête du vizir ce que tu prétends? Le médecin répliqua : « Dans ce cas, fais de ma tête ce que tu auras fait de celle du vizir. » Le roi ordonna de couper la tête de ce dernier, ce qui fut exécuté; le médecin la prit, planta un noyau de datte dans le cerveau, et le soigna jusqu'à ce qu'il devînt un arbre, et qu'il produisît cette noix!... Mais cette anecdote est un conte mensonger, et nous ne l'avons mentionnée, qu'à cause de sa grande célébrité chez les peuples de l'Inde.
Parmi les propriétés de cette noix, il faut observer qu'elle donne de la force au corps, qu'elle produit l'embonpoint, et augmente l'incarnat du visage. Quant au secours qu'elle procure pour les plaisirs de l'amour, son action en cela est admirable. Une des merveilles de ce fruit, c'est que, dans son commencement, lorsqu'il est encore vert, celui qui coupe avec un couteau une partie de son écorce, et qui creuse ainsi la tête de la noix, y boit une eau très douce et extrêmement fraîche, mais dont la nature, au contraire, est chaude, et excite aux plaisirs de Vénus. Il arrive que, après avoir avalé cette eau, il prend un morceau de l'écorce, et le façonne à l'instar d'une cuiller, avec laquelle il enlève l'aliment qui se trouve dans l'intérieur de la noix, et dont le goût ressemble à celui de l'œuf, lorsqu'il est rôti, mais qu'il n'est point encore tout à fait cuit; et il s'en nourrit. C'était là ma nourriture tout le temps de mon séjour aux îles Maldives, qui fut d'une année et demie. Une autre merveille de cette noix, c'est que l'on fabrique avec elle de l'huile, du lait et du miel.
Quand on veut en extraire du miel, les domestiques qui ont soin de cette sorte de palmiers, et qui s'appellent alfâzâniyah, montent sur le cocotier, matin et soir, à l'époque où ils veulent recueillir l'eau de cet arbre, dont ils font le miel, et à laquelle ils donnent le nom d'athwâk. Pour cela, ils coupent le rameau d'où sort le fruit, et ils en laissent subsister la longueur de deux doigts, où ils attachent un petit chaudron. L'eau qui coule du rameau tombe goutte à goutte dans cet ustensile, et s'il a été attaché le matin, le domestique revient le soir, portant avec lui deux coupes, faites avec l'écorce de la noix mentionnée plus haut; l'une de celles-ci est remplie d'eau. Il verse le liquide qui se trouve dans le chaudron dans la coupe vide, et lave le rameau avec l'eau contenue dans l'autre; il enlève ensuite un peu de son bois, et y fixe de nouveau le chaudron; puis, il agit le matin suivant comme il avait pratiqué le soir, et quand il a ainsi réuni une quantité suffisante de ce liquide, il le cuit à l'instar, de la liqueur des raisins, lorsque l'on fait le robb (suc épaissi). On a de la sorte un miel excellent, d'une grande utilité, qu'achètent les marchands de l'Inde, du Yémen et de la Chine, lesquels l'importent dans leurs pays, et dont ils fabriquent des sucreries.
Le lait de Coco se prépare de la manière qui suit : dans chaque maison il y a un meuble, ressemblant à un fauteuil, sur lequel une femme s'assied, tenant à la main un bâton, qui est garni, à une de ses extrémités, d'un morceau de fer proéminent. On fait dans la noix une ouverture par laquelle passe Ce fer en guise d'éperon, avec ce fer l'on casse ce qui se trouve dans l'intérieur de la noix. On recueille tout ce qui en sort dans un grand plat; jusqu'à ce que le coco soit entièrement vide ; puis on fait macérer dans l'eau toutes ces parties concassées, qui prennent la couleur blanche et le goût du lait frais, et qu'on mange généralement avec le pain.
Pour obtenir l'huile, on prend la noix de coco, après sa maturité et sa chute de l'arbre; on ôte son écorce, puis on coupe le contenu par morceaux, qu'on place au soleil. Quand ils sont desséchés, on les cuit dans des chaudières, et on en extrait l'huile. On emploie celle-ci pour l'éclairage, aussi bien que pour la préparation des aliments; les femmes s'en servent pour mettre sur leurs cheveux, et elle est ainsi d'une grande utilité.
C'est le sultan Almélic almoghîth, fils d'Almélic alfàïz (le roi triomphant), cousin du roi du Yémen. Son père était commandant de Zafar, sous la suzeraineté du seigneur du Yémen, auquel il devait un présent, qu'il lui envoyait chaque année; mais plus tard Almélic almoghîth se fit prince indépendant de Zafar, et se refusa à l'envoi du tribut. Il arriva alors ce que nous avons raconté plus haut, savoir : l'intention qu'eut le roi du Yémen de le combattre, la nomination de son cousin pour cet objet, et la chute de la muraille sur lui. Le sultan de Zafar a dans l'intérieur de la ville un palais appelé Alhisn (le château), qui est magnifique et vaste ; la mosquée principale est vis-à-vis de cet édifice. Il est d'usage déjouer des tambours, des clairons, des trompettes et des fifres, à la porte du sultan, tous les jours, après la prière de trois heures. Les lundis et les jeudis les troupes se rendent devant le palais, et elles restent une heure au dehors de la salle d'audience; puis elles s'en retournent. Le sultan ne sort pas, et personne ne le voit, excepté le vendredi, où il se rend à la prière, et retourne tout de suite après à son palais. Il ne défend à qui que ce soit l'entrée de la salle d'audience, à la porte de laquelle se tient assis le commandant des gardes, et c'est à lui que s'adressent ceux qui ont quelque chose à solliciter, ou quelque plainte à porter. Celui-ci expose l'affaire au sultan, et apporte immédiatement la réponse. Quand ce prince désire monter à cheval, on fait sortir du château ses montures, ainsi que ses armes et ses mamlouks, jusqu'à ce que l'on arrive à l'extérieur de la ville. L'on amène un chameau, portant une litière recouverte d'un rideau blanc brodé d'or, dans laquelle se placent le sultan et son commensal, de façon que nul ne les voit. Lorsque ce roi est arrivé dans son jardin, s'il veut monter un cheval, il le fait, et descend alors de son chameau. Une autre de ses habitudes, c'est que personne ne doit se trouver à côté de lui sur son chemin, ni s'arrêter pour le regarder, soit pour se plaindre, soit pour tout autre motif. Celui qui oserait commettre pareille chose, serait sévèrement battu ; c'est à cause de cela que l'on voit les gens s'enfuir, et éviter de suivre la même route que le sultan, lorsqu'ils apprennent sa sortie.
Le vizir de ce prince est le jurisconsulte Mohammed' al'adeny. Il était d'abord un instituteur de jeunes enfants; il enseigna ainsi au sultan la lecture et l'écriture, et lui fit promettre de le nommer son vizir, s'il devenait roi. Quand cela arriva, le prince accomplit sa promesse; mais le ministre ne remplissait pas bien ses fonctions ; il possédait seulement le nom de vizir, et un autre avait l'autorité attachée à l'emploi. Nous nous embarquâmes sur mer à Zafar, nous dirigeant vers l'Oman, dans un petit navire appartenant à un individu nommé Aly, fils d'Idris almassîry, originaire de l'île Massîrah. Le deuxième jour, nous abordâmes au port de Hâcic, habité par des gens de race arabe, pêcheurs de profession. Ici se trouve l'arbre qui fournit l'encens (olibanum thus); ses feuilles sont minces, et lorsqu'on pratique des incisions dans celles-ci, il en dégoutte une liqueur semblable au lait, et qui devient ensuite une gomme (ou plutôt, une résine); et c'est là l'encens, qui est très abondant dans ce pays. Les habitants de ce port ne vivent que de la pêche d'un genre de poisson, appelé alloukham, et qui ressemble à celui qui est nommé chien de mer. On le coupe par tranches, et aussi par lanières; on le fait sécher au soleil, on le sale, et on s'en nourrit. Les maisons de ces gens sont faites avec les arêtes des poissons, et leurs toits avec des peaux de chameaux. Nous voyageâmes encore quatre jours depuis le port de Hâcic; ensuite nous arrivâmes à la montagne Loum'an. Elle est située au milieu de la mer, et à son sommet se voit un couvent construit en pierre, mais dont la couverture est formée d'arêtes de poissons. A l'extérieur de l'édifice se voit un étang, qui est le produit de l'eau pluviale.
Après avoir jeté l'ancre au pied de cette montagne, nous la gravîmes pour nous rendre audit couvent, et nous y trouvâmes un vieillard qui dormait. Nous prononçâmes la formules du salut, il se réveilla, et nous rendit les salutations par signes. Nous lui adressâmes la parole, mais il ne nous, répondit pas, et secoua seulement la tête. Les marins lui apportèrent des mets, et il refusa de les recevoir. Nous lui demandâmes de prier pour nous ; il remua les lèvres, mais nous ne sûmes pas ce qu'il disait. Il portait une robe rapiécée, un bonnet de feutre, et il n'avait avec lui ni petite outre, ni aiguière, ni bâton ferré (ou bourdon), ni chaussure. Les gens de l'équipage dirent qu'ils ne l'avaient jamais vu dans cette montagne. Nous passâmes la journée en ce lieu et nous priâmes avec ce cheikh dans l'après-midi et au moment du coucher du soleil. Nous lui présentâmes des aliments, qu'il ne voulut pas accepter, et il continua à prier jusqu'à la nuit close. Alors il fit l'appel à la prière correspondante à cette heure, et nous la célébrâmes en sa compagnie. Il avait une belle voix et lisait fort bien. Quand ladite prière eut été terminée, il nous fit signe de nous retirer, ce que nous accomplîmes, après lui avoir dit adieu; et nous étions très étonnés de sa conduite. Après l'avoir quitté, je voulus retourner vers lui; mais, quand je me fus approché, je fus retenu par un sentiment de vénération à son égard, et la crainte l'emporta. Mes camarades étaient revenus aussi sur leurs pas, et je m'en retournai avec eux.
Nous nous embarquâmes de nouveau, et après deux jours, nous arrivâmes à l'île des Oiseaux, qui est dépourvue de population. Nous jetâmes l'ancre, nous montâmes dans l'île, et nous la trouvâmes remplie d'oiseaux ressemblant aux moineaux, mais plus gros que ceux-ci. Les gens du navire apportèrent des œufs, les firent cuire et les mangèrent. Ils se mirent à chasser ces mêmes oiseaux, et en prirent un bon nombre, qu'ils firent cuire aussi, sans les avoir préalablement égorgés, et ils les mangèrent. Il y avait, assis à mon côté, un marchand de l'île de Massîrah, qui habitait Zafar, et dont le nom était Moslim. Je le vis manger ces oiseaux avec les matelots, et je lui reprochai une telle action. Il en fut tout honteux, et il me répondit : « Je croyais qu'ils leur avaient coupé la gorge. » Après cela, il se tint éloigné de moi, par l'effet de la honte, et il ne m'approchait que lorsque je l'appelais.
Ma nourriture, pendant le voyage sur ce navire, était composée de dattes et de poissons. Les marins péchaient, matin et soir, une sorte de poisson nommé en persan chîr mâhy, mots dont la signification est « le lion du poisson » (ou mieux « poisson lion »). En effet, chîr veut dire « lion » et mâhy « poisson ». Il ressemble à celui qui est appelé chez nous tâzart. Ces gens ont l'habitude de le couper par petites tranches, de les faire rôtir, et d'en donner une seulement par personne à tous ceux qui montent le navire, sans accorder de préférence à qui que ce soit, y compris même le maître du bâtiment. Ils mangent ce poisson avec les dattes. J'avais avec moi du pain et du biscuit, que j'avais emportés de Zafar; et lorsqu'ils furent épuisés, je me nourris, comme eux, de ce poisson. Nous célébrâmes en mer la fête des sacrifices (dixième jour de dhou’lhidjdjeh, petit beïrâm); un vent violent souffla contre nous toute la journée; il commença après l'aurore, et dura jusqu'au lever du soleil (le jour suivant). Il fut bien près de nous submerger.
Il y avait avec nous sur le navire un pèlerin de l'Inde, nommé Khidhr, mais qu'on appelait Maoulânâ (notre maître), car il savait par cœur le Coran et il écrivait bien. Quand il vit l'extrême agitation de la mer, il enveloppa sa tête dans son manteau, et fit semblant de dormir. Lorsque Dieu eut dissipé le danger qui nous menaçait, je lui dis : « Ô notre maître Khidhr, qu'as-tu vu ? » Il me répondit : « Pendant la bourrasque, j'ouvrais les yeux pour voir si les anges qui saisissent les âmes venaient. Je ne les voyais point, et je m'écriais : Louange à Dieu ! car si la submersion devait avoir lieu, ils viendraient prendre possession des âmes; puis je fermais les yeux, et ensuite je les ouvrais de nouveau, pour regarder ce que je viens de dire, jusqu'à ce que Dieu eût détourné de nous le péril. » Un navire appartenant à un négociant nous avait devancés; il fut submergé, et il n'en échappa qu'une seule personne, qui se sauva à la nage, après de grands efforts.
Je goûtai, sur le bâtiment, un genre de mets que je n'avais jamais mangé auparavant, et que je ne goûtai plus après cette fois. Il avait été préparé par un des marchands de l'Oman, et consistait en millet dhourah, non moulu, que cet individu fit cuire, et sur lequel il versa du saïlàn, qui est un miel tiré des dattes; puis nous le mangeâmes.
Nous continuâmes notre voyage et nous arrivâmes à l'île de Massîrah, patrie du maître du navire sur lequel nous étions embarqués. Son nom se prononce a la manière du mot massîr (ce que l'on devient, issue, etc.), avec addition du ta (hâ), qui marque le féminin. C'est une île vaste, et ses habitants n'ont point d'autre nourriture que des poissons. Nous n'y débarquâmes pas, à cause de l'éloignement où sa rade est du rivage. Au reste, j'avais pris en horreur ces gens-là, lorsque je les eus vus manger les oiseaux sans leur couper la gorge (et sans dire : « Au nom de Dieu ! » — L'auteur fait allusion ici aux marins, qui étaient apparemment de cette île. Cf. ci-dessus). Nous y restâmes un jour, pendant lequel le patron du navire descendit à terre chez lui, puis il revint.
Après cela nous marchâmes un jour et une nuit, et nous arrivâmes à la rade d'un gros bourg au bord de la mer, nommé Sour. De cet endroit, nous vîmes la ville de Kalhât, située au pied d'une montagne, et qui nous sembla très proche. Nous jetâmes l'ancre un peu avant midi, et, quand nous aperçûmes ladite ville, je désirai m'y rendre à pied et y passer la nuit, car je détestais la société de nos marins. Je pris des informations touchant sa distance, et l'on me dit que j'arriverais à Kalhât à trois ou quatre heures de l'après-midi du même jour. Alors je louai un des matelots pour m'indiquer la route, et Khidhr, l'Indien dont nous avons déjà parlé, vint avec moi. Je laissai dans le bâtiment mes compagnons avec mes effets, et ils devaient venir me rejoindre le lendemain. Je pris un paquet de mes propres habillements, que je remis au guide, afin qu'il m'évitât la fatigue de les porter, et je saisis dans ma main une lance.
Mais ce guide voulait s'emparer de mes habillements. Il nous conduisit à un canal formé par la mer et où a lieu le flux et le reflux, et il se disposa à le traverser avec les hardes. Je lui dis alors : « Passe-le toi seul, et laisse ici les effets; nous traverserons, si nous le pouvons, sinon nous remonterons pour chercher le gué ». Il revint sur ses pas, et nous vîmes peu après des hommes qui passèrent le canal à la nage, ce qui nous prouva que l'intention du guide était de nous noyer, et de se sauver avec les vêtements. Alors je simulai l'allégresse; mais je me tins sur mes gardes, je serrai ma ceinture et je brandis ma lance ; le conducteur eut peur de moi. Nous montâmes jusqu'à ce que nous eussions rencontré un passage; ensuite nous nous trouvâmes dans une plaine déserte et sans eau. Nous eûmes soif et souffrîmes beaucoup; mais Dieu nous envoya un cavalier, suivi de plusieurs camarades, dont l'un tenait en main une petite outre pleine d'eau. Il me donna à boire, ainsi qu'à mon compagnon, et nous continuâmes à marcher, pensant que la ville était tout près de nous, tandis que nous en étions séparés par de larges fossés, dans lesquels nous cheminâmes plusieurs milles.
Quand ce fut le soir, le guide voulut nous entraîner du côté de la mer, qui n'offre pas ici de chemin, car le rivage est une suite de rochers. Son intention était que nous fussions embarrassés parmi les pierres, et qu'il pût ainsi s'en aller, avec le paquet; mais je lui dis : « Nous ne marcherons que sur la route où nous sommes. » Or il y avait environ un mille de distance de ce point à la mer. Lorsque la soirée fut devenue obscure, il nous dit : « Certes, la ville est proche de nous; allons, marchons, afin que nous puissions passer la nuit au dehors de la ville, en attendant l'aurore ! » Je craignis d'être attaqué par quelqu'un pendant la route, et je ne savais pas au juste quel intervalle il restait, encore à parcourir. Je répondis donc au conducteur : « Il vaut mieux que nous sortions du chemin et que nous dormions, et quand nous serons au matin, nous nous rendrons, s'il plaît à Dieu, à la ville. » J'avais vu; en effet, une troupe d’hommes au pied d'une montagne qui se trouvait en cet endroit; j'eus peur qu'ils ne fussent des voleurs, et me dis, à part moi : Il est préférable de se dérober aux regards. » Quant à mon camarade, il était vaincu par la soif, et n'approuvait pas ma détermination.
Cependant je quittai la route, et me dirigeai vers un de ces arbres appelés oumm Ghaïlân (épine d'Egypte, espèce d'acacia), car j'étais fatigué et je souffrais; mais je simulais la force et la constance, par crainte du guide. Mon compagnon était malade et n'avait plus d'énergie. Je plaçai le conducteur entre lui et moi, je mis le paquet de bardes entre mes vêtements et mon corps, et je tins ma lance à la main, Mon camarade dormit, ainsi que le guide; pour moi, je restai éveillé, et toutes les fois que ce dernier bougeait, je lui parlais, pour lui montrer que je ne dormais pas. Nous demeurâmes ainsi jusqu'à l'aurore; nous nous dirigeâmes alors vers le chemin, et vîmes des gens qui apportaient des denrées à la ville. J'envoyai le guide pour chercher de l'eau, mon compagnon ayant pris les habillements, et il y avait entre nous et la ville, des valions et des fossés. Le guide nous apporta de l'eau, que nous bûmes, et cela se passait à l'époque des chaleurs.
Enfin, nous arrivâmes à Kalhât, où nous entrâmes dans un état d'extrême souffrance. Ma chaussure était devenue trop étroite pour mon pied, de sorte qu'il s'en fallut de peu que le sang ne coulât de dessous les ongles. Lorsque nous atteignîmes la porte de la ville, il arriva, pour comble de malheur, que le gardien nous dit : « Il faut absolument que tu ailles avec moi chez le commandant de la ville, afin qu'il soit informé de ton aventure, et qu'il sache d'où tu viens. » J'allai avec lui, et je trouvai que l'émir était un homme de bien et d'un bon naturel. Il me fit des questions sur mon état, il me donna l'hospitalité, et je restai près de lui six jours. Pendant ce temps, je ne pus point me tenir debout sur mes pieds, tant ils étaient endoloris.
La ville de Kalhât est située sur le littoral; elle possède de beaux marchés, une des plus jolies mosquées qu'on puisse voir, et dont les murailles sont recouvertes de faïence colorée de Kâchân, qui ressemble au zélîdj. Cette mosquée est très élevée, elle domine la mer et le port, et sa construction est due à la pieuse Bîbi Merïam (Marie). Le sens du mot bîbi, chez ces gens, c'est « femme libre, noble ». J'ai mangé à Kalhât du poisson tel que je n'en ai goûté dans aucun autre pays; je le préférais à toute sorte de viandes, et c'était là ma seule nourriture. Les habitants le font rôtir sur des feuilles d'arbre, le mettent sur du riz, et le mangent; quant à ce dernier, il leur est apporté de l'Inde. Kalhât est habité par des marchands, qui tirent leur subsistance de ce qui leur arrive par la mer de l'Inde. Lorsqu'un navire aborde chez eux, ils s'en réjouissent beaucoup. Bien qu'ils soient Arabes, ils ne parlent point un langage correct. Après chaque phrase qu'ils prononcent, ils ont l'habitude d'ajouter la particule non. Ils disent par exemple : « Tu manges, non; tu marches, non; tu fais telle chose, non. » La plupart sont schismatiques, mais ils ne peuvent point pratiquer ostensiblement leur croyance, car ils sont sous l'autorité du sultan Kothb eddîn Temehten (Tehemten), roi de Hormouz, qui fait partie de la communion orthodoxe.
Près de Kalhât se voit le bourg de Thîby. Ge nom se prononce comme le mot thîb, lorsque celui qui parle le met en rapport d'annexion avec lui-même (ce qui fait thîby, « mon parfum », etc.). C'est un des plus jolis bourgs et des plus admirables par sa beauté; il possède des canaux dont le cours est rapide, des arbres verdoyants, des vergers nombreux, et l'on en exporte des fruits à Kalhât. Il fournit une sorte de banane appelée almorouârîd, c’est-à-dire, en persan, « perles », et qui y est très abondante. On en exporte aussi à Hormouz et ailleurs. On y voit encore du bétel, mais ses îles sont petites. Quant aux dattes, on les apporte de nân dans ces contrées.
Nous nous dirigeâmes ensuite vers ce dernier pays, et marchâmes six jours dans une plaine déserte; puis nous arrivâmes dans le pays d'Oman le septième jour. C'est une province fertile, riche en canaux, en arbres, en vergers, en enclos plantés de palmiers, et en beaucoup de fruits de différentes espèces. Nous entrâmes dans la capitale de ce pays, qui est la ville de Nazoua.
Elle est située au pied d'une montagne; des canaux l'entourent, ainsi que des vergers, et elle possède de beaux marchés et des mosquées magnifiques et propres. Ses habitants ont coutume de prendre leurs repas dans les cours des mosquées, chacun d'eux apportant ce qu'il possède; ils mangent aussi tous ensemble, et les voyageurs sont admis à leur festin. Ils sont forts et braves, toujours en guerre entre eux. Ils sont de la secte ibâdhite, et font quatre fois la prière du vendredi, à midi. Après cela, l'imâm lit des versets du Coran, et débite un discours, à l'instar du prône, dans lequel il fait des vœux pour Abou Bekr et Omar, et passe sous silence Othman et Aly. Quand ces gens veulent parler de ce dernier, ils emploient comme métonymie le mot homme, et ils disent: « On raconte au sujet de l'homme; » ou bien : « l’homme dit. » Ils font des vœux pour le scélérat, le maudit Ibn Moldjam, et l'appellent : « le pieux serviteur de Dieu, le vainqueur de la sédition. » Leurs femmes sont très corrompues, et ils n'en éprouvent aucune jalousie et ne blâment point leur conduite. Nous raconterons bientôt, après cet article, une anecdote qui témoignera de ce que nous venons d'avancer.
Le sultan d'Oman est un Arabe de la tribu d'Azd, fils d'Alghaouth, et il est connu sous le nom d'Abou Mohammed, fils de Nebhân. Chez ces peuples, Abou Mohammed est une dénomination usitée pour tous les sultans qui gouvernent l'Oman, comme celle d'atabek est employée pour les rois des Loûr. Il a l'habitude de s'asseoir, pour donner ses audiences, dans un endroit situé hors de son palais; il n'a ni chambellan, ni vizir, et tout individu, étranger ou non, est libre de l'approcher. Ce sultan honore son hôte, suivant la coutume des Arabes; il lui assigne le repas de l'hospitalité et lui fait des présents proportionnés à son rang ; il est doué de qualités excellentes. On mange à sa table la viande de l'âne apprivoisé, et l'on en vend dans le marché, car ces gens croient qu'elle est permise ; mais ils la cachent à l'étranger, et ne la font jamais paraître en sa présence.
Parmi les villes de l'Oman est celle de Zaky; je ne l'ai point visitée, mais l'on m'a assuré que c'est une grande cité. Il renferme aussi Alkouriyyât, Chaba, Calba, Khaour-Fouccân et Souhâr.[29] Ce sont des villes toutes bien pourvues de canaux, de jardins et de palmiers. La plus grande partie du pays d'Oman est placée sous le gouvernement de Hormouz.
Je me trouvais un jour chez ce sultan Abou Mohammed, fils de Nebhân, quand une femme très jeune, belle et d'une figure admirable, vint à lui. Elle se tint debout devant le prince, et lui dit : « ô Abou Mohammed! le démon s'agite dans ma tête. » Il lui répondit : « Va-t'en et chasse ce démon. » Elle répliqua : « Je ne le peux pas et je suis sous ta protection, ô Abou Mohammed ! » Le sultan reprit : « Sors, et fais ce que tu voudras. » J'ai su, après avoir quitté ce roi, que cette femme, et toutes celles qui agissent comme elles se mettent ainsi sous la tutelle du sultan et se livrent ensuite au libertinage. Ni son père, ni son plus proche parent n'ont le pouvoir de s'en montrer jaloux, et s'ils la tuent, ils sont condamnés à mort, car elle est protégée par le sultan.
Je partis de l'Oman pour le pays de Hormouz. On nomme ainsi une ville située sur le rivage de la mer, et que l'on appelle aussi Moûghostân.[30] La nouvelle ville de Hormouz s'élève en face de la première, au milieu de la mer, et elle n'en est séparée que par un canal de trois parasanges de largeur. Nous arrivâmes à la nouvelle Hormouz, qui forme une île, dont la capitale se nomme Djeraoun. C'est une cité grande et belle, qui possède des marchés bien approvisionnés. Elle sert d'entrepôt à l'Inde et au Sind ; les marchandises de l'Inde sont transportées de cette ville dans les deux Iraks, le Fars et le Khoraçan. C'est dans cette place que réside le sultan. L'île où se trouve la ville a de longueur un jour de marche; la plus grande partie se compose de terres d'une nature saline et de montagnes de sel, de l'espèce appelée dârâni. On fabrique avec ce sel des vases destinés à servir d'ornements, et les colonnes sur lesquelles on place les lampes. La nourriture des habitants consiste en poissons, et en dattes qui leur sont apportées de Basrah et d'Oman. Ils disent dans leur langue : Khormâ we mâhy louti pâdichâhy, c'est-à-dire, en arabe : « La datte et le poisson sont le manger des rois. » L'eau potable a une grande valeur dans cette île, et il y a des fontaines et des réservoirs artificiels, où l'eau de pluie est recueillie. Ils sont à une certaine distance de la ville, et les habitants, s'y rendent avec de grandes outres, qu'ils remplissent et qu'ils portent sur leur dos jusqu'à la mer. Alors ils les chargent sur des barques et les apportent à la ville. J'ai vu, en fait de choses merveilleuses, près de la porte de la mosquée djâmi, entre celle-ci et le marché, une tête de poisson aussi élevée qu'une colline, et dont les yeux étaient aussi larges que des portes. Des hommes entraient dans cette tête par un des yeux et sortaient par l'autre.
Je rencontrai à Djeraoun le cheikh pieux et dévot Abou’l Haçan alaksarâny, originaire du pays de Roum (l'Asie Mineure). Il me traita, me visita et me fit présent d'un vêtement. Il me donna la ceinture de l’amitié, dont il se servait pour maintenir sa robe retroussée; elle aide celui qui est assis et lui sert, pour ainsi dire, de support. La plupart des fakirs persans portent cette espèce de ceinture.
A six milles de cette ville est un sanctuaire que l'on appelle le sanctuaire de Khidhr et d'Élie; l'on dit qu'ils y font leurs prières (cf. Reinaud, Monuments arabes, I, 170, 171). Des bénédictions et des preuves évidentes (c'est-à-dire des miracles) attestent la sainteté de cet endroit. Il y a là un ermitage habité par un cheikh, qui y reçoit les voyageurs. Nous passâmes un jour près de lui, et nous partîmes de là afin de visiter un homme pieux retiré à l'extrémité de cette île, On a creusé une grotte pour lui servir d'habitation, et celle-ci contient un ermitage, une salle de réception et un petit appartement qu'occupe une jeune esclave, laquelle appartient au saint personnage. L'ermite a des esclaves, qui demeurent hors de la caverne, et font paître ses bœufs et ses moutons, Il était jadis au nombre des principaux marchands; il fit le pèlerinage du temple de la Mecque, et renonça à tous les attachements du monde, et se retira ici pour se livrer à la dévotion. Auparavant il remit son argent à un de ses confrères, afin qu'il le lui fît valoir dans le commerce. Nous passâmes une nuit près de cet homme, et il nous fit un accueil très hospitalier. Les signes distinctifs de la bonté et de la piété étaient reconnaissables sur sa personne.
C'est le sultan Kothb eddîn Temehten (Tehemten), fils de Touran chah.[31] Il est au nombre des sultans généreux ; son caractère est très humble, ses qualités sont louables. Il a coutume de visiter les jurisconsultes, les hommes pieux et les chérifs qui arrivent dans sa capitale, et de leur rendre les honneurs qui leur sont dus. Lorsque nous entrâmes dans son île, nous le trouvâmes préparé pour la guerre, dans laquelle il était engagé contre les deux fils de son frère Nizâm eddîn. Toutes les nuits il se disposait à combattre, quoique la disette régnât dans l'île. Son vizir Chems eddîn Mohammed, fils d'Aly, son kadi 'Imad eddîn achchéouancâry (le Chébancâreh, nom d'une peuplade d'origine kurde, qui occupait la partie orientale du Fars), et plusieurs hommes distingués, vinrent nous trouver, et s'excusèrent sur les occupations que leur donnait la guerre. Nous passâmes seize jours auprès d'eux. Lorsque nous voulûmes nous en retourner, je dis à un de mes compagnons: « Comment partirons-nous sans voir ce sultan ? » Nous allâmes à la maison du vizir, qui se trouvait dans le voisinage de la zaouïa où j'étais descendu, et je lui dis : « Je désire saluer le roi. » Il répondit : Bismîllâhi (au nom de Dieu; soit), me prit par la main et me conduisit au palais du roi. Cet édifice est situé sur le rivage de la mer, et les vaisseaux sont à sec dans son voisinage.
J'aperçus tout à coup un vieillard couvert de vêtements étriqués et malpropres. Sur sa tête il portait un turban, et il était ceint d'un mouchoir. Le vizir le salua, et je fis de même ; mais j'ignorais que c'était le roi. Il avait à ses côtés le fils de sa sœur, Aly chah, fils de Djélal eddîn Aliîdjy, avec lequel j’étais en relations. Je commençai à converser avec lui, car je ne connaissais pas le roi; mais le vizir me le fit connaître. Je fus honteux vis-à-vis du monarque, parce que j'avais osé causer avec son neveu, au lieu de m'entretenir avec lui, et je m'excusai auprès de ce prince. Ensuite il se leva et entra ans son palais, suivi par les émirs, les vizirs et les grands du royaume; j'entrai aussi en compagnie du vizir. Nous trouvâmes le roi assis sur le trône, et portant absolument les mêmes habits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Dans sa main était un chapelet de perles, dont personne n'a vu les pareilles, car les pêcheries de ces coquillages se trouvent soumises à l'autorité de ce prince. Un des émirs s'assit à son côté, et je m'assis à côté de cet émir.
Le sultan m'interrogea touchant mon état de santé, le temps de mon arrivée et les rois que j'avais vus dans le cours de mes voyages : je l'informai de ces diverses circonstances. On apporta des mets; les assistants en mangèrent, mais le prince n'en goûta pas avec eux. Après le repas, il se leva; je lui fis mes adieux et m'en retournai.
Voici le motif de la guerre qui existait entre le sultan et ses deux neveux. Le premier s'embarqua un jour sur mer, à la ville neuve, afin de se rendre en partie de plaisir au vieux Hormouz et à ses jardins. La distance qui sépare ces deux villes, par mer, est de trois parasanges, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Le frère du sultan, Nizâm eddîn, se révolta contre lui, et s'arrogea le pouvoir. Les habitants de l'île lui prêtèrent serment, ainsi que les troupes. Kothb eddîn conçut des craintes pour sa sûreté, et s'embarqua pour la ville de Kalhât, dont il a été parlé ci-dessus, et qui fait partie de ses états. Il y séjourna plusieurs mois, équipa des vaisseaux et fit voile vers l'île. Les habitants de celle-ci le combattirent, de concert avec son frère, et l'obligèrent de s’enfuir à Kalhât. Il renouvela la même tentative à plusieurs reprises ; il n'eut aucun succès, jusqu'à ce qu'il recourût au stratagème d'envoyer à une des femmes de son frère un émissaire qui la détermina à l'empoisonner. L'usurpateur étant mort, le sultan marcha de nouveau vers l'île et y fit son entrée. Ses deux neveux s'enfuirent, avec les trésors, les biens et les troupes, dans l'île de Kaïs, où se trouvent les pêcheries de perles. De cet endroit ils se mirent à intercepter le chemin à ceux des habitants de l’Inde et du Sind qui se dirigeaient vers l'île, et à faire des incursions dans les contrées du littoral ; de sorte que la plupart furent dévastées.
Nous partîmes de la ville de Djeraoun, pour visiter un pieux personnage dans la ville de Khondjopâl. Lorsque nous eûmes franchi le détroit, nous louâmes des montures aux Turcomans, qui sont les habitants de ce pays. On n'y voyage pas, si ce n'est avec eux, à cause de leur bravoure et de la connaissance qu'ils possèdent des chemins. On trouve en ces lieux un désert, d'une étendue de quatre jours de marche, où les voleurs arabes exercent leurs brigandages, et où le vent appelé semoûm souffle durant les mois de tamoûz (juillet) et de hazîrân (juin). Ce vent fait mourir tous ceux qu'il rencontre dans le désert, et l'on m'a raconté que quand il a tué quelqu'un, et que les compagnons du mort veulent laver son corps, chacun de ses membres se détache des autres parties. Dans ce désert se trouvent de nombreux tombeaux, renfermant ceux qui ont été tués par ce vent. Nous voyagions durant la nuit, et lorsque le soleil était levé, nous nous mettions à l'ombre sous les arbres, du genre de ceux nommés oumm Ghaïlân. Nous marchions depuis l'asr (environ quatre heures de l'après-midi) jusqu'au lever du soleil. Dans ce désert et dans la contrée qui l'avoisine, habitait le voleur Djémal allouc, qui jouit en ces lieux d'une grande réputation.
Djémal allouc était un habitant du Sedjestan, d'origine persane. Allouc signifie « celui qui a la main coupée », et, en effet, la main de cet homme avait été coupée dans un combat. Il commandait un corps considérable de cavaliers arabes et persans, à l'aide desquels il exerçait le brigandage sur les chemins. Il fondait des ermitages et fournissait à manger aux voyageurs, avec l'argent qu'il volait. On rapporte qu'il prétendait ne pas employer la violence, excepté contre ceux qui ne donnaient pas la dîme aumônière de leurs biens. Il persévéra longtemps dans cette conduite; lui et ses cavaliers faisaient des incursions, et traversaient des déserts que nul autre qu'eux ne connaissait, et ils y enterraient de grandes et de petites outres pleines d'eau Lorsque l'armée du sultan les poursuivait, ils entraient dans le désert et déterraient ces outres. L'armée renonçait à les poursuivre, de peur de périr. Djémal persista donc dans cette conduite pendant un certain nombre d'années, ni le roi de l'Irak ni aucun autre prince ne pouvant le vaincre; puis il fit pénitence et se livra à des exercices de dévotion jusqu'à sa mort. Son tombeau, qui se trouve dans son pays, le Sedjestan, est visité comme un lieu de pèlerinage.
Nous traversâmes ce désert jusqu'à ce que nous fussions arrivés à Cawrestân, petite ville ou l'on voit des rivières et des jardins, et dont l'air est très chaud. Nous marchâmes durant trois jours dans un désert semblable au premier, et nous arrivâmes à Lâr, grande ville, pourvue de sources, de rivières considérables et de jardins, et qui possède de beaux marchés. Nous y logeâmes dans la zaouïa du pieux cheikh Abou Dolaf Mohammed, celui-là même que nous avions le projet de visiter à Khondjopâl. Dans celle-ci se trouvait son fils Abou Zeïd Abd er-Rahman, ainsi qu'une troupe de fakirs. Une de leurs coutumes consiste à se réunir chaque jour dans l'ermitage, après la prière de l'asr; puis ils font le tour des maisons de la ville; on leur donne dans chaque maison un pain ou deux, et c'est avec cela qu'ils nourrissent les voyageurs. Les habitants des maisons sont accoutumés à cette offrande; ils la regardent comme faisant partie de leurs aliments et la préparent pour ces religieux, afin de les aider dans leurs distributions de vivres. Dans chaque nuit du jeudi au vendredi, les fakirs et les dévots de la ville se rassemblent dans cet ermitage, et chacun d'eux apporte autant de dirhems qu'il a pu s'en procurer. Ils les mettent en commun et les dépensent dans cette nuit même; ils la passent en actes de dévotion, comme la prière, la mention répétée du nom de Dieu, et la lecture du Coran; enfin, ils s'en retournent après la prière de l'aurore.
Il y a dans cette ville un sultan d'origine turcomane, nommé Djélal eddîn. Il nous envoya les mets de l'hospitalité; mais nous ne le visitâmes point et ne le vîmes pas.
Nous partîmes de Lâr pour la ville de Khondjopâl; le khâ de ce mot est remplacé quelquefois par un hâ (Hondjopâl). C'est là qu'habite le cheikh Abou Dolaf, que nous voulions visiter. Nous logeâmes dans son ermitage, et lorsque j'y fus entré, je vis le cheikh assis sur la terre, dans un coin. Il était couvert d'une tunique de laine verte, tout usée, et portait sur la tête un turban de laine, noir. Je le saluai; il me rendit poliment mon salut, m'interrogea touchant le temps de mon arrivée et sur mon pays, et me donna l'hospitalité. Il m'envoyait des aliments et des fruits par un de ses fils, qui était au nombre des gens pieux, très humble, jeûnant presque continuellement et fort assidu à dire ses prières. La condition de ce cheikh Abou Dolaf est extraordinaire et étrange, car la dépense qu'il fait dans cet ermitage est considérable : il distribue des dons superbes, fait présent aux autres de vêtements et de chevaux de selle; en un mot, il fait du bien à tous les voyageurs, de sorte que je n'ai pas vu son pareil dans cette contrée; et pourtant on ne lui connaît pas d'autre ressource que les offrandes qu'il reçoit de ses frères et de ses compagnons. Aussi beaucoup de personnes prétendent qu'il tire du trésor invisible de Dieu les sommes nécessaires à sa dépense.
Dans son ermitage se trouve le tombeau du pieux cheikh, de l'ami de Dieu, du pôle, Dânïâl dont le nom est célèbre dans ce pays, et qui jouit d'un rang éminent parmi les contemplatifs. Ce sépulcre est surmonté d'une haute coupole, élevée par le sultan Kothb eddîn Temehten (Tehemten), fils de Touran chah. Je passai un seul jour près du cheikh Abou Dolaf, à cause de l'empressement à partir de la caravane que j'accompagnais.
J'appris qu'il y avait dans cette ville de Khondjopâl un ermitage habité par plusieurs hommes pieux, qui se livraient à des pratiques de dévotion. Je m'y rendis dans la soirée, et je les saluai, eux et leur cheikh. Je vis des gens comblés de bénédictions, et sur la personne desquels les exercices de piété avaient laissé des traces profondes. Ils avaient le teint jaune, le corps maigre; ils gémissaient beaucoup et pleuraient abondamment. Lorsque j'arrivai auprès d'eux, ils m'apportèrent des aliments, et leur chef dit : « Faites-moi venir mon fils Mohammed. » Celui-ci était retiré dans un coin de la zaouïa, il vint nous trouver, et il ressemblait à un mort échappé de son tombeau, tant les actes de dévotion l'avaient exténué. Il salua et s'assit. Son père lui dit : « O mon cher fils, partage le repas de ces voyageurs, afin que tu participes à leurs bénédictions ! » Il jeûnait alors; mais il rompit le jeûne avec nous. Ces gens-là sont de la secte de Châfi'y; lorsque nous eûmes cessé de manger, ils firent des vœux en notre faveur, et nous nous en retournâmes.
De là nous nous rendîmes à la ville de Kaïs, nommée aussi Sîrâf.[32] Elle est située sur le rivage de la mer de l'Inde, qui est contiguë à celles du Yémen et de la Perse; on la compte au nombre des districts du Fars. C'est une ville d'une étendue considérable et sur un sol excellent. Elle est entourée de jardins magnifiques, où croissent des plantes odoriférantes et des arbres verdoyants. L'eau que boivent ses habitants provient de sources qui coulent des montagnes voisines. Les Sîrâfiens sont Persans et distingués par une noble origine. Parmi eux se trouve une tribu d'Arabes des Bènou-Sefâf, et ce sont ces derniers qui plongent à la recherche des perles.
La pêcherie des perles est située entre Sîrâf et Bahreïn, dans un golfe dont l'eau est calme, et qui ressemble à un grand fleuve. Lorsque les mois d'avril et de mai sont arrivés, des barques nombreuses se rendent en cet endroit, montées par les pêcheurs et des marchands du Fars, de Bahreïn et d'Alkathîf. Le pêcheur place sur son visage, toutes les fois qu'il veut plonger, une plaque en écaille de tortue, qui le couvre complètement. Il fabrique aussi avec cette écaille un objet semblable à des ciseaux, qui lui sert à comprimer ses narines; puis il attache une corde à sa ceinture et plonge. Ces gens-là diffèrent les uns des autres dans la durée du temps qu'ils peuvent rester sous l'eau. Parmi eux il y en a qui y demeurent une heure ou deux, ou plus que cela (!). Quand le plongeur arrive au fond de la mer, il y trouve les coquillages fixés dans le sable, au milieu de petites pierres; il les détache avec la main, ou les enlève à l'aide d'un couteau dont il s'est muni dans cette intention, et les place dans un sac de cuir suspendu à son cou. Lorsque la respiration commence à lui manquer, il agite la corde ; l'homme qui tient cette corde sur le rivage sent son appel, et le remonte à bord de la barque. On lui enlève son sac, et l'on ouvre les coquillages; on y trouvé à l'intérieur des morceaux de chair, que l'on détache avec un couteau. Dès que ceux-ci sont mis en contact avec l'air, ils se durcissent et se changent en perles, et toutes sont rassemblées, les petites comme les grosses. Le sultan en prélève le quint, et le reste est acheté par les marchands qui se trouvent dans les barques. La plupart sont créanciers des plongeurs, et reçoivent toutes les perles en échange de leur créance, ou bien une quantité proportionnée à la dette.
De Sîrâf nous allâmes à la ville de Bahreïn, qui est une cité considérable, belle, possédant des jardins, des arbres et des rivières. On s'y procure de l'eau à peu de frais : il suffit pour cela de creuser la terre avec les mains, et on trouve l’eau. Il y a en cet endroit des enclos de palmiers, de grenadiers, de citronniers, et l'on y cultive le coton. La température y est très chaude, les sables y abondent, et souvent ils s'emparent de quelques habitations, il y avait entre Bahreïn et Oman un chemin que les sables ont envahi, et sur lequel, pour cette raison, la communication a été interrompue. On ne se rend plus d’Oman en cette ville, si ce n'est par mer. Dans le voisinage de Bahreïn se trouvent deux hautes montagnes, dont l’une à l'occident, qui s'appelle Coceïr (petite fracture), l'autre à l'orient, qui s'appelle 'Oweïr (petite fissure). Elles ont passé en proverbe, car l'on dit: « Coceïr et 'Oweïr : or tout cela n'est pas bon » (à cause du danger qu'elles offrent aux navigateurs). Nous nous rendîmes de Bahreïn à la ville d'Alkothaîf (Alkathîf), dont le nom se prononce; à l'instar du diminutif du mot kathf (vendanges, etc.). C'est une place grande, belle et possédant beaucoup de palmiers. Elle est habitée par des tribus d'Arabes, qui sont des râfidhites outrés, et manifestent ouvert tentent leur, hérésie, sans craindre personne. Leur muezzin prononce les paroles suivantes, dans l'appel à la prière, après les deux professions de foi : « J'atteste qu'Aly est l'ami de Dieu. » Il ajoute après les deux formules : « Accourez à la prière, accourez au salut », la formule suivante : « Accourez à la meilleure des œuvres. » Il dit après le dernier tecbîr (louange du nom de Dieu) : « Mohammed et Aly sont les meilleurs des hommes, et quiconque s'est déclaré leur ennemi a été infidèle. »
De Kathîf nous allâmes à Hedjer, maintenant appelé Alhaça, ville au sujet de laquelle on dit en proverbe : « C'est comme celui qui apporte des dattes à Hedjer. » Car il s'y trouve plus de palmiers que dans aucune autre ville; aussi les habitants en font-ils manger les fruits à leurs bêtes de somme. Ces habitants sont des Arabes appartenant pour la plupart à la tribu d'Abd Alkaïs, fils d'Aksa. D'Alhaça nous nous rendîmes à la ville d'Alyemâmah, aussi appelée Hadjr. C’est une ville belle, fertile, possédant des rivières et des arbres. Elle est habitée par des tribus d'Arabes, qui appartiennent pour la plupart aux Bènou Hanîfah, dont elle est de toute antiquité la capitale, et qui ont pour émir Thofaïl, fils de Ghânim. Je quittai Yemâmah, en compagnie de cet émir, afin de faire le pèlerinage. On était alors dans l'année 732, (1332), et j'arrivai ainsi à la Mecque. Dans cette même année, Almélic annâcir, sultan d'Egypte, fit le pèlerinage, ainsi qu'un certain nombre de ses émirs. Ce fut la dernière fois qu'il l'accomplit, et il accorda des présents magnifiques aux habitants des deux villes saintes et nobles, et aux personnages qui s'y étaient fixés par esprit de dévotion. Pendant le même voyage, Almélic annâcir tua l'émir Ahmed, de qui l'on dit qu'il était le père. Il fit aussi périr le principal de ses émirs, Bectomoûr assâky (l'échanson).
On raconte qu'Almélic annâcir donna à Bectomoûr assâky une jeune esclave. Lorsque l'émir voulut s'en approcher, elle lui dit : « Je suis enceinte des œuvres du roi Annâcir. » Alors Bectomoûr la respecta, et dans la suite elle mit au monde un fils qu'il appela l'émir Ahmed, et qui grandit sous sa tutelle. La noblesse de cet enfant se révéla, et il fut connu sous le nom de fils d'Almélic annâcir. Or pendant ce pèlerinage, lui et Bectomoûr complotèrent de tuer le monarque; après quoi, l'émir Ahmed serait devenu maître du royaume. En conséquence, Bectomoûr emporta avec lui des étendards, des tambours, des vêtements (royaux) et de l'argent. La nouvelle du complot fut révélée à Almélic annâcir. Alors celui-ci envoya chercher l'émir Ahmed, un jour qu'il faisait extrêmement chaud; et l'émir vint le trouver.
Le sultan avait devant lui des coupes pleines de boisson; il en but une et en présenta à l'émir Ahmed une autre, dans laquelle il y avait du poison. Ahmed l'ayant vidée, Mélik Nacir donna l'ordre de décamper sur-le-champ, afin d'occuper le temps. Le cortège royal se mit en marche; mais il n'était pas encore arrivé à la prochaine station, que l'émir Ahmed rendit le dernier soupir. Bectomoûr fut affligé de sa mort, déchira ses vêtements et refusa de boire et de manger. Cette nouvelle étant parvenue à Mélik Nacir, il vint le trouver, lui donna des marques d'intérêt, lui adressa des consolations, et prenant une coupe dans laquelle il y avait du poison, il la lui présenta et lui dit : « Je t'en adjure par ma vie, ne boiras-tu pas pour amortir le feu qui brûle ton cœur? » Bectomoûr vida le vase et mourut sur l'heure. On trouva chez lui les vêtements, insignes de la souveraineté, et des sommes considérables, et c'est ainsi que fut vérifiée l'accusation qui avait été portée contre lui, d'attenter aux jours d'Almélic annâcir.
Lorsque le pèlerinage fut terminé, je me dirigeai vers Djouddah, afin de m'embarquer pour le Yémen et l'Inde; mais cela ne me réussit pas; je ne pus me procurer de compagnons, et je passai à Djouddah environ quarante jours. Il y avait en cette ville un navire appartenant à un individu nommé Abd Allah Attoûnecy, qui voulait se rendre à Koceïr, dans le gouvernement de Koûs. Je montai à bord, afin d'examiner dans quel état se trouvait ce navire, mais il ne me satisfit pas, et je ne me plus pas à l’idée de voyager sur ce bâtiment. Cela fut un effet de la bonté de Dieu; car ce vaisseau partit, et lorsqu'il fut arrivé au milieu de la mer, il coula à fond, dans un endroit appelé Râs Aby Mohammed (le cap d'Abou Mohammed). Le propriétaire du navire et quelques marchands se sauvèrent dans une barque, non sans de grands efforts; ils se virent sur le point de périr, et il en périt même quelques-uns. Le reste des passagers fut englouti, et il y avait à bord environ soixante et dix pèlerins.
Cependant je montai ensuite dans une barque, pour me rendre à 'Aïdhâb; mais le vent nous ayant repoussés vers un port appelé Ras Dawaïr (le cap des tourbillons), nous partîmes de cet endroit, par la voie de terre, avec les Bodjâh, et nous traversâmes un désert, où se trouvaient beaucoup d'autruches et de gazelles. On y rencontrait des Arabes des tribus de Djohaïnah et de Bènou Câhil, qui sont soumises aux Bodjâh. Nous arrivâmes près des sources nommées Mefroûr et Aldjedîd. Les vivres nous manquèrent; nous achetâmes des brebis à une troupe de Bodjâh dont nous fîmes rencontre dans le désert, et nous nous approvisionnâmes de la chair de ce bétail. Je vis dans ce désert un jeune garçon arabe, qui m'adressa la parole en sa langue, et m'informa que les Bodjâh l'avaient fait prisonnier. Il prétendait n'avoir pris depuis une année aucun autre aliment que du lait de chameau.
La viande que nous avions achetée ayant été consommée, il ne nous resta aucune provision de route ; j'avais avec moi environ une charge de dattes, des espèces appelées assaïhâny et alberny, que je réservais pour faire des présents à mes amis. Je les distribuai à la caravane, et nous en vécûmes pendant trois jours. Après une marche de neuf jours, à partir du Ras Dawâïr, nous arrivâmes à 'Aïdhâb, où quelques individus de la caravane nous avaient précédés. Les habitants vinrent à notre rencontre, avec du pain, des dattes et de l'eau, et nous passâmes plusieurs jours dans cette ville. Après avoir loué des chameaux, nous partîmes, en compagnie d'une troupe d'Arabes de la tribu de Daghîm, et nous arrivâmes près d'une source appellée Aldjanîb (alkhobaïb?) Nous campâmes ensuite à Homaïthira, où se trouve le tombeau de l'ami de Dieu Abou’ Haçan achchâdhily. Nous le visitâmes pour la seconde fois, et nous passâmes une nuit dans son voisinage, après quoi nous arrivâmes à la bourgade d'Al'athouâny, située sur le bord du Nil, vis-à-vis de la ville d'Adfou, dans le Sa’id supérieur. Nous passâmes le Nil pour nous rendre à la ville d'Esna, puis à Arment, puis à Alaksor, où nous vîmes une seconde fois le cheikh Abou'l-haddjâdj alaksory. Nous nous rendîmes ensuite à la ville de Koûs, puis à Kina, où nous visitâmes derechef le cheikh Abd Arrahîm alkinâwy. De là nous vînmes à Hou, à Ikhmîm, à Acioûth, à Manfaloûth, à Manlaouy, à Alochmoûnaïn, à Moniât ibn Alkhacîb, à Behneçah, à Boucla et à Moniat-Alkâïd. Toutes ces localités ont déjà été mentionnées par nous. Enfin nous arrivâmes à Misr, où je m'arrêtai plusieurs jours, après quoi je partis pour la Syrie, par le chemin de Bilbeïs, en compagnie du pèlerin Abd Allah, fils d'Abou Bekr, fils d'Alferhân attoûzery. Il ne cessa de m'accompagner durant plusieurs années, jusqu'à ce que nous fussions sur le point de quitter l'Inde, et il mourut à Sendaboûr, ainsi que nous le dirons ci-dessous. Cependant, nous arrivâmes à la ville de Ghazzah, puis à la ville d'Abraham (Hébron), où nous renouvelâmes la visite de sa sépulture, puis à Jérusalem, à Ramlah, à Acre, à Tripoli, à Djabala, où nous visitâmes pour la seconde fois le mausolée d'Ibrahim, fils d'Adhem, et enfin à Lâdhikiyah. Toutes ces villes ont été décrites par nous ci-dessus. Nous nous embarquâmes sur mer à Lâdhikiyah, dans un grand vaisseau appartenant à des Génois, et dont le patron était nommé Martelemîn (Bartolomeo?). Nous nous dirigeâmes vers la terre de Turquie, connue sous le nom de pays des Grecs (Arroum), On l'a nommée ainsi parce qu'elle a été jadis le pays de cette nation. C'est de là que vinrent les anciens Grecs et les Ioûnânis (Ioniens). Dans la suite les musulmans la conquirent, et il s'y trouve maintenant beaucoup de chrétiens, sous la protection des Turcomans mahométans. Nous naviguâmes pendant dix jours avec un bon vent; le chrétien (c'est-à-dire, le maître du bâtiment) nous traita avec considération, et n'exigea pas de nous le prix de notre passage (littéralement le nolis). Le dixième jour nous arrivâmes à la ville d'Alâïa, où commence le pays de Roum. C'est une des plus belles contrées du monde, et Dieu y a réuni les beautés dispersées dans le reste de l'univers. Ses habitants sont les plus beaux des hommes et les plus propres sur leurs vêtements; ils se nourrissent des aliments les plus exquis, et ce sont les plus bienveillantes créatures de Dieu. C'est pourquoi l'on dit : « La bénédiction se trouve en Syrie et la bonté dans le Roum. » On n'a eu en vue dans cette phrase que les habitants de cette contrée.
Lorsque nous nous arrêtions dans un ermitage ou dans une maison de ce pays, nos voisins des deux sexes prenaient soin de nous; les femmes n'étaient pas voilées. Quand nous quittions ces bonnes gens, ils nous faisaient des adieux comme s'ils avaient été de nos parents et des membres de nos familles; tu aurais vu les femmes pleurer, et s'attrister de notre séparation. Une des coutumes de ce pays consiste en ce que l'on cuit le pain une seule fois tous les huit jours, et l'on prépare alors ce qui doit suffire à la nourriture de toute la semaine. Les hommes venaient nous trouver, le jour où on le cuisait, apportant du pain chaud, et des aliments exquis dont ils nous faisaient présent. Ils nous disaient : « Les femmes vous envoient cela et implorent vos prières. »
Tous les habitants de ce pays professent la doctrine de l'imâm Abou-Hanîfah, et ils sont fermes dans la sonnah (tradition orthodoxe). Il n'y a parmi eux ni kadary (partisan du libre arbitre), ni râfidhy, ni mo'tazily (ne reconnaissant pas en Dieu des attributs distincts de l’essence), ni khâridjy, ni mobtadi’ (novateur). C'est un mérite par lequel Dieu les a favorisés; mais ils mangent du hachich (chanvre indien), et ne réprouvent pas l'usage de cette plante.
La ville d'Alâïa, mentionnée ci-dessus, est une grande place située sur le rivage de la mer et habitée par des Turcomans. Des marchands de Misr (le Caire), d'Alexandrie, de la Syrie y descendent; elle est très abondante en bois, que l'on transporte de cette ville à Alexandrie et à Damiette, et de là dans tout le reste de l'Egypte. 'Alâïa possède un château situé à l'extrémité supérieure de la ville. C'est un édifice admirable et très fort, construit par le sultan illustre Alâ eddîn Arroumy. Je visitai le kadi de cette ville, Djélal eddîn Alarzendjâny. Il monta avec moi dans la citadelle un vendredi, et nous y fîmes la prière. Il me traita avec honneur et me donna l'hospitalité, ainsi que Chems eddîn, fils d'Arredjîhâny, dont le père, 'Alâ eddîn, mourut à Mâly (Melli), dans le Soudan.
Le samedi, le kadi Djélal eddîn monta à cheval avec moi, et nous nous mîmes en route, afin de visiter le roi d'Alâïa, Yousef bec (bec veut dire roi), fils de Karaman. Son habitation était située à dix milles de la ville, et nous le rencontrâmes assis, tout seul, près du rivage, au haut d'une colline qui se trouve dans cet endroit. Les émirs et les vizirs se tenaient plus bas, et les soldats étaient rangés à sa droite et à sa gauche. Il avait les cheveux teints en noir. Je lui donnai le salut, et il m'interrogea touchant le temps de mon arrivée. Je l'informai de ce qu'il désirait savoir et je pris congé de lui; il m'envoya un présent.
Je me rendis d'Alâïa à Anthâlïah. Le nom de cette dernière ville ne diffère pas de celui d'Anthâkïah, en Syrie, (Antioche), si ce n'est que le câf (k) y est remplacé par un lâm (l). C'est une des plus belles villes du monde : elle est extrêmement vaste ; c'est la plus jolie cité que l'on puisse voir, la plus peuplée, et la mieux construite. Chaque classe de ses habitants est entièrement séparée des autres.
Les marchands chrétiens y demeurent dans un endroit appelé almînâ (le port). Leur quartier est entouré d'un mur, dont les portes sont fermées extérieurement pendant la nuit et durant la prière du vendredi. Les Grecs, anciens habitants d'Anthâlïah, demeurent dans un autre endroit; ils y sont également séparés des autres corps de nation et entourés d'un mur. Les juifs habitent aussi un quartier séparé et ceint d'une muraille. Le roi, les gens de sa cour et ses esclaves habitent une ville entourée d'un mur, qui la sépare des quartiers susmentionnés.
Toute la population musulmane demeure dans la ville proprement dite, où se trouve une mosquée principale, un collège, des bains nombreux et des marchés considérables, disposés dans l'ordre le plus merveilleux. Cette ville est entourée d'un grand mur, qui renferme aussi toutes les constructions que nous avons énumérées. Elle contient de nombreux jardins, et produit des fruits excellents, parmi lesquels est l'abricot admirable nommé dans le pays kamar eddîn (la lune de la religion). Son noyau renferme une amande douce; on fait sécher ce fruit et on le transporte en Egypte, où il est considéré comme quelque chose de rare. Il y a dans cette ville des sources d'une eau excellente, agréable au goût et très fraîche pendant l’été.
Nous logeâmes à Anthâlïah dans la medréceh, dont le supérieur était Schihâb eddîn Alhamawy. Une des coutumes des habitants de cette ville consiste en ce que plusieurs enfants lisent tous les jours, avec de belles voix, après la prière de l'asr, dans la mosquée djâmi et dans la medréceh, la sourate de la Victoire (xlviii), celle de l'Empire (lxvii) et la sourate 'Amma (lxxviii).
Le singulier d’akhiyyet est akhy, qui se prononce comme le mot akh « frère », lorsque celui qui parle (c'est-à-dire, la première personne) le met en rapport d'annexion avec lui même (ce qui fait akhy « mon frère »). Les Akhiyyet existent dans toute l'étendue du pays habité par des Turcomans en Asie Mineure, dans chaque province, dans chaque ville et dans chaque bourgade. On ne trouve pas, dans tout l'univers, d'hommes tels que ceux-ci, remplis de la plus vive sollicitude pour les étrangers, très prompts à leur servir des aliments, à satisfaire les besoins d'autrui, à réprimer les tyrans, à tuer les satellites de la tyrannie et les méchants qui se joignent à eux. Alakhy signifie, chez eux, un homme que des individus de la même profession, et d'autres jeunes gens célibataires et vivant seuls, s'accordent à mettre à leur tête. Cette communauté s'appelle aussi foutouwweh. Son chef bâtit un ermitage et y place des tapis, des lampes et les meubles nécessaires. Ses compagnons travaillent pendant le jour à se procurer leur subsistance; ils lui apportent après l'asr ce qu'ils ont gagné. Avec cela ils achètent des fruits, des mets et autres objets qui sont consommés dans l'ermitage. Si un voyageur arrive ce jour-là dans la place, ils le logent chez eux ces objets leur servent à lui donner le repas.de l'hospitalité, et il ne cesse d'être leur hôte jusqu'à son départ. S'il n'arrive pas d'étrangers, ils se réunissent pour manger leurs provisions; puis ils chantent et dansent. Le lendemain, ils retournent à leur métier, et après l'asr ils viennent retrouver leur chef, avec ce qu'ils ont gagné. Ils sont appelés les jeunes-gens et l’on nomme leur chef, ainsi que nous l'avons dit, Alakhy. Je n'ai pas vu dans tout l'univers d'hommes plus bienfaisants qu'eux; les habitants de Chiraz et ceux d'Ispahan leur ressemblent sous ce rapport, si ce n'est que ces jeunes-gens aiment davantage les voyageurs, et leur témoignent plus de considération et d'intérêt.
Le second jour après notre arrivée à Anthâliah, un de ces fitiân vint trouver le cheikh Schihâb eddîn Alhamawy et lui parla en turc, langue que je ne comprenais pas alors. Il portait des vêtements usés et avait sur sa tête un bonnet de feutre. Le cheikh me dit : « Sais-tu ce que veut cet homme? » Je répondis : « Je l'ignore. » — « Il vous invite, reprit-il, à un festin, toi et tes compagnons. » Je fus étonné de cela et je lui dis : « C'est bien. » Mais lorsqu'il s'en fut retourné, je dis au cheikh : « C'est un homme pauvre; il n'a pas le moyen de nous traiter et nous ne voulons pas l'incommoder. » Le cheikh se mit à rire et répliqua : « Cet individu est un des chefs des jeunes-gens-frères, c'est un cordonnier et il est doué d'une âme généreuse; ses compagnons, qui sont au nombre de deux cents artisans, l'ont mis à leur tête; ils ont bâti un ermitage pour y recevoir des hôtes, et ce qu'ils gagnent pendant le jour, ils le dépensent durant la nuit. » Lorsque j'eus fait la prière du coucher du soleil, cet homme revint nous trouver et nous nous rendîmes avec lui à sa zaouïa.
Nous trouvâmes un bel ermitage, tendu de superbes tapis grçcs.et où il y avait beaucoup de lustres en verre de l'Irak. Dans la salle de réception se voyaient cinq baïçoûs : on appelle ainsi une espèce de colonne ou candélabre de cuivre porté sur trois pieds; à son extrémité supérieure il a une sorte de lampe, aussi de cuivre, au milieu de laquelle il y a un tuyau pour la mèche. Cette lampe est remplie de graisse fondue, et on place à son côté des vases de cuivre, pleins de graisse, et dans lesquels se trouvent des ciseaux pour arranger les mèches. Un des frères est préposé à ce soin et on lui donne le nom de tcherâghtchy (lampiste). Une troupe déjeunes gens étaient rangés dans le salon ; leur costume était un kabâ (robe longue), et ils portaient aux pieds des bottines. Chacun d'eux avait une ceinture, à laquelle pendait un couteau de la longueur de deux coudées. Leur tête était couverte d'une kalançoueh (bonnet haut) blanche, en laine, au sommet de laquelle était cousue une pièce d'étoffe, longue d'une coudée et large de deux doigts. Lorsqu'ils tiennent leurs séances, chacun d'eux ôte sa kalançoueh et la place devant lui; une autre kalançoueh, d'un bel aspect, en zerd-khâny (soie fine, ressemblant à du taffetas), ou toute autre étoffe, reste sur sa tête. Au milieu de leur salle de réunion, se trouve une espèce d'estrade, placée pour les étrangers. Lorsque nous eûmes pris place près d'eux, on apporta des mets nombreux, des fruits et des pâtisseries; ensuite ils commencèrent à chanter et à danser. Leurs actes nous frappèrent d'admiration; notre étonnement de leur générosité et de la noblesse de leur âme fut très grand. Nous les quittâmes à la fin de la nuit, et les laissâmes dans leur zaouïa.
C’est Khidhr bec, fils de Yoûnis bec. Nous le trouvâmes malade, lors de notre arrivée dans cette ville: nous le visitâmes dans son palais, et il était alité. Il nous parla dans les termes les plus affables et les plus bienveillants; nous lui fîmes nos adieux et il nous envoya des présents.
Nous nous mîmes en roule pour la ville de Bordoûr (Bouldour), petite cité, riche en jardins et en rivières, et possédant un château situé sur la cime d'une haute montagne. Nous logeâmes dans la maison de son prédicateur. Les frères se réunirent et voulurent nous héberger; mais celui-ci n'y consentit pas. Ils préparèrent pour nous un repas dans un jardin appartenant à l'un d'eux, et où ils nous conduisirent. C'était une chose merveilleuse que la joie et l'allégresse qu'ils montraient, à cause de notre présence. Cependant ils ignoraient notre langue comme nous ignorions la leur, et il n'y avait pas de truchement qui pût nous servir d'intermédiaire. Nous passâmes un jour chez eux, et nous nous en retournâmes.
Nous partîmes ensuite de Bordoûr pour Sabarta (Isbarta), ville bien construite, pourvue de beaux marchés, de nombreux jardins et de plusieurs rivières; elle a un château bâti sur une haute montagne. Nous y arrivâmes le soir, et nous nous logeâmes chez son kadi.
Nous quittâmes cet endroit pour nous rendre à Akrîdoûr (Egherdir), qui est une grande ville, bien peuplée et possédant de beaux marchés, des rivières, des arbres, et des jardins. Elle a aussi un lac d'eau douce, par lequel les vaisseaux se rendent en deux jours à Akchehr, à Bakchehr et autres villes et bourgades. Nous y logeâmes dans une école située en face de la grande mosquée, et où enseignait le savant professeur, le dévot pèlerin, le vertueux Moslih eddîn. Ce personnage a professé en Egypte et en Syrie, et il a habité l'Irak pendant quelque temps. C'était un homme disert et éloquent, une des merveilles de son siècle. Il nous traita avec la plus grande considération et nous reçut de la manière la plus honorable.
Le sultan de cette ville est Abou Ishâk bec, fils d'Addendâr bec, un des principaux souverains de ce pays. Il habita l'Egypte du vivant de son père, et fit le pèlerinage de la Mecque. Il est doué de belles qualités, et c'est sa coutume d'assister chaque jour à la prière de l'asr, dans la mosquée djâmi. Lorsque cette prière est terminée, il s'adosse au mur de la kiblah; les lecteurs du Coran s'asseyent devant lui, sur une estrade de bois élevée, et lisent la sourate de la Victoire, celle de l'Empire et la sourate 'Amma, avec de belles voix qui agissent sur les âmes, et font que les cœurs s'humilient, les corps frissonnent et les yeux versent des larmes. Après cette cérémonie, le sultan retourne à son palais.
Nous passâmes près de ce prince les premiers jours du mois de ramadhan. Il s'asseyait, chacune des nuits de ce mois, sur un tapis qui touchait immédiatement la terre, sans estrade, et il s'appuyait sur un grand coussin. Le docteur Moslih eddîn s'asseyait à son côté, je m'asseyais à côté du fakîh, et les grands de son empire, ainsi que les émirs de sa cour, venaient après nous. On apportait ensuite des aliments. Le premier mets avec lequel on rompait le jeûne, était du therîd (potage composé de bouillon et de pain émietté), servi dans une petite écuelle et recouvert de lentilles trempées dans le beurre et sucrées. Les Turcs servent d'abord le therîd parce qu'ils le regardent comme un mets de bon augure. « Le Prophète, disent-ils, le préférait à tous les autres mets, et nous commençons par le manger à cause de cela. » On apporte ensuite les autres plats; c'est ainsi qu'agissent les Turcs pendant toutes les nuits du mois de ramadhan.
Le fils du sultan mourut un jour de ce même mois. Ces gens n'ajoutèrent rien aux lamentations habituelles pour implorer la miséricorde divine en faveur du mort, ainsi que font en pareil cas, les habitants de l'Egypte et de la Syrie, et contrairement à ce que nous avons raconté ci-dessus, touchant les pratiques des Loûrs, quand le fils de leur sultan vint à mourir. Lorsque le prince eut été enseveli, le sultan et les thâlibs (étudiants) continuèrent pendant trois jours à visiter son tombeau, après la prière de l'aurore. Le jour qui suivit ses obsèques, je sortis avec les autres personnes dans le même but. Le sultan m'aperçut marchant à pied; il m'envoya un cheval et me fit faire ses excuses. Lorsque je fus de retour à la medréceh, je renvoyai le cheval ; mais le sultan refusa de le reprendre et dit : « Je l'ai donné comme cadeau, et non comme prêt. » Il m'envoya aussi un vêtement et une somme d'argent.
Nous nous rendîmes d'Akrîdoûr à Koul Hissâr (Gheul Hissâr), petite ville entourée d'eau de tous côtés; des roseaux ont poussé au milieu de ces eaux. On n'y arrive que par un seul chemin, semblable à une chaussée, pratiqué entre les roseaux et l'eau, et où il ne passe qu'un cavalier à la fois. La ville, qui est située sur une colline au milieu du lac, est très forte et on ne peut la prendre. Nous y logeâmes dans la zaouïa d'un des jeunes-gens-frères.
C'est Mohammed Tchelebi, et ce dernier mot, dans la langue du pays de Roum, signifie monsieur, seigneur. Il est frère du sultan Abou Ishâk, roi d'Akrîdoûr. Lorsque nous arrivâmes dans sa capitale, il en était absent. Nous y passâmes quelques jours, au bout desquels le sultan revint. Il nous traita avec considération, et nous fournit des montures et des provisions de route. Nous partîmes par le chemin de Karâ Aghâdj; karâ signifie noir, et aghâdj, bois. C'est une plaine verdoyante, habitée par des Turcomans. Le sultan envoya avec nous plusieurs cavaliers, chargés de nous conduire jusqu'à la ville de Lâdhik, parce qu'une troupe de brigands, appelés les Djermïân interceptent les chemins dans cette plaine. On dit qu'ils descendent de Yézid, fils de Moawiah, et ils possèdent une ville appelée Coûtâhivah (Kutaya, Cotyœum). Dieu nous préserva de leurs attaques, et nous arrivâmes à la ville de Lâdhik, appelée aussi Doûn Ghozloh, ce qui signifie « la ville des porcs.[33] »
Elle est au nombre des villes les plus grandes et les plus admirables. Il s'y trouve sept mosquées où l'on fait la prière du vendredi, elle possède de beaux jardins, des rivières qui coulent abondamment, des sources jaillissantes et des marchés superbes. On y fabrique des étoffes de coton brodées d'or, qui n'ont pas leurs pareilles, et dont la durée est fort longue, à cause de l'excellente qualité du coton et de la force des fils employés. Elles sont connues par un nom emprunté de celui de la ville où elles se fabriquent. La plupart des personnes qui exercent des métiers à Lâdhik sont des femmes grecques ; car il y a ici beaucoup de Grecs tributaires. Ils payent au sultan des redevances, telles que la capitation et autres. Leur sigue distinctif consiste en des bonnets longs, parmi lesquels il y en a de ronges et de blancs. Les femmes des Grecs portent de grands turbans.
Les gens de cette ville ne réprouvent pas les mauvaises mœurs; bien plus, les habitants de tout ce pays en usent de même. Ils achètent de belles esclaves grecques et les laissent se prostituer; chacune d'elles doit payer une redevance à son maître. J'ai entendu dire, en cette ville, que les jeunes filles esclaves y entrent dans le bain avec les hommes, et que quiconque veut se livrer à la débauche se satisfait dans le bain, sans que personne lui en fasse un reproche. On m'a raconté que le kadi de cette ville possède des jeunes filles esclaves livrées à ce sale trafic.
Lors de notre arrivée à Lâdhik, nous passâmes par un marché. Des individus sortirent de leurs boutiques au-devant de nous, et prirent la bride de nos chevaux. D'autres personnes voulurent les en empêcher, et la dispute se prolongea entre les deux, partis, si bien que plusieurs individus tirèrent leurs couteaux. Nous ignorions ce qu'ils disaient. En conséquence, nous eûmes peur d'eux et nous pensâmes que c'étaient ces Djermïân qui pratiquent le brigandage sur les chemins, que c'était là leur ville et qu'ils voulaient nous piller; mais Dieu nous envoya un homme qui avait fait le pèlerinage et qui connaissait la langue arabe. Je lui demandai ce que ces gens nous voulaient. Il répondit : « Ce sont des fitiân (jeunes-gens-frères). Ceux qui sont arrivés les premiers près de vous sont les compagnons d'alfata Akhy Sinân; et les autres, les compagnons d'alfata Akhy Touman. Chaque troupe désire que vous logiez chez elle. » Nous fûmes étonnés de la générosité de leur âme.
Ils firent ensuite la paix, à condition qu'ils tireraient au sort, et que nous logerions d'abord chez ceux en faveur des quels le sort se déclarerait. Il échut à Akhy Sinan. Il apprit cette nouvelle, et vint nous trouver avec plusieurs de ses compagnons, qui nous donnèrent le salut. Nous logeâmes dans un ermitage qui lui appartenait, et l'on nous offrit différentes espèces de mets. Akhy Sinan nous conduisit ensuite au bain, y entra avec nous et se chargea de me servir lui-même; ses compagnons furent préposés au service des miens, trois ou quatre d'entre eux prenant soin d'un de ceux-ci. Quand nous fûmes sortis du bain, on apporta un festin somptueux, des sucreries et beaucoup de fruits, et lorsque nous eûmes fini de manger, les lecteurs du Coran lurent des versets de ce livre divin. Puis tous ces hommes commencèrent à chanter et à danser. Ils informèrent le sultan de notre arrivée, et le lendemain au soir il nous envoya chercher. Nous l'allâmes trouver, ainsi que son fils, comme nous le raconterons ci-dessous.
Nous retournâmes ensuite à l'ermitage; nous rencontrâmes le frère Touman et ses compagnons, qui nous attendaient. Ils nous menèrent à leur zaouïa, et imitèrent la conduite de leurs confrères en ce qui regardait le bain et le repas. Ils y ajoutèrent même quelque chose, eu répandant sur nous de l'eau de rose, après que nous fûmes sortis du bain. Ensuite ils retournèrent avec nous à la zaouïa, et se conduisirent absolument comme leurs compagnons, ou mieux encore, sous le rapport de l'excellence des mets, des sucreries et des fruits ; il en fut ainsi de la lecture du Coran après la fin du repas, du chant et de la danse. Nous passâmes plusieurs jours près d'eux à la zaouïa.
C'est Yenendj bec et il est au nombre des principaux sultans du pays de Roum. Lorsque nous fûmes descendus dans l'ermitage d'Akhy Sinân, ainsi que nous l'avons raconté, il nous envoya le prédicateur, le donneur d'avertissements, le savant 'Alâ eddîn Alkasthamoûny, et le fit accompagner par des chevaux en nombre égal au nôtre. Cela se passait dans le mois de ramadhan. Nous allâmes le trouver et nous lui donnâmes le salut. C'est la coutume des rois de ce pays de témoigner de l'humilité envers les voyageurs, de leur parler avec douceur, mais de leur faire peu de présents. Nous fîmes avec ce prince la prière du coucher du soleil; on lui servit à manger; nous rompîmes le jeûne près de lui et nous nous en retournâmes. Il nous envoya des dirhems. Son fils Mourad bec nous manda ensuite ; il habitait un jardin situé hors de la ville, car c'était alors la saison des fruits. Il envoya un nombre de chevaux égal au nôtre, ainsi qu'avait fait son père. Nous allâmes à son jardin et nous passâmes près de lui la nuit entière. Il avait un légiste qui servit d'interprète entre nous et le prince.
Nous nous en retournâmes au matin, et la fête de la rupture du jeûne nous ayant trouvés à Lâdhik, nous nous rendîmes au lieu de la prière. Le sultan sortit avec son armée et les jeunes-gens-frères sortirent aussi, tous munis de leurs armes. Les individus de tous les corps de métiers portaient des étendards, des clairons, des trompettes et des tambours. Ils s'efforcent de remporter les uns sur les autres le prix de la louange, et de se surpasser par l'éclat de leur costume et l'excellence de leurs armes. Ils ont avec eux des bœufs, des moutons et des charges de pain; ils égorgent les animaux près des sépultures, et font des aumônes avec leur chair et avec le pain. Ils se rendent d'abord aux tombeaux, puis au lieu de la prière. Lorsque nous eûmes fait la prière de la fête, nous entrâmes avec le sultan dans son palais, et l’on servit des aliments. Une table séparée fut dressée pour les docteurs de la loi, les cheikhs et les fitiân. Une autre table est destinée aux fakirs et aux malheureux ; car dans ce jour ni pauvre, ni riche n'est repoussé du palais du sultan.
Nous séjournâmes quelque temps dans cette ville, à cause du danger qu'offraient les chemins; mais une caravane s'étant préparée à partir, nous marchâmes avec elle pendant un jour et une portion de la nuit suivante, et nous arrivâmes à la forteresse de Thaouâs (Daouâs), qui est grande. On raconte que Sohaïb, compagnon de Mahomet, était originaire de cette place. Nous passâmes la nuit hors de ses murailles, et arrivâmes au matin près de sa porte. Les habitants du fort nous interrogèrent, du haut du mur, sur notre arrivée, et nous satisfîmes à leurs questions. Alors le commandant du château, Elias bec, sortit à la tête de ses troupes, afin d'explorer les environs de la forteresse et le chemin, de peur que les voleurs ne fondissent sur les troupeaux. Lorsque ces hommes eurent fait le tour de la place, les troupeaux sortirent; et c'est ainsi qu'ils agissent continuellement. Nous logeâmes dans le faubourg de cette forteresse, dans la zaouïa d'un homme pauvre. L'émir de la place nous envoya les mets de l'hospitalité, ainsi que des provisions de route.
De Thaouâs nous nous rendîmes à Moghlah, et nous logeâmes dans l'ermitage d'un des cheikhs de cet endroit, qui était au nombre des hommes généreux et vertueux. Il venait souvent nous trouver dans sa zaouïa, et n'arrivait jamais sans apporter des mets ou des fruits, ou des sucreries. Nous rencontrâmes dans cette ville Ibrahim bec, fils du sultan de la ville de Mîlâs, dont nous parlerons ci-après. Il nous traita avec considération, et nous fit présent de vêtements.
Nous nous rendîmes ensuite à Mîlâs qui est une des plus belles et des plus grandes villes du pays de Roum; elle abonde en fruits, en jardins et en eaux, et nous y logeâmes dans la zaouïa d'un des jeunes-gens-frères. Celui-ci surpassa de beaucoup, sous le rapport de la générosité, du repas d'hospitalité, de l’entrée dans le bain, et autres actions louables et actes bienséants, ceux qui l'avaient précédé près de nous. Nous rencontrâmes à Mîlâs un homme vertueux et âgé, nommé Babar echchouchtery; on racontait que son âge dépassait cent cinquante ans; mais il avait encore de la force et de l'activité; son intelligence était ferme et sa mémoire excellente. Il fit des vœux en notre faveur et nous obtînmes sa bénédiction;
C'est le sultan honoré Chodjâ' eddîn Orkhân bec, fils d'Almentecha. Il est au nombre des meilleurs souverains, il est donc d'une jolie figure et tient une belle conduite. Sa compagnie habituelle se compose de légistes, qui jouissent près de lui d'une grande considération. Plusieurs de ces hommes vivent à sa cour, parmi lesquels le fakîh Alkhârezmy, homme excellent et versé dans les diverses branches des sciences. Le sultan était mécontent de lui, lorsque je le vis, parce qu'il avait fait un voyage à la ville d'Ayâ Soloûk, qu'il en avait visité le prince et avait accepté ses dons. Ce docteur me pria de dire devant le roi, touchant son affaire, des choses capables d'effacer les mauvaises impressions qu'il avait dans l'esprit. Je fis son éloge en présence du sultan, et je rapportai ce que je connaissais de la science de ce jurisconsulte et de son mérite. Je ne cessai de parler ainsi, jusqu'à ce que la colère du prince contre lui eût disparu. Ce sultan nous fit du bien, et nous donna des montures et des provisions de route. Sa résidence était dans la ville de Bardjîn, voisine de Mîlâs; ces deux villes ne sont séparées que par une distance de deux milles. Celle de Bardjîn est nouvelle, située sur une colline, et pourvue de beaux édifices et de mosquées. Le sultan avait commencé d'y bâtir une mosquée djâmi, dont la construction n'était pas encore achevée. Nous le vîmes dans cette ville, et nous y logeâmes dans la zaouïa du jeune-homme-frère Aly.
Nous partîmes lorsque le sultan nous eut fait du bien, comme nous l'avons dit ci-dessus, et arrivâmes à Koûniyah, ville grande, bien bâtie, abondante en eaux, en rivières, en jardins et en fruits. Elle produit l'abricot appelé kamar eddîn, dont il a été question plus haut, et on l'exporte aussi de cette ville en Egypte et en Syrie. Les rues de Koûniyah sont fort vastes, ses marchés admirablement disposés, et les gens de chaque profession y occupent une place séparée. On dit que cette ville a été bâtie par Alexandre, et elle fait partie des états du sultan Bedr eddîn, fils de Karaman, dont nous parlerons ci-dessous; mais le souverain de l'Irak s'en est quelquefois emparé, à cause de sa proximité des villes qu'il possède dans ce pays.
Nous logeâmes à Koûniyah dans la zaouïa du kadi de cette ville, nommé Ibn Kalam chah. Il est au nombre des fitiân et son ermitage est un des plus grands qui existent. Il a beaucoup de disciples, dont l'affiliation à la chevalerie (prérogative de celui qui appartenait par quelque lien à la famille de Mahomet) remonte au prince des croyants 'Aly, fils d'Abou Thâlib. Le vêtement qui, chez eux, sert d'insigne à cette distinction, est le caleçon. C'est ainsi que les soufis revêtent le froc, comme marque de leur corporation. Le kadi agit encore d'une façon plus généreuse et plus belle que les personnes qui l'avaient précédé, en nous traitant avec considération et en nous donnant l'hospitalité. Il envoya son fils à sa place, pour nous introduire dans le bain.
On voit dans cette ville le mausolée du cheikh, de l'imâm pieux, du pôle, Djélal eddîn, connu sous le nom de Maoulânâ (notre maître). Cet homme jouissait d'une grande considération, et il y a dans le pays de Roum une confrérie qui lui doit sa naissance et qui porte son nom. On appelle donc ceux qui en font partie Djelâliens (actuellement Mewlewis), à l'instar des Ahmediens (ou Rîfâyiens) dans l'Irak, et des Haïderiens dans le Khoraçan. Par-dessus le mausolée de Djélal eddîn on a élevé une grande zaouïa, où l'on sert de la nourriture aux voyageurs.
On raconte que Djélal eddîn était, au début de sa carrière, un
légiste et un professeur. Les étudiants se réunissaient auprès de
lui, dans son école, à Koûniyah. Un homme qui vendait des sucreries
entra un jour dans la medréceh, portant sur sa tête un plateau de
pâtes douces, coupées en morceaux, dont chacun se vendait une obole.
Lorsqu'il fut arrivé dans la salle des leçons, le cheikh lui dit : «
Apporte ton plateau. » Le marchand y prit un morceau de sucrerie et
le donna au cheikh ; celui-ci le reçut dans sa main et le mangea. Le
pâtissier s'en alla, sans faire goûter de sa marchandise à aucune
autre personne. Le cheikh laissa la leçon, sortit pour le suivre et
négligea ses disciples. Ceux-ci l'attendirent longtemps; enfin, ils
allèrent à sa recherche; mais ne purent découvrir où il se tenait.
Il revint les trouver au bout de quelques années; mais son esprit
était dérangé; il ne parlait plus qu'en poésie persane liée (dont
les hémistiches rimaient l'un avec l'autre) et qu'on ne comprenait
pas. Ses disciples le suivaient, écrivant les vers qu'il récitait,
et ils en composèrent un livre, qu'ils appelèrent Mathnawy
![]() (« doublé, répété », parce
qu'il contient des vers de la même mesure, et dont les deux
hémistiches riment ensemble). Les habitants de ce pays révèrent cet
ouvrage, en méditent le contenu, l'enseignent, et le lisent dans
leurs zaouïas, toutes les nuits du jeudi au vendredi. On voit aussi
à Koûniyah le tombeau du jurisconsulte Ahmed, qui, à ce qu'on
raconte, fut le professeur du susdit Djélal eddîn.
(« doublé, répété », parce
qu'il contient des vers de la même mesure, et dont les deux
hémistiches riment ensemble). Les habitants de ce pays révèrent cet
ouvrage, en méditent le contenu, l'enseignent, et le lisent dans
leurs zaouïas, toutes les nuits du jeudi au vendredi. On voit aussi
à Koûniyah le tombeau du jurisconsulte Ahmed, qui, à ce qu'on
raconte, fut le professeur du susdit Djélal eddîn.
Nous partîmes de Koûniyah pour Lârendah, ville belle et abondante en eaux et en jardins.
Le sultan de cette ville est le roi Bedr eddîn, fils de Karaman ; elle appartenait d'abord à son frère utérin Mouça. Celui-ci la céda à Mélik Nacir (sultan d'Egypte), qui lui donna en place un équivalent, et y envoya un émir et une armée; mais ensuite le sultan Bedr eddîn s'en empara et y bâtit un palais royal ; son autorité s'y consolida. Je rencontrai ce sultan hors de la ville, qui revenait d'une partie de chasse. Je descendis devant lui de ma monture, et il descendit de la sienne; je le saluai et il s'avança vers moi. C'est la coutume des rois de ce pays de mettre pied à terre, lorsqu'un voyageur descend de sa monture devant eux. Son action leur plaît, et ils lui témoignent alors beaucoup de considération; mais s'il les salue sans descendre de cheval, cela leur déplaît, les mécontente, et devient une cause de désappointement pour le voyageur. C'est ce qui m'est arrivé avec un de ces rois, ainsi que je le raconterai. Lorsque j'eus donné le salut à celui-ci et que je fus remonté à cheval après lui, il m'interrogea touchant mon état de santé et le temps de mon arrivée; j'entrai avec lui dans la ville. Il ordonna de me donner l'hospitalité la plus parfaite; il m'envoya des mets copieux, des fruits et des sucreries dans des bassins d'argent, ainsi que des bougies. Il me donna des vêtements, une monture et d'autres présents.
Nous ne séjournâmes pas longtemps près de ce prince, et nous nous rendîmes à Aksera (Akseraï), une des villes les plus belles et les plus solidement bâties du pays de Roum. Des sources d'eau courante et des jardins l'entourent de tous côtés; trois rivières la traversent, et l'eau coule près de ses maisons. Elle a des arbres et des ceps de vignes, et elle renferme dans son enceinte un grand nombre de vergers. On y fabrique des tapis de laine de brebis, appelés de son nom, et qui n'ont leurs pareils dans aucune autre ville. On les exporte en Egypte, en Syrie, dans l'Irak, dans l’Inde, à la Chine et dans le pays des Turcs. Cette ville obéit au roi de l'Irak. Nous y logeâmes dans la zaouïa du chérif Hoceïn, lieutenant de l'émir Artena. Celui-ci est le représentant du roi de l'Irak, dans la portion du pays de Roum dont il s'est emparé. Le chérif Hoceïn fait partie de la corporation des fitiân (jeunes-gens-frères), et commande à une nombreuse confrérie. Il nous traita avec une extrême considération, et se conduisit comme ceux qui l'avaient précédé.
Nous partîmes ensuite pour la ville de Nacdeh (Nicdeh), qui appartient au roi de l'Irak. C'est une place considérable et très peuplée, mais dont une partie est en ruines. La rivière appelée le fleuve Noir la traverse. Celui-ci est au nombre des plus grands fleuves et porte trois ponts, dont un dans l'intérieur de la ville et deux à l'extérieur. On y a placé, tant au dedans qu'au dehors de la ville, des roues hydrauliques, qui arrosent les jardins. Les fruits sont fort abondants à Nacdeh. Nous y logeâmes dans la zaouïa du jeune-homme Akhy Djâroûk, qui remplit à Nacdeh les fonctions de commandant. Il nous traita généreusement, selon la coutume de ces jeunes-gens.
Nous passâmes trois jours à Nacdeh ; puis nous partîmes pour la ville de Kaïçârïah (Caesarea), qui appartient aussi au prince de l'Irak. C'est une des grandes villes du pays de Roum; une armée des habitants de l'Irak y réside, ainsi qu'une des khatoun de l'émir 'Alâ eddîn Artena, nommé plus haut, laquelle est au nombre des princesses les plus nobles et les plus vertueuses. Elle est parente du roi de l'Irak, et on l'appelle Agha, ce qui signifie Grand. Toutes les personnes qui ont quelque parenté avec le sultan sont appelées de ce titre. (Agha ou Aka désignait, chez les Mongols, une princesse de la famille royale.) Le nom de cette princesse est Taghy khatoun, et nous la visitâmes. Elle se leva devant nous, nous donna un salut gracieux, nous parla avec bonté, et ordonna de nous servir des aliments. Nous mangeâmes, et lorsque nous nous en fûmes retournés, elle nous envoya, par un de ses esclaves, un cheval sellé et bridé, une robe d'honneur et des dirhems, et elle nous fit présenter ses excuses.
Nous logeâmes à Caïçârïah dans la zaouïa du jeune-homme-fière, l'émir Aly. C'est un émir considérable et un des principaux frères de ce pays. Il est le supérieur d'une corporation composée de plusieurs des chefs et des grands de la ville. Son ermitage est au nombre des plus beaux par ses tapis, ses lampes, l'abondance de ses mets, et la solidité de sa construction. Les notables de la ville d'entre ses compagnons, ainsi que les autres, se rassemblent chaque nuit auprès de lui, et font, pour traiter généreusement les nouveaux venus, beaucoup plus que n'en font les autres, Une des coutumes de ce pays consiste en ce que, dans toute localité où il n'y a pas de sultan, c'est l'akhy qui remplit les fonctions de gouverneur. Il donne des chevaux et des vêtements aux voyageurs, et leur fait du bien selon la mesure de leur mérite. L'ordre que suit ce gouverneur, dans l'exercice de son autorité (mot à mot : dans son commandement et dans sa défense) et ses promenades à cheval est le même que celui des rois.
Nous nous rendîmes ensuite à la ville de Sîwâs. C'est une des possessions du roi de l'Irak, et la plus grande ville qui lui appartienne dans ce pays. Ses émirs et ses percepteurs y font leur résidence. Elle est bien construite; ses rues sont larges et ses marchés regorgent de monde. On y voit une maison qui ressemble à un collège et qui est appelée la maison du seïdat (dâr assiyâdah, l'hôtel du pouvoir »). Il n'y loge que des chérifs (descendants de Mahomet), et leur chef y habite; on leur y assigne, pour tout le temps de leur séjour, des lits, de la nourriture, des bougies et autres objets, et lorsqu'ils partent, on leur fournit des provisions de route.
Quand nous fûmes arrivés près de cette ville, les compagnons du jeune-homme Akhy Ahmed Bitchaktchy (coutelier), sortirent à notre rencontre. Bitchak signifie en turc « un couteau », et le nom de Bitchaktchy est dérivé de ce mot. Ils formaient une troupe nombreuse; les uns étaient à cheval, les autres à pied. Nous rencontrâmes ensuite les compagnons du jeune-homme Akhy Tcheleby, Celui-ci est un des principaux frères, et son rang surpasse celui d'Akhy Bitchaktchy. Ses compagnons nous invitèrent à loger chez eux; mais cela ne me fut pas possible, car ils avaient été prévenus par les autres. Nous entrâmes dans la ville avec eux tous; ils se vantaient à l'envi les uns des autres; ceux qui étaient arrivés les premiers près de nous témoignèrent la plus vive allégresse de ce que nous descendions chez eux. Ils agirent en toutes choses, repas, bain, séjour pendant la nuit, comme ceux qui les avaient précédés.
Nous passâmes trois jours chez eux, au milieu de la plus parfaite hospitalité. Le kadi vint ensuite nous trouver, accompagné d'une troupe d'étudiants, amenant avec eux des chevaux de l'émir 'Alâ eddîn Artena, lieutenant du roi de l'Irak dans le pays de Roum. Ainsi nous montâmes à cheval pour l'aller trouver. Il vint au-devant de nous jus qu'au vestibule de son palais, nous donna le salut et nous souhaita la bienvenue ; il s'exprimait en arabe avec éloquence. Il me questionna touchant les deux Irâks, Ispahan, Chiraz, le Kermân, le sultan Atabek, la Syrie, l'Egypte et les sultans des Turcomans. Il voulait que je louasse ceux d'entre les derniers qui s'étaient montrés généreux, et que je blâmasse les avares. Je n'agis pas ainsi, mais je fis l'éloge de tous indistinctement. Il fut content de moi, à cause de cette conduite, et m'en fit compliment; puis il ordonna d'apporter des mets et nous mangeâmes. Il nous dit : « Vous serez mes hôtes. » Akhy Tcheleby lui répondit : « Ils n'ont pas encore logé dans mon ermitage; qu'ils demeurent donc chez moi; les mets de ton hospitalité leur y seront remis. » L'émir répliqua : « Qu'il en soit ainsi! » En conséquence nous nous transportâmes dans l'ermitage d'Akhy Tcheleby, et nous y passâmes six jours, traités par lui et par l'émir, après quoi, celui-ci envoya un cheval, un vêtement et des pièces d'argent. Il écrivit à ses lieutenants, dans les pays voisins, de nous donner l'hospitalité) de nous traiter avec honneur et de nous fournir des provisions de route.
Nous partîmes pour la ville d'Amâciyah (Amasia), place grande et belle, possédant des rivières, des vergers, des arbres, et produisant beaucoup de fruits. Sur ses rivières on a placé des roues hydrauliques pour arroser les jardins et fournir de l'eau aux maisons. Elle a des rues spacieuses et des marchés fort larges ; son souverain est le roi de l'Irak. Dans son voisinage se trouve la ville de Soûnoça (Sounissa ou Souneïça, de Hadji Khalfah), qui appartient aussi au roi de l'Irak, et où habitent les descendants de l'ami de Dieu Abou'l 'Abbâs Ahmed arrifâ'y; parmi eux, le cheikh Izz eddîn, qui est à présent chef d'Arriwâk (le caravansérail), et propriétaire du tapis à prier d'Arrifâ'y, et les frères d’Izz eddîn, le cheikh Aly, le cheikh Ibrahim et le cheikh Yahia, tous fils du cheikh Ahmed Cutchuc (mot qui signifie « le Petit »). Ce dernier est le fils de Tadj eddîn Arrifâ'y. Nous logeâmes dans leur zaouïa, et nous les trouvâmes supérieurs à tous les autres hommes.
Puis nous nous rendîmes à la ville de Cumich (ou Gumich Khâneh « la maison d'argent »), qui appartient au roi de l'Irak. C'est une ville grande et peuplée, où il vient des marchands de l'Irak et de la Syrie, et où il se trouve des mines d'argent. A deux jours de distance, on rencontre des montagnes élevées et âpres (les monts Kolat Dagh), où je n'allai pas. Nous logeâmes à Cumich, dans l'ermitage du frère Medjd eddîn, et nous y passâmes trois jours, défrayés par lui. Il se conduisit comme ceux qui l'avaient précédé. Le lieutenant de l'émir Artena vint nous trouver, et nous envoya les mets de l'hospitalité et des provisions de route.
Nous partîmes de cette place et nous arrivâmes à Arzendjan, qui est du nombre des villes du prince de l'Irak. C'est une cité grande et peuplée ; la plupart de ses habitants sont des Arméniens, et les musulmans y parlent la langue turque. Arzendjan possède des marchés bien disposés ; on y fabrique de belles étoffes, qui sont appelées de son nom. Il y a des mines de cuivre, avec lequel on fabrique des vases, ainsi que les baïçôus que nous avons décrits. Ils ressemblent aux candélabres en usage chez nous. Nous logeâmes à Arzendjan, dans la zaouïa du fata Akhy Nizâm eddîn, laquelle est une des plus belles qui existent. Ce personnage est aussi un des meilleurs et des principaux jeunes-gens; et il nous traita parfaitement.
D'Arzendjan nous allâmes à Arz-erroum (Arzen erroum, Erzeroum), une des villes qui appartiennent au roi de l'Irak. Elle est fort vaste, mais en grande partie ruinée, à cause d'une guerre civile qui survint entre deux tribus de Turcomans qui l'habitaient. Trois rivières la traversent, et la plupart de ses maisons ont des jardins où croissent des arbres et des ceps de vignes. Nous y logeâmes dans l'ermitage du fata Akhy Touman. Cet homme est fort âgé : l'on dit qu'il a plus de cent trente années. Je l'ai vu, qui allait et venait à pied, appuyé sur un bâton. Sa mémoire était encore ferme; il était assidu à faire la prière aux heures déterminées, et il ne se reprochait rien, si ce n'est de ne pouvoir jeûner. Il nous servit lui-même pendant le repas, et ses fils nous servirent dans le bain. Nous voulûmes le quitter le second jour, mais cela lui déplut; il refusa d'y consentir et dit : « Si vous agissez ainsi, vous diminuerez ma considération; car le terme le plus court de l'hospitalité est de trois jours. » Nous passâmes donc trois jours près de lui.
Puis nous partîmes pour la ville de Birgui (Birkeh ou Birgheh).[34] Nous y arrivâmes après quatre heures du soir, et nous rencontrâmes un de ses habitants, à qui nous demandâmes où se trouvait la zaouïa du frère dans cette ville. Il répondit : « Je vous y conduirai. » Nous le suivîmes; mais il nous mena à sa propre demeure, située au milieu d'un jardin qui lui appartenait, et il nous logea tout en haut de la terrasse de sa maison. Des arbres ombrageaient cet endroit, et c'était alors le temps des grandes chaleurs. Cet homme nous apporta toutes sortes de fruits, nous hébergea parfaitement, et donna la provende à nos chevaux : nous passâmes la nuit chez lui.
Nous avions appris qu'il se trouvait dans cette ville un maître distingué, nommé Mohiy eddîn, et notre hôte, qui était un étudiant, nous conduisit dans le collège. Ce professeur venait d'y arriver, monté sur une mule fringante; ses esclaves et ses serviteurs l'entouraient à droite et à gauche, et les étudiants marchaient devant lui. Il portait des vêtements amples et superbes, brodés d'or. Nous le saluâmes; il nous souhaita la bienvenue, nous fit un gracieux salut et nous parla avec bonté ; puis il me prit par la main et me fit asseoir à son côté. Bientôt après arriva le kadi Izz eddîn Firichta; ce mot persan signifie ange, et le juge a été surnommé ainsi à cause de sa piété, de sa chasteté et de sa vertu. Il s'assit à la droite du professeur. Celui-ci commença à faire une leçon sur les sciences fondamentales et celles dérivées ou accessoires. Lorsqu'il eut achevé, il se rendit dans une cellule située dans l'école, il ordonna de la garnir de tapis et m'y logea. Puis il m'envoya un festin copieux.
Ce personnage me manda après la prière du coucher du soleil. Je me rendis près de lui, et le trouvai dans une salle de réception située dans un jardin qui lui appartenait. Il y avait en cet endroit un réservoir, dans lequel l'eau descendait d'un bassin de marbre blanc, entouré de faïence de diverses couleurs. Le professeur avait devant lui une troupe d'étudiants; ses esclaves et ses serviteurs étaient debout à ses côtés. Il était assis sur une estrade recouverte de beaux tapis peints, et lorsque je le vis, je le pris pour un roi. Il se leva devant moi, vint à ma rencontre, me prit par la main et me fit asseoir à son côté, sur son estrade. On apporta des mets; nous en mangeâmes et nous retournâmes dans la medréceh. Un des disciples me dit que c'était la coutume de tous les étudiants qui s'étaient trouvés cette fois près du maître d'assister chaque nuit à son repas. Ce professeur écrivit au sultan pour l'informer de notre arrivée, et dans sa lettre il fit notre éloge. Le prince se trouvait alors sur une montagne voisine, où il passait l'été, à cause de l'extrême chaleur. Cette montagne était froide, et il avait coutume d'y passer le temps des chaleurs.
C'est Mohammed, fils d'Aïdîn, un des meilleurs souverains, des plus généreux et des plus distingués. Lorsque le professeur lui eut expédié un message pour l'informer de ce qui me concernait, il m'envoya son lieutenant, afin de m'inviter à l'aller trouver. Le professeur me conseilla d'attendre jusqu'à ce qu'il me mandât une seconde fois. Une plaie qui venait de se déclarer sur son pied l'empêchait de monter à cheval, et lui avait fait même discontinuer ses leçons. Cependant le sultan m'ayant envoyé chercher une seconde fois, cela lui fit de la peine et il me dit : « Je ne puis monter à cheval, et c'était mon intention de t'accompagner, afin de convenir avec le sultan du traitement auquel tu as droit. » Mais il brava la douleur, enveloppa autour, de son pied des lambeaux d'étoffe, et monta à cheval sans placer le pied dans l'étrier. Moi et mes compagnons nous montâmes aussi à cheval, et nous gravîmes la hauteur sur un chemin qui avait été taillé dans le roc et bien aplani.
Nous arrivâmes vers une heure au campement du sultan, et nous descendîmes sur les bords d'une rivière, à l'ombre des noyers. Nous trouvâmes le prince dans une grande agitation et ayant l'esprit préoccupé, à cause de la fuite de son fils cadet, Soleïman, qui s'était retiré près de son beau-père, le sultan Orkhân bec. Lorsqu'il reçut la nouvelle de notre arrivée, il nous envoya ses deux fils, Khidhr bec et Omar bec. Ces deux princes donnèrent le salut au docteur (le professeur). Celui-ci leur ayant ordonné de me saluer, ils obéirent et m'interrogèrent touchant mon état et le temps de mon arrivée, puis ils s'en retournèrent Le sultan m'envoya une tente appelée, chez les Turcs, khargâh. Elle se compose de morceaux de bois, réunis en forme de coupole, et sur lesquels on étend des pièces de feutre. On ouvre la partie supérieure pour laisser entrer la lumière et l'air, à l'instar du bâdhendj ou ventilateur, et l'on bouche cette ouverture lorsqu'il est nécessaire. Ou apporta un tapis qu'on étendit par terre; le docteur s'assit et j'en fis autant; ses compagnons et les miens étaient en dehors de la tente, à l'ombre des noyers. Ce lieu (comme nous l'avons dit) est très froid : il me mourut un cheval cette nuit, à cause de la violence du froid.
Le lendemain, le professeur monta à cheval pour aller trouver le sultan, et s'exprima à mon égard selon ce que lui dicta sa bonté ; puis il revint me trouver et m'informa de cela. Au bout d'un certain temps, le prince nous envoya chercher tous les deux. Nous nous rendîmes à sa demeure; nous le trouvâmes debout et le saluâmes. Le docteur s'assit à sa droite, pour moi, je pris place immédiatement après celui-ci. Il m'interrogea sur mon état et mon arrivée, et m'adressa des questions relativement au Hedjaz, à l'Egypte, à la Syrie, au Yémen, aux deux Iraks et à la Perse, après quoi on servit des aliments; nous mangeâmes et nous nous en retournâmes. Le sultan nous envoya du riz, de la farine et du beurre, dans des ventricules de brebis : telle est la coutume des Turcs.
Nous restâmes plusieurs jours dans cet état; le sultan nous envoyait chercher chaque jour, pour assister à son repas. Il vint une fois nous visiter après l'heure de midi. Le docteur occupa la place d'honneur du salon ; je me plaçai à sa gauche et le sultan s'assit à sa droite. Il en agit ainsi à cause de la considération dont les hommes de loi jouissent chez les Turcs. Il me pria de lui écrire des paroles mémorables, ou traditions du Prophète. J'en traçai plusieurs pour lui, et le docteur les lui présenta sur l'heure. Le sultan prescrivit à ce savant de lui en écrire un commentaire en langue turque; puis il se leva et sortit. En se retirant, il vit nos serviteurs qui nous faisaient cuire des aliments, à l'ombre des noyers, sans aromates ni herbes potagères. Il ordonna pour cela de châtier son trésorier, et nous envoya des épices et du beurre.
Cependant notre séjour sur cette montagne se prolongea; l'ennui me prit, et je désirai m'en, retourner. Le docteur aussi était las de demeurer en cet endroit; et il expédia on message au sultan, pour l'informer que je voulais me remettre en route. Le lendemain le souverain envoya son lieutenant, et celui-ci parla au professeur en turc, langue que je ne connaissais pas alors. Ce dernier lui répandit dans le même langage ; l'officier s'en retourna. Le professeur me dit : « Sais-tu ce que veut cet homme ? » Je répliquai : « Je l'ignore. » « Le sultan, reprit-il, m'a envoyé demander ce qu'il te donnerait; j'ai dit à son messager: « Le prince possède de l'or, de l'argent, des chevaux et des esclaves. Qu'il lui donne là-dessus ce qu'il préférera. » L'officier alla donc retrouver le sultan, puis il revint près de nous et nous dit : « Le souverain ordonne que vous séjourniez tous deux ici aujourd'hui, et que vous descendiez avec lui demain, dans son palais en ville. » Le jour suivant, il envoya un excellent cheval de ses écuries, et descendit avec nous dans la ville. Les habitants sortirent à sa rencontre, et parmi eux, le kadi dont il a été question tout à. l'heure. Le sultan fit ainsi son entrée, accompagné par nous Lorsqu'il eut mis pied à terre à la porte de son palais, je m'en allais avec le professeur, me dirigeant vers la medréceh; mais il nous rappela et nous ordonna d'entrer avec lui dans son palais. Lorsque nous fûmes arrivés dans le vestibule, nous y trouvâmes environ vingt serviteurs du sultan, tous doués d'une très belle figure et couverts de vêtements de soie. Leurs cheveux étaient divisés et pendants; leur teint était d'une blancheur éclatante et mêlé de rouge. Je dis au docteur : « Quelles sont ces belles figures? » — « Ce sont, me répondit-il, des pages grecs. »
Nous montâmes avec le sultan un grand nombre de degrés, jusqu'à ce que nous fussions arrivés dans un beau salon, au milieu duquel se trouvait un bassin plein d'eau ; il y avait, en outre, à chacun des angles, une figure de lion en bronze, qui lançait de l'eau par la gueule. Des estrades, contiguës les unes aux autres et couvertes de tapis, faisaient le tour de ce salon ; sur une de celles-ci se trouvait le coussin du sultan. Lorsque nous fûmes arrivés près de cette dernière, le souverain enleva de sa propre main son coussin, et s'assit avec nous sur les tapis. Le docteur prit place à sa droite, le kadi, à la suite du fakîh, quant à moi, je venais immédiatement après le juge. Les lecteurs du Coran s'assirent au bas de l'estrade; car ils ne quittent jamais le sultan, quelque part qu'il donne audience. On apporta des plats d'or et d'argent, remplis de sirop délayé où l'on avait exprimé du jus de citron et mis de petits biscuits, cassés en morceaux; il y avait dans ces plats des cuillers d'or et d'argent. On apporta en même temps des écuelles de porcelaine, remplies du même breuvage, et où il y avait des cuillers de bois. Les gens scrupuleux se servirent de ces écuelles de porcelaine et de ces cuillers de bois. Je pris la parole pour rendre des actions de grâces au' sultan et faire l'éloge du docteur; j'y mis le plus grand soin, cela plut au sultan et le réjouit.
Tandis que nous étions assis avec le sultan, il arriva un vieillard dont la tête était couverte d'un turban garni d'un appendice qui tombait par derrière. Il salua le prince, et le juge et le docteur se levèrent en son honneur. Il s'assit vis-à-vis du sultan, sur l'estrade, et les lecteurs du Coran étaient au-dessous de lui. Je dis au docteur : « Quel est ce cheikh? » Il sourit et garda le silence; mais je renouvelai ma question, et il me répondit: « C'est un médecin juif; nous avons tous besoin de lui, et à cause de cela nous nous sommes levés lorsqu'il est entré, ainsi que tu as vu. » Je fus saisi de colère (litt. ma colère tant récente qu'ancienne [contre les juifs] me saisit) et je dis au juif: « O maudit, fils de maudit, comment oses-tu t'asseoir au-dessus des lecteurs du Coran, toi qui n'es qu'un juif ? » Je lui fis des reproches et j'élevai la voix. Le sultan fut étonné et demanda le sens de mes paroles. Le professeur l'en informa, et le juif se fâcha et sortit du salon, dans le plus piteux état. Lorsque nous nous en fûmes retournés, le fakîh me dit : « Tu as bien fait; que Dieu te bénisse! Nul autre que toi n'aurait osé parler ainsi à ce juif. Tu lui as appris à se connaître. »
Pendant cette audience, le sultan m'interrogea et me dit: « As-tu vu une pierre tombée du ciel? » Je répondis : « Je n'en ai jamais vu et n'en ai pas entendu parler. » — « Une pierre, reprit-il, est tombée du ciel près de la ville où nous sommes. » Puis il appela plusieurs individus, et leur ordonna d'apporter l'aérolithe. Ils apportèrent une pierre noire, compacte, très brillante et excessivement dure. Je conjecturai que son poids s'élevait à un quintal. Le sultan ordonna de faire venir des tailleurs de pierres, et il en vint quatre, auxquels il commanda de frapper l'aérolithe. Ils le frappèrent quatre fois, tous ensemble, comme un seul homme, avec des marteaux de fer; mais, à mon grand étonnement, ils ne laissèrent aucune trace sur la pierre. Le sultan ordonna de la reporter on elle se trouvait auparavant
Le troisième jour après notre entrée dans la ville avec le sultan, ce prince donna un grand festin, auquel il invita les légistes, les cheikhs, les chefs de l'armée et les principaux habitants de la ville. Lorsqu'on eut mangé, les lecteurs du Coran lurent avec leurs belles voix; puis nous retournâmes à notre demeure, dans la medréceh. Le sultan nous envoyait chaque nuit des mets, des fruits, des sucreries et des bougies ; puis il me donna cent mithlâls ou pièces d'or, mille dirhems, un vêtement complet, un cheval et un esclave grec, appelé Mikhâïyl (Michel). Il fit remettre à chacun de mes compagnons un vêtement et des pièces d'argent Nous dûmes tous ces bienfaits à la compagnie du professeur Mohiy eddîn. (Que Dieu l'en récompense!) Il nous fit ses adieux et nous partîmes. La durée de notre séjour près de celui-ci, tant sur la montagne que dans la ville, avait été de quatorze jours.
Nous nous dirigeâmes ensuite vers la ville de Tîreh, qui fait partie des Etats de ce sultan (le roi de Birgui), et qui est une belle cité, possédant des rivières, des jardins et des arbres fruitiers. Nous y logeâmes dans la zaouïa du fata Akhy Mohammed. Cet homme est au nombre des plus saints personnages; il pratique une grande abstinence, et a des compagnons qui suivent sa manière de vivre. Il nous donna l'hospitalité et fit des vœux en notre faveur.
Nous partîmes pour la ville d'Ayâ Soloûk (altération du nom d'Αγιος Θεολόγος, Saint-Jean, par lequel les Grecs du moyen âge désignaient l'ancienne Ephèse), cité grande, ancienne et vénérée par les Grecs. Il y a ici une vaste église construite en pierres énormes; la longueur de chacune est de dix coudées et au-dessus, et elles sont taillées de la manière la plus admirable. La mosquée djâmi de cette ville est une des plus merveilleuses mosquées du monde, et n'a pas sa pareille en beauté. C'était jadis une église appartenant aux Grecs; elle était fort vénérée chez eux, et ils s'y rendaient de divers pays. Lorsque cette ville eut été conquise, les musulmans firent de cette église une mosquée cathédrale. Ses murs sont en marbre de différentes couleurs, et son pavé est de marbre blanc. Elle est couverte en plomb et a onze coupoles de diverses formes, au milieu de chacune desquelles se trouve un bassin d'eau. Un fleuve la traverse (le Caïstre des anciens), sur les deux rives duquel sont plantés des arbres de diverses espèces, des ceps de vignes et des berceaux de jasmin. Elle a quinze portes.
L'émir de cette ville est Khidhr bec, fils du sultan Mohammed, fils d'Âïdin. Je l'avais vu chez son père à Birgui; je le rencontrai ensuite en dehors de cette ville, et je le saluai sans descendre de cheval. Cela lui déplut, et ce fut le motif du désappointement que j'éprouvai de sa part. La coutume de ces princes est de mettre pied à terre devant un voyageur, lorsqu'il leur en donne l'exemple, et cela leur fait plaisir. Khidhr bec ne m'envoya qu'une pièce d'étoffe de soie dorée, que l'on appelle annakh. J'achetai dans cette ville une jeune vierge chrétienne, moyennant quarante dinars d'or.
Nous nous dirigeâmes ensuite vers Yazmîr (Smyrne), grande ville située sur le rivage de la mer, mais dont la portion la plus considérable est en ruines. Elle possède un château contigu à sa partie supérieure. Nous logeâmes en cette ville dans la zaouïa du cheikh Yakoub, un des Ahmédiens, homme pieux et vertueux. Nous rencontrâmes, près de Yazmîr le cheikh Izz eddîn ibn Ahmed arrifâ'y, qui avait avec lui Zâdeh alakblâthy, un des principaux cheikhs, et cent fakirs, de ceux qui sont privés de leur raison. L'émir avait fait dresser pour eux des tentes; et le cheikh Yakoub leur donna un festin, auquel j'assistai; j'eus ainsi une entrevue avec ces malheureux.
L'émir de cette ville, est Omar bec, fils du sultan Mohammed, fils d'Âïdîn, dont il a été question tout à l'heure, et il habite dans la citadelle. Lors de notre arrivée, il se trouvait près de son père; mais il revint, cinq jours après. Une de ses actions généreuses, ce fut de venir, me visiter à la zaouïa; il me donna le salut et me fît des excuses. Puis il m'envoya un repas copieux, il me donna un petit esclave chrétien, haut de cinq empans, nommé Nikoûlak (Nicolas), et deux Vêtements de kemkha (velours). C’est une étoffe de soie fabriquée à Bagdad, à Tabriz, à Neïçâboûr et dans la Chine. Le docteur qui remplissait près de cet émir les fonctions d'imâm, m'apprit qu'il ne lui était pas resté, à cause de sa générosité, d'autre esclave que celui qu'il me donna. Que Dieu ait pitié de lui! Il fit aussi présent au cheikh Izz eddîn de trois chevaux tout harnachés, de grands vases d'argent, remplis de dirhems (cette sorte d'ustensile est nommée chez les Turcs almichrebeh « bocal, vase à' boire »), de vêtements de drap, de mer'izz (étoffe de laine], de kodsy, et de kemkha; enfin, de jeunes esclaves des deux sexes;
Ledit émir était généreux et pieux, il combattait souvent contre les infidèles. Il avait des vaisseaux de guerre, avec lesquels il faisait des incursions dans les environs de Constantinople la Grande; il prenait des esclaves, du butin et dissipait tout cela par sa générosité et sa libéralité; puis il retournait à la guerre sainte, si bien que ses attaques devinrent très pénibles pour les Grecs, qui eurent recours au pape. Celui-ci ordonna aux chrétiens de Gênes et de France de faire la guerre au prince de Yazmîr, ce qui eut lieu. De plus, il fit partir de Rome une armée, et ces troupes attaquèrent la ville de Yazmîr pendant la nuit, avec un grand nombre de vaisseaux; elles s'emparèrent du port et de la ville. L'émir Omar descendit du château à leur rencontre, les combattit, et succomba martyr de la foi, avec un grand nombre de ses guerriers. Les chrétiens s'établirent solidement dans la ville; mais ils ne purent s'emparer du château, à cause de sa force.
Nous partîmes de cette ville pour celle de Maghnîciyah (Magnetia, actuellement Manissa), et nous y logeâmes le soir du jour d'arafah (9 de dhou’lhidjdjeh), dans l'ermitage d'un des jeunes-gens. C'est une ville grande et belle, située sur la pente d'une montagne, et dont le territoire possède beaucoup de rivières, de sources, de jardins et d'arbres fruitiers.
Il se nomme Sâroû khân, et lorsque nous arrivâmes dans cette ville, nous le trouvâmes dans la chapelle sépulcrale de son fils, qui était mort depuis plusieurs mois. Il y passa, avec la mère du défunt, la nuit de la fête (du sacrifice, 10 de dhou’lhidjdjeh), et la matinée suivante. Le corps du jeune prince avait été embaumé, et placé dans un cercueil de bois recouvert de fer étamé; on le voyait ainsi suspendu au milieu d'une chapelle sans toit, afin que l'odeur du cadavre pût s'exhaler au dehors, après quoi on la recouvrira d’un toit, la bière sera placée en évidence sur le sol, et les vêtements du mort seront déposés sur celle-ci. J'ai vu agir de cette façon d'autres souverains que celui de Maghnîciyah. Nous saluâmes ce dernier en cet endroit, nous fîmes avec lui la prière de la fête, et nous retournâmes à la zaouïa.
Le jeune esclave qui m'appartenait prit nos chevaux, et partit pour les mener à l'abreuvoir, avec un autre esclave, appartenant à un de mes compagnons; mais ils tardèrent à revenir, et quand le soir fut arrivé, on ne reconnut d'eux aucune trace. Le jurisconsulte et professeur, l'excellent Moslih eddîn, habitait dans cette ville; il alla avec moi trouver le sultan, et nous lui apprîmes cet événement. Le souverain envoya à la recherche de ces fugitifs, et on ne les trouva pas alors, car les habitants étaient occupés à célébrer la fête. Ils s'étaient dirigés tous deux vers une ville appartenant aux infidèles (c'est-à-dire aux Génois), située sur le rivage de la mer, à une journée de marche de Maghnîciyah, et nommée Foûdjah (Phocée). Ceux-ci occupent une place très forte, et envoient chaque année un présent au sultan de Maghnîciyah, qui s'en contente, à cause de la force de leur ville. Lorsque l'heure de midi (du jour suivant) fut écoulée, quelques Turcs ramenèrent les deux fugitifs, ainsi que les chevaux. Ils racontèrent que, les esclaves ayant passé près d'eux le soir précédent, ils avaient conçu des soupçons à leur égard, et avaient insisté jusqu'à ce qu'ils avouassent le projet qu'ils avaient formé de s'enfuir.
Nous partîmes ensuite de Maghnîciyah, et nous passâmes la nuit près d'une horde de Turcomans, campés dans un pâturage qui leur appartenait. Nous ne trouvâmes pas chez eux de quoi nourrir nos bêtes de somme pendant cette nuit. Nos compagnons montèrent la garde à tour de rôle, de peur d'être volés. Quand ce fut le tour du docteur 'Afif eddîn Attouzery, je l'entendis qui lisait le chapitre de la Vache (iie du Coran), et je lui dis: « Lorsque tu voudras dormir, préviens-moi, afin que je voie qui devra monter la garde. » Puis je m'endormis; mais il ne me réveilla que quand le matin fat arrivé, et déjà les voleurs m'avaient pris un cheval, qui était monté d'ordinaire par ledit 'Afif eddîn, avec sa selle et sa bride. C'était un animal excellent, que j'avais acheté à Ayâ Soloûk.
Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Berghamah (Pergame), ville en ruines, qui possède une citadelle grande et très forte, située sur la cime d'une montagne. On dit que le philosophe Platon était un des habitants de cette ville, et la maison qu'il occupait est encore connue sous son nom. (L'auteur confond avec le médecin Galien.) Nous logeâmes à Berghamah dans l'ermitage d'un fakir ahmédien; mais un des grands de la ville survint, nous emmena à sa maison, et nous traita avec beaucoup de considération.
Il est appelé Yakhchy khân. Khân, chez ces peuples, signifie la même chose que sultan, et yakhshy veut dire excellent. Nous le trouvâmes dans son habitation d'été; on lui annonça notre arrivée, et il nous envoya un festin et une pièce de cette étoffe appelée kodsy.
Nous louâmes quelqu'un pour nous montrer le chemin, et nous voyageâmes dans des montagnes élevées et âpres, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à Balîkesri. C'est une ville belle, bien peuplée et pourvue de beaux marchés; mais il n'y avait pas de mosquée djâmi où l'on pût faire la prière du vendredi. Les habitants voulurent en bâtir une à l'extérieur, tout près de la ville. Ils en construisirent les murailles, mais ils n'y mirent pas de toit. Ils y priaient néanmoins, et y célébraient l'office du vendredi, à l'ombre des arbres. Nous logeâmes à Balîkesri, dans l'ermitage du jeune-homme Akhy Sinân, qui est au nombre des hommes les plus distingués de sa corporation. Le juge et prédicateur de cette cité, le légiste Mouça, vint nous visiter.
Il se nomme Domoûr khân, et il ne possède aucune bonne qualité. C'est son père qui a bâti cette ville, dont la population s'est accrue d'un grand nombre de vauriens, sous le règne du prince actuel ; « car les hommes suivent la religion de leur roi » (tel roi, tel peuple). Je visitai ce prince, et il m'envoya une pièce d'étoffe de soie. J'achetai dans cette ville une jeune esclave chrétienne, nommée Marghalîthah (Marguerite).
De là nous nous rendîmes à Boursa (Brousse), ville grande et possédant de beaux marchés et de larges rues. Des jardine et des sources d'eau vive l'entourent de toutes parts. Proche de ses murailles coule un canal, dont l'eau est très chaude et tombe dans un grand étang. On a bâti près de celui-ci deux édifices, dont l'un est consacré aux hommes et l'autre aux femmes. Les malades viennent chercher leur guérison dans cette source d'eau thermale, et s'y rendent des contrées les plus éloignées. Il y a là une zaouïa pour les voyageurs; ils y logent et y sont nourris tout le temps de leur séjour, c'est-à-dire trois journées. Elle a été construite par un roi turcoman.
Nous logeâmes à Boursa dans la zaouïa du jeune homme Akhy Chems eddîn, un des principaux jeunes gens, et nous passâmes près de lui le jour de l'achoura (10 de moharram). Il prépara un grand festin, et invita les chefs de l'armée et des habitants de la ville, pendant la nuit. Ils rompirent le jeûne chez lui, et les lecteurs du Coran firent une lecture avec leurs belles voix. Le légiste et prédicateur Medjd eddîn Alkoûnewy (de Konieh) était présent; il prononça un sermon et une exhortation, et fut très éloquent. Ensuite on se mit à chanter et à danser, et ce fut une nuit très imposante. Ce prédicateur était un homme fort pieux; il jeûnait habituellement, et ne rompait le jeûne que tous les trois jours; il ne mangeait que ce qu'il avait gagné par le travail de ses mains, et l'on disait qu'il n'acceptait de repas chez qui que ce fût. Il n'avait ni habitation, ni d'autres meubles que les vêtements dont il se couvrait; il ne dormait que dans le cimetière, et il prêchait et exhortait dans les réunions. Un certain nombre d'hommes faisaient pénitence entre ses mains, dans chaque assemblée. Je le cherchai, après cette nuit-là, mais je ne le trouvai pas. Je me rendis au cimetière sans le rencontrer; et l'on me dit qu'il y allait lorsque tout le inonde dormait.
Pendant que nous nous trouvions, cette nuit de l'achoura, dans l'ermitage de Chems eddîn, le susdit Medjd eddîn y prononça un sermon à la fin de la nuit. Un des fakirs poussa un grand cri, à la suite duquel il perdit connaissance. On répandit sur lui de l'eau de rose, mais il ne recouvra pas ses sens ; on réitéra cette effusion sans plus de succès. Les assistants n'étaient pas d'accord touchant son état : les uns disaient qu'il était mort, les autres qu'il n'était qu'évanoui. Le prédicateur termina son discours, les lecteurs du Coran firent leur lecture, et nous récitâmes la prière de l'aurore. Enfin le soleil se leva ; alors on s'assura de la position de cet homme, et l'on reconnut qu'il était mort. Que Dieu ait compassion de lui ! On s'occupa de laver son corps et de l'envelopper dans un linceul. Je fus du nombre de ceux qui assistèrent à la prière que l'on récita sur lui et à son enterrement.
Ce fakir était appelé le Criard; et l'on raconte qu'il se livrait aux exercices de la dévotion dans une caverne située dans une montagne voisine. Lorsqu'il savait que le prédicateur Medjd eddîn devait prêcher, il Fallait trouver, et assistait à son sermon. Il n'acceptait à manger de personne. Quand Medjd eddîn prêchait, il criait fort et perdait connaissance. Ensuite il revenait à lui, faisait ses ablutions et une prière de deux rec'ahs ; mais lorsqu'il entendait Medjd eddîn, il se remettait à crier, et il agissait ainsi à plusieurs reprises dans une même nuit. C'est à cause de cela qu'il fut surnommé le Criard. Il était estropié de la main et du pied, et il ne pouvait pas travailler; mais il avait une mère, qui le nourrissait du produit de son fuseau. Lorsqu'elle fut morte, il se sustentait au moyen des plantes de la terre.
Je rencontrai dans cette ville le pieux cheikh 'Abd Allah almisry, le voyageur; c'était un homme de bien. Il fit le tour du globe, sauf qu'il n'entra pas dans la Chine, ni dans l'île de Serendîb, ni dans le Maghreb, ni dans l'Espagne, ni dans le Soudan. Je l'ai surpassé en visitant ces régions.
C'est Ikhtiyâr eddîn Orkhân bec, fils du sultan Othman tchouk (Petit Othman). En turc, tchoûk (ou mieux djik), signifie petit. Ce sultan est le plus puissant des rois turcomans, le plus riche en trésors, en villes et en soldats. Il possède près de cent châteaux forts, dont il ne cesse presque jamais de faire le tour. Il passe plusieurs jours dans chacun d'eux, afin de les réparer et d'inspecter leur situation. On dit qu'il ne séjourna jamais un mois entier dam une ville. Il combat tes infidèles et les assiège. C'est son père qui a conquis sur les Grecs la ville de Boursa, et le tombeau de celui-ci se voit dans la mosquée de cette ville, qui était auparavant Une église des chrétiens. On raconte que ce prince assiégea la ville de Yeznîc pendant environ vingt ans, et qu'il mourut avant de la prendre. Son fils, que nous venons de mentionner, en fit le siège durant douze ans, et s'en rendit maître. Ce fut là que je le vis, et il m'envoya beaucoup de pièces d'argent.
Nous partîmes de Boursa pour la ville de Yeznîc (Nicée). Avant d'y arriver, nous passâmes une nuit dans une bourgade appelée Corleh (Gheurieh), dans la zaouïa d'un des jeunes-gens-frères. En quittant cette bourgade, nous marchâmes un jour entier parmi des rivières dont les bords étaient plantés de grenadiers, qui portaient les uns des fruits doux, les autres des fruits acides. Nous arrivâmes ensuite près d'un tac, à huit milles de Yeznîc, qui produit des roseaux. On né peut entrer dans cette ville que par un seul chemin, semblable à un pont, et sur lequel il ne peut passer qu'un cavalier à la fois. La ville de Nicée est ainsi défendue, et le lac l'entoure de tous côtés. Mais elle est en ruines (Coran, ch. ii, p. 361), et n'est habitée que par un petit nombre d'hommes au service du sultan. L'épouse de ce prince, Beïaloûn khatoun, y réside, et commande à ces hommes; c'est une femme pieuse et excellente.
La ville est entourée de quatre murs, dont chacun est séparé de l'autre par un fossé rempli d'eau. On y entre par des ponts de bois, que l'on enlève à volonté. A l'intérieur de la ville se trouvent des jardins, des maisons, des terres et des champs ensemencés. Chaque habitant a sa demeure, son champ et son verger, contigus les uns aux autres. L'eau potable est fournie par des puits, situés dans le voisinage. Cette ville produit toute sorte de fruits ; les noix et les châtaignes y abondent, et sont à bas prix. Les Turcs appellent celles-ci kasthanah, et les noix, koûz. On y trouve aussi le raisin nommé 'adhâri (perles, etc.), dont je n'ai vu le pareil en aucun autre endroit; il est extrêmement doux, très gros, d'une couleur claire et a la peau mince. Chaque grain n'a qu'un seul pépin.
Le jurisconsulte, l'imâm, le dévot pèlerin, 'Alâ eddîn assulthanyoûky, nous donna l'hospitalité dans cette ville. C'est un homme vertueux et généreux ; je n'allais jamais lui rendre visite sans qu'il me servît à manger. Sa figure était belle, et sa conduite, plus belle encore. Il alla trouver avec moi la khatoun susmentionnée; elle me traita avec honneur, me donna un festin et me fit du bien. Quelques jours après notre arrivée à Yeznîc, le sultan Orkhân bec, dont nous avons parlé ci-dessus, arriva dans cette ville.
Je séjournai à Yeznîc environ quarante jours, à cause de la maladie d'un cheval qui m'appartenait. Lorsque je fus las du retard, j'abandonnai cette bête, et je partis avec trois de mes compagnons, une jeune fille et deux esclaves. Il n'y avait avec nous personne qui parlât bien la langue turque et qui pût nous servir d'interprète. Nous en avions un qui nous quitta à Yeznîc.
Après être sortis de cette ville, nous passâmes la nuit dans une bourgade appelée Mekedja, chez un légiste, qui nous traita avec considération et, nous donna le festin de l'hospitalité. Nous le quittâmes et nous nous remîmes en route. Une femme turque nous précédait à cheval, accompagnée d'un serviteur; elle se dirigeait vers la ville de Yenidja, et nous suivions ses traces. Cette femme étant arrivée près d'une grande rivière appelée Sakary (ce mot signifie infernale; c'est la Sakaria des Turcs, le Sangarius des anciens), comme si elle tirait son nom de l'Enfer; que Dieu nous en préserve! cette femme, dis-je, entreprit de passer le fleuve. Lorsqu'elle parvint au milieu du courant, sa monture fut sur le point de se noyer avec elle, et la jeta en bas de son dos. Le serviteur qui l'accompagnait voulut la sauver; mais le fleuve les entraîna tous deux. Il y avait sur la rive des gens qui se jetèrent à la nage après eux, et retirèrent la femme ayant encore un souffle de vie. L'homme fut aussi retrouvé, mais il était mort. Que Dieu ait compassion de lui !
Ces gens nous informèrent que le bac se trouvait plus bas, et nom nous dirigeâmes vers celui-ci. Il consiste en quatre poutres, liées avec des cordes, et sur lesquelles on place les selles des montures et les effets; il est tiré par des personnes postées sur l'autre rive. Les hommes y montent, et on fait passer à la nage les bêtes de somme. C'est ainsi que nous pratiquâmes, et nous arrivâmes la même nuit à Câouiyah (Gheïwa). Ce mot est formé à l'instar du nom d'agent féminin, dérivé de cay, « cautérisation » (ou mieux du verbe caoua, « cautériser »; et signifie « celle qui cautérise »). Nous y logeâmes dans l'ermitage d'un des frères; nous lui parlâmes en arabe; il ne nous comprit pas, et nous adressa la parole en turc, mais nous ne le comprimes pas à notre tour. Il dit alors : « Appelez le fakîh, car il connaît l'arabe. » Celui-ci arriva et nous parla en persan; nous lui répondîmes en arabe; il ne comprit pas nos paroles, et dit au jeune homme dans l'idiome persan : Ichân 'araby kuhna mikouân wemen 'araby nau mîdânem. Ichân veut dire « ces gens-ci » ; kuhna signifie « ancien » ; mîkouân (mîgouïend), « ils disent »; men, « moi » ; non, « nouveau » ; mîdânem, « nous connaissons (je connais.) » Le fakîh voulait seulement, par ce discours, se mettre à couvert du déshonneur, parce que ces gens-là croyaient qu'il connaissait la langue arabe, tandis qu'il ne la savait pas. Il leur dit donc: « Ces étrangers parlent l'arabe ancien et je ne connais que l'arabe moderne. » Le jeune homme pensa que la chose était conforme à ce que disait le fakîh, et cette opinion nous servit près de lui, car il mit tous ses soins à nous traiter honorablement, et se dit: « Il est nécessaire de témoigner de la considération à ces gens-ci, puisqu'ils parlent la vieille langue arabe, qui était celle du Prophète et de ses compagnons. » Nous ne comprîmes pas alors les paroles du fakîh ; mais je les gravai dans ma mémoire, et lorsque j'eus appris la langue persane, j'en saisis le sens.
Nous passâmes la nuit dans la zaouïa, dont le propriétaire fit partir avec nous un guide qui nous conduisit à Ienidja, ville grande et belle; et nous y cherchâmes après la zaouïa du frère. Sur ces entrefaites, nous rencontrâmes un de ces fakirs privés de la raison, et je lui dis : « Cette maison est-elle la zaouïa du frère? » — « Oui », me répondit-il. Je fus joyeux de cela, puisque j'avais ainsi trouvé quelqu'un qui comprenait la langue arabe. Mais lorsque je l'eus mis à l'épreuve, le secret fut divulgué, vu qu'il ne savait de cet idiome que le seul mot na'am « oui, c'est bien ». Nous logeâmes dans la zaouïa, et un des étudiants nous apporta des aliments. Le frère n'était pas présent, mais la familiarité s'établit entre nous et ce thâlib. Il ne connaissait pas la langue arabe, mais il nous montra de la bonté et parla au gouverneur de la ville, qui me donna un de ses cavaliers.
Celui-ci se dirigea avec nous vers Keïnoûc (Kevnik), petite ville habitée par des Grecs infidèles, qui vivent sous la protection des musulmans. Il n'y a qu'une seule maison occupée par des mahométans, qui commandent aux Grecs. La ville fait partie des Etats du sultan Orkhân bec. Nous y logeâmes dans la maison d'une vieille infidèle, et c'était alors la saison de l'hiver et de la neige. Nous fîmes du bien à cette femme, et nous passâmes la nuit chez elle. Il n'y a dans cette ville ni ceps de vignes, ni arbres, et l'on n'y cultive que du safran. Notre vieille hôtesse nous en apporta beaucoup, car elle nous prenait pour des marchands, et pensait que nous lui achèterions son safran.
Lorsque le matin fut arrivé, nous montâmes à cheval; le cavalier (ou guide) que le jeune homme avait envoyé avec nous de Kâouïyah prit congé de nous, et fit partir à sa place un autre cavalier, qui devait nous conduire à la ville de Mothorni. Or il était tombé pendant la nuit beaucoup de neige, qui avait effacé les chemins. Ce guide prit les devants et nous suivîmes ses traces, jusqu'à ce que nous fussions arrivés, vers le milieu du jour, à une bourgade de Turcomans, qui nous apportèrent des vivres, dont-nous mangeâmes. Notre guide parla aux Turcomans, et l'un d'eux partit à cheval avec nous. Il nous fit traverser des lieux âpres, des montagnes et un cours d'eau, que nous dûmes passer plus de trente fois. Lorsque nous fûmes sortis de ces difficultés, il nous dit : « Donnez-moi un peu d'argent. » Nous lui répondîmes: « Lorsque nous serons arrivés à la ville, nous t'en donnerons et nous te rendrons satisfait. » Il ne fut pas content de cela, ou bien il ne comprit pas le sens de nos paroles. Il prit un arc appartenant à un de mes compagnons, et s'éloigna à une courte distance ; puis il revint et nous rendit l'arc. Je lui donnai quelques pièces d'argent, il les prit, s'enfuit et nous laissa, ignorant de quel côté nous devions nous diriger; car nous n'apercevions aucun chemin.
Mous cherchions à reconnaître les traces du chemin sous la neige, et nous les suivîmes jusqu'à ce que nous fussions arrivés, vers le coucher du soleil, à une montagne, sur laquelle on distinguait clairement la route, à cause de la grande quantité de pierres qui s'y trouvaient. Je craignis la mort tant pour moi que pour mes compagnons; car je m'attendais à ce que la neige tombât pendant la nuit, et il n'y avait aucune habitation en cet endroit Si nous descendions de nos montures, nous péririons; si nous marchions pendant la nuit, nous ne saurions de quel côté nous diriger. J'avais un cheval excellent, et je songeai à me tirer du danger; car je disais en moi-même : « Lorsque je serai sain et sauf, peut-être pourrai-je trouver un expédient pour sauver mes compagnons. » Il en fut ainsi. Je les recommandai à Dieu, et je me mis en marche.
Les habitants de ce pays construisent sur les sépulcres des maisons de bois, que celui qui les aperçoit prend d'abord pour des habitations, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que ce sont des tombeaux. J'en vis un grand nombre. Lorsque l'heure de la prière de la nuit fut écoulée, j'arrivai à des maisons et je dis : « ô mon Dieu! fais qu'elles soient habitées. « En effet, je les trouvai habitées, et Dieu me fit arriver à la porte d’une demeure où je vis un vieillard. Je lui adressai la parole en arabe; il me parla en turc et me fit signe d'entrer.
Je l'informai de la situation de mes compagnons; mais il ne me comprit pas. Il se trouva, grâce à la bonté de Dieu, que cette maison était une zaouïa appartenant à des fakirs, et que l'homme placé à la porte en était le supérieur. Quand les fakirs qui se trouvaient à l'intérieur de l'ermitage m'entendirent parler au cheikh, un d'eux, qui était connu de moi, sortit et me donna le salut. Je l'instruisis de ce qui était arrivé à mes compagnons, et je lui conseillai de partir avec les autres fakirs, afin de les délivrer. Ils y consentirent, et se dirigèrent avec moi vers eux. Nous revînmes tous ensemble à l'ermitage, et rendîmes grâces à Dieu de notre délivrance. C'était la nuit du jeudi au vendredi. Les habitants de la bourgade se réunirent, et passèrent la nuit à prier Dieu. Chacun d'eux apporta les aliments qu'il put se procurer, et notre peine cessa.
Nous partîmes à l'aurore et nous arrivâmes à la ville de Mothorni (Mouderni), au moment de la prière du vendredi. Nous logeâmes dans la zaouïa de l'un des jeunes-gens-frères, où était déjà une troupe de voyageurs. Nous n'y trouvâmes pas d'écurie pour nos montures. Nous fîmes la prière du vendredi. Nous étions inquiets, à cause de la quantité de la neige, du froid et du manque d'écurie. Sur ces entrefaites, nous vîmes un pèlerin, habitant de Mothorni, qui nous donna le salut; il connaissait la langue arabe. Je fus joyeux de le voir, et le priai de nous indiquer une écurie à louer pour nos montures. Il me répondit : « Quant à ce qui est de les attacher dans une habitation, cela n'est pas possible; car les portes des maisons de cette ville sont petites et des bêtes de somme ne sauraient y passer; mais je vous indiquerai un banc dans la place, où les voyageurs, et ceux qui viennent pour assister au marché, attachent leurs montures. » Il nous le montra effectivement, nous y liâmes nos montures, et un de mes compagnons s'établit dans une boutique vide, située en face de ce banc, afin de les garder.
Voici une aventure surprenante qui nous arriva : J'envoyai un des serviteurs acheter de la paille pour les bêtes de somme, et j'en expédiai un autre pour se procurer du beurre. Un d'eux revint avec de la paille; mais l'autre revint en riant, et ne rapportant rien. Nous l'interrogeâmes touchant le motif de ses rires. Il répondit : « Nous nous arrêtâmes près d'une boutique dans le marché, et nous demandâmes du beurre à son propriétaire. Il nous, fit signe d'attendre et parla à son garçon. Nous remîmes à celui-ci des pièces d'argent; il tarda quelque temps, et nous rapporta de la paille. Nous la lui primes et lui dîmes : « Nous voulons du beurre (samn) »— « Ceci, répondit-il, est du samn. » Il nous fut démontré par là que l'on dit, dans la langue des Turcs, samn, pour exprimer de la paille (tibn). Quant au beurre, on le nomme chez eux roûghân.
Lorsque nous eûmes rencontré ce pèlerin, qui connaissait la langue arabe, nous le priâmes de nous accompagner à Kasthamoûniyah, qui est éloignée de Mothorni de dix jours de marche. Je lui fis présent d'un de mes vêtements, dont l'étoffe était de fabrique égyptienne et je lui donnai une somme d'argent, qu'il laissa à sa famille, je lui assignai une monture et je lui promis de le bien traiter. Il partit avec nous. Nous découvrîmes qu'il était très riche, et qu'il possédait deux créances sur diverses personnes; mais qu'il avait des sentiments bas, un caractère vil, et qu'il agissait mal. Nous lui remettions des drachmes pour notre dépense; mats il prenait le pain qui restait, achetait avec cela des épices, des herbes potagères, et du sel, et gardait pour lui le prix de ces denrées. On me raconta qu'il volait, en outre, sur l'argent destiné à la dépense. Nous le supportions à cause des désagréments que nous souffrions par notre ignorance de la langue turque. La conduite de cet homme alla si loin, que nous lui en fîmes des reproches outrageants, et nous lui disions, à la fin de la journée : « ô pèlerin, combien nous as-tu volé aujourd'hui sur la dépense? » Il répondait : « Tant ». Nous riions de lui et nous nous contentions de cela. Voici quelques-unes de ses méprisables actions.
Un de nos chevaux étant mort dans une station, il l'écorcha de ses propres mains et en vendit la peau. Nous logeâmes une certaine nuit chez une sœur de ce pèlerin, qui habitait une bourgade. Elle nous apporta de la nourriture et des fruits secs, savoir : des poires, des pommes, des abricots et des pèches, que l'on met détremper dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils se ramollissent; après quoi, on les mange et l'on boit l'eau. Nous voulûmes récompenser cette femme; son frère le sut et nous dit : « Ne lui donnez rien, mais remettez-moi ce que vous lui destiniez. ». Nous lui donnâmes quelque chose pour le satisfaire; mais nous remîmes en cachette un présent à sa sœur, et il n'en sut rien.
Nous arrivâmes ensuite à la ville de Boûli (Boli). Lorsque nous en fûmes tout près, nous rencontrâmes une rivière qui semblait, à première vue, peu considérable; mais quand quelques-uns de nos compagnons y furent entrés, ils lui trouvèrent un courant très fort et très agité. Cependant, ils la franchirent tous, et il ne resta qu'une petite esclave, qu'ils craignirent de faire passer. Mon cheval étant meilleur que les leurs, je fis monter cette jeune fille en croupe, et j'entrepris de traverser la rivière. Lorsque je fus arrivé au milieu, il s'abattit sous moi et la fille tomba. Mes compagnons la retirèrent de l'eau, ayant à peine un dernier souffle de vie. Quant à moi, je fus préservé du danger.
Nous entrâmes dans la ville, et nous nous dirigeâmes vers la zaouïa d'un des jeunes-gens-frères. C'est une de leurs coutumes de tenir toujours du feu allumé dans leurs ermitages, pendant toute la durée de l'hiver. Ils placent à chaque angle de la zaouïa un foyer, et y adaptent des conduits ou évents, par lesquels la fumée monte, sans incommoder les habitants. On donne à ces évents le nom de bakhâry, dont le singulier est bakhîry.
Ibn Djozay dit ce qui suit : « Safy eddîn Abd el-Aziz, fils de Sarâya alhilly, a mentionné heureusement le bakhîry dans les vers suivants, où il a employé des expressions détournées. C'est la mention ici faite du bakhîry, qui me les remet en mémoire. »
Certes, depuis que vous avez laissé le bakhîry, les cendres sont répandues sur son foyer indigent.
Si vous aviez voulu qu'il fût au soir le père de la flamme (c'est-à-dire qu'il donnât de la flamme), vos mules seraient venues apportant du bois. (Allusion aux deux personnages bien connus, Abou Lahab ou « père de la flamme » et sa femme, Hammâlat alhathab, ou « porteuse de fagots ». Cf. t. I.)
Nous revenons au récit du voyageur. Lorsque nous entrâmes dans l'ermitage, nous trouvâmes le feu allumé; j'ôtai mes vêtements, j'en mis d'autres et je me réchauffai devant le feu. Le frère apporta des aliments et des fruits en abondance. Que Dieu bénisse cette admirable classe d'hommes! Combien leurs âmes sont généreuses, combien sont grandes leur libéralité et leur tendresse pour les étrangers ! Comme ils sont propices au voyageur, comme ils l'aiment et sont remplis d'une tendre sollicitude pour lui! L'arrivée d'un étranger auprès d'eux est comme son arrivée chez celui de ses proches qui l'aime le mieux. Nous passâmes cette nuit de la manière la plus agréable.
Nous partîmes au malin et arrivâmes à Gheredaï Boûli (Keredeb), grande et belle ville, située dans une plaine. Elle a des rues et des marchés fort étendus; elle est au nombre des villes les plus froides, et se compose de quartiers séparés les uns des autres, dont chacun est habité par une classe d'hommes distincte, qui ne se mêle avec aucune autre.
C'est Chah, bec, un des sultans de ce pays qui jouissent d'un médiocre pouvoir. Il est beau de visage, il tient une belle conduite et a un bon caractère; mais il est peu libéral. Nous fîmes dans cette ville la prière du vendredi, et nous y logeâmes dans une zaouïa. Je rencontrai le jurisconsulte et prédicateur Chems eddîn addimichky, le hanbalite. Il était fixé dans cette ville depuis un bon nombre d'années, et y avait eu plusieurs enfants. C'est le légiste et prédicateur de ce sultan, et il jouit auprès de lui d'un grand crédit. Il nous visita dans la zaouïa, et nous informa que le sultan venait nous voir. Je lui rendis grâces de son action ; j'allai au-devant du sultan et je le saluai. Il s'assit, et m'interrogea touchant mon état de santé et mon arrivée, et touchant les sultans que j'avais vus. Je l'informai de tout cela. Il resta une heure, après quoi il s'en retourna, et m'envoya une monture toute sellée et un vêtement.
Nous nous rendîmes à Borloû (Boïalu?), petite ville située sur une colline, et au bas de laquelle il y a un fossé; elle a un château placé sur la cime d'une haute montagne. Nous y logeâmes dans un beau collège; le pèlerin qui voyageait avec nous en connaissait le professeur et les étudiants, et assistait avec eux aux leçons. Dans quelque situation qu'il se trouvât, il ne cessait de faire partie du corps des étudiants, et il professait la doctrine hanéfite. L'émir de cette ville, Aly bec, fils du sultan illustre Soleïman pâdichâh, roi de Kasthamoûniyah, dont il sera parlé plus loin, nous invita. Nous l'allâmes trouver dans le château, et nous le saluâmes. Il nous souhaita la bienvenue, nous traita avec honneur et m'interrogea touchant mes voyages et ma situation.
Je satisfis à ses questions, et il me fit asseoir à son côté. Son kadi et secrétaire, le pèlerin (ou d'après deux autres manuscrits, le chambellan, alhâdjib) Alâ eddîn Mohammed, un des principaux câtibs, était présent. On apporta des aliments et nous mangeâmes; après quoi, les lecteurs du Coran firent une lecture avec des voix touchantes et des modulations admirables.
Nous nous en retournâmes, et nous partîmes le lendemain matin pour Kasthamoûniyah, qui est au nombre des plus grandes et des plus belles villes. Elle abonde en biens, et les denrées y sont à très bon marché. Nous y logeâmes dans l'ermitage d'un cheikh appelé le Sourdaud (Alothroûch) à cause de la dureté de son oreille, et je fus témoin d'une chose merveilleuse de sa part. En effet, un des étudiants traçait avec son doigt des lettres dans l'air ou parfois sur le sol, en présence de ce cheikh, qui le comprenait et lui répondait. On lui racontait par ce moyen des histoires tout entières, qu'il saisissait parfaitement.
Nous restâmes à Kasthamoûniyah environ quarante jours ». Nous achetions, moyennant deux dirhems, la moitié d’un mouton bien gras, et pour deux dirhems, une quantité de pain qui nous suffisait pour la journée ; or nous étions au nombre de dix. Nous prenions des sucreries au miel pour la même somme, et cela nous suffisait à tous. Nous nous procurions des noix pour un dirhem, et des châtaignes pour la même somme; nous en mangions tous, et il en restait encore. Nous payions la charge de bois un seul dirhem, et cela pendant un froid violent. Je n'ai vu aucune ville où le prix des denrées soit moins considérable.
Je rencontrai à Kasthamoûniyah le cheikh, l'imâm savant, le mufti, le professeur Tadj eddîn Assulthânyoûky, un des principaux savants de son temps. Il avait enseigné dans les deux Irâks et à Tibrîz, et avait habité cette dernière ville pendant quelque temps; il avait aussi professé à Damas, et avait jadis séjourné dans les deux villes saintes, la Mecque et Médine. Je rencontrai aussi à Kasthamoûniyah le savant professeur Sadr eddîn Soleïman alfenîky, originaire de Fenîkah (Phineka), dans le pays de Roum. Il me traita dans son école, située près du marché aux chevaux. Je vis aussi dans cette ville le cheikh vénérable et pieux, Dada émir Aly. Je le visitai dans sa zaouïa, située dans le voisinage du même marché, et je le trouvai étendu sur le dos. Un de ses serviteurs le mit sur son séant; un autre lui ayant soulevé les paupières (litt. les cils), il ouvrit les yeux, me parla dans un arabe fort élégant et me dit : « Sois le bien venu! » Je l'interrogeai sur son âge et il me répondit : « J’étais au nombre des compagnons du khalife Almostancir Billah; lorsqu'il mourut, j'étais âgé de trente ans, et j'ai maintenant cent soixante-trois ans. » (Mostancir Billah, l'avant-dernier des khalifes de Bagdad, étant mort en l'année 640 (1242), il doit y avoir une erreur dans le chiffre indiqué ici par Ibn Batoutah.) Je lui demandai de prier pour moi, ce qu'il fit, et je m'en retournai.
C'est le sultan illustre Soleïman pâdchâh (padichah); il est vieux, car son âge dépasse soixante et dix ans; il a une belle figure, une longue barbe, et son extérieur est majestueux et imposant. Les fakîhs et les gens de bien ont accès près de lui. Je le visitai dans sa salle de réception ; il me fit asseoir à son côté et m'interrogea touchant mon état, le temps de mon arrivée, et touchant les deux villes saintes, l'Egypte et la Syrie. Je satisfis à ses questions. Il commanda de me loger dans son voisinage, et me donna ce jour-là un beau cheval blanc, un vêtement et m'assigna une somme pour mon entretien, ainsi que du fourrage. Il m'assigna ensuite, sur une bourgade dépendante de la ville et éloignée de celle-ci d'une demi-journée, une certaine quantité de froment et d'orge qui fut perdue pour moi. En effet, je ne trouvai personne qui voulût me l'acheter, à cause du bas prix des denrées, et j'en fis don au pèlerin qui nous accompagnait.
C'est la coutume de ce sultan de donner une audience tous les jours, après la prière de l'asr. On apporte alors des aliments, on ouvre les portes et l'on n'empêche aucun individu de manger, qu'il soit citadin ou habitant de la campagne, étranger ou voyageur. Au commencement de la journée, ce prince tient une audience particulière. Son fils vient alors le trouver, lui baise les mains et s'en retourne à sa propre salle de réception. Les grands de l'empire viennent ensuite, mangent chez le souverain et s'en retournent.
C'est aussi sa coutume de se rendre à cheval, le vendredi, à la mosquée, qui est éloignée de son palais. Elle se compose de trois étages construits en bois. Le sultan, les grands de sa cour, le kadi, les jurisconsultes et les chefs des troupes, prient dans l'étage inférieur. L'éfendi (monsieur), frère du sultan, ses compagnons, ses serviteurs et quelques habitants de la ville, prient dans l'étage intermédiaire. Le fils du sultan, son successeur désigné, qui est le plus jeune de ses enfants et que l'on appelle Aldjewâd, ses compagnons, ses esclaves, ses serviteurs et le reste de la population, prient dans l'étage supérieur. Les lecteurs du Coran se rassemblent et s'asseyent en cercle devant le mihrâb (chœur); l'orateur (khathîb) et le kadi s'asseyent près d'eux. Le sultan se trouve placé en face du mihrâb. Les lecteurs lisent le chapitre de la Caverne (Coran, xviii) avec de belles voix, et répètent les versets d'après un ordre admirable. Lorsqu'ils ont fini leur lecture, le khathîb monte en chaire et prêche, après quoi il récite la prière. Quand celle-ci est finie, on fait des prières surérogatoires; le lecteur lit une dixième partie du Coran devant le sultan, puis ce dernier et ceux qui l'ont accompagné s'en retournent.
Alors le lecteur du Coran fait une lecture devant le frère du sultan. Lorsqu'il l'a terminée, celui-ci et ses compagnons se retirent, et le même individu fait une lecture devant le fils du sultan. Quand il a fini, le mo'arrif, qui est la même chose que le modhakkir (sorte de nomenclateur, voyez ci-dessous) se lève, célèbre en vers turcs le sultan et son fils, et fait des vœux en leur faveur, après quoi il se retire. Le fils du souverain se rend au palais de son père, après avoir, sur son chemin, baisé la main de son oncle, qui se tient debout en l'attendant. Ils entrent ensuite tous deux près du sultan, et le frère de ce dernier s'avance vers lui, baise sa main et s'assied devant ce prince. Le fils du sultan s'avance ensuite, baise la main de son père et s'en retourne dans son propre salon, où il s'assied en compagnie de ses officiers. Lorsqu'arrive le temps de la prière de l'après-midi, ils la célèbrent tous ensemble; le frère du sultan lui baise la main et se retire, et il ne revient le visiter que le vendredi suivant. Quant à son fils, il vient chaque matin, ainsi que nous l'avons dit.
Nous partîmes de Kasthamoûniyah et descendîmes dans une grande zaouïa, située dans une bourgade, et qui est au nombre des plus beaux ermitages que j'aie vus dans, cette contrée. Elle a été construite par un puissant émir, appelé Fakhr eddîn, qui fit pénitence de ses péchés. Il donna à son fils l'inspection sur cet édifice et la surveillance des, moines qui y demeurent. Les revenus de la bourgade ont été légués à cet établissement. L'émir susnommé a construit en face de la zaouïa un bain gratuit; chaque passant peut y entrer sans être obligé de rien payer. Il a bâti aussi dans la bourgade un marché qu'il a légué à la mosquée djâmi. Sur les biens légués à cette zaouïa, il assigna à chaque fakir qui arriverait des deux villes saintes et nobles, ou de la Syrie, de l'Egypte, des deux Iraks, du Khoraçan, etc. un vêtement complet, et, de plus, cent dirhems pour le jour de son arrivée, et trois cents le jour de son départ. Tout cela sans préjudice de sa nourriture durant son séjour, c'est-à-dire du pain, de la viande, du riz cuit au beurre et des sucreries. Il assigna à chaque fakir du pays de Roum dix dirhems, outre le droit de se faire héberger pendant trois jours. Nous partîmes de cette zaouïa et passâmes la nuit suivante dans une autre zaouïa, située sur une haute montagne où il n'y avait pas d'habitants. Elle avait été bâtie par un des jeunes-gens-frères, originaire de Kasthamoûniyah et appelé Nizâm eddîn, qui lui légua une bourgade dont le revenu devait être dépensé à traiter, dans cet édifice, les allants et venants.
Nous partîmes de là pour Sanoûb (Sinope), ville très populeuse et qui réunit la force à la beauté. La mer l'entoure de tous côtés, sauf un seul, qui est celui de l'orient. Elle a en cet endroit une porte, et l'on n'y entre qu'avec la permission de son émir. C'est Ibrahim bec, fils du sultan Soleïman padichah, dont il a été question ci-dessus. Lorsqu'on lui eut demandé la permission en notre faveur, nous pénétrâmes dans la ville et nous logeâmes dans la zaouïa d'Izz eddîn Âkhy Tchélébi, située hors de la porte de la mer. De cet endroit, on grimpe sur une montagne qui s'avance dans la mer, comme celle du port (Mina) à Ceuta, et où il se trouve des vergers, des champs cultivés et des ruisseaux. La plupart des fruits qu'elle produit sont des figues et des raisins. C'est une montagne inaccessible et qu'on ne saurait escalader. Il s'y trouve onze bourgades habitées par des Grecs infidèles, sous la protection des musulmans. Sur sa cime, il y a un ermitage appelé l'ermitage de Khidhr et d'Elie, et qui n'est jamais dépourvu de dévots. Près de celui-ci se trouve une source, et les prières qu'on y prononce sont exaucées. Au bas de cette montagne est le tombeau du pieux et saint compagnon de Mahomet, Bélâl l'Abyssin ; il est surmonté d'une zaouïa où l'on sert de la nourriture à tout venant.
La mosquée djâmi de la ville de Sinope est au nombre de » plus belles cathédrales. Elle a au milieu un bassin d'eau, surmonté d'une coupole soutenue par quatre piliers. Chaque pilier est accompagné de deux colonnes de marbre, au-dessus desquelles se trouve une tribune, où l'on monte par un escalier de bois. C'est une construction du sultan Perouâneh, fils du sultan Ala eddîn Erroumy. Il priait le vendredi en haut de cette coupole. Il fut remplacé par son fils Ghazi Tchélébi, et lorsque celui-ci fut mort, le sultan Soleïman, dont il a été parlé ci-dessus, s'empara de Sinope.[35] Ghazi Tchélébi était un homme brave et audacieux; Dieu l'avait doué d'une aptitude toute particulière à rester longtemps sous l'eau et à nager avec vigueur. Il s'embarquait souvent sur des navires de guerre, afin de combattre les Grecs. Lorsque les deux flottes étaient en présence et que l'on était occupé à combattre, il plongeait sous les vaisseaux grecs, la main armée d'un fer aigu, avec lequel il les perçait. Les ennemis n'apprenaient le sort qui les menaçait qu'en se voyant couler à fond. Des vaisseaux ennemis envahirent une fois le port de Sinope; Ghazi Tchélébi les coula à fond et fit prisonniers ceux qui les montaient.
Il avait un mérite sans égal; seulement on raconte qu'il faisait une grande consommation de hachich (électuaire enivrant préparé avec des feuilles de chanvre), et qu'il mourut à cause de cela : car il partit un jour pour la chasse, exercice qu'il aimait passionnément, et il poursuivît une gazelle, qui se réfugia au milieu des arbres. A cette vue, il accéléra beaucoup la course de son cheval; mais un arbre, s'étant rencontré sur son chemin, le frappa à la tête et la brisa; il mourut de cette blessure. Le sultan Soleïman s'empara de la ville de Sinope, où il mit, en qualité de gouverneur, son fils Ibrahim. On dit que ce prince mange du hachich, tout comme son prédécesseur. Au reste, les habitants de toute l'Asie Mineure ne blâment pas l'usage de cette drogue. Je passai un jour près de la porte de la mosquée djâmi de Sinope; il y a en cet endroit des estrades où les habitants s'asseyent. J'y vis plusieurs des chefs de l'armée, devant lesquels se tenait un serviteur, qui portait dans ses mains un sac (ou bonbonnière), rempli d'une substance semblable au hinnâ (poudre de couleur orange, extraite des feuilles du lawsonia inermis). L'un d'eux y puisait avec une cuiller et mangeait de cette substance. Je le regardais faire, ignorant ce que contenait le sac. J'interrogeai là-dessus quelqu'un qui m'accompagnait, et il m'apprit que c'était du hachich.
Le kadi de cette ville nous y traita; il était en même temps substitut de l'émir et son précepteur, et il était appelé ibn 'Abd Arrazzâk.
Lorsque nous fûmes entrés à Sinope, les habitants nous virent prier, les mains pendantes sur les côtés du corps. Ils sont hanéfites et ne connaissent pas la secte de Malik, ni sa manière de prier. Or celle qui est préférée, d'après sa doctrine, consiste à laisser pendre les mains sur les côtés.
Quelques-uns d'entre eux avaient vu, dans le Hedjaz et dans l'Irak, des Râfidhites prier en laissant ainsi pendre leurs mains. Ils nous soupçonnèrent de partager les doctrines de ces derniers, et nous interrogèrent là-dessus. Nous leur apprîmes que nous suivions la doctrine de Malik. Mais ils ne se contentèrent pas de cette assertion, et le soupçon s'affermit dans leur esprit à un tel point, que le lieutenant du sultan nous envoya un lièvre, et ordonna à un de ses serviteurs de rester près de nous, afin de voir ce que nous en ferions. Nous regorgeâmes, le fîmes cuire et le mangeâmes. Le serviteur s'en retourna et instruisit son maître de notre conduite. Alors tout soupçon cessa sur notre compte et l'on nous envoya les mets de l'hospitalité. En effet, les Râfidhites ne mangent pas de lièvre. (Cf. Chardin, Voyages en Perse, éd. de 1723, t. IV, p. 183.)
Quatre jours après notre arrivée à Sinope, la mère de l'émir Ibrahim y mourut et je suivis son cortège funèbre. Son fils le suivit à pied et ayant la tête découverte. Les émirs et les esclaves firent de même, et ils portaient leurs vêtements retournés à l'envers. Quant au kadi, au prédicateur et aux jurisconsultes, ils retournèrent aussi leurs habits, mais ils ne découvrirent pas leur tête, seulement ils y mirent des mouchoirs de laine noire, en place de turbans. On servit des aliments aux pauvres pendant quarante jours, car telle est la durée du deuil chez ces peuples.
Nous séjournâmes à Sinope environ quarante jours, attendant une occasion favorable de nous rendre par mer à la ville de Kiram. Nous louâmes un vaisseau appartenant à des Grecs, et nous attendîmes; encore onze jours, dans l'espoir d'un vent favorable, après quoi nous nous embarquâmes. Au bout de trois jours, lorsque nous nous trouvions déjà parvenus au milieu de la mer (Noire), celle-ci devint très agitée; notre situation fut pénible et nous vîmes la mort de très près. Je me trouvai dans la cabine du vaisseau en compagnie d'un habitant du Maghreb, qui s'appelait Abou Bekr. Je lui ordonnai de monter sur le tillac du navire, afin d'examiner l'état de la mer. Il obéit, vint me rejoindre dans la cabine et me dit : « Je vous recommande à Dieu. » Une tempête sans pareille survint; puis le vent changea et nous repoussa jusqu'aux environs de la ville de Sinope, que nous venions de quitter. Un des marchands voulut descendre dans le port de cette ville; mais j'empêchai le propriétaire du vaisseau de le faire débarquer. Bientôt le vent redevint favorable, et nous nous remîmes en route. Lorsque nous eûmes parcouru la moitié de la mer, elle fut de nouveau très agitée, et nous nous vîmes dans une situation pareille à la précédente. Enfin le vent se remit, et nous aperçûmes les montagnes du continent voisin.
Nous nous dirigeâmes vers un port appelé Kerch (Kertch, Panticapée ou Bosphore) et voulûmes y entrer. Des hommes, qui se trouvaient sur la montagne, nous firent signe de ne pas y aborder. En conséquence, nous craignîmes pour notre vie, dans la croyance qu'il se trouvait là des vaisseaux ennemis, et nous retournâmes vers le continent. Lorsque nous en approchâmes, je dis au maître du vaisseau: « Je veux descendre ici. » Il me fit descendre sur le rivage. J'y vis une église, je m'y rendis et y trouvai un moine. J'aperçus, sur une des murailles de l'église, la représentation d'un Arabe, coiffé d'un turban et ceint d'un sabre. Dans sa main était une lance et devant lui brûlait une lampe. Je dis au moine : « Quelle est cette figure? » Il me répondit : « C'est la figure du prophète Aly », et je fus étonné de sa réponse. Nous passâmes cette nuit dans l'église et nous fîmes cuire des poulets; mais nous ne pûmes les manger, car ils étaient au nombre des provisions que nous avions embarquées dans le vaisseau, et tous les objets qui se trouvaient à bord étaient imprégnés de l'odeur de la mer.
L'endroit où nous débarquâmes faisait partie de la plaine connue sous le nom de Decht Kifdjak. Decht, dans la langue des Turcs, signifie la même chose que Sahrâ, en arabe, (plaine, désert). Cette plaine est verdoyante et fleurie; mais il ne s'y trouve ni montagne, ni arbre, ni colline, ni pente. Il n'y a pas de bois à brûler, et l'on n'y connaît point d'autre combustible que la fiente d'animaux, laquelle est appelée tezec (bouse). Tu verrais les principaux d'entre les indigènes ramasser ce fumier, et le porter dans les pans de leurs vêtements. On ne voyage pas dans cette plaine, sinon sur des chariots. Elle s'étend l'espace de six mois de marche, dont trois dans les états du sultan Mohammed Uzbek, et trois dans ceux d'autres princes. Le lendemain de notre arrivée dans ce port, un des marchands, nos compagnons, alla trouver ceux des habitants de cette plaine qui appartiennent à la nation connue sous le nom de Kifdjak, et qui professent la religion chrétienne. Il loua d'eux un chariot traîné par des chevaux. Nous y montâmes, et nous arrivâmes à la ville de Cafa, grande cité qui s'étend sur le bord de la mer, et qui est habitée par des chrétiens, la plupart Génois. Ils ont un chef appelé Addemedîr (Demetrio?). Nous y logeâmes dans la mosquée des musulmans.
Lorsque nous fûmes descendus dans cette mosquée et que nous y eûmes
resté environ une heure, nous entendîmes retentir de tous côtés le
son des cloches. Je n'avais alors ja![]() mais entendu ce bruit; j'en
fus effrayé et j'ordonnai à mes compagnons de monter sur le minaret,
de lire le Coran, de louer Dieu et de réciter l'appel à la prière;
ils obéirent. Or nous aperçûmes qu'un homme s'était introduit près
de nous, couvert d'une cuirasse et armé. Il nous salua et nous le
priâmes de nous apprendre qui il était. Il nous fit savoir qu'il
était le kadi des musulmans de l'endroit, et ajouta: « Lorsque j'ai
entendu la lecture du Coran et l'appel à la prière, j'ai tremblé
pour vous, et je suis venu; vous trouver comme vous voyez. » Puis il
s'en retourna ; mais nous n'éprouvâmes que de bons traitements.
mais entendu ce bruit; j'en
fus effrayé et j'ordonnai à mes compagnons de monter sur le minaret,
de lire le Coran, de louer Dieu et de réciter l'appel à la prière;
ils obéirent. Or nous aperçûmes qu'un homme s'était introduit près
de nous, couvert d'une cuirasse et armé. Il nous salua et nous le
priâmes de nous apprendre qui il était. Il nous fit savoir qu'il
était le kadi des musulmans de l'endroit, et ajouta: « Lorsque j'ai
entendu la lecture du Coran et l'appel à la prière, j'ai tremblé
pour vous, et je suis venu; vous trouver comme vous voyez. » Puis il
s'en retourna ; mais nous n'éprouvâmes que de bons traitements.
Le lendemain, l'émir vint nous visiter et nous fit servir un festin. Nous mangeâmes chez lui et nous nous promenâmes dans la ville, que nous trouvâmes pourvue de beaux marchés. Tous ses habitants sont des mécréants. Ensuite nous descendîmes dans le port, et nous vîmes qu'il était admirable. Il s'y trouvait environ deux cents vaisseaux, tant bâtiments de guerre que de transport, petits et grands. Ce port est au nombre des plus célèbres de l'univers.
Nous louâmes un chariot et nous nous rendîmes à Kiram (Eski-Kirim ou Solghât), ville grande et belle, qui fait partie des états du sultan illustre, Mohammed Uzbek khân; elle a un gouverneur nommé par lui et appelé Toloctomoûr. Nous avions été accompagnés pendant le voyage par un des serviteurs de cet émir. Cet homme ayant annoncé à son maître notre arrivée, celui-ci m'envoya un cheval par son imâm Sa'd eddîn. Nous logeâmes dans un ermitage, dont le-supérieur était Zâdeh alkhorâçâny. Ce cheikh nous témoigna de la considération, nous complimenta sur notre arrivée, et nous traita généreusement. Il est fort vénéré de ces peuples; je vis les habitants de la ville, kadis, prédicateurs, jurisconsultes et autres, venir le saluer. Ce cheikh Zâdeh m'apprit qu'un moine chrétien habitait un monastère situé hors de la ville, qu'il s'y livrait aux pratiques de la dévotion et jeûnait très fréquemment; qu'il allait même jusqu'à jeûner quarante jours de suite, après quoi il rompait le jeûne avec une seule fève; enfin, qu'il découvrait clairement les choses cachées. Le cheikh me pria de l'accompagner dans une visite à ce personnage. Je refusai; mais, dans la suite, je me repentis de ne l'avoir pas vu, et de ne pas avoir ainsi reconnu la vérité de ce qu'on disait de lui.
Je vis à Kiram le grand kadi de cette ville, Chems eddîn Assâïly, juge des hanéfites; le kadi des chaféites, qui s'appelait Khidhr; le jurisconsulte et professeur 'Alâ eddîn al-assy; le prédicateur des chaféites, Abou Bekr, qui remplissait les fonctions d'orateur dans la mosquée djâmi, fondée dans cette ville par le défunt Almélic annâcir. Je vis aussi le cheikh, le sage et pieux Mozaffer eddîn (il était Grec de naissance, mais il embrassa sincèrement l'islamisme) ; enfin le cheikh pieux et dévot, Mozhhir eddîn, qui était au nombre des légistes les plus considérés. L'émir Toloctomoûr était alors malade, et nous allâmes le visiter; il nous témoigna de la considération et nous traita bien. Il était sur le point de se mettre en route pour la ville de Sera, résidence du sultan Mohammed Uzbek. Je me disposai à partir en sa compagnie, et j'achetai pour cela des chariots.
Les habitants de cette contrée les appellent 'arabah, et ce sont des chariots, dont chacun est pourvu de quatre grandes roues. Il y en a qui sont traînés par deux chevaux, ou même davantage; des bœufs et des chameaux les traînent également, selon la pesanteur ou la légèreté du char. L'individu qui conduit l'arabah monte sur un des chevaux qui tirent ce véhicule, et sa monture est sellée. Il tient dans sa main un fouet, afin d'exciter les chevaux à la marche, et un grand morceau de bois, avec lequel il les touche, lorsqu'ils se détournent du chemin. On place sur le chariot une espèce de pavillon, fait de baguettes de bois, liées ensemble avec de minces lanières de cuir. Cette sorte de tente est très légère, elle est recouverte de feutre ou de drap, et il y a des fenêtres grillées, par lesquelles celui qui est assis en dedans voit les gens, sans en être vu. Il y change de position à volonté; il dort, il mange, il lit et il écrit pendant la marche. Ceux de ces chariots qui portent les bagages, les provisions de route et les magasins de vivres, sont recouverts d'un pavillon pareil, fermant par une serrure.
Lorsque je voulus me mettre en route, je préparai, pour mon usage, un chariot recouvert de feutre, et où je pris place avec une jeune esclave qui m'appartenait; un autre plus petit, pour mon compagnon 'Afif eddîn Ettoûzery; et pour mes autres compagnons, un grand chariot, traîné par trois chameaux, sur d'un desquels était monté le conducteur de l'arabah.
Nous partîmes en compagnie de l'émir Toloctomoûr, de son frère 'Iça et de ses deux fils, Cothloûdomoûr et Sâroû-bec. Le dit émir fut aussi accompagné dans ce voyage par son imâm. Sa'd eddîn, par le prédicateur Abou Bekr, le kadi Chems eddîn, le jurisconsulte Cherf eddîn Mouça, et le nomenclateur (sorte de chambellan) Alâ eddîn. Les fonctions de ce dernier officier consistent à se tenir devant l'émir dans sa salle de réception, et, lorsqu’arrive le kadi, à se lever devant lui et à dire à haute voix : « Bismillâhi (au nom de Dieu), voici notre seigneur, notre maître, le chef des kadis et des magistrats, celui qui rend des réponses juridiques et des sentences claires et évidentes; au nom de Dieu ! » Lorsqu'arrive un jurisconsulte respecté ou un homme considérable, le nomenclateur dit ces mots: « Au nom de Dieu! voici notre seigneur, N..... de la religion; bismillâhi! » Les assistants se préparent à recevoir le nouveau venu, ils se lèvent devant lui, et lui font place dans la salle.
C'est la coutume des Turcs de voyager dans cette plaine de la même manière que les pèlerins voyagent sur la route du Hedjaz. Ils se mettent en marche après la prière de l'aurore, campent vers neuf ou dix heures du matin; repartent après l'heure de midi, et s'arrêtent de nouveau le soir. Lorsqu'ils se sont arrêtés quelque part, ils délient leurs chevaux, leurs chameaux et leurs bœufs, des arabah où ils sont attachés, et les mettent en liberté, afin qu'ils se repaissent, soit de nuit, soit de jour. Personne ne fait donner de fourrage à un herbivore, pas même le sultan. C'est le propre de cette plaine, que ses plantes remplacent l'orge pour les bêtes de somme, et aucun autre pays ne possède cette propriété. Pour ce motif, les bêtes de somme sont en grand nombre dans le Kifdjak; elles n'ont ni pasteurs, ni gardiens, à cause de la sévérité des lois des Turcs contre le vol. Voici quelle est leur jurisprudence à cet égard : celui en la possession duquel on trouve un cheval dérobé, est obligé de le rendre à son maître, et de lui en donner neuf semblables; s'il ne peut le faire, ses enfants sont saisis en remplacement de cette amende; si, enfin, il n'a pas d'enfant, il est égorgé comme une brebis.
Ces Turcs ne mangent pas de pain, ni aucun autre aliment solide (litt. grossier, dur). Ils préparent un mets avec un ingrédient que l'on trouve dans leur pays, qui ressemble à l’anly (espèce de millet) et que l'on appelle addoûghy. Pour cela ils placent de l'eau sur le feu, et, lorsqu'elle bout, ils y versent un peu de ce doûghy. S'ils ont de la viande, ils la coupent en petits morceaux et la font cuire avec ces grains. Ensuite, on sert à chaque personne sa portion dans une écuelle, on verse par-dessus du lait caillé, et on avale le tout. Ils boivent encore, après cela, du lait de jument aigri, qu'ils appellent kimizz.
Ce sont des gens forts, vigoureux et d'un bon tempérament, lis font quelquefois usage d'un mets, qu'ils appellent alboûrkhâny. C'est une pâte qu'ils coupent en petits morceaux; ils y font un trou au milieu et les placent dans un chaudron; lorsqu'ils sont cuits, ils répandent dessus du lait aigri et les avalent. Ils ont aussi une liqueur fermentée, fabriquée avec les grains du doûghy dont il a été question précédemment. Ces gens regardent comme une honte l'usage des sucreries. Je me trouvais un jour près du sultan Uzbek pendant le mois de ramadhan. On apporta de la viande de cheval, qui est celle dont ces peuples mangent le plus, de la viande de mouton, et du richta, lequel est une espèce de vermicelle, que l'on fait cuire, et que l'on boit avec du lait caillé. J'apportai cette même nuit au sultan un plateau de sucreries, qu'avait préparées un de mes compagnons, et je les lui présentai. Il y porta son doigt et le fourra ensuite dans sa bouche, mais il s'en tint là. L'émir Toloctomoûr me raconta qu'un des principaux esclaves de ce sultan avait environ quarante enfants ou petits-enfants, et que le sultan lui dit un jour : « Mange des sucreries et je vous affranchirai tous »; mais que cet homme refusa et répondit : « Quand bien même tu devrais me tuer, je n'en mangerais pas. »
Lorsque nous fûmes sortis de la ville de Kiram, nous campâmes près de l'ermitage de l'émir Toloctomoûr, dans un endroit appelé Sedjidjân, et il m'envoya inviter à l'allier trouver. J'enfourchai mon cheval, car j'en avais un toujours prêt à être monté par moi et que conduisait le cocher de l'arabah ; je m'en servais quand je voulais. Je me rendis donc à l'ermitage, et je trouvai que l'émir y avait préparé des mets abondants, parmi lesquels il y avait du pain. On apporta ensuite, dans de petites écuelles, une liqueur de couleur blanchâtre, et les assistants en burent. Le cheikh Mozaffer eddîn était assis tout près de l'émir, et je venais après le cheikh. Je dis à celui-ci : « Qu'est-ce que cela ? » — » C'est, me répondit-il, de l'eau de dohn (graisse, etc.) » Je ne compris pas ce qu'il voulait dire; je goûtai de ce breuvage, mais je lui trouvai une saveur acide, et je le laissai. Lorsque je fus sorti, je m'informai de cette boisson; on me dit ; « C'est du nebîdh (liqueur fermentée) fait avec des grains de doûghy. » Ces peuples, en effet, sont du rite hanéfite, et le nebîdh est considéré par eux comme permis. Ils appellent cette boisson fabriquée avec du doûghy, du nom d'alboûzah (sorte de bière). Le cheikh Mozaffer eddîn m'avait sans doute dit : « C'est de l'eau de dokhn (millet) ». Mais il avait une prononciation barbare, et je crus qu'il disait : « C'est de l'eau de dohn. »
Après avoir dépassé dix-huit stations, à partir de Kiram, nous arrivâmes près d'un grand amas d'eau, que nous mîmes un jour entier à traverser à gué. Lorsque les bêtes de somme et les voitures y furent entrées en grand nombre, la boue augmenta et le passage devint plus difficile. L'émir pensa à ma commodité, et me fit partir devant lui, avec un de ses serviteurs. Il écrivit en ma faveur une lettre à l'émir d'Azâk (Azof), pour l'informer que je désirais me rendre près du roi, et pour l'engager à me traiter avec considération. Nous marchâmes jusqu'à ce que nous atteignissions un autre amas d'eau, que nous mîmes une demi journée à traverser; puis, ayant encore voyagé pendant trois jours, nous arrivâmes à la ville d'Azâk, qui est située sur le rivage de la mer.
C'est une place bien bâtie; les Génois et d'autres peuples s'y rendent avec des marchandises. Un des jeunes-gens-frères Akhy Bitchaktchy, y habite; il est au nombre des grands personnages, et donne à manger aux voyageurs. Lorsque la « lettre de l'émir Toloctomoûr parvint au gouverneur d'Azâk, Mohammed Khodjah alkhârizmy, il sortit à ma rencontre accompagné du kadi et des étudiants, et me fit apporter des aliments. Quand nous lui eûmes donné le salut, nous nous arrêtâmes dans un endroit où nous mangeâmes. Nous arrivâmes ensuite à la ville, et nous logeâmes en dehors, non loin d'un couvent appelé le couvent de Khidhr et d'Elie. Un cheikh habitant à Azâk, et appelé Radjab Ennahr Meliky, par allusion à une bourgade de l'Irak (Nahr Melik, ou canal du roi), sortit de la ville, et nous donna un beau festin dans un ermitage qui lui appartenait. L'émir Toloctomoûr arriva deux jours après nous, et l'émir Mohammed sortit à sa rencontre, avec le kadi et les étudiants; on prépara pour lui des festins, et l'on dressa trois tentes contiguës l'une à l'autre; l'une d'elles était de soie de diverses couleurs et magnifique, et les deux autres de toile de lin. On les entoura d'une serâtcheh, ou enceinte de toile, que l'on appelle chez nous afrâdj (tente, et aussi assemblage de tentes, camp). En dehors se trouvait le vestibule, qui a la même forme que le bordj, ou tour, dans notre pays (à Fez). Lorsque l'émir fut descendu de cheval, on étendit devant lui des pièces de soie, sur lesquelles il marcha. Ce fut par une suite de sa générosité et de sa bonté qu'il me fit partir avant lui, afin que cet autre émir vît dans quelle estime il me tenait.
Nous arrivâmes ensuite à la première tente, qui était préparée pour que Toloctomoûr s'y reposât. A la place d'honneur était un grand siège de bois, incrusté d'or et revêtu d'un beau coussin, pour que l'émir pût s'y asseoir. Celui-ci me fit marcher devant lui, et il agit ainsi à l'égard du cheikh Mozaffer eddîn; puis il monta et s'assit entre nous deux. Nous nous trouvions ainsi tous trois sur le coussin. Le kadi et le prédicateur de Toloctomoûr s'assirent, de même que le kadi et les étudiants de cette ville, à la gauche de l'estrade et sur de riches tapis. Les deux fils de l'émir Toloctomoûr, son frère, l'émir Mohammed et ses enfants se tinrent debout, en signe de respect. Après cela on apporta des aliments, Consistant en chair de cheval, et autres viandes, ainsi que du laitage de jument. Puis on servit la boisson dite boûzah. Lorsqu'on eut fini de manger, les lecteurs du Coran firent une lecture avec leurs belles voix. Ensuite on dressa une chaire et le prédicateur y monta. Les lecteurs du Coran s'assirent devant lui, et il fit un discours éloquent, pria pour le sultan, pour l'émir et pour les assistants. Il parlait d'abord en arabe, puis il traduisait ses paroles en turc. Dans l'intervalle, les lecteurs du Coran répétaient des versets de ce livre avec des modulations merveilleuses; puis ils commencèrent à chanter. Ils chantaient d'abord en arabe et ils nomment cela alkaoul (la parole), puis en persan et en turc, ce qu'ils appellent almolamma' (le discours bigarré). On apporta plus tard d'autres mets, et l'on ne cessa d'agir ainsi jusqu'au soir. Toutes les fois que je voulus sortir, l'émir m'en empêcha. Enfin, l'on apporta un vêtement peur l'émir, et d'autres pour ses deux fils, pour son frère, pour le cheikh Mozaffer eddîn, et pour moi. L'on amena dix chevaux pour l'émir et pour son frère, six pour ses deux fils, pour chaque grand de sa suite un cheval, et un aussi pour moi.
Les chevaux sont très nombreux dans cette contrée et ils coûtent fort peu. Le prix d'un excellent cheval est de cinquante ou soixante dirhems du pays, qui correspondent à un dinar du Maghreb, ou environ. Ces chevaux sont les mêmes que l'on connaît en Egypte sous le nom d'acâdîch (au singulier icdîch, cheval de race mélangée, et aussi un cheval hongre). C'est d'eux que les habitants tirent leur subsistance, et ils sont aussi nombreux dans ce pays que les moutons dans le nôtre, ou même bien davantage : un seul Turc en possède quelquefois des milliers. C'est la coutume des Turcs établis dans ce pays, et possesseurs de chevaux, de placer, sur les 'arabah dans lesquels montent leurs femmes, un morceau de feutre de la longueur d'un empan, lié à un bâton mince, long d'une coudée, et fixé à l'un des angles du chariot. On y place un morceau par chaque millier de chevaux, et j'en ai vu qui avaient dix morceaux et au-dessus. Ces chevaux sont transportés dans l'Inde, et il y en a dans une caravane jusqu'à six mille, tantôt moins et tantôt plus. Chaque marchand en a cent ou deux cents, plus ou moins. Les marchands prennent à gage, pour chaque troupe de cinquante chevaux, un gardien qui en a soin et les fait paître comme des moutons; cet homme se nomme chez eux alkachy. Il monte un des chevaux, et tient dans sa main un long bâton auquel est attachée une corde. Quand il veut saisir un de ces animaux, il se place vis-à-vis de celui-ci avec le cheval qu'il a pour monture; il lui lance la corde au cou, le tire à soi, monte sur son dos, et laisse paître l'autre.
Lorsque les marchands sont arrivés avec leurs chevaux dans le Sind, ils leur font manger des grains, parce que les-plantes du Sind ne sauraient remplacer l'orge. Il meurt' beaucoup de ces animaux, et il en est aussi dérobé. Ou fait payer aux propriétaires un droit de sept dinars d'argent par cheval, dans une localité du Sind appelée Chech-nakâr; ils sont aussi taxés à Moltân, capitale du Sind. Autrefois, ils étaient imposés au quart de la valeur de ce qu'ils importaient. Mais le roi de l'Inde, le sultan Mohammed, a aboli ce droit; il a ordonné que l'on perçût sur les marchands musulmans la zekâh (dîme aumônière, consistant en deux et demi pour cent du capital), et sur les infidèles, le dixième. Malgré cela, il reste aux marchands de chevaux un grand bénéfice, car ils vendent, dans l'Inde, un cheval de peu de valeur, cent dinars d'argent; ceux-ci équivalent, en or du Maghreb, à vingt-cinq dinars. Souvent ils en retirent le double ou le triple de cette somme. Un excellent cheval vaut cinq cents dinars ou davantage. Les habitants de l'Inde ne les achètent pas pour la marche précipitée et la course; car ils revêtent, dans les combats, des cottes de mailles, et ils en couvrent aussi leurs chevaux. Os prisent seulement, dans un cheval, sa force et la longueur de ses pas. Quant aux chevaux qu'ils recherchent pour la course, on les leur amène du Yémen, de l'Oman et du Fars. Un de ces derniers se vend depuis mille jusqu'à quatre mille dinars.
Lorsque l'émir Toloctomoûr fut parti d'Azâk, je restai dans cette ville trois jours après lui, jusqu'à ce que l'émir Mohammed Khodjah m'eût préparé les objets nécessaires pour le voyage. Je me mis alors en route pour Mâtchar (Mâdjar), qui est une cité considérable, et l'une des plus belles villes qui appartiennent aux Turcs; elle est située sur un grand fleuve (la Kouma). Il s'y trouve des jardins, et les fruits y abondent. Nous y logeâmes dans l'ermitage du cheikh pieux et dévot, du vénérable Mohammed albathâïhy, originaire des Bathâïh, ou marais de l'Irak. Il était le successeur et vicaire du cheikh Ahmed arrifâ'y, dont Dieu soit satisfait. Il y avait dans sa zaouïa environ soixante et dix fakirs arabes, persans, turcs et grecs, tant mariés que célibataires. Leurs moyens d'existence consistaient en aumônes. Les habitants de ce pays ont une très bonne opinion des fakirs, et toutes les nuits ils amènent à l'ermitage des chevaux, des bœufs et des moutons. Le sultan et les princesses viennent visiter le cheikh et recevoir ses bénédictions; ils le traitent avec la plus grande libéralité, et lui font des présents considérables, particulièrement les femmes. Celles-ci répandent de nombreuses aumônes et recherchent les bonnes œuvres. Nous fîmes dans la ville de Mâdjar la prière du vendredi. Lorsque l’on se fut acquitté de cette prière, le prédicateur Izz eddîn monta en chaire. C'était un des docteurs ès-lois et des hommes distingués de Boukhara; il avait un bon nombre de disciples, et de lecteurs du Coran, qui lisaient ce livre devant lui. Il prêcha et exhorta les assistants en présence de l'émir et des grands de la ville; puis le cheikh Mohammed albathâïhy se leva et dit : « Le jurisconsulte et prédicateur désire voyager, et nous voulons pour lui des provisions de route. » Ensuite il ôta une tunique d'étoffe de laine, qui le couvrait, et ajouta : « Voilà le don que je lui fais. « Parmi les assistants, les uns se dépouillèrent de leurs vêtements, les autres donnèrent un cheval, d'autres, de l'argent. Beaucoup de ces divers objets furent recueillis pour le docteur.
Je vis, dans le bazar de cette ville, un juif qui me salua et me parla en arabe. Je l'interrogeai touchant son pays, et il me dit qu'il était originaire d'Espagne, qu'il était arrivé par la voie de terre, qu'il n'avait pas voyagé sur mer, et était venu, par le chemin de Constantinople la Grande, de l'Asie Mineure et du pays des Circassiens. Il ajouta que l'époque de son départ de l'Espagne remontait à quatre mois. Les marchands voyageurs, qui connaissent ces matières, m'informèrent de la vérité de son discours.
Je fus témoin, dans cette contrée, d'une chose remarquable, c'est-à-dire de la considération dont les femmes jouissent chez les Turcs; elles y tiennent, en effet, un rang plus élevé que celui des hommes. Quant aux femmes des émirs, la première fois que j'en vis une, ce fut lorsque je sortis de Kiram. J'aperçus alors la princesse, femme de l'émir Salthiyah, dans son chariot. Toute la voiture était recouverte de drap bleu d'un grand prix; les fenêtres et les portes du pavillon étaient ouvertes. Devant la princesse se tenaient quatre jeunes filles, d'une exquise beauté et merveilleusement vêtues. Par derrière venaient plusieurs autres chariots, où se trouvaient les jeunes filles qui la servaient. Lorsqu'elle approcha de la station de l'émir, elle descendit de l’arabah; environ trente jeunes filles descendirent aussi, pour soulever les pans de sa robe. Ses vêtements étaient pourvus de boutonnières; chaque jeune fille en prenait une; elles soulevaient ainsi les pans de tous côtés, et de cette manière la khatoun marchait avec majesté. Lorsqu'elle fut arrivée près de l'émir, il se leva devant elle, lui donna le salut et la fit asseoir à son côté, les jeunes esclaves entourant leur maîtresse. On apporta des outres de kimizz, ou lait de cavale. Elle en versa dans une coupe, s'assit sur ses genoux devant l'émir, et la lui présenta. Lorsqu'il eut bu, elle fit boire son beau-frère, et l'émir la fit boire à son tour. On servit des aliments, la princesse en mangea avec l'émir, il lui donna un vêtement et elle s'en retourna. C'est de cette manière que sont traitées les femmes des émirs, et nous parlerons ci-après des femmes du roi. Quant à celles des trafiquants et des petits marchands, je les ai vues aussi. L'une de celles-ci sera, par exemple, dans un chariot traîné par des chevaux. Près d'elle se trouveront trois ou quatre jeunes filles, portant les pans de sa robe, et sur sa tête sera un boghthâk, c'est-à-dire un âkroûf (bonnet haut, de forme conique), incrusté de joyaux et garni, à son extrémité supérieure, de plumes de paons. Les fenêtres de la tente du chariot seront ouvertes, et l'on verra la figure de cette femme; car les femmes des Turcs ne sont pas voilées. Une autre, en observant ce même ordre et accompagnée de ses serviteurs, apportera au marché des brebis et du lait, qu'elle vendra aux gens pour des parfums. Souvent la femme est accompagnée de son mari, que quiconque le voit prend pour un de ses serviteurs. Il n'a d'autre vêtement qu'une pelisse de peau de mouton, et il porte sur sa tête un haut bonnet, qui est en rapport avec cet habit, et qu'on appelle alcula.
Nous nous préparâmes à partir de la ville de Madjar, pour nous diriger vers le camp du sultan, qui était placé à quatre journées de distance, dans un endroit nommé Bichdagh (Bech-Taw). Le sens de bich, dans la langue des Turcs, est « cinq », et dagh a la signification de « montagne ». Dans ces cinq montagnes se trouve une source d'eau thermale, dans laquelle les Turcs se lavent ; car ils prétendent que quiconque s'y est baigné, est à l'abri des attaques de la maladie. Nous nous mimes donc en marche vers l'emplacement du camp, et nous y arrivâmes le premier jour de ramadhan. Nous trouvâmes que le cortège du sultan avait changé de place, et nous revînmes au lieu d'où nous étions partis, parce que le camp devait être planté dans le voisinage. Je dressai ma tente sur une colline située en cet endroit; je fixai devant la tente un étendard et je plaçai les chevaux et les chariots par derrière. Sur ces entrefaites, arriva le cortège impérial, que les Turcs appellent ordou (camp, horde). Nous vîmes ainsi une grande ville qui se meut avec ses habitants, qui renferme des mosquées et des marchés, et où la fumée des cuisines s'élève dans les airs; car les Turcs font cuire leurs mets pendant le voyage même. Des chariots, traînés par des chevaux, transportent ces peuples, et lorsqu'ils sont arrivés au lieu du campement, ils déchargent les tentes qui se trouvent sur les 'arabah, et les dressent sur le sol; car elles sont très légères. Ils en usent de même avec les mosquées et les boutiques. Les épouses du sultan passèrent près de nous, chacune avec son cortège séparé. Lorsque la quatrième en rang vint à passer (c'est la fille de l'émir 'Îça bec, et nous en parlerons ci-après), elle vit la tente dressée au sommet de la colline, et l'étendard qui était planté devant, lequel indiquait un nouvel arrivé. Elle envoya des pages et des jeunes filles, qui me saluèrent et me donnèrent le salut de sa part. Pendant ce temps elle était arrêtée à les attendre. Je lui envoyai un présent, par un de mes compagnons et par le mo'arrif ou chambellan de l'émir Toloctomoûr. Elle accueillit ce don comme un présage favorable, et ordonna que je logeasse dans son voisinage; puis elle se remit en marche. Le sultan arriva ensuite et campa dans son quartier séparé.
Son nom est Mohammed Uzbek, et le sens de khan, chez les Turcs, est celui de sultan. Il possède un grand royaume, il est très puissant, illustre, élevé en dignité, vainqueur des ennemis de Dieu, les habitants de Constantinople la Grande, et plein d'ardeur pour les combattre. Ses états sont vastes, et ses villes considérables. Parmi celles-ci, on compte Cafa, Kiram, Mâdjar, Azâk, Sordak (lisez Soûdâk), Kharezm et sa capitale, Asserâ. C'est un des sept plus grands et plus puissants rois du monde, savoir : 1° notre maître, le prince des croyants, l'ombre de Dieu sur la terre, chef de la troupe victorieuse, laquelle ne cessera de défendre la vérité jusqu'au jour de la résurrection ; que Dieu affermisse son autorité et ennoblisse sa victoire! (il s'agit ici du roi de Fez); 2° le sultan d'Egypte et de Syrie; 3° le sultan des deux Irâks; 4° le sultan Uzbek, dont il est ici question ; 5° le sultan du Turkestan et de Mâwarâ'nnahr (Transoxiane) ; 6° le sultan de l'Inde; 7° le sultan de la Chine. Lorsque le sultan Uzbek est en voyage, il n'a avec lui, dans son camp, que ses mamlouks et les grands de son empire. Chacune de ses femmes occupe un quartier séparé; quand il veut se rendre près d'une d'elles, il l'envoie prévenir, et elle se prépare à le recevoir. Il observe, dans ses audiences, dans ses voyages et dans ses affaires un ordre surprenant et merveilleux.
Il a coutume de s'asseoir le vendredi, après la prière, dans un pavillon appelé le pavillon d'or, et qui est richement orné et magnifique. Il est formé de baguettes de bois, revêtues de feuilles du même, métal. Au milieu est un trône de bois, recouvert de lames d'argent doré; ses pieds sont d'argent massif, et leur partie supérieure est incrustée de pierreries. Le sultan s'assied sur le trône, ayant à sa droite la princesse Thaïthoghly, après laquelle vient la khatoun Kebec, et à sa gauche, la khatoun Beïaloûn, que suit la khatoun Ordodjy. Le fils du sultan, Tina bec, est debout au bas du trône, à droite, et son second fils, Djâni bec, se tient debout au côté opposé. La fille d'Uzbek, Itcudjudjuc, est assise devant lui. Lorsqu'une de ces princesses arrive, il se lève devant elle, et la tient par la main, jusqu'à ce qu'elle soit montée sur le trône. Quant à Thaïthoghly, qui est la reine, et la plus considérée des khatoun aux yeux d'Uzbek, il va au-devant d'elle jusqu'à la porte de la tente, lui donne le salut, la prend par la main, et quand elle est montée sur le trône, et qu'elle s'est assise, alors seulement il s'assied. Tout cela se passe aux yeux des Turcs, et sans aucun voile. Les principaux émirs arrivent après ces cérémonies, et leurs sièges sont dressés à droite et à gauche ; car lorsque chacun d'eux vient à la réception du sultan, un page l'accompagne, portant son siège. Les fils de rois, cousins germains, neveux et proches parents du sultan, se tiennent debout devant lui. Les enfants des principaux émirs restent debout vis-à-vis d'eux, près de la porte de la tente. Les chefs des troupes se tiennent également debout derrière les fils des émirs, à droite et à gauche. Ensuite les sujets entrent pour saluer le sultan, selon leurs rangs respectifs, trois par trois; ils saluent, s'en retournent et s'asseyent à quelque distance.
Lorsque la prière de l'après-midi a été prononcée, la reine s'en retourne. Les autres khatoun s'en vont aussi et la suivent jusqu'à son campement. Quand elle y est rentrée, elles retournent à leur propre quartier, montées sur des chariots. Chacune est accompagnée d'environ cinquante jeunes filles, montées sur des chevaux. Devant l'arabah il y a environ vingt femmes âgées (kawâ'ïd, litt. en retraite, sans maris et sans enfants), à cheval, entre les pages et le chariot, et derrière le tout, environ cent jeunes esclaves. Devant les pages sont environ cent esclaves âgés, à cheval, et autant à pied. Ceux-ci tiennent dans leurs mains des baguettes, et ont des épées attachées à leurs ceintures; ils marchent entre les cavaliers et les pages. Tel est l’ordre que suit chaque princesse en arrivant et en s'en retournant.
Je me logeai dans le camp, non loin du fils du sultan, Djâni bec, dont il sera encore fait mention ci-après. Le lendemain de mon arrivée, je visitai le sultan, après la prière de trois à quatre heures. Il avait déjà rassemblé les cheikhs, les kadis, les docteurs de la loi, les chérifs, les fakirs, et il avait fait préparer un festin considérable. Nous rompîmes le jeûne en sa présence. Le noble seigneur, chef des descendants de Mahomet, ibn 'Abd Elhamîd, ainsi que le kadi Hamzah, parlèrent tous deux de moi, en termes favorables, et conseillèrent au sultan de me traiter honorablement. Ces Turcs ne suivent pas l'usage de loger les voyageurs et de leur assigner une somme pour leur entretien. Ils se contentent de leur envoyer des brebis et des chevaux destinés à être égorgés, et des outres de kimizz ou lait de jument. C'est là leur manière de montrer de la générosité. Quelques jours plus tard, je fis la prière de l'après-midi avec le sultan, et lorsque je voulus m'en retourner, il m'ordonna de m’asseoir. On apporta des aliments liquides, comme on en apprête avec la graine, appelée doûghy; puis on servit de la viande bouillie, tant de mouton que de cheval. Dans la même nuit, je présentai au sultan un plateau de sucreries. Il y porta le doigt, qu'il mit ensuite dans sa bouche; mais il s'en tint là.
Chacune d'elles monte dans un chariot, et la tente dans laquelle la princesse se tient sur ce véhicule a un dôme d'argent doré, ou de bois incrusté d'or. Les chevaux qui traînent l'arabah sont couverts de housses de soie dorée. Le conducteur qui monte un des chevaux est un jeune homme qui est appelé alkachy. La khatoun est assise dans son chariot, ayant à sa droite une espèce de duègne, que l'on nomme oûloû (ou grande) khatoun, c'est-à-dire « la conseillère », et à sa gauche, une autre duègne, nommée cutchuc (ou petite) khatoun, c'est-à-dire « la camériste ». Elle a devant elle six petites esclaves, appelées filles, d'une beauté exquise et parfaite, et enfin derrière elle, deux autres, toutes pareilles, sur qui elle s'appuie. Sur la tête de la khatoun se trouve un boghthâk, qui est une espèce de petite tiare, ornée de joyaux, et terminée à sa partie supérieure par des plumes de paon. La princesse est couverte d'étoffes de soie, incrustées de pierreries, et semblables au menoût (melloûthah ? du grec μαλλωτή, dont les Coptes ont fait μελωτή), que revêtent les Grecs. Sur la tête de la conseillère et de la camériste est un voile de soie, dont les bords sont brodés d'or et de perles. Chacune des filles porte sur la tête un bonnet qui ressemble à l'âkroûf (Cf. plus haut), et à la partie supérieure duquel est un cercle d'or, incrusté de joyaux, et surmonté de plumes de paon. Chacune est vêtue d'une étoffe de soie dorée, qui s'appelle annekh. Il y a devant la khatoun dix ou quinze eunuques grecs et indiens, revêtus d'étoffes de soie dorée, incrustées de pierreries, et portant chacun à la main une massue d'or ou d'argent, ou bien de bois recouvert d'un de ces métaux. Derrière le char de la khatoun en viennent environ cent autres, dans chacun desquels sont trois ou quatre esclaves, grandes et petites, vêtues de soie et coiffées de bonnets. Derrière ces chariots marchent environ trois cents autres, que traînent des chameaux et des bœufs, et qui portent les trésors de la khatoun, ses richesses, ses vêtements, son mobilier et ses provisions de bouche. Chaque 'arabah a son esclave, chargé d'en prendre soin, et marié à une des jeunes femmes mentionnées ci-dessus. La coutume des Turcs est que celui-là seul des jeunes esclaves mâles qui a une épouse parmi les jeunes esclaves de l'autre sexe, puisse s'introduire au milieu d'elles. Chaque princesse suit l'ordre que nous venons d'exposer, et nous allons maintenant les mentionner toutes séparément
Celle-ci est la reine, mère des deux fils du sultan, Djâni bec et Tina bec, dont nous parlerons ci-après. Mais elle n'est pas la mère de la fille du sultan, Ît Cudjudjuc; la mère de cette princesse est la reine qui a précédé celle d'à présent. Le nom de cette khatoun est Thaïthoghly; elle est la plus favorisée des femmes de ce sultan, et c'est près d'elle qu'il passe la plupart des puits. Le peuple la respecte, a cause de la considération que lui témoigne le souverain, et bien qu'elle soit la plus avare des khatoun, Quelqu'un en qui j'ai confiance, et qui connaît bien les aventures de cette reine, m'a conté que le sultan la chérit à cause d'une qualité particulière qu'elle possède. Celle-ci consiste en ce que le sultan la trouve chaque nuit semblable à une vierge. Un autre individu m'a raconté que cette princesse descendait de la femme qui, à ce qu'on prétend, fut cause que Salomon perdit le pouvoir pour un temps. Lorsqu'il l'eut recouvré, il ordonna de la conduire dans une plaine sans habitations; en conséquence, elle fut menée dans le désert de Kifdjak. (C'est ici une des mille fables sur l'anneau fameux de Salomon. Une femme le lui avait soustrait, puis il l'aurait retrouvé, etc.) Ce même individu assure que la matrice de la khatoun ressemble, par sa forme, à un anneau, et qu'il en est ainsi chez toutes les femmes qui descendent de celle en question. Je n'ai rencontré, dans le Kifdjak ni ailleurs, personne qui m'ait certifié avoir va une femme ainsi conformée, ou qui en ail même entendu parler, si l'on excepte le cas de cette khatoun. Seulement un habitant de la Chine m'a informé que, dans ce pays, il y a une espèce de femmes qui ont cette même conformation. Une pareille femme n'est pas tombée entre mes mains; je ne connais donc pas la vérité du fait.
Le lendemain de mon entrevue avec le sultan, je visitai cette khatoun. Je la trouvai assise au milieu de dix femmes âgées, qui paraissaient comme ses servantes. Devant elle, il y avait environ cinquante de ces petites esclaves nommées par les Turcs les filles; devant celles-ci se trouvaient des plats creux d'or et d'argent, remplis de cerises, qu'elles étaient occupées à nettoyer. Devant la khatoun, il y avait un plat d'or plein des mêmes fruits, qu'elle mondait aussi. Nous la saluâmes. Il y avait parmi mes compagnons un lecteur du Coran, qui lisait ce livre à la manière des Égyptiens, avec une méthode excellente et une voix agréable. Il fit une lecture, après laquelle la reine ordonna qu'on apportât du lait de jument. On en apporta dans des coupes de bois élégantes et légères. Elle en prit une de sa propre main et me l'avança. C'est la plus grande marque de considération chez les Turcs. Je n'avais pas bu de kimizz auparavant; mais je ne pus me dispenser d'en accepter. Je le goûtai, je n'y trouvai aucun agrément, et le passai à un de mes compagnons. La khatoun m'interrogea touchant beaucoup de circonstances de notre voyage, et nous répondîmes à ses questions; après quoi nous nous en retournâmes. Nous commençâmes nos visites par cette princesse, à cause de la considération dont elle jouit auprès du roi.
Son nom est Kebec khatoun; et le mot kebec, en turc, veut dire « le son (de la farine) ». Elle est fille de l'émir Naghathaï, qui est encore en vie; mais il souffre de la goutte, et je l'ai vu. Le lendemain de notre visite à la reine, nous visitâmes cette seconde khatoun, et nous la trouvâmes assise sur un coussin, occupée à lire le noble Coran. Devant elle se tenaient environ dix femmes âgées, et environ vingt filles qui brodaient des étoffes. Nous la saluâmes; elle répondit très bien à notre salut, et nous parla avec bonté. Notre lecteur fit une lecture dans le Coran ; elle lui accorda des éloges, et ordonna d'apporter du kimizz. On en servit, et elle m'avança elle même la coupe, comme l'avait fait la reine ; après quoi nous nous en retournâmes.
Elle se nomme Beïaloûn, et elle est fille du roi de Constantinople
la Grande, le sultan Tacfoûr (du mot arménien tagavor, qui
signifie roi. Il est ici question de l'empereur Andronic III le
Jeune). Nous la visitâmes, et la trouvâmes assise sur un trône
incrusté d'or et de pierreries, et dont les pieds étaient d'argent.
Devant elle environ cent jeunes filles ![]() grecques, turques,
nubiennes, se tenaient debout ou assises. Des eunuques étaient
placés auprès de cette princesse, et il y avait devant elle des
chambellans grecs. Elle s'informa de notre état, de notre arrivée,
de l'éloignement de notre demeure; elle pleura de tendresse et de
compassion, et s'essuya le visage avec un mouchoir qu'elle tenait
entre ses mains. Elle ordonna d'apporter des aliments, ce qui fut
fait; et nous mangeâmes en sa présence, pendant qu'elle nous
regardait. Lorsque nous voulûmes nous en retourner, elle nous dit :
« Ne vous séparez pas de nous pour toujours, revenez nous voir, et
informez-nous de vos besoins. » Elle montra des qualités généreuses,
et nous envoya, aussitôt après notre sortie, des aliments, beaucoup
de pain, du beurre, des mouton », de l'argent, un vêtement
magnifique, et treize chevaux, dont trois excellents. Ce fut en
compagnie de cette khatoun que je fis mon voyage à Constantinople la
Grande, ainsi que nous le raconterons ci-dessous.
grecques, turques,
nubiennes, se tenaient debout ou assises. Des eunuques étaient
placés auprès de cette princesse, et il y avait devant elle des
chambellans grecs. Elle s'informa de notre état, de notre arrivée,
de l'éloignement de notre demeure; elle pleura de tendresse et de
compassion, et s'essuya le visage avec un mouchoir qu'elle tenait
entre ses mains. Elle ordonna d'apporter des aliments, ce qui fut
fait; et nous mangeâmes en sa présence, pendant qu'elle nous
regardait. Lorsque nous voulûmes nous en retourner, elle nous dit :
« Ne vous séparez pas de nous pour toujours, revenez nous voir, et
informez-nous de vos besoins. » Elle montra des qualités généreuses,
et nous envoya, aussitôt après notre sortie, des aliments, beaucoup
de pain, du beurre, des mouton », de l'argent, un vêtement
magnifique, et treize chevaux, dont trois excellents. Ce fut en
compagnie de cette khatoun que je fis mon voyage à Constantinople la
Grande, ainsi que nous le raconterons ci-dessous.
Son nom est Ourdoudjâ ; ourdou, dans la langue des Turcs, signifie « le camp », et cette princesse fut ainsi nommée, parce qu'elle naquit dans un camp. Elle est fille du grand émir 'Iça bec, émir aloloûs, et le sens de ce dernier mot est « émir des émirs ». J'ai vu ce personnage, qui était encore en vie, et marié à la fille du sultan, Ît-Cudjudjuc. Cette quatrième khatoun est au nombre des princesses les meilleures, les plus généreuses de caractère, et les plus compatissantes. C'est celle qui m'envoya un message, lorsqu'elle vit ma tente sur la colline, lors du passage du camp, comme nous l'avons raconté ci-dessus. Nous la visitâmes, et nous reçûmes, de la bonté de son caractère et de la générosité de son âme, un traitement qui ne pourrait être surpassé. Elle commanda d'apporter des mets, et nous mangeâmes devant elle; puis elle demanda du kimizz, et mes compagnons en burent La khatoun nous interrogea touchant notre état, et nous satisfîmes à ses questions. Nous rendîmes aussi visite à sa sœur, femme de l'émir 'Aly, fils d'Arzak (ou Arzen).
Elle se nomme Ît-Cudjudjuc, c'est-à-dire « la caniche »; car ît signifie « chien », et cudjudjuc (cutchuc), « petit ». Nous avons déjà dit (Cf. ci-dessus) que les Turcs, ou Mongols, reçoivent les noms que le sort a désignés, ainsi que font les Arabes. Nous nous rendîmes près de cette khatoun, fille du roi, laquelle se trouvait dans un camp séparé, à environ six milles de celui de son père. Elle ordonna demander les docteurs de la loi, les kadis, le seigneur chérif Ibn 'Abd elhamîd, le corps des étudiants, les cheikhs et les fakirs. Son mari, l'émir 'Iça, dont la fille est l'épouse du sultan, assistait à cette réunion. Il s'assit avec la princesse sur un même tapis; il souffrait de la goutte, et ne pouvait marcher, ni monter achevai, et il montait seulement dans un chariot. Lorsqu'il voulait visiter le sultan, ses serviteurs le descendaient de voiture, et l'introduisaient dans la salle d'audience en le portant. C'est dans le même état que je vis l'émir Naghathaï, père de la seconde khatoun : car la maladie de la goutte est fort répandue parmi ces Turcs. Nous vîmes chez cette khatoun, fille du sultan, en fait d'actions généreuses et de bonnes qualités, ce que nous n'avions vu chez aucune autre. Elle nous fit des présents magnifiques, et nous combla de bienfaits. Que Dieu l'en récompense!
Ils sont nés de la même mère, qui est la reine Thaïthoghly, dont nous avons parlé ci-dessus. L'aîné s'appelle Tîna bec, bec a le sens d'émir, et tîn (ten) celui de corps; c'est donc comme s'il se nommait « émir du corps ». Le nom de son frère est Djâni bec. Djân signifie l'âme; c'est comme s'il s'appelait « émir de l'âme ». Chacun de ces deux princes a son camp séparé. Tîna bec était au nombre des hommes les plus beaux, et son père l'avait déclaré son successeur. Il jouissait près d'Uzbek d'une grande considération et d'un rang distingué. Mais Dieu ne voulut pas qu'il possédât le royaume paternel. Lorsque son père fut mort, il régna fort peu de temps, puis il fut tué, à cause d'affaires honteuses qui lui survinrent. Son frère Djàni bec lui succéda ; il était meilleur et plus vertueux que son aîné. Le seigneur chérif Ibn 'Abd alhamid avait pris soin de l'éducation de Djâni bec.
Ledit chérif, le kadi Hamzah, l'imâm Bedr eddîn Alkiwâmy, l'imâm et professeur de lecture coranique, Hoçâm eddîn Albokhâry, et d'autres personnes, me conseillèrent, lorsque j'arrivai, de me loger dans le camp de Djâni bec, à cause de son mérite; et j'agis de la sorte.
J’avais entendu parler de la ville de Bolghâr. Je voulus m'y rendre, afin de vérifier par mes yeux ce qu'on en racontait, savoir l'extrême brièveté de la nuit dans cette ville, et la brièveté du jour dans la saison opposée. Il y avait entre Bolghâr et le camp du sultan' une distance de dix jours de marche. Je demandai à ce prince quelqu'un pour m'y conduire, et il envoya avec moi un homme qui me mena à Bolghâr et me ramena près du sultan. J'arrivai dans cette ville pendant le mois de ramadhan. Lorsque nous eûmes fait la prière du coucher du soleil, nous rompîmes le jeûne; on appela les fidèles à la prière du soir, tandis que nous faisions, notre repas. Nous célébrâmes cette prière, ainsi, que les prières terâwih, chef, witr, et le crépuscule du matin parut aussitôt après. (Cf. sur ces diverses prières, le t. I.) Le jour est aussi court à Bolghâr, dans la saison des jours courts, c'est-à-dire l'hiver. Je passai trois journées dans cette ville.
J'avais désiré entrer dans la terre des Ténèbres ; on y pénètre en passant par Bolghâr, et il y a entre ces deux points une distance de quarante jours; mais ensuite je renonçai à mon projet, à cause de la grande difficulté que présentait le voyage, et du peu de profit qu'il promettait. On ne voyage pas vers cette contrée, sinon avec de petits chariots (traîneaux), tirés par de gros chiens; car, ce désert étant couvert de glace, les pieds des hommes et les sabots des bêtes de charge y glissent. Mais les chiens ont des ongles, et leurs pattes ne glissent pas sur la glace. Il n'entre dans ce désert que de riches marchands, dont chacun a cent chariots ou environ, chargés de provisions de bouche, de boissons et de bois à brûler. Il ne s'y trouve, en effet, ni arbres, ni pierres, ni habitations. Le guide des voyageurs dans cette contrée, c'est le chien qui l'a déjà traversée nombre de fois. Le prix d'un tel animal monte jusqu'à mille dinars ou environ. Le chariot est attaché à son cou, trois autres chiens sont attelés avec celui-là; il est le chef, et tous les autres chiens le suivent avec les 'arabah. Lorsqu'il s'arrête, ils s'arrêtent aussi. Le maître de cet animal ne le maltraite pas et ne le gronde point. Quand on sert des aliments, il fait d'abord manger les chiens, avant les hommes. Si le contraire a lieu, le chef des animaux est mécontent; il s'enfuit et abandonne son maître à sa perte. Lorsque les voyageurs ont marché quarante jours dans ce désert, ils campent près du pays des Ténèbres. Chacun d'eux laisse en cet endroit les marchandises qu'il a apportées, puis ils vont tous à leur station accoutumée. Le lendemain, ils reviennent examiner leurs marchandises. Ils trouvent vis-à-vis de celles-ci des peaux de martre-zibeline, de petit-gris et d'hermine. Si le propriétaire des marchandises est satisfait de ce qu'il voit vis-à-vis de sa pacotille, il le prend ; sinon, il le laisse. Les habitants du pays des Ténèbres augmentent les objets qu'ils ont laissés; mais souvent aussi ils enlèvent leurs marchandises, et laissent celles des trafiquants étrangers. C'est ainsi que se fait leur commerce, Les gens qui se dirigent vers cet endroit ne connaissent pas si ceux qui leur vendent et leur achètent sont des génies ou des hommes, et ils ne voient jamais personne.
L'hermine est la plus belle espèce de fourrure. Une pelisse de cette dernière vaut, dans l'Inde, mille dinars, dont le change en or du Maghreb équivaut à deux cent cinquante dinars. Elle est d'une extrême blancheur, et provient de la peau d'un petit animal de la longueur d'un empan. La queue de celui-ci est longue, et on la laisse dans la fourrure, dans son état naturel.
La zibeline est inférieure en prix à l'hermine : une pelisse de cette fourrure vaut quatre cents dinars et au-dessous. Une des propriétés de ces peaux, c'est que la vermine ne s'y met pas t aussi les princes et les grands de la Chine eh placent une attachée à leur pelisse, autour du cou. Les marchands de la Perse et des deux Irâks en usent de même.
Je revins de la ville de Bolghâr avec l'émir que le sultan avait envoyé en ma compagnie. Je retrouvai le camp de ce souverain dans l'endroit appelé Bichdagh, le 28 de ramadhan; j'assistai avec le prince à la prière de la rupture du jeûne. Le jour de cette solennité se trouva être un vendredi.
Le matin de cette fête, le sultan monta à cheval, accompagné de ses nombreux soldats. Chaque khatoun prit place dans son chariot, suivie de ses troupes particulières. La fille du sultan monta aussi dans un chariot, la couronne en tête, parce qu'elle était la vraie reine, ayant hérité de sa mère de la dignité royale. Les fils du sultan montèrent à cheval, chacun avec son armée. Le kadi des kadis Schihâb eddîn Assâïly était arrivé, pour assister à la fête, accompagné d'une troupe de jurisconsultes et de cheikhs. Ils montèrent à cheval, ainsi que le kadi Hamzah, l'imâm Bedr eddîn alkiwâmy, et le chérif Ibn 'Abd alhamîd, en compagnie de Tîna bec, héritier présomptif du sultan. Ils avaient avec eux des timbales et des étendards. Le kadi Schihâb eddîn pria avec eux, et prononça un magnifique sermon.
Cependant le sultan monta à cheval et arriva à une tour de bois, nommée chez ce peuple alcochc (pavillon, kiosque); il y prit place accompagné de ses khitoûn. Une seconde tour avait été élevée à côté, et l'héritier présomptif du sultan, ainsi que sa fille, la maîtresse du tâdj, ou couronne, s'y assirent. Deux autres tours furent construites auprès de celles-là, à droite et à gauche de la première, où se placèrent les fils du sultan et ses proches. Des sièges, appelés sandaly, furent dressés, pour les émirs et les fils de rois, à droite et à gauche de la tour du souverain, et chacun s'assit sur son siège. Ensuite on dressa des disques ou cibles, pour lancer des flèches, et chaque émir de thoûmân avait sa cible particulière. L'émir de thoûmân, chez ces peuples, est celui qui a sous ses ordres dix mille cavaliers. Les émirs de cette espèce, présents en cet endroit, étaient au nombre de dix-sept, conduisant ensemble cent soixante et dix mille hommes, et l'armée d'Uzbek dépasse ce chiffre. On éleva pour chaque émir une sorte de tribune, sur laquelle il s'assit pendant que ses soldats tiraient de l'arc devant lui. Ils s'occupèrent ainsi durant une heure. On apporta ensuite des robes d'honneur, et un de ces vêtements fut donné à chaque émir. Après l'avoir revêtu, il s'avançait sous la tour du sultan, et lui rendait hommage. Cette cérémonie consiste à toucher la terre avec le genou droit, et à étendre le pied sous ce genou, pendant que l'autre jambe reste perpendiculaire. Après cela on amène un cheval sellé et bridé; on lui soulève le sabot et l'émir le baise; puis il le conduit lui-même à son siège, et là il le monte et se tient en place avec son corps d'armée. Chaque émir de thoûmân accomplit le même acte.
Alors le sultan descend de la tour et monte à cheval, ayant à sa droite son fils et successeur désigné, et à côté de celui-ci, sa fille, la reine Ît-Cudjudjuc; à sa gauche il a son second fils, et devant lui les quatre khatoun, dans des chariots recouverts d'étoffes de soie dorée. Les chevaux qui traînent ces voitures portent des housses, également de soie dorée. Tous.les émirs, grands et petits, les fils de rois, les vizirs, les chambellans, les grands de l'empire, mettent pied à terre, et marchent ainsi devant le sultan jusqu'à ce qu'il arrive au withâk, qui est une grande tente, afrâdj. (Cf. ci-dessus.) On a dressé en cet endroit une vaste bârghâh, ou salle d'audience. La bârghâh, chez les Turcs, est une grande tente, soutenue par quatre piliers de bois, recouverts de feuilles d'argent doré. Au sommet de chaque pilier, il y a un chapiteau d'argent doré, qui brille et resplendit, et cette bârghâh apparaît de loin comme une colline. On place à sa droite et à sa gauche des tendelets de toile de coton et de lin, et partout le sol est recouvert de tapis de soie ; le grand trône est dressé au milieu, et les Turcs l'appellent attakht. Il est en bois incrusté de pierreries, et ses planches sont revêtues de feuilles d'argent doré; ses pieds sont en argent massif doré, et il est recouvert d'un vaste tapis. Au milieu de ce grand trône est un coussin, sur lequel s'assirent le sultan et la grande khatoun ; à la droite, un autre, sur lequel s'assirent sa fille Ît-Cudjudjuc et la khatoun Ordodja; à sa gauche, un troisième, où prirent place la khatoun Beïaloûn et la khatoun Kebec On avait dressé, à la droite du trône, un siège sur lequel s'assit Tîna bec, fils du sultan, et à la gauche, un autre, destiné au second fils de ce souverain, Djâni bec. Plusieurs sièges avaient été placés à droite et à gauche, sur lesquels s'assirent les fils de rois et les grands émirs, puis les petits émirs, comme ceux de hézâreh, lesquels commandent à mille hommes. On servit ensuite des mets sur des tables d'or et d'argent, dont chacune était portée par quatre hommes ou davantage.
Les mets des Turcs consistent en chair de cheval ou de mouton bouillie. Une table est placée devant chaque émir. Le bâwerdjy, c'est-à-dire l'écuyer tranchant, arrive, vêtu d'habits de soie, par-dessus lesquels est attachée une serviette de la même étoffe. Il porte à sa ceinture plusieurs couteaux dans leurs gaines. Chaque émir a un bâwerdjy, et lorsque la table a été dressée, cet officier s'assied devant son maître. On apporte une petite écuelle d'or ou d'argent, renfermant du sel dissous dans de l'eau. Le bâwerdjy coupe la viande en petits morceaux. Ces gens-là possèdent une grande habileté pour dépecer la viande, de façon qu'elle se trouve mélangée d'os; car les Turcs ne mangent que de celle-là.
On apporte ensuite des vases à boire, d'or et d'argent. La principale boisson des Turcs, c'est un vin préparé avec le miel (ou hydromel vineux) ; car ils sont de la secte hanéfite et regardent comme permis l'usage d’un tel vin. Lorsque le sultan veut boire, sa fille prend la coupe dans sa main; elle fait une salutation en fléchissant le genou devant son père, puis elle lui présente la coupe. Lorsque le sultan a bu, elle prend une autre coupe, la donne à la grande khatoun, qui y boit; puis elle la présente aux autres khatoun, selon leur rang. Après, cela l'héritier présomptif saisit la coupe, fait une salutation respectueuse devant son père, lui donne à boire, ainsi qu'aux khatoun et à sa sœur, en les saluant toutes. Ceci fait, le second fils du sultan se lève, prend la coupe, donne à boire à son frère et le salue. Ensuite les principaux émirs se lèvent, chacun d'eux offre à boire à l'héritier présomptif, et le salue. Les fils de rois se lèvent à leur tour, servent à boire au second fils du sultan et le saluent. Enfin, les émirs d'un rang inférieur se lèvent, et servent à boire aux fils de rois. Pendant ce temps-là, ils chantent des mawâliyah (sorte de chansons courtes ou couplets).
On avait dressé une grande tente vis-à-vis de la mosquée, pour le kadi, le prédicateur, le chérif, tous les jurisconsultes et les cheikhs. Je me trouvais avec eux. On nous apporta des tables d'or et d'argent, portées chacune par quatre des principaux Turcs; car les grands seuls vont et viennent, en ce jour, devant le sultan; et il leur ordonne de porter à qui il veut les tables qu'il désigne. Parmi les docteurs de la loi il y en eut qui mangèrent, et d'autres qui s'abstinrent de prendre leur repas sur ces tables d'argent et d'or. Aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, à droite et à gauche, je vis des chariots chargés d'outres, pleines de lait de jument aigri. Le sultan ordonna de les distribuer aux assistants, et l'on m'amena une voiture chargée de ce breuvage. Je le donnai aux Turcs mes voisins.
Nous nous rendîmes ensuite à la mosquée, afin d'y attendre le moment de la prière du vendredi. Le sultan ayant tardé d'arriver, il y eut des personnes qui dirent qu'il ne viendrait pas, parce que l'ivresse s'était emparée de lui; d'autres, disaient qu'il ne négligerait pas la prière du vendredi. Après une longue attente, le sultan arriva en se balançant à droite et à gauche. Il salua le seigneur chérif et lui sourit; il l'appelait du nom d'âthâ, qui signifie « père » en langue turque. Nous fîmes la prière du vendredi, et les assistants regagnèrent leurs demeures. Le sultan retourna dans la salle d'audience, et y resta ainsi jusqu'à la prière de l'après-midi. Alors tous les Turcs s'en allèrent; les épouses et la fille du roi passèrent cette nuit-là auprès de lui.
Lorsque la fête fut terminée, nous partîmes avec le sultan et le camp, et nous arrivâmes à la ville de Hadj Terkhân (Astracan). Le mot terkhân, chez les Turcs, désigne un lieu exempté, de toute imposition.[36] Le personnage qui a donné son nom à cette ville était un dévot pèlerin (hâddj) turc, qui s'établit sur l'emplacement qu'elle occupe. Le sultan exempta cet endroit de toute charge, à la considération de cet homme. Le lieu devint une bourgade ; celle-ci s'accrut et devint une ville. Elle est au nombre des plus belles cités; elle a des marchés considérables, et est bâtie sur le fleuve Itil (Volga), un des plus grands fleuves de l'univers. Le sultan séjourne en cet endroit jusqu'à ce que le froid devienne violent, et que le fleuve gèle, ainsi que les rivières qui s'y réunissent. Alors le sultan donne ses ordres aux habitants de ce pays, lesquels apportent des milliers de charges de paille, et la répandent sur la glace qui recouvre le fleuve. Les bêtes de somme de cette contrée ne mangent pas de paille, parce qu'elle leur fait du mal; il en est de même dans l'Inde. La nourriture de ces animaux consiste seulement en herbe verte, à cause de la fertilité du pays. On voyage dans des traîneaux sur ce fleuve et les canaux, ses affluents, l'espace de trois journées de marche. Souvent les caravanes le traversent, quoique l'hiver approche de son terme; mais elles sont parfois submergées et périssent.
Lorsque nous fûmes arrivés à la ville de Hadj Terkhân, la khatoun
Beïaloûn, fille du roi des Grecs, demanda au sul![]() tan la permission de visiter
son père, afin de faire ses couches près de lui, et de revenir
ensuite. Il lui accorda cette autorisation. Je le priai qu'il me
permit de partir en compagnie de la princesse, afin de voir
Constantinople la Grande. Il me le défendit d'abord, par crainte
pour ma sûreté; mais je le sollicitai et lui dis : « Je n'entrerai à
Constantinople que sous ta protection et ton patronage, et je ne
craindrai personne. » Il me donna la permission de partir, et nous
lui fîmes nos adieux. Il me fit présent de quinze cents ducats,
d'une robe d'honneur et d'un grand nombre de chevaux. Chaque khatoun
me donna des lingots d'argent, que ces peuples appellent saoum,
pluriel de saoumah. La fille du sultan me fit un cadeau plus
considérable que les leurs, et elle me fournit des habits et une
monture. Je me trouvai possesseur d'un grand nombre de chevaux, de
vêtements et de pelisses de petit-gris et de zibeline.
tan la permission de visiter
son père, afin de faire ses couches près de lui, et de revenir
ensuite. Il lui accorda cette autorisation. Je le priai qu'il me
permit de partir en compagnie de la princesse, afin de voir
Constantinople la Grande. Il me le défendit d'abord, par crainte
pour ma sûreté; mais je le sollicitai et lui dis : « Je n'entrerai à
Constantinople que sous ta protection et ton patronage, et je ne
craindrai personne. » Il me donna la permission de partir, et nous
lui fîmes nos adieux. Il me fit présent de quinze cents ducats,
d'une robe d'honneur et d'un grand nombre de chevaux. Chaque khatoun
me donna des lingots d'argent, que ces peuples appellent saoum,
pluriel de saoumah. La fille du sultan me fit un cadeau plus
considérable que les leurs, et elle me fournit des habits et une
monture. Je me trouvai possesseur d'un grand nombre de chevaux, de
vêtements et de pelisses de petit-gris et de zibeline.
Nous nous mîmes en route le 10 de chawwâl en compagnie de la khatoun Beïaloûn et sous sa protection. Le sultan l'accompagna l'espace d'une journée de marche ; puis il retourna sur ses pas, avec la reine et le successeur désigné. Les autres khatoun marchèrent encore une journée en société de la princesse, après quoi elles s'en retournèrent. L'émir Beïdarah escortait Beïaloûn, avec cinq mille de ses soldats. La troupe de la khatoun s'élevait à environ cinq cents cavaliers, parmi lesquels ses serviteurs étaient au nombre d'à peu près deux cents, tant mamlouks (c'est-à-dire esclaves achetés à prix d'argent), que Grecs; le reste se composait de Turcs. Elle était accompagnée d'environ deux cents jeunes filles esclaves, la plupart grecques. Elle avait près de quatre cents chariots et deux mille chevaux, tant pour le trait que pour la selle; environ trois cents bœufs et deux cents chameaux, aussi pour traîner les 'arabah. La princesse avait encore avec elle dix pages grecs, et autant d'Indiens; leur chef à tous s'appelait Sunbul l'Indien; quant au chef des Grecs, il se nommait Mikhâil (Michel), et les Turcs l'appelaient Loûloû (perle). Il était au nombre des plus braves guerriers. La princesse avait laissé la plupart de ses femmes esclaves et de ses bagages dans le camp du sultan, parce qu'elle n'était partie que pour visiter son père et faire ses couches.
Cependant nous marchions vers la ville d'Ocac, qui est une place d'une importance moyenne, bien construite, riche en biens, mais d'une température très froide. Entre elle et Sera, capitale du sultan, il y a dix jours de marche. A un jour de distance d'Ocac se trouvent les montagnes des Russes, qui sont chrétiens; ils ont des cheveux roux, des yeux bleus, ils sont laids de visage et rusés de caractère. Ils possèdent des mines d'argent, et on apporte de leur pays des saoum, c'est-à-dire des lingots d'argent, avec lesquels on vend et l'on achète dans cette contrée. Le poids de chaque lingot est de cinq onces.
Dix jours après être partis de cette cité, nous arrivâmes à Sordak (Soudak). C'est une des villes de la vaste plaine du Kifdjak; elle est située sur le rivage de la mer, et son port est au nombre des plus grands porte et des plus beaux. Il y a en dehors de la ville des jardins et des rivières. Des Turcs l'habitent, avec une troupe de Grecs qui vivent sous leur protection, et sont des artisans; la plupart des maisons sont construites en bois. Cette cité était autrefois fort grande; mais la majeure partie en fut ruinée, à cause d'une guerre civile qui s'éleva entre les Grecs et les Turcs. La victoire resta d'abord aux premiers; mais les Turcs reçurent du secours de leurs compatriotes, qui massacrèrent sans pitié les Grecs, et expulsèrent la plupart des survivants. Quelques autres sont restés dans la ville jusqu'à présent, sous le patronage des Turcs.
Dans chaque station de ce pays on apportait à la khatoun des provisions, consistant en chevaux, brebis, bœufs, doûghy (sorte de millet), lait de jument, de vache et de brebis. On voyage dans cette contrée matin et soir. Chacun des émirs de ces lieux accompagnait la khatoun, avec son corps d'armée, jusqu'à l'extrême limite de son gouvernement, par considération pour elle, et non point par crainte pour sa sûreté, car le pays est tranquille.
Nous arrivâmes à la ville nommée Baba Salthoûk. Baba a, chez les Turcs, la même signification que chez les Berbères (c'est-à-dire, celle de père) ; seulement ils font sentir plus fortement le bâ (b). On dit que ce Salthoûk était un contemplatif ou un devin, mais on rapporte de lui des choses que réprouve la loi religieuse. La ville de Baba Salthoûk est la dernière appartenant aux Turcs; entre celle-ci et le commencement de l'empire des Grecs, il y a dix-huit jours de marche dans un désert, entièrement dépourvu d'habitants. Sur ces dix-huit jours, on en passe huit sans trouver d'eau. En conséquence, on en fait provision pour ce temps, et on la porte sur des chariots, dans des outres tant petites que grandes. Nous entrâmes dans ce désert pendant les froids; nous n'eûmes donc pas besoin de beaucoup d'eau. Les Turcs transportaient du lait dans de grandes outres, le mêlaient avec le doûghy cuit, et le buvaient; cela les désaltérait pleinement.
Nous fîmes nos préparatifs à Baba Salthoûk, pour traverser le désert. Ayant eu besoin d'un surcroît de chevaux, je me rendis près de la khatoun et l'informai de cette circonstance. Or j'avais l'habitude d'aller la saluer matin et soir; et toutes les fois qu'on lui apportait des provisions, elle m'envoyait deux ou trois chevaux et des moutons; je m'abstenais d'égorger les chevaux. Les esclaves et les serviteurs qui étaient avec moi mangeaient en compagnie des Turcs, nos camarades. De cette manière je réunis environ cinquante chevaux. La khatoun m'en assigna quinze autres, et ordonna à son chargé d'affaires, Sâroûdjah le Grec, d'en choisir de gras, parmi les chevaux destinés à être mangés. Elle me dit: « Ne crains rien; si tu as besoin d'un plus grand nombre, nous t'augmenterons ». Nous entrâmes dans le désert, an milieu du mois de dhou’lka’deh. Nous avions marché dix-neuf jours, depuis celui où nous avions quitté le sultan, jusqu'à l'entrée du désert, et nous nous étions reposés pendant cinq jours. Nous marchâmes dans ce désert durant dix-huit jours, matin et soir. Nous n'éprouvâmes rien que d'avantageux; grâces en soient rendues à Dieu! Au bout de ce temps, nous arrivâmes à la forteresse de Mahtoûly, où commence l'empire grec.
Or les Grecs avaient appris la venue de la princesse dans son pays. Cafâly (pour Κεφαλή, chef) Nicolas, le Grec, arriva près d'elle dans cette forteresse, avec une armée considérable et d'amples provisions. Des princesses et des nourrices arrivèrent aussi du palais de son père, le roi de Constantinople. Entre cette capitale et Mahtoûly, il y a une distance de vingt-deux jours de marche, dont seize jusqu'au canal et six depuis cet endroit jusqu'à Constantinople. À partir de Mahtoûly, l'on ne voyage plus qu'avec des chevaux et des mulets, et l'on y laisse les chariots, à cause des lieux âpres et des montagnes qui restent à franchir. Le susdit Cafâly amena un grand nombre de mulets, et la princesse m'en envoya six. Elle recommanda au gouverneur de la forteresse ceux de mes compagnons et de mes esclaves que j'y laissai avec les chariots et les bagages; et cet officier leur assigna une maison.
L'émir Beïdarah s'en retourna avec ses troupes, et la princesse n'eut plus pour compagnons de voyage que ses propres gens. Elle abandonna sa chapelle dans cette forteresse, et la coutume d'appeler les hommes à la prière fut abolie. On apportait à la princesse, parmi les provisions, des liqueurs enivrantes dont elle buvait; on lui offrait aussi des porcs, et un de ses familiers m'a raconté qu'elle en mangeait. Il ne resta près d'elle personne qui fît la prière, excepté un Turc, qui priait avec nous. Les sentiments cachés se modifièrent, à cause de notre entrée dans le pays des infidèles; mais la princesse prescrivit à l'émir Cafâly de me traiter avec honneur; aussi, dans une circonstance, cet officier frappa un de ses esclaves, parce qu'il s'était moqué de notre prière.
Cependant nous arrivâmes à la forteresse de Maslamah, fils d'Abd Almélic. Elle est située au bas d'une montagne, sur un fleuve très considérable, que l'on appelle Asthafily ; il n'en reste que des vestiges ; mais hors de son enceinte, il y a un grand village. Nous marchâmes ensuite pendant deux jours, et nous arrivâmes au canal, sur le rivage duquel s'élève une bourgade considérable. Nous vîmes que c'était le moment du flux, et nous attendîmes jusqu'à ce que vînt l'instant du reflux; alors nous passâmes à gué le canal, dont la largeur est d'environ deux milles ; puis nous marchâmes l'espace de quatre milles dans des sables, et parvînmes au second canal, que nous traversâmes aussi à gué; sa largeur est d'environ trois milles. Nous fîmes ensuite deux milles dans un terrain pierreux et sablonneux, et nous atteignîmes le troisième canal, lorsque déjà le flux avait recommencé. Nous éprouvâmes en le passant beaucoup de fatigue; sa largeur est d'un mille; celle du canal tout entier est donc de douze milles, en comptant les parties où il y a de l'eau et celles qui sont à sec. Mais dans les temps de pluie il est entièrement rempli d'eau, et on ne le traverse qu'avec des barques.
Sur le rivage de ce troisième canal s'élève la ville de Fenîcah, qui est petite, mais belle et très forte; ses églises et ses maisons sont jolies; des rivières la traversent et des vergers l'entourent. On y conserve, d'une année à l'autre, des raisins, des poires, des pommes et des coings. Nous y passâmes trois jours, la princesse occupant un palais que son père possède en cet endroit. Au bout de ce temps, son frère utérin, appelé Cafâly Karâs, arriva avec cinq mille cavaliers, armés de toutes pièces. Lorsqu'ils se disposèrent à paraître devant la princesse, le frère de celle-ci monta sur un cheval gris, se vêtit d'habits blancs, et fit porter au-dessus de sa tête un parasol brodé de perles. Il mit à sa droite cinq fils de rois et à sa gauche un pareil nombre, revêtus également d'habits blancs et ombragés sous des parasols brodés d'or. Il plaça devant lui cent fantassins et autant de cavaliers, qui avaient couvert leur corps et celui de leurs chevaux d'amples cottes de mailles; chacun d'eux conduisait un cheval sellé et caparaçonné, qui portait les armes d'un cavalier, savoir : un casque enrichi de pierreries, une cotte de mailles, un carquois, un arc et un sabre ; dans la main il tenait une lance, au sommet de laquelle il y avait un étendard. La plupart de ces lances étaient recouvertes de feuilles d'or et d'argent. Les chevaux de main étaient les montures du 61s du sultan. Ce prince partagea ses cavaliers en plusieurs escadrons, dont chacun comprenait deux cents hommes. Ils avaient un commandant, qui envoya en avant dix cavaliers armés de toutes pièces, et conduisant chacun un cheval. Derrière le chef de corps se trouvaient dix étendards de diverses couleurs, portés par dix cavaliers, et dix timbales que portaient au cou autant de cavaliers, accompagnés de six autres, qui sonnaient du clairon, de la trompette et jouaient de la flûte ou du fifre (sornâï), instrument que l'on appelle aussi ghaïthah.
La princesse monta à cheval, en compagnie de ses esclaves, de ses suivantes, de ses pages et de ses eunuques ; tous ceux-ci étaient au nombre d'environ cinq cents, et vêtus d'étoffes de soie brodées d'or et de pierreries. La princesse était couverte d'un manteau de l'étoffe appelée annakh et aussi annécidj (brocart d'or), lequel était brodé de pierres précieuses. Elle avait sur la tête une couronne incrustée de pierreries, et son cheval était couvert d'une housse de soie brodée d'or; il avait aux quatre pieds des anneaux d'or, et à son cou des colliers enrichis de pierres précieuses; le bois de sa selle était revêtu d'or et orné de pierreries. La rencontre de la princesse et de son frère eut lieu dans une plaine, à environ un mille de la ville; le second mit pied à terre devant sa sœur, car il était plus jeune qu'elle; il baisa son étrier et elle l'embrassa sur la tête. Les émirs et les fils de rois descendirent de cheval et baisèrent tous aussi l'étrier de la princesse, laquelle partit ensuite avec son frère.
Nous arrivâmes le lendemain à une grande ville, située sur le rivage de la mer, et dont je ne me rappelle plus le nom avec certitude. Elle possède des rivières et des arbres, et nous campâmes hors de son enceinte. Le frère de la princesse, héritier désigné du trône, vint avec un cortège magnifique et une armée considérable, savoir dix mille hommes couverts de cottes de mailles. Il portait sur sa tête une couronne, il avait à sa droite environ vingt fils de rois et à sa gauche un pareil nombre. Il avait disposé sa cavalerie absolument dans le même ordre que son frère, sauf que la pompe était plus grande et le rassemblement plus nombreux. Sa sœur le rencontra, vêtue du même costume qu'elle avait la première fois (c'est-à-dire lors de sa rencontre avec son autre frère). Ils mirent pied à terre en même temps, et l'on apporta une tente de soie, dans laquelle ils entrèrent, et j'ignore comment se passa leur entrevue.
Nous campâmes à dix milles de Constantinople, et le lendemain la population de cette ville, hommes, femmes et enfants, en sortit, tant à pied qu'à cheval, dans le costume le plus beau et avec les vêtements les plus magnifiques. Dès l'aurore, on fit retentir les timbales, les clairons et les trompettes; les troupes montèrent à cheval, et le sultan, ainsi que sa femme, mère de la khatoun, les grands de l'empire et les courtisans, sortirent. Sur la tête de l'empereur se voyait un pavillon, que portaient un certain nombre de cavaliers et de fantassins, tenant dans leurs mains de longs bâtons, terminés à la partie supérieure par une espèce de boule de cuir, et avec lesquels ils soutenaient le pavillon. Au centre de celui-ci se trouvait une sorte de dais, supporté à l'aide de bâtons par des cavaliers. Lorsque le sultan se fut avancé, les troupes se mêlèrent et le bruit devint considérable. Je ne pus pénétrer au milieu de cette foule, et je me tins près des bagages de la princesse et de ses compagnons, par crainte pour ma sûreté. On m'a raconté que quand la princesse approcha de ses parents, elle mit pied à terre et baisa le sol devant eux; puis elle baisa les sabots de leurs montures, et ses principaux officiers en firent autant. Notre entrée dans Constantinople la Grande eut lieu vers midi, ou un peu après. Cependant les habitants faisaient retentir les cloches, de sorte que les cieux furent ébranlés par le bruit mélangé de leurs sons.
Lorsque nous parvînmes à la première porte du palais du roi, nous y
trouvâmes environ cent hommes, accompagnés de leur chef, qui se
tenait sur une estrade. Je les entendis qui disaient : « les
sarrasins, les sarrasins », mot ![]() qui désigne chez eux les
musulmans; et ils nous empêchèrent d'entrer. Les compagnons de la
princesse leur dirent : « Ces gens-là sont de notre suite. » Mais
ils répondirent : « Ils n'entreront qu'avec une permission. » Nous
restâmes donc à la porte, et l'un des officiers de la khatoun s'en
alla, et lui envoya quelqu'un pour l'instruire de cet incident. Elle
se trouvait alors près de son père, à qui elle raconta ce qui nous
concernait. L'empereur ordonna de nous laisser entrer, et nous
assigna une maison dans le voisinage de celle de la princesse. De
plus, il écrivit en notre faveur un ordre prescrivant de ne nous
causer aucun empêchement dans quelque partie de la ville que nous
allassions, et cela fut proclamé dans les marchés. Nous restâmes
durant trois jours dans notre demeure, où l'on nous envoyait des
provisions, savoir: de la farine, du pain, des moutons, des poulets,
du beurre, des fruits et du poisson; ainsi que de l'argent et des
tapis. Le quatrième jour nous visitâmes le sultan.
qui désigne chez eux les
musulmans; et ils nous empêchèrent d'entrer. Les compagnons de la
princesse leur dirent : « Ces gens-là sont de notre suite. » Mais
ils répondirent : « Ils n'entreront qu'avec une permission. » Nous
restâmes donc à la porte, et l'un des officiers de la khatoun s'en
alla, et lui envoya quelqu'un pour l'instruire de cet incident. Elle
se trouvait alors près de son père, à qui elle raconta ce qui nous
concernait. L'empereur ordonna de nous laisser entrer, et nous
assigna une maison dans le voisinage de celle de la princesse. De
plus, il écrivit en notre faveur un ordre prescrivant de ne nous
causer aucun empêchement dans quelque partie de la ville que nous
allassions, et cela fut proclamé dans les marchés. Nous restâmes
durant trois jours dans notre demeure, où l'on nous envoyait des
provisions, savoir: de la farine, du pain, des moutons, des poulets,
du beurre, des fruits et du poisson; ainsi que de l'argent et des
tapis. Le quatrième jour nous visitâmes le sultan.
Il se nomme Tacfoûr, fils de l'empereur Djirdjîs (George). Ce dernier est encore en vie, mais il a embrassé la vie religieuse, s'est fait moine, et il se livre uniquement à des actes de dévotion dans les églises; c'est pourquoi il a abandonné le royaume à son fils. Nous parlerons de lui ci-après. Le quatrième jour depuis notre arrivée à Constantinople, la khatoun m'envoya l'eunuque Sunbul, l'Indien, qui me prit par la main et me fit entrer dans le palais. Nous franchîmes quatre portes, près de chacune desquelles se trouvaient des bancs, où se tenaient des hommes armés, dont le chef était placé sur une estrade garnie de tapis. Lorsque nous fûmes arrivés à la cinquième porte, l'eunuque Sunbul me laissa et entra; puis il revint, accompagné de quatre eunuques grecs. Ceux-ci me fouillèrent, de peur que je n'eusse sur moi un couteau. Le chef me dit : « Telle est leur coutume; on ne peut se dispenser d'examiner minutieusement quiconque pénètre près du roi, que ce soit un grand personnage ou un homme du peuple, un étranger ou un régnicole. » C'est aussi l'usage dans l'Inde.
Lorsqu'on m'eut fait subir cet examen, le gardien de la porte se leva, prit ma main et ouvrit la porte. Quatre individus m'entourèrent, dont deux saisirent mes manches, et les deux autres me tenaient par derrière. Ils me firent entrer dans une grande salle d'audience, dont les murs étaient en mosaïque; on y avait représenté des figures de productions naturelles, soit animales, soit minérales. Il y avait au milieu du salon un ruisseau, dont les deux rives étaient bordées d'arbres; des hommes se tenaient debout à droite et à gauche; on gardait le silence, et personne ne parlait. Au milieu de la salle de réception il y avait trois hommes debout, auxquels mes quatre conducteurs me confièrent, et qui me prirent par mes habits, comme avaient fait les premiers. Un autre individu leur ayant fait un signe, ils s'avancèrent avec moi. Un d'eux, qui était juif, me dit en arabe : « Ne crains rien; ils ont coutume d'agir ainsi envers les étrangers; je suis l'interprète, et je tire mon origine de la Syrie. » Je lui demandai comment je devais saluer, et il reprit : « Dis : Que le salut soit sur vous! »
J'arrivai ensuite à un grand dais, où je vis l'empereur assis sur son trône, ayant devant lui sa femme, mère de la khatoun. Celle-ci, ainsi que ses frères, se tenaient au bas du trône. A la droite du souverain il y avait six hommes, quatre à sa gauche et autant derrière lui ; tous étaient armés. Avant que je le saluasse et que je parvinsse près de lui, il me fit signe de m'asseoir un instant, afin que ma crainte s'apaisât. J'agis ainsi, puis j'arrivai près du monarque et je le saluai. Il m'invita, par un geste, à m'asseoir, mais je n'en fis rien. Il me questionna au sujet de Jérusalem, de la roche bénie (la roche de Jacob, dans la mosquée d'Omar), d'Alkomâmah (les balayures; nom que les musulmans donnent à l'église du Saint-Sépulcre, ou de la Résurrection, Alkiyâmah), du berceau de Jésus (cf. t. I), de Bethléem et d'Alkhalîl (Hébron); puis il m'interrogea touchant Damas, le Caire, l'Irak et l'Asie Mineure. Je répondis à toutes ses demandes, le juif faisant entre nous l'office d'interprète. Mes paroles lui plurent, et il dit à ses enfants : « Traitez cet homme avec considération et protégez-le. » Puis il me fit revêtir d'un habit d'honneur et m'assigna un cheval sellé et bridé, ainsi qu'un parasol d'entre ceux qu'il fait porter au-dessus de sa tête ; car c'est là une marque de protection. Je le priai de désigner quelqu'un pour se promener chaque jour à cheval avec moi dans la ville, afin que j'en visse les raretés et les merveilles, et que je pusse les raconter dans ma patrie. Il obtempéra à mon désir. Une des coutumes de ce peuple, c'est que l'individu qui reçoit du roi un habit d'honneur et qui monte un cheval de ses écuries, doit être promené dans les places de la ville aux sons des trompettes, des clairons et des timbales, afin que la population le voie. Le plus souvent on agit de la sorte avec les Turcs qui viennent des états du sultan Uzbek, et cela pour qu'ils ne souffrent pas de vexations. On me conduisit ainsi dans les marchés.
Elle est extrêmement grande et divisée en deux portions que sépare un grand fleuve, où se font sentir le flux et le reflux, à la manière de ce qui a lieu dans le fleuve de Salé, ville du Maghreb. Il y avait anciennement sur ce fleuve un pont de pierres; mais il a été détruit, et maintenant on passe l'eau dans des barques. Le nom du fleuve est Absomy. Une des deux portions de la ville s'appelle Esthamboûl : c'est celle qui s'élève sur le bord oriental de la rivière, et c'est là qu'habitent le sultan, les grands de son empire et le reste de la population grecque. Ses marchés et ses rues sont larges, et pavés de dalles de pierres. Les gens de chaque profession y occupent une place distincte, et qu'ils ne partagent avec ceux d'aucun autre métier. Chaque marché est pourvu de portes que l'on ferme pendant la nuit; la plupart des artisans et des marchands y sont des femmes.
Cette partie de la ville est située au pied d'une montagne qui s'avance dans la mer, l'espace d'environ neuf milles, sur une largeur égale, ou même plus considérable. Sur la cime du mont s'élève une petite citadelle, ainsi que le palais du sultan. La muraille fait le tour de cette montagne, qui est très forte, et que personne ne saurait gravir du côté de la mer. Elle contient environ treize villages bien peuplés, et la principale église se trouve au milieu de cette portion de la ville.
Quant à la seconde partie de celle-ci, on la nomme Galata; elle est située sur le bord occidental de la rivière, et ressemble à Ribâth alfath (station de la Victoire, actuellement Rabat, ville du Maroc, vis-à-vis Salé) par sa proximité de la mer. Elle est destinée particulièrement aux chrétiens francs, et ils l'habitent. Ces gens-là sont de plusieurs nations ; il y a parmi eux des Génois, des Vénitiens, des individus de Rome et d'autres de France. L'autorité sur eux appartient à l'empereur de Constantinople, qui met à leur tête un des leurs, dont ils agréent le choix, et qu'ils appellent alkomes (le comte). Ils doivent un tribut annuel à l'empereur; mais ils se révoltent souvent contre lui, et il leur fait la guerre jusqu'à ce que le pape rétablisse la paix entre eux. Tous sont voués au commerce, et leur port est un des plus grands qui existent. J'y ai vu environ cent navires, tels que des galères et autres gros bâtiments. Quant aux petits, ils ne peuvent être comptés, à cause de leur multitude. Les marchés de cette portion de la ville sont beaux, mais les ordures y dominent ; une petite rivière fort sale les traverse. Les églises de ces peuples sont dégoûtantes aussi, et elles n'offrent rien de bon.
Je n'en décrirai que l'extérieur; car, quant à l'intérieur, je ne l'ai pas vu. Elle est appelée, chez les Grecs, Ayâ Soûfïâ (Αγία Σοφία, Sainte-Sophie), et l'on raconte qu'elle a été fondée par Asaf, fils de Barakhïâ, qui était fils de la tante maternelle de Salomon. C'est une des plus grandes églises des Grecs; elle a une muraille qui en fait le tour, comme si c'était une ville, et ses portes sont au nombre de treize. Elle a pour dépendance un terrain consacré, d'environ un mille, qui est pourvu d'une grande porte. Personne n'est empêché de pénétrer dans cette enceinte, et j'y suis entré avec le père du roi, dont il sera fait mention ci-après. Cet enclos consacré ressemble à une salle d'audience; il est recouvert de marbre et traversé par un ruisseau qui sort de l'église, et qui coule entre deux quais, élevés d'environ une coudée et bâtis en marbre veiné, sculpté avec l'art le plus admirable. Des arbres sont plantés avec symétrie de chaque côté du cours d'eau; et, depuis la porte de l'église jusqu'à celle de cette enceinte, il y a un berceau de bois très haut sur lequel s'étendent des ceps de vigne, et dans le bas, des jasmins et des plantes odoriférantes. En dehors de la porte de l'enclos s'élève un grand dôme de bois, où se trouvent des bancs de la même matière, sur lesquels s'asseyent les gardiens de cette porte; et, à la droite du dôme, il y a des estrades et des boutiques, la plupart en bois, où siègent les juges et les écrivains des bureaux de la trésorerie. Au milieu de ces boutiques existe une coupole en bois, à laquelle on monte par un escalier de charpente, et où se trouve un grand siège recouvert en drap, sur lequel s'assied leur juge, dont nous parlerons plus loin. A la gauche du dôme, situé à la porte de ce lieu, s'étend le marché des droguistes. Le canal que nous avons décrit se divise en deux bras, dont un passe par ce marché et l'autre par celui où sont les juges et les écrivains.
A la porte de l'église, il y a des bancs où se tiennent les gardiens, qui ont le soin d'en balayer les avenues, d'en allumer les lampes et d'en fermer les portes. Ils ne permettent à personne d'y entrer, jusqu'à ce qu'il se soit agenouillé devant la croix, qui jouit de la plus grande vénération parmi ces gens. Ils prétendent que c'est un reste de celle sur laquelle fut crucifié le personnage ressemblant à Jésus,
Elle se trouve au-dessus de la porte de l'église, et elle est placée dans un coffret d'or, de la longueur d'environ dix coudées. On a mis en travers de cette enveloppe un autre coffret d'or, pareil au premier, de manière à figurer une croix. Cette porte est revêtue de lames d'argent et d'or, et ses deux anneaux sont d'or pur. On m'a rapporté que le nombre des moines et des prêtres qui demeurent dans l'église s'élève à plusieurs milliers, et que quelques-uns d'entre eux descendent des apôtres de Jésus; que dans son enceinte se trouve une autre église destinée particulièrement aux femmes, et où il y a plus de mille vierges vouées uniquement aux pratiques de dévotion. Quant aux femmes âgées et vivant dans le veuvage, qui s'y trouvent aussi, leur nombre est encore plus considérable.
Le roi, les grands de son empire et le reste de la population ont coutume de venir, chaque matin, visiter cette église. Le pape s'y rend une fois l'an, et lorsqu'il est à quatre journées[37] de distance de la ville, le roi sort à sa rencontre, met pied à terre devant lui, et, au moment de son entrée dans la ville, il marche à pied devant le pontife. Il vient le saluer matin et soir pendant tout le temps de son séjour à Constantinople, et jusqu'à son départ.
Le mot mânistâr (monastère) s'écrit comme le mot miristân (hôpital), si ce n'est que, dans le premier, le noûn (n) vient avant le râ (r). Le monastère, chez les Grecs, correspond à la zaouïa des musulmans, et les édifices de cette espèce sont nombreux à Constantinople. Parmi ceux-ci, on distingue le couvent qu'a fondé le roi Djirdjîs (George), père du roi de Constantinople, dont nous ferons mention ci-après. Il est situé hors d'Esthanboûl, vis-à-vis de Galata.
On cite encore deux monastères à l'extérieur de la grande église, à droite de l'entrée; ils sont placés dans un jardin, et une rivière les traverse ; l'un d'eux est consacré aux hommes et l'autre aux femmes, et chacun comprend une église. Ils sont entourés de cellules destinées aux hommes et aux femmes qui se sont voués aux pratiques de la dévotion. Chacun de ces deux monastères a été l'objet de legs destinés à pourvoir au vêtement et à l'entretien des religieux, et ils ont été fondés par un roi.
On mentionne aussi deux monastères, à la gauche de l'entrée de la grande église, et semblables aux deux précédents. Ils sont aussi entourés de cellules; l'un d'eux est habité par des aveugles, et le second par des vieillards qui ne peuvent plus travailler, parmi ceux qui ont atteint soixante ans ou environ. Chacun d'eux reçoit l'habillement et la nourriture, sur des legs consacrés, à cette destination. A l'intérieur de chaque couvent de Constantinople est un petit appartement destiné à servir de retraite au roi, fondateur de l'édifice; car la plupart de ces rois, lorsqu'ils ont atteint soixante ou soixante et dix ans, construisent un monastère et revêtent des moçoûh (au singulier mish, « sac, cilice »), c'est-à-dire des vêtements de crin ; ils transmettent la royauté à leur fils, et s'occupent, jusqu'à leur mort, d'exercices de dévotion. Ils déploient la plus grande magnificence dans la construction de ces monastères, les bâtissant de marbre et les ornant de mosaïques, et ces édifices sont en grand nombre dans la ville.
J'entrai, avec le Grec que le roi avait désigné pour m'accompagner à cheval, dans un monastère que traversait un canal; on y voyait une église où se trouvaient environ cinq cents vierges, revêtues d'habits de poils (ou de bore) ; sur leurs têtes, qui étaient rasées, elles portaient des bonnets de feutre. Ces filles étaient douées d'une exquise beauté; mais les austérités avaient laissé sur elles des traces profondes. Un jeune garçon, assis dans une chaire, leur lisait l'Évangile, avec une voix telle que je n'en ai jamais entendu de plus belle. Il était entouré de huit autres enfants, également assis dans des chaires et accompagnés de leur prêtre. Quand ce garçon eut fini de lire, un autre fit la lecture. Le Grec, mon conducteur, me dit : « Celles-ci sont des filles de rois, qui se sont vouées au service de cette église; il en est de même de ces jeunes lecteurs, qui ont une autre église à l'extérieur de celle-ci ». J'entrai également, avec le Grec, dans une église située dans un-jardin; nous y trouvâmes environ cinq cents vierges, ou même davantage. Un enfant leur faisait la lecture, du haut d'une estrade, et il était accompagné d'une troupe de jeunes garçons assis, comme les précédents, dans des chaires. Le Grec me dit : « Ces femmes sont des filles de vizirs et d'émirs, qui se livrent, en cette église, à des exercices de dévotion. » J'entrai, avec le même individu, dans des églises où se trouvaient des vierges, filles des principaux habitants de la ville, et dans d'autres églises, occupées par de vieilles femmes et des veuves; enfin, dans des églises habitées par des moines. Il y a, dans chacune de ces dernières, cent hommes, plus ou moins. La majeure partie de la population de cette ville consiste en moines, en religieux et en prêtres. Les églises y sont innombrables. Les habitants, soit militaires ou autres, grands et petits, placent sur leur tête de vastes parasols, hiver comme été. Les femmes portent des turbans volumineux.
Ce roi donna l'investiture de la royauté à son fils et se consacra, dans la retraite, à des actes de dévotion. Il bâtit on monastère hors de la ville, sur le rivage, ainsi que nous l'avons dit. Je me trouvais un jour en compagnie du Grec, désigné pour monter à cheval avec moi, lorsque nous rencontrâmes tout à coup ce roi, marchant à pied, vêtu d'habits de crin, et coiffé d'un bonnet de feutre. Il avait une longue barbe blanche et une belle figure, qui présentait des traces des pratiques pieuses auxquelles il se livrait. Devant et derrière lui marchaient une troupe de moines. Il tenait à la main un bâton et avait au cou un chapelet. Lorsque le Grec le vit, il mit pied à terre et me dit: « Descends, car c'est le père du roi. » Quand le Grec l'eut salué, il lui demanda qui j'étais, puis il s'arrêta et m'envoya chercher. Je me rendis près de lui; il me prit la main et dit à ce Grec, qui connaissait la langue arabe. « Dis à ce sarrasin, c'est-à-dire musulman, que je presse la main qui est entrée à Jérusalem et le pied qui a marché dans la Sakhrah (la roche, c'est-à-dire la mosquée d'Omar), dans la grande église appelée Komâmah (le Saint-Sépulcre) et dans Bethléem. » Cela dit, il mit la main sur mes pieds et la passa ensuite sur son visage. Je fus étonné de la bonne opinion que ces gens-là professent à l'égard des individus d'une autre religion que la leur, qui sont entrés dans ces lieux. L'ancien roi me prit ensuite par la main et je marchai avec lui. Il me questionna au sujet de Jérusalem et des chrétiens qui s'y trouvaient, et il m'adressa de longue » interrogations. J'entrai en sa compagnie dans le terrain consacré, dépendant de l'église, et que nous avons, décrit tout à l'heure. Lorsqu'il approcha de la principale porte, une troupe de prêtres et de moines sortit pour le saluer; car il était un de leurs chefs dans le monachisme. Dès qu'il les vit, il lâcha ma main, et je lui dis : » Je désire entrer avec toi dans l'église. » Il dit à l'interprète : « Apprends-lui que quiconque y entre, doit absolument se prosterner devant la principale croix; » c'est là une chose prescrite par les anciens, et qu'on ne peut transgresser. Je le quittai donc, il entra seul, et je ne le revis plus.
Lorsque j'eus pris congé de ce roi, devenu moine, j'entrai dans le
marché des écrivains. Le kadi m'aperçut et m'envoya un de ses aides,
lequel questionna le Grec qui m'accompagnait. Celui-ci lui dit que
j'étais un savant musulman. Quand cet émissaire fut retourné près du
magistrat et qu'il l'eut instruit de cela, celui-ci me dépêcha un de
ses officiers. Or les Grecs appellent le juge Annedjchi Cafâly.
L'envoyé me dit : « Annedjchi Cafâly te demande. » Je montai pour le
voir dans le dôme qui a été décrit ci-dessus, et j'aperçus un
vieillard d'une belle figure et ayant une chevelure superbe. Il
portait l'habit des moines, lequel est en gros drap noir, et avait
devant roi environ dix écrivains occupés à écrire. Il se leva devant
moi, ainsi que ses employés et ne dit : « Tu es l'hôte du roi, et il
convient que nous te traitions avec honneur ». Il m'interrogea tou![]() chant Jérusalem, la Syrie et
l'Egypte, et prolongea la conversation. Une foule considérable
s'amassa autour de lui. Il me dit enfin : « Il faut absolument que
tu viennes à ma maison et je t'y traiterai. » Je le quittai et ne le
revis plus.
chant Jérusalem, la Syrie et
l'Egypte, et prolongea la conversation. Une foule considérable
s'amassa autour de lui. Il me dit enfin : « Il faut absolument que
tu viennes à ma maison et je t'y traiterai. » Je le quittai et ne le
revis plus.
Lorsqu'il sembla aux Turcs qui étaient dans la société de la khatoun qu'elle professait la religion de son père, et qu'elle désirait rester près de lui, ils demandèrent à cette princesse la permission de retourner dans leur pays. Elle la leur accorda, leur fit de riches présents, et envoya avec eux une personne chargée de les reconduire dans leur patrie. C'était un émir, appelé Sâroûdjah Assaghîr (le Petit), qui commandait à cinq cents cavaliers. La princesse m'envoya chercher, et me donna trois cents dinars en or du pays, qu'on appelle alberbérah (hyperpères); mais cet or n'est pas bon. Elle y joignit deux mille drachmes de Venise, une pièce de drap, de la façon des filles esclaves, et qui était de la meilleure espèce, dix vêtements de soie, de toile de lin et de laine, et enfin deux chevaux que me donnait son père. La princesse m'ayant recommandé à Sâroûdjah, je lui fis mes adieux et m'en retournai. J'avais séjourné chez les Grecs un mois et six jours.
Nous voyageâmes en compagnie de Sâroûdjah, qui me témoignait de la considération, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à l'extrémité du pays des Grecs, où nous avions laissé nos compagnons et nos chariots. Nous remontâmes dans ceux-ci, et nous entrâmes dans le désert. Sâroûdjah alla avec nous jusqu'à la ville de Baba Salthouk, et s'y arrêta trois jours, eu qualité d'hôte, après quoi il retourna dans son pays.
On était alors au plus fort de l'hiver. Je revêtais trois pelisses et deux caleçons, dont un doublé ; je portais aux pieds des bottines de laine, et par-dessus, une autre paire de toile de lin doublée, et enfin, par-dessus le tout, une troisième paire en borghâly (pour bolghâry), c'est-à-dire en cuir de cheval, fourré de peau de loup. Je faisais mes ablutions avec de l'eau chaude, tout près du feu; mais il ne coulait pas une goutte d'eau qui ne gelât à l'instant. Lorsque je me lavais la figure, l'eau, en touchant ma barbe, se changeait en glace, et si je secouais ma barbe, il en tombait une espèce de neige. L'eau qui dégouttait de mon nés se gelait sur mes moustaches. Je ne pouvais monter moi-même à cheval, à cause du grand nombre de vêtements dont j'étais couvert; en sorte que mes compagnons étaient, obligés de me mettre à cheval.
J'arrivai enfin à la ville de Hadj Terkhân, où nous avions pris congé du sultan Uzbek. Nous apprîmes qu'il en était parti, et qu'il habitait en ce moment la capitale de son royaume. Nous marchâmes pendant trois jours sur le fleuve Itil (Volga) et sur les rivières voisines, qui étaient alors gelés. Lorsque nous avions besoin d'eau, nous cassions des morceaux de glace, et nous les mettions fondre dans un chaudron; puis nous buvions de cette eau, et nous nous en servions pour faire noire cuisine. Nous arrivâmes ensuite à la ville de Sera, qui est aussi connue sous le nom de Sera Berekeh (le palais de Berekeh), et c'est la capitale du sultan Uzbek. Nous visitâmes ce souverain ; il nous interrogea touchant les événements de notre voyage, touchant le roi des Grecs et sa capitale. Nous l'instruisîmes de ce qu'il désirait savoir. Il ordonna de nous loger et de nous fournir les objets nécessaires à notre entretien.
Sera est au nombre des villes les plus belles, et sa grandeur est très considérable ; elle est située dans une plaine et regorge d'habitants ; elle possède de beaux marchés et de vastes rues. Nous montâmes un jour à cheval, en compagnie d'un des principaux habitants, afin de faire le tour de la ville et d'en connaître l'étendue. Notre demeure était à l'une de ses extrémités. Nous partîmes de grand matin, et nous n'arrivâmes à l'autre extrémité qu'après l'heure de midi. Alors nous fîmes la prière et prîmes notre repas. Enfin nous n'atteignîmes notre demeure qu'au coucher du soleil. Nous traversâmes aussi une fois la ville en largeur, aller et retour, dans l'espace d'une demi-journée. Il faut observer que les maisons y sont contiguës les unes aux autres, et qu'il n'y a ni ruines ni jardins. Il s'y trouve treize mosquées principales pour faire la prière du vendredi ; l'une de celles-ci appartient aux chaféites. Quant aux autres mosquées, elles sont en très grand nombre. Sera est habité par des individus de plusieurs nations, parmi lesquels on distingue : 1 ° les Mongols, qui sont les indigènes et les maîtres du pays; une partie professe la religion musulmane; 2° les Ass (Ossètes), qui sont musulmans; 3° les Kifdjaks; 4° les Tcherkesses; 5° les Russes; 6° les Grecs, et tous ceux-ci sont chrétiens. Chaque nation habite un quartier séparé, où elle a ses marchés. Les négociants et les étrangers, originaires des deux Irâks, de l'Egypte, de la Syrie, etc. habitent un quartier qui est entouré d'un mur, afin de préserver les richesses des marchands. Le palais du sultan, à Sera, est appelé Althoûn-Thâch. Althoûn signifie « or », et thâch « tête ». (C'est une erreur: thâch signifie « pierre »; c'est le mot bâch qui, en turc, veut dire « tête »).
Le kadi de Sera, Bedr eddîn ala'radj (le boiteux), est au nombre des meilleurs kadis. On y trouve aussi, parmi les professeurs des chaféites, le docteur, l'imâm distingué Sadr eddîn Soleïman Alleczy (le Lezgui), qui est un homme de mérite; et, parmi les malékites, Chems eddîn Almisry, qui est en butte aux reproches touchant le manque de pureté de sa foi. On voit à Sera l'ermitage du pieux pèlerin Nizâm eddîn ; il nous y traita et nous montra de la considération. On y voit encore celui du docteur et du savant imam Nomân eddîn Alkhârezmy, que je visitai. Il est au nombre des cheikhs distingués; c'est un homme doué de belles qualités, d'une âme généreuse, plein d'humilité, mais fort rude envers les riches. Le sultan Uzbek le visite chaque vendredi; mais ce cheikh ne va pas à sa rencontre et ne se lève pas devant le roi. Celui-ci s'assied vis-à-vis du cheikh, lui parle du ton le plus doux et s'humilie devant lui, et le cheikh tient une conduite tout opposée. Sa manière d'agir avec les fakirs, les malheureux et les étrangers, est le contraire de sa conduite envers le sultan; car il leur témoigne de l'humilité, leur parle du ton le plus doux et les honore. Il me traita avec considération (que Dieu l'en récompense!) et me fit présent d'un jeune esclave turc. Je fus témoin d'un miracle de sa part.
J'avais désiré me rendre de Sera à Kharezm; mais le cheikh me le défendit, en me disant : « Attends quelques jours encore, puis mets-toi en route. » Ma volonté s'y opposa. Je trouvai une grande caravane qui se préparait à partir, et parmi laquelle il y avait des marchands de ma connaissance. Je convins que je partirais avec eux, et j'annonçai au cheikh cet accord; mais il me dit : « Tu ne peux te dispenser d'attendre ici. » Néanmoins je me disposai au départ; mais un de mes esclaves s'enfuit, et je restai à cause de son évasion. Ce retard est au nombre des miracles évidents. Au bout de trois jours, un de mes compagnons trouva mon esclave fugitif à Hadj Terkhân et me le ramena. Je partis alors pour Kharezm.
Entre cette ville et la résidence royale de Sera, il y a un désert de quarante jours de marche, dans lequel on ne voyage pas avec des chevaux, à cause de la disette du fourrage. Les chameaux seuls y traînent les chariots.
FIN DU TOME DEUXIÈME.
[1] Cf. l'Histoire des Mongols, t. IV, p. 540.
[2] Géographie, trad. de M. Reinaud, t. II, p. 122.
[3] Voyage en Arabie, traduction française, t. I, p. 284 ; Cf. la Description de l’Arabie, édit. de 1774, p. 197 ; Rommel, Abulfedea Arabiœ Descriptio, Gottingen, 1803, p. 51, et la belle carte du sud-ouest de l'Arabie, par H. Kiepert, Berlin, 1852.
[4] Géographie, trad. de M. Jaubert, t. I, p. 150. Cf. aussi Marco Polo, édition de la Société de géographie, p. 243.
[5] Journal of the royal geograph. Society of London, t. XV, p. 129.
[6] Erdkunde, XIII, 3; t. I de l'Arabie, p. 373.
[7] Marco Polo, Voyages, édit. de la Société de géographie, p. 245.
[8] Voyez Lexicon geographicum, édit. Juynboll, t. I, Leyde, 1852, p. 288.
[9] D'Ohsson, Histoire des Mongols, t. III, p. 417, 418.
[10] Id. Ibid. t. IV, p. 315.
[11] Id. Ibid., p. 536.
[12] Voyez encore, sur ces divers mariages, Hamaker, Réflexions critiques sur quelques points contestés de l'histoire orientale, p. 18-20 ; le même, apud Uylenbroëk, Iracœ persicœ Descriptio. p. 80, note.
[13] Histoire du Bas-Empire, par Lebeau et Ameilhon, t. XXIV, p. 339, 240.
[14] Cf. les Orientalia, t. II, p. 353.
[15] Ameilhon, op. supra laud: XXIV, p. 418.
[16] Id. ibid. p. 431.
[17] Journal des Débats du 14 décembre 1853, article de M. Ernest Renan.
[18] Cf. le Journal asiatique, juillet 1842, p. 14, et 39-47 ; le même journal, novembre-décembre 1851, p. 482-484.
[19] Cf. Ali bey. Voyages, t. I, p. 53, 54, 55, 276 et 277; Ch. Didier, Promenade au Maroc, Paris, 1844, passim, et le Journal des Débats du 13 janvier 1851, d'après le Jewish chronicle.
[20] Voyez notamment S. de Sacy, Journal des Savants, janvier 1820, p. 19.
[21] Annales des voyages, t. IV, p. 24 et 25.
[22] Dans ce passage, ainsi que dans un passage antérieur, Ibn Batoutah parait regarder le Chatth Al 'arab, ou grand fleuve des Arabes, nom par lequel on désigne le Tigre et l'Euphrate réunis, comme un golfe ou canal (le mot arabe khalîdj comporte ces deux sens) d'eau salée, formé par le golfe Persique ou la mer de Perse des géographes arabes. On voit plus loin que notre voyageur considère le golfe Persique comme une continuation de ce même cours d'eau. C'est ce qui nous a engagés à traduire, dans ce dernier endroit, les mots bahr Fâris, par « océan Indien », pour rendre plus clairement les paroles de l'auteur. Nous devons faire observer qu'Edriçy (Géogr. trad. de M. Jaubert, t. I, p. 4 et 158) dit que « de la mer de la Chine et des Indes est dérivé le golfe Vert, qui est le golfe de Perse et d'Abila (lisez Obollah), qui se termine à Abila, près d'Abadan. » — Quant à ce qui est du goût salé que contractent les eaux du Chatth Al 'arab, comme l'atteste Ibn Batoutah, il suffit de faire observer que la marée est fort considérable dans ce grand cours d'eau, et que le flux y monte au delà de Corna, et se fait même sentir à Oumm Aldjemal. (Voyez Otter, Voyage en Turquie et en Perse, t, II, p. 58; et Niebuhr, Voyage en Arabie, t. II, p. 198, note b.)
[23] Disboûl, ou mieux Dizfoul, est le nom d'une ville située à environ dix lieues au nord ouest de Toster, sur la rive d'un fleuve qui porte les noms de rivière de Dizfoûl, d'Abi-zal et de Chatth Aldiz. (Cf. Macdonald Kinneir, A geographical manoir of the persian empire, p. 99; et Layard, dans les Nouvelles annales des voyages, avril 1847, p. 82, 83 et 87.)
[24] Le chapitre intitulé : Sur le roi d'Idhedj et de Toster, présente un anachronisme provenant de ce qu'Ibn Batoutah a confondu le souverain du Louristân, à l'époque où il traversa pour la première fois ce pays, en 737 (1327), avec celui qui régnait vingt ans après, lors de son retour en Perse. A la première de ces deux dates, ainsi que nous l'avons indiqué dans une parenthèse, le Louristân avait pour atabek Nosret eddîn Ahmed, qui ne mourut que six ans après, et fut remplacé successivement par ses deux fils, dont le second, Mozaffer eddîn Afrâciâb, est celui que vit Ibn Batoutah, et à qui notre voyageur reprocha si hardiment son amour pour le vin. Quoiqu’Ibn Batoutah ne mentionne pas Idhedj parmi les villes qu'il visita pour la seconde fois, en l'année 748 (1347), il est plus que probable qu'il revit cette capitale, laquelle se trouvait sur son chemin, et que ce fut alors qu'il eut les aventures dont il nous fait un si curieux récit. — Ibn Batoutah a commis une légère erreur, en donnant à l'atabek Yousef dix années de règne (p. 34); ce prince n'occupa le trône que pendant sept ans, de 1332 à 1339.
[25] Au lieu de « deux jours », que nous avons dû admettre dans notre texte, sur la foi des trois mss. 909,910 et 911, le ms. 908 donne « ce jour-là », leçon qui serait préférable au point de vue géographique. En effet, la distance de deux journées de marche, donnée par Ibn Batoutah, comme séparant Kélîl de Sormâ, est beaucoup trop considérable. En outre, il est peu exact de placer Kélîl et Sormâ entre Ispahan et Iezd Khâst; il faut rétablir ainsi l’ordre des localités citées par notre voyageur : 1° Yezdokhâs, 2° Sormâ, 3° Kélîl.
[26] Surnom de Hillah, ville qui était aussi appelée « Hillah aux deux djâmi ». (Voyez Méraçid t. I, p. 315 et 331; et cf. Otter, Voyage, etc. t. II, p. 308.)
[27] Ibn Batoutah n'a passé qu'une nuit à Mombas, et le temps lui a manqué pour examiner cette localité ; aussi a-t-il un peu exagéré l'étendue de l'île. Ce qu'il dit de la distance qui la sépare de la terre du Souahhel donnerait à penser qu'alors le littoral ainsi désigné comprenait seulement la partie des côtes basses qui s'étend depuis la pointe Ponna jusqu'aux environs du cap Delgado. Aujourd'hui le pays des Souahhéli on le Souahhel est considéré comme commençant à partir du Djoub. » (Note communiquée par M. le capitaine Guilain.)
[28] Les Limiîn sont mentionnés ailleurs par Ibn Batoutah (voyez Journ. asiat. mars 1843, p. 201) comme habitant les bords du Niger, et dépendants de la ville de Melli. (Cf. Desborough Cooley, The negroland of the Arabs, London, 1841, p. 115.)
[29] Dans la seconde partie de sa relation, notre voyageur a encore mentionné plusieurs des localités ici nommées; il y détermine, lettre par lettre, la manière dont leurs noms doivent être prononcés. D'après ce second passage, on devrait lire Alkouréyât, Chabbah et Calbah.
[30] Au lieu de « une ville », le ms. 910 porte « un pays ». Le nom de Moûghostân, ou Moghistân, désigne la partie de la province de Kermân située sur le golfe Persique. (Cf. Texeira, Voyages, 2e partie, Paris, 1681, p. 113.)
[31] Texeira est entré dans d'assez grands détails sur Kothb eddîn, ou, comme il l'appelle, Kodbadin (ibid. p. 97, 99-101, 106-113). Les renseignements qu'il donne sur ce prince, et qu'il a tirés d'une histoire de Hormouz, composée par Touran chah, son fils et son successeur, s'accordent avec le récit de notre voyageur, sauf en ce qui concerne la cause de la mort de Nizâm eddîn. Nous devons seulement faire observer qu'au lieu de donner pour père à Kothb eddîn un nommé Touran chah, le voyageur portugais le fait fils d'Izz eddîn Gordonxa (Gurdan chah, ou le roi des héros).
[32] Ibn Batoutah s'est trompé en donnant à la ville de Sîrâf le nom de Kaïs, confondant ainsi deux localités bien différentes. « Sîrâf, dit le géographe persan, Hamd Allah Mustaufy, a été jadis une ville considérable et très riche, et un port d'embarquement très fréquenté. Du temps des Deïlémites (ou Bouvéïhides), c'était de là, ou de Kîch que l'on partait pour entreprendre des voyages maritimes. Sa température est extrêmement chaude; l'eau que l'on y boit provient des plaies et est gardée dans des citernes. Elle possède aussi deux ou trois sources. Ses productions consistent en grains et en dattes. Nedjirem et Khorchi dépendent de cette ville. » (Nozhet al Koloub, ms. persan de la Bibliothèque impériale, n° 139, p. 646.) Quant à Kîch ou Kïs (selon la prononciation arabe, voyez le Mérassid, édit. Juynboll. t. II, p. 466 et 529), voici ce qu'en dit le même géographe : « C'est une île située à quatre parasanges du rivage de Hézou, elle a quatre parasanges de longueur sur autant de largeur, et l'on y voit une ville du même nom. Il y a dans cette île des champs ensemencés et des palmiers, et c'est là que se trouve la pêcherie, des perles. La température de Kîch est extrêmement chaude. L'eau qu'on y boit est fournie par la pluie et on la recueille dans des citernes. Dans le Fars Nameh, Kîch est comptée parmi les dépendances du district d'Ardéchîr Khorreh. » (Nozhet, ibid. p. 665.) La méprise de notre auteur, relativement à la prétendue identité de Sîrâf et de Kaïs ou Kîch, serait plus excusable si l'on pouvait admettre, avec de savants géographes, que Sîrâf eut été située à l'endroit occupé maintenant par la petite ville de Tcharrak, au pied d'une haute montagne, et à l'opposite de l'île de Kîch. Mais il paraît plus probable que l'on doit retrouver l'emplacement de Sîrâf dans des ruines étendues, situées à deux milles à l'ouest de la ville de Thahrieh, à huit milles environ au-dessous de Congoun. (Cf. toutefois, James Morier, A second journey through Persia, etc. London, 1818, p. 34.)
[33] Nous avons adopté la leçon qui est fournie par les mss. 910 et 911, parce que c'est, à la fois, celle qui se rapproche le plus de la véritable, et de l'interprétation donnée par notre auteur. Les mss. 908 et 910 portent dhognoaz, ou, comme on prononce vulgairement, dhognouz, signifie en turc « un cochon », et la particule lu, ajoutée aux noms substantifs, dans la même langue, en fait des adjectifs possessifs. Ainsi dhognouzlu signifierait : « qui possède des cochons » ; et dhomouzliq, mot très facile à confondre avec le premier, surtout dans l'écriture africaine, veut dire : « une étable à cochons ». Mais la vraie leçon est tinghizlu, où, comme on écrit maintenant, degnizlu, nom qui signifie : « possesseur de mers, maritime », et qui, selon Hadji Khalfa, fut donné à Lâdhikiyah ou Lâdhik, à cause de la grande quantité de ruisseaux et de rivières qui arrosent son territoire. On s'explique facilement qu'Ibn Batoutah ait accepté pour le nom vulgaire de Lâdhik une interprétation injurieuse, qui pouvait bien lui paraître justifiée par les habitudes de débauche qu'il attribue, ainsi que l'auteur du Méçâlic al Âbsâr aux habitants de cette ville.
[34] Comme M. Vivien de Saint-Martin l'a fait remarquer avec raison : « Il semble y avoir ici une lacune dans la relation du voyageur; car, sans transition aucune, il nous ramène des bords de l'Euphrate à l'autre extrémité de la péninsule, vers les rives de la mer de Roum, l'Egée des temps classiques. » (Hist. géographique de l’Asie Mineure, t. I, p. 514).
[35] Ibn Batoutah a commis ici une grave erreur historique : Berouânah, ou mieux Perouânah (en persan, « chambellan, garde des sceaux »), était le titre que portait Mo'iyn eddîn Soleïman ibn'Aly, ministre tout-puissant des sultans seldjoukides Rocn eddîn Kilidj Arslan IV, et Ghiâth eddîn Keï Khosrow III. Le sultan Rocn eddîn Kilidj Arslan lui avait affermé la ville de Sinope, en récompense de ce qu'il en avait fait la conquête, lui permettant de transmettre ce fief à son fils. Après l'exécution de Soleïman, décapité par l'ordre d'Abaka, second sultan des Mongols de la Perse, Sinope fut successivement possédée par son fils et par son petit-fils, et ce dernier étant mort en l'année 700 (1300 de J. C), le territoire de Sinope passa au pouvoir des princes de Kasthamoûniya. D'après M. Hammer (Histoire de l'Empire Ottoman, trad. fr. t. I, p. 51, 53), Ghazi Tchelébi était fils de Maç’oud II, avant-dernier des sultans seldjoukides d'Iconium. Il conserva toujours, selon le même savant, le gouvernement de Kastémouni et de Sinope, pendant un demi-siècle, jusqu'en 775 (1354). Mais le cheikh Haïder Oriân (apud Schihâb eddîn, Notices des manuscrits, t. XIII, p. 34o) affirme que Sinope était gouvernée au nom du prince de Kasthamoûniyah, par un émir nommé Ghazi Tchelébi.
[36] Ibn Batoutah n'est pas tout à fait exact dans l'interprétation qu'il donne du mot terkhân. Ce mot désignait, chez les Mongols, une personne exemptée de toute imposition, et, de plus, ayant droit à la possession exclusive du butin fait par elle dans les combats. Cette personne pouvait entrer sans permission, aussi souvent qu'elle le voulait, dans la salle d'audience du souverain, et elle n'était pas poursuivie criminellement avant d'avoir commis neuf fautes. On peut voir, à ce sujet, une note de Saint-Martin, apud Lebeau, Histoire du Bas-Empire, édition Didot, t. X, p. 64; et sir Henry Elliot, Appendix to the Arabs in Sind, Cape Town, 1853, in-8° p. 201, 203.
[37] Au lieu de « quatre journées », que portent trois de nos manuscrits, le ms. 908 donne « quatre milles ».