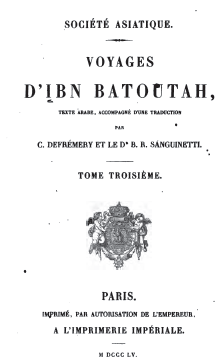
IBN BATOUTAH (رحلات ابن بطوطة)
VOYAGES - LIVRE IV.
Traduction française : C. DEFREMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
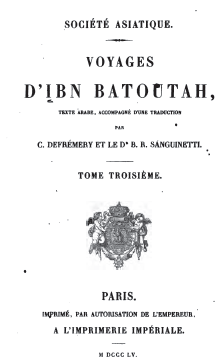
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SOCIÉTÉ ASIATIQUE.
VOYAGES
D'IBN BATOUTAH,
TEXTE ARABE, ACCOMPAGNÉ D'UNE TRADUCTION,
PAR
C. DEFRÉMERY ET LE Dr B. R. SANGUINETTI.
TOME QUATRIÈME.
(DEUXIÈME TIRAGE.)

PARIS.
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.
M DCCC LXXIX.
Exposé du motif pour lequel un présent fut envoyé en Chine ; mention des personnes qui furent expédiées avec moi et description du cadeau
Le roi de la Chine avait envoyé au sultan de l’Inde cent esclaves des deux sexes, cinq cents pièces de velours, dont cent étaient de l’espèce de celles que l’on fabrique dans la ville de Zeïtoun (Tseu-Thoung actuellement Thsiouen-tcheou-fou) et cent de celles que l’on fabrique dans la ville de Khansa (Hang-tcheou-fou) ; cinq mines de musc ; cinq vêtements brodés de perles ; cinq carquois de brocart et cinq épées. Il demandait au sultan qu’il lui permît de reconstruire un temple d’idoles qui se trouvait sur la lisière de la montagne de Karâtchîl, dont il a été question ci-dessus, dans un endroit appelé Samhal. Les habitants de la Chine s’y rendaient en pèlerinage. L’armée musulmane de l’Inde s’en empara, le pilla et le détruisit.
Quand le susdit présent parvint au sultan de l’Inde, il fit au roi de la Chine une réponse ainsi conçue : « Selon la religion musulmane, il n’est pas permit d’accorder une pareille demande ; la construction d’une église sur le territoire des musulmans n’est licite que pour des gens qui payent la capitation. Si tu consens à l’acquitter, nous t’autoriserons à construire ce temple. Salut à ceux qui suivent la bonne direction. » En échange de son présent, il lui en destina un autre, plus précieux, consistant en cent chevaux de race, sellés et bridés ; cent esclaves mâles ; cent jeunes filles hindoues, habiles dans le chant et la danse ; cent vêtement beïremis, c’est-à-dire en coton, qui n’avaient pas leurs pareils sous le rapport de la beauté, et dont chacun valait cent dînârs ; cent pièces d’étoffe de soie, appelés djozz (on nomme ainsi des étoffes dont la matière première est teinte de quatre ou cinq couleurs différentes); cent pièces de l’étoffe appelée salâhiyah ; cent pièces de chîrîn-bâf, cent de chân-bâf ; cinq cents de drap de laine, dont cent étaient noires, cent blanches, cent rouges, cent vertes et cent bleues ; cent morceaux de toile de lin de fabrique grecque, et cent robes de drap ; une grande tente ou sérâtcheh et six pavillons ; quatre chandeliers d’or et six d’argent émaillés de bleu ; quatre bassins d’or, avec leurs aiguières de même métal ; six bassins d’argent ; dix robes d’honneur en brocart, prises dans la garde-robe du sultan ; dix bonnets choisis également parmi les siens, et dont un était brodé de perles ; dix carquois de brocart, dont un était également brodé de perles ; dix épées, dont une avait son fourreau incrusté de perles ; des gants brodés de perles, et, enfin, quinze eunuques.
Le sultan désigna pour partir avec moi et accompagner ce présent, l’émir Zhéhîr eddîn Azzendjâny, un des savants les plus distingués, et l’eunuque Câfoûr acchorbdâr, à qui fut confiée la garde du cadeau. Il fit partir avec nous l’émir Mohammed Alhéraouy, à la tête de mille cavaliers, afin qu’il nous conduisît au lieu où nous devions nous embarquer sur la mer. Les ambassadeurs du roi de la Chine se mirent en route dans notre société ; ils étaient au nombre de quinze, dont le principal s’appelait Toursy ; leurs serviteurs étaient d’environ cent individus.
Nous partîmes donc en nombreuse compagnie et formant un camp considérable. Le sultan ordonna que nous fussions défrayés de tout, tant que nous voyagerions dans ses États. Nous nous mîmes en marche le 17 du mois de séfer de l’année 743 (22 juillet 1342), jour que choisirent les ambassadeurs pour leur départ. En effet, ces peuples choisissent pour entreprendre un voyage, parmi les jours du mois, un des suivants : le deuxième ou le septième, ou le douzième, ou le dix-septième, ou le vingt-deuxième, ou, enfin, le vingt-septième.
A la fin de notre première étape, nous nous arrêtâmes à la station de Tilbat, éloignée de Dihly de deux parasanges et un tiers. Nous en partîmes pour les stations d’Aou et de Hîloû, de cette dernière, nous nous rendîmes à la ville de Beïânah, place grande, bien construite et pourvue de jolis marchés. Sa mosquée principale est au nombre des plus magnifiques, et elle a des murailles et un toit de pierres. L’émir de Beïânah est Mozhaffer ibn Addâyah (fils de la nourrice), dont la mère a été la nourrice du sultan. Ce personnage a eu pour prédécesseur dans son emploi le roi Modjîr, fils d’Abou’rrédjâ, un des principaux rois, et dont il a été déjà question. Ce dernier se prétendait issu de la tribu de Koreïch ; il était fort orgueilleux et commettait beaucoup d’injustices. Il tua et mutila un grand nombre d’habitants de la ville. J’ai vu un des habitants de Beïânah, homme d’une belle figure, qui était assis dans le vestibule de sa maison, et à qui l’on avait coupé les deux mains et les deux pieds. Le sultan vint un jour dans cette ville, et les citadins lui adressèrent leurs plaintes contre le susdit roi Modjîr. Il ordonna de le saisir et de lui mettre au cou un carcan. On faisait asseoir le prisonnier dans la salle du conseil, vis-à-vis du vizir, pendant que les habitants écrivaient leurs griefs contre lui. Le sultan lui commanda de leur donner satisfaction, ce qu’il fit à prix d’argent ; après quoi il fut mis à mort.
Parmi les notables citoyens de Beïânah, on remarquait le savant imâm ’Izz eddîn Azzobeïry, de la postérité de Zobeïr ibn Alawwâm. C’est un des plus grands et des plus pieux jurisconsultes. Je le rencontrai à Gâlyoûr, auprès du roi ’Izz eddîn Albénétâny, surnommé A’zham Mélik (le principal roi).
Cependant, nous partîmes de Beïânah et nous arrivâmes à la ville de Coûl (Coel ou Cowil), cité belle et pourvue de vergers. La plupart de ses arbres sont des manguiers. Nous campâmes à l’extérieur de la ville, dans une vaste plaine. Nous vîmes à Coûl le cheikh vertueux et dévot Chams eddîn, connu sous le nom du fils de Tâdj Al’ârifîn. Il était aveugle et très âgé. Dans la suite, le sultan l’emprisonna et il mourut dans son cachot. Nous avons raconté ci-dessus son histoire (t. III).
Récit d’une expédition à laquelle nous assistÂmes près de CoÛl
A notre arrivée à la ville de Coûl, nous apprîmes qu’une troupe d’Hindous avait investi la ville de Djélaly et en avait formé le siège. Cette place était située à sept milles de distance de Coûl. Nous nous dirigeâmes vers elle et nous trouvâmes les idolâtres occupés à en combattre les habitants, qui se voyaient sur le point d’être exterminés. Les infidèles n’eurent connaissance de notre approche que quand nous les chargeâmes vigoureusement. Ils étaient au nombre d’environ mille cavaliers et trois mille fantassins. Nous les tuâmes jusqu’au dernier, et nous nous emparâmes de leurs chevaux et de leurs armes. Parmi nos compagnons, vingt-trois cavaliers et cinquante-cinq fantassins souffrirent le martyre. Dans le nombre se trouvait l’eunuque Câfoûr, l’échanson, dans les mains de qui le présent avait été remis. Nous écrivîmes au sultan pour lui annoncer cette mort, et nous séjournâmes à Coûl, afin d’attendre sa réponse. Pendant ce temps-là, les infidèles descendaient d’une montagne escarpée, située dans le voisinage, et faisaient des courses aux environs de Djélaly. Nos compagnons montaient à cheval tous les jours, en société de l’émir du district, afin de l’aider à repousser les assaillants.
Comme quoi je suis fait captif, je suis délivré et je me vois ensuite tiré d’une situation pénible par l’assistance d’un saint personnage
Un de ces jours-là, je montai à cheval, avec plusieurs de mes camarades. Nous entrâmes dans un verger, afin d’y faire la sieste, car on était alors dans la saison des chaleurs. Mais, ayant entendu des clameurs, nous enfourchâmes nos montures et nous rencontrâmes des idolâtres qui venaient d’assaillir un des villages dépendant de Djélaly. Nous les poursuivîmes ; ils se dispersèrent, et nos compagnons se débandèrent à leur poursuite. Je demeurai avec cinq camarades seulement. Alors nous fûmes attaqués par un corps de cavaliers et de fantassins qui sortirent d’une forêt voisine. Nous prîmes la fuite devant eux, à cause de leur grand nombre. Environ dix d’entre eux me donnèrent la chasse, mais ils renoncèrent bientôt à ma poursuite, à l’exception de trois. Je ne voyais devant moi aucun chemin, et le terrain dans lequel je me trouvais était fort pierreux. Les pieds de devant de mon cheval furent pris entre des pierres ; je descendis aussitôt, je dégageai les jambes de ma monture et me remis en selle. C’est la coutume dans l’Inde que chaque individu ait deux épées, dont l’une est suspendue à la selle et se nomme arricâby (l’épée de l’étrier) et l’autre repose dans le carquois. Mon épée dite arricâby, qui était enrichie d’or, tomba de son fourreau. Je remis pied à terre, je la ramassai, la passai à mon cou, et remontai à cheval. Cependant, les Hindous étaient toujours sur mes traces. J’arrivai ainsi à un grand fossé ; je descendis de ma monture et entrai dans la tranchée. A partir de ce moment, je ne vis plus les Hindous.
Je pénétrai dans une vallée, au milieu d’un bosquet touffu que traversait un chemin. Je suivis ce dernier, sans savoir où il aboutirait. Tout à coup, environ quarante idolâtres, tenant dans leurs mains des arcs, s’avancent vers moi et m’entourent. Je craignis qu’ils ne fissent tous sur moi une décharge simultanée de leurs flèches, si j’essayais de m’enfuir. Or je n’avais pas de cotte de mailles. Je me jetai donc par terre et me rendis prisonnier ; car les Hindous ne tuent pas quiconque agit ainsi. Ils me saisirent et me dépouillèrent de tout ce que je portais, à l’exception de ma tunique, de ma chemise et de mon caleçon ; puis ils m’entraînèrent dans cette forêt et me conduisirent à l’endroit de leur campement, près d’un bassin d’eau situé au milieu des arbres. Ils m’apportèrent du pain de mâch, c’est-à-dire de pois ; j’en mangeai et je bus de l’eau.
Il y avait, en compagnie de ces gens-là, deux musulmans qui m’adressèrent la parole en langue persane et m’interrogèrent touchant ma condition. Je leur appris une portion de ce qui me concernait ; mais je leur cachai que je venais de la part du sultan. Ils me dirent : « Il faut immanquablement que ces gens-ci ou bien d’autres te fassent périr. Mais voici leur chef. » Ils me montraient un d’entre eux, à qui j’adressai la parole par l’intermédiaire des musulmans. Je m’efforçai de capter sa bienveillance, et il me remit à la garde de trois de ses gens, savoir un vieillard, son fils et un méchant nègre. Ces trois individus me parlèrent, et je compris à leurs discours qu’ils avaient reçu l’ordre de me tuer. Le soir de ce même jour, ils me conduisirent dans une caverne. Dieu envoya au nègre une fièvre, accompagnée de frissons. Il plaça ses pieds sur moi ; quant au vieillard et à son fils, ils s’endormirent. Lorsque le matin fut arrivé, ils tinrent conseil entre eux, et me firent signe de descendre avec eux près du bassin. Je compris qu’ils voulaient m’assassiner. Je parlai au vieillard et m’efforçai de gagner sa bienveillance. Il eut pitié de moi ; je coupai les deux manches de ma chemise et les lui remis, afin que ses camarades ne le punissent pas à mon sujet, si je m’enfuyais.
Vers l’heure de midi, nous entendîmes parler près du bassin. Mes gardiens crurent que c’était la voix de leurs compagnons, et me firent signe de descendre avec eux. Nous descendîmes et trouvâmes que c’étaient d’autres individus. Ceux-ci conseillèrent à mes conducteurs de les accompagner ; mais ils refusèrent ; ils s’assirent tous trois devant moi et j’avais le visage dirigé vers eux. Ils placèrent à terre une corde de chanvre qu’ils avaient avec eux. Pendant ce temps je les considérais et je disais en moi-même : « C’est avec cette corde qu’ils me lieront au moment de me tuer. » Je restai ainsi une heure, au bout de laquelle arrivèrent trois de leurs camarades qui m’avaient capturé. Ils s’entretinrent avec eux et je compris qu’ils leur disaient : « Pourquoi ne l’avez-vous pas tué ? » Le vieillard montra le nègre, comme s’il voulait s’excuser sur la maladie de celui-ci. Un des trois personnages arrivés en dernier lieu était un jeune homme d’une belle figure. Il me dit : « Veux-tu que je te mette en liberté ? — Certes, répondis-je. — Va-t-en », reprit-il. J’ôtai la tunique dont j’étais couvert et la lui donnai. Il me remit un pagne bleu, tout usé, qu’il portait, et m’indiqua le chemin. Je partis, et, comme je craignais que ces gens-la ne changeassent d’avis et qu’ils me rattrapassent, j’entrai dans une forêt de bambous et je m’y cachai jusqu’à ce que le soleil eût disparu. Je sortis alors et suivis le chemin que m’avait montré le jeune homme, et qui me conduisit près d’une source d’eau. Je m’y désaltérai et continuai de marcher jusqu’à la fin du premier tiers de la nuit. J’arrivai à une montagne, au pied de laquelle je m’endormis. Quand le matin fut arrivé, je me remis en route et parvins, vers dix heures, à une haute montagne de rochers, sur laquelle croissaient des acacias et des lotus. Je cueillis des fruits de ce dernier arbre et les mangeai ; mais leurs épines imprimèrent sur mon bras des traces qui y restent encore.
Après être descendu de cette montagne, je me trouvai dans un terrain planté de coton, et où se voyaient aussi des arbustes de ricin. Il y avait encore un bâïn, nom par lequel les Indiens désignent un puits très spacieux, maçonné en pierres, et pourvu de marches au moyen desquelles on descend jusqu’à la surface de l’eau. Quelques-uns de ces puits ont au centre et sur les côtés des pavillons construits en pierres, des bancs et des sièges. Les rois et les chefs du pays s’efforcent de se surpasser les uns les autres, en construisant de pareilles citernes dans les chemins où il n’y a pas d’eau. Nous décrirons ci-après quelques-unes de celles que nous avons vues.
Quand je fus arrivé au bâïn en question, je m’y désaltérai. J’y trouvai quelques branches de sénevé que quelqu’un avait laissées tomber en les lavant ; j’en mangeai une partie et mis le reste de côté ; puis je m’endormis sous un ricin. Pendant ce temps arrivèrent au bâïn environ quarante cavaliers revêtus de cuirasses. Plusieurs entrèrent dans le champ et s’en allèrent ; Dieu les empêcha de m’apercevoir. Après leur départ, il en survint environ cinquante tout armés, qui s’arrêtèrent près de la citerne. Un d’eux s’approcha d’un arbre situé vis-à-vis de celui sous lequel j’étais ; mais il n’eut pas connaissance de ma présence. J’entrai alors dans le champ de coton, et y passai le reste du jour. Les Hindous demeurèrent près de la citerne, occupés à laver leurs habits et à jouer. Lorsque la nuit fut arrivée, leurs voix cessèrent de se faire entendre, et je sus par là qu’ils étaient partis ou bien endormis. Je sortis alors de ma cachette et suivis la trace des chevaux, car il faisait clair de lune. Je marchais jusqu’à ce que je fusse arrivé à une autre citerne surmontée d’un dôme. J’y descendis, je bus de son eau et mangeai des pousses de sénevé que j’avais sur moi ; puis j’entrai dans le pavillon, et le trouvai rempli de foin rassemblé par des oiseaux. Je m’endormis là-dessus ; je sentais sous ce foin des mouvements d’animaux, que je supposais être des serpents ; mais je ne m’en inquiétais pas, tant j’étais fatigué.
Lorsque le matin fut venu, je suivis un large chemin qui aboutissait à un bourg en ruine. J’en pris alors un autre qui était en tout semblable au premier. Je passai ainsi plusieurs jours, pendant un desquels j’arrivai à des arbres très serrés entre lesquels se trouvait un bassin d’eau. L’espace compris entre eux ressemblait à une maison, et, sur les côtés du bassin, il y avait des plantes pareilles au pourpier et d’autres. Je voulus m’asseoir en cet endroit, jusqu’à ce que Dieu envoyât quelqu’un qui me fit parvenir à un lieu habité ; mais, ayant recouvré un peu de force, je me remis en route sur un chemin où je trouvai des traces de bœufs. Je rencontrai un taureau chargé d’un bât et d’une faucille. Or ce chemin aboutissait à des villages d’idolâtres. J’en suivis donc un autre, qui me conduisit à une bourgade en ruine, où je vis deux nègres tout nus. J’eus peur d’eux et restai sous des arbres situés près de là. Lorsque la nuit fut venue, j’entrai dans la bourgade et trouvai une maison dans une des chambres de laquelle il y avait une espèce de grande jarre, que les Hindous disposent pour y serrer les grains. A la partie inférieure de ce vaisseau de terre, il y a un trou par lequel un homme peut passer. J’y entrai et en trouvai le fond couvert de paille ; il y avait aussi une pierre sur laquelle je posai ma tête et m’endormis. Sur cette jarre était perché un oiseau qui battit des ailes la majeure partie de la nuit. Je crois bien qu’il était effrayé ; ainsi nous nous trouvions deux à avoir peur.
Je restai dans cet état pendant sept jours, à partir de celui où je fus fait prisonnier, et qui était un samedi. Le septième jour, j’arrivai à un village d’idolâtres, bien peuplé, et où se trouvaient un bassin d’eau et des champs de légumes. Je demandai à manger aux habitants ; mais ils refusèrent de m’en donner. Je trouvai, autour d’un puits situé près du village, des feuilles de raifort, que je mangeai. J’entrai ensuite dans la bourgade, et y vis une troupe d’idolâtres qui était gardée par des sentinelles. Celles-ci m’appelèrent ; mais je ne répondis pas et m’assis par terre. Un des Hindous s’avança avec une épée nue, qu’il leva, afin de m’en frapper. Je ne fis aucune attention à lui, tant ma fatigue était grande. Il me fouilla, et ne trouva rien sur moi ; il prit la chemise dont j’avais donné les manches au vieillard chargé de ma garde.
Le huitième jour étant arrivé, ma soif devint extrême, et je n’avais pas d’eau pour la satisfaire. Je parvins à une bourgade déserte, où je ne trouvai pas de bassin. Cependant, les Hindous de ces villages ont coutume de faire des bassins où se rassemble l’eau de pluie, dont ils boivent durant toute l’année. Je suivis un chemin qui me conduisit à un puits non maçonné, auquel était adaptée une corde tressée avec des plantes ; mais il n’y avait aucun vase pour puiser de l’eau. Je liai en conséquence à la corde un morceau d’étoffe qui me couvrait la tête, et je suçai l’eau dont il s’imprégna dans le puits. Cela ne me désaltéra pas ; j’attachai à la corde une de mes bottines, et m’en servis pour puiser de l’eau, sans être plus désaltéré. Je voulus tirer de l’eau une seconde fois par le même moyen ; mais le câble se rompit, et ma chaussure tomba dans le puits. Je liai alors mon autre bottine, et bus jusqu’à ce que je fusse désaltéré. Alors je coupai ma bottine en deux, et attachai sa portion supérieure à un de mes pieds, avec la corde du puits et avec des guenilles que je trouvai en cet endroit. Tandis que j’étais ainsi occupé, tout en réfléchissant à ma position, voici qu’apparaît devant moi un individu ; l’ayant considéré, je vis que c’était un homme de couleur noire, tenant dans ses mains une aiguière et un bâton, et portant sur son épaule une besace. Il me dit : « Que le salut soit sur vous ! » Je lui répondis : « Sur vous soient le salut, la miséricorde de Dieu et ses bénédictions ! » Il reprit en persan : « Qui es-tu ? » Je répliquai : « Je suis un homme égaré. — Et moi de même », reprit-il. Là-dessus il attacha son aiguière à une corde qu’il avait sur lui et puisa de l’eau. Je voulus boire ; mais il me dit : « Prends patience. » Puis il ouvrit sa sacoche, et en tira une poignée de pois chiches noirs, frits avec un peu de riz ; j’en mangeai et je bus. Cet individu fit ses ablutions, et une prière de deux génuflexions ; de mon côté, j’en fis autant. Il me demanda mon nom, et je répondis : « Mohammed. » Je l’interrogeai touchant le sien, et il me répondit : Alkalb Alfârih, le Cœur joyeux. Je tirai de cela un présage favorable, et m’en réjouis.
Il me dit ensuite : « Au nom de Dieu, accompagne-moi. — Oui », répliquai-je, et je marchai quelque peu avec lui ; puis j’éprouvai du relâchement dans mes membres et ne pus plus avancer. En conséquence, je m’assis. « Qu’as-tu donc ? », me demanda mon compagnon. Je lui répondis : « Avant de te rencontrer, je pouvais marcher ; mais à présent que j’ai fait ta rencontre je ne le puis plus. » Il reprit : « Dieu soit loué ! monte à cheval sur mon dos. — Certes, répliquai-je, tu es faible, et tu n’as pas assez de force pour cela. — Dieu, répliqua-t-il, me fortifiera ; il faut absolument que tu agisses ainsi. » En conséquence, je grimpai sur son dos, et il me dit : « Récite un grand nombre de fois ce verset du Coran : “Dieu nous suffit, et c’est un excellent protecteur.” » Je le répétai nombre de fois, puis mes yeux se fermèrent malgré moi, et je ne me réveillai qu’en me sentant tomber par terre. Alors je sortis de mon sommeil, et n’aperçus aucune trace de cet individu. Voilà que je me trouve dans un village bien peuplé ; je m’y avance, et découvre qu’il appartient à des cultivateurs hindous, et que son gouverneur est musulman. On l’informa de ma présence, et il vint me trouver. Je lui dis : « Quel est le nom de cette bourgade ? — Tadj Boûrah », me répondit-il. Or, entre elle et la ville de Coûl, où étaient mes compagnons, il y avait deux parasanges de distance. Le gouverneur me conduisit à sa maison et me servit des aliments chauds ; après quoi je me lavai ; il me dit alors : « J’ai chez moi un habit et un turban que m’a laissés en dépôt un Arabe d’Égypte, du nombre des gens du camp qui se trouve à Coûl. — Apporte-les-moi, lui répondis-je, je m’en revêtirai jusqu’à ce que j’arrive au campement. » Il me les apporta, et je reconnus que c’étaient deux de mes vêtements, que j’avais donnés à l’Arabe en question, lors de notre arrivée à Coûl. Je fus fort étonné de cela ; puis je songeai à l’individu qui m’avait porté sur son dos, et je me rappelai ce que m’avait annoncé le saint Abou ’Abd Allah Almorchidy, ainsi que nous l’avons rapporté dans la première partie de ces Voyages, alors qu’il me dit : « Tu entreras dans l’Inde, et tu y rencontreras mon frère Dilchâd, qui te délivrera d’une peine dans laquelle tu seras tombé. » D’un autre côté, je me souvins de la réponse que me fit l’inconnu, quand je lui demandai son nom. Il dit : « Alkalb Alfârih », ce qui veut dire la même chose que le persan Dilchâd, Cœur joyeux. Je sus que c’était le même personnage dont Almorchidy m’avait prédit la rencontre, et que c’était un saint. Je ne jouis de sa société que le court espace de temps dont j’ai parlé.
Ce même jour, j’écrivis à mes compagnons, à Coûl, pour leur faire part de mon salut ; ils m’amenèrent un cheval, m’apportèrent des vêtements et se réjouirent de ma présence. J’appris que la réponse du sultan leur était parvenue ; qu’il avait envoyé, en remplacement de Câfoûr, le martyr, un eunuque appelé Sunbul, le maître de la garde-robe, et qu’il nous avait prescrit de poursuivre notre voyage. J’appris aussi que mes camarades avaient écrit au prince ce qui m’était arrivé, et qu’ils auguraient mal de notre ambassade, à cause de ce qui était survenu dès son début à moi et à Câfoûr ; aussi voulaient-ils s’en retourner. Lorsque je vis l’insistance du sultan à nous ordonner ce voyage, je les pressai de l’accomplir, et ma résolution fut affermie. Ils me répondirent : « Ne vois-tu pas ce qui est advenu au commencement de cette expédition ? Le sultan t’excusera. Retournons donc près de lui, ou bien attendons jusqu’à ce que sa réponse arrive. » Je leur répliquai : « Il n’est pas possible d’attendre ; la réponse nous joindra partout où nous serons. »
Nous partîmes donc de Coûl, et nous campâmes à Bordj Boûrah, où se trouve un bel ermitage, habité par un supérieur aussi beau que vertueux, que l’on appelait Mohammed le Nu, parce qu’il ne revêtait pas d’autre habillement qu’un pagne, descendant, à partir de son nombril, jusqu’à terre ; le reste de son corps demeurait découvert. Il avait été disciple du pieux et saint Mohammed Al’oriân « le Nu », lequel habitait le cimetière de Karâfah, au vieux Caire. (Que Dieu nous fasse profiter de ses mérites !)
Il était au nombre des saints ; il persistait à garder le célibat, et portait une tennoûrah, c’est-à-dire un pagne qui le couvrait depuis le nombril jusqu’aux pieds. On raconte qu’après avoir fait la prière de la nuit close il prenait tout ce qui restait dans l’ermitage de mets, ou d’assaisonnements, ou d’eau, le distribuait aux malheureux, et jetait la mèche de sa lampe ; de sorte qu’il se trouvait le lendemain sans moyen d’existence assuré. Il avait coutume de servir à ses disciples, le matin, du pain et des fèves. Les boulangers et les marchands de fèves accouraient à son ermitage à l’envi les uns des autres ; il en acceptait de quoi nourrir les pauvres, et disait à celui de qui il avait pris ces provisions : « Assieds-toi. » Et cet homme recevait la première aumône, grande ou petite, qui était donné au cheikh ce jour-là.
Voici un autre trait de ce cheikh : lorsque Kazan (ou Ghazan) roi des Tatares (ou Mongols de la Perse), arriva en Syrie avec ses troupes, et qu’il se fut emparé de Damas, à l’exception de sa citadelle, Almélic Annâcir se mit en marche, afin de le repousser, et une rencontre eut lieu entre les deux souverains, à deux journées de distance de Damas, dans un endroit appelé Kachhab. Almélic Annâcir était alors très jeune, et n’était pas habitué aux combats. Il avait près de lui le cheikh Al’oriân, qui mit pied à terre, et prit une chaîne avec laquelle il mit des entraves aux pieds du cheval du roi Nasir, afin que celui-ci ne se retirât pas au moment du combat, à cause de son jeune âge, ce qui aurait occasionné la défaite des musulmans. Le roi Nasir tint ferme, et les Tatares essuyèrent une honteuse déroute, dans laquelle beaucoup d’entre eux furent tués, et beaucoup noyés par les eaux qu’on lâcha sur eux ; aussi, par la suite, ce peuple ne renouvela pas ses tentatives contre les provinces musulmanes. (cf. d’Ohsson, t. IV, p. 330-4 et l’Hist. des sultans Mamlouks, t. II, 2e partie, p. 199 où on lit schakab). Le cheikh Mohammed Al’oriân, disciple de celui dont il a été question en dernier lieu, m’a rapporté que lui-même assista à ce combat, étant alors très jeune.
Cependant, nous partîmes de Bordj Boûrah, et campâmes près de la rivière appelée Abi Siâh, l’Eau noire. Puis nous nous rendîmes à la ville de Kinaoûdj (Canoge), place grande et joliment construite, bien fortifiée. Les denrées y sont à bas prix et le sucre y est très abondant ; de là on l’exporte à Dihly. La ville est entourée d’un grand mur, et nous en avons déjà fait mention. Le cheikh Mou’in eddîn Albâkharzy l’habitait, et nous y traita. Le commandant de Canoge était Firouz Albadakhchâny, de la postérité de Behram Djoûr (Tchoûbîn), compagnon de Chosroès. Elle compte parmi ses habitants plusieurs personnages vertueux et distingués, connus par leurs nobles qualités, et que l’on appelle les enfants de Cheref Djihan, l’Illustration du Monde. Leur aïeul était grand kadi de Daoulet Abad ; il était bienfaisant et grand distributeur d’aumônes, et il obtint l’autorité sur les provinces de l’Inde.
Anecdote relative à ce personnage
On raconte qu’il fut un jour destitué de la dignité de kadi. Or il avait des ennemis, et l’un de ceux-ci l’accusa, près du kadi qui avait été nommé à sa place, d’avoir entre ses mains dix mille dinars à lui appartenant ; mais il ne possédait aucune preuve de son allégation, et il voulait obliger Cheref Djihan à prêter serment. Le kadi manda celui-ci, qui dit au messager : « Que me réclame-t-on ? — Dix mille pièces d’or », répondit l’appariteur. Cheref Djihan envoya cette somme au tribunal du kadi, et elle fut livrée au demandeur. Le sultan ’Alâ eddîn apprit cela, et la fausseté de cette réclamation lui fut démontrée. En conséquence, il rétablit Cheref Djihan dans les fonctions de kadi, et lui donna dix mille pièces d’or.
Nous demeurâmes trois jours à Canoge, et nous y reçûmes la réponse du sultan touchant ce qui me concernait. Elle était ainsi conçue : « Si l’on ne retrouve pas N. (Ibn Batoutah), que Wedjîh Almulc, kadi de Daoulet Abad, parte en sa place. »
Après avoir quitté Canoge, nous campâmes successivement dans les stations de Hanaoul, de Vézirboûr et de Bédjâliçah, puis nous arrivâmes à la ville de Maoury, qui est petite, mais pourvue de beaux marchés. J’y rencontrai le cheikh pieux et vénérable Kothb eddîn, autrement appelé Haïder Alferghâny. Il était atteint d’une maladie. Cependant, il fit des vœux en ma faveur, me donna, comme provision de route, un pain d’orge, et m’apprit que son âge dépassait cent cinquante ans. Ses disciples me racontèrent qu’il jeûnait constamment et souvent longtemps de suite, et accomplissait de nombreux actes de dévotion. Fréquemment il restait dans sa cellule durant quarante jours, prenant pour toute nourriture quarante dattes, une par jour. J’ai vu à Dihly le cheikh nommé Redjeb Alborko’y entrer dans sa cellule, avec quarante dattes, y passer quarante jours et en sortir ensuite, ayant encore treize de ces fruits.
Après être partis de Maoury, nous arrivâmes à la ville de Marh Cette ville est grande ; la plupart des habitants sont des idolâtres, et ils sont soumis à un tribut. Elle est bien fortifiée, et l’on y trouve d’excellent froment, tel qu’il n’en existe pas ailleurs. On en exporte à Dihly ; ses grains sont allongés, très jaunes et d’un fort volume. Je n’ai point vue de pareil froment, excepté en Chine. La ville de Marh appartient, dit-on, aux Malawah. On nomme ainsi une tribu d’Hindous qui ont le corps robuste, la stature élevée, le visage beau. Leurs femmes sont douées d’une exquise beauté, et sont renommées pour l’agrément de leur commerce et pour les plaisirs qu’elles savent procurer. Il en est de même des femmes des Mahrates et de celles de l’île de Dhîbat Almahal (les Maldives).
Nous partîmes de Marh pour la ville d’Alâboûr, qui est petite, et dont la plupart des habitants sont des infidèles qui payent tribut aux musulmans. A la distance d’une journée de là demeurait un sultan idolâtre, appelé Katam, qui était le roi de Djenbîl. Il assiégea la ville de Gualior ; après quoi il fut tué.
Ce souverain idolâtre avait précédemment assiégé la ville de Râbéry, place située sur la rivière Djomna, et dont dépendent beaucoup de villages et de terres en culture. Elle avait pour commandant Khatthâb, l’Afghân, qui était au nombre des braves. Katam demanda (ensuite) du secours à un autre sultan infidèle, que l’on nommait Radjoû, et dont la ville capitale s’appelait Sulthânboûr. Tous deux mirent le siège devant Râbéry, et Khatthâb demanda assistance au sultan de l’Inde, qui tarda à le secourir, car la place assiégée se trouvait à quarante journées de Dihly. En conséquence, le commandant craignit que les infidèles ne le vainquissent. Il rassembla environ trois cents hommes de la tribu des Afghans, autant d’esclaves armés, et environ quatre cents individus choisis dans le reste de la population. Tous placèrent leurs turbans déroulés au cou de leurs chevaux, car telle est la coutume des Indiens, lorsqu’ils veulent mourir et qu’ils font à Dieu le sacrifice de leur vie. Khatthâb et ses contribules s’avancèrent, suivis du reste de la troupe. Dès l’aurore, ils ouvrirent les portes de la ville et se précipitèrent comme un seul homme sur les infidèles, qui étaient au nombre d’environ quinze mille. Par la permission de Dieu, ils mirent en déroute et tuèrent leurs deux rois, Katam et Radjôu, dont ils envoyèrent les têtes au sultan de l’Inde. Il n’échappa, parmi les idolâtres, qu’un petit nombre de fugitifs.
Histoire de l’émir d’Alâboûr et de son martyre
L’émir d’Alâboûr était Bedr, l’Abyssin, un des esclaves du sultan de l’Inde. C’était un de ces héros dont la bravoure a passé en proverbe. Il ne cessait de faire tout seul des courses contre les infidèles, de tuer et de prendre des captifs, de sorte que sa réputation se répandit au loin, qu’il devint célèbre et que les Hindous le craignirent. Il était de haute taille et fort gros, et mangeait une brebis tout entière en une seule fois. On m’a raconté qu’il avalait environ un rithl et demi de beurre fondu après son repas, selon la coutume observée par les Abyssins dans leur pays natal. Il avait un fils qui approchait de lui en bravoure.
Il arriva un certain jour que Bedr fondit, avec un détachement de ses esclaves, sur un village appartenant à des Hindous, et que son cheval tomba avec lui dans une fosse. Les villageois se rassemblèrent autour de lui, et l’un d’eux le frappa avec une gattârah. On nomme ainsi un fer semblable à un soc de charrue (il a une extrémité creuse) dans laquelle on introduit la main, et qui recouvre l’avant-bras ; la partie restante est longue de deux coudées, et les coups qu’elle porte sont mortels ; l’Hindou tua donc Bedr d’un coup de cette arme. Les esclaves du mort combattirent très courageusement, s’emparèrent du village, en tuèrent les habitants, firent prisonnières leurs femmes, etc., retirèrent le cheval sain et sauf de la fosse où il était tombé, et le ramenèrent au fils de Bedr. Une rencontre singulière, c’est que ce jeune homme, étant monté sur le même cheval, prit la route de Dihly. Les idolâtres l’attaquèrent ; il les combattit jusqu’à ce qu’il fût tué, et le coursier retourna près des compagnons de son maître, qui le reconduisirent à la famille du défunt. Un beau-frère de celui-ci le prit pour monture ; mais les Hindous le tuèrent aussi sur ce même cheval.
D’Alâboûr, nous nous rendîmes à la ville de Gâlyoûr, appelée encore Gouyâlior (Gualyor), qui est grande et pourvue d’une citadelle inexpugnable, isolée sur la cime d’une haute montagne. On voit à la porte de cette citadelle la figure d’un éléphant et celle de son cornac, toutes deux en pierre. Il en a déjà été fait mention, à l’article du sultan Kothb eddîn (t. III). L’émir de Gâlyoûr, Ahmed, fils de Sîrkhân, personnage distingué, me traitait avec considération pendant mon séjour près de lui, antérieurement au voyage dont il est ici question. J’entrai chez lui un jour, au moment où il voulait faire fendre en deux par le milieu du corps un idolâtre. Je lui dis : « Par Dieu ! ne fais pas cela, je n’ai jamais vu tuer personne en ma présence. » Il ordonna de mettre en prison cet individu, qui échappa ainsi à la mort.
Nous partîmes de la ville de Gâlyoûr pour celle de Perouan, petite place située au milieu du pays des idolâtres, mais appartenant aux musulmans. Elle a pour commandant Mohammed, fils de Beïram, turc d’origine. Les lions sont très nombreux dans son voisinage. Un de ses habitants m’a raconté qu’un de ces animaux y entrait pendant la nuit, quoique les portes fussent fermées, et y enlevait des hommes, de sorte qu’il tua beaucoup de citadins. On se demandait avec étonnement de quelle manière il pouvait entrer. Un habitant de la ville, Mohammed Attaoufîry, dans le voisinage de qui j’étais logé, me rapporta que ce lion s’introduisit nuitamment dans sa maison et emporta un enfant de dessus son lit. Un autre individu m’a raconté qu’il se trouvait en nombreuse société dans une habitation où se célébrait une noce. Un des invités sortit pour satisfaire un besoin, et le lion l’enleva. Les camarades de ce malheureux allèrent à sa recherche, et le trouvèrent étendu dans le marché ; le lion avait bu son sang, mais n’avait pas dévoré sa chair. On prétend que c’est ainsi qu’il agit envers les hommes. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que quelqu’un m’a rapporté que l’auteur de ces maux n’était pas un lion, mais un homme, du nombre de ces magiciens appelés djoguis, lequel revêtait la figure d’un lion. Lorsqu’on me raconta cela, je n’en voulus rien croire, quoique nombre de personnes me l’affirmassent. Or, transcrivons ici une partie de ce qui concerne les susdits magiciens.
Ces gens-là accomplissent des choses merveilleuses. C’est ainsi qu’un d’eux restera des mois entiers sans manger ni boire. On creuse pour beaucoup d’entre eux des trous sous la terre. Quand le djogui y est descendu, on bouche la fosse avec de la maçonnerie, en y laissant seulement une ouverture suffisante pour que l’air y pénètre. Cet individu y passe plusieurs mois ; j’ai même entendu dire que quelques djoguis demeurent ainsi une année. J’ai vu dans la ville de Mandjaroûr (Mangalore) un musulman qui avait pris des leçons de ces gens-là. On avait dressé pour lui une espèce de plate-forme, sur laquelle il se tint pendant vingt-cinq jours sans boire ni manger. Je le laissai dans cet état, et j’ignore combien de temps il y demeura encore après mon départ.
Le peuple prétend que les individus de cette classe composent des pilules, et qu’ils en avalent une pour un nombre de jours ou de mois déterminé, durant lesquels ils n’ont besoin ni d’aliment ni de boisson. Ils prédisent les choses cachées. Le sultan les vénère et les admet dans sa société. Parmi eux il y en a qui bornent leur nourriture aux seuls légumes ; il y en a qui ne mangent pas de viande, et ce sont les plus nombreux. Ce qu’il y a de certain dans leur affaire, c’est qu’ils se sont accoutumés à l’abstinence, et n’ont aucun besoin des biens du monde ni de ses pompes. Parmi eux il y en a dont le seul regard suffit pour faire tomber mort un homme. Les gens du commun disent que, dans ce cas-là, si l’on vient à fendre la poitrine du mort, on n’y trouve pas de cœur. « Son cœur, prétendent-ils, a été mangé. » Cela a lieu surtout chez les femmes. La femme qui agit ainsi est appelée caftâr. (hyène, en persan).
Lorsqu’arriva dans l’Inde la grande famine causée par la sécheresse, pendant que l’empereur se trouvait dans le pays de Tiling, ce prince publia un ordre portant que l’on donnât aux citoyens de Dihly de quoi se nourrir, sur le pied d’un rithl et demi par personne et par jour. En conséquence, le vizir les rassembla et partagea ceux d’entre eux qui étaient indigents entre les émirs et les kadis, afin que ceux-ci prissent soin de les nourrir. Pour ma part, j’en reçus cinq cents. Je construisis pour eux des hangars dans deux maisons et les y établis. Je leur distribuais tous les cinq jours les provisions nécessaires à leur subsistance durant cet espace de temps. Or, un certain jour, on m’amena une femme du nombre de ces gens-là, et l’on me dit : « C’est une caftâr, et elle a dévoré le cœur d’un enfant qui se trouvait près d’elle. » On apporta le corps de cet enfant. Par conséquent je prescrivis aux dénonciateurs de conduire cette femme au vice-roi. Celui-ci ordonna qu’on lui fasse subir une épreuve. Voici en quoi elle consista on remplit d’eau quatre jarres, qu’on lia aux mains et aux pieds de la femme ; on jeta celle-ci dans la rivière Djomna, et elle ne se noya pas. On sut ainsi que c’était une caftâr, car si elle n’avait pas surnagé au-dessus de l’eau, elle n’aurait pas été une de ces misérables. Alors, le vice-roi commanda de la brûler toute vive. Les habitants de la ville, hommes et femmes, accoururent et ramassèrent ses cendres, car ces gens-là prétendent que quiconque fait avec cela des fumigations est en sûreté contre les enchantements des caftârs pour toute la durée de l’année.
Le sultan m’envoya chercher un certain jour, pendant que je résidais près de lui, dans sa capitale. Je me rendis en sa présence et le trouvai dans un cabinet, ayant avec lui plusieurs de ses familiers et deux de ces djoguis. Ces gens s’enveloppent dans des manteaux et couvrent leur tête, parce qu’ils la dépouillent de ses cheveux avec des cendres, de la même manière que les autres hommes emploient pour s’épiler sous les aisselles. Le sultan m’ordonna de m’asseoir, ce que je fis, et il dit à ces deux individus : « Cet étranger (litt. Cet homme illustre) est d’un pays éloigné ; montrez-lui donc ce qu’il n’a jamais vu. — Oui », répondirent-ils, et l’un d’eux s’accroupit ; puis il s’éleva de terre, de sorte qu’il resta en l’air au-dessus de nous, dans la posture d’un homme accroupi. Je fus étonné de cela, la crainte me saisit et je tombai évanoui. Le sultan commanda de me faire avaler une potion qu’il tenait prête ; je revins à moi et m’assis. Cet individu-là était encore dans la même posture. Son camarade tira d’un sac qu’il portait sur lui une sandale avec laquelle il frappa le sol, à la façon d’un homme en colère. La sandale monta jusqu’à ce qu’elle fût arrivée au-dessus du cou de l’individu accroupi en l’air. Elle commença alors à le frapper à la nuque, pendant qu’il descendait petit à petit, de sorte qu’il se trouva enfin assis près de nous. Le sultan me dit : « L’homme accroupi est le disciple du propriétaire de la sandale. » Puis il ajouta : « Si je ne craignais pour ta raison, je leur ordonnerais d’opérer des choses plus extraordinaires que ce que tu as vu. » Je m’en retournai, je fus pris d’une palpitation de cœur et tombai malade ; mais le sultan prescrivit de m’administrer une potion qui me débarrassa de ce mal.
Nous dirons donc que nous partîmes de la ville de Perouan pour la station d’Amouâry, puis pour celle de Cadjarrâ où se trouve un grand bassin dont la longueur est d’environ un mille et près duquel il y a des temples où sont des idoles, que les musulmans ont mutilées. Au milieu de l’étang s’élèvent trois pavillons de pierres rouges hauts de trois étages ; il a à chacun de ses quatre angles un autre pavillon. Ce lieu est habité par une troupe de djoguis, qui ont agglutiné leurs cheveux au moyen d’une substance gluante et les ont laissés croître, de sorte qu’ils sont devenus aussi longs que leurs corps. Le teint de ces gens-là est extrêmement jaune, par suite de leur abstinence. Beaucoup de musulmans les suivent, afin d’apprendre leurs secrets. On raconte que quiconque est atteint d’une infirmité, telle que la lèpre ou l’éléphantiasis, se retire près d’eux pendant un long espace de temps, et est guéri par la permission du Dieu très haut.
La première fois que je vis des gens de cette classe, ce fut dans le camp du sultan Thermachîrîn, souverain du Turkestan. Ils étaient au nombre d’environ cinquante. On leur creusa une fosse sous la terre, et ils y séjournèrent sans en sortir, sinon pour satisfaire quelque besoin. Ils ont une espèce de corne dont ils sonnent au commencement du jour, vers sa fin et après la nuit close. Tout ce qui les concerne est extraordinaire. L’homme qui prépara pour le sultan Ghiâth eddîn Addâméghâny, souverain de la côte de Coromandel, des pilules que ce prince avalait pour se fortifier dans l’accomplissement de l’acte vénérien, cet homme, dis-je était un des leurs. Parmi les ingrédients de ces pilules se trouvait de la limaille de fer. Leur effet plut au sultan ; il en prit plus que la quantité nécessaire et mourut. Il eut pour successeur son neveu Nasir eddîn, qui traita avec considération ce djogui et l’éleva en dignité.
Cependant, nous partîmes pour la ville de Tchandîry, qui est grande et pourvue de marchés magnifiques. C’est là qu’habite le chef des émirs de la contrée, ’Izz eddîn Albénétâny, que l’on appelle A’zham Mélik (le plus grand roi), et qui est un homme excellent et distingué. Il admet dans sa familiarité les savants, et parmi eux : 1° le jurisconsulte ’Izz eddîn Azzobeïry ; 2° le savant légiste Wédjîh eddîn Albiâny, originaire de la ville de Biânah, dont nous avons parlé ci-dessus ; 3° le jurisconsulte et kadi nommé Kadi Khâssah ; et, enfin 4° l’imâm Chams eddîn. Le lieutenant d’A’zham Mélik, pour ce qui concerne les affaires du Trésor, est appelé Kamar eddîn, et son lieutenant, pour les choses qui regardent l’armée, Sé’âdah Attilinguy, un des principaux héros, devant qui les troupes passent en revue. A’zham Mélik ne se montre que le vendredi, et rarement les autres jours.
De Tchandîry nous nous rendîmes à la ville de Zhihâr (Dhâr), qui est la capitale du Malwa, le plus grand district de ces régions. Les grains y abondent, surtout le froment. De cette ville, on exporte à Dihly des feuilles de bétel. Il y a entre les deux places vingt-quatre jours de distance. Sur le chemin qui les sépare se trouvent des colonnes sur lesquelles est gravé le nombre de milles qu’il y a entre deux colonnes. Quand le voyageur désire savoir combien de chemin il a parcouru dans sa journée, et combien il lui en reste pour arriver à la station ou à la ville vers laquelle il se dirige, il lit l’inscription qui se trouve sur les colonnes et connaît ce qu’il veut apprendre. La ville de Zhihâr est un fief appartenant au cheikh Ibrahim, originaire de Dhibat Almahal (les îles Maldives).
Le cheikh Ibrahim, étant arrivé près de cette ville, fixa son habitation en cet endroit. Il rendit à la fertilité un terrain inculte, situé dans le voisinage, et y sema des pastèques. Celles-ci se trouvèrent extrêmement douces, et on n’en voyait pas de pareilles en ce canton. Les cultivateurs avaient beau semer des pastèques dans les terres voisines, elles ne ressemblaient pas à celles-là. Ibrahim donnait à manger aux fakirs et aux indigents. Lorsque le sultan se dirigea vers le pays de Ma’bar, le cheikh lui fit présent d’une pastèque, qu’il accepta et trouva excellente. Aussi lui donna-t-il en fief la ville de Dhâr, et lui prescrivit-il de construire un ermitage sur une colline qui dominait cette ville. Ibrahim éleva cet édifice avec le plus grand soin ; il y servait des aliments à tout-venant. Il persévéra dans cette conduite durant plusieurs années ; après quoi il alla trouver le sultan et lui porta treize lacs (de drachmes), lui disant : « Voici ce qui me reste de l’argent que j’ai employé à donner à manger au public ; le fisc y a plus de droits que moi. » Le sultan accepta la somme ; mais il n’approuva pas l’action du cheikh, d’avoir amassé des richesses et de n’en avoir pas dépensé la totalité à distribuer des aliments.
C’est dans cette même ville de Dhâr que le fils de la sœur du vizir Khodjah Djihan voulut assassiner son oncle, s’emparer des trésors de celui-ci et se rendre ensuite près du chef rebelle, dans le pays de Ma’bar (cf. t. III). Ce complot étant parvenu à la connaissance de son oncle, il se saisit de lui et de plusieurs émirs et les envoya au sultan. Le souverain mit à mort les émirs et renvoya leur chef à son oncle, le vizir, qui le fit périr.
Quand le neveu du vizir eut été renvoyé à son oncle, celui-ci ordonna de lui faire éprouver le même supplice qu’avaient subi ses camarades. Le malheureux avait une concubine qu’il chérissait ; il la manda, lui fit manger du bétel, et en accepta de sa main ; puis il l’embrassa en signe d’adieu et fut jeté aux éléphants. Il fut écorché et sa peau remplie de paille. Lorsque la nuit fut arrivée, la jeune femme sortit de la maison et se précipita dans un puits voisin, non loin du lieu où son amant avait péri. Le lendemain, elle fut trouvée morte ; on la retira du puits et l’on ensevelit son corps dans le même tombeau où furent déposées les chairs du neveu du vizir. Cet endroit fut appelé Koboûr (Goûr) Achikân, ce qui signifie en persan « le tombeau des amants ».
De la ville de Dhâr nous nous rendîmes à celle d’Oudjaïn, cité belle et bien peuplée, où résidait le roi Nasir eddîn, fils d’Aïn Almulc, homme distingué, généreux et savant, qui souffrit le martyre dans l’île de Sendâboûr, lorsqu’elle fut conquise. J’ai visité son tombeau dans cet endroit-là, ainsi qu’il en sera fait mention. C’est aussi à Oudjaïn qu’habitait le jurisconsulte et médecin Djémal eddîn, le Maghrébin originaire de Grenade.
D’Oudjaïn, nous allâmes à Daoulet Abad, qui est une ville considérable, illustre, égale à la capitale Dihly par l’élévation de son rang et la vaste étendue de ses quartiers. Elle est divisée en trois portions, dont l’une est Daoulet Abad (proprement dite). Celle-ci est particulièrement destinée à l’habitation du sultan et de ses troupes. La seconde portion est nommée Catacah. Quant à la troisième, c’est la citadelle qui n’a pas sa pareille sous le rapport de la force, et qui est appelée Doueïguir.
C’est à Daoulet Abad que demeure le très grand khân Kothloû khân, précepteur du sultan. Il en est le commandant et y tient la place du monarque, ainsi que dans les pays de Sâghar, de Tiling et dépendances. Le territoire de ces provinces comprend un espace de trois mois de marche, parfaitement peuplé. Le tout est soumis aux ordres de Kothloû khân, et ses lieutenants y exercent l’autorité. La forteresse de Doueïguir, dont nous avons fait mention, est un rocher situé au milieu d’une plaine. Il a été taillé, et l’on a bâti sur le sommet un château où l’on monte avec une échelle de cuir, que l’on enlève la nuit.
C’est là qu’habitent, avec leurs enfants, les Mofred, qui sont les mêmes que les Zimâmy (soldats inscrits sur les listes de l’armée). On y emprisonne dans des fosses les individus qui se sont rendus coupables de grands crimes. Il y a dans ces fosses des rats énormes, plus gros que les chats. Ces derniers animaux s’enfuient devant eux et ne peuvent leur résister, car ils seraient vaincus. Aussi ne les prend-on qu’en ayant recours à des ruses. J’ai vu ces rats à Doueïguir et j’en ai été émerveillé.
Le roi Khatthâb, l’Afghân, m’a raconté qu’il fut une fois mis en prison dans une fosse située dans cette forteresse, et que l’on appelait la Fosse aux rats. « Ces animaux, dit-il, se rassemblaient près de moi, la nuit, afin de me dévorer. Je me défendais contre eux, non sans éprouver de la fatigue. Je vis ensuite dans un songe quelqu’un qui me dit : « Lis cent mille fois le premier chapitre de la Piété sincère (cxiie chapitre du Coran), et Dieu te délivrera. » Je récitai ce chapitre, continue Khatthâb, et lorsque je l’eus achevé, je fus tiré de prison. Le motif de ma sortie de captivité fut le suivant : le roi Mell était emprisonné dans une citerne voisine de la mienne. Or il tomba malade, les rats mangèrent ses doigts et ses yeux, et il mourut. Cette nouvelle étant parvenue au sultan, il dit : « Faites sortir Khatthâb, de peur qu’il ne lui arrive la même chose. »
Ce fut dans la forteresse de Doueïguir que se réfugièrent Nasir eddîn, fils du même roi Mell, et le kadi Djélal eddîn, lorsqu’ils furent mis en déroute par le sultan.
Les habitants du territoire de Daoulet Abad appartiennent à la tribu des Mahrattes, dont Dieu a daigné gratifier les femmes d’une beauté particulière, surtout en ce qui concerne le nez et les sourcils. Elles possèdent des talents que n’ont pas les autres femmes dans l’art de procurer du plaisir aux hommes et dans la connaissance des divers actes qui ont rapport à l’union des sexes. Les idolâtres de Daoulet Abad sont voués au négoce, et leur principal commerce consiste en perles. Leurs richesses sont considérables ; on donne à ces marchands le nom de Sâha (sanscrit Sârthavahâ, pali Sâtthavahâ, prononcé à Ceylan Sattvahé ou Sattbahé), mot dont le singulier est sâh, et ils ressemblent aux Câremis de l’Égypte.
On trouve à Daoulet Abad des raisins et des grenades ; la récolte de ces fruits a lieu deux fois chaque année. Cette place est au nombre des villes les plus importantes et les plus considérables, en ce qui regarde les taxes et l’impôt foncier, et cela à cause de sa nombreuse population et de l’étendue de son territoire. On m’a raconté qu’un certain Hindou prit à ferme, moyennant dix-sept coroûrs, les contributions de la ville et celles de son district. Ce dernier s’étend, ainsi que nous l’avons dit, l’espace de trois mois de marche. Quant au coroûr, il équivaut à cent lacs, et un de ces derniers, à cent mille dinars. Mais l’Hindou ne satisfit pas à ses engagements ; un reliquat demeura à sa charge, ses trésors furent saisis et lui-même fut écorché.
Description du marché des chanteurs
Il y a dans la ville de Daoulet Abad un marché pour les chanteurs et les chanteuses. Ce marché, que l’on appelle Tharb Abad (le séjour de l’allégresse) est au nombre des plus beaux et des plus grands qui existent. Il a beaucoup de boutiques, dont chacune a une porte qui aboutit à la demeure de son propriétaire ; indépendamment de cette porte, la maison en a une autre. La boutique est décorée de tapis, et au milieu d’elle s’élève une espèce de grand lit, sur lequel s’assied ou se couche la chanteuse. Celle-ci est ornée de toute espèce de bijoux, et ses suivantes agitent son lit (ou hamac). Au centre du marché, il y a un grand pavillon, garni de tapis et doré, où vient s’asseoir tous les jeudis, après la prière de quatre heures du soir, le chef des musiciens, ayant devant lui ses serviteurs et ses esclaves. Les chanteuses arrivent troupe par troupe, chantent et dansent en sa présence, jusqu’au moment du coucher du soleil ; après quoi il s’en retourne.
Dans ce marché, il y a des mosquées destinées à la prière, et où des chapelains récitent l’oraison dite térâouîh, durant le mois de ramadhan. Un certain souverain des Hindous idolâtres, toutes les fois qu’il passait par ce marché, descendait dans son pavillon et les musiciennes chantaient en sa présence. Un certain sultan des musulmans agissait de même.
De cet endroit, nous nous rendîmes à la ville de Nadharbâr, qui est petite, et habitée par les Mahrattes. Ceux-ci sont des ouvriers excellents dans les arts mécaniques ; les médecins, les astrologues et les nobles Mahrattes s’appellent brahmanes, et aussi kchatria. Ils se nourrissent de riz, de légumes et d’huile de sésame, car ils ne veulent pas tourmenter les animaux, ni les égorger ; et ils se lavent avant de manger, comme on se purifie (chez nous) d’une pollution. Ils ne se marient pas avec leurs parentes, à moins qu’il n’y ait entre chacun des conjoints sept degrés de parenté. Ils ne boivent pas de vin, car ce serait à leurs yeux le plus grand des vices ; il en est de même, dans toute l’Inde, chez les musulmans : chacun de ceux-ci qui boit du vin est puni de quatre-vingts coups de fouet, et mis en prison pendant trois mois dans une fosse, qu’on ne lui ouvre qu’au moment des repas.
De Nadharbâr, nous allâmes à Sâghar, grande ville, située sur un fleuve considérable, appelé du même nom. Près des rives de ce fleuve, on voit des roues hydrauliques et des vergers, où croissent des manguiers, des bananiers et des cannes à sucre. Les habitants de cette ville sont des gens de bien, des hommes pieux et honnêtes, et tous leurs actes sont dignes d’approbation. Ils ont des vergers où se trouvent des ermitages, destinés aux voyageurs. Quiconque fonde un ermitage lui lègue un verger et en donne la surveillance à ses enfants. Si ces derniers ne laissent pas de postérité, la surveillance passe aux juges. La population de Sâghar est très considérable ; les étrangers s’y rendent, afin de participer aux mérites de ses habitants, et parce qu’elle est exempte de taxes et d’impôts.
De Sâghar, nous nous transportâmes à Kinbâyah (Cambaie), qui est situé sur un golfe formé par la mer, et ressemblant à un fleuve. Les vaisseaux y entrent, et l’on y sent le flux et le reflux. J’y ai vu des navires à l’ancre dans le limon, au moment du reflux, et qui, lorsqu’arrivait le flux, flottaient sur l’eau. Kinbâyah est au nombre des plus belles villes, par l’élégance de sa construction et la solidité de ses mosquées. Cela vient de ce que la plupart de ses habitants sont des marchands étrangers, qui y bâtissent continuellement de belles maisons et de superbes temples ; ils cherchent en cela à se surpasser les uns les autres. Parmi les grandes habitations que l’on y voit se trouve celle du chérif Assâmarry (cf. t. III), avec qui m’arriva l’aventure des pâtisseries, et que le roi des favoris accusa de mensonge à cette occasion. Je n’ai jamais vu de pièces de bois plus fortes que celles que je vis dans sa demeure. La porte de celle-ci ressemble à la porte d’une ville, et elle a tout près d’elle une grande mosquée, qui porte le nom d’Assâmarry. On remarque encore la demeure du roi des marchands, Alcâzéroûny, qui a aussi près d’elle sa mosquée, et la demeure du négociant Chams eddîn Coulâh Doûz. Ces deux derniers mots signifient (en persan) « celui qui coud les bonnets ».
Lorsqu’arriva ce que nous avons déjà raconté, savoir la rébellion du kadi Djélal eddîn Alafghâny, ce Chams eddîn ici mentionné, le patron de navire Elias, qui était un des principaux habitants de Kinbâyah, et le roi des médecins, dont il a été parlé plus haut, voulurent se défendre dans cette ville contre le rebelle. Ils entreprirent de creuser autour d’elle un fossé, car elle n’avait pas de murailles. Mais Djélal les vainquit et entra dans la place. Les trois individus en question se cachèrent dans une même maison, et craignirent d’être découverts. En conséquence, ils convinrent de se tuer, et chacun d’eux en frappa un autre avec une gattârah. (nous avons déjà dit en quoi consiste cet objet, ci-dessus) Deux d’entre eux moururent, mais le roi des médecins survécut.
Parmi les principaux marchands de Kinbâyah, on trouvait encore Nedjm eddîn Aldjîlâny, qui était doué d’une belle figure et extrêmement riche. Il fit construire en cette ville une grande maison et une mosquée. Dans la suite, le sultan le manda, le nomma gouverneur de Kinbâyah et lui conféra les honneurs. Cela fut la cause de la perte non seulement de ses richesses, mais de sa vie.
Le commandant de Kinbâyah, au moment de notre arrivée en cette ville, était Mokbil Attilinguy, qui jouissait d’une grande considération auprès du sultan. Il avait près de lui Accheikh Zâdeh d’Ispahân, qui lui tenait lieu de suppléant dans toutes ses affaires. Ce cheikh possédait des richesses considérables, et avait une profonde connaissance des affaires de l’État. Il ne cessait d’envoyer des sommes d’argent dans son pays, et de méditer des ruses afin de s’enfuir. Le sultan eut connaissance de cela, et on lui rapporta qu’il projetait de prendre la fuite. Il écrivit à Mokbil de lui envoyer cet individu, et Mokbil l’ayant fait partir en poste, on l’amena devant le monarque, qui lui donna des gardiens. Or c’est la coutume, quand ce prince a donné des surveillants à quelqu’un, que cet individu n’échappe que très rarement. Le cheikh s’accorda avec son gardien, moyennant une somme d’argent qu’il devait lui payer, et tous deux s’enfuirent. Un homme digne de foi m’a raconté avoir vu ce personnage dans l’angle d’une mosquée de la ville de Kalhât, ajoutant qu’il parvint ensuite dans son pays natal, rassembla ses trésors et fut à l’abri de ce qu’il craignait.
Le roi Mokbil nous traita un jour dans son palais. Par un hasard singulier, le kadi de la ville, qui était borgne de l’œil droit, se trouva assis en face d’un chérif de Bagdad qui lui ressemblait beaucoup par sa figure et son infirmité, sauf qu’il était borgne de l’œil gauche. Le chérif se mit à considérer le juge en riant. Le kadi l’ayant réprimandé, il lui répondit : « Ne m’adresse pas de reproches, car je suis plus beau que toi. — Comment cela ? », demanda le magistrat. Le chérif répliqua : « C’est parce que tu es borgne de l’œil droit, et que je ne le suis que du gauche. » Le gouverneur et les assistants se mirent à rire et le juge fut honteux. Il ne put répliquer à son interlocuteur, car dans l’Inde les chérifs sont extrêmement considérés.
Parmi les gens de bien de cette ville (Cambaie) se trouvait le pèlerin Nasir, originaire du Diârbecr et qui habitait un des pavillons de la mosquée principale. Nous le visitâmes et partageâmes son repas. Il lui arriva de venir trouver le kadi Djélal, lorsque celui-ci, à l’époque de sa rébellion, entra dans la ville de Kinbâyah. On rapporta au sultan qu’il avait prié en faveur du rebelle. Il s’enfuit, de peur d’être mis à mort comme Alhaïdéry. Un autre homme de bien, habitant Kinbâyah, est le marchand Khodjah Ishak, qui possède un ermitage où l’on sert à manger à tout-venant. Il dépense beaucoup en faveur des fakirs et des indigents, et malgré cela sa richesse croît et augmente.
De Kinbâyah, nous nous rendîmes à la ville de Câouy (Goa), située sur un golfe où l’on éprouve le flux et le reflux. Elle fait partie des États du raja infidèle Djâlansy, dont nous parlerons bientôt. De Câouy, nous allâmes à Kandahar qui est une ville considérable, appartenant aux idolâtres, et située sur un golfe formé par la mer.
C’est un infidèle nommé Djâlansy, qui est soumis à l’autorité des musulmans, et offre chaque année un présent au roi de l’Inde. Lorsque nous arrivâmes à Kandahar, il sortit à notre rencontre et nous témoigna la plus grande considération, au point de quitter son palais, et de nous y loger. Nous reçûmes la visite de ceux des principaux musulmans qui habitaient à sa cour, tels que les enfants de Khodjah Bohrah, au nombre desquels se trouvait le patron de navire Ibrahim, qui avait six vaisseaux à lui appartenant. C’est à Kandahar que nous nous embarquâmes sur mer.
Nous montâmes dans un vaisseau appartenant audit Ibrahim et que l’on nommait Aldjâguer. Nous y embarquâmes soixante et dix des chevaux faisant partie du présent offert par le roi de l’Inde à l’empereur de la Chine, et nous plaçâmes les autres, avec les montures de nos compagnons, dans un navire qui était la propriété d’un frère d’Ibrahim, et que l’on appelait Menoûrt. Djâlansy nous donna un vaisseau où nous mîmes les chevaux de Zhéhîr eddîn, de Sunbul et de leurs camarades. Il le pourvut en notre faveur d’eau, de vivres et de fourrages, et fit partir en notre compagnie son fils sur un navire nommé Alocaïry, et qui ressemble à un ghorâb (une galère), sauf qu’il est plus spacieux. Il est pourvu de soixante rames et on le recouvre d’une toiture au moment du combat, afin que ni les dards ni les pierres n’atteignent les rameurs. Je montai à bord du Djâguer, où se trouvaient cinquante archers et autant de guerriers abyssins. Ceux-ci sont les dominateurs de cette mer, et lorsqu’il s’en trouve un seul à bord d’un vaisseau les pirates et les idolâtres hindous s’abstiennent toujours de l’attaquer.
Au bout de deux jours, nous arrivâmes à l’île de Beïrem, qui est inhabitée et éloignée de la terre ferme de quatre milles. Nous y descendîmes et puisâmes de l’eau dans un réservoir qui s’y trouve. Le motif pour lequel elle est déserte, c’est que les musulmans l’envahirent sur les infidèles ; depuis lors, elle n’a plus été habitée. Le roi des marchands, dont il a été question, avait voulu la repeupler ; il y bâtit un retranchement, y plaça des mangonneaux et y établit quelques musulmans.
Nous partîmes de Beïrem et arrivâmes le lendemain à la ville de Koukah, qui est grande et possède de vastes marchés. Nous jetâmes l’ancre à quatre milles de distance, à cause du reflux. Je descendis dans une barque avec quelques-uns de mes compagnons, lors du reflux, afin d’entrer dans la place. La barque s’embourba et nous restâmes à environ un mille de la ville. Lorsque notre bateau s’enfonça dans le limon, je m’appuyai sur deux de mes camarades. Les assistants me firent craindre le retour du flux avant que j’arrivasse à Koukah. Or je ne savais pas bien nager ; mais je parvins sans encombre à la ville et fis le tour de ses marchés. J’y vis une mosquée dont on attribuait la construction à Khidhr et à Elias. J’y fis la prière du coucher du soleil, et y trouvai une troupe de fakirs haïdériens, accompagnés de leur supérieur. Je retournai ensuite au vaisseau.
C’est un idolâtre, appelé Doncoûl, qui témoignait de la soumission au sultan de l’Inde, mais qui en réalité était un rebelle.
Trois jours après avoir remis à la voile, nous arrivâmes à l’île de Sendâboûr, au milieu de laquelle il y a trente-six villages. Elle est entourée par un golfe, et, au moment du reflux, l’eau qu’on y trouve est douce et agréable, tandis qu’au moment du flux elle est salée et amère. Il y a au milieu de l’île deux villes, l’une ancienne, de la construction des infidèles, la seconde bâtie par les musulmans à l’époque où ils conquirent cette île pour la première fois. Il y a dans la seconde de ces villes une grande mosquée cathédrale, qui ressemble aux mosquées de Bagdad, et qu’a fondée le patron de navire Haçan, père du sultan Djémal eddîn Mohammed Alhinaoûry, dont il sera question plus loin, s’il plaît à Dieu, ainsi que de mon séjour près de lui, quand l’île fut conquise pour la seconde fois. Nous laissâmes derrière nous cette île, en passant tout près d’elle, et nous jetâmes l’ancre près d’une petite île voisine du continent, où se trouvent un temple, un verger et un bassin d’eau. Nous y rencontrâmes un djogui.
Lorsque nous eûmes mis pied à terre dans cette petite île, nous y trouvâmes un djogui appuyé contre le mur d’un bodkhânah, c’est-à-dire d’un temple d’idoles. Il se tenait entre deux de ces idoles et présentait des traces de mortifications. Nous lui adressâmes la parole, mais il ne nous répondit pas. Nous regardâmes s’il avait près de lui quelque aliment, et nous n’en vîmes aucun. Pendant que nous nous livrions à cet examen, il poussa une grande clameur et aussitôt une noix de coco tomba devant lui ; il nous la présenta. Nous fûmes surpris de cela, et nous lui offrîmes des pièces d’or et d’argent, qu’il n’accepta pas. Nous lui apportâmes des provisions, qu’il refusa également. Un manteau de poil de chameau était étendu par terre devant lui. Je retournai ce vêtement dans mes mains, et il me le remit. J’avais dans ma main un chapelet de coquillages, qu’il mania et que je lui donnai. Il le frotta entre ses doigts, le flaira, le baisa, en montrant le ciel, puis le côté où se trouve la kiblah. Mes compagnons ne comprirent pas ses signes ; mais je compris qu’il indiquait qu’il était musulman, et cachait sa religion aux habitants de cette île. Il se nourrissait de noix de cocotier. Lorsque nous prîmes congé de lui, je baisai sa main et mes camarades désapprouvèrent mon action. Il s’aperçut de leur improbation, prit ma main, la baisa en souriant et nous fit signe de nous en retourner. Nous partîmes donc, et je fus le dernier de la bande à sortir. Le djogui m’ayant tiré par mon vêtement, je tournai la tête vers lui, et il me donna dix pièces d’or. Quand nous fûmes hors de sa présence, mes compagnons me dirent : « Pourquoi t’a-t-il tiré ? » Je leur répondis : « Il m’a donné ces pièces d’or. » Et j’en remis trois à Zhéhîr eddîn, et autant à Sunbul, leur disant : « Cet homme est un musulman. N’avez-vous pas vu comment il a montré le ciel, pour indiquer qu’il connaît le Dieu très haut, et comment il a montré le côté de La Mecque, indiquant ainsi qu’il a connaissance de la mission du Prophète ? Ce qui confirme cela, c’est qu’il a pris le chapelet. » Lorsque je leur eus dit ces paroles, ils retournèrent vers cet individu, mais ils ne le trouvèrent plus.
Nous partîmes aussitôt, et le lendemain nous arrivâmes à la ville de Hinaour, qui est située près d’un grand golfe où pénètrent les gros vaisseaux. La cité est éloignée de la mer d’un demi-mille. Durant le pouchcâl, c’est-à-dire la saison pluvieuse, l’agitation et l’impétuosité de cette mer deviennent fort considérables. Aussi, pendant quatre mois consécutifs, personne ne peut s’y embarquer, si ce n’est pour la pêche.
Le jour de notre arrivée à Hinaour, un djogui hindou vint me trouver secrètement et me remit six pièces d’or, en disant : « Le brahmane (il désignait par ce nom le djogui à qui j’avais donné mon chapelet et qui m’avait donné des dinars) t’envoie cet argent. » Je reçus de lui les dinars et lui en offris un, qu’il n’accepta pas. Lorsqu’il fut parti, j’informai de cela mes deux compagnons, et leur dis : « Si vous voulez, vous recevrez votre part de cette somme. » Ils refusèrent, mais ils témoignèrent de l’étonnement de cette aventure et me dirent : « Nous avons ajouté aux six pièces d’or que tu nous as données une pareille somme, et nous avons déposé le tout entre les deux idoles, dans l’endroit où nous avons vu cet individu. » Je fus fort surpris de ce qui concernait cet homme, et je conservai les dinars dont il m’avait fait cadeau.
Les habitants de Hinaour font profession de la doctrine de Châfe’ï ; ils sont pieux, dévots, courageux, et font la guerre sur mer aux infidèles. Ils sont devenus célèbres sous ce rapport ; mais la fortune les a ensuite abaissés, après qu’ils eurent conquis Sendâboûr. Nous raconterons cet événement.
Parmi les saints personnages que je rencontrai à Hinaour, se trouvait le cheikh Mohammed Annâkaoury, qui me traita dans son ermitage. Il faisait cuire les aliments de sa propre main, regardant comme impures celles des esclaves mâles ou femelles. J’y vis aussi le jurisconsulte Ismâ’îl, qui enseignait à lire le Coran. C’était un homme adonné à l’abstinence, doué d’un extérieur avantageux et d’une âme généreuse. J’y vis encore le kadi de la ville, Noûr eddîn ’Aly, et le prédicateur, dont j’ai oublié le nom.
Les femmes de Hinaour et de toutes les autres régions du littoral ne revêtent pas d’habits cousus, mais seulement des habits sans couture. Chacune d’elles se ceint le milieu du corps avec une des extrémités de l’étoffe, et place le reste sur sa tête et sa poitrine. Elles sont belles et chastes ; chacune d’elles passe dans son nez un anneau d’or. Une de leurs qualités consiste en ce que toutes savent par cœur le noble Coran. J’ai vu dans Hinaour treize écoles destinées à l’enseignement des filles, et vingt-trois pour les garçons, chose dont je n’ai été témoin nulle part ailleurs.
Les habitants de Hinaour tirent leur subsistance du commerce maritime, et ils n’ont pas de champs en culture. Les habitants du Malabar donnent chaque année au sultan Djémal eddîn une somme déterminée, car ils le craignent à cause de sa puissance sur mer. L’armée de ce prince monte à environ six mille hommes, tant cavaliers que fantassins.
C’est Djémal eddîn Mohammed, fils de Haçan, qui est au nombre des meilleurs et des plus puissants souverains. Il est soumis à la suprématie d’un monarque idolâtre nommé Hariab, et dont nous parlerons ci-après. Le sultan Djémal eddîn est adonné à la prière faite en commun avec les autres fidèles. Il a coutume de se rendre à la mosquée avant l’aurore et d’y lire dans le Coran, jusqu’à ce que paraisse le crépuscule. Alors il prie pour la première fois ; puis il va faire une promenade à cheval hors de la ville. Il revient vers neuf heures, rend d’abord visite à la mosquée, s’y prosterne et rentre ensuite dans son palais. Il jeûne durant les jours blancs (le 12e, le 13e, ou le 13e, le 14e et le 15e à partir de la nouvelle lune). Durant mon séjour près de lui, il m’invitait à rompre le jeûne en sa compagnie. J’assistais à cette cérémonie, ainsi que les jurisconsultes ’Aly et Ismâ’îl. On plaçait par terre quatre petits sièges, sur l’un desquels il s’asseyait. Chacun de nous autres s’asseyait sur un autre siège.
De l’ordre observé dans les repas de ce sultan
Voici en quoi consiste cet ordre on apporte une table de cuivre, que les gens du pays appellent (en persan) Khavendjeh (Khântcheh), et sur laquelle on pose un plateau du même métal, que l’on nomme thâlem. Une belle esclave, enveloppée d’une étoffe de soie, arrive et fait placer devant le prince les marmites contenant les mets. Elle tient une grande cuiller de cuivre, avec laquelle elle puise une cuillerée de riz, qu’elle verse dans le plateau ; elle répand par-dessus du beurre fondu, y met du poivre en grappes confit, du gingembre vert, des limons confits et des mangues. Le convive mange une bouchée, et la fait suivre de quelque portion de ces conserves. Lorsque la cuillerée que l’esclave a placée dans le plateau est consommée, elle puise une autre cuillerée de riz, et sert sur une écuelle une poule cuite, avec laquelle on mange encore du riz. Cette seconde portion achevée, elle puise encore dans la marmite, et sert une autre espèce de volaille, que l’on mange toujours avec le riz. Quand on a fini d’avaler les différentes espèces de volailles, on apporte diverses sortes de poissons, avec lesquelles on prend encore du riz. Après les poissons, on sert des légumes cuits dans le beurre et le laitage, et qui sont mangés aussi avec du riz. Lorsque tous ces aliments sont consommés, on apporte du coûchân, c’est-à-dire du lait aigri, qui sert à terminer le repas. Aussi, dès qu’il a été servi, on sait qu’il ne reste plus rien à manger. Par dessus tout cela, on boit de l’eau chaude, car l’eau froide serait nuisible dans la saison des pluies.
Je passai, dans une autre occasion, onze mois près de ce sultan, sans manger de pain, car la nourriture de ces gens-là consiste en riz. Je séjournai aussi trois années dans les îles Maldives, à Ceylan, sur les côtes de Coromandel et de Malabar, ne mangeant que du riz, de sorte que je ne l’ingurgitais qu’au moyen de l’eau.
Le vêtement du sultan de Hinaour consiste en couvertures de soie et de lin très fines ; il lie autour de son corps un pagne, et s’enveloppe de deux couvertures, l’une par-dessus l’autre ; il tresse ses cheveux et roule autour d’eux un petit turban. Quand il monte à cheval, il revêt une tunique et se drape par-dessus dans deux couvertures. On bat et on sonne devant lui de la timbale et de la trompette.
Nous passâmes près de lui cette fois-là trois jours ; il nous donna des provisions de route, et nous prîmes congé de lui. Au bout de trois autres jours, nous arrivâmes dans le pays de Moulaïbâr (Malabar), qui produit le poivre. Il s’étend en longueur l’espace de deux mois de marche sur la côte de la mer, depuis Sendâboûr jusqu’à Caoulem. Pendant toute cette distance, le chemin passe sous l’ombrage produit par les arbres ; à chaque demi-mille, il y a une maison de bois, où se trouvent des estrades sur lesquelles s’asseyent tous les voyageurs, musulmans ou infidèles. Près de chacune de ces maisons il y a un puits où l’on boit, et à la garde duquel est préposé un idolâtre. Il fait boire dans des vases quiconque est infidèle ; quant à ceux qui sont musulmans, il leur verse à boire dans leurs mains, et cela sans s’arrêter, jusqu’à ce qu’ils lui en donnent le signal, ou qu’ils l’empêchent de continuer. La coutume des idolâtres dans le pays de Malabar, c’est qu’aucun musulman n’entre dans leurs maisons, ni ne mange dans leur vaisselle. Dans le cas contraire, ils brisent le vase ou le donnent aux mahométans. Quand un de ceux-ci entre dans une localité de ce pays où il ne se trouve aucune maison appartenant à des musulmans, les infidèles lui font cuire des aliments, les lui servent sur des feuilles de bananier, et versent par-dessus des condiments. Les chiens et les oiseaux mangent ce qui reste. Dans toutes les stations du chemin qui traverse le Malabar, il y a des maisons de musulmans chez lesquels logent leurs coreligionnaires, et qui vendent à ceux-ci toutes les choses dont ils ont besoin. Ces gens-là leur font cuire leurs aliments. Sans ce secours, aucun musulman ne voyagerait dans cette contrée.
Sur ce chemin, dont nous avons dit qu’il s’étendait l’espace de deux mois de marche, il n’y a pas un emplacement d’un palme ou davantage qui ne soit cultivé. Chaque homme a son jardin séparé, et sa maison au milieu de ce jardin. Le tout est entouré d’une enceinte de planches, et le chemin passe à travers les jardins. Lorsqu’il arrive à l’enclos d’un verger, on voit en ce lieu des degrés de bois par lesquels on monte, et d’autres à l’aide desquels on descend dans le verger voisin. Cela continue ainsi l’espace de deux mois de marche. Personne ne voyage dans ce pays avec une monture, et il n’y a de chevaux que chez le sultan. Le principal véhicule des habitants est un palanquin porté sur les épaules d’esclaves ou de mercenaires ; ceux qui ne montent pas dans un palanquin, quels qu’ils soient, marchent à pied. Les gens qui ont des bagages ou du mobilier, soit ballots de marchandises ou autre chose, louent des hommes qui portent cela sur leur dos. Tu verras en ce pays-là un marchand accompagné de cent individus, plus ou moins, portant ses denrées. Dans la main de chacun, il y a un bâton grossier, terminé à son extrémité inférieure par une pointe en fer, et à l’extrémité supérieure par un crochet du même métal. Lorsque le porteur est fatigué et qu’il ne trouve pas d’estrade pour se reposer, il fiche en terre son bâton et y suspend son fardeau. Quand il s’est reposé, il prend sa charge sans auxiliaire et se remet en marche.
Je n’ai pas vu de chemin plus sûr que celui-là ; car les Hindous tuent l’homme qui a dérobé une noix. Aussi, quand quelque fruit tombe par terre, personne ne le ramasse, jusqu’à ce que le propriétaire le prenne. On m’a raconté que plusieurs Hindous passèrent par ce chemin, et qu’un d’eux ramassa une noix. Le gouverneur, ayant appris cela, ordonna d’enfoncer en terre un pieu, d’en tailler l’extrémité supérieure, de fixer celle-ci dans une tablette de bois, de sorte qu’une portion dépassât au-dessus de la planche. Le coupable fut étendu sur cette dernière et fiché sur le pieu, qui lui entra dans le ventre et lui sortit par le dos ; il fut laissé dans cette posture, pour servir d’exemple aux spectateurs. Sur ce chemin, il y a beaucoup de pieux semblables à celui-là, afin que les passants les voient et en tirent un avertissement.
Or nous rencontrions pendant la nuit, sur la route, des infidèles qui, dès qu’ils nous voyaient, se détournaient du chemin, jusqu’à ce que nous eussions passé. Les musulmans sont les gens les plus considérés dans ce pays-là, si ce n’est que les indigènes, ainsi que nous l’avons dit, ne mangent pas avec eux et ne les font pas entrer dans leurs maisons.
Il y a dans le Malabar douze sultans idolâtres, parmi lesquels il s’en trouve de puissants, dont l’armée s’élève à cinquante mille hommes, et de faibles, dont l’armée ne monte qu’à trois mille hommes. Mais il n’y a parmi eux aucune discorde, et le puissant ne convoite pas la conquête de ce que possède le faible. Entre les États de chacun d’eux, il y a une porte de bois sur laquelle est gravé le nom de celui dont le domaine commence en cet endroit. On l’appelle la porte de sûreté de N. Lorsqu’un musulman ou un idolâtre s’est enfui des États d’un de ces princes, à cause de quelque délit, et qu’il est arrivé à la porte de sûreté d’un autre prince, il se trouve en sécurité, et celui qu’il fuit ne peut le prendre, quand bien même il serait puissant et disposerait de nombreuses armées.
Les souverains de ce pays-là laissent leur royauté en héritage au fils de leur sœur, à l’exclusion de leurs propres enfants. Je n’ai vu personne qui agisse ainsi, excepté les Messoûfah (voile qui couvre la partie inférieure du visage), porteurs du lithâm et que nous mentionnerons par la suite. Lorsqu’un souverain du Malabar veut empêcher ses sujets d’acheter et de vendre, il donne ses ordres à un de ses esclaves, qui suspend aux boutiques un rameau d’arbre muni de ses feuilles. Personne ne vend ni n’achète tant que ces rameaux restent sur les boutiques.
Les poivriers ressemblent à des ceps de vigne ; on les plante vis-à-vis des cocotiers, autour desquels ils grimpent à l’instar des ceps, sauf qu’ils n’ont pas, comme ceux-ci, de ’asloûns, c’est-à-dire de bourgeons. Leurs feuilles sont pareilles à des feuilles de rue, et en partie aussi à celles de la ronce. Le poivrier porte de petites grappes, dont les grains sont semblables à ceux de l’aboû-kinninah (le père de la bouteille : le raisin ?) lorsqu’ils sont verts. Quand arrive l’automne, on cueille le poivre et on l’étend au soleil sur des nattes, comme on fait pour les raisins lorsqu’on veut les faire sécher. On ne cesse de le retourner, jusqu’à ce qu’il soit parfaitement sec et qu’il devienne très noir ; après quoi on le vend aux marchands. Le peuple de notre pays prétend qu’on le fait griller sur le feu, et que c’est pour ce motif qu’il y survient des rugosités ; mais il n’en est rien, et cela n’est produit que par l’action du soleil. J’en ai vu dans la ville de Calicut, où on le mesure au boisseau comme le millet dans nos contrées.
La première ville du Malabar où nous entrâmes était Abouséroûr (Barcelore), qui est petite, située sur un grand golfe et fertile en cocotiers. Le chef de la population musulmane est le cheikh Djoum’ah, connu sous le nom d’Abou Sittah, Père des Six, qui est au nombre des hommes généreux, et qui a dépensé ses richesses en faveur des fakirs et des indigents, si bien qu’elles se sont évanouies complètement. Deux jours après notre départ de cette ville, nous arrivâmes à celle de Fâcanaour (Bacanore), qui est grande et située sur un golfe. On y voit en abondance d’excellentes cannes à sucre, qui n’ont pas leurs pareilles en ce pays-là. Il s’y trouve un certain nombre de musulmans, dont le chef s’appelle Houçaïn Assélâth. Il y a un kadi et un prédicateur, et ce Houçaïn y a construit une mosquée, afin qu’on célébrât la prière du vendredi.
C’est un idolâtre appelé Bâçadao, il a environ trente vaisseaux de guerre, dont le commandant en chef est un musulman nommé Loûlâ. Celui-ci est un homme pervers, qui exerce le brigandage sur mer et dépouille les marchands. Lorsque nous eûmes jeté l’ancre à Fâcanaour, le sultan nous envoya son fils, qui resta sur le vaisseau en qualité d’otage. Nous allâmes trouver le prince, qui nous hébergea parfaitement pendant trois jours, afin de témoigner son respect pour le souverain de l’Inde, afin de lui rendre ce qui lui était dû, et aussi par le désir de gagner en trafiquant avec l’équipage de nos navires. C’est la coutume, en ce pays, que chaque vaisseau qui passe près d’une ville ne puisse se dispenser d’y jeter l’ancre ni d’offrir à son prince un présent que l’on appelle le droit du port. Si quelque navire se dispense de cela, les habitants se mettent à sa poursuite sur leurs embarcations, le font entrer de force dans le port, lui imposent une double taxe, et l’empêchent de repartir aussi longtemps qu’il leur plaît.
Nous quittâmes Fâcanaour, et nous arrivâmes, au bout de trois jours, à la ville de Mandjaroûr (Mangalore), qui est grande et située sur un golfe nommé le golfe d’Addounb, le plus vaste qu’il y ait dans le Malabar. C’est dans cette ville que descendent la plupart des marchands du Fars et du Yémen ; le poivre et le gingembre y sont très abondants.
C’est un des principaux souverains de ce pays, et il s’appelle Rama Dao. Il y a dans Mandjaroûr environ quatre mille musulmans, qui habitent un faubourg tout à côté de la ville. Souvent la guerre s’engage entre eux et les habitants de la ville ; mais le sultan les réconcilie, à cause du besoin qu’il a des marchands. On trouve dans Mandjaroûr un kadi qui est au nombre des hommes distingués et généreux ; il professe la doctrine de Châfe’ï, se nomme Bedr eddîn Alma’bary et enseigne les sciences. Il vint nous visiter à bord du navire et nous pria de descendre dans la ville. Nous lui répondîmes : « Nous n’en ferons rien jusqu’à ce que le sultan ait envoyé son fils, afin qu’il reste à bord. — Le sultan de Fâcanaour, reprit-il, n’agit ainsi que parce que les musulmans qui habitent sa ville ne possèdent aucune puissance ; mais, quant à nous, le sultan nous craint. » Nous persistâmes à refuser de débarquer, à moins que le souverain n’envoyât son fils. Il nous députa celui-ci, comme avait fait le souverain de Fâcanaour. Alors nous descendîmes à terre ; on nous y traita avec une grande considération et nous y demeurâmes trois jours.
Au bout de ce temps, nous partîmes pour Hîly (Ramdilly ?), où nous arrivâmes deux jours après. C’est une ville grande, bien construite, située sur un grand golfe, où entrent les gros vaisseaux. Les navires de la Chine arrivent dans cette ville ; ils ne pénètrent que dans son port et dans ceux de Caoulem et de Calicut. Hîly est considérée des musulmans et des idolâtres à cause de sa mosquée principale, qui jouit de grandes bénédictions et est éclatante de lumière. Les navigateurs sur mer lui vouent des offrandes considérables, et elle possède un riche trésor, qui est placé sous la surveillance du prédicateur Houçaïn et de Haçan Alwazzân (le peseur), chef des musulmans. Il y a dans cette mosquée un certain nombre d’étudiants, qui apprennent les sciences, et qui jouissent d’une pension sur les revenus du temple. Celui-ci a une cuisine où l’on prépare des aliments pour les voyageurs, ainsi que d’autres, destinés aux pauvres musulmans de la ville. Je rencontrai dans la mosquée un vertueux jurisconsulte originaire de Makdachaou et que l’on appelait Sa’id. Il était doué d’une belle figure, d’un bon caractère, et il jeûnait constamment. Il me raconta qu’il était demeuré à La Mecque quatorze ans et autant à Médine ; qu’il avait vu l’émir de La Mecque, Abou Némy, et celui de Médine, Mansour, fils de Djammâz ; enfin, qu’il avait voyagé dans l’Inde et en Chine.
Nous nous rendîmes de Hîly à la ville de Djor Fattan, située à trois parasanges de la première. J’y rencontrai un jurisconsulte d’entre les habitants de Bagdad, homme d’un grand mérite et que l’on appelait Sarsary, par allusion à une ville éloignée de dix milles de Bagdad, sur le chemin de Coûfah. Le nom de cette localité est le même que celui de (la montagne de) Sarsar, que l’on trouve chez (cf. le Mochtaric de Yakout, éd. Wüstenfeld), dans le Maghreb. Le personnage dont je parle avait un frère très riche qui habitait à Djor Fattan et qui avait de jeunes enfants. Ce frère les lui avait recommandés en mourant, et je le laissai se disposant à les emmener à Bagdad ; car c’est la coutume des habitants de l’Inde, aussi bien que de ceux du Soudan, de ne se mêler en rien de la succession des étrangers qui meurent parmi eux, quand bien même ils laisseraient des millions de pièces d’or. Leur argent reste entre les mains du chef des musulmans, jusqu’à ce que celui qui y a des droits d’après les lois le reçoive.
On l’appelle Coueïl, mot qui a la forme des diminutifs en arabe. C’est un des plus puissants souverains du Malabar, et il possède de nombreux vaisseaux qui vont dans l’Oman, le Fars, le Yémen. De ses États font partie Deh Fattan et Bodd Fattan, dont nous ferons mention.
Nous nous rendîmes de Djor Fattan à Deh Fattan, grande ville située sur un golfe, et possédant de nombreux vergers ; on y voit des cocotiers, des poivriers, de la noix d’arec, du bétel et beaucoup de colocasie (arum cocolasia L.), avec laquelle les Hindous font cuire la viande. Quant à la banane, je n’ai vu aucun pays qui en produise davantage ni à meilleur marché. On voit à Deh Fattan un très grand bâïn ou bassin, qui a cinq cents pas de longueur, sur trois cents de largeur. Il est revêtu de pierres de taille rouges, et a sur ses côtés vingt-huit dômes de pierre, dont chacun renferme quatre sièges de la même matière. On monte à chaque pavillon au moyen d’un escalier en pierre. Au milieu de l’étang, il y a un grand pavillon, haut de trois étages, dont chacun a quatre sièges. On m’a raconté que c’est le père du sultan Coueïl qui a fait construire ce bâïn. Il y a vis-à-vis de celui-ci une mosquée cathédrale pour les musulmans. La mosquée a des marches au moyen desquelles on descend jusqu’au bassin, où les fidèles font leurs ablutions et se lavent. Le jurisconsulte Houçaïn m’a rapporté que le personnage qui a bâti la mosquée et le bain était un des ancêtres de Coueïl, qui était musulman, et dont la conversion à l’islamisme fut déterminée par une aventure merveilleuse que nous raconterons.
De l’arbre extraordinaire qui se trouve vis-à-vis de la mosquée
Je vis que la mosquée était située près d’un arbre verdoyant et beau, dont les feuilles ressemblaient à celles du figuier, sauf qu’elles étaient lisses. Il était entouré d’une muraille et avait près de lui une niche ou oratoire, où je fis une prière de deux génuflexions. Le nom de cet arbre, chez les gens du pays, était derakht (dirakht) acchéhâdah, « l’arbre du témoignage ». On m’a rapporté en cet endroit que tous les ans, quand arrivait l’automne, il tombait de cet arbre une feuille, dont la couleur avait d’abord passé au jaune, puis au rouge. Sur cette feuille était écrite, avec le roseau de la puissance divine, la parole suivante : « Il n’y a de dieu que Dieu, et Mohammed est l’envoyé de Dieu. » Le jurisconsulte Houçaïn et plusieurs hommes dignes de foi me racontèrent qu’ils avaient vu cette feuille et lu l’inscription qui s’y trouvait. Houçaïn ajouta que, quand venait le moment de sa chute, les hommes dignes de confiance, parmi les musulmans et les idolâtres, s’asseyaient sous l’arbre. Lorsque la feuille était tombée, les musulmans en prenaient la moitié, l’autre était déposée dans le trésor du sultan infidèle. Les habitants s’en servent pour chercher à guérir les malades.
Cet arbre fut cause de la conversion à l’islamisme de l’aïeul de Coueïl, qui construisit la mosquée et le bassin. Ce prince savait lire les caractères arabes ; lorsqu’il eut déchiffré l’inscription et compris ce qu’elle contenait, il embrassa la religion islamique et la professa parfaitement. Son histoire est transmise par la tradition parmi les Hindous. Le jurisconsulte Houçaïn me raconta qu’un des enfants de ce souverain retourna à l’idolâtrie, après la mort de son père, se conduisit injustement et ordonna d’arracher l’arbre par la racine. L’ordre fut exécuté et l’on ne laissa pas un vestige de l’arbre ; mais il repoussa par la suite, et redevint aussi beau qu’il l’avait jamais été auparavant. Quant à l’idolâtre, il mourut bientôt après.
De Deh Fattan nous nous rendîmes à Bodd Fattan, qui est une ville considérable et située sur un grand golfe. Il y a hors de la ville, dans le voisinage de la mer, une mosquée où se réfugient les étrangers musulmans ; car il n’y a pas de musulmans à Bodd Fattan. Le port de cette cité est au nombre des plus beaux ; l’eau qu’elle possède est douce, la noix d’arec y abonde, et on la transporte de là dans l’Inde et la Chine. La plupart des habitants de Bodd Fattan sont des brahmanes, ils sont considérés des idolâtres et haïssent les musulmans. C’est pourquoi il n’y a aucun de ceux-ci parmi eux.
On m’a raconté que le motif pour lequel les brahmanes laissèrent cette mosquée sans la ruiner, c’est qu’un d’eux en démolit le toit pour faire avec les matériaux une toiture à sa maison ; mais le feu prit à celle-ci, et il fut consumé avec ses enfants et ses meubles. Les Hindous respectèrent ce temple, ne méditèrent plus contre lui aucun mauvais dessein, lui rendirent des hommages, placèrent de l’eau à l’extérieur, afin que les voyageurs pussent boire, et mirent à la porte un treillis, pour que les oiseaux n’y entrassent pas.
De Bodd Fattan, nous nous rendîmes à Fandaraïna, ville grande, belle et possédant des jardins et des marchés. Les musulmans y occupent trois quartiers, dont chacun a une mosquée ; quant au temple principal, situé sur le rivage, il est admirable ; il a des belvédères et des salons donnant sur la mer. Le kadi et prédicateur de Fandaraïna est un individu originaire de l’Oman, qui a un frère, homme de mérite. C’est dans cette ville que les navires de la Chine passent l’hiver.
Nous allâmes de Fandaraïna à Kâlikoûth (Calicut), un des grands ports du Malabar. Les gens de la Chine, de Java, de Ceylan, des Maldives, du Yémen et du Fars s’y rendent, et les trafiquants des diverses régions s’y réunissent. Son port est au nombre des plus grands de l’univers.
C’est un idolâtre, nommé Assâmary (le Samorin), il est avancé en âge et se rase la barbe, comme font une partie des Grecs. Je l’ai vu à Calicut, et je parlerai de lui, s’il plaît à Dieu. Le chef des marchands en cette ville était Ibrahim Chah Bender (le roi ou le chef du port), originaire de Bahreïn. C’est un homme distingué, doué de qualités généreuses ; les commerçants se réunissent chez lui et mangent à sa table. Le kadi de Calicut était Fakhr eddîn ’Othman, homme distingué et généreux. Le supérieur de l’ermitage était le cheikh Schihâb eddîn Alcâzéroûny, à qui l’on remet les offrandes que les habitants de l’Inde et de la Chine vouent au cheikh Abou Ishâk Alcâzéroûny (que Dieu nous fasse profiter de ses mérites !). C’est à Calicut qu’habite le patron de navire Mithkâl, dont le nom est célèbre ; il est possesseur de richesses considérables et de vaisseaux nombreux, qui servent à son commerce avec l’Inde, la Chine, le Yémen et le Fars.
Quand nous arrivâmes en cette ville, Ibrahim, le chef du port, sortit à notre rencontre, ainsi que le kadi, le cheikh Chihâb eddîn, les principaux marchands et le lieutenant du souverain idolâtre, nommé Kolâdj. Ils avaient sur leurs vaisseaux des timbales, des trompettes, des clairons et des étendards. Nous entrâmes dans le port en grande pompe, et telle que je n’en ai pas vu de pareille dans ce pays-là. Mais c’était une réjouissance que devait suivre l’affliction. Nous séjournâmes dans le port de Calicut, où se trouvaient alors treize vaisseaux de la Chine ; nous descendîmes ensuite dans la ville, et chacun de nous fut placé dans une maison. Nous y restâmes trois mois, attendant le moment de partir pour la Chine. Nous étions cependant hébergés par le souverain idolâtre. On ne voyage sur la mer de Chine qu’avec des vaisseaux chinois. Or, mentionnons l’ordre observé sur ceux-ci.
Description des vaisseaux de la Chine
Il y en a trois espèces : 1° les grands, qui sont appelés gonoûk et au singulier gonk « jonque (du chinois tchouen) » ; 2°les moyens, nommés zaou (sao ou seou) ; et 3° les petits nommés cacam (hoa-hang). Il y a sur un de ces grands navires douze voiles et au-dessous jusqu’à trois. Leurs voiles sont faites de baguettes de bambous, tissées en guise de nattes ; on ne les amène jamais, et on les change de direction, selon que le vent souffle d’un côté ou d’un autre.
Quand ces navires jettent l’ancre, on laisse flotter les voiles au vent. Chacun d’eux est manœuvré par mille hommes, savoir : six cents marins et quatre cents guerriers, parmi lesquels il y a des archers, des hommes armés de boucliers, des arbalétriers, c’est-à-dire des gens qui lancent du naphte. Chaque grand vaisseau est suivi de trois autres : le nisfy « moyen », le thoulthy « celui du tiers », et le roub’y « celui du quart ». On ne les construit que dans la ville de Zeitoun, en Chine, ou dans celle de Syn Calân (Canton), c’est-à-dire Syn Assyn. Voici de quelle manière on les fabrique : on élève deux murailles de bois et on remplit l’intervalle qui les sépare au moyen de planches très épaisses, reliées en long et en large par de gros clous, dont chacun a trois coudées de longueur. Quand les deux parois sont jointes ensemble à l’aide de ces planches, on dispose par-dessus le plancher inférieur du vaisseau, puis on lance le tout dans la mer et on achève la construction. Les pièces de bois et les deux parois qui touchent l’eau servent à l’équipage pour y descendre se laver et accomplir ses besoins. C’est sur les côtés de ces pièces de bois que se trouvent les rames, qui sont grandes comme des mâts ; dix et quinze hommes se réunissent pour en manier une ; ils rament en se tenant debout. On construit sur un vaisseau quatre ponts ; il renferme des chambres, des cabines et des salons pour les marchands. Plusieurs de ces cabines (misryah) contiennent des cellules et des commodités. Elles ont une clef, et leurs propriétaires les ferment. Ils emmènent avec eux leurs concubines et leurs femmes. Il advient souvent qu’un individu se trouve dans sa cabine sans qu’aucun de ceux qui sont à bord du vaisseau ait connaissance de sa présence, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent lorsqu’ils sont arrivés dans quelque région.
Les marins font habiter ces cabines par leurs enfants ; ils sèment des herbes potagères, des légumes et du gingembre dans des baquets de bois. L’intendant du vaisseau ressemble à un grand émir ; quand il descend à terre, les archers et les Abyssins marchent devant lui avec des javelines, des épées, des timbales, des cors et des trompettes. Lorsqu’il est arrivé à l’hôtellerie qu’il doit habiter, ils fichent leurs lances de chaque côté de la porte, et ne cessent de se comporter ainsi pendant toute la durée de son séjour. Parmi les habitants de la Chine, il y en a qui possèdent de nombreux navires, sur lesquels ils envoient à l’étranger leurs facteurs. Il n’y a pas dans tout l’univers des gens plus riches que les Chinois.
Comment nous entreprîmes de nous rendre en Chine, et quelle fut la fin de ce voyage
Quand arriva le moment de partir pour la Chine, le sultan, le Samorin, équipa pour nous une des treize jonques qui se trouvaient dans le port de Calicut. L’intendant de la jonque s’appelait Soleïman Assalady Acchâmy, et j’étais en connaissance avec lui. Je lui dis : « Je veux une cabine que personne ne partage avec moi, à cause des jeunes esclaves, car c’est ma coutume de ne voyager qu’avec elles. » Il me répondit : « Les marchands de la Chine ont loué les cabines pour l’aller et le retour. Mon gendre en a une que je te donnerai, mais elle ne renferme pas de commodités ; il est possible que l’on trouve à l’échanger contre une autre. » Je donnai mes ordres à mes compagnons ; ils chargèrent sur le navire ce que je possédais d’effets, et les esclaves tant mâles que femelles montèrent sur la jonque. Cela ayant eu lieu un jeudi, je restai à terre, afin de faire la prière du vendredi, et de rejoindre ensuite mes gens. Le roi Sunbul et Zhéhîr eddîn s’embarquèrent avec le présent. Cependant, un eunuque qui m’appartenait, et que l’on appelait Hilal, vint me trouver le matin du vendredi et me dit : « La cabine que nous avons prise sur la jonque est trop étroite et ne convient pas. » Je répétai cela au patron du navire, qui me répondit : « Il n’y a pas moyen d’y remédier ; mais, situ consens à t’embarquer dans le cacam, il y a sur ce vaisseau des cabines à ton choix. — C’est bien », répondis-je, et je donnai mes ordres à mes camarades, qui transportèrent mes esclaves femelles et mes effets à bord du second navire et s’y établirent avant l’heure de la prière du vendredi. Or il arrive habituellement sur cette mer-là que l’agitation de ses flots redouble chaque jour, après quatre heures du soir, et que personne ne peut alors s’y embarquer. Les jonques étaient déjà parties, et il ne restait plus que celle qui renfermait le présent, une autre dont les propriétaires avaient résolu de passer l’hiver à Fandaraïna, et le cacam dont j’ai parlé. Nous passâmes sur le rivage la nuit du vendredi au samedi, ne pouvant nous embarquer sur le cacam ; ceux qui se trouvaient à bord ne pouvaient pas davantage venir nous trouver. Je n’avais gardé qu’un tapis pour me coucher. Le samedi au matin, la jonque et le cacam se trouvèrent loin du port. La mer jeta sur des rochers la jonque, dont l’équipage voulait gagner Fandaraïna ; elle fut brisée, une partie de ceux qui la montaient périrent, les autres échappèrent. Il y avait sur ce navire une jeune esclave appartenant à un certain marchand, et qui lui était fort chère. Il offrit de donner dix pièces d’or à quiconque la sauverait. Elle s’était attachée à une pièce de bois placée à l’arrière de la jonque. Un des marins d’Hormuz répondit à cet appel, et retira du danger la jeune fille. Mais il refusa de recevoir les pièces d’or et dit : « Je n’ai fait cela que pour l’amour de Dieu. »
Lorsque la nuit fut arrivée, la mer jeta sur des récifs la jonque où se trouvait le présent. Tous les individus qui la montaient moururent. Au matin, nous examinâmes les endroits où gisaient leurs corps. Je vis que Zhéhîr eddîn avait eu la tête fendue, que sa cervelle avait été éparpillée ; quant à Mélic Sunbul, un clou l’avait frappé à l’une des tempes et était sorti par l’autre. Nous récitâmes les prières sur leurs corps et les ensevelîmes. Je vis le sultan idolâtre de Calicut, ayant à sa ceinture une grande pièce d’étoffe blanche roulée depuis le nombril jusqu’aux genoux, et sur sa tête un petit turban ; il avait les pieds nus, et un parasol était porté au-dessus de son front par un jeune esclave. Un feu était allumé devant lui sur le rivage, et ses satellites frappaient les assistants, afin qu’ils ne pillassent pas ce que la mer rejetait. La coutume du pays de Malabar, c’est que, toutes les fois qu’un vaisseau est brisé, ce que l’on en retire revient au fisc, si ce n’est en cette seule ville. En effet, les épaves y sont recueillies par leurs possesseurs légitimes, et c’est pour cela qu’elle est florissante et que les étrangers y arrivent en foule.
Quand l’équipage du cacam aperçut ce qui était advenu à la jonque, il mit à la voile et s’éloigna, emportant toute ma propriété et mes esclaves des deux sexes. Je demeurai seul sur le rivage, n’ayant avec moi qu’un esclave que j’avais affranchi. Lorsqu’il vit ce qui m’était arrivé, il me quitta, et il ne me resta plus que les dix pièces d’or que le djogui m’avait données et le tapis que j’avais étendu par terre. Les assistants m’annoncèrent qu’il faudrait absolument que ce cacam entrât dans le port de Caoulem. Je résolus donc de me rendre dans cette ville, qui était éloignée de Calicut de dix journées de marche, soit par terre, soit par le fleuve, pour quiconque préfère ce dernier moyen de transport. Je partis par la rivière, et je louai un musulman pour porter mon tapis. La coutume des Hindous, quand ils voyagent sur ce fleuve, est de descendre à terre le soir et de passer la nuit dans les villages situés sur ses rives. Le lendemain matin, ils retournent sur leur bateau. Nous faisions de même. Il n’y avait pas sur le bateau de musulman, si ce n’est celui que j’avais pris à gage. Il buvait du vin chez les infidèles quand nous relâchions, et se comportait avec moi comme un homme ivre. Aussi le mécontentement de mon esprit était extrême.
Le cinquième jour après notre départ, nous arrivâmes à Cundjy Cary, qui est situé sur la cime d’une montagne ; il a pour habitants des juifs, qui ont pour chef un d’entre eux, et payent la capitation au sultan de Caoulem.
De la cannelle et du bakkam (BRésil)
Tous les arbres qui se trouvent près de ce fleuve sont des canneliers et des arbres de brésil On s’en sert en cet endroit pour le chauffage, et nous en allumions le feu pour cuire nos aliments durant ce voyage.
Le dixième jour, nous parvînmes à la ville de Caoulem (Coulan), qui est une des plus belles du Malabar. Ses marchés sont magnifiques, et ses négociants sont connus sous le nom de soulys. Ils ont des richesses considérables : un d’entre eux achète un vaisseau avec ses agrès et le charge de marchandises qu’il tire de sa propre demeure. Il y a dans Caoulem plusieurs trafiquants musulmans, dont le chef est ’Alâ eddîn Alâwédjy, originaire d’Aweh, dans l’Irak (persique). Il est râfidhite (ou partisan d’Aly) et a des camarades qui suivent la même doctrine, et cela ouvertement. Le kadi de Caoulem est un homme distingué, originaire de Kazouïn ; le chef de tous les musulmans, en cette ville, est Mohammed Chah Bender, qui a un frère excellent et généreux, nommé Taky eddîn. La mosquée principale y est admirable ; elle a été construite par le marchand Khodjah Mohaddheb. Caoulem est la ville du Malabar la plus rapprochée de la Chine, et la plupart des (trafiquants) Chinois s’y rendent. Les musulmans y sont considérés et respectés.
C’est un idolâtre appelé Attyréwéry ; il vénère les musulmans et rend des sentences sévères contre les voleurs et les malfaiteurs.
Parmi les événements dont je fus témoin à Caoulem se trouva celui-ci : un des archers originaires de l’Irâk tua un de ses camarades, et s’enfuit dans la maison d’Alâwédjy. Or ce meurtrier possédait des richesses considérables. Les musulmans voulurent ensevelir le mort ; mais les préposés du souverain les en empêchèrent et dirent : « Il ne sera pas enterré tant que vous ne nous aurez pas livré son meurtrier, qui sera tué pour le venger. » On le laissa donc dans sa bière, à la porte d’Alâwédjy, jusqu’à ce que le cadavre sentît mauvais et tombât en corruption. Alâwédjy livra aux officiers l’assassin, offrant de leur abandonner les richesses de celui-ci à condition qu’ils le laissassent en vie. Mais ils refusèrent, mirent à mort le coupable, et alors sa victime fut ensevelie.
On m’a raconté que le souverain de Caoulem monta un jour à cheval pour se promener hors de cette ville. Or son chemin passait entre des jardins, et il avait avec lui le mari de sa fille, qui était un fils de roi. Ce personnage ramassa une mangue, qui était tombée hors d’un des jardins. Le sultan avait les yeux sur lui ; il ordonna à l’instant de lui fendre le ventre et de partager son corps en deux ; une moitié fut mise sur une croix, à la droite du chemin, et l’autre à la gauche. La mangue fut divisée en deux moitiés, dont chacune fut placée au-dessus d’une portion du cadavre. Ce dernier fut laissé là pour servir d’exemple aux regardants.
Parmi les événements analogues qui arrivèrent à Calicut se trouve le suivant : le neveu du lieutenant du souverain prit, par force, une épée qui appartenait à un marchand musulman. Celui-ci se plaignit à l’oncle du coupable, et en reçut la promesse qu’il s’occuperait de son affaire. Là-dessus, le dignitaire s’assit à la porte de sa maison. Tout à coup, il aperçoit son neveu portant au côté cette épée ; il l’appelle, et lui dit : « Ceci est le sabre du musulman. — Oui, répond le neveu. — Le lui as-tu acheté ? reprend son oncle. — Non », répliqua le jeune homme. Alors le vice-roi dit à ses satellites : « Saisissez-le. » Puis il ordonna de lui couper le col avec cette même épée.
Je passai quelque temps à Caoulem, dans l’ermitage du cheikh Fakhr eddîn, fils du cheikh Chihâb eddîn Alcâzéroûny, supérieur de l’ermitage de Calicut. Je n’appris aucune nouvelle concernant le cacam. Durant mon séjour à Caoulem, les envoyés du roi de la Chine, qui nous avaient accompagnés et s’étaient embarqués dans une des jonques précitées, entrèrent dans cette ville. Leur navire avait aussi été mis en pièces. Les marchands chinois les habillèrent, et ils s’en retournèrent dans leur pays, où je les revis par la suite.
Je voulais retourner, de Caoulem, près du sultan de Dihly, pour lui faire connaître ce qui était arrivé au cadeau ; mais je craignis qu’il ne cherchât des sujets de reproche dans ma conduite, et qu’il ne dît : « Pourquoi t’es-tu séparé du présent ? » Je résolus donc d’aller retrouver le sultan Djémal eddîn Alhinaoury et de rester près de lui jusqu’à ce que j’apprisse des nouvelles du cacam. Je retournai à Calicut, et j’y trouvai des vaisseaux du sultan de l’Inde, sur lesquels il avait expédié un émir arabe, nommé le seyîd Abou’l Haçan. Ce personnage était un des berdédârs (du persan perdeh-dâr, chambellan), c’est-à-dire des principaux portiers. Le sultan l’avait fait partir avec des sommes d’argent, afin qu’il s’en servît pour enrôler autant d’Arabes qu’il pourrait, dans les territoires d’Hormuz et d’Alkathîf, car ce prince a de l’affection pour les Arabes. J’allai trouver cet émir, et le vis se disposant à passer l’hiver à Calicut, pour se rendre ensuite dans le pays des Arabes. Je tins conseil avec lui touchant mon retour près du sultan de l’Inde ; mais il n’y donna pas son assentiment. Je m’embarquai avec lui sur mer à Calicut. On était alors à la fin de la saison propre à ces voyages maritimes. Nous naviguions pendant la première moitié du jour, après quoi nous jetions l’ancre jusqu’au lendemain. Nous rencontrâmes en chemin quatre navires de guerre dont nous eûmes peur, mais qui ne nous causèrent aucun mal.
Nous arrivâmes à la ville de Hinaour j’allai trouver le sultan et le saluai. Il me logea dans une maison, où je n’avais aucun serviteur, et il me pria de réciter avec lui les prières. J’étais, la plupart du temps, assis dans sa mosquée, et je lisais complètement le Coran chaque jour. Par la suite, je fis cette même lecture deux fois par jour ; je la commençais, pour la première fois, après la prière de l’aurore, et la terminais vers une heure après midi. Je renouvelais alors mes ablutions, et recommençais la lecture, que j’achevais, pour la seconde fois, vers le coucher du soleil. Je ne cessai d’agir ainsi durant trois mois, sur lesquels je passai quarante jours entiers dans les exercices de dévotion.
De notre départ pour la guerre sainte, et de la conquête de Sendâboûr
Le sultan Djémal eddîn avait équipé cinquante-deux vaisseaux, dont la destination était de conquérir Sendâboûr. Une inimitié avait éclaté entre le souverain de cette île et son fils. Ce dernier avait écrit au sultan Djémal eddîn, pour l’engager à venir faire la conquête de Sendâboûr, s’obligeant, de son côté, à embrasser l’islamisme et à épouser la sœur du sultan. Quand les vaisseaux furent équipés, il me parut à propos de partir avec eux pour la guerre sainte. J’ouvris donc le Coran, afin de l’examiner. Dans la première page sur laquelle je tombai, on lisait ces mots : « Le nom de Dieu y est mentionné souvent. « Certes, Dieu secourra ceux qui le secourront. (Coran, xxii, 41) » Je me réjouis de cela, et le souverain étant venu pour faire la prière de quatre heures du soir, je lui dis : « Je veux partir aussi. — Tu seras donc le chef de l’expédition », répondit-il. Je l’informai de ce qui s’était présenté à moi dès que j’eus ouvert le Coran. Cela lui fit plaisir, et il résolut de partir en personne, quoiqu’il ne l’eût pas jugé à propos auparavant. Il s’embarqua donc sur un des vaisseaux, et je l’accompagnai. Cela se passait un samedi. Le soir du lundi, nous arrivâmes à Sendâboûr, et nous entrâmes dans son golfe. Nous trouvâmes ses habitants prêts à combattre, et ayant déjà dressé des mangonneaux. Nous passâmes la nuit suivante près de la ville. Quand il fit jour, les timbales, les trompettes et les cors retentirent, et les vaisseaux s’avancèrent. Les assiégés firent une décharge contre eux avec les mangonneaux. Je vis une pierre qui atteignit un de ceux qui se trouvaient dans le voisinage du sultan. Les gens des vaisseaux se jetèrent dans l’eau, tenant dans leurs mains leurs boucliers et leurs épées. Le sultan descendit à bord d’un ’ocaïry, qui est une espèce de chellîr (barque). Quant à moi, je me précipitai dans l’eau avec tout le monde. Il y avait près de nous deux tartanes ouvertes à l’arrière, et où se trouvaient des chevaux. Elles sont construites de manière que le cavalier puisse y monter sur son cheval, se couvrir de son armure et sortir ensuite. C’est ainsi que firent les cavaliers montés sur ces deux navires.
Dieu permit que Sendâboûr fût conquis, et il fit descendre la victoire sur les musulmans. Nous entrâmes dans la ville à la pointe de l’épée, et la plupart des infidèles se réfugièrent dans le palais de leur souverain. Nous y mîmes le feu ; ils sortirent, et nous les saisîmes. Le sultan leur accorda ensuite la vie sauve, et leur rendit leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient au nombre d’environ dix mille, à qui il assigna pour demeure le faubourg de la ville. Lui-même habita le palais, et donna aux gens de sa cour les maisons voisines. Il me gratifia d’une jeune captive nommée Lemky, et que j’appelai Mobâracah (bénie). Le mari de cette femme voulut la racheter, mais je refusai. Le sultan me revêtit d’une robe ample d’étoffe d’Égypte, qui avait été trouvée parmi les richesses du souverain idolâtre. Je restai près de lui à Sendâboûr, depuis le jour de la conquête de cette ville, qui était le 13 de djoumada premier, jusqu’au milieu de chaban ; puis je lui demandai la permission de voyager, et il exigea de moi la promesse que je reviendrais près de lui.
Je partis par mer pour Hinaour, d’où je me rendis successivement à Fâcanaour, à Mandjaroûr, à Hîly, à Djor Fattan, à Deh Fattan, à Bodd Fattan, à Fandaraïna, à Calicut, toutes villes dont il a été question ci-dessus. J’allai ensuite à Châlyât, ville des plus jolies, où se fabriquent des étoffes qui portent son nom, et où je séjournai longtemps. De là, je retournai à Calicut. Deux de mes esclaves embarqués à bord du cacam arrivèrent en cette ville, et m’apprirent que la jeune esclave qui était enceinte, et au sujet de laquelle j’avais été inquiet, était morte ; que le souverain de Java s’était emparé des autres esclaves femelles ; que mes effets avaient été la proie des étrangers, et que mes camarades s’étaient dispersés en Chine, à Java et dans le Bengale.
Lorsque j’eus connaissance de ces nouvelles, je retournai à Hinaour, puis à Sendâboûr, où j’arrivai, à la fin de moharrem, et où je séjournai jusqu’au second jour du mois de rebi’ second, Le souverain idolâtre de cette ville, sur qui nous en avions fait la conquête, s’avança pour la reprendre, et tous les infidèles s’enfuirent près de lui. Les troupes du sultan étaient dispersées dans les villages, et elles nous abandonnèrent ; les idolâtres nous assiégèrent et nous serrèrent de près. Quand la situation devint pénible, je sortis de la ville, que je laissai assiégée, et m’en retournai à Calicut. Je résolus de me rendre à Dhîbat Almahal (les Maldives), dont j’entendais beaucoup parler. Dix jours après que nous nous fûmes embarqués à Calicut, nous arrivâmes aux îles de Dhîbat Almahal. Dhîbat se prononce comme le féminin de Dhîb (loup, en arabe ; c’est l’altération du sanscrit douîpa, île). Ces îles sont au nombre des merveilles du monde ; on en compte environ deux mille. Il y a cent de ces îles et au-dessous qui se trouvent rassemblées circulairement en forme d’anneau ; leur groupe a une entrée semblable à une porte, et les vaisseaux n’y pénètrent que par là. Quand un navire est arrivé près d’une d’elles, il lui faut absolument un guide pris parmi les habitants, afin qu’il puisse se rendre, sous sa conduite, dans les autres îles. Elles sont tellement rapprochées les unes des autres que les têtes des palmiers qui se trouvent sur l’une d’elles apparaissent dès que l’on sort de l’autre. Si le vaisseau manque le chemin, il ne peut pénétrer dans ces îles, et le vent l’entraîne vers le Ma’bar (côte de Coromandel) ou vers Ceylan.
Tous les habitants de ces îles sont des musulmans, hommes pieux et honnêtes. Elles sont divisées en régions ou climats, dont chacun est commandé par un gouverneur, que l’on appelle cordoûiy, Parmi ces climats, on distingue : le climat de Pâlipour, Cannaloûs, Mahal, climat par le nom duquel sont désignées toutes les îles, et où résident leurs souverains ; Télâdîb ; Carâïdoû ; Teïm ; Télédomméty ; Hélédomméty, nom qui ne diffère du précédent que parce que sa première lettre est un hé ; Béreïdoû, Candacal, Moloûc, Souweïd. Ce dernier est le plus éloigné de tous. Toutes les îles Maldives sont dépourvues de grains, si ce n’est que l’on trouve, dans la région de Souweïd, une céréale qui ressemble à l’anly (espèce de millet), et que l’on transporte de là à Mahal. La nourriture des habitants consiste en un poisson pareil au lyroûn, et qu’ils appellent koulb almâs (coboly masse, c’est-à-dire poisson noir, selon Pyrard, 1ère partie). Sa chair est rouge, il n’a pas de graisse, mais son odeur ressemble à celle de la viande des brebis. Quand on en a pris à la pêche, on coupe chaque poisson en quatre morceaux, on le fait cuire légèrement, puis on le place dans des paniers de feuilles de palmier, et on le suspend à la fumée. Lorsqu’il est parfaitement sec, on le mange. De ce pays, on en transporte dans l’Inde, à la Chine et au Yémen. On le nomme koulb almâs.
La plupart des arbres de ces îles sont des cocotiers ; ils fournissent à la nourriture de leurs habitants, avec le poisson ; il en a déjà été question. La nature des cocotiers est merveilleuse. Un de ces palmiers produit chaque année douze régimes ; il en sort un par mois. Les uns sont petits, les autres grands, plusieurs sont secs, le reste est vert, et cela dure continuellement. On fabrique, avec le fruit, du lait, de l’huile et du miel, ainsi que nous l’avons dit dans la première partie (t. II). Avec son miel, on fait des pâtisseries, que l’on mange avec les noix de coco desséchées. Tous ces aliments tirés des noix de coco, et le poisson dont on se nourrit en même temps, procurent une vigueur extraordinaire et sans égale dans l’acte vénérien. Les habitants de ces îles accomplissent en ce genre des choses étonnantes. Pour moi, j’avais en ce pays quatre femmes légitimes, sans compter les concubines. Je faisais chaque jour une tournée générale, et je passais la nuit chez chacune d’elles à son tour. Or je continuai ce genre de vie durant une année et demie que je demeurai dans les Maldives.
On remarque encore, parmi les végétaux de ces îles, le tchoumoûn (eugenia jamba), le citronnier, le limonier et la colocasie. Les indigènes préparent avec la racine de celle-ci une farine dont ils fabriquent une espèce de vermicelle, qu’ils cuisent dans du lait de coco : c’est un des mets les plus agréables qui existent ; je le goûtais fort, et j’en mangeais.
Des habitants de ces îles et de quelques-unes de leurs coutumes ; description de leurs demeures
Les habitants des îles Maldives sont des gens probes, pieux, d’une foi sincère, d’une volonté ferme ; leur nourriture est licite et leurs prières sont exaucées. Quand un d’entre eux en rencontre un autre, il lui dit : « Dieu est mon seigneur, Mohammed est mon prophète ; je suis un pauvre ignorant. » Leurs corps sont faibles ; ils n’ont pas l’habitude des combats ni de la guerre, et leurs armes, c’est la prière. J’ordonnai un jour, en ce pays, de couper la main (droite) d’un voleur ; plusieurs des indigènes qui se trouvaient dans la salle d’audience s’évanouirent. Les voleurs de l’Inde ne les attaquent pas et ne leur causent pas de frayeur ; car ils ont éprouvé que quiconque leur prenait quelque chose était atteint d’un malheur soudain. Quand les navires ennemis viennent dans leur contrée, ils s’emparent des étrangers qu’ils rencontrent ; mais ils ne font du mal à aucun des indigènes. Si un idolâtre s’approprie quelque chose, ne fût-ce qu’un limon, le chef des idolâtres le punit et le fait frapper cruellement, tant il redoute les suites de cette action. S’il en était autrement, certes ces gens-là seraient les plus méprisables des hommes aux yeux de leurs agresseurs, à cause de la faiblesse de leurs corps. Dans chacune de leurs îles, il y a de belles mosquées, et la plupart de leurs édifices sont en bois.
Ces insulaires sont des gens propres ; ils s’abstiennent de ce qui est sale, et la plupart se lavent deux fois le jour, par mesure de propreté, à cause de l’extrême chaleur du climat et de l’abondance de la transpiration. Ils consomment beaucoup d’huiles de senteur, comme l’essence de bois de sandal, etc., et s’oignent de musc apporté de Makdachaou. C’est une de leurs coutumes, quand ils ont récité la prière de l’aurore, que chaque femme vienne trouver son mari ou son fils, avec la boîte au collyre, de l’eau de rose et de l’huile de musc ; celui-ci s’enduit les cils de collyre et se frotte d’eau de rose et d’huile de musc, de manière à polir son épiderme et à faire disparaître de son visage toute trace de fatigue.
Le vêtement de ces gens-là consiste en pagnes ; ils en attachent un sur leurs reins, au lieu de caleçon, et placent sur leur dos des étoffes dites alouilyân, qui ressemblent à des ihrâm (pièce d’étoffe dont se servent les musulmans pendant le pèlerinage). Les uns portent un turban, d’autres le remplacent par un petit mouchoir. Quand un d’entre eux rencontre le kadi ou le prédicateur, il ôte de dessus ses épaules son vêtement, se découvre le dos et accompagne ainsi ce fonctionnaire jusqu’à ce qu’il soit arrivé à sa demeure. Une autre de leurs coutumes, c’est que, quand un d’entre eux se marie et qu’il se rend à la demeure de sa femme, celle-ci étend, en son honneur, des étoffes de coton depuis la porte de la maison jusqu’à celle de la chambre (nuptiale) ; elle place sur ces étoffes des poignées de cauris, à droite et à gauche du chemin qu’il doit suivre, et elle-même se tient debout à l’attendre auprès de la porte de l’appartement. Lorsqu’il arrive près d’elle, elle lui jette sur les pieds un pagne, que prennent ses serviteurs. Si c’est la femme qui se rend à la demeure du mari, cette demeure est tendue d’étoffes, et l’on y place des cauris ; la femme, quand elle arrive près de son époux, lui jette le pagne sur les pieds. Telle est la coutume de ces insulaires lorsqu’il s’agit de saluer le souverain ; il leur faut absolument une pièce d’étoffe qui soit jetée dans ce moment-là, ainsi que nous le dirons.
Leurs constructions sont en bois, et ils ont soin d’élever le plancher des maisons à une certaine hauteur au-dessus du sol, par mesure de précaution contre l’humidité, car le sol de leurs îles est humide. Voilà de quelle manière ils s’y prennent : ils taillent des pierres, dont chacune est longue de deux ou trois coudées, les placent sur plusieurs rangs et mettent en travers des poutres de cocotier ; puis ils élèvent les murailles avec des planches. Ils montrent en cela une adresse merveilleuse. Dans le vestibule de la maison, ils construisent un appartement qu’ils appellent mâlem, et où le maître du logis s’assied avec ses amis. Cette pièce a deux portes, l’une ouvrant sur le vestibule et par où s’introduisent les étrangers, et l’autre, du côté de la maison, par laquelle entre le propriétaire de celle-ci. Près de la chambre en question, il y a une jarre pleine d’eau, une écuelle nommée ouélendj et faite de l’écorce de la noix du cocotier. Elle a un manche long de deux coudées, et l’on s’en sert pour puiser de l’eau dans les puits, à cause de leur peu de profondeur.
Tous les habitants des Maldives, soit nobles, soit plébéiens, ont les pieds nus. Les rues y sont balayées et bien propres ; des arbres les ombragent et le promeneur s’y trouve comme dans un verger. Malgré cela, il faut nécessairement que tout individu qui entre dans une maison se lave les pieds avec l’eau qui se trouve dans la jarre placée près du mâlem, et qu’il se les frotte avec un tissu grossier de lîf (appendice ou stipule qui enveloppe la base des pétioles des feuilles du dattier) mis en cet endroit ; après quoi, il pénètre dans la maison. Chaque personne qui entre dans une mosquée en use de même. C’est la coutume des indigènes, quand il leur arrive un vaisseau, que les canâdirs (au singulier candurah), c’est-à-dire les petites barques, s’avancent à sa rencontre, montées par les habitants de l’île (voisine), lesquels portent du bétel et des caranbah, c’est-à-dire des noix de coco vertes. Chacun d’eux offre cela à qui il veut parmi les gens du vaisseau cet individu devient son hôte et porte à sa maison les marchandises qui lui appartiennent, comme s’il était un de ses proches. Quiconque, parmi ces nouveaux venus, veut se marier en est le maître. Lorsqu’arrive le moment de son départ, il répudie sa femme, car les habitantes des Maldives ne sortent pas de leur pays. Quant à celui qui ne se marie pas, la femme dans la maison de laquelle il se loge lui prépare des aliments, le sert et lui fournit des provisions de route lors de son départ. En retour de tout cela, elle se contente de recevoir de lui le plus petit cadeau. Le profit du Trésor, que l’on appelle bender (entrepôt de la douane), consiste dans le droit d’acheter une certaine portion de toutes les marchandises à bord du vaisseau, pour un prix déterminé, soit que la denrée vaille juste cela ou davantage ; on nomme cela la loi du bender. Ce bender a dans chaque île une maison de bois que l’on appelle bédjensâr, où le gouverneur, qui est le cordouéry, rassemble toutes les marchandises ; il les vend et les échange. Les indigènes achètent, avec des poulets, des poteries quand on leur en apporte ; une marmite se vend chez eux cinq ou six poulets.
Les vaisseaux exportent de ces îles le poisson dont nous avons parlé, des noix de coco, des pagnes, des ouilyâns et des turbans ; ces derniers sont en coton. Ils exportent aussi des vases de cuivre, qui sont très communs chez les indigènes, des cauris et du kanbar : tel est le nom que l’on donne à l’enveloppe filamenteuse de la noix de coco. Les indigènes lui font subir une préparation dans des fosses creusées près du rivage, puis ils la battent avec des pics ; après quoi les femmes la filent. On en fait des cordes pour coudre (ou joindre ensemble) les planches des vaisseaux, et on exporte ces cordages à la Chine, dans l’Inde et le Yaman. Le kanbar vaut mieux que le chanvre. C’est avec des cordes de ce genre que sont cousues les (planches des) navires de l’Inde et du Yaman, car la mer des Indes est remplie de pierres, et si un vaisseau joint avec des clous de fer venait à heurter contre un roc il serait rompu ; mais, quand il est cousu avec des cordes, il est doué d’élasticité et ne se brise pas.
La monnaie des habitants de ces îles consiste en cauris. On nomme ainsi un animal (un mollusque) qu’ils ramassent dans la mer, et qu’ils déposent dans des fosses creusées sur le rivage. Sa chair se consume et il n’en reste qu’un os blanc. On appelle cent de ces coquillages syâh, et sept cents, fâl ; douze mille se nomment cotta, et cent mille bostoû. On conclut des marchés au moyen de ces cauris, sur le pied de quatre bostoûs pour un dinar d’or. Souvent ils sont à bas prix, de sorte qu’on en vend dix bostoûs pour un dinar. Les insulaires en vendent aux habitants du Bengale pour du riz, car c’est aussi la monnaie en usage chez ceux-ci. Ils en vendent également aux gens du Yémen, qui les mettent dans leurs navires comme lest, en place de sable. Ces cauris servent aussi de moyen d’échange aux nègres dans leur pays natal. Je les ai vu vendre, à Mâly et à Djoudjou, sur le pied de onze cent cinquante pour un dinar d’or.
Les femmes de ces îles ne se couvrent pas la tête ; leur souveraine elle-même ne le fait pas. Elles se peignent les cheveux et les rassemblent d’un seul côté. La plupart d’entre elles ne revêtent qu’un pagne, qui les couvre depuis le nombril jusqu’à terre ; le reste de leur corps demeure à découvert. C’est dans ce costume qu’elles se promènent dans les marchés et ailleurs. Lorsque je fus investi de la dignité de kadi dans ces îles, je fis des efforts pour mettre fin à cette coutume et ordonner aux femmes de se vêtir ; mais je ne pus y réussir. Aucune femme n’était admise près de moi pour une contestation, à moins qu’elle n’eût tout le corps couvert ; mais, à cela près, je n’obtins aucun pouvoir sur cet usage. Quelques femmes revêtent, outre le pagne, des chemises qui ont les manches courtes et larges. J’avais de jeunes esclaves dont l’habillement était le même que celui des habitantes de Dihly. Elles se couvraient la tête ; mais cela les défigurait plutôt que de les embellir, puisqu’elles n’y étaient pas habituées.
La parure des femmes des Maldives consiste en bracelets ; chacune en place un certain nombre à ces deux bras, de sorte que tout l’espace compris entre le poignet et le coude en est couvert. Ces bijoux sont d’argent ; les femmes seules du sultan et de ses proches portent des bracelets d’or. Les habitantes des Maldives ont des khalkhâl (anneaux placés à la cheville du pied), que l’on appelle baïl, et des colliers d’or qu’elles mettent à leur gorge, et que l’on nomme besdered. Une de leurs actions singulières consiste à s’engager comme servantes dans les maisons, moyennant une somme déterminée, qui ne dépasse pas cinq pièces d’or. Leur entretien est à la charge de celui qui les prend à gage. Elles ne regardent pas cela comme un déshonneur, et la plupart des filles des habitants en usent ainsi. Tu trouveras dans la demeure d’un homme riche dix et vingt d’entre elles. Le prix de tous les vases qu’une de ces servantes casse demeure à sa charge. Lorsqu’elle veut passer d’une maison dans une autre, les maîtres de celle-ci lui donnent la somme dont elle est redevable ; elle la remet aux gens de la maison dont elle sort, et cette créance sur elle demeure aux autres (c’est-à-dire à ses nouveaux maîtres). La principale occupation de ces femmes à gage, c’est de filer le kanbar.
Il est facile de se marier dans ces îles, à cause de la modicité de la dot, ainsi qu’à raison de l’agrément qu’y présente le commerce des femmes. La plupart des hommes ne parlent pas d’un don nuptial ; on se contente de prononcer la profession de foi musulmane, et un don nuptial conforme à la loi est donné. Quand il arrive des vaisseaux, les gens de l’équipage prennent femme, et, lorsqu’ils veulent partir, ils la répudient ; c’est une sorte de mariage temporaire. Les femmes des Maldives ne sortent jamais de leur pays. Je n’ai pas vu dans l’univers de femmes d’un commerce plus agréable. Chez les insulaires, l’épouse ne confie à personne le soin de servir son mari ; c’est elle qui lui apporte des aliments, qui dessert après qu’il a mangé, qui lui lave les mains, qui lui offre de l’eau pour les ablutions, et qui lui couvre les pieds quand il veut dormir. Une de leurs coutumes, c’est que la femme ne mange pas avec son mari, et que l’homme ne sache pas ce que mange son épouse. J’ai épousé, dans ce pays, plusieurs femmes ; quelques-unes mangèrent avec moi, sur ma demande, d’autres ne le firent pas ; je ne pus réussir à les voir prendre leur nourriture, et aucune ruse ne me fut utile pour cela.
Récit du motif pour lequel les habitants de ces îles se convertissent à l’islamisme ; description des malins esprits d’entre les génies qui leur causaient du dommage tous les mois
Des gens dignes de confiance parmi les habitants des Maldives, tels que le jurisconsulte Iça Alyamany, le jurisconsulte et maître d’école ’Aly, le kadi ’Abd Allah et autres, me racontèrent que la population de ces îles était idolâtre, et qu’il lui apparaissait tous les mois un malin esprit d’entre les génies, qui venait du côté de la mer. Il ressemblait à un vaisseau rempli de lanternes. La coutume des indigènes, dès qu’ils l’apercevaient, était de prendre une jeune vierge, de la parer et de la conduire dans un boudkhânah, c’est-à-dire un temple d’idoles, lequel était bâti sur le bord de la mer et avait une fenêtre d’où on la découvrait. Ils l’y laissaient durant une nuit, et revenaient au matin ; alors ils trouvaient la jeune fille privée de sa virginité et morte. Ils ne cessaient pas chaque mois de tirer au sort, et celui qu’il atteignait livrait sa fille. Dans la suite arriva chez eux un Maghrébin, appelé Abou’lbérécât, le Berbère, qui savait par cœur l’illustre Coran. Il se logea dans la maison d’une vieille femme de l’île Mahal. Un jour qu’il visitait son hôtesse, il trouva qu’elle avait rassemblé sa famille et que ces femmes pleuraient comme si elles eussent été à des funérailles. Il les questionna au sujet de leur affliction, mais elles ne lui en firent pas connaître la cause. Un drogman survint et lui apprit que le sort était tombé sur la vieille, et qu’elle n’avait qu’une seule fille, que devait tuer le mauvais génie. Abou’lbérécât dit à la vieille : « J’irai cette nuit en place de ta fille. » Or il était complètement imberbe. On l’emmena donc la nuit suivante, et on l’introduisit dans le temple d’idoles, après qu’il eut fait ses ablutions. Il se mit à réciter le Coran, puis il aperçut le démon par la fenêtre et continua sa récitation. Dès que le génie fut à portée de l’entendre, il se plongea dans la mer, et quand vint l’aurore le Maghrébin était encore occupé à réciter le Coran. La vieille, sa famille et les gens de l’île arrivèrent pour enlever la fille, selon leur coutume, et brûler son corps. Ils trouvèrent l’étranger, qui répétait le Coran, le conduisirent à leur roi, que l’on appelait Chénoûrâzah, et lui firent connaître cette aventure. Le roi en fut étonné ; le Maghrébin lui offrit d’embrasser l’islamisme et lui en inspira le désir. Chénoûrâzah lui dit : « Reste près de nous jusqu’au mois prochain ; situ fais encore ce que tu viens de faire et que tu échappes au mauvais génie, je me convertirai. » L’étranger demeura près des idolâtres, et Dieu disposa l’esprit du roi à recevoir la vraie foi. Il se fit donc musulman avant la fin du mois, ainsi que ses femmes, ses enfants et les gens de sa cour. Quand commença le mois suivant, le Maghrébin fut conduit au temple d’idoles ; mais le démon ne vint pas, et le Berbère se mit à réciter le Coran jusqu’au matin. Le sultan et ses sujets arrivèrent alors et le trouvèrent dans cette occupation. Ils brisèrent les idoles, et démolirent le temple. Les gens de l’île embrassèrent l’islamisme et envoyèrent des messagers dans les autres îles, dont les habitants se convertirent aussi. Le Maghrébin resta chez ce peuple, jouissant d’une grande considération. Les indigènes firent profession de sa doctrine, qui était celle de l’imâm Malik. Encore à présent, ils vénèrent les Maghrébins à cause de lui. Il bâtit une mosquée, qui est connue sous son nom. J’ai lu l’inscription suivante, gravée dans le bois, sur la tribune grillée de la grande mosquée : « Le sultan Ahmed Chénoûrâzah a embrassé l’islamisme entre les mains d’Abou’lbérécât, le Berbère, le Maghrébin. » Ce sultan assigna le tiers des impôts des îles comme une aumône aux voyageurs, en reconnaissance de ce qu’il avait embrassé l’islamisme par leur entremise. Cette portion des tributs porte encore un nom qui rappelle cette circonstance.
A cause du démon dont il a été question, beaucoup d’entre les îles Maldives furent dépeuplées avant leur conversion à l’islamisme. Lorsque nous pénétrâmes dans ce pays, je n’avais aucune connaissance de cet événement. Une nuit que je vaquais à une de mes occupations, j’entendis tout à coup des gens qui récitaient à haute voix les formules : « Il n’y a pas d’autre dieu que Dieu », et « Dieu est très grand ». Je vis des enfants portant sur leur tête des Corans et des femmes qui frappaient dans des bassins et des vases de cuivre. Je fus étonné de leur action et je dis : « Que vous est-il donc arrivé ? » On me répondit : « Est-ce que tu ne vois pas la mer ? » Je la regardai et découvris une espèce de grand vaisseau, paraissant plein de lampes et de réchauds. On me dit : « C’est le démon ; il a coutume de se montrer une fois par mois. Mais, dès que nous avons fait ce que tu as vu, il s’en retourne et ne nous cause pas de dommage. »
Une des merveilles des îles Maldives, c’est qu’elles ont pour souverain une femme, qui est Khadîdjah, fille du sultan Djélal eddîn ’Omar, fils du sultan Salâh eddîn Sâlih Albendjâly. La royauté a appartenu d’abord à son aïeul, puis à son père, et lorsque ce dernier fut mort, son frère Chihâb eddîn devint roi. Il était en bas âge, et le vizir ’Abd Allah, fils de Mohammed Alhadhramy, épousa sa mère et s’empara de l’autorité sur lui. C’est le même personnage qui épousa la sultane Khadîdja, après la mort de son premier mari, le vizir Djémal eddîn, ainsi que nous le raconterons. Quand Chihâb eddîn parvint à l’âge viril, il chassa son beau-père, le vizir ’Abd Allah, et l’exila dans les îles de Souweïd. Il resta seul maître du pouvoir, choisit pour vizir un de ses affranchis nommé ’Aly Calaky, qu’il destitua au bout de trois années et qu’il exila à Souweïd. On racontait du sultan Chihâb eddîn qu’il allait trouver nuitamment les femmes des fonctionnaires de son royaume et de ses courtisans. On le déposa à cause de cela et on le déporta dans la région d’Hélédoutény ; puis on y envoya quelqu’un qui le tua.
Il ne restait plus de la famille royale que les sœurs du défunt, Khadîdja, qui était l’aînée, Miryam et Fathimah. Les indigènes élevèrent à la souveraineté Khadîdja, qui était mariée à leur prédicateur Djémal eddîn. Ce dernier devint vizir et maître de l’autorité, et promut son fils Mohammed à l’emploi de prédicateur en sa place ; mais les ordres ne sont promulgués qu’au nom de Khadîdja. On les trace sur des feuilles de palmier, au moyen d’un fer recourbé qui ressemble à un couteau. On n’écrit sur du papier que des Corans et les traités scientifiques. Le prédicateur fait mention de la sultane le vendredi et d’autres jours. Voici en quels termes il s’exprime : « Mon Dieu, secours ta servante, que tu as préférée, dans ta science, aux autres mortels, et dont tu as fait l’instrument de ta miséricorde envers tous les musulmans, c’est-à-dire la sultane Khadîdja, fille du sultan Djélal eddîn, fils du sultan Salâh eddîn. »
Lorsqu’un étranger arrive chez ce peuple et qu’il se rend à la salle d’audience, que l’on nomme dâr, la coutume exige qu’il emporte avec lui deux pagnes. Il fait une salutation du côté de la sultane et jette un des deux pagnes ; puis il salue son vizir, qui est aussi son mari, Djémal eddîn, et jette le second. L’armée de cette souveraine se compose d’environ mille hommes d’entre les étrangers ; quelques-uns des soldats sont des indigènes. Ils viennent chaque jour à la salle d’audience, saluent et s’en retournent. Leur solde consiste en riz, qui leur est fourni sur le bender tous les mois. Lorsque le mois est terminé, ils se présentent à la salle d’audience, saluent et disent au vizir : « Fais parvenir nos hommages (à la souveraine), et apprends-lui que nous sommes venus demander notre solde. » Là-dessus, les ordres nécessaires sont donnés en leur faveur. Le kadi et les fonctionnaires, qui chez ce peuple portent le titre de vizirs, se présentent aussi chaque jour à la salle d’audience. Ils font une salutation, et s’en retournent après que les eunuques ont transmis leur hommage à la souveraine.
Des fonctionnaires et de leur manière d’agir
Les habitants des Maldives appellent le vizir suprême, lieutenant de la sultane, calaky, et le kadi, fandayarkâloû. Tous les jugements ressortissent au kadi ; il est plus considéré, chez ce peuple, que tous les autres hommes, et ses ordres sont exécutés comme ceux du sultan et mieux encore. Il siège sur un tapis dans la salle d’audience ; il possède trois îles, dont il perçoit les impôts pour son propre compte, d’après une ancienne coutume qu’a établie le sultan Ahmed Chenoûrâzah. On appelle le prédicateur hendîdjéry, le chef de la trésorerie fâmeldâry, le receveur général des finances mâfâcaloû, le magistrat de police fitnâyec et l’amiral mânâyec. Tous ces individus ont le titre du vizir. Il n’y a pas de prison dans ces îles ; les coupables sont enfermés dans des maisons de bois destinées à recevoir les denrées des marchands. Chacun d’eux est placé dans une cellule en bois, comme on fait chez nous (au Maroc) pour les prisonniers chrétiens.
De mon arrivée dans ces îles et des vicissitudes que j’y éprouvai
Lorsque j’arrivai dans ce pays, je descendis dans l’île de Cannaloûs, qui est belle et où se trouvent de nombreuses mosquées. Je me logeai dans la maison d’un de ses plus pieux habitants. Le jurisconsulte ’Aly m’y donna un festin. C’était un personnage distingué et il avait des fils adonnés à l’étude. Je vis un homme nommé Mohammed et originaire de Zafar Alhomoûdh, qui me traita et me dit : « Si tu entres dans l’île de Mahal, le vizir te retiendra par force, car les habitants n’ont pas de kadi. » Or mon dessein était de me rendre de ce pays-là dans le Ma’bar (côte de Coromandel), à Serendîb (Ceylan), au Bengale, puis en Chine. Or j’étais arrivé dans les îles Maldives sur le vaisseau du patron de navire ’Omar Alhinaoury, qui était au nombre des pèlerins vertueux. Quand nous fûmes entrés à Cannaloûs, il y demeura dix jours ; puis il loua une petite barque pour se rendre de cette île à Mahal, avec un présent destiné à la souveraine et à son mari. Je voulus partir avec lui, mais il me dit : « La barque n’est pas assez grande pour toi et tes compagnons. Si tu veux te mettre en route sans eux, tu en es le maître. » Je refusai cette proposition, et ’Omar s’éloigna. Mais le vent lui fut contraire (litt. joua avec lui), et au bout de quatre jours il revint nous trouver, non sans avoir éprouvé des fatigues. Il me fit des excuses, et me conjura de partir avec lui, accompagné de mes camarades. Nous mettions à la voile le matin, nous descendions vers le milieu du jour sur quelque île ; nous la quittions et nous passions la nuit dans une autre. Après quatre jours de navigation, nous arrivâmes à la région de Teïm, dont le gouverneur se nommait Hilâl. Il me salua, me donna un festin et vint ensuite me trouver en compagnie de quatre hommes, dont deux avaient placé sur leurs épaules un bâton et y avaient suspendu quatre poulets. Les deux autres portaient un bâton pareil et y avaient attaché environ dix noix de coco. Je fus étonné du cas qu’ils faisaient de ces méprisables objets ; mais on m’apprit qu’ils agissaient ainsi par manière de considération et de respect.
Nous quittâmes ces gens-là et descendîmes le sixième jour dans l’île d’Othman, qui est un homme distingué, et un des meilleurs que l’on puisse voir. Il nous reçut avec honneur et nous traita.
Le huitième jour, nous relâchâmes dans une île appartenant à un vizir appelé Télemdy. Le dixième, enfin, nous parvînmes à l’île de Mahal, où résident la sultane et son mari, et nous jetâmes l’ancre dans le port. La coutume du pays, c’est que personne ne débarque, si ce n’est avec la permission des habitants. Ils nous l’accordèrent, et je voulus me transporter dans quelque mosquée ; mais les esclaves qui se trouvaient sur le rivage m’en empêchèrent et me dirent : « Il faut absolument visiter le vizir. » J’avais recommandé au patron de dire, lorsqu’on l’interrogerait à mon sujet : « Je ne le connais pas », et cela de peur qu’ils ne me retinssent ; car j’ignorais qu’un bavard malavisé leur eût écrit pour leur faire connaître ce qui me concernait, et que j’avais été kadi à Dihly. Quand nous arrivâmes à la salle d’audience, nous nous assîmes sur des bancs placés près de la troisième porte d’entrée. Le kadi ’Iça Alyamany survint et me salua. De mon côté, je saluai le vizir. Le patron de navire Ibrahim (plus haut il est nommé Omar) apporta dix pièces d’étoffe, fit une salutation du côté de la souveraine, et jeta un de ces pagnes ; puis il fléchit le genou en l’honneur du vizir et jeta un autre pagne, et ainsi de suite jusqu’au dernier. On l’interrogea à mon sujet, et il répondit : « Je ne le connais pas. »
On nous présenta ensuite du bétel et de l’eau de rose, ce qui est une marque d’honneur chez ce peuple. Le vizir nous fit loger dans une maison, et nous envoya un repas consistant en une grande écuelle pleine de riz et entourée de plats où se trouvaient de la viande salée et séchée au soleil, des poulets, du beurre fondu et du poisson.
Le lendemain je partis avec le patron de navire et le kadi ’Iça Alyamany pour visiter un ermitage situé à l’extrémité de l’île, et fondé par le vertueux cheikh Nedjîb. Nous revînmes pendant la nuit, et le lendemain matin le vizir m’envoya des vêtements et un repas comprenant du riz, du beurre fondu, de la viande salée et séchée au soleil, des noix de coco, du miel extrait de ce même fruit, et que les insulaires appellent korbâny, ce qui signifie eau de sucre. On apporta cent mille cauris pour servir à mes dépenses. Au bout de dix jours arriva un vaisseau de Ceylan, où il y avait des fakirs arabes et persans qui me connaissaient et qui apprirent aux serviteurs du vizir ce qui me concernait. Cela augmenta la joie que lui avait causée ma venue. Il me manda au commencement de ramadhan. Je trouvai les chefs et les vizirs déjà rassemblés, et l’on servit des mets sur des tables, dont chacune réunissait un certain nombre de convives. Le grand vizir me fit asseoir à son côté, en compagnie du kadi ’Iça, du vizir fâmeldâry, ou chef de la trésorerie, et du vizir ’Omar déherd, ce qui veut dire « général de l’armée ». Le repas de ces insulaires consiste en riz, poulets, beurre fondu, poisson, viande salée et séchée au soleil, et bananes cuites. Après avoir mangé, ils boivent du miel de coco mélangé avec des aromates, ce qui facilite la digestion.
Le 9 de ramadhan, le gendre du vizir mourut. Sa femme, la fille de ce ministre, avait été déjà mariée au sultan Chihâb eddîn ; mais aucun de ces deux époux n’avait cohabité avec elle à cause de son jeune âge. Le vizir, son père, la reprit chez lui et me donna sa maison, qui était au nombre des plus belles. Je lui demandai la permission de traiter les fakirs revenant de visiter le Pied d’Adam, dans l’île de Ceylan. Il me l’accorda et m’envoya cinq moutons, animaux qui sont rares chez ces insulaires, car on les y apporte du Ma’bar, du Malabar et de Makdachaou. Le vizir m’expédia également du riz, des poulets, du beurre fondu et des épices. Je fis porter tout cela à la maison du vizir Soleïman, le mânâyec (amiral), qui prit le plus grand soin de le faire cuire, en augmenta la quantité, et m’envoya des tapis et des vases de cuivre. Nous rompîmes le jeûne selon la coutume, dans le palais de la sultane, avec le grand vizir, et je le priai de permettre à quelques-uns des autres vizirs d’assister à mon repas. Il me dit : « Moi aussi je m’y rendrai. » Je le remerciai et retournai à ma maison ; mais il y était déjà arrivé avec les vizirs et les grands de l’État. Il s’assit dans un pavillon de bois élevé. Tous ceux qui arrivaient, chefs ou vizirs, saluaient le grand vizir et jetaient une pièce d’étoffe non façonnée, de sorte que le nombre total de ces pagnes monta à cent ou environ, que prirent les fakirs. On servit ensuite les mets et l’on mangea ; puis les lecteurs du Coran firent une lecture avec leurs belles voix, après quoi on se mit à chanter et à danser. Je fis préparer un feu ; les fakirs y entrèrent et le foulèrent aux pieds ; parmi eux il y en eu qui mangèrent des charbons ardents, comme on avale des confitures, jusqu’à ce que la flamme fût éteinte.
Récit d’une partie des bienfaits du vizir envers moi
Quand la nuit fut achevée, le vizir s’en retourna, et je l’accompagnai. Nous passâmes par un jardin appartenant au fisc, et le vizir me dit : « Ce jardin est à toi ; j’y ferai construire une maison pour qu’elle te serve de demeure. » Je louai sa manière d’agir et fis des vœux en sa faveur. Le lendemain il m’envoya une jeune esclave, et son messager me dit : « Le vizir te fait dire que, si cette fille te plaît, elle est à toi ; sinon, il t’expédiera une esclave mahratte. » Les jeunes filles mahrattes me plaisaient ; aussi répondis-je à l’envoyé : « Je ne désire que la Mahratte. » Le ministre m’en fit mener une, dont le nom était Gulistân, ce qui signifie la Fleur du jardin (ou plus exactement le parterre de fleurs, cf. Saadi). Elle connaissait la langue persane, et elle me plut fort. Les habitants des îles Maldives ont une langue que je ne comprenais pas.
Le lendemain, le vizir m’envoya une jeune esclave du Coromandel, appelée Anbéry (couleur d’ambre gris), La nuit suivante, après la prière de la nuit close, il vint chez moi avec quelques-uns de ses serviteurs, et entra dans la maison, accompagné de deux petits esclaves. Je le saluai, et il m’interrogea sur ma situation. Je fis des vœux en sa faveur et le remerciai. Un des esclaves jeta devant lui une lokchah (bokchah), c’est-à-dire une espèce de serviette, dont il tira des étoffes de soie et une boîte contenant des perles et des bijoux. Le vizir m’en fit cadeau, en ajoutant : « Si je t’avais expédié cela avec la jeune esclave, elle aurait dit : « Ceci est ma propriété, je l’ai apporté de la maison de mon maître. » Maintenant que ces objets t’appartiennent, fais-lui-en présent. » J’adressai à Dieu des prières pour le ministre et rendis à celui-ci les actions de grâce dont il était digne.
Du changement de dispositions du vizir, du projet que je formai de partir et du séjour que je fis ensuite aux Maldives
Le vizir Soleïman le mânâyec m’avait fait proposer d’épouser sa fille. J’envoyai donc demander au vizir Djémal eddîn la permission de conclure ce mariage. Mon messager revint me trouver et me dit : « Cela ne lui plaît pas, il désire te marier à sa fille, lorsque le terme légal du veuvage de celle-ci sera écoulé. » Je refusai de consentir à cette union, craignant la fâcheuse influence attachée à la fille du grand vizir, puisque deux époux étaient déjà morts près d’elle, avant d’avoir consommé le mariage. Sur ces entrefaites, une fièvre me saisit et j’en fus fort malade. Il faut absolument que toute personne qui entre dans cette île-là ait la fièvre, Je pris une forte résolution de partir de ce pays ; je vendis une portion de mes bijoux pour des cauris, et louai un vaisseau afin de me rendre dans le Bengale. Quand j’allai prendre congé du vizir, le kadi sortit à ma rencontre et me tint ce discours : « Le vizir te fait dire ceci : “Si tu veux t’éloigner, rends-nous ce que nous t’avons donné et pars ensuite.” » Je répondis : « Avec une partie des bijoux j’ai acheté des cauris ; faites-en ce que vous voudrez. » Au bout de quelque temps le kadi revint me trouver. « Le vizir, reprit-il, dit ceci : “Nous t’avons donné de l’or, et non des cauris”. » Je répliquai : « Eh bien, je les vendrai et je vous rendrai l’or. » En conséquence, j’envoyai prier les marchands de m’acheter les coquillages. Mais le vizir leur ordonna de n’en rien faire ; car son dessein, en se conduisant ainsi, était de m’empêcher de m’éloigner de lui.
Ensuite il me députa un de ses familiers, qui me tint ce discours : « Le vizir te fait dire de rester près de nous et que tu auras tout ce que tu désireras. » Je dis en moi-même : « Je suis sous leur autorité ; si je ne demeure pas de bonne grâce, je demeurerai par contrainte. Un séjour volontaire est donc préférable. » Je répondis à l’envoyé : « Très bien, je resterai près de lui. » Le messager retourna trouver son maître, qui fut joyeux de ma réponse et me manda. Lorsque j’entrai chez lui, il se leva, m’embrassa et me dit : « Nous voulons ta proximité et tu veux t’éloigner de nous ! » Je lui fis mes excuses, qu’il accueillit, et lui dis : « Si vous désirez que je reste, je vous imposerai des conditions. » Le vizir répondit : « Nous les acceptons ; fixe-les donc. » Je repris : « Je ne puis me promener à pied. » Or c’est la coutume des insulaires que personne ne monte à cheval en ce pays, si ce n’est le vizir. Aussi, lorsqu’on m’eut donné un cheval et que je le montai, la population, les hommes comme les enfants, se mit à me suivre avec étonnement, jusqu’à ce que je m’en plaignisse au vizir. On frappa sur une donkorah, et l’on proclama parmi le peuple que personne ne me suivît. La donkorah est une espèce de bassin de cuivre, que l’on bat avec une baguette de fer, et dont le bruit est entendu au loin. Après l’avoir frappée, on crie en public ce que l’on veut.
Le vizir me dit : « Si tu veux monter dans un palanquin, à merveille ; sinon, nous avons un étalon et une cavale. Choisis celui des deux animaux que tu préfères. » Je choisis la cavale, que l’on m’amena sur l’heure. On m’apporta en même temps des vêtements. Je dis au vizir : « Que ferai-je des cauris que j’ai achetés ? » Il me répondit : « Fais partir un de tes compagnons, afin qu’il te les vende dans le Bengale. — Je le ferai, repris-je, à condition que tu expédieras quelqu’un pour l’aider dans cette opération. — Oui, répliqua-t-il. » J’envoyai alors mon camarade Abou Mohammed, fils de Ferhân, en compagnie de qui on fit partir un indigène nommé le pèlerin ’Aly. Or il advint que la mer fut agitée ; l’équipage du navire jeta toute la cargaison, y compris le mât, l’eau et toutes les autres provisions de route. Ils restèrent pendant seize jours n’ayant ni voile ni gouvernail, etc. Après avoir enduré la faim, la soif et les fatigues, ils arrivèrent à l’île de Ceylan. Au bout d’une année, mon camarade Abou Mohammed vint me retrouver. Il avait visité le Pied (d’Adam), et il le revit en ma société.
Récit de la fête à laquelle j’assistai en compagnie des insulaires
Lorsque le mois de ramadhan fut achevé, le vizir m’envoya des vêtements, et nous nous rendîmes à l’endroit consacré aux prières. Le chemin que devait traverser le ministre, depuis sa demeure jusqu’au lieu des prières, avait été décoré ; on y avait étendu des étoffes, et l’on avait placé, à droite et à gauche, des monceaux de cauris. Tous ceux d’entre les émirs et les grands qui possédaient une maison sur ce chemin avaient fait planter près d’elle de petits cocotiers, des aréquiers et des bananiers. Des cordes avaient été tendues d’un arbre à l’autre, et des noix vertes y avaient été suspendues. Le maître du logis se tenait près de la porte, et quand le vizir passait, il lui jetait sur les pieds une pièce de soie ou de coton. Les esclaves du ministre s’en emparaient, ainsi que des cauris placés sur sa route. Le vizir s’avançait à pied, couvert d’une ample robe en poil de chèvre, de fabrique égyptienne, et d’un grand turban. Il portait en guise d’écharpe une serviette de soie ; quatre parasols ombrageaient sa tête, et ses pieds étaient couverts de sandales. Tous les autres assistants, sans exception, avaient les pieds nus. Les trompettes, les clairons et les timbales le précédaient ; les soldats marchaient devant et derrière lui, poussant tous le cri de : Dieu est très grand, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au lieu de la prière.
Quand elle fut terminée, le fils du vizir prêcha ; puis on amena une litière dans laquelle le ministre monta. Les émirs et les autres vizirs le saluèrent, en jetant des pièces d’étoffe selon la coutume. Auparavant, le grand vizir n’était pas monté dans une litière, car les rois seuls agissent ainsi. Les porteurs l’enlevèrent alors, j’enfourchai mon cheval et nous entrâmes au palais. Le ministre s’assit dans un endroit élevé, ayant près de lui les vizirs et les émirs. Les esclaves se tinrent debout, avec des boucliers, des épées et des bâtons. Alors on servit des mets, puis des noix d’arec et du bétel, après quoi on apporta une petite assiette contenant du sandal mokassiry. Aussitôt qu’une partie des assistants avaient mangé, ils se frottaient de sandal. Ce jour-là, je vis au-dessus de quelqu’un de leurs mets un poisson de l’espèce des sardines, salé et cru, qu’on leur avait apporté en présent de Caoulem. Ce poisson est très abondant sur la côte du Malabar. Le vizir prit une sardine et se mit à la manger. Il me dit en même temps : « Mange de cela ; il ne s’en trouve pas dans notre pays. » Je répondis « Comment en mangerais-je ? Cela n’est pas cuit. — C’est cuit », reprit-il ; mais je répliquai : « Je connais bien ce poisson, car il abonde dans ma patrie. »
De mon mariage et de ma nomination à la dignité de Kadi
Le deuxième jour de chawwâl, je convins avec le vizir Soleïman mânâyec, ou amiral, que j’épouserais sa fille, et j’envoyai demander au vizir Djémal eddîn que le contrat de mariage eût lieu en sa présence, dans le palais. Il y consentit et fit apporter le bétel, selon la coutume, et le sandal. La population fut présente à la cérémonie. Le vizir Suleïman tarda d’y venir ; on le manda ; mais il n’arriva pas. On le manda alors une seconde fois, et il s’excusa sur la maladie de sa fille ; mais le grand vizir me dit en secret : « Sa fille refuse de se marier, et elle est maîtresse de ses propres actions. Voilà que les gens se sont réunis. Veux-tu épouser la belle-mère de la sultane, veuve du père de celle-ci ? » (Or le fils du grand vizir était marié à la fille de cette femme.) Je répondis : « Oui, certes. » Il convoqua le kadi et les notaires. La profession de foi musulmane fut récitée, et le vizir paya le don nuptial. Au bout de quelques jours, mon épouse me fut amenée. C’était une des meilleures femmes qui existassent. La bonté de ses manières était telle que, quand je fus devenu son mari, elle m’oignait de bonnes odeurs et parfumait mes vêtements ; pendant cette opération, elle riait et ne laissait voir aucune incommodité.
Lorsque j’eus épousé cette femme, le vizir me contraignit à accepter les fonctions de kadi. Le motif de ma nomination, c’est que je reprochai au kadi de prendre la dixième partie des successions, quand il en faisait le partage entre les ayants droit. Je lui dis : « Tu ne dois avoir qu’un salaire dont tu conviendras avec les héritiers. » Ce juge ne faisait rien de bien.
Après que j’eus été investi des fonctions de kadi, je déployai tous mes efforts pour faire observer les préceptes de la loi. Les contestations ne se passent point dans ce pays-là comme dans le nôtre. La première méchante coutume que je réformai concernait le séjour des femmes divorcées dans la maison de ceux qui les avaient répudiées. Car chacune de ces femmes ne cessait de demeurer dans l’habitation de son ancien époux, jusqu’à ce qu’elle fût mariée à un autre. J’empêchai d’agir ainsi sous aucun prétexte. On m’amena environ vingt-cinq hommes qui s’étaient conduits de la sorte ; je les fis frapper à coups de fouet et promener dans les marchés. Quant aux femmes, je les contraignis de sortir de la demeure de ces gens-là. Ensuite, je m’efforçai de faire célébrer les prières ; j’ordonnai à des hommes de se rendre en hâte dans les rues et les marchés, aussitôt après la prière du vendredi. Quiconque ils découvraient n’ayant pas prié, je le faisais bâtonner et promener en public. J’obligeai les imâms et les muezzins en possession d’appointements fixes de s’acquitter assidûment de leurs fonctions. J’écrivis dans le même sens aux magistrats de toutes les îles. Enfin j’essayai de faire adopter des vêtements aux femmes ; mais je ne pus y parvenir.
De l’arrivée du vizir ’Abd Allah, fils de Mohammed Alhadhramy, que le sultan Chihâb eddîn avait exilé à Souweïd ; récit de ce qui se passa entre nous
J’avais épousé la belle-fille de ce personnage, la fille de sa femme, et j’aimais cette épouse d’un amour très fort. Quand le grand vizir l’eut mandé et rappelé dans l’île de Mahal, je lui envoyai des présents, allai à sa rencontre et l’accompagnai au palais. Il salua le vizir suprême, et celui-ci le logea dans une superbe maison, où je lui rendis souvent visite. Il advint que je passai en prières le mois de ramadhan, et que tous les habitants me visitèrent, excepté ’Abd Allah. Le vizir Djémal eddîn lui-même vint me voir, et ’Abd Allah avec lui, pour lui tenir compagnie. Une inimitié s’éleva entre nous. Or, quand je sortis de la retraite, les oncles maternels de ma femme, belle-fille d’Abd Allah, se plaignirent à moi. Ils étaient fils du vizir Djémal eddîn Assindjary. Leur père avait nommé pour leur tuteur le vizir ’Abd Allah, et leurs propriétés se trouvaient encore entre ses mains, quoiqu’ils fussent sortis de sa tutelle, d’après la loi. Ils demandèrent sa comparution dans le tribunal. J’avais coutume, quand je mandais une des parties adverses, de lui envoyer un morceau de papier, avec ou sans écriture. Aussitôt qu’elle en avait connaissance, elle se rendait au tribunal, ou sinon je la châtiais. J’envoyai donc un papier à ’Abd Allah, selon mon habitude. Ce procédé le mit en colère, et à cause de cela il conçut de la haine contre moi. Il cacha son inimitié et chargea quelqu’un de parler en sa place. Des discours déshonnêtes me furent répétés comme ayant été tenus par lui.
La coutume des insulaires, faibles ou puissants, était de saluer le vizir ’Abd Allah de la même manière que le vizir Djémal eddîn. Leur salutation consiste à toucher la terre avec l’index, puis à le baiser et à le placer sur leur tête. Je donnai des ordres au crieur public, et il proclama dans le palais du souverain, en présence de témoins, que tout individu qui rendrait hommage au vizir ’Abd Allah de la même manière qu’au grand vizir encourrait un châtiment sévère. J’exigeai de lui un engagement de ne plus laisser les hommes agir ainsi. Son inimitié envers moi en fut augmentée.
Cependant j’épousai encore une autre femme, fille d’un vizir très considéré des insulaires, et qui avait eu pour aïeul le sultan Dâoud, petit-fils du sultan Ahmed Chénoûrâzah ; puis j’en épousai une qui avait été mariée au sultan Chihâb eddîn, et je fis construire trois maisons dans le jardin que m’avait donné le vizir. Quant à ma quatrième femme, qui était belle-fille du vizir ’Abd Allah, elle habitait sa propre demeure. C’était celle de toutes mes épouses que je chérissais le plus. Lorsque je me fus allié par mariage aux individus que j’ai cités, le vizir et les habitants de l’île me craignirent beaucoup, à cause de leur faiblesse. De faux rapports furent répandus près de moi et du vizir suprême, en grande partie par les soins du vizir ’Abd Allah, si bien que notre éloignement réciproque fut définitif.
De ma séparation d’avec ces gens-là, et quel en fut le motif
Il arriva un certain jour que la femme d’un esclave du défunt sultan Djélal eddîn se plaignit de lui au vizir, et rapporta à celui-ci qu’il se trouvait près d’une concubine du sultan, avec laquelle il avait un commerce adultère. Le vizir envoya des témoins, qui entrèrent dans la maison de la jeune femme, trouvèrent l’esclave endormi avec elle sur le même tapis, et les emprisonnèrent. Lorsque le matin fut venu et que j’eus appris cette nouvelle, je me rendis à la salle d’audience et m’assis dans le lieu où j’avais coutume de m’asseoir. Je ne dis pas un mot de cette affaire. Un courtisan s’approcha de moi et me dit : « Le vizir te fait demander si tu as quelque besoin. — Non », répondis-je. Le dessein du ministre était que je parlasse de l’affaire de la concubine et de l’esclave ; car c’était mon habitude qu’il ne se présentât aucune cause sans que je la jugeasse. Mais, comme j’éprouvais contre lui du mécontentement et de la haine, je négligeai d’agir ainsi. Je m’en retournai ensuite à ma maison, et m’assis dans l’endroit où je rendais mes sentences. Aussitôt arrive un vizir, qui me dit, de la part du grand vizir : « Hier il est advenu telle et telle chose, à cause de l’affaire de la concubine et de l’esclave ; juge-les tous deux conformément à la loi. » Je répondis : « C’est une cause sur laquelle il ne convient pas de rendre un jugement, si ce n’est dans le palais du sultan. » J’y retournai donc, le peuple se rassembla, et l’on fit comparaître la concubine et l’esclave. J’ordonnai de les frapper tous deux à cause de leur tête-à-tête ; je prononçai la mise en liberté de la femme et je retins en prison l’esclave, après quoi je m’en retournai à ma maison.
Le vizir me dépêcha plusieurs de ses principaux serviteurs pour me parler de la mise en liberté de l’esclave. Je leur dis : « On intercède près de moi en faveur d’un esclave nègre qui a violé le respect qu’il devait à son maître, et hier vous avez déposé le sultan Chihâb eddîn et vous l’avez tué parce qu’il était entré dans la maison d’un de ses esclaves. » Et aussitôt j’ordonnai de frapper le coupable avec des baguettes de bambou, ce qui produit plus d’effet que les coups de fouet. Je le fis promener par toute l’île, ayant corde au cou. Les messagers du vizir allèrent le trouver et l’instruisirent de ce qui s’était passé. Il montra une grande agitation et fut enflammé de colère. Il réunit les autres vizirs, les chefs de l’armée, et m’envoya chercher. Je me rendis près de lui. Or j’avais coutume de lui rendre hommage en fléchissant le genou. Cette fois-là je ne le fis pas, et me contentai de dire : « Que le salut soit sur vous ! » Puis je dis aux assistants : « Soyez témoins que je me dépouille des fonctions de kadi, parce que je suis dans l’impuissance de les exercer. » Le vizir m’ayant adressé la parole, je montai et m’assis dans un endroit où je me trouvais vis-à-vis de lui ; puis je lui répondis de la manière la plus dure. Sur ces entrefaites, le muezzin appela à la prière du coucher du soleil, et le grand vizir entra dans sa maison en disant : « On prétend que je suis un souverain ; or voici que j’ai mandé cet homme, afin de me mettre en colère contre lui, et il se fâche contre moi. » Je n’étais considéré de ces insulaires qu’à cause du sultan de l’Inde, car ils connaissaient le rang dont je jouissais près de lui. Quoiqu’ils soient éloignés de lui, ils le craignent fort dans leur cœur.
Quand le grand vizir fut rentré dans sa maison, il manda le kadi destitué, qui était éloquent, et qui m’adressa ce discours : « Notre maître te fait demander pourquoi tu as violé, en présence de témoins, le respect qui lui est dû, et pourquoi tu ne lui as pas rendu hommage ? » Je répondis : « Je ne le saluais que quand mon cœur était satisfait de lui ; mais, puisqu’un mécontentement est survenu, j’ai renoncé à cet usage. La salutation des musulmans ne consiste que dans le mot assélâm (le salut soit sur vous), et je l’ai prononcé. » Le vizir m’envoya une seconde fois cet individu, qui me dit : « Tu n’as d’autre but que de nous quitter ; paye les dots de tes femmes et ce que tu dois aux hommes, et pars quand tu voudras. » Sur cette parole, je m’inclinai, je m’en allai à ma demeure, et acquittai les dettes que j’avais contractées. Vers ce temps-là, le vizir m’avait donné des tapis et un mobilier, consistant en vases de cuivre et autres objets. Il m’accordait tout ce que je demandais, m’aimait et me traitait avec considération ; mais il changea de dispositions, et on lui inspira des craintes à mon sujet.
Lorsqu’il apprit que j’avais payé mes dettes et que je me disposais à partir, il se repentit de ce qu’il avait dit et différa de m’accorder la permission de me mettre en route. Je jurai par les serments les plus forts qu’il me fallait absolument reprendre mon voyage, je transportai ce qui m’appartenait dans une mosquée située sur le rivage de la mer, et répudiai une de mes femmes. Une autre était enceinte, je lui assignai un terme de neuf mois, pendant lequel je devais revenir, à défaut de quoi elle serait maîtresse d’en user à sa volonté. J’emmenai avec moi celle de mes femmes qui avait été mariée au sultan Chihâb eddîn, afin de la remettre entre les mains de son père, qui habitait l’île de Moloûc, et ma première épouse, dont la fille était sœur consanguine de la sultane. Je convins avec le vizir ’Omar deherd et le vizir Haçan, l’amiral, que je me rendrais dans le pays de Ma’bar, dont le roi était mon beau-frère, que j’en reviendrais avec des troupes, afin que les îles fussent réduites sous son autorité, et qu’alors j’y exercerais le pouvoir en son nom. Je choisis, comme devant servir de signaux entre eux et moi, des pavillons blancs, qui seraient arborés à bord des vaisseaux. Aussitôt qu’ils les auraient vus, ils devaient se soulever dans l’île (littéral. sur terre). Je n’avais jamais ambitionné cela, jusqu’au jour où j’éprouvai du mécontentement. Le vizir me craignait et disait au peuple : « Il faut absolument que cet homme-là s’empare du vizirat, soit de mon vivant, soit après ma mort. » Il faisait de nombreuses questions sur ce qui me concernait et ajoutait : « J’ai appris que le roi de l’Inde lui a envoyé de l’argent, afin qu’il s’en serve pour exciter des troubles contre moi. » Il redoutait mon départ, de peur que je ne revinsse de la côte de Coromandel avec des troupes. Il me fit donc dire de rester jusqu’à ce qu’il eût équipé pour moi un navire ; mais je refusai.
La sœur consanguine de la sultane se plaignit à celle-ci du départ de sa mère avec moi. La sultane voulut l’empêcher, sans pouvoir y parvenir. Lorsqu’elle la vit résolue à partir, elle lui dit : « Tous les bijoux que tu possèdes proviennent de l’argent de l’entrepôt de la douane. Si tu as des témoins pour attester que Djélal eddîn te les a donnés, à merveille ; sinon, restitue-les. » Ces bijoux avaient beaucoup de valeur ; néanmoins, ma femme les rendit à ces personnes-là. Les vizirs et les chefs vinrent me trouver pendant que j’étais dans la mosquée et me prièrent de revenir. Je leur répondis : « Si je n’avais pas juré, certes, je m’en retournerais. » Ils reprirent : « Va-t’en dans quelque autre île, afin que ton serment soit vrai, après quoi tu reviendras. — Oui », répliquai-je afin de les satisfaire. Lorsqu’arriva le jour où je devais partir, j’allai faire mes adieux au vizir. Il m’embrassa et pleura, de sorte que ses larmes tombèrent sur mes pieds. Il passa la nuit suivante à veiller lui-même sur l’île, de peur que mes parents par alliance et mes compagnons ne se soulevassent contre lui.
Enfin je partis et arrivai à l’île du vizir ’Aly. De grandes douleurs atteignirent ma femme, et elle voulut s’en retourner. Je la répudiai et la laissai là, et j’écrivis cette nouvelle au vizir, car cette femme était la mère de l’épouse de son fils. Je répudiai aussi l’épouse à laquelle j’avais fixé un terme (pour mon retour), et mandai une jeune esclave que j’aimais. Cependant, nous naviguâmes au milieu de ces îles, passant d’une région (ou groupe) dans une autre.
Des femmes qui n’ont qu’une seule mamelle
Dans une de ces îles, je vis une femme qui n’avait qu’une seule mamelle. Elle était mère de deux filles, dont l’une lui ressemblait en tout, et dont l’autre avait deux mamelles, sauf que l’une était grande et renfermait du lait ; l’autre était petite et n’en contenait pas. Je fus étonné de la conformation de ces femmes.
Nous arrivâmes ensuite à une autre de ces îles, qui était petite et où il n’y avait qu’une seule maison, occupée par un tisserand, marié et père de famille. Il possédait de petits cocotiers et une petite barque, dont il se servait pour prendre du poisson et se transporter dans les îles où il voulait aller. Sur son îlot il y avait encore de petits bananiers ; nous n’y vîmes pas d’oiseaux de terre ferme, à l’exception de deux corbeaux, qui volèrent au-devant de nous à notre arrivée et firent le tour de notre vaisseau. J’enviais vraiment le sort de cet homme et formais le vœu, dans le cas où son île m’eût appartenu, de m’y retirer jusqu’à ce que le terme inévitable arrivât pour moi.
Je parvins ensuite à l’île de Moloûc, où se trouvait le navire appartenant au patron Ibrahim et dans lequel j’avais résolu de me rendre à la côte de Coromandel. Cet individu vint me trouver avec ses compagnons, et ils me traitèrent dans un beau festin. Le vizir avait écrit en ma faveur un ordre prescrivant de me donner dans cette île cent vingt bostoû de cauris, vingt gobelets d’athouân, ou miel de coco, et d’y ajouter chaque jour une certaine quantité de bétel, de noix d’arec et de poisson. Je passai à Moloûc soixante et dix jours, et j’y épousai deux femmes. Moloûc est au nombre des îles les plus belles, étant verdoyante et fertile. Parmi les choses merveilleuses que l’on y voit, je remarquai qu’un rameau qui aura été coupé sur un de ses arbres, et planté en terre ou dans une muraille, se couvrira de feuilles et deviendra lui-même un arbre. Je vis aussi que le grenadier ne cesse d’y porter des fruits durant toute l’année. Les habitants de cette île craignirent que le patron Ibrahim ne les pillât au moment de son départ. En conséquence, ils voulurent se saisir des armes que contenait son vaisseau, et les garder jusqu’au jour de son départ. Une dispute s’engagea pour ce motif, et nous retournâmes à Mahal, où nous ne débarquâmes pas. J’écrivis au vizir pour lui faire savoir ce qui avait eu lieu. Il envoya un écrit portant qu’il n’y avait pas de raison de prendre les armes de l’équipage. Nous retournâmes donc à Moloûc, et nous en repartîmes au milieu du mois de rebi’ second de l’année 745 (26 août 1344).
Dans le mois de cha’bân de cette même année (décembre 1344) mourut le vizir Djémal eddîn. La sultane était enceinte de lui et accoucha après sa mort. Le vizir ’Abd Allah l’épousa.
Quant à nous, nous naviguâmes, n’ayant pas avec nous de capitaine instruit. La distance qui sépare les Maldives de la côte de Coromandel est de trois jours. Cependant, nous voguâmes pendant neuf jours, et le neuvième nous débarquâmes à l’île de Ceylan. Nous aperçûmes la montagne de Sérendîb, qui s’élève dans l’air comme si c’était une colonne de fumée. Quand nous arrivâmes près de cette île, les marins dirent : « Ce port n’est pas dans le pays d’un sultan dans les États duquel les marchands entrent en toute sûreté ; mais il se trouve dans ceux du sultan Aïry Chacarouaty, qui est au nombre des hommes injustes et pervers. Il a des vaisseaux qui exercent la piraterie sur mer. » En conséquence, nous craignîmes de descendre dans son port ; mais, le vent ayant augmenté, nous redoutâmes d’être submergés, et je dis au patron : « Mets-moi à terre, et je prendrai pour toi un sauf-conduit de ce sultan. » Il fit ce que lui demandais et me déposa sur le rivage. Les idolâtres s’avancèrent au-devant de nous et dirent : « Qui êtes-vous ? » Je leur appris que j’étais beau-frère et ami du sultan du Coromandel, que j’étais parti pour lui rendre visite, et que ce qui se trouvait à bord du vaisseau était un présent destiné à ce prince. Les indigènes allèrent trouver leur souverain et lui firent part de ma réponse. Il me manda, et je me rendis près de lui dans la ville de Batthâlah (Putelam), qui était sa capitale. C’est une place petite et jolie, entourée d’une muraille et de bastions de bois. Tout le littoral voisin est couvert de troncs de cannelliers entraînés par les torrents. Ces bois sont rassemblés sur le rivage et y forment des espèces de collines. Les habitants du Coromandel et du Malabar les emportent sans rien payer ; seulement, en retour de cette faveur, ils font cadeau au sultan d’étoffes et de choses analogues.
Entre le Coromandel et l’île de Ceylan, il y a une distance d’un jour et d’une nuit. On trouve aussi dans cette île beaucoup de bois de brésil, ainsi que l’aloès indien, nommé alcalakhy, mais qui ne ressemble pas au kamâry, ni au kâkouly, Nous en parlerons ci-après.
On l’appelle Aïry Chacarouaty, et c’est un souverain puissant sur mer. Je vis un jour, tandis que je me trouvais sur la côte de Coromandel, cent de ses vaisseaux, tant petits que grands, qui venaient d’y arriver. Il y avait dans le port huit navires appartenant au sultan du pays et destinés à faire un voyage dans le Yémen. Le souverain ordonna de faire des préparatifs, et rassembla des gens pour garder ses vaisseaux. Lorsque les Ceylanais désespérèrent de trouver une occasion de s’en emparer, ils dirent : « Nous ne sommes venus que pour protéger des vaisseaux à nous appartenant, et qui doivent aussi se rendre dans le Yémen. »
Quand j’entrai chez le sultan idolâtre, il se leva, me fit asseoir à son côté et me parla avec la plus grande bonté. « Que tes compagnons, me dit-il, débarquent en toute sûreté et qu’ils soient mes hôtes jusqu’à ce qu’ils repartent. Il existe une alliance entre moi et le sultan de la côte de Coromandel. » Puis il ordonna de me loger, et je restai près de lui pendant trois jours, avec une grande considération, qui augmentait chaque jour. Il comprenait la langue persane, et goûtait fort ce que je lui racontais touchant les rois et les pays étrangers. J’entrai chez ce prince un jour qu’il avait près de lui des perles en quantité, qu’on avait apportées de la pêcherie qui se trouve dans ses États. Les officiers de ce prince séparaient celles qui étaient précieuses de celles qui ne l’étaient pas. Il me dit : « As-tu vu des pêcheries de perles dans les contrées d’où tu viens ? — Oui, lui répondis-je, j’en ai vu dans l’île de Keïs et dans celle de Kech, qui appartient à Ibn Assaouâmély. — J’en ai ouï parler », reprit-il ; puis il prit plusieurs perles et ajouta : « Y a-t-il dans cette île-là des perles pareilles à celles-ci ? » Je répliquai : « Je n’en ai vu que d’inférieures. » Ma réponse lui plut, et il me dit : « Elles t’appartiennent. Ne rougis pas, ajouta-t-il, et demande-moi ce que tu voudras. » Je repris donc : « Je n’ai d’autre désir, depuis que je suis arrivé dans cette île, que celui de visiter l’illustre Pied d’Adam. » Les gens du pays appellent ce premier homme bâbâ (père) et ils appellent Eve mâmâ (mère). « Cela est facile, répondit-il ; nous enverrons avec toi quelqu’un qui te conduira. — C’est ce que je veux », lui dis-je ; puis j’ajoutai : « Le vaisseau dans lequel je suis venu se rendra en toute sûreté dans le Ma’bar (Coromandel), et quand je serai de retour tu me renverras dans tes vaisseaux. — Certes », répliqua-t-il.
Lorsque je rapportai cela au patron du navire, il me dit : « Je ne partirai pas jusqu’à ce que tu sois revenu, quand même je devrais attendre un an à cause de toi. » Je fis part au sultan de cette réponse, et il me dit : « Le patron sera mon hôte jusqu’à ce que tu reviennes. » Il me donna un palanquin que ses esclaves portaient sur leur dos, et envoya avec moi quatre de ces djoguis qui ont coutume d’entreprendre annuellement un pèlerinage pour visiter le Pied ; il y joignit trois brahmanes, dix autres de ses compagnons, et quinze hommes pour porter les provisions. Quant à l’eau, elle se trouve en abondance sur la route.
Le jour de notre départ, nous campâmes près d’une rivière, que nous traversâmes dans un bac formé de rameaux de bambous. De là nous nous rendîmes à Ménâr Mendely, belle ville située à l’extrémité du territoire du sultan, et dont la population nous traita dans un excellent festin. Ce repas consistait en jeunes buffles, pris à la chasse dans un bois voisin et ramenés tout vivants ; en riz, beurre fondu, poisson, poules et lait. Nous ne vîmes pas en cette ville de musulman, à l’exception d’un Khoraçanien, qui y était resté pour cause de maladie et qui nous accompagna. Nous partîmes pour Bender Sélâouât, petite ville, et, après l’avoir quittée, nous traversâmes des lieux âpres et pleins d’eau. On y trouve de nombreux éléphants, mais qui ne font pas de mal aux pèlerins, ni aux étrangers, et cela par la sainte influence du cheikh Abou’Abd Allah, fils de Khafîf, le premier qui ouvrit ce chemin pour aller visiter le Pied. Auparavant, les infidèles empêchaient les musulmans d’accomplir ce pèlerinage, les vexaient, ne mangeaient ni ne commerçaient avec eux. Mais, quand l’aventure que nous avons racontée dans la première partie de ces voyages (t. II) fut arrivée au cheikh Abou’Abd Allah, c’est à savoir le meurtre de tous ses compagnons par des éléphants, sa préservation, et la manière dont un éléphant le porta sur son dos, à dater de ce temps-là les idolâtres se mirent à honorer les musulmans, à les faire entrer dans leurs maisons et à manger avec eux. Ils ont même confiance en eux, en ce qui regarde leurs femmes et leurs enfants. Jusqu’à ce jour ils vénèrent extrêmement le cheikh susdit et l’appellent le grand cheikh.
Cependant, nous parvînmes à la ville de Conacâr, résidence du principal souverain de ce pays. Elle est construite dans une tranchée, entre deux montagnes, près d’une grande baie, que l’on appelle la baie des pierres précieuses, parce que des gemmes y sont trouvées. A l’extérieur de cette ville se voit la mosquée du cheikh ’Othman, le Chîrâzien, surnommé Châoûch (l’huissier). Le souverain et les habitants de la place le visitent et lui témoignent de la considération. C’est lui qui servait de guide pour aller voir le Pied. Quand on lui eut coupé une main et un pied, ses fils et ses esclaves devinrent guides à sa place. Le motif pour lequel il fut ainsi mutilé, c’est qu’il égorgea une vache. Or la loi des Hindous ordonne que celui qui a tué une vache soit massacré comme elle, ou enfermé dans sa peau et brûlé. Le cheikh ’Othman étant respecté de ces gens-là, ils se contentèrent de lui couper une main et un pied, et lui firent cadeau de l’impôt levé sur un certain marché.
Il est désigné par le nom de Conâr et possède l’éléphant blanc. Je n’ai pas vu dans l’univers d’autre éléphant blanc. Le souverain le monte dans les solennités, et attache au front de cet animal de grosses gemmes. Il advint à ce monarque que les grands de son empire se soulevèrent contre lui, l’aveuglèrent et firent roi son fils. Quant à lui, il vit encore, dans cette ville, privé de la vue.
Les gemmes admirables dites albahramâns (rubis ou escarboucles) ne se trouvent que dans cette ville. Parmi elles il y en a que l’on tire de la baie, et ce sont les plus précieuses aux yeux des indigènes ; d’autres sont extraites de la terre.
On rencontre des gemmes dans toutes les localités de l’île de Ceylan. Dans ce pays, le sol tout entier constitue une propriété particulière. Un individu en achète une portion, et creuse afin de trouver des gemmes. Il rencontre des pierres blanches et ramifiées ; c’est dans l’intérieur de ces pierres qu’est cachée la gemme. Le propriétaire la remet à des lapidaires, qui la frottent jusqu’à ce qu’elle soit séparée des pierres qui la recèlent. Il y en a de rouges (rubis), de jaunes (topazes) et de bleues que l’on appelle neïlem (nîlem). La coutume des indigènes, c’est que les pierres précieuses dont la valeur s’élève à cent fanem sont réservées au sultan, qui en donne le prix, et les prend pour lui. Quant à celles qui sont d’un prix inférieur, elles demeurent la propriété de ceux qui les ont trouvées. Cent fanem équivalent à six pièces d’or.
Toutes les femmes dans l’île de Ceylan possèdent des colliers de pierres précieuses de diverses couleurs ; elles en mettent à leurs mains et à leurs pieds, en guise de bracelets et de khalkhâls. Les concubines du sultan font avec ces gemmes un réseau qu’elles placent sur leur tête. J’ai vu sur le front de l’éléphant blanc sept de ces pierres précieuses, dont chacune était plus grosse qu’un œuf de poule. J’ai vu également près du sultan Aïry Chacarouaty une écuelle de rubis aussi grande que la paume de la main, et qui contenait de l’huile d’aloès. Je témoignai mon étonnement au sujet de cette écuelle ; mais le sultan me dit : « Nous possédons des objets de la même matière plus grands que celui-là. »
Cependant, nous partîmes de Conacâr, et nous nous arrêtâmes dans une caverne appelée du nom d’Ostha Mahmoud Alloûry. Ce personnage était au nombre des gens de bien ; il a creusé cette caverne sur le penchant d’une montagne, près d’une petite baie. Après avoir quitté cet endroit, nous campâmes près de la baie nommée Khaour bouzneh (baie des singes), Bouzneh (en persan boûzîneh) désigne la même chose que alkoroûd (pluriel d’alkird, singe) en arabe.
Ces animaux sont très nombreux dans ces montagnes ; ils sont de couleur noire et ont de longues queues. Ceux qui appartiennent au sexe masculin ont de la barbe comme les hommes. Le cheikh ’Othman, son fils et d’autres personnages m’ont raconté que ces singes ont un chef à qui ils obéissent comme si c’était un souverain. Il attache sur sa tête un bandeau de feuilles d’arbres et s’appuie sur un bâton. Quatre singes, portant des bâtons, marchent à sa droite et à sa gauche, et quand le chef s’assied ils se tiennent debout derrière lui. Sa femelle et ses petits viennent, s’asseyent devant lui tous les jours. Les autres singes arrivent et s’accroupissent à quelque distance de lui ; puis un des quatre susmentionnés leur adresse la parole, et tous se retirent ; après quoi, chacun apporte une banane ou un limon, ou quelque fruit semblable. Le roi des singes, ses petits et les quatre singes principaux mangent. Un certain djogui m’a raconté avoir vu ces quatre singes devant leur chef et occupés à frapper un autre singe à coups de bâton ; après quoi ils lui arrachèrent les poils.
Des gens dignes de foi m’ont rapporté que, quand un de ces singes s’est emparé d’une jeune fille, celle-ci ne peut se dérober à sa lubricité. Un habitant de l’île de Ceylan m’a raconté qu’il y avait chez lui un singe, qu’une de ses filles entra dans une chambre et que l’animal l’y suivit. Elle cria contre lui, mais il lui fit violence. « Nous accourûmes près d’elle, continuait ce personnage, nous vîmes le singe qui la tenait embrassée, et nous le tuâmes. »
Cependant, nous partîmes pour la baie des Bambous, de laquelle Abou’Abd Allah, fils de Khafîf tira les deux rubis qu’il donna au sultan de cette île, ainsi que nous l’avons raconté dans la première partie de ces voyages (t. II); puis nous marchâmes vers un endroit nommé la Maison de la Vieille, et qui se trouve à l’extrême limite des lieux habités. Nous en partîmes pour la caverne de Baba Thâhir, qui était un homme de bien, et ensuite pour celle de Sébîc. Ce Sébîc a été au nombre des souverains idolâtres et s’est retiré en cet endroit pour s’y livrer à des pratiques de dévotion.
Dans ce lieu-là, nous vîmes la sangsue volante, que les indigènes appellent zoloû. Elle se tient sur les arbres et les herbes qui se trouvent dans le voisinage de l’eau, et quand un homme s’approche d’elle elle fond sur lui. Quelle que soit la place du corps de cet individu sur laquelle tombe la sangsue, il en sort beaucoup de sang. Les habitants ont soin de tenir prêt, pour ce cas, un limon dont ils expriment le jus sur le ver qui se détache de leur corps ; ils raclent l’endroit sur lequel il est tombé avec un couteau de bois destiné à cet usage. On raconte qu’un certain pèlerin passa par cette localité, et que des sangsues s’attachèrent à lui. Il montra de l’impassibilité, et ne pressa pas sur elles un citron ; aussi tout son sang fut épuisé et il mourut. Le nom de cet homme était Bâbâ Khoûzy, et il y a là une caverne qui porte le même nom.
De ce lieu, nous nous rendîmes aux Sept Cavernes, puis à la colline d’Iskender (Alexandre). Il y a ici la grotte dite d’Alisfahâny, une source d’eau et un château inhabité, sous lequel se trouve une baie appelée le Lieu de la Submersion des Contemplatifs. Dans le même endroit se voient la caverne de l’orange et celle du sultan. Près de celle-ci est la porte (derwâzeh en persan, bâb en arabe) de la montagne.
De la montagne de Sérendîb (PIC D’ADAM)
C’est une des plus hautes montagnes du monde ; nous l’aperçûmes de la pleine mer, quoique nous en fussions séparés par une distance de neuf journées de marche. Pendant que nous en faisions l’ascension, nous voyions les nuages au-dessus de nous, qui nous dérobaient la vue de sa partie inférieure. Il y a sur cette montagne beaucoup d’arbres de l’espèce de ceux qui ne perdent pas leurs feuilles, des fleurs de diverses couleurs, et une rose rouge aussi grande que la paume de la main. On prétend que sur cette rose il y a une inscription dans laquelle on peut lire le nom du Dieu très haut et celui de son prophète. Sur le mont il y a deux chemins qui conduisent au Pied d’Adam. L’un est connu sous le nom de chemin du Père, et l’autre sous le nom de chemin de la Mère. On désigne ainsi Adam et Eve. Quant à la route de la Mère, c’est une route facile, par laquelle s’en retournent les pèlerins ; mais celui qui la prendrait pour l’aller serait regardé comme n’ayant pas fait le pèlerinage. Le chemin du Père est âpre et difficile à gravir. Au pied de la montagne, à l’endroit où se trouve sa porte, est une grotte qui porte aussi le nom d’Iskender, et une source d’eau.
Les anciens ont taillé dans le roc des espèces de degrés, à l’aide desquels on monte ; ils y ont fiché des pieux de fer, auxquels on a suspendu des chaînes, afin que celui qui entreprend l’ascension puisse s’y attacher. Ces chaînes sont au nombre de dix, savoir : deux au bas de la montagne, à l’endroit où se trouve la porte, sept contiguës les unes aux autres, après les deux premières ; quant à la dixième, c’est la chaîne de la profession de foi (musulmane), ainsi nommée parce que l’individu qui y sera arrivé et qui regardera en bas de la montagne sera saisi d’hallucination et, de peur de tomber, il récitera les mots : « J’atteste qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu, et que Mahomet est son prophète. » Quand tu auras dépassé cette chaîne, tu trouveras un chemin mal entretenu. De la dixième chaîne à la caverne de Khidhr, il y a sept milles. Cette caverne est située dans un endroit spacieux, et elle a près d’elle une source d’eau remplie de poissons, laquelle porte aussi le nom de Khidhr. Personne ne pêche de ces poissons. Dans le voisinage de la caverne, il y a deux bassins creusés dans le roc, de chaque côté du chemin. C’est dans la grotte de Khidhr que les pèlerins laissent ce qui leur appartient ; de là ils gravissent encore deux milles jusqu’à la cime du mont, où se trouve le pied.
La marque du noble pied, celui de notre père Adam, se voit dans une roche noire et haute, et dans un endroit spacieux. Le pied s’est enfoncé dans la pierre, de sorte que son emplacement est tout déprimé ; sa longueur est de onze empans. Les habitants de la Chine y vinrent jadis ; ils ont coupé dans la pierre la place du gros orteil et de ce qui l’avoisine, et ont déposé ce fragment dans un temple de la ville de Zeïtoûn (Tseu-thoung), où ils se rendent des provinces les plus éloignées. Dans la roche où se trouve l’empreinte du pied, on a creusé neuf trous, dans lesquels les pèlerins idolâtres déposent de l’or, des pierres précieuses et de perles. Tu pourras voir les fakirs, quand ils seront arrivés à la grotte de Khidhr, chercher à se devancer les uns les autres, pour prendre ce qu’il y a dans le creux. Pour nous, nous n’y trouvâmes que quelques petites pierres et un peu d’or, que nous donnâmes à notre guide. C’est la coutume que les pèlerins passent trois jours dans la caverne de Khidhr, et que, durant ce temps, ils visitent le pied matin et soir. Nous fîmes de même.
Lorsque les trois jours furent écoulés, nous nous en retournâmes par le chemin de la Mère, et nous campâmes près de la grotte de Cheïm, qui est le même que Cheïth (Seth), fils d’Adam. Nous nous arrêtâmes ensuite près de la baie des poissons, des bourgades de Cormolah, de Djebercâouân, de Dildinéoueh et d’Atkalendjeh. C’est dans cette dernière localité que passait l’hiver le cheikh Abou ’Abd Allah, fils de Khafîf. Toutes ces bourgades et ces stations sont situées dans la montagne. Près du pied de celle-ci, dans ce même chemin, se trouve Dérakht (dirakht) kewân, « l’arbre marchant », qui est un arbre séculaire, duquel il ne tombe pas une seule feuille. Je n’ai rencontré personne qui ait vu ses feuilles. On le désigne aussi sous le nom de mâchïah (marchant) par ce que l’individu qui le considère du haut de la montagne le juge placé à une grande distance de lui et rapproché du pied de cette montagne, tandis que celui qui le regarde du bas de celle-ci le croit dans une position tout opposée. J’ai vu en cet endroit une troupe de djoguis qui ne quittaient pas le pied de la montagne, attendant la chute des feuilles de cet arbre. Il est placé dans un lieu où il n’est en aucune manière possible de l’atteindre. Les idolâtres débitent à son sujet des mensonges, au nombre desquels est celui-ci : quiconque mange de ses feuilles recouvre la jeunesse, quand bien même il serait un vieillard. Mais cela est faux.
Sous cette montagne se trouve la baie d’où l’on tire les pierres précieuses. Ses eaux paraissent aux yeux extrêmement bleues.
De cet endroit, nous marchâmes pendant deux jours jusqu’à la ville de Dînéwer, qui est grande, située près de la mer et habitée par des marchands. On y voit dans un vaste temple une idole qui porte le même nom que la ville. Il y a dans ce temple environ mille brahmanes et djoguis, et environ cinq cents femmes, nées de pères idolâtres, lesquelles chantent et dansent toutes les nuits devant la statue. La ville et ses revenus sont la propriété particulière de l’idole ; tous ceux qui demeurent dans le temple et ceux qui le visitent sont nourris là-dessus. La statue est d’or et de la grandeur d’un homme. Elle a, en place d’yeux, deux grands rubis, et l’on m’a rapporté qu’ils éclairaient durant la nuit comme deux lanternes.
Cependant, nous partîmes pour la ville de Kâly, qui est petite et à six parasanges de Dînéwer. Il s’y trouve un musulman, appelé le patron de navire Ibrahim, qui nous traita dans son habitation.
Nous nous mîmes en route pour la ville de Calenbou (Colombo), une des plus belles et des plus grandes de l’île de Sérendîb. C’est là que demeure le vizir prince de la mer, Djâlesty, qui a près de lui environ cinq cents Abyssins.
Trois jours après avoir quitté Calenbou, nous arrivâmes à Batthâlah, dont il a déjà été question. Nous en visitâmes le sultan, dont il a été parlé ci-dessus. Je trouvai le patron de navire Ibrahim qui m’attendait, et nous partîmes pour le pays du Ma’bar. Le vent devint fort, et l’eau fut sur le point d’entrer dans le vaisseau. Nous n’avions pas de capitaine instruit. Nous arrivâmes ensuite près de certaines roches, et peu s’en fallut que le vaisseau ne s’y brisât ; puis nous entrâmes dans une eau peu profonde, le bâtiment toucha, et nous vîmes la mort de très près (littéral. de nos propres yeux). Les passagers jetèrent à la mer ce qu’ils possédaient et se firent leurs adieux. Nous coupâmes le mât du navire et le lançâmes à l’eau ; les marins construisirent un radeau avec des planches. Il y avait entre nous et la terre une distance de deux parasanges. Je voulus descendre dans le radeau. Or j’avais deux concubines, et deux compagnons. Ceux-ci me dirent : « Descendras-tu et nous abandonneras-tu ? » Je les préférai à moi-même et je leur dis : « Descendez tous deux, ainsi que la jeune fille que j’aime. » L’autre jeune fille dit : « Je sais bien nager, je m’attacherai à une des cordes du bac et je nagerai avec ces gens-là. » Mes deux camarades descendirent ; un d’eux était Mohammed, fils de Ferhân Attaouzéry, et l’autre, un Égyptien. Une des jeunes filles était avec eux, la seconde nageait. Les marins lièrent des cordages au radeau et s’en aidèrent pour nager. Je mis près de ces gens-là ce que je possédais de précieux en meubles, joyaux et ambre. Ils arrivèrent à terre sains et sauf, car le vent leur venait en aide. Pour moi, je restai sur le vaisseau, dont le patron gagna la terre sur une planche. Les marins entreprirent de construite quatre radeaux ; mais le nuit survint avant qu’ils fussent achevés, et l’eau nous envahit. Je montai sur la poupe et y restai jusqu’au matin. Alors plusieurs idolâtres vinrent nous trouver dans une barque qui leur appartenait. Nous descendîmes avec eux sur le rivage, dans le pays du Ma’bar, et nous leur apprîmes que nous étions au nombre des amis de leur sultan, à qui ils payaient tribut. Ils lui écrivirent pour lui donner avis de cela. Le souverain était occupé à faire la guerre aux infidèles, à deux journées de distance ; je lui envoyai une lettre pour lui annoncer ce qui m’était arrivé. Les idolâtres en question nous firent entrer dans un grand bois, et nous apportèrent un fruit qui ressemble à la pastèque et que porte l’arbre de mokl (doûm, ou palmier nain). Ce fruit renferme une espèce de coton qui contient une substance mielleuse, que l’on extrait, et dont on fabrique une pâtisserie nommée tell et pareille au sucre. On nous servit encore du poisson excellent. Nous restâmes là trois jours, au bout desquels arriva, de la part du sultan, un émir appelé Kamar eddîn, et accompagné d’un détachement de cavaliers et de fantassins. Ils amenaient un palanquin et dix chevaux, je montai à cheval, ainsi que mes camarades, le patron du navire et une des deux jeunes filles ; l’autre fut portée dans le palanquin. Nous parvînmes au fort de Hercâtoû, dans lequel nous passâmes la nuit. J’y laissai les jeunes filles, une partie de mes esclaves et de mes compagnons. Le second jour nous arrivâmes au camp du sultan.
C’était Ghiâth eddîn Addâméghâny, et, dans le principe, il était cavalier au service de Mélik Modjîr, fils d’Abou’rredjâ, un des officiers du sultan Mohammed ; puis il servit l’émir Hâdjy, fils du seiyd sultan Djélal eddîn. Enfin, il fut investi de la royauté. Avant cela, il s’appelait Sirâdj eddîn ; mais à partir de son avènement il prit le nom de Ghiâth eddîn. Auparavant, le pays de Ma’bar avait été soumis à l’autorité du sultan Mohammed, roi de Dihly. Dans la suite, mon beau-père, le chérif Djélal eddîn Ahçân Chah, y excita un soulèvement et y régna pendant cinq ans, après quoi il fut tué et remplacé par un de ses émirs, ’Alâ eddîn Odeïdjy, qui gouverna une année. Au bout de ce temps, il se mit en marche pour combattre les infidèles, leur prit des richesses considérables et d’amples dépouilles, et revint dans ses États. L’année suivante, il fit une seconde expédition contre les idolâtres, les mit en déroute et en massacra un grand nombre. Le jour même où il leur fit éprouver ce désastre, le hasard voulut qu’il retirât son casque de dessus sa tête, afin de boire ; une flèche lancée par une main inconnue l’atteignit et il mourut sur-le-champ. On mit sur le trône son gendre Kothb eddîn, mais comme on n’approuva pas sa conduite, on le tua au bout de quarante jours. Le sultan Ghiâth eddîn fut investi de l’autorité ; il épousa la fille du sultan et chérif Djélal eddîn, celle-là même dont j’avais épousé la sœur à Dihly.
Récit de mon arrivée près du sultan GHIÂTH eddîn
Lorsque nous parvînmes dans le voisinage de son campement, il envoya à notre rencontre un de ses chambellans. Le sultan était assis dans une tour de bois. C’est la coutume, dans toute l’Inde, que personne n’entre sans bottines chez le souverain. Or je n’en avais pas, mais un idolâtre m’en donna, quoiqu’il y eût en cet endroit un certain nombre de musulmans. Je fus surpris que l’idolâtre eût montré plus de générosité qu’eux. Je me présentai donc devant le sultan, qui m’ordonna de m’asseoir, manda le kadi et pèlerin Sadr azzémân (le chef de l’époque) Béhâ eddîn, et me logea dans trois tentes situées dans son voisinage. Les habitants de ce pays appellent ces tentes khiyâm. Le sultan m’envoya des tapis, ainsi que les mets en usage dans le pays, c’est-à-dire du riz et de la viande. La coutume en cet endroit consiste à servir du lait aigri après le repas, ainsi qu’on fait dans nos contrées.
Après tout cela, j’eus une entrevue avec le sultan et lui proposai l’affaire des îles Maldives et l’envoi d’une armée dans ces îles. Il forma la résolution d’accomplir ce projet, et désigna pour cela des vaisseaux. Il destina un présent à la souveraine des Maldives, des robes d’honneur et des dons aux émirs et aux vizirs. Il me confia le soin de rédiger son contrat de mariage avec la sœur de la sultane ; enfin, il ordonna de charger trois vaisseaux d’aumônes pour les pauvres des îles et me dit : « Tu reviendras au bout de cinq jours. » L’amiral Khodjah Serlec lui dit : « Il ne sera possible de se rendre dans les îles Maldives qu’après trois mois révolus à partir de ce moment » Le sultan reprit en s’adressant à moi : « Puisqu’il en est ainsi, viens à Fattan, afin que nous terminions cette expédition-ci, et que nous retournions dans notre capitale de Moutrah ; c’est de là que l’on partira. » Je séjournai donc près de lui, et, en attendant, je mandai mes concubines et mes camarades.
Récit de l’ordre de la marche du sultan, et de sa honteuse conduite en tuant des femmes et des enfants
Le terrain que nous devions traverser était un bois formé d’arbres et de roseaux, et tellement touffu que personne ne pouvait le parcourir. Le sultan ordonna que chacun des individus composant l’armée, grand ou petit, emportât une hache pour couper ces obstacles. Dès que le camp eut été dressé, il s’avança à cheval vers la forêt, en compagnie des soldats. On abattit les arbres depuis le matin jusque vers midi. Alors on servit des aliments, et tout le monde mangea, troupe par troupe ; après quoi on se remit à couper des arbres jusqu’au soir. Tous les idolâtres que l’on trouva dans le bois, on les fit prisonniers ; on fabriqua des pieux aiguisés à leurs deux extrémités et on les plaça sur les épaules des captifs, afin qu’ils les portassent. Chacun était accompagné de sa femme et de ses enfants, et on les amena ainsi au camp. La coutume de ces peuples, c’est d’entourer leur campement d’une palissade munie de quatre portes, et qu’ils appellent catcar. Ils disposent autour de l’habitation du souverain un second catcar ; en dehors de la principale enceinte, ils élèvent des estrades hautes d’environ une demi-brasse et y allument du feu pendant la nuit. Les esclaves et les sentinelles passent la nuit en cet endroit ; chacun d’eux tient un faisceau de roseaux très minces, et quand quelques infidèles s’approchent afin d’attaquer le camp durant la nuit tous ces gens-là allument le fagot qu’ils ont dans leurs mains. Grâce à l’intensité de la lumière, la nuit devient semblable au jour, et les cavaliers sortent à la poursuite des idolâtres.
Or, dès que le matin fut arrivé, les Hindous qui avaient été faits prisonniers la veille furent partagés en quatre troupes, dont chacune fut amenée près d’une des portes du grand catcar. Les pieux qu’ils avaient portés furent plantés en terre dans cet endroit, et ils furent eux-mêmes fichés sur les pieux, jusqu’à ce que ceux-ci les traversassent de part en part. Ensuite, leurs femmes furent égorgées et attachées par leurs cheveux à ces pals. Les petits enfants furent massacrés sur le sein de leurs mères, et leurs corps laissés en cet endroit. Puis on dressa le camp, on s’occupa à couper les arbres d’une autre forêt, et on traita de la même manière les Hindous qui furent encore faits captifs. C’est là une conduite honteuse, et que je n’ai vu tenir par aucun autre souverain. Ce fut pour cela que Dieu hâta la mort de Ghiâth eddîn.
Un jour que le kadi était à la droite de ce prince, que je me trouvais à sa gauche, et qu’il prenait son repas avec nous, je vis qu’on avait amené un idolâtre, accompagné de sa femme et de son fils, âgé de sept ans. Le sultan fit signe de la main aux bourreaux de couper la tête de cet homme ; puis il leur dit : wé zeni ou wé pousseri ou, ce qui signifie en arabe : « et (à) son fils et (à) sa femme ». On leur trancha le cou, et je détournai ma vue de ce spectacle. Lorsque je me levai, je trouvai leurs têtes, qui gisaient à terre.
J’étais une autre fois en présence du sultan Ghiâth eddîn, à qui on avait amené un Hindou. Il prononça des paroles que je ne compris pas, et aussitôt plusieurs de ses satellites tirèrent leurs poignards. Je m’empressai de me lever, et il me dit : « Où vas-tu ? » Je répondis : « Je vais faire la prière de quatre heures de l’après-midi. » Il comprit quel était le motif de ma conduite, sourit, et ordonna de couper les mains et les pieds de l’idolâtre.A mon retour, je trouvai ce malheureux nageant dans son sang.
De la victoire que Ghiyâth eddîn remporta sur les idolâtres et qui est au nombre des plus grands succès de l’islamisme
Dans le voisinage de ses États, il y avait un souverain infidèle nommé Bélâl Diao, qui était au nombre des principaux souverains hindous. Son armée dépassait cent mille hommes, et il avait en outre près de lui vingt mille individus musulmans, soit gens débauchés et coupables de crimes, soit esclaves fugitifs. Ce monarque convoita la conquête de la côte de Coromandel, où l’armée des musulmans ne s’élevait qu’à six mille soldats, dont la moitié était d’excellentes troupes, et le reste ne valait absolument rien. Les mahométans en vinrent aux mains avec lui près de la ville de Cobbân ; il les mit en déroute et ils se retirèrent à Moutrah (Madura), capitale du pays. Le souverain idolâtre campa près de Cobbân, qui est une des plus grandes et des plus fortes places que possèdent les musulmans. Il l’assiégea pendant dix mois, et au bout de ce temps la garnison n’avait plus de vivres que pour quatorze jours. Bélâl Diao envoya proposer aux assiégés de se retirer avec un sauf-conduit, et de lui abandonner la ville ; mais ils répondirent : « Nous ne pouvons nous dispenser de donner avis de cette proposition à notre sultan. » Il leur promit donc une trêve, qui devait durer quatorze jours, et ils écrivirent au sultan Ghiâth eddîn dans quelle situation ils se trouvaient. Ce prince lut leur lettre au peuple le vendredi suivant. Les fidèles pleurèrent et dirent : « Nous sacrifierons notre vie à Dieu. Si l’idolâtre prend cette ville-là, il viendra nous assiéger : mourir par le glaive est préférable pour nous. » Ils prirent donc entre eux l’engagement de s’exposer à la mort, et se mirent en marche le lendemain, ôtant de leurs têtes leurs turbans, et les plaçant au cou des chevaux, ce qui indique quelqu’un qui cherche le trépas. Ils postèrent à l’avant-garde les plus courageux et les plus braves d’entre eux, au nombre de trois cents ; à l’aile droite Seïf eddîn Behadour (le héros), qui était un jurisconsulte pieux et brave ; et à l’aile gauche Almélic Mohammed assilahdâr (armiger). Quant au sultan, il se plaça au centre accompagné de trois mille hommes, et mit à l’arrière-garde les trois mille qui restaient, sous le commandement d’Açad eddîn Keïkhosrew Alfâricy. Ainsi rangés, les musulmans se dirigèrent, au moment de la sieste, vers le camp du prince infidèle, dont les soldats n’étaient pas sur leurs gardes, et avaient envoyé leurs chevaux au pâturage. Ils fondirent sur le campement ; les idolâtres, s’imaginant que c’étaient des voleurs, sortirent au-devant d’eux en désordre et les combattirent. Sur ces entrefaites, le sultan Ghiyâth eddîn survint, et les Hindous essuyèrent la pire de toutes les déroutes. Leur souverain essaya de monter à cheval, quoiqu’il fût âgé de quatre-vingts ans. Nasir eddîn, neveu du sultan, et qui lui succéda atteignit le vieillard et voulut le tuer, car il ne le connaissait pas. Mais, un de ses esclaves lui ayant dit : « C’est le souverain (hindou) », il le fit prisonnier et le mena à son oncle, qui le traita avec une considération apparente, jusqu’à ce qu’il eût extorqué de lui ses richesses, ses éléphants et ses chevaux, en promettant de le relâcher. Quand il lui eut enlevé toutes ses propriétés, il l’égorgea et le fit écorcher ; sa peau fut remplie de paille et suspendue sur la muraille de Moutrah, où je l’ai vue dans la même position.
Mais revenons à notre propos. Je partis du camp et arrivai à la ville de Fattan, qui est grande, belle et située sur le rivage. Son port est admirable, on y a construit un grand pavillon de bois, élevé sur de grosses poutres et où l’on monte par un chemin en planches, recouvert d’une toiture. Quand arrive l’ennemi, on attache à ce pavillon les vaisseaux qui se trouvent dans le port ; les fantassins et les archers y montent, et l’assaillant ne trouve aucune occasion de nuire. Dans cette ville, il y a une belle mosquée bâtie de pierres, et on y voit beaucoup de raisin, ainsi que d’excellentes grenades. Je rencontrai à Fattan le pieux cheikh Mohammed Anneïçâboûry, un de ces fakirs dont l’esprit est troublé, et qui laissent pendre leurs cheveux sur les épaules. Il était accompagné d’un lion qu’il avait apprivoisé, qui mangeait avec les fakirs et s’accroupissait près d’eux. Le cheikh avait près de lui environ trente fakirs, dont l’un possédait une gazelle qui habitait dans le même endroit que le lion, et à laquelle celui-ci ne faisait aucun mal. Je séjournai dans la ville de Fattan.
Cependant, un djogui avait préparé pour le sultan Ghiâth eddîn des pilules destinées à augmenter ses forces lors de la copulation charnelle. On dit que, parmi les ingrédients de ces pilules, se trouvait de la limaille de fer. Le sultan en avala plus qu’il n’était nécessaire et tomba malade. Dans cet état, il arriva à Fattan ; je sortis à sa rencontre et lui offris un présent. Quand il fut établi dans la ville, il manda l’amiral Khodjah Soroûr et lui dit : « Ne t’occupe que des vaisseaux désignés pour l’expédition aux Maldives. » Il voulut me remettre le prix du cadeau que je lui avais fait ; je refusai, mais je m’en repentis ensuite, car Ghiâth eddîn mourut, et je ne reçus rien. Le sultan resta la moitié d’un mois à Fattan, puis il partit pour sa capitale ; je demeurai encore une quinzaine de jours après son départ, et je me mis en route pour sa résidence, qui était Moutrah, ville grande et possédant de larges rues. Le premier prince qui la prit pour sa capitale fut mon beau-père, le sultan chérif Djélal eddîn Ahçan Chah, qui la rendit semblable à Dihly, et la construisit avec soin.
A mon arrivée à Moutrah, j’y trouvai une maladie contagieuse, dont on mourait en peu de temps. Ceux qui en étaient atteints succombaient dès le second ou le troisième jour. Si leur trépas était retardé, ce n’était que jusqu’au quatrième jour. Quand je sortais, je ne voyais que malades ou morts. J’achetai en cette ville une jeune esclave, sur l’assurance qu’on me donna qu’elle était saine ; mais elle mourut le lendemain. Un certain jour une femme, dont le mari avait été au nombre des vizirs du sultan Ahçan Chah, vint me trouver, avec son fils âgé de huit ans, et qui était un enfant plein d’esprit, de finesse et d’intelligence. Elle se plaignit de son indigence, et je lui donnai, ainsi qu’à son fils, une somme d’argent. Tous deux étaient sains et bien constitués ; mais dès le lendemain la mère revint, demandant pour son fils un linceul, car il était mort subitement. Je voyais dans la salle d’audience du sultan, au moment de sa mort, des centaines de servantes qui avaient été amenées afin de broyer le riz destiné à préparer de la nourriture pour d’autres personnes que le souverain ; je voyais, dis-je, ces femmes qui, étant malades, s’étaient jetées par terre, exposées à l’ardeur du soleil.
Lorsque Ghiâth eddîn entra dans Moutrah, il trouva sa mère, sa femme et son fils en proie à la maladie. Il resta dans la ville durant trois jours, puis il se transporta près d’un fleuve situé à une parasange de distance, et sur la rive duquel il y a un temple appartenant aux infidèles. J’allai le trouver un jeudi, et il ordonna de me loger près du kadi. Quand des tentes eurent été dressées pour moi, je vis des gens qui se hâtaient et dont les uns se poussaient sur les autres ; l’un disait : « Le sultan est mort » ; l’autre assurait que c’était son fils qui avait succombé. Nous recherchâmes la vérité, et nous connûmes que le fils était mort. Le sultan n’avait pas d’autre fils ; aussi ce trépas fut une des causes qui augmentèrent la maladie dont il était atteint. Le jeudi suivant la mère du souverain mourut.
De la mort du sultan, de l’avènement du fils de son frère, et de ma séparation d’avec le nouveau prince
Le troisième jeudi, Ghiâth eddîn mourut. J’appris cela et m’empressai de rentrer dans la ville, de peur du tumulte. Je rencontrai le neveu et successeur du défunt, Nasir eddîn qui se transportait au camp, où on l’avait mandé, le sultan n’ayant pas laissé de fils. Il m’engagea à retourner sur mes pas en sa compagnie ; mais je refusai, et ce refus fit impression sur son esprit (litt. son cœur). Ce Nasir eddîn avait exercé l’état de domestique à Dihly, avant que son oncle parvînt au trône. Quand Ghiâth eddîn fut devenu roi, le neveu s’enfuit près de lui, sous le costume des fakirs, et la destinée voulut qu’il régnât après lui. Lorsqu’on eut prêté serment à Nasir eddîn, les poètes récitèrent ses louanges, et il leur accorda des dons magnifiques. Le premier qui se leva pour débiter des vers fut le kadi Sadr azzémân, à qui il donna cinq cents pièces d’or et un habit d’honneur ; puis vint le vizir nommé Alkadi (le juge), que le sultan gratifia de deux mille pièces d’argent. Quant à moi, il me fit cadeau de trois cents pièces d’or et d’un habit d’honneur. Il répandit des aumônes parmi les fakirs et les indigents. Quand le prédicateur prononça le premier discours où il inséra le nom du nouveau souverain, on répandit sur celui-ci des drachmes et des dinars placés dans des assiettes d’argent. On célébra la pompe funèbre du sultan Ghiâth eddîn. Chaque jour on lisait le Coran tout entier près de son tombeau. Puis ceux dont l’emploi était de lire la dixième partie du saint livre faisaient une lecture ; après quoi, on servait des aliments, et le public mangeait ; enfin, on donnait des pièces d’argent à chaque individu, en proportion de son rang. On continua d’agir ainsi pendant quarante jours. On renouvela cette cérémonie chaque année, le jour anniversaire de la mort du défunt.
La première mesure que prit le sultan Nasir eddîn, ce fut de destituer le vizir de son oncle, et d’exiger de lui des sommes d’argent. Il investit du vizirat Mélik Bedr eddîn, le même que son oncle avait expédié à ma rencontre, pendant que j’étais à Fattan. Ce personnage ne tarda pas à mourir, et le sultan nomma vizir Khodjah Soroûr l’amiral, et ordonna qu’on l’appelât Khodjah Djihan, tout comme le vizir de Dihly. Quiconque lui adresserait la parole sous un autre titre devait payer un certain nombre de pièces d’or. Après cela, le sultan Nasir eddîn tua le fils de sa tante paternelle, qui était marié à la fille du sultan Ghiâth eddîn et épousa ensuite celle-ci. On lui rapporta que Mélik Maç’oud avait visité son cousin dans la prison, avant qu’il fût mis à mort, et il le fit périr, ainsi que Mélik Behadour, qui était au nombre des héros généreux et vertueux. Il ordonna de me fournir tous les vaisseaux que son oncle m’avait assignés pour me rendre aux Maldives. Mais je fus atteint de la fièvre, mortelle en cet endroit. Je m’imaginai que ce serait pour moi le trépas. Dieu m’inspira d’avoir recours au tamarin, qui est fort abondant en ce pays ; j’en pris donc environ une livre, que je mis dans l’eau. Je bus ensuite ce breuvage, qui me relâcha pendant trois jours, et Dieu me guérit de ma maladie. Je pris en dégoût la ville de Moutrah, et demandai au sultan la permission de voyager. Il me dit : « Comment partirais-tu ? Il ne reste pour se rendre aux Maldives qu’un mois. Demeure donc jusqu’à ce que nous te donnions tout ce que le Maître du monde (le feu sultan) a ordonné de te fournir. » Je refusai, et il écrivit en ma faveur à Fattan, afin que je partisse dans n’importe quel vaisseau je voudrais. Je retournai en cette ville ; j’y trouvai huit vaisseaux qui mettaient à la voile pour le Yémen, et je m’embarquai dans un d’eux. Nous rencontrâmes quatre navires de guerre, qui nous combattirent pendant peu de temps, puis se retirèrent ; après quoi nous arrivâmes à Caoulem. Comme j’avais un reste de maladie, je séjournai dans cette ville durant trois mois, puis je m’embarquai sur un vaisseau, afin d’aller trouver le sultan Djémal eddîn Alhinaoury ; mais les idolâtres nous attaquèrent entre Hinaour et Fâcanaour.
Comment nous fûmes dépouillés par les Hindous
Quand nous fûmes arrivés à la petite île située entre Hinaour et Fâcanaour, les idolâtres nous assaillirent avec douze vaisseaux de guerre, nous combattirent vivement et s’emparèrent de nous. Ils prirent tout ce que je possédais et que j’avais mis en réserve contre les adversités, ainsi que les perles, les pierres précieuses qui m’avaient été données par le roi de Ceylan, mes habits et les provisions de route dont m’avaient gratifié des gens de bien et de saints personnages. Ils ne me laissèrent d’autre vêtement qu’un caleçon. Ils se saisirent aussi de ce qui appartenait à tous les passagers et marins, et nous firent descendre à terre.
Je retournai à Calicut et entrai dans une de ses mosquées. Un jurisconsulte m’envoya un habillement, le kadi un turban, et un certain marchand, un autre habit. J’appris en ce lieu le mariage du vizir ’Abd Allah avec la sultane Khadîdjah, après la mort du vizir Djémal eddîn, et je sus que la femme que j’avais laissée enceinte était accouchée d’un enfant mâle. Il me vint à l’esprit de me rendre dans les îles Maldives ; mais je me rappelai l’inimitié qui avait existé entre moi et le vizir ’Abd Allah. En conséquence, j’ouvris le Coran, et ces mots se présentèrent à moi : « Les anges descendront près d’eux et leur diront : “Ne craignez pas et ne soyez pas tristes. (Coran, xli, 30) »
J’implorai la bénédiction de Dieu, me mis en route, arrivai au bout de dix jours aux îles Maldives, et débarquai dans celle de Cannaloûs. Le gouverneur de cette île, ’Abd El-Aziz Almakdachâouy, m’accueillit avec considération, me traita et équipa pour moi une barque. J’arrivai ensuite à Hololy, qui est l’île où la sultane et ses sœurs se rendent pour se divertir et se baigner. Les indigènes appellent ces amusements tetdjer et se livrent à des jeux sur les vaisseaux. Les vizirs et les chefs envoient à la sultane des présents et des cadeaux tant qu’elle se trouve dans cette île. J’y rencontrai la sœur de la sultane, son mari le prédicateur Mohammed, fils du vizir Djémal eddîn, et sa mère, qui avait été ma femme. Le prédicateur me visita, et l’on servit à manger.
Cependant, quelques-uns des habitants de l’île se transportèrent près du vizir ’Abd Allah, et lui annoncèrent mon arrivée. Il fit des questions touchant mon état et les personnes qui m’avaient accompagné. On l’informa que j’étais venu afin d’emmener mon fils, qui était âgé d’environ deux ans. La mère de cet enfant se présenta au vizir, afin de se plaindre de mon projet mais il lui dit : « Je ne l’empêcherai pas d’emmener son fils. » Il me pressa d’entrer dans l’île (de Mahal), et me logea dans une maison située vis-à-vis de la tour de son palais, afin d’avoir connaissance de mon état. Il m’envoya un vêtement complet, du bétel et de l’eau de rose, selon la coutume de ces peuples. Je portai chez lui deux pièces de soie, afin de les jeter au moment où je le saluerais. On me les prit, et le vizir ne sortit pas pour me recevoir ce jour-là. On m’amena mon fils, et il me parut que son séjour près des insulaires était ce qui lui valait le mieux. Je le leur renvoyai donc, et demeurai cinq jours dans l’île. Il me sembla préférable de hâter mon départ, et j’en demandai la permission. Le vizir m’ayant fait appeler, je me rendis près de lui. On m’apporta les deux pièces d’étoffe que l’on m’avait prises, et je les jetai en saluant le vizir, comme c’est la coutume. Il me fit asseoir à son côté, et m’interrogea touchant mon état. Je mangeai en sa compagnie et lavai mes mains dans le même bassin que lui, ce qu’il ne fait avec personne. Ensuite on apporta du bétel, et je m’en retournai. Le vizir m’envoya des pagnes et des bostoû (centaines de mille) de cauris, et se conduisit parfaitement.
Cependant, je partis ; nous restâmes en mer quarante-trois jours ; après quoi nous arrivâmes dans le Bengale, qui est un pays vaste et abondant en riz. Je n’ai pas vu dans l’univers de contrée où les denrées soient à meilleur marché que dans celle-ci ; mais elle est brumeuse, et les individus venus du Khoraçan l’appellent doûzakhast (doûzakhi) pouri ni’met ce qui signifie en arabe « un enfer rempli de biens ». J’ai vu vendre le riz, dans les marchés de ce pays, sur le pied de vingt-cinq rithl de Dihly pour un dinar d’argent ; celui-ci vaut huit drachmes, et leur drachme équivaut absolument à la drachme d’argent. Quant au rithl de Dihly il fait vingt rithl du Maghreb. J’ai entendu des gens de la contrée dire que ce prix était élevé pour eux (en proportion du taux habituel). Mohammed Almasmoûdy, le Maghrébin, qui était un homme de bien, ayant habité le Bengale anciennement, et qui mourut chez moi, à Dihly, me raconta qu’il avait une femme et un serviteur et qu’il achetait la nourriture nécessaire à eux trois, pour une année, moyennant huit drachmes. Or il payait le riz dans son écorce (ou balle) sur le pied de huit drachmes les quatre-vingts rithl poids de Dihly. Quand il l’avait broyé, il en retirait cinquante rithl poids net, ce qui faisait dix quintaux. J’ai vu vendre dans le Bengale une vache à lait pour trois dinars d’argent. Les bœufs de ce pays-là sont des buffles. Quant aux poules grasses, j’en ai vu vendre huit pour une drachme. Les petits pigeons étaient payés une drachme les quinze. J’ai vu donner un bélier gras pour deux drachmes ; un rithl de sucre, poids de Dihly, pour quatre drachmes ; un rithl de sirop pour huit drachmes ; un rithl de beurre fondu pour quatre drachmes, et un d’huile de sésame pour deux drachmes. Une pièce de coton fin, d’excellente qualité, mesurant trente coudées, a été vendue, moi présent, deux dinars. Une belle jeune fille, propre à servir de concubine, se payait en ma présence, un dinar d’or, ce qui fait deux dinars et demi en or du Maghreb. J’achetai, environ à ce prix-là, une jeune esclave nommée ’Achoûrah, qui était douée d’une exquise beauté. Un de mes camarades acheta un joli petit esclave, appelé Loûloû Perle, pour deux dinars d’or.
La première ville du Bengale où nous entrâmes était Sodcâwân, grande place située sur le rivage de la vaste mer (l’océan Indien). Le fleuve Gange, vers lequel les Hindous se rendent en pèlerinage, et le fleuve Djoûn (Djoumna ; ici le Brahmapoutra) se réunissent près d’elle et se jettent dans la mer. Les Bengalis ont sur le fleuve (Gange) de nombreux navires, avec lesquels ils combattent les habitudes du pays de Lacnaouty.
C’est le sultan Fakhr eddîn, surnommé Fakhrah, qui est un souverain distingué, aimant les étrangers, surtout les fakirs et les soufis. La royauté de ce pays a appartenu au sultan Nasir eddîn, fils du sultan Ghiâth eddîn Balaban, et dont le fils, Mo’izz eddîn, fut investi de la souveraineté à Dihly. Nasir eddîn se mit en marche pour combattre ce fils ; ils se rencontrèrent sur les bords du fleuve (Gange) et leur entrevue fut appelée la Rencontre des deux astres heureux. Nous avons déjà raconté cela, et comment Nasir eddîn abandonna l’empire à son fils et retourna dans le Bengale. Il y séjourna jusqu’à sa mort, et eut pour successeur son (autre) fils, Chams eddîn, qui, après son trépas, fut lui-même remplacé par son fils Chihâb eddîn, lequel fut vaincu par son frère, Ghiâth eddîn Behadour Boûr (ou Bourah). Chihâb eddîn demanda du secours au sultan Ghiâth eddîn Toghlok, qui lui en accorda, et fit prisonnier Behadour Boûra. Celui-ci fut ensuite relâché par le fils de Toghlok, Mohammed, après son avènement, à condition de partager avec lui le royaume du Bengale ; mais il se révolta contre lui, et Mohammed lui fit la guerre jusqu’à ce qu’il le tuât. Il nomma alors gouverneur de ce pays un de ses beaux-frères, que les troupes massacrèrent. ’Aly Chah, qui se trouvait alors dans le pays de Lacnaouty, s’empara de la royauté du Bengale. Quand Fakhr eddîn vit que la puissance royale était sortie de la famille du sultan Nasir eddîn, dont il était un des affranchis (ou clients), il se révolta à Sodcâwân et dans le Bengale, et se déclara indépendant. Une violente inimitié survint entre lui et ’Aly Chah. Lorsqu’arrivaient le temps de l’hiver et la saison des pluies (litt. des boues), Fakhr eddîn faisait une incursion sur le pays de Lacnaouty, au moyen du fleuve, sur lequel il était puissant. Mais, quand revenaient les jours où il ne tombe pas de pluie, ’Aly Chah fondait sur le Bengale par là voie de terre, à cause de la puissance qu’il avait sur celle-ci.
L’affection du sultan Fakhr eddîn pour les fakirs alla si loin qu’il plaça un d’eux comme son vice-roi à Sodcâwân. Cet individu était appelé Cheïdâ (en persan, « fou d’amour »). Le sultan s’étant éloigné, afin de combattre un de ses ennemis, Cheïdâ se révolta contre lui, voulut se rendre indépendant, et tua un fils du souverain, qui n’en avait pas d’autre que celui-là. Fakrh eddîn apprit cette conduite, et revint sur ses pas vers sa capitale. Cheïdâ et ses adhérents s’enfuirent vers la ville de Sonorcâwân (Sonârgânou, Soonergong), qui est très forte. Le sultan envoya des troupes, afin de les assiéger ; mais les habitants, craignant pour leur vie, se saisirent de Cheïdâ et le firent mener au camp du souverain. On donna avis de cette nouvelle à Fakrh eddîn, et il ordonna qu’on lui expédiât la tête du rebelle, ce qui fut exécuté. Un grand nombre de fakirs furent tués, à cause de la conduite de leur camarade.
A mon entrée à Sodcâwân, je ne visitai pas le sultan de cette ville et n’eus pas d’entrevue avec lui, parce qu’il était révolté contre l’empereur de l’Inde, et que je craignais les suites, qu’aurait pu avoir une différente manière d’agir. Je partis de Sodcâwân pour les montagnes de Câmaroû (le pays d’Assam), qui en sont à un mois de marche. Ce sont des montagnes étendues, qui confinent à la Chine et aussi au pays de Thebet (Tibet), où l’on trouve les gazelles qui produisent le musc. Les habitants de ces montagnes ressemblent aux Turcs, et ce sont de vigoureux travailleurs ; aussi un esclave d’entre eux vaut-il plusieurs fois autant qu’un esclave d’une autre nation. Ils sont connus comme s’adonnant beaucoup à la magie. Mon but, en me dirigeant vers le pays montagneux de Câmaroû, était de voir un saint personnage qui y demeure, c’est-à-dire le cheikh Djélal eddîn Attibrîzy.
Il était au nombre des principaux saints et des hommes les plus singuliers ; il avait opéré des actes importants, des miracles célèbres. C’était un homme fort âgé ; il me raconta avoir vu à Bagdad le khalife Mosta’cim billah l’Abbâside, et s’être trouvé en cette ville au moment de l’assassinat de ce souverain. Dans la suite, ses disciples me rapportèrent qu’il était mort à l’âge de cent cinquante ans ; que, pendant environ quarante années, il observa le jeûne, et ne le rompait qu’après l’avoir continué pendant dix jours consécutifs. Il possédait une vache, avec le lait de laquelle il mettait fin à son jeûne. Il restait debout durant toute la nuit ; il était maigre, de grande taille, et avait peu de poils sur les joues. Les habitants de ces montagnes embrassèrent l’islamisme entre ses mains, et ce fut pour ce motif qu’il séjourna parmi eux.
Plusieurs de ses disciples me racontèrent qu’il les convoqua un jour avant sa mort, leur recommanda de craindre Dieu, et leur dit : « Certes, je vous quitterai demain, s’il plaît à Dieu ; et mon successeur, près de vous, ce sera le Dieu seul et unique. » Quand il eut fait la prière de midi, le lendemain, Dieu prit son âme, pendant la dernière prosternation de cette prière. On trouva, à côté de la caverne qu’il habitait, une tombe toute creusée, près de laquelle étaient le linceul et les aromates ; on lava son corps, on l’enveloppa dans le suaire, on pria sur lui et on l’ensevelit dans ce tombeau.
Lorsque je me dirigeai pour visiter le cheikh, quatre de ses disciples me rencontrèrent à deux jours de distance du lieu de son habitation, et m’informèrent que leur supérieur avait dit aux fakirs qui se trouvaient près de lui : « Le voyageur de l’Occident arrive vers vous ; allez à sa rencontre. » Ils ajoutèrent qu’ils étaient venus au-devant de moi par l’ordre du cheikh. Or celui-ci ne connaissait rien de ce qui me concernait ; mais cela lui avait été révélé. Je me mis en route avec ces gens-là pour aller voir le cheikh, et arrivai à son ermitage, situé hors de la caverne. Il n’y a pas d’endroits cultivés près de cet ermitage, mais les gens de la contrée, tant musulmans qu’infidèles, viennent visiter le cheikh, et lui apportent des dons et des présents. C’est là-dessus que vivent les fakirs et les voyageurs. Quant au cheikh, il se borne à la possession d’une vache, avec le lait de laquelle il rompt le jeûne tous les dix jours, comme nous l’avons déjà dit. A mon entrée chez lui, il se leva, m’embrassa et m’interrogea touchant mon pays et mes voyages. Je l’instruisis de ces particularités, et il me dit : « Tu es le voyageur (par excellence) des Arabes. » Ceux des ses disciples qui étaient présents lui dirent : « Et des Persans aussi, ô notre maître. » Il reprit : « Et des Persans ; traitez-le donc avec considération. » On me conduisit à l’ermitage, et l’on me donna l’hospitalité pendant trois jours.
Anecdote étonnante et qui renferme le récit de plusieurs miracles du cheikh
Le jour même où j’entrai chez le cheikh, je vis sur lui une ample robe de poil de chèvre qui me plut. Je dis donc en moi-même : « Plût à Dieu que le cheikh me la donnât ! » Quand je le visitai pour lui faire mes adieux, il se leva, vint dans un coin de sa caverne, ôta sa robe et me la fit revêtir, ainsi qu’un haut bonnet, qu’il retira de dessus sa tête ; lui-même se couvrit d’un habit tout rapiécé. Les fakirs m’informèrent que le cheikh n’avait pas coutume de se vêtir de cette robe, qu’il ne l’avait prise qu’au moment de mon arrivée, et leur avait dit : « Le Maghrébin demandera cette robe ; un souverain idolâtre la lui prendra et la donnera à notre frère Borhân eddîn Assâghardjy, à qui elle appartient, et pour qui elle a été faite. » Lorsque les fakirs m’eurent rapporté cela, je leur dis : « J’ai obtenu la bénédiction du cheikh, puisqu’il m’a revêtu de son habillement ; je n’entrerai avec cette robe chez aucun sultan idolâtre, ni musulman. » Je quittai le cheikh, et il m’advint longtemps après de pénétrer dans la Chine et d’arriver dans la ville de Khansâ (Hang-tchéou-fou). Mes compagnons se séparèrent de moi, à cause de la foule qui nous pressait. Or j’avais sur moi la robe en question. Tandis que je me trouvais dans une certaine rue, le vizir vint à passer avec un grand cortège, et sa vue tomba sur moi. Il me fit appeler, me prit la main, me questionna touchant mon arrivée, et ne me quitta pas jusqu’à ce que nous fussions parvenus à la demeure du souverain. Je voulus alors me séparer de lui ; mais il m’en empêcha, et m’introduisit près du prince, qui m’interrogea au sujet des sultans musulmans. Pendant que je lui répondais, il regarda ma robe et la trouva belle. Le vizir me dit : « Tire-là », et il ne me fut pas possible de résister à cet ordre. Le souverain prit la robe, ordonna de me donner dix vêtements d’honneur, un cheval tout harnaché et une somme d’argent. Mon esprit fut mécontent à cause de cela ; ensuite je me rappelai le mot du cheikh, à savoir qu’un souverain idolâtre s’emparerait de cette robe, et je fus fort étonné de l’événement.
L’année suivante, j’entrai dans le palais du roi de la Chine, à Khân Bâlik (Pékin) et me dirigeai vers l’ermitage du cheikh Borhân eddîn Assâghardji. Je le trouvai occupé à lire, et ayant sur lui la même robe. Je fus surpris de cela, et retournai l’étoffe dans ma main. Il me dit : « Pourquoi la manies-tu ; tu la connais donc ? » Je répondis : « Oui, c’est celle que m’a prise le souverain de Khansâ. — Cette robe, reprit-il, a été faite pour moi, par mon frère Djélal eddîn, qui m’a écrit : « La robe te parviendra par les mains d’un tel. » Puis il me présenta la lettre, je la lus et fus émerveillé de la prescience infaillible du cheikh. Je fis savoir à Borhân eddîn le commencement de l’aventure, et il me dit : « Mon frère Djélal eddîn est au-dessus de tous ces prodiges ; il disposait de richesses surnaturelles ; mais il a émigré vers la miséricorde de Dieu (c’est-à-dire : il est mort). On m’a raconté, ajouta-t-il, qu’il faisait chaque jour la prière du matin à La Mecque, et accomplissait le pèlerinage chaque année ; car il disparaissait les deux jours d’Arafah et de la fête des Victimes (le 9 ou le 10 de dhou’lhiddjeh), et l’on ne savait où il était allé. »
Quand j’eus fait mes adieux au cheikh Djélal eddîn, je me mis en route vers la ville de Habank, qui est au nombre des places les plus grandes et les plus belles. Elle est traversée par un fleuve qui descend des montagnes de Câmaroû, et que l’on appelle Annahr Alazrak, « le fleuve Bleu », et par lequel on se rend au Bengale et dans le pays de Lacnaouty. Il y a près de ce fleuve des roues hydrauliques, des jardins et des bourgs, tant à droite qu’à gauche, comme on en voit près du Nil, en Égypte. Les habitants de ces bourgades sont des idolâtres soumis aux musulmans ; on perçoit d’eux la moitié de leurs récoltes, et, en outre, des contributions. Nous voyageâmes sur cette rivière pendant quinze jours, entre des bourgs et des jardins, comme si nous eussions traversé un marché. On y trouve des navires en quantité innombrable, et à bord de chacun desquels il y a un tambour. Quand deux navires se rencontrent, l’équipage de chacun bat du tambour et les mariniers se saluent. Le sultan Fakhr eddîn, dont il a été question, a ordonné qu’on n’exigeât sur ce fleuve aucun nous des fakirs, et qu’on fournît des provisions de route à ceux d’entre eux qui n’en auraient pas. Quand un fakîr arrive dans une ville, il est gratifié d’un demi-dînâr.
Au bout de quinze jours de navigation sur ce fleuve, comme nous venons de le dire, nous parvînmes à la ville de Sonorcâwân, dont les habitants se saisirent du fakîr Cheïdâ, quand il s’y fut réfugié. A notre arrivé en cette place, nous y trouvâmes une jonque qui voulait se rendre dans la contrée de Java, qui en est éloignée de quarante jours. Nous nous embarquâmes sur cette jonque et parvînmes, au bout de quinze jours, au pays de Barahnagâr, dont les habitants ont des bouches semblables à la gueule d’un chien. Ces gens-là sont des brutes (litt. des sots), ne professant ni la religion des Hindous ni aucune autre. Leurs demeures sont des maisons de roseaux, recouvertes d’une toiture d’herbes sèches, et situées sur le bord de la mer. Ils ont beaucoup de bananiers, d’aréquiers et de bétels (piper betel L.).
Les hommes de ce pays nous ressemblent au physique, si ce n’est que leurs bouches sont pareilles à des gueules de chien. Mais il n’en est pas de même de leurs femmes, qui sont d’une exquise beauté. Les hommes sont nus et ne revêtent pas d’habit ; seulement, quelques-uns placent leur membre viril et leurs testicules dans un étui de roseau peint et suspendu à leur ventre. Les femmes se couvrent de feuilles d’arbres. Ces gens-là ont parmi eux un certain nombre de musulmans, originaires du Bengale et de Java, qui habitent un quartier séparé. Ceux-ci nous informèrent que les indigènes s’accouplent comme les brutes, et ne se cachent pas pour cela ; que chaque homme a trente femmes, plus ou moins ; mais que ces individus ne commettent pas d’adultère. Si l’un d’eux se rend coupable de ce crime, son châtiment consiste à être mis en croix jusqu’à ce que mort s’ensuive, à moins que son camarade ou son esclave ne se présente et ne soit crucifié en sa place, auquel cas il est renvoyé libre. La peine encourue par la femme, sa complice, est celle-ci : le sultan ordonne à tous ses serviteurs d’avoir commerce avec elle, l’un après l’autre, en sa présence, jusqu’à ce qu’elle meure, puis on la jette dans la mer. C’est pour ce motif que les indigènes ne permettent à aucun passager de loger chez eux, à moins qu’ils ne soient au nombre des gens domiciliés parmi eux. Ils ne trafiquent avec les étrangers que sur le rivage, et leur portent de l’eau à l’aide des éléphants, vu qu’elle est éloignée de la côte, et ils ne la leur laissent pas puiser, tant ils craignent pour leurs femmes, parce qu’elles recherchent les beaux hommes. Les éléphants sont nombreux chez eux, mais personne, si ce n’est leur sultan, ne peut en disposer ; on les lui achète pour des étoffes. Ces gens ont une langue extraordinaire, que comprennent ceux-là seulement qui ont habité avec eux et qui les ont fréquemment visités. Lorsque nous arrivâmes sur le rivage, ils vinrent à nous dans de petites barques, dont chacune était creusée dans un tronc d’arbre, et ils nous apportèrent des bananes, du riz, du bétel, des noix d’arec et du poisson.
Le sultan de ce peuple vint nous trouver, monté sur un éléphant qui portait une espèce de housse faite avec des peaux. Le vêtement du prince se composait de peaux de chèvre, dont le poil était tourné en dehors. Sur sa tête, il y avait trois fichus de soie de diverses couleurs, et il tenait à la main une javeline de roseau. Il était accompagné d’environ vingt de ses proches, montés sur des éléphants. Nous lui envoyâmes un présent composé de poivre, de gingembre, de cannelle, de ce poisson que l’on trouve dans les îles Maldives, et, enfin, d’étoffes du Bengale. Ces gens-là ne s’en revêtent point ; mais ils en couvrent les éléphants dans leurs jours de fête. Le sultan a droit de prélever, sur chaque vaisseau qui relâche dans ses États, un esclave de chaque sexe, des étoffes destinées à recouvrir un éléphant, des bijoux d’or, que la reine place à sa ceinture et à ses doigts de pied. Si quelqu’un ne paye pas ce tribut, on prépare contre lui un enchantement par lequel la mer est agitée, et il périt ou peu s’en faut.
Pendant une des nuits que nous passâmes dans le port de ce peuple, il advint qu’un esclave du patron du navire, du nombre de ceux qui avaient eu de fréquents rapports avec les indigènes, descendit à terre et convint d’un rendez-vous avec la femme d’un de leurs chefs, dans un endroit semblable à une caverne, et situé sur le rivage. Le mari de cette femme eut connaissance du fait, vint à la grotte avec plusieurs de ses compagnons, et y trouva les deux amants. On les conduisit au sultan du pays, qui ordonna de couper les testicules de l’esclave et de le mettre en croix. Quant à la femme, il la livra à la lubricité des assistants, jusqu’à ce qu’elle mourût. Après quoi, il se rendit sur la côte, s’excusa de ce qui s’était passé, et dit : « Nous ne trouvons pas de moyen pour nous dispenser d’accomplir nos lois. » Il donna au patron du vaisseau un esclave, en échange de celui qui avait été crucifié.
Nous quittâmes ce peuple, et après un trajet de vingt-cinq jours, nous arrivâmes à l’île de Djâouah (Sumatra), qui donne son nom à l’encens djâouy, ou au benjoin. A la distance d’une demi-journée de chemin, nous l’aperçûmes déjà ; elle est verdoyante, belle, et la plus grande partie de ses arbres ce sont des cocotiers, des arecs, des girofliers, des aloès indiens, le cheky, le berky (jacquier), le manguier, le djambou, l’oranger aux doux fruits et le roseau du camphre. La vente et l’achat, chez cette population, se font au moyen de morceaux d’étain et de l’or chinois natif, et non fondu. La plupart des espèces odorantes ou des parfums qui se trouvent dans cette île sont dans la partie occupée par les infidèles. Chez les musulmans, on en rencontre bien moins.
Quand nous fûmes arrivés en rade, les habitants de l’île, montés sur de petites embarcations, vinrent nous trouver. Ils portaient des noix de coco, des bananes, des mangues et des poissons. C’est leur habitude d’en faire cadeau aux marchands, et chacun de ceux-ci les récompense suivant ses moyens. Le vice-amiral se rendit aussi à bord de notre navire ; il examina les marchands qui étaient avec nous, et nous permit de prendre terre. Nous descendîmes donc vers le bender, ou port, qui est un gros bourg sur le rivage de la mer, et où se trouvent des maisons ; on l’appelle Sarha, et il est à quatre milles de la ville (de Sumatra). Bohroûz, le vice-amiral, écrivit au sultan, et l’informa de mon arrivée. Alors celui-ci donna l’ordre à l’émir Daouléçah de s’avancer à ma rencontre, accompagné du noble kadi, Emir sayyid de Chiraz, de Tadj eddîn, d’Ispahan, et d’autres jurisconsultes. Ils sortirent en effet, et amenèrent pour moi un cheval d’entre les propres montures du sultan, ainsi que d’autres chevaux. Je montai à cheval, et mes compagnons en firent autant. Nous fîmes ainsi notre entrée dans la capitale, c’est-à-dire dans la ville de Somothrah ou Sumatra. Elle est belle et grande, pourvue d’une enceinte de bois, et de tours également en bois.
Du sultan de Djâouah (SUMATRA)
C’est le sultan Almalic Azzhâhir, un des rois les plus illustres et les plus généreux. Il professe la doctrine de Châfi’y, il affectionne les légistes, qui se rendent à ses audiences pour lire le Coran et tenir une conférence. Il fait souvent la guerre, surtout aux infidèles ; il est très humble, et se rend à pied à la prière du vendredi. Ses sujets suivent aussi le rite de Châfi’y ; ils aiment à combattre les païens, et marchent de bon gré avec leur souverain. Ils ont remporté la victoire sur les infidèles qui les avoisinent, et ceux-ci leur payent le tribut, ou la capitation, pour avoir la paix.
De notre entrée dans le palais du sultan et de ses bienfaits envers nous
Lorsque nous nous dirigeâmes vers le palais du sultan, nous vîmes, dans son voisinage, des lances fichées en terre des deux côtés du chemin ; et c’est là le signe que l’on doit descendre de cheval. Personne ne devant aller plus loin sur sa monture, nous mîmes donc pied à terre en cet endroit. Nous entrâmes dans la salle d’audience, où nous vîmes le lieutenant du souverain, et il est appelé ’Omdat Almolc, ou l’appui du royaume. Il se leva à notre approche, et il nous salua ; or le salut, chez ce peuple, consiste à toucher la main. Nous nous assîmes avec lui ; il écrivit un billet au sultan pour l’informer de notre présence, le cacheta et le remit à un jeune garçon, ou page. La réponse lui parvint, tracée sur le dos du billet. Après cela un jeune garçon arriva, portant une bokchah, c’est-à-dire une enveloppe ou un paquet de hardes, que le lieutenant prit avec sa main. Puis il me saisit par la main, et me fit entrer dans un petit logement ou maisonnette, que ces gens nomment ferdkhâneh, mot qui ressemble, dans la forme, à zerkhâneh, si ce n’est que la première lettre est un fâ (f) et non un zâ (z). Ce ferdkhâneh, ou demeure isolée, était la place où le lieutenant se reposait pendant le jour ; car il est d’usage que le lieutenant du sultan se rende dans la salle d’audience après l’aurore, et qu’il ne la quitte pas, si ce n’est à la nuit close. Il en est de même des ministres et des principaux commandants.
Le lieutenant du souverain tira du paquet : trois pagnes, dont l’un était de pure soie, l’autre soie et coton, le troisième soie et lin ; trois vêtements, appelés dans le pays habits de dessous, du genre des pagnes ; trois vêtements de différentes sortes, nommés habits du milieu ; trois vêtements du genre des manteaux, ou casaques de laine, dont l’un était blanc, et trois turbans. Je revêtis un de ces pagnes, en place de culottes, suivant l’habitude de ces peuples, et un vêtement de chaque genre. Mes compagnons prirent pour eux tout le reste. On apporta ensuite des aliments, dont la plupart consistaient en riz ; puis, une sorte de bière, enfin le bétel, ce qui indique que le moment est arrivé de se retirer. Nous prîmes ce masticatoire, nous nous levâmes, et le lieutenant nous imita.
Nous sortîmes de l’endroit des audiences, nous montâmes à cheval, et le lieutenant du sultan vint avec nous. On nous conduisit dans un jardin entouré d’une enceinte de bois ; au milieu il y avait une maison, aussi en bois, et dont le plancher était recouvert de ces tapis de coton velus et à franges découpées appelés mokhmalât ; les uns étaient teints, les autres ne l’étaient pas. On voyait dans cette demeure des lits en bambou recouverts de courtes-pointes piquées de soie, de couvertures légères et de coussins nommés béouâlicht. Nous nous assîmes dans cette maison avec le lieutenant. L’émir Daouléçah arriva, conduisant en présent deux femmes esclaves et deux serviteurs, ou eunuques. Il me dit : « Le sultan te fait observer que ce présent est dans la proportion de ses moyens, et non de ceux du sultan Mohammed (de Dihly). » Alors le lieutenant sortit, l’émir Daouléçah resta en ma compagnie.
Cet émir et moi nous nous connaissions, car il s’était rendu comme envoyé chez le sultan de Dihly. Or je lui dis : « Quand verrai-je le souverain ? » Il me répondit : « C’est l’usage chez nous que celui qui arrive ne salue le sultan qu’après trois jours, afin que la fatigue de son voyage soit cessée et que son esprit soit revenu à l’état naturel. » Nous restâmes ainsi trois jours, recevant la nourriture trois fois dans la journée ; les fruits et les pâtisseries soir et matin. Au quatrième jour, qui était un vendredi, l’émir Daouléçah vint me trouver et me dit : « Tu pourras saluer le sultan aujourd’hui après la prière, dans la tribune grillée de la mosquée cathédrale. » Je me rendis à la mosquée et j’y fis la prière avec le chambellan du souverain, nommé Kaïrân. Ensuite j’entrai chez le sultan, et trouvai à sa droite et à sa gauche le juge Emir sayyid et les hommes de science. Le prince me toucha la main, et je le saluai ; il me fit asseoir à son côté gauche, m’adressa des questions sur le sultan Mohammed, sur mes voyages, et je lui répondis. Alors il reprit la conférence qu’il avait nouée sur la jurisprudence, d’après le rite de Châfi’y, et la continua jusqu’au moment de la prière de l’après-midi. Celle-ci étant accomplie, il entra dans un appartement ou vestiaire, et ôta les habits qu’il portait. C’étaient des robes de légiste, avec lesquelles il se rend à pied à la mosquée, le jour du vendredi. Il endossa les vêtements royaux, c’est-à-dire des tuniques de soie et de coton.
Du retour du sultan à son palais, et de l’ordre qu’on y observe dans la cérémonie du salut
Lorsqu’il fut sorti de la mosquée, il trouva à la porte les éléphants et les chevaux. C’est l’habitude chez ces peuples, quand le souverain monte sur un éléphant, que sa suite prenne des chevaux, et quand il enfourche un cheval, qu’elle monte sur des éléphants. Les savants se tiennent à la droite du sultan. Ce jour-là, il prit pour monture un éléphant, et nous montâmes des chevaux. Nous nous dirigeâmes avec lui vers le lieu des audiences, et mîmes pied à terre dans l’endroit accoutumé ; le sultan entra à cheval. Il y avait déjà dans la salle d’audience les ministres, les commandants, les secrétaires, les grands de l’État, et les chefs de l’armée, rangés sur plusieurs files. Les ministres, qui sont au nombre de quatre, et les secrétaires, tenaient le premier rang ; ils saluèrent le sultan, et se retirèrent à la place qui leur était assignée. Vint après cela le rang des commandants, lesquels saluèrent et se rendirent dans le lieu désigné, à l’instar de chaque classe de gens. Puis ce fut le tour des chérifs, ou descendants de Mahomet, et des jurisconsultes ; successivement, des favoris du souverain, des savants et des poètes ; des chefs de l’armée, des jeunes garçons ou pages, et des mamloûcs ou esclaves militaires.
Le sultan se tint sur son éléphant, en face de la coupole des séances. On éleva au-dessus de sa tête un parasol incrusté d’or et de pierreries ; on plaça à sa droite cinquante éléphants parés, et autant à sa gauche ; on rangea aussi à son côté droit cent chevaux, et cent autres à son côté gauche ; tous étaient des chevaux de relais. Devant le souverain se trouvaient ses chambellans les plus intimes. Les musiciens arrivèrent, et ils chantèrent en présence du sultan. On amena des chevaux caparaçonnés de soie, portant des anneaux d’or aux jambes et des licous faits de brocart d’or. Ils dansèrent devant le souverain, et j’en fus émerveillé ; j’avais déjà vu pareille chose devant le roi de l’Inde. Vers le soir, le sultan entra dans son palais, et les assistants se retirèrent dans leurs demeures.
De la révolte d’un fils du frère du sultan, et de la cause de cette rébellion
Le sultan avait un neveu, fils de son frère, qui était marié avec sa fille, et auquel il donna à gouverner une des provinces. Ce jeune homme se prit d’amour pour la fille d’un certain émir, et désira de l’épouser. Or l’usage de ce pays est que, lorsqu’un homme, soit émir, soit marchand, ou autre, a une demoiselle qui a atteint l’âge nubile, il est obligé de prendre les ordres du souverain à ce sujet. Le prince envoie une femme, qui examine la jeune fille ; si la description qu’elle lui fait de celle-ci lui plaît, il l’épouse ; sinon, il permet que les parents de la demoiselle la donnent en mariage à celui qu’ils veulent. Les habitants de ces contrées souhaitent fort que le sultan épouse leurs filles, à cause de la dignité de la noblesse qu’ils obtiennent par ce moyen.
Quand le père de la demoiselle aimée par le fils du frère du sultan consulta le souverain, celui-ci envoya une personne pour voir la jeune fille, et l’épousa. La passion du jeune homme devint violente, et il ne trouva aucun moyen d’obtenir celle qu’il aimait. Plus tard, le sultan partit pour guerroyer contre les infidèles, qui étaient à la distance d’un mois de marche. Le fils de son frère se révolta alors, il entra à Sumatra sans résistance, car cette ville n’avait pas encore d’enceinte ; il s’empara du pouvoir, et reçut le serment de fidélité d’une partie de ses sujets ; les autres le refusèrent. Son oncle, ayant été informé de ces événements, rebroussa chemin, et revint à Sumatra. Le rebelle prit ce qu’il put, en fait de biens et de trésors ; il enleva la femme qu’il aimait, et se dirigea vers la contrée des infidèles, à Moul Djâouah, ou la Djâouah primitive (l’île de Java). Ce fut à la suite de cela que son oncle construisit le mur, ou plutôt l’enceinte de bois, autour de Sumatra.
Je restai avec ce souverain à Sumatra quinze jours après ce temps, je lui demandai la permission de continuer mon voyage, le moment étant arrivé (celui de la mousson sud-ouest). En effet, on ne peut pas se rendre en Chine en toutes saisons. Le souverain nous fit préparer une jonque ; il nous donna des provisions, nous combla de bienfaits, de bontés (que Dieu l’en récompense !), et il envoya avec nous un de ses compagnons pour nous régaler du repas d’hospitalité sur la jonque. Nous voyageâmes tout le long de son pays pendant vingt et une nuits, puis, nous arrivâmes à Moul Djâouah (l’île de Java). C’est la contrée des infidèles, et sa longueur est de deux mois de marche ; elle produit les espèces aromatiques, l’excellent aloès de Kâkoulah et de Kamârah, deux localités qui font partie de son territoire. Dans le pays du sultan Azzhâhir, à Sumatra, il n’y a que l’encens, ou le benjoin, le camphre, quelque peu de girofle, et une petite quantité d’aloès de l’Inde ; mais la plupart de ces choses se retrouvent à Java. Nous allons mentionner ce que nous en avons vu par nous-même, ce que nous avons examiné de nos propres yeux, et ce que nous avons vérifié attentivement.
L’arbre de l’encens est petit, c’est tout au plus s’il atteint la hauteur de la taille d’un homme. Ses rameaux ressemblent à ceux du chardon ou à ceux de l’artichaut ; ses feuilles sont petites, minces ; quelquefois elles tombent, et laissent l’arbre dépouillé. L’encens, ou le benjoin, est une substance résineuse qui se trouve dans les rameaux de l’arbre (styrax benzoin). Il y en a plus dans le pays des musulmans que dans celui des infidèles.
Quant aux arbres qui donnent le camphre, ce sont des roseaux semblables à ceux de nos contrées ; la seule différence est que, dans les premiers, la partie comprise entre deux nœuds, ou le tuyau, est plus longue et plus épaisse. Le camphre se trouve dans l’intérieur de chaque tuyau, et lorsque l’on rompt le roseau on remarque dans la partie interne de tous les tuyaux, entre les nœuds, un tuyau pareil de camphre. Le secret étonnant en cela, c’est que le camphre ne se forme dans ces roseaux qu’après que l’on a immolé à leur pied quelque animal ; si on ne le fait pas, il n’y a pas de camphre. Le meilleur, appelé dans le pays alhardâlah, celui qui a atteint le plus haut degré de froid, et qui tue un homme à la dose d’une drachme, en congelant la respiration, est le camphre près du roseau duquel on a sacrifié un être humain. On peut remplacer la créature humaine par de jeunes éléphants.
L’aloès de l’Inde est un arbre qui ressemble au chêne, si ce n’est que son écorce est mince ; ses feuilles sont exactement comme celles du chêne, et il ne produit point de fruits. Son tronc n’atteint pas un grand développement, ses racines sont longues, étendues au loin, et c’est dans celles-ci que se trouve l’odeur ou le principe aromatique. Les rameaux et les feuilles de l’arbre n’ont pas d’arôme. Dans le pays des musulmans, tous les arbres d’aloès sont considérés comme une propriété ; mais dans le pays des infidèles la plupart sont abandonnés. Ceux qui sont regardés chez eux comme une propriété particulière, ce sont les aloès qui croissent à Kâkoulah, et qui donnent la meilleure qualité de bois d’aloès. Il en est ainsi pour ceux de Kamârah, dont l’aloès est également d’une qualité supérieure ; on le vend aux habitants de Sumatra pour des étoffes. Il y a aussi une espèce d’aloès kamâry qui reçoit des empreintes, à la manière de la cire. Quant à la variété nommée ’athâs, on en coupe la racine, et on la cache sous terre plusieurs mois ; elle conserve toutes ses qualités, et c’est une des meilleures sortes d’aloès.
Les girofliers sont des arbres séculaires très gros ; il y en a en plus grand nombre dans la contrée des infidèles que dans celle des musulmans ; ils ne sont pas regardés comme une propriété particulière à cause de leur grande quantité. Ce que l’on en importe dans nos pays, ce sont les bois (ou les écorces, sorte de cannelle giroflée) ; ce que les habitants de nos contrées appellent la fleur du girofle, ce sont les parties de fleurs qui tombent, et qui ressemblent à celles de l’oranger. Le fruit du giroflier est la noix de muscade, connue chez nous sous le nom de noix de parfum. La fleur (ou plutôt l’enveloppe) qui s’y forme, c’est le macis. Voilà ce que j’ai vu de mes propres yeux. (Il paraît pourtant que, dans ces dernières lignes, l’auteur a confondu le giroflier avec le muscadier, et la noix du giroflier, ou ravendsara, avec la noix muscade).
Nous arrivâmes au port de Kâkoulah et y trouvâmes un certain nombre de jonques préparées pour la piraterie, et aussi pour résister à ceux qui se révolteraient contre les habitants, dans les jonques. En effet, ceux-ci s’arrogent le droit à un certain paiement ou tribut imposé à chaque jonque. Puis nous quittâmes le vaisseau et entrâmes dans la ville de Kâkoulah, qui est belle, et dont le mur, en pierres de taille est assez large pour permettre que trois éléphants y marchent de front. La première chose que je remarquai à l’extérieur de la ville, ce furent des éléphants chargés de bois d’aloès indien ; les habitants le brûlent dans leurs maisons, car il vaut le même prix que le bois de chauffage chez nous, et même moins. Cela n’a lieu, à la vérité, que lorsqu’ils se le vendent entre eux ; mais, quand ils le vendent aux marchands étrangers, ils exigent un vêtement de coton pour une charge de bois d’aloès. Les étoffes de coton sont, chez ces gens, plus chères que celles de soie. Il y a dans Kâkoulah beaucoup d’éléphants ; ils servent à porter les hommes ainsi que les marchandises. Tout le monde attache ses éléphants à sa porte ; chaque boutiquier attache près de lui son éléphant, qu’il monte pour se rendre à sa demeure, et tous portent les fardeaux. Il en est ainsi chez les Chinois et chez les habitants de Khitha, ou Chine septentrionale. Ils en usent au sujet des éléphants, exactement de cette manière.
C’est un infidèle, et je l’ai vu en dehors de son château, assis sur le sol, près d’un pavillon, sans aucun tapis sous lui. Il était avec les grands de l’État, et les troupes défilaient devant lui à pied ; personne n’a de chevaux dans ce pays, excepté le sultan. Le peuple monte les éléphants, et combat sur ces animaux. Le souverain, ayant été informé de ma présence, me fit appeler ; je m’avançai et dis : « Que le salut soit sur quiconque suit la vraie religion ! » Tous les assistants ne comprirent que le mot salut ; le sultan me souhaita la bienvenue, et ordonna d’étendre par terre une étoffe pour que je pusse m'asseoir dessus. Alors je dis au drogman : « Comment m'assoirais-je sur l’étoffe, tandis que le sultan est assis sur le sol ? » Il répondit : « Telle est son habitude, il s’assied sur la terre par humilité ; mais tu es un hôte, et tu viens chez un monarque illustre : c’est donc un devoir de t’honorer. » Je m’assis ; le prince m'interrogea sur le sultan (de l’Inde), et il fut concis dans ses questions. Il me dit : « Tu resteras près de nous en qualité d’hôte pendant trois jours, puis tu partiras. »
D’un fait étonnant dont j’ai été témoin dans l’audience de ce prince
J’ai vu, pendant l’audience de ce sultan, un homme qui tenait dans sa main un couteau semblable à celui d’un grappilleur. Il le plaça sur son propre cou, et se mit à parler longtemps dans une langue que je ne compris point. Après cela, il saisit le couteau avec ses deux mains à la fois, et se coupa la gorge. Sa tête tomba par terre, à cause du tranchant acéré de l’arme et de la force avec laquelle il la tenait. Je restai tout stupéfait de son action ; mais le sultan me dit : « Est-ce que chez vous quelqu’un agit de la sorte ? » Je lui répondis : « Jamais je n’ai vu pareille chose. » Il sourit et reprit : « Ces gens-ci sont nos esclaves, et ils se tuent par amour pour nous. » Puis il donna des ordres afin que l’on emportât l’individu qui s’était suicidé, et qu’on le brûlât. Les lieutenants du sultan, les grands de l’État, les troupes et les sujets assistèrent à la crémation, ou au brûlement. Le souverain assigna une riche pension aux enfants du mort, à sa femme, à ses frères ; et ils furent très honorés de son action.
Une personne, présente à la séance où le fait que j’ai raconté s’est passé, m’a dit que le discours prononcé par l’individu qui s’est sacrifié exprimait son attachement pour le souverain. Il disait donc qu’il voulait s’immoler par affection pour le sultan, comme son père l’avait fait par affection pour le père du prince, et de même que son aïeul l’avait pratiqué par amour pour le grand-père du même prince.
Quand j’eus quitté la séance, le sultan m’envoya les vivres de l’hospitalité pour trois jours, au bout desquels nous partîmes, et voyageâmes de nouveau sur mer. Après trente-quatre jours, nous arrivâmes à la mer Lente ou Pacifique, qui offre une teinte rougeâtre. On pense que cette couleur est due à la terre d’un pays qui l’avoisine. Il n’y a point de vent dans cette mer, ni de vagues ni de mouvement d’aucune sorte, malgré sa grande étendue. C’est à cause de cela que chaque jonque chinoise est accompagnée par trois bâtiments, comme nous l’avons déjà dit. Ils servent à la faire avancer en ramant et à la remorquer. En outre, il y a dans la jonque environ vingt rames fort grosses, à la manière des mâts de navire ; trente hommes, plus ou moins, se réunissent autour d’une de ces rames ; ils se tiennent debout sur deux rangs, l’un faisant face à l’autre. La rame est pourvue de deux fortes cordes, ou câbles, qui ressemblent à des massues ; une des deux files d’hommes tire sur un câble, puis le lâche, et alors l’autre file sur le second câble. Ces rameurs, en travaillant, chantent avec de belles voix, et ils disent ordinairement la’la, la’la.
Nous passâmes sur cette mer trente-sept jours, et les marins furent surpris de la facilité qu’éprouva le trajet. D’ordinaire, ils y emploient de quarante à cinquante jours, et regardent même alors la traversée comme très heureuse. Puis nous arrivâmes au pays de Thaouâlicy (peut-être l’île de Célèbes, ou plutôt le Tonkin) , mot qui est le nom du roi de cette contrée. Elle est très vaste, et son souverain égale celui de la Chine ; il possède de nombreuses jonques, avec lesquelles il fait la guerre aux Chinois, jusqu’à ce qu’ils lui demandent la paix, en lui accordant quelques avantages. Les habitants de ce pays sont idolâtres ; ils ont de belles figures, et qui ressemblent on ne peut plus à celles des Turcs. Ils ont en général le teint cuivré, et ils sont braves et courageux. Leurs femmes montent des chevaux, lancent fort bien les flèches ou les javelines, et combattent absolument comme les hommes. Nous jetâmes l’ancre dans un de leurs ports, dans la ville de Caïloûcary, une des plus belles et des plus grandes parmi leurs cités. Le fils de leur roi y demeurait auparavant, mais quand nous fûmes entrés dans le port, des soldats vinrent à nous, et le capitaine, ou patron du navire, débarqua pour leur parler. Il portait avec lui un présent pour le fils du roi, et leur demanda des nouvelles de ce prince. Alors ils l’informèrent que son père lui avait donné à gouverner une autre province, et qu’il avait préposé sur cette ville-ci sa fille, appelée Ordoudjâ.
Le second jour après notre arrivée au port de Caïloûcary, cette princesse invita le nâkhodhah, ou patron du navire, le carâny ou secrétaire, les marchands, les chefs, le tendîl ou général des piétons, et le sipâhsâlâr ou général des archers. C’était à l’occasion du repas d’hospitalité qu’Ordoudjâ leur offrait, suivant son habitude. Le patron du navire me pria d’y aller aussi en leur compagnie ; mais je refusai, puisque ces peuples sont des infidèles, et qu’il n’est pas permis de manger de leurs aliments. Quand les invités furent arrivés chez la princesse, elle leur dit : « Y a-t-il quelqu’un des vôtres qui ne se soit pas rendu ici ? » Le patron du navire lui répondit : « Il n’y a d’absent qu’un seul homme, le bakhchy, ou le juge, lequel ne mange pas de vos mets. » Ordoudjâ reprit : « Faites-le venir dans ce lieu, » Ses gardes vinrent me trouver, et avec eux les compagnons du nâkhodhah, qui me dirent : « Obéis à la princesse. »
Je me rendis près de celle-ci, et la trouvai assise sur son grand siège, ou trône d’apparat ; devant elle, des femmes tenaient à la main des registres qu’elles lui présentaient. Autour d’elle il y avait des femmes âgées, ou duègnes, qui sont ses conseillères ; elles étaient assises au-dessous du trône, sur des fauteuils de bois de sandal. Devant la princesse étaient aussi placés les hommes. Le trône était tendu de soie, surmonté de rideaux de soie, et fait en bois de sandal incrusté de lames d’or. Dans la salle de l’audience, on voyait des estrades de bois sculpté, sur lesquelles étaient beaucoup de vases d’or, grands et petits, tels qu’amphores, cruches et bocaux. Le patron du navire m’a dit qu’ils étaient remplis d’une boisson préparée avec du sucre mêlé d’aromates ; que ces gens-là prennent après le repas ; que son odeur est aromatique, sa saveur douce ; qu’elle porte à la gaieté, rend l’haleine agréable, active la digestion et excite au plaisir de l’amour.
Lorsque j’eus salué la princesse, elle me dit en langue turque : Khochmîcen iakhchîmîcen, ce qui signifie : « Es-tu bien ? Comment te portes-tu ? » Elle me fit asseoir près d’elle. Cette princesse savait bien écrire l’arabe, et elle dit à un de ses domestiques : Daouâh oué betec guétoûr, paroles dont le sens est : « Apporte l’encrier et le papier. » Il les apporta, et la princesse écrivit : « Au nom de Dieu clément et miséricordieux » ; puis elle me dit : « Qu’est-ce ceci ? » Je lui répondis : Tangry nâm, c’est-à-dire : « C’est le nom de Dieu. Elle reprit : Khoch, ou, en d’autres termes : « C’est bon. » Après cela, elle me demanda de quel pays j’arrivais, et je lui dis que je venais de l’Inde. La princesse dit alors : « Du pays du poivre ? » (le Malabar), et je répondis par l’affirmative. Elle m’interrogea beaucoup sur ce pays, sur ses vicissitudes, et je satisfis à ses demandes. La princesse ajouta : « Il faut absolument que je fasse la guerre à cette contrée, et que je m’en empare pour moi ; car l’abondance de ses richesses et de ses troupes me plaît. » Je lui dis : « Faites cela. » Cette princesse me fit donner des vêtements ; la charge de deux éléphants en riz ; deux buffles femelles ; dix brebis ; quatre livres de julep ou sirop ; quatre marthabân, ou grands vases de porcelaine, remplis de gingembre, de poivre, citron et mangue ; le tout étant salé, et de ces choses qu’on prépare pour servir aux voyages sur mer.
Le patron du navire m’a raconté qu’Ordoudjâ compte dans son armée des femmes libres, des filles esclaves et des captives, qui combattent comme les hommes ; qu’elle sort avec les troupes, composées d’hommes et de femmes, qu’elle fait des invasions dans les terres de ses ennemis, qu’elle assiste aux combats, et qu’elle lutte contre les braves. Il m’a dit aussi qu’une fois une bataille opiniâtre eut lieu entre cette princesse et l’un de ses ennemis ; qu’un grand nombre des soldats d’Ordoudjâ furent tués, et que toutes ses troupes étaient sur le point de prendre la fuite ; qu’alors la princesse se lança en avant, qu’elle traversa les rangs des guerriers, jusqu’à ce qu’elle fût arrivée au roi qu’elle combattait ; qu’elle le perça d’un coup mortel, qu’il en mourut, et que ses troupes s’enfuirent ; qu’Ordoudjâ revint avec la tête de son ennemi sur une lance, et que les parents de celui-ci dégagèrent ou rachetèrent d’Ordoudjâ cette tête, au moyen de riches trésors ; enfin que, lorsque la princesse retourna vers son père, il lui donna cette ville de Caïloûcary, que son frère gouvernait avant elle. Je tiens encore du même patron de navire que les fils des rois demandent à se marier avec Ordoudjâ, et qu’elle répond : « Je n’épouserai que celui qui combattra contre moi et me vaincra » ; mais qu’ils évitent de lutter contre elle, par crainte du tort que cela leur ferait si elle l’emportait sur eux.
Nous quittâmes le pays de Thaouâljcy, et après dix-sept jours de trajet, pendant lesquels le vent fut toujours favorable, et notre marche accélérée et heureuse, nous arrivâmes en Chine. C’est une vaste contrée, abondante en toutes sortes de biens, en fruits, céréales, or et argent ; aucun autre pays du monde ne peut rivaliser avec la Chine sous ce rapport. Elle est traversée par le fleuve nommé Abi-haïâh, mots qui signifient l’Eau de la vie. On l’appelle aussi le fleuve Sarou (fleuve Jaune), du même nom que celui qui se trouve dans l’Inde. Sa source est sur des montagnes situées auprès de la ville de Khân-bâlik (Cambalu, Pékin) et connues sous le nom de Coûhi-boûznah, ce qui veut dire la montagne des Singes. Ce fleuve parcourt, au milieu de la Chine, l’espace de six mois de marche, jusqu’à ce qu’il arrive à Sîn-assîn (ou Sin-calân, Canton). Il est entouré par des villages, par des champs cultivés, des vergers, des marchés, à la manière du Nil de l’Égypte ; mais ici le pays est plus florissant, et sur le fleuve il y a un grand nombre de roues hydrauliques. On trouve en Chine beaucoup de sucre égal à celui de l’Égypte, et même meilleur ; on trouve aussi les raisins et les prunes. Je pensais d’abord que la prune nommée ’othmâny, et qui se trouve à Damas, n’avait pas sa pareille ; mais je vis que j’étais dans l’erreur, lorsque je connus la prune de la Chine. Dans ce pays, il y a l’excellente pastèque, qui ressemble à celle de Khârezm et d’Ispahân. En somme, tous les fruits que nous possédons dans nos pays ont leurs pareils en Chine, ou plutôt leurs supérieurs. Dans ce dernier pays, le froment est en très grande abondance, et je n’en ai jamais vu de plus beau, ou de meilleur. On peut dire la même chose des lentilles et des pois chiches.
De la poterie chinoise ou porcelaine
On ne fabrique pas en Chine de porcelaine, si ce n’est dans les villes de Zeïtoûn et de Sîn-calân. Elle est faite au moyen d’une terre tirée des montagnes qui se trouvent dans ces districts, laquelle terre prend feu comme du charbon, ainsi que nous le dirons plus tard. Les potiers y ajoutent une certaine pierre qui se trouve dans le pays ; ils la font brûler pendant trois jours, puis versent l’eau par-dessus, et le tout devient comme une poussière ou une terre qu’ils font fermenter. Celle dont la fermentation a duré un mois entier, mais pas plus, donne la meilleure porcelaine ; celle qui n’a fermenté que pendant dix jours en donne une de qualité inférieure à la précédente. La porcelaine en Chine vaut le même prix que la poterie chez nous, ou encore moins. On l’exporte dans l’Inde et les autres contrées, jusqu’à ce qu’elle arrive dans la nôtre, le Maghreb. C’est l’espèce la plus belle de toutes les poteries.
Les poules et les coqs de la Chine sont très gros, plus volumineux même que l’oie de nos pays. Les œufs de la poule, chez les Chinois, sont aussi plus forts que ceux de l’oie parmi nous. Or l’oie chez eux est très-petite. Nous achetâmes un jour une poule que nous voulions faire cuire ; mais elle ne tint pas dans une seule marmite, et nous fûmes obligés d’en employer deux. En Chine, le coq est aussi grand que l’autruche ; quelquefois ses plumes tombent, et il reste pour lors comme une vraie masse rougeâtre. La première fois de ma vie que j’ai vu un coq chinois, ce fut dans la ville de Caoulem (côte du Malabar). Je l’avais pris pour une autruche, et j’en fus étonné ; mais son maître me dit : « Certes en Chine, il y a des coqs encore plus gros que celui-ci. » Quand j’y fus arrivé, j’eus la preuve de ce qu’il m’avait avancé à ce sujet,
Quelques détails sur les Chinois
Les Chinois sont des infidèles, des adorateurs d’idoles, et ils brûlent leurs morts à la manière des Indiens. Leur roi est un Tartare de la postérité de Tenkîz khân, ou Gengis kan. Dans chacune de leurs villes, il y a un quartier affecté aux musulmans, où ils habitent seuls, où ils ont leurs mosquées pour y faire les prières, tenir les réunions du vendredi, et autres ; ils sont honorés et respectés. Les païens de la Chine mangent les viandes des porcs et des chiens, qu’ils vendent publiquement sur leurs marchés. Ce sont, en général, des gens aisés, opulents ; mais ils ne soignent pas assez leur nourriture ni leur habillement. On peut voir tel de leurs grands négociants, si riche que l’on ne saurait compter ses trésors, marcher vêtu d’une grossière tunique de coton. Les Chinois mettent toute leur sollicitude à posséder des vases d’or et d’argent. Ils portent tous un bâton ferré, sur lequel ils s’appuient en marchant, et qu’ils appellent la troisième jambe.
La soie est très abondante en Chine, car les vers qui la donnent s’attachent aux fruits, s’en nourrissent et ne demandent pas beaucoup de soins. C’est pour cela que la soie est en si grande quantité, et qu’elle sert à habiller les religieux pauvres et les mendiants du pays ; sans les marchands, la soie ne vaudrait absolument rien. Un seul vêtement de coton, chez les Chinois, en vaut plusieurs en soie. L’habitude de ce peuple est que tout négociant fonde en lingots l’or et l’argent qu’il possède, chacun de ces lingots pesant un quintal, plus ou moins, et qu’il les place au-dessus de la porte de sa maison. Celui qui a cinq lingots met à son doigt une bague ; celui qui en a dix y met deux bagues ; celui qui en a quinze est nommé séty, ce qui revient au même que cârémy en Égypte (sorte de riche marchand, surtout en épices). Un lingot est nommé en Chine barcâlah.
Des drachmes de papier qui servent, chez les Chinois, pour vendre et pour acheter
Les habitants de la Chine n’emploient dans leurs transactions commerciales ni pièces d’or ni pièces d’argent. Toutes celles qui arrivent dans ce pays sont fondues en lingots, comme nous venons de le dire. Ils vendent et ils achètent au moyen de morceaux de papier, dont chacun est aussi large que la paume de la main, et porte la marque ou le sceau du sultan. Vingt-cinq de ces billets sont appelés bâlicht (bâlich) ce qui revient au sens du mot dinar, ou de pièce d’or chez nous. Lorsque quelqu’un se trouve avoir entre les mains de ces billets usés ou déchirés, il les rapporte à un palais dans le genre de l’Hôtel de la monnaie de notre pays, où il en reçoit de nouveaux en leur place, et livre les vieux. Il n’a de frais d’aucune sorte à faire pour cela, car les gens qui sont chargés de confectionner ces billets sont payés par le sultan. La direction dudit palais est confiée à un des principaux émirs de la Chine. Si un individu se rend au marché avec une pièce d’argent, ou bien avec une pièce d’or, dans le dessein d’acheter quelque chose, on ne la lui prend pas, et l’on ne fait aucune attention à lui, jusqu’à ce qu’il l’ait changée contre le bâlicht ou les billets, avec lesquels il pourra acheter ce qu’il désirera.
De la terre que les Chinois brûlent au lieu de charbon
Tous les habitants de la Chine et du Khitha (Cathay ou Chine septentrionale) emploient comme charbon une terre ayant la consistance ainsi que la couleur de l’argile de notre pays. On la transporte au moyen des éléphants, on la coupe en morceaux de la grosseur ordinaire de ceux du charbon chez nous, et l’on y met le feu. Cette terre brûle à la manière du charbon, et donne même une plus forte chaleur. Quand elle est réduite en cendres, on les pétrit, en y versant de l’eau, on les fait sécher, et l’on s’en sert encore une seconde fois pour cuisiner. On continue d’agir de la sorte jusqu’à ce qu’elles soient entièrement consumées. C’est avec cette terre que les Chinois fabriquent les vases de porcelaine, en y ajoutant une autre pierre, comme nous l’avons déjà raconté.
Du talent pour les arts, particulier aux Chinois
Le peuple de la Chine est de tous les peuples celui qui a le plus d’habileté et de goût pour les arts. C’est là un fait généralement connu, que beaucoup d’auteurs ont noté dans leurs ouvrages, et sur lequel ils ont fort insisté. Pour ce qui regarde la peinture, aucune nation, soit chrétienne ou autre, ne peut rivaliser avec les Chinois : ils ont pour cet art un talent extraordinaire. Parmi les choses étonnantes que j’ai vues chez eux à ce sujet, je dirai que toutes les fois que je suis entré dans une de leurs villes, et que depuis il m’est arrivé d’y retourner, j’y ai toujours trouvé mon portrait et ceux de mes compagnons peints sur les murs et sur des papiers placés dans les marchés. Une fois, je fis mon entrée dans la ville du sultan (Pékin), je traversai le marché des peintres, et arrivai au palais du souverain avec mes compagnons ; nous étions tous habillés suivant la mode de l’Irak. Au soir, quand je quittai le château, je passai par le même marché ; or je vis mon portrait et les portraits de mes compagnons peints sur des papiers qui étaient attachés aux murs. Chacun de nous se mit à examiner la figure de son camarade, et nous trouvâmes que la ressemblance était parfaite.
On m’a assuré que l’empereur avait donné l’ordre aux peintres de faire notre portrait ; ceux-ci se rendirent au château pendant que nous y étions ; qu’ils se mirent à nous considérer et à nous peindre, sans que nous nous en fussions aperçus. C’est, au reste, une habitude établie chez les Chinois de faire le portrait de quiconque passe dans leur pays. La chose va si loin chez eux à ce propos que, s’il arrive qu’un étranger commette quelque action qui le force à fuir de la Chine, ils expédient son portrait dans les différentes provinces, en sorte qu’on fait des recherches, et en quelque lieu que l’on trouve celui qui ressemble à cette image, on le saisit.
Ibn Djozay ajoute : « Ceci est conforme aux récits des historiens touchant l’aventure de Sâboûr Dhoû’l Actâf, ou Sapor aux épaules, roi des Persans, lorsqu’il entra déguisé dans le pays des Romains, et qu’il assista à un festin que donnait leur roi. Le portrait de Sapor se trouvait sur un vase, ce que voyant un des serviteurs de l’empereur de Constantinople, et s’apercevant que c’était tout juste l’image de Sapor, qui était présent, il dit à son souverain : “Ce portrait m’informe que Chosroès est avec nous, dans ce salon.” Or la chose était ainsi ; et il arriva à Sapor ce que racontent les livres d’histoire. (Cf. Mirkhond, Hist. des Sassanides) »
De l’usage des Chinois d’enregistrer tout ce qui se trouve sur les navires
Lorsqu’une jonque chinoise veut entreprendre un voyage, il est d’habitude, chez le peuple de la Chine, que l’amiral et ses secrétaires montent à bord, pour noter le nombre des archers qui sont embarqués, celui des domestiques et des marins. Ce n’est qu’après l’accomplissement de cette formalité qu’on leur permet de partir. Quand la jonque retourne en Chine, lesdits personnages montent de nouveau à bord. Ils comparent les personnes présentes avec les chiffres de leurs registres, et s’il manque quelqu’un de ceux qu’ils ont notés, ils en rendent responsable le patron du navire. Il faut que celui-ci fournisse la preuve que l’individu en question est mort, ou bien qu’il s’est enfui, ou encore qu’il lui est arrivé tel autre accident déterminé ; sinon il est pris et puni.
Ils ordonnent ensuite au patron du bâtiment de leur dicter en détail tout ce que la jonque contient en fait de marchandises, qu’elles soient de peu de valeur ou d’un prix considérable. Alors tout le monde débarque, et les gardiens de la douane siègent pour passer l’inspection de ce que l’on a avec soi. S’ils découvrent quelque chose qu’on leur ait caché, la jonque et tout ce qu’elle contient deviennent propriété du fisc. C’est là un genre d’injustice que je n’ai vu pratiquer dans aucun autre pays, soit d’infidèles, soit de musulmans ; je n’ai vu cela qu’en Chine. Cependant, il y avait jadis dans l’Inde quelque chose d’analogue ; car celui dans les mains duquel on trouvait une marchandise qu’il avait soustraite au paiement de l’impôt était condamné à payer onze fois le montant dudit impôt. Le sultan Mohammed a aboli cette tyrannie lorsqu’il a décrété la suppression des droits fiscaux pesant sur les marchandises.
De l’habitude qu’ont les Chinois d’empêcher que les marchands ne se livrent au désordre et au libertinage
Lorsqu’un marchand musulman arrive dans une des villes de la Chine, on lui laisse le choix de descendre chez un négociant de sa religion, désigné parmi ceux domiciliés dans le pays, ou bien d’aller à l’hôtellerie. S’il préfère la demeure chez le négociant, on compte tout le bien qu’il a, on le confie audit négociant choisi par lui, lequel dépense l’argent de l’étranger pour pourvoir aux besoins de celui-ci, mais d’une manière honnête. Quand il veut partir, on examine son argent, et s’il en manque, le négociant chez lequel il demeure et qui a reçu la somme en dépôt est obligé de combler le déficit.
Dans le cas où le marchand qui arrive aime mieux se rendre à l’hôtellerie, on livre son argent au maître de l’auberge, à titre de dépôt. Ce dernier achète pour le compte de l’étranger ce que celui-ci désire, et s’il veut une concubine, il fait pour lui l’acquisition d’une jeune fille esclave. Il le met alors dans un appartement dont la porte s’ouvre sur l’intérieur de l’hôtellerie, et il fait la dépense pour l’homme et pour la femme. Nous dirons à ce propos que les jeunes filles esclaves sont à très bon marché dans la Chine ; qu’en outre tous les Chinois vendent leurs garçons, de même que leurs filles, et que cela n’est point considéré chez eux comme un déshonneur. Seulement, on ne les force pas à voyager avec ceux qui les achètent, et l’on ne les empêche pas non plus, si toutefois ils le veulent bien. Quand le marchand étranger désire se marier en Chine, il le peut aussi très facilement ; mais, pour ce qui est de dépenser son argent dans le libertinage, cela ne lui est nullement permis. Les Chinois disent : « Nous ne voulons point que l’on entende rapporter dans le pays des musulmans qu’ils perdent leurs richesses dans notre contrée, que c’est une terre de débauche et de beauté fragile ou mondaine. »
Du soin QU’ILS PRENNENT des voyageurs sur les routes
La Chine est la plus sûre ainsi que la meilleure de toutes les régions de la terre pour celui qui voyage. On peut parcourir tout seul l’espace de neuf mois de marche sans avoir rien à craindre, même si l’on est chargé de trésors. C’est que dans chaque station il y a une hôtellerie surveillée par un officier, qui est établi dans la localité avec une troupe de cavaliers et de fantassins.
Tous les soirs, après le coucher du soleil, ou après la nuit close, l’officier entre dans l’auberge, accompagné de son secrétaire ; il écrit le nom de tous les étrangers qui doivent y passer la nuit, en cachette la liste, et puis ferme sur eux la porte de l’hôtellerie. Au matin, il y retourne avec son secrétaire, il appelle tout le monde par son nom, et en écrit une note détaillée. Il expédie avec les voyageurs une personne chargée de les conduire à la station qui vient après, et de lui apporter une lettre de l’officier proposé à cette seconde station, établissant que tous y sont arrivés ; sans cela ladite personne en est responsable. C’est ainsi que l’on en use dans toutes les stations de ce pays, depuis Sîn-Assîn jusqu’à Khân-Bâlik. Dans ces auberges, le voyageur trouve tout ce dont il a besoin en fait de provisions ; il y a surtout des poules et de oies ; quant aux moutons, ils sont rares en Chine.
Pour revenir aux détails de notre voyage, nous dirons qu’après notre trajet sur mer la première ville chinois où nous débarquâmes, ce fut celle de Zeïtoûn, Bien que Zeïtoûn en arabe signifie olives, il n’y a pourtant pas d’oliviers dans cette cité, pas plus que dans aucun autre endroit de la Chine ni de l’Inde ; seulement, c’est là son nom. C’est une ville grande, superbe, où l’on fabrique les étoffes damassées de velours, ainsi que celles de satin, et qui sont appelées de son nom zeïtoûniyyah ; elles sont supérieures aux étoffes de Khansâ et de Khân-bâlik. Le port de Zeïtoûn est un des plus vastes du monde ; je me trompe, c’est le plus vaste de tous les ports. J’y ai vu environ cent jonques de grande dimension ; quant aux petites, elles étaient innombrables. C’est un vaste golfe qui, de la mer, entre dans les terres, jusqu’à ce qu’il se réunisse avec le Grand Fleuve. Dans cette ville, comme dans toute autre de la Chine, chaque habitant a un jardin, un champ, et sa maison au milieu, exactement de même que cela se pratique chez nous, dans la ville de Siglimâçah. C’est pour cette raison que les cités des Chinois sont si grandes.
Les mahométans demeurent dans une ville à part. Le jour de mon entrée, j’y vis l’émir qui était arrivé dans l’Inde comme ambassadeur et porteur d’un cadeau, qui était parti en notre compagnie (pour le Malabar), et dont la jonque avait été submergée. Il me salua, et informa sur mon compte le chef du conseil, qui me fit loger dans une belle habitation. Je reçus la visite du juge des musulmans, Tadj eddîn Alardoouîly, homme vertueux et généreux ; du cheikh de l’islamisme Kamal eddîn Abdallah, d’Ispahan, homme très pieux ; des principaux marchands. Parmi ceux-ci, je nommerai seulement Cheref eddîn de Tibrîz, un des négociants envers lesquels je m’endettai lors de mon arrivée dans l’Inde, et celui dont les procédés furent les meilleurs ; il sait tout le Coran par cœur, et il lit beaucoup. Comme ces commerçants sont établis dans le pays des infidèles, il s’ensuit que, lorsqu’ils voient un musulman qui se rend près d’eux, ils s’en réjouissent considérablement, et se disent : « Celui-ci vient de la terre de l’islamisme. » Ils lui donnent l’aumône légale sur leurs biens, de sorte que ce voyageur devient riche à la manière de l’un d’eux. Au nombre des cheikhs éminents qui se trouvaient à Zeïtoûn, il y avait Borhân eddîn Alcâzéroûny, qui possédait un ermitage au-dehors de la ville. C’est à lui que les marchands payaient les offrandes qu’ils faisaient au cheikh Abou Ishak de Câzéroûn.
Lorsque le chef du conseil, ou le magistrat de cette ville, eut connu ce qui me concernait, il écrivit au kân, qui est le grand roi, ou l’empereur des Chinois, pour lui apprendre que j’étais arrivé de la part du roi de l’Inde. Je priai le chef du conseil d’envoyer avec moi quelqu’un pour me conduire au pays de Sin-assîn, que ces peuples appellent Sîn-calân, afin qu’en attendant la réponse du kân je visitasse cette contrée, qui est sous sa domination. Il m’accorda ma demande, et fit partir avec moi un de ses gens pour m’accompagner. Je voyageai sur le fleuve dans un navire semblable aux vaisseaux de guerre de notre pays, si ce n’est que dans celui-ci les marins rament debout et tous à la fois au milieu du bâtiment ; les passagers se tiennent à la proue et à la poupe. Pour avoir de l’ombre, on tend au-dessus du navire des étoffes fabriquées au moyen d’une plante du pays, laquelle ressemble au lin, mais qui n’en est pas ; elle est plus fine que le chanvre.
Nous voyageâmes sur ce fleuve vingt-sept journées ; tous les jours, un peu avant midi, nous jetions l’ancre dans un village, où nous achetions ce dont nous avions besoin, et faisions notre prière de midi. Le soir, nous descendions dans un autre village ; et ainsi de suite jusqu’à notre arrivé à Sîn-calân (Canton), qui est la ville de Sîn-assîn. On y fabrique la porcelaine, de même qu’à Zeïtoûn, et c’est ici que la rivière nommée Abi-haïâh, ou l’Eau de vie, se décharge dans la mer, et qu’on l’appelle le confluent des deux mers. Sin-assîn est une des plus vastes cités, et une de celles dont les marchés sont les plus jolis. Celui de la porcelaine dans les autres villes de la Chine, dans l’Inde et dans le Yémen.
Au milieu de la ville, on voit un superbe temple, ayant neuf portes ; à l’intérieur de chacune d’elles sont un portique et des estrades, où s’asseyent ceux qui habitent ce monument. Entre la deuxième et la troisième porte, il existe un local dont les chambres sont occupées par les aveugles et les infirmes, ou les gens mutilés. Ils sont nourris et habillés au moyen des legs pieux affectés au temple. Entre les autres portes, il y a aussi des établissements de ce genre ; on y voit un hôpital pour les malades, la cuisine pour préparer les mets, les logements pour les médecins, et ceux des gens de service. On m’a assuré que les vieillards qui n’ont pas la force de gagner leur vie y sont entretenus et habillés ; qu’il en est ainsi des orphelins et des veuves sans ressources. Ce temple a été bâti par un roi de la Chine, qui a légué cette ville, ainsi que les villages et les jardins qui en dépendent, comme fondation pieuse pour cet établissement. Son portrait se voit peint dans ledit temple, et les Chinois vont l’adorer.
Dans un des côtés de cette grande cité se trouve la ville des musulmans, où ils ont la mosquée cathédrale, l’ermitage et le marché ; ils ont aussi un juge et un cheikh. Or, dans chacune des villes de la Chine, il y a toujours un cheikh de l’islamisme, qui décide en dernier ressort tout ce qui concerne les musulmans, et un kadi, qui leur rend la justice. Je descendis chez Aouhad eddîn, ou l’unique dans la religion, de la ville de Sindjâr ; il est au nombre des hommes de mérite les plus considérables et les plus riches. Ma demeure auprès de lui fut de quatorze jours ; les cadeaux du juge et des autres mahométans se succédèrent sans interruption chez moi. Tous les jours, ils préparaient un festin nouveau ; ils s’y rendaient dans de jolies barques, longues de dix coudées, et avec des chanteurs. Au-delà de cette ville de Sin-assîn il n’y en a point d’autres, soit aux infidèles, soit aux musulmans. Entre elle et le rempart, ou grande muraille de Gog et Magog, il y a un espace de soixante jours de marche, selon ce qui m’a été rapporté.
Ce territoire est occupé par des païens nomades, qui mangent les hommes lorsqu’ils peuvent s’en emparer. C’est pour cela que l’on ne se rend point dans leur pays, et que l’on n’y voyage pas. Je n’ai vu dans cette ville personne qui ait été jusqu’à la grande muraille, ou qui ait connu quelqu’un qui l’ait visitée.
Lors de mon séjour à Sîn-calân, j’entendis dire qu’il y avait dans cette ville un cheikh très âgé, ayant dépassé deux cents ans ; qu’il ne mangeait pas, ni ne buvait, qu’il ne s’adonnait pas au libertinage, ni n’avait aucun rapport avec les femmes, quoique ses forces fussent intactes ; qu’il habitait dans une caverne, à l’extérieur de la ville, où il se livrait à la dévotion. Je me rendis à cette grotte, et je le vis à la porte ; il était maigre, très rouge, ou cuivré, portait sur lui les traces des exercices de piété, et n’avait point de barbe, Après que je l’eus salué, il me prit la main, la flaira et dit à l’interprète : « Celui-ci est d’une extrémité du monde comme nous sommes de l’autre bout. » Alors il me dit : « Tu as été témoin d’un miracle ; te souviens-tu du jour de ton arrivée dans l’île où il y avait un temple, et de l’homme assis entre les idoles, lequel t’a donné dix pièces d’or ? » Je répondis : « Oui, bien. » Il reprit : « Cet homme, c’est moi. » Je baisai sa main ; le cheikh réfléchit un certain temps et ne revint plus vers nous. On aurait dit qu’il éprouvait du regret de ce qu’il avait raconté. Nous fûmes téméraires, nous entrâmes dans la grotte pour le surprendre ; mais nous ne le trouvâmes pas. Nous vîmes un de ses compagnons qui tenait quelques béouâlicht de papier (billets de banque, au singulier bâlicht), et qui nous dit : « Voici pour votre repas d’hospitalité ; allez-vous-en. » Nous lui répondîmes : « Nous voulons attendre le personnage. » Il reprit : « Quand même vous resteriez en ce lieu dix ans, vous ne le verriez pas. Or c’est son habitude de ne plus se laisser voir jamais par l’individu qui a connu un de ses secrets. » Il ajouta : « Ne pense pas qu’il soit absent ; au contraire, il est ici présent avec toi. »
Je fus surpris de tout cela, et je partis ; je racontai son histoire au kadi, au cheikh de l’islamisme et à Aouhad eddîn de Sindjâr. Ils dirent : « C’est là sa manière d’agir avec les étrangers qui vont le visiter ; personne ne sait quelle religion il professe, et celui que vous avez cru être un de ses compagnons, c’était le cheikh même. » Ils m’apprirent que ce personnage avait quitté cette contrée-là pendant cinquante années environ, et qu’il y était retourné depuis un an ; que les rois, les commandants et les grands vont le visiter, et qu’il leur fait des cadeaux dignes de leur rang ; que tous les jours les fakirs, ou les religieux pauvres viennent le voir, et reçoivent de lui des dons proportionnés au mérite de chacun d’eux, bien que la grotte dans laquelle il demeure ne renferme absolument rien. Ils me racontèrent encore que ce personnage fait des récits sur les temps passés, qu’il parle du prophète Mahomet et qu’il dit à ce propos : « Si j’eusse été avec lui, je l’aurais secouru. » Il cite avec vénération les deux califes : ’Omar, fils d’Alkhatthâb, et ’Aly, fils d’Abou Thâlib, et il en fait un grand éloge. Au contraire, il maudit Yazîd, fils de Mo’âouiyah, et condamne le même Mo’âouiyah. Les personnes ci-dessus nommées me racontèrent beaucoup d’autres choses touchant ce cheikh.
Aouhad eddîn de Sindjâr m’a rapporté à ce sujet ce qui suit : « J’allai le voir une fois, me dit-il, dans la caverne, et il prit ma main. Aussitôt je m’imaginai être dans un immense château, où le cheikh était assis sur un trône ; il me semblait que sur sa tête il portait une couronne, qu’à ses deux côtés étaient de belles servantes, et que des fruits tombaient sans cesse dans des canaux qui se voyaient dans cet endroit. Je me figurais que je prenais une pomme pour la manger ; et voici que je m’aperçois que je suis dans la grotte, et que je vois le cheikh devant moi, riant et se moquant de ma personne. J’en fis une forte maladie qui me dura plusieurs mois, et je ne retournai plus rendre visite à cet homme extraordinaire. »
Les habitants de ce pays-là croient que ce cheikh est musulman ; mais personne ne l’a jamais vu prier. Pour ce qui est de l’abstinence des aliments, on peut dire qu’il est toujours à jeun. Le kadi m’a raconté ceci : « Un jour, dit-il, je lui parlai de la prière, et il me répondit : “Est-ce que tu sais, toi, ce que je fais ? Certes, ma prière diffère de la tienne”. » Toutes les circonstances qui regardent cet homme sont étranges.
Le lendemain de mon entrevue avec ce cheikh, je partis pour retourner à la ville de Zeïtoûn, et, quelques jours après que j’y fus arrivé, on reçut un ordre du kân portant que j’eusse à me rendre dans sa capitale, défrayé de tout, et bien honoré. Il me laissait libre de voyager, soit par eau, soit par terre ; je préférai m’embarquer sur le fleuve. On disposa pour moi un joli navire, un de ceux qui servent à transporter les commandants ; l’émir fit partir avec moi ses compagnons, et me fournit beaucoup de vivres ; le kadi et les négociants musulmans m’envoyèrent aussi des provisions nombreuses. Nous voyageâmes comme hôtes du sultan, nous dînions dans un village, nous soupions dans un autre ; et, après un trajet de dix jours, nous arrivâmes à kandjenfoû. C’est une belle et grande cité, dans une plaine immense, entourée par des jardins ; on dirait la campagne (Ghoûthah) qui avoisine la ville de Damas.
A notre arrivée sortirent pour nous recevoir le kadi, le cheikh de l’islamisme et les marchands ; ils avaient des drapeaux, des tambours, des cors et des trompettes ; les musiciens les accompagnaient. Ils nous amenèrent des chevaux, que nous montâmes ; ils marchèrent tous à pied devant nous, excepté le kadi et le cheikh, qui cheminèrent à cheval avec nous. Le gouverneur de la ville et ses domestiques sortirent aussi à notre rencontre, car l’hôte du sultan est très honoré par ces peuples. Nous fîmes notre entrée dans Kandjenfoû, qui a quatre murs. Entre le premier et le second habitent les esclaves du sultan, soit ceux qui gardent la ville le jour, soit ceux qui la gardent pendant la nuit ; ces derniers sont nommés pâçouânân (sentinelles de nuit). Entre le deuxième mur et le troisième sont les militaires à cheval et l’émir qui commande dans la ville. A l’intérieur de la troisième muraille habitent les musulmans, et ce fut là que nous descendîmes, chez leur cheikh Zhahîr eddîn alkorlâny. Les Chinois demeurent dans l’intérieur de la quatrième muraille, ce qui constitue la plus grande de ces quatre villes. La distance qui sépare une porte de celle qui la suit, dans cette immense cité de Kandjenfoû, est de trois et quatre milles. Chaque habitant, comme nous l’avons dit déjà, y a son jardin, sa maison, et ses champs.
Un jour que je me trouvais dans la demeure de Zhahîr eddîn alkorlâny, voici qu’arrive un grand navire appartenant à un des jurisconsultes les plus vénérés parmi ces musulmans. On demanda la permission de me présenter ce personnage et on l’annonça : « Notre maître Kiouâm eddîn assebty. » Son nom me surprit ; mais quand il fut entré, et que l’on se fut mis à converser après les salutations d’usage, il me vint à l’esprit que je le connaissais. Je me mis à le regarder fixement, et il me dit : « Il me paraît que tu me regardes comme un homme qui me connaît. — De quel pays es-tu — De Ceuta. — Et moi, je suis de Tanger. » Or il me renouvela le salut, il pleura, et pleurai à son exemple. Je lui demandai : « As-tu été dans l’Inde ? — Oui, j’ai été à Dihly, la capitale. » Quand il eut dit cela, je me souvins de lui, et je repris : « Est-ce que tu n’es pas Albochry ? — Oui. » Il était arrivé à Dihly avec son oncle maternel, ’Abou’l Kâcim de Murcie, et il était alors tout jeune, sans barbe ; mais un étudiant des plus habiles, sachant par cœur le Moouatthâ, ou livre approprié (sur les traditions ; ouvrage célèbre de l’imâm Malik). J’avais informé sur son compte le sultan de l’Inde, qui lui donna trois mille dînârs et l’engagea à rester à Dihly. Il refusa, car il voulait se rendre en Chine, pays où il s’acquit une grande renommée et beaucoup de richesses. Il m’a dit qu’il avait environ cinquante pages, ou esclaves mâles, et autant du sexe féminin ; il me donna deux des premiers et deux femmes, ainsi que des cadeaux nombreux. Plus tard, je vis son frère en Nigritie : quelle énorme distance les séparait !
Je restai à Kandjenfoû quinze jours, puis je partis. La Chine, quoique belle, ne me plaisait pas ; au contraire, mon esprit y était fort troublé, en pensant que le paganisme dominait en cette contrée. Lorsque je sortais de mon logis, j’étais témoin de beaucoup de choses, très blâmables ; cela me désolait au point que je restais la plupart du temps chez moi, et que je ne quittais la maison que par nécessité. Durant mon séjour en Chine, toutes les fois que je voyais des musulmans, c’était comme si j’eusse rencontré ma famille et mes proches parents. Ledit jurisconsulte Albochry poussa la bonté si loin à mon égard qu’il voyagea avec moi pendant quatre jours, lorsque je quittai Kandjenfoû, et jusqu’à mon arrivée à Baïouam Kothlouy. C’est une petite ville habitée par des Chinois, militaires et marchands ; les mahométans n’y ont que quatre maisons, occupées par des partisans du légiste Albochry, nommé ci-dessus. Nous descendîmes chez l’un d’eux et restâmes avec lui trois jours ; ensuite je dis adieu au légiste, et me remis en route.
Comme d’habitude, je voyageais sur le fleuve ; nous dînions dans un village, nous soupions dans un autre, et après un trajet de dix-sept jours nous arrivâmes à la ville de Khansâ (actuellement Hang-tchéou-fou). Son nom est semblable à celui de la poétesse Khansâ (la sœur de Sakhr) ; mais je ne sais pas s’il est arabe, ou bien seulement analogue à l’arabe. Cette cité est la plus grande et j’aie jamais vue sur la surface de la terre ; sa longueur est de trois jours de chemin, de sorte que le voyageur marche et fait halte dans la ville. D’après ce que nous avons dit de l’arrangement suivi dans les constructions de la Chine, chacun dans Khansâ est pourvu de son jardin et de sa maison. Cette cité est divisée en six villes, comme nous le montrerons tout à l’heure. A notre arrivée sortirent à notre rencontre : le kadi de Khansâ, nommé Afkhar eddîn, le cheikh de l’islamisme, et les descendants d’Othman, fils d’Affân l’Égyptien, qui sont les musulmans les plus notables de Khansâ. Ils portaient un drapeau blanc, des tambours, des trompettes et des cors. Le commandant de cette cité sortit aussi à notre rencontre avec son escorte.
Nous entrâmes dans ladite cité, qui se divise en six villes ; chacune a son mur séparé, et une grande muraille les entoure toutes. Dans la première ville demeurent les gardiens de la cité avec leur commandant. J’ai su par le kadi et par d’autres qu’ils sont au nombre de douze mille, inscrits sur le rôle des soldats. Nous passâmes la nuit dans la maison de ce commandant.
Le lendemain, nous entrâmes dans la deuxième ville par une porte nommée la Porte des Juifs ; cette ville est habitée par les israélites, les chrétiens, et les Turcs adorateurs du soleil ; ils sont fort nombreux. L’émir de cette ville est un Chinois, et nous passâmes la seconde nuit dans sa demeure. Le troisième jour, nous fîmes notre entrée dans la troisième ville, et celle-ci est occupée par les musulmans. Elle est belle, les marchés y sont disposés comme dans les pays de l’islamisme ; elle renferme les mosquées et les muezzins ; nous entendîmes ces derniers appeler les fidèles à la prière de midi, lors de notre entrée dans la ville.
Ici nous fûmes logés dans la maison des descendants d’Othman, fils d’Affân l’Égyptien. C’était un des plus notables négociants, qui prit cette ville en affection et s’y domicilia ; elle porte même son nom (la ville d’Othman, ou Al’othmâniyah). Il transmit à sa postérité dans cette ville la dignité et le respect dont il jouissait ; ses fils imitent leur père dans le bien qu’ils font aux religieux pauvres, et dans les secours qu’ils accordent aux gens nécessiteux. Ils ont un ermitage, ou zaouïa, nommée Al’othmâniyah, qui est d’une construction fort jolie, et pourvue de legs pieux. Elle se trouve habitée par une troupe de soufis. C’est ledit ’Othman qui a bâti la mosquée cathédrale qui se voit dans cette ville, et à laquelle il a légué, comme fondation pieuse, des sommes considérables, ainsi qu’il l’a fait pour l’ermitage. Les musulmans sont très nombreux dans cette ville, nous restâmes avec eux quinze jours, pendant lesquels, jour et nuit, nous assistions à un festin nouveau. Ils ne cessaient point de mettre une grande pompe dans leurs repas, et ils se promenaient tous les jours à cheval avec nous dans les différentes parties de la ville, pour nous divertir. Un jour, ils montèrent à cheval avec moi, et nous entrâmes dans la quatrième ville, qui est celle où siège le gouvernement et où se trouve le palais du grand émir Korthaï.
Lorsque nous eûmes franchi la porte de la ville, mes compagnons me quittèrent, et je fus reçu par le vizir, qui me conduisit au palais du grand émir Korthaï. J’ai déjà raconté comment ce dernier me prit par la pelisse qui m’avait été donnée par l’ami de Dieu, ou le saint Djélal eddîn de Chîrâz. Cette quatrième ville est uniquement destinée pour l’habitation des esclaves du sultan et de ses serviteurs ; c’est la plus belle des six villes, et elle est traversée par trois cours d’eaux. L’un est un canal qui sort du Grand Fleuve, et sur lequel arrivent à la ville, dans de petits bateaux, les denrées alimentaires, ainsi que les pierres à brûler ; on y voit aussi des navires pour aller se promener. Le michouer, ou la forteresse est située au milieu de cette ville ; elle est immensément vaste, et au centre se trouve l’hôtel du gouvernement. La citadelle entoure celui-ci de tous côtés ; elle est pourvue d’estrades où se voient les artisans qui font des habits magnifiques, et qui travaillent aux instruments de guerre ou aux armes. L’émir Korthaï m’a dit qu’ils sont au nombre de seize cents maîtres, et que chacun de ceux-ci a sous sa direction trois ou quatre apprentis. Tous sont esclaves du kân ; ils ont les chaînes aux pieds, et habitent au-dehors du château. On leur permet de se rendre aux marchés de la ville, mais on leur défend de sortir hors de la porte. L’émir les passe en revue tous les jours, cent par cent, et, s’il en manque un, son chef en est responsable.
L’usage est qu’après que chacun d’eux a servi dix ans on brise ses entraves, et il peut choisir l’une ou l’autre de ces deux conditions continuer à servir, mais sans chaînes, ou aller où il veut, dans les limites du pays de kân, sans quitter son territoire. A l’âge de cinquante ans, il est dispensé de tout travail, et entretenu aux frais de l’État. D’ailleurs, chaque personne qui a cet âge, ou à peu près, peut, à la Chine, être nourrie par le Trésor. L’individu qui a atteint soixante ans est considéré comme un enfant par les Chinois, et n’est plus sujet aux peines ordonnées par la loi. Les vieillards sont très vénérés dans ce pays-là ; chacun d’eux est nommé âthâ, c’est-à-dire père.
C’est le principal commandant de la Chine ; il nous offrit l’hospitalité dans son palais, il donna un festin que ces peuples appellent thowa (thoï), et auquel assistèrent les grands de la ville. Il fit venir des cuisiniers musulmans qui égorgèrent les animaux et firent cuire les mets. Cet émir, malgré sa grandeur, nous présentait lui-même les aliments, et coupait les viandes de sa propre main. Nous fûmes ses hôtes pendant trois jours, et il envoya son fils pour se promener avec nous sur le canal. Nous montâmes sur un navire semblable à un brûlot, le fils de l’émir monta sur un autre, et il avait avec lui des musiciens et des chanteurs. Ceux-ci chantèrent en chinois, en arabe et en persan. Le fils de l’émir était un grand admirateur de ce dernier chant ; or ils entonnèrent une poésie persane qu’il leur fit répéter à plusieurs reprises, de sorte que je l’appris par cœur de leur bouche. Cette poésie avait une jolie cadence, et la voici (mètre radjez):
Tâ dil bémihnet dâdîm
Der bahri fier uftâdîm
Tchoûn der namâz istâdîm
Kaouy bémihrâb anderîm
(Le sens de ces mots est :
Depuis que nous avons donné à notre cœur la tristesse,
Nous sommes tombés dans l’océan des soucis,
Lorsque nous nous tenons debout pour la prière,
Nous sommes forts devant l’autel.)
Une foule de gens se réunirent sur ce canal, montés sur des bâtiments ; on y voyait des voiles de couleur, des parasols de soie ; les bâtiments aussi étaient peints d’une manière admirable. Ces individus commencèrent à se charger ou à s’attaquer, en se jetant mutuellement des oranges et des citrons. Nous retournâmes au soir dans la demeure de l’émir et nous y passâmes la nuit. Les musiciens vinrent, et chantèrent différentes chansons fort belles.
Cette même nuit, un jongleur, esclave du kân, se présenta, et l’émir lui dit : « Fais-nous voir quelqu’une de tes merveilles. » Or il prit une boule de bois qui avait plusieurs trous, par lesquels passaient de longues courroies. Il la jeta en l’air, et elle s’éleva au point que nous ne la vîmes plus. Nous nous trouvions au milieu du michouer, ou citadelle, et c’était à l’époque des grandes chaleurs. Quand il ne resta dans sa main qu’un petit bout de la courroie, le jongleur ordonna à un des apprentis de s’y suspendre, et de monter dans l’air, ce qu’il fit, jusqu’à ce que nous ne le vissions plus. Le jongleur l’appela trois fois, sans en recevoir de réponse ; alors il prit un couteau dans sa main, comme s’il eût été en colère, il s’attacha à la corde et disparut aussi. Ensuite, il jeta par terre une main de l’enfant, puis un pied, après cela l’autre main, l’autre pied, le corps et la tête. Il descendit en soufflant, tout haletant, ses habits étaient tachés de sang ; il baisa la terre devant l’émir et lui parla en chinois. L’émir lui ayant ordonné quelque chose, notre homme prit les membres du jeune garçon, et les attacha bout à bout ; il lui donna un coup de pied, et voici l’enfant qui se lève et qui se tient tout droit. Tout cela m’étonna beaucoup, et j’en eus une palpitation de cœur, pareille à celle dont je souffris chez le roi de l’Inde quand je fus témoin d’une chose analogue. On me fit prendre un médicament, qui me débarrassa de mon mal. Le kadi Afkhar eddîn se trouvait à côté de moi, et me dit : « Par Dieu ! il n’y a eu ici ni montée, ni descente, ni coupure de membres ; tout n’est que jonglerie. »
Le jour suivant, nous entrâmes par la porte de la cinquième ville, la plus grande de toutes les six. Elle est habitée par le peuple, ou les Chinois, et ses marchés sont jolis ; elle renferme des ouvriers fort habiles, et c’est là que l’on fabrique les vêtements nommés alkhansâouiyah. Parmi les belles choses que l’on confectionne dans cette ville, il y a les plats ou assiettes, qu’on appelle dest ; elles sont faites avec des roseaux, dont les fragments sont réunis ensemble d’une manière admirable ; on les enduit d’une couche de couleur ou vernis rouge et brillant. Ces assiettes sont au nombre de dix, l’une placée dans le creux de l’autre ; et telle est leur finesse que celui qui les voit les prend pour une seule assiette. Elles sont pourvues d’un couvercle, qui les renferme toutes. On fait aussi de grands plats, avec les mêmes roseaux. Au nombre de leurs propriétés admirables sont celles-ci : qu’ils peuvent tomber de très haut sans se casser ; que l’on s’en sert pour les mets chauds, sans que leur couleur en soit altérée, et sans qu’elle se perde. Ces assiettes et ces plats sont expédiés de Khansâ dans l’Inde, le Khoraçan et autres pays.
Nous passâmes une nuit dans cette cinquième ville, comme hôtes de son commandant, et le lendemain nous entrâmes dans la sixième, par une porte nommée kechtïouânân, ou « des Pilotes ». Cette ville est habitée seulement par les marins, les pêcheurs, les calfats, les charpentiers, et ces derniers sont appelés doroûdguérân ; par les sipâhiyah, ou cavaliers, qui sont les archers ; enfin par les piyâdeh, et ce sont les piétons. Tous sont esclaves du sultan, nul autre de demeure avec eux, et ils sont en très grand nombre. La ville dont nous parlons est située au bord du grand fleuve, et nous y restâmes une nuit, jouissant de l’hospitalité de son commandant. L’émir Korthaï nous fit préparer un navire pourvu de tout le nécessaire en fait de provisions de bouche et autres ; il fit partir avec nous ses compagnons pour que nous fussions partout reçus comme les hôtes du sultan ; et nous quittâmes cette ville, qui est la dernière des provinces de la Chine pour entrer dans le Khithâ.
Le Khithâ est le pays du monde le mieux cultivé, et dans toute la contrée on ne trouve pas un seul endroit qui soit en friche. La raison en est que, s’il arrive qu’une localité reste sans culture, on force ses habitants, ou, à leur défaut, ceux qui les avoisinent, d’en payer l’impôt foncier. Les jardins, les villages et les champs ensemencés sont rangés avec ordre des deux côtés du fleuve, depuis la ville de Khansâ jusqu’à celle de Khân-bâlik ; ce qui fait un espace de soixante-quatre jours de voyage. Dans ces localités, on ne trouve pas de musulmans, à moins qu’ils ne soient de passage, et non établis ; car elles ne sont pas propres à une demeure fixe, et l’on n’y remarque point de ville constituée. Ce ne sont que des villages et des plaines, où l’on voit des céréales, des fruits et (des cannes à) sucre. Je ne connais point dans le monde entier de région comparable à celle-ci, excepté l’intervalle de quatre jours de marche entre Anbâr et ’Anah. Tous les soirs, nous descendions dans un nouveau village, où nous recevions l’hospitalité.
Nous arrivâmes ainsi jusqu’à Khân-bâlik, nommée encore Khânikoû (Pékin). C’est la capitale du kân, ou du grand sultan des Chinois, qui commande dans les pays de la Chine et du Khithâ. Nous jetâmes l’ancre, suivant l’usage de ces peuples, à dix milles de Khân-bâlik, et l’on écrivit à notre sujet aux émirs de la mer (amiraux), qui nous permirent d’entrer dans le port, ce que nous fîmes. Ensuite, nous descendîmes dans la ville même, qui est une des plus grandes du monde ; mais elle diffère des autres villes de la Chine, en ceci que les jardins ne sont pas dans son enceinte ; ils sont au-dehors, comme dans les cités des autres pays. La ville ou le quartier où demeure le sultan est située au milieu, à la manière d’une citadelle, ainsi que nous le dirons ci-après. Je logeai chez le cheikh Borhân eddîn de Sâghardj : c’est le personnage à qui le roi de l’Inde envoya quarante mille dinars, l’invitant à aller dans son pays ; il prit la somme d’argent, avec laquelle il paya ses dettes ; mais il ne voulut pas se rendre chez le souverain de Dihly, et se dirigea vers la Chine. Le kân le mit à la tête de tous les musulmans qui habitaient son pays, et il l’appela du nom de Sadr al-Djihan, ou « prince du monde ».
Du sultan de la Chine et du Kithâ, surnommé kân
Le mot kân, chez les Chinois, est un terme générique qui désigne quiconque gouverne le royaume, tous les rois de leur contrée ; de la même manière que ceux qui possèdent le pays de Loûr sont appelés Atâbec. Le nom propre de ce sultan est Pâchâï, et les infidèles n’ont pas, sur la face de la terre, de royaume plus grand que le sien.
Le château de ce monarque est situé au milieu de la ville destinée pour sa demeure ; il est presque entièrement construit en bois sculpté, et il est disposé d’une manière admirable ; il possède sept portes. A la première est assis le cotouâl, qui est le chef des concierges. On y voit des estrades élevées à droite et à gauche de la porte, où s’asseyent les mamloûcs perdehdâriyah, ou chambellans, qui sont les gardiens de la porte du château. Ils sont au nombre de cinq cents, et l’on m’a dit qu’auparavant ils étaient mille hommes. A la deuxième porte sont assis les sipâhiyah, ou archers, au nombre de cinq cents ; à la troisième porte sont assis les nîzehdâriyah, ou lanciers, au nombre de cinq cents aussi ; à la quatrième porte sont assis les tîghdâriyah, ou porteurs de sabres et de boucliers à la cinquième porte se trouvent les bureaux du vizirat, et elle est pourvue de beaucoup d’estrades. Sur la plus grande de celles-ci s’assied le vizir, au-dessus d’un coussin, énorme, élevé. On appelle ce lieu almisnad ; devant le vizir se voit une grande écritoire en or. En face se trouve l’estrade du secrétaire intime ; à droite de celle-ci, l’estrade des secrétaires des missives, et à droite de l’estrade du vizir est celle des écrivains des finances.
Ces quatre estrades en ont vis-à-vis quatre autres ; l’une est nommée le bureau du contrôle, où siège le contrôleur ; la deuxième est celle du bureau de mostakhradj, ou produit de l’extorsion, dont le chef est un des grands émirs. On appelle mostakhradj ce qui reste dû par les employés ou percepteurs, et par les émirs, sur leurs fiefs. La troisième est le bureau de l’appel au secours, où se trouve assis l’un des grands officiers, assisté des jurisconsultes et des secrétaires. Quiconque a été victime d’une injustice s’adresse à eux pour implorer aide et protection. La quatrième, c’est le bureau de la poste, où est assis le chef de ceux qui rapportent les nouvelles, ou les nouvellistes.
A la sixième porte du château, on voit assis les gardes du monarque, ou les gendarmes, ainsi que leur commandant principal. Les pages, ou les eunuques, sont assis à la septième porte ; ils ont trois estrades, dont l’une est pour les pages abyssins, l’autre pour les pages indiens, et la troisième pour les pages chinois. Chacune de ces trois classes a un chef, qui est chinois.
De la sortie du kân pour combattre le fils de son oncle, et de la mort de ce monarque
Lorsque nous arrivâmes à la capitale Khân-bâlik, nous trouvâmes que le kân en était absent, et qu’il était sorti pour combattre son cousin, ou le fils de son oncle Fîroûz, lequel s’était révolté contre lui en la contrée de Karakoroum et de Bichbâligh dans la Chine septentrionale. De la capitale pour arriver à ces localités, il y a trois mois de marche par un pays cultivé. J’ai su de Sadr al-Djihan, Borhân eddîn de Sâghardj, que le kân ayant rassemblé les armées et convoqué les milices, cent troupes, ou escadrons de cavaliers se réunirent autour de lui, chaque escadron étant composé de dix mille hommes, et le chef est appelé émir thoûmân, ou commandant de dix mille. Outre cela, l’entourage du sultan et les gens de sa maison fournissaient encore cinquante mille hommes à cheval. L’infanterie comptait cinq cent mille hommes. Quand le monarque se mit en marche, la plupart des émirs se rebellèrent et convinrent de le déposer, car il avait violé les lois du yaçâk, ou statut ; c’est-à-dire les lois établies par Tenkîz khân, leur aïeul, qui ruina les contrées de l’islamisme. Ils passèrent dans le camp du cousin du sultan qui s’était soulevé, et écrivirent au kân d’abdiquer, en gardant la ville de Khansâ pour son domaine. Le kân refusa, il les combattit, fut mis en déroute et tué.
Peu de jours après notre arrivée à sa capitale, ces nouvelles y parvinrent. Alors la ville fut ornée, on battit les tambours, on sonna les cors et les trompettes, on s’adonna aux jeux et aux divertissements l’espace d’un mois. Ensuite, on amena le kân mort, ainsi qu’environ cent hommes tués parmi ses cousins, ses proches parents et ses favoris. On creusa pour le kân un grand nâoûs, qui est une maison souterraine ou caveau ; on y étendit de superbes tapis, et l’on plaça le kân avec ses armes. On y mit aussi toute la vaisselle d’or et d’argent de son palais, quatre jeunes filles esclaves et six mamlouks des plus notables, qui tenaient à la main des vases pleins de boisson. Puis on mura la porte du caveau, on le recouvrit de terre, de sorte qu’il ressemblait à une haute colline. On fit venir quatre chevaux qu’on força de courir près de la tombe du sultan, jusqu’à ce qu’ils s’arrêtassent (de fatigue). Alors on dressa près du sépulcre une grande pièce de bois, ou poutre, à laquelle on suspendit ces chevaux, après avoir introduit dans leur derrière une pièce de bois qu’on fit sortir par leur bouche. Les parents du kân dont il a été parlé plus haut furent mis dans des caveaux, avec leurs armes et la vaisselle de leurs maisons. Auprès des sépulcres des principaux d’entre eux, qui étaient au nombre de dix, on mit en croix trois chevaux pour chacun ; auprès des autres, on crucifia ou empala un cheval pour chaque tombe.
Ce fut là un jour solennel ; tout le monde, soit homme, soit femme, musulman ou infidèle, assista à ce spectacle. Tous revêtirent des habits de deuil, c’est-à-dire de courts manteaux blancs pour les infidèles et des robes blanches pour les musulmans. Les dames du kân et ses favoris restèrent sous des tentes, auprès de son tombeau, durant quarante jours ; plusieurs y restèrent davantage, et jusqu’à une année. On avait établi dans les environs un marché, où l’on vendait tout le nécessaire en fait de nourriture, etc. Je ne sache pas qu’aucun autre peuple suive dans notre siècle de pareilles pratiques. Les païens de l’Inde et de la Chine brûlent leurs morts ; les autres nations les enterrent, mais ne mettent personne avec l’individu décédé. Cependant, des gens qui méritent toute confiance m’ont raconté, en Nigritie, que les infidèles de ce pays, lors de la mort de leur roi, lui préparent un vaste souterrain, ou caveau ; ils y font entrer avec lui quelques-uns de ses favoris et de ses serviteurs, ainsi que trente personnes des deux sexes, prises dans les familles des grands de l’État. On a soin préalablement de briser à ces victimes les mains et les pieds. On met aussi dans cette maison souterraine des vases pleins de boisson.
Un notable de la peuplade des Messoûfah, habitant parmi les nègres dans la contrée de Coûber et qui était très honoré par leur sultan, m’a raconté qu’il avait un fils, et qu’au moment de la mort dudit sultan on voulait introduire ce fils dans le tombeau du souverain, en compagnie des autres individus que l’on y mettait, et qui étaient pris parmi les enfants du pays. Ce notable ajouta : « Or je leur dis “Comment pourriez-vous agir ainsi, tandis que ce garçon n’est pas de votre religion, ni de votre contrée ?” Et je le leur rachetai au moyen d’une forte somme d’argent. »
Lorsque le kân fut tué, comme nous l’avons dit, et que le fils de son oncle, Fîroûz, s’empara du pouvoir, il choisit pour sa capitale la ville de Karâkoroum, pour le motif qu’elle était rapprochée des territoires ou contrées de ses cousins, les rois du Turkistân et de la Transoxiane. Puis plusieurs émirs qui n’étaient pas présents au meurtre du kân se révoltèrent contre le nouveau souverain ; ils se mirent à intercepter les routes, et les désordres furent considérables.
De mon retour en Chine et dans l’Inde
La révolte ayant éclaté et les discordes civiles s’étant allumées, le cheikh Borhân eddîn et autres me conseillèrent de retourner à la Chine avant que les désordres fissent des progrès. Ils se rendirent avec moi chez le lieutenant du sultan Firouz, qui fit partir en ma compagnie trois de ses camarades, et écrivit, afin que j’eusse à recevoir partout l’hospitalité. Nous descendîmes le fleuve jusqu’à Khansâ, Kandjenfoû et Zeïtoûn. Arrivé à cette dernière ville, je trouvai des jonques prêtes à voguer vers l’Inde ; parmi celles-ci, il y en avait une appartenant au roi Zhâhir, souverain de Djâouah (Sumatra), dont l’équipage était composé de musulmans. L’administrateur du navire me reconnut, et il se réjouit de mon arrivée. Nous eûmes bon vent pendant dix jours ; mais en approchant du pays de Thaouâlicy il changea, le ciel devint noir, et la pluie tomba en abondance. Durant dix jours, nous fûmes sans voir le soleil ; puis nous entrâmes dans une mer inconnue. Les marins eurent peur et voulurent retourner en Chine, mais ils ne le purent point. Nous passâmes ainsi quarante-deux jours, sans savoir dans quelle eau nous étions.
De l’oiseau monstrueux nommé Rokkh
Au quarante-troisième jour, nous vîmes, après l’aurore, une montagne dans la mer, à environ vingt milles de distance, et le vent nous portait tout droit contre elle. Les marins furent surpris, et dirent : « Nous ne sommes pas dans le voisinage de la terre ferme, et l’on ne connaît point de montagne dans cette mer. Si le vent nous force à heurter contre celle-ci, nous sommes perdus. » Alors tout le monde eut recours aux humiliations, au repentir, au renouvellement de la résipiscence. Nous nous adressâmes tous à Dieu par la prière, et cherchâmes un intermédiaire dans son prophète Mahomet. Les marchands promirent de nombreuses aumônes, que j’inscrivis pour eux de ma propre main sur un registre. Le vent se calma un peu ; nous vîmes, au lever du soleil, ce mont, qui était très haut dans l’atmosphère, ou les airs, et nous distinguâmes le jour qui brillait entre lui et la mer. Nous fûmes étonnés de cela ; j’aperçus les marins qui pleuraient, se disant mutuellement adieu, et je fis : « Qu’avez-vous donc ? » Ils me répondirent : « Certes, ce que nous avions pris pour une montagne, c’est le Rokkh ; s’il nous voit, il nous fera périr. » Il était à ce moment-là à moins de dix milles de la jonque, Ensuite le Dieu très haut nous fit la grâce de nous envoyer un bon vent, qui nous détourna de la direction du Rokkh ; nous ne le vîmes donc pas, et ne connûmes point sa véritable forme.
Deux mois après ce jour, nous arrivâmes à Sumatra et descendîmes dans la ville de ce nom. Nous trouvâmes que son sultan, le roi Zhâhir, venait d’arriver d’une de ses expéditions guerrières ; il avait ramené beaucoup de captifs, d’entre lesquels il m’envoya deux jeunes filles et deux garçons. Il me logea, comme à l’ordinaire, et je fus témoin de la noce de son fils, qui se mariait avec sa cousine, ou la fille du frère du sultan.
Description des noces du fils du roi Zhâhir
J’assistai à la cérémonie du mariage ; je vis que l’on avait dressé au milieu de l’endroit des audiences une grande tribune, ou estrade, recouverte d’étoffes de soie. La nouvelle mariée arriva, sortant à pied de l’intérieur du château, et ayant la figure découverte. Elle était accompagnée d’environ quarante dames d’honneur, toutes femmes du sultan, de ses émirs et de ses vizirs, lesquelles tenaient les pans de sa robe, et avaient aussi la face découverte. L’assistance entière pouvait les voir, le noble comme le plébéien. Cependant, leur habitude n’est pas de paraître ainsi sans voile devant le public ; elles ne font jamais cela que dans les cérémonies de la noce. L’épouse monta sur l’estrade, ayant devant elle les musiciens, hommes et femmes, qui jouaient des instruments et qui chantaient. Ensuite vint l’époux, placé sur un éléphant paré, qui portait sur son dos une sorte de trône surmonté d’un pavillon, à la manière d’un parasol. Le marié portait la couronne sur la tête ; on voyait, à sa droite et à sa gauche, près de cent garçons, fils de rois et d’émirs, vêtus de blanc, montés sur des chevaux parés, et portant sur leur tête des calottes ornées d’or et de pierreries. Ils étaient du même âge que l’époux, et aucun d’eux n’avait de barbe au menton.
On jeta parmi le public des pièces d’or et d’argent, lors de l’entrée du marié. Le sultan s’assit dans un lieu élevé, d’où il pouvait voir toutes ces choses. Son fils descendit de l’éléphant, il alla baiser le pied de son père, puis il monta sur l’estrade vers la mariée. Celle-ci se leva, lui baisa la main ; il s’assit à son côté, et les dames d’honneur éventaient la nouvelle mariée. On apporta la noix d’arec et le bétel ; l’époux les prit avec sa main, il en mit dans la bouche de sa femme, qui en prit à son tour, et en mit dans la bouche de son mari. Alors ce dernier plaça dans sa bouche une feuille de bétel, et la déposa ensuite dans celle de son épouse, qui imita ici encore la conduite de son mari. Tout cela se faisait en présence du public. On recouvrit la mariée d’un voile ; on transporta l’estrade, ou tribune, dans l’intérieur du château, pendant que les jeunes mariés y étaient encore ; les assistants mangèrent et partirent. Le lendemain, le sultan convoqua le public, il nomma son fils son successeur au trône, et on lui prêta le serment d’obéissance. Le futur souverain distribua dans ce jour des cadeaux nombreux en habits d’honneur et en or.
Je passai deux mois dans cette île de Sumatra, puis m’embarquai sur une jonque. Le sultan me donna beaucoup d’aloès, de camphre, de girofle, de bois de sandal, et il me congédia. Or je partis, et après quarante jours j’arrivai à Caoulem. Ici je me mis sous la protection d’Alkazouîny, le juge des mahométans ; c’était dans le mois de ramadhan, et j’assistai en cette ville à la prière de la fête de la Rupture du jeûne dans sa mosquée cathédrale. L’habitude de cette population est de se rendre, le soir qui précède la fête, à la mosquée, et d’y réciter les louanges de Dieu jusqu’à l’aurore, puis jusqu’au moment de la prière de la fête. Ils font alors cette prière, le prédicateur prononce le prône, et les assistants se retirent.
De Caoulem, nous nous rendîmes à Kâlikoûth, où nous restâmes quelques jours. Je voulais d’abord retourner à Dihly, mais ensuite j’eus des craintes à ce sujet ; or je me rembarquai, et après un trajet de vingt-huit jours j’arrivai à Zhafâr. C’était dans le mois de moharram de l’année 48 (748 de l’hégire ; avril ou mai 1347 de J. C.). Je descendis chez le prédicateur de cette ville, ’Iça, fils de Thatha.
Cette fois, je trouvai pour son sultan le roi Nâcir, fils du roi Moghîth, lequel régnait en cette ville lorsque j’y abordai la première fois (t. II). Son lieutenant était Saïf eddîn ’Omar, émir djandar, ou « prince porte-épée », un personnage d’origine turque. Ce sultan me donna l’hospitalité et m’honora.
Je m’embarquai sur mer, et arrivai à Maskith (Mascate), petite ville où l’on trouve beaucoup de ce poisson nommé koulb almâs. Ensuite, nous abordâmes aux ports de Kourayyât, Chabbah et Kelbah. Ce dernier mot s’écrit comme le féminin de kelb, ou « chien ». Après cela, nous arrivâmes à Kalhât, dont nous avons parlé précédemment. Toutes ces localités font partie du pays, ou du gouvernement d’Hormouz, bien qu’on les compte parmi celles de l’Oman. Nous allâmes à Hormouz et y restâmes trois jours ; puis nous voyageâmes par terre vers Caourestân, Lâr et Khondjopâl, endroits dont nous avons fait mention ci-dessus (t. II).
Ensuite, nous nous rendîmes à Cârzy et y restâmes trois jours ; puis à Djamécân, à Meïmen, à Bessa et à Chîrâz. Nous trouvâmes qu’Abou Ishâk, sultan de cette dernière ville, régnait encore, mais il en était absent. J’y vis notre cheikh pieux et savant, Madjd eddîn, le grand juge ; il était alors aveugle. Que Dieu soit avec lui, et nous fasse grâce par son intermédiaire !
De Chîrâz j’allai à Mâïn, puis à Yezdokhâs, à Kélîl, à Cochc-zer, à Ispahân, Toster, Howaïza et Basrah. Tous ces lieux ont été déjà mentionnés. Je visitai dans cette dernière ville les nobles sépulcres qu’elle renferme : ce sont ceux de Zobeïr, fils d’Al’awwâm ; de Thalhah, fils d’Obaïd Allah ; de Halîmah Assa’diyyah, ou de la tribu des Bénôu Sa’d ; d’Abou Becrah, d’Anas, fils de Mâlic ; de Haçan de Basrah, de Thâbit Albonâny, de Mohammed, fils de Sîrîn ; de Mâlic, fils de Dînâr ; de Mohammed, fils de Ouâci’ ; de Habîb le Persan et de Sahi, fils d’Abdallah, de Toster. Que le Dieu très haut soit satisfait d’eux tous !
Nous partîmes de Basrah et arrivâmes à (la ville nommée) Mechhed’Aly, où se trouve le mausolée d’Aly, fils d’Abou Thâlib ; nous le visitâmes. Ensuite nous nous dirigeâmes vers Coufah et allâmes voir sa mosquée bénie ; après, nous nous rendîmes à Hillah, où est le sanctuaire du Maître de l’époque.
Il arriva, à peu près vers ce temps-là, qu’un certain émir fut nommé gouverneur de cette ville, et défendit à ses habitants de se rendre, selon leur coutume, à la mosquée du Maître de l’époque, ou du dernier imâm, et d’attendre celui-ci dans cet endroit. Il leur refusa la monture qu’ils prenaient tous les soirs du commandant de Hillah. Or ce gouverneur fut atteint d’une maladie dont il mourut promptement, et cette circonstance augmenta encore l’erreur, ou la folie de ces schismatiques. En effet, ils dirent que la cause de la mort de ce personnage avait été son refus de donner la monture. Depuis lors, elle ne fut plus refusée.
Je partis pour Sarsar, puis pour Bagdad, où j’arrivai dans le mois de chawwâl de l’année 748 de l’hégire (janvier 1348). Un Maghrébin que j’y rencontrai me fit connaître la catastrophe de Tarifa (30 octobre 1340) et m’apprit que les chrétiens s’étaient emparés d’Algésiras. Dieu veuille réparer de ce côté les brèches survenues dans les affaires des musulmans !
Le sultan de Bagdad et de l’Irak, au temps de mon entrée dans ladite ville, à la date ci-dessus mentionnée, était le cheikh Haçan, fils de la tante paternelle du sultan Abou Sa’id. Quand ce dernier fut mort, le cheikh Haçan se rendit maître de son royaume de l’Irak ; il épousa la veuve d’Abou Sa’id, nommée Dilchâd, fille de Dimachk Khodjah, fils de l’émir Altchoûbân, à l’exemple de l’action dudit sultan Abou Sa’id, qui avait épousé la femme du cheikh Haçan. Celui-ci était absent de Bagdad lorsque j’y arrivai, et il était en marche pour combattre le sultan Atâbec Afrâciâb, souverain du pays de Loûr.
De Bagdad je me rendis à la ville d’Anbâr, puis à Hît, à Hadîthah et ’Anah, Ces contrées sont au nombre des plus belles et des plus fertiles du monde ; la route entre ces différentes villes est bordée d’un grand nombre d’habitations ; de sorte que l’on dirait que le voyageur se trouve toujours dans un marché. Nous avons déjà dit que nous n’avions vu aucun pays qui ressemblât à la contrée située sur le fleuve de la Chine, excepté celui dont il est ici question.
J’arrivai à la ville de Rahbah, qui ajoute à son nom celui de Malik, fils de Thaouk ; c’est la plus belle localité de l’Irak, et elle est le commencement de la Syrie.
De Rahbah, nous allâmes à Sakhnah, jolie ville, dont la plupart des habitants sont des chrétiens infidèles. Son nom de Sakhnah, ou « chaleur », est emprunté de l’état thermal de ses eaux. Cette ville renferme des cellules pour les hommes et d’autres pour les femmes, où se prennent des bains chauds. La nuit, ils puisent de cette eau et la mettent sur les terrasses pour qu’elle refroidisse.
Nous allâmes à Tadmor, la ville du prophète de Dieu Salomon, pour qui les génies l’ont construite, comme dit le poète Nâbighah :
Ils bâtissent Palmyre avec les pierres plates et les colonnes.
Nous arrivâmes à Damas de Syrie, ville que j’avais quittée depuis vingt ans complets. J’y avais laissé une épouse enceinte, et, pendant mon séjour dans l’Inde, je sus qu’elle avait mis au monde un garçon. Alors j’envoyai à l’aïeul maternel de l’enfant, qui était un habitant de la ville de Micnâcah, en Afrique, quarante dînârs indiens en or. A mon arrivée à Damas, cette fois, ma première pensée fut de demander des nouvelles de mon fils. J’entrai donc dans la mosquée, et j’y rencontrai heureusement Nour eddîn Assakhâouy, imâm et supérieur des mâlikites. Or je le saluai, mais il ne me reconnut pas ; je lui dis qui j’étais, et je lui fis des questions sur mon fils. Il m’apprit que l’enfant était mort depuis douze ans ; il ajouta qu’un jurisconsulte de Tanger habitait dans la madraçah azzhâhiriyyah ou « école de Zhâhir ». Je m’empressai d’aller voir ce légiste, afin de m’informer de l’état de mon père et de celui de ma famille. C’était un cheikh vénérable, je le saluai et lui parlai de ma parenté. Il m’annonça que mon père était décédé depuis quinze ans, et que ma mère vivait toujours.
Ma demeure à Damas de Syrie se continua jusqu’à la fin de l’année ; la disette des vivres était grande, et le pain était si cher que sept onces coûtaient une drachme en argent. L’once de Damas équivaut à quatre onces de l’Afrique. Le principal juge des mâlikites était, à cette époque, Djémal eddîn Almaslâty : c’était un compagnon du cheikh ’Alâ eddîn Alkoûnéouy, avec lequel il se rendit à Damas ; il y fut connu, et puis investi de la charge de kadi. Quant au principal juge des chafiites, c’était Taky eddîn, fils d’Assobky. Le commandant de Damas était Arghoûn Chah, le roi des émirs.
Il mourut à Damas, vers cette époque, un des grands de la ville, qui laissa par testament des biens aux pauvres. La personne chargée de mettre à exécution ses volontés achetait du pain, qu’elle distribuait tous les jours aux indigents après la prière de l’après-midi. Or ceux-ci se réunirent un soir en foule, ils prirent de force le pain que l’on devait leur distribuer, et s’emparèrent aussi du pain des boulangers. Le gouverneur, Arghoûn Châh, ayant été informé de ces méfaits, fit sortir ses sbires, qui disaient à chaque pauvre qu’ils rencontraient : « Viens, viens prendre du pain ! » Un grand nombre d’indigents furent ainsi ramassés, et Arghoûn les fit emprisonner pour cette nuit-là. Le lendemain, il sortit à cheval, fit comparaître ces prisonniers au pied de la forteresse, et ordonna de leur couper les mains et les pieds. Cependant, la plupart d’entre eux étaient innocents du délit qu’on leur imputait. Arghoûn fit quitter Damas à la peuplade des Harâfîch (gens vils ou canaille, cf. t. I), qui émigrèrent à Hims, Hamâh et Alep. On m’a assuré que ce gouverneur de Damas n’a vécu que peu de temps après cela, et qu’il a été assassiné.
Je quittai cette dernière ville pour me rendre à Hims, puis à Hamâh, Ma’arrah, Sermîn et Alep. Le commandant de cette dernière cité était alors le hâddj, ou pèlerin, Roghthaï.
Un religieux pauvre, appelé le cheikh des cheikhs, habitait dans une montagne en dehors de la ville d’Aïn-tâb ; la multitude allait le visiter et lui demander sa bénédiction. Il avait un disciple qui ne le quittait pas ; mais, au reste, il vivait isolé, célibataire, sans épouse. Or il arriva, à peu près au temps dont il s’agit ici, que ce fakir dit dans un de ses discours : « Certes, le prophète Mahomet n’a pas pu se passer de femmes ; moi, je m’en passe. » On porta témoignage contre lui à ce sujet, et le fait fut établi devant le kadi. Cette affaire fut déférée aux émirs de la contrée ; on amena le religieux, ainsi que son disciple, qui avait approuvé son discours. Les quatre juges décidèrent qu’ils méritaient tous les deux la mort, et la sentence fut exécutée. Ces quatre kadis étaient : Chihâb eddîn, le mâlikite ; Nacir eddîn al’adîm, ou le pauvre, le hanéfite ; Taky eddîn, fils de l’orfèvre, le chafiite, et ’Izz eddîn de Damas, le hanbalite.
Dans les premiers jours du mois de rabi’ premier de l’année 749 de l’hégire (commencement de juin 1348), la nouvelle nous parvint à Alep que la peste s’était déclarée à Ghazzah, et que le nombre des morts, en un seul jour, y avait dépassé le chiffre de mille. Or je retournai à Émèse, et trouvai que l’épidémie y était ; le jour de mon arrivée il y mourut trois cents personnes environ. Je partis pour Damas, et y entrai un jeudi ; ses habitants venaient de jeûner pendant trois jours ; le vendredi, ils se dirigèrent vers la mosquée des pieds, comme nous l’avons raconté dans notre premier livre ou voyage. Dieu allégea pour eux la maladie ; le nombre des morts, à Damas, avait atteint deux mille quatre cents dans un jour. Enfin je me rendis à ’Adjloûn, puis à Jérusalem ; je vis que la peste avait alors cessé dans cette dernière ville. J’y trouvai son prédicateur ’Izz eddîn, fils de Djamâ’ab, fils de l’oncle paternel d’Izz eddîn, grand juge au Caire. C’est un homme de mérite très généreux ; ses honoraires, comme prédicateur, sont de mille drachmes par mois.
Le prédicateur ’Izz eddîn donna un jour un festin auquel il m’invita en compagnie d’autres personnes. Je lui demandai le motif de ce repas prié, et il m’apprit qu’il avait, pendant l’épidémie, fait vœu de donner un festin, si la peste cessait ses ravages, et s’il passait un jour sans avoir à prier sur aucun mort. Il ajouta : « Hier je n’ai prié sur aucun mort, et c’est pour cela que je donne le festin promis. »
Les cheikhs que j’avais connus à Jérusalem avaient presque tous émigré vers l’Être suprême. (Que Dieu ait pitié d’eux !) Il en restait fort peu, et parmi ceux-ci : le savant traditionnaire, l’imâm ou chef de mosquée Salah eddîn Khalil, fils de Caïcaldy Al’alây ; le pieux Cheref eddîn Alkhocchy, supérieur de l’ermitage de la mosquée Alaksa et le cheikh Soleïman de Chiraz. Je vis ce dernier, et il me donna l’hospitalité ; c’est le seul personnage, de tous ceux que j’ai rencontrés en Syrie et en Égypte, qui ait visité le Pied d’Adam (dans l’île de Ceylan).
Je partis de Jérusalem, et j’eus pour compagnons de voyage le prédicateur, le traditionnaire Cheref eddîn Soleïman, de Miliânah et le cheikh des Africains à Jérusalem, l’excellent soufi Thalhah Al’abdalouâdy. Nous arrivâmes à Hébron, ou la ville de l’ami de Dieu, Abraham ; nous visitâmes sa tombe, ainsi que celles des autres prophètes, qui sont enterrés auprès de lui. Nous nous rendîmes à Gaza, et trouvâmes la plus grande partie de la ville déserte, à cause du nombre immense des victimes que la peste avait faites. Le juge de la ville nous dit que de quatre-vingts notaires qu’elle possédait, il n’y en avait plus que le quart, et que le chiffre des morts avait atteint le nombre de onze cents par jour. Nous voyageâmes par terre, et arrivâmes à Damiette ; j’y vis Kothb eddîn Annakchouâny, qui est un jeûneur infatigable. Il m’accompagna de Damiette à Fârescoûr, Semennoûd et Abou Sîr. Ici nous descendîmes dans l’ermitage d’un Égyptien.
Pendant que nous étions dans cet ermitage, voici venir à nous un fakir, qui nous salua. Nous lui offrîmes des aliments, qu’il refusa en disant que son seul but avait été de nous visiter. Toute cette nuit-là il ne cessa point d’incliner sa tête et de se prosterner. Nous fîmes la prière de l’aurore, puis nous nous occupâmes de réciter les louanges de Dieu ; le fakir était toujours dans un coin de la zaouïa. Le supérieur apporta des comestibles et appela ce religieux, mais n’en reçut aucune réponse ; il alla vers lui et le trouva mort. Nous fîmes les prières sur son corps et nous l’ensevelîmes. (Que la miséricorde de Dieu soit sur lui !)
Je me rendis à Almahallah Alcabîrah, à Nahrâriyah, Abiâr, Demenhoûr et Alexandrie. Dans cette dernière ville, la peste avait beaucoup diminué d’intensité, après avoir fait jusqu’à mille et quatre-vingts victimes par jour. J’arrivai ensuite au Caire, et l’on me dit que le nombre des morts, pendant l’épidémie, y avait atteint le chiffre de vingt et un mille dans un seul jour. Tous les cheikhs que j’y connaissais étaient morts. (Que le Dieu très haut ait pitié d’eux !)
Le souverain de l’Égypte à cette époque était le roi Nacir Haçan, fils du roi Nacir Mohammed, fils du roi Mansour Kalâoûn. Il a été déposé plus tard, et l’on a choisi pour roi à sa place son frère, Almalic Assâlih.
En arrivant au Caire, je trouvai que le grand juge ’Izz eddîn, fils du grand juge Bedr eddîn, fils de Djamâ’ah, s’étant rendu à La Mecque avec une forte caravane, que l’on appelle radjéby, car elle part au mois de radjeb. J’ai su que la peste continua d’accompagner les gens de cette caravane jusqu’à leur arrivée au défilé d’Aïlah, et qu’alors cette maladie s’éloigna d’eux.
Du Caire, je me rendis dans les pays de la haute Égypte, dont il a été déjà question, et jusqu’à ’Aïdhâb. Ici je m’embarquai pour Djouddah, et de cette ville je me rendis à La Mecque (que Dieu l’ennoblisse et l’honore !), où j’arrivai le vingt-deuxième jour du mois de cha’bân de l’année 749 de l’hégire. Je me mis sous la protection de l’imâm des mâlikites, le pieux, dévot et vertueux Abou ’Abdallah Mohammed, fils d’Abderrahmân, nommé Khalîl, ou ami sincère. Tout le mois de ramadhan je jeûnai à La Mecque, et je visitai tous les jours les lieux saints, suivant le rite de Châfi’y. Parmi les cheikhs de La Mecque que je connaissais, je vis : Chihâb eddîn Alhanéfy ; Chihâb eddîn Atthabary ; Abou Mohammed Alyâfi’y ; Nadjm eddîn Alosfoûny ; et Alharâzy.
Dans la susdite année, après avoir fait le pèlerinage, je partis de La Mecque en compagnie de la caravane de Syrie, et arrivai à Thaïbah, ou Médine, la ville de l’envoyé de Dieu, de Mahomet. Je visitai son tombeau vénéré, parfumé (que Dieu augmente son parfum et sa vénération !) ; je priai dans la noble mosquée (que Dieu la purifie et augmente sa noblesse !) ; enfin, je visitai les compagnons du Prophète qui sont enterrés dans le cimetière de Médine (que Dieu soit content d’eux !). Parmi les cheikhs que je vis, je nommerai Abou Mohammed, fils de Farhoûn.
Nous partîmes de la noble Médine et arrivâmes successivement à ’Ola, Tabouc, Jérusalem, Hébron, Gaza, les stations du sable ou du désert, et Le Caire. Toutes ces localités ont déjà été décrites. A notre arrivée au Caire, nous apprîmes que notre maître, le commandant des fidèles, le défenseur de la religion, celui qui met sa confiance dans le Maître des mondes, je veux dire Abou ’Inân (que le Dieu très haut le protège !), avait, avec le secours divin, réuni les choses dispersées, ou réparé les malheurs de la dynastie mérînite et délivré par sa bénédiction les pays du Maghreb du danger dans lequel ils s’étaient trouvés. Nous sûmes que ce souverain répandait les bienfaits sur les grands et sur la multitude, et qu’il couvrait tout le monde de ses grâces copieuses. Or les hommes désiraient beaucoup de se tenir à sa porte, et n’avaient d’autre espoir que celui d’être admis à baiser son étrier. Alors je me décidai à me rendre dans son illustre résidence ; j’étais mû par le souvenir de la patrie, l’affection pour la famille et les amis chéris qui m’entraînaient vers mon pays, lequel, à mon avis, l’emporte sur toutes les autres villes.
C’est le pays où l’on a suspendu à mon cou les amulettes ; c’est la première contrée dont la poussière a touché ma peau.
Je m’embarquai sur un petit navire appartenant à un Tunisien : c’était pendant le mois de safar de l’année 750 de l’hégire, et je me fis descendre à l’île de Djerbah. Le susdit bâtiment continua sa route vers Tunis ; mais les ennemis s’en emparèrent. Plus tard, je me rembarquai sur un petit bâtiment pour aller à Kâbis, où je descendis, jouissant de l’hospitalité des deux illustres frères, Abou Merouân et Abou’l ’Abbâs, fils de Mekky, et commandants de Djerba ainsi que de Kâbis. Je passai chez eux la fête du jour anniversaire de la naissance de Mahomet ; ensuite, je me rendis par mer à Sefâkos et à Boliânah ; puis par terre, avec les Arabes, à Tunis, où j’arrivai après beaucoup d’ennuis. Dans ce temps-là, cette ville était assiégée par les Arabes.
Tunis était sous la domination de notre maître le commandant des musulmans, le défenseur de la religion, le champion du Maître des mondes dans la guerre contre les infidèles, le prince des princes, l’unique parmi les rois généreux, le lion des lions, le libéral des libéraux, le pieux, le dévot, ou qui vient à résipiscence, l’humble, le juste, Abou’l Haçan. Il était fils de notre maître le commandant des musulmans, le champion du Maître des mondes dans la guerre sainte, le défenseur de la religion mahométane, celui dont la bienfaisance a passé en proverbe, dont les actes de générosité et de vertu sont connus dans les différents pays, l’auteur et le possesseur d’actions généreuses et vertueuses, de mérites et de bienfaits, le roi juste, illustre, Abou Sa’id. Celui-ci était fils de notre maître le commandant des musulmans, le défenseur de la religion, le guerrier dans les saints combats, par amour pour le Maître des mondes ; le vainqueur et le destructeur des infidèles, celui qui, une première fois, a rendu manifestes des actes mémorables dans la guerre sainte, et qui souvent les a répétés ; le protecteur de la foi, le prince sévère dans les choses qui regardent l’être miséricordieux, le serviteur de Dieu, le dévot toujours assidu à la prière, à incliner sa tête, à se prosterner ; l’humble, le pieux, Abou Yoûçuf, fils d’Abdalhakky. (Que Dieu soit satisfait d’eux tous, et qu’il fasse durer le royaume dans leur postérité, jusqu’au jour du jugement dernier !)
A mon arrivée à Tunis, j’allai voir le pèlerin Abou’l Haçan annâmîcy, à cause des liens de parenté et de nationalité qui existaient entre nous deux. Il me fit loger dans sa maison, et puis se dirigea avec moi vers le lieu des audiences. J’entrai dans l’illustre salle, et je baisai la main de notre maître Abou’l Haçan. (Que Dieu soit content de lui !) Le souverain m’ordonna de m’asseoir, et j’obéis ; il me fit des questions sur le noble Hidjâz, sur le sultan du Caire, et je répondis à ses demandes ; il m’interrogea aussi sur Ibn Tîfarâdjîn. Or je l’informai de tout ce que les Africains avaient fait à son égard, de leur intention de le tuer à Alexandrie, et du mal qu’ils lui firent endurer, dans la vue de venger et de secourir notre maître Abou’l Haçan. (Que Dieu soit satisfait de lui !) Étaient présents à l’audience, en fait de jurisconsultes l’imâm Abou ’Abdallah assatthy, et l’imâm Abou ’Abdallah Mohammed, fils d’Assabbâgh, ou le teinturier. En fait de Tunisiens, il y avait : leur juge, Abou ’Aly, ’Omar, fils d’Abdarrafî’, ou le serviteur du Très Haut, et Abou ’Abdallah, fils de Haroun.
Je quittai le noble lieu des audiences ; mais, après la prière de l’après-midi, notre maître Abou’l Haçan me fit appeler. Il était alors sur une tour qui dominait l’endroit où l’on combattait, et avait en sa compagnie les cheikhs illustres dont les noms suivent : Abou ’Omar ’Othman, fils d’Abdalouâhid, ou le serviteur du Dieu unique, atténâlefty ; Abou Hassoûn Ziyân, fils d’Amriyoûn al’alaouy ; Abou Zacariyyâ Iahia, fils de Soleïman al’ascary, et le pèlerin Abou’l Haçan annâmîcy. Le sultan s’informa du roi de l’Inde, et je répondis aux questions qu’il me fit sur ce sujet. Je ne cessai point d’aller et de venir dans sa salle d’audience illustre, tout le temps de ma demeure à Tunis, qui fut de trente-six jours. Je vis alors dans cette ville le cheikh, l’imâm, la fin ou la perfection des savants et leur chef, c’est-à-dire Abou ’Abdallah Alobolly. Il était alité par suite de maladie, et m’interrogea sur beaucoup de matières touchant mes voyages.
Mon départ de Tunis eut lieu par mer, m’étant embarqué avec des Catalans, et nous arrivâmes à l’île de Sardaigne, qui est une des îles gouvernées par les chrétiens. Elle possède une jolie rade, entourée par d’énormes pièces de bois, et dont l’entrée ressemble à une porte, laquelle ne s’ouvre qu’avec la permission des habitants. Cette île a plusieurs châteaux forts ; nous entrâmes dans l’un de ceux-ci, et vîmes qu’il était pourvu de beaucoup de marchés. Je fis le vœu au Dieu très haut de jeûner pendant deux mois consécutifs, s’il nous tirait sains et saufs de cette île ; car nous avions été informés que ses habitants étaient décidés à nous poursuivre lors de notre sortie, pour nous faire captifs.
Cependant, nous partîmes de l’île de Sardaigne, et arrivâmes dix jours après à la ville de Ténès, puis à Mâzoûnah, à Mostaganem et à Tilimçân. Ici je me dirigeai vers ’Obbâd (Revue de l’Orient, janvier 1853 ; Journ. Asiatique, août 1854) et visitai le sépulcre du cheikh Abou Médîn (Que Dieu soit satisfait de lui, et nous fasse grâce par son intermédiaire !) Je quittai Tilimçân par le chemin de Nedroûmah, je suivis la route d’Akhandékân, et passai la nuit dans l’ermitage du cheikh Ibrahim. Puis nous partîmes, et lorsque nous étions auprès d’Azaghnaghân, nous fûmes assaillis par cinquante hommes à pied et deux à cheval. J’étais accompagné par le pèlerin Ibn Karî’ât, de Tanger, et par son frère Mohammed, qui périt plus tard en mer, martyr de la foi. Nous nous préparâmes à les combattre et déployâmes un drapeau ; mais ils nous demandèrent la paix, et nous la leur accordâmes. (Que Dieu soit loué !) Ensuite, j’arrivai à la ville de Taza, où j’appris la nouvelle que ma mère était morte de la peste. (Que le Dieu très haut ait pitié d’elle !) Je quittai Taza, et entrai dans Fez, la ville capitale, un vendredi, sur la fin du mois de chaban le vénéré de l’année 750 de l’hégire (le 8 novembre 1349 de J. C.).
Or je me tins debout en présence de notre illustre maître, le très noble imâm, le commandant des fidèles, l’homme qui met sa confiance dans le Maître des mondes, Abou ’Inân. (Que Dieu favorise sa grandeur et abatte ses ennemis !) Sa dignité me fit oublier celle du sultan de l’Irak ; sa beauté, celle du roi de l’Inde ; ses belles manières, celles du roi du Yémen ; son courage, celui du roi des Turcs ; sa mansuétude, ou sa longanimité, celle de l’empereur de Constantinople ; sa dévotion, celle du roi du Turkestan, et son savoir, celui du roi de Djâouah. Devant le sultan se trouvait son premier et excellent ministre, l’auteur d’actions généreuses et de hauts faits généralement connus, Abou Ziyân, fils de Ouedrâr, qui m’interrogea sur les pays d’Égypte, car il y avait été ; et je répondis à ses questions. Il me combla tellement de bienfaits provenant de notre maître (puisse le Dieu très haut le protéger !) que je me sens impuissant à le remercier convenablement ; Dieu seul est le maître de l’en récompenser. Je jetai le bâton de voyage dans le noble pays de ce souverain, après m’être assuré par un jugement incontestable que c’est le meilleur de tous les pays. En effet, les fruits y sont abondants, les eaux, les vivres s’y obtiennent sans difficulté, et bien peu de contrées jouissent de tous les avantages que celle-ci réunit. Aussi, c’est avec beaucoup de raison, qu’un poète a dit :
L’Occident est le plus beau pays du monde, et j’en ai la preuve ;
La pleine lune s’y observe d’abord, où c’est de là qu’on l’attend, et le soleil se dirige de son côté.
Les drachmes de l’Occident sont petites ; mais, par contre, leurs avantages sont grands. Si tu considères le prix des denrées dans cette région, ainsi que dans les pays de l’Égypte et de la Syrie, tu verras alors comme quoi ce que j’ai avancé est vrai, et de combien le Maghreb l’emporte sur les autres contrées. Or je dirai que la chair de mouton, ou de brebis, se vend en Égypte à raison d’une drachme nokrah, ou d’argent, qui vaut six drachmes du Maghreb, les dix-huit onces. Dans ce dernier pays, lorsqu’elle est chère, la viande est vendue deux drachmes les dix-huit onces, ce qui fait le tiers de la drachme nokrah. Quant au beurre, il est très rare en Égypte ; en général, les mets, ou les assaisonnements qu’emploient les Égyptiens ne sont nullement considérés par les habitants de la Mauritanie et ce sont pour la plupart les lentilles et les pois chiches ; que les Égyptiens font cuire dans d’énormes chaudières, en y ajoutant de l’huile de sésame ; les becillâs, qui sont une espèce de pois (en persan besleh, en italien piselli ou petits pois); ils les font bouillir, et y ajoutent de l’huile d’olive ; les courges, qu’ils font cuire et qu’ils mélangent avec du lait caillé ; l’herbe potagère fade, ou le pourpier, qu’ils font cuire comme ci-dessus ; les bourgeons, ou les jeunes pousses des amandiers, qu’ils font bouillir, et sur lesquelles ils versent du lait aigre ; la colocasie, que l’on se contente de faire bouillir. Tout cela est très abondant dans les pays de Maghreb ; mais Dieu a permis que les habitants s’en passassent, à cause de la grande quantité de viande, de beurre fondu, ou salé, de beurre frais, de miel, etc., qu’ils ont à leur disposition. Au reste, la verdure, ou les herbes potagères, est ce qu’il y a de plus rare en Égypte ; et les fruits y sont pour la plupart importés de la Syrie. Le raisin, quand il est à bon marché, s’y vend au prix d’une drachme nokrah les trois livres d’Égypte, et la livre de ce pays est de douze onces.
Pour ce qui concerne les contrées de la Syrie, les fruits, il est vrai, y sont en abondance ; mais néanmoins, dans la Mauritanie, ils se vendent à meilleur marché qu’en Syrie. En effet, dans cette dernière, le prix du raisin est d’une drachme nokrah pour une livre du pays, laquelle en fait trois du Maghreb. Quand il est à fort bon marché, le raisin s’y vend à une drachme nokrah les deux livres. Le prix des prunes est d’une drachme nokrah les dix onces ; celui des grenades et des coings est, pour chaque pièce, de huit foloûs, ce qui constitue une drachme de Mauritanie. Quant aux herbes potagères, on en a moins en Syrie pour une drachme nokrah que dans notre pays pour une petite drachme. Enfin, la viande coûte en Syrie deux drachmes et demie nokrah pour chaque livre du pays. Or, si tu médites bien tout ce qui précède, il deviendra évident pour toi que les pays du Maghreb sont ceux où les denrées alimentaires sont à meilleur marché, où les fruits de la terre sont en plus grande abondance, où les commodités et les avantages de la vie sont plus considérables.
Cependant, Dieu a augmenté encore la noblesse et le mérite de la Mauritanie, au moyen de l’imâmah, ou de la direction de notre maître, le commandant des fidèles, qui a répandu l’ombre de la sécurité dans ses provinces, fait surgir le soleil de la justice dans tous ses districts, pleuvoir les nuées de la bienfaisance sur ses campagnes comme sur ses villes, ou sur les nomades et les citadins, purifié le pays des gens criminels, et fait régner partout les lois de la justice humaine ainsi que les commandements de la religion. Je vais maintenant mentionner ce que j’ai vu et vérifié touchant sa justice, sa mansuétude, son courage, son zèle pour apprendre la science, et pour étudier la jurisprudence, les aumônes qu’il a faites et les injustices qu’il a supprimées.
De quelques-uns des mérites de notre maître
(que Dieu le protège et le fortifie !)
Pour ce qui concerne sa justice, elle est plus célèbre que tout ce que l’on pourrait écrire à son sujet dans un livre. Une des preuves de cette vertu, c’est l’habitude de ce souverain de tenir exprès des séances pour écouter les plaintes de ses sujets. Il consacre le vendredi pour les pauvres ; il divise cette journée entre les hommes et les femmes, en faisant passer d’abord celles-ci, à cause de leur faiblesse. Les pétitions des femmes sont lues après la prière du vendredi (ou de la fête), et jusqu’au moment de celle de l’après-midi. Chaque femme est appelée à son tour par son nom ; elle se tient debout en la noble présence du sultan, qui lui parle sans intermédiaire. Si elle a été traitée injustement, la réparation ne se fait pas attendre ; si elle demande une faveur, celle-ci arrive vite. Lorsqu’on a fait la prière de l’après-midi, on prend connaissance des pétitions des hommes, et le souverain en use à l’égard de ceux-ci comme à l’égard des femmes. Les jurisconsultes et les kadis sont présents à l’audience, et le sultan leur renvoie tout ce qui se rattache aux décisions de la loi. C’est là une conduite que je n’ai vu tenir d’une manière si parfaite, avec autant d’équité, par aucun souverain ; car le roi de l’Inde a chargé un de ses émirs de la fonction de recevoir les placets des mains du public, d’en faire un rapport succinct, et de l’exposer au souverain ; mais ce dernier ne fait pas venir devant lui les plaignants ou les pétitionnaires.
Quant à sa mansuétude, ou douceur, c’est une vertu dont j’ai vu par moi-même des effets merveilleux ; car ce sultan (que Dieu l’aide !) a pardonné à la plupart de ceux qui ont osé combattre ses troupes et se révolter contre son autorité. Il a fait grâce aussi aux grands coupables, aux auteurs de ces crimes que nul ne pardonne si ce n’est celui qui se confie en son Seigneur et qui connaît, de la science de la certitude, le sens de ces paroles de Dieu dans le Coran : [Le paradis est préparé pour...] et pour ceux qui pardonnent aux hommes (chapitre iii, verset 128).
Voici ce que dit Ibn Djozay : « Parmi les choses étonnantes dont j’ai été témoin, relativement à la douceur du caractère de notre maître (puisse Dieu le protéger !), il y a que, depuis mon arrivée à son illustre cour, sur la fin de l’année 753 de l’hégire, et jusqu’à ce moment, aux premiers jours de l’an 757 (vers le 5 janvier 1356), je ne l’ai vu faire périr personne, à moins que la sentence de mort ne fût rendue par le code religieux, dans quelques-unes de ces lois établies par le Dieu très haut, soit comme peine du talion, soit comme punition de guerre. Cela a eu lieu malgré l’étendue du royaume, la grandeur des provinces et la diversité des populations. On n’a point entendu raconter une pareille chose, ni pour les temps passés ni pour les contrées les plus éloignées. »
Au sujet de sa valeur ou de son courage, on sait les preuves de constance et de généreuse audace qu’il a données sur d’illustres champs de bataille, comme dans la journée du combat contre les Bénoû ’Abdalouâdy et autres adversaires. J’avais entendu raconter les nouvelles de ce fait d’armes dans le pays des nègres, et on les mentionna en présence de leur sultan qui fit : « C’est ainsi que l’on doit se conduire, ou bien il ne faut pas s’en mêler. »
Ibn Djozay dit : « Les anciens rois ne cessaient point de lutter entre eux de gloire à qui tuerait les lions et mettrait en fuite les ennemis. Notre maître, lui (que Dieu le fortifie !), a tué un lion plus facilement qu’un lion ne tue une brebis. Or il arriva qu’un lion assaillit les troupes de ce sultan dans la vallée des charpentiers, qui se trouve dans Alma’moûrah, ou partie cultivée du district de Salé. Les braves eux-mêmes cherchaient à l’éviter, les cavaliers et les fantassins fuyaient devant le lion. Notre maître (que Dieu l’assiste !) s’élance contre cette bête féroce sans aucun souci, sans nulle crainte, et il la perce entre les deux yeux d’un tel coup de lance qu’elle en tombe morte sur le sol. Sur les mains et sur la bouche ! (Proverbe dont le sens est Dieu merci ! Cf. Journal asiatique, Ve série, t. V).
« Quant à l’action de mettre en fuite les ennemis, cela arrive aux rois au moyen de la fermeté de leurs troupes, ou de leurs fantassins, et de la bravoure de leurs cavaliers. Le lot des rois est d’avoir de la constance et d’exciter les guerriers au combat. Notre maître (puisse Dieu l’assister !) s’est avancé tout seul et de sa noble personne contre ses ennemis, après avoir vu fuir toutes ses troupes et s’être bien assuré qu’il ne restait plus aucun soldat qui combattît auprès de lui. Alors l’épouvante saisit les cœurs des ennemis, qui s’enfuirent devant notre maître, et ce fut une chose étonnante de voir des nations entières prendre la fuite en présence d’un seul adversaire. C’est là une grâce que Dieu accorde à qui il veut (Coran, v, 59 ; lvii, 21 et lxii, 4). Le succès est pour ceux qui craignent Dieu (Coran, vii, 125 ; xxviii, 83). Au reste, tout ceci n’est que le fruit des faveurs que notre maître obtient de Dieu, par suite de sa confiance dans l’Être suprême et de son entier abandon à lui. (Que Dieu élève toujours la dignité de notre sultan !) »
Relativement à son zèle pour la science, certes notre maître (que le Dieu très haut l’assiste !) noue des conférences savantes tous les jours après la prière de l’aurore, dans la mosquée de son illustre palais ; les princes des jurisconsultes et les plus distingués d’entre les disciples y assistent. On lit devant le souverain le commentaire du noble Coran, les traditions sur l’Élu, ou Mahomet, les règles de la doctrine de Malik, et les ouvrages des soufis, ou religieux contemplatifs. Dans toutes ces sciences, notre maître tient le premier rang ; il dissipe leurs obscurités avec la lumière de son intelligence, et tire de sa mémoire ses admirables saillies, ou bons mots. C’est là, sans nul doute, la conduite des imâms, ou chefs, bien dirigés et des califes orthodoxes. Parmi tous les autres rois de la terre, je n’en ai connu aucun dont la sollicitude pour la science atteignît un si haut degré. Pourtant, j’ai vu chez le souverain de l’Inde que l’on conférait tous les jours en sa présence, et après la prière de l’aurore, spécialement sur les sciences fondées sur le raisonnement, ou métaphysiques. J’ai vu aussi que le roi de Djâouah assistait à des conférences que l’on tenait devant lui, après la prière du vendredi, surtout au sujet des règles ou doctrines, d’après le rite de Châfi’y. J’avais admiré l’assiduité du roi du Turkestân aux prières de la nuit close et de l’aurore dans la réunion des fidèles ; mais mon admiration a cessé, depuis que j’ai vu l’assiduité de notre maître (que Dieu l’aide !) dans la mosquée, pour toutes les sciences, et pour l’exacte observance des cérémonies du Ramadhan. Dieu fait part de sa miséricorde à qui il veut. (Coran, ii, 99 ; iii, 67).
Ibn Djozay ajoute : « Si l’on supposait un savant, sans nulle autre occupation que d’étudier la science, la nuit comme le jour, il n’atteindrait même pas au premier degré de l’instruction de notre maître (que Dieu l’assiste !) dans toutes les sciences. Cependant, il donne aussi ses soins aux affaires qui regardent les chefs des peuples, il gouverne des régions éloignées, il examine par lui-même la situation de son royaume, mieux que roi au monde ne l’a jamais fait, et il juge en personne les plaintes de ceux qui ont été lésés. Malgré tout cela, il ne se présente pas dans sa noble audience de question savante, sur quelque science que ce soit, qu’il n’en dissipe l’obscurité, qu’il n’en expose les finesses, n’en mette au jour les points cachés, et ne fasse comprendre aux savants qui assistent à la séance les détails difficiles qu’ils n’avaient pas saisis.
« Ensuite il s’éleva (que Dieu l’assiste !) jusqu’à la sublime science de l’ordre des soûfis, ou contemplatifs ; il comprit leurs symboles et adopta leurs mœurs. Les preuves en furent manifestes dans son humilité, malgré sa position illustre, dans sa commisération, ou sa clémence pour ses sujets, et sa douceur en toute chose. Il s’adonna beaucoup à l’étude des belles-lettres, qu’il cultiva comme auteur et qu’il honora par ses réponses écrites, ou diplômes. Or il a composé la sublime épître et le poème qu’il a envoyés au mausolée noble, saint, pur ; je parle du mausolée du prince des ambassadeurs, de l’intercesseur des coupables, de l’envoyé de Dieu, ou Mahomet. Il les a tracés de sa propre main, dont l’écriture surpasse en beauté tous les autres ornements du saint tombeau. C’est là une action qu’aucun autre roi de l’époque n’a pris soin d’accomplir, ni même n’a espéré de pouvoir atteindre. Quiconque a bien considéré les rescrits, ou patentes, émanés de notre souverain (que Dieu l’assiste !), et a connu d’une manière complète tout ce qu’ils contenaient, se sera fait une bonne idée du haut degré d’éloquence dont Dieu l’a gratifié en le créant, et de ce qu’il a réuni en sa faveur, en fait d’éloquence persuasive naturelle et acquise. »
Ce qui touche les aumônes que répand notre maître et les ermitages qu’il a fait construire dans ses pays, pour donner à manger à tous les allants et venants, ne trouve point de parallèle dans la conduite des autres rois, excepté dans celle du sultan Atâbec Ahmed. Cependant, notre maître lui est supérieur en ce qu’il donne à manger aux pauvres tous les jours, et en ce qu’il distribue des céréales aux pauvres honteux d’entre les anachorètes.
Ibn Djozay dit : « Notre maître (que Dieu l’assiste !) a inventé de telles choses au sujet de la générosité et des aumônes qu’elles n’étaient venues à l’esprit de personne, et que les sultans n’avaient pas eu le mérite de les pratiquer. Telles sont, entre autres : la distribution constante d’aumônes aux pauvres, dans toutes les parties de son royaume ; la fixation d’aumônes nombreuses pour les prisonniers, dans toute l’étendue du pays ; la disposition que toutes les aumônes dont on vient de parler fussent faites en pain bien cuit, et prêt à être utilisé ; le don de vêtements aux pauvres, aux infirmes, aux vieilles femmes, aux vieillards, et à ceux qui sont attachés aux mosquées, dans la totalité de ses domaines ; la désignation des holocaustes pour ces classes de gens, le jour de la fête des Sacrifices ; la distribution en aumônes de toute la recette des impôts perçus aux portes du pays, ou des octrois, le vingt-septième jour du mois de ramadhan, pour honorer cette illustre journée et pour la sanctifier comme elle le mérite ; le festin qu’il offre au public, dans tous ses pays, la nuit anniversaire de la naissance sublime de Mahomet, et son action de rassembler le peuple dans cette circonstance, pour accomplir les cérémonies religieuses d’une telle solennité ; le soin qu’il prend de la circoncision des garçons orphelins du pays, ainsi que du banquet qui la suit, et les habillements qu’il leur donne le jour de l’âchoûrâ ; la charité qu’il fait aux paralytiques et aux infirmes de couples (d’esclaves ?), pour labourer la terre, et au moyen desquels ces malheureux améliorent leur position ; l’aumône qu’il fait aux pauvres de sa capitale de tapis moelleux et de tapis velus excellents, qu’ils étendent lorsqu’ils veulent dormir : c’est là une libéralité sans pareille ; la construction d’hôpitaux dans chaque ville de son royaume, la désignation de legs nombreux pour servir à la nourriture ou à l’entretien des malades, et la nomination de médecins pour les soigner et les guérir. Je passe sous silence plusieurs autres sortes de libéralités et de vertus rendues manifestes par notre maître. Puisse Dieu rétribuer ses bienfaits et récompenser ses grâces ! »
Quant à la suppression des injustices qui pesaient sur ses sujets, il convient de mentionner les taxes de péage que l’on percevait sur les routes. Notre maître (que Dieu l’aide !) a ordonné de les abolir totalement, et il n’a pas été arrêté en cela par la considération qu’elles étaient la source d’une recette fort importante. Ce que Dieu tient en réserve vaut mieux, et est plus durable (Coran, xxviii, 60 ; xlii, 34). Relativement aux soins que notre maître prend, afin de repousser les mains, ou les secours de l’oppression, loin de lui, ce sont là des choses bien connues. Je l’ai entendu qui disait à ses receveurs d’impôts : « Ne vexez jamais les sujets » ; et il leur faisait de grandes recommandations à ce propos.
Ibn Djozay ajoute ici : « Quand même il n’y aurait à citer, comme preuve de la bonté de notre maître (que Dieu l’aide !) pour ses sujets, que la suppression ordonnée par lui du droit d’hospitalité, ou de bienvenue, que les percepteurs des contributions et les gouverneurs des villes exigeaient du public, cela seul, dis-je, suffirait pour montrer un signe manifeste de justice et une lumière éclatante de bienveillance. Que dirons-nous, puisqu’il est établi que notre maître a aboli en fait d’injustices et prodigué en fait d’avantages ce qu’on est impuissant à compter ? Au moment où l’on écrivait ce livre, un ordre sublime est émané de notre maître, d’avoir à traiter les prisonniers avec douceur et de supprimer les lourdes charges qu’on leur imposait ; cet ordre embrassait toute l’étendue du pays. C’est là un vrai bienfait pour ces misérables, et c’est un acte digne de sa clémence célèbre. De même, il a commandé qu’on punît d’une manière exemplaire tout juge et tout gouverneur dont la tyrannie serait constatée. Voilà un bon moyen d’empêcher l’injustice et de repousser les oppresseurs. »
Tout ce qui se rapporte à sa conduite pour aider les habitants de l’Andalousie dans la guerre sainte, pour fournir aux places frontières des secours en argent, provisions de bouche et armes, pour affaiblir le pouvoir de l’ennemi ou briser ses alliances, au moyen de préparatifs en munitions de guerre, et d’une belle parade de vigueur ; tout cela, disons-nous, est très notoire, la connaissance n’en est nullement effacée dans l’esprit des peuples de l’Occident ni de l’Orient, et aucun roi ne mérite la préférence sur notre maître sous ce rapport.
Ibn Djozay dit : « A celui qui veut connaître ce que notre souverain (que Dieu l’assiste !) a fait pour défendre les contrées des musulmans et pour repousser les peuples infidèles, qu’il lui suffise de savoir ce qu’il a pratiqué pour la délivrance de la ville de Tripoli d’Ifriqiya (de l’Afrique proprement dite, ou de Barbarie). Or, cette cité étant tombée au pouvoir de l’ennemi, qui avait étendu sur elle la main de l’injustice, notre maître (que Dieu le protège !) vit qu’il serait impossible d’envoyer les armées à son secours, à cause de la distance. Par conséquent, il écrivit à ses serviteurs, dans les pays de l’Afrique proprement dite, de racheter Tripoli avec de l’argent ; ce qui fut fait, au moyen de cinquante mille dinars d’or, en espèces sonnantes. Lorsque cette nouvelle lui parvint, il dit : « Louons Dieu, qui a repris la ville des mains des infidèles, pour cette petite misère ! » Il donna l’ordre immédiatement d’expédier la somme d’argent dans l’Ifriqiya, et la ville de Tripoli retourna à l’islamisme par son action. Personne ne s’était jusqu’alors imaginé qu’un homme regarderait comme une petite misère, ou une bagatelle, cinq quintaux d’or. C’est donc notre maître (que Dieu l’assiste !) qui a montré cette immense libéralité, et cet acte de vertu sublime. Les rois n’en ont pas fourni d’autres exemples, et l’annonce de ce grand fait a été par eux beaucoup honorée.
« Une des actions les plus connues de notre maître (que Dieu l’assiste !) dans la guerre sainte contre les infidèles, c’est qu’il a fait construire des bâtiments de guerre tout le long des côtes de la mer, qu’il a fait une grande provision de tout ce qui a rapport à la marine, dans les temps de paix et de trêve, pour être prêt au jour du malheur, ou de la guerre, et pour couper court avec sa prévoyance à l’avidité des infidèles. Il confirma cette conduite par le voyage qu’il fit lui-même (que Dieu l’aide !), l’an dernier, dans les montagnes de Djânâtab, afin de faire couper les bois nécessaires pour les constructions, de montrer l’importance qu’il attachait à tout cela, et sa volonté de diriger en personne les travaux pour la guerre sainte, dans l’espoir d’une récompense de la part du Dieu très haut, et bien certain d’en obtenir une excellente rétribution. »
Parmi les plus belles actions de notre maître (que Dieu l’assiste !), nous citerons les suivantes : la construction de la nouvelle mosquée, dans la Ville Blanche, la capitale de son illustre royaume : c’est la mosquée qui se distingue par sa beauté, la solidité de sa structure, son brillant éclat et son arrangement merveilleux ; la construction du grand collège, dans l’endroit appelé Château, tout près de la citadelle de Fez : il n’a pas son pareil dans tout le monde habité pour la grandeur, la beauté, la magnificence, la quantité d’eau, et l’avantage de l’emplacement ; je n’ai vu aucun collège qui lui ressemble, ni en Syrie, ni en Égypte, ni dans l’Irak, ni dans le Khoraçan ; la fondation de la grande zaouïa, ou ermitage, sur l’étang des pois chiches, au-dehors de la ville de Fez ; il n’a pas son pareil non plus à cause de son admirable emplacement et de sa merveilleuse construction. Le plus joli ermitage que j’aie vu dans les pays d’Orient, c’est celui de (la petite ville de) Siriâkaous, bâti par le roi Nacir ; mais l’ermitage de Fez, qui nous occupe, est plus beau, d’une structure plus solide et plus jolie. Que le Dieu suprême aide et assiste notre maître dans ses nobles desseins, qu’il récompense ses vertus sublimes, qu’il fasse durer longtemps ses jours en faveur de l’islamisme et des musulmans, qu’il soit l’auxiliaire de ses étendards et de ses drapeaux victorieux ! Revenons maintenant au récit du voyage.
Après avoir eu le bonheur de contempler cette résidence illustre, et après avoir été comblé des avantages de ses copieux bienfaits, je voulus visiter la tombe de ma mère. En conséquence, je me rendis à ma ville natale, Tanger, d’où je partis ensuite pour Ceuta. Ici je passai plusieurs mois, dont trois en état de maladie ; mais Dieu m’accorda enfin la santé, et je désirai prendre part à la guerre sainte et aux combats contre les infidèles. Je traversai donc la mer, de Ceuta jusqu’en Espagne, dans un petit navire, ou une saïque, appartenant à des gens d’Assîla. Or j’arrivai en Andalousie (que Dieu la garde !), où la rétribution est abondante pour quiconque y habite, où la récompense est mise en réserve pour quiconque s’y arrête et y voyage. C’était tout de suite après la mort du tyran des chrétiens nommé Adfoûnos (Alphonse XI). Il avait assiégé la montagne, ou Gibraltar, pendant dix mois, et il pensait s’emparer de tous les pays qui restaient encore en Espagne entre les mains des musulmans. Dieu l’enleva au moment où il ne s’y attendait pas, et il mourut de la peste, qu’il craignait plus que tout autre homme.
La première ville d’Espagne que j’ai vue, ç’a été la montagne de la victoire. J’y rencontrai son illustre prédicateur, Abou Zacariyyâ Iahia, fils de Sirâdj de Rondah ; j’y rencontrai aussi son juge, ’Iça Alberbery, chez qui je descendis. C’est avec ce dernier que je parcourus tout le tour de la montagne ; j’y vis les travaux admirables exécutés par notre (défunt) maître Abou’l Haçan (que Dieu soit satisfait de lui !), ses préparatifs et ses munitions ; je vis encore ce que notre maître (que Dieu l’assiste !) a ajouté à tout cela. J’aurais désiré alors d’être, jusqu’à la fin de mes jours, au nombre de ceux qui gardent et défendent cette localité.
Ibn Djozay dit : « La montagne de la Conquête, ou de la Victoire, est la forteresse de l’islamisme, placée, pour les étouffer, en travers des gosiers des adorateurs d’idoles ; c’est la bonne action de notre maître Abou’l Haçan (que Dieu soit content de lui !), laquelle se rattache à son nom ; c’est l’œuvre pieuse qu’il a fait marcher devant lui, comme une brillante lumière ; c’est la place des munitions pour la guerre sainte, et le lieu où résident les lions des armées ; c’est le thaghr (bouche, frontière, etc.) qui a souri à la victoire de la foi et qui a fait goûter aux Espagnols la douceur de la sécurité, après l’amertume de la crainte. La grande conquête de l’Espagne a eu son commencement en ce lieu, lors de la descente de Thârik, fils de Ziyâd, affranchi de Mouça, fils de Nossaïr, pour l’invasion de ce pays. La montagne prit par conséquence le nom de ce guerrier ; elle fut appelée la Montagne de Tharik, et aussi la Montagne de la Conquête, puisque celle-ci commença par ce point. On voit encore les restes de la muraille que ce capitaine et ses compagnons y bâtirent, et qui sont nommés le mur des Arabes. Je les ai vus pendant mon séjour dans cette place, à l’époque du siège de la ville d’Algésiras par les chrétiens (Que Dieu la fasse retourner à l’islamisme !)
« Gibraltar fut de nouveau conquis par notre maître Abou’l Haçan (que Dieu soit content de lui !) et arraché des mains des chrétiens, qui l’avaient possédé plus de vingt ans. Il envoya, pour en faire le siège, son fils, le prince illustre Abou Malik, qu’il secourut avec beaucoup de richesses et de nombreuses troupes. Le château fut pris l’an 733 de l’hégire (1333 de J. C.), après avoir été assiégé pendant six mois. Cette place n’était pas alors dans l’état où elle se trouve maintenant. Notre maître Abou’l Haçan (que Dieu lui fasse miséricorde !) y bâtit l’immense tour dans le haut du château ; il n’y avait d’abord qu’une tourelle, qui fut ruinée par les pierres lancées par les balistes, et notre maître fit construire à sa place la vaste tour dont je viens de parler. Il fit aussi bâtir à Gibraltar un arsenal, ou des ateliers, qui manquaient avant son temps ; enfin, il éleva la grande muraille qui entoure le monticule rouge, et qui commence à l’arsenal et va jusqu’à la tuilerie. Plus tard, notre maître, le commandant des fidèles, Abou ’Inân (que Dieu l’assiste !), renouvela les fortifications de Gibraltar et ses embellissements ; il construisit une muraille jusqu’à l’extrémité de la montagne ; or cette partie qu’il a ajoutée est la plus remarquable, et celle dont l’utilité est la plus générale. Il fit porter à Gibraltar d’abondantes munitions de guerre, ainsi que de bouche, et des provisions de toutes sortes ; il agit en cela envers l’Être suprême avec la meilleure intention et la piété la plus sincère.
« Dans les derniers mois de l’année 756 de l’hégire (1355 de J. C.), il arriva à Gibraltar un fait qui démontra la grande foi religieuse de notre maître (que Dieu l’assiste !), le fruit de sa pleine et entière confiance dans l’Être suprême, et le degré de bonheur parfait qui lui a été accordé. C’est que le gouverneur de Gibraltar, le traître qui a fini sa vie dans la misère, ’Iça, fils d’Alhaçan, fils d’Abou Mendîl, retira de l’obéissance sa main perfide, qu’il abandonna la défense des intérêts de la communion des fidèles, fit preuve d’hypocrisie, s’obstina dans la trahison et dans la révolte. Ce rebelle se mêla donc de ce qui ne le regardait pas, et ne sut voir ni le commencement ni la fin de sa mauvaise position. Les hommes s’imaginèrent que c’était là la première manifestation d’une guerre civile qui coûterait pour l’éteindre d’immenses trésors, et qui exigerait pour s’en garantir la mise sur pied de cavaliers et de fantassins. Cependant, le bonheur de notre maître (que Dieu l’assiste !) décréta que cette pensée serait vaine, et la sincérité de sa foi jugea que ces désordres auraient une fin inattendue, singulière. En effet, à peine quelques jours s’étaient passés, que les habitants de Gibraltar réfléchirent, qu’ils se mirent d’accord, se soulevèrent contre l’insurgé, se révoltèrent contre le coupable rebelle, et firent tout ce qu’ils devaient à leur obéissance envers le souverain. Ils se saisirent du gouverneur révolté et de son fils, qui l’avait secondé dans l’hypocrisie. On les conduisit tous les deux bien garrottés dans l’illustre capitale, où on leur appliqua la sentence que Dieu a portée contre les rebelles, fauteurs de guerres civiles (Coran, v, 37). Ainsi le Très Haut délivra le pays du mal que voulaient faire ces deux criminels.
Dès que le feu de la discorde se fut apaisé, notre maître (que Dieu l’aide !) montra une telle sollicitude pour les provinces de l’Espagne que les habitants de ce pays n’osaient pas tant espérer. Il envoya à Gibraltar son fils, le plus heureux, le béni, le plus pieux, Abou Bekr, nommé le Fortuné, une des épithètes affectées aux personnes impériales (que le Dieu très haut l’assiste !). Le sultan fit partir avec lui les cavaliers les plus braves, les notables d’entre les diverses tribus, et les hommes les plus accomplis. Il leur fournit tout le nécessaire, leur donna d’abondantes assignations en terres, rendit leurs pays libres d’impôts, et leur prodigua toutes sortes de bienfaits. Les soins que notre maître prenait de Gibraltar et de tout ce qui le concernait étaient si grands qu’il ordonna de construire le plan, ou la figure exacte de cette place ; il y fit représenter ses murs, ses tours, son château, ses portes, son arsenal, ses mosquées, ses magasins de munitions de guerre, ses greniers pour les céréales, la forme de la montagne et de la colline ou monticule rouge, qui lui est adjacent. Ce plan a été exécuté dans le lieu fortuné des audiences ; il est admirable, et fort bien travaillé par les ouvriers. Quiconque a vu Gibraltar, et puis examiné cette copie, en a reconnu le mérite. Notre maître a fait cela par suite de son extrême désir d’être informé et de méditer sur tout ce qui regarde Gibraltar, de s’occuper de ses fortifications et de ses provisions. Que le Dieu très haut fasse triompher l’islamisme dans la péninsule occidentale, ou l’Espagne, par l’intermédiaire de notre maître ; qu’il accomplisse ce que ce dernier espère touchant la conquête des pays des infidèles, et la dispersion, la ruine des adorateurs de la croix !
« En composant ceci, je me suis rappelé les expressions dont s’est servi pour décrire cette montagne bénie le littérateur éloquent, le poète admirable, Abou Abdallah Mohammed, fils de Ghâlib Arrossâfy (que Dieu ait pitié de lui !). C’est dans son poème célèbre, fait pour louer ’Abdalmoûmin, fils d’Aly, et qui commence par ce distique :
Si tu étais venu près du feu de la vraie religion, du côté de la montagne, tu aurais pris ce qui t’aurait plu, en fait de science et en fait de lumière.
« Le poète, après avoir parlé des vaisseaux et de leur trajet, consacre à la description de la montagne les vers suivants, les plus beaux que l’on ait jamais faits :
Jusqu’à ce que les navires eussent touché la montagne des deux victoires, celle dont le rang est vénéré, celle qui est renommée entre toutes les montagnes.
Sa hauteur est superbe ; elle est revêtue d’un manteau noir, dont le collet non boutonné est formé par tes nuages.
Les étoiles couronnent au soir son sommet ; elles tournent autour de l’atmosphère et ressemblent à des dinars d’or.
Souvent elles le caressent, au moyen de l’excédant de leurs boucles de cheveux, entraîné sur ses deux tempes.
Cette montagne n’a plus les dents de devant ; elle les a perdues par ses morsures sur les bois des temps passés, ou par le cours des siècles.
Elle est remplie d’expérience, a connu toutes les vicissitudes, les bonnes et les mauvaises ; elle les a poussées, comme les conducteurs des chameaux poussent ceux-ci, en chantant, les uns après les autres.
Sa marche est entravée, ses pensées se promènent dans ce qu’il y a d’étonnant en ses deux situations, celle du passé, celle du présent ou de l’avenir.
Pensive, elle fait silence et regarde en bas ; elle montre de la gravité et cache des mystères.
Comme si elle était attristée par l’asservissement où la tient la peur des deux menaces : de l’oppression et de l’abandon.
Que cette montagne mérite d’être, dès demain, en sûreté contre toute espèce de crainte, ou d’infortune, quand même toutes les autres montagnes de la terre devraient trembler sur leurs bases !
« Après cela l’auteur fait, dans son poème, l’éloge d’Abd-almoûmin, fils d’Aly. Or revenons, conclut Ibn Djozay, au récit du cheikh Abou ’Abdallah, ou Ibn Batoutah. »
De Gibraltar, je me rendis à la ville de Ronda, qui est une des localités de l’islamisme les mieux fortifiées et les plus heureusement situées. Son commandant était alors le cheikh Abou Arrabî’ Soleïman, fils de Daoud Al’ascary, son juge était le fils de mon oncle paternel, le jurisconsulte Abou’lkâcim Mohammed, fils de Iahia, fils de Bathoûthah. Je vis à Ronda le légiste, le juge, le littérateur Abou’l Haddjâdj Youçouf, fils de Mouça Almontéchâkary, qui me donna l’hospitalité dans sa maison ; j’y vis aussi son prédicateur, le pieux, le pèlerin, l’excellent Abou Ishâk Ibrahim, plus connu sous le nom de Chandéroukh, qui est mort plus tard à Salé, ville de l’Afrique occidentale ; je vis enfin à Ronda un bon nombre de gens dévots, parmi lesquels je citerai ’Abdallah Assaffâr.
Au bout de cinq jours, je quittai Ronda pour me diriger vers Marbelah, ou Marbella. La route entre ces deux villes est très raboteuse, très difficile, remplie d’obstacles. Marbella est une jolie petite ville, où les denrées alimentaires abondent. J’y trouvai une troupe de cavaliers qui partaient pour Malaga ; je voulais voyager en leur compagnie, mais le Dieu très haut me fit la grâce de me protéger ; ils partirent avant moi et furent faits prisonniers en chemin, comme nous le dirons tout à l’heure. Je me mis en route un peu après leur départ. Quand j’eus dépassé le district de Marbella et que je fus entré dans celui de Sohaïl, je vis un cheval mort dans un fossé, puis un panier de poissons, renversé par terre. Ces choses m’inquiétèrent ; or devant moi se trouvait la tour du surveillant, ce qui me fit dire, à part moi : « Si l’ennemi avait paru ici, le gardien de la tour l’aurait signalé, et aurait donné l’alarme. » Ensuite, j’entrai dans une maison, où je vis un cheval tué ; pendant que je m’y trouvais, j’entendis des cris derrière moi. J’avais devancé mes camarades, mais je rebroussai chemin et retournai vers eux. Ils étaient accompagnés par le commandant du fort de Sohaïl, qui m’apprit que quatre galères ennemies s’étaient montrées dans ces parages et qu’une partie des hommes qui les montaient étaient descendus à terre, au moment où le surveillant n’était pas dans la tour ; que les cavaliers sortant de Marbella, au nombre de douze, vinrent à passer devant les ennemis, ou les chrétiens, que ceux-ci en tuèrent un, qu’un autre se sauva en prenant la fuite, et que les dix restants furent faits captifs ; enfin, qu’un homme, pêcheur de profession, se trouvant avec lesdits cavaliers, fut tué. C’était celui dont j’avais vu le panier jeté à terre.
Ce commandant me conseillait de passer la nuit dans sa localité, d’où il me ferait ensuite parvenir à Malaga. Par conséquent, je dormis chez lui dans le château de la station des cavaliers, défenseurs de la frontière, station dite de Sohaïl. Les galères dont il a été parlé ci-dessus étaient à l’ancre près de cet endroit. Le commandant monta à cheval avec moi dès le lendemain, et nous arrivâmes à Malaga. C’est une des capitales de l’Espagne et l’une de ses plus belles cités ; elle réunit les avantages de la terre ferme à ceux de la mer ; elle renferme en grande abondance les denrées alimentaires et les fruits. J’ai vu dans ses marchés vendre les raisins au prix d’une petite drachme les huit livres. Ses grenades, appelées de Murcie et couleur de rubis, n’ont leurs pareilles dans aucun autre pays du monde. Quant aux figues et aux amandes, on les exporte de Malaga et de ses districts dans les contrées de l’Orient et de l’Occident.
Ibn Djozay dit : « C’est à cela que fait allusion le prédicateur Abou Mohammed ’Abdalouahhâb, fils d’Aly, de Malaga, dans les vers suivants, qui offrent (en arabe) un bel exemple d’allitération, ou jeu de mots, ou paronomase :
Salut, ô Malaga ; que de figues tu produis ! C’est à cause de toi que les navires en sont chargés.
Mon médecin m’avait défendu ton séjour, à raison d’une maladie ; mais mon médecin ne possède point l’équivalent de ma vie.
« Le juge de la réunion des fidèles, Abou ’Abdallah, fils d’Abdalmalic, a ajouté le distique ci-après, comme appendice à ces vers, en employant aussi la figure appelée paronomase :
Et Hims ! tu n’oublieras pas ses figues. Outre celles-ci, tu te souviendras bien de ses olives. »
On fabrique à Malaga la belle poterie, ou porcelaine dorée, que l’on exporte dans les contrées les plus éloignées. Sa mosquée est très vaste, célèbre pour sa sainteté, pourvue d’une cour sans pareille en beauté et contenant des orangers d’une grande hauteur. En entrant à Malaga, je trouvai son juge, le prédicateur excellent Abou ’Abdallah, fils de son excellent prédicateur Abou Dja’far, fils de son saint prédicateur Abou ’Abdallah Atthandjâly, assis dans la grande mosquée cathédrale. Il était entouré des jurisconsultes et des habitants les plus notables, qui rassemblaient de l’argent pour racheter les captifs dont nous avons parlé ci-dessus. Je dis au juge : « Louange à Dieu, qui m’a sauvé, et ne m’a point mis au nombre de ces prisonniers ! » Alors je l’informai de ce qui m’était arrivé après leur départ, et il en fut surpris. Ce juge m’envoya le repas de l’hospitalité (que Dieu ait pitié de lui !). Je reçus aussi le repas d’hospitalité du prédicateur de Malaga, Abou ’Abdallah Assâhily, nommé Almou’ ammam.
De Malaga je me rendis à Bellech, qui est à la distance de vingt-quatre milles. C’est une belle ville, ayant une jolie mosquée ; elle abonde en raisins, fruits et figues, à la manière de Malaga. Nous partîmes de Velez pour Alhammah, petite ville, avec une mosquée très heureusement située et fort bien bâtie. Elle possède une source d’eau chaude au bord de son fleuve, et à la distance d’environ un mille de la ville. On y voit une maison pour les bains des hommes et une autre pour ceux des femmes. Ensuite, je partis pour Grenade, la capitale de l’Andalousie et la nouvelle mariée d’entre ses villes. Ses environs n’ont pas leurs semblables dans tout l’univers ; ils constituent un espace de quarante milles, coupé par le célèbre Chennîl, et autres fleuves nombreux. Les jardins, les vergers, les prairies, ou les potagers, les châteaux et les vignobles entourent Grenade de tous côtés. Un de ses plus jolis endroits est celui qui est appelé la fontaine des Larmes : c’est une montagne où se voient des potagers et des jardins ; aucune autre ville n’en peut vanter la pareille.
Voici ce que dit Ibn Djozay : « Si je ne craignais pas d’être accusé de partialité pour ma patrie, je pourrais, puisque j’en trouve l’occasion, m’étendre beaucoup dans la description de Grenade. Cependant, une ville qui est si célèbre n’a pas besoin qu’on insiste longtemps sur son éloge. Que Dieu récompense notre cheikh Abou Becr Mohammed, fils d’Ahmed, fils de Chîrîn Albosty, et fixé à Grenade, lorsqu’il s’exprime en vers, dans ces termes :
Que Dieu garde Grenade, ce lieu de séjour qui réjouit l’homme triste, ou qui protège l’homme exilé ! Mon ami s’est déplu dans cette ville, lorsqu’il a vu ses prairies devenir souvent gelées par la neige. C’est le thaghr, dont les habitants sont aidés et secourus par Dieu. Or ce n’est pas le meilleur thaghr, celle qui n’est point fraîche. »
(On voit qu’il y a ici un jeu de mots car thagr signifie en même temps bouche, frontière, etc.).
Au temps où j’entrai dans cette ville, elle était gouvernée par le sultan Abou’l Haddjâdj Youçouf, fils du sultan Abou’l Oualîd Ismâ’îl, fils de Fardj, fils d’Ismâ’îl, fils de Youçouf, fils de Nasr. Je n’ai pu le voir à cause d’une maladie qui l’affligeait ; mais sa mère, la noble, la pieuse et la vertueuse, m’envoya des pièces d’or, qui me furent très utiles.
Je vis à Grenade plusieurs de ses savants, tels que : le juge de la communion des fidèles en cette ville, le noble, l’éloquent Aboul Kâcim Mohammed, fils d’Ahmed, fils de Mohammed, de la postérité de Hoçaïn, et originaire de Ceuta ; son jurisconsulte, le professeur, le savant prédicateur Abou ’Abdallah Mohammed, fils d’Ibrahim Albayyâny, ou de Baena ; son savant et son lecteur du Coran, ou professeur de lecture coranique, le prédicateur Abou Sa’id Fardj, fils de Kâcim, connu sous le nom d’Ibn Lobb ; le kadi de la réunion des fidèles, la rareté du temps, la merveille de l’époque, Abou’l Baracât Mohammed, fils de Mohammed, fils d’Ibrahim Assalémy Albala’ba’y. Ce dernier venait d’arriver à Grenade, étant parti d’Almeriyyah. Je me trouvai avec lui et fis sa connaissance dans le jardin du légiste Abou’l Kâcim Mohammed, fils du légiste et illustre secrétaire Abou ’Abdallah, fils d’Assim, où nous restâmes deux jours et une nuit.
Ibn Djozay ajoute ce qui suit : « J’étais avec eux dans ce jardin, où le cheikh Abou ’Abdallah nous a réjouis par le récit de ses voyages. Dans cette occasion, j’écrivis exactement les noms des personnages illustres qu’il avait vus pendant ses pérégrinations, et nous profitâmes de plus d’une manière de ce qu’il nous a dit d’admirable. Un bon nombre de notables de la ville de Grenade se trouvaient en notre compagnie ; parmi eux était l’excellent poète, l’individu extraordinaire, Abou Djafar Ahmed, fils de Rodhouân, fils d’Abdal’azhîm, de la tribu de Djodhâm. L’histoire de ce jeune homme est merveilleuse, car il a été élevé dans le désert, sans étudier la science, sans fréquenter les savants, ni les hommes lettrés. Pourtant, il s’est ensuite fait connaître par des poésies magnifiques, telles qu’en composent rarement les principaux d’entre les hommes éloquents et les chefs des littérateurs. En voici un exemple :
O vous qui avez choisi mon cœur pour domicile, sa porte c’est l’œil qui le regarde.
Mon insomnie après votre absence a tenu ouverte cette porte. Or envoyez vos spectres avec le sommeil pour la fermer.
Je visitai encore à Grenade le cheikh des cheikhs, supérieur des soufis, ou religieux contemplatifs dans cette ville, le jurisconsulte Abou ’Aly ’Omar, fils du cheikh pieux et saint Abou ’Abdallah Mohammed, fils d’Almahroûk. Je restai quelques jours dans son ermitage, situé au-dehors de Grenade, et il m’honora excessivement. Puis j’allai en sa compagnie visiter la zaouïa célèbre, vénérée du public et appelée Râbithat Al’okâb ou la station de l’Okâb (aigle noir, etc.). ’Okâb est le nom d’une montagne qui domine l’extérieur de Grenade et qui est à la distance d’environ huit milles de cette cité ; elle est tout près de la ville de Tîrah, qui est maintenant déserte et ruinée. Je vis également le fils du frère dudit supérieur des soufis, le jurisconsulte Abou’l Haçan ’Aly, fils d’Ahmed, fils d’Almahroûk, dans son ermitage appelé l’ermitage du Lidjâm, ou de la Bride. Il est situé dans le haut du faubourg de Nedjed, hors de Grenade, et qui est adjacent à la montagne d’Assabîcah, ou du Lingot. Ce personnage est le cheikh, ou supérieur des fakirs, qui sont petits marchands, ou colporteurs.
Il y a dans Grenade un certain nombre de fakirs étrangers, qui s’y sont domiciliés, à cause de sa ressemblance avec leur pays. Je nommerai parmi eux : le pèlerin Abou ’Abdallah, de Samarkand ; le pèlerin Ahmed, de Tibrîz ; le pèlerin Ibrahim, de Kounia ; le pèlerin Hoçaïn, du Khoraçan ; les deux pèlerins Aly et Rachid, de l’Inde.
De Grenade, je retournai à Alhama, à Velez et à Malaga ; puis je me dirigeai vers le château de Dhacouân, qui est beau, abondant en eaux, en arbres, et en fruits.
De là j’allai à Ronda, puis au bourg des Bènou Riyâh, où je logeai chez son chef, Abou’l Haçan ’Aly, fils de Soleïman Arriyâhy. C’est un des hommes les plus généreux et un des notables les plus éminents ; il donne à manger à tous les voyageurs, et il me traita d’une façon très hospitalière.
Étant retourné à Gibraltar, je m’embarquai sur le même navire qui m’y avait transporté, et qui appartient, ainsi que je l’ai dit, aux armateurs d’Arzille. J’arrivai à Ceuta, dont le commandant était alors le cheikh Abou Mahdy ’Iça, fils de Soleïman, fils de Mansour ; son juge était le jurisconsulte Abou Mohammed Azzédjendery.
De Ceuta, je me rendis à Arzille, où je résidai quelques mois ; puis j’allai à Salé, d’où je partis, et arrivai ensuite à la ville de Maroc.
C’est là une des plus belle cités que l’on connaisse ; elle est vaste, occupe un immense territoire, et abonde en toutes sortes de biens. On y voit des mosquées magnifiques, telles que sa mosquée principale, appelée la mosquée des Libraires. On y voit aussi une tour extrêmement élevée et admirable ; j’y suis monté, et j’ai aperçu de ce point la totalité de la ville. Malheureusement, cette dernière est en grande partie ruinée, et je ne puis la comparer qu’à Bagdad sous ce rapport ; mais à Bagdad les marchés sont plus jolis. Maroc possède le collège merveilleux qui se distingue par la beauté de son emplacement et la solidité de sa construction. Il a été bâti par notre maître, le commandant des fidèles, Abou’l Haçan. (Que Dieu soit satisfait de lui !)
Ibn Djozay dit : « Voici sur Maroc des vers de son kadi, l’imâm historien Abou ’Abdallah Mohammed, fils d’Abdalmalic, de la tribu d’Aous :
Que Dieu protège l’illustre ville de Maroc ! Qu’ils sont admirables ses habitants, les nobles seigneurs !
Si un homme dont la patrie est éloignée, si un étranger vient à descendre dans cette cité, ils lui font, par leur familiarité, bientôt oublier l’absence de sa famille et de son pays.
Des choses que l’on entend au sujet de Maroc ou de celles que l’on y voit naît l’envie entre l’œil et entre l’oreille.
Je partis de Maroc en compagnie de l’étrier illustre (la personne du sultan, Abou ’Inân), l’étrier de notre maître (que Dieu le favorise !), et nous arrivâmes à la ville de Salé, puis à celle de Micnâçah, l’admirable, la verdoyante, la florissante, celle qui est entourée de tous côtés de vergers, de jardins et de plantations d’oliviers. Ensuite nous entrâmes dans la capitale, Fez (que le Dieu très haut la garde !), où je pris congé de notre maître (que Dieu l’aide !), et je partis pour voyager dans le Soudan, ou pays des nègres. Or j’arrivai à la ville de Sidjilmâçah, une des cités les plus jolies. On y trouve des dattes en grande quantité et fort bonnes. La ville de Basrah lui ressemble sous le rapport de l’abondance des dattes ; mais celles de Segelmessa sont meilleures. Elle en fournit surtout une espèce appelée îrâr, qui n’a pas sa pareille dans tout l’univers. Je logeai, à Segelmessa, chez le jurisconsulte Abou Mohammed Albochry, dont j’avais vu le frère dans la ville de Kandjenfoû, en Chine. Que ces deux frères étaient éloignés l’un de l’autre ! Mon hôte me traita de la manière la plus distinguée. J’achetai, dans Segelmessa, des chameaux, auxquels je donnai du fourrage pendant quatre mois.
Au commencement du mois divin de moharram de l’année 753 de l’hégire (18 février 1352 de J. C.), je me mis en route avec une compagnie ou caravane dont le chef était Abou Mohammed Yandécân Almessoûfy (que Dieu ait pitié de lui !). Elle renfermait beaucoup de marchands de Segelmessa et d’autres pays. Après avoir voyagé vingt-cinq jours, nous arrivâmes à Taghâza, qui est un bourg sans culture et offrant peu de ressources. Une des choses curieuses que l’on y remarque, c’est que ses maisons et sa mosquée sont bâties avec des pierres de sel, ou du sel gemme ; leurs toits sont faits avec des peaux de chameaux. Il n’y a ici aucun arbre ; le terrain n’est que du sable, où se trouve une mine de sel. On creuse dans le sol, et l’on découvre de grandes tables de sel gemme, placées l’une sur l’autre, comme si on les eût taillées et puis déposées par couches sous terre. Un chameau ne peut porter ordinairement que deux de ces tables ou dalles épaisses de sel.
Taghâza est habité uniquement par les esclaves des Messoûfites, esclaves qui s’occupent de l’extraction du sel ; ils vivent de dattes qu’on apporte de Dar’al et de Segelmessa, de chairs de chameau et de l’anli, sorte de millet importé de la contrée des nègres. Ces derniers arrivent ici de leurs pays et ils en emportent le sel. Une charge de chameau de ce minéral se vend, à Îouâlâten, de huit à dix mithkâls, ou dinars d’or ; à la ville de Mâlli, elle vaut de vingt à trente dinars, et quelquefois même quarante. Les nègres emploient le sel pour monnaie, comme on fait ailleurs de l’or et de l’argent ; ils coupent le sel en morceaux, et trafiquent avec ceux-ci. Malgré le peu d’importance qu’a le bourg de Taghâza, on y fait le commerce d’un très grand nombre de quintaux, ou talents d’or natif, ou de poudre d’or.
Nous passâmes à Taghâza dix jours dans les souffrances et dans la gêne ; car l’eau en est saumâtre, et nul autre endroit n’a autant de mouches que ce bourg. C’est pourtant de Taghâza qu’on emporte la provision d’eau pour pénétrer dans le désert qui vient après ce lieu, et qui est de dix jours de marche, et où l’on ne trouve point d’eau, si ce n’est bien rarement. Nous eûmes néanmoins le bonheur de rencontrer en ce désert beaucoup d’eau, dans des étangs que les pluies y avaient laissés. Un jour, nous aperçûmes un étang entre deux collines de pierres ou de roche, et dont l’eau était douce et bonne. Nous nous y désaltérâmes et y lavâmes nos hardes. Il y a une grande quantité de truffes dans ce désert ; il y a aussi des poux en grand nombre : c’est au point que les voyageurs sont obligés de porter au cou des fils contenant du mercure, qui tue cette vermine.
Dans les commencements de notre marche à travers ce désert, nous avions l’habitude de devancer la caravane ; et lorsque nous trouvions un lieu convenable pour le pâturage, nous y faisions paître nos bêtes de somme. Nous ne cessâmes d’agir ainsi, jusqu’à ce que l’un de nos voyageurs, nommé Ibn Zîry, se fût perdu dans le désert. Depuis ce moment, je n’osai plus ni précéder la caravane ni rester en arrière. Cet Ibn Zîry avait eu une dispute avec le fils de son oncle maternel, le nommé Ibn ’Ady, et ils s’étaient dit réciproquement des injures : c’est pour cela qu’Ibn Zîry s’écarta de la caravane et s’égara. Lorsque celle-ci fit halte, personne ne sut où était Ibn Zîry ; je conseillai à son cousin de louer un Messoûfite, qui chercherait ses traces et qui peut-être le rencontrerait. Ibn ’Ady ne le voulut pas ; mais, le lendemain, un Messoûfite consentit, de bon gré, et sans exiger de salaire, à aller à la recherche de l’homme qui manquait. Il reconnut les vestiges de ses pas, qui tantôt suivaient la grande route, et tantôt en sortaient ; cependant, il ne put point retrouver Ibn Zîry lui-même, ni avoir de ses nouvelles. Nous venions de rencontrer une caravane sur notre chemin, laquelle nous apprit que quelques-uns de leurs compagnons s’étaient séparés d’eux. En effet, nous en trouvâmes un mort sous un arbrisseau d’entre les arbres qui croissent dans le sable du désert. Ce voyageur portait ses habits sur lui, tenait un fouet à la main, et l’eau n’était plus qu’à la distance d’un mille lorsqu’il avait succombé.
Nous arrivâmes à Tâçarahlâ, lieu de dépôts, ou amas souterrains d’eaux pluviales ; les caravanes descendent dans cet endroit et y demeurent pendant trois jours. Les voyageurs prennent un peu de repos ; ils raccommodent leurs outres, les remplissent d’eau, et y cousent tout autour des tapis grossiers (cf. Dozy, Dictionn. détaillé), par crainte des vents ou de l’évaporation. C’est de ce lieu que l’on expédie le takchîf ou (le messager de) la découverte.
C’est là le nom que l’on donne à tout individu des Messoûfah que la caravane paye pour la précéder à Îouâlâten. Il prend les lettres que les voyageurs écrivent à leurs connaissances ou à leurs amis de cette ville, afin qu’ils leur louent des maisons, et qu’ils viennent à leur rencontre avec de l’eau, à la distance de quatre jours de marche. Celui qui n’a pas d’amis à Îouâlâten adresse sa missive à un négociant de cette place connu par sa bienfaisance, lequel ne manque pas de faire pour cette personne comme pour les autres de sa connaissance. Souvent il arrive que le takchîf, ou messager, périt dans ce désert ; alors les habitants d’Îouâlâten n’ont aucun avis de la caravane, qui succombe tout entière ou en grande partie. Cette vaste plaine est hantée par beaucoup de démons ; si le messager est seul, ils jouent avec lui, le fascinent, de sorte qu’il s’écarte de son but et meurt. En effet, il n’y a dans ce désert aucun chemin apparent, aucune trace visible ; ce ne sont que des sables que le vent emporte. On voit quelquefois des montagnes de sable dans un endroit, et peu après elles sont transportées dans un autre lieu.
Le guide dans cette plaine déserte est celui qui y est allé et en est revenu plusieurs fois, et qui est doué d’une tête très intelligente. Une des choses étonnantes que j’ai vues, c’est que notre conducteur avait un œil perdu, le second malade, et, malgré cela, il connaissait le chemin mieux qu’aucun autre mortel. Le messager que nous louâmes dans ce voyage nous coûta cent ducats d’or ; c’était un homme de la peuplade des Messoûfah. Au soir du septième jour après son départ, nous vîmes les feux des gens qui étaient sortis vers nous, et cela nous réjouit extrêmement.
Cette plaine est belle, brillante ; la poitrine s’y dilate, l’âme s’y trouve à l’aise, et les voleurs n’y sont pas à craindre. Elle renferme beaucoup de bœufs sauvages, au point que souvent on voit une troupe de ceux-ci s’approcher assez de la caravane pour qu’on puisse les chasser avec les chiens et les flèches. Cependant, leur chair engendre la soif chez les gens qui la mangent ; et c’est pour cette raison que bien des personnes s’abstiennent d’en faire usage. Une chose curieuse, c’est que, quand on tue ces animaux, on trouve de l’eau dans leurs ventricules. J’ai vu des Messoûfites presser un de ces viscères, et boire l’eau qu’il contenait. Il y a aussi dans ce désert une grande quantité de serpents.
Nous avions dans notre caravane un marchand de Tilimsân, appelé Zeyyân le Pèlerin, qui avait l’habitude de saisir les serpents et de jouer avec ces reptiles ; je lui avais dit de ne pas le faire, et il continua. Un certain jour, il mit sa main dans le trou d’un lézard, pour le faire sortir ; mais, en place, il trouva un serpent qu’il prit dans sa main. Il voulut alors monter à cheval, et le serpent lui mordit le doigt indicateur de la main droite, ce qui lui causa une douleur considérable. On lui cautérisa la plaie avec un fer rouge, et le soir sa douleur s’augmenta ; elle devint atroce. Notre patient égorgea un chameau ; il introduisit sa main droite dans l’estomac de l’animal, et l’y laissa toute la nuit. Les parties molles du doigt malade tombèrent par fragments, et il coupa par sa base le doigt tout entier. Les Messoûfites nous dirent que ce reptile avait certainement bu de l’eau un peu avant de piquer le marchand ; car, sans cela, sa blessure aurait été mortelle.
Quand les personnes qui venaient à notre rencontre avec de l’eau nous eurent rejoints, nous donnâmes à boire à nos chevaux, puis nous entrâmes dans un désert énormément chaud, et bien différent de celui auquel nous avions été habitués jusqu’alors. Nous nous mettions en marche après la prière de l’après-midi ; nous voyagions pendant toute la nuit, et faisions halte au matin. Des hommes de la tribu des Messoûfah, de celle des Berdâmah, etc., venaient vendre des charges d’eau. Nous arrivâmes ainsi à la ville d’Îouâlâten juste au commencement du mois de rabî’ premier, ayant voyagé deux mois pleins, depuis Segelmessa. Îouâlâten est le premier endroit du pays des nègres ; et le lieutenant du sultan, dans cette ville, était Ferbâ Hoçain : ce mot ferbâ signifie vice-roi, lieutenant.
A notre arrivée à Îouâlâten, les négociants déposèrent leurs marchandises sur une vaste place, et chargèrent les nègres de les garder. Ils se rendirent chez le ferbâ, qui était assis sur un tapis et abrité par une espèce de toit. Ses gardes étaient devant lui, ayant à la main des lances et des arcs ; les grands des Messoûfites se tenaient derrière le ferbâ. Les négociants se placèrent debout en face de celui-ci, qui leur parla par l’intermédiaire d’un interprète, bien qu’ils fussent tout près de lui, et uniquement par suite de son mépris pour eux. Ce fut alors que je regrettai de m’être rendu dans le pays des nègres, à cause de leur mauvaise éducation et du peu d’égards qu’ils ont pour les hommes blancs. Je m’en allai chez Ibn Beddâ, personnage distingué de la ville de Salé, auquel j’avais écrit de me louer une maison, ce qu’il fit.
Plus tard, le mochrif d’Îouâlâten, le nommé Menchâ Djoû, invita tous ceux qui étaient arrivés dans la caravane à un repas d’hospitalité qu’il leur offrait. Je refusai d’abord de paraître à ce festin ; mais mes camarades m’en prièrent, et ils insistèrent tellement que je m’y rendis avec les autres convives. On servit le repas, qui consistait en millet concassé, mélangé avec un peu de miel et de lait aigre. Tout ceci était mis dans une moitié de courge ou calebasse, à laquelle on avait donné la forme d’une grande écuelle, ou d’une sébile ; les assistants burent donc, et se retirèrent. Je leur dis : « Est-ce pour cela que le Noir nous a invités ? » Ils répondirent : « Oui ; et ce qu’il nous a donné est considéré par les nègres comme le repas d’hospitalité le plus beau. » Je reconnus ainsi avec certitude qu’il n’y avait rien de bon à espérer de ce peuple, et je désirai un moment de m’en retourner presque tout de suite avec les pèlerins qui partent d’Îouâlâten ; puis je me décidai à aller voir la résidence du roi des nègres.
Mon séjour à Îouâlâten a été d’environ sept semaines, pendant lesquelles les habitants m’honorèrent et me donnèrent des festins. Parmi mes hôtes, je nommerai : le juge de la ville, Mohammed, fils d’Abd Allah, fils de Yénoûmer, et son frère, le jurisconsulte et professeur Iahia.
La chaleur est excessive à Îouâlâten ; il y a dans cette ville quelques petits palmiers, à l’ombre desquels on sème des melons et des pastèques. L’eau se tire de ces amas d’eaux de pluie qui se forment sous le sable. La viande de brebis y est abondante. Les vêtements des habitants sont jolis et importés d’Égypte. La plus grande partie de la population appartient à la tribu des Messoûfah. Les femmes y sont très belles ; elles ont plus de mérite et sont plus considérées que les hommes.
Des Messoûfites qui demeurent à Îouâlâten
La condition de ce peuple est étonnante, et ses mœurs sont bizarres. Quant aux hommes, ils ne sont nullement jaloux de leurs épouses ; aucun d’eux ne se nomme d’après son père ; mais chacun rattache sa généalogie à son oncle maternel. L’héritage est recueilli par les fils de la sœur du décédé, à l’exclusion de ses propres enfants. Je n’ai vu pratiquer cette dernière chose dans aucun autre pays du monde, si ce n’est chez les Indiens infidèles de la contrée du Malabar. Cependant, ces Messoûfites sont musulmans ; ils font avec exactitude les prières prescrites par la loi religieuse, étudient la jurisprudence, la théologie, et apprennent le Coran par cœur. Les femmes des Messoûfites n’éprouvent nul sentiment de pudeur en présence des hommes et ne se voilent pas le visage ; malgré cela, elles ne manquent point d’accomplir ponctuellement les prières. Quiconque veut les épouser le peut sans difficulté ; mais ces femmes messoûfites ne voyagent pas avec leur mari ; si même l’une d’elles y consentait, sa famille l’en empêcherait. Dans ce pays, les femmes ont des amis et des camarades pris parmi les hommes étrangers ou non parents. Les hommes, de leur côté, ont des compagnes qu’ils prennent parmi les femmes étrangères à leur famille. Il arrive souvent qu’un individu entre chez lui et qu’il trouve sa femme avec son compagnon ; il ne désapprouve pas cette conduite, et ne s’en formalise pas.
J’entrai un jour chez le juge d’Îouâlâten, après qu’il m’en eut donné la permission, et, trouvai avec lui une femme très jeune, admirablement belle. Alors je doutai, j’hésitai et désirai retourner sur mes pas ; mais elle se mit à rire de mon embarras, bien loin de rougir de honte. Le juge me dit : « Pourquoi t’en irais-tu ? Celle-ci est mon amie. » Je m’étonnai de la conduite de ces deux personnes. Pourtant cet homme est un légiste, un pèlerin ; j’ai même su qu’il avait demandé au sultan la permission de faire cette année-là le pèlerinage de La Mecque en compagnie de son amie. Est-ce celle-ci ou une autre ? Je l’ignore ; mais le souverain ne l’a pas voulu, et il a répondu par la négative.
Anecdote analogue à la précédente
Je me rendis une fois chez Abou Mohammed Yandecân le Messoûfite, celui-là même en compagnie duquel nous étions arrivés à Îouâlâten. Il était assis sur un tapis, tandis qu’au milieu de la maison il y avait un lit de repos, surmonté d’un dais, sur lequel était sa femme, en conversation avec un homme assis à son côté. Je dis à Abou Mohammed : « Qui est cette femme ? — C’est mon épouse, répondit-il. — L’individu qui est avec elle, que lui est-il ? — C’est son ami. — Est-ce que tu es content d’une telle chose, toi qui as habité nos pays, et qui connais les préceptes de la loi divine ? — La société des femmes avec les hommes, dans cette contrée, a lieu pour le bien et d’une façon convenable, ou en tout bien et en tout honneur : elle n’inspire aucun soupçon. Nos femmes, d’ailleurs, ne sont point comme celles de vos pays. » Je fus surpris de sa sottise ; je partis de chez lui, et n’y retournai plus jamais. Depuis lors, il m’invita, à plusieurs reprises, à l’aller voir, mais je m’en abstins constamment.
Lorsque je fus décidé à entreprendre le voyage de Mâlli, ville qui est à la distance de vingt-quatre jours de marche d’Îouâlâten pour celui qui voyage avec célérité, je louai un guide de la tribu de Messoûfah. Il n’y a, en effet, nul besoin de voyager en nombreuse compagnie sur ce chemin, car il est très sûr. Je me mis en route avec trois de mes compagnons ; et tout le long du chemin nous trouvâmes de gros arbres séculaires. Un seul suffit pour donner de l’ombre à toute une caravane. Il y en a qui n’ont ni branches ni feuilles, et, malgré cela, leur tronc ombrage un homme à merveille. Quelques-uns de ces arbres ont souffert une carie à l’intérieur, par suite de laquelle l’eau de pluie s’est amassée dans leur creux, et a formé comme un puits, dont l’eau est bue par les passants. Dans d’autres, la cavité est occupée par des abeilles et du miel ; les hommes recueillent alors ce dernier. Une fois je passai devant un de ces arbres cariés, et je vis dans son intérieur un tisserand ; il avait dressé là son métier, et il tissait : j’en fus bien surpris.
Ibn Djozay ajoute ceci : « Il y a en Andalousie deux arbres du genre des châtaigniers, dans le creux de chacun desquels se voit un tisserand qui fabrique des étoffes. Un de ces arbres se trouve au bas du mont, près de Guadix, et l’autre dans la montagne Alpuxarras, près de Grenade. »
Parmi les arbres de cette sorte de forêt qui se trouve entre Îouâlâten et Mâlli, il y en a dont les fruits ressemblent aux prunes, aux pommes, aux pêches et aux abricots ; mais ils sont d’un autre genre. Il y a aussi des arbres qui donnent un fruit de la forme d’un concombre long ; lorsqu’il est bon ou mûr, il se fend et met à découvert une substance ayant l’aspect de la farine ; on la fait cuire, on la mange, et l’on en vend également dans les marchés. Les indigènes tirent de dessous ce sol des graines qui ont l’apparence de fèves ; ils les font frire, les mangent, et leur saveur est comme celle des pois chiches frits. Quelquefois, ils font moudre ces graines pour en fabriquer une espèce de gâteau rond spongieux, ou beignet, qu’ils font frire avec le gharti ; on appelle ainsi un fruit pareil à la prune, lequel est très sucré, mais nuisible aux hommes blancs qui en mangent. On broie ses noyaux, et l’on en extrait de l’huile, qui sert aux gens de ce pays à plusieurs usages. Tels sont, entre autres d’être employée pour la cuisine ; de fournir à l’éclairage dans les lampes ; d’être utile pour la friture du gâteau ou beignet dont il a été parlé ci-dessus ; de servir à leurs onctions du corps ; d’être employée, après son mélange avec une terre qui se trouve dans cette contrée, à enduire les maisons, comme on le fait ailleurs au moyen de la chaux.
Cette huile est très abondante chez les nègres, et elle est facile à obtenir. On la transporte de ville en ville, dans de grandes courges ou calebasses, de la contenance des jarres de nos contrées. Les courges atteignent, dans le Soûdân, une grosseur énorme, et c’est avec elles que les habitants font leurs grandes écuelles (et, en général, leur vaisselle). Ils coupent chaque courge en deux moitiés et en tirent deux écuelles, qu’ils ornent de jolies sculptures. Quand un nègre voyage, il se fait suivre par ses esclaves des deux sexes, qui portent, outre ses lits, les ustensiles pour manger et pour boire, lesquels sont fabriqués avec des courges.
Le voyageur, dans ces contrées, n’a pas besoin de se charger de provisions de bouche, de mets, de ducats, ni de drachmes ; il doit porter avec lui des morceaux de sel gemme, des ornements ou colifichets de verre, que l’on appelle nazhms, et quelques substances aromatiques. Parmi ces dernières, les indigènes préfèrent le girofle, la résine-mastic et le tâçarghant ; celui-ci est leur principal parfum. Lorsque le voyageur arrive dans un village, les négresses sortent avec du millet, du lait aigre, des poulets, de la farine de lotus (ou rhamnus nabeca), du riz, du foûni, qui ressemble aux graines de moutarde, et avec lequel on prépare le coscoçoû, ainsi qu’une sorte de bouillie épaisse, enfin de la farine de haricots. Le voyageur peut leur acheter ce qu’il désire d’entre toutes ces choses. Il faut pourtant remarquer que le riz est nuisible aux Blancs qui en font usage ; le foûni est meilleur.
Après avoir voyagé dix jours depuis Îouâlâten, nous arrivâmes au village de Zâghari, qui est grand, et habité par des commerçants noirs nommés Ouandjarâtah. Il y a aussi un certain nombre d’hommes blancs qui appartiennent à la secte des schismatiques et hérétiques dits ibâdhites ; ils sont appelés Saghanaghoû. Les orthodoxes mâlikites, parmi les Blancs, y sont nommés toûri. C’est de ce village que l’on importe à Îouâlâten l’anli ou millet.
Nous partîmes de Zâghari et arrivâmes au grand fleuve, qui est le Nil ou Niger, dans le voisinage duquel se trouve la ville de Cârsakhoû. Ce fleuve descend d’ici à Câbarah, puis à Zâghah : ces deux dernières localités ont deux sultans, qui font acte de soumission au roi de Mâlli. Les habitants de Zâghah ont adopté l’islamisme depuis très longtemps ; ils ont une grande piété et beaucoup de zèle pour l’étude de la science.
De Zâghah, le Nil descend à Tonboctoû et à Caoucaou, villes que nous mentionnerons plus tard ; ensuite à Moûli, lieu qui fait partie du pays des Lîmiyyoûn et qui est le dernier district de Mâlli.
Le fleuve descend de Moûli à Yoûfi, un des pays les plus considérables du Soûdân, et dont le souverain est un des plus grands rois de la contrée. Aucun homme blanc n’entre à Yoûfi ; car les nègres le tueraient avant qu’il y arrivât.
Le Nil pénètre dans le pays des Nubiens, lesquels professent la religion chrétienne ; ensuite, il arrive à Donkolah, leur ville principale. Le sultan de cette cité, appelé Ibn Kenz eddîn, s’est fait musulman du temps du roi Nâcir.
Le fleuve descend encore à Djénâdil (les cataractes du Nil); c’est là la fin de la contrée des nègres et le commencement du district d’Oçouân (Assouan ou Syène), dans la haute Égypte.
Je vis à Cârsakhoû, dans cet endroit du Nil ou Niger, et près du rivage, un crocodile ressemblant à une petite barque. Un jour, étant descendu vers le Nil pour satisfaire un besoin, voici qu’un nègre arrive et se tient debout entre moi et le fleuve. Je fus surpris de sa mauvaise éducation, du peu de pudeur qu’il montrait, et je racontai cela à quelqu’un qui me dit : « Il n’a fait cette chose que par crainte que le crocodile ne t’attaquât ; il s’est ainsi placé entre toi et l’animal amphibie. »
Nous quittâmes Cârsakhoû et voyageâmes vers la rivière Sansarah, qui est à environ dix milles de Mâlli. Il est d’usage que l’on défende l’entrée de cette ville à quiconque n’en a pas obtenu d’avance la permission. J’avais déjà écrit à la communauté des hommes blancs à Mâlli, dont les chefs sont Mohammed, fils d’Alfakîh Aldjozoûly, et Chams eddîn, fils d’Annakouîch Almisry, afin qu’ils y louassent une habitation pour moi. Quand je fus arrivé à ladite rivière, je la traversai dans le bac, et personne ne s’y opposa.
Arrivé à Mâlli, capitale du roi des nègres, je descendis près du cimetière de cette ville, et de là je me rendis dans le quartier occupé par les hommes blancs. J’allai trouver Mohammed, fils d’Alfakîh ; j’appris qu’il avait loué pour moi une maison en face de la sienne, et j’y entrai sans retard. Son gendre ou allié, le jurisconsulte, le lecteur du Coran, le nommé Abdalouâhid, vint me rendre visite, et m’apporta une bougie et des aliments. Le lendemain, le fils d’Alfakîh (Mohammed) vint me trouver, ainsi que Chams eddîn, fils d’Annakouîch, et ’Aly Azzoûdy, de Maroc. Ce dernier est un étudiant ou un homme de lettres. Je vis le juge de Mâlli, ’Abdarrahmân, qui vint chez moi ; c’est un nègre, un pèlerin, un homme de mérite et orné de nobles qualités ; il m’envoya une vache pour son repas d’hospitalité. Je vis aussi le drogman Doûghâ, un des hommes distingués parmi les nègres, et un de leurs principaux personnages ; il me fit tenir un bœuf. Le jurisconsulte ’Abd Alouâhid me fit présent de deux grands sacs de foûni et d’une gourde remplie de gharti ; le fils d’Alfakîh me donna du riz et du foûni ; Chams eddîn m’envoya aussi un festin d’hospitalité. En somme, ils me fournirent tout ce qui m’était nécessaire, et de la façon la plus parfaite. Que Dieu les récompense pour leurs belles actions ! Le fils d’Alfakîh était marié avec la fille de l’oncle paternel du sultan, et elle prenait soin de nous, en nous fournissant des vivres et autres choses.
Dix jours après notre arrivée à Mâlli, nous mangeâmes un potage, ou bouillie épaisse, préparé avec une herbe ressemblant à la colocasie, et appelée kâfi ; un tel potage est préféré par ce peuple à tous les autres mets. Or, le jour suivant, nous étions tous malades, au nombre de six, et l’un de nous mourut. Pour ma part, je me rendis à la prière du matin, et je perdis connaissance pendant qu’on la faisait. Je demandai à un Égyptien un remède évacuant, et il m’apporta une substance nommée beïder. Ce sont des racines végétales (pulvérisées) qu’il mélangea avec de l’anis et du sucre, après quoi il versa le tout dans l’eau et l’agita. Je bus ce médicament, et je vomis ce que j’avais mangé, conjointement avec beaucoup de bile jaune. Dieu me préserva de la mort, mais je fus malade l’espace de deux mois.
Le souverain de Mâlli, c’est Mensa Soleïman ; mensa signifie sultan, et Soleïman est son nom propre. C’est un prince avare, et il n’y a point à espérer de lui un présent considérable. Il arriva que je restai tout ce temps à Mâlli sans le voir, à cause de ma maladie. Plus tard il prépara un banquet de condoléance, à l’occasion de la mort de notre maître Abou’l Haçan (que Dieu soit satisfait de lui !). Il y invita les commandants, les jurisconsultes, le juge et le prédicateur ; j’y allai en leur compagnie. On apporta les coffrets renfermant les cahiers du Coran, et on lut ce livre en entier. On fit des vœux pour notre maître Abou’l Haçan (que Dieu ait pitié de lui !) ; on fit aussi des vœux pour Mensa Soleïman. Après cela je m’avançai et saluai ce dernier ; le juge, le prédicateur et le fils d’Alfakîh lui apprirent qui j’étais. Il leur répondit dans leur langage, et ils me dirent : « Le sultan t’invite à remercier Dieu. » Alors je dis : « Louons Dieu et rendons-lui grâces dans toutes les circonstances ! »
Du vil cadeau d’hospitalité de ces gens, et du grand cas qu’ils en faisaient
Lorsque je me fus retiré, après la cérémonie que je viens de raconter, on m’envoya le don de l’hospitalité. D’abord on le fit porter à la maison du juge, qui l’expédia, par l’entremise de ses employés, chez le fils d’Alfakîh. Celui-ci sortit alors à la hâte et nu-pieds de sa demeure, il entra chez moi et dit : « Lève-toi, voici que je t’apporte les biens ou les étoffes (komâch) du sultan, ainsi que son cadeau. » Je me levai, pensant que c’étaient des vêtements d’honneur et des sommes d’argent ; mais je ne vis autre chose que trois pains ronds, un morceau de viande de bœuf frit dans le gharti et une gourde contenant du lait caillé. Or je me mis à rire, et je ne pus m’empêcher de m’étonner beaucoup de la pauvreté d’esprit, de la faiblesse d’intelligence de ces individus, et de l’honneur qu’ils faisaient à un présent aussi méprisable.
Des paroles que j’adressai plus tard au sultan et du bien qu’il me fit
Après avoir reçu le don susmentionné, je restai deux mois sans que le sultan m’envoyât la moindre chose. Nous entrâmes ainsi dans le mois de ramadhan ; dans l’intervalle, j’étais allé souvent dans le lieu du conseil ou des audiences, j’avais salué le souverain, je m’étais assis en compagnie du juge et du prédicateur. Ayant causé avec le drogman Doûghâ, il me dit : « Adresse la parole au sultan, et moi j’expliquerai ce qu’il faudra. » Le souverain tint séance dans les premiers jours du mois de ramadhan, je me levai en sa présence et lui dis : « Certes j’ai voyagé dans les différentes contrées du monde ; j’en ai connu les rois ; or je suis dans ton pays depuis quatre mois, et tu ne m’as point traité comme un hôte ; tu ne m’as rien donné. Que pourrai-je dire de toi aux autres sultans ? » Il fit : « Je ne t’ai jamais vu ni connu ! » Le juge et le fils d’Alfakîh se levèrent ; ils lui répondirent en disant : « Il t’a déjà salué, et tu lui as envoyé des aliments. » Alors il ordonna de me loger dans une maison, et de me fournir la dépense journalière. La vingt-septième nuit du mois de ramadhan, il distribua au juge, au prédicateur et aux jurisconsultes une somme d’argent appelée zécâh ou aumône ; il me donna à cette occasion trente-trois ducats et un tiers. Au moment de mon départ, il me fit cadeau de cent ducats d’or.
Des séances que le sultan tient dans sa coupole
Le sultan a une coupole élevée dont la porte se trouve à l’intérieur de son palais, et où il s’assied fréquemment. Elle est pourvue, du côté du lieu des audiences, de trois fenêtres voûtées en bois, recouvertes de plaques d’argent, et au-dessous de celles-ci, de trois autres, garnies de lames d’or, ou bien de vermeil. Ces fenêtres ont des rideaux en laine, qu’on lève le jour de la séance du sultan dans la coupole : on connaît ainsi que le souverain doit venir en cet endroit. Quand il y est assis, on fait sortir du grillage de l’une des croisées un cordon de soie auquel est attaché un mouchoir à raies, fabriqué en Égypte ; ce que le public voyant, on bat des tambours et l’on joue des cors.
De la porte du château sortent environ trois cents esclaves, ayant à la main, les uns des arcs, les autres de petites lances et des boucliers. Ceux-ci se tiennent debout, à droite et à gauche du lieu des audiences ; ceux-là s’asseyent de la même manière. On amène deux chevaux sellés, bridés, et accompagnés de deux béliers. Ces gens prétendent que les derniers sont utiles contre le mauvais œil. Dès que le sultan a pris place, trois de ses esclaves sortent à la hâte et appellent son lieutenant, Kandjâ Moûça, Les ferâris, ou les commandants, arrivent ; il en est ainsi du prédicateur, des jurisconsultes, qui tous s’asseyent devant les porteurs d’armes ou écuyers, à droite et à gauche de la salle d’audience. L’interprète Doûghâ se tient debout à la porte ; il a sur lui des vêtements superbes en zerdkhâneh, etc., son turban est orné de franges que ces gens savent arranger admirablement. Il a à son cou un sabre dont le fourreau est en or ; à ses pieds sont des bottes et des éperons personne, excepté lui, ne porte de bottes ce jour-là. Il tient à la main deux lances courtes, dont l’une est en argent, l’autre en or, et leurs pointes sont en fer.
Les militaires, les gouverneurs, les pages ou eunuques, les Messoûfites, etc., sont assis à l’extérieur du lieu des audiences, dans une rue longue, vaste et pourvue d’arbres. Chaque commandant a devant lui ses hommes, avec leurs lances, leurs arcs, leurs tambours, leurs cors (ceux-ci sont faits d’ivoire, ou de défenses d’éléphants), enfin avec leurs instruments de musique, fabriqués au moyen de roseaux et de courges, que l’on frappe avec des baguettes et qui rendent un son agréable. Chacun des commandants a son carquois suspendu entre les épaules, il tient son arc à la main et monte un cheval ; ses soldats sont les uns à pied, les autres à cheval. Dans l’intérieur de la salle d’audience, et sous les croisées, se voit un homme debout ; quiconque désire parler au sultan s’adresse d’abord à Doûghâ ; celui-ci parle audit personnage qui se tient debout, et ce dernier, au souverain.
Des séances qu’il tient dans le milieu des audiences
Quelquefois, le sultan tient ses séances dans le lieu des audiences ; il y a dans cet endroit une estrade, située sous un arbre, pourvue de trois gradins et que l’on appelle penpi. On la recouvre de soie, on la garnit de coussins, au-dessus on élève le parasol, qui ressemble à un dôme de soie, et au sommet duquel se voit un oiseau d’or, grand comme un épervier. Le sultan sort par une porte pratiquée dans un angle du château ; il tient son arc à la main, et a son carquois sur le dos. Sur sa tête est une calotte d’or, fixée par une bandelette, également en or, dont les extrémités sont effilées à la manière des couteaux, et longues de plus d’un empan. Il est le plus souvent revêtu d’une tunique rouge et velue, faite avec ces tissus de fabrique européenne nommés mothanfas, ou étoffe velue.
Devant le sultan sortent les chanteurs, tenant à la main des kanâbirs (instruments dont le nom au singulier est sans doute konbarâ, qui signifie alouette) d’or et d’argent ; derrière lui sont environ trois cents esclaves armés. Le souverain marche doucement ; il avance avec une grande lenteur, et s’arrête même de temps en temps ; arrivé au penpi, il cesse de marcher et regarde les assistants. Ensuite, il monte lentement sur l’estrade, comme le prédicateur monte dans sa chaire ; dès qu’il est assis, on bat les tambours, on donne du cor et on sonne des trompettes. Trois esclaves sortent alors en courant, ils appellent le lieutenant du souverain ainsi que les commandants, qui entrent et s’asseyent. On fait avancer les deux chevaux et les deux béliers ; Doûghâ se tient debout à la porte, et tout le public se place dans la rue, sous les arbres.
De la manière dont les nègres s’humilient devant leur roi, dont ils se couvrent de poussière par respect pour lui, et de quelques autres particularités de cette nation
Les nègres sont, de tous les peuples, celui qui montre le plus de soumission pour son roi, et qui s’humilie le plus devant lui. Ils ont l’habitude de jurer par son nom, en disant : Mensa Soleïmân kî. Lorsque ce souverain, étant assis dans la coupole ci-dessus mentionnée, appelle quelque nègre, celui-ci commence par quitter ses vêtements ; puis il met sur lui des habits usés ; il ôte son turban et couvre sa tête d’une calotte sale. Il entre alors, portant ses habits et ses caleçons levés jusqu’à mi-jambes ; il s’avance avec humilité et soumission ; il frappe fortement la terre avec ses deux coudes. Ensuite il se tient dans la position de l’homme qui se prosterne en faisant sa prière ; il écoute ainsi ce que dit le sultan. Quand un nègre, après avoir parlé au souverain, en reçoit une réponse, il se dépouille des vêtements qu’il portait sur lui ; il jette de la poussière sur sa tête et sur son dos, absolument comme le pratique avec de l’eau celui qui fait ses ablutions. Je m’étonnais, en voyant une telle chose, que la poussière n’aveuglât point ces gens.
Lorsque dans son audience le souverain tient un discours, tous les assistants ôtent leurs turbans et écoutent en silence. Il arrive quelquefois que l’un d’eux se lève, qu’il se place devant le sultan, rappelle les actions qu’il a accomplies à son service et dise : « Tel jour j’ai fait une telle chose, tel jour j’ai tué un tel homme » ; les personnes qui en sont informées confirment la véracité des faits. Or cela se pratique de la façon suivante celui qui veut porter ce témoignage tire à lui et tend la corde de son arc, puis la lâche subitement, comme il ferait s’il voulait lancer une flèche. Si le sultan répond au personnage qui a parlé : « Tu as dit vrai » ou bien « Je te remercie », celui-ci se dépouille de ses vêtements et se couvre de poussière ; c’est là de l’éducation chez les nègres, c’est là de l’étiquette.
Ibn Djozay ajoute : « J’ai su du secrétaire d’État, de l’écrivain de la marque, ou formule impériale, le jurisconsulte Abou’l Kâcim, fils de Rodhouân (que Dieu le rende puissant !), que le pèlerin Moûça Alouandjarâty s’étant présenté à la cour de notre maître Abou’l Haçan (que Dieu soit content de lui !), en qualité d’ambassadeur de Mensa Soleïmân ; quand il se rendait à l’illustre endroit des audiences, il se faisait accompagner par quelqu’un de sa suite, qui portait un panier rempli de poussière. Toutes les fois que notre maître lui tenait quelques propos gracieux, il se couvrait de poussière, suivant ce qu’il avait l’habitude de faire dans son pays. »
Comment le souverain fait la prière les jours de fête et célèbre les solennités religieuses
Je me trouvai à Mâlli pendant la fête des Sacrifices et celle de la Rupture du jeûne. Les habitants se rendirent à la vaste place de la prière, ou oratoire, située dans le voisinage du château du sultan ; ils étaient recouverts de beaux habits blancs. Le sultan sortit à cheval, portant sur sa tête le thaïléçân. Les nègres ne font usage de cette coiffure qu’à l’occasion des fêtes religieuses, excepté pourtant le juge, le prédicateur, et les légistes qui la portent constamment. Ces personnages précédaient le souverain le jour de la fête, et ils disaient, ou fredonnaient : « Il n’y a point d’autre Dieu qu’Allâh ! Dieu est tout-puissant ! » Devant le monarque se voyaient des drapeaux de soie rouge. On avait dressé une tente près de l’oratoire, où le sultan entra et se prépara pour la cérémonie ; puis il se rendit à l’oratoire ; on fit la prière et l’on prononça le sermon. Le prédicateur descendit de sa chaire, il s’assit devant le souverain et parla longuement. Il y avait là un homme qui tenait une lance à la main et qui expliquait à l’assistance, dans son langage, le discours du prédicateur. C’étaient des admonitions, des avertissements, des éloges pour le souverain, une invitation à lui obéir avec persévérance, et à observer le respect qui lui était dû.
Les jours des deux fêtes (la rupture du jeûne et la solennité des sacrifices), le sultan s’assied sur le penpi aussitôt qu’est accomplie la prière de l’après-midi. Les écuyers arrivent avec des armes magnifiques : ce sont des carquois d’or et d’argent, des sabres embellis par des ornements d’or, et dont les fourreaux sont faits de ce métal précieux, des lances d’or et d’argent, et des massues ou masses d’armes de cristal. A côté du sultan se tiennent debout quatre émirs, qui chassent les mouches ; ils ont à la main un ornement, ou bijou d’argent, qui ressemble à l’étrier de la selle. Les commandants, les juges et le prédicateur s’asseyent, selon l’usage. Doûghâ, l’interprète, vient, en compagnie de ses épouses légitimes, au nombre de quatre, et de ses concubines, ou femmes esclaves, qui sont une centaine. Elles portent de jolies robes, elles sont coiffées de bandeaux d’or et d’argent, garnis de pommes de ces deux métaux.
On prépare pour Doûghâ un fauteuil élevé, sur lequel il s’assied ; il touche un instrument de musique fait avec des roseaux et pourvu de grelots à sa partie inférieure. Il chante une poésie à l’éloge du souverain, où il est question de ses entreprises guerrières, de ses exploits, de ses hauts faits. Ses épouses et ses femmes esclaves chantent avec lui et jouent avec des arcs. Elles sont accompagnées par à peu près trente garçons, esclaves de Doûghâ, qui sont revêtus de tuniques de drap rouge et coiffés de calottes blanches ; chacun d’eux porte au cou et bat son tambour. Ensuite viennent les enfants, ou jeunes gens, les disciples de Doûghâ ; ils jouent, sautent en l’air, et font la roue à la façon des natifs du Sind. Ils ont pour ces exercices une taille élégante et une agilité admirable ; avec des sabres, ils escriment aussi d’une manière fort jolie.
Doûghâ, à son tour, joue avec le sabre d’une façon étonnante, et c’est à ce moment-là que le souverain ordonne de lui faire un beau présent. On apporte une bourse renfermant deux cents mithkâls, ou deux cents fois une drachme et demie, de poudre d’or, et l’on dit à Doûghâ ce qu’elle contient, en présence de tout le monde. Alors les commandants se lèvent, et ils bandent leurs arcs, comme un signe de remerciement pour le monarque. Le lendemain, chacun d’eux, suivant ses moyens, fait à Doûghâ un cadeau. Tous les vendredis, une fois la prière de l’après-midi célébrée, Doûghâ répète exactement les cérémonies que nous venons de raconter.
De la plaisante manière dont les poètes récitent leurs vers au sultan
Le jour de la fête, après que Doûghâ a fini ses jeux, les poètes arrivent, et ils sont nommés djoulâ, mot dont le singulier est djâli. Ils font leur entrée, chacun d’eux étant dans le creux d’une figure formée avec des plumes, ressemblant à un chikchâk, et à laquelle on a appliqué une tête de bois pourvue d’un bec rouge, à l’imitation de la tête de cet oiseau. Ils se placent devant le souverain dans cet accoutrement ridicule, et lui débitent leurs poésies. On m’a informé qu’elles consistent en une sorte d’admonition et qu’ils y disent au sultan : « Certes, sur ce penpi sur lequel tu es assis maintenant a siégé tel roi, qui a accompli telles actions généreuses ; tel autre, auteur de telles nobles actions, etc. Or fais à ton tour beaucoup de bien, afin qu’il soit rappelé après ta mort. »
Ensuite, le chef des poètes gravit les marches du penpi et place sa tête dans le giron du sultan ; puis il monte sur le penpi même et met sa tête sur l’épaule droite, et après cela sur l’épaule gauche du souverain, tout en parlant dans la langue de cette contrée ; enfin, il descend. On m’a assuré que c’est là une habitude très ancienne, antérieure à l’introduction de l’islamisme parmi ces peuples, et dans laquelle ils ont toujours persisté.
Je me trouvais un jour à l’audience du sultan, lorsqu’un jurisconsulte de ce pays-là se présenta, et il arrivait alors d’une province éloignée. Il se leva devant le souverain, il tint un long discours ; le juge se leva après lui et confirma ses assertions ; ensuite le sultan dit qu’il était de leur avis. A ce moment, tous les deux ôtèrent leur turban et se couvrirent de poussière en présence du prince. Il y avait à côté de moi un homme blanc qui me demanda : « Sais-tu ce qu’ils ont dit ? — Non. — Le légiste a raconté que, les sauterelles s’étant abattues dans leur contrée, un de leurs saints personnages se rendit sur les lieux, fut effrayé de la quantité de ces insectes et dit : “Ces sauterelles sont en bien grand nombre !” L’une d’elles lui répondit : “Dieu nous envoie pour détruire les semailles du pays où l’injustice domine.” Le juge et le sultan ont approuvé le discours du légiste. »
A cette occasion, le souverain dit aux commandants : « Je suis innocent de toute espèce d’injustice, et j’ai puni ceux d’entre vous qui s’en sont rendus coupables. Quiconque a connu un oppresseur sans me le dénoncer, qu’il soit responsable des crimes que ce délinquant a commis. Dieu en tirera vengeance et lui en demandera compte. » En entendant ces paroles, les commandants ôtèrent leurs turbans de dessus leurs têtes, et déclarèrent qu’ils n’avaient à se reprocher nul acte d’oppression, nulle injustice.
Une autre fois, j’assistais à la prière du vendredi, quand un marchand messoûfite, qui était en même temps un étudiant ou un homme lettré, et qui était appelé Abou Hafs, se leva et dit : « O vous qui êtes présents dans cette mosquée, soyez mes témoins que je prends à partie Mensa Soleïman (le sultan) et que je le cite au tribunal de l’envoyé de Dieu, ou Mahomet. » Alors plusieurs personnes sortirent de la tribune grillée du souverain, allèrent vers le plaignant et lui demandèrent : « Qui est-ce qui a commis une injustice à ton égard ? Qui t’a pris quelque chose ? » Il répondit : « Menchâ Djoû d’Îouâlâten, c’est-à-dire le gouverneur de cette ville, m’a enlevé des objets dont la valeur est de six cents ducats, et il m’offre, comme compensation, cent ducats seulement. » Le sultan envoya quérir tout de suite ce fonctionnaire, qui arriva quelques jours après, et il renvoya les deux parties devant le juge. Ce magistrat donna raison au marchand, qui recouvra ses valeurs, et le gouverneur fut destitué par le souverain.
Il arriva, pendant mon séjour à Mâlli, que le sultan se fâcha contre son épouse principale, la fille de son oncle paternel, qui était appelée Kâçâ ; le sens de ce mot, chez les nègres, est reine. Or elle est dans le gouvernement l’associée du souverain, d’après l’usage de ce peuple, et l’on prononce son nom sur la chaire, conjointement avec celui du roi. Son mari la mit aux arrêts chez l’un des commandants, et donna le pouvoir, à sa place à son autre épouse, la nommée Bendjoû, qui n’était pas au nombre des filles de rois. Le public parla beaucoup sur ce sujet, et il désapprouva la conduite du sultan. Les cousines paternelles de ce dernier se rendirent chez Bendjoû, pour la féliciter d’être devenue reine ; elles mirent des cendres sur leurs bras, mais ne se couvrirent point la tête de poussière. Plus tard, le monarque ayant fait sortir Kâçâ de sa prison, les mêmes filles de son oncle paternel entrèrent auprès de cette princesse pour la congratuler sur sa mise en liberté ; elles se couvrirent la tête et le corps de poussière, comme d’habitude. Bendjoû se plaignit au sultan de ce manque d’égards, et celui-ci se mit en colère contre ses cousines paternelles, qui eurent peur de lui, et cherchèrent un refuge dans la mosquée cathédrale. Cependant, il leur pardonna, et les invita à venir en sa présence. C’est l’usage, quand elles se rendent chez le sultan, qu’elles se dépouillent de leurs vêtements et qu’elles entrent toutes nues ; elles firent ainsi, et le sultan se déclara satisfait. Elles continuèrent à se présenter à sa porte durant sept jours, matin et soir, comme doit le pratiquer toute personne à qui le sultan a fait grâce.
Kâçâ montait donc à cheval tous les jours en compagne de ses esclaves des deux sexes, ayant tous de la poussière sur la tête ; elle s’arrêtait dans le lieu des audiences, étant recouverte d’un voile, de sorte que l’on ne voyait point son visage. Les commandants parlèrent beaucoup au sujet de cette princesse, et le sultan les ayant fait venir dans l’endroit des audiences, Doûghâ leur dit de la part du souverain : « Vous vous êtes entretenus longuement sur Kâçâ ; mais sachez qu’elle s’est rendue coupable d’un grand crime. » Alors on fit venir une de ses filles esclaves avec des entraves aux jambes, les mains attachées au cou, et on lui dit : « Expose ce que tu sais. » Elle raconta que Kâçâ l’avait expédiée près de Djâthal, un cousin paternel du sultan, qui était en fuite à Candborn ; qu’elle l’avait invité à dépouiller le souverain de son royaume, et qu’elle lui disait : « Moi et tous les militaires, nous te sommes entièrement dévoués. »
Lorsque les commandants entendirent ces propos, ils s’écrièrent : « C’est là un crime énorme, et, pour ce motif, Kâçâ mérite la mort. » Cette princesse éprouva des craintes à ce sujet, et elle chercha asile dans la maison du prédicateur ; car c’est un usage reçu chez ce peuple que l’on se réfugie dans la mosquée, ou, à son défaut, dans l’habitation du prédicateur.
Les nègres avaient en aversion Mensa Soleïman, à cause de son avarice. Avant lui a régné Mensa Maghâ, et avant celui-ci, Mensa Moûçâ. Ce dernier était un prince généreux et vertueux ; il aimait les hommes blancs et leur faisait du bien. C’est lui qui a donné en un seul jour à Abou Ishâk Assâhily quatre mille ducats. Une personne digne de confiance m’a raconté aussi qu’il a fait présent à Modric, fils de Fakkoûs, de trois mille ducats, d’un seul coup. Son aïeul, Sârek Djâthah, s’était fait musulman par les soins de l’aïeul du même Modric.
Ce jurisconsulte Modric m’a raconté qu’un homme natif de Tilimsân, ou Trémecen, et appelé Ibn Cheikh Alleben, avait fait don à Mensa Moûçâ, dans son jeune âge, de sept ducats un tiers. Alors ce dernier n’était qu’un enfant, et il ne jouissait pas de beaucoup de considération. Plus tard, il arriva qu’Ibn Cheikh Alleben se rendit, à cause d’un procès, chez Mensa Moûçâ, qui était devenu sultan. Celui-ci le reconnut, l’appela, le fit approcher et asseoir avec lui sur le penpi. Ensuite, il le força à mentionner la bonne action que ce personnage avait commise à son égard, et dit aux commandants : « Quelle récompense mérite celui qui a pratiqué ce bienfait ? » Ils lui répondirent : « Un bienfait dix fois aussi considérable (Coran, vi, 61). Or donne-lui soixante et dix ducats. » Le souverain lui fit cadeau immédiatement de sept cents ducats, d’un habillement d’honneur, de plusieurs esclaves des deux sexes, et lui dit de ne point le quitter. Cette même histoire m’a encore été rapportée par le propre fils du susdit Ibn Cheikh Alleben, qui était un homme de lettres, et qui enseignait le Coran à Mâlli.
De ce que j’ai trouvé de louable dans la conduite des nègres et, par contre, de ce que j’y ai trouvé de mauvais
Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes :
Le petit nombre d’actes d’injustice que l’on y observe ; car les nègres sont de tous les peuples celui qui l’abhorre le plus. Leur sultan ne pardonne point à quiconque se rend coupable d’injustice.
La sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l’homme sédentaire, n’a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs.
Les Noirs ne confisquent pas les biens des hommes blancs qui viennent à mourir dans leur contrée, quand même il s’agirait de trésors immenses. Ils les déposent au contraire, chez un homme de confiance d’entre les Blancs, jusqu’à ce que les ayants droit se présentent et en prennent possession.
Ils font exactement les prières ; ils les célèbrent avec assiduité dans les réunions des fidèles, et frappent leurs enfants, s’ils manquent à ces obligations. Le vendredi, quiconque ne se rend point de bonne heure à la mosquée ne trouve pas une place pour prier, tant la foule y est grande. Ils ont pour habitude d’envoyer leurs esclaves à la mosquée étendre leurs nattes qui servent pendant les prières, dans le lieu auquel a droit chacun d’eux, et en attendant que le maître s’y rende lui-même. Ces nattes sont faites avec les feuilles d’un arbre qui ressemble au palmier, mais qui ne porte pas de fruits.
Les nègres se couvrent de beaux habits blancs tous les vendredis. Si par hasard, l’un d’eux ne possède qu’une seule chemise, ou tunique usée, il la lave au moins, il la nettoie, et c’est avec elle qu’il assiste à la prière publique.
Ils ont un grand zèle pour apprendre par cœur le sublime Coran. Dans le cas où leurs enfants font preuve de négligence à cet égard, ils leur mettent des entraves aux pieds et ne les leur ôtent pas qu’ils ne le sachent réciter de mémoire. Le jour de la fête, étant entré chez le juge, et ayant vu ses enfants enchaînés, je lui dis : « Est-ce que tu ne les mettras pas en liberté ? » Il répondit : « Je ne le ferai que lorsqu’ils sauront par cœur le Coran. » Un autre jour, je passai devant un jeune nègre, beau de figure, revêtu d’habits superbes, et portant aux pieds une lourde chaîne. Je dis à la personne qui m’accompagnait : « Qu’a fait ce garçon ? Est-ce qu’il a assassiné quelqu’un ? » Le jeune nègre entendit mon propos et se mit à rire. On me dit : « Il a été enchaîné uniquement pour le forcer à apprendre le Coran de mémoire. »
Voici maintenant quelques-unes des actions blâmables de cette population :
Les servantes, les femmes esclaves et les petites filles paraissent devant les hommes toutes nues, et avec les parties sexuelles à découvert. J’en ai vu beaucoup de cette manière pendant le mois de ramadhan ; car c’est l’usage chez les nègres que les commandants rompent le jeûne dans le palais du sultan, que chacun d’eux y fasse servir ses mets, qu’apportent ses femmes esclaves, au nombre de vingt ou plus, et qui sont entièrement nues.
Toutes les femmes qui entrent chez le souverain sont nues, et elles n’ont aucun voile sur leur visage ; ses filles aussi vont toutes nues. La vingt-septième nuit du mois de ramadhan, j’ai aperçu environ cent femmes esclaves qui sortaient du château du sultan, et elles étaient nues. Deux filles du souverain, douées d’une forte gorge, les accompagnaient, et elles n’avaient non plus aucun voile sur elles.
Les Noirs jettent de la poussière et des cendres sur leur tête pour montrer de l’éducation, et comme signe de respect.
Ils pratiquent une sorte de bouffonnerie quand les poètes récitent leurs vers au sultan, ainsi que nous l’avons raconté.
Enfin, un bon nombre de nègres mangent des charognes, des chiens et des ânes.
J’étais entré dans cette ville le 14 de mois de djoumada premier de l’année 753, et je l’ai quittée le 22 de moharram de l’an 754 de l’hégire. Mon départ eut lieu en compagnie d’un marchand nommé Abou Bekr, fils de Ya’koûb. Nous nous dirigeâmes par la route de Mîmah ; je montais un chameau, car les chevaux sont très chers dans ce pays, un de ces animaux valant cent ducats. Or nous arrivâmes à un large canal qui sort du Nil, et que l’on ne peut traverser que dans des barques. Il y a dans cet endroit une quantité énorme de moustiques, et personne n’y passe, si ce n’est pendant la nuit. Lorsque nous atteignîmes le canal, c’était au premier tiers de la nuit, qui était éclairée par la lune.
Des chevaux ou hippopotames qui se trouvent dans le Nil
Arrivés que nous fûmes au canal, je vis près de la rive seize animaux d’une forte dimension ; j’en fus étonné, et je pensai que c’étaient des éléphants ; car il y en a beaucoup dans ce pays. Ensuite je vis ces animaux entrer dans le fleuve, et je demandai à Abou Becr, fils de Ya’koûb : « Quelles bêtes sont celles-ci ? » Il répondit : « Ce sont des chevaux marins ou de rivière qui étaient venus à terre pour y paître. » Ils sont plus gros que les chevaux, ils ont des crinières, des queues, leurs têtes sont comme celles des chevaux, et leurs jambes comme les jambes des éléphants. Je vis de ces hippopotames une seconde fois, quand nous voyageâmes sur le Nil en bateau, depuis Tombouctou jusqu’à Caoucaou. Ils nageaient dans l’eau du fleuve, ils levaient la tête et soufflaient. Les hommes de l’équipage eurent peur, et ils s’approchèrent de la terre, pour éviter d’être noyés.
Les gens de cette contrée se servent pour prendre les hippopotames d’un joli expédient. Ils font des lances percées, dans les trous desquels on a passé de fortes cordes. Ils frappent l’animal avec ces armes. Si le coup atteint soit la jambe soit le col, il pénètre dans les parties amphibies, qu’ils tirent, au moyen des cordes, jusqu’au rivage, où ils le tuent et mangent sa chair. On voit au bord du fleuve une grande quantité d’os de ces hippopotames.
Nous descendîmes près dudit canal dans un gros bourg, qui avait pour gouverneur un nègre, un pèlerin, homme de mérite, nommé Ferbâ Maghâ. C’est un de ceux qui avaient fait le pèlerinage de La Mecque en compagnie du sultan Mensa Moûça.
Ferbâ Maghâ m’a raconté que, lorsque Mensa Moûçâ arriva à ce canal, il avait avec lui un juge de race blanche surnommé Abou’l ’Abbâs, mais plus connu sous le sobriquet d’Addocâly, ou natif de Doccâlah. Le sultan lui fit cadeau de quatre mille ducats pour sa dépense, et quand ils furent arrivés à Mîmah, ce juge se plaignit au sultan que les quatre mille ducats lui avaient été dérobés dans sa maison. Le souverain fit venir le commandant de Mîmah, et le menaça de mort s’il n’amenait pas le voleur. Alors le commandant se mit à le chercher, mais il ne le trouva point ; car il n’y avait aucun voleur dans le pays. Il entra dans la maison du juge, il insista près de ses domestiques, et leur fit peur. Or une des esclaves d’Addocâly dit : « Mon maître n’a rien perdu ; seulement il a caché lui-même la somme d’argent dans cet endroit. » Elle indiqua le lieu au commandant, qui en tira les ducats, les porta au souverain, et lui fit connaître toute l’histoire.
Le sultan se fâcha contre le juge, qu’il exila dans le pays de ces nègres infidèles qui mangent les hommes. Il y resta quatre années, au bout desquelles le sultan le fit retourner dans son pays natal. Le motif pour lequel les indigènes anthropophages ne l’ont point mangé, c’est qu’il était blanc. En effet, ils disent que la chair des hommes blancs est nuisible, vu qu’elle n’est pas mûrie ; celle des Noirs est seule mûre, dans leur opinion.
Le sultan Mensa Soleïmân reçut une fois la visite d’une troupe de nègres anthropophages, accompagnés par un de leurs commandants. Ils ont l’habitude de mettre à leurs oreilles de grandes boucles, dont le diamètre est d’un demi-empan. Ils s’enveloppent le corps avec des manteaux de soie, et dans leur pays se trouve une mine d’or. Le sultan les honora et leur donna une servante, comme cadeau d’hospitalité. Ces nègres l’égorgèrent et la mangèrent ; ils se souillèrent la figure, ainsi que les mains, de son sang, et ils se présentèrent devant le souverain pour le remercier. J’ai su que toutes les fois qu’ils se rendent chez lui ils agissent de cette manière. On m’a dit aussi que ces anthropophages prétendent que les meilleurs morceaux des chairs des femmes sont les mains et les seins.
Nous partîmes de ce bourg situé près du canal, et arrivâmes ensuite à la ville de Kori Mensa. Ce fut ici que mourut le chameau qui me servait de monture, et quand son gardien m’informa de cet accident je sortis pour voir la bête. Je trouvai que les nègres l’avaient déjà mangée, suivant leur coutume d’avaler les charognes. Or j’expédiai deux garçons que j’avais pris à mon service, afin qu’ils m’achetassent un autre chameau à Zâghari, localité qui se trouvait à la distance de deux jours de marche. Quelques compagnons d’Abou Becr, fils de Ya’koûb, restèrent avec moi, tandis qu’il était parti pour nous attendre à Mîmah. Je passai donc six jours à Kori Mensa, durant lesquels je reçus l’hospitalité de plusieurs habitants qui avaient fait le pèlerinage de La Mecque ; puis arrivèrent les deux garçons avec le chameau.
Pendant ma demeure à Kori Mensa, je rêvai une nuit qu’un individu me disait : « Ô Mohammed, fils de Bathoûthah ! pourquoi ne lis-tu point tous les jours la soûrah Yâ Sin ? » Depuis lors, je n’ai jamais manqué d’en faire la lecture tous les jours, soit que je fusse en voyage, soit que je fusse sédentaire.
Je me rendis à Mîmah, où nous campâmes hors de la ville et auprès de divers puits.
De là, nous allâmes à Tonboctoû, ville qui se trouve à quatre milles de distance du fleuve Nil, et qui est habitée principalement par des Messoûfites porteurs du lithâm, voile ou bandeau qui couvre le bas du visage. Le gouverneur est appelé Ferbâ Moûçâ. Je me trouvai chez lui un jour qu’il nomma un Messoûfite commandant d’une troupe ; il le revêtit d’un habillement, d’un turban, de caleçons, le tout en étoffes de couleur, et il le fit asseoir sur un bouclier. Les grands de la tribu de ce Messoûfite le soulevèrent par-dessus leurs têtes.
On voit à Tonboctoû le tombeau du poète illustre Abou Ishâk Assâhily Algharnâthy, ou originaire de Grenade, qui est plus connu dans son pays sous le nom d’Atthouwaïdjin. On y remarque aussi le tombeau de Sirâdj eddîn, fils d’Alcouwaïc, un des principaux négociants, et natif d’Alexandrie.
Lorsque le sultan Mensa Moûça fit son pèlerinage, il s’arrêta dans un jardin que ce Sirâdj eddîn avait à Bircat Alhabech, ou l’Étang des Abyssins, à l’extérieur de la ville du Caire ; c’est là que le sultan descend. Mensa Moûça eut besoin d’argent, et il en emprunta à Sirâdj eddîn, ses émirs en firent autant. Sirâdj eddîn expédia son mandataire avec eux, afin qu’il touchât la somme qui lui était due ; mais ce dernier séjourna à Mâlli. Alors Sirâdj eddîn partit lui-même pour demander son argent, et il se fit accompagner par son fils. Parvenu à Tonboctoû, Sirâdj eddîn reçut l’hospitalité d’Abou Assâhily, et la mort l’atteignit fatalement dans la nuit. Le public s’entretint beaucoup de cet accident, et soupçonna que Sirâdj eddîn avait été empoisonné. Or son fils dit à ces gens-là : « Certes, j’ai mangé des mêmes mets que mon père ; s’ils avaient renfermé du poison, ce poison nous aurait tués tous deux ; donc le terme de sa vie était arrivé. » Le fils de Sirâdj eddîn continua son voyage jusqu’à Mâlli ; il reçut son argent, et repartit pour l’Égypte.
A Tonboctoû, je m’embarquai sur le Nil, dans un petit bâtiment, ou canot, fait d’un seul tronc d’arbre creusé. Tous les soirs nous descendions dans un village, nous y achetions les vivres et le beurre dont nous avions besoin, en payant avec du sel, des épices et des verroteries. J’arrivai dans une localité dont j’ai oublié le nom, et qui avait pour commandant un homme de mérite, un pèlerin appelé Ferbâ Soleïmân. C’est un personnage célèbre pour son courage et pour sa vigueur ; nul n’est en état de bander son arc. Je n’ai point vu parmi les nègres d’individu plus haut ni plus corpulent que lui. Il arriva que je voulus me procurer ici un peu de millet ; par conséquent, je me rendis chez Ferbâ Soleïmân, et c’était le jour anniversaire de la naissance de Mahomet. Je saluai ce commandant, qui me questionna sur mon arrivée (sur le motif de ma visite). Il y avait en sa compagnie un jurisconsulte qui était son secrétaire ; je pris une tablette qui se trouvait devant ce dernier, et j’y écrivis ces mots : « O jurisconsulte ! dis à ce commandant que nous avons besoin d’un peu de millet pour notre provision de route. Salut ! »
Je passai la tablette au légiste, afin qu’il lût à part lui ce qu’elle portait tracé, et qu’il parlât ensuite sur ce sujet à l’émir, dans sa langue ; mais il lut, au contraire, à haute voix, et l’émir le comprit. Celui-ci me prit alors par la main ; il m’introduisit dans son michouer, ou le lieu de ses audiences, où se voyaient beaucoup d’armes, telles que des boucliers, des arcs et des lances. Je trouvai chez ce commandant un exemplaire du Kitâb Almodhich, ou du livre intitulé L’Etonnant, d’Ibn Aldjeouzy, et je me mis à le lire. On apporta une boisson en usage dans ce pays, et appelée daknoû : c’est de l’eau contenant du millet concassé, mêlé avec une petite quantité de miel ou de lait aigre. Ces gens s’en servent en place d’eau ; car, s’ils boivent celle-ci pure, elle leur fait du mal. A défaut de millet, ils ajoutent à l’eau du miel ou du lait aigri. Ensuite, on nous offrit une pastèque, dont nous mangeâmes.
Un jeune garçon, haut de cinq empans, entra ; Ferbâ Soleïman l’appela, et, s’adressant à moi, il dit : « Celui-ci est ton présent d’hospitalité ; garde-le bien afin qu’il ne prenne pas la fuite. » Je l’acceptai, et désirai m’en retourner ; mais l’émir me dit : « Reste jusqu’à l’arrivée des mets. » Une jeune esclave de Ferbâ Soleïman vint à nous ; elle était de Damas, Arabe de naissance, et elle me parla dans ma langue. Sur ces entrefaites, nous entendîmes des cris dans la maison du commandant, qui fit partir cette femme pour en savoir la cause. L’esclave revint, et informa son maître qu’une fille à lui venait de mourir. Alors il me dit : « Je n’aime pas les pleurs ; viens, marchons vers le bahr (mer, fleuve, etc.) » ; il entendait parler du Nil, et il possède plusieurs maisons sur la rive de ce fleuve. On amena un cheval, et l’émir me dit : « Monte-le, » Je répondis : « Je ne le monterai pas, puisque tu es à pied. » Nous allâmes donc à pied tous les deux, et arrivâmes aux habitations qu’il a près du Nil. On apporta des mets, nous mangeâmes ; puis je pris congé de mon hôte et me retirai. Je n’ai jamais connu de nègre plus généreux ni meilleur que lui. Le jeune esclave qu’il m’a donné est encore en ma possession.
Je partis pour Caoucaou, grande ville située près du Nil. C’est une des plus belles cités des nègres, une des plus vastes et des plus abondantes en vivres. On y trouve beaucoup de riz, de lait, de poules et de poisson ; on s’y procure cette espèce de concombre surnommé ’inâny, et qui n’a pas son pareil. Le commerce de vente et d’achat chez les habitants se fait au moyen de petites coquilles ou cauris, au lieu de monnaie ; il en est de même à Mâlli. Je demeurai à Caoucaou environ un mois, et je reçus l’hospitalité des personnages suivants : Mohammed, fils d’Omar, natif de Méquinez : c’était un homme aimable ; folâtre et rempli de mérite ; il est mort à Caoucaou, après mon départ ; le pèlerin Mohammed Alouedjdy Attâry : c’est un de ceux qui ont voyagé dans le Yaman ; le jurisconsulte Mohammed Alfîlâly (de Tafilalet, ou Tafilet), chef de la mosquée des Blancs.
De Caoucaou, je me dirigeai par terre vers Tacaddâ, en compagnie d’une caravane nombreuse, formée par des gens natifs de Ghadâmès. Leur guide et leur chef était le pèlerin Outtchîn, mot qui, dans le langage des nègres, signifie le loup. J’avais un chameau pour monture, et une chamelle pour porter mes provisions ; mais, après le premier jour de chemin, cette dernière s’arrêta, s’abattit. Le pèlerin Outtchîn prit tout ce que la bête avait sur elle, il le distribua à ses compagnons pour le transporter, et ceux-ci s’en partagèrent la charge. Il y avait dans la caravane un Africain originaire de Tâdéla, qui refusa de porter la moindre de ces choses, contrairement à ce que les autres avaient fait. Un certain jour, mon jeune esclave eut soif ; je demandai de l’eau au même Africain, qui ne voulut pas en donner.
Nous arrivâmes dans la contrée des Bardâmah, ou tribu berbère de ce nom. Les caravanes n’y voyagent en sûreté que sous leur protection, et celle de la femme est plus efficace encore que celle de l’homme. Les Bardâmah forment une population nomade qui ne s’arrête jamais longtemps dans le même lieu. Leurs tentes sont faites d’une façon étrange : ils dressent des bâtons de bois ou des perches, sur lesquels ils placent des nattes ; par-dessus celles-ci, ils posent des bâtons entrelacés, ou une sorte de treillage, qu’ils recouvrent de peaux ou bien d’étoffes de coton.
Les femmes des Bardâmah sont les plus belles du monde et les plus jolies de figure ; elles sont d’un blanc pur et ont de l’embonpoint ; je n’ai vu dans aucun pays de l’univers, de femmes aussi grasses que celles-ci. Leur nourriture consiste en lait frais de vache et en millet concassé, qu’elles boivent, le soir et le matin, mêlé avec de l’eau et sans le faire cuire. Quiconque veut se marier avec ces femmes doit demeurer avec elles dans l’endroit le plus rapproché de leur contrée, et il ne peut jamais dépasser, en leur compagnie, Caoucaou ni Îouâlâten.
Je devins malade dans ce pays, par suite de l’extrême chaleur et d’une surabondance de bile jaune. Nous hâtâmes notre marche, jusqu’à ce que nous fussions arrivés à Tacaddâ ou Tagaddâ, où je logeai près du cheikh des Africains, Sa’id, fils d’Aly Aldjozoûly, Je reçus l’hospitalité du juge de la ville, Abou Ibrahîm Ishâk Aldjânâty, un des hommes distingués. Je fus aussi traité par Dja’far, fils de Mohammed Almessoûfy. Les maisons de Tacaddâ sont bâties avec des pierres rouges ; son eau traverse des mines de cuivre, et c’est pour cela que sa couleur et son goût sont altérés. On n’y voit d’autres céréales qu’un peu de froment, que consomment les marchands et les étrangers ; il se vend à raison d’un ducat d’or les vingt modds, ou muids ; cette mesure est ici le tiers de celle de notre pays. Le millet s’y vend au prix d’un ducat d’or les quatre-vingt-dix muids.
Il y a beaucoup de scorpions à Tacaddâ ; ces insectes venimeux tuent les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de puberté, mais il est rare qu’ils tuent les hommes adultes. Pendant que j’étais dans cette ville, un fils du cheikh Sa’id, fils d’Aly, fut piqué un matin par les scorpions ; il mourut sur l’heure, et j’assistai à ses funérailles. Les habitants de Tacaddâ n’ont point d’autre occupation que celle du commerce ; ils font tous les ans un voyage en Égypte, d’où ils importent dans leur pays de belles étoffes, etc. Cette population de Tacaddâ vit dans l’aisance et la richesse ; elle est fière de posséder un grand nombre d’esclaves des deux sexes ; il en est ainsi des habitants de Mâlli et d’Îouâlâten. Il arrive bien rarement que ces gens de Tacaddâ vendent les femmes esclaves qui sont instruites ; et quand cela a lieu, c’est à un très haut prix.
En arrivant à Tacaddâ, je désirai acheter une fille esclave instruite ; mais je ne la trouvai pas. Plus tard, le juge Abou Ibrahim m’en envoya une, appartenant à un de ses compagnons ; je l’achetai pour vingt-cinq ducats ; puis le maître de l’esclave se repentit de l’avoir vendue, et me demanda la résiliation du contrat. Je lui répondis : « Si tu peux m’indiquer une autre esclave de ce genre, je résilierai le marché. » Il me fit connaître une esclave d’Aly Aghioûl, de cet Africain de Tâdéla qui ne voulut se charger d’aucune partie de mes effets lorsque ma chamelle s’abattit, et qui refusa de l’eau à mon jeune esclave souffrant de la soif. J’achetai cette esclave, qui valait mieux encore que la précédente, et j’annulai le contrat avec le premier vendeur. Cet Africain regretta aussi d’avoir cédé son esclave ; il désira casser le marché et il insista beaucoup sur cela auprès de moi. Je refusai, pour lui donner la récompense que méritait sa mauvaise conduite à mon égard, et peu s’en fallut qu’il ne devînt fou ou qu’il ne mourût de chagrin. Cependant, je me décidai plus tard à lui accorder la résiliation du contrat.
La mine de cuivre se trouve au-dehors de Tacaddâ. On creuse dans le sol, et l’on amène le minerai dans la ville, pour le fondre dans les maisons. Cette besogne est faite par les esclaves des deux sexes. Une fois que l’on a obtenu le cuivre rouge, on le réduit en barres longues d’un empan et demi, les unes minces, les autres épaisses. Quatre cents de celles-ci valent un ducat d’or ; six cents ou sept cents de celles-là valent aussi un ducat d’or. Ces barres servent de moyen d’échange, en place de monnaie : avec les minces, on achète la viande et le bois à brûler ; avec celles qui sont épaisses, on se procure les esclaves mâles et femelles, le millet, le beurre et le froment.
On exporte le cuivre de Tacaddâ à la ville de Coûber, située dans la contrée des nègres infidèles ; on l’exporte aussi à Zaghâï et au pays de Bernoû. Ce dernier se trouve à quarante jours de distance de Tacaddâ, et ses habitants sont musulmans ; ils ont un roi nommé Idrîs, qui ne se montre jamais au peuple, et qui ne parle pas aux gens, si ce n’est derrière un rideau. C’est de Bernoû que l’on amène, dans les différentes contrées, les belles esclaves, les eunuques et les étoffes teintes avec le safran. Enfin, de Tacaddâ l’on exporte également le cuivre à Djeoudjéouah, dans le pays des Moûrtébôun, etc.
Lors de mon séjour à Tacaddâ, les personnages que je vais nommer se rendirent chez le sultan, un Berber appelé Izâr, et qui se trouvait à ce moment-là à une journée de distance de la ville. C’étaient : le juge Abou Ibrahim ; le prédicateur Mohammed ; le professeur Abou Hafs ; le cheikh Sa’id, fils d’Aly. Un différend s’était élevé entre Izar, le sultan de Tacaddâ, et entre le Tacarcary, qui est aussi un des sultans des Berbères. Ces quatre personnages allaient auprès d’Izâr pour arranger l’affaire, et mettre la paix entre les deux souverains. Je désirai connaître le sultan de Tacaddâ ; en conséquence, je louai un guide, et me dirigeai vers ce monarque. Les personnages déjà nommés l’informèrent de mon arrivée, et il vint me voir, monté sur un cheval, mais sans selle : tel est l’usage de ce peuple. En place de selle, le sultan avait un superbe tapis rouge. Il portait un manteau, des caleçons et un turban, le tout de couleur bleue. Les fils de sa sœur l’accompagnaient, et ce sont eux qui hériteront de son royaume. Nous nous levâmes à son approche, et lui touchâmes la main ; il s’informa de mon état, de mon arrivée, et on l’instruisit sur tout cela.
Le sultan me fit loger dans une des tentes des Yénâthiboûn, qui sont comme les domestiques dans notre pays. Il m’envoya un mouton entier rôti à la broche, et une coupe de lait de vache. La tente de sa mère et de sa sœur était dans notre voisinage ; ces deux princesses vinrent nous voir et nous saluer. Sa mère nous avait fait apporter du lait frais après la prière de la nuit close : c’est le moment où l’on a ici l’habitude de traire les bestiaux. Les indigènes boivent le lait à cette heure, ainsi que de bon matin. Quant au blé ou au pain, ils ne le mangent ni ne le connaissent. Je restai dans cet endroit six jours, pendant lesquels le sultan me régalait de deux béliers rôtis, le matin et le soir. Il me fit présent d’un chameau femelle et de dix ducats d’or. Je pris congé de ce souverain et retournai à Tacaddâ.
De l’ordre auguste que je reçus de la part de mon souverain
Quand je fus retourné à Tacaddâ, je vis arriver l’esclave du pèlerin Mohammed, fils de Sa’id Assidjilmâçy, portant un ordre de notre maître, le commandant des fidèles, le défenseur de la religion, l’homme qui se confie entièrement dans le Seigneur des mondes (Abou Inân). Cet ordre m’enjoignait de me rendre dans son illustre capitale ; je le baisai avec respect, et je m’y conformai à l’instant. J’achetai donc deux chameaux de selle, que je payai trente-sept ducats et un tiers, me préparant à partir pour Taouât. Je pris des provisions pour soixante et dix nuits ; car on ne trouve point de blé entre Tacaddâ et Taouât. Tout ce que l’on peut se procurer, c’est de la viande, du lait aigre et du beurre, que l’on achète avec des étoffes.
Je sortis de Tacaddâ le jeudi onze du mois de chaban de l’année cinquante-quatre (754 de l’hégire = 12 septembre 1353 de J. C.), en compagnie d’une caravane considérable, où se trouvait Djafar de Taouât, un des hommes distingués. Il y avait avec nous le jurisconsulte Mohammed, fils d’Abd Allah, juge à Tacaddâ. La caravane renfermait environ six cents filles esclaves. Nous arrivâmes à Câhor qui fait partie des domaines du sultan Carcary : c’est un endroit riche en herbages, et où les marchands achètent, des Berbères, les moutons, dont ils coupent les chairs en lanières pour les faire ensuite sécher. Les gens de Taouât importent ces viandes dans leur pays.
Puis nous entrâmes dans un désert sans habitations, sans culture, sans eau, et de la longueur de trois jours de marche ; après cela, nous voyageâmes quinze journées dans un autre désert sans culture aussi, mais offrant de l’eau. Nous atteignîmes le point où se séparent le chemin de Ghât, qui conduit en Égypte, et celui de Taouât. Il y a là des puits, ou amas d’eau qui traverse du fer ; lorsqu’on lave avec cette eau une étoffe blanche, la couleur de l’étoffe devient noire.
Nous marchâmes encore dix jours, et arrivâmes au pays des Haccâr, ou Haggâr, qui sont une tribu de Berbères, portant un voile sur la figure ; il y a peu de bien à en dire : ce sont des vauriens. Un de leurs chefs vint à notre rencontre, et arrêta la caravane, jusqu’à ce qu’on se fût engagé à lui donner des étoffes et autres choses. Ce fut pendant le mois de ramadhan que nous entrâmes dans le territoire des Haccâr ; à cette époque de l’année, ils ne font pas d’incursions en pays ennemi, et n’empêchent point les caravanes de passer. Leurs voleurs mêmes, s’ils trouvent quelque objet sur la route durant le mois de ramadhan, ne le ramassent pas. C’est ainsi qu’agissent tous les Berbères qui habitent sur ce chemin.
Pendant un mois nous voyageâmes dans la contrée des Haccâr ; elle a peu de plantes, beaucoup de pierres, et sa route est scabreuse. Le jour de la fête de la Rupture du jeûne, nous arrivâmes dans un pays de Berbères porteurs de ce voile qui recouvre le bas du visage, à la manière de ceux que nous venions de quitter. Ils nous donnèrent des nouvelles de notre patrie ; ils nous apprirent que les fils ou la tribu de Kharâdj, ainsi que le fils de Yaghmoûr, s’étaient révoltés, et qu’ils résidaient alors à Téçâbît, dans le pays de Taouât. Les hommes de la caravane furent remplis de crainte quand ils entendirent ces récits.
Ensuite nous arrivâmes à Boûda, un des principaux villages, de Taouât ; son territoire consiste en sables et en terrains salés. Il y a ici beaucoup de dattes, mais elles ne sont pas bonnes ; cependant, les gens de Boûda les préfèrent à celles de Sidjilmâçah. Le pays de Boûda ne fournit ni grains, ni beurre, ni huile d’olive ; ces denrées y sont importées des contrées du Maghreb. Les habitants se nourrissent de dattes et de sauterelles ; ces insectes y sont aussi en grande abondance ; ils les emmagasinent comme on le pratique avec les dattes, et s’en servent pour aliments. La chasse des sauterelles se fait avant le lever du soleil, car alors le froid les engourdit et les empêche de s’envoler.
Après avoir demeuré quelques jours à Boûda, nous partîmes avec une caravane, et arrivâmes à Sidjilmâçah au milieu du mois de dhoû’lka’dah. Je sortis de cette ville le second jour du mois de dhou’lhiddjeh (de l’année 754 de l’hégire ou à la fin de décembre 1353 de J. C.) ; c’était au moment d’un grand froid, et la route était remplie de neige. J’avais vu dans mes voyages des chemins difficiles, ainsi que beaucoup de neige, à Boukhara, à Samarkand, dans le Khoraçan et les pays des Turcs ; mais je n’avais pas connu de route plus scabreuse que celle d’Oumm Djonaïbah, La nuit qui précède la fête des Sacrifices, nous atteignîmes Dâr Atthama’ ; j’y restai le jour de la fête, et partis le lendemain.
Enfin j’entrai dans la capital Fez, résidence de notre maître le commandant des fidèles (que Dieu l’assiste !) ; je baisai sa main auguste, j’eus le bonheur de voir son visage béni, et je demeurai sous la protection de ses bienfaits, après un très long voyage. Que le Dieu très haut le récompense pour les nombreuses faveurs qu’il m’a accordées et pour ses grâces généreuses ! Que le Très Haut prolonge ses jours et réjouisse les musulmans par la longue durée de son existence !
****************************
Ici finit le récit du voyage intitulé : Cadeau fait aux observateurs, traitant des curiosités offertes par les villes, et des merveilles rencontrées dans les voyages. La rédaction en a été terminée le 3 de dhou’lhiddjeh de l’année 756 de l’hégire (le 13 décembre de l’an 1355 de J. C.), Louange à Dieu, et paix à ceux d’entre ses serviteurs qu’il a élus (Coran, xxvii, 60).
Ibn Djozay dit : « Voilà la fin de ce que j’ai rédigé, d’après l’écrit du cheikh Abou ’Abd Allah, Mohammed, fils de Batoutah (que Dieu l’honore !). Aucun homme intelligent ne méconnaîtra que ce cheikh ne soit le voyageur de l’époque. Celui qui dirait : « C’est le voyageur de cette religion ou de cette nation musulmane » n’exagérerait pas. Notre cheikh, qui a pris le monde entier pour but de ses voyages, n’a choisi la capitale de Fez pour demeure et pour patrie, après l’immense longueur de ses pérégrinations, que parce qu’il s’est bien assuré que notre maître (que Dieu l’assiste !) est le plus grand des rois de l’univers, celui qui possède le plus de mérites, qui multiplie le plus les bienfaits, qui a le plus de sollicitude pour ceux qui viennent le visiter, et qui donne le plus de protection à l’étude de la science.
« Il convient qu’un homme comme moi loue le Dieu très haut, pour la grâce qu’il lui a faite dans sa jeunesse, et dès le commencement de son émigration, de venir demeurer dans cette même capitale, que notre cheikh n’a choisie qu’à la suite d’un voyage de vingt-cinq années. C’est là, en effet, une faveur inestimable, et que l’on ne saurait suffisamment payer de reconnaissance. Que le Dieu très haut nous accorde son aide dans le service de notre maître le commandant des fidèles, qu’il fasse durer sur nous l’ombre de la protection, de la miséricorde de ce souverain, et qu’il le rétribue pour nous, qui ne sommes qu’une réunion d’étrangers dévoués à notre maître, de la plus illustre récompense que les bienfaiteurs puissent désirer !
« O Dieu ! puisque tu as élevé notre maître au-dessus des autres rois, au moyen de deux mérites, la science et la piété ; puisque tu l’as distingué par une grande douceur et par une intelligence solide, répands aussi sur son royaume les causes de la vigueur et de la puissance ; fais-lui connaître les bienfaits du secours sublime et de la victoire éclatante ! Ô Dieu ! ô le plus miséricordieux des miséricordieux ! conserve l’empire dans la postérité de notre souverain, jusqu’au jour du dernier jugement réjouis-le dans sa personne, dans ses enfants, dans son royaume et dans ses sujets !
« Que la bénédiction de Dieu et le salut soient sur notre seigneur, notre maître, notre prophète Mahomet, qui est le sceau, ou le plus excellent des prophètes, et le chef des envoyés ! Louange à Dieu, maître des créatures !
« La transcription de cet ouvrage a été achevée dans le mois de safar de l’année 757 de l’hégire (février 1356 de J. C.). Que Dieu rétribue celui qui le copiera ! »
Fin du tome quatrième et dernier.