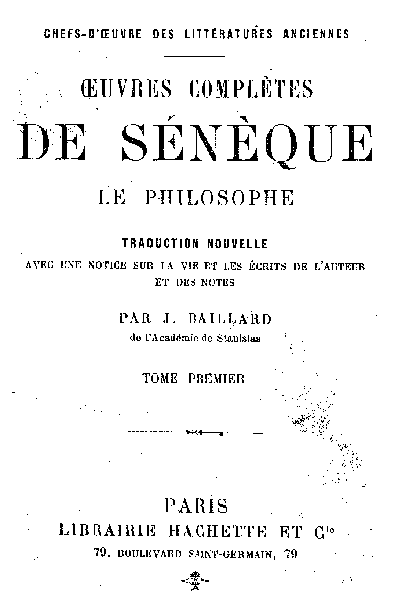|
SÉNÈQUE
Des bienfaits LIVRE VII Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Traduction J. Baillard, 1914.
I. Bon courage, cher Libéralis, Enfin nous prenons terre : ici plus de longueurs, De détours fatigants, d'importunes lenteurs.[1] Ce livre-ci rassemble les restes d'une matière épuisée, et j'avise à découvrir non ce que je dois dire, mais ce que je n'ai pas dit. Prends toutefois tout ce reliquat en bonne part, puisque c'est pour toi qu'il y a reliquat. Si je n'avais eu qu'un but d'amour-propre, l'intérêt de mon œuvre eût dû croître graduellement, et j'eusse ménagé pour la fin de quoi réveiller même un appétit satisfait. Mais j'ai accumulé tout le plus essentiel sur le commencement : maintenant je glane ce qui a pu m'échapper. Et franchement, si tu me demandes mon avis, je ne crois pas qu'il importe fort, les points qui règlent la morale une fois traités, de s'attacher à d'autres questions imaginées non comme remèdes de l'âme, mais comme exercices de l'esprit. Car, ainsi que le dit si bien Démétrius[2] le cynique, grand homme à mon avis, même si on le compare aux plus grands : « Il est plus utile de ne posséder qu'un petit nombre de sages préceptes, pourvu qu'on les tienne à sa portée et à son usage, que d'en avoir étudié mille qu'on n'a plus sous la main.[3] Le bon lutteur, dit-il, n'est pas celui qui sait à fond toute la théorie des temps et enlacements dont l'application est rare sur l'arène; c'est celui qui, après s'être longtemps et soigneusement exercé dans une ou deux positions, épie attentivement l'instant de les saisir: qu'importe en effet qu'il sache beaucoup, s'il sait tout ce qu'il faut pour vaincre?[4] De même, dans la philosophie, pour une foule de choses qui amusent, peu frappent au but. i Il est permis d'ignorer la cause qui fait déborder, puis refluer l'Océan ; pourquoi chaque septième année d'âge marque l'homme d'un cachet nouveau; pourquoi les arcs d'un portique vu de loin ne gardent pas les mêmes proportions, mais se rétrécissent et se rapprochent vers les extrémités, tellement que l'intervalle des dernières colonnes devient nul; pourquoi des jumeaux conçus séparément naissent ensemble; si un seul acte de copulation suffit pour tous deux, ou si chacun a sa conception propre ; pourquoi à des naissances pareilles des destins divers, des points d'arrivée si distants l'un de l'autre, quand les points de départ diffèrent si peu. On ne perd pas grand’ chose à négliger ce qu'il n'est ni possible ni utile de savoir. L'impénétrable vérité reste cachée dans son abîme. Et nous ne pouvons faire un crime à la nature de nous envier nos découvertes : car il n'y a de difficiles que celles dont tout l'avantage consiste à les avoir faites. Tout ce qui nous doit rendre meilleurs ou heureux, elle l'a mis sous nos yeux ou tout près de nous. Que, dédaignant les vicissitudes du sort, un homme s'élève au-dessus de la crainte et n'embrasse pas l'infini dans ses avides espérances, mais sache trouver en lui-même ses richesses;[5] qu'il ait banni les terreurs humaines et religieuses, bien sûr qu'il y a peu à redouter de la part des hommes et rien de la part des dieux ; que contempteur de ces choses qui font le supplice en même temps que la décoration de la vie, il soit parvenu à voir clairement que la mort n'est la source d'aucun mal, et qu'elle est le terme de bien des maux; qu'il ait voué son cœur à la vertu et trouve unies toutes les voies par où elle l'appelle ; qu'en qualité d'être sociable et né pour le service de tous, il regarde le monde comme la patrie commune du genre humain; qu'il ouvre sa conscience aux dieux[6] et se conduise en tout comme il ferait sous l'œil du public; qu'il ait pour soi plus de respect encore que pour les autres, un tel homme s'est dérobé aux orages et fixé où résident le calme et la sérénité ; il possède complètement la science utile et nécessaire : le reste n'est fait que pour amuser ses loisirs. Car il est permis à l'âme déjà recueillie en lieu sûr de se distraire à des études qui ornent l'esprit sans lui apporter plus de force. II. Ces principes, notre Démétrius veut que le disciple déjà en progrès les tienne pour ainsi dire à deux mains, qu'il ne s'en dessaisisse jamais, qu'il se les inculque et se les assimile, et qu'en les méditant chaque jour, il arrive au point que la règle morale s'offre d'elle-même à lui et réponde partout et sur le champ à son appel; que sans délai lui apparaisse la grande distinction de l'honnête et de son contraire, pour lui rappeler qu'il n'est de mal que ce qui est honteux, de bien que ce qui est honnête; qu'elle soit sa règle pour ordonner les œuvres de sa vie, sa loi constante pour agir et juger, et qu'il tienne pour le plus malheureux des hommes, dans quelque haute fortune qu'il brille, quiconque, esclave de la table et des femmes, laisse croupir son âme dans une léthargique inertie. Qu'il se dise : « La volupté est chose fragile, qui passe vite, sujette aux dégoûts; plus avidement on l'épuisé, plus tôt elle dégénère en souffrance que suit bientôt infailliblement ou le repentir ou la honte. Y a-t-il en elle rien de noble ou de séant à cette nature humaine qui approche de celle des dieux? Abjecte par elle-même, ayant pour agents, pour guides des organes déshonnêtes et vils, ses résultats sont repoussants. La volupté digne d'un homme, d'un homme qui sait l'être, n'est pas de remplir, d'engraisser son corps ; de réveiller des passions qu'il est bien plus sûr de laisser dormir; c'est d'échapper aux troubles violents que soulèvent dans les âmes les rivalités de l'ambition, comme à ces frayeurs irrésistibles parce qu'elles viennent de plus haut, lorsqu'au sujet des dieux on ajoute foi à l'opinion et qu'on les juge d'après nos propres vices. » Cette volupté toujours égale, imperturbable, jamais exposée au dégoût d'elle-même, est le partage de l'homme dont nous traçons l'image, de celui qui, pour ainsi dire, savant de la science des lois divines et humaines, jouit de ce qui est sans dépendre de ce qui sera, car point de fixité pour qui se porte vers l'incertain. Ainsi exempt des soucis qui absorbent, qui torturent la pensée, il n'espère ni ne craint; il ne s'élance point dans le vague du hasard : ce qu'il a lui suffit. Et ne va pas croire que peu lui suffise : il est maître de tout, non comme le fut Alexandre,[7] arrêté au bord de la mer Rouge, et auquel il manquait plus qu'il n'avait conquis; car il n'est même pas sûr de ce qu'il tient, de ce qu'il a dompté, lorsque, au milieu de l'Océan, Onésicrite, son éclaireur, se hasarde sur une mer inconnue à la recherche de nouvelles guerres. Rien prouve-t-il mieux sa pauvreté réelle que cette rage de porter ses armes au delà des bornes de la nature, sur un abime inexploré et sans fond comme sans rives, où le pousse son aveugle, son irrésistible convoitise? Qu'importe tout ce qu'il a pu ravir ou donner de royaumes et combien de provinces il écrase de tributs? Il est pauvre de tout ce qu'il désire.[8] III. Et telle fut la maladie non d'Alexandre seulement, qu'une témérité heureuse poussa sur les traces d'Hercule et de Bacchus, mais de tous ceux que la Fortune combla de ses irritantes faveurs. Passe en revue Cyrus, Cambyse et toute la lignée des rois de Perse, lequel trouveras-tu qui, rassasié de succès, se soit dit: « C'est assez, » et que la mort n'ait pas surpris reculant encore en espoir les bornes de son Empire? Qu'on ne s'en étonne pas : tout ce que la cupidité peut saisir s'absorbe et se perd sans laisser de trace ; si le gouffre est insatiable, il n'importe combien l'on jette. Le sage seul possède et conserve tout sans effort. Il n'a pas de lieutenants à envoyer au delà des mers, ni de camp à tracer sur les rives ennemies, ni de garnisons à répartir dans les postes convenables : il ne lui faut ni légions ni troupes à cheval. Tout de même que les dieux règnent sans armées, et du trône paisible où ils siègent gouvernent tutélairement leur empire, le sage, quelque loin que ses devoirs s'étendent, les accomplit sans trouble ; il est le plus puissant, le meilleur de toute la race humaine, qu'il regarde à ses pieds. Nonobstant vos railleries, c'est le privilège d'une âme sublime, quand l'Orient et l'Occident se découvrent à sa pensée qui pénètre jusqu'aux lieux reculés dont des déserts iv us ferment l'accès, quand elle contemple tant d'êtres divers et cette abondance de toutes choses qu'enfante si libéralement la nature, de pouvoir se dire, comme ferait un dieu : « Tout cela est à moi. » Et c'est ainsi qu'on ne désire plus, puisque au delà de tout il n'y a rien. IV. « C'est cela même que je voulais, dis-tu. Je te tiens : je suis curieux de voir de quelle manière tu te tireras du piège où tu es volontairement tombé. Dis-moi comment il est possible de rien donner au sage, si le sage possède tout? Car l'objet même qu'on lui donne est à lui. Il ne peut donc recevoir un bienfait : on ne lui offre que ce qui lui appartient. A t'entendre, pourtant, on peut donner au sage. » Je réponds, moi, en te faisant au sujet des amis la même objection. « Vous dites qu'entre eux tout est commun : donc on ne saurait rien donner à son ami; ce serait lui donner ce qui lui est commun avec, vous. » Rien n'empêche qu'une chose soit commune au sage et à celui qui la possède, à qui elle fut livrée en propre. Dans le droit politique tout est au roi, et cependant ces biens, dont le roi possède l'uni vénalité, sont répartis entre une foule d'individus, et chaque chose a son maître particulier. Ainsi l'on peut donner au roi une maison, un esclave, de l'argent, sans qu'il soit dit qu'on lui donne son bien à lui. Aux rois est la souveraineté du tout, aux particuliers la propriété. Ce qu'on appelle territoire d'Athènes ou de Campanie se subdivise et se distingue de voisin à voisin par délimitations spéciales, et les champs de l'un comme de l'autre sont tous terres de la république. Individuellement[9] le droit du possesseur est reconnu; et de cette façon je puis donner mes terres à l'État, quoiqu'elles s'appellent terres de l’État, parce qu'il les possède à un titre différent du mien. Met-on en doute que l'esclave avec son pécule n'appartienne au maître? Le maître, toutefois, peut recevoir de l'esclave. Car il n'est pas vrai que l'esclave n'ait rien parce qu'il cessera d'avoir dès que son maître le voudra; et son don ne laisse pas d'en être un, bien qu'il ne donne de plein gré que ce qu'on eût pu lui ravir même malgré lui. Comme nous avons démontré que tout appartient au sage (point sur lequel nous sommes d’accord), il reste à établir ceci : Comment y a-t-il encore matière à libéralité envers l'homme qui possède toute chose, comme nous l'admettons? Au père appartient tout ce dont ses enfants disposent. Qui ne sait pourtant qu'un fils peut aussi donner à son père? Il n'est rien qui ne soit aux dieux : néanmoins nous leur apportons des offrandes, nous leur versons des tributs. Ce que j'ai demeure mien, quoiqu'il soit tien aussi; car il peut être à moi en même temps qu'à toi. « Mais, dit-on, les prostituées sont à l'homme qui en fait trafic : or si tout appartient au sage, les prostituées font partie de ce tout et conséquemment appartiennent au sage; et l'on appelle prostitueur le propriétaire de ces femmes, donc le sage est prostitueur. » De même on ne veut pas qu'il achète, et l'on dit : « Nul n'achète sa propre chose ; or toute chose est au sage, donc il n'achète rien. » On ne veut pas non plus qu'il emprunte, attendu que personne ne paye les intérêts de son propre argent. Je ne saurais nombrer ce qu'on nous suscite de chicanes, quoiqu'on entende à merveille le sens de nos paroles. V. Et en effet, quand je dis que tout appartient au sage, c'est sans déposséder qui que ce soit de ses biens propres: de même que sous un bon roi tout est à lui comme souverain, et aux particuliers comme propriétaires, distinction dont la preuve viendra dans son temps. Pour laquestjon présente, il suffit qu'une chose possédée par le sage et par moi à titres différents puisse être par moi donnée au sage. Rien d'étonnant qu'on puisse donner à qui possède tout. J'ai loué ta maison : j'acquiers là un droit à côté du tien : la chose est à toi, l'usage de la chose à moi. Ainsi encore, tu ne toucheras point, si ton fermier s'y oppose, aux fruits mêmes de tes terres, et, s'il y a cherté ou famine, Ils seront pour autrui ces longs amas de grains,[10] quoique nés de ton fonds et entassés chez toi, et destinés à remplir tes greniers. Et tu n'entreras pas, toi propriétaire, dans ce que tu m'as loué; et ton esclave, devenu mon mercenaire, ne pourra te suivre, et quand j'aurai pris à loyer ta voiture, ce sera bénévolement si je te laisse monter dans ce véhicule qui est à toi. Tu vois donc qu'il peut se faire qu'en recevant sa propre chose se soit un don qu'on reçoive. VI. Dans tous les exemples ci-dessus, il y a deux maîtres d'une même chose, et somment? L'un en est le propriétaire, l'autre l'usufruitier. Les mêmes livres que nous disons être de Cicéron, Dorus le libraire les appelle siens, et ne dit pas moins vrai que nous. L'un les revendique comme auteur, l'autre comme acquéreur, et l'on décide avec raison qu'ils sont à tous deux; car tous deux y ont droit, mais non le même droit. Ainsi Tite Live peut recevoir ses propres écrits de Dorus ou les lui acheter,[11] je puis donner au sage ce qui est à moi personnellement, bien que tout soit à lui. Dès qu'en effet, à l'instar des rois, il possède moralement toutes choses, mais que les propriétés individuelles sont disséminées entre autant de maîtres, rien ne l'empêche de recevoir, de devoir, d'acheter, de louer. César possède tout; mais son trésor ne renferme que ses biens propres et privés : si le monde est sous son empire, son patrimoine se borne à ce qui lui est personnel. On peut discuter si telle chose lui appartient ou non, sans amoindrir sa puissance ; car ce que la loi lui dénie comme revenant à autrui, est à lui sous un autre rapport. De même le sage, qui possède en son âme l'universalité des choses, n'a de droit et en propriété que ses biens à lui. VII. Bion a des arguments pour démontrer tantôt que tout le monde est sacrilège, tantôt que personne ne l'est. Quand il veut tous nous précipiter du roc Tarpéien, il dit : « Quiconque enlève, détruit, détourne à son usage ce qui appartient aux dieux est sacrilège : or toute chose leur appartient; tout ce qu'on prend on le prend donc aux dieux : quiconque prend la moindre chose est donc sacrilège. » Après quoi il nous invite à forcer les temples et à piller impunément le Capitole, en disant que le sacrilège n'existe pas, attendu que tout ce qu'on enlève d'un endroit appartenant aux dieux est transféré dans un endroit qui leur appartient. Ici l'on répond : « Tout sans doute appartient aux dieux, mais tout ne leur est pas consacré. On ne reconnaît de sacrilège qu'à l'égard des choses que la religion assigne à la Divinité. Ainsi le monde entier est le temple des immortels, le seul temple digne de leur grandeur et de leur magnificence;[12] et cependant le profane se distingue du sacré, et tout n'est pas licite dans le sanctuaire appelé fanum, comme il pourrait l'être sous le ciel et en présence des astres. L'homme sacrilège ne peut faire injure à Dieu, que sa nature céleste a placé hors de toute atteinte: mais il est puni pour l'avoir voulu outrager comme Dieu. Sa conscience, comme la nôtre, l'oblige à une réparation pénale. » De même donc qu'on juge sacrilège celui qui dérobe un objet sacré, bien que le fruit du vol, quelque part qu'il l'ait transporté, se trouve dans les limites du monde ; de même on peut voler le sage. Car on lui soustrait non point de ces choses qui rentrent dans son universelle souveraineté, mais de celles qu'il possède à titre particulier, qui lui servent personnellement.il ne reconnaîtra, lui, que la possession du premier genre; pour la seconde, il n'y prétendra point, quand il le pourrait; et on l'entendra dire, comme ce général romain (Cur. Dentatus) auquel on décernait, pour prix de sa valeur et de son dévouement au service de l'État, tout le terrain qu'un sillonne charrue pourrait embrasser en un jour: « Vous n'avez pas besoin d'un citoyen qui aurait besoin de plus qu'un autre citoyen. » N'y avait-il pas, dis-moi, plus de grandeur à refuser cette offre qu'à l'avoir méritée? Car beaucoup envahissent les limites d'autrui, nul ne s'en donne à soi-même. VIII. Ainsi quand nous considérons l'âme du sage, cette souveraine de toutes choses, rayonnant comme telle sur le monde entier, nous disons que tout lui appartient; quant à son droit vulgaire de propriété, il consiste, le cas échéant, à payer le cens personnel. Bien autre chose est de priser sa richesse d'après la grandeur de son âme ou sur le rôle de l'impôt : l'idée de tout avoir, comme vous l'entendez, le révolterait. Je ne rappellerai point Socrate, Chrysippe, Zénon ni tant d'autres grands hommes, d'autant plus grands que l'envie ne fait pas obstacle aux gloires du passé. Je citais tout à l'heure ce même Démétrius que la nature me semble avoir fait naître de nos jours pour constater que ni lui ne pouvait être corrompu par nous, ni nous corrigés par personne,[13] cet homme, bien qu'il s'en défende, d'une sagesse consommée, d'une fermeté de décision inébranlable,[14] d'une éloquence digne de ses mâles doctrines, sans colifichets ni puéril souci de mots, et qui, pleine d'enthousiasme, selon que le souffle l'y porte poursuit jusqu'au bout son sujet. Oui sans doute, si la Providence a donné le spectacle d'une telle vie et d'un tel talent[15] de parole, c'a été pour que notre siècle ne manquât ni de censeur ni de modèle. IX. Si quelque dieu venait offrir à ce Démétrius la possession de ce que nous appelons nos biens, sous l'expresse condition de ne pouvoir en rien donner, j'affirme qu'il refuserait, qu'il dirait : « Qui, moi! m'affubler de ce lourd et inextricable réseau ! Embourber dans cette fange profonde le plus indépendant des hommes! Pourquoi m'adjuger ce que possèdent de maux tous les peuples, ce que je n'accepterais pas, même pour en faire largesse, car j'y vois trop de choses qu'il ne me siérait point de donner! Embrassons, je le veux, d'un coup d'œil ce qui fascine les peuples et les rois : voyons ce que vous payez de votre sang et de vos vies. Étalez-moi les plus riches dépouilles du luxe ; déployez-les par ordre ou, mieux encore, faites-moi du tout un seul monceau. Je vois l'écaillé de la tortue minutieusement travaillée en marqueterie, et l'enveloppe de l'animal le plus difforme et le plus lent achetée à des prix énormes, et la variété même de ses taches qu'on admire remplacée au moyen de l'art par d'autres teintes parfaitement imitées.[16] Je vois des tables faites d'un bois qu'on estime tout le revenu d'un sénateur, et d'autant plus recherché qu'un vice de croissance l'aura déformé par un plus grand nombre de nœuds.[17] Je vois des cristaux qui enflamment les enchères en raison de leur fragilité : car à tout objet la sottise trouve un charme de plus dans le risque même qui devrait la rebuter.[18] Je vois des coupes murrhines:[19] car vos orgies seraient trop peu coûteuses si les rasades[20] dont on se fait raison et qui doivent se vomir ensuite ne se portaient à la ronde dans de profondes pierres précieuses. Je vois des perles dont une seule ne suffit plus pour une oreille, car déjà les oreilles sont faites à porter des fardeaux; on veut des perles accouplées deux par deux et en outre accumulées par étages. Vous n'étiez point assez esclaves des extravagances de vos femmes, si deux ou trois[21] patrimoines ne leur pendaient à chaque oreille. Je vois la soie tissue en vêtements, s'il faut appeler vêtements ce qui ne peut en rien protéger le corps ou du moins la pudeur, ce qui donne à peine à une femme le droit d'assurer qu'elle n'est pas nue.[22] Voilà ce qu'on fait venir à si grands frais et de pays même inconnus au commerce, afin que dans le secret du boudoir ces nobles épouses ne puissent rien montrer à leurs amants qu'elles n'aient laissé voir à tout un public. X. « Avarice, à quoi songes-tu? Que d'objets l'emportent en valeur sur ton or ! Tous ceux dont je viens de parler sont en plus grand honneur et à plus haut prix? Voyons maintenant, passons en revue tes trésors, tes lingots d'or et d'argent, dont l'humaine cupidité s'éblouit! La terre elle-même, en offrant à sa surface tout ce qui pouvait nous être utile, avait caché, enfoui ces métaux; et, comme c'étaient choses nuisibles et qui ne se produiraient au jour que pour le malheur des peuples, elle pesait sur elles de tout son poids.[23] Je vois le fer, qu'on arrache aux mêmes ténèbres que l'or et que l'argent, de peur que l'instrument ni le salaire ne manquent aux hommes pour s'entr'égorger. Encore ceci offre-t-il quelque chose de matériel, quelque chose où l'esprit peut se laisser prendre à l'erreur des yeux: mais je vois aussi des contrats, des billets, des cautionnements, simulacres vides de la possession, des formules[24] dont une avidité malade abuse l'imagination, heureuse de croire à ce qui n'est pas. Qu'est-ce en effet que tout cela? Que sont les placements, les livres d'échéances, les usures, sinon des dénominations que la cupidité va chercher hors de la nature réelle? Je puis me plaindre que cette nature n'ait pas plus profondément enseveli l'or et l'argent, qu'elle ne les ait pas surchargés d'un poids impossible à soulever. Mais que dire des registres, des supputations, de la vente du temps,[25] des sangsues du centième par mois, fléaux volontaires[26] qui découlent de l'état social, ne présentant rien de visible aux yeux, de palpable aux mains, rêves d'une avarice qui n'embrasse que du vent? Oh ! que je plains quiconque fonde sa joie sur l'énorme liste de ses domaines, sur de vastes espaces de terre cultivés par des malheureux enchaînés, et sur d'immenses troupeaux qui ont des provinces et des royaumes pour pacages, et sur un domestique plus nombreux que de belliqueuses nations, et sur des édifices privés qui surpassent en étendue de grandes villes ! Quand il aura bien couvé des yeux tous ces objets sur lesquels il a réparti et disséminé au loin sa fortune, quand il se sera bien gonflé d'orgueil, qu'il compare ce qu'il possède avec ce qu'il désire, il est pauvre. Laisse-moi libre, et rends-moi à mes vrais trésors. Mon royaume, à moi, c'est la sagesse : il est immense, il est paisible; je possède toutes choses à condition qu'elles soient à tous. » XI. Aussi un jour que Caligula lui offrait deux cent mille sesterces, Démétrius se mit à rire et les refusa, ne jugeant même point qu'il y eût dans ce chiffre de quoi se vanter du refus. Bons dieux! quelle mesquinerie pour honorer une telle âme ou pour la séduire ! Rendons témoignage à cet homme il lustre. On m'a cité de lui un mot admirable ; comme il s'étonnait que Caïus ait eu la folie de penser le corrompre à ce prix : « S'il avait résolu de m'éprouver, dit-il, c'est tout son empire qu'il devait m'offrir. » XII. Ainsi l'on peut donner au sage, bien que tout lui appartienne; de même, quoique nous disions qu'entre amis tout est commun, rien n'empêche de faire un don à son ami. Car cette communauté avec un ami n'est pas celle d'un associé qui a sa part comme moi la mienne : c'est celle du père et de la mère qui, ayant deux enfants, n'ont pas chacun le leur, mais en ont chacun deux. Or avant tout je veux faire savoir à quiconque m'invite à m'associer avec lui qu'entre nous deux il n'y a rien de commun. Pourquoi? c'est qu'une telle communauté n'a lieu qu'entre sages ; ils sont tous amis. Les autres ne sont pas plus amis qu'associés.[27] D'ailleurs il est plus d'un genre de communauté. Les bancs des chevaliers appartiennent a tout chevalier romain ; et sur ces bancs toutefois la place que j'ai prise me devient propre. Si je la cède à un autre, bien qu'elle me soit commune avec lui, je passe pour lui faire une faveur. Certaines choses ne donnent certains droits qu'à une condition spéciale. J'ai ma place aux bancs des chevaliers non pour la vendre, ni pour la louer, ni pour y être à demeure : c'est à la seule fin d'y voir le spectacle. Je ne mentirai donc pas si je dis que j'ai ma place sur ces bancs; mais si je viens au théâtre et qu'ils soient tous remplis, j'ai là ma place de droit, puisqu'il m'est permis de m'y asseoir, et je ne l'ai pas, puisque ceux qui jouissent du même droit que moi les occupent toutes. Sache qu'il en est de même entre amis. Tout ce que possède mon ami nous est commun à tous deux, mais reste propre au détenteur : en disposer sans son aveu m'est interdit. « Vous vous moquez, dira-t-on; si les biens de mon ami sont à moi, je pourrai les vendre. » Non, pas plus que les places de chevaliers, bien qu'elles vous soient communes avec les autres chevaliers. Ne concluez pas qu'une chose n'est point à vous de ce que vous ne pouvez ni la vendre, ni la consommer, ni la détériorer ou l'améliorer. Cette chose est vôtre, bien qu'elle ne soit vôtre qu'avec restriction. Vous avez reçu, mais tous ont reçu au même titre. XIII. Disons, pour ne pas te faire trop languir : le bienfait ne saurait croître en grandeur, mais les circonstances du bienfait peuvent grandir, se multiplier et offrir un champ plus vaste aux effusions d'une libéralité qui suive son penchant comme les amants s'abandonnent au leur : ceux-ci, par de nombreux baisers, par d’étroits embrassements, n'augmentent pas leur tendresse, mais lui donnent carrière. La question qui vient ensuite a été aussi traitée à fond dans les premiers livres : je l'effleurerai donc brièvement, car on y peut rattacher tous les arguments présentés ailleurs. La voici : Celui qui a tout fait pour payer sa dette l'a-t-il payée? La preuve, dit-on, qu'il n'a pas payé, c'est qu'il a tout fait sans y réussir. Évidemment donc la chose n'a point eu lieu, dès que l'occasion a manqué. Et le débiteur n'a point remboursé quand, pour y parvenir, il a partout cherché sans trouver sa somme. Il est des choses de nature telle qu'elles doivent se résoudre en effets; il en est d'autres où l'on répute pour effets d'avoir tout tenté pour effectuer. Si le médecin, pour me guérir, a épuisé les ressources de l'art, toute sa tâche est remplie; son client eût-il succombé, l'orateur a toujours le mérite de l'éloquence qu'il a déployée, s'il a fait valoir tous les moyens de droit; la gloire ne couronne pas moins le général malheureux à la guerre, si d'ailleurs sa prudence, ses talents, sa valeur ont répondu à ce qu'on attendait de lui.[28] L'obligé a tout fait pour te rendre : ta prospérité l'en a empêché. Aucune disgrâce ne t'est survenue qui mît à l'épreuve la sincérité de son amitié. Il n'a pu donner à un riche, veiller au chevet d'un homme bien portant, assister un heureux. Il s'est acquitté, bien que tu n'aies pas recouvré ton bienfait. En un mot, l'homme qui toujours rêve à se libérer, qui en épie l'occasion, qui n'y épargne ni soins ni peine, a plus fait que celui qui doit au hasard de s'être acquitté promptement. XIV. La comparaison du débiteur est inexacte : il ne suffit pas à celui-ci d'avoir cherché de l'argent, s'il ne paye ; il a toujours en face l'impitoyable créancier qui ne laisse pas un jour s'écouler gratis. Le bienfaiteur, plein de bonté, témoin de tes mille démarches, de tes soucis, de tes anxiétés, te dira : « Bannis ce soin de ta pensée.[29] Cesse de te persécuter toi-même. Tu m'as tout rendu. Tu me ferais, injure de croire que je désire rien de plus. Je suis pleinement récompensé par ton intention. » On me demandera si c'est avoir, selon moi, rendu le bienfait que d'avoir de la sorte montré sa gratitude. A ce compte, dira-t-on, il n'y a nulle différence entre rendre et ne rendre pas. Je répondrai par l'hypothèse d'un homme qui aurait oublié le bienfait reçu, qui n'aurait pas même tenté de le reconnaître : on niera certes qu'il se soit acquitté. L'autre, au contraire, a nuit et jour prodigué sa peine, négligeant tout autre devoir, ne s'attachant, ne travaillant qu'à une seule chose, à ne laisser fuir : aucune occasion. Mettra-t-on sur la même ligne celui qui n'a eu cure de se montrer reconnaissant et l'homme qui n'a jamais perdu la pensée du devoir? Il y aurait injustice à exiger de moi des effets, quand il est clair que l'intention ne m'a point manqué. Enfin suppose que, te sachant captif, j'emprunte de l'argent et laisse pour sûreté au créancier mes biens en gage; que je côtoie, par un hiver déjà rigoureux, des rivages infestés de brigands et que j'essuie tout ce que la mer peut offrir de périls, même aux temps de calme; que je parcoure d'immenses solitudes, cherchant ce que tout navigateur fuyait, les pirates qu'à la fin je trouve, lorsqu'un autre déjà t'a racheté, nieras-tu que je me sois acquitté? Et si, durant cette traversée, l'argent que je m'étais procuré pour ta rançon je l'ai perdu dans un naufrage? Et si, en Voulant t'affranchir de tes fers, moi-même j'y suis tombé, nieras-tu que je me sois acquitté? Certes, Harmodius et Aristôgiton reçoivent des Athéniens le titre de tyrannicides; la main que laissa Mucius sur le foyer ennemi l'illustra autant que l'eût fait la mort de Porsenna; et toujours la vertu qui a lutté contre la Fortune, lors même qu'échoue son entreprise, en sort glorieusement.il est plus méritoire de poursuivre des occasions qui fuient sans cesse et de tenter mille et mille voies pour arriver à témoigner sa gratitude que de se trouver reconnaissant sans la moindre peine, à la première occasion. XV. « Le bienfaiteur, me dit-on, t'a obligé doublement, d'intention et de fait ; et tu lui es doublement redevable. » On peut tenir ce langage à qui ne témoignerait qu'une oisive intention : mais celui qui, outre l'intention, fait effort et n'omet aucune tentative, celui-là ne le mérite pas : car il satisfait aux deux choses autant qu'il est en lui. Et puis il ne faut pas toujours comparer les choses numériquement : quelquefois une seule en vaut deux. Ici, par exemple, l'effet est compensé par cette volonté si dévouée, si désireuse de rendre. Que si l'intention sans le fait est un retour insuffisant, nul ne s'acquitte envers les dieux, auxquels on n'offre que l'intention. « C'est, dira-t-on, qu'où ne peut leur donner autre chose. » Eh bien! si je ne puis faire mieux pour mon bienfaiteur, pourquoi ne serai-je pas reconnaissant envers cet homme de la même façon qu'envers les dieux? XVI. Si pourtant tu me demandes mon avis, si tu veux que je te signifie ma réponse, ce sera que l'un se croie payé et que l'autre sache qu'il n'a point rendu; que le bienfaiteur libère l'obligé et que celui-ci se tienne lié; que le premier dise : « J'ai reçu, » et que l'autre réponde : « Je dois. » Dans toute question ayons en vue l'intérêt social. Il faut fermer aux ingrats toute excuse qui pourrait leur être une échappatoire, un prétexte à nier leur dette. Tu as tout fait, dis-tu : eh bien! fais encore. Crois-tu nos pères assez peu sensés pour n'avoir pas compris qu'il est fort injuste de mettre sur la même ligne celui qui dissipe en débauches ou au jeu l'argent reçu de son créancier, et l'homme à qui un incendie, un vol ou quelque autre accident fâcheux font perdre le bien d'autrui avec le sien? S'ils n'ont admis aucune excuse, c'était pour apprendre aux hommes qu'ils doivent à tout prix tenir leur parole. Car il valait mieux rejeter un petit nombre d'excuses même fondées que de permettre à tous d'en hasarder de mauvaises. Tu as tout fait pour rendre. Cela doit suffire à ton bienfaiteur; pour toi, c'est trop peu. De même, en effet, que s'il laisse ton zèle le plus ardent et le plus dévoué passer sous ses yeux comme non avenu, il ne mérite plus de retour; de même aussi tu es ingrat si, quand il accepte comme payement ta bonne volonté, tu ne te crois pas d'autant plus redevable que l'on te tient quitte. Ne t'empare point de cet aveu, n'en prends pas acte, n'en cherche pas moins les occasions de rendre. Rends à l'un parce qu'il te répète, à l'autre parce qu'il te fait remise; à celui-ci parce qu'il est méchant homme, à celui-là parce qu'il ne l'est point. Aussi ne crois pas que cette question-ci te concerne : Le bienfait reçu d'un homme vertueux doit il se rendre quand cet homme cesse de l'être et qu'il tourne au mal? Car tu lui rendrais un dépôt qu'il t'aurait remis étant sage ; car, fût-il devenu méchant, tu lui paierais une dette : pourquoi pas aussi un bienfait? Parce qu'il change, doit-il te changer? Ce que tu recevrais d'un homme bien portant, tu ne le rendrais donc pas s'il tombait malade? Comme si toujours un ami souffrant n'avait pas plus de droits sur nous! Eh bien, l'âme de celui-ci est malade : assiste-le, supporte-le;[30] le vice est une maladie morale. Mais je crois qu'ici, pour mieux comprendre, il faut distinguer XVII. Il y a deux genres de bienfaits : l'un, que le sage seul peut conférer au sage, c'est le bienfait par excellence et le seul vrai; l'autre, vulgaire et plébéien, qui s'échange entre nous autres ignorants. Sur celui-ci, point de doute qu'on ne doive le rendre, quel qu'en soit l'auteur, devînt-il homicide, voleur, adultère par la suite. Il y a des lois pour les crimes, et le juge corrige mieux que l'ingrat. Nul ne doit te rendre méchant parce qu'il l'est lui-même. Au méchant, je jetterai vite son bien fait; au bon, je rendrai: à celui-ci parce que je dois; à l'autre pour ne plus devoir. XVIII. Quant au premier genre de bienfait il y a doute. Si je n'ai pu recevoir qu'à titre de sage, ce n'est donc qu'à un sage que je puis rendre. Quand je lui rendrais, il ne pourrait plus recevoir; il n'est plus apte au bienfait, il ne sait plus l'art d'en user. Me dirais-tu de renvoyer la balle à un manchot? Ce serait folie de donner à quelqu'un ce qu'il ne peut reprendre. Pour répondre d'abord à ces derniers mots : je ne lui donnerai pas ce qu'il ne pourra recevoir; je lui rendrai, même s'il ne peut reprendre; car si je ne puis obliger sans qu'on reçoive, je ne me libérerai qu'en restituant. « Il ne pourra en tirer parti? » C'est son affaire; à lui la faute, non à moi. XIX. « Rendre, dit-on, c'est remettre à quelqu'un qui reçoive. Car enfin, si tu me dois du vin et que je te dise de le répandre sur un tamis ou sur un crible, prétendras-tu que cela c'est rendre? me voudras-tu rendre une chose qui, au moment de la restitution, sera perdue entre nous deux ? Selon moi, rendre c'est livrer la chose due au propriétaire, et quand il la veut. Voilà tout ce que j'ai à faire. Que la chose rendue lui reste, ce soin-là ne nie concerne plus. Je ne lui dois pas ma tutelle, mais ma parole; il vaut bien mieux encore qu'il ne conserve pas que si je ne rendais point. Je rendrai, même à un créancier qui sur le champ dépenserait la somme en gourmandises : m'eût-il délégué sa concubine pour toucher l'argent, je le verserai; dût-il jeter dans les plis d'une robe sans ceinture les écus qu'il recevra, je les donnerai. Car je dois rendre, et non conserver ou défendre ce que j'aurai rendu. C'est du bienfait reçu, ce n'est pas du bienfait, rendu que la garde m'est imposée. Tant qu'il est chez moi il doit être intact; mais, dût-il glisser des mains qui vont le reprendre, je lé livrerai si on le réclame. Je rendrai à l'honnête homme selon sa convenance; au méchant dès qu'il demandera. « Mais, dit-on, tu ne peux lui rendre son bienfait tel que tu l'as reçu. Tu l'as reçu d'un sage, tu le rends à un fou. » Non pas : je le lui rends tel qu'il peut maintenant le recevoir : ce n'est point par mon fait qu'il est amoindri, c'est par le sien. Ce que j'ai reçu, je le rendrai. S'il est revenu à la sagesse, je le lui rendrai tel que je l'ai reçu, tant qu'il compte parmi les méchants, je ne le rends que tel qu'il peut le recevoir. « Quoi! s'il est devenu non seulement méchant, mais cruel, mais atroce, tel qu'un Apollodore, un Phalaris, lui rendras-tu même alors le bienfait que tu auras reçu? » Une aussi grande métamorphose chez le sage n'est point dans la nature : car en tombant d'un état parfait dans la pire des situations, nécessairement il a gardé, même dans le mal, quelques vestiges du bien. Jamais la vertu ne s’éteint si complètement qu'elle ne laisse imprimés dans l'âme des caractères trop profonds pour qu'aucun changement les puisse effacer. L'animal sauvage qui, élevé parmi nous, s'est enfui de nouveau dans ses forêts, y retient quelque chose de ses mœurs radoucies, et diffère autant des races toutes domestiques que de ces races vraiment indomptées qui n’ont jamais souffert la main de l'homme. Nul mortel ne tombe au dernier degré de la perversité, pour peu qu'il se soit attaché à la sagesse. Il en est trop intimement empreint pour l'avoir pu dépouiller toute et passer à !a teinte opposée. Je demanderai ensuite si cet homme n'est cruel que dans le secret de son cœur, ou si c'est un génie destructeur qui se déchaîne sur les peuples. Car tu me présentes un Apollodore, un Phalaris ; si le caractère de ces tyrans est au fond le sien, certes je lui renverrais son bienfait, pour que de lui à moi nul lien ne subsiste. Mais si le sang humain est une joie, une pâture pour lui ; si les supplices d'hommes de tout âge deviennent les passe-temps de son insatiable barbarie; si ce n'est plus la colère, mais je ne sais quelle soif de meurtre qui l'enivre; s'il égorge les fils en présence du père; si, peu content de la mort simple, il torture et fait non seulement brûler, mais rôtir ses malheureuses victimes; si son château-fort dégoutte sans cesse d'un carnage récent, c'est trop peu de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les nœuds qui l'unissaient à moi, la violation du droit humain et social les a tranchés. Qu'un homme m'ait fait quelque avantage, mais qu'il porte les armes contre ma patrie, tous ses droits sur moi sont perdus, et ma reconnaissance passerait pour un crime. S'il n'attaque pas ma patrie, mais qu'il opprime la sienne; si, trop éloigné de mes concitoyens, ce sont les siens qu'il tourmente, une telle dépravation morale n'en a pas moins tout rompu entre nous. Pour n'être pas mon ennemi, il ne m'en est pas moins odieux, et mes devoirs envers le genre humain me commandent d'abord et plus haut que ma dette envers un seul homme. XX. Mais les choses fussent-elles à ce point, et eussé-je dès lors toutes représailles libres envers un homme qui, brisant tous les devoirs, a donné contre lui le droit de tout faire, je croirai devoir garder une mesure telle que, si ma restitution n'est capable ni d'augmenter son pouvoir désastreux pour tous, ni de l'affermir, et qu'elle puisse se faire sans entraîner la ruine publique, je la ferai. Je sauverai son fils en bas âge : en quoi ce service nuit-il à aucun de ceux que sa cruauté déchire? Mais de l'argent pour stipendier et retenir ses satellites, je ne lui en fournirai point. S'il désire des marbres, de riches costumes, cet attirail de luxe ne peut chez lui faire tort à personne : mais je ne lui donnerai ni armes, ni soldats. S'il demande comme cadeau d'un grand prix des artistes scéniques, des courtisanes,[31] de ces choses qui peuvent amollir son humeur féroce, volontiers les lui offrirai-je. Je ne lui enverrai ni trirèmes, ni bâtiments de guerre; mais des vaisseaux de plaisance et de parade et autres fantaisies de rois qui s'ébattent sur la mer, à la bonne heure. Et si la guérison de cette âme est totalement désespérée, du même coup je rendrai service au monde et m'acquitterai envers l'bomme, puisque pour de tels caractères sortir de la vie est le seul remède, et que le mieux est de cesser d'être quand on ne peut plus revenir à soi.[32] Mais de pareils monstres sont rares et passent toujours pour des phénomènes, comme les brusques déchirements du sol et l'éruption de volcans sous-marins. Donc éloignons d'eux notre pensée ; parlons de ces vices que l'on déteste, mais sans frémir. Ce méchant homme, que je puis rencontrer dans le premier marché venu, et qu'individuellement on redoute, recouvrera auprès de moi le bienfait que j'aurai reçu de lui. Il n'est pas juste que son iniquité me profite : que ce qui n'est pas à moi retourne au possesseur, bon ou méchant. Avec quel scrupule je ferais mon enquête si, au lieu de rendre, je voulais donner! Il faut qu'ici je cite une anecdote. XXI. Un pythagoricien avait acheté d'un cordonnier une paire de sandales, grosse emplette pour lui, et n'avait pu payer comptant. Quelques jours après il revient à la boutique pour se libérer, la trouve close et frappe longtemps. A la fin quelqu'un lui dit : « Vous perdez votre peine : le cordonnier que vous cherchez est mort et déjà en cendre. Cela peut nous sembler fâcheux, à nous qui perdons les nôtres pour toujours ; mais à vous, bagatelle! vous savez bien qu'il ressuscitera. » Ainsi raillait-il le pythagoricien. Et notre philosophe remporte chez lui sans trop de regret ses trois ou quatre deniers, qu'il fait de temps en temps sonner dans sa main. Peu après il se reprocha le secret plaisir de n'avoir pas rendu ; voyant trop que cette triste aubaine lui avait souri, il reprit le chemin de la boutique et se dit : « Le cordonnier pour toi vit encore ; rends ce que tu dois. » Puis, par un endroit de la cloison où les planches s'étaient disjointes, il glisse et fait tomber dans l'intérieur quatre deniers, pour se punir d'un coupable désir et ne point s'accoutumer à retenir le bien d'autrui. XXII. Ce que tu dois, cherche à qui le rendre : si nul ne réclame, il faut te sommer toi-même; que ton bienfaiteur soit bon ou méchant, peu t'importe. Paye-le, tu l'accuseras après, et rappelle-toi comment les rôles sont partagés entre vous deux. A lui l'oubli est demandé, ton devoir à toi est de te souvenir. On aurait tort toutefois de croire qu'en disant que l'auteur du bienfait doit oublier, nous voulons lui enlever la mémoire de ce qu'il y a au monde de plus honorable. Si parfois nos préceptes dépassent la mesure, c'est pour mieux revenir au vrai et à leur point. Quand nous disons qu'il ne doit pas se souvenir, nous voulons faire entendre qu'il ne doit pas publier ses actes, ni en tirer gloire, ni se rendre importun. Certaines gens vont de cercle en cercle raconter tout le bien qu'ils ont fait: ils en parlent à jeun, ils ne peuvent s'en taire dans l'ivresse, ils en étourdissent les inconnus, ils le confient à leurs amis. Pour guérir cette manie de souvenirs qui sont de vrais reproches, nous avons prescrit l'oubli au bienfaiteur ; et lui commander au delà du possible, c'était lui conseiller le silence. XXIII. Chaque fois qu'on se défie d'un homme à qui l'on impose une tâche, on doit lui demander plus qu'il ne faut pour en obtenir tout ce qu'il faut. Une hyperbole n'exagère qu'afin d'atteindre à la réalité par le mensonge. Le poète qui parle de coursiers Plus légers que les vents et plus blancs que la neige, parle d'une chose impossible pour faire admettre le mieux possible. Et celui qui a dit d'un homme : Plus ferme que ces rocs, plus fougueux qu'un torrent, ne comptait persuader à personne qu'un homme fût aussi ferme qu'un rocher. Jamais l'hyperbole n'espère en proportion de ce qu'elle ose; mais[33] elle affirme l'incroyable de peur d'être au-dessous du croyable. Quand nous disons : « Que l'auteur du bienfait l'oublie, » nous voulons dire : « Qu'il paraisse l'oublier; que ses souvenirs ne se laissent pas voir, ne nous assiègent pas. » En avançant que le bienfait ne doit pas se redemander, nous ne proscrivons point toute réclamation ; souvent, en effet, les méchants ont besoin qu'on les presse, et les bons même qu'on les avertisse. Eh quoi! ne montrerai-je pas l'occasion à qui ne la voit point? Ne lui révélerai-je pas mes besoins, que plus tard il feindrait ou gémirait d'avoir ignorés? Faisons intervenir parfois, l'avertissement, mais avec réserve : point de requête ni d'appel au droit. XXIV. Socrate dit un jour devant ses amis : « J'aurais acheté un manteau, si j'avais eu de l'argent. » Sans demander à aucun d'eux, il les avertit tous, et ce fut à qui l'obligerait. Après tout, c'était si peu de chose qu'allait recevoir Socrate ! mais c'était beaucoup d'être l'homme de qui Socrate voudrait recevoir. Pouvait-il leur faire plus doucement la leçon? « J'aurais acheté un manteau, si j'avais eu de l'argent. » Cette parole dite, le don le plus empressé vient trop tard : il a laissé Socrate au dépourvu. C'est à cause des trop rigoureuses exigences que nous défendons de redemander, non pour qu'on ne le fasse jamais, mais pour qu'on y mette de la discrétion. XXV. Aristippe, un jour, savourant des parfums, s'écria : « Maudits soient les efféminés qui ont fait décrier une si douce chose! » A notre tour disons : Maudits soient ces déloyaux, ces importuns usuriers de bienfaisance qui ont aboli ce beau droit, le droit de rappel entre amis ! N'importe! j'userai, moi, de cette prérogative de l'amitié, et demanderai le retour d'un service à l'homme que j'eusse prié de ce même service. Il acceptera comme une grâce nouvelle l'occasion de s'acquitter. Jamais, dussé-je en venir à la plainte, je ne dirai : Jeté nu sur ces bords, je l'arrache au trépas; Je partage, insensée, avec lui mes États.[34] Ce n'est point là un avertissement : c'est un amer reproche. C'est rendre ses bienfaits haïssables; c'est faire que l'ingratitude devienne un droit, un plaisir. Il suffit et au delà de ces autres paroles modestes et affectueuses qui réveillent les souvenirs : Si j'ai bien mérité de toi, si dans ton cœur J'eus quelque place[35] ……………………. C'est à l'autre, en revanche, à dire : « Dieux! si tu as mérité! Jeté sur le rivage, dépouillé de tout, tu m'as recueilli. » XXVI. « Mais, dit-on, nul moyen ne sert. Il dissimule, il a oublie : que dois-je faire? » Tu poses là une question de haute importance et par laquelle il convient de couronner cet ouvrage : comment faut-il supporter les ingrats? Dans un esprit de calme, de douceur, de magnanimité. Que jamais l'âme la plus insensible, la plus oublieuse, la plus ingrate, ne te blesse au point qu'il ne te reste même plus la satisfaction d'avoir donné. Que jamais mauvais procédé ne t'arrache ces paroles : « Je voudrais ne l'avoir point fait. » Que ton bienfait, même malheureux, conserve encore pour toi ses charmes. L'ingrat se repentira toute sa vie si, même à ce moment, toi tu ne te repens point.[36] Il n'y a pas à t'indigner de cet accident comme de quelque chose d'inouï, tu devrais t'étonner plutôt si cela n'arrivait point. C'est ou la peine ou la dépense qui rebute ces hommes, ou le risque à courir, ou la mauvaise honte d'avouer en rendant qu'ils ont reçu; chez l'un c'est faute de savoir s'y prendre, chez l'autre indolence, chez un autre trop d'occupations. Vois ces immenses cupidités béantes et demandant toujours : t'étonneras-tu que nul ne rende, quand nul ne croit recevoir assez? Est-il parmi de telles gens une âme tellement sûre et solide qu'on y puisse déposer sans risque un bienfait? Ils sont forcenés de luxure ou esclaves de leur ventre, ou tout entiers au lucre, dont le chiffre seul, non les moyens, les préoccupe; travaillés soit par l'envie, soit par l'ambition qui se rue en aveugle à travers les glaives. Et que d'âmes paralysées et décrépites! Et, à l'opposé, que de cœurs inquiets, agités, en tourmente perpétuelle! Et puis l'excessive estime de soi, et l'impudence, gonflée de ce qui fait sa honte. Que dirai-je des tendances obstinées au mal, de ces légèretés d'humeur voltigeant sans cesse d'un projet à l'autre? Que l'on y joigne la témérité étourdie, et la crainte, toujours infidèle conseillère, et ce labyrinthe d'inconséquences où se débattent les hommes, l'audace chez les lâches, la discorde entre les plus intimes, et l'universelle maladie d'avoir foi en l'incertitude même, de dédaigner ce qu'on possède, de convoiter ce qu'on avait jugé inespérable. XXVII. C'est parmi les passions les plus orageuses que tu cherches la vertu la plus calme, la fidélité. Si l'exacte image de la vie humaine s'offrait à tes regards, il te semblerait voir le tableau d'une ville emportée d'assaut où, sans pudeur ni respect du juste, la force prend-conseil d'elle seule, comme au signal donné d'un bouleversement général. On ne s'abstient ni du fer ni de la flamme ; le crime est libre du frein des lois ; la religion elle-même, cette sauvegarde des suppliants au milieu des armes ennemies, n'est d'aucun obstacle pour des gens qui courent à la proie. C'est à qui pillera le particulier, le public, le profane, le sacré: on brise, on escalade; impatient d'une voie trop étroite, on renverse tout ce qui gêne, on marche au butin sur des ruines. L'un dépouille et n'égorge pas ; l'autre a le bras chargé de sanglantes rapines; pas un qui n'emporte quelque chose d'autrui. Au milieu de cette avidité de la race humaine, certes tu oublies trop quel sort pèse sur nous tous, si tu cherches dans une armée de ravisseurs quelqu'un qui restitue. Tu t'indignes qu'il y ait des ingrats ! Indigne-toi donc qu'il y ait des fastueux, qu'il y ait des avares, des impudiques; indigne-toi que la maladie soit hideuse, que la vieillesse soit blême.[37] L'ingratitude est un vice affreux, intolérable, qui rompt toute, société entre les hommes et détruit la concorde, cet appui-de notre débilité ; et pourtant ce vice est tellement vulgaire que celui même qui s'en plaint n'y a pas échappé. XXVIII. Demande à ta conscience si tous ceux qui t'ont obligé t'ont trouvé reconnaissant ; si jamais bienfait ne s'est perdu dans ton âme, si la mémoire de tous les services qui te furent rendus ne t'a point quitté. Tu verras ceux qu'on a prodigués à ton enfance évanouis avant ta jeunesse; d'autres, placés sur ta jeunesse, n'ont point duré jusqu'à tes vieux jours. Certains souvenirs se perdent, d'autres sont repoussés ; ou peu à peu ils se dérobent à notre vue, ou nos regards s'en détournent. Disons, pour excuser à tes yeux ta faiblesse, que ta mémoire, la première, est fragile et ne suffit pas à la multitude des objets. Nécessairement, à mesure qu'elle reçoit elle doit perdre, et les impressions dernières étouffent les plus anciennes. De là est venu que ta nourrice n’a plus qu'une minime influence sur toi, les années qui suivirent ayant laissé tous ses bons offices en arrière. Ainsi s'en allèrent tes premiers respects pour ton précepteur;[38] ainsi, tout occupé des comices consulaires ou candidat aux sacerdoces, les votes qui t'ont fait questeur sont déjà loin de ta pensée. Peut-être le vice dont tu te; plains, si tu secoues avec soin les replis de ton âme, tu l'y trouveras caché. S'irriter d'un tort que tous partagent, c'est injustice ; qui est le tien, c'est folie. Pour être absous, sois indulgent. La tolérance ramènera le coupable; les reproches certes l'éloigneraient. Garde que son front ne s'endurcisse ; quelque pudeur peut y survivre : souffre qu'il la conserve. Souvent la voix trop hautaine du reproche a rompu les hésitations du respect humain : nul ne craint d'être ce qu'il paraît déjà;[39] démasqué, on met bas toute honte.[40] XXIX. « J'ai perdu mon bienfait! » Ce que l'on consacre aux dieux, dit-on jamais qu'on l'a perdu? Le bienfait est au rang des choses consacrées si, tout stérile qu'il puisse être, on l'a placé à bonne intention. « Cet homme n'est pas tel que nous l'espérions! s Soyons tels que nous fûmes : ne l'imitons pas. Elle a eu lieu dès l'origine, la perte dont tu t'aperçois seulement. Ce n'est pas sans mortification pour toi-même que tu dénonces l'ingrat : car se plaindre d'un bienfait perdu, c'est signe qu'on avait mal donné. Plaidons de notre mieux devant nous-mêmes la cause de l'ingrat : peut-être n'a-t-il pas pu, peut-être n'a-t-i! pas su, peut-être rendra-t-il. Plus d'un mauvais titre est devenu bon, grâce à la sage lenteur du créancier qui a soutenu, qui a aidé par des délais. Faisons de même : prêtons secours à une reconnaissance qui chancelle. XXX. « J'ai perdu mon bienfait! » Insensé! tu ne connais pas la date de ta perte. Tu as perdu, mais au moment où tu donnais : ta perte aujourd'hui se déclare. Dans les cas même qui semblent désespérés, les ménagements parfois ont grandement servi. Comme les plaies dû corps, celles de l'âme veulent être touchées avec délicatesse; souvent l'abcès que le temps eût ouvert, une obstination brutale le déchire. Qu'est-il besoin de mots blessants, de plaintes, de reproches sans fin? Pourquoi me faire grâce, me tenir quitte? Si je suis ingrat, me voilà libéré sans toi. Qui te pousse à m'exaspérer, après que tu as tant fait pour moi? Veux-tu qu'un ami douteux se changé en ennemi déclaré et cherche, pour réhabiliter son honneur, à flétrir le tien, et qu'on dise : « Je ne sais pourquoi cet homme, à qui il devait tant, lui est devenu insupportable. Il y a là-dessous quelque chose. » Toute plainte[41] contre un supérieur, si elle ne la souille pas, ternit sa dignité ; et nul ne s'en tient à de légères imputations : car l'énormité du mensonge est un moyen de l'accréditer. XXXI. Combien je préfère la méthode qui nous fait conserver les dehors de l'amitié pour l'ingrat, et l'amitié même, s'il veut venir à résipiscence! Une bonté opiniâtre triomphe du plus mauvais cœur; et il n'en est point d'assez durs, d'assez rétifs à tout ce qui se fait aimer, pour ne pas affectionner le bienfaiteur même qu'ils outragent,[42] auquel ils doivent dès lors, comme une obligation de plus, l'impunité de leur banqueroute. Tes réflexions donc doivent aboutir à ceci : « On ne m'a point payé de retour : que faire? » Imiter les dieux, ces généreux auteurs de toutes choses, qui nous l'ont du bien avant que nous puissions : les connaître, qui persistent lors même que nous les méconnaissons. Celui-ci les accuse d'indifférence envers nous, celui-là d'injustice; un autre les chasse du monde, leur ouvrage,[43] comme insouciants, privés de sensibilité, de lumière et d'action : il n'en tient nul compte; le soleil, à qui nous devons de partager les heures entre le travail et le repos, et de n'être pas plongés dans les ténèbres et le chaos d'une éternelle nuit ; le soleil qui dans sa course gouverne l'année, alimente les corps, fait croître les plantes et mûrir les fruits, tel autre l'appelle une sorte de pierre ou un globe de feux concentrés par hasard, enfin toute autre chose qu'un dieu. Et cependant, pareils à ces bons pères qui, aux bravades de leurs jeunes enfants, ne savent que sourire, les dieux ne laissent pas d'accumuler leurs bienfaits sur ceux qui mettent en problème l'existence de ces bienfaiteurs : leur main impartiale dispense ses faveurs sur les grands peuples comme sur les plus minces tribus ; leur lot, leur unique puissance est de faire le bien. Ils versent à propos les pluies sur la terre, balancent les mers de leur souffle, marquent les saisons par la révolution des astres, aux temps froids de même qu'aux temps chauds nous envoient pour les adoucir des brises caressantes, et souffrent avec le calme de l'indulgence l'erreur de leurs faillibles créatures.[44][45] Prenons-les pour modèles. Donnons, quand nous aurions beaucoup donné en vain : donnons malgré tout, soit à d'autres, soit à ceux mêmes qui nous ont fait perdre. Jamais l'écroulement d'une maison n'empêcha de la relever, et quand le feu a dévoré nos pénates, à cette place encore tiède nous posons des fondements nouveaux, et des villes mainte fois englouties se rebâtissent hardiment[46] sur le même sol. Tant notre âme est tenace à bien espérer de l'avenir ! Sur la terre comme sar l'onde tout travail humain s'arrêterait, si les tentatives malheureuses ne laissaient le désir de recommencer. XXXII. « Il est ingrat ! » Ce n'est pas à moi qu'il a fait tort, c'est à lui : j'ai joui de mon service, au moment même où je le rendais. N'en soyons pas plus lent à donner, mais plus circonspect. Ce que l'un m'a fait perdre, d'autres m'en indemniseront. Mais lui aussi je l'obligerai de nouveau : comme le bon agriculteur, à force de soins, de culture, je vaincrai la stérilité du sol ; et si' le bienfait est perdu pour mol, lui le sera pour tout le monde. Ce n'est pas tout pour un grand cœur de donner et de perdre : un grand cœur doit perdre et donner encore. [1] Virg., Géorg., II, 45. [2] Voy. sur Démétrius, De la Providence, iii, Lettre xcxiv, et plus bas, ch. viii. [3] Voy. De la vie heureuse, xviii, et Lettre xx. [4] Le trop d’expédients peut gâter une affaire On perd du temps au choix, on fête, on veut tout faire. N’en ayons qu’un, mais qu’il soit bon. (La Font.) [5] Heureux de sa raison qui suit toujours la pente, Qui sans chercher au loin un bonheur hasardé, S’est avec son destin sans peine accommodé; Craignant, désirant peu, modeste, sans système, Sachant trouver tout fait son bonheur eh lui-même. (Ducis, Epît. à Bouffl.) [6] Revela Domino opera tua. (Prov. xvi, 3.) [7] Voy. Lettres xvii, lxi, xci, xcxiv et alias ; et Boileau, Sat. viii. [8] Moins riche de ce qu’il possède, Que pauvre de ce qu’il n’a pas. (J. B. Rousseau) [9] Au texte: pars .... quoque. Je lis avec un mss. quaeque. [10] Virg., Géorg., I, 158. [11] Exigis ut donem nostros tibi, Quinte, libellos; Non habeo: sed habet bibliopola Tryphon. (Mart., III, Ep. lxxii.) [12] « Maître qu’il est du ciel et de la terre, il n’habite pas dans les temples faits de main d’hommes. » (Act. apost., xvii. 24.) Voir aussi xixe frag. de Sénèque. [13] Nec nos ab illo, leçon vulg. Je lis avec Gruler : ab ullo. [14] C’est lui qui dit un jour à Néron: « Tu me menaces de la mort; la nature t’en menace toi-même. » Il eut pourtant la faiblesse de défendre devant le sénat l’assassin de Soranus, l’infâme Egnatius Celer. (Tacite, Hist., IV, xl.) [15] L’accord d’un beau talent et d’un beau caractère. (Andrieux, Ép. à Ducis.) [16] « On transforme en bois l’écaille même de la tortue. » (Pline, Hist., XVI, lxiii.) [17] Il s’agit du citre. Voir Consol. à Helvia, ii; de la Colère, III, xxxv; Pétrone, cxxix; Pline, Hist., xlii, xv. C’est le thuya d’Algérie. [18] « Leur fragilité même en faisait le prix Ce fut une preuve d’opulence et la vraie gloire du luxe, de posséder ce qui pouvait d’un choc périr tout entier. » (Pline, Hist., XXXIII, ii.) [19] Probablement porcelaines de Chine. Voy. De la Providence, ni, cl Lettre cxix. [20] Je lis avec Érasme : prapinaverint- ternaire : pronunttai/erint. [21] Voir de la Vie heureuse xvii Matrona incedit census induta nepotum, (Propert., iii, Elég. xiii.) Henri IV se moquait des courtisans qui portaient sur leur dos leurs prés et leurs hautes futaies. [22] Voy. Consolation à Helvia xvi et Lettre xc. [23] ……………………… Itum est in viscera terrae — Quas que recondiderat, stygiisque admoverat umbris, Effodiuntur opes, irritamenta malorum. (Ov., Métam. I) [24] Je lis avec un mss : verba quœdam. Leçon vnlg. : timbras quasdam. [25] Du centième par mois : taux d’intérêt habituel à Rome. Voir lettre cxviii. Hinc usura vorax, avidumque in tempora faenus. (Lucain, I, 181.) La dette, affreux serpent qui ronge l’avenir. [26] Même pensée développée dans la lettre cxxii. [27] Entre les meschants quand ils s’assemblent, c’est complot, non pas compaignie. Ils ne s’entretiennent pas, mais ils s’entrecraignent. » (La Boétie. Servit. volont.) [28] Passage imité par Quintilien, II, xvii. [29] Virg., Enéide, IV. [30] Encore une parole évangélique. [31] Allusion à la courtisane Acté, et justification des complaisances forcées de Sénèque pour Néron. [32] Phrase prophétique sur Néron. V. Note 14. De la colère, l. vi. [33] Voir de la Vie heureuse, xx. « Ces précepteurs de vertu semblent avoir porté les devoirs de l’homme au delà des bornes de la stature afin que notre esprit, tout en s’efforçant d’y atteindre, s’arrêtât point marqué par la raison. (Cic., Pro Muren., xxxi.) Praecipiamus omnia, ut saltem plura fiant. (Quintil.) « L’hyperbole exprime au delà de la vérité, pour ramener l’esprit à la mieux connaître. » (La Bruyère.) [34] Énéide, IV, 373. [35] Énéide, IV, 317. [36] « Fais du bien à ton ennemi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. « (Évangile.) [37] Voir de la Colère, II, X. Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, etc. Ils sont ainsi faits, c’est leur nature; s’en fâcher, c’est ne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que le feu s’élève. (La Bruyère, de l’Homme.) [38] Voy. livre III, iii. [39] ………………… Nihil est audacius illis Deprensis, iram atque animos a crimine sumunt. (Juvénal. VI, 284.) [40] Deprensus pudor emittitur : vraie leçon que donnent tous les mss.. moins un. Lemaire : amittitur. [41] Je lis avec Fickert querendo au lieu de quaerendo, éd. Lemaire. [42] Texte vulg. : et tracius. Les meilleurs mss. ont injuriatus. [43] Dangereux novateur, par son cruel système Il veut du ciel désert chasser l’être suprême. (Gilbert, le dix-huitième siècle.) [44] Voy. Livre I, i et ix; II, xxiv; III, xxv; VII, xvi. [45] Le Nil a vu, sur ses rivages, Les noirs habitants des déserts Insulter par leurs cris sauvages L’astre éclatant de l’univers. Crime impuissant, fureurs bizarres ! Tandis que ces monstres barbares Poussaient d’insolentes clameurs, Le Dieu, poursuivant sa carrière, Versait des torrents de lumière Sur ses obscurs blasphémateurs. (Pompignan, Mort de J. B. Rousseau.) [46] Je lis avec trois mss. credimus. Deux ont : condimus.
|