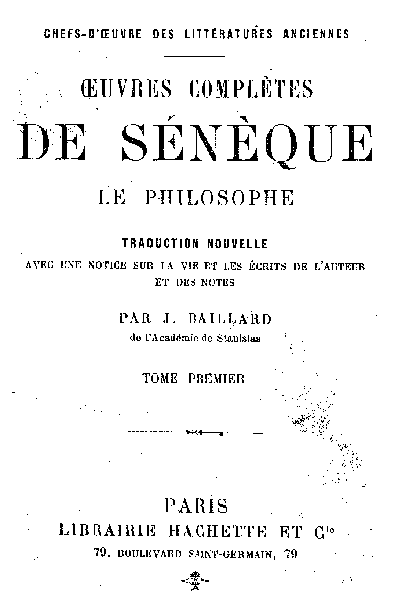|
SÉNÈQUE
Traduction J. Baillard, 1914.
I. L'ingratitude est honteuse, mon cher Ébutius Liberalis ; tout le monde en convient. Aussi entendons-nous les ingrats eux-mêmes se plaindre des ingrats; et cependant ce vice, qui déplaît à tous, semble inhérent au coeur de tous; et nous poussons si loin l'inconséquence, que certains hommes deviennent nos plus grands ennemis, non pas seulement après le bienfait, mais à cause du bienfait même. Ce sentiment est, je l'avoue, dans quelques-uns, l'effet d'une perversité naturelle; mais, chez le plus grand nombre, c'est le temps qui a effacé le souvenir des bienfaits : car les impressions les plus vives au premier moment, s'affaiblissent avec les années qui s'écoulent. Je me rappelle la discussion que nous eûmes ensemble au sujet de ceux que vous ne voulez point nommer ingrats, mais oublieux : comme si la cause de l'ingratitude en était l'excuse. Quoi, pour être oublieux, on ne sera point réputé ingrat, tandis qu'il n'y a que l'ingrat qui oublie ? Il est plusieurs espèces d'ingrats, comme de voleurs et. d'homicides ; leur crime est au fond le même; mais, dans les détails, il varie à l'infini. Ingrat est celui qui nie le bienfait qu'il a reçu; ingrat, qui le cache; ingrat, qui ne le paie pas de retour : mais le plus ingrat de tous est celui qui l'oublie. Dans les autres cas, si l'on ne paie pas, l'on reconnaît au moins sa dette ; et quelque trace des services rendus se conserve au moins dans les replis secrets d'une mauvaise conscience. Un motif quelconque peut d'un jour à l'autre les porter à la reconnaissance, soit qu'il survienne une honte salutaire, ou quelque mouvement subit de vertu tel qu'il s'en élève quelquefois dans les coeurs les plus dépravés; soit enfin qu'une occasion facile les excite à la gratitude : mais celui quia perdu jusqu'à l'idée du bienfait pourrait-il jamais devenir reconnaissant? Lequel, à votre avis, est le plus coupable, ou de manquer de reconnaissance pour le bienfait, ou de manquer de mémoire? Les yeux qui redoutent la lumière, sont malades ; ceux qui ne la voient plus sont aveugles. Si ne point aimer les auteurs de ses jours est une impiété, il y a folie à ne les pas reconnaître. Et quelle pire ingratitude, que d'avoir tellement éloigné, banni de son coeur ce qui devrait y tenir le premier rang, qu'on en est arrivé à l'ignorance totale du bienfait ? Il est évident qu'on n'a pas souvent songé à la restitution, quand on a oublié la dette. II. Enfin l'acquittement d'un bienfait réclame la bonne intention, le temps, la faculté, et la fortune favorable ; mais le souvenir est une reconnaissance qui ne coûte rien. Et pour ne pas faire ce qui n'exige ni peine, ni richesse, ni bonheur, quelle excuse peut-on alléguer? Jamais en effet il ne voulut être reconnaissant, celui qui a rejeté le souvenir du bienfait assez loin pour le perdre de vue. Les ustensiles qu'on touche, qu'on manie tous les jours, sont toujours préservés par là de la rouille et de la poussière : ceux au contraire qui, relégués loin des regards, gisent dans un coin comme inutiles, se couvrent avec le temps d'une couche d'ordures : de même les objets dont la pensée s'occupe sans cesse, n'échappent jamais à la mémoire, qui ne perd que les souvenirs sur lesquels elle n'est pas souvent revenue. III. Outre cette cause, il en est d'autres qui nous cachent quelquefois les services les plus importants. La première et la plus puissante provient de ce que, toujours occupés de nouveaux désirs, nous ne regardons plus l'objet que nous avons, mais celui que nous voulons avoir : tout ce qu'on a chez soi n'a plus de prix. Qu'en résulte-t-il? la vivacité de vos nouveaux désirs vous inspire pour le bienfait passé une indifférence qui s'étend sur son auteur. Nous aimions un bienfaiteur, nous le révérions, nous reconnaissions en lui l'artisan de notre fortune, tant que nos voeux se bornaient à l'état où sa bonté nous avait placés; mais ensuite de nouveaux désirs s'emparèrent de notre âme, et elle s'élança vers eux avec cette. ardeur qui, d'ordinaire, après de grandes choses, en fait désirer de plus grandes. Dès ce moment s'évanouit le souvenir de ce qu'auparavant nous exaltions comme un bienfait : nous ne voyons plus les avantages qui nous ont mis au-dessus des autres, mais seulement le spectacle que nous étale la fortune de ceux qui marchent devant nous. Or, il est impossible d'être à la fois envieux et reconnaissant : l'envie suppose du mécontentement et du chagrin; la reconnaissance est inséparable de la satisfaction. Ensuite, comme nous n'envisageons guère que le temps présent, qui passe si vite, rarement nous reportons notre attention sur le passé. De là vient l'oubli que nous faisons de nos précepteurs et de leurs bienfaits, parce que nous avons laissé derrière nous notre enfance: ainsi périt le souvenir des soins bienfaisants dont notre adolescence a été l'objet; car nous l'avons également perdue de vue. Ce qui a été, on ne le met pas seulement au passé, on le met comme au néant. Aussi rien de plus infidèle que la mémoire de ceux qui s'attachent seulement à l'avenir. IV. C'est ici le lieu de rendre justice à Épicure. Sans cesse il se plaint de ce que, dans notre ingratitude pour le passé, nous ne savons pas revenir par la souvenance au bonheur qui nous est autrefois advenu, ni le compter au nombre des plaisirs. Il n'est cependant pas de plaisir plus vrai que celui dont rien ne peut nous ravir la jouissance. Les biens présents, en effet, ne nous sont pas irrévocablement acquis; un accident peut nous les enlever : les biens à venir sont chanceux et incertains : il n'est que les biens passés qui soient hors d'atteinte. Le moyen d'être reconnaissant des bienfaits, quand on passe toute sa vie à poursuivre des yeux le présent et l'avenir? C'est le souvenir qui fait la reconnaissance ; et l'on enlève au souvenir tout ce qu'on donne à l'espérance. V. Il est, mon cher Liberalis, des connaissances qu'une première perception grave pour toujours dans notre esprit; il en est d'autres que, pour les posséder, il ne suffit pas d'avoir apprises : telle est la géométrie, telle est la science des choses célestes, telles sont ces hautes études qui, par leur subtilité, se dérobent à notre souvenir. De même, il y a des bienfaits que leur importance préserve de l'oubli; d'autres, moindres, mais plus nombreux et rendus à diverses époques, échappent à notre mémoire. J'en ai dit la raison : c'est qu'elle n'y revient pas de temps en temps, et qu'en général ce n'est pas volontiers que nous faisons la récapitulation de nos dettes. Écoutez les solliciteurs. il n'en est pas un qui ne vous promette une reconnaissance inaltérable, éternelle; qui ne proteste d'un zèle, d'un dévouement absolu à votre personne, et qui, s'il est quelque expression plus humble qui puisse lui servir de garant, ne s'empresse de l'employer. Le bienfait accordé, leur bouche se refuse à de telles expressions, comme viles et dégradantes; enfin ils en viennent à ce qui, selon moi, est le dernier terme d'une coupable ingratitude, à l'oubli total : car, encore une fois, il y a tant d'ingratitude à oublier, qu'il suffit de se souvenir du bienfait, pour être reconnaissant. VI. On demande si ce vice odieux devrait rester impuni, et si la loi par laquelle, dans nos écoles, on donne action contre l'ingrat, loi qui paraît si juste à tout le monde, ne devrait pas être applicable dans la société? Pourquoi non ? ne voit-on pas des villes reprocher les services qu'elles ont rendus à des villes, et faire payer aux descendants les avances faites à leurs ancêtres? Nos pères, ces modèles de grandeur, ne redemandaient qu'à leurs ennemis les services rendus : ils donnaient noblement et perdaient de même. Excepté la nation des Mèdes, il n'est point de peuple chez qui l'action contre les ingrats ait été admise; et c'est déjà une grande présomption qu'elle ne devait point l'être. Toutes les nations de la terre sont d'accord sur les autres crimes ; et l'homicide, l'empoisonnement, le parricide, le sacrilège subissent chacun, selon les localités, une peine diverse mais partout ils en subissent une. Quant à l'ingratitude, ce vice si général qui n'est puni nulle part, elle est partout décriée. Ce n'est point qu'on lui fasse grâce ; mais comme l'appréciation de ce délit eût été difficile et incertaine, on ne l'a condamné qu'à la haine, et on l'a laissé au nombre des crimes qu'on renvoie au jugement des dieux. VII. En effet, une foule de raisons se présentent à mon esprit pour que ce crime ne tombe point sous l'action de la loi. Là première, c'est que le principal mérite du bienfait serait détruit, si, comme une obligation pécuniaire, un près ou un contrat, il donnait lieu à une action judiciaire. Ce qui fait la grandeur du bienfait, c'est qu'on donne même avec la certitude de perdre; c'est que le bienfaiteur remet tout à la discrétion de l'obligé. Si je l'actionne, si je le cite devant le juge, dès ce moment ce n'est plus un bienfait, c'est une créance. En second lieu, si rien n'est plus estimable que la reconnaissance, elle cesse de l'être, du moment qu'elle est forcée; et il n'y aura pas plus de mérite à être reconnaissant qu'à restituer un dépôt ou à payer une dette, sans attendre la sentence du juge. Ainsi nous gâterions les deux plus belles vertus de l'humanité, la bienfaisance et la reconnaissance. Qu'y a-t-il donc en effet de beau dans la première, si au lieu de donner, elle prête? et dans la seconde, si elle rend non pas spontanément, mais par nécessité? Point de gloire à être reconnaissant, s'il n'y a pas de sûreté à se montrer ingrat. Ajoutez maintenant que, pour l'exécution de cette loi, tous les tribunaux seront à peine suffisants. Qui ne se trouvera pas dans le cas d'actionner? qui sera à l'abri d'une action ? Il n'est personne qui n'exagère ses propres bienfaits, personne qui ne grossisse les moindres services qu'il a rendus. D'ailleurs, tous les objets qui ressortissent des tribunaux, sont spécifiés par la loi, et ne laissent pas au juge un arbitraire indéfini. C'est pour ce motif que, dans une bonne cause, il y a plus d'avantage à s'en rapporter au juge qu'à un arbitre : le premier est assujetti à des formes, qui lui imposent des limites qu'il ne peut franchir ; la conscience du second, au contraire, est libre, affranchie de toutes entraves : il peut ajouter et retrancher à son gré, et prendre pour base de la sentence, non ce que la loi ou la justice commande, mais les inspirations de la bienveillance et de la compassion. L'action contre l'ingrat n'imposerait aucune entrave au juge : elle l'investirait d'un pouvoir illimité. Car la nature des bienfaits n'est pas encore déterminée; et, pour ce qui est de leur valeur, la fixation dépendrait entièrement du plus ou moins de bienveillance du juge. Qu'est-ce qu'un ingrat ? aucune loi ne le définit. Souvent, même après avoir rendu ce qu'on a reçu, on est ingrat; et souvent, sans l'avoir rendu, on est reconnaissant. Il est des cas où le juge le plus ignorant peut porter une sentence, lorsqu'il s'agit de prononcer si un fait est ou non accompli, ou quand le seul vu des pièces suffit pour trancher la question. Mais lorsque, entre deux parties adverses, c'est la raison qui doit fixer les droits, il faut juger d'après la vraisemblance ; lorsque la question à décider est du ressort de l'intelligence seule, alors il ne suffit pas, pour de telles causes, d'aller prendre un juge dans la foule des privilégiés que le cens ou l'héritage d'un chevalier a fait inscrire au tableau. VIII. Ainsi ce n'est point l'ingratitude qui n'a pas paru susceptible d'être déférée aux juges ; mais on n'a pas trouvé de juge propre à en connaître. Vous n'en serez pas surpris, en approfondissant les difficultés sans nombre qui surgiraient d'une pareille accusation. Tel homme a donné beaucoup d'argent, mais il est riche et ne devait pas se ressentir d'une pareille dépense. Un autre, en donnant autant, s'est exposé à compromettre tout son patrimoine. La somme est égale, le bienfait ne l'est pas. Encore un autre exemple : celui-ci, pour empêcher une saisie, a avancé son argent, mais il n'a fait que le tirer de son coffre ; l'autre a donné la même somme, mais après l'avoir empruntée, après l'avoir sollicitée, après avoir consenti à se charger d'une grave obligation. Mettez-vous au même rang, et celui qui, sans se gêner, m'a gratifié d'un service, et celui qui en a reçu un pour m'en faire part? Quelquefois c'est moins la somme que l'à-propos qui fait le prix de la chose. C'est un bienfait de donner une terre d'une fertilité à faire baisser le prix des denrées ; c'est un bienfait d'offrir un pain à un homme qui a faim. C'est un bienfait de donner des domaines que traversent plusieurs fleuves navigables, mais pour des malheureux consumés par la soif, et dont le gosier desséché leur permet à peine de respirer, c'est un bienfait de leur indiquer une source. Comment comparer, comment peser entre elles toutes ces circonstances ? Il est malaisé de prononcer, quand ce n'est pas la chose, mais le mérite de la chose qu'on doit examiner. Admettez des deux côtés l'égalité parfaite du bienfait : il y a eu disparité dans la façon de l'accorder. Cet homme m'a fait du bien, mais non de bonne grâce, mais en témoignant du regret, mais en me regardant avec plus d'arrogance que de coutume ; enfin il y a mis cette lenteur qui désoblige plus qu'un prompt refus. Toutes ces circonstances, comment le juge en pourrait-il faire l'appréciation, lorsqu'un mot, un signe d'hésitation, un coup d'oeil suffit pour anéantir le mérite d'un service rendu ? IX. Que dirai-je de certains services qu'on n'appelle bienfaits que parce qu'on les désire avec trop de passion? D'autres n'ont point cet éclat qu'y attache l'opinion; mais ils n'en ont que plus d'importance, malgré l'apparence contraire. Vous appelez un bienfait la concession du droit de cité chez un peuple puissant, l'admission au théâtre sur les bancs des chevaliers, la défense d'un client accusé de crime capital ; mais donner un bon conseil, mais retenir l'homme qui va commettre un forfait, mais arracher à un furieux le glaive dont il va se percer ; mais; par des consolations efficaces, soulager un coeur affligé, et réconcilier avec l'existence l'homme qui voulait suivre au tombeau ceux qu'il pleure ; mais veiller au chevet du lit d'un malade, et, lorsque sa guérison et sa vie dépendent d'un instant, épier ce moment favorable pour lui faire prendre quelque nourriture, pour ranimer par le vin ses artères défaillantes, enfin pour lui amener le médecin qui l'arrache à la mort: qui pourra régler l'appréciation de pareils bienfaits? et quel juge en établira la compensation par la réciprocité de bienfaits analogues ? On vous a donné une maison ; et moi je vous ai averti que la vôtre allait vous écraser dans sa chute. On vous a donné un héritage; et moi je vous ai tendu une planche dans le naufrage. On a combattu pour vous, pour vous on a reçu des blessures ; moi je vous ai sauvé la vie par mon silence. Comme le bienfait se donne et s'acquitte différemment, il est malaisé d'établir à cet égard une mesure précise. X. De plus, pour l'acquit d'un bienfait, il n'est point de jour fixé comme pour le paiement d'une créance. Ainsi celui qui ne s'est pas encore libéré, peut se libérer plus tard. Pourriez-vous indiquer le terme fatal pour être atteint et convaincu d'ingratitude? Les plus grands bienfaits sont sans preuves: souvent ils sont cachés au fond de la conscience des deux intéressés. En induirons-nous qu'il ne faut faire du bien que devant témoin? Ensuite, quelle peine infligerons-nous aux ingrats? sera-t-elle la même pour tous, malgré la disparité des bienfaits? sera-t-elle graduée? puis, selon l'importance du bienfait, plus grave ou plus légère? Fort bien; ce sera donc une taxation pécuniaire; mais si c'est la vie, si c'est plus que la vie que le bienfaiteur ait accordé, quelle peine prononcerez-vous? Sera-t-elle au-dessous du bienfait? quelle injustice! Y sera-t-elle proportionnée? c'est la peine capitale. Quelle barbarie, que des bienfaits aboutissent à une fin sanglante! XI. Mais, dira-t-on, on a accordé aux pères une action privilégiée. Pourquoi cette considération exclusive que la loi a bien voulu avoir pour les bienfaits paternels, ne s'étendrait-elle pas aux autres bienfaits ? Je réponds que nous avons consacré, par une législation exceptionnelle, la dignité des parents, parce qu'il importait que leurs enfants fussent élevés : il fallait les exciter puissamment à remplir une tâche pénible et d'un succès incertain. On ne pouvait pas leur dire comme aux bienfaiteurs : « Choisissez les objets de vos dons; ne vous en prenez qu'à vous-même, si vous vous êtes trompé : n'assistez que ceux qui en sont dignes. » Dans l'éducation de leurs enfants, rien n'est laissé au choix : il n'y a que des voeux à former; et c'est pour les encourager à courir cette chance qu'il a fallu leur donner quelque pouvoir. Autre différence : les pères qui ont été les bienfaiteurs de leurs enfants, le sont encore et le seront toujours ; et l'on n'a pas a craindre qu'ils en imposent à cet égard. Mais pour les autres bienfaits, avant de savoir s'ils ont été reconnus, il faut savoir s'ils ont été accordés. De la part des pères tout est avoué, reconnu d'avance; et, attendu qu'il est utile à la jeunesse d'être gouvernée, nous avons établi sur elle comme des magistrats domestiques, à la surveillance desquels elle fût confiée. Enfin tous les bienfaits des pères étant de même nature, on a pu les apprécier une fois pour toutes: les autres bienfaits si divers, si dissemblables, modifiés par tant de circonstances, n'ont jamais été assujettis à une règle commune; car il valait mieux n'en établir aucune, que de les soumettre au même niveau. XII. Il est des choses qui coûtent beaucoup à donner ; d'autres qui, considérables pour qui les obtient, ne coûtent rien à qui les accorde. Il est des services qu'on rend à des amis, d'autres qu'on rend à des inconnus; et alors le service, supposé le même, augmente de valeur pour celui avec qui il nous met en relation. Tantôt on vous a donné des secours, tantôt des honneurs, tantôt des consolations. Vous trouverez tel homme à qui rien n'est plus doux, rien n'est plus précieux que d'avoir un coeur ami pour y reposer son malheur. Tel autre aimera mieux qu'on travaille à son élévation, qu'à sa sécurité. Enfin, un troisième se croira plus obligé au défenseur de sa vie qu'à celui qui l'a rendu homme de bien. Or, toutes ces obligations seront plus ou moins haut taxées, selon le penchant secret du juge pour l'un ou pour l'autre de ces bons offices. D'ailleurs, c'est moi-même qui choisis mon créancier; mais un bienfait, souvent je le reçois malgré moi, quelquefois même à mon insu. Que ferez-vous? appellerez-vous ingrat celui que, sans son aveu, on a chargé d'une obligation que sciemment il n'eût point acceptée? et n'appellerez-vous point ingrat celui qui n'a pas rendu ce qu'il a reçu de façon ou d'autre ? XIII. Un homme m'a rendu service, mais plus tard il m'a fait une offense. Un premier bienfait m'oblige-t-il à dévorer toutes ses injures? ou serai-je quitte de ma reconnaissance, parce qu'il aura lui-même annulé son bienfait par les torts qui l'ont suivi? Et alors comment estimerez-vous si le bien que j'ai reçu équivaut au mal qu'on m'a fait? Le jour entier ne suffirait pas à dénombrer toutes les difficultés qui se présentent. On sera moins empressé, direz-vous, à répandre des bienfaits, s'il n'y a point d'action ouverte aux bienfaiteurs, et de peine portée contre les ingrats. Mais songez plutôt que ce que vous proposez irait à l'inverse du but : on sera moins empressé d'accepter des bienfaits qui vous exposeront à soutenir un procès, qui seront un prétexte d'inquiéter l'innocence. Par la même raison, on serait plus lent à donner car on n'aime pas à obliger un homme malgré lui. Mais si, pour obliger, on n'a pas d'autre motif que la générosité, que le plaisir de faire le bien, on trouvera plus de satisfaction à obliger des hommes dont la reconnaissance sera tout à fait libre. La gloire du bienfait s'affaiblit par les précautions prises pour en être payé. XIV. En second lieu, les bienfaits seront moins nombreux, mais plus vrais. Eh bien ! est-ce un mal de réprimer une bienfaisance banale et inconsidérée ? Voilà précisément le but que se sont proposé les législateurs qui ont laissé sans loi cette matière : il sont voulu qu'on donnât avec plus de réserve, et qu'avec plus de réserve on choisît ceux qu'on veut obliger. Examinez bien, je le répète, à qui vous allez donner: vous n'aurez contre lui ni action légale, ni répétition à exercer. Vous êtes dans l'erreur, si vous vous attendez à l'assistance d'un juge aucune loi ne doit pourvoir à vos recouvrements. N'espérez qu'en la bonne foi de l'homme que vous obligez. C'est ainsi que les bienfaits conservent leur valeur et leur éclat : vous les souillez, si vous en faites une matière à procès. C'est une expression très juste, et conforme au droit des gens : « Rendez ce que vous devez. » Mais, dans un bienfait, rien n'est honteux comme ce mot : « Rendez » Que pourra-t-il rendre? La vie qu'il me doit, l'honneur, la sécurité, la santé? de telles dettes sont trop grandes pour être acquittées. Eh bien! ajoutez-vous, qu'il me rende un équivalent. C'est là ce que je disais: la dignité du bienfait périra, si vous en faites une sorte de marchandise. N'excitons point les âmes à l'avarice, aux plaintes, à la discorde; elles s'y portent déjà trop naturellement: résistons, au contraire, de tout notre pouvoir, et les occasions qu'on cherche, sachons les prévenir. XV. Et plût aux dieux que nous pussions encore persuader aux hommes de s'en rapporter, pour le paiement de leurs créances, à la bonne volonté de leurs débiteurs! Plût aux dieux qu'aucune stipulation ne liât le vendeur et l'acheteur ! que les engagements et les conventions ne fussent point garantis par l'empreinte des cachets, et ne fussent placés que sous la sauvegarde de la bonne foi et de la loyauté! Mais on a substitué la contrainte aux plus nobles sentiments, et on aime mieux enchaîner la bonne foi que de compter sur elle. On appelle des témoins de part et d'autre: celui-ci ne prête que sur plusieurs signatures et par l'entremise des courtiers; celui-là ne se contente pas d'une promesse verbale, il veut que son prêteur se lie de sa propre main. Honteux et déplorable aveu de la méchanceté humaine, de la perversité publique! on se fie plus à nos cachets qu'à nos coeurs. Pourquoi cette réunion de personnages honorables? à quelle fin impriment-ils leur sceau sur ces actes? c'est pour que cet homme ne nie point avoir reçu ce qu'il a reçu en effet. Et la probité incorruptible de tous ces garants de la vérité n'est pas du moins mise en doute? Tout aussi bien : dans l'instant on s'armera contre eux des mêmes précautions, pour leur prêter de l'argent. Eh ! n'était-il pas plus honorable de subir la mauvaise foi de quelques-uns, que de redouter la déloyauté de tous? Il ne manque plus à l'avarice que l'avantage de voir les bienfaits entourés de cautions. C'est le fait d'un coeur généreux et magnanime d'aider, de servir ses semblables: qui donne imite les dieux; qui redemande imite les usuriers. Eh quoi! en donnant des garanties aux bienfaiteurs, voudrions-nous les assimiler au rebut de la société? XVI. Il y aura, dit-on, encore plus d'ingrats, si l'on n'a contre eux aucun recours légal. Dites plutôt: il y en aura moins, parce qu'on mettra plus de choix dans la distribution des bienfaits. D'ailleurs, il n'est pas sans inconvénient de publier combien les ingrats sont nombreux: le nombre des coupables ôtera la honte du crime, et un vice général cessera d'être un opprobre. Quelle femme rougit à présent du divorce, depuis que certaines dames illustres et de noble race ne comptent plus leurs années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris? depuis qu'elles divorcent pour se marier, et se marient pour divorcer? On craignait cette infamie, tant qu'elle fut rare; maintenant que tous les registres publics sont couverts, d'actes de divorce, ce qu'on entendait si souvent répéter, on s'est instruit à le faire. A-t-on aujourd'hui la moindre honte de l'adultère, depuis qu'on en est venu au point qu'une femme ne prend un mari que pour stimuler les amants? La chasteté n'est plus qu'une preuve de laideur. Où trouverez-vous une femme assez misérable, assez chétive pour se contenter d'une couple d'amants? Ne faut-il pas qu'elle partage les heures de sa journée entre plusieurs? encore un jour entier ne suffit pas à tous. Ne faut-il pas qu'on la porte chez l'un, et qu'elle passe quelque temps chez l'autre? Il n'y a qu'une malapprise et une arriérée qui ne sache pas que l'adultère avec un seul est appelé mariage. Comme la honte de ces crimes a disparu depuis qu'ils se sont multipliés, ainsi les ingrats deviendront plus nombreux et plus hardis, si vous leur fournissez l'occasion de se compter. XVII. Eh quoi! l'ingrat sera donc impuni ? Mais, dites-moi, l'impie ne l'est-il pas? le méchant, l'avare, l'emporté, le cruel, ne le sont-ils pas ? Regardez-vous donc comme impuni ce qui est abhorré ? et trouvez-vous un supplice plus rigoureux que la haine générale? Le châtiment de l'ingrat consiste en ce qu'il ne peut recevoir du bien de personne, ni en faire; qu'il est ou se croit montré au doigt par tout le monde; qu'il a perdu le sentiment de la plus honnête, de la plus douce affection. Ne plaignez-vous pas le malheur de celui dont les yeux ne voient plus la lumière, ou qu'une maladie a rendu sourd? Combien n'est point à plaindre celui qui a perdu le sentiment des bienfaits ! Il redoute les dieux, témoins infaillibles de l'ingratitude ; son âme est torturée, bourrelée de la conscience des bienfaits qu'il a méconnus; enfin (et cette seule peine est assez forte), la jouissance la plus délicieuse, comme je viens de le dire, il ne la connaît pas. Mais celui que charme le souvenir du bienfait reçu, goûte une volupté constante et perpétuelle; il songe à l'intention du bienfaiteur, et non point à ce qu'il tient de lui, et cette pensée fait sa joie. L'ingrat ne sent qu'une fois le plaisir du bienfait ; un coeur reconnaissant goûte ce plaisir à tous moments. Comparons leur vie à tous deux : l'un a l'air triste et inquiet, tel que doit l'avoir un fripon, un banqueroutier frauduleux; il ne rend point à ses parents, à son gouverneur, à ses maîtres, l'honneur qui leur est dû. L'autre est gai, content, cherchant sans cesse l'occasion de témoigner sa reconnaissance, et trouvant son bonheur dans ce sentiment même. Loin de vouloir faire banqueroute, il n'aspire qu'à s'acquitter largement et avec usure, non seulement envers ses parents et ses amis, mais même envers ses inférieurs : car si même il a pu recevoir quelque bienfait d'un de ses esclaves, il considère moins la personne que la chose. XVIII. Cependant il est des philosophes, Hécaton entre autres, qui ont mis en question si l'esclave peut jamais devenir le bienfaiteur de son maître ? car il y en a qui font la distinction suivante : certaines choses sont des bienfaits, quelques autres des devoirs, d'autres enfin des services obligés. Le bienfait est le don d'un étranger qui, sans encourir le blâme, aurait pu s'abstenir ; le devoir est le propre du fils, ou de, l'épouse, ou des autres personnes que les liens de la nature obligent à s'entraider; le service obligé est d'un esclave placé dans une condition telle, que, quoi qu'il fasse, il ne peut acquérir un titre contre son supérieur. D'ailleurs, celui qui n'admet pas le bienfait de l'esclave envers son maître ignore le droit naturel; car le point important, c'est le sentiment de celui qui donne, et non sa condition. La vertu n'exclut personne; elle ouvre les bras à tous les hommes; elle les admet tous, elle les appelle tous : libres, affranchis, esclaves, rois, exilés; elle n'a de préférence ni pour la noblesse ni pour l'opulence : elle se contente de l'homme dans sa nudité. Quel refuge, en effet, resterait-il contre les accidents soudains, quelle grande chose l'âme pourrait-elle se promettre à elle-même, si une vertu éprouvée était soumise aux caprices de la fortune ? Si l'esclave ne peut devenir le bienfaiteur de son maître, il en est ainsi du sujet à l'égard de son roi, et du soldat envers son général. Qu'importe effectivement le pouvoir qui nous domine, si ce pouvoir est absolu? car si l'esclave est empêché d'acquérir le titre de bienfaiteur par l'obstacle de la nécessité, et par la crainte des derniers châtiments, le même obstacle arrêtera le sujet et le soldat, parce que, sous des noms divers, c'est la même autorité. On oblige pourtant son roi; on oblige son général : donc, on peut obliger son maître. Un esclave peut être juste, courageux, magnanime; il peut donc être aussi un bienfaiteur. Car c'est encore ici de la vertu : il est si vrai qu'un esclave peut devenir le bienfaiteur de son maître, que souvent un maître doit tout à son esclave. On ne doute pas qu'un esclave ne puisse être le bienfaiteur d'autrui; pourquoi donc pas de son maître ? XIX. « Par la même raison, dit Hécaton, qu'un esclave qui donne de l'argent à son maître ne peut devenir son créancier. D'ailleurs chaque jour il oblige son maître : il le suit dans ses voyages, le soigne dans ses maladies, et consacre tous ses efforts à le servir. Cependant tous ces bons offices, qui de la part de tout autre seraient qualifiés de bienfaits, ne sont de la part d'un esclave que des services obligés. En effet, il n'y a de bienfait que lorsque l'on donne ce qu'on est libre de ne pas donner ; or, l'esclave n'a point la liberté de refuser : il n'accorde rien, il obéit, et il ne peut se faire un mérite d'une action qu'il n'a pas le droit de ne pas faire ». En admettant cette nécessité, j'aurai encore gain de cause, et je vous montrerai qu'à cet égard l'esclave, en maintes circonstances, est libre. En attendant, dites-moi, si je vous montre un esclave combattant pour la vie de son maître, au mépris de la sienne, et qui, couvert de blessures, répand pour lui tout le sang qui lui reste, afin de lui ménager par sa mort le temps de s'échapper, nierez-vous qu'il ne soit le bienfaiteur de son maître, parce qu'il est son esclave ? Et si je vous en fais voir un autre que l'on voudrait forcer à révéler les secrets de son maître, et qu'un tyran ne peut ni corrompre par aucune promesse, ni effrayer par aucune menace, ni vaincre par aucuns tourments; qui élude, et, autant qu'il est en lui, écarte tous les soupçons, en sacrifiant sa vie à sa fidélité, nierez-vous qu'il ne soit le bienfaiteur de son maître, parce qu'il est son esclave? Reconnaissez plutôt que le bienfait est d'autant plus méritoire, que les exemples de vertu sont plus rares chez les esclaves; qu'il mérite d'autant plus de reconnaissance, que, malgré l'odieux qui s'attache à toute domination et à toute contrainte pesante, l'attachement à un maître a triomphé de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin que ce ne soit pas un bienfait, parce qu'un esclave en est l'auteur, c'est quelque chose de plus, puisque sa servitude même n'a pu y mettre obstacle. XX. C'est une erreur de penser que la servitude absorbe l'homme tout entier : la meilleure partie de lui-même en est exempte. Le corps seul obéit et reconnaît la loi du maître : l'âme demeure indépendante; elle est si libre et dégagée d'entraves, que, dans cette prison même où elle est renfermée, elle ne peut être empêchée de prendre son essor, pour s'élever aux plus sublimes objets, et s'élancer auprès des dieux dans l'infini. C'est donc le corps seul que le sort a mis entre les mains du maître : c'est là ce qu'il achète, ce qu'il vend; l'âme est et reste émancipée. Tout ce qui vient d'elle est libre ; car nous ne pouvons donner des ordres illimités, et nos esclaves ne sont pas tenus de nous obéir en tout: ils ne feront pas ce qu'on leur commandera contre la république ; ils ne prêteront la main à aucun crime. XXI. Il est des actions qui ne sont ni ordonnées ni défendues par la loi : celles-là peuvent fournir matière aux bienfaits de l'esclave. Tant qu'il ne s'acquitte que des devoirs de l'esclave, il fait son service : tout ce qui dépasse ses obligations devient un bienfait ; tout ce qu'il n'accomplit que par amitié n'est plus une affaire de service. Il est des objets qu'un maître doit fournir à ses esclaves : le vivre et le vêtement : personne n'appelle cela bienfait. Mais lorsqu'un maître a des soins particuliers pour un esclave, qu'il lui procure une éducation honorable, qu'il le fait instruire dans les arts réservés aux hommes libres : voilà un bienfait. Il en est de même, par réciprocité, pour l'esclave : tout soin qui de sa part excède les limites de son service ordinaire; tout ce qu'il fait, non par obéissance ni par devoir, mais par pure bonne volonté, est un bienfait, pourvu que la chose soit assez importante pour mériter ce nom, si elle venait de toute autre personne. XXII. L'esclave, selon Chrysippe, est un mercenaire à perpétuité. Comme le mercenaire va jusqu'au bienfait, lorsqu'il travaille au delà du temps pour lequel il s'est engagé ; de même l'esclave qui, par sa bienveillance envers son maître, a franchi les limites de sa condition, et par un effort, dont s'honorerait même un homme d'une naissance illustre, a surpassé les espérances de son maître, devient un bienfaiteur domestique. Est-il juste, à votre avis, puisque nous nous fâchons contre eux, quand ils font moins que leur devoir, de leur dénier notre reconnaissance, s'ils font plus que leur devoir ou l'usage ne leur impose ? Voulez-vous savoir où le bienfait n'est pas? c'est lorsque l'on peut dire : Qu'aurais-je fait, s'il n'avait pas voulu? Mais s'il a fait ce qu'il pouvait ne pas vouloir, sa bonne volonté mérite des louanges. Il y a opposition entre le bienfait et l'outrage. L'esclave peut conférer un bienfait à son maître, si de ce même maître il peut recevoir un outrage. Or les injures des maîtres envers leurs esclaves sont du ressort d'un magistrat chargé de réprimer la cruauté, la lubricité, ainsi que l'avarice dans la prestation des aliments nécessaires. Quoi donc? un maître reçoit un bienfait de son esclave ? non, mais un homme d'un autre homme. Enfin, ce qui dépendait de l'esclave, il l'a fait: il a offert un bienfait à son maître. Si vous ne voulez pas recevoir d'un esclave, vous le pouvez. Mais quel homme la fortune a-t-elle rendu assez grand, pour qu'il ne puisse avoir jamais besoin des plus petits? Je vais vous rapporter un grand nombre d'exemples différents, ou même opposés entre eux. Un esclave a donné la vie à son maître; un autre lui a donné la mort ou l'a sauvé quand il allait périr, et, si ce n'est assez, il l'a sauvé en périssant lui-même. L'un a aidé la mort, l'autre l'a frustrée. XXIII. Claudius Quadrigarius rapporte dans le dix-huitième livre de ses Annales, qu'au siège de Grumentum, lorsque les habitants étaient déjà réduits aux dernières extrémités, deux esclaves passèrent à l'ennemi, et lui rendirent des services. La ville prise, tandis que le vainqueur s'y répandait de tous côtés, les deux esclaves, connaissant les localités, se rendirent avec lui à la maison où ils avaient servi, et firent marcher devant eux leur maîtresse, répondant à tous ceux qui les questionnaient, que c'était leur maîtresse, et une maîtresse très cruelle, qu'ils menaient eux-mêmes au supplice. L'ayant ainsi conduite hors des murs, ils la cachèrent avec le plus grand soin, jusqu'à ce que la fureur de l'ennemi fût apaisée. Sitôt que nos soldats, rassasiés, furent redevenus Romains, ces esclaves revinrent à leurs habitudes, et se remirent eux-mêmes sous la puissance de leur maîtresse. Elle les affranchit aussitôt l'un et l'autre, et ne rougit pas de devoir la vie à deux esclaves sur lesquels elle avait droit de vie et de mort. Elle eut même à s'en féliciter d'autant plus, que, sauvée d'une autre manière, elle n'aurait dû son salut qu'à l'effet ordinaire d'une clémence commune; mais sauvée par ses esclaves, elle devint un sujet d'entretien, un exemple célèbre pour deux villes. Dans l'horrible confusion d'une cité prise d'assaut, quand chacun ne songeait qu'à sa propre sûreté, tous avaient abandonné cette femme, excepté les transfuges; et ceux-ci, pour faire voir le motif de leur première fuite, se firent encore une fois transfuges, et quittèrent les vainqueurs pour la captive, en prenant le rôle de parricides. Car ce qui donne surtout un caractère sublime à ce bienfait, c'est qu'ils se décidèrent, afin de sauver leur maîtresse, à passer pour ses assassins. Non, croyez-moi, je vous le dis, il n'est point d'une âme servile d'acheter ainsi une belle action par la renommée d'un crime. C. Vettius, préteur des Marses, était mené captif à Rome. Un de ses esclaves tira l'épée du soldat qui le conduisait, et commença par tuer son maître. « Maintenant, dit-il, songeons à moi; j'ai déjà délivré mon maître; » puis il se perça d'un autre coup. Citez-moi quelqu'un qui ait sauvé son maître avec plus de grandeur d'âme. XXIV. César assiégeait Corfinium, et tenait Domitius enfermé dans cette place. Domitius appela son médecin, qui était aussi son esclave, et lui demanda du poison. Le voyant hésiter : « Que tardes-tu, dit-il, comme si tout dépendait de toi ? Je te demande la mort les armes à la main. » L'esclave promit, apporta un breuvage innocent, qui assoupit Domitius; puis il alla trouver le fils de son maître, et lui dit : « Faites-moi mettre en prison, jusqu'à ce que l'événement vous prouve si j'ai donné du poison à votre père. » Domitius vécut, et reçut la vie de César : mais il l'avait auparavant reçue de son esclave. XXV. Dans la guerre civile, un esclave cacha son maître proscrit: puis paré des anneaux de celui-ci et couvert de ses habits, il alla au-devant de ceux qui le cherchaient, leur disant qu'il ne leur demandait point de grâce, qu'ils eussent à exécuter les ordres reçus; puis il tendit la gorge. Quel héroïsme, d'avoir voulu mourir pour son maître, dans un temps où c'était un prodige de fidélité que de ne pas vouloir sa mort ! qu'il était beau de se montrer humain et fidèle, quand la cruauté et la perfidie étaient universelles ! et quand la trahison était encouragée par les plus grandes récompenses, de ne désirer, pour sa fidélité, d'autre récompense que la mort ! XXVI. Je n'omettrai pas les exemples de notre temps. Sous Tibère, la fureur des délations était devenue fréquente; c'était comme une rage presque générale, qui, plus terrible que toutes les guerres civiles, ensanglantait en pleine paix la république. On recueillait les mots échappés à l'ivresse, à l'abandon de la plaisanterie : pour sévir, tout prétexte était bon. Déjà l'on ne s'informait plus du résultat des procès : il n'y en avait qu'un. Le prétorien Paullus assistait à un repas, portant à son doigt une image de Tibère, gravée en relief sur une pierre précieuse. Il serait bien sot à moi de chercher des périphrases pour dire qu'il prit un pot de chambre. La chose fut remarquée par Maron, fameux délateur de cette époque. Mais l'esclave de celui à qui l'on tendait un piégé profita de son ivresse pour lui ôter son anneau. Maron prenait déjà les convives à témoin que l'image de l'empereur avait été approchée d'un endroit obscène, et dressait sa dénonciation, quand l'esclave montra l'anneau dans sa main. Si celui-ci s'appelle encore un esclave, je consens à ce que Maron s'appelle un convive. XXVII. Sous le divin Auguste, une parole indiscrète ne mettait pas encore en péril, mais pouvait déjà compromettre. Le sénateur Rufus avait, dans un souper, exprimé le voeu que César ne revint point sain et sauf d'un voyage projeté ; ajoutant que tous les veaux et tous les taureaux formaient le même voeu. Ce propos fut soigneusement recueilli par certains convives. Le lendemain, dès qu'il fit jour, l'esclave qui s'était tenu aux pieds de Rufus, lui raconte ce qu'il a dit dans l'ivresse, et lui conseille d'aller sur-le-champ trouver l'empereur pour se dénoncer lui-même. Docile à ce conseil, Rufus se présente à César, comme il descend de son palais : il lui proteste avec serment qu'il avait perdu la raison la veille, et qu'il souhaite que son méchant voeu retombe sur lui-même et sur ses enfants ; il le conjure de lui pardonner et de lui rendre ses bonnes grâces. Auguste y consent. « Personne, ajoute Rufus, ne croira que vous m'ayez rendu votre affection, si vous ne m'accordez quelque bienfait. » Et alors il lui demanda une somme que n'eût pas dédaignée un courtisan en faveur. César la lui accorda encore, en ajoutant : « Pour mon intérêt, je me donnerai bien de garde de me fâcher jamais contre vous. » Auguste fit bien sans doute de pardonner, et d'ajouter la libéralité à la clémence. Quiconque entendra parler de ce fait ne manquera pas de louer l'empereur ; mais il faut d'abord louer l'esclave. Est-il besoin de vous dire qu'il fut affranchi ? mais non pas gratuitement; César avait payé le prix de sa liberté. XXVIII. Après tant d'exemples, doutera-t-on qu'un maître ne reçoive quelquefois un bienfait de son esclave? Faut-il que la personne avilisse la chose? et ne vaut-il pas mieux que la chose elle-même honore la personne ? Nous avons tous les mêmes commencements, une même origine. Nul n'est plus noble qu'un autre, s'il n'a l'esprit plus droit et plus propre à la vertu. Ceux qui exposent dans leur vestibule les images de leurs ancêtres, et placent à l'entrée de leur demeure une longue série de noms liés entre eux par les rameaux d'un arbre généalogique, sont plus connus que nobles. Le père commun, c'est le monde. Par des degrés ou brillants ou obscurs, chacun de nous remonte à cette origine première. Ne vous laissez pas abuser par ceux qui, récapitulant la liste de leurs aïeux, partout où manque un nom illustre, y supposent un dieu. Ne méprisez aucun homme, même entouré de noms vulgaires et peu favorisés de la fortune. Bien que dans votre généalogie vous ne rencontriez que des affranchis, ou des esclaves, ou des étrangers, élevez hardiment votre âme, et tout ce qu'entre eux et vous il peut y avoir d'abject, franchissez-le d'un bond : au bout vous trouverez une haute noblesse. Pourquoi l'orgueil nous gonfle-t-il au point de nous faire rejeter avec dédain les bienfaits d'un esclave, et de ne songer qu'à sa condition sans nous rappeler ses mérites? Un esclave ! Osez-vous bien donner à quelqu'un ce nom, vous, l'esclave de la débauche et de la gourmandise ? vous, le valet d'une maîtresse adultère? que dis-je? le valet de toutes les femmes adultères? Vous appelez un homme esclave! où vous entraînent donc ces porteurs qui promènent çà et là votre litière ? et ces serviteurs affublés en soldats, et revêtus d'un brillant costume, où vous transportent-ils donc ? A la loge de quelque portier, aux jardins de quelque esclave qui n'a pas même de fonctions déterminées. Puis vous prétendez que votre esclave ne peut être votre bienfaiteur, quand le baiser de l'esclave d'autrui est pour vous un bienfait. Quelle est donc cette inconséquence de votre esprit? D'un côté, vous méprisez les esclaves, et de l'autre, vous recherchez leur baiser comme un bienfait ! Impérieux et fier chez vous, humble au dehors, et aussi dédaigné que dédaigneux : car nul n'a l'âme plus abjecte que celui dont l'orgueil est le plus immodéré ; nul n'est plus disposé à fouler aux pieds les autres, que celui qui apprit à outrager, à force d'outrages reçus. XXIX. Cette sortie était nécessaire pour rabattre l'insolence de ces hommes qui ne s'attachent qu'à la fortune, et pour revendiquer le droit des esclaves au titre de bienfaiteurs, tout aussi bien que je le revendique en faveur des fils. On demande, en effet, quelquefois si les enfants ne peuvent accorder à leurs parents de plus grands bienfaits qu'ils n'en ont reçu? On convient que très souvent les fils ont été plus grands et plus puissants que leurs pères : on convient également qu'ils ont été plus vertueux. Ce point accordé, il peut se faire qu'ayant une fortune plus ample et des dispositions meilleures, ils surpassent leurs pères en bienfaits. « Quelque chose, dit-on, qu'un fils donne à son père, ce sera toujours moins qu'il n'a reçu, parce que, jusqu'à cette faculté de donner, il tient tout de son père. Ainsi un père ne peut jamais être surpassé en bienfaits par son fils, qui ne tient que de lui cette même supériorité ». Je réponds d'abord : il est des choses qui doivent leur origine à d'autres, et qui cependant sont plus grandes que leur origine; et de ce que l'une n'eût pu s'accroître, si elle n'eût dû son commencement à l'autre, il ne s'ensuit pas que la première ne puisse surpasser en grandeur la seconde. Il n'est aucune chose en ce monde qui, dans ses rapides progrès, n'aille bien au delà de son principe. Les semences sont le principe de tout ce qui naît en ce monde; et cependant elles ne sont que la plus petite partie des substances qu'elles engendrent. Voyez le Rhin, voyez l'Euphrate, en un mot, tous les fleuves célèbres : quelle est leur grandeur comparée à leur source? Tout ce qui les rend redoutables et fameux, c'est dans leur cours qu'ils l'ont acquis. POtez les racines, les forêts cesseront de s'élever, et les hautes montagnes seront privées de leur parure. Voyez ces troncs si élevés, si vous mesurez leur hauteur; si énormes, si vous mesurez l'étendue que couvrent au loin leurs rameaux : combien est petit en comparaison l'espace qu'embrassent leurs racines déliées! Sur leur base s'appuient et nos temples et les vastes murs de notre Rome; et pourtant cette base sur laquelle tout s'appuie est cachée sous le sol. Il en est ainsi de toutes choses : la grandeur qu'elles acquièrent avec le temps efface la trace de leur origine. Je n'aurais pu rien acquérir, si les bienfaits de mes parents n'eussent précédé; mais il ne s'ensuit pas que tout ce que j'ai acquis soit moindre que la faculté sans laquelle je n'aurais pu rien acquérir. Si ma nourrice n'avait allaité mon enfance, je n'eusse rien pu faire de ce que je fais aujourd'hui de la tête et des bras; je ne serais point parvenu à environner mon nom de cette illustration que m'ont procurée mes services civils et militaires : mettrez-vous pour cela au-dessus de mes grands travaux les services de ma nourrice? Cependant il m'eût été aussi difficile de m'avancer sans les soins de ma nourrice que sans les bienfaits de mon père. XXX. Que si à l'auteur de mes jours je dois tout ce que je puis, considérez que mon commencement n'est ni mon père, ni même mon aïeul. Il y aura toujours quelque chose d'antérieur d'où chaque origine tire sa propre origine. Or, personne ne soutient que je dois plus à des ancêtres inconnus et placés au delà du souvenir des hommes, que je ne dois à mon père. Je leur devrais cependant davantage, puisque mon père tenait d'eux jusqu'à la faculté de me donner la vie. Tout ce que je fais pour mon père, quelque important qu'il soit, n'est point équivalent au bienfait paternel, parce que je ne serais pas, s'il ne m'eût engendré ? A ce compte, si quelque médecin a guéri mon père expirant, je ne pourrai faire pour lui rien qui ne soit au-dessous de son bienfait; car mon père ne m'eût point engendré, s'il n'eût été guéri. Mais voyez s'il ne vaut pas mieux penser que ce que j'ai pu faire, et ce que j'ai fait, m'appartient en propre, comme procédant de ma force et de ma volonté. Quant à la vie pure et simple, considérez ce qu'elle est en soi ; vous verrez que c'est un don bien petit, bien incertain, une source égale de bien et de mal. Sans doute c'est le point de départ de toutes choses; mais ce n'est pas la plus grande, quoique la première. J'ai sauvé la vie à mon père; je l'ai élevé à la plus haute dignité, je l'ai rendu le premier de ses concitoyens; je l'ai non seulement honoré par mes actions, mais, pour qu'il en fit lui-même d'aussi honorables, je lui ai ouvert une voie large et facile, je lui ai fourni des moyens non moins sûrs que glorieux. Les distinctions, l'opulence, tout ce qui excite l'ambition des hommes, je l'ai accumulé sur lui. Supérieur à tous les autres, je me suis toujours maintenu son inférieur. Dites maintenant : Cela même, la faculté d'agir ainsi, est encore un bienfait de votre père. Je vous répondrai : Oui, si, pour agir ainsi, c'était assez que de naître; mais si, pour vivre bien, le moins essentiel est de vivre, et si vous m'avez fait un don que les bêtes sauvages, les animaux les plus petits et même les plus immondes partagent avec moi, ne vous attribuez pas un mérite qui ne procède point de vos bienfaits, quoiqu'il en soit la conséquence. Supposez que je vous aie donné la vie, en échange de celle que vous m'avez donnée. Encore ici je l'emporte sur vous ; car vous sentiez mon bienfait, je le sentais aussi ; car je ne vous donnais pas la vie pour mon plaisir, et moins encore par mon plaisir ; car il est plus important de conserver la vie que de la recevoir, comme il y a moins de tourment à mourir qu'à craindre la mort. XXXI. Quand je vous ai sauvé la vie, vous pouviez en jouir aussitôt ; quand vous me l'avez donnée, je n'avais point le sentiment de mon existence : je vous ai donné la vie, alors que vous craigniez de mourir ; en me la donnant, vous m'avez destiné à mourir; moi, je vous ai sauvé une vie complète à laquelle rien ne manquait ; vous avez engendré en moi un être privé de raison, et à charge aux autres; et la preuve que donner ainsi la vie n'est pas un grand bienfait, c'est que vous pouviez m'exposer; et, en ce cas, c'eût été un mauvais service de m'avoir engendré. D'où je conclus que le moindre des bienfaits est la cohabitation de mon père et de ma mère, si, maints accessoires ne venant se joindre à ce commencement de bienfait, il n'est ratifié en quelque sorte par d'autres bienfaits. Le bien ne consiste pas à vivre, mais à bien vivre. Oui, je vis bien ; mais je pourrais vivre mal : ainsi la seule chose que je tiens de vous, c'est de vivre. Si vous voulez mettre en compte la vie seule, la vie nue, dépourvue de raison ; si vous vantez cela comme un grand bien, songez que cet avantage est celui des mouches et des vermisseaux. Enfin, pour ne parler que des arts libéraux dont l'étude salutaire a dirigé vers le bien le cours de ma vie, même en profitant de ce bienfait, je vous ai restitué plus que je n'ai reçu. Vous m'aviez donné à moi-même ignorant, ébauché; et moi je vous rends un fils tel que vous seriez heureux de l'avoir engendré. XXXII. Mon père m'a nourri; si je le nourris à mon tour, je lui rends davantage ; parce qu'il est doublement aise d'être nourri, et nourri par son fils; parce qu'il jouit plus encore de mon bon coeur que de la chose elle-même. Les aliments qu'il m'a donnés n'ont touché que mon corps. Et si l'on est parvenu à se rendre célèbre parmi les nations, ou par l'éloquence, ou par la justice, ou par les exploits militaires, si l'on a entouré son père d'une grande renommée et dissipé l'obscurité de sa naissance par une vive splendeur, n'a-t-on pas conféré à ses parents un inestimable bienfait? Qui connaîtrait Ariston et Gryllus, sans leurs fils, Platon et Xénophon? Socrate rend immortel le nom de Sophronisque. Il serait trop long d'énumérer ceux qui ne vivent dans la mémoire, que parce que l'éclatant mérite de leurs fils a transmis leur nom à la postérité. Est-ce le père d'Agrippa, homme inconnu même après Agrippa, qui a fait plus pour son fils, ou cet illustre fils qui a plus fait pour son père, lui qui fut décoré d'une couronne navale, exemple unique entre les récompenses militaires ? lui qui orna cette ville de tant de beaux ouvrages surpassant en magnificence tout ce qu'on avait fait jusqu'alors, et tout ce qu'on a fait depuis? Et Octave, fit-il plus de bien à son fils que l'empereur Auguste n'en fit à son père Octave, quoique ce père naturel soit éclipsé par le père adoptif? Quelle joie il eût éprouvée en voyant ce jeune vainqueur, après les guerres civiles, jeter en maître les bases d'une paix solide ! Il n'eût pas reconnu son propre ouvrage, et, en se regardant lui-même, eût-il jamais pu croire qu'un tel homme fût né dans sa famille ? Pourquoi citerais-je à présent tous ces autres pères, qui depuis longtemps seraient tombés dans l'oubli, si la gloire de leurs fils ne les eût arrachés à l'obscurité, et ne les retenait encore au grand jour? D'ailleurs, nous n'examinons pas s'il est arrivé qu'un fils ait rendu à son père plus qu'il n'avait reçu de lui, mais si la chose est possible. Si les exemples que j'ai rapportés ne vous satisfont pas encore, et si les bienfaits des fils ne vous paraissent pas supérieurs à ceux des pères, il n'en est pas moins vrai que la nature peut produire ce que les siècles n'ont pas encore enfanté. Enfin, si, pris un à un, ils ne peuvent égaler la grandeur du bienfait paternel, accumulés en masse, ils le surpasseront. XXXIII. Scipion sauva la vie à son père dans un combat ; encore vêtu de la prétexte, il poussa son cheval dans les rangs ennemis : c'était peu d'avoir affronté, pour se faire jour jusqu'à son père, tous les périls qui assiègent les plus grands capitaines, et triomphé de tant d'obstacles ; c'était peu d'avoir, pour son début comme soldat, pénétré jusqu'à la première ligne à travers le corps des vétérans, et prouvé ainsi que sa valeur n'attendait pas le nombre des années; ajoutez à cela qu'il défendit son père accusé, qu'il l'arracha aux complots et à la brigue d'ennemis puissants; qu'il accumula sur lui un deuxième et même un troisième consulat, sans compter d'autres honneurs faits pour flatter l'ambition d'un consulaire ; qu'il soulagea sa pauvreté par des richesses qu'il tenait de la conquête ; et, ce qui est le plus flatteur pour les hommes de guerre, qu'il le fit riche des dépouilles des ennemis. Cela vous semble-t-il encore trop peu ? ajoutez qu'il le fit proroger dans le gouvernement des provinces et dans d'autres commandements extraordinaires; ajoutez qu'après avoir renversé de fond en comble les plus grandes villes, ce héros, défenseur et vrai fondateur de l'empire romain, qui devait désormais s'étendre sans égal du couchant à l'aurore, ajouta le lustre d'une nouvelle noblesse à la noblesse de son père. Dites maintenant : Mais le père de Scipion ---. Peut-on douter que le bienfait vulgaire de la génération n'ait été surpassé par le dévouement et l'héroïsme du fils, à qui je ne sais si Rome doit plus sa sûreté que sa gloire? XXXIV. Ensuite, si ce n'est assez, imaginez un homme qui ait arraché son père à la torture, et qui l'ait subie en sa place. Vous pouvez, jusqu'où vous voudrez, étendre les bienfaits du fils: le don paternel est simple, il est facile, et même accompagné de plaisir pour le bienfaiteur : c'est un bienfait dont il a, par la force des choses, fait part à beaucoup d'autres, sans le savoir; un bienfait dans lequel il est de moitié avec la mère. Il a pu avoir en vue la loi de son pays, les privilèges de la paternité, le soin de perpétuer son nom et sa famille, enfin tout plutôt que l'individu auquel il donnait l'être. Mais si un fils s'est élevé jusqu'à la sagesse, et l'a communiquée à son père, douterons-nous encore s'il n'a pas donné plus qu'il n'avait reçu? Mais, insiste-t-on, tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez donner, vous le devez au bienfait de votre père. C'est aussi à mon précepteur que je dois mes progrès dans les lettres. Cependant nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées, du moins quant aux éléments. Quoique, sans ces premiers maîtres, on n'eût pu parvenir à rien, il ne s'ensuit pas que, malgré tous ses progrès, on soit toujours au-dessous d'eux : entre les commencements et la perfection la différence est grande; et les uns ne sont pas comparables à l'autre, bien que celle-ci ne puisse exister sans ceux-là. XXXV. Il est bien temps que nous tirions enfin quelque pièce de notre fonds. Celui à qui l'on doit un bienfait au-dessus duquel il y a quelque chose peut être surpassé. Le père a donné la vie à son fils; mais il est des choses meilleures que la vie: ainsi un père peut être surpassé comme bienfaiteur, puisqu'il existe des bienfaits plus grands que le sien. Celui qui a donné la vie à un autre, si on la lui a sauvée deux fois à lui-même, a reçu un plus grand bienfait qu'il n'a donné. Or, un père a donné la vie : si donc il est plus d'une fois préservé de la mort par son fils, il aura plus reçu que donné. Un bienfait, pour celui qui l'a reçu, est d'autant plus grand, qu'en le recevant il en avait plus besoin : or, celui qui vit a plus besoin de la vie que celui qui n'est pas né, et qui ne, peut avoir besoin de rien. Un père, donc, qui reçoit la vie de son fils, lui est plus redevable qu'un fils en recevant la vie de son père. Sur quel fondement prétendez-vous que les bienfaits du fils ne peuvent surpasser ceux du père? Parce qu'il a reçu la vie de son père, et que, s'il ne l'avait pas reçue, il ne serait capable d'aucun bienfait. Mais ici le père se trouve dans le même cas que tous ceux qui ont donné la vie à quelqu'un: on n'aurait pu leur témoigner sa reconnaissance, si l'on n'eût point reçu la vie. En conclurons-nous aussi qu'on ne peut par la reconnaissance surpasser le bienfait d'un médecin, car on peut devoir la vie à un médecin; ni celui d'un matelot qui vous a sauvé du naufrage? Et toutefois il est possible de surpasser en bienfaits et en dévouement ceux à qui, d'une manière ou d'une autre, nous devons la vie. La même chose est donc possible pour les pères. Si quelqu'un m'accorde un bienfait qui ait besoin d'être entretenu par la sollicitude bienfaisante de beaucoup d'autres personnes, et que le bienfait que j'ai rendu en échange n'ait besoin de la participation d'aucun tiers, j'ai plus donné que reçu. Or, le père n'a donné à son fils qu'une vie qui s'éteindrait sans une infinité de soins accessoires pour l'entretenir : mais la vie que le fils conserve à son père n'a nullement besoin de secours étrangers; elle se conserva d'elle-même. Ainsi le père qui reçoit de son fils la vie qu'il lui avait donnée, reçoit un bienfait plus grand. XXXVI. Ceci ne détruit pas le respect qu'on doit à son père, et ne rend pas les enfants plus mauvais, mais au contraire meilleurs; car la vertu est essentiellement ambitieuse, et brûle de prendre le pas sur ce qui la devance. La piété filiale deviendra plus active, si au désir de rendre la pareille se joint l'espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes subiront volontiers et avec joie cette défaite, car il arrive souvent que la défaite offre des avantages. De là une lutte bien désirable, et pour les pères le bonheur si grand d'avoir à s'avouer surpassés en bienfaits par leurs enfants! Ne point partager cette opinion, c'est fournir une excuse à l'ingratitude des enfants, c'est ralentir l'élan de leur reconnaissance, tandis que nous devrions les stimuler, en disant: « Courage, vertueux jeunes. gens; c'est ici entre les pères et leurs enfants une honorable lutte; c'est à qui donnera plus qu'il n'a reçu. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous avoir prévenus. Prenez courage, ainsi qu'il convient de le faire, et ne vous lassez point, afin de vaincre vos pères qui désirent être vaincus. Et dans cette noble arène vous ne manquerez pas de généraux qui vous exhortent à les imiter, et vous invitent à marcher sur leurs traces à la victoire que des fils ont souvent obtenue. » XXXVII. Énée a surpassé son père: il n'avait été pour lui dans son enfance qu'un fardeau sans péril et sans embarras : mais son père, accablé de vieillesse, il le fallut porter à travers les bataillons ennemis, à travers les ruines de Troie, qui s'écroulait autour de lui, alors que ce pieux vieillard, tenant embrassés les vases sacrés et ses dieux domestiques, surchargeait d'un double poids les épaules de son fils, qui ne cheminait qu'à grand'peine. Énée le porta au milieu des flammes, et que ne peut la piété? il le plaça comme une sorte de dieu parmi les fondateurs de l'empire romain. Ils ont surpassé leurs pères, ces jeunes Siciliens, qui, au milieu des secousses violentes de l'Etna, au milieu d'une lave brûlante inondant les villes, les campagnes et la plus grande partie de l'île, emportèrent leurs parents sur leurs épaules. Les flammes, dit-on, s'écartèrent et, se retirant à droite et à gauche, ouvrirent un large chemin à ces héroïques jeunes gens, si dignes d'accomplir en sûreté cette glorieuse entreprise. Antigone remporta la même victoire, lui qui, après avoir vaincu l'ennemi dans une grande bataille, transmit à son père le prix de la guerre, et lui abandonna le trône de Chypre. C'est être vraiment roi que de ne pas vouloir régner quand on le peut. T. Manlius triompha de son père, tout impérieux qu'il était. Relégué jusqu'alors à la campagne par la volonté paternelle, à cause de la stupidité grossière qu'il montrait dans son adolescence; il alla trouver le tribun du peuple qui avait ajourné son père, demanda une entrevue à ce magistrat, et l'obtint. Le tribun espérait que le fils se rendrait le délateur d'un père odieux; il croyait même s'être fait un ami de ce jeune homme, parce que, entre autres crimes dont il accusait le père, il alléguait l'exil du fils. Mais celui-ci, le trouvant seul, tire un poignard caché dans son sein, et lui dit : «Si tu ne jures de te désister de ton accusation contre. mon père, je, te perce de ce glaive: c'est à toi de choisir de quelle manière mon père sera délivré de son accusateur. » Le tribun jura, et tint son serment: seulement il rendit compte à l'assemblée du motif de son désistement. Jamais, depuis, aucun autre citoyen ne se permit impunément de faire rentrer dans l'ordre un tribun. XXXVIII. Il est maints autres exemples de fils qui ont arraché leurs pères aux dangers, qui les ont élevés de l'état le plus humble au faîte des honneurs, qui les ont tirés de la plèbe et de la foule pour rendre leurs noms à jamais immortels.
Il n'est point de langage assez fort, de parole assez éloquente pour exprimer
dignement tout ce qu'il y a de mérite, tout ce qu'il y a de gloire immortelle, à
pouvoir se dire : « J'ai obéi à mes parents; je leur ai cédé : à leurs ordres,
justes ou non, et quelque durs qu'ils fussent, je me suis toujours montré
obéissant et soumis : je n'ai été rebelle qu'en un seul point: je n'ai pas voulu
qu'ils me surpassassent en bienfaits.»
|