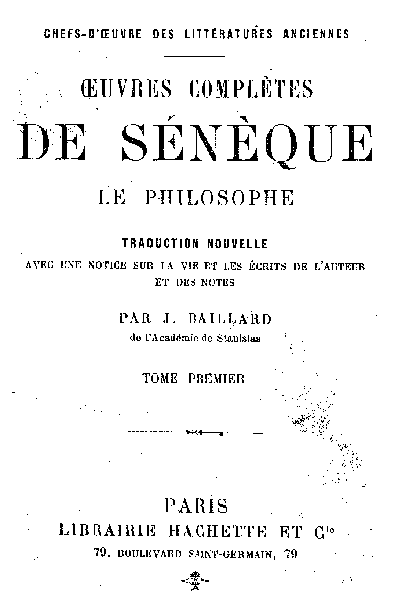|
SÉNÈQUE
Traduction J. Baillard, 1914.
1. Parmi tant d'erreurs
diverses où nous entraînent l'irréflexion et la légèreté de notre esprit, la
moins pardonnable, à mon avis, mon cher Libéralis, c'est de ne savoir ni donner
ni recevoir. Car nécessairement un bienfait mal placé doit être mal reconnu;
mais avons-nous fait un ingrat, il n'est plus temps de nous plaindre : c'était
un service perdu au moment où il était rendu. Et il ne faut pas s'étonner qu'au
milieu de vices si graves et si nombreux, le plus commun soit encore
l'ingratitude. Cela tient à plusieurs causes, et surtout à notre imprudence dans
le choix des personnes que nous obligeons: mais nous qui, avant de prêter notre
argent, avons soin de prendre des informations si exactes sur les biens meubles
et immeubles de l'emprunteur, et qui regarderions comme une folie de semer dans
un terrain épuisé ou stérile; aveugles dans notre bienfaisance, nous gaspillons
au hasard plutôt que nous ne donnons. Et peut-être n'y a-t-il pas moins de honte
à nier un bienfait, qu'à en réclamer le prix. C'est un genre de créance dont le
remboursement est tout volontaire, et l'on a mauvaise grâce à se plaindre de son
débiteur; car ces dettes-là ne se paient pas en argent : c'est le coeur qui les
acquitte, et c'est les acquitter, que d'aimer à les reconnaître. Quelle obligation puis-je vous avoir d'un bienfait que vous laissez tomber du haut de votre orgueil, ou que, dans votre colère, vous me jetez à la tête, ou que vous abandonnez de guerre lasse, et pour vous soustraire à l'importunité ? N'espérez pas de retour d'un homme lassé par vos délais, torturé par l'attente. La reconnaissance n'est exigible que dans la mesure du bienfait : il ne faut donc pas obliger à la légère; car nous ne croyons devoir qu'à nous-mêmes le bien qu'on nous fait sans connaissance de cause : il ne faut pas non plus le faire attendre; car si dans tout bienfait l'on doit compter pour beaucoup l'intention du bienfaiteur, un bienfait tardif suppose un refus prolongé. Gardez-vous aussi d'y mêler rien d'injurieux; car la nature a voulu que le souvenir des mauvais offices se gravât plus profondément que celui des bons; et la mémoire, si oublieuse du bien, garde le mal avec une fidélité opiniâtre. N'attendez donc pas de reconnaissance, si vous blessez en obligeant; c'est vous en montrer assez que de vous pardonner votre bienfait. La foule des ingrats ne doit pas pourtant ralentir notre bienfaisance. Nous-mêmes d'abord, comme je l'ai dit, nous contribuons à en augmenter le nombre : ensuite l'oubli sacrilège de l'impie entrave-t-il cette loi de bonté immuable que les dieux immortels se sont faite ? Obéissant à cette nécessité de leur nature, ils versent leurs bienfaits jusque sur les sacrilèges et ceux qui les oublient. Imitons leur exemple, autant que le permet la faiblesse humaine; que nos bienfaits soient un don et non pas un prêt usuraire. On mérite d'être trompé, lorsqu'on donne avec l'arrière-pensée de rentrer dans ses avances. Mais notre bienfait a mal tourné : nos enfants, nos femmes n'ont-ils donc jamais déçu notre espoir ? et cependant l'on prend femme, l'on élève des enfants; l'expérience même nous laisse là-dessus si indociles, que, tout meurtris, nous revenons à la charge, et ne craignons pas de nous remettre en mer après le naufrage. Que de motifs plus nobles encore pour persévérer dans notre bienfaisance ! y renoncer, parce que nous en avons été pour nos frais, c'est déclarer que nos dons étaient de pures avances; c'est justifier les ingrats, pour qui l'ingratitude est une honte, alors seulement que la reconnaissance est facultative. Que de gens indignes de voir le jour! et le soleil pourtant se lève pour eux. Que de gens mécontents d'être au monde ! cependant la nature enfante des générations nouvelles, et laisse vivre ceux-là même qui aimeraient mieux n'être pas nés. C'est la marque d'une âme grande et belle, de ne chercher d'autre fruit du bienfait que le bienfait lui-même, et, après avoir rencontré tant de méchants, de croire encore à la vertu. Qu'aurait de si beau la bienfaisance, si elle n'était jamais trompée? Le mérite est dans le bienfait; qu'il soit perdu ou non, l'homme généreux en recueille le fruit à l'instant même. La crainte de l'ingratitude doit si peu décourager la bienfaisance, et la rendre paresseuse à remplir ses nobles fonctions, que, fût-on assuré de ne pas trouver un seul coeur reconnaissant, il vaudrait mieux encore perdre ses bienfaits, que de ne pas obliger. S'abstenir de faire le bien, c'est prendre l'avance sur l'ingratitude ; et, pour dire même toute ma pensée, si l'ingrat est le plus coupable, la première faute est à celui qui s'abstient d'obliger. II. Des bienfaits qu'au hasard sur la foule on répand Pour bien placer un seul, il en faut perdre cent. Il y a deux choses à reprendre dans le premier vers : on ne doit pas répandre ses bienfaits sur la foule ; et si la prodigalité est un défaut, c'est surtout en matière de bienfaits. La bienfaisance sans discernement n'est plus de la bienfaisance; c'est tout autre chose. Au premier coup d'oeil, la pensée du second vers est fort belle : un seul bienfait, s'il est bien placé, console de la perte de cent autres. N'est-il pas cependant plus vrai, plus conforme au noble esprit de la bienfaisance, de dire qu'elle doit s'exercer, même sans espoir de bien tomber une seule fois? Il est faux qu'il faille perdre cent bienfaits; aucun n'est perdu; la perte suppose un espoir de gain, et la bienfaisance ne tient pas de livres à partie double : elle n'a de compte ouvert que pour la dépense : tout ce qui lui rentre est en pur gain : que rien ne lui rentre, il n'y a point de perte. On donne pour le plaisir de donner, sans tenir note de ses bienfaits pour les réclamer à jour et à heure fixes comme un avide créancier. L'homme de bien ne pense jamais aux services qu'il a rendus, si la reconnaissance de l'obligé ne les lui rappelle : un service, autrement, a l'air d'un prêt. C'est une usure honteuse que de porter un bienfait en ligne de compte. Quel que soit le sort d'un premier service, continuons à en rendre de nouveaux : c'est un fonds qu'il vaut mieux laisser dormir aux mains des ingrats qu'aux nôtres; du moins chez eux la honte, l'occasion, l'exemple, peuvent un jour réveiller la reconnaissance. Ne vous ralentissez pas, faites votre devoir jusqu'au bout, remplissez votre tâche d'homme de bien; obligez de votre bourse, de votre crédit, de votre pouvoir, de votre expérience, de vos avis, de vos préceptes salutaires. III. Les bêtes elles-mêmes sont sensibles aux bons traitements; et il n'est point d'animal si farouche qui, à force de soins, ne s'apprivoise et ne devienne susceptible d'attachement. Le lion laisse manier impunément sa gueule par son maître; et la reconnaissance pour la main qui le nourrit soumet le farouche éléphant à l'obéissance la plus servile. Tant la persévérance et la continuité des soins ont de pouvoir, même sur ces êtres incapables de comprendre et d'apprécier un bienfait! L'ingratitude de cet homme a tenu bon contre un premier service ; elle ne tiendra pas contre un second : a-t-elle résisté aux deux premiers? un troisième lui rappellera le souvenir des deux autres. On ne perd un bienfait que pour avoir cru trop tôt l'avoir perdu. Persévérez, rendez service sur service, et vous arracherez la reconnaissance au coeur le plus dur et le plus insensible. Devant tant de largesses, l'ingrat n'osera lever les yeux : de quelque côté qu. il se tourne pour échapper à ses souvenirs, qu'il vous retrouve, qu'il soit comme assiégé de vos bienfaits. Maintenant, avant de m'étendre sur le caractère de la bienfaisance et sur son pouvoir, je vous demanderai la permission de me borner à réfuter en passant plusieurs questions étrangères au fond du sujet : pourquoi les Grâces sont-elles au nombre de trois? pourquoi sont-elles soeurs? pourquoi les figure-t-on les mains entrelacées, l'air riant, jeunes, vierges, sans ceinture, et vêtues de robes transparentes? Selon les uns, elles représentent la bienfaisance dans ses trois acteurs, celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui rend : selon d'autres, sous ses trois faces: le bienfait, la dette, et la reconnaissance. Quelle que soit, du reste, l'explication que j'adopte, peu importe cette vaine érudition. Leurs mains entrelacées, et ce groupe qui se replie sur lui-même, signifient, dit-on, que la chaîne du bienfait, en passant de main en main, revient toujours au bienfaiteur, entièrement détruite s'il y a solution de continuité, mais dans tout son prix et dans toute sa beauté, si les anneaux se suivent et se succèdent sans interruption. Elles ont le visage riant, parce que telle est la physionomie du bienfaiteur et de l'obligé. Le sourire de l'aînée a quelque chose de plus noble, comme celui du bienfaiteur lui-même. Elles sont jeunes, parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas vieillir; vierges, parce qu'ils sont purs, sans tache, et sacrés pour tout le inonde; si leurs ceintures sont détachées, c'est que tout, dans les bienfaits, doit être libre et sans contrainte ; si le tissu de leur robe est transparent, c'est que les bienfaits veulent être aperçus. S'il est des gens assez esclaves des Grecs pour soutenir l'utilité de ces jeux d'esprit, on n'en trouvera pas, j'espère, qui poussent l'engouement jusqu'à voir de l'importance dans les noms qu'Hésiode a donnés aux Grâces. Il appelle la première Aglaé, la seconde Euphrosyne, la troisième Thalie. Chacun, sans doute, est libre d'interpréter ces noms et de les torturer à sa guise pour en tirer un sens raisonnable; mais le nom qu'Hésiode leur prête n'en est pas moins un nom de fantaisie. Aussi Homère ne s'est-il pas fait scrupule d'en changer un, et d'appeler l'une des Grâces Pasithea, en lui donnant même un époux, ce qui prouve qu'elles ne sont pas des vestales. Un autre poète leur donne des ceintures et les habille de robes phrygiennes chargées d'une épaisse broderie d'or; il y a même un tableau qui représente Mercure avec elles non que la raison ou l'éloquence relève le prix du bienfait; mais tel a été le caprice du peintre. Chrysippe lui-même, si remarquable par cette finesse d'esprit qui pénètre au fond des choses, et va droit au but, sans perdre plus de paroles qu'il n'en tant pour se faire comprendre; Chrysippe remplit son ouvrage de ces niaiseries, tandis qu'il ne dit presque rien sur la manière de répandre, de recevoir et de rendre les bienfaits. Ces fables semblent faire le fond de son sujet, au lieu d'en être l'accessoire. Car, enchérissant sur ces détails rapportés par Hécaton, il ajoute que les Grâces sont filles de Jupiter et d'Eurynome, plus jeunes que les Heures, mais plus jolies, ce qui les a fait donner à Vénus pour compagnes. Il attache aussi une grande importance an nom de leur mère. On l'appelle, dit-il, Eurynome, parce que les bienfaits se répandent ainsi que les fruits d'une maternité féconde ; comme si le nom pouvait remonter des filles à la mère, ou comme si les poètes étaient bien scrupuleux sur l'exactitude des noms. Semblables à ces esclaves chargés de nous dire les noms des passants, et qui, à défaut de mémoire, payant d'effronterie, les inventent quand ils ne les savent pas, les poètes ne s'embarrassent guère d'altérer la vérité ; et pour peu que la mesure les y contraigne, ou que la beauté du mot les séduise, ils appellent les choses du nom qui va le mieux à leur vers : et on ne leur fait pas un crime de mettre un nouveau mot en circulation; le premier poète qui suivra ne se fera pas faute d'en créer un autre. En voulez-vous une preuve ? voyez Thalie, dont on parle tant; chez Hésiode c'est une Grâce, c'est une Muse chez Homère. IV. Mais pour ne pas tomber dans le défaut que je reprends, laissons là des détails si étrangers au sujet, qu'ils ne s'y rattachent pas même comme accessoires. Veuillez seulement prendre ma défense, si l'on me reproche d'avoir remis à sa place Chrysippe, homme assurément d'un esprit supérieur, mais de cet esprit tout grec qui se fausse et s'émousse par sa trop grande finesse ; plus superficiel que profond, alors même qu'il semble pénétrer dans les entrailles du sujet. A quoi bon enfin toutes ces subtilités? C'est de la bienfaisance qu'il s'agit, et des règles d'une vertu qui forme le lien le plus puissant de la société humaine : ce sont des principes de conduite qu'il faut donner à l'homme, pour que, sous les dehors de la générosité, il ne se laisse pas séduire à une facilité imprudente ; pour que notre bienfaisance, dont nous ne devons être ni avares ni prodigues, ne soit pas restreinte par des précautions qui n'ont pour but que de la régler. Il faut nous apprendre à recevoir comme à donner de bon coeur, à nous piquer d'une noble émulation pour parvenir, je ne dis pas à égaler nos bienfaiteurs, mais à les surpasser de fait et d'intention ; car, en matière de reconnaissance, on doit passer le but pour l'atteindre: il faut apprendre aux bienfaiteurs à ne jamais se croire en avance, aux obligés à se croire toujours en arrière. Or, savez-vous comment s'y prend Chrysippe, pour nous encourager à cette généreuse rivalité, à ce noble combat de bienfaisance ? Comme les Grâces sont filles de Jupiter, nous dit-il, l'ingratitude est presque un sacrilège, un outrage fait à ces vierges divines. Eh! enseignez-moi plutôt quelque moyen de doubler mes bienfaits et ma reconnaissance, d'établir entre l'obligé et le bienfaiteur une sorte d'émulation qui pousse l'un à oublier le bien qu'il a fait, l'autre à se souvenir sans cesse du bien qu'il a reçu. Abandonnez ces futilités aux poètes, dont le seul but est de charmer les oreilles, et de nous amuser par d'agréables mensonges. Mais ceux qui se proposent de guérir les esprits, de fixer la bonne foi sur la terre, et d'inculquer la reconnaissance au coeur de l'homme, ceux-là doivent parler sérieusement; et se mettre franchement à l'oeuvre ; à moins de croire que des propos frivoles, des fables, des contes de vieille femme soient suffisants pour arrêter l'ingratitude, la plus odieuse de toutes les banqueroutes. V. Après m'être contenté, comme je l'ai dit, d'effleurer en passant des questions si futiles, il faut entrer en matière, et, avant tout, apprendre à sacrilège quelles obligations un bienfait nous impose. Chacun se croit redevable de ce qu'il a reçu l'un d'une somme d'argent, l'autre du consulat, celui-ci du sacerdoce, cet autre d'un gouvernement. Mais ce ne sont là que les signes extérieurs du bienfait; ce n'est pas le bienfait lui-même car le bienfait n'est point chose palpable ; l'âme seule peut le saisir. Entre un service et l'objet qui en fait la matière, la différence est grande : ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni rien de ce que nous recevons du dehors, qui le constitue, mais la volonté seule du bienfaiteur. Le vulgaire remarque seulement ce qui saute aux yeux, ce qui se donne et se reçoit ; quant à ce qui fait le véritable prix et la valeur du bienfait, il en tient fort peu de compte. Mais ces objets que nous touchons, que nous voyons et auxquels s'attachent nos désirs, ne sont que des objets périssables ; la fortune et l'injustice peuvent nous les enlever : le bienfait, même après la perte de la chose donnée, subsiste encore. C'est une bonne action qu'aucune puissance ne peut anéantir. J'avais racheté mon ami des mains des pirates ; un autre ennemi le prend et le jette en prison : ce n'est pas mon bienfait qui lui est. ravi, c'est la jouissance de mon bienfait. J'ai rendu à un père ses enfants sauvés de l'incendie ou du naufrage : qu'une maladie ou tout autre accident vienne à les lui enlever ensuite, ce qu'on a fait pour eux subsiste même sans eux. Toutes ces choses que nous décorons si légèrement du nom de bienfaits, ne sont que des moyens par lesquels se montre une volonté amie. Est-ce donc là le seul exemple où la représentation de la chose soit indépendante de la chose elle-même? Un général distribue des colliers, des couronnes murales ou civiques : qu'ont donc de si précieux en soi une couronne, une robe prétexte, des faisceaux, un tribunal, un char ? Rien de tout cela n'est l'honneur, mais bien le signe convenu de l'honneur. De même aussi, ce qui frappe les yeux n'est pas le bienfait lui-même; ce n'en est que la représentation et l'image. VI. Qu'est-ce donc qu'un bienfait ? C'est une action toute de bienveillance, trouvant son plaisir dans celui qu'elle procure, essentiellement volontaire et spontanée. Ainsi, ce n'est pas l'action même ou le don qu'il faut considérer, mais l'intention : car le bienfait ne consiste pas dans la chose faite ou donnée ; il est tout entier dans la disposition d'esprit de celui qui la donne ou la fait. Et pour sentir toute la vérité de cette distinction, remarquez que le bienfait est toujours un bien, tandis que la chose faite ou donnée n'est ni un bien ni un mal. C'est l'intention qui relève le prix des plus petites choses, qui ennoblit les plus viles, qui avilit les plus précieuses et les plus estimées; mais ces objets que convoitent nos désirs ne sont en eux-mêmes ni bons, ni mauvais ; ils ne sont rien sans cette impulsion première qui modifie toute chose. Cet argent qui se compte, ou ce présent qui se donne, ne constituent pas plus le bienfait, que la beauté des victimes, ou les riches ornements qui les couvrent, ne constituent le respect de la divinité : ce qui l'honore, c'est la piété du sacrificateur, c'est la droiture de son âme. Pour adorer les dieux, l'homme de bien n'a besoin que d'un peu de farine, ou d'un gâteau grossier ; quant au méchant, les flots de sang dont il arrose les autels ne le laveront pas de son impiété. VII. Si le bienfait consistait dans la chose elle-même, et non dans la volonté du bienfaiteur, le prix du bienfait serait en raison du prix de l'objet donné. Mais, bien loin de là; jamais peut-être nous n'avons plus d'obligations qu'à celui qui donne peu, mais généreusement; qui égale dans son coeur les richesses des rois, qui rend un léger service, mais de bonne grâce : qui oublie sa pauvreté en voyant la mienne; pour qui la bienfaisance n'est pas seulement un désir, mais une passion ; qui se regarde comme l'obligé, quand il est le bienfaiteur; qui donne comme s'il était sûr de rentrer dans ses avances, et y rentre comme s'il n'avait rien avancé; qui, peu content d'être utile quand l'occasion se présente, la cherche même et la prévient. Un bienfait, au contraire, nous est pénible, je le répète, quelle que. soit sa valeur apparente ou réelle, dès qu'il nous faut comme l'arracher de force, ou qu'on le laisse tomber par mégarde. Pour en rehausser le prix, il faut donner de bon coeur plutôt que prodiguer à pleines mains. L'un a fait peu pour nous, mais il n'a pu faire davantage ; l'autre a donné beaucoup, mais après mainte hésitation et maint délai, avec un soupir de regret, avec faste, en faisant parade de son service, sans songer à être agréable à celui qu'il obligeait; c'est à sa vanité, enfin, qu'il a donné, et non pas à moi. VIII. Socrate recevait de nombreux présents de ses disciples; chacun lui donnait selon sa fortune : quand vint le tour d'Eschine, qui était pauvre : « Je n'ai rien à vous offrir, lui dit-il, qui soit digne de vous, et c'est cela seulement qui me fait sentir ma pauvreté. Je vous offre donc la seule chose que je possède . moi-même. Ce présent, tel qu'il est, ne le dédaignez pas, et pensez que si les autres vous ont donné beaucoup, ils ont encore gardé plus pour eux-mêmes. - Et pourquoi donc m'aurais-tu donné si peu, lui répondit Socrate, à moins que tu ne t'estimes peu de chose? C'est donc à moi d'avoir soin de te rendre meilleur que je ne t'ai reçu. » Et par ce seul présent Eschine l'emporta et sur Alcibiade, dont le coeur égalait les richesses, et sur la munificence des plus opulents disciples de Socrate.
IX. Vous voyez donc comme, au sein même de l'indigence, l'âme trouve encore
matière à libéralité. Il me semble qu'Eschine dit à la fortune : « Tu n'as rien
fait en me faisant pauvre; tu ne m'empêcheras pas d'offrir à ce grand homme un
présent digne de lui; et si je ne peux lui donner du tien, c'est du mien que je
lui donnerai. » Et il ne faut pas croire qu'il s'estimât bien peu lui-même, en
se donnant lui-même en paiement : l'adroit jeune homme eut l'esprit de se gagner
Socrate en échange ---. Ce n'est point la valeur du présent qu'il faut
considérer, mais la valeur de celui qui donne. L'homme adroit offre un accès
facile à des désirs immodérés ; il nourrit par ses discours des espérances
coupables qu'il ne doit jamais réaliser. Encore est-il préférable à celui qui,
affectant un ton brusque et des airs importants, provoque l'envie par l'étalage
de ses richesses. En courtisant sa fortune, on le déteste, et on le hait, quitte
à l'imiter, si le hasard nous mettait à même de le faire -. Tel se fait un jouet
des femmes d'autrui, non pas en cachette, mais en public, et abandonne la sienne
aux autres. Ainsi l'adultère est le genre de fiançailles le plus décent. Veufs par consentement mutuel, maris garçons, notre femme n'est pas celle que nous avons épousée, mais celle que nous avons enlevée à son époux. Dissiper en prodigalités le fruit de nos rapines, chercher dans des rapines nouvelles un aliment à de nouvelles prodigalités, n'avoir de respect pour rien, mépriser la pauvreté dans les autres, et la redouter pour nous comme le plus grand des maux, mettre partout le désordre par nos dérèglements, écraser le faible sous la violence et la crainte, voilà quelle est notre vie. Et si les provinces sont livrées au pillage, si des juges mercenaires vendent la justice au plus offrant et dernier enchérisseur, faut-il s'en étonner? Le droit des gens ne permet-il pas de vendre ce qu'on achète?
X. Mais excité par le sujet, notre ardeur nous mène trop loin : arrêtons-nous,
et ne rejetons pas sur notre siècle seul la responsabilité de ces désordres. Il
y a longtemps que nos ancêtres s'en plaignirent pour la première fois; nous nous
en plaignons comme eux, et nos enfants s'en plaindront à leur tour : les bonnes
moeurs sont détruites, c'est le vice qui règne; de jour en jour la vertu devient
plus rare, et le genre humain plus corrompu. Tout cependant reste au même point,
et y restera toujours, sans éprouver d'antre alternative de fluctuation que
celle de la vague poussée en avant par le flux, et ramenée en arrière quand la
mer se retire. Aujourd'hui c'est l'adultère qui est à la mode, et la débauche
marche le front levé; demain ce sera la fureur de la gastronomie et de la bonne
chère, gouffre le plus honteux où puisse s'engloutir le patrimoine : puis
viendra le tour de la toilette et la recherche excessive de la beauté, recherche
qui décèle la laideur de l'âme; puis l'abus de la liberté déchaînera l'audace et
la licence : la cruauté enfin sera une mode chez les particuliers, comme dans
l'état, et la fureur des guerres civiles profanera tout ce qu'il y a de plus
saint et de plus sacré. L'ivrognerie à son tour deviendra un titre de gloire, et
bien boire sera une vertu. Mais si nous devons avoir soin d'obliger d'abord ceux dont la reconnaissance nous est assurée, il est aussi dés services que nous devons rendre, même sans espoir de retour, nonobstant toute présomption, que dis-je? toute certitude de faire des ingrats. Puis-je arracher les enfants d'un autre à un danger imminent sans m'y exposer moi-même? je n'hésiterai pas. Mérite-t-il ce service? au prix même de mon sang je le sauverai, je partagerai son péril. Ne le mérite-t-il pas? s'il ne faut qu'un cri pour le tirer des mains des brigands, refuserai-je le secours de ma voix, quand elle peut sauver un homme? XI. Il nous reste à examiner maintenant quelle doit être la nature des bienfaits, et la manière de donner. Donnons d'abord le nécessaire, ensuite l'utile, puis l'agréable. Donnons surtout quelque chose qui reste; commençons d'abord par le nécessaire. Un service d'où dépend notre vie nous va plus au coeur que celui qui ne contribue qu'à notre agrément ou à notre bien-être. On peut faire le dédaigneux sur un présent dont il serait facile de se passer et de dire: Reprenez-le, je n'en ai pas besoin; ce que j'ai me suffit. Heureux encore, quand on se contente de vous le rendre, sans le rejeter !
Les choses nécessaires se divisent en trois classes : celles sans lesquelles on
ne peut pas, celles sans lesquelles on ne doit pas, celles sans lesquelles on ne
veut pas vivre. Dans la première sont les services qui nous arrachent au glaive
de l'ennemi, à la vengeance d'un tyran, à la proscription, et à tous ces dangers
qui assiégent la vie humaine. La grandeur alors ou l'imminence du péril dont
nous sommes préservés ne fait qu'ajouter à notre reconnaissance; car
l'imagination se retrace toute l'étendue des maux auxquels on échappe, et la
crainte passée donne du charme au bienfait. Gardons-nous cependant d'attendre,
pour sauver quelqu'un, que la crainte du péril rehausse le prix du service. Puis enfin vient la foule des bienfaits d'agrément: leur premier mérite doit être leur à-propos: il faut, par exemple, que ce ne soient pas choses communes; qu'elles aient toujours été rares ou qu'elles le soient de notre temps; si le présent n'est pas précieux par lui-même, qu'il emprunte son prix du lieu et des circonstances. Cherchez à donner ce qui doit faire le plus de plaisir, et frapper souvent la vue du possesseur, pour que votre souvenir s'offre à lui aussi fréquemment que l'objet même. Gardez-vous également de tout présent inutile, comme d'instruments de chasse pour un vieillard ou une femme, de livres pour un homme illettré, de filets pour un amateur de l'étude et des lettres. Craignons aussi le défaut contraire, et, tout en voulant consulter l'agrément et la convenance, évitons ce qui peut avoir l'air d'un reproche, comme l'envoi d'une caisse de vins à un ivrogne, ou de remèdes à un cacochyme. L'injure commence et le présent cesse, quand il fait ressortir les défauts de l'obligé. XII. Avons-nous le choix des bienfaits? donnons la préférence aux plus durables, pour leur ôter, autant que possible, ce qu'ils ont de mortel. Il y a peu d'hommes assez reconnaissants pour songer à ce qu'ils ont reçu, lorsqu'une fois l'objet ne frappe plus leurs regards; et, fussiez-vous disposé à l'ingratitude, le souvenir du bienfait s'offre à vous en même temps que le présent lui-même, lorsque, placé sous vos yeux, loin de vous permettre de l'oublier, il imprime et grave dans votre esprit le nom du bienfaiteur. Ce qui doit surtout nous engager à choisir des bienfaits durables, c'est qu'il ne nous appartient pas de les rappeler à l'obligé : l'objet lui-même doit seul réveiller un souvenir qui s'éteint. Je donnerai donc plus volontiers de l'argenterie que de l'argent, plus volontiers des statues que des vêtements et autres objets susceptibles de se détruire par l'usage. La reconnaissance survit rarement à l'objet donné ; plus souvent elle cesse avec l'usage de la chose. Que mon bienfait ne périsse donc pas, s'il est possible, mais qu'il subsiste, qu'il reste, qu'il vive, pour ainsi dire, avec mon ami. Il n'y a personne, je pense, assez stupide pour qu'il soit besoin de lui rappeler qu'on n'envoie pas des gladiateurs ou des bêtes féroces, quand les jeux sont terminés, ni des habits d'été pendant l'hiver, ni des habits d'hiver pendant l'été. Il faut, dans le bienfait, un bon sens qui ait égard au temps, au lieu, aux personnes ; ce qui est agréable aujourd'hui est désagréable demain. Ne fait-on pas plus de plaisir à quelqu'un en lui donnant ce qu'il n'a pas, plutôt que ce qu'il a en abondance ; ce qu'il cherche depuis longtemps sans pouvoir le trouver, que ce qu'il peut rencontrer à chaque pas? C'est donc moins la richesse qu'il faut rechercher, en fait de présents, que leur rareté, et ce goût délicat qui leur donne du prix, même aux yeux de l'opulence. Ainsi ces fruits communs, que peu de jours après nous dédaignerons, nous sont agréables dans leur primeur. Nos présents auront encore quelque prix, si celui à qui nous les offrons n'en a jamais reçu de semblables, ou si nous n'en avons jamais donné de semblables à personne. XIII. Dans le temps qu'Alexandre de Macédoine, vainqueur de l'Orient, élevait jusqu'au ciel ses pensées d'ambition, les Corinthiens lui envoyèrent une ambassade pour le féliciter et lui offrir le titre de citoyen de Corinthe. Ce singulier hommage le fit sourire. « Sache, reprit alors un des députés, que ce titre, Hercule et toi, vous l'avez seuls obtenu. » Flatté d'une marque d'honneur si peu prodiguée, Alexandre, s'empressa d'admettre les députés à sa table, et les combla de politesses, songeant moins à ceux qui lui donnaient ce titre, qu'au héros qui l'avait reçu avant lui. Et cet homme, amoureux de la gloire, dont il ne connaissait ni la nature, ni les bornes, marchant sur les traces d'Hercule et de Bacchus, sans s'arrêter là même où elles lui manquaient, détourna ses regards de ceux qui lui faisaient cette offre, pour ne voir que son rival de gloire, comme s'il fût déjà en possession du ciel qu'ambitionnait sa vanité, parce qu'on l'avait assimilé à Hercule. Et qu'avait-il de commun avec Hercule, ce jeune fou, dont une heureuse témérité fit tout le mérite ? Hercule ne conquit rien pour lui-même ; il parcourut l'univers, non pas en ambitieux, mais en libérateur. Eh ! qu'avait à conquérir l'ennemi des méchants, le vengeur des bons, le pacificateur de la terre et des mers? Pour Alexandre, brigand dès son enfance, destructeur des nations, fléau de ses amis comme de ses ennemis, son plus grand bonheur fut d'être l'effroi du monde, oubliant que, si les plus nobles animaux sont redoutables, les plus vils ne sont pas moins à craindre par la malignité de leur venin. XIV. Revenons maintenant à notre sujet. Prodigué à tout le monde, un présent n'est agréable à personne. Nul ne se regarde comme l'hôte d'un aubergiste ou d'un cabaretier, ni comme le convive d'un homme qui tient table ouverte, et de qui l'on peut dire : Qu'a-t-il fait pour moi? ce qu'il a fait pour le premier venu, pour son ennemi, pour le dernier des hommes. M'a-t-il distingué personnellement? du tout : c'est sa manie qu'il a satisfaite. Voulez-vous donc de la reconnaissance? ne donnez rien de commun : on ne sait aucun gré d'un présent banal. Qu'on ne s'imagine point par là que je veux restreindre la bienfaisance et l'enchaîner dans d'étroites limites. Qu'elle se donne pleine et libre carrière, mais en marchant au but, et non en courant à l'aventure. On peut encore, tout en prodiguant ses bienfaits, persuader à chacun de ceux sur lesquels ils tombent, qu'on ne l'a point confondu dans la foule. Que chacun d'eux, grâce à quelque marque distinctive, puisse se flatter d'une faveur particulière, et se dire : J'ai reçu la même chose que les autres, mais sans l'avoir demandée; ce qu'ils n'ont dû qu'à de longs services, il ne m'a fallu qu'un instant pour l'obtenir. Je ne suis pas le seul qui ait obtenu cette faveur, mais aucun ne l'a reçue en termes si obligeants et si gracieux. D'autres ne l'ont obtenue qu'après l'avoir demandée ; on ne m'a pas laissé le temps d'achever ma demande. Cet autre a reçu comme moi, mais il était en position de rendre, et sa vieillesse prodigue et sans postérité ouvrait tout vaste champ à l'espérance. On m'a donc plus donné, tout en me donnant la même chose, puisqu'on m'a donné sans espoir de retour. Comme une coquette, en partageant ses faveurs entre la foule de ses amants, a toujours l'art de laisser à chacun d'eux quelque marque d'amour particulière, celui qui veut rendre ses bienfaits aimables doit trouver le secret, en obligeant tout le monde, de flatter chacun d'une préférence personnelle. Loin de moi la pensée de vouloir entraver la bienfaisance: plus elle s'étend et se multiplie, plus elle devient honorable. Mais elle demande du discernement; prodiguée sans choix et au hasard, elle ne provoque pas la reconnaissance. N'allez donc pas croire, qu'en vous donnant ces préceptes, j'aie l'intention de la circonscrire et de la renfermer dans des bornes plus étroites : ce serait bien mal comprendre mes leçons. Est-il une vertu pour laquelle nous ayons plus de respect, que nous encouragions davantage ? à qui sied-il mieux d'en parler, qu'à nous autres philosophes, qui voulons rendre sacrés les liens de la société humaine ? XV. Quel est donc mon but ? Puisqu'il n'y a point de passion honnête, quelque louable qu'elle soit dans son principe, quand la modération n'en fait pas une vertu, je ne veux point que la bienfaisance devienne prodigue. Si l'on aime à recevoir un bienfait, si on le reçoit avec tout l'empressement de la reconnaissance, c'est quand la raison le fait tomber sur qui le mérite, quand il n'est pas abandonné au hasard et à une précipitation irréfléchie, quand on peut s'en glorifier et s'en faire honneur. Est-ce un bienfait, lorsqu'on rougit d'en avouer l'auteur? Mais combien la reconnaissance est plus agréable, comme elle se grave plus profondément dans le coeur, et pour ne jamais s'effacer, quand elle se donne au bienfaiteur, plutôt qu'au bienfait lui-même ! «Il y a des gens, disait Crispus Passienus, dont j'aime mieux l'estime que. les bienfaits; il y en a d'autres dont j'aime mieux les bienfaits que l'estime par exemple, ajoutait-il, je préférerais l'estime d'Auguste, mais j'aimerais mieux les bienfaits de Claude. » Quant à moi, je pense que nous ne devons pas désirer les bienfaits de ceux dont nous dédaignons l'estime. Eh quoi ! fallait-il donc refuser les présents de Claude ? Non, sans doute ; mais on ne devait les recevoir que comme ceux de la Fortune, qui d'un instant à l'autre peut devenir notre ennemie. Pourquoi donc séparer deux choses si essentiellement liées entre elles ? Un bienfait. cesse de l'être, lorsqu'on en ôte ce qui en fait le mérite, le discernement. L'or prodigué sans jugement et sans bienveillance, ne mérite pas plus 1e nom de bienfait qu'un trésor trouvé par hasard. Il y a de ces choses qu'on peut recevoir, mais qui n'obligent pas à la reconnaissance. |
|
|