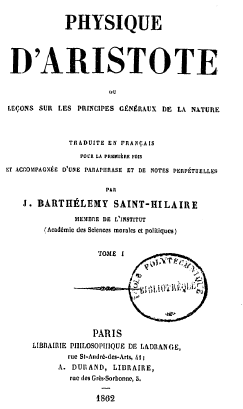
ARISTOTE
PHYSIQUE.
TOME UN : PARAPHRASE DU LIVRE III DE LA PHYSIQUE D'ARISTOTE. DÉFINITION DU MOUVEMENT. - DE L'INFINI.
PARAPHRASE DU LIVRE II - PARAPHRASE DU LIVRE IV
LIVRE III (traduction, texte grec et notes)
|
|
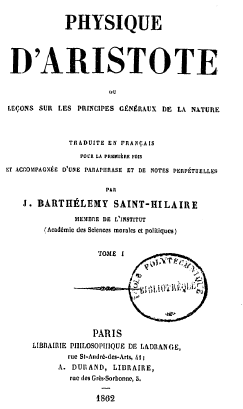
1.
La nature étant le principe du mouvement, ou, en termes plus généraux, du changement, et notre étude présente s'appliquant à la nature, nous devons nous rendre bien compte de ce que c'est que le mouvement ; car, ignorer ce qu'il est, ce serait ignorer absolument ce que c'est que la nature, dans toutes les parties qui la composent. Puis ensuite, une fois que nous aurons défini le mouvement, il faudra tâcher d'étudier les conditions dont il est toujours accompagné et les phénomènes qu'il implique. Ainsi le mouvement doit être rangé dans la classe des quantités continues ; et le premier caractère du continu, c'est d'être infini. On ne peut pas, en effet, définir le continu sans employer la notion de l'infini, et le continu n'est, on peut dire, que ce qui est divisible à l'infini. De plus, il n'y a point de mouvement possible sans espace et sans temps, la question de l'espace comprenant aussi celle du vide. Voilà donc déjà des motifs pour étudier avec soin l'espace, le vide, le temps et le mouvement ; mais nous avons en outre cette raison, qu'ils sont communs à toutes choses, et qu'ils sont universels. Nous examinerons chacune de ces questions séparément ; car il faut commencer par les qualités générales et communes des choses, avant d'en venir à leurs propriétés spéciales. Débutons par la définition du mouvement, ainsi que nous venons de le dire.
Rappelons-nous d'abord les différents points de vue sous lesquels on peut considérer l'être. Il est tantôt une réalité actuelle, une entéléchie, tantôt il est à l'état de simple puissance, tantôt il est les deux à la fois. A un autre égard, l'être est tantôt substance, tantôt quantité, tantôt qualité, ou telle autre des catégories dans lesquelles il se partage. Pour les relatifs, il faut distinguer ceux qui ont entre eux le rapport d'excès et de défaut, comme le grand et le petit, le peu et le beaucoup, et ceux qui ont le rapport de passif et d'actif. C'est dans cette dernière subdivision qu'il faut classer le moteur et le mobile, puisque le moteur meut le mobile, et que le mobile est mu par le moteur ; relations, comme on le voit, d'action d'une part, et de souffrance de l'autre. Il n'y a pas de mouvement en dehors des choses ainsi comprises ; et c'est toujours en elles que le mouvement se passe ; car, tout être qui change doit nécessairement changer, ou dans sa substance, ou dans sa quantité, ou dans sa qualité, on de lieu. Or, il n'y a point d'être commun à toutes les catégories qui ne soit, en même temps, ou substance, ou quantité, ou qualité, ou telle autre catégorie de l'être. Par conséquent, il n'y a point de mouvement possible qui ne rentre dans une de ces catégories, puisqu'il n'y a point d'être possible si ce n'est en elles.
Mais chacune de ces catégories peut être double selon le point de vue d'où on la considère. Ainsi, dans la substance, on distingue la forme et la privation ; dans la qualité, les deux contraires, par exemple, le blanc et le noir ; la quantité peut être complète et incomplète ; et, enfin, dans la catégorie du lieu, l'être va en haut ou va en bas, selon qu'il est léger ou pesant, etc. Par conséquent, il y a autant de genres de mouvement qu'il y a de genres de l'être dans les catégories qui on vient d'énoncer. De plus, comme dans chaque genre on peut distinguer l'acte de la simple puissance, il s'en suit qu'on peut définir le mouvement de cette façon : L'acte, la réalisation ou entéléchie de l'être qui était en puissance, avec les diverses nuances que cet être peut présenter. Ainsi, l'altération est le mouvement de l'être altéré en tant qu'altéré; l'accroissement et la décroissance sont les mouvements de l'être qui s'accroît ou qui diminue ; la langue grecque n'a pas pour ces deux nuances une expression commune, ainsi qu'elle en a une pour l'altération ; la génération et la destruction sont les mouvements de l'être qui est engendré ou détruit, qui se produit ou qui disparaît ; enfin, la translation est le mouvement de l'être transféré d'un lien à un autre.
Ce qui prouve bien l'exactitude de cette définition, qui fait du mouvement un acte, c'est que quand une chose passe de la puissance à l'acte, nous disons que son mouvement est accompli. Soit, par exemple, une chose à construire, une chose qui peut être construite. A ne la considérer que sous ce rapport, du moment qu'elle se réalise et qu'elle est en entéléchie, nous disons qu'elle est construite, et le mouvement de cette chose est la construction. Même remarque pour tout autre acte, l'acte d'apprendre, l'acte de guérir, l'acte de rouler, l'acte de sauter, l'acte de vieillir, etc. Ainsi le mouvement est l'acte. Mais ce n'est pas là encore sa définition tout entière. Les mêmes choses peuvent être en acte et en puissance, mais non pas à la fois ni relativement à la même chose ; par exemple, un même objet est chaud en puissance, mais en, réalité il est froid. Il s'en suit qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui agissent ou qui souffrent les unes par les autres. Tout est à la fois actif et passif, suivant l'aspect sous lequel on le considère. Par conséquent, le moteur, qui agit selon les lois de la nature, est mobile à son tour, et tout ce qui meut a d'abord été mu lui-même ; mais je limite ceci au domaine de la nature, et je ne vais pas aussi loin que certains philosophes qui croient que tout moteur, sans aucune exception, reçoit le mouvement qu'il communique. Nous nous réservons de démontrer ailleurs, vers la fin de ce traité, qu'il doit y avoir un moteur qui est lui-même absolument immobile (Livre VIII).
Mais, pour le moment, nous nous bornons à répéter ici que le mouvement est l'acte, la réalisation ou entéléchie de ce qui était en puissance, quand cet être qui, antérieurement, était simplement possible, devient actuel en tant que mobile, soit qu'il reste en lui-même ce qu'il est, soit qu'il subisse une certaine altération. Quand je dis : En tant que mobile, j'entends par exemple que l'airain est la statue en puissance, bien que l'acte ou entéléchie de l'airain, en tant qu'airain, ne soit pas le mouvement; car, ce n'est pas essentiellement la même chose d'être de l'airain et d'être mobile en puissance ; et, si absolument parlant et même rationnellement, c'était là une seule et même chose, l'acte de l'airain en tant qu'airain serait le mouvement. Mais cela n'est pas du tout ; et pour se convaincre que l'essence de la chose ne se confond pas avec sa mobilité, il suffit de regarder aux contraires. Ainsi, c'est chose fort différente de pouvoir se bien porter et de pouvoir être malade ; car, s'il n'y avait pas de différence entre les simples possibilités, il n'y en aurait pas davantage dans les réalités actuelles ; et se bien porter se confondrait avec être malade, la santé se confondrait avec la maladie. Ce qui demeure et subsiste ici, c'est le sujet qui garde son unité, soit qu'il se porte bien, soit qu'il souffre par l'effet du phlegme on du sang. Mais le sujet ne doit pas être confondu avec sa puissance, pas plus que la couleur actuelle ne doit être confondue avec la couleur en puissance, le visible ; et j'en conclus que le mouvement peut être défini très convenablement : L'acte ou entéléchie du possible en tant que possible.
Je maintiens la justesse de cette définition, et j'affirme que le mouvement n'est que cela ; qu'une chose n'a de mouvement vrai qu'au moment où cette réalisation, cette entéléchie a lieu, et qu'elle n'en a ni avant ni après ; car toute chose peut être ou n'être pas en acte. Ainsi, une maison à construire est en simple puissance ; mais quand elle est construite, elle est une maison en acte, en réalité. L'acte de la chose constructible en tant qu'elle est à construire, c'est la construction ; et l'acte de la chose à construire, c'est-à-dire la construction, a pour résultat la maison. Mais une fois la maison faite, la chose constructible, c'est-à-dire qui pouvait être construite, n'existe plus, puisque la chose à construire est construite. Donc, nécessairement, la construction est bien l'acte ; la construction est un mouvement d'une certaine espèce ; et le même mode de définition serait applicable à tout autre genre de mouvement.
Une dernière preuve de l'exactitude de cette définition, c'est de voir les difficultés qu'ont eues les philosophes à définir le mouvement autrement qu'on ne le fait ici, et les erreurs qu'ils ont commises. Ils n'ont pas pu classer le mouvement et le changement dans un autre genre que celui de l'acte, et ils n'ont fait que s'égarer en considérant le mouvement sous un autre jour. On peut vérifier, en effet, ce que devient le mouvement dans ces théories où on en fait une diversité, ou une inégalité, ou même le non-être. Mais il est évident qu'il n'y a pas de mouvement nécessaire, ni pour le divers, ni pour l'inégal, ni surtout pour ce qui n'existe point. Le changement ne tend pas plus au divers, à l'inégal et au non-être, qu'il ne vient d'eux, ni de leurs opposés, le même, l'égal et l'être. Mais l'erreur des philosophes que nous désignons ici vient de ce qu'ils ont pris le mouvement comme quelque chose d'indéfini. Ils l'ont classé dans leur série négative, correspondant à leur première série positive. Mais les termes de la série négative n'existent pas en réalité, puisqu'ils sont purement privatifs, et qu'aucun d'eux n'est ni substance, ni quantité, ni qualité, ni aucune des autres catégories ; le mouvement a été placé dans la série des termes indéterminés. Je conçois d'ailleurs l'hésitation et l'embarras de ces philosophes, attendu qu'on ne peut ranger d'une manière absolue le mouvement ni dans la puissance ni dans l'acte des êtres ; il n'est absolument ni acte ni puissance. Ainsi, une chose qui peut devenir de telle quantité n'a pas nécessairement le mouvement pour acquérir cette quantité, et l'airain ne devient pas nécessairement statue, de même qu'une chose arrivée à avoir telle quantité n'a plus alors de mouvement, puisqu'elle est parvenue à son terme et à sa forme. Le mouvement est donc bien une sorte d'acte ; mais c'est un acte incomplet; et cela se conçoit, puisque le possible dont le mouvement est l'acte est lui-même incomplet.
Je reconnais d'ailleurs, et ces distinctions subtiles le prouvent assez, qu'il y a grand-peine à savoir avec précision ce qu'est le mouvement ; car il faut nécessairement le classer, soit dans la privation, soit dans l'acte, soit dans la puissance ; mais qu'on en fasse un acte, une puissance ou une privation, la théorie n'est jamais parfaitement satisfaisante. Reste donc à le considérer, ainsi que nous venons de le faire, comme un acte d'un certain ordre. Mais, j'avoue que cet acte, même tel que nous l'avons expliqué, est très difficile à bien comprendre, quoi que ce ne soit pas tout à fait impossible.
II.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, tout moteur dans la nature est d'abord mu lui-même, parce qu'il est mobile en puissance, et que son immobilité, qui n'est pas absolue est simplement la privation du mouvement, ou le repos.
Le repos est l'immobilité de ce qui, par nature, possède le mouvement sans en faire usage à un certain moment donné. Agir sur un mobile en tant qu'il est mobile, c'est là précisément ce qu'on appelle mouvoir ; mais le moteur ne peut agir que par contact, et du moment qu'il touche le mobile il en reçoit une certaine action, en même temps qu'il lui en communique une. Je transforme donc un peu la définition du mouvement, et je dis qu'il est l'acte ou entéléchie, la réalisation du mobile en tant que mobile. Mais comme le contact est indispensable pour le phénomène qui se passe ici, le moteur souffre en même temps qu'il agit. C'est une forme nouvelle que le moteur apporte toujours à l'être qu'il meut, soit eu substance, soit en qualité ; et cette forme sera, comme cause finale, le principe du mouvement que donne le moteur. C'est, par exemple, un homme actuel, réel ou en entéléchie, qui fait un homme réel de l'être qui n'était homme qu'en puissance. Ainsi, le mouvement vient sans doute du moteur qui le donne ; mais il est réellement dans le mobile qui le reçoit, et dont il est l'entéléchie. Ainsi, l'acte du moteur se confond avec celui du mobile et ne peut être autre ; car il faut que tous deux aient leur réalisation, leur entéléchie. Le moteur en puissance est moteur à ce titre, par cela seul qu'il peut mouvoir ; mais le moteur réel est moteur à ce titre, parce qu'effectivement il meut et agit. Il est l'agent du mobile ; et, par conséquent, il n'y a qu'un seul acte pour le moteur et pour le mobile à la fois. C'est ainsi que dans les nombres il n'y a qu'un seul et même intervalle d'un à deux et de deux à un, soit que l'on monte soit que l'on descende, du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Les deux choses n'en font bien qu'une ; mais, cependant, leur définition réciproque n'est pas la même : un est la moitié de deux, et deux est le double de un. C'est là aussi le rapport et la différence du moteur au mobile qu'il meut.
Il est vrai qu'a cette théorie on fait une objection, et il faut y répondre, bien qu'elle soit purement logique et qu'elle ne repose pas sur une réalité. L'acte du moteur, dit-on, doit être différent de celui du mobile, comme l'acte de l'actif est différent de celui du passif. D'une part, c'est l'activité ; de l'autre au contraire, c'est la passion et l'affection subie. L'oeuvre et la lin, du moteur, c'est un résultat produit ; l'oeuvre du mobile et sa fin c'est un certain état tout passif. Voici la réponse que je fais à cette objection. Si l'on prétend séparer les deux actes du moteur et du mobile, au lieu de les réunir en un seul, on en fait deux mouvements ; et alors je demande, en admettant qu'ils sont autres, dans quel terme, le moteur ou le mobile, on les place. Ou les deux actes sont dans ce qui souffre l'action, dans le mobile ; ou bien l'action se trouve d'une part dans le moteur qui agit; et d'autre part, la passion se trouve dans le mobile qui souffre l'action. Mais si l'on donne également le nom d'acte, ou d'action à cette passivité, c'est une simple homonymie, une pure équivoque de mots. Si on les sépare et qu'on place l'action dans l'agent et la passion dans le patient, comme il semble que cela doit être, alors on met le mouvement dans le moteur, au lieu du mobile où il est, ainsi que nous venons de le démontrer ; car entre le moteur et le mobile, le rapport est le même qu'entre l'action et la passion. On sera ainsi amené à. soutenir ces deux absurdités, ou que tout moteur est mu comme le mobile, ou que ce qui ale mouvement ne l'a pas ; car si le mouvement est dans le moteur, ainsi qu'on le prétend, il faut alors que le moteur soit mu, ce qui est contradictoire ; ou bien si l'on dit que le moteur n'est pas mu, ou ne comprend plus qu'ayant en soi le mouvement, il ne l'éprouve pas. Que si l'on prétend que les deux actes sont dans le mobile, c'est-à-dire dans le patient au lieu d'être dans l'agent ou le moteur, de même que le disciple qui étudie réunit en lui l'enseignement qu'il reçoit et l'étude par laquelle il s'applique, je réponds qu'il en résultera cette première absurdité, que l'acte d'un être n'est plus dans cet être, puisque l'action de l'agent sera dans le patient et non plus dans l'agent lui-même ; puis, une seconde absurdité non moins évidente, c'est qu'une seule et même chose pourra avoir à la fois deux mouvements différents et peut-être même contraires. Mais comment concevoir dans un seul et même être deux modifications diverses, lesquelles tendraient cependant à la même fin et à la même forme ? Dira-t-on qu'il n'y a qu'un seul et même acte pour l'agent et le patient ? Je réponds que c'est impossible, parce qu'il est contre toute raison que deux choses d'espèce différente, comme le sont l'agent et le patient, puissent avoir un seul et même acte. Que si l'on identifie l'enseignement que reçoit le disciple avec l'étude personnelle qu'il fait pour s'instruire lui-même, l'action avec la passion, alors il faudra admettre aussi, qu'enseigner est la même chose qu'étudier, que souffrir et agir sont tout un, que quand ou enseigne ou étudie, et que celui qui meut est aussi celui qui souffre et qui est mu. Je conviens qu'à certains égards, il n'est pas absurde de soutenir que l'acte d'une chose puisse être dans une autre chose. Ainsi l'enseignement est bien l'acte du maître qui enseigne ; mais cet acte a beau résider dans un certain être doué de telle ou telle capacité, il n'y est pas complètement isolé et abstrait ; il y est l'acte de cet être qui enseigne, dans un autre être qui reçoit l'enseignement; c'est l'acte du maître dans et sur le disciple. Il n'est pas non plus impossible que le même acte appartienne à deux choses différentes. Sans doute, il n'y est pas essentiellement et absolument identique, comme le sont dans leur définition un Habit et un Vêtement ; mais le même acte peut être, dans l'une des deux choses, en puissance, et dans l'autre, en réalité actuelle. J'ajoute, pour répondre au doute soulevé tout à l'heure, que ce n'est pas une conséquence nécessaire, comme on le dit, que l'acte de l'enseignement et celui de l'étude soient identiques ; et en supposant même qu'il faille à certains égards confondre l'action et la passion, ce n'est pas du tout comme on confond l'Habit et le Vêtement, dont la définition essentielle est toute pareille ; mais c'est seulement comme l'on peut confondre le même chemin fait en deux sens différents. D'Athènes à Thèbes, et de Thèbes à Athènes, le chemin est pareil ; mais dans un cas, c'est l'aller ; et dans l'autre, le retour. C'est qu'en effet on peut bien dire de deux choses qu'elles sont identiques, quand elles ne le sont qu'à certains égards et relativement ; mais pour être absolument identiques, il faut qu'elles le soient dans leur essence. En d'autres termes, en supposant que l'enseignement et l'étude sont une même chose, il ne s'en suivrait pas que l'acte d'enseigner et l'acte d'étudier fussent un seul et même acte. La distance est la même sans doute entre les cieux points ; mais ce n'est pas identiquement la même chose d'aller du premier au second, ou du second, au premier.
Pour résumer ceci en quelques mots, je dirai qu'à proprement parler, ni l'enseignement et l'étude, ni l'action et la passion ne sont une seule et même chose. La seule chose identique de part et d'autre, c'est le mouvement, dont l'action et la passion ne sont que des modes divers ; car on peut distinguer rationnellement l'acte d'une chose qui agit sur une autre, et l'acte d'une chose qui souffre l'action d'une autre chose. Sous ces deux faces, c'est toujours le mouvement.
III.
Telle est donc selon nous la définition du mouvement, soit considéré en général, soit considéré dans ses espèces ; et les explications que nous avons données suffisent pour qu'on ne soit pas embarrassé à définir chacune des espèces particulières. Par exemple, si l'on voulait définir l'espèce de mouvement qu'on appelle l'altération, c'est-à-dire le mouvement dans la qualité, on dirait que l'altération est l'acte ou l'entéléchie de l'être altérable, en tant qu'il peut être réellement altéré. On pourra même trouver encore une expression plus claire, en disant que le mouvement est l'acte de ce qui peut agir ou souffrir, en tant que l'objet est ce qu'il est ; et cela, soit d'une manière absolue et toute générale, soit d'une manière spéciale, selon les cas divers : ici l'acte de la construction d'une maison que l'on construit ; ailleurs l'acte de la guérison que le médecin opère, etc. Le procédé serait le même pour tous les cas possibles du mouvement, et l'on ferait subir les mêmes changements à la définition que nous en avons essayée.
IV.
Après avoir donné une idée toute générale du mouvement, nous poursuivons le cours de notre étude. La science de la nature, telle que nous la concevons, s'occupe nécessairement de trois choses : les grandeurs, le mouvement et le temps; et ces trois choses, qui comprennent à peu près tout, doivent être ou infinies ou finies. Je dis qu'elles comprennent à peu près tout, parce qu'il y a quelques exceptions ; et, par exemple, il y a des choses qui ne peuvent pas être ni finies ni infinies ; ainsi, le point en mathématiques et la qualité dans les choses ; car ni la qualité ni le point ne peuvent être rangées ni dans l'une ni dans l'autre classe du fini ou de l'infini. Il convient donc, quand on étudie la nature, d'étudier aussi l'infini ; et c'est ce que nous allons faire en nous demandant si l'infini existe ou s'il n'existe pas, et en recherchant, une fois son existence reconnue, ce qu'il est essentiellement.
En nous livrant à cette étude, nous ne faisons qu'imiter les autres philosophes, qui ont pensé, comme nous, qu'elle est indispensable à la science de la nature ; et tous ceux qui ont quelque autorité en ces matières, se sont si bien occupés de l'infini qu'ils en ont fait un principe des êtres. Les uns, comme les Pythagoriciens et Platon, pensant que l'infini est le principe essentiel des êtres, et non pas un attribut et un simple accident, en ont fait une substance existant par elle-même. La seule différence entre l'école de Pythagore et le système Platonicien, c'est que pour les premiers, l'infini fait partie des choses possibles, puisque d'une part ils ne séparent pas le nombre en l'abstrayant des choses elles-mêmes, et que d'autre part ils placent aussi l'infini en dehors du ciel, où ils admettent encore des choses sensibles. Platon au contraire ne voit rien en dehors du ciel et de ce monde, pas mêmes les Idées, auxquelles on ne peut d'ailleurs assigner aucun lieu ; et il met l'infini à la fois dans les choses sensibles et dans les Idées. Une autre différence encore entre les Pythagoriciens et Platon, c'est qu'ils identifiaient l'infini et le pair, attendu que tout nombre pair est indéfiniment divisible par deux. En ce sens, le nombre pair, par la possibilité de ses divisions indéfinies, donne l'infinitude aux choses, tandis que l'impair, même quand il dépasse le pair ou qu'il le limite en empêchant les divisions d'aller aussi loin, ne peut être considéré comme infini ; car l'impair est essentiellement indivisible. En preuve, les Pythagoriciens citaient ce qui se passe dans la série des nombres, où, en ajoutant à l'unité les gnomons, c'est-à-dire la suite des nombres impairs 3, 5, 7, 9, etc., on obtient toujours la même figure, laquelle est un carré, tandis qu'en ajoutant à l'unité la suite des nombres pairs 2, 4, 6, 8, etc., on obtient toujours une figure différente, ou plutôt des figures qui varient à l'infini. Quant à Platon, loin de considérer ainsi l'infini, il reconnaissait deux infinis, l'un de grandeur et l'autre de petitesse.
Le point de vue où se sont placés les Physiciens n'est plus celui des Pythagoriciens ni de Platon. Ils n'ont plus donné à l'infini une nature substantielle, et ils en ont fait un simple attribut des éléments qu'ils admettaient, l'air, l'eau et les intermédiaires analogues. Parmi les philosophes qui limitent le nombre des éléments, soit à deux, soit à trois, soit à quatre, personne n'a songé à dire que ces éléments en nombre fini fussent infinis en grandeur. Mais ceux qui supposent les éléments en nombre infini, comme Anaxagore avec ses parties similaires ou Homoeoméries, et Démocrite avec ses germes et ses atomes partout répandus, ceux-là pensent que l'infini est composé par le contact universel des choses, et leur absolue continuité. Anaxagore affirme qu'une partie quelconque du monde est un mélange pareil à tout le reste de l'univers, se fondant sur cette observation, d'ailleurs fort contestable, que tout vient de tout dans l'état présent des choses. De là il tire cette induction que tout à l'origine des choses était dans tout, que la chair, par exemple, qui aujourd'hui est distincte de l'os était alors de l'os aussi bien que de la chair, ou telle autre chose, que toutes choses étaient confondues pêle-mêle les unes avec les autres, en un mot que tout était tout. Selon lui, il y a dans une chose quelconque non seulement un principe qui distingue cette chose de toutes les autres, mais aussi des principes qui peuvent distinguer toutes les autres choses. D'autre part, comme tout ce qui se produit actuellement sous nos yeux vient d'un corps semblable à celui qui est produit, et qu'il faut bien un principe à la génération des êtres, qui est très réelle, sans d'ailleurs qu'elle soit simultanée et confuse comme le croit Anaxagore, il en concluait que le principe de toute génération est en définitive unique ; et ce principe unique de tout ce qui est, Anaxagore l'appelait l'Intelligence. Or, l'Intelligence qui ne peut agir qu'intellectuellement, est partie, pour son oeuvre d'organisation, d'un certain état antérieur. Donc tout était dans le chaos, que l'Intelligence a ordonné, et c'est elle qui a communiqué à tontes choses le mouvement régulier et immuable que nous voyons. Telles sont les théories d'Anaxagore. Démocrite pensait au contraire que jamais les éléments primordiaux des choses, les atomes, ne peuvent venir les uns des autres ; c'est la matière commune de tout, c'est un élément et un corps commun, qui ne varie que par la grandeur et la configuration de ses parties.
Ainsi, tout ce qui précède prouve bien que l'étude de l'infini appartient à la science de la nature ; et il faut louer les philosophes d'avoir toujours fait de l'infini, un de leurs principes. L'infini, en effet, ne peut pas avoir été fait pour rien ; et on ne peut lui donner un autre caractère que celui de principe ; car tout doit être ou principe ou conséquence d'un principe ; or, l'infini ne peut avoir de principe, puisque alors il aurait une limite qui le rendrait fini ; donc il est bien principe, et il ne peut être que cela. De plus, étant un principe, il faut que l'infini soit incréé et impérissable ; car tout ce qui a été créé doit avoir une fin, et il y a un terme à tout ce qui dépérit. Or, l'infini ne peut avoir de terme sous quelque rapport que ce soit ; il n'y a donc pas de principe pour lui, et c'est lui au contraire qui est le principe de tout le reste. "Il embrasse tout ; il gouverne tout," comme le disent ceux qui, en dehors de l'infini, ne reconnaissent point d'autres causes que lui, et n'ont point recours à l'intervention de l'Intelligence ou de l'Amour. Ces philosophes ajoutent aussi que l'infini est l'être divin, puisqu'il est immortel et indestructible, ainsi que le disait Anaximandre et avec lui la plupart des Naturalistes.
VII
Il y a cinq arguments principaux à l'aide desquels on peut démontrer l'existence de l'infini. C'est d'abord le temps, qui est infini, et qui ne peut avoir de fin, de même qu'il n'a point eu de commencement. En second lieu, c'est la divisibilité des grandeurs qui est sans fin ; et les mathématiques font souvent usage de la notion de l'infini. En troisième lieu, la génération et la destruction perpétuelles des êtres, et leur renouvellement indéfectible prouvent bien qu'il y a un infini d'où sort sans cesse tout ce qui se produit ; car, sans lui, cette succession éternelle viendrait à défaillir. Quatrièmement, tout ce qui est fini est toujours fini relativement. quelque chose qui le limite ; et, nécessairement, il n'y aurait ni limite ni fin, s'il fallait que toujours une chose en limitât une autre ; c'est donc à quelque chose d'infini qu'aboutissent les choses, et c'est l'infini qui est leur limite commune. Enfin, le cinquième et dernier argument est le plus puissant de tous, et c'est celui qui a le plus occupé les philosophes : c'est que notre pensée conçoit l'infini, soit pour les nombres, soit pour les grandeurs, soit pour l'espace en dehors des sphères célestes, et que quelque grand que soit un nombre, une grandeur, un espace quelconque, la pensée peut toujours concevoir quelque chose de plus grand. L'espace qui est en dehors du ciel que nous voyons étant infini, il faut bien qu'il y ait un corps infini et des mondes sans fin ; car, pourquoi le vide serait-il dans une partie de l'univers, puisqu'il n'est pas dans celle où nous sommes ? Pourquoi le plein ne serait-il point partout, du moment qu'il est quelque part ? Et même en admettant le vide, il n'en faudrait pas moins que cet espace vide fût infini ; et l'on reviendrait ainsi à admettre l'existence d'un corps infini ; car dans les choses éternelles, du moment qu'une chose peut être, elle est ; et la puissance s'y confond avec l'acte, l'acte s'y confond avec la puissance.
J'avoue que, malgré ce que je viens de dire, la théorie de l'infini est toujours fort difficile, et que l'on tombe dans une foule d'impossibilités, soit qu'on en admette, soit qu'on en rejette l'existence. D'autre part, l'existence de l'infini étant admise et démontrée, de nouvelles questions se présentent. Comment existe-t-il ? Est-ce comme substance ? Ou bien n'est-il qu'un accident de quelque autre substance existant elle-même dans la nature ? Ou bien encore n'existe-t-il ni à l'état de substance, ni à l'état d'attribut ? Mais, sans se perdre dans ces recherches épineuses, on peut affirmer que l'infini existe, ne serait-ce que par cette seule considération que le nombre des choses est infini. Et parmi toutes ces questions, celle qui intéresse plus particulièrement le Physicien, c'est de savoir si parmi les choses sensibles, dont l'étude constitue la science de la Physique, il est une grandeur qui soit infinie.
VI.
Pour approfondir cette question spéciale, il faut d'abord avoir le soin de bien distinguer les diverses acceptions du mot Infini. Premièrement, on entend par Infini ce qui, par sa nature, ne peut être parcouru ni mesuré ; de même que, par sa nature, la voix est invisible, par ce seul motif qu'elle est faite pour être entendue et non pas vue. En un second sens moins précis que celui-là, on dit d'une chose qu'elle est infinie par cela seul qu'elle n'a point, an moment où on la considère, le terme qu'elle a ordinairement. Bien que par sa nature elle ait un terme nécessaire, on dit qu'elle est sans terme ou à peu près sans terme ; et à cet égard on l'appelle infinie, parce que sa fin ne nous est pas immédiatement accessible. Enfin, une chose peut être considérée comme infinie, soit parce qu'elle peut s'accroître sans terme, soit parce qu'elle peut être supposée divisée à l'infini, soit même parce qu'elle peut être considérée sous ces deux rapports à la fois.
Ceci posé, nous disons qu'il est impossible que l'infini soit séparé des choses sensibles, ainsi qu'on l'a quelquefois prétendu, et que ce quelque chose ainsi isolé de tout soit lui-même infini ; car si l'on soutient que l'infini n'est ni un nombre, ni une grandeur, et qu'il est essentiellement une substance, et non point un accident, il s'en suit que l'infini est indivisible, attendu que le divisible est toujours nécessairement ou une grandeur, on un nombre. Mais s'il est indivisible, il n'est plus infini, si ce n'est indirectement, de même qu'on dit de la voix qu'elle est invisible. Essentiellement la voix n'est pas invisible ; elle est, si l'on peut dire ainsi, inentendable. Mais ce n'est pas sous ce rapport indirect que l'on considère l'infini quand on en admet l'existence, et ce n'est pas ainsi que nous l'étudions nous-mêmes, puisque pour nous la nature essentielle de l'infini, c'est de ne pouvoir être parcouru et épuisé ; il est divisible, et ses divisions ne peuvent avoir de terme. D'autre part, si l'infini existe comme simple accident des choses, et non plus comme substance, il n'est pas alors, comme on le disait, l'élément et le principe des choses, pas plus que l'invisible, qui est un accident de la voix, n'est l'élément et le principe du langage, bien que la voix soit invisible. En outre, comment comprendre que l'infini puisse être lui-même séparé des choses quand le nombre et la grandeur, dont l'infini est un attribut, ne sont pas eux-mêmes séparés ? Certes, si le sujet n'est pas séparé, l'attribut l'est bien moins encore ; et ce prétendu infini l'est nécessairement bien moins que la grandeur et le nombre.
Mais si l'infini, ainsi compris, ne peut être ni substance, ni principe, il est évident qu'il ne peut pas davantage être actuellement, être en acte, dans les choses sensibles ; car, s'il était en acte, il serait divisible ; et, alors, toute partie qu'on en séparerait devrait être infinie comme lui. Mais, du moment qu'on fait de l'infini, une substance et non plus un simple attribut, il n'est plus possible de distinguer l'infini et l'essence de l'infini. L'infini étant simple en tant que substance, il se confond avec son essence, et il n'y a pas là de division possible. Par conséquent, ou l'infini est indivisible, ou selon cette théorie il est divisible en d'autres infinis ; mais c'est là une impossibilité, et l'infini est nécessairement un. Une partie de l'air est bien encore de l'air ; mais il ne se peut pas de la même façon qu'il y ait un infini d'infini, et qu'une partie de l'infini soit l'infini. C'est cependant à cette conclusion qu'on est amené si l'on suppose que l'infini est une substance et un principe. Dira-t-on, au contraire, que l'infini est indivisible, et non plus divisible ? Alors, il est impossible qu'un être réel, un être actuel, soit infini, parce qu'il faut toujours qu'un tel être soit une quantité déterminée, c'est-à-dire une quantité qui est précisément le contraire de l'infini. Que si l'on cesse de soutenir que l'infini soit une substance, et si on le réduit à être un simple attribut, dès lors il cesse d'être un principe ; et par suite, le véritable infini, c'est ce dont l'infini est l'attribut, et non plus l'infini lui-même ; c'est l'air, par exemple, si l'on prend l'air comme infini ; c'est le nombre pair indéfiniment divisible, si c'est le nombre que l'on considère. En un mot, c'est se tromper étrangement sur l'infini, que d'en faire avec les Pythagoriciens, une substance, et de le regarder en même temps comme formé de parties diverses.
VII.
Nous savons bien qu'on pourrait étendre encore l'étude que nous faisons ici et qu'on pourrait considérer l'infini non seulement dans la nature, mais aussi dans les mathématiques, dans la pensée, et dans les choses qui, comme elle, n'ont pas de grandeur. Mais loin d'élargir le cercle, nous préférons le borner ; et comme la Physique ne doit s'occuper que de choses sensibles, nous nous astreindrons à cette seule question de savoir si, parmi les choses que perçoivent nos sens, il peut y en avoir une dont le développement soit infini. Nous nous servirons d'arguments rationnels et d'arguments physiques, pour prouver qu'il n'y a pas de corps sensible qui soit infini.
Logiquement, il y a contradiction à ce qu'un corps soit infini ; car le corps est défini : Ce qui est limité par une surface. Dès lors, la raison ne peut pas plus concevoir un corps infini que les sens ne peuvent le percevoir. Mais le nombre lui-même considéré dans les choses n'est pas infini, de même qu'il l'est quand on le considère abstraitement. Le nombre dans ce cas n'est que ce qui est numérable ; et puisqu'on peut toujours nombrer le numérable, il s'ensuivrait qu'on pourrait ainsi parcourir et épuiser l'infini. Voilà pour les arguments rationnels.
Physiquement, les arguments ne sont pas moins forts, et ils prouvent que ce prétendu corps infini ne peut être ni composé ni simple, en d'autres termes qu'il ne peut exister. Ainsi le corps infini ne peut pas être composé, si l'on suppose que les éléments naturels sont en nombre fini, comme ils le sont en effet ; car nécessairement les éléments contraires qui le forment doivent être plus d'un, et comme il faut qu'ils se fassent contrepoids pour que le composé se conserve, il est bien impossible que l'un deux soit infini, attendu que par cela seul qu'il serait infini, il détruirait toujours tous les autres. Supposons que la puissance qui est dans un des deux éléments composants, soit inférieure à celle de l'autre, et que, par exemple, le feu et l'air composant l'infini, le feu soit fini, tandis que l'air serait infini. On croit que le feu suffisamment multiplié, mais d'ailleurs toujours fini, pourra faire équilibre à l'air ; je dis qu'il n'en est rien, et que l'air étant infini l'emportera sur une quantité quelconque finie de feu ; l'infini annulera toujours le fini quel qu'il soit. Si l'on dit que ce n'est pas un des éléments du corps infini qui est infini, mais que tous ses éléments sont également infinis, ce n'est pas plus possible ; car le corps est ce qui a des dimensions finies en tous sens, longueur, largeur, profondeur ; mais l'infini a des dimensions infinies, et alors il suffira qu'un seul des éléments soit infini pour remplir l'univers. Par conséquent, ce corps infini aura des dimensions infinies en tous sens, ce qui, est contradictoire à la notion même de corps.
Mais si le corps infini ne peut pas être composé, il n'est pas possible davantage qu'il soit un et simple, même en le prenant pour quelque chose en dehors des éléments ordinaires qui en sortent et en naissent, comme le veulent quelques philosophes; ou pour mieux dire, il est impossible qu'il existe. Il y a des philosophes, en effet, qui conçoivent l'infini de cette façon, sans oser le placer ni dans l'air ni dans le feu, de peur de détruire les autres éléments par celui d'entre eux qu'on ferait infini. Les éléments naturels ont les uns à l'égard des autres une opposition qui en fait des contraires. Ainsi, l'air est froid ; l'eau est humide ; l'air est chaud ; et si l'un de ces éléments était infini, il annulerait à l'instant tous les autres. Aussi les philosophes dont nous parlons, font-ils du principe d'où viennent les éléments selon leur système, quelque chose de distinct des éléments. Mais il est impossible qu'il y ait un tel corps en dehors des éléments naturels, non pas seulement en tant qu'infini ; car on pourrait dire de lui qu'il détruirait les autres comme on le dirait tout aussi bien de l'air, de l'eau, ou de tout autre élément ; mais aussi, parce qu'il ne peut pas exister un corps sensible de ce genre en dehors de ce qu'on appelle les éléments. Tout en effet se résout en définitive dans l'élément primordial d'où il vient ; il faudrait donc un élément différent de l'air, du feu, de la terre et, de l'eau, et l'observation peut nous convaincre qu'il n'y en a pas, puisque. l'eau, la terre, le feu et l'air, ne se résolvent pas dans cet élément unique d'où on les fait sortir.
On vient de montrer qu'il ne peut pas y avoir un élément infini en dehors des quatre éléments ; il ne se peut pas davantage que ce soit un de ces éléments qui soit infini ; car pour que l'univers, même en le supposant limité, devienne un élément unique comme le prétend Héraclite, qui croit que tout a été jadis du feu, il faut qu'un des quatre éléments devienne infini. On pourrait en dire autant de ce principe unique que supposent nos philosophes en dehors des éléments, et il faudrait que les éléments se fussent convertis en cet unique principe ; mais alors il n'y aurait plus de changement dans l'univers ; car pour que le changement ait lieu, il faut qu'il se fasse du contraire au contraire, et, par exemple, du chaud au froid.
Ce que je viens de dire peut nous servir, d'une manière générale, à savoir s'il est possible qu'il y ait un corps sensible infini. Et d'abord, voici des raisons qui semblent prouver qu'il est impossible qu'un tel corps existe. D'après les lois les plus évidentes de la nature, tout corps est dans un lieu ; chaque espèce de corps a un lieu qui lui est propre, et la partie est toujours dans le même lieu que le tout. Ainsi, une motte de terre a le même lieu que la masse totale de la terre, c'est-à-dire qu'elle se dirige en bas ; une étincelle a le même lien que la masse entière du feu, c'est-à-dire qu'elle se dirige en haut. De ces principes, je tire cette conséquence que, la partie du corps sensible infini étant homogène au tout, ou elle sera éternellement immobile, ou elle sera toujours en mouvement.
Mais je prouve que ces deux hypothèses sont également inadmissibles, En effet, pourquoi le mouvement de la partie irait-il en bas plutôt qu'en haut ou dans tout autre sens, puisque le corps sensible infini dont elle est la partie, est nécessairement partout ? Je reprends l'exemple de la motte de terre, et en supposant que la terre, dont elle est une partie soit ce corps sensible infini, je demande : Dans quel lieu pourra se porter cette motte de terre, si elle est en mouvement ? Dans quel lieu aura-t-elle son repos ? Car, encore une fois, le lieu du corps sensible infini auquel elle est supposée homogène est infini ; et il ne reste plus de lieu pour la partie. Dira-t-on par hasard que cette motte de terre remplira tout l'espace, comme la terre elle-même est supposée le remplir ? Mais comment serait-ce possible ? Comment aurait-elle alors mouvement ou repos ? Dans quel lieu seront-ils l'un et l'autre ? Si elle est partout en repos, alors elle n'aura jamais de mouvement ; et si son mouvement est partout, alors elle ne sera jamais en repos ; ce qui est également contraire aux phénomènes que nous pouvons observer.
Si au lieu de supposer la partie homogène au tout, on la suppose dissemblable, la partie ne ressemblant plus au tout, il s'en suit qu'elle aura un lien autre que lui. Mais la partie étant d'une autre espèce que le tout, l'unité du tout, qui est le corps sensible infini, disparaît ; ou plutôt, il n'y a plus d'unité que celle qui résulte de la contiguïté des parties. Ajoutez que les espèces des parties du tout seront aussi ou en nombre fini ou en nombre infini ; mais l'une et l'autre hypothèse est également insoutenable. D'abord il n'est pas possible que les parties soient finie s; car le tout étant infini, il y aura des parties infinies à coté des parties finies, le feu ou l'eau, par exemple ; et alors les contraires détruiront les contraires, comme je l'ai dit un peu plus haut. Voilà pourquoi, je le remarque en passant, pas un des philosophes qui ont traité de la nature n'ont admis que l'un ou l'infini pût être le feu ou la terre, dont les lieux sans doute sont trop spécialement déterminés ; mais ils ont choisi pour en faire l'infini, l'air ou l'eau, ou même cet autre élément qui est intermédiaire entre ceux-là et dont on a parfois admis l'existence hypothétique. Le lieu de la terre et celui du feu étaient de toute évidence, puisque l'une se dirige en bas et l'autre en haut ; mais les lieux des autres éléments sont moins certains. Mais je laisse cette discussion, et je poursuis.
Je viens de prouver que les parties du corps sensible infini ne pouvaient être finies ; elles ne peuvent pas davantage être infinies, et simples ; car alors les lieux de ces parties seraient infinis comme elles, et les éléments seraient également en nombre infini ; ce qui est manifestement faux. Mais les lieux sont eux-mêmes en nombre fini, ainsi que les éléments : et le tout, c'est-à-dire le corps sensible qu'on prétendait infini, sera fini comme eux. En effet, il est impossible que le lien et le corps qui occupe ce lieu ne soient pas égaux et conformes l'un à l'autre. Ainsi le lieu ne peut pas être plus grand que le corps infini, ni le corps infini plus grand que le lieu ; car si le lieu était plus grand, c'est que le corps cesserait d'être infini, et il y aurait du vide ; ce qui est contre l'hypothèse; ou bien si le corps était plus grand, il y aurait alors un corps qui n'aurait pas de lieu et ne serait nulle part ; ce qui n'est pas moins impossible.
Anaxagore se trompe étrangement quand il prétend que l'infini est immobile, parce qu'il se soutient lui-même et qu'il existe en lui seul, rien ne pouvant le contenir. On croirait, à l'entendre, qu'il suffit qu'une chose soit dans un lieu quelconque pour que ce soit absolument sa nature d'y être; mais cette conséquence n'est pas juste ; car une chose peut être par force dans un certain lieu, toutes les fois qu'elle n'est pas là où sa nature voudrait qu'elle fût. Si donc c'est surtout de l'univers, c'est-à-dire de l'ensemble des choses, qu'on doit affirmer qu'il est immobile, puisque de toute nécessité ce qui ne s'appuie que sur soi et n'existe que par soi ne peut avoir de mouvement, il aurait fallu nous apprendre pourquoi il n'est pas dans sa nature de se mouvoir. On se débarrasse aisément de cette difficulté en disant qu'il en est ainsi ; mais, une telle explication n'est pas suffisante; car un corps quelconque peut tout aussi bien que le corps infini n'être pas en mouvement, bien que la mobilité soit parfaitement dans sa nature. Ainsi, la terre n'a pas de mouvement dans l'espace ; et, la supposât-on infinie, elle ne quitterait pas pour cela le centre et le milieu du monde ; et elle resterait toujours au centre, non pas seulement parce qu'étant infinie il n'y aurait pas de lieu où elle pût se porter, mais surtout parce qu'il est essentiellement dans sa nature de demeurer au centre et de ne point aller ailleurs. Cependant, on pourrait dire de la terre, tout aussi bien qu'on le dit de l'infini, qu'elle s'appuie et se soutient elle-même. Si donc ce n'est pas en tant qu'elle serait infinie que la terre resterait au centre, et si elle y reste à cause de sa pesanteur, attendu que tout ce qui est pesant reste au centre, on peut dire que l'infini existe en lui-même par quelque cause différente de celle qu'on indique, et que ce n'est pas du tout par cela seul qu'il est infini qu'il se soutient lui-même.
Une autre conséquence non moins vaine de ces théories, c'est qu'une partie quelconque de l'infini devrait être eu repos tout comme lui. L'infini se soutenant lui-même, dit-on, se repose en soi ; donc une partie quelconque de l'infini sera également en repos sur elle-même ; car les lieux sont pareils et pour le tout et pour la partie. Là où est le tout, là est aussi la partie ; et, par exemple, le lieu de la masse terrestre tout entière étant en bas, le lieu d'une simple motte de terre y sera de même. Le lieu d'une étincelle est en haut, comme y est le lieu de la masse totale du feu. Par conséquent, si le lieu de l'infini est d'être en soi, le lieu de la partie de l'infini sera tout pareil, et elle aura également son repos en elle-même.
Mais je reviens à mon sujet, et je dis qu'il est impossible de soutenir qu'il y a un corps sensible infini, sans détruire cet autre principe incontestable que les corps ont un lieu qui leur est propre selon leur nature. En effet, tout corps sensible est ou pesant ou léger. S'il est pesant, sa tendance naturelle le dirige au centre ; s'il est léger, elle le porte eu haut. L'infini, en supposant que ce soit un corps sensible, est nécessairement soumis cette condition, qui est commune à tous les corps. Or, il est évidemment impossible, et que l'infini dans sa totalité ait l'une ou l'autre de ces propriétés, c'est-à-dire qu'il soit ou tout entier pesant ou tout entier léger, et qu'il ait une de ces propriétés dans une de ses moitiés, et l'autre dans l'autre moitié. En effet, comment diviser l'infini ? Comment une partie de l'infini serait-elle en bas ? et comment une autre partie sera-t-elle en haut ? En d'autres termes, comment une des parties de l'infini serait-elle aux extrémités, tandis que l'autre partie serait au centre ?
A ces preuves qui démontrent qu'il ne peut pas y avoir de corps sensible infini, ajoutez encore celle-ci. Tout corps perceptible à nos sens est dans un lieu, et les différences spécifiques du lieu sont le haut et le bas, le devant et le derrière, la droite et la gauche. Ces distinctions ne sont pas seulement relatives à nous et à la position réciproque des choses ; elles se retrouvent également dans l'univers, et elles reposent sur les lois naturelles qui le régissent. Or, il est de toute impossibilité que ces distinctions se retrouvent dans le corps sensible infini qu'on suppose ; car, le lieu de ce corps ne pouvant pas être infini, et tout corps devant être dans un lieu, il s'ensuit que ce corps n'existe pas. Enfin, si ce qui est dans un lieu spécial et déterminé est d'une manière générale dans un lien, et si réciproquement ce qui est dans un lieu est nécessairement quelque part, c'est-à-dire en un certain lieu spécial, il s'ensuit que le corps sensible infini, tel qu'on le suppose, ne pourra être nulle part ; car il ne peut pas avoir, comme il le faudrait pourtant, une certaine quantité finie, de deux coudées, par exemple, de trois coudées ou de telle autre étendue, puisqu'il est supposé infini ; et il ne peut être par conséquent dans aucune des six positions indiquées tout à l'heure, le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche ; car chacune de ces positions est évidemment une limite, et l'infini ne peut en avoir.
Donc, en résumé, il n'y a pas de corps infini perceptible à nos sens ; il n'y a pas de corps sensible infini.
VIII.
Il ne faudrait pas cependant que ces difficultés signalées par nous fissent croire que l'infini n'existe pas ; car si l'on niait son existence, on ne soulèverait pas moins d'impossibilités. Par exemple, il faudrait alors soutenir que le temps a eu un commencement et une fin, que les grandeurs ne sont pas divisibles à l'infini en grandeurs, et que le nombre n'est pas plus infini que les grandeurs et le temps. Mais ceci nous met dans un singulier embarras, et comme il semble résulter des considérations précédentes, que, tout à la fois, l'infini est et n'est pas, il ne nous reste qu'à dire qu'en effet, en un sens, l'infini n'existe point, et, qu'en un autre sens, il existe. Être, ainsi que nous l'avons dit, signifie tantôt être en puissance, et tantôt être en acte. De plus l'infini peut tout à la fois se former par addition ou par retranchement. Un nombre est infini, parce qu'on peut toujours ajouter à un nombre quelque grand qu'il soit ; la grandeur est infinie, parce qu'on peut toujours la diviser à l'infini, au moins par la pensée. Nous venons de démontrer qu'il ne peut pas y avoir de grandeur actuelle et réelle qui soit infinie ; mais sous le rapport de la divisibilité, elle peut l'être ; car il n'y a pas de lignes insécables au sens où on l'a cru ; et je dis que si l'infini ne peut être en acte, il existe certainement en puissance. Mais ici il faut faire encore une distinction essentielle. Quand je dis que l'infini est en puissance, ce n'est pas du tout comme je dis que telle matière étant en puissance une statue, elle deviendra une statue effectivement. Il n'y a pas d'infini qui puisse se réaliser actuellement, comme la statue qui est dans l'airain se réalise sous la main de l'artiste. Mais grâce aux diverses acceptions du mot Être, il faut comprendre que l'infini est comme est le jour que l'on compte, ou la période des Jeux Olympiques, l'olympiade. Le jour, l'olympiade n'est jamais, à proprement parler ; elle devient sans cesse, par la succession toujours différente du temps qui s'écoule ; car pour ces dates des Jeux solennels où la Grèce se rassemble, on peut distinguer l'acte et la puissance, puisque l'on compte les Olympiades aussi bien par les jeux qui peuvent être célébrés, que par ceux qu'on célèbre actuellement et réellement au moment où l'on parle.
Mais évidemment l'infini n'est pas la même chose, si on le considère dans le temps et la succession perpétuelle des générations, par exemple, des générations humaines, que si on le considère dans la divisibilité des grandeurs. D'une manière générale, l'infini existe par cela seul qu'à une quantité donnée on peut toujours et sans fin ajouter une quantité quelconque. La quantité ajoutée est finie sans doute ; mais on peut l'ajouter sans cesse, et elle est toujours et toujours différente. L'infini n'est donc pas à considérer comme quelque chose de précis et de spécial, tel que serait, par exemple, un homme, une maison ; mais il est comme le jour ou l'Olympiade dont je parlais tout à l'heure. Ce ne sont pas des choses précises et déterminées comme des substances ; ce sont des choses qui en sont sans cesse à devenir et qui périssent sans cesse. Elles sont limitées et finies sans doute ; mais elles sont toujours autres et toujours autres. Seulement dans la comparaison que nous faisions plus haut, il y a cette différence que, pour l'infini considéré dans les grandeurs, la grandeur d'où l'on part pour y ajouter sans cesse, est et demeure substantiellement ce qu'elle est, tandis que pour les générations successives et pour le temps, les générations et le temps s'éteignent et périssent sans cesse, et que l'infini ne résulte que de la succession qui n'a jamais ni interruption ni lacune.
Quant à l'infini qui se forme dans les nombres par addition continuelle, il ressemble beaucoup à l'infini qu'on obtient par la division indéfinie des grandeurs continues ; seulement l'infini se produit, dans les nombres auxquels on petit ajouter sans cesse, à l'inverse de ce qu'il est dans une quantité finie. En tant que cette quantité déterminée est indéfiniment divisible, il semble qu'on ajoute sans cesse au nombre des divisions. Ainsi le nombre en s'accroissant, et la quantité finie, en diminuant toujours, présentent à peu près le même phénomène. Mais quand je parle de divisions infinies dans une quantité finie, il faut bien comprendre que sur cette quantité finie on divise toujours par la même proportion, et que, par exemple, on prend sans cesse la moitié de ce qui reste et non pas la moitié de la quantité primitive ; car en divisant ainsi par un diviseur proportionnel quoique immuable, on n'épuise pas le fini, tandis qu'on l'aurait bientôt épuisé de l'autre manière, quel que fût le diviseur, si proportionnellement la quantité réellement retranchée ne variait pas à chaque division. La quantité finie aurait beau être grande ; il n'en resterait rien au bout de quelques divisions, si la quotité de plus en plus petite du retranchement n'était pas en rapport avec le nombre même des divisions qui se succèdent. La proportion reste constante pendant que la quantité varie.
L'infini n'existe pas si on veut le comprendre autrement que je ne viens de le faire; mais il existe de la manière que je viens de dire. En d'autres termes, il est en puissance comme dans la division que je citais tout à l'heure ; mais il n'est en acte que comme y est la journée, comme y est l'Olympiade, dont je parlais un peu plus haut. Il est en puissance absolument, comme la matière qui peut recevoir toutes les formes ; et il n'est jamais en soi, comme y est le fini. S'il s'agit d'addition sans cesse répétée, comme dans le nombre, l'infini dans ce cas est aussi en puissance, à peu près comme il est dans la divisibilité indéfinie; car, dans l'un et l'autre cas, l'infini existe par cela seul qu'on peut toujours en prendre une quantité nouvelle en dehors de ce qu'on a, soit qu'on ajoute par la pensée au nombre donné, quelque grand qu'il puisse être, soit qu'on pousse la division au-dessous de la dernière division qu'on a faite, sans jamais s'arrêter. Cependant, l'infini qu'on observe dans l'addition qui se répète sans cesse, ne peut arriver jamais à reproduire la première quantité donnée ; il en approche tant qu'on veut sans y être jamais égal, de même que dans la division, l'infini consiste en ce qu'on peut toujours supposer une division plus petite que toute division antérieure. Ainsi, on ne réalise jamais l'infini par les additions successives que l'on fait, et l'on ne peut pas même supposer que l'infini puisse jamais égaler la quantité donnée vers laquelle il s'avance sans cesse ; car on ne peut pas admettre que l'infini en acte soit un simple accident ou attribut d'une autre substance, comme l'admettent les Physiciens qui font infini l'air ou tel autre élément qu'ils placent en dehors du monde. C'est alors cet élément qui est infini, et l'infini lui-même n'en est plus que l'attribut, cessant ainsi d'avoir par lui-même une existence réelle. Mais si, comme nous l'avons démontré, il n'est pas possible qu'il y ait un acte, un corps sensible infini de ce genre, il n'est pas moins impossible que l'infini puisse se former par addition autrement que je ne viens de le montrer, à l'inverse de la division et réciproquement à elle.
Ces deux infinis, l'un par addition, l'autre par retranchement, sont sans doute les deux infinis qu'a reconnus Platon ; car tous deux semblent évidemment se produire, quoiqu'en suivant une marche opposée. Mais une chose assez singulière, c'est qu'après avoir constaté l'existence de ces deux infinis, Platon n'en fait aucun usage ; ainsi, dans les nombres, il ne peut pas y avoir pour lui d'infini, par retranchement et division, puisqu'il fait de l'unité le plus petit nombre possible, et il n'y a pas davantage d'infini par addition, puisqu'il ne veut pas pousser le nombre au-delà de la décade.
IX.
On voit donc que l'infini est tout le contraire de ce que croient nos philosophes. L'infini n'est pas du tout, comme ils le disent, ce en dehors de quoi il n'y a rien ; loin de là ; c'est ce qui a perpétuellement quelque chose en dehors, et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ils auraient pu s'apercevoir de leur erreur, puisque pour faire concevoir l'infini, ils ont recours eux-mêmes à l'exemple des bagues sans chaton, où l'on peut toujours, en effet, prendre un point en dehors de celui auquel on s'arrête. Mais, ce n'est là qu'une similitude assez imparfaite, et ce n'est pas une représentation vraie, et une expression exacte. Il faut bien, pour l'infini, cette première condition, à savoir qu'on puisse toujours y prendre quelque chose en dehors de ce qu'on a ; mais il faut, en outre, que ce ne soit jamais la même quantité qu'on ait déjà prise. Or, il n'y a rien de pareil dans le cercle ; et, dans un anneau sans chaton, le point qu'on prend après un autre point, n'est pas précisément nouveau ; il vient seulement à la suite de celui qui le précède. Donc, il faut définir l'infini, comme nous le faisons : Ce qui peut toujours, en dehors de la quantité qu'on a, fournir quelque chose qui soit réellement une quantité nouvelle. Ce en dehors de quoi il n'y a rien, ce n'est pas l'infini ; c'est au contraire le parfait, le tout, le complet, l'entier ; car, on doit entendre par quelque chose d'entier et de complet, ce à quoi il ne manque rien, en fait de parties. Par exemple, un homme est complet ; un coffre est complet et entier, s'il ne manque d'aucune des parties qui doivent essentiellement le composer. La définition qu'on donnerait ici de l'homme ou du coffre complet, c'est-à-dire de tout objet particulier regardé comme complet, s'applique aussi bien au terme général et absolu, et l'on doit dire que le tout, l'entier, le parfait, est ce en dehors de quoi il n'y a plus rien. Mais ce en dehors de quoi il reste toujours quelque chose qui lui manque, n'est plus complet, quelle que soit la chose qui lui manque. L'entier et le parfait sont des termes identiques, ou du moins, dont la signification est très voisine; or, le parfait a nécessairement une fin ; et toute fin est une limite. Par conséquent, l'infini est le contraire du parlait et de l'entier. Aussi, doit-on trouver à ce point de vue que Parménide était plus dans le vrai que Mélissus ; car, ce dernier disait que l'infini est l'entier, est le tout, tandis que le premier prétendait, au contraire, que l'entier est toujours limité et fini :
« De tous côtés égal, à partir du milieu. »
et comme le dit le proverbe populaire, ce n'est pas précisément joindre un bout de fil à un bout de fil, que de confondre l'infini avec le tout et l'entier.
X.
Je conçois, d'ailleurs, et j'excuse l'emphase avec laquelle on parle de l'infini, quand on dit "qu'il renferme toutes choses et qu'il embrasse tout l'univers en soi." C'est qu'en effet l'infini ne laisse pas que d'avoir quelque ressemblance avec un tout, avec un entier. Ainsi, l'infini est la matière de la perfection ou de la forme achevée, que peut recevoir la grandeur. Il est le tout et l'entier en puissance ; il ne l'est point en acte. Il est divisible, soit par le retranchement, soit par l'addition prise en sens inverse, ainsi que je l'ai expliqué plus haut. Il devient entier si l'on veut, et fini, non pas en soi, mais par l'intermédiaire d'un autre terme. A vrai dire, il ne contient pas ; il est contenu, au contraire, en tant qu'infini ; et ce qui fait qu'il est impossible de le connaître dans sa nature essentielle, c'est que la matière par elle-même n'a pas de forme, et qu'elle ne peut être connue qu'autant qu'elle en a. Par conséquent, loin que l'infini doive être considéré comme un tout, il faudrait bien plutôt le prendre pour une partie ; car la matière, avec laquelle on peut le confondre, est une partie du tout qui revêt une forme ; et c'est ainsi que l'airain est une partie de la statue dont il est la matière. Mais si, dans les choses sensibles et intelligibles, on admet que le grand et le petit, c'est-à-dire les deux infinis, rendent raison de tout, il faut admettre aussi qu'ils embrassent également les purs intelligibles ; alors, il semble que c'est se tromper lourdement que de demander à l'inconnu et à l'indéterminé la connaissance et la détermination des choses, que, cependant, les intelligibles doivent donner à l'esprit.
XI
On comprend aisément que l'infini qui se forme par addition, ne peut jamais arriver à égaler la grandeur initiale dont il approche saris cesse, et qui est sa limite, tandis qu'au contraire l'infini, qui se forme par la division, est réellement infini, puisque la divisibilité n'a point de ternie. L'infini est contenu, connue la matière elle-même, dans l'intérieur de l'être, et c'est la forme qui est le contenant de l'un et de l'autre. La raison peut concevoir également que pour le nombre, il y a une limite dans le sens de l'extrême petitesse, et qu'il n'y en a pas dans le sens de l'accroissement, puisqu'un nombre, quelque grand qu'il soit, étant donné, on peut toujours en imaginer un plus grand encore. Pour les grandeurs, c'est tout le contraire ; car on peut toujours, dans la série décroissante, imaginer une grandeur toujours plus petite que toute grandeur donnée, tandis que, dans le sens de l'accroissement, il y a toujours une limite infranchissable, et il n'est pas possible qu'il y ait une grandeur infinie. Cette différence, entre les nombres et les grandeurs, tient à ce que l'unité est indivisible, quelle que soit d'ailleurs cette unité. L'homme, par exemple, n'est jamais qu'un homme, et il est bien impossible de le diviser en plusieurs hommes, tandis que le nombre est toujours plus que l'unité, et qu'il est un ensemble de quantités quelconques réunies.
Il faut donc s'arrêter à l'individu, et la division ne peut pas être poussée plus loin, tandis que les nombres, deux, trois, etc., ne sont que des paronymes de l'unité, qui tirent d'elle la dénomination qui les fait ce qu'ils sont, deux signifiant deux unités; trois, trois unités ; et ainsi de suite pour tous les autres nombres. Mais dans le sens de l'augmentation numérique, il est toujours possible de penser un nombre de plus en plus grand, parce que les divisions de la grandeur par deux sont indéfiniment possibles, et que leur nombre s'accroît sans cesse. L'infini y est donc toujours en puissance, bien qu'il n'y soit jamais en acte ; la quantité nouvelle qu'on ajoute est toujours finie, bien qu'elle puisse dépasser sans cesse toute quantité déterminée. D'ailleurs, ce nombre n'est pas abstrait et séparé des divisions de la grandeur, qu'on peut sans cesse diviser par deux. L'infinitude, loin de s'arrêter comme achevée et finie, se forme et devient sans cesse, ainsi que le temps se forme et devient sans cesse aussi, comme le nombre et la mesure du temps, qui est le mouvement. C'est tout l'opposé pour les grandeurs ; le continu y est bien divisible à l'infini, dans le sens de la petitesse ; mais il n'y a pas d'infini dans le sens de l'accroissement ; et l'infini, dans ce cas, n'est en acte que précisément autant qu'il est en puissance, c'est-à-dite qu'il reste perpétuellement en puissance. Donc, puisque aucune grandeur sensible n'est infinie, il faut en conclure qu'il est impossible que toute grandeur déterminée soit sans cesse dépassée : car, dès lors, il pourrait y avoir quelque chose de plus grand que le ciel ; ce qui est absolument impossible.
L'infini du reste n'est pas absolument identique pour la grandeur, pour le mouvement et pour le temps. A ces égards, ce n'est pas une seule et même nature ; et de ces trois infinis, le suivant ne se comprend que par celui qui le précède. Ainsi, le mouvement ne se comprend qu'à la condition préalable d'une grandeur dans laquelle il y a un mouvement quelconque de translation, d'altération, ou de croissance ; le temps à son tour ne se comprend que par le mouvement qu'il mesure. Pour le moment, nous nous bornerons à indiquer ces idées; plus tard (Livre VI), nous reviendrons sur ces questions, et nous expliquerons comment toute grandeur est toujours divisible en d'autres grandeurs. Tout ce que nous voulons dire ici, c'est que notre définition de l'infini ne porte aucune atteinte aux spéculations des mathématiciens, en niant que, sous le rapport de l'accroissement, l'infini puisse jamais être en acte et être tout à fait réalisable. A leur point de vue, les mathématiciens n'ont pas besoin directement de l'infini, et il ne leur est pas indispensable, puisqu'ils peuvent toujours supposer la ligne finie aussi grande qu'ils le veulent. Réciproquement, la grandeur la plus grande étant donnée, ils peuvent toujours y appliquer une division proportionnelle, qui n'a pas de fin quelque petite que devienne la grandeur successivement divisée. Ainsi les mathématiciens peuvent se passer de l'infini réel dans leurs démonstrations ; et en fait, l'infini ne se trouve que dans les grandeurs actuelles, au sens où je viens de le dire.
Ce qui rapproche encore l'infini de la matière, c'est que parmi les quatre espèces de causes admises par nous, l'infini ne peut être que cause matérielle ; car l'être de l'infini est la privation, comme celui de la matière ; et il n'y a que le continu et le sensible qui est et subsiste en soi. Nous pouvons d'autant mieux insister sur ce point que tous les philosophes ont, ainsi que nous, considéré l'infini comme matière ; mais où nous nous séparons complètement d'eux, c'est qu'ils ont fait de l'infini le contenant au lieu d'en faire le contenu ; et selon nous, c'est une grave erreur.
XII.
Après tout ce qui précède sur l'infini, il ne nous reste plus qu'à examiner les arguments par lesquels on essaie de démontrer que l'infini n'est pas seulement en puissance, ainsi que nous venons de l'exposer, mais aussi qu'il est quelque chose de déterminé. Parmi ces arguments, les uns n'entraînent pas de conclusions nécessaires, et ne valent guère qu'on s'en occupe ; les autres peuvent être réfutés par des raisons décisives. Ainsi, je dis qu'il ne faut pas que l'infini soit en acte un corps perceptible à nos sens, pour que la génération des choses puisse ne jamais défaillir ; car il se peut fort bien que tout étant limité et fini, la destruction d'une chose soit la génération d'une autre, et réciproquement. Le cercle de la génération est alors infini et indéfectible. Voilà la réponse à un des arguments dont il a été question plus haut (Voir plus haut, V). Quant à celui qui prétend qu'une chose doit toujours en toucher une autre et qu'on arrive ainsi à réaliser l'infini, nous répondons en distinguant le contact et la limitation, qu'il ne faut pas du tout confondre. Le contact est toujours une chose relative et dépendante, puisque tout corps qui touche doit nécessairement toucher quelque chose qui le touche à son tour ; et le contact est l'attribut d'une chose limitée et finie. La limitation, au contraire, n'a rien de relatif ; et une chose quelconque ne peut pas au hasard toucher la première chose venue. Il peut donc y avoir quelque chose qui ne touche plus rien. Enfin l'argument tiré de la pensée, dans laquelle ou croit trouver l'infini, n'est pas plus péremptoire ; car on peut bien par la pensée s'imaginer que quelqu'un est mille fois plus grand qu'il n'est ; mais en réalité il reste ce qu'il était ; l'accroissement successif ou la réduction successive ne passent pas le moins du monde dans l'objet lui-même; et il ne suffit pas de supposer que quelqu'un est hors de la ville pour qu'il y soit effectivement, ni qu'il est aussi grand que nous, pour que sa taille devienne égale à la nôtre. La chose reste ce qu'elle est, et la supposition arbitraire que l'on fait ne change rien à la réalité. Quant au temps et au mouvement, ils ne sont infinis, ainsi que la pensée, qu'en ce sens que rien n'y subsiste réellement et n'y demeure, mais qu'il n'y a qu'une succession sans terme possible. Enfin dans le retranchement ou dans l'addition que la pensée peut toujours faire, il ne se forme jamais une grandeur qui soit actuellement infinie.
Nous ne poussons pas plus loin cette théorie de l'infini ; et par les explications que nous venons de donner, on doit voir commuent ou peut dire que l'infini est et n'est pas, et l'on doit comprendre ce qu'il est au point de vue où nous nous sommes placés.