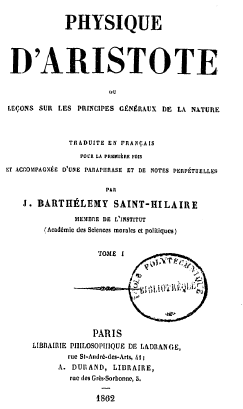
ARISTOTE
PHYSIQUE.
TOME UN : PARAPHRASE DU LIVRE I DE LA PHYSIQUE D'ARISTOTE.
PARAPHRASE DU LIVRE II
LIVRE I (traduction, texte grec et notes)
|
|
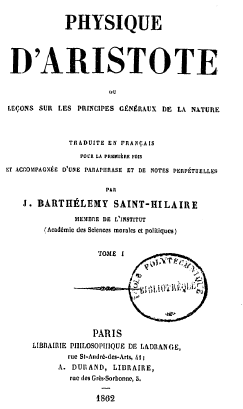
I
Exposons brièvement la méthode que nous comptons suivre dans l'étude de la nature et que nous avons déjà souvent appliquée. Dans tout sujet qui se prête à des recherches régulières, parce qu'il s'y trouve des principes, des causes et des éléments, on ne croit comprendre et savoir quelque chose que quand on est remonté jusqu'à ces causes premières, à ces premiers principes et à ces éléments premiers, dont la connaissance constitue toujours le véritable savoir. Il n'en sera pas autrement pour la science de la nature ; et le soin qu'on y doit d'abord, c'est de déterminer ce qui regarde les principes. La marche la plus naturelle, c'est de commencer par les choses qui sont pour nous les plus claires et les plus faciles à connaître, et de passer ensuite aux choses qui par leur propre nature sont en soi plus notoires et plus claires. Ces deux ordres de connaissances ne sont pas identiques ; et c'est là ce qui fait qu'il est nécessaire de débuter par les connaissances qui sont relativement à nous plus claires et plus notoires, afin de nous élever de là aux notions qui le sont en soi. Or, ce qui tout d'abord semble pour nous le plus clair et le plus facile à connaître est cependant le plus composé et le plus confus ; mais en analysant ces composés, pour faire cesser leur confusion, on arrive aux éléments et aux principes, qui sont alors d'une parfaite clarté. On peut dire, en un certain sens, que c'est procéder du tout à la partie, du général au particulier ; car c'est le tout que nous donne la sensation, qui est d'abord le plus connu ; et en décomposant ce tout complexe, on y découvre une foule de parties qu'il contient dans son vaste ensemble. Il y a ici quelque chose d'analogue au rapport qu'on peut établir entre les noms des choses et la définition de ces choses. Le nom est une sorte de généralité confuse et indéterminée ; par exemple, le mot Cercle, qui comprend bien des idées; mais en le définissant et en le résolvant dans ses éléments premiers, on l'éclaircit et on le précise. Une autre comparaison achèvera de faire comprendre cette pensée. Dans les premiers temps de la vie, les enfants appellent indistinctement Papa, Maman, tous les hommes, toutes les femmes qu'ils voient ; mais plus tard ils les discernent fort bien et ne les confondent plus.
II.
Notre méthode étant ainsi expliquée, nous en faisons usage, et nous essayons de découvrir quels sont les principes généraux des êtres. Nécessairement il y a dans l'être, dans tout être quel qu'il soit, ou un principe unique, ou plusieurs principes. S'il n'y a qu'un seul principe, ou ce principe unique est immobile, comme l'affirment Parménide et Mélissus, ou il est mobile comme le soutiennent les Physiciens, qui voient ce principe, soit dans l'air soit dans l'eau. Si, au contraire, on admet que l'être ait plusieurs principes, le nombre de ces principes est ou fini ou infini. S'ils sont en nombre fini, en étant toujours plus d'un, ils sont alors deux, trois, quatre ou tel nombre déterminé ; et s'ils sont en nombre infini, ils peuvent être, comme le vent Démocrite, tous du même genre absolument, ne différant que de figure ou d'espèce : ou bien ils peuvent aller jusqu'à être contraires les uns aux autres. C'est une étude pareille à celle-ci que font d'autres philosophes, en recherchant quel peut être le nombre des êtres ; car ils se demandent également si la source d'où sortent tous les êtres, est une ou multiple ; et quand ils admettent qu'il y a plusieurs principes des êtres, ils se demandent si ces principes sont en nombre fini ou infini. Au fond, la question est la même, et elle revient à savoir si l'élément qui constitue l'être est unique, on si, au contraire, il faut plusieurs éléments pour le composer.
Mais ici il faut faire une déclaration : c'est que ce n'est plus étudier la nature que de rechercher si l'être est un et immobile. En géométrie, il n'y a plus à discuter avec un adversaire qui nie les principes sur lesquels la géométrie repose ; il faut le renvoyer à une autre science, qui peut être la science commune de tous les principes ; mais ce n'est plus là une question géométrique. De même, dans la science de la nature, il faut savoir sur quel terrain on se place ; et du moment qu'on dit que l'être est un et immobile, cela revient à dire qu'il n'y a pas de principe, puisque le principe est toujours le principe d'une ou de plusieurs choses qui en découlent. Rechercher si l'unité de l'être est possible au sens où on le soutient, c'est une thèse tout aussi vaine que celles qu'on avance trop souvent pour le simple besoin de la dispute, comme la fameuse thèse d'Héraclite. Autant vaudrait soutenir que le genre humain tout entier se concentre dans un seul et unique individu. Au fond, ce serait donner beaucoup trop d'importance à un argument qui n'est que captieux ; c'est le défaut que présentent les opinions de Mélissus et de Parménide, lesquelles ne reposent que sur des prémisses fausses et ne concluent même pas régulièrement. J'ajoute que la théorie de Mélissus me paraît encore la plus grossière des deux et qu'il n'y a point à s'y arrêter ; car là où l'on rencontre au début une première donnée fausse, il est facile de voir que toutes les conséquences qui en sortent, ne sont pas moins fausses et qu'elles ne méritent pas plus d'attention.
Quant à nous, nous posons comme un principe indiscutable, que dans la nature il y a du mouvement, soit pour toutes les choses, soit du moins pour quelques-unes ; et n'est là un fait fondamental que nous fout connaître et l'observation sensible et l'induction réfléchie. Mais ce principe une fois posé, nous ne prétendons pas répondre aux questions qui en impliqueraient la négation, et nous nous contenterons de réfuter les erreurs qui pourraient être commises, en partant de ce principe lui-même, qu'il faut préalablement accepter. Les théories qui le nient doivent nous rester tout à fait étrangères ; car c'est ainsi que le géomètre, en choisissant parmi les démonstrations de la quadrature, peut bien réfuter celle qu'on prétend faire à l'aide des segments ; mais il n'a plus rien à voir à celle d'Antiphon. Néanmoins, comme les philosophes qui nient le mouvement touchent encore à des questions physiques, bien qu'ils n'étudient plus précisément la nature, il ne sera peut-être pas sans utilité d'en dire quelques mots, parce que ces recherches ne laissent pas que d'avoir encore un côté philosophique.
III.
Précisons bien le sens des mots dont nous nous servons ; et comme le mot d'Être a plusieurs acceptions, il faut se rendre compte, avant d'aller plus loin, de ce qu'on entend quand on dit que l'être tout entier est un. Est-ce à dire qu'il est uniquement substance ? ou bien uniquement quantité ? ou bien uniquement qualité ? Si tout est substance dans l'être, comprend-on qu'il n'y a au monde qu'une seule substance ? Ou bien vent-on dire que dans l'homme un, dans le cheval un, dans l'âme une, il n'y a que l'homme, le cheval ou l'âme ? Si l'être n'est que qualité, soutient-on par là qu'il est uniquement chaud, ou uniquement froid, ou telle autre qualité exclusive ? Ce sont là évidemment des points de vue très différents ; mais ils ont ceci de commun qu'ils sont tous également insoutenables.
Si l'on prétend que l'être est tout ensemble substance, quantité et qualité, il en résulte toujours qu'il y a plusieurs sortes d'êtres, soit qu'on réunisse ces trois éléments, soit qu'on les isole et qu'on les rende indépendants les uns des autres. Si l'on disait par hasard que l'être tout entier n'est que qualité et quantité, la substance étant mise à part ou rejetée, ce serait là une opinion absurde, ou pour mieux dire impossible, puisque la substance est toujours indispensable, et qu'elle est le support de tout le reste, qui sans elle n'existerait pas. Voyez en effet la contradiction : Mélissus soutient que l'être est infini ; soit ; mais cela revient à dire que l'être est une quantité, puisque l'infini n'est que dans la catégorie de la quantité. Or, la substance et la qualité ne peuvent jamais être infinies, si ce n'est d'une manière indirecte, en tant qu'on les considère comme quantités à un certain point de vue. La définition de l'infini emprunte toujours l'idée de quantité ; mais elle ne suppose pas celles de substance et de qualité. Que si l'on admet que l'être est à la fois substance et quantité, comme il est toujours nécessaire qu'il le soit, alors ses principes sont au moins deux, et l'être n'est plus un comme on le prétend. Si l'on réduit l'être à n'être que substance, alors il n'est plus infini ; il n'a même plus une grandeur quelconque ; car pour en avoir, il faudrait qu'il fût en outre quantité.
Une difficulté du même genre encore, c'est de savoir ce qu'on veut dire précisément en soutenant que l'être est un ; car le mot d'Un est susceptible d'acceptions diverses tout aussi bien que le mot d'Être. Une chose est une quand elle est continue ou qu'elle est divisible. On dit de deux choses qu'elles sont une seule et même chose quand leur définition est identique, comme elle l'est, par exemple, pour le Jus de la treille et pour le Vin. Or, si par Un on entend le continu, l'être alors est multiple et n'est plus un ; car le continu est divisible à l'infini.
Mais à propos de l'unité de l'être, on peut se poser une question qui, sans tenir très directement à notre sujet actuel, vaut la peine cependant qu'on la traite. Le tout et la partie sont-ils une môme chose ? ou sont-ils des choses différentes ? De quelle manière peut-on concevoir leur unité ou leur multiplicité ? et, si ce sont des choses multiples, quelle espèce de multiplicité forment-elles ? Les parties peuvent d'ailleurs n'être pas continues ; et si les parties en tant qu'indivisibles forment chacune une moitié, comment chacune d'elles peut-elle être une avec le tout ? Mais je ne fais qu'indiquer ces questions, et je poursuis.
Si l'être est un en tant qu'indivisible, il ne l'est plus alors comme quantité et qualité, et du même coup il cesse d'être infini comme le veut Mélissus. Il n'est même pas fini comme le soutient Parménide ; car c'est la limite seule des choses qui est indivisible, et ce n'est pas le fini lui-même. Que si l'on dit que tous les êtres sont Uns en ce sens qu'ils n'ont tous en masse qu'une définition commune et identique, comme l'est celle de Vêtement et d'Habit, par exemple, alors on revient à l'opinion d'Héraclite, et désormais tout va se perdre dans le plus obscur mélange ; le bien et le mal se confondent ; le bon, avec ce qui n'est pas bon ; le bien, avec ce qui n'est pas bien ; l'homme et le cheval sont tout un. Mais il faut répondre à cette singulière théorie que ce n'est plus là affirmer que tous les êtres sont Uns ; c'est affirmer qu'ils ne sont rien, et que la quantité et la qualité sont absolument identiques.
Du reste, cette question du rapport de l'unité à la multiplicité semble avoir troublé plus d'un philosophe parmi les modernes ou les anciens. Pour échapper à la contradiction qu'on supposait entre les deux termes, les uns, comme Lycophron, se sont imaginé de supprimer le verbe d'existence et de retrancher le mot Est de tout ce qu'ils disaient. Les autres ont détourné l'expression, et au lieu de dire que l'homme est blanc, ils ont dit qu'il blanchit ; ou de dire qu'il est marchant, ils ont dit qu'il marche. Ils se donnaient toute cette peine pour éviter le mot Est, de peur de faire plusieurs êtres d'un seul, et croyant confondre par là l'un et l'être absolument. Comme si les êtres n'étaient pas multiples, ainsi que le prouve même leur définition ; comme si la définition de blanc et celle de musicien n'étaient pas essentiellement différentes, bien que ces deux qualités puissent appartenir simultanément à un seul et même être ! Il faut donc affirmer que le prétendu Un est multiple, comme tout être est multiple, ne serait-ce que par la division, puisqu'il forme nécessairement un tout et qu'il a des parties. A ce point de vue, nos philosophes étaient bien forcés d'avouer, malgré tout leur embarras, que l'être n'est pas un et qu'il est multiple ; car une même chose peut fort bien tout à la fois être une et multiple ; seulement elle ne peut avoir à la fois les qualités opposées, attendu que l'être peut être un, ou en simple puissance, ou en réalité complète, en entéléchie. Donc, il faut conclure de tout ceci que les êtres ne peuvent pas être uns au sens où on le prétend.
IV.
Ou pourrait d'ailleurs avec les principes mêmes que ces philosophes admettent dans leurs démonstrations, les mieux employer, et résoudre assez aisément les difficultés qui les arrêtent. Je viens de dire que le raisonnement de Mélissus et de Parménide est captieux, et que partant de données fausses ils ne concluent même pas régulièrement. J'ajoutais que le raisonnement de Mélissus est plus grossier et moins soutenable encore, parce qu'il suffit qu'une seule donnée soit fausse pour que toutes les conclusions le soient comme elle, ce qui est très facile à voir. Mélissus se trompe évidemment en partant de cette hypothèse que tout ce qui a été produit ayant un principe, ce qui n'a pas été produit ne doit point en avoir. A cette première erreur, il en ajoute une autre non moins grave, c'est de croire que tout a eu un commencement, excepté le temps, et qu'il n'y a point de commencement pour la génération absolue, tandis qu'il y en aurait pour l'altération des choses, comme s'il n'y avait pas évidemment des changements qui se produisent tout d'un coup. Puis, ne peut-on pas demander pourquoi l'être serait immobile par cette raison qu'il est un ? Puisqu'une partie du tout qui est une, de l'eau par exemple, a un mouvement propre, pourquoi le tout dont elle fait partie n'aurait-il pas le mouvement au même titre ? Pourquoi n'aurait-il pas, lui aussi, le mouvement l'altération ? Enfin l'être ne peut être un en espèce, que sous le rapport du genre unique qui comprend les espèces, et d'où elles sortent. Il y a des Physiciens qui ont entendu l'unité de l'être de cette façon, croyant à l'unité du genre et non point à celle de l'espèce ; car il est par trop évident que l'homme n'est pas le même spécifiquement que le cheval, tout aussi bien que les contraires diffèrent spécifiquement entr'eux.
Les arguments qu'on vient d'opposer à la théorie de Mélissus n'ont pas moins de force contre celle de Parménide, qui lui aussi admet des hypothèses fausses et qui n'en tire pas des conclusions plus régulières. Il y a d'ailleurs contre le système de Parménide des objections toutes spéciales. Une première donnée fausse, c'est que Parménide suppose que le mot d' Être n'a qu'un seul sens, tandis qu'il en a plusieurs. En second lieu, sa conclusion est irrégulière en ce que même en admettant que le blanc soit un, par exemple, il ne s'en suit pas du tout que les objets qui sont blancs ne soient qu'un. Évidemment ils sont plusieurs. Le blanc n'est un, ni par continuité ni même par définition. L'essence de la blancheur ne se confond pas avec l'essence de l'être qui est affecté de cette blancheur. En dehors de cet être, et indépendamment de lui, il n'y a pas de substance séparée qui soit la blancheur ; et ce n'est pas en tant que séparée qu'elle diffère de lui, c'est par son essence ; or c'est là ce que Parménide n'a pas su discerner.
Ainsi, quand on soutient que l'être et l'un se confondent, il faut nécessairement admettre que l'être auquel l'un est attribué, exprime l'un tout aussi bien qu'il exprime l'être lui-même, mais que de plus il exprime l'essence de l'être et l'essence de l'un. L'être devient alors un simple attribut de l'un, et le sujet même auquel on prétend attribuer l'être, s'évanouit et n'existe plus ; c'est alors créer un être qui existe sans exister. C'est qu'il ne faut sérieusement considérer comme être que ce qui existe substantiellement. L'être ne peut pas être son attribut à lui-même, à moins qu'on ne prête arbitrairement d'autres sens à l'idée d'être ; mais elle n'a cependant qu'une seule signification, et l'on ne peut pas réaliser ainsi tout ce qu'on veut. L'être réel n'est jamais l'attribut, l'accident d'autre chose ; c'est lui au contraire qui reçoit les attributs. Si l'on n'admet pas ce principe évident, on en arrive à confondre l'être et le non-être dans une égale indétermination. L'être qui est blanc n'est pas identique à sa blancheur, puisque la blancheur ne peut jamais comme lui recevoir d'attributs. L'être réel est ; le blanc n'est pas, non point seulement en ce sens qu'il n'est point tel être spécial, mais parce que de fait il n'est rien en dehors du sujet où il est. En confondant l'être et sa blancheur, l'être devient comme elle un non-être ; car s'il est blanc, le blanc avec lequel il se confond n'est qu'un non-être. Si l'on soutient encore que le blanc est un être tout aussi bien que le sujet lui-même où il est, c'est qu'alors on donne au mot d'être des acceptions fausses, au lieu de la seule qu'il a véritablement.
En voulant ainsi confondre l'un et l'être, Parménide en arrive à cette absurdité de nier que l'être puisse avoir aucune dimension ; car du moment qu'il y a un être réel, il a des parties, et chacune de ces parties a un être différent ; ce qui détruit la prétendue unité de Parménide. Mais ce n'est pas seulement toute dimension qu'il ôte à l'être, c'est aussi toute essence ; car tout être en suppose d'autres au-dessus de lui, qui sont impliqués dans sa définition. Ainsi l'homme est un certain être ; mais quand on le définit, on voit que nécessairement il en suppose d'autres : l'animal, le bipède, qui ne sont pas des accidents, des attributs de l'homme, mais qui font partie de son être essentiellement. La preuve que ce ne sont pas là des attributs ou des accidents, c'est qu'on entend par accident ce qui peut indifféremment être ou n'être pas dans le sujet, et ce dont la définition comprend l'être auquel il est attribué. Ainsi être assis n'est qu'un accident d'un être quelconque et un accident séparable ; mais l'attribut Camard, par exemple, comprend toujours dans sa définition l'idée de nez, parce que Camard ne peut être que l'attribut du nez.
Il ne faudrait pas d'ailleurs pousser ceci trop loin ; et les éléments qui servent à composer la définition d'un tout ne comprennent pas toujours ce tout dans leur propre définition. Ainsi la définition de l'homme n'entre pas dans celle de Bipède ; et la définition de l'homme blanc n'entre pas dans celle de Blanc. Mais si bipède était en ce sens un simple accident de l'homme et ne faisait pas partie de son essence, il faudrait que cet accident fût séparable, c'est-à-dire que l'homme ne fût pas bipède ; ou autrement, la définition de l'homme ferait partie de celle de bipède, comme celle-ci fait elle-même partie de la définition de l'homme. Mais il n'en est rien, et c'est précisément le contraire qui est vrai, puisque l'idée de bipède est impliquée dans l'idée d'homme. Si animal et bipède pouvaient être de simples accidents, rien n'empêcherait que l'homme en fût un aussi et qu'il pût servir d'attribut à un autre être. Loin de là ; l'être réel, comme est un homme par exemple, est précisément ce qui ne peut jamais être l'attribut de quoi que ce soit ; c'est le sujet substantiel auquel s'appliquent les deux termes d'animal et de bipède, soit qu'on les considère à part, soit qu'on les réunisse dans un seul tout. L'être serait par conséquent composé d'indivisibles, si l'on s'en rapporte à la singulière théorie de Parménide, puisque selon lui l'être n'a ni dimension ni parties intégrantes et essentielles.
Certains philosophes ont accepté les deux solutions à la fois : ils ont cru avec Parménide que tout est un et que le non-être est quelque chose ; et en second lieu, ils ont reconnu dans le inonde des existences individuelles, auxquelles ils arrivaient par la méthode de division, qui consiste à toujours diviser les choses en deux jusqu'à ce qu'on parvienne à des éléments indivisibles. Évidemment on se tromperait si partant de l'unité de l'être et de l'opposition nécessaire des contradictoires, qui ne peuvent jamais être vraies toutes les deux à la fois, on allait conclure qu'il n'y a pas de non-être. Le non-être ne désigne pas quelque chose qui n'est point absolument ; mais il désigne une chose qui n'est pas telle autre chose. Ce qui est absurde, c'est de croire que tout est un parce qu'il ne peut rien exister en dehors des êtres réels ; car si l'être n'est pas un être réel et spécial, que peut-il être ? et comment peut-on le comprendre ? Mais du moment qu'on admet la réalité des êtres, il faut admettre aussi leur pluralité ; et il est impossible de dire avec Parménide que l'être est un.
V
Après Parménide et Mélissus, qui ne sont pas des Physiciens proprement dits, il faut étudier les systèmes des Physiciens véritables. Il faut distinguer ici cieux opinions différentes. Les uns, trouvant l'unité de l'être dans le corps substantiel auquel s'appliquent les attributs, en font sortir tous les changements des êtres, dont ils reconnaissent la multiplicité réelle. Il leur suffit, pour expliquer cette origine des phénomènes, de la rapporter aux modifications infinies de la raréfaction et de la condensation, soit qu'ils adoptent un des trois éléments, l'eau, l'air, !e feu, soit qu'il en adoptent un quatrième moins subtil que le feu, et moins grossier que l'air. Mais la raréfaction et la condensation sont des contraires : c'est l'excès, et le défaut, comme le dit Platon en parlant du grand et du petit. La seule différence entre Platon et les Physiciens, c'est qu'il fait de ces contraires la matière même des êtres, dont l'unité se réduit à leur simple forme, tandis que pour les Physiciens c'est le sujet même qui est matière, et que les contraires sont des différences et des espèces. Il est d'autres philosophes qui, comme Anaximandre, pensent que les contraires sortent de l'être un qui les renferme ; et c'est là aussi l'opinion d'Empédocle et d'Anaxagore, qui admettent tout à la fois l'unité et la pluralité des êtres. D'après leurs théories, toutes les choses sont issues d'un mélange primordial ; et la seule divergence entr'eux, c'est que pour Empédocle il y a des retours périodiques et réguliers, tandis qu'Anaxagore n'admet qu'un mouvement une fois donné. Anaxagore regarde commue infinis les contraires et les parties similaires des choses, les Homoeoméries ; Empédocle ne voit l'infini que dans les éléments.
Pour expliquer comment Anaxagore a pu admettre cette infinité de l'être, il faut supposer qu'il a cru avec bien d'autres Physiciens que rien ne peut venir du néant. C'est là sans doute aussi l'argument de ceux qui soutiennent qu'à l'origine des choses tout était mêlé et confus, que tout phénomène n'est qu'un simple changement, et que tout se réduit à des mouvements de décomposition et de recomposition. Anaxagore s'appuie en outre sur ce principe que les contraires naissent les uns des autres, ce qui implique qu'ils existaient antérieurement dans le sujet ; car tout phénomène qui se produit vient ou de l'être ou du néant ; et s'il est impossible qu'il vienne du néant, comme tous les Physiciens en tombent d'accord, il ne reste plus qu'à dire que les contraires naissent d'éléments qui se trouvent déjà dans le sujet, mais qui nous échappent à cause de leur ténuité infinie. Voilà comment ces Physiciens ont été amenés à soutenir que tout est dans tout. Voyant que tout peut naître de tout, ils ont cru que les choses n'étaient différentes et ne recevaient différents noms que d'après l'élément qui prédomine, bien que le nombre de leurs parties diverses soit infini. Ainsi jamais rien n'est dans sa totalité purement blanc ou purement noir ; seulement selon que l'un ou l'autre prédomine, on prend l'élément qui l'emporte pour la nature même de la chose ; et c'est d'après cet élément prédominant qu'on la qualifie.
Voici ce qu'on peut répondre à Anaxagore. L'infini en tant qu'infini ne peut être connu. Si c'est l'infini en nombre et en grandeur, on ne peut le comprendre dans sa quantité ; si c'est l'infini en espèce, on ne peut le comprendre dans sa qualité. Si donc on fait les principes infinis, soit en espèce soit en nombre, il est impossible de jamais connaître les combinaisons qu'ils forment ; car nous ne croyons connaître un composé que quand nous savons l'espèce et le nombre de ses éléments. A ce premier argument, on peut en ajouter un second : c'est que les parties des choses ne peuvent pas avoir cette petitesse infinie dont parle Anaxagore. Si une des parties dans lesquelles un tout se divise pouvait être d'une infinie petitesse, le tout devrait être lui-même susceptible de cette même condition. Or un animal, une plante ne peuvent pas avoir des dimensions arbitraires, soit en petitesse soit en grandeur. Il s'en suit que leurs parties ne le peuvent pas davantage. La chair, les os et les autres matières analogues sont des parties de l'animal, tout comme le fruit est une partie de la plante ; et il est bien impossible que les os et la chair aient indifféremment une dimension quelconque, soit en grandeur, soit en petitesse.
D'autre part, si tout est dans tout, comme le prétend Anaxagore, si les choses naissent toujours d'autres choses antérieures où elles sont en germe, et si elles sont dénommées d'après la qualité qui prédomine en elles, alors tout est confondu ; l'eau vient de la chair, et la chair vient de l'eau. Mais si d'un corps fini on retranche quelque chose, on parvient enfin à l'épuiser; et dès lors tout n'est pas dans tout, ainsi qu'on le prétend. Si de l'eau on tire une première portion de chair, puis encore une autre portion qu'on en sépare, quelque petite que soit cette soustraction, elle sera toujours appréciable, puisqu'il faut bien que cette chair soit quelque chose ; mais il faudra que la décomposition s'arrête à un certain point ; et évidemment, tout n'est pas dans tout, puisqu'il n'y a plus de chair dans ce qui reste d'eau.
Que si l'on dit que cette décomposition ne s'arrête pas, et qu'elle va à l'infini, alors dans une grandeur finie il y aura des parties finies et égales entr'elles qui seront en nombre infini ; ce qui est bien tout-à-fait impossible. De plus, à mesure qu'on enlève quelque chose à un corps quelconque, ce corps devient de plus en plus petit. Or, la chair est limitée dans les deux sens en grandeur et en petitesse. On arrivera donc par des soustractions successives à une certaine quantité de chair qui sera la plus petite possible, et l'on ne pourra plus en rien retrancher, puisque la partie qu'on en retrancherait serait nécessairement moindre que la plus petite quantité possible ; ce qui ne se peut pas non plus. Puis ensuite, dans ces corps qu'on suppose infinis, il y a des éléments infinis aussi et séparés entr'eux, de la chair, du sang, de la cervelle ; et chacun de ces éléments pris à part est infini.
Mais cela ne peut plus se comprendre,
et c'est une théorie dénuée de toute raison. Si, pour échapper à ces
impossibilités, on prétend que la séparation des éléments ne pourra
jamais être définitive, c'est là sans doute une idée juste ; mais on
ne s'en rend pas très bien compte en l'employant ici. Les qualités
sont, on le sait, inséparables des choses qu'elles déterminent ; et
si, par hasard, on suppose qu'elles en sont séparées après y avoir
été primitivement mêlées, il s'ensuit que telle ou telle qualité, le
blanc, le salubre par exemple, existera par elle-même et
substantiellement, sans être même l'attribut de quelque sujet réel.
Alors l'Intelligence, dont Anaxagore a fait un si pompeux éloge,
court grand risque de tomber dans l'absurde en essayant de réaliser
des impossibilités. Et c'est là ce qu'elle tente cependant en
voulant faire une séparation des choses qui n'est possible ni en
quantité ni en qualité : en quantité, parce qu'on en arrive de
subdivision en subdivision à une quantité qui est la plus petite
possible ; en qualité, parce que les affections et les qualités des
choses en sont absolument inséparables.
Une dernière objection contre les théories d'Anaxagore, c'est que la
génération des choses ne s'explique pas bien si l'on prétend la
tirer exclusivement des parties similaires, comme il le fait. Ainsi
pour prendre le premier exemple venu, la boue se divise bien si l'on
vent en parties similaires, c'est-à-dire en d'autres boues ; mais
elle se divise en d'autre éléments aussi, la terre et l'eau, qui ne
sont plus similaires entr'eux. Parfois le rapport entre le tout et
les parties est encore très différent ; et si l'on peut dire qu'en
un sens les murs viennent de la maison et que la maison vient des
murs, il y a d'autres cas où ce rapport est changé, par exemple
quand on dit que l'eau vient du feu, ou que le feu vient de l'eau.
C'est là une transformation, où il n'y a plus de parties similaires.
Le système d'Anaxagore n'est donc pas acceptable en ceci, et
peut-être vaudrait-il encore mieux admettre, avec Empédocle, des
principes finis et moins nombreux.
VI.
Un point où s'accordent les Physiciens, c'est que tous ils regardent les contraires comme des principes. Telle est l'opinion de ceux qui admettent que l'être est un et immobile, comme Parménide, qui prend pour principes le froid et le chaud, sous le nom de terre et de feu ; telle est encore l'opinion de ceux qui admettent pour principes le dense et le rare, la raréfaction et la condensation, ou comme le dit Démocrite, le plein et le vide, prenant l'un de ces contraires pour l'être, et l'autre pour le non-être; enfin c'est également l'opinion de ceux qui expliquent l'existence et l'origine des choses par la position, la figure et l'ordre des éléments ; car ce ne sont là évidemment que des variétés de contraires ; la position étant en haut, en bas, en avant, en arrière ; la figure étant d'avoir des angles ou de ne point en avoir, d'être droit ou circulaire, etc. En un mot, dans tous ces systèmes, les contraires sont adoptés pour principes ; et c'est là, je le répète, en point commun à toutes ces théories.
Je reconnais du reste qu'on doit approuver cet axiome car les principes ne peuvent point venir réciproquement les uns des autres ; et loin de venir non plus d'autres choses, c'est d'eux que doit sortir tout le reste. Or, c'est là précisément ce que sont dans chaque genre les contraires primitifs. En tant que primitifs, ils ne peuvent dériver de rien qui leur soit antérieur ; et en tant que contraires, ils ne peuvent pas davantage dériver l'un de l'autre réciproquement. Mais cette théorie vaut la peine qu'on l'approfondisse ; et c'est ce que nous allons faire. D'après les lois de la nature, l'action des choses ou la souffrance des choses n'est pas arbitraire ; la première chose venue ne produit pas au hasard ou ne souffre pas telle action quelconque. Il n'est pas possible davantage que les choses se produisent indifféremment les unes par les autres, à moins qu'on n'entende ce mot de production dans un sens tout à fait détourné. Par exemple, comment l'idée de blanc viendrait-elle de l'idée de musicien, à moins que le blanc ou le noir ne soit un attribut purement accidentel du musicien ? Le blanc ne peut venir que du non-blanc, ou plus précisément du noir et des couleurs intermédiaires entre le noir et le blanc. De même, le musicien vient du non-musicien, ou plus précisément encore de ce qui n'a pas cultivé la musique, tout en pouvant la cultiver, ou de ce qui n'a pas eu telle autre qualité intermédiaire entre le musicien et le non-musicien. Mais si une chose ne vient pas indifféremment d'une autre chose, elle ne se perd pas non plus indifféremment dans la première chose venue. Ainsi selon l'ordre naturel des choses, le blanc quand il disparaît ne se perd pas dans le musicien, si ce n'est en un sens détourné et purement accidentel ; mais il se perd dans son contraire, le non-blanc, et non pas même dans le non-blanc en général, mais dans ce non-blanc spécial qui est le noir, ou dans telle autre couleur intermédiaire. Tout de même pour le musicien, qui ne change et ne se perd que dans le non-musicien, et non pas encore dans le non-musicien eu général, mais dans ce qui n'a pas cultivé la musique, bien qu'il fût capable de la cultiver, ou dans telle autre qualité intermédiaire.
Ce qu'on dit ici de termes simples, comme blanc et musicien, s'applique également aux termes composés ; mais en général cette opposition des contraires passant de l'un à l'autre, n'est pas comprise, parce que les propriétés opposées des choses n'ont pas reçu de nom spécial qui en signale les contraires. Je prends diverses choses composées, et je cite les trois exemples suivants. Soit, si l'on veut, quelque chose qui est organisé et dont toutes les parties se correspondent harmonieusement. Je dis que l'organique vient de l'inorganique ; et à l'inverse, l'inorganique vient de l'organique. A l'organisation harmonieuse des parties, je puis substituer leur ordre ou leur combinaison ; cela revient toujours au même ; ainsi je puis à l'organisation substituer la combinaison ou l'ordre, soit dans une maison soit dans une statue. La maison n'est que la combinaison de tels matériaux qui ont été réunis d'une certaine façon, mais qui, antérieurement ne l'étaient pas de cette façon spéciale. La statue, ou toute autre chose figurée comme elle, vient de ce qui, antérieurement, était sans figure et a reçu l'ordre qui constitue la statue. Les contraires sont, d'une part, ce qui a une certaine combinaison régulière ou un certain ordre régulier, et de l'autre, ce qui n'a ni cet ordre ni cette combinaison. Mais ces contraires n'ont pas reçu de nom spécial dans la langue, c'est-à-dire que la statue, la maison, n'ont pas leurs contraires.
Si cette théorie est vraie, comme elle semble l'être, on peut dire d'une manière générale que, dans le monde entier, tout ce qui vient à naître vient de contraires, et que tout ce qui périt se résout dans ses contraires également, ou dans ses intermédiaires, qui d'ailleurs ne viennent eux-mêmes que des contraires. Ainsi, toutes les couleurs intermédiaires dérivent du blanc et du noir, qui sont aux deux extrémités ; et l'on peut affirmer ainsi que toutes les choses de la nature sont des contraires ou viennent des contraires.
C'est là le point commun où sont
arrivés tous les philosophes dont nous parlions tout à l'heure. Sans
peut-être se bien rendre compte des expressions qu'ils emploient,
tous qualifient de contraires les éléments et les principes qu'ils
reconnaissent, et l'on dirait que tous sont conduits à ce système
par la force même de la vérité qui les y pousse à leur insu. La
seule différence, c'est que les uns prennent leurs principes le plus
haut possible, et que les autres ne s'adressent pas à des termes
aussi élevés et aussi généraux : les uns s'adressant à la pure
raison et aux idées qui sont les plus claires pour elle ; les autres
s'adressant à des idées qui sont plus notoires que pour les sens.
Ainsi, pour les uns, les contraires élémentaires sont le chaud et le
froid, le sec et l'humide, toutes choses qui nous sont révélées par
la sensibilité ; pour les autres, c'est le pair et l'impair, ou
enfin c'est l'Amour et la Discorde, qui sont les causes premières de
toute génération. Ces différents systèmes ne diffèrent entr'eux que
par la diversité des contraires, dont tous reconnaissent
l'existence. Ils s'accordent donc en un sens, et en un sens ils se
contredisent, comme chacun peut le voir sans qu'il soit besoin
d'entrer dans de plus longs détails. Leur analogie, c'est d'avoir
tous également une série de contraires, à l'aide de laquelle ils
croient expliquer le monde ; leur différence, c'est que les uns
prennent des contraires plus généraux et qui enveloppent plus de
choses, tandis que les contraires admis par les autres sont moins
vastes, et sont à leur tour subordonnés à d'autres contraires qui
les enveloppent. Telle est la ressemblance et la dissemblance de ces
théories, où l'on s'exprime plus ou moins bien selon qu'on s'en
rapporte, comme je viens de le dire, soit à des notions purement
rationnelles soit à des notions purement sensibles. L'universel est
plus notoire à la raison ; le particulier l'est davantage aux sens ;
car la notion sensible n'est jamais que particulière. Le grand et le
petit sont des notions rationnelles plutôt que des notions sensibles
; mais le rare et le dense ne sont guère compris que par la
sensibilité.
Donc, pour nous résumer, les principes sont nécessairement des
contraires.
VII
En suivant ces considérations, nous allons rechercher si les principes de l'être sont seulement au nombre de deux, comme les contraires le sont nécessairement dans chaque genre, ou bien s'il y a dans l'être trois principes au lieu de deux, ou même davantage. D'abord évidemment, il n'y a pas dans l'être un principe unique, ainsi qu'on l'a dit, puisque les contraires sont au moins deux. D'autre part, il n'est pas moins évident que les principes ne peuvent être en nombre infini ; car alors l'être serait inaccessible à la science, et l'on ne pourrait jamais savoir quels sont ses principes. Dans tout genre quel qu'il soit, il n'y a jamais qu'une seule opposition par contraires ; et dans le genre de la substance, par exemple, il n'y a de contraires que la substance, d'une part, et ce qui n'est pas substance, d'autre part, c'est-à-dire les attributs ou accidents. Mais si les principes ne peuvent être infinis, ils peuvent bien être finis, comme le veut Empédocle, qui prétend expliquer mieux les choses, avec ses principes finis, qu'Anaxagore ne peut les expliquer par les infinis qu'il admet. Ceci ne veut pas dire d'ailleurs que tous les contraires sont des principes; car il y a des contraires qui sont antérieurs à d'autres contraires, tandis que d'autres contraires dérivent de contraires plus généraux. Le doux et l'amer, le blanc et noir, se rapportent à des genres supérieurs ; et ce ne sont pas là des contraires qu'on puisse considérer comme des principes, attendu que les principes sont par leur nature absolument immuables. Je conclus donc que les principes de l'être ne se réduisent pas à un seul, et que de plus ils ne sont pas en nombre infini.
Mais quel est le nombre des principes de l'être ? Du moment qu'il sont en nombre limité, il semble assez difficile qu'ils ne soient que deux seulement ; car on ne comprend pas comment l'un pourrait agir sur l'autre. La rareté ne peut rien sur la densité ; pas plus que la densité n'a la moindre action sur la rareté. L'Amour ne peut pas davantage se concilier la Discorde, et la Discorde de son côté ne peut rien faire de l'Amour. Même remarque pour toute espèce de contraires. Mais si l'on suppose entr'eux un troisième terme, ils peuvent agir alors l'un ou l'autre sur cet élément nouveau, qui est différent d'eux ; et voilà comment certains philosophes ont supposé plus de deux principes pour expliquer les choses. Une autre raison qui fait une nécessité d'admettre un troisième terme, support des deux contraires, c'est que les contraires ne sont jamais des substances ; ils ne sont que des attributs de quelqu'autre chose. Mais un principe proprement dit ne peut jamais être l'attribut de quoi que se soit ; car il y aurait alors principe de principe, puisque c'est le sujet des attributs qui est leur principe, en leur étant toujours antérieur. De plus la substance, comme on le sait, ne peut être contraire à la substance ; elle ne peut pas venir davantage de ce qui n'est pas substance ; et comment le principe, s'il n'est pas substance, serait-il antérieur à la substance même ?
Si donc on admet d'une part que les principes sont des contraires, et d'autre part qu'ils ne sont pas des substances, on est amené à conclure qu'il faut nécessairement entre les deux contraires supposer un troisième terme. C'est bien là aussi ce que pensent les philosophes qui n'admettent dans le monde qu'un élément unique, l'eau, le feu ou tel autre élément intermédiaire, dont ils font le support commun des contraires ; et je remarque que c'est plutôt cet intermédiaire qu'ils devraient choisir pour leur élément unique, puisque le feu, la terre, l'air et l'eau sont toujours mélangés et entremêlés de quelques contraires. Aussi, je suis plutôt de l'avis de ceux qui ont recours à cet intermédiaire qui n'est aucun des quatre éléments ; et je mettrais ensuite ceux qui adoptent l'air dont les différences sont les moins sensibles, et enfin ceux qui ont recours à l'eau. Mais je reviens, et je dis que tous ces philosophes, quel que soit le principe unique qu'ils adoptent, le transforment aussitôt par des contraires : le rare et le dense, le plus et le moins, ou comme nous le disions aussi un peu plus haut, l'excès et le défaut ; car c'est une opinion fort ancienne que de réduire tous les principes des choses à trois : l'unité, le défaut et l'excès. Mais ceci n'a pas été entendu de la même manière par tout le monde ; car les anciens prétendaient que c'est l'excès et le défaut qui agissent, l'unité souffrant leur action, tandis que les modernes soutiennent au contraire que c'est l'unité qui agit, et que le défaut et l'excès supportent l'action qu'elle exerce sur eux.
Les arguments qui précèdent et d'autres arguments analogues qu'on y pourrait joindre, donnent à penser très justement que les principes de l'être sont au nombre de trois, ainsi qu'on vient de l'indiquer. En effet, on ne peut aller au-delà de ce nombre, et l'unité suffit à souffrir et à expliquer l'action des contraires. Mais si les principes sont au nombre de quatre, il y a dès lors deux oppositions de contraires, et il faudra un sujet et une unité à chacune d'elles, c'est-à-dire qu'il y aura deux sujets au lieu d'un.
De même que si l'on suppose une seule unité pour les deux oppositions, alors l'une des deux oppositions devient parfaitement inutile. Il est d'ailleurs impossible qu'il y ait dans chaque genre plus d'une seule opposition primordiale de contraires ; car, prenant le genre de la substance, par exemple, les principes ne peuvent plus y différer entr'eux qu'en tant que postérieurs et antérieurs ; mais ils n'y diffèrent pas en genre, parce que dans chaque genre il ne peut y avoir qu'une opposition à laquelle se rapportent en définitive toutes les autres.
Ainsi donc, il y a dans l'être plus d'un principe ; mais évidemment il ne peut pas y en avoir plus de deux ou trois. Où est ici le vrai ? c'est ce qu'il est très difficile de dire.
VIII.
Afin de suivre dans cette recherche une méthode sûre, nous traiterons d'abord de la génération des choses, entendue de la manière la plus large possible ; car il semble tout à fait rationnel et conforme à l'ordre naturel d'exposer d'abord les propriétés communes des choses, pour en arriver ensuite aux propriétés particulières. Posons quelques principes qui serviront à expliquer la théorie que nous adopterons.
Quand on dit d'une manière absolue qu'une chose vient d'une autre, ou d' une manière relative que la même chose devient, par un changement quelconque, autre qu'elle n'était, nous pouvons employer, pour rendre ces idées, ou des ternies simples ou des termes complexes : simples, quand je dis que l'homme devient musicien, ou que le non-musicien devient musicien ; complexes, quand je dis au contraire, en joignant les deux termes, que l'homme non-musicien devient homme musicien. Dans un cas, le terme est simple, homme, non-musicien, musicien ; dans le second cas, le terme est complexe, homme non-musicien, homme musicien. Dans l'expression complexe, il y a à la fois, et le sujet qui devient quelque chose, et l'attribut qu'il devient par le changement qu'il subit. De ces deux expressions, la dernière signifie que non seulement l'être devient telle chose, mais que de plus il avait, antérieurement à ce changement, une certaine manière d'être différente. Quant à l'expression simple : L'homme devient musicien, elle n'a pas une signification absolue ; car elle ne signifie pas que l'homme a cessé d'être homme pour devenir musicien ; elle signifie uniquement que l'homme, tout en restant homme, a subi ce changement qui consiste à devenir musicien, ce qu'il n'était pas auparavant. Dans les choses qui se produisent ainsi, c'est-à-dire où tel être subit telle modification et où telle chose devient telle autre chose, nous entendons toujours qu'il y a une partie qui subsiste tout en subissant un changement, tandis qu'il y a une partie qui ne subsiste pas et qui disparaît. L'homme a beau devenir musicien, il n'en subsiste pas moins en tant qu'homme ; l'homme reste ; mais le non-musicien, ce qui n'est pas musicien, peu importe le terme plus ou moins compliqué dont on se sert ici, ne subsiste pas ; et loin de là, il disparaît dans le changement.
Ceci posé, un peut appliquer ce principe à toute génération, et l'on verra que dans tous les cas, comme dans celui-ci, il faut qu'il y ait un certain élément qui subsiste et demeure pour servir de support à tout le reste. Ce qui subsiste ainsi est toujours un, numériquement parlant ; mais il n'est pas toujours un, sous le rapport de la forme ; et par la forme, j'entends ici la définition qui remplace le sujet pour le déterminer par une qualité spéciale : ainsi le non-musicien mis à la place de l'homme. Homme et non-musicien ne sont pas des termes identiques, puisque l'un subsiste tandis que l'autre ne subsiste pas. Ce qui subsiste, c'est précisément ce qui n'est pas susceptible d'opposition ; c'est l'homme proprement dit, tandis que le musicien et le non-musicien ou l'homme non-musicien, ne subsistent pas de cette façon.
C'est surtout aux choses qui ne subsistent pas, qu'on applique cette expression qu'une chose vient de telle chose et non qu'elle devient telle autre chose ; on dit que de non-musicien vient le musicien, car c'est le non-musicien qui cesse de subsister; mais comme ce n'est pas l'homme qui cesse de subsister parce qu'il devient musicien, on ne dit pas que d'homme il devient musicien. Parfois cependant on applique cette expression d'une manière vicieuse à ce qui subsiste, aux substances ; et l'on dit, que la statue vient de l'airain, tandis qu'on devrait dire, au contraire, que c'est l'airain qui devient statue. Quant à l'attribut qui peut être l'un des deux contraires, on emploie indifféremment l'une de ces deux expressions, et l'on dit, ou que de non-musicien l'être devient musicien, ou que telle chose devient telle autre chose. Ainsi on dit également que du non-musicien vient le musicien, on que l'homme non-musicien devient homme musicien.
C'est que le mot Devenir peut avoir plusieurs sens, selon qu'on le prend d'une manière absolue on d'une manière relative. Lorsqu'une chose devient absolument parlant, c'est qu'elle naît, et sort du non-être ; mais dans les cas oit l'expression n'est pas absolue, on ne dit pas seulement qu'une chose devient ; on ajoute qu'elle devient telle autre chose, par suite du changement qu'elle subit. Devenir d'une manière absolue ne s'applique qu'aux substances ; tout autre Devenir suppose préalablement un sujet déjà existant, qui subit une modification. Ainsi les changements qui se passent dans la quantité, la qualité, la relation, le temps, le lieu, ne se produisent que par rapport à un certain sujet, puisque jamais la substance ne sert d'attribut à quoi que ce soit, tandis que tonde reste sert d'attribut à la substance. Toutes les substances, et en général tous les êtres qui ont l'existence d'une manière absolue, viennent d'un sujet antérieur qu'elles supposent nécessairement. Toujours il y a préalablement un être qui subsiste avant celui qui naît et qui en sort, comme est le germe dans les plantes et dans les animaux. Tout ce qui naît, et devient généralement parlant, ne peut venir que des manières suivantes : transformation, comme la statue qui vient de l'airain ; addition, comme les plantes et les êtres qui se développent en s'accroissant ; réduction, comme l'Hermès qu'on tire d'un bloc de marbre ; arrangement et combinaison, comme la maison qu'on bâtit ; enfin altération, comme les choses qui changent dans leur matière. Mais tous ces changements supposent, on le voit, assez clairement, un sujet quelconque qui existe antérieurement à eux et qui est apte à les subir.
Il résulte de ces considérations que, quand une chose quelconque vient à se produire, le phénomène est toujours complexe ; car il y a deux termes : la chose même qui se produit, et celle qui devient de telle ou telle façon. Cette dernière chose, qui est le sujet du changement, peut présenter encore des nuances diverses ; car elle est ou le sujet même ou l'opposé de ce qui devient ; et par exemple, l'opposé c'est le non-musicien qui devient musicien, au lieu de l'homme qui serait le sujet propre. L'opposé, c'est ce qui est privé de la forme, ou de la figure et de l'ordre, comme dans les exemples cités plus haut ; le sujet, c'est l'or, l'airain ou la pierre. Une autre conséquence évidente de ceci, c'est que, comme tout ce qui est dans la nature a des principes primordiaux qui font que les êtres sont ce qu'ils sont essentiellement, d'après les propriétés qui leur font donner une dénomination spéciale, tout ce qui se produit et devient se compose à la fois et du sujet et de la forme que ce sujet vient à revêtir. Ainsi l'homme devenu musicien est composé en quelque sorte de l'homme, qui est le sujet, et du musicien, qui est la forme nouvelle de ce sujet ; car la définition de l'homme musicien pourrait se résoudre dans les deux définitions particulières de l'homme et du musicien séparément. Ce sont là les deux principes nécessaires de tout phénomène qui se produit. Le sujet est un, numériquement parlant ; mais il est deux, sous le rapport des espèces. Aussi est-ce l'homme et l'airain, ou d'une manière plus générale, la matière, que l'on compte ; parce que c'est elle qui est la chose réelle, et que ce n'est pas seulement par accident que le phénomène vient d'elle ; mais la privation et l'opposition sont de purs accidents de l'être. Quant à la forme, elle est absolument une, et elle ne se décompose pas comme le sujet en deux éléments : c'est, par exemple, l'ordre donné aux matériaux qui forment la maison ; ou bien la musique, qui est la qualité nouvelle de l'homme devenu musicien.
Ainsi l'on peut dire que les principes sont au nombre de deux ; mais on peut soutenir aussi qu'ils sont au nombre de trois, puisque le sujet se décompose en deux. En un sens, les principes peuvent être encore considérés comme des contraires, lorsqu'on dit que le non-musicien devient musicien, que le chaud devient froid, que l'inorganisé devient organisé. En un autre sens, les principes ne sont pas des contraires ; car il est impossible que les contraires agissent l'un sur l'autre, comme le font ici la privation et la forme. Pour résoudre cette difficulté, il faut remarquer que le sujet ne se confond ni avec la privation ni avec la forme, et il n'est pas un contraire de la forme qu'il reçoit. Ainsi donc les principes de l'être, quand on n'en compte que deux, ne sont pas plus nombreux que les contraires ; et numériquement ils ne sont que deux aussi ; mais on ne peut pas dire qu'ils soient absolument deux, attendu que leur essence est différente ; et par exemple, l'essence de l'homme n'est pas identique à l'essence du non-musicien, bien que ce soit l'homme qui est non-musicien ; l'essence du non-figuré n'est pas non plus identique à l'essence de l'airain, dans l'exemple de la statue.
Tel est donc le nombre des principes dans la génération de tout phénomène naturel ; et nous avons expliqué comment il faut comprendre ce nombre. Il n'est pas moins clair qu'il faut un sujet qui serve de support aux deux contraires. Mais il n'est pas même besoin ici des deux contraires ; il suffit d'un seul pour produire le changement, selon qu'il est présent ou qu'il est absent. Pour faire bien voir ce qu'est cette matière qui sert de support à la forme, je prends des comparaisons. Ce que l'airain est à la statue, ce que le bois est au lit, ce que sont la matière et le non-figuré à toutes les choses qui reçoivent une figure et une forme, cette nature première qui sert de support aux contraires, l'est à la substance, à l'objet réel et sensible, à l'être en un mot. Elle est bien un principe ; mais son unité ne fait pas un être réel comme l'est tel objet individuel et particulier ; elle est une en ce sens seulement que sa définition est une ; mais elle implique en outre son contraire, qui est la privation.
Je résume donc tout ce qui précède, et je dis qu'on doit comprendre maintenant comment les principes sont deux, et comment aussi ils sont davantage. D'abord on avait montré que les principes ne peuvent être que des contraires ; mais on a dû ajouter qu'à ces contraires il fallait nécessairement un sujet qui leur servit de support ; et que par conséquent, il fallait bien compter trois principes, au lieu de deux. On doit voir clairement quelle est la distinction établie ici entre les contraires, et quels sont les rapports des principes entr'eux, et enfin ce qui est le sujet qui sert de support. Ce qui reste actuellement à savoir, c'est si l'essence des choses consiste dans la forme ou dans le sujet. On résoudra plus tard cette question ; mais il fallait d'abord se fixer sur le nombre des principes, qui sont trois, et sur la manière dont ils sont trois ; et voilà quelle est notre théorie sur le nombre et la nature des principes.
IX.
Les développements qui précèdent sont déjà une manière de résoudre les difficultés qui arrêtaient les anciens philosophes. Malgré leur amour sincère de la vérité et malgré des recherches profondes sur la nature des choses, ils s'égaraient dans les fausses voies où les poussait leur inexpérience, et ils étaient amenés à soutenir que rien ne naît et que rien ne périt : « Car, disaient-ils, tout ce qui naît ou se produit doit venir de l'être ou du non-être ; or, il y a des deux parts égale impossibilité, puisque d'une part l'être n'a pas besoin de devenir puisqu'il est déjà, et qu'en second lieu rien ne peut venir du non- être et qu'il faut toujours quelque chose qui serve de support. » Puis aggravant encore ces premières erreurs, ils ajoutaient que l'être ne peut être multiple, et ils ne reconnaissaient dans l'être que l'être seul. En d'autres termes, ils étaient conduits à affirmer l'unité et l'immobilité de l'être. Déjà nous avons indiqué d'où provenait un système aussi faux. Mais à notre avis, il n'y a réellement ici que confusion de mots. Ainsi l'on dit qu'une chose doit venir de l'être ou du non-être, que l'être ou le non-être fait ou souffre telle chose, que telle chose devient telle autre chose quelconque. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ces expressions. Elles ne sont pas plus difficiles à comprendre que quand on dit que le médecin fait ou souffre telle chose, ou bien que de médecin il devient telle ou telle chose, en acquérant telle ou telle autre qualité. Cette seconde expression, relative au médecin, a deux sens ; les autres expressions, à savoir que la chose vient de l'être ou du non-être, que l'être ou le non-être agit ou souffre, ont deux sens également. Si donc le médecin vient à construire une maison, ce n'est certainement pas en tant que médecin ; mais c'est en tant qu'architecte ; s'il devient blanc, ce n'est pas davantage en tant que médecin, c'est en tant qu'il était noir ou de telle autre couleur. Mais s'il réussit ou s'il échoue en soignant une maladie, c'est alors eu tant que médecin et comme médecin qu'il agit. La distinction est évidente ; il suffit de l'appliquer à l'être et au non-être. De même qu'on dit au sens propre que c'est le médecin qui agit ou qui souffre, quand il agit ou souffre expressément comme médecin, de même quand on dit qu'une chose vient du non-être, cela veut dire simplement qu'elle devient ce qu'elle n'était pas.
Si les premiers philosophes se sont égarés, c'est qu'ils n'ont pas fait cette distinction si simple, entre ce qui est en soi et ce qui est accidentellement ; et cette première erreur les a conduits à cette autre erreur, non moins forte, que rien autre chose que l'être lui-même ne se produit ni n'existe, et qu'il n'y a point de génération des choses, tout étant immobile et un. Nous aussi nous convenons qu'absolument parlant rien ne vient de rien, du non-être : mais indirectement et accidentellement, quelque chose peut très bien venir du non-être. Le phénomène vient de la privation, qui se confond avec le non-être, c'est-à-dire que la chose devient ce qu'elle n'était pas. J'avoue que cette proposition est, au premier coup-d'oeil, faite pour étonner ; et on ne comprend pas bien d'abord que, même en ce sens restreint, quelque chose puisse venir de rien. Mais il faut bien remarquer que ce n'est pas seulement du non-être que l'être vient par accident ; c'est aussi de l'être. L'être vient de l'être, d'une manière générale et peu précise, comme l'animal pris généralement vient de l'animal, aussi bien que l'animal pris particulièrement pourrait aussi venir de tel animal particulier. Par exemple si l'on disait que le chien vient du cheval, on ne pourrait jamais vouloir dire par là que c'est d'une manière directe ; seulement, le chien en tant qu'animal, et non pas spécialement chien, viendrait du cheval ; car le cheval est indirectement aussi animal ; mais ce n'est pas du tout en soi que l'un viendrait de l'autre, si cette supposition était admissible ; le chien est déjà animal lui-même, et il n'a que faire de le devenir. Mais quand un être doit devenir animal directement et non plus par simple accident, ce n'est pas de l'animal pris en général qu'il sort, c'est d'un être réel, et il ne vient alors ni de l'être ni du non-être ; car cette expression : Venir du non-être, signifie seulement que la chose devient ce qu'elle n'était pas.
Par là, nous n'ébranlons pas ce principe fondamental que toute chose doit être ou n'être pas ; l'être et le non-être, limités comme nous le faisons, suffisent à résoudre la difficulté à laquelle se sont heurtés les anciens philosophes. Une autre manière de la résoudre encore ce serait de distinguer entre la puissance et l'acte, la simple possibilité et la réalité positive. Mais nous avons traité à fond cette théorie dans d'autres ouvrages, et nous croyons ne pas devoir y revenir ici. Donc en résumé, nous avons expliqué, ainsi que nous l'avions promis, comment les anciens philosophes avaient été conduits à méconnaître quelques-uns des principes que nous adoptons, et comment ils s'étaient tous écartés de la route où ils auraient compris la génération et la destruction des choses, c'est-à-dire le changement. Cette nature première du sujet, servant de support à tout le reste, aurait suffi à dissiper leur ignorance, s'ils l'eussent reconnue ainsi que nous.
X.
Il y a bien quelques philosophes qui ont touché à cette théorie de la nature première de l'être ; mais ils ne l'ont pas approfondie suffisamment. Voici en quoi ils diffèrent de nous ; c'est que reconnaissant que quelque chose peut venir du non-être, ce qui donne toute raison à Parménide, ils affirment que cette nature première de l'être étant une numériquement et en réalité, elle est une aussi en puissance, Or, c'est là une opinion qui nous sépare absolument d'eux. Pour nous, il nous paraît que la matière et la privation, loin de se confondre comme ils le veulent, sont des choses fort distinctes entr'elles. La matière est le non-être indirectement ; mais la privation est le non-être en soi ; la matière, fort voisine de la substance, est à certains égards la substance même, tandis que la privation ne peut jamais l'être. D'autres philosophes ont pris pour le non-être un des deux contraires, le grand ou le petit, par exemple, indifféremment, soit en les réunissant tous les deux dans l'idée supérieure qui les contient, soit en les considérant chacun à part. Mais on voit que cette manière de comprendre la triade ou les trois éléments de l'être, est tout à. fait différente de la manière que nous venons d'indiquer. Ces philosophes, en effet, ont bien admis, ainsi que nous, qu'il fallait dans l'être une nature qui servît de support aux contraires ; mais ils ont supposé bien à tort que cette nature était une ; et si quelque philosophe se borne à reconnaître la dyade composée du grand et du petit, il ne se trompe pas moins que ceux dont nous venons de parler, puisqu'il oublie toujours dans l'être cette partie qui est la privation.
On conçoit du reste aisément cet oubli. La partie de l'être qui subsiste concourt, comme une mère en quelque sorte, à produire avec la forme tous les phénomènes qui adviennent. Mais quant à l'autre partie qui constitue l'opposition des contraires, c'est-à-dire l'opposition de la matière et de la forme, on peut bien croire qu'elle n'existe pas, si l'on se borne à la regarder par son côté destructif, puisque la privation tend à détruire les choses. En effet, comme il y a dans les choses un élément divin, excellent et désirable, nous reconnaissons volontiers qu'entre nos deux principes, la matière et la privation, le dernier est, on peut dire, contraire à cet élément divin, tandis que le premier est fait par sa propre nature pour le rechercher et le désirer. Mais dans les théories que nous combattons, on est amené à supposer que le contraire désire sa propre destruction. Cependant, il est également impossible et que la forme se désire elle-même, puisqu'elle n'a aucune défectuosité ni rien qui lui manque, et que le contraire la désire, puisque les contraires se détruisent mutuellement. Or, c'est là précisément le rôle de la matière ; et l'on pourrait dire métaphoriquement que c'est comme la femelle qui tend à devenir mâle, ou le laid qui tend à devenir beau. Mais la matière n'est pas le laid en soi ; elle ne l'est qu'indirectement ; et elle n'est pas davantage la femelle en soi ; elle ne l'est que par accident, et à cause de la privation qu'elle subit. A un certain point de vue, la matière naît et périt ; et à un autre point de vue, on peut soutenir également qu'elle ne naît point et qu'elle ne périt point. Ce qui périt en elle, c'est la privation ; mais en puissance, elle-même ne naît ni ne périt. Loin de là, il faut nécessairement la concevoir comme impérissable, et comme n'étant point engendrée, c'est-à-dire comme ne devenant pas. Elle est, et elle subsiste ce qu'elle est. En effet si elle naissait et se produisait comme se produisent du non-être à l'être les phénomènes qu'elle subit tour à tour, il faudrait qu'il y eût antérieurement à elle quelque principe primordial d'où elle pût sortir, un sujet d'où elle pût naître ; or, c'est là précisément sa nature propre de servir de sujet et de support ; et à ce compte, la matière existerait avant même de naître, puisque c'est elle qui est le sujet primitif où s'appuie tout le reste, et d'où vient originairement et directement la chose qui en sort. Mais la matière ne peut pas plus périr qu'elle ne peut naître ; car étant le terme extrême, comme elle est le terme premier, il faudrait qu'elle rentrât en elle-même, et il s'ensuivrait qu'elle aurait péri avant même de périr. Mais ce sont là des impossibilités auxquelles il ne convient pas de s'arrêter davantage.
Quant an principe de la forme que je
devrais traiter après celui de la matière, ce n'est pas à la
Physique, mais à la Philosophie première de déterminer avec
précision si ce principe est unique, ou s'il est multiple, et d'en
étudier la nature spéciale dans l'un ou l'autre cas. Je renvoie donc
à la Philosophie première cette théorie importante ; et je ne veux
parler ici que des formes naturelles périssables. Ce sera l'objet
des démonstrations qui vont suivre ; car je me suis borné jusqu'ici
à établir seulement qu'il y a des principes, et à faire voir quelle
en est la nature et le nombre. Il me faut actuellement aborder une
antre étude non moins grave.