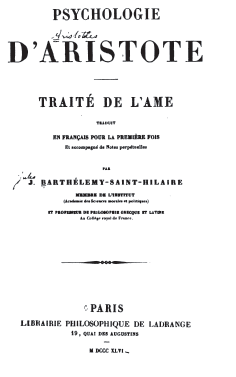
ARISTOTE
TRAITE DE L'AME.
PREFACE - PLAN GENERAL
TRAITÉ DE L'AME.
|
DU
TRAITE DE L'AME.
PLAN GENERAL
DU TRAITÉ DE L'AME.
LIVRE PREMIER.
POSITION DES QUESTIONS. — EXAMEN CRITIQUE DES THÉORIES ANTÉRIEURES. Quand, parmi les sciences, qui toutes méritent notre attention, l'une nous intéresse plus que l'autre, ce ne peut guère être que pour deux motifs : ou cette science exige des recherches plus difficiles, ou elle étudie des objets plus grands et plus admirables. A ces deux titres, nous pouvons avec toute raison placer en première ligne l'histoire de l'âme. D'abord elle est une partie considérable de la vérité totale que la science poursuit : et en second lieu, elle sert beaucoup à faire comprendre la nature, puisque l'âme est, on peut dire, le principe des êtres animés. Deux ordres de faits nous occuperont ici : les faits propres à l'âme, c'est-à-dire, son essence et sa nature; puis, les faits accessoires qui n'ont qu'elle seule pour but dans les êtres animés. On voit sans peine tout ce que 2 cette étude de l'âme a de difficile : elle se mêle à beaucoup de questions fort obscures, et par exemple, à celle de l'essence et des qualités. Y a-t-il une méthode unique, générale, pour étudier l'essence des choses? S'il n'y a pas de méthode de ce genre, il s'ensuit que l étude de chaque objet particulier exige une méthode spéciale ; et alors la difficulté, loin de diminuer, ne fait que s'accroître; car cette méthode une fois trouvée, démonstration, division, ou toute autre, reste toujours à savoir de quels principes il convient de partir. Et ici encore les chances d'erreur sont fort grandes, puisque les principes varient presque autant que les objets mêmes auxquels ils se rapportent. Pour l'étude de l'âme en particulier, ou peut se demander d'abord dans quelle catégorie il faut ranger l'âme. Est-elle substance;> ou simplement quantité, qualité, etc.? Est-elle seulement en puissance, ou bien est-elle une réalité complète, achevée, parfaite, une entéléchie ? De plus l'âme a-t-elle des parties? ou bien est-elle indivisible ? Toutes les âmes sont-elles de la même espèce? ou bien y a-t-il des espèces et des genres différents? Aujourd'hui ceux qui cherchent à approfondir ces questions ont le tort de ne s'occuper que de l'âme de l'homme. C'est limiter beaucoup trop la recherche, et il convient de l'étendre davantage. Doit-on donner de l'âme une définition générale qui puisse s'appliquer à l'animal? ou bien faut-il en donner une différente pour chaque espèce d'animaux, le cheval, le chien, l'homme, en remontant même jusqu'à Dieu ? Mais l'animal, ou tout autre tenue analogue, auquel ou rapporterait la définition de l'âme, 3 n'est qu'un terme universel, c'est-à-dire, un terme qui ne représente rien de réel, ou qui du moins représente quelque chose de très ultérieur. D'autre part, si l'âme a des parties, faut-il étudier ces parties avant le tout? N'est-ce pas en outre chose fort difficile de trouver entre ces parties des différences bien naturelles? Et puis, faut-il étudier ces parties diverses avant les fonctions qu'elles accomplissent? Et si l'on veut commencer par l'étude des fondions, ne faut-il pas, avant les fonctions mêmes, remonter jusqu'aux objet» auxquels elles s'appliquent? et ainsi se rendre compte de ce qu'est l'objet sensible avant d'aborder la sensibilité; de ce qu'est l'objet intelligible, avant d'aborder l'intelligence? Il est hon sans doute, pour connaître les qualités, d'avoir étudié auparavant l'essence; mais la connaissance même des qualités ne contribue-t-elle pas aussi beaucoup à bien faire connaître l'essence de la chose? L'essence n'est-elle pas le principe de toute démonstration? Et les définitions qui n'expliquent pas à fond l'essence de l'objet qu'elles prétendent définir, sont-elles autre chose que des définitions de pure dialectique, c'est-à-dire, parfaitement vaines ? Enfin les affections de l'âme lui sont-elles toutes sans exception communes avec le corps? ou en a-t-elle quelqu'une qui lui soit tout-à-fait propre? question indispensable, mais qui n'est pas plus facile que toutes les précédentes. La sensation, prise dans toute sa généralité, ne se produit jamais pour l'âme sans l'intermédiaire obligé du corps; et la pensée même, qui semble appartenir exclusivement à l'âme, ne peut guère se concevoir sans lui. L'âme n'ayant rien qui ne lui soit eu quelque manière com- 4 mun avec le corps, lui semble donc indissolublement unie ; elle n'en peut être séparée, pas plus que, dans une sphère, on ne peut imaginer la courbure isolée du corps matériel dont elle est la forme. Dans toutes les affections de l'âme, courage, douleur, crainte, pitié, joie, amour, haine, le corps a toujours sa part. Le corps agit certainement sur l'âme; et selon qu'il est disposé, ou l'âme ne ressent pas même les affections les plus fortes, ou elle est mise hors d'elle par les plus légères. Il serait donc possible de trouver à toutes les affections de l'âme, des raisons purement matérielles; et quand on se sert d'expressions comme celle-ci : Se mettre en colère, n'oublions pas qu'il s'agit toujours aussi d'un certain mouvement du corps qui est dans tel état, et affecté de telle manière, mouvement causé par tel objet et tendant à telle fin. Concluons de là que c'est au naturaliste, au physicien, qu'il appartient surtout d'étudier l'âme. D'ailleurs le naturaliste et le dialecticien auraient l'un et l'autre des procédés tout différents pour définir l'âme et ses affections. S'agit-il de la colère? Le dialecticien dira que c'est un désir de rendre mal pour mal, ou donnera telle autre explication analogue. Le physicien, au contraire, dira que la colère est un bouillonnement du sang qui se porte avec violence au cœur. Ainsi, l'un s'attache surtout à la matière, l'autre surtout à la forme, à la définition. S'il s'agit d'une maison, par exemple, et non plus de l'âme, l'un parlera des poutres, des pierres qui la composent; l'autre ne verra que le but pour lequel elle a été construite. Ces définitions sont incomplètes de part et d'autre, et le mieux c'est sans doute de les 5 réunir pour en faire une seule qui comprenne et explique la chose tout entière. Mais l'on peut dire qu'ici les rôles sont distincts. Le physicien s'occupe des phénomènes en tant qu'ils sont unis à la matière, et ne les considère jamais à part. Les modifications de la matière en tant que séparées de la matière sont l'objet d'études fort différentes, qui n'en mènent pas moins à la pratique, et qui font par exemple l'architecte on le médecin. Les modifications non séparées, mais étudiées abstraitement, sont la hase des mathématiques; et les modifications prises en elles-mêmes et isolément, sont étudiées par la philosophie première, c'est-à-dire la métaphysique. Mais revenons à notre point de départ, et rappelons-nous bien que les modifications de l'âme sont tout-à-fait inséparables de la matière physique dans les êtres organisés, et qu'elles ne peuvent être isolées comme on le fait pour les abstractions mathématiques. Mais, avant d'aller plus loin, il convient d'examiner les théories antérieurement émises sur ce grave sujet. Nous pourrons en retirer ce double avantage, d'y recueillir la part de vérité qui s'y trouve, et d'éviter les erreurs que d'autres auront commises avant nous. Deux caractères très frappants distinguent l'être animé de l'être inanimé : c'est le mouvement et la sensibilité. Aussi nos devanciers se sont-ils attachés à ces deux caractères; l'âme a été surtout pour eux ce qui produit le mouvement dans l'animal. De là vient que Démocrite et Leucippe en ont fait un feu, un corps chaud, et qu'ils l'ont crue sphéroïde comme ces corpuscules flottant dans l'air, 6 visibles dans un rayon de soleil, à travers les fentes des portes, atomes qui, selon ces philosophes, composent l'univers, pénètrent partout, et communiquent à tout le reste le mouvement dont ils sont doués eux-mêmes. C'est par suite de cette opinion qu'ils ont pris aussi la respiration pour la mesure même de la vie; car dans leurs théories ce sont les atomes du dehors qui, entrant dans le corps pendant l'acte de l'aspiration, y maintiennent et y fortifient ceux qui y sont déjà, contre l'action comprimante et destructive de l'enveloppe corporelle. Les animaux, suivant Leucippe et Démocrite, vivent aussi longtemps qu'ils peuvent accomplir cette fonction. Les Pythagoriciens sont à peu près du même avis; pour eux aussi l'âme ressemble à ces corpuscules, à ces atomes, et peut-être est-ce elle qui leur communique le mouvement. Enfin des philosophes, dont les théories sont fort voisines de celles-là, ont prétendu que l'âme est ce qui se meut soi-même. Ainsi pour eux tous, le mouvement, spontané ou communiqué, est le caractère propre de l'âme. Anaxagore est du même sentiment, si c'est lui ou tout autre qui soutient que l'intelligence meut tout l'univers. La différence qui distingue Anaxagore de Démocrite, c'est que celui-ci confond tout-à-fait l'intelligence et l'âme, ne voulant admettre d'autre mesure de la vérité que ce qui paraît vrai à chacun de nous, tandis qu'Anaxagore, d'ailleurs moins précis, tantôt fait de l'intelligence toute seule la cause du beau et du bien, et tantôt l'assimile à l'âme, qu'il trouve égale dans les êtres les plus élevés et les plus has, malgré l'énorme distance qui sépare, non pas seulement les animaux, mais aussi 7 les hommes entre eux. A côté de ces philosophes qui ont surtout considéré l'âme comme le principe du mouvement, d'autres l'ont considérée plutôt comme le principe de la connaissance et de la sensibilité. Ils l'ont prise alors pour l'élément unique ou pour les éléments multiples des choses. Ainsi, pour Empédocle, l'âme vient des éléments; chaque élément même est une âme distincte. A l'en croire : « Nous voyons la terre par la terre, l'eau par l'eau, l'air par l'air divin, le feu par le feu qui consume, l'amour par l'amour, et la discorde par la discorde funeste. » Platon même, dans le Timée, fait venir l'âme des éléments. Selon lui, c'est le semblable qui connaît le semblable; l'animal en soi vient de l'un en soi, et des idées premières de longueur, largeur et profondeur. Pour lui aussi, l'intelligence est représentée par un, la science par deux ; le nombre de la surface se rapporte à l'opinion, comme celui du solide c'est la sensation. C'est que Platon prend les nombres pour les idées mêmes, et les principes des choses pour les éléments dont elles viennent. Sur les traces de Platon, d'autres philosophes ont combiné ces deux idées de mouvement et de nombre, et ils en sont venus à dire que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. On fera plus loin justice de cette étrange opinion. Du reste, on n'est d'accord ni sur le nombre ni sur l'espèce des éléments et des principes. Pour ceux-ci il n'y en a qu'un, pour ceux-là il y eu a plusieurs; l'âme subit aussi toutes ces variations. Voici les qualités détaillées qu'on lui prête. Selon Démocrite, si l'âme donne le mouvement à tout le reste, c'est à cause de la petitesse de 8 ses parties et à cause aussi de sa figure; elle est de feu, elle est sphérique comme le feu ; l'intelligence l'est comme elle, car la sphère est la plus mobile des figures. Pour Anaxagore, qui fait de l'intelligence le principe de tontes choses, l'intelligence est simple, pure, sans mélange, et elle seule dans l'univers possède ces admirables qualités ; c'est elle à la fois qui meut tout et qui connaît tout. On peut range- aussi Thalès parmi ceux qui ont fait de l'âme le principe du mouvement, puisqu'il attribuait une âme à l'aimant par cela seul que l'aimant attire le fer. Diogène assimilait l'âme à l'air, qui est le principe de tout selon lui, et qui est le corps dont les parties sont les plus ténues. Héraclite la faisait l'évaporation primitive dont est sorti tout le reste, et la plus incorporelle de toutes les choses; mais il la croyait, comme l'univers entier, dans un flux perpétuel. Alcméon supposait l'âme immortelle, à cause du mouvement éternel dont elle est douée comme tous les grands corps de la nature, la lune, le soleil, les astres, le ciel entier. D'autres, moins éclairés, et tel est Hippon, ont confondu l'âme avec l'eau, parce qu'ils ont identifié l'âme et la semence, qui pour tous les êtres est liquide. Critias ne voyait pas de différence entre l'âme et le sang, qui était pour lui le principe de la sensibilité. Ainsi tous les éléments ont eu leurs partisans, excepté la terre, qui n'a pas encore été prise pour principe de l'âme, si ce n'est en ce sens qu'on a dit que la terre était composée de tous les autres éléments. Voilà donc en tout trois caractères fort distincts qu'on a donnés à l'âme : le mouvement, la sensation, l'immatérialité. Si on l'a faite ou un élé- 9 ment ou un composé des éléments, c'est qu'on s'est imaginé que la connaissance n'était possible que du semblable au semblable ; et comme l'âme connaît tout, il fallait alors, ou qu'elle fût le principe unique si l'on n'en admettait qu'un, ou les divers principes si l'on en admettait plusieurs. Il ne faut faire ici qu'une exception, et c'est en faveur d'Anaxagore. Il a nettement séparé l'intelligence de tout le reste ; mais il restait à dire dans ce système comment alors l'âme peut connaître quelque chose. Or, c'est ce qu'Anaxagore n'a point fait; et, d'après ce qu'il a dit, on ne saurait voir très clairement quelle est sa pensée à cet égard. D'ailleurs, ceux qui ont expliqué les principes par les contraires ont admis aussi des oppositions analogues pour l'âme ; et si l'âme a été le chaud pour les uns, elle a été le froid pour les autres. — Telles sont en résumé les théories antérieures sur l'âme et les motifs sur lesquels elles s'appuient. Occupons-nous d'abord des théories sur le mouvement; car peut-être est-ce à la fois une erreur et une impossibilité absolue que l âme soit le principe du mouvement, ou qu'elle soit douée de mouvement. On a démontré ailleurs que le mouvement ne pouvait être que de deux sortes, ou spontané ou acquis. Dans un vaisseau, par exemple, les matelots ne sont pas mus comme l'est le vaisseau lui-même : le vaisseau se meut par une cause quelconque; les matelots sont seulement dans la chose mue; et ceci est tellement vrai qu'ils n'ont point alors le mouvement propre à l'homme, la progression au moyen des jambes et des pieds. On distingue quatre espèces de mouvement: translation, changement, destruction, 10 accroissement, qui tous s'accomplissent dans un lieu. Il faut donc que l'âme ait un ou plusieurs de ces mouvements; et, de plus, qu'elle ait un lieu, tout comme eux. Si le mouvement lui est essentiel, elle sera mue par elle-même et non par accident, comme le sont la couleur et la longueur avec le corps dans lequel elles sont. Mais à son mouvement naturel peut se joindre un mouvement qu'elle reçoit d'une force extérieure, de même que son repos peut être ou naturel ou forcé. Si elle se meut en haut, elle se rapproche du feu; si elle se meut en has, elle a le mouvement même de la terre. De plus, elle ne peut donner an corps qu'elle meut que les mouvements qu'elle-même possède: et, comme le corps change de place par translation, il faut que l'âme puisse avoir aussi ce mouvement, ou tout entière, ou du moins dans ses parties. Mais alors ne pourra-t-on pas en conclure qu'elle a la faculté de rentrer dans le corps après en être sortie, et qu'ainsi les êtres morts ressuscitent? Si l'essence de l'âme est le mouvement, elle ne peut être mue du dehors qu'accidentellement, de même que ce qui est hon en soi et par soi ne l'est pas par un autre et pour un autre. Si quelque cause extérieure met l'âme en mouvement, on peut dire que ce sont surtout les objets sensibles. Ainsi l'âme a tout ensemble et un mouvement propre qui ne vient que d'elle, et nu mouvement acquis venant du dehors. Le mouvement spontané lui est essentiel. On a bien prétendu, il est vrai, que l'action du corps sur l'âme était tout-à-fait réciproque à celle que l'âme exerce sur lui : c'est l'opinion de Démocrite; mais cette explication n'explique pas plus 11 les choses que celle de Philippe, l'acteur comique, qui prétendait que la Vénus en bois faite par Dédale se mettait seule en mouvement pourvu qu'on y versât de l'argent fondu. Les sphères indivisibles de Démocrite communiquent tout de même le mouvement au corps, parce qu'il est de leur nature de ne jamais rester en place. Mais Démocrite aurait bien dû nous dire si ce sont elles aussi qui causent le repos. Ce n'est donc pas du tout ainsi que l'âme meut l'animal : elle le meut par la volonté et la pensée, ce qui est tout autre chose. La physiologie de Timée n'est guère plus satisfaisante. Si l'âme meut le corps, d'après lui, c'est qu'elle se meut elle-même. Elle est composée dans ce système des éléments; ses divisions répondent aux nombres harmoniques, et c'est là qu'elle puise le sentiment inné de l'harmonie : c'est par là qu'elle règle tous ses mouvements sur ceux de l'univers. Timée veut qu'elle décrive un cercle au lieu d'une ligne droite : il partage ce cercle en deux d'abord, puis en sept autres, qui correspondent aux sept translations du ciel. Mais d'abord est-il bien exact de faire de l'âme une grandeur? et l'âme sensible et passionnée, telle qu'elle est en nous, se rapproche-t-elle beaucoup de l'âme du monde? a-t-elle une translation circulaire? L'intelligence est une et continue, par la succession non interrompue des pensées. Mais est-ce comme la grandeur est continue, comme l'est le nombre? L'intelligence n'a pas de parties comme la grandeur ; et, si elle était grandeur, comment penserait-elle? Réduisez même les parties de l'âme à n'être que des points : alors le nombre en est infini. Et l'intelligence pourra-t-elle 12 les parcourir? Si ces parties ont de la grandeur, l'intelligence pensera alors une même chose un nombre infini de fois, taudis qu'au contraire son action paraît tout indivise et instantanée. S'il suffit à l'âme, pour comprendre une chose, dela toucher par une seule de ses parties, pourquoi Timée exige-t-il le contact du cercle entier qui la représente ? S'il n'y a qu'une de ses parties qui touche, le cercle pensera-t-il par celles qui ne touchent pas ? et s'il ne pense pas par celles qui ne touchent point, penserait-il même par celles qui touchent? L'intelligence, en effet, est ce cercle tout entier, et la pensée est le mouvement de l'intelligence, comme la périphorie est celui du cercle. Mais comme le mouvement du cercle est éternel, celui de l'intelligence ne le sera pas moins; et alors elle pensera éternellement quelque chose. Mais l'expérience nous démontre que toute pensée a ses limites, comme tout raisonnement, toute démonstration, toute définition a les siennes. Le raisonnement même, quand il ne conclut pas, ne revient pas pour cela sur lui-même : il ne se fait pas circulaire; il avance toujours eu ligne droite, et la circonférence de Timée revient nécessairement à son point de départ. De plus, comme alors ce mouvement circulaire se renouvelle, il faudra donc que la pensée aussi pense plusieurs fois la même chose. Ne peut-on pas dire d'ailleurs que la pensée donne l'idée du repos bien plutôt que celle du mouvement? Et alors quelle est la condition de l'intelligence, qui reçoit ainsi un mouvement en contradiction avec sa nature, et qui est de plus soumise à ce!te dure loi de ne pouvoir se délivrer jamais du corps auquel elle est unie? Timée 13 aurait bien fait de nous dire aussi la cause de ce mouvement circulaire du ciel. Il ne vient pas de l'âme qui le reçoit et le subit : il vient bien moins du corps, à plus forte raison. Le mouvement vaut-il mieux pour l'âme que le repos ? Il fallait nous l'apprendre; car Dieu ne peut lui avoir donné le mouvement, si ce n'était pour elle un état meilleur. Nous ne voulons pas, du reste, pousser plus loin ces objections qui appartiennent à un autre ouvrage que celui-ci; mais nous dirons, en général, que les erreurs de Timée, comme celles de tant d'autres, viennent de ce qu'il ne s'est pas assez occupé du corps. Est-ce qu'une âme quelconque peut entrer dans un corps quelconque? Est-ce que le corps ne doit pas être de telle ou telle façon? Les rapports qui lient l'âme au corps, l'une agent, l'autre patient, l'une moteur, l'autre mobile, ne sont pas du tout fortuits. C'est là imiter les Pythagoriciens, qui, dans leurs rêves, s'imaginent que la première âme venue peut s'unir à un corps quelconque. Chaque chose dans le monde a sa nature et sa forme propres. L'architecture ne fait pas les instruments de musique : l'art ne peut faire que ce qui lui est spécial ; et c'est à certaines conditions très précises que l'âme peut se servir du corps. Une opinion accréditée au moins autant que toutes celles qui précèdent, et dont nous avons déjà fait justice, dans nos ouvrages publiés, c'est que l'âme est une harmonie. Mais qu'est-ce que l'harmonie? C'est un rapport, une combinaison des choses mélangées. L'âme peut-elle bien être l'un ou l'autre? C'est l'âme qui, de l'aveu de tout le monde, produit le mouvement. Une harmonie peut-elle le produire? L'har- 14 monie peut s'entendre tout au plus du la sauté et des qualités du corps; et pour s'en convaincre, il suffit d'essayer d'appliquer rigoureusement à l'âme et à ses facultés tout ce qu'on peut dire de l'harmonie. Que de difficultés alors ne rencontre-t-on pas? ni comme rapport, ni comme combinaison, le mot harmonie ne peut être l'expression convenable pour l'âme. L'âme n'est pas un rapport au sens où l'est l'harmonie, quand il s'agit des grandeurs et dela juste proportion des parties. Elle n'est pas davantage une combinaison des parties dont le corps aussi se compose. Est-ce l'intelligence, est-ce la sensibilité qui est une combinaison de ce genre? Et quels sont alors leurs éléments? L'âme n'est pas davantage le rapport du mélange des parties matérielles. Le rapport des parties qui forment la chair, n'est pas le même que le rapport des parties qui forment les os. Ou bien faudrait-il aller jusqu'à soutenir qu'il y a plusieurs âmes dans le corps? On peut le demander à Empédocle qui tient beaucoup aussi à cette idée de rapport. Quand l'âme vient animer les membres du corps, est-elle donc déjà un rapport de ces membres? L'amour, à qui ce philosophe assigne un si grand rôle, formerait-il des unions si fortuites? ou plutôt ne forme-t-il pas des unions soumises à de justes rapports? Il est vrai qu'à ces questions on peut en opposer d'autres, et demander par exemple, pourquoi, si l'âme n'est pas le rapport des parties corporelles, la vie lui est ôtée en même temps qu'à ces parties. On peut encore demander, si l'âme n'est pas le rapport, ce qu'est ce quelque chose qui est détruit quand l'âme vient à défaillir. Mais il faut laisser de côté cette discussion : 15 ce que nous avons dit suffit pour montrer que l'âme n'est pas plus une harmonie qu'elle n'est un mouvement circulaire. Il ne vaut guère mieux soutenir d'une manière toute générale que l'âme se meut elle-même ; mais il faut ajouter qu'alors aussi elle se meut par accident, c'est-à-dire, avec la chose même qu'elle meut; car sans cette chose, qui est le corps, l'âme ne peut se déplacer dans l'espace. Le mouvement de l'âme ne doit pas d'ailleurs s'entendre des modifications qu'elle subit. S'attrister, se réjouir, espérer, craindre, penser, sentir, semblent autant de mouvements de lame ; et, à ce titre, l'on pourrait conclure que l'âme se meut. Il n'en est rien pourtant. L'âme, à vrai dire, ne s'indigne pas plus, ne se réjouit pas plus qu'elle ne tisse de la toile, ou qu'elle ne bâtit des maisons : il serait beaucoup plus exact de dire que c'est l'homme qui, par son âme, s'indigne, ou se réjouit. Il faut remarquer de plus, si l'on veut à toute force accorder un mouvement à l'âme seule, que, si parfois le mouvement vient réellement d'elle, parfois aussi il part du dehors pour venir jusqu'à elle. Il suffit de se rappeler ce qu'est la sensation, ou la mémoire appliquée aux perceptions des sens. En outre, les modifications, les altérations prétendues de l'âme appartiennent-elles bien certainement à l'âme elle-même? L'intelligence dans l'âme estime véritable substance, c'est-à-dire indestructible. L'affaiblissement même de la vieillesse ne l'atteint pas, comme on pourrait le croire. La vieillesse n'atteint que le corps. L'œil du vieillard, s'il restait conformé comme celui du jeune homme, verrait tout aussi bien. Pareillement, ce n'est pas 16 l'intelligence qui vieillit, ce n'est pas l'âme qui s'altère; c'est uniquement le coi;ps dans lequel elle est. Si la pensée se flétrit, c'est que quelque autre chose qu'elle à l'intérieur du corps se flétrit; niais le principe lui-même est absolument impassible. Penser, aimer, haïr, ne sont pas des modifications qui lui appartiennent en propre, elles ne sont qu'à la chose qui possède ce principe; et réduit à lui seul, le principe ne peut ni se souvenir ni aimer. C'était le corps périssable qui se souvenait, qui aimait. Quant à l'intelligence, elle est quelque chose de plus divin, elle est douée d'impassibilité. On serait donc porté à conclure, si l'on considérait les choses à fond, que l'âme n'a pas de mouvement spontané. Mais au milieu de toutes ces assertions, la plus déraisonnable de beaucoup est celle qui fait de l'âme un nombre qui se meut lui-même. Cette théorie réunit à elle seule les impossibilités de toutes les autres, et celles qui résultent de l'idée de mouvement, et celles qui résultent de l'idée de nombre. Comment comprendre en effet une unité qui se meut? Sans parties, sans différence aucune, qui l'a produite? Et comment vit-elle? Si elle est à la fois moteur et mobile, comme on le dit, n'est-ce pas là une différence, bien qu'on ne veuille pas admettre de différences en elle? Mais puisqu'on dit bien qu'une ligne engendre une surface, et qu'un point engendre une ligne, ou peut croire aussi que le mouvement des unités produira des lignes ; et dès lors le nombre de l'âme aura tout ensemble, et un lieu où il sera, et une position particulière dans ce lieu. D'un autre côté, si d'un nombre quelconque on retranche ou l'unité, ou un 17 nombre, il reste un nombre différent du premier. Mais pour l'âme il en est tout autrement : car dans les plantes, et même dans beaucoup d'animaux, on peut couper, diviser des parties, qui n'eu ont pas moins la même âme que celles dont on les a séparées. Mais ces unités dont l'âme est formée pour être un nombre, pareilles en tout aux corpuscules de Démocrite, doivent être mises en mouvement par quelque chose; et par suite, lame ne sera que moteur, et non pas, comme on nous l'affirme, nécessairement moteur et mobile tout ensemble. Si l'on réduit l'âme à être une unité, et non plus un nombre, elle ne pourra dès lors avoir, ainsi que le point, d'autre différence que la position, relativement aux autres parties. Si l'on veut distinguer entre les unités du corps et les points du corps, les unités prendront alors la place des points; et il pourra y avoir dans un même lieu une infinité d'unités, du moment qu'on admet qu'il peut y en avoir seulement deux. Si les points corporels forment le nombre de l'âme, ou si le nombre de ces points est l'âme, d'où vient que tous les corps sans aucune exception n'ont point d'âme? car tous ont des points, et même des points en nombre infini. Enfin comment est-il possible, dans cette théorie, que les âmes se séparent et se délivrent des corps, puisque les lignes ne se divisent pas réellement en points ? Toute l'erreur vient ici de ce qu'on regarde l'âme comme un corps à parties très ténues, et que c'est au sens de Démocrite que l'on comprend que l'âme meut le corps. Si l'on fait de l'âme un corps, il y a nécessairement alors deux corps dans un seul et 18 même lien; de même que si l'on eu fait un nombre, il y a nécessairement alors plusieurs points dans un seul point; ce qui est également impossible, à moins qu'on ne fasse du nombre de l'âme un nombre tout à part, et ne ressemblant en rien au nombre que forment les points du corps. Il faut remarquer de plus que, dans cette hypothèse, le corps se trouve mis en mouvement par un nombre. Cela ne revient-il pas à peu près aux petites sphères de Démocrite, qui donnent le mouvement à l'animal parce qu'elles-mêmes possèdent le mouvement? On pourrait opposer bien d'autres objections encore à cette théorie qui place le mouvement dans le nombre. Ce n'est point là sans aucun doute la définition essentielle de l'âme, ce n'en est pas même la définition accidentelle. On peut s'en convaincre par un procédé tout-à-fait analogue à celui que nous avons indiqué, pour faire voir que la métaphore de l'harmonie n'expliquait pas du tout la nature de l'âme. Essayez d'appliquer l'idée de nombre aux diverses modifications de l'âme, au raisonnement, à la sensibilité, au plaisir, à la douleur; et vous verrez quel parti vous tirerez d'une si fausse définition. Ainsi les trois principales déterminations de l'âme, d'après sa mobilité, sa ténuité, son immatérialité, nous ont offert des difficultés et des contradictions insurmontables. Reste à réfuter cette dernière opinion, qui veut retrouver dans l'âme un composé des éléments. Du moment qu'on prétend que l'âme connaît tout, et qu'il n'y a que le semblable qui puisse connaître le semblable, on se crée des impossibilités dont on ne pourra se débarrasser. Une première conséquence qu'on ne 19 peut éviter, c'est qu'alors l'âme est en quelque sorte les choses elles-mêmes. Mais est-ce que les choses sont toutes seules au monde? et que fait-on des composés qu'elles peuvent former entre elles, et qui sont en nombre infini? Admettons pourtant que lame connaisse tous les principes spéciaux des choses, comment connaîtra-t-elle l'ensemble même d'une chose, nue chose totale, Dieu, l'homme; ou, en descendant plus has, la chair, l'os? Car ce n'est pas au hasard que les choses se forment; il y a un certain rapport entre les éléments qui les composent. Empédocle lui-même a reconnu cette nécessité quand il explique à sa façon comment les os se sont formés : « La terre fertile, en ses vastes creusets, reçut deux des huit parties de la splendeur liquide; quatre furent attribuées à Vulcain, et les os devinrent blancs. » Ainsi donc ce n'est point assez, dans ce système, que les éléments soient dans l'âme; il faut, en outre, qu'elle ait en elle et les rapports et toutes les combinaisons de ces éléments. Si le semblable seul peut connaître le semblable, est-ce à dire que, pour que l'âme connaisse la pierre ou l'homme, elle doit avoir en elle l'homme ou la pierre? Mais peut-on sérieusement poser une telle question et y répondre? Et ceci pourrait s'étendre à des choses toutes morales, au lieu de choses matérielles. L'âme a-t-elle besoin d'avoir en elle le bien et le mal pour connaître l'un et l'autre? Mais quand on dit que l'âme a en elle les choses, les êtres, de quels êtres, de quelles choses veut-on parler? Être signifie substance; mais il signifie également quantité, qualité, ou telle autre catégorie, suivant les divisions admises par nous. 20 L'âme sera-t-elle formée de toutes les catégories? De plus, les substances seules ont des éléments au sens où on le comprend ici: alors comment connaîtra-telle le reste ? Ou bien sera-t-elle quantité, qualité, etc., tout comme elle est substance? Car les éléments de la quantité, quoi qu'on fasse, ne rendront jamais qu'une quantité, fin outre, tout en soutenant que le semblable seul peut connaître le semblable, on n'en affirme pas moins, contradiction énorme, que le semblable ne peut être affecté par le semblable, comme si sentir ce n'était pas être affecté. Le semblable connaît si peu le semblable, que tout ce qu'il y a de terre dans le corps des animaux, os, nerfs, poils, ne sent absolument pas du tout, et ne sent pas les semblables que, si l'on en croyait cette théorie, il devrait parfaitement sentir. D'autre part, si le semblable connaît le semblable, que de choses ignorera le principe, pour quelques unes qu'il saura! C'est là ce qui fait du dieu d'Empédocle le moins intelligent des êtres; lui seul, par exemple, ne connaît pas la discorde que tous les êtres mortels connaissent pourtant, puisque chacun d'eux est composé de tous les éléments. Ajoutez que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont formées nécessairement d'un ou de plusieurs éléments, et que tous cependant n'ont point «l'âme. Quel est d'ailleurs le principe qui ramènera tous les éléments divers à l'unité? Et ce principe n'est-il pas, sans comparaison, la partie la plus importante? Mais ici ce principe supérieur n'est-il pas l'âme? n'est-il pas l'intelligence, en dépit des assertions de ces philosophes qui font des éléments les premières de toutes les choses? — Une critique gé- 21 nérale qu'on peut adresser à toutes ces théories, c'est qu'elles ne parlent pas de l'âme dans toute son extension, de toutes les âmes; elles bornent l'âme à la sensibilité et au mouvement. Mais tous les animaux ne jouissent pas du mouvement, et nous en connaissons qui restent toujours en place. Les plantes n'ont ni locomotion ni sensibilité, et n'en vivent pas moins. Il est, en outre, une foule d'animaux qui ne possèdent pas la pensée. Ces théories ont donc le tort de ne rendre compte ni de toutes les espèces d'âmes, ni même d'une âme prise seule et tout entière. C'est une erreur analogue qu'on trouve dans les vers prétendus Orphiques : « L'âme vient de l'univers entrer dans les animaux quand ils respirent, apportée par les vents. » Mais les plantes, qu'en fait-on? Elles ne respirent pas. Certains animaux ne respirent pas davantage; ils ont une âme pourtant. Mais les auteurs de ces assertions ne se sont guère inquiétés de tous ces faits. Qu'est-il besoin, en outre, de composer l'âme de tous les éléments pour expliquer la connaissance en elle? Est-ce que souvent il ne suffit pas d'un seul des deux termes de l'opposition pour connaître les deux? Du moment qu'on connaît le droit, ne connaît-on pas aussi à la fois et le droit lui-même et le courbe? — Sans former précisément l'âme avec les éléments, d'autres ont soutenu que l'âme était répandue dans l'univers entier, et c'est peut-être en ce sens que Thalès affirmait que le monde est plein de dieux. Mais cette opinion n'est pas non plus sans difficultés. L'âme, tout en étant dans l'air et dans le feu, n'y produit pas cependant d'animal, comme elle en produit dans les 22 mixtes. Dans l'air et dans le feu, l'âme paraît supérieure à ce qu'elle est dans les animaux; mais il faudrait dire d'où lui vient cette supériorité. L'air et le feu pourront-ils être appelés des animaux parce qu'il y a une âme en eux? Et, s'ils ont une âme, ne pas les appeler des animaux, n'est-ce pas également absurde? Si ces philosophes accordent une âme à l'air et au feu, c'est sans doute parce que dans ces deux éléments le tout est parfaitement homogène aux parties. Accorderont-ils alors que l'âme soit tout-à-fait homogène aux parties du corps? Mais si les parties de l'âme sont dissemblables, il en résulte que telle de ses parties existera et que telle autre n'existera pas. Ainsi. ou toutes les parties de l'âme sont semblables, ou bien il faut renoncer à dire qu'elle est répandue dans chacune des parties de l'univers. Concluons donc que l'âme n'est pas formée des éléments, et qu'elle ne se meut pas au sens où on l'a dit. Reste toujours à savoir si la pensée, la sensation, la locomotion, qui appartiennent bien certainement à l'âme, se produisent par l'âme tout entière ou par une de ses parties. Chacun de ces phénomènes se rapporte-t-il à toute l'âme, ou seulement à une partie spéciale? La vie est-elle dans une seule de ses parties, ou dans plusieurs, ou dans toutes? Est-elle produite par une autre cause que l'âme ? Quelques philosophes admettent la divisibilité de l'âme; selon eux, telle partie pense, telle autre désire. Mais qui maintient et unit toutes ces parties, si naturellement l'âme est divisée? Ce n'est pas le corps apparemment; car loin de maintenir l'âme, il est bien plutôt maintenu par elle ; une fois qu'elle l'a quitté, il cesse 23 de respirer et n'est bientôt plus que corruption. Le principe qui unit les parties, c'est surtout l'âme; mais ce principe lui-même est-il un? ou a-t-il aussi des parties? S'il est un, autant vaut alors accorder du premier coup l'unité à l'âme; s'il est divisé, revient alors la première question : Qui uuit ses parties? Du moment qu'on admet des parties dans l'âme, on peut se demander encore si chacune d'elles unit quelques parties du corps ; mais il semble bien que cela est impossible. Quelles parties du corps l'intelligence, par exemple, peut-elle unir? Les plantes et certains insectes vivent tout aussi bien après avoir été divisés : chacune des parties a même dans ces derniers la locomotion et la sensibilité, au moins durant quelque temps. Dans chaque portion, l'âme se retrouve donc avec toutes les parties qui la composent; elle paraît divisible tout entière, et non point par parties séparables les unes des autres. Pour les plantes, on peut dire que le principe qui les fait vivre est bien aussi une sorte d'âme; et l'âme qu'elles ont est la seule qui leur soit commune avec les animaux. Cette âme qu'ont les plantes peut être séparée de la sensibilité, mais il n'y a pas d'être sensible qui ne la possède aussi. 24 LIVRE DEUXIÈME.
DÉFINITION DE L'ÂME .- NUTRITION. — SENSIBILITÉ. Maintenant que nous connaissons les opinions de nos devanciers, reprenons la question comme si elle n'avait point été traitée, et commençons par définir l'âme en en donnant la notion la plus générale possible. Posons d'abord ce principe que la substance, l'un des genres de l'être, implique nécessairement trois éléments : en premier lieu, la matière, qui n'est par elle même rien de spécial; puis la forme, l'espèce, qui détermine le nom particulier de chaque chose ; et enfin le composé qui résulte de ces deux premiers éléments, et qui est une chose réelle, individuelle, comme toutes celles que nous offre la nature. La matière n'est qu'une simple puissance, pouvant recevoir indifféremment l'un et l'autre contraire : la forme, l'espèce, est une réalité achevée, complète, entière, une véritable entéléchie. Mais ici même cette entéléchie peut s'entendre de deux façons, de même que la science peut se dire et de celle qui sait positivement les choses, et de celle qui observe et cherche à les savoir. Les substances sont surtout les corps naturels, qui sont les principes de tous les autres que l'art peut former. Parmi les corps naturels, les uns ont la vie, les autres en sont privés; et la vie, selon nous, consiste à pou voir se nourrir, se développer et mourir. Tout corps naturel est donc substance, mais substance composée des trois éléments que nous venons d'indiquer. Le corps ne sau- 25 rait être pris pour l'âme; car dans le composé formé des deux, le corps joue bien plutôt le rôle de matière, de sujet. Si donc l'âme est substance, et elle l'est certainement, elle ne peut l'être qu'à ce titre d'être la forme d'un corps naturel qui a la vie en puissance, qui est capable de vivre. Mais comme toute substance est une réalité achevée, parfaite, entière, une entéléchie, il faut transformer cette première définition, et admettre que l'âme est l'entéléchie du corps tel que nous venons de le dire ; elle en est l'achèvement, la perfection, la réalisation complète. De plus nous avons reconnu à ce mot d'entéléchie deux sens analogues à ceux qu'on peut donner au mot de science. L'entéléchie est d'abord évidemment comme la science acquise et parfaite, car la veille et le sommeil ont lieu pour l'âme comme pour le corps. La veille répond à cette science qui observe et qui étudie. Le sommeil représente davantage une faculté qu'on possède, mais qui n'agit pas. Or, la science comprise en ce dernier sens est génériquement antérieure à l'autre; et c'est là le vrai sens dans lequel il faut comprendre l'entéléchie. Ainsi donc la définition se transforme encore, et l'on doit dire que 26 l'âme est l'entéléchie première, la réalisation supérieure d'un corps naturel capable de vivre. Mais ceci même ne suffit pas; il faut, pour que le corps vive, qu'il ait des organes, lesquels peu vent être d'ailleurs excessivement simples, comme le pétale, le péricarpe dans la plante, les racines même, qui pour le végétal font les fonctions de bouche. Transformons donc encore une fois la définition, et, pour lui donner la forme la plus générale possible, disons que l'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel doué d'organes. Une conséquence qu'il convient de tirer tout d'abord de ce qui précède, c'est qu'il ne faut pas demander si l'âme se confond avec le corps. L'âme ne se confond pas plus avec le corps que la cire ne se confond avec l'empreinte qu'elle reçoit, et pas plus, en général, que la matière d'une chose quelconque ne se confond avec la chose même; car l'un, l'être, la chose individuelle et réelle, doivent surtout se comprendre au sens que nous donnons ici à l'entéléchie. — Voilà donc la définition de l'âme, et c'est une essence que la raison seule connaît; c'est l'essence propre de l'être animé, comme l'essence pour tout objet, même pour les objets formés par l'art humain, une hache par exemple, c'est d'être ce qu'ils sont. Cette essence une fois enlevée, la chose n'existe plus que par une pure homonymie, une vaine et stérile dénomination. Mais seulement l'âme n'est pas essence pour un corps tel que la hache, elle est toujours l'essence d'un corps forme parla nature, et ayant en lui le principe du mouvement et du repos. Ceci peut s'étendre encore et s'appliquer aux parties mêmes de l'être animé. Si l'animal était l'œil, l'âme de l'animal serait la vue, qui est l'essence même de l'œil. Et en effet, la vue une fois absente, l'œil n'est plus un œil, si ce n'est, comme nous venons de le dire, par simple homonymie. L'œil de pierre, ainsi que l'œil en peinture, est aussi un œil. D'une partie de l'animal, transportons ceci à une faculté, à la sensibilité; transportons-le même à la vie tout entière, et nous aurons une idée exacte de l'âme. L'être capable de vivre est 27 celui qui possède une âme, et non celui qui l'a perdue. Ainsi la faculté de couper est l'essence de la hache, la vision l'essence de l'œil; la veille pour le corps est sa véritable essence, sa réalité complète, achevée, son entéléchie. Le corps n'est qu'une puissance, l'âme vient le compléter; et, en s'y joignant, elle forme l'animal, composé de ces deux indispensables éléments. Mais si l'âme n'est pas le corps, il est tout aussi évident qu'elle ne peut être séparée du corps, non plus qu'aucune de ses parties, si toutefois l'âme a des parties; et si des parties peuvent jamais être à elles seules des réalités complètes, entières, des entéléchies. Mais si l'âme n'est jamais séparée du corps, en est-elle l'entéléchie, la perfection, comme le marin est l'âme du vaisseau qu'il dirige? Question obscure, et que nous n'approfondirons pas ici, n'ayant voulu donner de l âme qu'une esquisse plutôt qu'une définition complète. Mais la clarté pour la raison peut sortir même de choses obscures, auxquelles l'esprit s'est d'abord attaché parce qu'elles étaient les plus apparentes ; nous pouvons donc aller plus loin dans l'étude de l'âme. La vraie définition doit faire connaître non seulement l'existence de la chose, mais aussi sa cause. C'est, il est vrai, une condition dont on ne s'inquiète pas toujours; et l'on définit souvent les choses comme on définit la quadrature, quand on dit que la quadrature consiste à trouver une figure ayant ses angles droits et ses côtés égaux, qui soit égale à une figure dont les côtés sont inégaux. La véritable définition est celle qui établit que la quadrature est la découverte d'une moyenne proportionnelle; car 28 cette définition donne la cause de la quadrature. Voyons donc la cause même de l'âme. L'être animé se distingue de l'être inanimé en ce qu'il vit; et il y a vie du moment qu'il existe l'une des quatre facultés suivantes : l'intelligence, la sensibilité, la locomotion et la nutrition, en comprenant dans la nutrition le dépérissement tout aussi bien que l'accroissement. De ceci il résulte qu'on peut dire des plantes qu'elles vivent. Elles vivent et se développent haut et bas par la force qu'elles ont en elles; et tant qu'elles se nourrissent, elles vivent. Elles n'ont pas d'autre faculté de l'âme que la nutrition ; car la nutrition peut exister indépendamment de toute autre fonction, tandis que les autres fonctions ne peuvent exister qu'avec elle. La nutrition suffit donc pour constituer l'être vivant. C'est la sensibilité qui constitue véritablement, primitivement l'être animé, l'animal. La locomotion ne lui est pas nécessaire; car il y a des animaux qui ne changent jamais de place, et dont on ne peut pas dire qu'ils sont simplement des êtres vivants. Dans la sensibilité, ou peut distinguer un sens qui appartient sans exception à tous les animaux, c'est le toucher, qui s'isole de tous les autres sens, comme la nutrition s'isole de toutes les autres fonctions. La nutrition est donc une partie de l'âme qui se retrouve dans tous les êtres vivants y compris les plantes; le toucher est un sens qui se retrouve dans tous les animaux. Nous expliquerons plus tard chacun de ces faits. Bornons-nous à dire ici que l'âme est le principe des quatre facultés énumérées et qu'une seule suffit pour la définir : la nutrition, la sensibilité, la pensée et le mouvement. Mais ces fa- 29 cultés sont-elles chacune l'âme tout entière? ne sont-elles que des parties de l'âme ? et si elles sont des parties, ne peuvent-elles être isolées que par la raison ? ou sont-elles séparables aussi matériellement? Ce sont là des questions dont les unes sont aisées à résoudre, et dont les autres sont extrêmement difficiles. Il y a des plantes qu'on peut couper, diviser sans que la vie cesse dans les parties ainsi séparées les unes des autres. L'âme se retrouve tout entière dans chacune d'elles. Même phénomène dans certains insectes; chaque partie coupée est douée encore de sensibilité et de locomotion. Du moment qu'elles ont la sensibilité, elles ont nécessairement aussi l'imagination et le désir ; car le désir se retrouve là où il y a plaisir et douleur, et la douleur et le plaisir se retrouvent là où il y a sensibilité. S'il y a dans ces êtres sensibilité, locomotion, y a-t-il aussi et par suite intelligence? C'est ce qu'on ne saurait affirmer; car l'intelligence est un tout autre genre d'âme qui diffère de tout le reste, comme l'éternel diffère du périssable. Quant aux autres parties de l'âme, les faits démontrent qu'elles ne sont pas séparables ; mais elles sont très distinctes aux yeux de la raison, qui ne peut point confondre la sensation et la pensée. Ajoutez que parmi les animaux les uns ont les quatre facultés de la vie; les autres en ont plusieurs; d'autres enfin n'en ont qu'une seule. Même remarque pour les sens. Certains animaux les ont tous; ceux-ci n'en ont que quelques uns; ceux-là n'en ont qu'un seul, l'indispensable, le toucher.—L'âme est donc le principe par lequel nous vivons, sentons, pensons; elle est raison et forme; elle n'est ni matière ni sujet, et elle ne doit 30 pas plus se confondre avec le corps que la science ne se confond avec la faculté qui sait, et la santé avec le corps qui nous la donne quand il est dans telle disposition. On ne peut donc point du tout rejeter la définition présentée plus haut et faire du corps la réalisation complète, l'achèvement, l'entéléchie de l'âme ; c'est l'âme tout au contraire qui est la perfection suprême, l'entéléchie du corps. Aussi a-t-on toute raison de soutenir que l'âme ne peut être sans le corps, et que pourtant elle n'est pas un corps. Elle n'est pas le corps, elle est quelque chose du corps; elle est dans le corps, et dans le corps fait de telle façon très spéciale, et non pas du tout dans un corps quelconque, comme l'ont dit quelques philosophes antérieurs. Ici la loi est parfaitement précise. Pour qu'il y ait réalité parfaite, entéléchie pour quoi que ce soit, il faut une puissance déterminée et une matière propre à la recevoir ; hors de là, la chose ne peut être ni achevée ni complète. Aux quatre facultés de l'âme on peut ajouter le désir, les appétits qui sont inséparables de la nutrition et de la sensibilité. Le désir lui-même n'est que l'appétit de ce qui fait plaisir, et la sensibilité implique toujours un objet ou agréable ou pénible. Le toucher est, on peut dire, le sens de l'alimentation dans les animaux, et voilà pourquoi tous le possèdent ; c'est que tous se nourrissent. Cela aussi nous explique fort bien comment la saveur, qui tient de si près à la nourriture de l'animal, est sentie par un sens analogue à celui du toucher. C'est que la saveur est l'assaisonnement de ce qui apaise la faim et la soif, tandis que le sou, la couleur, l'odeur, ne 31 contribuent absolument en rien à nourrir l'animal. La locomotion est enfin répartie entre les êtres animés comme le sont la sensibilité, la pensée. Les uns la possèdent, les autres en sont privés. —Ceci prouve que la définition de l'âme, telle que nous l'avons donnée, ne peut être générale et commune que comme l'est la définition de la figure en géométrie. Il n'y a point dans cette science de figures autres que le triangle et toutes celles qui suivent le triangle. Vouloir trouver une notion qui s'appliquât à toutes en général, sans s'appliquer à aucune en particulier, serait absurde ; il ne le serait pas moins de vouloir trouver une notion de l'âme qui s'appliquât à toutes les espèces d'âmes en général, sans s'appliquer à aucune particulièrement. Mais il en est à un autre égard des facultés diverses de l'âme comme pour les figures géométriques. Si le carré implique le triangle, la sensibilité implique la nutrition, etc. Ainsi pour tous les êtres spéciaux, il faudra rechercher l'âme spéciale qui leur appartient, qu'il s'agisse d'une plante, d'une bête ou d'un homme. Quant à la série régulière des facultés, voici comment elles se subordonnent entre elles: la nutrition d'abord, sans laquelle les autres ne sont pas; la sensibilité, dans laquelle le toucher peut s isoler des autres sens, puisqu'il y a des animaux qui n'ont ni la vue, ni l'ouïe, ni l'odorat; la locomotion, qui suppose toujours la sensibilité, mais dont la sensibilité peut fort bien se passer; enfin l'intelligence, qui suppose nécessairement toutes les facultés inférieures. La notion commune qui conviendra le mieux à toutes ces facultés, est aussi celle qui conviendra le mieux à l'âme. 32 Pour étudier régulièrement les facultés, il faut se rendre bien compte de ce qu'est chacune d'elles, et voir ensuite les conséquences nécessaires de cette première et essentielle donnée. Mais avant d'étudier la faculté en soi, ne faut-il pas étudier préalablement l'acte et la fonction? et savoir, par exemple, pour bien connaître la sensibilité et l'intelligence, ce que c'est que sentir et penser? Ne faut-il pas, même encore avant les actes, étudier les objets de ces actes, et se demander ce que c'est que l'objet sensible, l'objet intelligible?—Commençons par la faculté de nutrition, qui se confond aussi avec la génération, but et emploi de la nourriture. L'acte le plus naturel aux êtres vivants, c'est de produire un être pareil à eux : l'animal, un animal ; la plante, une plante, etc. Ils ne s'en abstiennent que s'ils sont mutilés, infirmes, incomplets. C'est par là que tous participent autant qu'ils le peuvent de l'éternel et du divin. C'est là le but qu'instinctivement ils poursuivent et pour lequel la nature les a faits. Périssables et passagers comme ils le sont, ils ne sauraient individuellement rester uns et identiques; la perpétuité ne saurait leur demeurer en propre, ils sont tous destinés à périr. Mais l'éternel leur appartient dans une certaine mesure ; et si ce n'est pas l'être même, l'individu qui subsiste, c'est presque lui, c'est son espèce, dont il contribue pour sa part à entretenir et à perpétuer la durable unité. L'âme est bien la cause et le principe du corps vivant, dans les trois acceptions diverses qu'on peut donner à l'idée de cause; elle est cause motrice, principe du mouvement; elle est cause finale; et enfin elle est essence. 33 L'essence des êtres qui vivent, c'est la vie, et c'est l'âme qui la leur donne. De plus, l'âme est si bien cause finale, que c'est en vue d'elle que la nature fait tout ce qu'elle fait dans les animaux, et même dans les plantes. Tous les corps dans la nature ne sont que les instruments de l'âme. Enfin, c'est l'âme qui est le principe de la locomotion; et sans elle, l'altération, qui est, soit l'accroissement de l'être et son dépérissement, soit la sensation qu'il éprouve, ne serait point possible, pas plus que la vie ne le serait sans la nutrition. Disons en passant qu'Empédocle a bien méconnu les fonctions de l'âme dans les plantes, quand il a expliqué leur accroissement eu has par leur rapport à la terre, qui a par nature ce mouvement, et leur accroissement en haut par leur rapport au feu, qui, lui aussi, a ce mouvement non moins naturel. Le haut et le bas ne sont pas pour tous les êtres ce qu'ils sont pour l'univers. Les racines dans les plantes représentent la tête pour les animaux, si c'est par les fonctions qu'il faut comparer les organes. En outre, la terre et le feu, malgré leurs tendances si contraires, se trouvent réunis et maintenus par quelque cause apparemment dans les plantes; et cette cause que peut-elle être, si ce n'est celle qui fait qu'elles croissent et se nourrissent ? Il n'est pas plus vrai, comme l'ont dit d'autres philosophes, que le feu soit la seule cause de la nutrition. Il y contribue sans aucun doute ; mais la cause absolue de la nutrition, c'est l'âme bien plutôt que le feu. Il est vrai que c'est le seul de tous les éléments qui paraît se nourrir et s'accroître ; et de là on a bien pu supposer qu'il était le principe unique du développement dans les 34 êtres ; mais il faut dire aussi qu'il s'accroît à l'infini, sans terme ni mesure, tant qu'il trouve du combustible; tandis que dans les corps formés par la nature, il y a une certaine limite, un rapport de grandeur et d'accroissement que l'âme seule détermine et non point le feu. — Mais revenons à l'alimentation. Quelle est l'idée vraie qu'on doit se faire de la nourriture? Est-ce un contraire qui agit sur un contraire, avec toutes les conditions requises pour une action de ce genre? Ou bien est-ce, comme le soutiennent quelques philosophes, le semblable qui nourrit le semblable? Ces deux opinions sont en partie vraies, en partie fausses. Il faut distinguer dans la nourriture, selon qu'elle est digérée ou qu'elle ne l'est pas. Le corps est à l'égard de la nourriture comme l'ouvrier à l'égard de la matière ; il la modifie, et en un sens il n'en est pas modifié. Quand la nourriture n'est pas digérée, et sous cette forme on l'appelle aussi nourriture, c'est le contraire qui nourrit le contraire; mais quand elle est digérée, c'est le semblable qui nourrit et accroît le semblable. Il ne faut point du reste confondre accroître et nourrir. Si la nourriture accroît le corps, c'est qu'elle est elle-même une quantité; mais si elle le nourrit, c'est qu'elle est une certaine essence et qu'elle a certaines qualités. L'être conserve son essence, il subsiste tout autant de temps qu'il peut se nourrir. La nourriture n'engendre pas l'être qu'elle nourrit; elle est en quelque sorte l'être nourri lui-même qui ne fait que se conserver, mais qui ne se produit point. Ainsi la nutrition pourrait être appelée cette faculté de l'âme qui conserve l'être qui la possède; et de là 35 vient que ce qui est privé de nourriture ne peut vivre. Il faut donc, dans la nutrition, distinguer trois choses: ce qui nourrit, l'être nourri, ce par quoi il est nourri; l'âme, le corps, l'aliment. Mais comme il convient de qualifier les choses par la fin qu'elles poursuivent, et que la fin ici est de produire un être pareil à soi, la première espèce d'âme, l'âme nutritive, sera celle qui fait que l'être engendre un être semblable à lui. Ainsi deux termes sont nécessaires pour nourrir un être, l'âme et l'aliment, comme il en faut deux pour conduire un vaisseau, la main et le gouvernail; l'un moteur et mobile, l'autre moteur seulement. Ajoutons que la nutrition, ou plutôt la digestion, ne peut avoir lieu sans chaleur, et que voilà pourquoi tous les êtres animés sont doués de chaleur. Nous n'avons voulu du reste tracer ici qu'une simple esquisse de la nutrition; les détails et les éclaircissements viendront dans les ouvrages spéciaux, où ils seront mieux placés. Après la nutrition, parlons de la sensibilité, et parlons-en de la manière la plus générale. La sensation est, on peut dire, une sorte d'altération subie par l'animal, c'est une modification qu'il éprouve. Mais on a soutenu d'abord que le semblable seul pouvait être affecté par le semblable. Nous avons discuté déjà cette opinion, et nous avons montré ce qu'elle a de vrai et de faux, dans nos études générales sur l'action et la passion. On demande en outre pourquoi il n'y a pas sensation des sensations elles-mêmes, et pourquoi la sensation ne peut avoir lieu qu'avec les objets extérieurs, tandis que le feu, la terre et les autres éléments, qui sont déjà au-dedans de l'animal, 36 n'en sont pas moins perçus au dehors par lui. La raison de cette différence tient à ce que la sensibilité par elle-même n'est pas vraiment en acte, elle est simplement en puissance. Tel est le combustible qui ne brûle pas tout seul et sans la chose qui doit le faire hrûler. Il a beau être capable de brûler, il ne brûle qu'autant que le feu réel, effectif, en entéléchie, vient agir sur lui. Il faut donc distinguer soigneusement cette double nuance dans le mot de sensation. D'un être endormi qui pourrait voir et entendre s'il était éveillé, nous disons qu'il sent, tout comme nous le disons de l'être qui sent et qui agit en toute réalité. D'une part, cependant, la sensation n'est qu'en puissance, tandis que de l'autre part elle est dans sa pleine activité. On peut donc ici identifier ces trois idées : souffrir, être mû, être en acte ; elles sont pareilles au point de vue de la sensation. Il en résulte que, dans le fait complexe de la sensibilité, c'est bien le semblable qui est affecté par le semblable ; mais il est également vrai que c'est le dissemblable qui l'est aussi. Tant que l'être souffre et éprouve quelque chose de l'être qui agit du dehors sur lui, il est dissemblable; mais après qu'il a souffert, il est semblable, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. Il faut également distinguer pour la puissance elle-même, comme on le fait entre la puissance et l'acte réel, parfait, l'entéléchie. Jusqu'ici nous n'avons employé le plus souvent ces termes que dans un sens absolu. Voici cependant une nuance fort importante dans la puissance. On dit d'un homme quelconque, et par cela seul qu'il appartient à l'espèce humaine, qu'il est susceptible de science, qu'il peut savoir, 37 qu'il est savant; mais on le dit également d'un homme qui est savant en toute réalité, qui possède une science spéciale, celle de la grammaire par exemple. Dès qu'il le voudra, celui-ci pourra exercer cette science, l'appliquer, si rien du dehors Devient y faire obstacle. Peut-on dire que ces deux hommes soient capables au même titre? la puissance est-elle la même chez les deux? peuvent-ils également l'un et l'autre? Non, sans doute; l'un est vraiment savant parce que l'étude l'a déjà modifié profondément et l'a fait passer d'un état bien différent à l'état où il est. L'autre n'est savant que parce qu'il a une certaine organisation qui le rend capable de le devenir, quand il voudra bien agir de certaine façon. Les deux nuances que nous distinguons dans l'idée de puissance, il faut également les reconnaître dans l'idée de souffrir. Souffrir signifie tantôt la destruction de l'être qui souffre, et tantôt au contraire sa conservation, son parfait développement, sa transition de la simple puissance à l'acte complet, achevé, à l'entéléchie. Ainsi un être qui possède la science vient à percevoir par l'observation un objet de cette science; c'est bien, si l'on veut, une altération qu'il subit, mais au fond c'est bien plutôt un simple développement de l'être sur lui-même, un pas, un acheminement vers sa parfaite réalité, son entéléchie. L'être pensant, quand il pense, n'est pas altéré certainement, pas plus que le constructeur de vaisseaux n'est altéré quand il construit. Passer de la puissance à l'acte parfait n'est pas pour un être savant un apprentissage. C'est un simple complément qu'il se donne, une réalisation de ce qu'il peut. Même pour 38 l'être qui réellement apprend, qui, sans avoir préalablement la science, la reçoit de celui qui la possède, on ne peut pas dire qu'il souffre, qu'il soit altéré; ou tout au moins doit-on faire une grande différence entre une altération qui conduit l'être à la privation de ce qu'il a, et cette altération tout autre qui le conduit à l'acquisition de ce qu'il n'a pas. Le premier changement de ce genre remonte dans l'être jusqu'à son origine même, jusqu'à sa naissance; car celui qui l'engendre lui donne déjà en quelque sorte la science et la sensibilité. On pourrait distinguer dans l'acte les nuances que nous avons signalées dans la science ; mais il faut bien remarquer ici que ce qui produit l'acte dans la sensation vient toujours du dehors. C'est un objet vu, entendu, en un mot un objet sensible. La sensation ne s'applique jamais qu'à des choses particulières; la science, au contraire, s'applique aux choses universelles, aux universaux, qui sont en quelque sorte dans l'âme elle-même. Ceci nous fait bien comprendre pourquoi l'on ne sent pas quand on le veut, tandis que l'on pense spontanément. C'est là d'ailleurs une très grave question que nous retrouverons l'occasion d'éclaircir davantage. Ajoutons encore que la puissance peut s'entendre aussi en deux sens parfaitement distincts. Nous disons également d'un enfant qu'il peut être général d'armée, comme nous le disons d'un homme qui aurait vraiment l'âge de l'être. Toutes ces nuances signalées par nous ne sont pas représentées dans la langue par des mots spéciaux ; elles sont bien réelles cependant. Mais nous avons dû nous contenter des expressions reçues, sauf à 39 faire nos réserves. La seule conclusion à laquelle nous tenions ici, c'est que pour se faire une juste idée de la sensibilité, il faut admettre que l'être qui sent est en puissance à peu près comme est en réalité, en entéléchie, l'être senti. Avant de sentir, il est dissemblable : une fois qu'il a senti, il est devenu presque semblable à l'être senti. Maintenant que nous savons ce que c'est en général que la sensibilité, étudions l'objet sensible avant de passer à l'étude de chaque sens en particulier. Objet sensible a trois acceptions différentes : les deux premières où l'objet est vraiment senti en soi, la troisième où il ne l'est que par accident. La première classe des objets sensibles se compose des objets propres de chaque sens : le son pour l'ouïe, la couleur pour la vue, la saveur pour le goût. Le sens ne se trompe jamais sur cet ordre d'objets, et il distingue sans aucune erreur possible ce qui n'appartient qu'à lui seul. Objet sensible s'applique aussi à ces objets d'un tout autre ordre, qui n'appartiennent plus à tel ou tel sens, mais qui sont communs à tous : je veux dire le mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur. Ce sont là des objets que perçoivent tous les sens, ou du moins que plusieurs sens peuvent discerner parfaitement; et le mouvement peut être perçu par le toucher tout aussi bien que par la vue. Enfin, dans la dernière acception, on dit d'un objet qu'il est sensible par accident, lorsque c'est indirectement et à propos de la sensation qu'on le perçoit. Je vois un objet blanc s'approcher, je reconnais que c'est le fils de Diarès. Cette dernière notion est purement accidentelle; c'est la sensation 40 du blanc qui me l'a donnée : je dis que le fils de Diarès n'est pour moi un objet sensible que par accident. Quoi qu'il en soit de la vérité de ces distinctions, l'expression de sensible doit surtout s'appliquer aux objets propres des sens, aux objets que chacun d'eux perçoit essentiellement. Ce à quoi s'applique la vue est un objet visible. Le visible se compose à la fois de la couleur de l'objet, et de cette autre portion de l'objet que la raison seule conçoit et qui n'a pas de nom spécial. Ceci deviendra plus clair par la suite de cette discussion; mais on peut dire que le visible, c'est la couleur, et la couleur est ce qui est sur l'objet visible en soi. L'objet visible en soi est celui qui porte en lui-même la cause qui le rend visible aux sens, et non pas à la seule raison. Toute couleur met en mouvement le diaphane, et c'est là sa nature spéciale. Il n'y a donc pas d'objet visible sans lumière ; sans lumière il n'y a pas de couleur visible. Qu'est-ce donc que la lumière? D'abord j'appelle diaphane ce qui est visible, non pas en soi, mais avec le secours d'une couleur étrangère. Tel est l'air, par exemple, telle est l'eau, et beaucoup de corps solides. En soi l'air et l'eau ne sont pas diaphanes à proprement parler; ils ne le sont que parce que la nature qui est en eux est analogue à celle du corps éternel supérieur, du ciel. La lumière est l'acte du diaphane en tant que diaphane; car là où le diaphane n'est qu'en puissance, il peut y avoir obscurité. La lumière est en quelque sorte la couleur du diaphane lorsqu'il est diaphane en toute réalité, en entéléchie, et qu'il est ainsi réalisé, soit par le feu, soit par telle autre cause, et très par- 41 ticulièrement par le corps supérieur, dont la nature est tout-à-fait identique avec celle du feu. La lumière et le diaphane ne sont pas précisément des corps, ce ne sont pas même des émanations d'un corps, car la lumière serait un corps elle-même en ce cas : seulement, on peut dire que dans le diaphane le feu ou quelque chose d'analogue fait sentir sa présence. L'obscurité est le contraire de la lumière ; elle tient à cet état particulier de l'air où le diaphane n'est plus en acte, tandis que la lumière est précisément cet état de l'air où le diaphane est en acte. Empédocle, si toutefois c'est bien lui, a eu tort de soutenir que la lumière se formait et circulait entre la terre et ce qui l'enveloppe, sans que nous l'y vissions se mouvoir ; ceci n'est soutenante ni par le raisonnement ni par les faits. Comment veut-on que dans un si grand intervalle, d'Orient en Occident, un mouvement aussi considérable échappe à notre attention ? Le diaphane, quand il est en puissance, au lieu d'être en réalité, est sans couleur; car il n'y a qu'une chose incolore qui puisse recevoir la couleur, une chose insonore qui reçoive le son. Le diaphane en puissance est l'invisible, ou du moins ce qui est à peine visible : c'est l'obscurité ; car c'est une même chose qui est tantôt ténèbres et tantôt lumière. Il y a des objets qui ne sont pas visibles à la lumière, et qui dans les ténèbres produisent une vive sensation. Tels sont les corps qui semblent ignés et flamboyants, car la langue grecque n'a pas de nom spécial pour les désigner: le champignon, la corne, les têtes de poissons, leurs écailles, leurs yeux. Ce n'est pas la couleur propre de ces corps que l'on voit. Quelle est donc la cause qui les rend vi- 42 sibles ? C'est une question qui nous entraînerait trop loin et dont il faut nous abstenir ici. Admettons donc que ce qui est visible à la lumière, c'est la couleur, qui, par conséquent, n'est pas visible sans lumière; et que l'essence de la couleur, c'est de mettre en mouvement ce qui est diaphane en acte. La lumière est si bien la réalité complète, l'entéléchie du diaphane, que si l'on place l'objet sur l'organe de la vue même, on ne le verra pas ; mais il faut que la couleur meuve le diaphane, l'air, par exemple; et l'air, qui est continu de l'objet à l'œil, meut l'organe qui voit. Démocrite s'est donc bien trompé quand il a prétendu que si le milieu devenait vide, on verrait parfaitement une fourmi même dans le ciel. Cela est absolument impossible. Pour que la vision ait lieu, il faut que l'organe reçoive une impulsion : ce n'est pas la cour leur même qui la lui donne, il faut donc que ce soit le milieu. Sans ce milieu, non seulement on ne verrait pas bien, mais encore on ne verrait point du tout. Mais si la couleur ne peut être vue que dans la lumière, le feu est vu tout aussi bien dans l'obscurité que dans la lumière; et ceci se conçoit sans peine, puisque c'est le feu qui fait que le diaphane est diaphane. Cette nécessité d'un milieu s'applique également au son et à l'odeur. L'objet n'a pas besoin de toucher l'organe; mais le son et l'odeur mettent en mouvement le milieu, qui meut l'organe à son tour et lui donne la sensation. Posé sur l'organe directement, le corps sonore, le corps odorant n'y cause plus rien. On en peut dire autant du goût et du toucher, quoique ceci soit moins évident pour ces deux sens; mais on le prouvera plus loin. Le milieu des 43 sons est évidemment l'air : celui de l'odeur n'a pas de nom spécial; mais il y a certainement pour les odeurs une certaine modification dans l'air et même dans l'eau; car il y a des animaux aquatiques qui ont le sens de l'odorat. Remarquons en passant que l'homme, et en général les animaux terrestres qui respirent, ne peuvent sentir l'odeur qu'en aspirant. Plus tard nous dirons pourquoi. On peut distinguer pour le son, comme on l'a fait plus haut, l'acte et la puissance. Certains corps n'ont pas de son, comme l'éponge, la laine, etc.; d'autres au contraire en ont beaucoup, comme l'airain et tous les corps durs et polis. Le son en acte, le son réel suppose toujours trois termes : un premier corps qui en frappe un second, puis un milieu dans lequel sont ces deux corps. Un seul objet ne suffit pas pour produire le sou. De plus, il n'y a pas de percussion sans mouvement, et la percussion ne doit pas être appliquée à un objet quelconque. La laine a beau être frappée, elle ne résonne pas; tandis que l'airain a besoin à peine d'être frappé pour résonner fortement. Dans les choses creuses, le son se répercute plusieurs fois ; et après le premier coup il s'en forme plusieurs autres, parce que le milieu qui y est renfermé ne peut en sortir. Le son s'entend surtout dans l'air; mais il peut s'entendre aussi dans l'eau, quoique moins bien. L'air n'est pas la principale condition du son non plus que l'eau; avant tout, il faut que ce soient des corps solides qui se choquent entre eux ou qui choquent l'air. Mais pour que ce choc contre l'air ait lieu, il faut que l'air demeure et ne se disperse pas : aussi faut-il le frapper vite et fort 44 pour qu'il rende un son, comme si l'on voulait frapper sur un nuage de poussière emporté rapidement par les vents. L'écho se produit quand le premier air qu'a réuni le vase vient de nouveau frapper l'air extérieur, sans qu'il puisse se disperser, étant enfermé comme dans une sphère. Il semble donc que l'écho devrait être perpétuel ; mais il en est du son comme de la lumière : la lumière s'étend au-delà de l'objet ou du lieu directement éclairé par le soleil, car autrement il y aurait ténèbres partout où sa lumière ne serait pas. Mais cette réfraction de la lumière qui se disperse n'est pas comme celle qui a lieu dans l'eau, ou comme la réflexion sur les surfaces lisses, et par exemple sur celle de l'airain. Le vide peut passer pour la condition souveraine de l'audition, si l'on admet que l'air soit le vide ; car c'est l'air qui, étant continu de l'objet sonore à l'organe, transmet le son. Le son meut l'air d'abord, et l'air à son tour meut l'ouïe, qui est son terme corrélatif dans ce cas. Si l'animal n'entend pas partout, c'est qu'il n'y a pas d'air partout; c'est que partout l'organe n'a pas l'air qui lui est nécessaire. L'air à lui seul n'a pas de son, et il faut qu'on l'empêche de se disperser pour qu'il en ait un. L'air qui est logé dans nos oreilles, y est très profondément enfoncé, afin qu'il y soit immobile, et que l'organe perçoive toutes les nuances les plus distinctes du mouvement. C'est là aussi ce qui fait que nous entendons dans l'eau, si l'eau ne pénètre pas jusqu'à cette portion d'air qui est en rapport direct avec le son. Il ne faut pas non plus que l'eau s'introduise dans les circonvolutions de l'oreille, car alors la perception ne peut plus 45 avoir lieu. On cesse aussi d'entendre quand la membrane est malade, de même qu'on cesse de voir quand la membrane de la pupille est affectée. Sous l'eau, l'oreille hruït toujours comme lorsqu'on en approche une corne : c'est que l'air qui est dans les oreilles a toujours un certain mouvement qui lui est particulier, et qui n'est pas eu rapport propre avec le son du dehors ; mais il est une condition nécessaire pour entendre, aussi bien que le peuvent être l'air ou le vide et le corps sonore. Est-ce le corps frappé qui résonne, est-ce le corps frappant? L'un et l'autre, quoi que ce soit d'une façon bien différente. Le son doit être considéré comme un mouvement analogue à celui d'une chose rebondissante, frappée sur un corps lisse et dur. Mais tout corps frappant et frappé ne résonne pas, et il faut certaines conditions de surface pour que l'air reçoive le mouvement qui est le son. Les différences des corps sonnants se distinguent sans peine dans le sou réel, le son en acte. Si la lumière est indispensable à la perception des couleurs, le grave et l'aigu ne peuvent pas davantage être perçus sans le son. Le grave et l'aigu sont des mots métaphoriquement empruntés au sens du toucher. Un son est aigu lorsque, dans un court espace de temps, il meut fréquemment l'organe ; il est grave quand, en un long espace de temps, il le meut un petit nombre de fois. Le grave lui-même n'est pas lent, l'aigu n'est pas rapide ; mais le mouvement qui les produit est l'un et l'autre. On peut voir aisément par ceci comment le grave et l'aigu ressemblent à l'obtus et à l'aigu perçus par le toucher : l'aigu semble percer l'organe; le grave 46 semble ne faire que le pousser, parce que le mouvement pour l'un se répète à un court intervalle, et que pour l'autre il se répète à intervalles beaucoup plus longs. Mais nous ne voulons pas pousser plus loin ces considérations sur le son. Ajoutons pourtant que la voix est un son produit par un être animé. Nul être inanimé n'a de voix; et c'est uniquement par similitude qu'on dit quelquefois qu'ils en ont une, comme on le dit de la lyre, de la flûte et des choses sans vie qui ont une vibration, un chant, une sorte de langage et une partie des nuances qu'a aussi la voix. Il y a d'ailleurs beaucoup d'animaux qui n'ont pas de voix; et par exemple ceux qui n'ont pas de sang ; et parmi ceux qui ont du sang, les poissons. Et cela est tout simple, puisque le son est un certain mouvement de l'air. Les poissons qui, à ce qu'on prétend, ont une voix, comme ceux du fleuve Achélous, font tout simplement ce bruit avec leurs branchies ou tel autre organe. On peut donc dire que la voix est propre à l'animal. Mais comme elle n'est pas produite par telle partie prise au hasard, et que de plus il faut, pour que le son se produise, la condition indispensable de l'air, milieu où sont les deux corps, frappant et frappé, il faut dire aussi que la voix ne peut appartenir qu'à ces êtres qui reçoivent l'air. La nature fait ici comme dans tant d'autres cas : si la langue lui sert à la fois pour le goût et pour le langage, le premier tout-à-fait indispensable à l'animal, l'autre seulement utile, elle emploie également l'air aspiré, le souffle à deux fins : la chaleur intérieure, qui n'est pas moins indispensable que le goût, et la voix, qui est utile comme 47 peut l'être le langage, sans être plus nécessaire que lui. L'appareil de la respiration se compose d'ailleurs du gosier et du poumon, qui donne aux animaux terrestres plus de chaleur qu'aux autres ; et comme le premier lieu vers le cœur a aussi besoin de respiration, c'est là ce qui fait que l'air pénètre au-dedans même du corps. La voix est donc précisément le coup que l'air aspiré par l'âme qui est dans ces parties, donne contre ce qu'on appelle l'artère. Mais tout son produit par l'animal n'est pas une voix; la toux n'est pas une voix, par exemple. Pour qu'il y ait voix, il faut que le corps frappant soit animé, et qu'il frappe avec une certaine intention, car la voix est un son qui exprime quelque chose. Le coup porté dans ce cas est le choc de l'air qui est dans l'artère contre l'artère elle-même; et la preuve, c'est qu'on ne peut émettre de voix si, au lieu d'aspirer et d'expirer, on retient l'air; la fonction est alors détruite. Si les poissons n'ont pas de voix, c'est qu'ils n'ont pas de gosier ; et s'ils n'ont pas de gosier, c'est qu'ils ne reçoivent pas et ne respirent pas l'air. Mais c'est dans un autre ouvrage qu'il faut étudier la cause de cette organisation des animaux aquatiques. La théorie de l'odorat offre plus de difficultés que toutes celles qui précèdent. On ne sait pas très positivement ce que c'est que l'odeur, comme on sait ce qu'est le son ou la couleur. Cela tient peut-être à ce que chez l'homme ce sens n'est pas très parfait, et beaucoup d'animaux l'ont plus délicat que lui. Nous ne pouvons sentir aucune odeur, sans la trouver agréable ou désagréable ; et ceci prouve que chez nous cet organe n'est pas très fin. C'est comme les animaux qui ont les 48 yeux durs; ils ne jugent les nuances des couleurs que selon qu'elles leur inspirent ou ne leur inspirent pas de crainte. L'odorat ne vaut même pas chez l'homme le sens du goût, parce que le goût est une espèce de toucher, et que ce dernier sens dans l'espèce humaine est excessivement délicat. Si, pour d'autres sens, l'homme est au-dessous des animaux, pour celui-là il est au-dessus d'eux tous sans aucune comparaison ; et c'est là aussi ce qui le fait le plus intelligent de beaucoup. En poussant plus loin, enverrait même que, dans notre espèce, les individus diffèrent considérablement entre eux sous le rapport du toucher, ce qui n'a pas lieu dans les autres espèces ; et que les individus qui ont la chai? dure sont beaucoup moins bien doués pour l'intelligence que ceux qui ont la chair molle et tendre. Les odeurs sont agréables ou pénibles tout comme les saveurs; mais si à certains égards il y a des analogies entre l'odorat et le goût, il y a aussi bien des différences. Les saveurs étant plus distinctes en général que les odeurs, c'est aux saveurs que les odeurs ont emprunté leurs noms. Il y a odeur douce, âpre, forte, aigre, faible, etc., comme il y a saveur. Si l'on dit que l'odeur du miel est douce, c'est à cause de sa ressemblance avec sa saveur, qui est douce aussi. L'odeur du thym et des plantes aromatiques de ce genre est appelée forte par un motif tout pareil. Du reste, l'odorat s'applique à ce qui est odorant et à ce qui ne l'est pas, comme la vue se rapporte à ce qui est visible et à ce qui ne l'est pas, l'ouïe à ce qui est sonore et à ce qui ne l'est pas, etc. L'olfaction se fait aussi par un milieu; et ce milieu peut être l'air ou l'eau; 49 car les animaux aquatiques paraissent avoir le sens de l'odorat, et il en est qui sont attirés même de fort loin par l'odeur de leur proie. Ce fait rend encore plus difficile à comprendre pourquoi l'homme ne peut odorer qu'en aspirant l'air, et pourquoi il cesse d'odorer quand il expire l'air ou qu'il retient son souffle, tout aussi bien que lorsqu'il pose directement l'objet odorant sur la membrane du nez. Ce dernier phénomène est commun à tous les animaux et pour tous les organes des sens ; mais n'odorer qu'en aspirant est une propriété tout-à-fait spéciale à l'espèce humaine. On ne peut supposer que les animaux privés de sang aient un autre sens pour suppléer à l'odorat, qui, dit-on, leur manque. L'odorat ne leur manque point et n'a pas besoin d'être suppléé par un sens nouveau, comme l'on peut s'en convaincre aisément. Les fortes odeurs les tuent tout aussi bien que l'homme ; et il suffit d'essayer sur eux l'odeur du soufre, de l'asphalte et des corps analogues. Ces animaux odorent, quoiqu'ils ne respirent pas. L'organe de l'olfaction dans l'homme diffère de ce qu'il est dans les autres animaux, à peu près comme pour lui l'appareil de la vue diffère de celui des animaux qui ont les yeux durs. Les yeux de l'homme ont le rempart des paupières qu'il doit ouvrir et remuer pour voir; les animaux qui ont les yeux durs voient, directement et sans intermédiaires de ce genre, les objets qui sont dans le diaphane. De même pour l'odorat : chez les animaux qui reçoivent l'air, cet organe est couvert d'un tégument ; chez les autres, il est sans opercule, comme les yeux des animaux qui ont les yeux durs. Ce tégument se découvre quand les ani- 50 maux respirent, et les veines et les pores qui y sont placés se dilatent. On voit dès lors pourquoi les animaux qui respirent ne peuvent point odorer dans l'eau ; c'est qu'ils n'y respirent pas. D'ailleurs l'odorat s'applique surtout aux objets secs, comme le goût aux objets humides; et en puissance, l'organe olfactif est d'une nature sèche. Le goût, avons-nous dit, est une sorte de toucher; il s'ensuit qu'un objet perçu par le goût est presque un objet touché. Si, pour agir, le goût n'a pas besoin d'un intermédiaire, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, c'est que le toucher n'en a pas besoin non plus. La seule condition nécessaire ici, c'est l'humidité ; sans elle le goût ne saurait s'exercer, et l'humidité est un corps perceptible au toucher. Si nous étions plongés dans l'eau au lieu de vivre sur la terre, nous sentirions directement la saveur qui viendrait se mêler à l'eau, comme nous sentons maintenant la saveur mêlée à notre boisson. Mais l'eau qui nous apporterait la sensation n'en est pas la condition essentielle, pas plus que la couleur, pour être perçue, n'a besoin de se mêler à quoi que ce soit, bien qu'elle traverse un intermédiaire pour arriver jusqu'à notre organe. De même l'humidité accompagne toujours la sensation du goût; et la preuve, c'est le sel qui fond si aisément au simple contact de la langue. Nous faisions remarquer un peu plus haut que la vue s'applique et à ce qui est visible et à ce qui ne l'est pas, à la lumière qu'elle voit tout aussi bien qu'aux ténèbres qu'elle ne voit pas, parce qu'elles sont privés de toute lumière, et aux objets dont l'éclat est si vif qu'elle ne peut le soutenir. Nous taisions la même 51 remarque aussi pour le son et pour l'ouïe. Nous pouvons également la faire pour le goût. Il s'applique et à ce qui est sapide et à ce qui ne l'est pas ; il juge les diverses saveurs, et il en juge aussi l'absence. L'insipide peut être à la fois et ce qui a peu ou point de saveur, et ce qui a une saveur mauvaise. C'est, en termes plus précis, l'impotable et le potable, qui règlent le sens du goût. Mais comme toute chose sapide est nécessairement humide dans une certaine mesure, il faut que l'organe destiné à. la sentir ne soit pas lui-même humide eu toute réalité, en entéléchie; il faut seulement qu'il puisse devenir humide dans une certaine proportion, sans cesser d'être ce qu'il est. Ce qui le prouve bien, c'est que la langue perd la faculté du goût si elle est trop humide, tout aussi bien que si elle est trop sèche. La langue est, on peut dire, le toucher de l'humide primitif, du vrai principe humide. On peut voir le rôle qu'elle joue, et lorsque après une très forte saveur on en goûte une toute différente . et lorsque l'individu est malade et que toutes les saveurs lui semblent amères, parce que sa langue, en effet, est imprégnée de cette amertume qu'il attribue à tous les objets. Les espèces des saveurs se classent à peu près comme celles des couleurs, par les contraires : le doux et l'amer d'abord, puis le fade qui suit le doux, l'âpre qui suit l'amer; et entre les extrêmes, l'aigre, l'acide, le pur, le fort, etc. Un objet qui peut être perceptible au goût est un objet qui peut causer ces saveurs au goût : l'objet sapide, perçu par le goût, est celui qui réellement les cause. Nous n'étudierons pas à part le toucher et l'objet 52 tangible; ce qu'on dira de l'un s'appliquera sans peine à l'autre. Deux questions principales se présentent pour le toucher : Est-ce un sens unique ou multiple? Quel est l'organe qui perçoit positivement dans le toucher ? Est-ce la chair, ou bien n'est-elle qu'un intermédiaire? En général, chaque sens ne paraît avoir, dans les objets qu'il perçoit en propre, qu'une seule opposition par contraires : la vue a le blanc et le noir, l'ouïe a le grave et l'aigu, le goût a le doux et l'amer. Le toucher semble avoir plusieurs de ces oppositions, au lieu d'une seule : ainsi il a le chaud et le froid, le sec et l'humide, le dur et le mou, et plusieurs autres encore. Il est vrai qu'on peut répondre que le son a, lui aussi, plusieurs oppositions et non point une seule ; et que s'il a le grave et l'aigu, il a en outre le fort et le faible, le dur et le doux, et plusieurs autres nuances que présente certainement la voix. On pourrait faire encore des distinctions analogues pour la couleur. Mais toujours est-il que, pour le toucher, on ne peut dire aussi nettement quel est son objet propre, qu'on dit du son qu'il est l'objet propre de l'ouïe. Maintenant, y a-t-il un organe intérieur qui touche ? ou bien est-ce la chair elle-même qui touche directement? On ne peut pas éclaircir cette question, en remarquant que, dans l'état actuel de notre organisation, nous ne sentons les objets qu'au moment même où nous les touchons; car il suffit d'étendre sur la chair une peau, une membrane, pour se convaincre que, malgré cet intermédiaire, on perçoit tout aussi bien certaines sensations du toucher. Il est évident pourtant que l'organe du toucher n'est pas dans cette peau, qui d'ailleurs ne peut pas être tout 53 à-fait assimilée à la chair, en ce que certainement elle nous transmet la sensation moins vite. Si l'air nous enveloppait comme notre chair nous enveloppe, nous percevrions le son, la couleur, l'odeur, par un sens unique; et nous confondrions la vue, l'ouïe et l'odorat. Mais comme les milieux qui nous transmettent ces mouvements sont fort différents, les organes ne nous le paraissent pas moins; et nous ne pouvons pas du tout les confondre les uns avec les autres. Dans le toucher, quel est l'intermédiaire entre l'objet et l'organe propre? C'est ce qu'il est bien difficile de préciser. Un corps animé n'est jamais simplement composé d'air ni d'eau; il a toujours nécessairement quelque partie solide. Il est donc un mélange de terre et d'autres éléments, comme semble bien l'être en effet la chair, et chez les animaux qui n'ont pas de chair, les parties qui la remplacent. Le corps paraît donc être l'intermédiaire indispensable que doivent traverser les sensations du toucher, toutes multiples qu'elles sont. La multiplicité est bien manifeste dans l'action de la langue, qui a tout à la fois et les perceptions du toucher et celles du goût, bien que ces deux organes soient d'ailleurs parfaitement distincts, et qu'ils ne puissent jamais être pris ni agir l'un pour l'autre. Mais ici on peut poser une question fort grave et de mander : Puisque tout corps a les trois dimensions et en particulier l'épaisseur, la profondeur, comment deux corps peuvent-ils se toucher, quand ils ont entre eux un corps intermédiaire? Dans l'eau, les corps ne se touchent certainement pas ; car ils ont entre eux une couche du liquide dont leurs bords sont inondés. Il en est encore absolument ainsi dans 54 l'air, qui joue tout-à-fait le même rôle que l'eau à l'égard des corps qu'il contient et enveloppe. Par suite, on peut donc se demander si, pour les divers sens, il y a divers modes de perception, ou bien un mode unique. Le goût et le toucher semblent avoir besoin du contact immédiat, tandis que les autres sens s'exercent à distance. Il est vrai que certaines perceptions qui semblent propres au toucher, sont acquises par des sens différents du toucher, sans que cette condition du contact soit nécessaire, et qu'ainsi le dur et le doux sont perçus par l'ouïe, la vue, l'odorat. Mais l'on peut répondre à cette objection, que ces perceptions mêmes se font toujours par des intermédiaires, et que nous ignorons pour le goût et pour le toucher, s'il n'y a pas aussi des intermédiaires analogues. Rappelons-nous ce que nous disions tout-à-l'heure de la membrane qui, recouvrant la chair, n'empêche pas du tout la sensation du toucher. Supposons qu'une pareille membrane nous isolât complètement de tout, en nous entourant complètement, ne serions-nous pas constamment alors comme nous sommes maintenant, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, ou même aussi lorsque nous restons dans l'air? Nous nous semblerions toucher les choses mêmes, et nous affirmerions qu'il n'y a point d'intermédiaire entre elles et nous. Il faut faire d'ailleurs ici une distinction capitale : c'est que pour les perceptions de la vue et de l'ouïe, nous les sentons parce que l'intermédiaire agit d'une certaine façon sur nous, tandis que pour les perceptions du toucher nous les avons, non pas par l'intermédiaire, 55 mais avec l'intermédiaire lui-même. C'est comme un homme qui, caché sous son bouclier, reçoit un coup : ce n'est pas le bouclier qui, frappé d'abord, frappe ensuite celui qu'il couvre; l'homme et le bouclier ont été tous les deux frappés à la fois. Ainsi ce que l'air et l'eau sont pour la vue, l'ouïe et l'odorat, la chair semble l'être pour l'organe du toucher. Il n'y aurait donc pas plus sensation pour le toucher, si l'objet le touchait directement, qu'il n'y en a pour les autres sens dans le même cas. Il y a bien pour lui comme pour les autres un organe intérieur qui sent l'objet tangible. Tout se passe alors comme pour le reste des sens : l'organe sent toujours par un intermédiaire les objets qui ne posent pas directement sur lui ; et cet intermédiaire, c'est la chair. Nous avons fait voir dans nos Études sur les Éléments que les différences du corps en tant que corps, froid, chaud, sec, humide, sont toute» perceptibles au toucher. L'organe qui perçoit les différences est l'organe propre du toucher; et la partie du corps où se trouve primitivement le sens qu'on nomme ainsi, est celle qui a la faculté de sentir cet ordre de perceptions, et qui peut être chaude ou froide, sèche ou humide. Or, sentir, c'est éprouver une affection. Ce qui rend une chose pareille à soi n'agit ainsi que parce que la chose elle-même est telle en puissance sans l'être encore en fait. Voilà pourquoi nous ne sentons pas ce qui est chaud ou froid précisément au degré où nous le sommes nous-mêmes, dur ou mou au degré où nous le sommes. Nous ne sentons que les différences, et la sensibilité n'est en quelque sorte qu'une moyenne entre les qualités 56 contraires des choses sensibles. Le moyen terme est surtout propre à mesurer et à juger les extrêmes, parce qu'il est à la fois l'un et l'autre. Tout de même, ce qui doit percevoir le blanc et le noir ne peut être en fait ni l'un ni l'autre ; mais il faut qu'ils soient tous les deux en puissance; et pareillement pour toutes les autres perceptions, et en particulier pour celles du toucher. Le toucher ne doit donc être ni chaud ni froid, afin de percevoir le froid et le chand. Ajoutons une dernière remarque analogue à plusieurs autres qui précèdent. Si le toucher s'applique à ce qui est tangible, il s'applique aussi à ce qui ne l'est pas; et ou peut dire d'un objet qu'il n'est pas tangible, quand il n'offre à la sensation qu'une différence très peu appréciable, comme l'air par exemple; ou bien quand il affecte l'organe avec une telle violence qu'il y détruit toute sensation. Nous voici arrivé à la fin de cette esquisse qui, ainsi que nous le voulions, a successivement traité de chacun des sens en particulier. Pour parler maintenant des sens d'une manière générale, qui s'applique à tous sans exception, il faut admettre que le sens est ce qui reçoit les formes sensibles des objets, sans la matière de ces objets mêmes; comme la cire reçoit l'empreinte de l'anneau sans le fer ou l'or dont l'anneau est composé. La sensibilité est absolument affectée ainsi par les objets qui ont couleur, son, saveur, etc.; non pas qu'elle devienne chacun de ces objets et puisse être nommée comme eux, mais elle devient quelque chose d'analogue que la raison seule peut concevoir. L'organe est le primitif dans lequel est cette faculté. Il 57 est identique aux objets, bien que son être et le leur soient différents ; et ce qui sent la grandeur d'un objet est aussi une sorte de grandeur. L'essence de ce qui sent n'est pas une grandeur; la sensation n'en est pas une davantage; mais c'est un certain rapport à la grandeur, une certaine puissance de la grandeur. Cela nous fait parfaitement comprendre pourquoi les qualités excessives des choses sensibles échappent à la sensation : c'est que le rapport est détruit; l'harmonie de l'objet et de l'organe a cessé, comme l'harmonie et l'accord disparaissent si les cordes sont trop fortement touchées. C'est là aussi ce qui nous explique pourquoi les plantes, qui sont susceptibles des sensations du toucher puisqu'elles s'échauffent et se refroidissent, qui de plus ont une âme d'une certaine espèce, ne sont pas sensibles cependant : c'est qu'elles n'ont pas la qualité moyenne qui est indispensable à la sensibilité, et qu'elles n'ont pas en elles de principe capable de recevoir les formes toutes seules des objets; elles sont affectées avec la matière, et non sans la matière, par les formes sensibles. On peut donc demander encore si un objet perceptible à un certain sens, affecte en quelque façon un être qui n'a pas ce sens spécial; et, par exemple, si l'odeur affecte de quelque manière les êtres qui n'ont pas le sens de l'odorat. On peut répondre que là où le sens manque, l'objet sensible ne fait d'impression d'aucun genre sur l'être privé de ce sens ; on doit ajouter même que les êtres qui peuvent sentir ne sent affectés qu'autant que le sens s'applique à son objet spécial. Ce qui le prouve bien, c'est que ni la lumière, ni 58 l'obscurité, ni le son, ni l'odeur, n'affectent point du tout les corps et ne les changent en rien; mais ce sont les corps mêmes auxquels ces qualités sont jointes qui affectent les autres corps. Ce n'est pas le bruit du tonnerre qui fend le bois frappé de la foudre ; mais c'est l'air dans lequel a lieu ce Bruit. IIll faut reconnaître cependant que les qualités tangibles, tout comme les saveurs, agissent sur les corps; car on peut observer que les choses inanimées elles-mêmes en sont vivement affectées et altérées. Les autres qualités agissent-elles aussi comme ces deux-là sur les corps? ou doit-on dire que les corps ne sont pas susceptibles d'être affectés par le sou ou par l'odeur? ou, enfin, les corps affectés ainsi ne sont-ils pas des corps tout indéterminés et mobiles comme l'air, qui peut contracter une odeur et qui en est si bien modifié qu'il nous la rend aussitôt perceptible? Contracter une odeur, c'est donc éprouver une affection, une sensation d'un certain genre.
LIVRE TROISIEME.
FIN DE LA THÉORIE DE LA SENSIBILITÉ. — IMAGINATION. — INTELLIGENCE. — LOCOMOTION. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. Pour se convaincre que nous avons tous les sens possibles, et qu'il n'y en a point d'autres au-delà des cinq que nous possédons, la vue, l'ouïe, l'o- 59 dorat, le goût et le toucher, il suffit de faire les remarques suivantes. Tous les objets perceptibles au toucher nous sont actuellement connus par ce sens, car le toucher nous révèle toutes les différences de l'objet tangible en tant que tangible. Il faut en conclure, en étendant ceci aux autres sens, que si quelque sensation nous manque, c'est qu'il nous manque aussi quelque organe. Or, les choses du toucher sont directement senties par le toucher lui-même; les autres le sont par des intermédiaires, qui sont deux éléments simples, l'air et l'eau. De plus, nous sommes constitués de telle sorte que, si des choses de genre différent peuvent être perçues par un seul intermédiaire, il faut que l'être qui a l'organe relatif à ce seul élément, perçoive aussi les choses diverses que cet élément lui transmet. Ainsi, l'air peut transmettre à la fois le son et la couleur; et nous avons la perception tout à la fois et des sons et des couleurs. Et réciproquement, si deux éléments peuvent nous transmettre une seule sensation, comme l'air et l'eau qui, diaphanes tous deux, peuvent nous transmettre la couleur, il suffit de pouvoir sentir par l'intermédiaire de l'un, pour avoir toutes les perceptions que les deux autres peuvent donner. On doit ajouter que l'air et 60 l'eau sont les seuls éléments dont relèvent nos organes. Le feu ne se rapporte à aucun organe en particulier; ou plutôt il se rapporte à tous, car il n'y a pas de sensibilité possible sans chaleur. La terre ne sert à aucune perception, si ce n'est peut-être à celle du toucher, où elle joue le rôle qui lui est propre ; et l'on pourrait dire en général que le feu et l'eau sont les seuls éléments avec lesquels nos sens soient eu rapport. Or, dans la constitution actuelle des choses, il y a des animaux qui sont en rapport avec l'un et avec l'autre. Ainsi tous les sens, et tous sans exception, sont possédés par les animaux, quand les animaux ne sont ni mutilés ni incomplets ; la taupe même n'est pas privée d'yeux comme on le croit ; on les lui retrouve sous la peau. Donc, en résumé, à moins qu'il n'y ait une autre organisation possible, et qu'il n'y ait une autre sensibilité qui ne puisse s'appliquer à aucun des corps d'ici-has, on peut affirmer qu'aucun sens ne nous manque. Il n'était pas nécessaire davantage qu'il y eût un sens spécial pour les choses communes, dont chaque sens nous donne indirectement la perception, le mouvement, le repos, la figure, la grandeur, le nombre et l'unité. Le mouvement explique tout cela ; le mouvement nous révèle la grandeur, et aussi la figure qui est une sorte de grandeur ; il nous révèle également le repos, par l'opposition même ; le nombre nous est révélé comme l'unité par tous les sens, comme le mouvement lui-même, qui n'a pas de sens particulier. C'est ainsi que les objets propres d'un sens sont même perçus par un autre sens. La vue perçoit aussi les choses douces, et elle les juge telles, à certaines circonstances déjà connues qui se rencontrent simultanément. Autrement nous n'aurions jamais que des sensations accidentelles, comme lorsque voyant le fils de Cléon, nous sentons, non pas qu'il est le fils de Cléon, mais qu'il est blanc. D'ailleurs, ou peut dire que pour les choses communes, nous avons un sens commun, sinon un sens propre. Ce qui fait 61 que nous ne les percevons pas à vrai dire par simple accident, comme nous venons de le dire du fils de Cléon, c'est que les sens peuvent percevoir fortuitement les objets spéciaux les uns des autres, sans que chacun d'eux cesse pour cela d'être ce qu'il est. Seulement, un même objet donne à la fois une double sensation. En voyant la bile, on sait à la fois et qu'elle est jaune et qu'elle est amère. Aucun des deux sens, ni la vue ni le goût, ne peut dire à lui tout seul que la hile a ces deux qualités; et c'est là ce qui fait qu'on se tromperait, si par cela seul qu'on voit un corps jaunâtre, on allait affirmer que c'est de la hile. On peut alors demander pourquoi, si nous n'avons pas de sens spécial pour les choses communes, nous avons plusieurs sens pour les percevoir; c'est afin que nos erreurs soient moins fréquentes sur ces choses qui ne font qu'accompagner les autres, comme le mouvement, la grandeur. Si la vue était seule appelée à juger de la grandeur, elle serait exposée à se tromper bien plus encore qu'elle ne le fait; et elle confondrait toujours la grandeur et la couleur, parce que pour elle l'une ne serait jamais séparée de l'autre. Mais comme à la vue vient se joindre, pour la perception des choses communes, un autre sens qui la rectifie, la vue ne se trompe point; et nous savons, à n'en pas douter, que la couleur et la grandeur, quoique toujours réunies, sont pourtant très différentes entre elles. L'homme ne sent pas seulement : il a en outre la faculté de sentir qu'il sent ; il sent qu'il voit, il sent qu'il entend. Est-ce par la vue qu'il sent qu'il voit? ou bien est-ce par un autre sens? Si c'est par la vue, 62 le même sens aurait alors deux objets : la vue verrait la couleur, mais de plus elle verrait la vue. Si l'on suppose qu'il y ait uu autre sens, où s'arrêtera-t-on? Ce nouveau sens ne devra-t-il pas, comme le premier, se sentir lui-même ? Et alors pourquoi ne pas accorder tout de suite cette faculté à la vue? Ajoutons que si l'on voit ce qui voit, il faudra que ce qui voit la couleur ait aussi primitivement une couleur, puisqu'il n'y a que la couleur qui puisse être vue. C'est là une difficulté qui est assez grave. Sentir par la vue, voir, n'est donc pas un fait simple, comme on pourrait le croire. Il n'est pas simple au sens où on vient de le dire; il n'est pas simple au sens ordinaire; car même lorsque nous ne voyons pas, ce n'est pas moins la vue qui juge de l'obscurité tout aussi bien que de la lumière ; mais cette complexité n'est pas semblable à celle que nous venons de signaler. De plus, il est bien vrai que ce qui voit est en quelque sorte coloré; car les sens, avons-nous dit, reçoivent la chose sensible sans la matière; et voilà ce qui fait que, même en l'absence des objets, les sensations ainsi que les images peuvent rester dans les organes des sens : or, ici la chose sensible, c'est la couleur. Comment donc résoudre la difficulté que nous avons posée plus haut? et comment sentons-nous que nous sentons ? L'acte de l'objet sensible et l'acte de la sensation sont un seul et même acte, bien que leur être soit différent. Ainsi, prenons un sens quelconque, l'ouïe; je dis que le son en acte est identique à l'ouïe en acte. En effet, on peut fort bien avoir l'ouïe sans entendre; l'objet sonore peut fort bien ne pas résonner. Mais quand le sens qui peut 63 entendre agit, et que l'objet sonore résonne, l'ouïe en acte a lieu en même temps que le son en acte. On pourrait dire de l'un qu'il est l'audition, et de l'autre qu'il est la résonnance. Mais, si dans la chose qui est faite il y a tout à la fois et le mouvement qui l'a faite, et l'action que ce mouvement produit, et la modification résultant de cette action, il faut nécessairement que dans l'ouïe en puissance il y ait tout à la fois et le son en acte et l'ouïe en acte; car l'ouïe est double tout comme l'est le son : elle peut ou agir réellement, selon la faculté qui lui est propre, ou n'être qu'à l'état de simple puissance qui n'agit pas, bien qu'elle puisse agir. Le raisonnement que l'on fait ici s'appliquerait tout aussi bien aux autres sens que l'ouïe; et l'on peut dire eu général que l'action et la souffrance se réunissant dans l'être qui souffre, et non pas dans l'être qui agit, l'acte de l'objet sensible et l'acte de l'organe qui sent sont dans l'être qui sent et ne sont qu'en lui. Les deux nuances que nous venons de signaler pour l'ouïe ont reçu un nom spécial : quelques autres en ont reçu aussi ; mais il est des sens pour lesquels on n'a pas fait ces distinctions; et par exemple, si l'acte de la vue est appelé vision, l'acte de la couleur n'a pas reçu de dénomination particulière. L'acte du goût a son nom, et l'acte de la saveur n'a pas le sien. Si le principe que nous venons de poser est vrai, si l'acte de l'objet sensible et l'acte du sens sont un seul et même acte, quoique leur être soit différent, il s'ensuit que l'un de ces actes ne peut pas être détruit, sans que l'autre ne le soit aussi à l'instant même ; et qu'à l'inverse, ils subsistent aussi tous les deux à la fois. Mais ce qui 64 est vrai de l'acte lie l'est pas de la puissance, et l'une des puissances peut exister ou disparaître, sans que l'autre existe ou disparaisse nécessairement avec elle. Voilà l'erreur des anciens physiologistes, qui ont cru qu'il n'y avait ni blanc ni noir indépendamment de la vue. On comprend d'où cette erreur procédait ; c'est qu'ils n'avaient pas su distinguer la double acception de sensation et d'objet sensible; ils n'avaient pas distingué l'acte de la puissance ; et de là, leur opinion est en partie vraie, eu partie fausse, parce qu'ils avaient traité comme simples des choses qui ne le sont pas. Cette relation des deux actes, que l'on peut surtout observer dans la relation si délicate de la voix et de l'harmonie à l'ouïe, explique bien, à un autre point de vue, ce que nous disions plus haut, à savoir que tout excès de l'objet sensible échappe à l'organe des sens. Un son trop grave, un son trop aigu, échappent à l'ouïe; la vue ne voit pas plus un objet trop brillant qu'elle ne voit un objet trop obscur; l'odorat ne sent pas plus une odeur trop forte qu'une odeur trop faible. C'est qu'au fond la sensation n'est qu'un rapport, et les choses ne sont bien perçues par nous, et ne nous sont agréables, que quand elles sont mélangées dans une mesure convenable. L'harmonie dans la musique ne se compose pas du grave tout seul ou de l'aigu tout seul ; elle se compose des deux, unis dans une juste proportion. Le toucher ne se plaît ni au chaud ni au froid; il se plaît à leur juste mélange. Aussi, le rapport qui constitue la sensation n admet aucun excès ni d'une façon ni de l'autre : tout excès détruit la sensation, ou du moins la rend pénible. Ainsi donc, 65 chaque sens s'applique à son objet spécial, et il juge les différences de cet objet. La vue juge les différences de la couleur, le blanc et le noir; et les autres sens en font autant pour les objets qui leur sont propres. Mais comment jugeons-nous les différences des objets qui appartiennent à des sens différents, par exemple la différence du blanc et du doux? Nous jugeons bien de chaque chose en elle-même ; mais nous jugeons aussi de ses rapports avec les autres. Comment portons-nous ce dernier jugement? c'est nécessairement encore par un sens, puisqu'il s'agit toujours de choses sensibles. Cela nous prouve bien que la chair ne saurait être cet organe extrême de la sensation que nous cherchons, car cet organe ne pourrait alors sentir qu'en touchant directement les objets. Mais il est impossible que ce soient des sens séparés qui jugent que le blanc est différent du doux ; il faut que ces deux qualités, pour être jugées différentes, apparaissent à un seul et unique sens. Quand il y a deux êtres qui sentent comme il y a deux objets sentis, la différence est évidente. Vous sentez telle chose, j'en sens telle autre; sans le moindre doute, ces choses sont diverses. Ici au contraire c'est un seul être qui dit que le blanc et le doux sont différents, et il le pense et le sent tout comme il le dit. Mais si l'être qui juge l'une de ces choses et l'être qui juge l'autre sont un seul et même être et ne peuvent être séparés, il n'est pas possible davantage que ce soit dans des temps séparés que ce jugement se forme. Le même être affirme maintenant que les objets sont autres, et il l'affirme aussi pour les deux dans le même moment. L'assertion qui concerne 66 l'un des objets concerne l'autre, et elle supplique simultanément à tous les deux. Mais on peut objecter qu'un seul et même être ne peut avoir dans un temps indivisible des mouvements contraires ou différents. L'impression d'un objet doux ne meut pas la sensibilité comme l'impression d'un objet amer; elle la meut contrairement. Celle d'un objet blanc la meut tout autrement encore; et ce qu'on dit de la sensibilité s'applique également à la pensée. Pour répondre à cette objection, ne peut-an pas dire que l'être qui juge ces impressions diverses et déclare la différence qu'il sent, est bien en effet numériquement inséparable et indivisible, mais que par sa manière d'être il est divisible? Il peut tout à la fois sentir les choses séparées en tant qu'il peut se séparer lui-même, et il les sent aussi en tant qu'indivisible. Ou bien cette réponse à l'objection est-elle insuffisante? En puissance, le même peut être divisible et indivisible, il peut avoir les contraires ; mais en agissant, il opte nécessairement pour l'un des deux. Son action le rend nécessairement divisible; il ne lui est pas possible d'être tout à la fois noir et blanc, et par conséquent il ne peut avoir simultanément la sensation et la pensée du noir et du blanc. Mais pour conclure dans cette discussion, il faut dire que le sens qui juge ainsi les perceptions de tous les autres et les compare, doit être considéré comme une sorte de point. Le point est bien un ; mais il peut être considéré comme deux, relativement aux lignes qu'il unit ou qu'il distingue. En tant qu'indivisible, ce sens qui juge les autres est un, et il agit simultanément pour les deux percep- 67 tions; en tant que divisible, il emploie deux fois eu même temps la même notion; il juge les deux perceptions par leur limite commune, et elles sont séparées pour lui comme s'il était séparé lui-même. Mais en tant qu'un aussi, il les juge en les réunissant en un seul et même point et tout à la fois. Nous bornerons ici nos considérations sur la sensibilité. Comme on reconnaît surtout deux facultés dans l'âme, la locomotion d'abord, puis ce qu'on appelle pensée, jugement, sensibilité, on pourrait croire par suite que penser, réfléchir, c'est une sorte de sensation. Et il y a cette ressemblance apparente que, de part et d'autre, l'âme distingue et connaît quelque chose ; aussi les anciens n'ont-ils pas hésité à confondre la sensation et la pensée; Empédocle, par exemple, et Homère également. Ils ont supposé que la pensée était corporelle tout comme la sensation, et que le semblable seul pouvait, ainsi que nous l'avons déjà dit, sentir et connaître le semblable. Mais ces philosophes auraient dû rechercher alors d'où vient l'erreur, qui est à peu près l'état hahituel des êtres animés et de notre âme. Selon cette doctrine, ou il faut que tout ce qui nous apparaît soit vrai tel qu'il nous paraît, et quelques uns l'ont soutenu ; ou bien, c'est le contact du dissemblable qui produit l'erreur, de même que c'est le contact du semblable qui donne la vérité. Mais on voit sans peine que sentir et penser sont choses fort différentes : l'une appartient à tous les animaux sans exception; l'autre, au contraire, est réservée à quelques uns. Pour ne pas confondre la sensation et la pensée, il suffit encore de remarquer 68 que la pensée admet le bien et le mal, la sagesse et l'imprudence, la science et l'erreur, tandis que la sensation ne nous offre rien de pareil. La sensation s'applique aux choses particulières, et elle est toujours vraie dans tous les animaux. La pensée, au contraire, si elle est vraie, peut être fausse aussi; et cette faculté d'erreur n'appartient qu'aux êtres qui ont en même temps la raison. C'est qu'il faut distinguer avec soin l'imagination de la sensation et de la pensée intellectuelle. Il est vrai que l'imagination ne se produit pas sans la sensation, et que sans elle il n'y a pas non plus de conception pour l'intelligence. Mais la conception et la pensée ne se confondent point. L'imagination ne dépend que de nous, ne relève que de notre volonté, et nous pouvons par elle nous mettre les objets devant les yeux, presque aussi distinctement que nous les retrouvons dans les emblèmes et les signes mnémoniques dont on se sert quelquefois. L'opinion, au contraire, ne dépend pas de nous ; eu présence d'une sensation, l'opinion que nous acquérons est nécessairement vraie ou fausse. De plus, si notre opinion a pour objet quelque chose de terrible, nous en sommes aussitôt tout épouvantés; ou dans un autre sens, si l'objet est agréable, nous sommes aussitôt rassurés. L'imagination, au contraire, est une sorte de spectacle où nous ne sommes pas plus émus que devant des peintures qui nous représenteraient des choses épouvantables et horribles. Nous ne voulons pas d'ailleurs étudier ici eu détail les différences que la conception intellectuelle peut présenter, science, opinion, sagesse et leurs contra ires; c'est l'objet d'un autre ouvrage; mais nous voulons seule- 69 ment montrer toute la distance qui sépare l'imagination de l'intelligence. La conception est à l'intelligence ce que l'imagination est à la sensibilité. Nous nous occuperons d'abord de l'imagination, et nous étudierons ensuite l'intelligence. Si l'imagination est la faculté qui nous présente des images (sans prendre d'ailleurs ce mot dans un sens purement métaphorique), elle peut être considérée alors comme l'une de ces facultés qui nous fout connaître le vrai ou le faux. Or, ces facultés sont la sensation, l'opinion, la science et l'intelligence. L'imagination est-elle l'une de ces facultés? Et d'abord est-elle la sensation? La sensation est double, avons-nous dit, en acte ou en simple puissance, comme la vision et la vue. Sans que ni l'une ni l'autre espèce de sensation ait lieu, nous pouvons apercevoir des images : témoin les songes. De plus, la sensation est toujours actuelle; l'imagination ne l'est pas. Si l'imagination se confondait avec l'acte de la sensation, on la retrouverait, sans exception, dans tous les animaux qui sont doués de sensibilité. Mais est-ce que l'imagination se retrouve, par exemple, dans la fourmi, l'abeille, le ver? Ajoutez que toutes les sensations sont toujours vraies, et que la plupart des représentations de l'imagination sont fausses. Quand nous avons une perception exacte d'un objet qui tombe sous nos yeux, nous ne disons pas, comme pour l'imagination, qu'il nous paraît, qu'il nous semble que cet objet est de telle ou telle façon. Pour les sensations, nous n'employons ces formes dubitatives que quand nous avons besoin d'un second et plus attentif examen pour nous assurer de ce qu'est l'objet. Si l'ima- 70 gination n'est pas la sensation, à plus forte raison ne sera-t-elle pas l'une de ces facultés éternellement vraies, la science, l'entendement, l'intelligence. L'imagination, si elle est vraie quelquefois, est bien plus souvent fausse. Reste donc qu'elle soit l'opinion, puisqu'elle ne peut être ni sensation, ni science, ni intelligence. L'opinion est fausse aussi quelquefois ; mais l'opinion causée en nous par la sensation entraîne nécessairement à sa suite une croyance, une persuasion de l'esprit : or, cette croyance, cette persuasion ne saurait appartenir aux brutes, tandis que l'imagination leur appartient, si ce n'est à toutes, du moins à un hon nombre. Enfin la persuasion implique nécessairement la raison ; et si quelques bêtes ont l'imagination, il n'en est pas une qui ait la raison en partage. Si l'imagination n'est ni l'opinion qui accompagne la sensation, ni le résultat de la sensation, est-elle davantage une combinaison de la sensation et de l'opinion? Non sans doute, en admettant même que cette combinaison se fasse, de la sensation que nous donne un objet, et de l'opinion que nous nous formons de ce même objet à la suite de l'impression reçue ; car il ne peut s'agir ici de la sensation causée par un certain objet et de l'opinion relative à un objet différent. Du reste il faut remarquer que les images de quelques objets peuvent être fausses en nous, bien que la conception en soit parfaitement vraie. L'image du soleil a pour nous un pied de diamètre ; et cependant nous savons sans le moindre doute qu'il est plus grand que la terre. Ici donc, ou l'on perd l'opinion vraie que l'on avait de la chose, sans que d'ailleurs la chose elle-même vienne 71 à changer; ou bien, si l'on garde cette même opinion, elle est à la fois vraie et fausse. Concluons donc que l'imagination n'est ni l'une des facultés que nous avons énumérées, ni le résultat de ces facultés. Mais l'on peut dire que l'imagination est indissolublement liée à la sensation; car sans la sensation, ce mouvement particulier auquel nous donnons le nom d'imagination ne se produit pas; qu'il ne se produit que dans les êtres qui sentent; que l'être qui possède l'imagination peut être très diversement mû par elle, soit activement, soit passivement; et qu'enfin l'imagination peut être également et vraie et fausse. Voici comment, tenant de si près à la sensation, elle peut être fausse, tandis que la sensation ne l'est jamais. La sensation des objets propres est toujours vraie sans exception; ou, pour mieux dire, elle a le moins d'erreur possible. Mais la sensation où les objets propres ne sont qu'accessoires peut déjà être erronée. Quand on dit, par exemple, que telle chose est blanche, on ne se trompe pas; mais si l'on dit que cette chose blanche est telle ou telle chose, on peut dès lors commettre une erreur; à plus forte raison, s'il s'agit des choses communes à tous les sens et des accidents des objets propres, du mouvement, de la grandeur, etc. Mais le mouvement produit par l'acte même de la sensation, l'imagination, différera de ces trois espèces de sensations. Le premier mouvement causé par la sensation actuelle de l'objet présent est vrai; les deux autres peuvent être faux,, même quand l'objet est présent, et bien plus encore quand il est éloigné. Ainsi l'imagination sera le mouvement causé par la sensation en acte. Mais comme 72 la vue est le principal de nos sens, l'imagination a reçu son nom de l'image que la lumière nous révèle. De plus, comme l'image subsiste dans l'esprit toute pareille aux sensations, il y a des animaux qui agissent par l'imagination comme ils agissent par la sensation, les uns parce qu'ils n'ont pas l'intelligence en partage : telles sont les hrutes; les autres, parce que l intelligence se trouve parfois éclipsée chez eux par les passions, les maladies, le sommeil : tel est l'homme. Voilà ce que nous avions à dire sur l'imagination. Quant à cette partie de l'âme par laquelle l'âme connaît et pense, il faut voir ce qui la distingue de toutes les autres, que cette partie d'ailleurs soit séparée ou qu'en réalité elle ne le soit pas, bien qu'elle puisse l'être rationnellement. Puisque l'intelligence ressemble à la sensation, penser se réduit à éprouver de la part de l'objet intelligible une affection ou quelque chose d'analogue. Mais l'intelligence est complètement impassible : seulement, elle est capable de recevoir la forme des objets. En puissance, elle est comme l'objet, sans être précisément l'objet lui-même; en d'autres termes, l'intelligence est à l'égard des objets intelligibles ce que la sensibilité est à l'égard des objets sensibles. Il suit de là que pour penser les choses, il faut nécessairement que l'intelligence soit distincte des choses, comme le dit Anaxagore; c'est à cette condition seule qu'elle peut les dominer, c'est-à-dire les connaître. L'extérieur, auprès de sa lumière, est obscur et s'éclipse, l'intelligence est donc, par sa nature, simplement en puissance ; avant de penser, elle n'est en acte aucun 73 des objets. Il s'ensuit évidemment que l'âme ne peut être mêlée au corps ; car dès lors elle prendrait quelque qualité matérielle; elle deviendrait comme lui et avec lui, chaude ou froide par exemple, ou bien encore elle aurait des organes divers comme en a la sensibilité. Elle n'est absolument rien de pareil, et l'on a toute raison de dire qu'elle n'est que le lieu des formes : seulement, il ne faudrait pas appliquer ceci à l'âme tout entière ; on doit le restreindre à l'âme intelligente, et de plus on doit bien se rappeler qu'il s'agit ici, non pas des formes en toute réalité, en entéléchie, mais des formes en puissance. Du reste, il est bien clair que quand on parle de l'impassibilité de l'intelligence, on n'entend point une impassibilité pareille à celle qu'éprouvent les sens quelquefois. Quand la sensation est trop violente, l'organe ne la perçoit plus. L'ouïe cesse de percevoir le son au milieu de bruits violents; les couleurs trop vives, les odeurs trop fortes, ne sont pas perçues davantage par les organes qui s'y rapportent. Loin de là, l'intelligence s'exerce d'autant plus énergiquement que son objet est plus fort: plus l'objet est intelligible, mieux elle le comprend. D'où vient cette différence profonde? c'est que la sensibilité ne peut agir sans le corps, et que l'intelligence, au contraire, est séparée de lui. Lors même que l'intelligence devient en quelque sorte les choses réelles qu'elle pense, elle ne cesse pas pour cela d'être toujours en puissance : seulement alors elle n'y est pas tout-à-fait, comme elle y était avant de découvrir et d'apprendre la chose. Le savant qui sait réellement une chose n'en est pas moins en 74 puissance à l'égard de cette chose toutes les fois qu'il ne la pense pas ; mais il n'y est pas pourtant comme avant de la savoir et de la connaître. L'intelligence, une fois qu'elle a connu ainsi les choses, peut alors agir toute seule ; elle peut arriver à se penser elle-même. C'est que l'intelligence s'applique surtout à l'essence des choses. La sensibilité peut bien apprendre à l'âme qu'il existe telle grandeur; l'intelligence seule comprend ce qu'est en soi la grandeur. Parfois ces deux notions se confondent; mais le plus souvent elles sont distinctes, et elles se rapportent ou à des facultés diverses de l'âme, ou tout au moins à l'âme diversement disposée ; de même qu'une ligne droite peut devenir courbe et être rendue ensuite à son premier état. Ainsi être de la chair ou être la chair, sont deux choses que distinguent des facultés différentes de l'âme, ou tout au moins que l'âme distingue en prenant elle-même une disposition différente. Il est vrai que dans les abstractions, dans les mathématiques, le droit comme le convexe ne se conçoit jamais sans un corps matériel dans lequel ils sont tous les deux ; mais, quant à l'essence, et, par exemple, quanta celle du droit, ce n'est pas par la même faculté que nous jugeons et ce qui est droit et ce qu'est le droit. La faculté ou la disposition de l'âme est autre, quand elle juge dans l'un et l'autre cas. On peut donc dire en général que l'essence des choses isolée de la matière qui les compose est l'objet propre de l'intelligence. Mais il reste ici une difficulté : l'intelligence est-elle en effet parfaitement simple, impassible, sans mélange avec quoi que ce soit, comme 75 le veut Anaxagore? Comment alors pourrait-elle penser ? Si penser c'est éprouver une affection, il y a donc quelque chose de commun entre les deux termes, dont l'un paraît être agent et l'autre paraît être passif. On peut demander encore si l'intelligence a le pouvoir de se prendre elle-même pour objet intelligible; car de deux choses l'une : ou l'intelligence devra se retrouver aussi dans les antres choses intelligibles, si l'intelligible est un et identique en espèce ; ou bien l'intelligence aura eu elle-même un mélange qui la rendra tout à la fois intelligente, et intelligible comme le reste des choses. Mais cette prétendue passiveté de l'âme qui la confondrait avec le reste s'explique par la distinction que nous avons faite plus haut. L'intelligence est en puissance comme les choses mêmes qu'elle pense; mais en réalité, en entéléchie, elle n'en est aucune avant que de penser. Elle est comme un feuillet où, de fait, il n'y a encore rien d'écrit, mais où tout peut l'être. Elle a lu puissance de tout recevoir. Elle est elle-même intelligible, comme le sont pour elle toutes les choses intelligibles. C'est que, dans les choses sans matière, le sujet qui pense et l'objet pensé se confondent et sont identiques. Ainsi pour la science purement théorique, l'objet su par elle et la science elle-même sont un seul et même objet. Mais alors aussi pourquoi l'intelligence ne pense-t-elle pas toujours? C'est bien dans les choses matérielles que sont les choses intelligibles; mais l'intelligence ne peut être dans les choses matérielles, puisqu'elle est précisément la puissance des choses sans matière ; et c'est 76 dans l'intelligence qu'est réellement l'intelligible. Mais cette grande distinction qui se présente dans la nature entière, la matière et la cause, doit se retrouver aussi dans l'âme. La matière est toutes choses en puissance ; mais c'est la cause qui fait tout, ainsi que l'art dispose souverainement de la matière comme il le veut. L'intelligence elle aussi peut à la fois, et tout devenir comme la matière, et tout faire comme la cause. Elle est une virtualité comme la lumière qui transforme en couleurs réelles, positives, perceptibles à nos sens, les couleurs qui ne sont qu'en puissance et qui nous resteraient invisibles. Ainsi l'intelligence, séparée de tout, impassible à tout, sans mélange avec quoi que ce soit, est un acte par son essence propre. Mais ce qui agit est supérieur à ce qui souffre l'action, tout de même que le principe l'est à la matière qu'il forme. De plus, en soi l'acte est antérieur à la puissance, comme par exemple la science en acte est antérieure à la science en puissance ; et si la science en puissance paraît antérieure à la science en acte, c'est pour l'individu seul et non point absolument dans le temps. Il en est également de l'intelligence : ainsi ce n'est pas quand tantôt elle pense et tantôt ne pense pas qu'elle est vraiment dans son essence ; c'est en tant que séparée qu'elle est pleinement tout ce qu'elle est. Cette partie de l'intelligence est la seule qui soit immortelle et éternelle; et si elle ne nous donne pas la mémoire, c'est qu'elle est impassible. L'intelligence passive au contraire est périssable, et il lui est impossible de rien penser sans le secours de l'autre, sans le secours de l'intelligence active. 77 Ainsi donc l'intelligence est infaillible quand elle s'applique à des choses qui sont indivisibles. Là, au contraire, où il y a erreur ou vérité, c'est qu'il y a déjà aussi une certaine combinaison d'idées que la pensée assemble et dont elle forme une unité. Mais c'est un peu comme l'hypothèse d'Empédocle : « Pour bien des êtres, des têtes vinrent à pousser sans cou, » les têtes et les cous se combinant plus tard par la puissance de l'amour. Il en arrive souvent ainsi à nos pensées ; on combine les pensées les plus opposées entre elles, et on les réunit comme se réunissent, par exemple, les idées de commensurable et de diamètre, ou de diagonale. S'il s'agit de choses qui ont été dans le passé, ou qui doivent être dans l'avenir, l'esprit ajoute dans la combinaison l'idée du temps, etc. Mais c'est toujours la combinaison des idées qui rend l'erreur possible. Si l'on dit que tel objet blanc n'est pas blanc, l'erreur ne provient encore que de la combinaison du non-blanc indûment faite : l'erreur peut s'étendre d'ailleurs au passé et à l'avenir; c'est toujours l'intelligence qui réduit les éléments divers à l'unité; et l'on pourrait dire, en ce sens, que toutes les choses sont divisées, puisqu'il faut que l'intelligence les combine et les unisse. Mais l'intelligence, tout en donnant cette unité, est chacun des éléments qu'elle unit. C'est qu'il faut distinguer l'indivisible en puissance et l'indivisible en acte. L'indivisible, quand il pense, peut penser l'étendue en tant que divisible; mais, s'il est indivisible, il est aussi, et par cela même, dans un temps indivisible; car le temps et l'étendue sont absolument divisibles et indivisibles l'un comme 78 l'autre. On ne pourrait donc pas dire que l'intelligence pense dans chacune des moitiés qu'elle unit et pour l'étendue et pour le temps, puisqu'elle divise l'une et l'autre du même coup ; mais c'est l'indivisible en espèce et non point en quantité que pense l'intelligence dans un temps indivisible, et par la partie indivisible de l'âme. Il est vrai qu'elle ne le pense pas par son accident et en tant que divisible comme il l'est en réalité, mais comme indivisible ainsi que le temps dans lequel il est. Et les êtres mêmes ont, en effet, quelque chose d'indivisible, quoique non séparé, qui donne l'unité au temps et à l'étendue, et à tout continu en général quel qu'il soit. Mais le point et tout indivisible de ce genre ne sont jamais considérés et compris que comme privation de quelque chose ; et l'on connaît le point par ce qui n'est pas lui, comme l'intelligence connaît le mal et le noir par leurs contraires. Il n'en faut pas moins que toujours ce qui connaît soit en puissance la chose connue et que cette chose soit en lui. Quand ce n'est pas quelque objet extérieur qui est ainsi opposé à l'intelligence, elle se connaît alors elle-même; elle est alors vraiment en acte et séparée de tout ce qui n'est pas elle. Toute assertion, toute affirmation est nécessairement vraie ou fausse. Mais l'intelligence est toujours vraie quand elle juge la chose d'après l'essence même de la chose. Elle peut ne pas l'être, quand elle attribue une chose à une autre chose. Mais, pour ces choses que l'esprit voit sans matière, il est toujours dans le vrai, comme est toujours aussi dans le vrai la sensation appliquée à son objet propre et n'allant pas au-delà. 79 La science en acte est, avons-nous dit, identique avec la chose qui est sue ; mais la science en puissance n'est antérieure dans le temps que par rapport à l'individu : absolument parlant, elle ne l'est point. Tout ce qui se produit, tout ce qui devient, a pour principe un être actuel, effectif, qui le précède. L'objet sensible n'a sa véritable action, son action complète, que grâce à l'être qui sent d'abord en puissance. La sensibilité ne souffre rien, n'est altérée en rien; et c'est là ce qui fait qu'elle est soumise à une tout autre espèce de mouvement que le mouvement ordinaire. Le mouvement n'est, d'après nos théories, que l'acte de l'incomplet; l'acte absolu est tout différent et ne s'applique qu'à ce qui est parfaitement accompli. Sentir les choses, les penser, c'est à peu près les dire. Si la chose est agréable ou pénible, c'est bien une sorte d'affirmation ou de négation que fait l'âme en la recherchant ou en la fuyant. Avoir du plaisir ou de la douleur, c'est agir, à l'égard du bien ou du mal, par cette moyenne qui constitue la sensibilité. En acte, la haine de l'un, le désir de l'autre, sont identiques; et le principe qui désire ne diffère pas plus du principe qui hait, qu'ils ne diffèrent l'un et l'autre de ce qui sent. Il n'y a de différences que dans la manière d'être, mais l'être lui-même est identique. Quant à l'âme intelligente, les images sont pour elle de véritables sensations; elle ne pense jamais sans images. Dès qu'elle affirme le bien ou qu'elle le nie, elle recherche le bien ou fait le mal ; et les images la modifient, tout comme l'air modifie la pupille, qui elle-même modifie quelque chose de plus profond. Mais 80 le terme extrême où toutes ces modifications aboutissent est unique, de même que la moyenne sensible qui perçoit toutes les sensations diverses est unique aussi, et n'a réellement que des façons d'être différentes. C'est précisément parce qu'elle est une qu'elle peut distinguer, ainsi qu'on l'a dit plus haut, la différence des choses entre elles, le doux du chaud, par exemple ; tout comme elle distingue les contraires dans un même genre, le blanc du noir. L'âme est à la fois, en quelque sorte, l'un et l'autre; ou, pour mieux dire, elle est la limite commune de tous les deux. C'est que l'intelligence pense les formes des choses dans les images qu'elle en reçoit; et elle se détermine par les images à fuir tel objet ou à rechercher tel autre, sans que la sensation intervienne dans ces déterminations que les images seules décident. Ainsi, sentant que le flambeau est allumé, et voyant en outre par le sens, qui est commun, qu'il est en mouvement, l'âme comprend qu'il y a danger d'être brûlé. Parfois aussi l'on calcule d'après les images ou les pensées qui sont dans l'âme, tout comme si l'on voyait les choses; et l'on dispose de l'avenir en conséquence du présent. Lorsqu'on se dit que la chose actuelle est agréable ou pénible, on la recherche ou on la fuit actuellement, et l'on se met en action. De même pour les choses où il n'y a plus d'action, pour le vrai et le faux, qui sont dans le même genre que le bien et le mal, avec cette seule différence que le vrai et le faux sont absolus, tandis que le bien et le mal sont relatifs. L'intelligence peut penser les choses abstraitement, comme elle pense le camus : en tant que camus, elle ne peut 81 l'isoler du nez auquel il se rapporte; mais, en tant que courbe, elle l'isole parfaitement de la chair qui a réellement cette courbure. C'est ainsi qu'elle pense comme séparés les êtres mathématiques, qui, en réalité, n'existent pas indépendamment des choses. Mais, en résumant toute cette théorie, nous pouvons dire que l'intelligence, quand elle pense en acte les choses, n'est que les choses mêmes. Peut-elle, sans être séparée de l'étendue, et privée de toute grandeur, penser quelque chose qui soit également séparé de l'étendue? C'est une question que nous éclaircirons plus tard. Nous pouvons donc répéter que l'âme est en quelque sorte tout ce qui est. Les choses ne sont que sensibles ou intelligibles : or, la science est en quelque façon les choses qu'elle sait : la sensation est de même aussi les choses qu'elle sent. C'est que la sensation et la science doivent être divisées, comme le sont les choses elles-mêmes auxquelles elles s'appliquent. Si les choses sont en puissance, la science et la sensation sont en puissance ; si les choses sont en toute réalité, elles aussi sont en toute réalité. Le principe qui sait, le principe qui sent dans l'âme, sont en puissance les objets mêmes, ici l'objet qui peut être su, là l'objet qui peut être senti. Mais est-ce bien l'objet lui-même ou seulement sa forme? Évidemment ce ne peut être l'objet réel, matériel, effectif : la pierre n'est pas dans l'âme, c'est seulement sa forme qui s'y trouve. De même que la main est l'instrument des instruments, de même l'intelligence est la forme des formes; et la sensation est la forme des choses sensibles. Mais comme il n'y a rien en 82 dehors des choses sensibles et matérielles, il faut admettre que les intelligibles sont dans les formes sensibles comme y sont les abstraits, comme y sont les qualités et les modifications diverses des choses sensibles ; et voilà pourquoi sans la sensibilité l'être ne peut absolument rien savoir ni rien comprendre, pourquoi sans images il ne peut rien concevoir intellectuellement. Les images sont, ou peut dire, des sensations sans matière ; mais l'imagination n'est pas l'affirmation ou la négation que fait l'esprit. Où sera donc la différence des images et des pensées premières de l'intelligence? qui empêchera qu'on ne les confonde? Tout ce qu'on peut assurer, c'est que les idées premières, les principes, ne sont pas des images ; seulement, sans les images ils ne seraient pas. Des deux facultés principales qu'on attribue à l'âme, le jugement, œuvre de la pensée et de la sensation, et la locomotion, il ne nous reste plus à étudier que la dernière. Quelle partie de l'âme produit le mouvement? Cette partie est-elle séparée, distincte de toutes les autres, matériellement et non pas seulement en raison? Ou bien est-ce l'âme tout entière et non l'une de ses parties qui cause le mouvement? Cette partie est-elle en dehors de toutes celles que nous avons étudiées jusqu'ici? ou bien est-ce l'une de celles-là? Mais d'abord, qu'entend-on quand on dit que l'âme a des parties ? combien en a-t-elle réellement? En un sens, il semble que le nombre en soit infini et qu'elles ne soient pas bornées à celles qu'énumèrent certains philosophes: la partie raisonnable, la partie affective, Ia partie passionnée; ou, selon d'autres, la partie raisonnable et la partie irraison- 83 nable. En adoptant même les principes qui ont présidé à ces divisions, il serait facile de trouver des parties différentes de celles-là, qui seraient entre elles plus éloignées encore, et par conséquent plus distinctes. Nous en avons traité dans cet ouvrage ; et par exemple, nous avons distingué la nutrition, qui appartient aux plantes comme aux animaux, sans aucune exception, et la sensibilité, qu'il serait bien difficile de faire rentrer dans la division de: raisonnable et irraisonnable. Vient ensuite l'imagination, qui, considérée comme pareille à l'une des parties énumérées ou comme dissemblable, présente toujours les plus grandes difficultés, du moment qu'on admet que les parties de l'âme sont séparées. On peut reconnaître encore la partie des appétits, qui, par son action propre et le rôle que la raison lui attribue, ne diffère pas moins de toutes les autres que l'imagination; et cependant il serait également absurde de l'isoler. La volonté se retrouve dans la partie qui raisonne ; le désir et la passion se retrouvent aussi dans la partie dénuée de raison ; et si l'âme se compose de ces diverses parties, l'appétit tiendra sa place également dans chacune d'elles. Mais revenons à la question que nous devons traiter ici : Quel est dans l'animal le principe de la locomotion? (Quant à ce mouvement particulier d'accroissement et de destruction qui appartient à tous les animaux, il semble que dans tous il vienne de principes qui leur sont communs à tous, la génération et la nutrition. Nous nous réservons de parler ailleurs des fonctions de la respiration et de l'expiration, du sommeil et de la veille, sujets qui ne sont pas non plus sans de graves diffi- 84 cultés.) Pour la locomotion, quelle est la cause qui la donne à l'animal? Évidemment ce n'est pas la faculté nutritive. La locomotion a toujours une fin spéciale, un but déterminé; et elle est toujours accompagnée d'imagination et de désir. Nul être ne se meut s'il n a désir ou crainte; et si les plantes avaient l'un ou l'autre, elles seraient certainement mobiles, elles auraient des organes pour la locomotion. Ce ne peut pas être davantage la sensibilité qui cause la locomotion. Il y a des animaux doués de sensation qui n'en restent pas moins perpétuellement immobiles. Mais, si la nature ne fait jamais rien en vain, un principe non moins sûr, c'est qu'elle n'omet jamais rien non plus de ce qui est nécessaire, si ce n'est dans les êtres avortés ou incomplets. Or les animaux dont nous parlons ne sont pas du tout avortés ou incomplets; ils se reproduisent.se développent et meurent; et s'ils n'ont pas les organes de la progression, c'est que la sensibilité ne doit pas eu être nécessairement accompagnée. Est-ce la partie raisonnable de l'âme qui meut les animaux? est-ce ce qu'on appelle l'intelligence ? Pas plus. D'abord l'intelligence, spéculative comme elle l'est, ne s'occupe guère de ce qui est à faire; elle ne dit ni ce qui est à fuir ni ce qui est à rechercher ; tandis que le mouvement ne peut venir que d'un être qui fuit ou qui recherche quelque chose. Bien plus, lors même que l'intelligence conçoit quelque objet effrayant ou agréable, ce n'est pas elle qui peut ordonner à l'être de le poursuivre ou de l'éviter; elle a beau penser à un objet de ce genre, elle n'ordonne pas de le craindre ou de l'aimer: c'est le cœur, c'est la passion seule qui imprime le mouve- 85 ment, et c'est là une tout autre partie de l'âme. L'intelligence a beau donner ses ordres, la pensée a beau dire qu'il faut fuir telle chose ou en rechercher telle autre, l'être ne se meut point pour cela; il n'obéit qu'à sa passion, comme l'intempérant qui ne sait point se dominer. Il se passe alors quelque chose d'analogue à ce qui arrive souvent dans l'art de la médecine : ce n'est pas toujours celui qui connaît le mieux les préceptes de la science qui guérit le plus; et l'on dirait qu'il y a quelque chose qui sait mieux encore que la science agir suivant les vrais préceptes de la science. Enfin, ce n'est pas la partie appétitive de l'âme qui dispose absolument de la locomotion; et la preuve, c'est que les gens tempérants ont beau sentir des désirs et des appétits, ils ne les écoutent pas et ne suivent que leur seule raison. On peut donc hésiter entre deux facultés de l'âme, l'intelligence et l'appétit, pour savoir à laquelle des deux il faut attribuer la locomotion, en admettant toutefois que l'imagination est aussi une sorte de pensée intellectuelle qui meut les animaux autres que l'homme, et n'ayant point comme lui l'intelligence et le raisonnement. L'intelligence qui peut produire le mouvement est. du reste, l'intelligence pratique et non l'intelligence spéculative. L'intelligence pratique se propose toujours un but, une fin que n'a jamais l'autre. Mais tout appétit tend nécessairement à quelque chose ; et c'est alors cette chose dont il y a appétit qui devient pour l'intelligence pratique le principe du mouvement. L'objet désiré meut la pensée et l'intelligence, qui à son tour communique le mouvement au corps; mais, au fond, c'est l'objet désiré 86 qui est la cause première de la locomotion. L'imagination même, quand elle meut l'animal, ne peut le mouvoir sans l'appétit. Donc on peut dire, en résumé, que c'est l'objet de l'appétit, du désir, qui est le seul et vrai principe du mouvement. La volonté, sans laquelle l'intelligence ne peut mouvoir le corps, n'est aussi qu'un appétit; et le raisonnement, quand il meut l'être raisonnable, est toujours accompagné de volonté. Quanta l'appétit, il peut produire le mouvement malgré et contre la raison même. La grande différence qui sépare l'intelligence de l'appétit et de l'imagination, c'est que l'intelligence est toujours juste, tandis que les deux autres peuvent ne pas toujours l'être. Du reste, l'objet désiré qui provoque le mouvement est toujours un bien ou réel ou apparent, non pas le bien dans toute sa généralité, mais le bien pratique, c'est-à-dire qui pourrait aussi être autrement qu'il n'est. Répétons que c'est une faculté de l'âme analogue à celle qu'on nomme l'appétit, qui est la cause du mouvement; et si l'on distingue les parties de l'âme d'après les facultés, on peut alors en reconnaître un grand nombre, nutritive, sensible, intelligente, volontaire, appétitive, différant toutes entre elles beaucoup plus que ne diffèrent ces deux parties si souvent admises : celle des désirs et celle des passions. Les appétits, d'ailleurs, peuvent être contraires entre eux ; et cette opposition, qui vient toujours du combat de la raison contre le désir, ne se manifeste que dans les êtres qui ont le sentiment du temps. L'intelligence commande de résister parce qu'elle a en vue le résultat futur. Le désir exige la satisfaction immédiate. 87 L'objet, parce qu'il est actuellement agréable, paraît absolument agréable, absolument hon; car l'être ne prévoit pas ce qui doit suivre; et si c'est toujours la partie appétitive de l'âme qui meut l'animal, c'est toujours aussi l'objet même de l'appétit qui est le premier des moteurs. Il meut, en effet, sans être mû lui-même, et par cela seul qu'il est conçu par l'intelligence ou senti par l'imagination. En espèce, le moteur est donc unique; numériquement, les moteurs peuvent être presque infinis. C'est que des trois termes indispensables, le moteur, ce par quoi il meut, et le mobile, le premier, le moteur, peut être ou immobile ou mû lui-même. Le moteur immobile, c'est le bien qui est à faire ; l'appétit est le moteur qui est mû aussi lui-même; le mobile, c'est l'animal; et l'instrument par lequel l'appétit le meut étant un instrument tout corporel, il s'ensuit qu'il faut étudier la locomotion dans les actes communs de l âme et du corps. Ce sont les deux pièces indispensables du mouvement, comme dans un gond la mortaise et le tenon, qui sont la fin et le principe, sont séparables rationnellement, mais en réalité sont indissolubles pour former l'ensemble et réaliser le mouvement. C'est une sorte de cercle où le centre immobile est le point d'où part le mouvement du système entier. Eu nous résumant donc, nous pouvons dire que si l être se meut, c'est qu'il est susceptible d'appétit, qu'il n'y a pas d'appétit sans imagination, que toute imagination est ou raisonnable ou sensible, et qu'enfin les animaux ont l'appétition tout aussi bien que l'homme. Dans les animaux imparfaits, qui n'ont, par 88 exemple, que le sens du toucher, le moteur qui les anime est-il le même? ont-ils l'imagination et le désir? Il y paraît bien pour le désir, puisqu'ils ont aussi douleur et plaisir. Mais comment auraient-ils l'imagination, cette faculté étant d'ailleurs en eux tout indéterminée, comme y est le mouvement lui-même? Il faut distinguer dans l'imagination celle que j'appellerais sensible : celle-là, ils peuvent l'avoir; mais quant à l'imagination qui va jusqu'à la volonté, celle-là ne peut se trouver que dans les êtres doués de raison. Faut-il faire telle ou telle chose? voilà ce que décide le raisonnement; et, pour juger, l'être doit rapporter les choses à une mesure unique, c'est-à-dire, au meilleur, qu'il poursuit, et réduire les images diverses à l'unité que l'intelligence peut seule comprendre. Quand l'être paraît ne pas avoir la faculté d'opinion, c'est qu'il n'a pas cette opinion qui s'appuie sur le raisonnement, tandis que l'imagination douée de volonté la possède. Mais l'appétit, pris en général, n'a pas cette volonté capable de délibération. Si parfois la volonté l'emporte sur lui, plus souvent il l'emporte sur elle; et c'est comme une halle que les joueurs se renvoient l'un à l'autre. C'est aussi parfois l'appétit qui meut brutalement l'appétit; et tel est le cas de l'intempérance qui ne peut se rassasier. Mais c'est la partie supérieure de l'âme qui est la vraie dominatrice, et elle peut produire le mouvement, qui a d'ailleurs ces trois directions diverses. La partie scientifique de l'âme est immobile ; ou bien, si l'on admet qu'elle puisse aussi causer le mouvement, il faut alors distinguer entre la conception de l'universel, ou rai- 89 son, et la conception du particulier, ou l'opinion : cette dernière seule devrait être considérée comme principe du mouvement, parce que seule aussi elle est mobile; quant à l'autre, si on veut lui accorder qu'elle cause le mouvement, il faut toujours reconnaître qu'elle-même n'a pas le mouvement. Maintenant terminons tout ce traité par quelques généralités sur les diverses facultés que nous avons assignées à l'âme. La nutrition appartient sans aucune exception possible à tous les êtres vivants, parce que tous, une fois nés, doivent croître, se développer et périr, fonctions qui, sans la nutrition, seraient absolument impossibles. Mais la sensibilité n'est pas nécessaire à tous les êtres vivants. Ceux dont le corps est simple ne possèdent pas le toucher; mais sans le toucher, il n'y a pas d'animal; et la sensibilité n'est pas faite pour les êtres qui ne peuvent recevoir les formes des objets sans la matière. Mais la sensibilité est tout-à-fait nécessaire à l'animal, s'il est vrai que la nature ne fait rien en vain ; et ce principe est incontestable. Si donc un corps qui peut se déplacer n avait pas la sensibilité, il périrait infailliblement, et n'arriverait pas à sa fin, ce qui est le grand objet de la nature. Comment, en effet, sans la sensibilité, pourrait-il se nourrir? Les êtres qui restent en place ont directement la nourriture indispensable à la conservation de leur vie. Sans la sensibilité, il n'y a point d'intelligence possible. Tout corps, et j'entends un corps qui n'est pas immortel et qui de plns est engendré, ayant une âme qui raisonne, doit être sensible. A quoi, en effet, lui servirait de n'être pas sensible? 90 Ce ne serait bien ni pour son âme ni pour son corps; car l'une ne pensera pas mieux, et l'autre ne sera rien de plus pour n'avoir pas cette faculté. Ainsi donc, en général, il n'y a pas de corps non immobile qui ait une âme, sans avoir aussi la sensibilité. Mais dès qu'un corps est sensible, il ne peut être simple, puisque s'il était simple il serait privé du toucher, et qu'il faut de toute nécessité qu'il le possède. Privé du sens du toucher, il ne pourrait se conserver. Quand l'être touche les choses, s'il ne les sentait pas, il ne saurait ni éviter les unes ni rechercher les autres, conditions indispensables à son existence. C'est là ce qui fait que le goût est une sorte de toucher; il est le sens de la nutrition, et l'aliment est toujours un objet perceptible au toucher. Le son, la couleur, l'odeur ne nourrissent pas et ne donnent à l'animal ni l'accroissement ni le dépérissement; mais le goût devait nécessairement être une sorte de toucher, parce qu'il s'applique à ce qui peut être touché et peut nourrir. Donc, sans le toucher, l'animal ne saurait être; le toucher lui est le seul sens indispensable. Quant aux autres, ils lui sont simplement utiles: aussi appartiennent-ils tous, non pas à tous les animaux sans exception, mais seulement à quelques uns, et spécialement à ceux qui sont doués de la faculté de marcher. En effet, il ne faut pas seulement, pour que ces animaux puissent vivre, qu'ils sentent les objets quand ils les touchent : ils doivent encore les sentir de loin ; et c'est ce qui a lieu, s'ils peuvent sentir à travers un intermédiaire que mette en mouvement l'objet sensible, comme cet intermédiaire meut l'animal lui-même. 91 L'agent qui meut l'animal le fait changer de place ; l'animal mis ainsi en mouvement peut aussi en mouvoir un autre; et pourtant le moteur initial peut être lui-même immobile, tout en donnant le mouvement. Le moteur intermédiaire est mû et meut tout à la fois ; le mobile dernier, qui peut venir après bien des intermédiaires, est simplement mû et ne meut rien. Le mouvement d'altération peut être tout-à-fait de même; mais seulement il se passe sur place. C'est comme la cire dans laquelle on plonge un cachet : elle en est assez profondément modifiée. Certaines choses s'altèrent fort peu, comme la pierre; d'autres se modifient beaucoup, l'air par exemple, et l'air est le plus mobile de tous les corps, en ce sens qu'il agit et souffre plus que tout autre. Aussi vaut-il mieux admettre, pour expliquer la vue, que c'est, non pas la vision sortant de l'œil qui est réfractée, mais l'air, qui peut être affecté par les figures et les couleurs sans cesser d'être ce qu'il est. L'air est un de la surface à l'organe; et quand il meut la vue, c'est comme si l'empreinte marquée sur la cire la traversait, et était transmise jusqu'à la limite même où la cire s'étend. Nous pouvons donc répéter qu'il n'est pas possible que le corps de l'animal soit simple, c'est-à-dire, composé d'un seul élément, de feu ou d'air ; car tous les éléments, si l'on excepte la terre, peuvent être des instruments de la sensibilité. Le toucher semble sentir directement les choses ; mais les autres sens, qui sont bien aussi des espèces de toucher, sentent les choses par des intermédiaires qui 91 sont l'eau, l'air ou le feu. Pourtant le corps d'aucun animal n'est composé de ces éléments seuls. Il ne saurait l'être davantage de terre, car le toucher perçoit non seulement les différences applicables à la terre, mais encore celles du chaud, du froid, etc., qui ne peuvent être appliquées à la terre. Si nous ne sentons ni par les os, ni par les cheveux ni par les autres parties analogues, c'est qu'elles sont composées de terre, et c'est là aussi ce qui ôte la sensibilité aux plantes. Si donc le toucher est le sens indispensable, il est impossible aussi qu'il soit formé de terre ni d'aucun autre élément simple. Sans le toucher, répétons-le, l'animal ne saurait vivre; car c'est le seul sens nécessaire. Voilà pourquoi les impressions des autres organes, quand elles sont trop violentes, détruisent les sensations seulement et ne détruisent l'animal qu'indirectement; et, par exemple, les sensations de la vue ou de l'odorat mettent en mouvement certaines parties du corps qui détruisent l'animal par le toucher. Si les sensations du goût peuvent tuer l'animal, c'est que le goût est un toucher d'une certaine espèce. Quant aux sensations propres du toucher, le froid, le chaud, le dur, leur violence tue l'animal directement. L'excès dans tout objet détruit l'organe qui le sent. Le tangible détruit donc le toucher: or, c'est le toucher qui constitue essentiellement l'animal, puisque sans lui, comme nous l'avons démontré, l'animal ne peut vivre. Il a ce sens-là pour être; il n'a les autres que pour être mieux; la vue, pour pouvoir discerner les objets, soit dans l'air, soit dans l'eau, en un mot dans le dia- 92 phane ; il a le goût pour discerner, par la saveur agréable ou pénible, les aliments qui lui conviennent, les désirer et se mouvoir afin de se les procurer; il a l'ouïe pour comprendre lui-même les choses; comme enfin il a la voix pour se faire comprendre des êtres qui l'entourent. (1) « Le corps est un instrument dont l'âme se sert à sa volonté... De là... l'extrême différence du corps et de l'âme, parce qu'il n'y a rien de plus différent de celui qui se sert de quelque chose, que la chose même dont il se sert. » Bossuet, Connaissance de Dieu et de soi-même, page 73, a, éd. de 1836. (2) Voir, pour la Dialectique platonicienne appréciée comme elle l'est ici, mon Rapport sur l'École d'Alexandrie, pr. xx. (3) Je ne veux point parler ici de l'influence qu'a pu exercer la théorie d'Aristote sur le mysticisme alexandrin. Ce sujet est très curieux et très obscur ; j'en ai dit quelques mots dans les notes du Traité de l'Ame, liv. III, chap. ii, § 12, et aussi dans mon Rapport sur l'école d'Alexandrie, pag. 42 et 125. (4) Voir Barthez, Nouveaux éléments de la science de l'homme, tom. I. p. 184, 192, 195 et suiv.; et Bérard, Doctrine des rapports du physique et du moral, p. 74, 84 et suiv.*
(5) Les deux seuls ouvrages de Buisson, mort à vingt-huit ans,
sont :
1° sa thèse inaugurale, De la division la plus naturelle des
phénomènes physiologiques, 1804 ; et 2° une dissertai ion non moins
remarquable, De l'influence des passions sur les phénomènes
organiques. Brisson était fort lié avec M. de Bonald. dont il
partageait les croyances spiritualistes, sans partager, comme il le
dit lui-même, ses croyances religieuses. |