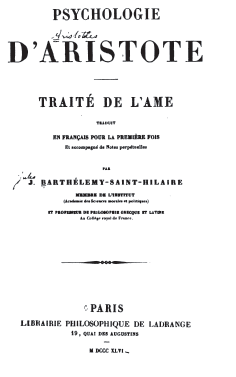
ARISTOTE
TRAITE DE L'AME.
PREFACE - PLAN GENERAL
TRAITÉ DE L'AME.
|
AUTRES OUVRAGES DE L'AUTEUR. DE LA LOGIQUE D'ARISTOTE, Mémoire couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, 2 vol. in-8. 14 fr. LOGIQUE D'ARISTOTE, traduite pour la première fois en français, accompagnée de notes perpétuelles, 4 vol. gr. in-8. 30 fr. LA POLITIQUE D'ARISTOTE, traduite en français avec le texte grec en regard, 2 vol. gr. in-8, rare. METEOROLOGIE D'ARISTOTE, traduite pour la première fois en français, accomp. de notes perpétuelles, 1 vol. gr. in-8 (sous presse). DE L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE, Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques, précédé d'un Essai sur la méthode des Alexandrins et le mysticisme, et suivi d'une traduction de morceaux choisis de PLOTIN. 1 vol. in 8, 1865. 6 fr. Paris. Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.
PSYCHOLOGIE
D'ARISTOTE
TRAITÉ DE L'ÂME
TRADUIT EN FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS Et accompagné de Notes perpétuelles ΡAR BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRΕ (Académies des Sciences morales et politiques) ET PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE GRECQUE ET LATINE Au collège royal de France.
PARIS LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE DE LADRANGE
19, QUAI DES AUGUSTINS M DCCC XLVI
Cette traduction du Traité de l'Ame a été faite deux fois, à huit ans de distance, d'abord sur l'édition générale de l'Académie de Berlin, et ensuite sur l'édition spéciale de M. Trendelenbourg ( Iéna, 1833, in-8), la plus récente et la meilleure de toutes. La division des paragraphes a été empruntée à cette dernière édition. J'ai eu constamment sous les yeux : 1° Les explications particulières qu'Alexandre d'Aphrodise, dans ses Questions, a données de quelques passages ; et son Traité de l'Ame qui reproduit en très grande partie l'ouvrage d'Aristote; 2° La paraphrase de Thémistius ; 3° Les commentaires de Simplicius et ceux de Philopon; 4° Ceux d'Averroès; 5° Ceux d'Albert-le-Grand, de Saint Thomas, des Coïmbrois et du cardinal Tolet ;
6° L'édition spéciale de Pacius. La
paraphrase française de Pierre de Marcassus (Paris, 1641, in-12) n'a
pu m'être d'aucune utilité : selon toute apparence, elle a été faite
sur une version latine, et non sur l'original grec.
Distinction de Pâme et du corps; importance de cette question, — Psychologie d'Aristote. Ses erreurs et ses lacunes : 1° sur la nature et les facultés de rame; 2° sur le fondement de la morale ; 3° sur l'immortalité ; 4° sur le principe de la méthode. — Supériorité de la psychologie platonicienne. — Mérites scientifiques du Traité de l'âme ; son influence. — La physiologie, malgré ce qu'en a cru Aristote, ne peut, en aucune manière, fonder la psychologie. État de la physiologie contemporaine. — Conclusion : devoir de la philosophie. L'âme est-elle distincte du corps? La force que nous sentons en nous, vouloir, penser et sentir, est-elle la même que cette autre force qui conserve et répare notre organisme? L'intelligence et la nutrition sont-elles soumise à une seule et même puissance? L'homme est-il composé de deux principes? Obéit-il à un principe unique et l'âme se confond-elle avec le corps? Aujourd'hui, il est permis à peine de poser cette question. Elle fait sourire la philosophie qui l'a cent fois résolue; elle in- iv digne la religion, qui croit, avec raison, qu'un doute de cet ordre l'ébranlé et la ruine; elle étonne le sens commun, qui ne se la fait pas, mais qui, lorsqu'on la lui pose, y répond, comme la religion et la philosophie, par une affirmation imperturbable : Oui, l'âme est distincte du corps. La discussion ne reste ouverte que pour ces physiologistes en petit nombre qui ne se sont point assez rendu compte des vraies limites de leur science, et qui, dans l'ardeur d'une étude encore nouvelle et indécise ne s'aperçoivent pas de ses empiétements sur le domaine d'études voisines, mais différentes. Depuis Descartes, il n'est pas un philosophe qui puisse ignorer ni le chemin infaillible qui conduit à cette distinction capitale de l'âme et du corps, ni les conséquences, ou plutôt les dogmes, qui en sortent. Mais quand la philosophie commençait à bégayer en Grèce, il y a près de trois mille ans, la question n'était ni aussi simple, ni même aussi grave. Les Écoles qui précédèrent Platon n'en comprenaient point toute l'étendue ni toute la portée. Platon seul a su montrer tout ce qu'elle renfermait d'essentiel, et pour l'explication de la nature de l'homme et pour ses destinées. La vé- v rité n'avait jamais été présentée sous des formes aussi belles, appuyée d'arguments aussi invincibles, conquise par une méthode plus irréprochable. Les siècles ont adopté la solution platonicienne; ils l'ont approfondie, ils ne l'ont pas changée. Mais au temps même de Platon, la victoire ne pouvait être aussi facile. La vérité, que l'homme n'acquiert qu'au prix de labeurs si longs, ne règne pas en un jour. La découvrir a coûté bien des peines, l'établir n'en coûte pas moins. Il est bon que des protestations nombreuses, même celles du génie qui s'égare en se révoltant contre elle, viennent l'affermir en cherchant vainement à l'ébranler. Son triomphe serait moins sur s'il était plus rapide. La liberté d'ailleurs réserve toujours ses droits, plus imprescriptibles encore que ceux de la vérité. C'est la grandeur de l'esprit humain de n'accepter qu'après bien des combats l'empire même du vrai, et de ne jamais vouloir en subir le despotisme. La distinction de l'âme et du corps, démontrée par Platon, et surtout par Descartes, n'en sera pas moins toujours contestée, comme toutes les grandes vérités desquelles relève le destin de l'homme. Ces vérités n'ont de valeur qu'autant qu'elles vi sont discutables ; elles ne s'imposent pas à notre raison comme les axiomes de la géométrie ; elles ne peuvent sauver l'homme, ou le perdre, que parce qu'elles peuvent être toujours, ou librement admises, ou librement rejetées. Les contradicteurs n'ont donc pas manqué à Platon ; et le plus illustre, comme le plus redoutable, fut son grand disciple. Aristote avait toutes les armes nécessaires pour soutenir la lutte : le génie d'abord, hautement reconnu, et développé même par son maître; les vastes connaissances; les enseignements de la philosophie antérieure; et les discussions prolongées vingt ans au sein de l'école qu'il devait combattre, sans compter les trésors d'un roi capable de comprendre ses études en les favorisant. Ce serait beaucoup exagérer que de croire qu'Aristote a confondu l'âme et le corps, comme l'ont fait plus tard de grossiers systèmes. Les erreurs de ces hautes intelligences diffèrent au moins par la forme de celles du vulgaire, quoiqu'elles portent les mêmes conséquences, avouées ou incertaines. Elles ont même ceci de plus dangereux, qu'elles se dissimulent sous des dehors admirables, et qu'elles se cachent à vii des profondeurs où les jeux les plus sagaces ne savent pas toujours les discerner. On a disputé longtemps, dans l'antiquité, au moyen-âge surtout, on peut encore disputer de nos jours, pour savoir ce qu'Aristote a pensé de l'avenir de l'âme. Des passages équivoques ont répondu dans l'un et l'autre sens, au gré des préjugés religieux ou philosophiques de ceux qui les interrogeaient. Susciter de pareilles controverses n'est pas absolument, comme on pourrait le croire, un privilège du génie. C'est plutôt la marque d'une de ses faiblesses. On ne discute point ce qui est évident; et si Aristote s'était prononcé plus nettement, si ses opinions eussent été plus arrêtées et plus fermes, elles n'eussent pas fourni matière à des interprétations si diverses. Qui a jamais demandé à Platon ce qu'il pensait de l'immortalité de l'âme? Qui a jamais demandé! à Aristote lui-même ce qu'il pensait de l'éternité du monde? On n'interroge que lorsqu'on doute. Mais s'il est des questions qu'on peut laisser dans l'ombre, soit qu'on les dédaigne, soit qu'on les oublie, ce ne doit jamais être que des questions secondaires. Sur les questions essentielles, il ne doit y avoir ni oubli ni obscurité. Les viii laisser douteuses, c'est ne pas les comprendre assez. L'opinion d'Aristote sur la distinction de l'âme et du corps ne nous apparaîtra donc point avec une entière netteté. Mais en interrogeant d'abord sa doctrine sur ce point spécial, puis surtout en interrogeant son système sur les conséquences qui découlent infailliblement de ce principe, selon qu'on l'affirme ou qu'on le nie, nous saurons à quoi nous en tenir; et l'accusation, puisqu'il faut nous résoudre à en élever une contre lui, reposera, nous le tâcherons du moins, sur des bases équitables. Voici d'abord sa théorie : L'histoire de l'âme, pour reproduire l'expression même dont il se sert, est l'une des études les plus graves que puisse entreprendre la philosophie. Elle exige des recherches profondes et difficiles, et l'objet qu'elle traite est grand et admirable. Ainsi, Aristote s'avoue toute l'importance des investigations auxquelles il va se livrer. Peut-être même il l'exagère un peu, ou du moins il la déplace ; car il affirme qu'on ne peut bien connaître la nature si l'on ne connaît l'âme, qui est, selon lui, le principe des êtres animés, la partie principale des êtres vivants. ix Il se propose donc de rechercher et quelle est l'essence de l'âme, et quelles sont ses qualités. Mais il ne veut pas se borner, comme on l'a fait avant lui, à étudier l'âme de l'homme; ce n'est point un champ assez large; c'est à l'ensemble des êtres organisés, depuis le végétal jusqu'aux animaux les plus élevés dans l'échelle de la vie, qu'il demandera les faits qui doivent fonder son système. Qu'on s'arrête avec quelque attention sur ce premier principe ; car c est de la que sont sorties toutes les erreurs d'Aristote. Si l'âme de l'homme ne circonscrit pas nos f études, si l'on sort de la nature humaine pour interroger l'univers, ce n'est plus de la psychologie qu'on fait : c'est de la physiologie générale. La question est certainement agrandie ; mais elle est tout autre. Elle devient en outre tellement vaste, que le génie même court risque de s'y perdre. Bientôt la physiologie ne suffira pas plus que n'a suffi la psychologie; et en dédaignant d'étudier l'âme seule de l'homme, on sera bien près d'étudier l'âme du monde, et de tomber dans les abîmes où s'est égaré Timée, que l'on a critiqué avec tant de raison et de sévérité. L'histoire de l'âme ainsi entendue x est un préliminaire de l'histoire des animaux. Aussi les commentateurs n'ont pas manqué de mettre le Traité de l'Ame en tête de ces admirables et nombreux ouvrages qui composent l'histoire naturelle dans l'encyclopédie d'Aristote. Les commentateurs ont bien fait, et ils ont obéi à une tradition chère au Péripatétisme. Mais, il faut bien le remarquer : on a beau prétendre traiter de l'âme en général, c'est surtout de l'âme humaine qu'on s'occupera. Et la raison en est toute simple : c'est que l'âme de l'homme est celle qui est le mieux connue à l'homme. Les autres, s'il en est d'autres que la sienne, ou lui échappent, ou du moins restent bien obscures pour lui. Aristote ne fera donc pas précisément ce qu'il désire; quoi qu'il en dise, il sortira très peu de l'homme; et les faits étrangers qu'il viendra joindre aux faits purement humains, pourront bien faire briller son immense savoir; mais, loin d'éclaircir la question, ils ne feront que l'embarrasser. Certainement il est de frappants et intimes rapports entre l'homme et les êtres qui l'entourent: il se nourrit comme eux; quelques uns sentent à peu près comme lui. Mais n'est-ce pas assembler les choses les plus xi disparates que de confondre dans une seule étude les plantes, qui se nourrissent et ne sentent pas; les animaux, qui se nourrissent et qui sentent, mais qui ne pensent pas; et, enfin, l'homme, qui a seul le privilège de l'entendement, de cet entendement dont Aristote a fait la partie supérieure de l'âme? N'est-ce pas s'exposer à des confusions fatales ? Et une sage méthode ne s'en tiendrait-elle pas ici, bien plus encore que dans la politique, à ce précepte donné par le philosophe lui-même : « Quand on veut étudier la nature, c'est aux êtres complets qu'il convient de s'adresser, ce n'est point aux êtres inférieurs ? » (Voir la Politique, liv. 1, chap. ii, § 10.) Mais passons. Après avoir montré tout ce qu'a d'important l'étude de l'âme, Aristote indique, avec sa concision habituelle et avec la sûreté de son coup d'œil, les questions principales qu'il convient d'agiter. L'âme est-elle une substance? N'est-elle qu'une qualité? Est-elle simplement en puissance? ou est-elle une réalité complète ? Plus tard, il soutiendra qu'elle est une substance, qu'elle est en acte et non pas seulement en puissance; mais nous verrons en quel sens il prête à l'âme la substantialité xii et l'énergie. Puis, il se demande si l'âme possède quelque affection qui lui soit propre ou si plutôt toutes ses affections ne lui sont pas communes avec le corps. La sensation a besoin du corps évidemment ; la pensée n'en a pas moins besoin, bien qu'elle semble plus propre à l'âme que la sensibilité. L'âme est donc indissolublement unie au corps: elle ne peut pas plus être séparée de lui qu'on ne peut séparer d'un objet quelconque la forme qui le limite et le détermine. Les passions de l'âme, Aristote le remarque avec toute raison, sont toujours accompagnées de certaines modifications du corps; et de cette observation, qui est vraie et qu'eût approuvée Descartes, mais qui est incomplète, puisqu'il y a dans l'âme autre chose que des passions, que conclut Aristote? Que l'étude de l'âme appartient exclusivement au naturaliste, ou, comme nous le dirions aujourd'hui, au physiologiste. Et de peur qu'on ne s'y méprenne, Aristote explique ce qu'il entend par le naturaliste, et, pour parler grec, le physicien : c'est celui qui étudie les phénomènes en tant qu'ils sont unis à la matière ; c'est celui qui en étudiant l'âme, par exemple, ne la sépare point du corps auquel xiii elle est jointe. Le physicien est, à cet égard, au-dessous même de quelques artistes, de l'architecte, du médecin, qui étudient certaines modifications de la matière, indépendamment de la matière même ; au-dessous du mathématicien, qui étudie abstraitement d'autres modifications ; fort au-dessous, par conséquent, du métaphysicien, qui étudie plus abstraitement encore les propriétés générales de l'être. Sur ce point, il est impossible d'être plus clair que ne l'est Aristote. Suivant lui, l'étude de l'âme n'est qu'une partie de l'histoire naturelle; elle n'appartient en rien à la métaphysique, à la philosophie première. Ceci est une conséquence parfaitement rigoureuse de la définition posée dès le début. Si l'âme est le principe des êtres vivants, il faut l'étudier dans les êtres vivants ; l'homme apparemment n'est pas le seul être qui vive, le seul être animé et organisé. Adjugeons donc à la science qui étudie l'organisation des êtres l'élude du principe sans lequel les êtres ne seraient pas. Mais ici admirons Aristote : il vient de montrer toute l'étendue de son sujet; il en a fixé les détails et les limites ; il en a déterminé la méthode, par la nature même de xiv la science à laquelle il l'attribue. Cette science, l'histoire naturelle, il la possède comme personne ne l'a possédée avant lui, comme depuis lors personne peut-être ne l'a possédée. Il est aussi parfaitement sûr de ses forces que du chemin dans lequel il doit marcher ; et pourtant, il ne veut pas s'en remettre à lui seul. D'autres avant lui ont parcouru la même carrière; il les interrogera à la fois pour leur emprunter loyalement la vérité, s'ils l'ont découverte, et pour éviter prudemment leurs erreurs, s'ils en ont commis. Réserve bien rare dans le génie, qui croit en général immodérément à lui-même, et qui serait cependant bien plus puissant encore, s'il était plus modeste et s'il s'appuyait sur la tradition ! Aristote s'adresse donc à ses devanciers, et s'il les combat, ce n'est qu'après les avoir longuement consultés : il se sépare d'eux, mais il ne les omet pas. Depuis Thalès jusqu'à Timée, Platon, Xénocrate, il étudie et critique ses prédécesseurs, ses maîtres, ses condisciples. Deux facultés de l'âme ont surtout attiré leur attention : la sensibilité et le mouvement. Mais Aristote trouve qu'ils ne les ont bien expliquées ni l'une ni l'autre. Ces philosophes trop peu instruits ont cher - xv ché à définir le mouvement dans l'âme, comme ils le définissaient dans l'univers, ne voyant pas que dans l'âme, (l'âme humaine sans doute, malgré ce qu'en a dit plus haut Aristote) le mouvement tient surtout à cette force qu'on appelle la volonté et la pensée. En outre, ils ont pris les modifications de l'âme «pour des mouvements en elle : sentir, penser même, s'attrister, se réjouir, espérer, craindre, s'indigner, ce ne sont pas là des mouvements de l'âme ; ce sont des mouvements qui n'appartiennent qu'au corps, se développant avec lui, se flétrissant et mourant avec lui. Quant à l'intelligence proprement dite, elle donne si peu le mouvement qu'elle est c un principe impassible, tout divin, tout indestructible qu'il est. L'intelligence même ne pense, ne sent, n'aime, ne se souvient, qu'en compagnie du corps. Les modifications de l'âme, qu'on prend pour des mouvements, ne sont donc pas proprement à elle. Si les philosophes antérieurs ont commis cette erreur, c'est qu'ils n'avaient pas assez étudié le corps ; ils ne s'étaient pas assez rendu compte des conditions qu'il doit remplir pour être uni à l'âme. Ils n'ont pas mieux compris la sensibilité. L'âme, pour connaître les choses, xvi n'a pas besoin d'être semblable aux choses ; ni surtout, comme l'ont imaginé quelques esprits grossiers, d'être les choses mêmes. Il n'y a point entre l'âme et les êtres qu'elle connaît cette insoutenable identité. De plus, Aristote9 comme son maître dans le Phédon, fait justice de cette opinion que l'âme est l'harmonie du corps, métaphore inexacte donnée pour une explication scientifique. Il n'est pas moins sévère pour cette autre métaphore plus vide encore, qui fait de l'âme un nombre qui se meut lui-même. Enfin, il termine cet examen rapide des théories qui ont précédé la sienne, en les accusant d'être incomplètes, parce qu'elles n'ont pas étudié l'âme dans toute sa généralité. La sensibilité, le mouvement, n'épuisent pas les facultés de l'âme. La plante a une âme puisqu'elle se nourrit, et pourtant elle ne sent ni ne se meut. Certains animaux, qui sentent, sont immobiles. Leur refusera-t-on une âme ? Et s'ils en ont une, pourquoi l'a-t-on oubliée, dans des systèmes qui ont la prétention d'expliquer l'âme tout entière ? A ces théories insuffisantes il faut en substituer une plus vaste et plus exacte. Et d'abord, Aristote s'occupe de donner la dé- xvii finition de l'âme. Quelle est cette définition ? On peut, d'après ce qui précède, le deviner presque sans peine. Tout être, toute substance se compose de trois éléments, qu'y peut distinguer la raison : la matière d'abord, qui n'est par elle-même rien de déterminé, et n'est qu'une simple puissance; la forme, qui détermine l'être, lui donne un nom, le fait ce qu'il est ; puis en troisième lieu, l'être lui-même, composé de la matière et de la forme, l'être tel que nos sens nous le montrent. Que peut donc être l'âme ? Évidemment, elle ne peut être que la forme du corps, non pas du premier corps venu, comme l'ont dit les Pythagoriciens et quelques autres, mais d'un corps formé par la nature, et doué par elle d'organes qui le rendent capable de vivre. L'âme, en venant se joindre à la matière organisée, lui apporte donc actuellement la vie. De la simple puissance, elle la fait passer à la réalité entière et complète. L'âme est donc l'achèvement du corps, sa perfection, son acte, et, pour parler la langue aristotélique, son entéléchie. De là il résulte que l'âme ne se confond pas plus avec le corps, que la cire ne se confond avec l'empreinte qu'elle reçoit, pas plus que la matière d'une xviii chose quelconque ne se confond avec cette même chose. L'âme est l'essence du corps qui sans elle n'est plus ce qu'il est, tout comme un œil de pierre, un œil en peinture n'est pas un œil véritable. L'âme n'est pas tout-à-fait le corps; elle est quelque chose du corps ; mais elle n'en peut être séparée, et Aristote n'ose même pas dire qu'elle y soit distinctement, comme le marin est dans le vaisseau qu'il gouverne. Voilà donc la définition de l'âme ; et le philosophe qui a fait sur la définition en général la grande théorie déposée dans les Analytiques, veut prouver que celle-ci est irréprochable. A ses yeux, elle remplit la condition essentielle de toute bonne définition : elle contient la cause. L'âme ainsi comprise est la cause du corps vivant; c'est elle qui, en lui donnant la vie, le fait ce qu'il est. Elle la lui donne par quatre facultés diverses ; la nutrition, la sensibilité, l'intelligence, la locomotion. Partout où l'on voit j l'une de ces facultés, on peut affirmer qu'il I y a vie, qu'il y a une âme. Ces facultés, du reste, se répartissent très inégalement entre les êtres vivants. Les uns n'en ont qu'une : ainsi, les plantes n'ont que la faculté de nutrition, n'ont que l'âme nutritive ; d'autres xix êtres jouissent de toutes les facultés réunies : tel est l'homme. Ajoutez que ces facultés se subordonnent entre elles dans une série parfaitement régulière. La nutrition peut être isolée de toutes les autres; mais la sensibilité, qui est le caractère propre et premier de l'animal, ne l'a jamais sans la nutrition ; la locomotion suppose nécessairement la sensibilité, comme celle-ci suppose la nutrition. Enfin, l'intelligence implique toutes les facultés inférieures. Je n'insiste pas sur la grandeur et la vérité de ces considérations physiologiques. On sait assez ce qu'on peut attendre de l'auteur de l'Histoire des Animaux. Tout ce qu'il convient de remarquer ici, c'est qu'Aristote fait de l'âme la cause directe de la nutrition et de la génération, destinées, l'une à conserver l'individu, l'autre à perpétuer la race» Il réfute les philosophes qui ont attribué au seul élément du feu ce grand acte de la nutrition. Certainement, sans la chaleur, la nutrition n'est pas possible; et voilà pourquoi tous les êtres vivants sont pourvus d'une certaine chaleur. Mais c'est l'âme qui est la cause absolue de la nutrition. C'est elle qui nourrit le corps au moyen des aliments qu'elle lui assimile. C'est elle xx qui, tout en le développant, lui conserve néanmoins sa figure, tandis que le feu, s'il était seul chargé de cette fonction, accroîtrait cette figure sans règle et sans limites. Après la théorie de la nutrition, vient la théorie de la sensibilité, dont j'apprécierai plus tard l'admirable méthode. Aristote étudie chacun des sens dans l'ordre suivant : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Laissons de côté tous les détails, et attachons-nous uniquement à l'idée générale qu'il se fait de la sensibilité. La sensibilité, pour Aristote, est une simple puissance, une faculté qui peut toujours agir, bien qu'elle n'agisse pas toujours. La sensation n'est donc pas tout-à-fait une altération. comme on l'a dit souvent ; c'est un acte qui complète l'être qui l'éprouve; en sentant, il développe la faculté qui est en lui, il réalise ce qu'il peut. Ainsi, dans la sensation^ l'être ne souffre pas; il agit. De plus, comme, dans la sensation, il y a toujours et nécessairement un objet senti, il faut admettre que l'être sensible est en puissance à peu près comme est en réalité l'être senti. Avant de sentir, il est dissemblable à l'être qu'il sent; après avoir senti, il est, eu quelque façon, pareil à lui. La sensibilité xxi est donc ce qui reçoit la forme des objets sensibles, sans la matière même de ces objets. C'est comme la cire, qui reçoit l'empreinte de l'anneau sans le fer ou l'or dont l'anneau est composé. La sensibilité ne devient pas précisément chacun des objets qui agissent sur elle; mais elle devient quelque chose d'analogue ; et ce quelque chose, il n'y a que la raison qui puisse le comprendre, c'est-à-dire que le phénomène n'a rien de matériel. L'objet n'est point véritablement sensible tant qu'il n'est pas senti ; la sensibilité, de son côté, n'est qu'une puissance tant qu'elle ne sent pas. L'acte de l'objet senti et l'acte de la sensibilité se confondent donc et sont indissolubles. De là, un rapport, une sorte d'harmonie nécessaire entre le sens et l'objet. Une sensation trop violente n'est pus perçue. La sensibilité est, à proprement parler, une moyenne : en-deçà d'un certain point, ou au-delà, elle n'agit plus. Mais l'homme n'a pas seulement la faculté de sentir, il a en outre la faculté de sentir qu'il sent. Il sent qu'il voit, il sent qu'il entend. Est-ce par la vue qu'il sent qu'il voit, ou bien est-ce par un autre sens ? C'est par la vue ; ou, pour mieux dire, les perceptions de la vue, comme celles de tous xxii les autres sens, aboutissent les autres sens, aboutissent à un centre, à un point unique, qui leur sert à toutes de limite commune, qui les compare et les mesure en un instant indivisible comme l'est ce point lui-même, indivisible comme l'est le principe qui perçoit et qui sent. Telle est la théorie de la sensibilité. Elle n'offre pas la moindre trace, comme l'on voit, de ces espèces sensibles, de ces images, de ces idées représentatives, comme dirait Reid, sans lesquelles, a-t-on répété souvent, Aristote n'aurait pu expliquer la perception. Je ne dis pas qu'avant lui quelques philosophes, Démocrite et d'autres, n'aient point supposé l'intervention d'images partant des objets, et aboutissant à l'esprit pour lui faire comprendre les objets. Je ne dis pas qu'après Aristote, ses commentateurs, et les Scholastiques surtout, ne lui aient point prêté, en cherchant à le comprendre, les opinions que Reid a combattues et renversées. Mais je crois pouvoir affirmer que ces opinions ne sont pas celles d'Aristote. Il s'est servi d'une métaphore pour expliquer la perception ; et l'usage de la métaphore, qu'il a lui-même formellement proscrit en philosophie, ne lui a point porté bonheur, puisqu'elle a pu donner le change sur sa vé xxiii ritable pensée. Mais il n'est pas allé au-delà. En observateur parfaitement fidèle, il a constaté les faits; il n'en a pas inventé. Devant ce grand mystère de la perception, il s'est arrêté avec une prudence que n'a point dépassée la prudence écossaise. Reid s'est contenté, après avoir montré toute l'inexactitude des théories antérieures, de protester contre elles, sans prétendre leur en substituer une plus complète ; il a déclaré que la perception, avec tous les caractères qu'il lui a reconnus, est un fait irréductible à tout autre. Sous une forme différente, avec moins de profondeur et de délicatesse d'analyse, Aristote a dit précisément comme Reid : « Nous éprouvons dans la sensation une modification que la raison seule peut concevoir. » Aristote, il est vrai, a poussé plus loin que Reid en ajoutant que, dans la perception, l'être qui perçoit devient en quelque manière conforme à l'être perçu. La remarque est peut-être plus ingénieuse que solide ; mais ce n'est pas la faute d'Aristote si, plus tard, on a tiré de ses théories des conséquences qu'il n'y avait point mises, qui les contredisaient même. Il n'a pas plus admis la doctrine des idées-images, des idées représentatives; qu'il n'admettait cette xxiv confusion de la sensation et de la pensée, qu'où lui a tant de fois attribuée, et qu'il réfute à plusieurs reprises dans le Traité même de l'Ame. Reid a certainement rendu un service réel à la science en la débarrassant d'une hypothèse, source de tant d'erreurs, partagées par les plus beaux génies, par Descartes entre autres. Mais cette erreur, Aristote ne l'a pas commise, ses théories ne la contiennent pas; et s'il y a erreur, ce n'est que dans l'accusation portée par Reid. Ce qui peut-être a trompé le philosophe écossais, c'est qu'Aristote a dit que l'intelligence ne peut penser sans le secours de l'imagination, et que les images sont pour l'intelligence des espèces de sensations. Mais que Reid se rassure. Aristote a séparé profondément l'imagination, de la sensation, tout comme il la sépare de l'intelligence. L'imagination est pour lui ce qu'elle est pour Reid et pour nous : une faculté toute volontaire, qui évoque sous les yeux de l'esprit la représentation immatérielle de certains objets, les combine suivant son caprice, et n'a rien de cette fatalité qui pèse sur la sensation, et sur la perception, suite nécessaire de la sensation. La théorie de l'imagination dans Aristote est obscure, et peut fournir xxv l'occasion de plus d'un malentendu; mais s'il est un point qu'il ait mis en une pleine lumière, c'est que l'imagination, bien qu'elle s'appuie sur la sensation, en est parfaitement distincte. Ce qu'Aristote a dit de l'imagination ne concerne donc qu'elle seule; et si Reid l'a étendu jusqu'à la perception, c'est Reid qui doit être encore ici responsable de cette méprise. Nous touchons à la plus grave de toutes les théories qui sont développées dans le Traité de l'Ame : celle de l'entendement. En l'abordant, le style d'Aristote, habituellement déjà si austère, prend je ne sais quel nouveau degré d'austérité. L'entendement, l'intelligence est un principe divin, impérissable, éternel; et c'est ce principe qui rattache l'homme à tout ce qu'il y a de supérieur à lui. Le ton du philosophe, sans cesser d'être simple comme toujours, devient solennel comme au douzième livre de la Métaphysique, où il a parlé d'un sujet presque pareil. Seulement, au Traité de l'Ame, il s'agit de l'entendement dans l'homme, et non plus de l'entendement en Dieu. D'abord Aristote veut distinguer de toute autre partie de l'âme, cette partie qui pense xxvi et qui comprend la sagesse. Si matériellement elle n'est pas séparée des autres, rationnellement du moins on peut l'en isoler; et c'en est assez pour l'étudier dans toute sa dignité. Quelle que soit la distance qui sépare la sensibilité de l'intelligence, et Aristote a fait cette distance aussi grande que personne, l'intelligence procède cependant à peu près comme la sensibilité. Pour elle, l'objet intelligible est ce que l'objet sensible est pour la sensation. L'intelligence aussi reçoit la forme des objets intelligibles. Comme la sensibilité, elle n'est qu'une simple puissance. Avant de penser, elle n'est pas; elle n'est vraiment intelligence qu'au moment même où elle pense l'objet intelligible; et réciproquement, l'objet ne devient intelligible qu'au moment même où il est pensé par l'intelligence. Mais si à ce point de vue la sensibilité et l'intelligence se rapprochent, voyez d'ailleurs toute leur différence. La sensation, quand elle est trop vive, ne peut être perçue : elle accable et dépasse l'organe; au contraire l'objet intelligible, plus il est intelligible, mieux l'intelligence le comprend. En outre, la sensibilité ne s'exerce jamais qu'avec le corps; l'intelligence, au contraire, en est séparée. Préci - xxvii sèment parce qu'elle est devenue, en quelque sorte, les choses qu'elle pense, c'est elle-même qu'elle pense en les pensant. L'intelligence n'en reste donc pas moins parfaitement impassible; elle ne se mêle à quoi que ce soit ; elle demeure pure de tout mélange, comme l'a si bien dit Anaxagore. La sensation nous fait connaître tel corps particulier qui est étendu, telle grandeur particulière; l'intelligence connaît la grandeur. Une grandeur réelle, spéciale, et la grandeur en général ne sont pas du tout identiques ; ce ne sont pas des facultés identiques de l'âme qui les perçoivent l'une et l'autre. Si c'est toujours l'âme qui connaît l'abstrait, comme elle connaît le concret, c'est du moins l'âme disposée d'une façon tout autre. L'intelligence, quand elle pense un objet, ne souffre pas plus de cet objet que la sensibilité ne souffre de l'objet sensible. L'intelligence aussi passe de la puissance à l'acte ; elle se complète, elle s'achève, loin de s'altérer; et comme l'objet auquel elle s'applique est absolument immatériel, la pensée et l'objet qu'elle pense ne sont au fond qu'un seul et même objet. Les choses intelligibles sont bien toujours dans les choses matérielles ; mais elles n'y sont qu'en puis- xxviii sance. L'intelligible en réalité, en acte, n'est vraiment que dans l'intelligence; car c'est elle qui le fait. Si donc, dans la nature, il faut distinguer toujours la matière qui peut indifféremment être tout, et la cause qui la fait réellement ce qu'elle est; de même dans l'intelligence, il faut distinguer, et cette partie qui peut devenir toutes choses, comme la matière, et cette autre partie qui rend et fait toutes choses intelligibles. Il y a donc une partie de l'intelligence qui est passive, et celle-là est périssable; mais il y a une autre partie qui est active, et celle-là seule est immortelle et éternelle. Mais, comme elle est impassible, elle ne nous donne pas la mémoire. Est-il besoin de dire que l'intelligence active est supérieure et antérieure à l'intelligence passive? que l'acte de l'intelligence est indivisible, et que de plus il est infaillible, quand l'intelligence ne s'applique qu'à ce qui lui est propre, aux choses abstraites, aux essences, et qu'elle n'affirme d'une chose que la chose même ? Mais cette intelligence, qui fait ainsi les intelligibles et les sépare de la matière, peut-elle exister elle-même et penser indépendamment de toute matière? Grande question qu'Aristote pose, xxix mais ne résout pas. Ajoutez un dernier trait : l'intelligence tient à la sensibilité par la ressemblance du procédé qu'elle suit; elle y tient bien plus encore en ce que c'est à la sensibilité qu'elle emprunte ses premiers matériaux. Sans la sensibilité, point d'imagination ; sans l'imagination, point d'intelligence. La sensation est la forme des objets sensibles; l'intelligence sera la forme des formes; elle agira sur les images comme la sensibilité agit sur les objets matériels. Nous savons ce qu'est l'âme, selon Aristote, dans la nutrition, dans la sensibilité, dans l'intelligence. Il ne nous reste plus qu'à savoir ce qu'elle est dans la locomotion. Un mot suffira. Le philosophe reprochait à ses devanciers d'avoir mal expliqué le mouvement dans l'âme; il aurait voulu qu'on insistât davantage sur le pouvoir spécial de la volonté et de la pensée qui meut le corps. Mais lui-même, oubliant bientôt cette juste critique, insiste fort peu sur ce pouvoir; il signale bien la pensée et l'appétit ( pour prendre ici son langage), comme les deux causes du mouvement ; mais il atténue beaucoup l'action de l'âme. C'est à l'objet extérieur, désiré par l'âme, qu'il transporte presque toute la causalité. L'objet désiré xxx est le moteur immobile, qui attire l'animal et le met en mouvement: théorie identique à cette théorie fameuse de la Métaphysique qui fait de Dieu le moteur immobile de l'univers, attirant tout le reste à lui par le désir et l'amour. L'intelligence, la volonté sont des moteurs sans doute, mais des moteurs qui sont eux-mêmes mobiles, c'est-à-dire, qui ont besoin de recevoir le mouvement, qu'ils communiquent et ne font pas. Nous sommes maîtres maintenant de toute la théorie d'Aristote. Certes ce n'est ni la grandeur, ni la nouveauté, ni surtout la sagacité, qui lui manquent. Mais est-elle aussi vraie qu'elle est étendue ? Est-elle surtout complète ? Malgré tous les faits qu'elle contient, n'en omet-elle pas encore davantage? Si elle nous donne de grandes et nombreuses vérités, ne renferme-t-elle pas aussi des erreurs? Tient-elle bien tout ce que promet un Traité de l'Ame, surtout quand ce traité est de l'auteur de la Logique, de la Métaphysique, de la Morale et de l'Histoire des Animaux? On peut demander d'abord à Aristote ce qu'il sait de l'âme des plantes et de celle des animaux. Dans les plantes, la vie est profondément obscure, précisément par cette xxxi circonstance qu'Aristote lui-même a signalée : la plante n'a qu'une seule des quatre facultés constitutives de la vie, la nutrition. Les phénomènes par lesquels la vie se révèle dans la plante sont donc très peu nombreux, et voilà pourquoi nous en savons si peu de chose. Pour les animaux, les laits se multiplient ; car les animaux ont comme nous la nutrition, la sensibilité, la locomotion, et une sorte d'intelligence bâtarde qu'on appelle l'instinct. Et pourtant, que savons-nous des animaux? Nous pouvons observer leurs formes et leurs mœurs, décrire leurs habitudes et leurs organes, classer leurs espèces et leurs genres. Aristote le sait mieux que qui que ce soit. Mais, quant à la vie qui est en eux, quant au principe qui les anime et les fait mouvoir, qu'en connaissons-nous ? Nous ne le connaissons point absolument eu lui-même. Nous en voyons de merveilleux effets ; mais de ces effets, quand ils ne suffisent pas à notre curiosité, comment remontons-nous à la cause ? Par des hypothèses, qui sont plus ou moins ingénieuses, mais dont aucune ne peut fonder la science. Que si de la plante et des animaux, nous nous élevons jusqu'à l'homme, sommes-nous encore réduits au même doute? L'homme est-il aussi xxxii obscur pour nous, c'est-à-dire pour lui-même, que la plante ou l'animal? Certes l'homme ne se connaît pas tout entier : il reste encore en lui d'impénétrables ténèbres. Mais il n'est point tout obscurité ; il possède une lumière intérieure qui, comme le dit Aristote admirablement inspiré, «n'a besoin que de paraître pour éclipser de son éclat tout objet étranger. » Cette lumière, c'est l'intelligence. Elle projette ses rayons sur les choses du dehors, et c'est elle seule qui nous les fait connaître. Mais, de plus, elle a la puissance de réfléchir ses rayons sur elle-même, et l'intelligence se connaît bien mieux encore qu'elle ne connaît le reste. Je ne dis pas que l'homme se comprenne parfaitement, qu'il se sache pleinement et sans réserve ; mais je dis que l'homme se comprend mieux qu'il ne comprend les autres êtres; ceux-là, il ne les comprend pas, à proprement parler, il les devine. S'il se meut lui-même, il sait que c'est par l'acte d'une volonté qui lui est personnelle, qui est libre, d'une volonté indépendante de tout, en ce sens que, si tout peut agir sur elle, rien ne peut jamais la contraindre. Mais quand il voit les animaux se mouvoir, sait-il précisément la cause qui xxxiii les détermine à l'action ? Il la suppose pareille à celle qu'il porte en lui, du moins dans une certaine mesure; mais c'est une simple supposition; nous ne pouvons pas légitimement affirmer que la volonté soit dans les animaux absolument ce qu'elle est en nous. Il y a donc entre ces trois ordres d'êtres, qu'Aristote prétend soumettre à une même et seule théorie, des différences considérables. La plante, l'animal, l'homme, nous sont très diversement connus, et très inégalement. Ce qu'il y a de commun entre ces trois ordres d'êtres, c'est qu'ils sont tous animés d'un principe qui les fait « naître, se développer et mourir.» Ce principe, c'est ce qu'on appelle la vie; et précisément comme l'homme est le plus parfait de tous les êtres, il réunit en lui les facultés qui sont éparses dans les autres. L'homme vit bien comme les plantes, comme les animaux ; mais à cette vie commune il en joint une autre qui n'est qu'à lui seul. Cette vie spéciale et privilégiée, c'est son âme qui la lui donne. Aristote a donc commis une bien grave erreur en confondant l'âme et la vie, en comprenant sous une seule défini- xxxiv tion et l'âme des plantes, et l'âme des animaux, et l'âme de l'homme. « Mais, dira-t-on peut-être, c'est une simple différence de mots; Aristote donne le nom d'âme à ce que vous appelez la vie. » Cette objection n'a pas la moindre force, puisque Aristote comprend l'intelligence dans la vie telle qu'il la décrit. Certes il ne voudrait point confondre l'intelligence avec la nutrition, puisqu'il ne veut pas même la confondre avec la sensibilité. Ses études sur les sens, sur l'imagination, sur l'intelligence, prouvent incontestablement que c'est une théorie de l'âme qu'il a prétendu faire, de l'âme comme tout le monde l'entend. Seulement, il a prêté à l'âme la faculté la plus infime de toutes, si d'ailleurs elle est matériellement la plus indispensable, la nutrition ; et selon lui, l'homme, dans cette fonction, n'est pas plus que la plante. Mais on peut encore ici combattre Aristote par Aristote lui-même. «L'homme, a-t-il dit, n'a pas seulement la faculté de sentir, il a de plus le privilège de sentir qu'il sent. » L'homme sent donc en lui la sensibilité, qui le met en relation avec le dehors, tout comme il sent la pensée, qui le met en rela- xxxv tion avec lui-même. Comment Aristote n'a-t-il pas remarqué que l'homme ne sent pas du tout ainsi la nutrition? La nutrition a-t-elle en nous ce caractère d'activité dépendante de nous, qu'Aristote à signalé avec une analyse si perçante dans l'intelligence et la sensibilité? Nous ne sommes pas tout certainement dans l'acte de la sensation et de l'entendement ; mais nous y sommes pour beaucoup. Sommes-nous pour quelque chose dans la fonction de la nutrition? La réponse ne peut être un seul instant douteuse : nous n'y sommes absolument pouf rien. Nous n'intervenons pas plus dans notre propre nutrition que nous n'intervenons dans la nutrition de la plante. L'âme, telle que nous la sentons en nous, sensible, intelligente, volontaire, est donc essentiellement distincte de cet autre principe qui fait vivre notre corps, le nourrit et le fait végéter. Assimilons, si vous le voulez, la nutrition dans l'homme à la nutrition dans la plante; reconnaissons de part et d'autre une fonction toute pareille, et même des organes analogues, quelque différents qu'ils soient. Mais à aucun prix, si nous tenons à observer exactement les faits, ne confondons le principe qui sent et pense avec le principe xxxvi qui nourrit. Ne les confondons pas même dans l'homme, où nous les voyons réunis ; ne les confondons pas davantage dans l'homme et dans la plante, où nous les voyons si manifestement séparés. Aristote a donc méconnu le caractère propre de l'âme, en voulant étendre son domaine? Non; l'âme de l'homme, en tant qu'il lui est donné de se connaître elle-même, n'a pas conscience de soi ailleurs que dans l'intelligence et la sensibilité. C'est là ce qui fait que ces philosophes antérieurs, qu'Aristote a blâmés, se sont bornés à l'âme de l'homme. Guidés par un sûr instinct, ils n'avaient pas tort de n'étudier en elle que la sensibilité et le mouvement : ils les étudiaient mal, ou l'accorde; mais ils avaient toute raison de n'y point étudier la nutrition. Aristote, sans aucun doute, analyse mieux que ses devanciers les opérations des sens et celle de l'entendement ; mais il • se trompe, lorsque, prétendant agrandir le cercle de son étude, il la dénature et l'obscurcit. Voyez les terribles conséquences de cette première erreur. Précisément parce qu'au fond l'homme n'est pour rien dans la nutrition, Aristote sera conduit, peut-être mal- xxxviii gré lui, à refuser à l'âme toute substantialité. La sensibilité, l'entendement même, en dépit de la haute estime qu'il en fait, ne sont que de simples puissances, des facultés latentes et inertes, attendant d'une excitation extérieure, sans laquelle leur acte n'est pas possible, la réalisation de la virtualité qu'elles ont en elles, mais qui ne s'exerce pas. L'intelligence et la sensibilité sont donc en nous comme si elles n'étaient point ; et, si l'extérieur ne venait les provoquer et les faire vivre, elles pourraient nous demeurer à nous-mêmes perpétuellement inconnues. Aussi Aristote n'hésite-t-il pas à dire que l'intelligence n'est pas autre chose que la succession même des pensées (Traité de l'Ame, livre I, chap. iii, § 13), principe fatal qu'ont répété, ou que peut-être ont de nouveau découvert Spinoza et Hume, qui en ont tiré les systèmes déplorables que l'on connaît. Ainsi l'âme, selon Aristote, n'est point une véritable substance. Elle est .aveugle dans la nutrition, et morte, pour ainsi dire, dans cette fonction où elle s'ignore. Existe-t-elle davantage dans la sensibilité et l'intelligence, dont les actes passagers ne lui donnent qu'une existence passagère comme eux ? xxxviii Certes, voilà déjà une conséquence bien grave d'un faux principe; en voici une seconde qui l'est tout autant. Dans un traité sur l'Ame, conçoit-on qu'on oublie la théorie des facultés morales? Conçoit-on que l'on parle des facultés sensibles et intellectuelles, sans rien dire de la loi supérieure qui est destinée à régler l'exercice des unes et des autre? Il est vrai qu'Aristote a traité de la morale dans un autre ouvrage; que, dans cet ouvrage, après avoir fixé le but même de la vie humaine, il a fait des vertus et des passions une analyse pleine de science et de vérité. Il est vrai qu'il y a indiqué, comme la source de la loi morale, le principe intelligent et divin que l'homme porte en lui, et qui seul nous donne le discernement du bien et du mal. Mais, si dans son traité, la morale, Aristote n'a point absolument omis cette faculté de l'entendement, il ne lui a point consacré une étude suffisante. Dans le Traité de l'âme, où cette étude était à sa vraie place, il l'a tout-à-fait négligée; et, sauf un seul mot, un mot unique, qu'on peut regarder comme une bien obscure réserve (Voir Traité de l'âme, liv. lII, chap. iv, § i), il n'a rien dit de la conscience morale dans l'homme. Sans doute, xxxix il ne l'a pas niée; mais, si l'on ne connaissait que le Traité de l'âme, on pourrait croire qu'il l'a presque complètement ignorée; et ce qu'il en dit ailleurs ne peut point réparer cette regrettable lacune. C'est qu'en attribuant à l'âme des facultés inférieures qu'elle n'a pas, on compromet les facultés supérieures qu'elle possède, et que les autres excluent. On peut jusqu'à un certain point accorder l'intelligence au principe qui accomplit les merveilleuses opérations de la nutrition, et Stabl n'a pas manqué de la lui accorder; mais il est impossible, quoi qu'on fasse, de découvrir en lui la moralité. S'étonnera-t-on maintenant qu'après avoir méconnu la substantialité de l'âme, après avoir omis ses facultés morales, lui avoir enlevé presque entièrement l'initiative du mouvement, Aristote hésite et chancelle dans cette grande question de l'immortalité? Il a bien dit que l'entendement était un principe divin dans l'homme, indestructible, éternel. Il a bien dit aussi que ce principe était en nous une véritable substance. Mais quelle substance ? Nous l'avons vu : dans l'entendement lui-même, il y a une partie périssable, comme sont pé- xl rissables l'imagination, la sensibilité, la nutrition : et cette partie, c'est la partie passive, celle qui est, en quelque sorte, la matière de l'intelligible. L'intelligence active, celle qui fait l'intelligible, survit éternellement au corps, qui seul doit périr. Mais dans cette vie nouvelle, il ne reste rien de la personnalité humaine, de cette personnalité sans laquelle l'immortalité de l'âme n'est qu'un vain mot et un leurre. Et pourquoi ? C'est que l'intelligence active est un principe impassible; par conséquent, selon Aristote, il ne peut nous donner la mémoire, que le concours du corps peut seul nous assurer, et sans laquelle il n'y a point de personnalité véritable. Voilà toute la doctrine du Traité de l'Ame sur l'immortalité; et pour qu'il n'y ait pas de doute possible, Aristote n'a pas dit un seul mot de Dieu, ni des rapports que l'âme de l'homme soutient avec la cause intelligente et supérieure d'où elle vient. Certes, en présence d'une telle doctrine, il a fallu beaucoup de bonne volonté pour soutenir qu'Aristote avait cru à l'immortalité de l'âme. Dans les premiers temps de l'Eglise, la plupart des Pères subissaient eu partie la pensée aristotélique, quand ils xli faisaient l'âme corporelle. Plus tard, l'Eglise a cru devoir faire prouver que le maître de l'École professait, sur un point aussi essentiel, des croyances qui s'accordaient avec l'orthodoxie. Mais le Traité de l'Ame ne renferme point ces croyances, si d'ailleurs il ne les contredit pas formellement. Pour saisir la vraie pensée d'Aristote, il convient aussi d'interroger ses disciples, ses successeurs, ses commentateurs les plus autorisés : Aristoxène, Dicéarque, Straton, Alexandre d'Aphrodise, auxquels vous pouvez joindre Averroès, Pomponat et leurs partisans. Tous répondront unanimement que l'âme est mortelle, et ne survit point au corps. Ajoutez que c'est là une conséquence évidente et nécessaire de cette théorie qui fait de l'âme la forme du corps. Il n'est pas très difficile de reconnaître que la forme ne peut subsister par elle-même sans la matière qu'elle détermine, et qu'elle périt avec cette matière. Après l'âme qui meurt, reste, il est vrai, cette partie divine et immortelle qui est l'intelligence active. Mais cette parcelle de Dieu accordée à l'homme, que peut-elle devenir à la mort ? Elle ne peut que se confondre avec la substance infinie, dont elle avait été un instant détachée. Je xlii ne voudrais pas prêter au Péripatétisme des opinions qu'il n'a point exposées. Mais cette théorie qui condamne l'intelligence active à s'abîmer dans l'âme du monde est en germe dans les théories d'Aristote. Elle a été certainement adoptée par ses disciples ; et c'est d'eux peut-être que la reçut le Stoïcisme, et plus tard l'École d'Alexandrie, sans parler d'Averroès qui identifie l'intelligence active de l'homme et l'intelligence universelle. Aristote a combattu les philosophes qui voulaient faire de l'âme un composé de tous les éléments; il a combattu ceux qui croient que l'âme est répandue dans l'univers entier. Mais n'inclinait-il pas lui-même à cette erreur en réservant à l'intelligence active, impérissable et divine, un avenir sans personnalité, une existence éternelle qui ne peut se distinguer de celle même de Dieu ? N'est-ce pas reproduire Timée après l'avoir réfuté? Il est, je le sais, d'autres ouvrages d'Aristote où sou opinion est plus développée, et où sa croyance à l'immortalité de l'âme peut paraître assez précise. Ou pourrait alléguer surtout quelques passages de la Morale à Nicomaque ( Voir Liv. I, ch. xi, et Liv. X, ch. vii ). Mais dans ces passages xliii mêmes, sa pensée reste encore bien obscure; et il a soin d'annoncer qu'il ne voudrait point se mettre en contradiction avec les opinions communément reçues. C'est une concession qu'il croit devoir faire; ce n'est point une conviction qu'il exprime. Condescendre aux faiblesses du vulgaire, c'est ne pas les partager; et ce n'est point faire tort au fondateur du Péripatétisme, de croire que la doctrine du Traité de l'âme est la seule qu'il reconnaisse et avoue pour sienne. Enfin, sachons signaler une dernière conséquence qui n'est pas moins fâcheuse que toutes celles qui précèdent. Aristote a bien dit que l'intelligence, en pensant l'intelligible, se pensait elle-même, parce que c'est elle qui fait l'intelligible. Suivant lui, il faut toujours à l'intelligence un objet différent d'elle, qu'elle s'assimile en quelque sorte, et qu'elle peut alors comprendre sous la loi de sa propre activité. Mais Aristote n'a jamais dit qu'elle eût conscience de soi indépendamment de tout intelligible. Ceci est tout simple. Du moment qu'un refuse à l'âme d'être une substance, l'intelligence peut bien être actuellement quelque chose quand l'intelligible provoqué par l'extérieur xliv apparaît en elle ; mais sans la présence de l'intelligible, elle n'est pas : elle ne subsiste pas. L'âme donc ne réfléchit point ; elle n'a pas la puissance de revenir sur elle-même, de s'analyser, de se connaître dans ce qui n'est absolument qu'elle toute seule. Si l'âme n'a point ce pouvoir, si la réflexion et la conscience ne lui appartiennent pas, sur quelle base alors repose la philosophie ? sur quel fondement s'appuie la science ? S'il est un point que le génie de Platon se soit efforcé de mettre en lumière, c'est celui-là sans contredit. C'est qu'en effet ce point renferme en lui seul tout le secret de la méthode philosophique. Descartes, plus tard, quand il a de nouveau mis à nu, dans les profondeurs de la conscience, cette inébranlable assise de toute certitude, a pu faire mieux que Platon; mais il n'a pas fait autre chose. Voilà ce premier principe que la sagesse antique avait entrevu et découvert à demi, et sur lequel elle assurait ses plus fermes théories, sans le bien connaître encore; voilà le premier principe que le réformateur de la philosophie moderne a rendu désormais indiscutable, et qui demeure sacré à tout esprit qui veut t>e comprendre lui-même. L'âme ainsi repliée en xlv soi, y découvre tout d'abord la pensée, qui la constitue et la distingue profondément de tout ce qui n'est pas elle ; elle y découvre ces lois intellectuelles et morales, qui la mettent, par une irrésistible évidence, en rapport avec le monde qu'elle comprend, et avec Dieu qui l'a faite. Ce premier principe, Aristote, j'ai vraiment peine à le dire, ne l'a pas connu ; il l'a passé sous silence dans le Traité de l'âme, dans tous ses autres ouvrages. Et voyez le résultat de cet oubli. Le système péripatéticien, tout admirable qu'il est dans les détails, quelques immenses services qu'il ait rendus à l'esprit humain, quelque scientifique qu'il soit, est sans base. Aristote a bien pu fixer d'une main infaillible les lois de la logique ; mais à quelle source a-t-il puisé ces lois ? qui les lui a révélées ? Il a bien pu analyser avec une parfaite justesse quelques uns des phénomènes de l'âme; mais comment a-t-il observé ces phénomènes? Il a bien pu découvrir quelques unes des grandes lois de la nature; mais ces lois, que les siècles ont reçues pieusement de ses mains, et que les progrès de la science n'ont pas dû modifier, xlvi par quelle faculté les a-t-il comprises ? Ces règles éternelles de la morale, dont il a esquissé quelques nobles traits, à qui les a-t-il empruntées ? Cette grande doctrine de l'unité de Dieu, qui est le couronnement de sa métaphysique, qui la lui a inspirée? Où est le lien commun et indissoluble qui rattache et unit la logique, la psychologie, la morale, la théodicée ? A cette question, le Péripatétisme reste sans réponse. Et cette question est pourtant la première et la plus importante que puisse se poser tout système de philosophie. C'est la première que doit se poser tout esprit « qui veut conduire ses pensées par ordre, » comme dirait Descartes. Comment l'élève de Platon ne s'en est-il pas inquiété? Comment On génie si profondément méthodique a-t-il omis le fait capital sans lequel il n'y a point de méthode ? Arrêtons-nous ici quelques instants; et avant de poursuivre, voyons bien le chemin que nous avons déjà fourni. Nous avons dû constater quatre erreurs considérables dans la théorie d'Aristote. Elles peuvent se résumer toutes en quelques mots : xlvii Aristote n'a pas fait de l'âme une substance, c'est-à-dire une force libre et distincte de toutes les autres ; II n'a point rattaché à l'âme les facultés morales dont l'homme est doué; Il n'a pas cru à l'immortalité de l'âme : Enfin, il n'a pas montré dans l'âme le fondement même de toute philosophie et de toute science. A quoi tiennent des erreurs si profondes et si diverses? à quelle cause contient-il de les rapporter? A une seule, qui les explique toutes, si elle ne les justifie. Aristote n'a pas su distinguer assez complètement l'âme et le corps. Il les a confondus, en attribuant à l'une des fonctions qui manifestement appartiennent à l'autre. Il a réduit l'homme à un principe unique, tandis que l'homme est évidemment composé de deux principes, que sa raison distingue parfaitement, si d'ailleurs elle ne les voit jamais matériellement séparés. Quand l'âme a su donner à cette interrogation intérieure, l'attention et la persévérance qu'exigent de si délicates études, elle se discerne elle-même avec une évidence que rien xlviii n'égale. L'homme s'aperçoit alors avec le caractère éminent qui lui est propre, avec le caractère unique de la pensée. Il ne nie rien du corps auquel son âme est attachée dans cette vie. Mais il reconnaît que le corps n'est pas lui, précisément parce que le corps est à lui, et que ce qui possède est distinct de ce qui est possédé (1). Il ne sait point si l'âme est la forme du corps. Mais ce que l'âme sait, quand elle en est arrivée à se saisir ainsi elle-même, c'est qu'elle est la souveraine et la dominatrice de la matière à laquelle elle est unie, et que cette matière est son instrument, et son compagnon subordonné, quoique trop souvent indocile. L'âme ne se comprend elle-même que sous la condition de la pensée, sans laquelle elle ne serait pas : elle n'a pas besoin de la condition du corps, sans lequel elle pourrait être, bien qu'elle ne soit jamais sans lui. La pensée seule lui est donc essentielle. Voilà ce que Descartes enseigne divi- xlix nement ; voilà ce que Descartes enseigne avec une clarté qui ne laisse plus aucun nuage, avec cette autorité qui n'appartient qu'au vrai, et qui ne souffre plus de controverse. Mais est-il équitable de juger Aristote par Descartes, et de mesurer ces antiques théories à des théories venues deux mille ans plus tard ? Est-il équitable de demander au siècle d'Alexandre tout ce qu'a pu tenir le dix-septième siècle, tout ce que le nôtre pourrait donner? Sans doute la nature et la réalité ne changent pas ; et le génie, quand il applique sa puissance à les observer, peut d'un premier effort les pénétrer et les comprendre tout entières. Aristote a rencontré parfois ce bonheur ; et la logique, par exemple, a été construite de toutes pièces par ses seules mains, sans que ce prodigieux édifice eût été préparé par des travaux antérieurs, sans qu'il ait été agrandi ou changé par les travaux qui ont .suivi. Mais ce sont là de bien rares fortunes; et quoiqu'Aristote en ait eu encore une autre presque aussi belle dans l'Histoire des animaux, il serait excessif d'attendre toujours, même de lui, des œuvres aussi achevées. C'est qu'à côté de la puissance du l génie, qui est individuel, il y a cette autre puissance de l'esprit humain qui grandit de siècle en siècle, et dépasse par des labeurs incessamment accumulés les élans du génie lui-même, admirables, mais passagers. On a souvent commis cette iniquité de soumettre les grands hommes du passé à la mesure du présent: et il a été facile de les convaincre d'erreur et de faiblesse. Mais c'est bien mal comprendre la loi qui préside au développement de l'intelligence humaine. C'est exiger de l'enfance ce qu'on ne doit demander qu'à la virilité. Aujourd'hui, moins que jamais, une appréciation aussi injuste ne doit être permise. Elle serait impardonnable, en présence de tous les enseignements qu'ont dû nous donner et la philosophie de l'histoire et l'histoire même de la philosophie. Ne jugeons donc pas Aristote par Descartes; et puisqu'un heureux hasard nous permet de comparer les théories du disciple à celles de son maître, jugeons Aristote par Platon; Aristote a vingt ans étudié à cette école. Il y aura de plus cet avantage que, si la sentence portée au nom de Platon est toute pareille à celle que nous eussions portée au nom de Descartes, le jugement li pourra passer pour infaillible; ce sera l'expression même de la vérité, découverte d'abord par le génie, et confirmée par le témoignage des temps. Voyons ce que Platon enseigne sur l'âme. L'a-t-il distinguée parfaitement du corps ? Eu a-t-il fait une substance? L'a-t-il crue immortelle ? A-t-il su trouver dans l'âme et dans la réflexion le principe de la véritable méthode? Mais, e» cherchant une réponse à ces questions, gardons-nous de séparer Platon de Socrate, puisque le pieux disciple a voulu que la postérité ne l'écoutât jamais que par l'intermédiaire et sous la garantie de son incomparable maître. Socrate vient d'exposer à ses amis cette théorie de l'immortalité de l'âme qui remplit le Phédon ; il va boire le poison dans la coupe que lui présentera le serviteur des Onze. Mais, avant de mourir, il veut se baigner, afin d'épargner aux femmes la peine de laver un cadavre. Alors Criton prenant la parole : « Socrate, lui dit-il, n'as» tu rien à nous recommander, à moi et aux autres, sur tes enfants ou sur toute autre chose où nous pourrions te rendre service? — » Ce que je vous ai toujours recommandé, Criton ; rien de plus : ayez soin lii de vous ; ainsi, vous me rendrez service à moi, à ma famille, à vous-même, alors «même que vous ne me promettriez rien présentement; au lieu que si vous vous négligez vous-même, et si vous ne voulez pas suivre, comme à la trace, ce que nous venons de dire, ce que nous avons dit il y a longtemps, me fissiez-vous aujourd'hui les promesses les plus vives, tout cela ne » servira pas à grand'chose. — » Nous ferons tous nos efforts, répondit Criton, pour nous conduire ainsi. Mais comment t'ensevelirons-nous ? — » Tout comme il vous plaira, dit-il, si toutefois vous pouvez me saisir et que je ne vous échappe pas. Puis, en même temps, nous regardant avec un sourire plein de douceur : Je ne saurais venir à bout, mes amis, de persuader à Criton que je suis le Socrate qui s'entretient avec vous, et qui ordonne toutes les parties de son discours. Il s'imagine toujours que je suis celui qu'il va voir mort tout-à-l'heure, et il me demande comment il m'ensevelira; et tout ce long discours que je viens de faire pour prouver que, dès que j'aurai avalé le poison, je ne demeurerai plus avec vous, mais que je vous quitterai, et liii irai jouir de félicités ineffables, il me paraît que j'ai dit tout cela en pure perte pour lui, comme si je n'eusse voulu que vous consoler et me consoler moi-même. Soyez donc mes cautions auprès de Criton, mais d'une manière toute contraire à celle dont il a voulu être la mienne auprès de mes juges; car il a répondu pour moi que je ne m'en irais point; vous, au contraire, répondez pour moi que je ne serai pas plus tôt mort que je m'en irai ; afin que le pauvre Criton prenne les choses plus doucement, et qu'en voyant brûler mon corps ou le mettre en terre, il ne s'afflige pas sur moi, comme si je souffrais de grands maux, et qu'il ne dise pas à mes funérailles qu'il exposé Socrate, qu'il l'emporte, qu'il l'enterre ; car il faut que tu saches, mon cher Criton, lui dit-il, que parler improprement, ce n'est pas seulement une faute envers les choses, mais c'est aussi un mal que l'on fait aux âmes. Il faut avoir plus de courage, et dire que c'est mon corps que tu enterres; et enterre-le comme il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme aux lois. » (Traduction de M. Cousin, p. 515). Sous l'impression d'exemples si frap- liv pants, devant de si vives leçons, dont la vérité d'ailleurs pouvait être à tout instant contrôlée par l'observation même des faits, on comprend sans peine que la distinction de l'âme et du corps dut apparaître à Platon comme une sorte d'axiome incontestable. Aussi, sans s'expliquer avec autant de netteté que, plus tard, Descartes a pu le faire, Platon a-t-il pris, comme lui, l'âme réduite à la seule pensée pour le principe suprême de toute philosophie. Quel est le devoir du philosophe? C'est de s'examiner soi-même; c'est de conserver pure de toute souillure cette partie de son être qui comprend le juste et l'injuste; c'est de la perfectionner au péril même de sa vie. Mais le premier obstacle que le philosophe rencontre, c'est le corps qui l'empêche d'arriver au vrai et au bien. Les besoins du corps, ses passions, ses faiblesses, ses plaisirs et ses douleurs sont comme autant de clous par lesquels l'âme lui est rivée ; c'est par le corps qu'elle est entraînée dans ces régions inférieures et obscures où elle est en proie au vice et à l'erreur. Il faut donc que le philosophe, s'il veut atteindre à la vertu et à la vérité, sépare son âme du corps ; il faut qu'il la délivre du lien des sens dont elle se sert, et lv lui apprenne, dès cette vie, à mourir, en quelque sorte, si la mort est la séparation du corps et de l'âme. La philosophie sera donc comme un apprentissage et comme une anticipation de la mort véritable. Cette vie nouvelle de l'âme est la seule vie réelle, la seule vraiment digne de l'homme. L'âme recueillie en elle-même, au-dessus des troubles et des vertiges que le corps lui donne, quand elle reste unie à lui, se reconnaît alors pour un principe divin, immortel, intelligent, simple, indissoluble. Elle est invisible et immatérielle. Il n'y a que le corps qui puisse être perçu par les sens. Mais si l'âme échappe à la prise des sens, s'ils ne peuvent ni la voir ni la toucher, l'âme se voit et se touche elle-même. Elle se confond si peu avec le corps qu'elle se sent faite pour lui commander, le combattre, et au besoin, l'anéantir. C'est elle qui anime le corps et qui le fait ce qu'il est; car sans elle il n'est plus qu'un cadavre; sans elle il se corrompt; et l'homme a beau vouloir conserver cette vaine dépouille, tout l'art des Égyptiens n'y peut rien ; le corps tombe bientôt en dissolution, tandis que l'âme se sent réservée à des destinées toutes différentes. Cette vie de l'intelligence et de la sagesse lvi que la philosophie assure à l'âme, on sait assez ce qu'elle est dans le système de Platon. L'âme est alors en rapport avec les Idées, c'est-à-dire, avec les notions générales et universelles, dont elle ne voit dans le monde des sens que des cas particuliers et des ombres. Aristote a beaucoup combattu la théorie des Idées; et je ne veux pas dire qu'elle soit inattaquable de tous points. Mais s'il a nié surtout que les Idées pussent exister à part et indépendamment des êtres que nos sens nous révèlent, il n'a jamais nié qu'elles existassent. Comment, en effet, aurait-il pu le nier ? Sa théorie de l'entendement n'est point autre à cet égard que la théorie même de son maître. L'universel est le seul objet de la science pour Aristote tout aussi bien que pour Platon. Mais, selon Aristote, les sens et le corps sont indispensables pour former l'universel, collection de ce qu'il y a de commun dans chacun des phénomènes. Suivant Platon, au contraire, le témoignage des sens n'est pour l'âme qu'une occasion de s'élever à la notion universelle qu'elle porte en elle, et qu'elle y doit retrouver, quand elle sait rentrer en soi sous la conduite de la philosophie. Après l'excitation toute passagère par lvii laquelle le corps a provoqué l'âme, il n'a donc plus rien à faire dans le monde de l'intelligence. L'âme y est seule avec les Idées qu'elle comprend et qu'elle contemple, mais qu'elle ne fait pas, comme Aristote l'a pensé. On le voit : si, dans l'ordre actuel des choses, l'âme est unie au corps, si elle n'en peut être matériellement séparée, elle peut du moins, selon Platon, se distinguer si parfaitement de lui qu'elle se fait une existence, dans laquelle le corps n'est plus réellement pour rien. L'âme en est donc profondément distincte. Et notez bien qu'il ne s'est agi jusqu'ici dans les théories de Platon que de faits réels, tous vérifiables à la plus scrupuleuse analyse, et non point de ces hypothèses qui confirment la distinction de l'âme et du corps, qui en sont des conséquences plus ou moins certaines, mais qui ne la démontrent pas. Je veux parler de cette éternité que Platon attribue à l'âme, de cette vie antérieure où l'âme sans le corps a connu directement les Idées dont elle ne fait que se souvenir ici-bas, de ces existences successives par lesquelles l'âme doit passer pour recouvrer sa pureté première, de ces récompenses et de ces peines que lui réserve la justice des Dieux, selon qu'elle aura bien lviii ou mal vécu. Ces croyances, qui sont le fond du Platonisme, ont sans doute une immense importance. Mais même en les négligeant, on peut affirmer, sans la moindre hésitation, que Platon a procédé comme Descartes dans cette grande distinction de l'âme et du corps, et que sa théorie a la même vérité, si d'ailleurs elle présente aussi les mêmes périls. Mais Platon est allé plus loin que Descartes, en insistant encore plus que lui sur les moyens qu'il convient d'employer pour bien discerner l'âme du corps. Il a même indiqué les causes qui le plus ordinairement empêchent les hommes de pouvoir faire cette distinction, et de se bien connaître eux-mêmes. Descartes prévoyait, en terminant ses Principes (4e partie, § 201, éd. de M. Cousin), «qu'il ne serait pas approuvé par ceux qui prennent leurs sens pour la mesure des choses qui se peuvent connaître. » Et il ajoutait «qu'à son avis, c'était faire grand tort au raisonnement humain que de ne vouloir pas qu'il allât au-delà des yeux. » Platon a vingt fois répété que, pour bien connaître la véritable nature de l'âme, «on ne doit pas la considérer dans l'état de dégradation où la mettent son lix union avec le corps et d'autres maux; et qu'il faut la contempler attentivement, des yeux de l'esprit, telle qu'elle est en elle-même, dégagée de tout ce qui lui est étranger. Ceux qui verraient Glaucus le marin, disait-il encore, auraient peine à reconnaître sa première forme, parce que les anciennes parties de son corps ont été, les unes brisées, les autres usées et totalement défigurées par les flots, et qu'il s'en est formé de nouvelles de coquillages, d'herbes marines et de cailloux, de sorte qu'il ressemble plutôt à un monstre qu'à un homme tel qu'il était auparavant. Ainsi, l'âme s'offre à nos regards défigurée par mille maux. Mais voici par quel endroit il convient de la regarder. C'est par son goût pour la vérité. Considérons à quelles choses elle s'attache, quel commerce elle recherche, comme étant par sa nature de la même famille que ce qui est divin, immortel, impérissable. Considérons ce qu'elle peut devenir, lorsque, se livrant tout entière à cette poursuite, elle s'élève par ce noble élan du fond des flots qui la couvrent aujourd'hui, et qu'elle se débarrasse des cailloux et des coquillages qu'amasse autour d'elle la vase dont elle se nourrit, croûte épaisse et gros- lx sière de terre et de sable. » (République, liv. X, p. 275, trad. de M. Cousin.) Puis, dans cette sage conciliation que Platon a tentée entre le sensualisme Ionien et l'idéalisme de Mégare, il employait la douce ironie qu'il avait apprise de Socrate, à se moquer « de ces hommes semés par Cadmus, de ces vrais fils de la terre, qui soutiennent hardiment que tout ce qu'ils ne peuvent pas palper n'existe eu aucune manière, de ces terribles gens qui voudraient saisir l'âme, la justice, la sagesse, ou leurs contraires, comme ils saisissent à pleines mains les pierres et les arbres qu'ils rencontrent, et qui n'ont que du mépris, et n'en veulent pas entendre davantage, quand on vient leur dire qu'il y a quelque chose d'incorporel. « (Sophiste, p. 252, trad. de M. Cousin). Platon n'est pas parvenu à convaincre tous ces profanes, comme il les appelait encore; Descartes n'a pas davantage persuadé tous les profanes de son temps. Mais Platon et Descartes ont montré la route; les esprits attentifs et sérieux n'ont plus qu'à les y suivre. Maintenant est-il besoin de dire que Platon a fait de l'âme une substance, au sens le plus rigoureux de ce mot ? Tout ce lxi que l'on vient de voir ne le prouve-t-il pas assez? Et pour l'immortalité, que dire encore, que tout le monde ne sache? Disons toutefois que dans la philosophie de Platon, ce dogme a une importance et un caractère qu'il n'a point ailleurs Les religions, même les plus positives et les plus éclairées, se contentent d'affirmer que l'âme est immortelle, tout comme elles affirment que Dieu est. La philosophie va beaucoup plus loin : elle ne se contente pas d'affirmer, elle démontre. Elle cherche des preuves, les classe, les discute, pour en faire ressortir, avec d'autant plus d'évidence, la vérité que doit accepter la raison après l'avoir soumise librement à son examen. Depuis le Phédon, la République et les Lois, l'esprit humain a-t-il trouvé des arguments nouveaux ? en a-t-il trouvé de plus solides? Et est-il personne qui ne puisse adopter ceux qui donnèrent à Socrate son imperturbable foi devant une mort inique et cruelle ? Quel immense intérêt s'attachait donc, pour Platon, à cette question qui achève et comprend toutes les autres ? La vie de l'homme, telle qu'elle nous est faite ici-bas, lui apparut comme une énigme indéchiffrable, et digne de pitié plutôt que d'étude, si rien lxxii ne la suit. L'homme, s'il ne se rattache à rien de supérieur, s'il ne se rattache point à Dieu, lui apparut comme un être inexplicable et monstrueux. De là, dans son système, cette grande croyance de l'immortalité, qui fait du Platonisme une sorte de religion tout aussi inébranlable, et, sur' quelques points, beaucoup plus complète que toute autre. En un mot, après Socrate et Platon, les siècles n'ont eu, sur ce dogme, absolument rien à faire ; ils n'ont eu qu'à le sanctionner. Ceci nous explique sans la moindre peine pourquoi la morale de Platon est à la fois si vraie et si sublime, si profonde et si pratique. C'est une conséquence, quand une fois on a compris la vraie destinée de l'âme, de comprendre aussi, dans toute son étendue, la loi qui lui est imposée. Le philosophe n'a plus, comme le vulgaire, qu'à interroger sa conscience; il y trouve la voix intérieure qui parlait si haut à Socrate, et que tout homme porte en lui, si d'ailleurs tout homme ne sait pas l'entendre aussi bien, et la suivre aussi docilement. Le philosophe n'a donc qu'à recueillir ces infaillibles oracles ; et mieux il les aura écoutés, plus son langage prendra de grandeur et lxiii d'autorité. Si Platon a mieux parlé de la morale que ne l'a fait Aristote, si surtout il a su l'inspirer mieux que son disciple, n'en cherchons pas d'autre cause. Platon a mieux compris la nature de l'âme, parce qu'eu ne voyant en elle que la pensée, il l'a prise par son essence, et ne l'a point dénaturée en lui prêtant des facultés qu'elle n'a point. Platon même en ceci est bien plus grand que Descartes : parti d'un principe identique, il en tire des conséquences morales que le philosophe moderne a passées sous silence, conséquences qui n'avaient plus, il est vrai, au dix-septième siècle, la même importance qu'au sein du paganisme, mais que la science du moins réclamait comme un indispensable complément. Ainsi, conduit par une exacte analyse des faits, Platon a posé d'abord la distinction de l'âme et du corps et la substantialité de l'âme : il a posé son immortalité véritable avec le cortège obligé des récompenses et des peines : il a découvert la loi morale et l'a montrée, dans toute sa puissance et sa pureté, au fond de la conscience humaine. Sur ces divers points, nous avions trouvé Aristote, ou à peu près muet, ou tout au moins obscur; Platon, au contraire, a ré- lxiv pondu avec une clarté et une assurance admirables. En sera-t-il de même sur la question de la méthode ? Oui, sans doute ; et en ceci la solution de Platon n'a été ni moins complète ni moins sûre. On peut déjà facilement pressentir ce qu'elle doit être. Il est impossible à l'âme de se placer en face d'elle-même, sans reconnaître bientôt cette évidence suprême qui accompagne tout acte de conscience, et qui de là se répand sur toutes les notions que l'âme peut saisir directement en elle. Or, ces notions ne concernent pas l'âme toute seule; elles s'appliquent aussi au monde extérieur, aux êtres, aux phénomènes, qui, sans elles demeureraient parfaitement incompréhensibles à l'intelligence, parce qu'ils seraient sans lois. Il faudra donc que l'âme rentre en elle-même, non pas seulement pour se comprendre, mais aussi pour comprendre tout ce qui n'est pas elle. De là, la dialectique, « science toute rationnelle qui, sans intervention des sens, s'élève à l'essence des choses, » et les entend aussi parfaitement qu'il est donné à l'homme de les entendre : science supérieure à toutes les sciences phy' siques, supérieure même à toutes les sciences intelligibles, parce que c'est elle seule lxv qui a le secret «Je toutes les autres et connaît leurs limites et leurs rapports. On peut dire que « la dialectique est l'air dont les autres sciences ne sont qu'un vain prélude.» Elle est la plus vraie de toutes, parce qu'elle ne s'occupe que de ce qui ne passe point, et que la vérité ne se fonde que sur ce qui est. On a souvent représenté la dialectique platonicienne comme la méthode qui, des idées particulières, s'élève de degré en degré à des notions de plus en plus générales, pour aboutir par toutes les voies à cette idée suprême et universelle du bien, «qui illumine le monde intelligible, comme le soleil éclaire le monde des sens. » La dialectique est bien cela sans doute; mais elle est plus encore : elle est la méthode unique, applicable à tous les cas, aux plus humbles comme aux plus relevés : en un mot, elle est la méthode, au sens même où Descartes l'a plus tard entendu. De là vient que Platon déclare que le philosophe est le seul à posséder la dialectique, tout comme Descartes n'a demandé la méthode qu'à la seule philosophie. De là vient encore que Platon interdit la dialectique à la jeunesse, et qu'il veut qu'elle couronne, et non qu'elle précède la culture des sciences particulières. lxvi C'est que en effet, pour bien connaître et montrer le chemin, il faut d'abord l'avoir parcouru. Telle est la portée véritable de la dialectique platonicienne ; c'est là ce qui lui assigne le grand rôle qu'elle joue dans l'histoire de la philosophie. Elle est l'antécédent direct de la méthode cartésienne, laquelle est le fondement de toute la philosophie moderne (2). Comprendre autrement la dialectique de Platon, c'est la méconnaître. Aristote le premier l'a entièrement méconnue ; et, si l'on a bien compris pourquoi le système péripatéticien est sans méthode et sans base, ou voit tout aussi clairement pourquoi le disciple n'a point accepté la méthode du maître : c'est qu'Aristote n'a point constaté dans l'âme ce grand fait de la réflexion sur lequel Platon a tant insisté. Aristote a rabaissé la dialectique presque au niveau de l'art des Sophistes; et bien d'autres après lui ont répété cet anathème. Peut-être la dialectique vulgaire de son temps ne valait-elle pas davantage; peut-être même celle que Kant a voulu ressusciter ne vaut-elle pas beaucoup mieux ; mais lxvii ou peut l'affirmer contre Aristote et contre Kant, ce n'est pas là la dialectique de Platon. Certes, je ne veux pas dire que la méthode platonicienne soit à l'abri de toute critique, ni qu'elle soit sans danger, Le demi-scepticisme des cinq Académies qui se sont succédé est un fâcheux symptôme. Le mysticisme des Alexandrins est encore plus déplorable, ainsi que l'idéalisme sorti de l'école cartésienne; mais ce sont là des aberrations et des conséquences immodérées de la méthode; ce n'en sont pas de légitimes applications. Il faut donc répéter que la méthode de Platon est la vraie méthode, et que qui ne l'adopte pas court le risque de ne point s'entendre complètement avec soi-même, et de parcourir la carrière, sans la bien connaître, quel que soit d'ailleurs son génie. Aristote aurait donc pu apprendre de Platon d'abord ce qu'est la méthode philosophique, et de quelle faculté de l'âme elle ressort ; il aurait pu apprendre de lui quel est le vrai fondement de la morale; il aurait pu apprendre de quelle importance est le dogme de l'immortalité, appuyé sur lxviii l'étude de la conscience humaine ; enfin il aurait pu apprendre que ce dogme, cette morale et cette méthode reposent uniquement sur cette essentielle distinction de l'âme et du corps. Mais certes Aristote n'a rien ignoré de ce qu'enseignait Platon ; et s'il s'est décidé pour des solutions contraires, c'est à parfait escient. Malheureusement les siècles ont prononcé dans ces grandes controverses, et c'est à Platon qu'ils ont donné raison. Le témoignage même des siècles ne serait rien; mais l'observation attentive des faits s'élève contre Aristote, et c'est la vérité qui dépose contre lui. Il faut le déclarer, quoi qu'il en coûte: Aristote, en contredisant Platon, a rétrogradé vers le passé; il a rebroussé chemin à peu près jusqu'à l'Ionisme; et malgré la sagacité des développements nouveaux qu'il a donnés à des principes surannés, le germe que contenaient ces principes n'a pas tardé à reparaître : si Je maître lui-même a su échapper au sensualisme, son école presque tout entière y est fatalement tombée. C'est donc à une condamnation presque absolue d'Aristote que nous sommes arrivés lxix en le comparant à Platon. Le jugement eût été le même si nous en avions appelé à Descartes; la réponse n'aurait pas changé pour être donnée à deux mille ans de distance, parce que la vérité ne change point. Voilà, ce semble, ce grand Traité de l'Ame bien abaissé; voilà d'immenses erreurs et des lacunes non moins immenses. Par quels mérites se relèvera-t-il donc à nos yeux? Ces mérites, les voici ; et s'ils sont moins élevés que nous ne l'eussions désiré, ils le sont bien assez encore pour justifier toute la gloire du Péripatétisme. Rendons d'abord toute justice à la forme même de l'ouvrage et à sa composition. De toutes les œuvres d'Aristote, sans en excepter même la Logique ni l'Histoire des animaux, celle-ci est certainement la plus accomplie. Le plan est, comme on l'a vu plus haut, parfaitement simple et parfaitement suivi. Après une vue générale et rapide des parties principales de son sujet, Aristote s'enquiert de la tradition, qu'il examine assez longuement ; puis, traitant la question du point de vue qui lui est propre, il étudie l'une après l'autre les quatre grandes facultés qu'il reconnaît à l'âme; et il termine par des généralités qui résument ce lxx qui précède. La plupart des ouvrage? aristotéliques ne nous sont arrivés que dans un état de désordre et de mutilation qui permet rarement d'en juger l'ensemble. Jusqu'à présent la sagacité des érudits a échoué devant |a Métaphysique, que personne n'a pu restituer légitimement. On sait quelle est l'interversion des livres de la Politique. On sait les lacunes de la Poétique, les doubles et triples rédactions de la Rhétorique et de la Morale. L'Histoire même des Animaux n'est point terminée ; et le dixième et dernier livre, qui n'appartient point à Aristote, ne nous donne pas, et nous ne trouvons point ailleurs, le grand résumé qui devrait compléter des théories aussi vastes et les relier entre elles. La Physique n'est pas davantage à l'abri de toute critique. La Logique même, tout admirable qu'en est la composition, présente quelques taches : les parties diverses de cette construction colossale ne se tiennent pas assez entre elles; et, bien que les rapports de subordination qui les unissent incontestablement se révèlent à une étude patiente, les meilleurs esprits ont pu s'y tromper, dans l'antiquité comme dans les temps modernes. La biographie d'Aristote, on le sait, peut nous expliquer fort lxxi bien les défauts qui nous choquent dans ses œuvres. Élève de Platon jusqu'à l'âge de quarante ans à peu près, plus tard mêlé aux affaires politiques de l'Asie-Mineure et de la Macédoine, précepteur d'Alexandre, Aristote, selon toute apparence, ne publia pas un seul de ses ouvrages avant cinquante ans. A cette époque même, livré tout entier à l'enseignement d'une nombreuse école, il ne paraît pas qu'il ait pu donner à cette publication tous les soins nécessaires. L'exil et la mort vinrent le surprendre à soixante deux ans, avant qu'il eût pu mettre la dernière main à aucun de ses travaux; et ses manuscrits, confus et inachevés, devinrent l'héritage d'un élève bien capable de les comprendre, mais qui ne prit pas la peine de les classer, laissant ce soin pieux à des mains moins habiles et moins éclairées. Par une exception peut-être unique, le Traité de l'Ame, s'il n'a pas reçu toute la perfection qu'un auteur plus minutieux pourrait donner à ses écrits, a reçu cependant toute cette perfection qu'Aristote prétendait, à ce qu'il semble, donner aux siens. C'est dans le Traité de l'Ame, plus que partout ailleurs, qu'on peut bien voir ce qu'est toute sa manière, cette ordonnance gran- lxxii diose et lucide des pensées, ce style concis et ferme jusqu'à l'obscurité et à la sécheresse axiomatiques, sans ornements d'aucun genre qu'une admirable justesse, une incomparable propriété d'expressions, une vigueur sans égale, et, au milieu d'une apparente et réelle négligence, des allures où éclate toujours la puissance du génie. Ce sont là les qualités extérieures du style aristotélique ; il en a d'autres plus profondes, dont la philosophie lui doit plus particulièrement tenir compte. La forme que la science y revêt est celle même qu'elle a depuis lors conservée, et qu'elle ne changera point. Nous ne savons pas au juste ce qu'était la forme adoptée par la philosophie antérieurement à Platon. Je ne parle pas de cette philosophie qui écrivait en vers et conservait, au grand préjudice de la pensée, les indécisions de la poésie, .sans en garder les grâces. Mais les ouvrages de Démocrite, dont le génie a tant de rapport avec celui d'Aristote, ne sont point parvenus jusqu'à nous; et les rares fragments qui nous en restent ne permettent pas d'en porter un jugement bien précis. Les Sophistes n'ont pu rien faire pour la science, parce qu'ils ne la prenaient point au sérieux. lxxiii Quant à la forme du dialogue adoptée par Platon, c'est une exception absolument inimitable, d'abord par la perfection où Platon a su le porter, et ensuite par l'insuffisance même du procédé. On peut voir ce que le dialogue a fourni à Leibnitz et même à Malebranche. Entre les mains du disciple de Socrate, il a produit des chefs-d'œuvre qu'Aristote avait essayé d'imiter, bien vainement sans doute. Platon non plus, tout grand artiste qu'il est, n'aurait certainement pas choisi de lui-même une telle forme, et son génie livré à lui seul n'en eût pas tiré un tel parti. Mais Socrate avait posé trente ans devant lui. Le dialogue, la discussion avait été toute sa puissance et tout son enseignement. En voulant reproduire l'esprit, si ce n'est tout-à-fait les doctrines de Socrate, Platon n'avait pas à choisir. Le récit aurait glacé ces vivantes démonstrations ; et cela est si vrai, bien que Xénophon ne s'en soit pas aperçu, que Platon n'a été ni le seul, ni même le premier à reproduire ces conversations qui avaient instruit Athènes, et l'avaient charmée tout en l'irritant. Que devenaient ces conversations, du moment que Socrate cessait d'y figurer en personne ? L'art a fait lxxiv beaucoup sans doute pour les dialogues de Platon, mais la réalité a fait encore plus. Si les Platons sont bien rares, les Socrates le sont davantage. Le dialogue platonicien ne serait désormais possible qu'à la condition d'un nouveau personnage aussi merveilleux, et peut-être même à la condition d'une catastrophe aussi lamentable. La philosophie s'interdira donc à jamais le dialogue, sous peine de se laisser entraîner à une imitation vaine. Que le dialogue reste le monopole éternel de Platon, puisqu'il n'a été donné qu'à lui seul d'avoir un Socrate pour maître. Que ce soit pour lui un titre de gloire aussi incontestable, s'il est moins grand, que la théorie des Idées. Mais le dialogue ne peut être la forme vraie de la science, malgré les services qu'il lui a rendus une fois. Aristote peut donc légitimement passer à nos yeux pour avoir donné à la philosophie la forme qui lui est propre. II semble bien que d'autres sciences, la médecine, par exemple, avaient déjà trouvé la leur. Mais la philosophie s'ignorait encore. Aristote le premier lui fit tenir le langage qui lui convient ; et le Traité de l'Ame est son chef-d'œuvre, de même qu'avec la Métaphysique, il renferme ses théories les plus importantes. lxxv A ce mérite du style et de la forme, joignez le mérite de connaissances de physiologie et de physique aussi vastes que positives. Je crois que la physiologie n'a rien, à faire dans un traité de l'âme; Aristote, selon moi, comme le prouve toute la discussion précédente, a eu tort de l'y introduire, et elle a certainement contribué à ses erreurs. Mais ces études, prises en elles-mêmes et dégagées d'une fausse application, n'en sont pas moins admirables, Elles n'apparaissent dans le Traité de l'âme qu'avec une juste mesure, et pour le besoin assez restreint du sujet. Mais, chaque fois qu'elles se montrent, elles éclatent en traits de lumière. Il n'est pas une seule de ces généralités sur la vie et les êtres organisés que la science n'ait recueillies, et qu'elle ne conserve encore aujourd'hui comme de réelles conquêtes. On peut l'aller demander a Buffon et de nos jours à Cuvier. Ces grands principes de la physiologie comparée, qui sont le cadre de la science et ses plus sûrs jalons, à qui doit^on les rapporter, si ce n'est à l'auteur de l'Histoire des animaux ? Depuis Aristote, les observations se sont multipliées ; elles sont devenues plus exactes, en devenant plus nombreuses. L'ana- lxxvi lyse s'est approfondie en même temps qu'elle s'est étendue. Mais les premières vues du génie avaient été si sagaces et si larges, qu'elles ont embrassé l'ensemble de la vérité, si d'ailleurs elles n'ont pu atteindre tous les détails. Quelques uns de ces grands aperçus se retrouvent dans le Traité de l'âme, et lui donnent une valeur que la physiologie surtout doit apprécier. Les théories de physique qui s'y présentent n'ont guère moins de prix. Je riterai surtout celles de la lumière et du son, exposées à l'occasion des sens de la vue et de l'ouïe. A certains égards, elles sont pleines de vérité : et par exemple, le génie d'Aristote, devançant les découvertes les plus modernes, n'a pas hésité à déclarer que la lumière ne pouvait être ni un corps, ni une émanation d'un corps, et qu'elle était un mouvement, dans un milieu particulier qu'il appelait le diaphane. La physique de nos jours ignore ces vieilles théories; elle les dédaigne parce qu'elle ne les connaît pas, et surtout parce qu'elle n'estime point assez sa propre histoire. Elle ne sait pas à quelles conditions la science a successivement grandi; elle ne sait pas les longues incertitudes, les rudes labeurs qui ont rendu possibles ses récents triomphes. lxxvii Mais quand on suit de près toutes les discussions qu'ont soulevées les théories d'Aristote, et les commentaires sans nombre dont ces théories ont été l'objet, on voit poindre peu à peu et se développer cet esprit d'investigation exacte, positive, dont les physiciens de nos jours croient avoir découvert le secret. Au moyen-âge on respectait superstitieusement la parole du maître; mais ce respect même poussait à étudier les faits, afin de prouver que le maître les avait tous lus et les avait tous compris. On étudiait la nature pour glorifier Aristote; et parfois même on la faussait plutôt que de le critiquer. Mais ces études qu'Aristote avait provoquées devaient porter leurs fruits. Pour s'en convaincre, et pour se bien rendre compte des services que le Péripatétisme a rendus en ceci, comme en tant d'autres sciences, à l'esprit moderne, il suffirait de consulter le commentaire des Coïnibrois sur le Traité de l'âme à la fin du seizième siècle. On y verrait tout ce que ces études aristotéliques du moyen-âge, si décriées, avaient accumulé de matériaux et préparé de découvertes. Si les vues physiologiques et physiques d'Aristote ont tant d'importance dans le Traité de l'âme, que dirons-nous de ses lxxviii théories psychologiques (3) ? Au milieu du dix-huitième siècle, l'école écossaise, marchant sur les pas de Locke tout en le combattant, a cru découvrir la méthode qu'il convient d'appliquer à la description des faits de l'entendement humain. Parmi nous, dans ces derniers temps, on a souvent répété cet éloge peu mérité et certainement peu modeste que l'école écossaise s'était décerné. C'est à peine si l'on a fait quelques timides réserves en faveur des anciens. Il faut être plus équitable pour cette admirable antiquité, que les philosophes écossais, et Reid tout le premier, connaissaient trop peu. Il faut dire, sans hésiter, que la méthode d'exposition suivie par Aristote est la méthode suivie par Reid. Les résultats obtenus par le philosophe du dix-huitième siècle sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus détaillés, je ne le nie pas ; mais le procédé est absolument le même ; c'est de part et d'autre une étude attentive des faits, observés avec la patience et la sagacité les plus désintéressées de toute idée systématique. lxxxix Platon a indiqué, tout aussi bien que Descartes et que Heid, comment on doit observer les faits de l'esprit. Aristote, en mêlant une science étrangère à la psychologie, n'a pas aussi bien compris que son maître le rôle véritable de la conscience et sa compétence exclusive. Mais, tout en partant d'un principe moins certain et moins clair, Aristote a parfaitement décrit une multitude de faits; il leur a donné le caractère qui leur est propre; il a vu les rapports qui les lient, et il les a classés, pour en tirer des lois générales, avec une justesse et une rigueur qui ne peuvent être surpassées. Est ce qu'il ne détermine pas d'abord les facultés de l'âme? Est-ce qu'ensuite il ne les décompose pas dans leurs éléments? Cette analyse sans doute n'a pas été poussée aussi loin qu'elle pouvait l'être, bien qu'il ne faille pas oublier qu'à côté du Traité de l'âme, Aristote a déposé, dans plusieurs ouvrages secondaires, une foule d'observations de détail dont celui-ci n'est que le résumé. Sans doute l'analyse de Reid est autant au-dessus de celle d'Aristote, que la physique du dix-huitième siècle est au-dessus de la physique de ces âges reculés. Mais la philosophie ne doit pas imiter l'orgueil un peu aveugle des lxxx sciences naturelles, ni croire, comme elles, qu'elle ait fait une révolution dans son sein. Elle a tout simplement fait des progrès. Si l'on regarde les deux points extrêmes, comme ils sont fort éloignés, on les croit séparés l'un de l'autre ; et le dernier paraît très supérieur, parce qu'il semble isolé. Mais, si l'on rétablit les intermédiaires, et que de Platon et d'Aristote on passe aux commentateurs anciens, de ceux-là aux commentateurs du moyen-âge, puis aux philosophes du seizième siècle, ensuite à Descartes, et enfin à Locke, on voit peu à peu s'élever la psychologie au point où les Ecossais l'ont trouvée. Sans doute les Ecossais ont fait beaucoup pour la science; mais ils n'ont pas fait autant que leurs admirateurs un peu passionnés, et eux-mêmes l'ont cru sincèrement. Une partie de leur gloire, c'est d'être venus les derniers. Aristote a si bien procédé comme eux, il a si bien voulu faire des facultés de l'esprit une science d'observation, que, comme eux aussi, il a négligé les questions } et s'est beaucoup moins enquis que ne l'avait fait Platon, son maître, des destinées de l'âme. Nous avons trouvé que c'était une immense lacune dans les théories d'Aristote. Aux yeux de Reid, lxxxi cette lacune aurait dû paraître un immense mérite; pour lui, elle devait suffire a réhabiliter l'inventeur prétendu « des espèces sensibles et des espèces intelligibles. » II est très facile à Reid et à ses successeurs de négliger les questions et de les ajourner après l'observation des faits, longue, infaillible et complète sans doute : pour eux les questions sont résolues. Ils ne demandent pas à la philosophie si l'âme est immortelle, et quels sont les rapports qu'elle soutient avec Dieu. Une grande religion à laquelle ils croient de toute leur foi a tranché sans discussion ces problèmes essentiels. Les philosophes Ecossais peuvent donc, en toute sécurité, traiter les faits de l'âme comme les physiciens traitent les faits de la nature : ils peuvent, en toute sécurité, faire l'histoire naturelle de l'âme. Cette indifférence, qui se conçoit en eux, doit paraître fort peu louable dans Aristote. Les questions, comme on les appelle non sans quelque dédain, ne s'ajournent jamais : les faits n'ont d'importance que pour les résoudre. Chaque siècle, chaque philosophie, chaque philosophe même doit avoir des solutions avant tout : les faits sur lesquels elles reposent sont plus ou moins bien observés, plus ou moins nombreux; il n'im- lxxxii porte guère. La psychologie Ecossaise, toute scientifique, toute précise qu'elle est, n'eu a pas plus appris au dix-huitième siècle, sur l'immortalité de l'âme, que n'en savait Platon. Aristote a donc eu tort, puisqu'il ne se reposait pas, comme les Ecossais, sur des réponses dictées par une autorité supérieure, de s'occuper exclusivement, ou à peu près, de l'observation des phénomènes. Mais ce tort il le partage avec les Écossais ; et, si l'on en fait une gloire à d'autres, il faut faire partager cet honneur au disciple et à l'antagoniste de Platon. C'est en ce sens, et avec toutes ces réserves, que la méthode appliquée par Aristote à la description des faits de la sensibilité et de l'entendement, me semble admirable. Aristote a constitué la science psychologique, tout aussi certainement qu'il a constitué la science de l'histoire naturelle. Buffon et Cuvier lui ont rendu pleine justice. Ne serait-il pas au moins singulier que les psychologues ne fussent pas aussi équitables que les naturalistes? Pour notre part, concluons en disant que le Traité de l'âme a fondé la psychologie scientifique, deux mille ans avant les Ecossais. A ces mérites de forme et de composition, à ces mérites plus relevés que la physiolo- lxxxiii gie et la physique peuvent trouver dans le Traité de l'Ame, à ce mérite surtout que la psychologie doit y constater, joignons cette influence qu'à toutes les époques les théories aristotéliques ont exercée sur les sciences voisines de la philosophie, et spécialement sur la théologie. Il n'y a pas deux moyens de bien faire comprendre Dieu à l'homme; il faut d'abord faire comprendre l'homme à l'homme lui-même. Toute théologie un peu profonde s'appuie nécessairement sur une psychologie. Ce fut la doctrine d'Aristote qui régna durant tout le moyen-âge, non pas qu'elle fût la plus vraie, mais parce qu'elle était la plus régulière. C'est même un spectacle assez surprenant de voir toute la théologie chrétienne déserter le Platonisme, qui lui est si conforme, pour adopter la psychologie péripatéticienne, dont les conséquences sont si contradictoires à l'orthodoxie. On peut rappeler, pour ne citer qu'un seul exemple, la place considérable que tient la psychologie d'Aristote dans la Somme de saint Thomas. Plus tard, elle n'en tient pas moins dans l'admirable ouvrage de Bossuet : la Connaissance de Dieu et de soi-même n'est souvent qu'une paraphrase ou une traduction du Traité de l'Ame. Ce n'est pas lxxxiv seulement parce que saint Thomas et Bossuet étaient des admirateurs et des disciples du Péripatétisme; c'est que la psychologie péripatéticienne était devenue la doctrine officielle de l'Église. La croyance religieuse ne courait aucun danger à ce contact. Les faits étaient parfaitement observés par le philosophe païen; on les lui empruntait. Quant aux doctrines qu'il en avait tirées, on s'en inquiétait peu, et au besoin on savait les accommoder avec le dogme. Telle est la légitime et salutaire autorité qu'exercent toujours la discipline et la règle. Aristote seul pouvait servir l'Ecole. Platon avait rendu jadis à la religion des services plus essentiels, mais moins apparents : il avait préparé les voies au christianisme dans le monde païen. Mais ce n'était pas lui qui pouvait être le précepteur de la Scolastique. La valeur du Traité de l'Ame est surtout une valeur scientifique. Les croyances d'Aristote sont incertaines et flottantes : on peut les interpréter dans l'un et l'autre sens ; mais on peut le suivre presque aveuglément dans l'étude exacte des phénomènes. A qui se serait-on adressé, je le demande, si ce n'est à lui, pour connaître en détail et clairement les faits de la sensi- lxxxv bilité et ceux de l'intelligence? Platon aussi les avait décrits; tuais il y avait bien peu d'esprits capables de recueillir les descriptions éparses dans ses dialogues, et de les dégager, avec toute leur vérité et leur grandeur, de l'enveloppe parfois un peu trop éclatante dont Platon les avait revêtues. Au contraire la forme didactique et sévère d'Aristote aidait puissamment à l'étude; et ce n'est pas à la philosophie du dix-neuvième siècle de méconnaître ou de dédaigner un tel avantage. A la théologie nous pourrions ajouter aussi la médecine, si l'exemple de Van-Helmont et surtout celui de Stahl n'étaient des exemples individuels et isolés. Je ne doute pas que l'idée principale de la physiologie de Stahl ne lui ait été inspirée par le Traité de l'Ame. Aristote avait dit que c'est l'âme qui nourrit le corps, et il avait fait de la nutrition l'une des quatre facultés par lesquelles l'âme se manifeste. Stahl exagère cette idée. Toutes les actions et les modifications du corps, les opérations les plus délicates et les plus profondes qui se passent en lui, sont faites et accomplies par l'âme et pour l'âme seule. C'est l'âme qui se construit le corps, tout aussi lxxxvi bien que c'est elle qui le conserve et le meut, sans l'intervention ou le concours d'aucun autre moteur. (Voir Theoria medica vera, Physiologia, sect. l, memb. i, pag. 255 et 254, éd. de 1831, in-16.) Pour qu'on ne s'y méprenne pas, Stahl ajoute qu'il entend parler de l'âme rationnelle; et il se raille de ces antiques rêveurs (antiquœ naeniae), qui ont cru trouver dans le corps humain d'autres agents que l'âme intelligente, et qui ont distingué trois âmes, végétative, sensitive, raisonnable, comme si les deux premières n'avaient pas besoin, autant que l'autre, d'intelligence et de connaissance pour accomplir leurs admirables fonctions (id., ib., pag. a58). Stabl ne sait pas, quoiqu'il soit fort érudit, qu'eu voyant la vie uniquement dans l'âme, en les confondant l'une avec l'autre, il ne fait que reproduire Aristote ( De mixti et vivi corporis verâ diversitate, p. 106 et suiv.— Physiologiœ brevis repetitio, p. 475 et 479). Il ne sait pas qu'en se moquant d'Aristote, il se moque de lui-même, puisque sa pensée n'est au fond que celle du philosophe ancien. Nous venons de parcourir les mérites du Traité de l'Ame, et nous les avons trouvés lxxxvii considérables. Mais ces mérites, tout grands qu'ils sont, ne peuvent point racheter les erreurs que, dans l'intérêt de la vérité, nous avons dû signaler et combattre. Sans doute, c'est une grande chose de fonder la science, de lui assurer le caractère qui lui est propre, de l'ordonner dans ses parties principales, de décrire exactement quelques uns des faits qui la doivent composer; et ce serait de l'ingratitude que d'oublier de tels services. Mais, je le déclare, si ces travaux, tout admirables qu'ils peuvent être, n'aboutissent qu'à satisfaire une curiosité vaine; si les doctrines auxquelles ils doivent conduire sont obscures ou fausses ; si en traitant longuement des facultés et des actions de l'âme, on oublie de se prononcer sur ses destinées, la science peut encore applaudir; mais la philosophie n'obtient pas ce qu'elle demande : elle a manqué le but qu'elle doit poursuivre. Il faut le répéter hautement : toute l'erreur d'Aristote vient de ce qu'il n'a pas assez vu, malgré les conseils de Platon, que l'âme n'est observable que par l'âme elle-même. En attribuer l'étude à la physiologie, c'est la perdre; chercher à compren- lxxxviii dre l'âme de l'homme en observant les plantes et les animaux, c'est s'exposer aux plus tristes mécomptes. L'exemple d'Aristote doit nous instruire ; et son naufrage doit nous apprendre à éviter les écueils sur lesquels il s'est brisé. Platon avait dit que « l'âme ne peut être aperçue que des yeux de l'esprit. » Aristote, sans engager une polémique directe, avait essayé d'étudier l'âme surtout par l'observation ordinaire et le témoignage des sens, comme tout autre objet extérieur. Les deux points de vue étaient diamétralement opposés. Je ne sais si Platon a bien connu la pensée de son disciple, et s'il y a fait quelque allusion en réfutant les philosophes ioniens. Mais Aristote, qui a certainement connu celle de son maître, ne semble pas en avoir tenu le moindre compte. Soit dédain, soit inattention, il prit une route contraire, et, redisons-le, une route absolument fausse; nous en avons pour garants, avec Platon et Descartes, les faits eux-mêmes. Mais, quelque diverses que fussent les méthodes suivies par les deux philosophes qui, dans l'antiquité, se partagent tout le domaine de la science, la question n'était pas posée en Ire eux. Ce n'est que de nos jours qu'elle l'a été, et lxxxix qu'une discussion, si ce n'est très régulière, au moins assez étendue, a été instituée entre les naturalistes et les philosophes. La physiologie s'est rappelé que jadis l'étude de l'âme lui appartenait. Elle s'est souvenu, quoique très confusément, qu'Aristote la lui avait attribuée; et, chose assez étrange, Cabanis, qui, au début de son célèbre ouvrage, passe en revue les travaux des anciens, ne semble pas se douter que le Traité de l'Ame existe, et qu'il a pour lui une aussi grande autorité. (Voir les Rapports du physique et du moral, p. 66 et ?4, édit. de M. Peisse.) Mais par suite des erreurs de la philosophie même, par suite de ses faiblesses devant les sciences naturelles qu'elle doit éclairer, et qu'elle ne doit point suivre, des physiologistes en sont venus, de nos jours, à revendiquer pour leur science la psychologie tout entière, et sans doute aussi, comme annexes indispensables, la logique, la morale, la métaphysique, c'est-à-dire, toute la philosophie. On a montré parfaitement que cette aberration remontait dans les temps modernes jusqu'à Locke, et que les prétentions imprudentes de la physiologie avaient pour premiers complices des philosophes. (Voir M. de Rémusat, Essais de philosophie, t. II, xc Essai sur la physiologie intellectuelle.) Mais il faut reculer davantage la date de l'usurpation. C'est Aristote qui est le premier coupable, et Cabanis n'a pas été plus positif que lui. On sent même tout ce que la parole d Aristote a de plus grave : c'est un philosophe qui préconise la physiologie ; ce n'est pas un médecin, qui peut toujours être suspect dans sa propre cause. C'est donc une opinion de grande importance que celle qui attribue l'étude de l'âme à la physiologie. Je n'affirmerais pas qu'Aristote, malgré le principe qu'il a si nettement posé, consentît à subir toutes les conséquences qu'en tirent quelques uns de nos modernes physiologistes. Mais comme c'est lui qui a d'abord émis cette doctrine, et que de plus il l'a réalisée dans la mesure de son temps, nous adjoignons Aristote aux physiologistes du nôtre, lls ne refuseront pas, nous le croyons, ce puissant auxiliaire. L'éclat d'un tel nom est beaucoup pour une cause comme la leur, bien qu'Aristote même ne puisse suffire à la faire triompher. Il ne sera donc pas inutile de jeter un coup d'œil sur la physiologie de notre époque, puisque la question qu'elle discute contre la psychologie est la question même qu'Aristote a si réso- xci lument tranchée en faveur de l'histoire naturelle. Le débat contemporain pourra nous éclairer encore sur les théories antiques, en nous montrant plus complètement les conséquences de ces théories ; et nos physiologistes pourront apprendre, par l'exemple même du passé, tout ce que valent les objections qu'on leur oppose. Aujourd'hui on peut compter trois partis très distincts dans la physiologie. L'un, acceptant l'héritage de la psychologie, déclarée impuissante et morte, se charge de la remplacer, sans savoir précisément à quoi il s'engage, et se réservant sans doute, contre les suites nécessaires de la psychologie, des fins de non-recevoir qui seront comme une sorte de bénéfice d'inventaire. Le second parti, qui est beaucoup plus sage, iie veut pas dépouiller la psychologie, dont la succession n'est pas ouverte, selon lui : il se borne à vouloir l'aider dans ses délicates et pénibles recherches; il lui offre très loyalement sou concours, déclarant que la physiologie et la psychologie sont sœurs, et qu'elles sont incomplètes l'une sans l'autre. Enfin, un troisième parti reconnaît la compétence exclusive de la psychologie dans les questions psychologiques; et, gardant à la phy- xcii siologie les limites qui lui sont propres, il essaie de la guider par la philosophie, loin de vouloir guider la philosophie par elle. De ces trois partis, le premier, selon nous, a radicalement tort; le second, malgré des intentions excellentes, n'a pas toute raison; le troisième seul est dans le vrai. Je n'exagère point en prêtant au premier de ces trois partis des prétentions aussi insoutenables. Les noms de Cabanis, de Gall, de Broussais, sans nommer des physiologistes encore vivants, en disent assez; et si l'on veut se convaincre que l'aveuglement systématique et réfléchi de la physiologie va jusque là, qu'on interroge les physiologistes de l'Allemagne. En ce moment ce sont les plus illustres, et, ce semble, les plus compétents, ou tout au moins les plus autorisés. Je n'en cite qu'un seul, M. Burdach. Qu'est ce que la physiologie pour lui? Ecoutez-le, car c'est presque un commentaire d'Aristote. a Maintenant, dit-il, la physiologie cherche, » en dernière analyse, à connaître l'esprit «humain, l'essence de l'entendement, qui «rentre dans les attributions de toute physiologie. » Selon M. Burdach, c'est si bien là le problème de la physiologie, que c'est uniquement pour le résoudre « qu'elle con - xciii temple l'homme sous tous ses autres points de vue. » Ceci est déjà bien clair; mais M. Burdach veut une clarté plus vive encore, et il la demande à l'étymologie, qui pour lui justifie pleinement cette définition. Il ajoute donc : « La physiologie doit avoir pour objet l'essence envisagée d'une manière complète et dans toute son étendue (par conséquent le moral et le physique). Pour arriver à la connaissance de l'homme, elle doit porter-ses regards sur la nature entière, et contempler tous les phénomènes de l'univers. Le nom de physiologie, imposé par excellence à la science de l'essence humaine, indique le rang que l'homme occupe dans la nature. La physiologie est donc le commencement de toutes les sciences naturelles, le point unitaire de la connaissance de toute réalité. Elle doit même s'élever à l'intuition de l'existence absolue; elle doit devenir la connaissance expérimentale de Dieu ou théologie naturelle. » Devant des déclarations si formelles et si hautaines, on serait confondu d'étonnement, si ce n'était là le défaut de toutes les sciences à leur début. Le Droit n'a-t-il pas jadis proclamé aussi qu'il était la « science des choses divines et humaines?» Ne le répète-t-il pas xciv encore quelquefois? Il y a deux mille ans qu'Aristote a remarqué cette ambition des sciences de tout embrasser, malgré le point de vue très particulier où nécessairement chacune d'elles se place. La médecine de son temps ne s'intitulait-elle pas aussi : « la science de ce qui est?» Aristote montrait le vice de pareilles définitions et leur prétentieuse insuffisance. Platon avait essayé de les prévenir, en disciplinant toutes les sciences de détail sous la conduite et la surveillance de la dialectique, ou pour mieux dire de la philosophie. Mais, de nos jours, la philosophie oublie peut-être un peu trop le rôle et les devoirs qu'après Platon et Descartes, Bacon lui-même lui assignait. A côté de M. Burdach, bien d'autres physiologistes ont élevé des prétentions non moins exclusives. Les plus conciliants ont reconnu que pour le moment la science de l'intelligence ne fait pas partie essentielle de la physiologie. Mais cette situation, selon eux, est transitoire ; elle ne peut durer. La physiologie ne tardera point à avoir raison de cette indépendance de la psychologie, qui lui appartient; et elle saura bien faire rentrer sous sa loi l'idéologie, qui s'en est un instant écartée. xcv Les philosophes, de leur côté, ont prêté les mains aux physiologistes; et M. de Traey, interprète d'une partie du dix-huitième siècle, a résigné la philosophie, qui ne savait plus se défendre. Pour convertir ces physiologistes immodérés et les ramener dans les limites vraies de leur science, il convient de les renvoyer à l'école de Platon et de Descaries. Avant tout, il faut qu'ils comprennent la distinction de l'âme et du corps. Une fois qu'ils auront senti la profonde différence qui sépare les faits de conscience de tous les autres faits, ils conviendront, avec les psychologistes, que l'observation intérieure ne peut se confondre en aucune manière avec l'observation du dehors. C'est là le point qu'ils doivent éclaircir avant tout autre, sous peine de commettre, sans même le savoir, les confusions les plus graves et les plus insoutenables. La physiologie se fait gloire d'être une science de faits; et l'une des dernières venues, elle a raison de se ranger sous le drapeau commun. Mais, qu'elle le sache bien : le fait de conscience n'est pas seulement un fait aussi réel que tous les autres, il est encore le plus réel de tous, puisque sans lui tous les autres seraient pour nous comme s'ils xcvi n'étaient pas Si l'observateur ne portait pas en lui-même la perception des faits sensibles qu'il observe, aucune science ne serait possible. Regarder cette perception indépendamment de l'objet particulier auquel elle s'applique, regarder la faculté indépendamment de toute action particulière, c'est le devoir de la psychologie ; et comme les sens ne peuvent en rien nous révéler les perceptions intérieures et les facultés que nous portons en nous, c'est à l'esprit seul de voir et d'étudier l'esprit. Certainement les facultés se manifestent au dehors par certains effets, observables comme le sont tous les effets d'un autre ordre, \lais n'est-ce pas une chose bien peu rationnelle, quand on possède directement l'objet de son étude, d'aller étudier un objet différent? Quand on peut observer le principe, pourquoi ne s'adresser qu'aux conséquences? La physiologie aura beau faire, elle ne trouvera jamais dans les actes extérieurs de l'homme, dans son organisation matérielle, à quelque degré qu'elle y pénètre, rien qui ressemble à la pensée douée de conscience. La physiologie, cédant aux conseils d'Aristote, s'égarera bien davantage encore, quand des actes extérieurs de l'homme et de ses orga- xcvii nes propres, elle descendra, toujours pour observer la pensée humaine, aux actes et aux organes des animaux. Elle passera alors des complications déjà bien insurmontables que la vie offre dans l'homme, à ces inextricables et obscurs détails où se perd la physiologie comparée, quand on l'arrache de son domaine spécial pour la plier à l'explication des faits de l'entendement humain. La physiologie, en méconnaissant l'instrument direct que nous offre la conscience, ne s'aperçoit pas qu'elle imite un peu l'anatomie ancienne, qui étudiait l'organisme des animaux pour apprendre l'organisme de l'homme. C'est qu'il faut que les physiologistes se résignent à reconnaître avec Cuvier (Rapport historique, page 6,) « que les sciences naturelles finissent là où il n'y a plus à considérer que les opérations de l'esprit et leur influence sur la volonté. » Avec lui encore, il faut qu'ils se résignent à reconnaître « cet hiatus infranchissable » dont il parle en réfutant Gall, « et qui sépare la matière divisible du moi indivisible. » Mais c'est un sacrifice trop douloureux pour les physiologistes auxquels nous faisons allusion. A leurs yeux, laisser la physiologie à l'observation des phéno- xcviii mènes de la vie, ne pas la pousser jusqu'à l'observation des phénomènes de l'esprit, c'est abdiquer. Mais arrêtons-nous ici; pour les éclairer sur cette capitale erreur, nous n'aurions à leur répéter que ce que nous disions plus haut sur Aristote. Les objections qui valent contre le Traité de l'Ame valent aussi évidemment contre eux. Voyez, en effet, les grands triomphes qu'a remportés la physiologie, quand elle a risqué, sur la foi de ces prétentions illégitimes, d'édifier avec ses matériaux propres la science de l'entendement ! A quelles tentatives informes, impuissantes, ne s'est-elle pas laissé emporter? Le triste naufrage de la phrénologie devrait être pourtant une leçon. Il a fallu chasser du temple cette fausse science, malgré tout le bruit qu'elle a fait,et pour être vrai, il faut ajouter que c'est la physiologie elle-même qui, par ses plus illustres représentants, a exercé cette sévère justice. Mais la philosophie ne s'était pas montrée plus indulgente : et pour elle la psychologie phrénologique n'a jamais été que la plus vaine, si ce n'est la plus dangereuse des chimères. C'est que la philosophie pouvait s'appuyer dès lors sur les ad- xcix mirables travaux de l'École Écossaise ; et la réforme nouvelle était si loin de cette exactitude et de cette sagesse, que vraiment la discussion ne pouvait être sérieuse; car elle était à peine possible. L'erreur de ces physiologistes est au fond identique à celle d'Aristote, Comme lui, ils confondent la pensée et la vie, toutes distinctes qu'elles sont. La pensée peut dans l'homme s'observer directement elle-même: la vie échappe complètement à la conscience, Il est bien vrai qu'il n'y a pas de pensée sans vie; mais il y a vie sans pensée. La distinction est donc ici beaucoup plus facile qu'elle ne l'est souvent dans d'autres sciences qui se touchent d'aussi près. Les limites sont .si nettement indiquées, qu'il semble que le conflit n'aurait jamais dû naître. Tout ce que la conscience peut atteindre est du domaine de la psychologie ; tout ce que l'observation extérieure peut seule fournir appartient à la physiologie. De part et d'autre» c'est se rendre coupable d'usurpation que de franchir ces bornes évidentes. La psychologie elle-même, toute sage qu'elle est, les franchit quelquefois : et quand elle tâche d'expliquer la sensibilité, il faut bien qu'elle fasse, bon gré mal gré, quelques empiète- c ments. Mais elle ne prétend pas absorber la science qui lui est limitrophe; elle ne prétend pas tenter sur la physiologie la conquête violente que la physiologie a tentée plusieurs fois sur elle; car, on ne doit pas l'oublier, Stahl était un médecin et non point un philosophe. La physiologie, depuis Aristote jusqu'à nos jours, a été beaucoup moins circonspecte; et parce qu'il y avait des questions mixtes, elle s'est persuadé que, non seulement ces questions-là, mais toutes les questions, lui appartenaient. Elle a donné d'ailleurs à cette usurpation un prétexte qui, pour être spécieux, n'a pas cependant la moindre valeur. En étudiant l'homme dans sa partie la plus apparente, et, à ce qu'il semble au vulgaire, la plus considérable, elle a cru qu'il lui était donné d'étudier l'homme tout entier. Nous en convenons : il faut bien une science qui comprenne l'homme, et l'analyse dans son ensemble et non dans ses parties. La psychologie a bien dit aussi quelquefois qu'elle était « la science de l'homme, la science de la nature humaine; » mais on voit en quel sens : c'est par la pensée que l'homme est vraiment ce qu'il est; et la psychologie, science de la pensée, a pu, par une expres- ci sion d'ailleurs peu exacte, assurer qu'elle étudiait l'homme. Mais la psychologie ue connaît pas plus l'homme tout entier que ne le connaît la physiologie. La science complète de l'homme ne sera ni l'une ni l'autre : ce sera l'anthropologie, si l'on veut, laquelle ne sera elle-même qu'une partie de l'histoire naturelle. Mais l'histoire naturelle de l'homme ne doit pas se confondre avec sa physiologie. A plus forte raison ne se confondra-t-elle pas avec la psychologie. Encore bien moins, l'histoire naturelle ne pourrat-elle prétendre à cette mission souveraine de la psychologie, qui ne doit observer l'esprit humain que pour découvrir le vrai et universel fondement de la science, qui ne doit observer la pensée que pour connaître les vraies destinées de l'homme, autant qu'il a été donné à notre faiblesse de les connaître. La physiologie n'est donc pas la science de l'homme tout entier, comme elle s'en vante quelquefois. Elle n'est pas davantage la science de la pensée, bien que, pour se rendre compte de certains phénomènes qui lui appartiennent, il lui faille souvent étudier la pensée qui ne lui appartient pas. C'est que, par la nature complexe de l'homme, le physiologiste est forcé de devenir parfois psy- cii chologue, de même que le psychologue devient parfois physiologiste. Mais c'est s'ignorer beaucoup soi-même que de passer, sans le savoir, de l'observation de conscience à l'observation sensible, et de mêler, sans discernement, les résultats obtenus par toutes deux. C'est là aussi, on peut le craindre, l'une des causes qui ont égaré Aristote ; mais Aristote, bien qu'il fût l'élève de Platon, est en ceci bien plus excusable que ne le sont nos physiologistes. Après Descartes et Reid, le chemin est trop connu pour qu'il soit encore permis d'en chercher un autre. Du temps d'Aristote, malgré l'admirable effort de Platon, il pouvait rester des doutes. On pouvait subir encore les traditions antérieures. Un philosophe, même le fondateur du Péripatétisme, pouvait ne pas apercevoir cette lumière de la conscience qui ne brille que pour les yeux qui s'appliquent longtemps à la contempler. Aujourd'hui, pour rester dans les ténèbres, il faut presque le vouloir. Mais peut-être les physiologistes qui continuent à nier la conscience et le moi, sont-ils de « la race de ces terribles gens» dont a parlé Platon ; et nous perdrions bien vainement nos peines avec ceux que ciii Platon même ne peut convaincre. Laissons-les donc s'obstiner à contredire, non pas seulement la philosophie presque entière et toutes les religions, mais aussi le sens commun et toutes les langues que parle l'homme : laissons-les se contredire eux-mêmes dans le langage qu'ils parlent comme tout le monde, et où la notion de conscience et de moi est perpétuellement impliquée par ceux même qui la nient. Mais si la physiologie ne peut fonder la psychologie, peut-être du moine pourra-telle lui prêter quelque secours. Faire de la psychologie et de la physiologie, deux sciences qui Si: soutiennent et se complètent, c'est là ce que proposent d'autres physiologistes. Mais ce parti moyen ne semble guère plus acceptable que le parti extrême. La psychologie, renfermée dans l'observation de la conscience, se sait parfaitement indépendante. Elle prétend n'avoir besoin de l'appui de personne. Si donc on croit, en lui offrant un secours, que ce secours lui soit indispensable, on se trompe. La physiologie est bien récente : elle devrait ne pas l'oublier; la psychologie, au contraire, est bien vieille; elle a fait sa route longtemps avant que sa prétendue sœur ne fût née ; et quand civ on se rappelle ce qu'est le Platonisme, on voit qu'une telle route n'a point égaré l'esprit humain, et qu'elle mène très sûrement au but. Cette priorité et ces succès de la psychologie sont déjà, contre les offres de la physiologie, une objection qui a certainement le plus grand poids. Descartes était médecin et en savait certainement sur l'organisation humaine autant qu'homme de son siècle. A quoi lui a servi sa physiologie? Il était même novateur, et personne n'a soutenu plus hardiment et plus savamment que lui la grande découverte d'Harvey. Pourquoi donc Descartes n'a-t-il pas procédé par la physiologie dans le Discours de la Méthode ? C'est qu'il n'en avait pas besoin ; ou, pour mieux dire, c'est qu'il ne le pouvait pas, attendu qu'on n'observe la pensée que par la pensée même. De notre temps, quels services réels la physiologie a-t-elle rendus à la psychologie ? Comment a-t-elle prouvé qu'elle lui fût, je ne dis même pas nécessaire, mais seulement utile? S'il était, ce semble, une question grave où la philosophie pût recourir à une aide étrangère, ce serait sans contredit celle de la sensibilité. Eh bien, qu'a fait la physiologie pour compléter en ceci les données cv psychologiques ? J'aperçois bien les découvertes les plus ingénieuses, celle de M. Charles Bell entre autres. Mais ces découvertes, toutes précieuses qu'elles sont pour la physiologie, ont-elles fait avancer d'un seul pas la théorie de la sensibilité, la théorie de la perception? Les physiologistes sont encore entre eux dans les plus extrêmes désaccords sur le siège de la sensibilité. Us ne s'entendent pas davantage sur la nature des agents qui transmettent la sensation jusqu'au cerveau. On croit généralement que ce sont les nerfs; mais des physiologistes ont démontré qu'il y a des nerfs insensibles : qu'il y a des parties du corps dépourvues de nerfs, qui n'en sont pas moins très sensibles, la dure-mère, les ligaments, les tendons, le périoste, la cornée, etc. (4) : qu'au contraire, il y a d'autres parties tapissées de nerfs très nombreux, qui sentent à peine, le poumon, la rate, le foie, etc. : que le cerveau lui-même est beaucoup moins sensible que les nerfs, et que les nerfs en général le sont moins que les organes auxquels ils se ramifient : que cvi les nerfs ne servent pas uniquement à la sensibilité : que l'anatomie comparée présente la sensibilité sans système nerveux, tout aussi bien qu'elle présente des mouvements sans muscles, etc., etc. Non contente d'étudier l'homme en santé, la physiologie a mis à contribution la pathologie. La pathologie ne lui a pas suffi; elle a fait des vivisections, et interrogé, à ses risques et périls, un état anormal qu'elle créait malgré les avis de Cuvier. Elle a passé des sciences de l'organisation aux sciences accessoires, physique et chimie ; et elle en est presque revenue à Van Helmont, Paracelse et les autres, Mais qu'y a-t-elle gagné? ou plutôt, qu'y a gagné la psychologie, qu'elle prétend servir? La psychologie attend encore qu'on le lui apprenne. Elle ne refuse pas le secours qu'on lui promet; mais ce secours n'est pas encore venu, et, selon toute apparence, il ne viendra pas. Il serait beaucoup plus facile à la psychologie, si elle voulait récriminer, de montrer tous les services qu'elle a rendus à la physiologie : ils sont très nombreux et très importants. Mais il est inutile d'y insister; car il est plus d'un physiologiste qui les a loyalement reconnus. cvii Ainsi, des trois partis que nous avions distingués dans la physiologie, le premier peut être considéré comme ayant tiré du système d'Aristote les conséquences extrêmes qu'il contient; et il nie la psychologie proprement dite. Le second, qui représente peut-être plus exactement la vraie pensée aristotélique, croit que la psychologie ne peut être complète qu'à la condition de la physiologie, opinion conciliatrice qui a besoin encore d'être justifiée. Reste enfin un dernier parti qui, par la valeur de ses doctrines, par les noms illustres de ceux qui le composent, peut-être même par le nombre de ses adhérents, est le plus considérable de tous. Ce parti ne prétend pas fonder la psychologie; il ne prétend même pas la compléter : il la reconnaît comme une science parfaitement distincte et indépendante. Il étudie les phénomènes de la vie pour la vie elle-même; il admet trois éléments dans l'homme., le corps ou la matière, la vie et la pensée. De ces trois éléments essentiels, le premier seul est visible: les deux autres ne le sont pas. L'étude de la vie jointe à celle du corps constitue la physiologie : l'étude de la pensée constitue la psychologie. Les deux sciences sont voisines; cviii sur quelques points même elles se touchent ; mais elles ne se confondent point. Voilà la vérité; la voilà dans toute sa simplicité, et aussi dans toute sa rigueur. Sous une autre forme, c'est l'opinion de Platon: c'est l'opinion de Descartes. Cette grande doctrine, que nous tenons pour parfaitement fondée, est celle qu'a toujours professée l'école de Montpellier. Elle l'a professée depuis Bordeu et Lacaze, se rattachant eux-mêmes à l'animisme exagéré de Stahl, jusqu'à Barthez, qui a pu croire ses opinions tout-à-fait nouvelles, parce que, en effet, personne avant lui ne les avait aussi nettement exprimées. Tous les efforts de Barthez ont eu pour but d'isoler de tout le reste le principe vital : c'est de la vie toute seule qu'il veut s'occuper; le corps et l'âme pensante sont exclus de ses recherches. Il reproche à Descartes d'avoir été le chef de ceux qui n'ont reconnu dans l'homme que deux éléments : l'âme et le corps. Avec plus de justice peut-être, il reproche aux animistes et à Perrault, même avant Stahl, d'avoir rapporté toutes les fonctions à une seule âme. Cette opinion de Barthez a suscité une école entière : Dumas, qui, du même point de vue, a déclaré formellement que la physiologie cix ne devait attendre sa régénération que de la philosophie : Bérard, qui, malgré quelques indécisions, a cependant montré plus clairement que qui que ce soit parmi les physiologistes, la délimitation exacte des deux sciences : l'une s'occupant de la sensation avec conscience ou perception; l'autre, de l'impression sans conscience ou sensation proprement dite. A la suite de Bérard, de Dumas, de Barthez, ou pourrait citer, dans l'école de Montpellier, d'autres physiologistes encore vivants, dont les travaux non moins utiles soutiennent le vitalisme à la hauteur où leurs devanciers l'avaient porté. L'école de Montpellier se fait gloire, on le sait, de conserver la vraie doctrine hippocratique; c'est aux historiens de la médecine de prononcer sur un point aussi obscur. Mais il y a déjà bien longtemps que Galien avait remarqué des analogies nombreuses et frappantes entre les théories de Platon et celles d'Hippocrate; et nous pouvons dire que le vitalisme, en faisant une part aussi nette à la psychologie, s'il reste fidèle au Père de la médecine, reste bien plus encore fidèle à Platon. D'ailleurs l'école de Montpellier n'a point été la seule, au début de ce siècle, à soute- cx nir des théories qui laissent à la psychologie tout son domaine, et donnent à l'intelligence une place séparée et supérieure. On pourrait trouver dans Bichat même une foule de passages où il reconnaît, à côté de l'organisation matérielle et de la vie, un autre principe tout différent auquel il rapporte « les actes purement intellectuels et volontaires. » Mais cette tendance au spiritualisme, confuse encore dans Bichat, éclate avec puissance dans Buisson, son collaborateur, mort encore plus jeune que lui. Unisson, dans une thèse qui est presque une œuvre de génie, a plusieurs fois, et avec toute raison, redressé quelques unes des idées de son illustre parent. Il n'a point hésité à établir que notre intelligence nous est connue par la conscience intime que nous avons de ses opérations. Il en conclut admirablement qu'il faut examiner l'homme indépendamment des autres êtres organisés, et que raisonner de l'homme d'après les animaux, c'est se tromper de route, et partir de l'inconnu pour arriver au connu. Personne mieux que Buisson, et plus de vingt ans avant Bérard, n'a démontré tout ce que le matérialisme appliqué à l'étude de la nature humaine a d'insuffisant et de faux. Il a cxi signalé dans tous les phénomènes du principe sensible l'intervention indispensable de l'activité volontaire, comme l'avait toujours signalé l'école de Montpellier; et il l'a fait avec une assurance que n'a point dépassée M. de Biran. Rappelons que Buisson écrivait en 1802 ; et malgré l'apparence du paradoxe, disons que, dès cette époque, il fondait scientifiquement le spiritualisme, qui ne devait faire une réforme en philosophie que quelques années plus tard (5). En traitant de la physiologie contemporaine, nous ne sommes pas aussi loin d'Aristote qu'il pourrait le sembler. Aristote avait donné l'étude de l'âme à l'histoire naturelle. Après vingt siècles, une partie de la physiologie, la moins éclairée, accepte le legs : elle tente de prendre possession de la psychologie, et elle échoue. Une autre partie de la physiologie, la plus sage et la plus considérable, se garde de revendiquer un si douteux héritage; et elle reconnaît son cxii incompétence dans les matières psychologiques. Ainsi, la raison d'abord, puis le maître d'Aristote, ensuite le grand réformateur de la philosophie au dix-septième siècle, enfin la physiologie même de notre temps, voilà les autorités que nous avons tour à tour invoquées contre la théorie péripatéticienne. Ces autorités ne paraissent-elles pas suffisantes? En veut-on d'autres? Nous n'en connaissons pour notre part ni de plus grandes, ni de plus décisives. Nous sommes de l'avis de Platon et de Descartes, à qui nous pourrions joindre le témoignage de Buffon, de Cuvier, de Barthex même, si Platon et Descartes n'avaient déjà pour eux le témoignage de la vérité. Il faut donc, après avoir condamné la doctrine d'Aristote, condamner aussi la méthode qui semble la lui avoir imposée. Disons-le sans hésitation à la physiologie antique ou moderne: elle ne doit élever aucune prétention sur la psychologie, parce que toute prétention de ce genre est illégitime et funeste. La physiologie doit s'en tenir aux merveilles de l'organisme humain : le champ est encore assez vaste et assez beau; quant à la pensée, la physiologie ne cxiii saurait l'étudier, sans cesser d'être elle-même, sans se transformer en psychologie. Les sciences doivent connaître et respecter leurs limites avec bien plus de soin encore que les Etats ne doivent respecter les leurs. La vérité est plus précieuse pour l'esprit humain que ne le sont la puissance et la richesse pour les peuples; et la vérité ne se donne qu'à ceux qui savent la chercher dans les routes où elle se trouve. Aristote lui-même l'a méconnue; les physiologistes de nos jours ne la rencontreront pas plus que lui dans la carrière où ils prétendent la chercher, et où elle n'est pas. Il faut bien voir, en effet, de quel ordre est le problème qui s'agite ici. Il importerait assez peu, ce semble, que les faits de l'âme fussent étudiés par telle science plutôt que par telle autre; et des esprits légers pourraient croire que la philosophie, en élevant cette question d'attribution, n'élève au fond qu'une question d'amour-propre. Certainement il y a plus d'un physiologiste qui ne voit en cela rien autre chose ; et l'empiétement tenté sur la psychologie lui paraît d autant plus juste qu'il est plus vivement contesté. Je crois avoir démontré plus haut qu'au point de vue même de la science, la cxiv physiologie s'égare, et qu'en confondant l'observation intérieure et l'observation du dehors, elle confond les choses les plus différentes. Mais que parlé-je de la science ? Ses intérêts sont très graves, sans doute; mais il en est de bien plus chers encore. Quand l'homme étudie son âme, doit-il l'étudier avec ce désintéressement et cette sorte de curiosité indifférente, qui suffisent à l'étude de tout autre objet? La plupart des faits extérieurs, tout admirables qu'ils sont, ne nous touchent que fort peu eu eux-mêmes. En les observant, nous satisfaisons d'abord ce désir de savoir qu'Aristote signale, au début de sa Métaphysique, comme le sentiment le plus naturel à l'esprit humain, comme là source de toutes les sciences. De plus, la connaissance de la nature nous est immensément utile pour subvenir à ces besoins moins relevés qui sont ceux de notre corps; et la science alors se confond presque avec les arts et l'industrie. Mais les besoins du corps, ceux même de l'esprit, sont-ils les seuls que notre nature éprouve? ou pour mieux dire, ces besoins, tout légitimes qu'ils sont, ne se rattachent-ils pas à un besoin fort supérieur? L'homme ne veut pas seulement savoir ce qu'il est : il veut surtout savoir ce qu'il doit cxv être; il veut bien davantage encore savoir ce qu'il sera. La vie, telle qu'elle nous est faite ici-bas, est bien courte et bien obscure; si on l'isole encore, et qu'on ne s'enquière ni de ce qui la précède, ni de ce qui doit la suivre, elle nous demeure incompréhensible ; et dès lors, selon les ténèbres de notre esprit, ou les caprices de notre faiblesse, la vie devient une indéchiffrable énigme, ou un accablant fardeau. Il y a bien, il est vrai, quelques hommes qui se contentent de cette obscurité profonde, et qui, tout entiers aux nécessités et aux passions de chaque jour, ne voient rien au-delà, et ne cherchent point à connaître l'ensemble de leur destinée. Ils ont même, pour pallier cette indifférence, le plus spécieux prétexte : ils s'en prennent aux bornes si étroites de l'esprit de l'homme; et, sur la foi d'une impuissance imaginaire, ils se reposent dans un scepticisme qui se croit sage et modeste, et qui le plus souvent ne tarde pas à tomber dans une déplorable négation. Mais ce sont là des exceptions aussi rares qu'elles sont douloureuses. L'humanité ne se croit point condamnée à l'ignorance; et pour savoir ce qu'est l'homme, elle se soumet aux religions, ou se livre à là philosophie. Les religions et la philosophie, cxvi comme l'histoire l'atteste, satisfont pleinement l'humanité, bien qu'à des degrés divers, et lui apprennent son origine et sa destinée. La physiologie veut-elle se charger de cette mission sainte ? et après avoir remplacé la philosophie, se chargera-t-elle encore de remplacer les religions ? On sait assez comment la physiologie répondrait à la confiance que l'humanité mettrait en elle : elle déclarerait le problème insoluble, et n'hésiterait pas à traiter de chimère et d'hallucination cet éternel besoin de l'homme de se connaître lui-même; ou plutôt, quand elle aurait appris incomplètement à l'homme ce qu'est son corps, elle croirait lui avoir appris tout ce qu'il demande et tout ce qu'il nous est donné de savoir. C'est donc par une lin de non-recevoir et par un refus que la physiologie résoudrait la question ; et voilà pourquoi la philosophie ne peut à aucun prix lui abandonner l'étude de l'âme; car ce serait trahir les plus chers intérêts de l'humanité. Je sais bien que la philosophie, quand elle essaie de revendiquer ses droits, a d'autres adversaires encore que les physiologistes; et que les théologiens prétendent, avec non moins d'assurance, démontrer l'inanité de cxii ses efforts. La théologie et la physiologie, chose remarquable, font sur ce point cause commune : la première, parce qu'elle veut retenir le monopole de la discussion ; la seconde, parce qu'elle soutient que la discussion est parfaitement vaine. Elles se réunissent toutes deux pour refuser à la philosophie sa compétence, celle-ci sur une question qui ne lui appartient pas, celle-là sur une question qui n'en est pas une. Entre ces deux classes d'adversaires, la philosophie n'en fait pas moins son chemin. Depuis trente siècles qu'elle étudie l'homme, elle lui a généralement enseigné quelle est sa nature, quelles sont ses légitimes espérances. Avec la théologie, elle a cru que l'homme a une destinée qu'il lui était permis de connaître. Mais pour s'éclairer, la philosophie a pris une route qui n'était pas celle de la théologie, bien que cette route aboutît à peu près au même but. Plus tard, quand la physiologie est venue contester des droits exercés depuis si longtemps et si bien justifiés, la philosophie a dû lui répondre comme elle avait répondu à la théologie, en faisant appel à la raison. Elle invite la physiologie à observer les faits et à les bien comprendre, tout comme elle invite la théologie à ne pas calomnier les cxviii facultés que Dieu a données à l'homme. Le rôle de la philosophie peut être pénible; mais il est du moins aussi simple qu'il est grand ; et l'axiome socratique : « Connais-toi toi-même, » peut toujours lui su (lire et rester éternellement sa règle et sa limite. Quand l'homme s'est compris lui-même; quand, disciple fidèle de cette sagesse immuable dont Platon et Descartes sont les plus clairs interprètes, il a compris ce qu'est en lui la pensée, il affirme, avec une certitude désormais inébranlable, que son intelligence, qui ne s'est point faite elle-même, vient d'une intelligence supérieure ù elle; il affirme que son intelligence agit sous l'œil de son créateur, et qu'elle doit le retrouver infailliblement au-delà de cette vie. L'homme n'est point égaré en ce monde. Sa destinée peut y être douloureuse, intolérable même ; mais dès lors elle n'est plus obscure pour lui. Sa faiblesse peut quelquefois en gémir; mais il la comprend, et il sait en outre qu'il en dispose, au moins dans une certaine mesure. Il n'en faut pas davantage à l'homme. Savoir d'où il vient, savoir ce qu'il est, savoir où il va, que demanderait-il encore? Tout le reste n'est qu'un facile développement de ces féconds cxix principes; et l'homme intelligent et libre, s'il a tout à craindre encore des abus de sa liberté, peut se reposer avec une sécurité imperturbable sur la bonté, la justice et la puissance de Dieu. Fonder méthodiquement ces grandes croyances, sous l'autorité seule de la raison, les éclairer de cette lumière incomparable qui n'appartient qu'aux faits de conscience, en déduire les conséquences rigoureuses et leur soumettre la pratique de la vie, tel est le devoir de la philosophie; telle est, qu'on le sache bien, la cause de cette suprême estime où j'esprit humain l'a toujours tenue et la tiendra toujours. La philosophie n'impose point de symbole à personne, parce qu'avant tout elle respecte la liberté, sans laquelle l'homme n'est point ; elle ne donne à personne des croyances toutes faites; mais à tous ceux qui la suivent, elle apprend à s'en faire ; et elle ne peut que plaindre ceux que ne touche pas la foi d'un Socrate. La philosophie n'est donc point impuissante, comme le répète la théologie ; elle n'est point vaine, comme le croit la physiologie. La philosophie a su démontrer là où d'autres nient ou affirment sans preuves; elle a connu et satisfait le cœur de l'homme que d'autres ignorent et mutilent; cxx et ce n'est pas sa faute si ceux-ci restent dans leurs ténèbres, et ceux-là dans leur injuste dédain. Maintenant, je le demande, si former ces croyances dans l'esprit humain, qui ne doit point vivre sans elles, c'est l'objet véritable ile la philosophie; si ces croyances sont bien le but supérieur que poursuit la pensée humaine, quelle valeur aura l'étude des faits de l'âme ? Evidemment, les faits ne vaudront qu'autant qu'ils contribueront à ce résultat décisif. Ces faits, précisément parce qu'ils appartiennent à l'âme, ne peuvent se suffire à eux-mêmes; ce ne sont que les matériaux d'un plus noble édifice. Jusqu'à un certain point, l'homme peut se passer de connaître les faits du dehors; mais, quant aux faits qui lui sont propres, il ne peut les ignorer qu'au risque d'étouffer en lui les plus légitimes réclamations de sa nature. Par là, nous aurons la mesure de ces doctrines qui, en étudiant l'âme de l'homme, se bornent à constater des phénomènes, et qui se croient prudentes parce qu'elles n'osent prononcer sur les questions que ces phénomènes doivent aider à résoudre; par là, nous aurons la mesure de la doctrine de nos physiologistes modernes ; nous aurons cxxi surtout la mesure de la doctrine antique, dont la leur n'est qu'un écho. Nous admirerons la science d'Aristote et son prodigieux génie, mais nous ne le suivrons pas : ou plutôt, en acceptant quelques unes de ses théories, nous déplorerons que ces théories n'aboutissent à aucune croyance claire et précise. Nous voudrions que, dans cet essentiel sujet, le philosophe se fût prononcé plus résolument, et n'eût pas laissé à d'autres le soin périlleux de développer sa vraie pensée. Je ne crois pas avoir calomnié Aristote en lui prêtant les principes que j'ai dû réfuter. Mais ces principes n'ont pas toujours été reconnus pour les siens, on lui en a prêté même de tout contraires. Certes, je serais heureux de m'être trompé; mais j'ai fait tout ce qu'il a dépendu de moi pour me défendre de toute prévention et de toute erreur; et je crois pouvoir affirmer, en résumant cette longue et pénible discussion, que si, dans la question de l'âme, Aristote s'est éloigné beaucoup de son maître, il ne s'éloigne pas moins de la vérité. 30 avril 1846. (1) « Le corps est un instrument dont l'âme se sert à sa volonté... De là... l'extrême différence du corps et de l'âme, parce qu'il n'y a rien de plus différent de celui qui se sert de quelque chose, que la chose même dont il se sert. » Bossuet, Connaissance de Dieu et de soi-même, page 73, a, éd. de 1836. (2) Voir, pour la Dialectique platonicienne appréciée comme elle l'est ici, mon Rapport sur l'École d'Alexandrie, pr. xx. (3) Je ne veux point parler ici de l'influence qu'a pu exercer la théorie d'Aristote sur le mysticisme alexandrin. Ce sujet est très curieux et très obscur ; j'en ai dit quelques mots dans les notes du Traité de l'Ame, liv. III, chap. ii, § 12, et aussi dans mon Rapport sur l'école d'Alexandrie, pag. 42 et 125. (4) Voir Barthez, Nouveaux éléments de la science de l'homme, tom. I. p. 184, 192, 195 et suiv.; et Bérard, Doctrine des rapports du physique et du moral, p. 74, 84 et suiv.*
(5) Les deux seuls ouvrages de Buisson, mort à vingt-huit ans,
sont :
1° sa thèse inaugurale, De la division la plus naturelle des
phénomènes physiologiques, 1804 ; et 2° une dissertai ion non moins
remarquable, De l'influence des passions sur les phénomènes
organiques. Brisson était fort lié avec M. de Bonald. dont il
partageait les croyances spiritualistes, sans partager, comme il le
dit lui-même, ses croyances religieuses. |