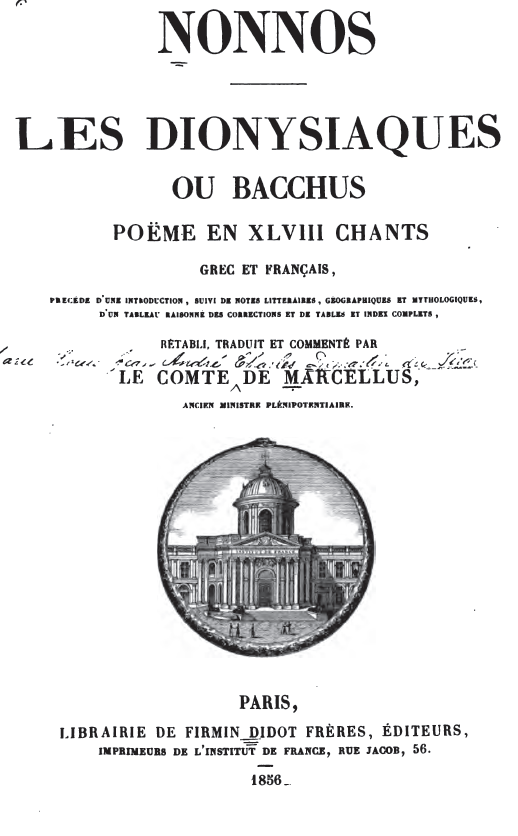
NONNOS
LES DIONYSIAQUES ou BACCHUS.
Introduction.
Traduction française : LE COMTE DE MARCELLUS.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
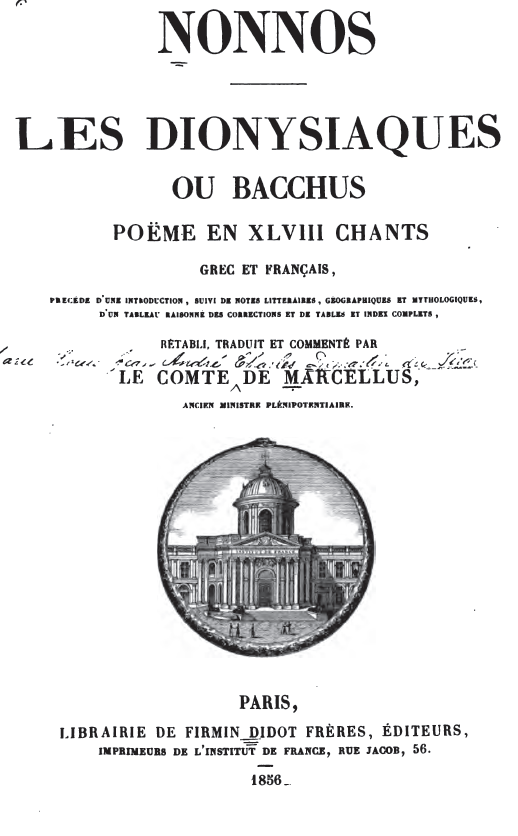
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
INTRODUCTION
I.
Pourquoi j'ai traduit Nonnos.
C'est sans doute une étrange entreprise que de déterrer, en plein dix-neuvième siècle, le mieux enfoui des poètes grecs. Tenter d'intéresser un public français à une mythologie surannée ou aux vers d'un Égyptien du Bas-Empire, n'est-ce pas folie? C'est au moins s'éloigner résolument des sujets qui out à peu près seuls l'habitude de nous toucher ; c'est en quelque sorte, j'en conviens, remonter le siècle au plus fort de son courant.
Mais quoi? notre civilisation transcendante s'étale en effet en chemins de fer, en palais de cristal, en télégraphes, en ballons jusqu'ici inutiles et seulement périlleux : notre industrie marche, il est vrai, à toute vitesse vers la fortune. Fait-on des progrès aussi rapides dans cette voie littéraire qui ne part et n'arrive que sous les bannières de la morale et de l'honneur? Courons-nous aussi vers les saines doctrines, vers l'affranchissement de l'esprit; et les renversements périodiques de l'ordre des États peuveut-ils passer pour des conquêtes de la philosophie et de la vraie liberté ? En affaissement du caractère, et en dégradation de la plume ou de la parole, ne rivalisons-nous pas avec ce quatrième siècle où mes essais vont nous ramener un instante Il semble qu'il y ait aujourd'hui une contradiction évidente entre le développement matériel et la défaillance spirituelle. Lumières, éclat même en inventions mécaniques; ténèbres, et presque silence dans les belles-lettres.
A l'exception de quelques esprits, vénérés de l'Europe et chers à l'Académie, qui, s'obstinant dans les convictions comme dans les admirations de leur jeunesse, travaillent presque seuls à la restauration du goût, et donnent à leur pays de beaux exemples d'indépendance, que voyons-nous? Au lieu de cette grande littérature où la noblesse des pensées, où la dignité du style empreint l'esprit du lecteur d'idées généreuses, et l'élève en quelque sorte à la hauteur de l'écrivain, ce ne sont que débauches de l'imagination ; abondance de phrases lancées sans étude, sans révision ; notre bel idiome vulgarisé, le style se pavanant dans ses négligences, le penchant au trivial, le goût du difforme, nos moeurs reproduites dans leur exacte turpitude : voilà ce qui bâtit aujourd'hui la renommée des auteurs les plus bruyants; et cependant ils absorbent l'attention publique, refusée à des écrivains plus sérieux ! Triste époque, si peu digne des temps qui t'ont précédée ! Ah ! si tu n'es que l'erreur d'un moment, un rêve fugitif, quelle aurore doit te faire évanouir?
De bonne foi, y a-t-il donc tant de carrières ouvertes aux hommes qui cherchent à bien dire, et à donner à leur pensée une existence de plus d'un jour?
La poésie ? Mais nos plus grands poètes, froissés de nos discordes civiles, ont détendu leurs lyres devant une société muette, et nos jeunes versificateurs remontent aussi les âges pour y puiser leurs inspirations !
La politique? Mais elle se hérisse de réticences, et se dérobe surtout à nous qui, serviteurs de la monarchie de nos pères, n'avons courbé le genou devant aucune des idoles nées de nos tempêtes; à nous, fils d'une France de quatorze siècles, et non d'une France découverte comme une comète sanglante vers la fin du siècle dernier; à nous, enfin, qui ne demandons à notre temps rien autre chose que le respect pour nos souvenirs, pour nos sentiments, et qui persistons dans notre fidélité.
L'histoire? Mais comment la traiter, si l'époque d'où on la juge est elle-même une énigme; si, dans ce grand silence qui a succédé au tumulte, une seule voix sans rivale parle de temps en temps pour tous à Westminster; si notre France emprunte à la Russie qu'elle combat sa taciturnité ; et si même l'étude de nos antiques annales n'est libre qu'à la condition de jeter vers elles quelques regards lointains, mais jamais des regrets ?
La mythologie seule nous reste, inoffensive et, pour ainsi dire, innocente, Là, du moins, le champ peut se dégager de toute allusion, de toute espérance suspectes; pour mon compte, je me suis réfugié dans les obscurités de la Fable, dans les événements ensevelis sous la poussière de trois mille années, et j'ai demandé un asile à ces lettres grecques, compagnes fidèles de ma vie, et mes meilleurs auxiliaires coutre les ennuis ou les illusions du pèlerinage.
II.
Manie des hellénistes.
Je ne saurais d'ailleurs comment justifier autrement, même à mes propres yeux, cette espèce de manie qui m'a pris de traduire en totalité les Dionysiaques. Le principal attrait de ce long travail a été pour moi de ne suivre aucun sentier frayé, et de m'élever seul, au milieu des buissons et des ronces, vers le sommet d'une montagne que personne n'a foulé encore; ou plutôt c'était un second Olympe mythologique que j'essayais de surmonter, au penchant de l'âge, après ce premier Olympe dominateur de l'Asie Mineure que j'ai franchi à grand'peine, dans mes jeunes ans, cime glacée où la neige et les frimas ne laissaient voir aucune trace humaine.
Que vous dirai-je ? les hellénistes sont les plus fantasques des écrivains, et presque toujours leurs préférences s'attachent aux livres méconnus, parfois même aux manuscrits réputés médiocres, enfin à ce qu'il y a de moins lu et de moins admiré. Serait-ce donc qu'ils trouvent ainsi plus d'honneur à les remettre en lumière?
Oppien, le chantre de la chasse et de la pèche, devenu, au détriment d'Homère et de Sophocle, le poète grec favori de l'empereur Septime-Sévère, et par conséquent de sa cour, fait aussi, quinze cents ans plus tard, les délices du célèbre Levantin Guys, le premier investigateur des coutumes de la Grèce antique, perpétuées dans la Grèce moderne.
Un Hellène du Fanar, auteur de quelques poésies légères imprimées à Venise, portait tous les jours avec lui, dans nos promenades solitaires du Bosphore, Apollonius de Rhodes; et un jour aux roches Cyanées, il me montra, sous les larges replis de sa ceinture orientale, l'épopée qui chante les Argonautes, leurs premiers explorateurs.
Pour ne parler que du grec, et de vers encore, l'abbé Piatti, dans son observatoire de Palerme, que j'ai gravi avec une si ardente curiosité, temple de l'astronomie dressé sous le ciel le plus transparent, n'a-t-il pas chargé son mémoire et ses cahiers des Phénomènes d'Aratus, entourés, à un vers par feuillet, des plus doctes commentaires? ces Phénomènes, tellement précis que Cicéron les avait appris en entier, et n'a pas dédaigné de les traduire en vers moins immortels que sa prose?
Nicandre, et ses traités poétiques sur l'art de guérir, avaient toute la faveur du médecin allemand qui herborisait avec moi dans les plaines et dans les forêts de la Bithynie ; et les marges d'une vieille édition de 1547, surchargées de notes officinales du docteur Pariset, l'intrépide antagoniste de la peste et de la fièvre jaune sont encore l'un des ornements de ma bibliothèque.
Enfin, pour mettre en un seul monceau ces préférences accordées aux poètes grecs d'un mérite secondaire, j'ai là, près de moi, pendant que j'écris, un Callimaque usé en tout sens sous les doigts d'un Français, catholique fervent que je n'ose nommer, tant mon coeur s'émeut à sa mémoire ! Cet ami des chants religieux puisait dans les hymnes élégants et profanes du poète d'Alexandrie de pieuses inspirations pour ses cantiques; et ils sont empreints encore avec ses bienfaits, dans le souvenir des jeunes populations groupées autour de la demeure qu'il m'a laissée.
Il ne serait certes pas difficile de retracer de nos jours, envers nos poètes modernes, de semblables engouements, dus sans doute à leurs qualités, ou quelquefois même à leurs défauts. Il règne, à toutes les crises de décadence littéraire et de déviation de la morale, une sorte de dédain pour la poésie classique; et c'est alors que naissent les enthousiasmes aussi éphémères que violents pour les auteurs de transition, et pour les talents de la seconde ou de la troisième époque. Il en fut à peu près ainsi chez nous, au début du siècle, des oeuvres de Delille, avec lequel d'ailleurs mon poète a plus d'une affinité, et, il y a quinze ans, des drames de Victor Hugo préférés aux tragédies de Racine. Je passe à dessein Lamartine, plus populaire encore, mais doué d'une renommée poétique si durable que ses narrations dramatiques de l'histoire des peuples ne pourront jamais en effacer ni en atteindre l'éclat. Il a créé une langue à l'usage des âmes rêveuses ; et ses premiers vers vivront dans nos mémoires attendries tant que nos coeurs battront sous l'inspiration d'une religion sublime et d'une mélancolie enivrante.
Je suis assurément fort éloigné d'éprouver pour le Panopolitain une sympathie aussi profonde. Je ne prends pas pour génie un amour de rimer; et ce n'est pas mon penchant que je manifeste ici, c'est mon choix que je justifie. Je ne relis pas, quant à moi, les expéditions de Bacchus de façon à amincir sous mes doigts studieux les marges de leurs rares éditions, fort peu portatives du reste. Je les quitte, au contraire, bien souvent pour Pindare, Théocrite, surtout Homère, qu'elles ont tant cherché à imiter. Mais je me persuade que la connaissance de ce poème (et tous ceux qui l'ont lu, à sa renaissance ou depuis, l'ont déclaré comme moi) peut jeter de véritables lumières sur certains points encore obscurs de l'antiquité. Les Dionysiaque: doivent être considérées comme un grand magasin mythologique; elles donnent un nouvel aspect à la littérature peu connue, et dès lors assez mal appréciée, du quatrième siècle; et il peut y avoir encore, ce me semble, même pour les esprits les plus dégoûtés des allégories de la Fable, une sorte d'intérêt à suivre dans un poème tout païen le progrès des images bibliques envahissantes, comme l'influence de l'Évangile sur les idées et leur expression. Mon entraînement vers le poète de Panopolis résulte en grande partie de sa situation particulière au sein de son époque. Ce dernier des épiques grecs, qui met d'abord la supériorité de son talent rythmique, la profonde connaissance du plus bel idiome, et tout ce qu'un siècle épuisé lui laisse d'imagination, au service de cette même mythologie, quand il va la répudier; ce païen, esprit fort, qui cède, dans le sein de la Thébaïde, à l'influence naissante du christianisme, et fait résonner sur sa lyre toute vibrante encore des orgies bachiques les récits du chaste disciple ; ce chantre des profanes conquêtes d'une impure divinité, qui amplifie l'Évangile de saint Jean, le plus sublime des Évangiles, lesquels sont eux-mêmes, suivant Origène, la partie la plus excellente des saintes Écritures (01); cet imitateur passionné d'Homère, passant à la Bible avec le même enthousiasme, et perfectionnant le vers hexamètre pour mieux rehausser la vie surnaturelle du Sauveur; ce rhéteur épique, qui fait resplendir les merveilles de l'Olympe, sans y croire ; enfin, cet Égyptien qui, sous l'emblème d'un breuvage corrupteur, conduit en triomphe aux limites du monde la civilisation antique, au moment où il la voit s'éteindre, et surgir auprès d'elle, dans ce même Orient, l'aurore d'une autre civilisation toute pure et divine ; il y a là, convenons-en, quelque chose qui s'élève au-dessus des données vulgaires, et qui peut fournir une plus exacte compréhension de la marche et de la puissance des idées chrétiennes s'infiltrant dans les veines du paganisme pour le dissoudre et pour le remplacer.
Quoi donc? quand, la plus vive curiosité s'attachant à la plus petite monnaie des temps helléniques, les yeux les mieux armés et les mains les plus expertes s'occupent à en dégager la rouille encroûtée; quand le moindre fragment de marbre datant de quelques siècles exerce la méditation, et soulève de nombreuses controverses; quand les voyageurs ou les antiquaires relèvent avec une si heureuse pointillerie les inscriptions, ou même les traces présumées des caractères grecs que la pierre a conservés; lors qu'enfin les livres les moins lus ou les moins rares, s'ils se cachent sous une vieille on sous une artistique enveloppe, deviennent, la mode aidant, l'objet des investigations les plus assidues comme des plus folles enchères, et que Nonnos lui-même, tout surpris de figurer sous une riche reliure et des tranches dorées, vient d'être enregistré, pour la première fois, parmi les morceaux les plus recherchés de la bibliographie (02) : faut-il que son poème, témoin important dans l'histoire de l'intelligence, ne puisse secouer également la poussière des âges, voir ses mutilations réparées, et montrer à son tour aux regards un monument précieux du plus magnifique langage qu'ait jamais animé la pensée humaine?
Et cependant cette langue est la seule dont les flots abondants, après avoir arrosé des champs si fertiles et quelques déserts, ont coulé sans se perdre pendant trois mille années ; toujours la même depuis les vers législateurs d'Orphée, jusqu'aux chants libérateurs de Riga; si peu rongée par la lente pression des siècles, que le berger de la Thessalie prend moins de peine à s'animer des patriotiques imprécations d'Eschyle contre les Perses, qu'il ne nous faut d'études à nous, Français civilisés, pour comprendre nos vieux romans de la Table ronde et les poésies de nos troubadours. Oui, cet idiome hellénique est un prisme divin qui colore tout ce qui le pénètre; il s'assouplit à la multiplicité des formes qu'enfantent l'imagination ou même le caprice; il remonte aussi haut que les plus anciens souvenirs de l'histoire ou de la Fable : Hérodote, après cinq cents ans, le reçoit d'Homère, à peu près tel que, sept cents ans plus tard, saint Jean Chrysostome va le dérober à Démosthène. Sans jamais disparaître dans les abîmes des âges, il domine tous ces dialectes européens qui s'engendrent l'un l'autre, et qui ne savent ni se fondre, ni subsister longtemps sous la même physionomie ; et lorsque dans sa variété il emprunte, soit à l'Orient, soit à l'Occident qu'il touche et sépare, il ne leur prend que l'image en l'appropriant à sa nature, et rejette pudiquement l'expression étrangère à sa pureté.
Puis, quand les transformations des peuples ou de leurs coutumes lui amènent des idées nouvelles, il n'a recours pour les répandre que lui-même, et à ces trésors toujours ouverts par les sciences et l'industrie de l'Europe puisent sans cesse une sorte de lexique commun et universel. Nourrice du génie, sa parole est la plus harmonieuse et la plus riche ; car elle peint la plus éclatante nature, retentit sur les mers les plus sonores, dans les airs les plus transparents ; et cette plante féconde et délicate, qui n'a pu fleurir ailleurs que sous le beau ciel où le commencement des temps la vit naître, embaume cependant le monde entier de son inaltérable parfum.
III.
Le véritable nom du Poète.
Il n'existe aucune traduction moderne en aucune langue du poème des Dionysiaques, et en langue latine on en connaît une seulement. On verra plus tard que l'interprétation française de Boitet, aussi illisible qu'elle est calquée, dès la renaissance du poème, sur cette traduction latine si informe, et non sur le texte grec, ne peut entrer en ligne de compte, ni passer pour une reproduction. Rien n'a pareil en Italie et en Espagne, où gisent encore dans les plus poudreuses bibliothèques les manuscrits du quinzième siècle déployés à peine; rien n'est sorti jusqu'ici des universités britanniques; et M. Louis Dindorf, un des plus savants scrutateurs de la philologie antique, me disait récemment, à Leipsick, que toutes ses recherches en Allemagne, atelier incessant des plus patientes élucubrations, étaient restées vaines, et ne lui avaient fait découvrir aucune traduction des Dionysiaques dans le nord de l'Europe ni ailleurs.
Mais, ici, je m'arrête au début de mon voyage; car j'ai hâte de faire cesser ma gêne et de me délivrer au plus tôt d'un embarras qui ralentit ma marche. J'ai à dégager, de prime abord, de ses ténèbres le nom de mon poète, et je m'aperçois que, dès mes premiers pas, il m'a fallu péniblement éviter de le prononcer, faute de l'avoir laissé indéterminé jusqu'à présent.
Je vais donc, pour première témérité, et certes ce sera la plus grande, supprimer le nom latin de Nonnus, et lui substituer, au moins dans tout le cours de mon ouvrage, si mon exemple ne parvient pas à lui conférer la nationalité française, le nom grec et primitif de Nonnos.
Je le demande, y a-t-il rien de plus naturel et de plus légitime que cette restitution ? Et pourquoi nous qui n'avons laissé à aucun Grec, et à fort peu de Latins, grands hommes de lettres, d'État on de guerre, leurs appellations originaires, nous qui avons peuplé l'histoire de ces mêmes époques d'Ambroises, de Jérômes et de Juliens, quand leurs noms véritables sonnent tout autrement ; nous enfin qui avons fait des Denys, tout court, de tant de Dionysos empruntant leurs noms à Bacchus, par parenthèse; pourquoi dis-je, nous obstinerions-nous à laisser à l'Égyptien Nonnos cette terminaison latine que nous avons retranchée presque partout, et dont nous l'avons défiguré à peu près seul dans son siècle avec Proclus ? et certes je n'hésiterai pas à débaptiser celui-ci, dès que H. Victor Cousin, son élégant et docte éditeur, m'en aura donné la permission.
En effet, quand des noms propres de Théocritos et de Callimachos, poètes gréco-égyptiens comme mon auteur, les Latins ont fait Callimachus et Théocritus, nous n'avons point persévéré dans cette prononciation toute romaine conservée par quelques idiomes du Nord, et nous les nommons en français Théocrite et Callimaque, après les italiens, qui les ont appelés Teocrito et Callimaco, tout d'abord.
Or, si l'Allemand Lubin Eilbart, inintelligent traducteur, a jugé à propos d'affronter la postérité sous le double déguisement de Lubinus Eilhartus, pourquoi faut-il courber Nonnos sous le joug ridicule d'une pareille transformation ? Latiniser les noms grecs sous l'étreinte d'une syllabe où siffle cet U qui déshonore l'alphabet français, comme a dit un Anglais (03) (un Anglais à la langue rude et sourde), d'une syllabe si peu grecque enfin qu'elle exige une grimace des lèvres, et que nous ne savons pas même l'adoucir en la prononçant à l'italienne ; c'est presque aussi étrange que de les franciser. Nous sourions en voyant, dans notre prose du règne de Henri IV, les chantres des Argonautes métamorphosés en Apolloine et en Valère-Flacque; de grâce, ne l'imitons pas : laissons les Grecs ce qu'ils sont, surtout ce qu'ils ont été ; et n'allons pas, de gaieté de coeur, nous priver de cette belle désinence hellénique qui retentit comme un son jeté à l'écho.
Un autre argument en faveur de mon système, mais celui-ci, je ne le donne pas pour concluant, c'est que si, au grand ébahissement des libraires, vous demandez Nonnus dans une de ces mille boutiques obscures consacrées aux vieux livres (car dans nos étalages, au grand jour, d'imprimés modernes, on ne vous comprendrait pas) ; ou bien si, dans une bibliothèque publique, vous voulez consulter ses ouvrages, ne fût-ce que pour vous singulariser aux yeux des préposés à la garde des trésors de l'esprit, on met presque toujours en vos mains les traités latins de Nonius Marcellus, grammairien du troisième siècle; et quand, par hasard, c'est moi qui fais la recherche, la méprise devient toute naturelle; car alors le bouquiniste ou le surveillant, qui me connaissent, ne manquent pas de s'imaginer que je veux faire ainsi appel à un écrivain de ma famille, et revendiquer en quelque sorte un héritage.
Sérieusement, cette méthode capricieuse et irrégulière de dégoiser dans les langues vivantes ou de dénaturer les noms grecs, traîne parfois après elle de grands inconvénients pour l'interprétation, et une confusion véritable dans l'histoire et la géographie. Il serait bien temps d'y remédier par un système uniforme, ou du moins plus rapproché de l'euphonie et de la vérité originelles. Et pourtant je ne me dissimule pas qu'en froissant un usage, en contrariant une habitude, je vais m'exposer à de vives récriminations. Mais quoi? y a-t-il donc un usage positivement établi, ou une habitude prise pour un auteur qu'on connaît à peine et qu'on lit si peu ?
Non, en désignant le chantre des Dionysiaques sous le nom de Nonnos à la place de Nonnus, je ne crois point céder à une vaine affectation de singularité. Je me figure au contraire que je le réhabilite; que j'inaugure favorablement ainsi, dès l'intitulé, mon système de rectification, et que les mânes du poète une sauront gré de rétablir un nom qu'il n'a donné à personne le droit d'altérer.
Cela dit, et mon innovation expliquée, du moins si elle n'est complètement autorisée, je poursuis.
IV.
La vie et les contemporains de Nonnos.
Que dire de la vie de Nonnos, quand on sait à peine son nom? Pour lui, comme pour la plupart des épigrammatistes grecs qui ont concouru à l'anthologie de la troisième époque, quand le collecteur Agathias, ajoutant son Cercle (kyklos) aux Bouquets de fleurs de Méléagre et aux Couronnes de Philippe le Thessalonien, a enregistré leurs petits vers, sans s'inquiéter de leur vie, tout se réduit à très peu de certitudes mêlées de beaucoup de conjectures.
Nonnos est né à Panos, ou Panopolis, la ville de Pan, en Égypte : voilà ce qui n'est douteux pour personne, et ce que confirmerait indirectement, au besoin, son poème des Dionysiaques. Cette ville de Pan (aujourd'hui Akhrnin) portait en premier lieu, disent les anciens géographes, le nom de Chemmis; et bien qu'Étienne de Byzance en fasse deux villes, ou plutôt les place en deux endroits distincts de son catalogue alphabétique, où les notions de la géographie ne semblent qu'un accessoire aux enseignements de la grammaire, il y a lieu de réunir ici les deux cités, et de les confondre pour en faire la patrie commune de Nonnos. Car la ville de Cliemmis, qu'Hérodote dit être la seule où les indigènes ne montraient, de son temps déjà, aucun éloignement pour les coutumes grecques, est bien la ville de Pan, dont Diodore de Sicile nous a transmis l'étymologie égyptienne, Chernmo. De là sans doute le rôle important que le dieu Pan joue dans les Dionysiaques, où on le voit toujours acolyte de Bacchus, l'Osiris égyptien. Ainsi, quand Nonnos faisait choix des triomphes de Bacchus pour son épopée, c'était, il ne faut pas l'oublier, un sujet national qu'il traitait, ou du moins l'antique origine du culte favori de sa ville natale. Qui sait même si Nonnos n'a pas été amené à célébrer les progrès de Bacchus, dieu civilisateur, ou les conquêtes du génie grec sur la barbarie indienne, par le spectacle de la religion qui altérait alors la face du monde, et si le futur néophyte n'a pas puisé l'idée-mère des Dionysiaques dans ses propres méditations sur la philosophie chrétienne, civilisatrice aussi, dont il voyait chaque jour grandir et se développer l'empire? Le chantre de Cymodocée a bien demandé à la patrie d'Homère les brillantes couleurs dont il a revêtu les Martyrs. Panopolis était située dans la Thébaïde, sur la rive orientale du Nil, près d'Antéopolis, en face de Crocodilopolis; et l'on peut, à la lecture de tous les nomes énumérés sous des appellations grecques par Pline le Naturaliste, s'étonner à bon droit de voir la langue des Hellènes porter si loin son influence, étendre jusqu'à la ligne du désert la parfaite connaissance de ses dialectes, et faire nature presque à la limite de l'Éthiopie ce poète grec que Suidas et l'impératrice Eudocie, auteur du Violier (Ionia), tous les deux échos des jugements littéraires des temps qui les ont précédés, s'accordent à désigner sous l'épithète enviée de Logiotalos. Or cette expression, à l'époque où elle est employée, signifiait très habile à bien dire. Serait-ce donc un écrivain sans valeur que celui dont le nom a sauvé de l'oubli le nom même de sa patrie? Car ce même Suidas et Étienne de Byzance ne semblent attacher d'autre importance à Panopolis que celle dont elle est redevable à son illustre citoyen.
Panopolis néanmoins eut plus d'un habitant digne d'être signalé au souvenir de la postérité. Et je ne puis m'empêcher de constater ici une véritable analogie entre Nonnos et l'un de ses compatriotes, que l'on pourrait croire son disciple : c'est Cyros de Panopolis que je veux dire. Dans le peu de vers qu'il nous a légués, Cyros, a l'exemple de l'auteur des Dionysiaques, semble avoir, avant tout, ambitionné la beauté du rythme, et en même temps l'imitation d'Homère. Cette recherche de la forme et du mètre homérique était de nature d'ailleurs à plaire à son auguste protectrice, une autre Eudocie, qui porta sur le trône du second Théodose l'amour des arts et de l'élégance attiques ; Eudocie, femme philosophe, ce qui, chez les Grecs, signifiait tantôt l'amie des lettres, tantôt tout simplement la femme vertueuse ; car ce titre n'avait pas encore toute la fierté qu'il a portée à une certaine époque du siècle dernier. Je suis, je l'avoue, vivement frappé de la rencontre, dans une même époque, ou plutôt de la conformité de destinées qui enchaîne ces trois esprits éminents. Cette impératrice païenne à Athènes, sous le nom d'Athénaïs, qui devient chrétienne à Constantinople, emploie le vers héroïque à traduire le début de la Genèse, les prophéties de Daniel, et construit, à l'aide des hémistiches de l'Iliade et de l'Odyssée, les Centons destinés à célébrer les mystères de notre foi : Nonnos, d'autre part, le chantre de Bacchus, qui paraphrase, quelques années plus tôt, l'Évangile de saint Jean avec l'idiome et le rythme d'Homère, comme s'il cherchait à poétiser le christianisme; enfin Cyros, poète lui-même, qui, dégoûté des honneurs et des fonctions politiques, devient prêtre et reçoit la charge de l'épiscopat. L'histoire n'est pas restée muette pour ce dernier néophyte; elle nous apprend que ses nobles qualités, ses talents, et l'atticisme de son érudition ayant gagné la confiance d'Endocie, Théodose l'avait élevé au rang de préfet du prétoire d'Orient. Bientôt, jaloux de son mérite et de sa faveur auprès du peuple, l'empereur le destitua ; et c'est alors sans doute que Cyros, abandonnant la capitale du monde oriental pour la solitude, s'écriait en beaux vers (04) :
«
Pourquoi mon
père ne m'a-t-il pas enseigné l'art de faire paître les brebis à
l'épaisse toison? Assis sous les ormes ou sous une roche, je
dissiperais mes chagrins au son de mes chalumeaux ! Muses, fuyons la
ville aux pompeux édifices, cherchons une nouvelle patrie; je vais
apprendre au monde combien nuisent aux abeilles les pernicieux
frelons.
»
(Anth. Jacobs. ix, Ep. 136.)
Et ici, il faut le remarquer, l'épithète homérique εὐκτιμένην (la
bien bâtie) prend, dans la bouche de Cyros, une acception toute
personnelle. Dans le cours do son habile administration, le poète
avait reconstruit les remparts de Constantinople, embelli la ville,
et mérité ce cri populaire qui fut l'une des causes de sa dis grâce
:
«
Constantin a fondé notre cité; mais Cyros l'a renouvelée.
»
Or, si ces premières conjectures ne m'égarent, je voudrais en tirer quelque lumière chronologique, non sans doute pour déterminer d'une manière précise les dates de la naissance ou de la mort de Nonnos, mais du moins pour fixer plus exactement le temps où il écrivait. Et maintenant que l'identité des chantres des Dionysiaques et de l'Évangile est reconnue; quand les nuages répandus sur cette question, pour ainsi dire bibliographique, par les premiers investigateurs des poésies grecques à leur renaissance, se trouvent complètement dissipés; quand la similitude des qualités ou des défauts des deux ouvrages, bien qu'en matière si diverse, ne laisse subsister aucun doute, je suis porté à croire que le poème de Bacchus, sujet épique et national qui doit avoir précédé de plusieurs années dans la vie de Nonnos ses poésies chrétiennes, fut composé, puisqu'on ne peut dire parut, vers la fin du quatrième siècle, sans doute avant les décrets de 391, où le grand Théodose déclarait les sacrifices païens criminels, et ordonnait de fermer les temples des faux dieux. Je penserais volontiers, d'un autre côté, que la paraphrase de l'Évangile. date des dernières années de ce même siècle ou du commencement du siècle suivant, et a dû devancer de peu de temps la fin de Nonnos, puisqu'un versificateur si abondant n'a pas laissé d'autre production, même dans l'Anthologie, grossie de tant de vers de cette époque.
Nonnos serait-il ce même grammairien auquel un certain Ausone le Sophiste adressait des épîtres et des vers, comme le dit Suidas sans autre explication ? Or cet Ausone, s'il faut donner au titre de Sophiste le sens favorable qu'indique le scoliaste de Pindare (05), ne serait autre que le poète latin de mon pays. Sans doute il fut contemporain de Nonnos ; mais ses vers, même dans leurs dédicaces si multipliées, n'offrent aucun vestige du poète de Panopolis. Ou bien s'agirait-il ici d'un autre Ausone, l'un de ces orateurs et de ces subtils philosophes à qui le glossateur d'Aristophane confère encore le nom de sophiste (06), mais cette fois sous l'acception défavorable qu'il garde encore en notre langue ? Cela est, en effet, beaucoup plus probable.
Nonnos était-il le père de ce jeune Sosenna que Synèse, Africain aussi, recommande à ses amis, et représente comme nourri et élevé dans l'art de bien dire? Διὰ λόγων τραφέντα καὶ αὐξηθέντα. (Syn. épître 102.) On peut le supposer, sans donner à ce témoignage une autorité exagérée, et reconnaître ici ce même Sosenna de l'épître 43 . Or, dans un tel silence de l'histoire, ce ne serait pas peut-être forcer démesurément la conjecture que de retrouver,. dans les malheurs dont Synèse fait un titre de recommandation au fils de Nonnos, la spoliation des biens des païens, ordonnée par Théodose. On pourrait alors comprendre notre poète parmi ces missionnaires de la philosophie, καὶ μάλιστα οἱ φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλόμενοι, que Socrate, le scolastique, leur contemporain, nous dit avoir racheté leur vie par leur conversion au christianisme. (Socrate, Hist. eccl., V, ch. 16, p. 274.)
Autre argument en faveur de la date approximative que j'assigne à la vie de Nonnos, de 360 à 420 de notre ère.
Est-ce Nonnos, évêque d'Édesse, à qui Nicéphore-Calliste applique l'épithète de divin (07)? Je suis loin de le croire.
Il n'est pas non plus ce Théophane Nonnos, médecin, qui, vivant sous Constantin Porphyrogénète, le savant encyclopédique, né dans la pourpre impériale, lui dédiait le recueil de ses préceptes sur l'art de guérir.
Il est encore bien moins cet autre médecin, Ludovicus Nonnus, à terminaison incontestablement latine cette fois, dont on a publié, dans le dix-septième siècle, les traités latins Sur le régime alimentaire et sur l'ichthyophage.
Il ne peut être ni le diacre Nonnos, figurant en 451 parmi les secrétaires du concile de Chalcédoine, ni un certain Nonnos de Palestine, partisan d'Origène, dont Siméon le Métaphraste fait mention dans les Vies de saint Saba et de saint Cyriaque. D'un autre côté, Bentley a soutenu que le Nonnos, auteur des récits explicatifs des allusions mythologiques de saint Grégoire de Nazianze, dans son panégyrique de saint Basile, n'avait rien de commun avec notre poète; et ces extraits, dont on retrouvera quelque trace dans mes notes, quand ils traitent de certains sujets rappelés dans les Dionysiaques, m'ont servi beaucoup moins qu'à l'impératrice Eudocie. « C'est à ces petits ruisseaux, » dit le docte Creuzer, « qu'elle a bien souvent puisé « l'eau dont elle arrose ses Violettes (08). »
Je trouve tout aussi vainement un Nonnos, évêque de Raphanée (l'Apamée de Médie), parmi les signataires de la requête présentée à l'empereur Justinien, pendant le concile de Constantinople, par les évêques de la Syrie Blanche, pour se plaindre de leurs exacteurs.
Nous remarquerons à ce propos que les Égyptiens donnaient le nom de Nonnos, qui signifie saint, aux solitaires de la Thébaïde, et aux chefs spirituels, comme aussi le nom de saintes, Nonnai, Nonides, aux vierges avancées en âge et aux matrones consacrées à Dieu (09). C'est une appellation respectueuse que les enfants appliquent encore en Italie à leurs aïeux : il Nonno, la Nonna. Et, pour le dire en passant, c'est par ce motif que les martyrologes désignent sous le nom de Nonnus, saint Hippolyte, le célèbre et savant martyr, dont M. le chevalier Bunsen, philologue et diplomate à la fois, a voulu retrouver une oeuvre égarée dans les Philosophournena d'Origène, récemment imprimés. Saint Hippolyte était évêque de Porto, village désert à l'embouchure du Tibre, réuni maintenant au diocèse d'Ostie, plus désert encore, dont. j'ai si souvent parcouru les vastes solitudes, et qui sert de titre suburbicaire à l'un des six principaux dignitaires du sacré collège; ce saint érudit, martyrisé dans l'année 240, ne peut assurément se confondre avec le poète de Panopolis ; et d'ailleurs Suidas a tranché la question ; car il dit formellement que Nonnos était le nom personnel de l'auteur des Dionysiaques, et n'avait jamais été par conséquent ni un adjectif ni un sobriquet.
Nonnos est incontestablement, par exemple, ce personnage que l'historien Agathias, dans ses habitudes de tout dire sans rien approfondir, désigne ainsi (et certes il aurait pu nous en parler plus longuement, s'il avait jugé à propos, suivant l'excellente méthode de nos jours, de faire précéder d'une notice biographique les oeuvres des poètes dont il nous a conservé les noms et les vers dans son Anthologie) : — « Voilà, » dit-il, « les fables que chantent les poètes primitifs, et qu'en les recevant d'eux, célèbrent aussi les poètes récents, parmi lesquels je citerai Nonnos, né dans la ville de Pan en Égypte, dans je ne sais laquelle des compositions patriotiques qu'il a intitulée : Dionysiaques (10). »
Au bout de cette trop longue revue de tous les Nonnos connus ou nommés dans l'histoire, pourquoi donc ne pas reconnaître ici le Nonnos dont parle Suidas, lequel, après avoir appris seize fois de mémoire Démosthène tout entier, ne pouvait faire sortir de sa bouche la moindre harangue tolérable? Et cette singulière obstination inspire au savant lexicographe une réflexion tout à l'usage de notre siècle, que j'ai entendu plus d'une fois répéter par M. Chateaubriand : « C'est une tout autre chose d'improviser pour la multitude, ou d'écrire avec élégance (11). »
On le voit, tout cela est vague et conjectural, comme le dit Heinsius; et quant aux conclusions qu'il tire au profit de son Aristarchus sacer, de ce que Nonnos, dans sa Paraphrase de l'Évangile, paraît, sous le point de vue théologique, pénétré des écrits de saint Grégoire de Nazianze, et semble ignorer les commentaires de saint Jean Chrysostome, cette indication, plus ingénieuse que précise, ne donnerait pas au Panopolitain une époque autre que celle que je viens de lui assigner.
V.
Éducation de Nonnos. État des lettres en Égypte. Paraphrase de l'Évangile selon saint Jean.
Nonnos, on peut le soupçonner à sa vaste érudition, fut très probablement élevé à Alexandrie, à l'ombre du Muséum primitif, au sein de cette bibliothèque du Sérapéon, fondée par Marc-Antoine, que des mains barbares allaient bientôt outrager. « Nulle part, » dit éloquemment M. Villemain, « le polythéisme n'était plus tenace et plus inépuisable que sur cette terre des Pharaons, où rien ne périssait, ni la réalité ni le mensonge; où l'antiquité mystérieuse des monuments conservait l'antiquité des croyances ; où la vie était si forte qu'elle semblait une émanation divine partout répandue, et où l'imagination superstitieuse du peuple faisait incessamment pulluler de nouveaux dieux, comme les fanges échauffées du Nil multiplient les reptiles (12). »
Sur ce sol générateur de tant de confuses divinités, d'où Nonnos a fait jaillir l'idée-mère de son poème, des classes de philosophie, de littérature, qu'on appelait alors grammaire (c'est presque encore un même mot, qu'il vienne du grec ou du latin), et de ces mathématiques qui dominent toujours dans les temps de décadence, étaient constamment ouvertes. On devinerait encore l'étudiant familier de l'observatoire d'Alexandrie, dressé par les Ptolémées, à son penchant pour l'astronomie révélé à tout propos dans les Dionysiaques : science ou contemplation poussée si loin chez les Égyptiens, premiers observateurs du ciel, qu'elle produisit bientôt l'astrologie, comme pour égarer mieux encore nos siècles les moins éclairés. Une multitude de grammairiens expliquait aussi, sous les voûtes publiques du Muséum ou dans des écoles privées, les beautés des grands écrivains classiques, ainsi que les mythes du paganisme. Les talents se formaient aux règles de la discipline poétique, assouplissaient le langage aux formes des moeurs raffinées; mais, hélas ! le génie ne tient pas école, et la sublime simplicité des poèmes antiques fit place au travail des pensées et à la science des mots. Le style, poli dans son afféterie, se surchargeait de la mémoire des siècles précédents et d'allusions érudites ; mais il déguisait mal, sous l'harmonie et la rondeur des phrases, l'absence de l'imagination ; le goût et le jugement se, dépravaient à ces pointilleuses études; l'amas des figures, des jeux de mots et ales subtilités énervait la diction; enfin tout était pour l'oreille, rien pour le coeur. « Époque corrompue comme la nôtre, » me disait M. de Bonald, « où l'on mettait l'esprit au-dessus de la raison, et la grâce au-dessus de la vertu. »
Cependant les ténèbres approchaient; l'ignorance, en dehors du christianisme, étendait ses sombres ailes sur le quatrième siècle, où l'Empire croulant couvrait à la fois de ses débris les Romains et les Grecs. Déjà la langue latine avait, comme la langue grecque, reçu l'influence des sectes littéraires qui partaient de l'Égypte pour envahir l'Europe; et néanmoins cette même époque, qui vit dégénérer l'idiome romain et se voiler le génie d'Athènes, vit aussi l'éloquence et la polémique chrétiennes prendre leur plus grand essor. Le siècle, en s'éteignant, s'éclairait encore de quelques lueurs poétiques. Tandis que Claudien reproduisait à Rome plusieurs des qualités et bien des défauts de cette école d'Alexandrie qui avait été sa patrie et sa nourrice, tandis qu'Ausone dans l'Aquitaine, avec ses vives et spirituelles saillies, et plus tard Boèce à Milan, appuyé sur sa philosophie consolante et généreuse, allaient tirer encore quelque étincelle du vers latin dans l'empire d'Occident, la douce et rêveuse mélancolie de saint Grégoire de Nazianze, Synèse et ses méditations d'une métaphysique sublime, Palladas et quelques élégants épigrammatistes d'Alexandrie et de Constantinople, enfin Nonnos au fond de l'Égypte, à l'aide de ses gracieuses imitations et de la perfection de son rythme, faisaient, dans l'empire d'Orient, briller encore de quelque heureux reflet le beau langage d'Anacréon et d'Euripide.
Remarquons ici, en thèse générale, que les écrivains, en vers comme en prose, de la deuxième époque d'une littérature, sont presque toujours sous le rapport de la diction, supérieurs aux écrivains secondaires de l'époque florissante : la raison en est toute simple : ils n'ont pas reçu pour la diriger dans ses premiers pas, la langue échappée à peine de son berceau; elle leur est arrivée grandie, développée, et, pour ainsi dire toute faite des mains de leurs devanciers. C'est ainsi que Lucien et Plutarque ont une phraséologie beaucoup plus artistique qu'Hérodote. Mais si l'instrument est plus parfait, l'inspiration qui le fait résonner s'est affaiblie. Quant à Nonnos en particulier, dans une ère où le génie enthousiaste tenait si peu de place, il a dû, pour se faire un nom, écrire très correctement, et chercher, par le charme et l'harmonie du mètre, relever le style poétique; il faut remarquer en effet, le soin qu'il met à s'éloigner des expressions vulgaires, des tournures hostiles à l'atticisme, des phrases triviales et incorrectes qui s'introduisaient dans l'idiome grec à Alexandrie, et dont Lycophron et les hymnes orphiques nous offrent plus d'une trace. Placé en outre sur la limite du paganisme qui va mourir et du christianisme naissant, il hérite des idées et des expressions de ces deux régimes qui ont successivement changé la face du monde. Il recueille les traditions ou les moeurs des peuples avant et pendant cette grande transition comme les connaissances éparses dans tous les écrits précieux que le temps nous a dérobés.
Encouragé par ces réflexions, je me suis persuadé qu'en introduisant ce poète presque étranger à la république des lettres, dans cette petite fraction de la société européenne qui jette un regard vers les générations passées pour en étudier les coutumes, mon travail pouvait ne pas rester sans quelque utilité, ne fût-ce, et j'insiste sur ce point, que pour profiter des lumières éteintes depuis qui entouraient alors Nonnos comme pour éclairer l'histoire littéraire d'un temps si peu connu, et servir d'initiation aux esprits de notre époque, quand, afin d'arriver à l'intelligence complète du génie moderne ils croient devoir encore demander quelques lumières au génie de l'antiquité.
Ainsi, je l'avoue, j'ai suivi Nonnos avec une curiosité véritable, dans les révolutions de son esprit, autant que dans les variétés de son style, toujours empreint d'Homère, même quand il délaye la Bible. J'ai étudié, dans l'application si diverse de son talent, ce poète qui passe des tableaux de la mythologie, sans en voiler la nudité, aux images si pures du disciple que les Grecs ont surnommé la Vierge (13), et que les érudits du seizième siècle appellent aussi sanctissimus Parthenias. J'ai hâte de dire que ce contraste des ornements ou des figures de la poésie profane appliqués à la morale chrétienne, cette sorte d'anachronisme d'expression, qui serait de nature à nous offenser comme la parodie mondaine d'un sujet évangélique, disparaît totalement du poème païen. Là, du moins, en raison de son titre, l'imagination de Nonnos peut se donner carrière, et même s'égarer, sans trop scandaliser la nôtre.
Et, à ce propos, c'est, selon moi, à son thème trop exclusivement mythologique, et aux scrupules des savants du seizième siècle, qu'il faut attribuer l'oubli où languissent les Dionysiaques, tandis que les commentateurs affluent pour la Paraphrase, et en out multiplié les traductions. Ces préjugés, dont on ne peut certes réprouver les motifs, mais qu'on peut regretter dans un intérêt purement littéraire, ont été portés si avant qu'on a cherché à établir la supériorité poétique de ce dernier écrit sur le premier. Cette sentence, je dois le dire, me semblerait souverainement injuste, et j'ajourne volontiers le débat jusqu'après la lecture de la traduction, ou plutôt du texte tel que je l'ai reconstitué. On comprendra plus facilement alors combien la proposition contraire est plus naturelle et plus vraie. il y a plus d'invention, cela va de soi-même, mais aussi, je le soutiens, beaucoup plus de poésie et de talent réel dans les épisodes de la vie de Bacchus, même en y comprenant ses ancêtres, que dans la glose des récits évangéliques, tout artistement régulière qu'elle puisse se présenter. Et, bien que l'allure du rythme, la prodigalité et le néologisme des épithètes soient les mêmes des deux cotés, on ne peut s'empêcher de s'apercevoir que le poète est bien plus à l'aise dans les quarante-huit chants des Dionysiaques, ouverts aux caprices des légendes même les plus contradictoires, que dans les vingt-trois chapitres du saint Évangile, où il a dû rester asservi à une marche uniforme et à un thème rigoureux.
Convenons-en d'ailleurs avec Despréaux :
De la foi d'un chrétien les
mystères terribles
D'ornements égayés ne sont pas susceptibles.
Je m'appuie de cette sentence pour faire observer que, dans le cours entier de mon oeuvre, je me suis faiblement occupé de ce second ouvrage de Nonnos, et que je n'ai voulu ni le défendre contre Heinsius, ni le juger moi-même.
Je ne me suis pas privé cependant des lumières qui pouvaient jaillir de la confrontation des deux textes, des similitudes que le poète peut avoir recherchées, et des locutions qu'il a fait passer de son grand ouvrage dans le dernier. On retrouvera quelques vestiges de mes travaux sur la Paraphrase, dans les commentaires, où j'ai rapproché les épithètes et certains hexamètres. Il n'est que trop vrai, c'est surtout vers cette longue amplification de l'Évangile selon saint Jean que s'est tourné jusqu'ici le zèle des philologues et des grammairiens, quand ils ont voulu fixer la place que doit occuper Nonnos dans la littérature grecque du quatrième siècle ; c'est cette diction et ces images qu'ils ont soumises par prédilection à leur censure et à leur creuset, en négligeant la composition originale dont elles étaient la copie. Et cependant Nausius, le plus célèbre de ses traducteurs, disait dans un avis préliminaire :
« J'aurais voulu donner aux partisans de la poésie grecque quelque goût pour une autre oeuvre de Nonnos : et je ne puis trop les inviter et les exhorter, après avoir lu attentivement Homère, Hésiode, Callimaque, Théocrite, Apollonius et les autres anciens poètes, à étudier avec soin les Dionysiaques : ils y trouveront bien des choses excellentes (praeclara) qu'on ne rencontre point ailleurs. »
Tout est dit depuis longtemps sur la Paraphrase de l'Évangile. Les éditions abondent comme les traductions et les commentaires; et il m'a semblé qu'en m'appesantissant sur un sujet si peu analogue au mien, j'aurais pu encourir, aux yeux de mes lecteurs, le blâme d'un mélange hétérogène et d'une sorte de profanation.
VI.
Pourquoi je ne juge pas ici Nonnos.
Ne pouvant rien, ou presque rien, pour dissiper les ténèbres accumulés sur l'existence de Nonnos, c'eût été peut-être ici le cas, pour m'en dédommager, de m'étendre dans un chapitre spécial sur les mérites ou les défauts de ses ouvrages, on tout au moins du poème à qui j'ai consacré mes veilles : mais il m'a semblé plus naturel de céder mon tour de parole à ceux qui, dans l'un ou l'autre sens, reproche ou éloge, m'ont devancé ; et, en cette double matière, avant de puiser chez moi, j'ai eu beaucoup à choisir chez les autres. Presque tons les critiques qui ont lu jusqu'au bout les Dionysiaques à leur réapparition, dans les premières éditions si incorrectes, ou, à proprement parler, dans l'édition primitive et unique répétée simplement à une plus tardive époque, soit même la plupart des érudits à qui, de nos jours, le texte de Graëfe, bien défectueux encore, a permis d'en parcourir certains épisodes détache, comme pour compenser ce labeur ou se vanter de leur patience, ont cru devoir en publier un jugement parfois indulgent, mais beaucoup plus souvent sévère. Quant à moi, qui me suis prescrit la tâche de rendre à ses vers, autant que je l'ai su, leur lustre primitif, de les dégager des obscurités ou des répétitions dues à de maladroits copistes, enfin de les traduire en entier, je me contenterai de rapporter en gros ici, et en détail dans le corps de l'ouvrage, le sentiment de mes savants prédécesseurs, me réservant de le confirmer ou de le combattre à l'occasion. Je tiens surtout à laisser le lecteur juger lui-même ; et, dans ce but, j'ai renvoyé aux notes spéciales mes propres appréciations. C'est là seulement, et non dans cette préface qui n'est pas près de finir, que j'essayerai de faire valoir ou plutôt de souligner le texte, pour ainsi dire. Mes remarques porteront aussi sur le style ou la composition, quand ma traduction ne les aura pas signalés suffisamment par elle même; et ici je dois m'excuser d'avance de ne pouvoir, dans une prose toujours un peu traînante quand elle interprète la poésie, faire goûter tout le charme de cette versification élégante même sous son enflure, et de cet idiome toujours mélodieux dans son abondance. Les traductions ne sont-elles pas toutes, et ici je parle des meilleures, comme ces fleurs que copie sur le plus parfait modèle la main d'une femme ingénieuse? exactement pareilles de forme et de couleur à ces mêmes fleurs que créa la nature, il leur manque toujours, non pas seulement le parfum, mais aussi cette fraîcheur délicate que lui donne la rosée native, enfin ce je ne sais quel charme pour celui qui va la cueillir, de la voir brillante sur la tige qui l'a nourrie et attachée encore au sol où elle a vécu.
VII.
Historique des éditions : Sambucus, acquéreur de la copie princeps; l'archevêque Arsénios, copiste ou propriétaire de ce manuscrit.
Maintenant, pour suppléer à une biographie sérieuse de Nonnos que je viens de poursuivre à tâtons sans pouvoir l'atteindre, je saute par dessus les douze siècles qu'il a traversés lui-même, dormant dans la poudre des manuscrits et j'arrive aux jours de sa renaissance. Ces jours tardèrent à poindre bien plus encore pour lui que pour les autres poètes grecs, et ils ne jettent, aujourd'hui même, sur l'horizon littéraire que de très faibles lueurs.
Un siècle environ après que la découverte de l'imprimerie eut vivifié les lettres et propagé rapidement le goût des chefs-d'oeuvre antiques, naquit en Hongrie un homme qui se distingua entre tous les autres par son penchant pour les vieux manuscrits, comme par ses recherches assidues des monuments des siècles grecs et latins : Jean Sambucus, né d'une famille patricienne à Tyrnau, au sein des provinces où le latin se parle encore, et où en 1820 quelques phrases empruntées méchamment à Cicéron m'aidèrent à faire atteler sur ma mince voiture de courrier huit chevaux pour franchir les lacs de boue qu'on appelait alors la route impériale; Jean Sambucus, dis-je, à l'ombre de son nom latin et préparé à ses fouilles intellectuelles par de laborieuses études, se mit à travers l'Europe en quête des vieux papyrus, objet de son unique ambition. Il s'arrêta peu devant la modicité de sa fortune, mais jamais en face des difficultés ou même du danger des voyages. Spirituel, excentrique même, comme tous ces amateurs de vieux livres dont Charles Nodier fut chez nous le type le plus éclatant, il ne se contenta pas, comme eux et lui, de les poursuivre sur les parapets des ponts, et sur les rayons étalés en plein air des quais d'une seule ville; il voulut les relancer dans leurs retraites les plus mystérieuses, et il courut le monde, tantôt à cheval, tantôt descendant le cours des fleuves dans une barque, seul, suivi de deux chiens fidèles, dont il nous a conservé les noms, comme si la présence de Madel et de Bombo (14), sagaces et infatigables investigateurs des hôtes des bois et des plaines, devaient lui servir d'encouragement et d'emblème dans ses chasses littéraires. Ses pérégrinations durèrent vingt deux ans, beaucoup plus sans doute que la vie des quadrupèdes ses assidus compagnons. C'est ainsi que, dans le cours de ses patientes perquisitions, il vint à Tarente, ville déshéritée alors comme aujourd'hui des communications européennes, mais dont la situation plus rapprochée de la Grèce avait fait, mieux encore que des autres villes italiennes du littoral adriatique, le refuge des Grecs lettrés, après la prise de Constantinople.
C'est là qu'avait vécu, ou plutôt c'est là qu'était mort Arsénios, l'auteur ou le compilateur des Scholies d'Euripide, oeuvre inachevée, car rien de ce qui concerne ce savant personnage ne devait demeurer complet ou incertain. Il avait été déposé du siége de Monembasie, en Morée, par une sentence du synode de Constantinople, vers 1509, et non point nommé archevêque de Monembasie par Léon X, ainsi que l'a avancé, avec une légèreté qui ne lui est pas habituelle, Clavier son biographe (Biog. univ., art. Arsénios), comme si ce vain titre n'eût pas été de nature à raviver les regrets du prélat, plutôt qu'à le consoler de la patrie perdue. Il n'est pas même avéré qu'il ait jamais paru à Rome; ou apprend seulement par sa dédicace des Scholies, adressée en 1534 au pape Paul III, qu'il se plaignait amèrement de l'abandon où le saint-siège laissait l'Église grecque. Arsénios avait échappé à l'invasion des barbares, avec son père Apostolios; et tous les deux, selon la mode du temps, reçurent ou prirent, en abordant l'Italie, cette terminaison latine de l'us, substituée à l'os, qu'ils ont conservée depuis (15).
Apostolios composa dans son exil, pour aider sa misère, cette espèce de lexique des proverbes grecs (Paroimiai) qui secourut puissamment Érasme dans le gigantesque travail de ses Adages. Or, soit dit en passant, ce goût des proverbes et des dictons populaires n'a point encore cessé chez les Hellènes, et je possède un recueil des locutions et des sentences de la sagesse des Grecs modernes, qui a été imprimé à Larta, à l'ombre même de la forteresse d'Ali-Pacha, tyran de l'Épire.
Apostolios ne put se résoudre à vivre loin de la Grèce, et il laissa ses deux fils en Italie; le second, Aristobule Arsénios, auteur du poème de la Guerre des chats et des souris (la Galéomyomachie), n'était pas moins versé que le premier dans la littérature antique. Son père revint mourir dans l'île de Crète, d'où il envoyait, pour subvenir à sa vieillesse, des copies des anciens manuscrits, exécutées par lui-même. A cet effet, il en avait réuni un grand nombre; je ne puis croire néanmoins que l'exemplaire des Dionysiaques qui fut trouvé parmi les papiers de son fils, l'archevêque Arsénios, fût une copie de sa main. J'ai, pour en douter, autant de motifs qu'il y a de fautes dans l'impression fidèle de Falkenburg ; et certes Arsénios ne les eût pas laissé subsister dans la condition et le nombre où elles nous sont révélées. Je dois même croire que cet exemplaire de Nonnos fut rarement consulté par le père ou par le fils dans leurs élucubrations philologiques, car l'un et l'autre en font à peine mention. Le savant archevêque, en dédiant à Charles-Quint l'édition vénitienne des iambes zoologiques de Philé, dont il possédait l'exemplaire unique, explique toute la peine que lui a donnée ce manuscrit, foulé aux pieds, déchiré en nombreux morceaux, sans suite, à feuilles déplacées et décousues; c'est enfin, dit-il, un autre Pélias qu'une autre Médée pourrait seule rajeunir (16).
Certes Nonnos n'était guère moins nécessiteux d'assistance; et, en passant sous la plume de l'archevêque Arsénios, il n'en serait pas sorti tel que Falkenburg ou même Graëfe nous l'ont présenté. Me pardonnera-t-on d'ajouter que la suscription de cette lettre d'Arsénios à Charles-Quint, écrite trente-huit ans avant la bataille de Lépante, est digne de remarque dans un temps où, après avoir, comme le grand empereur, refoulé les barbares en Afrique, l'Europe occidentale étouffe la Grèce à leur profit? « Au roi Charles. Puisse-t-il toujours dresser les trophées de ses victoires sur les barbares! »
Toutefois, j'ai hâte de le redire après cette longue digression, c'est à Tarente que notre voyageur bibliophile fit la rencontre de ce manuscrit de Nonnos, vendu avec la défroque de l'indigent archevêque, et qu'il parvint à l'acquérir au prix de quarante-cinq écus d'or. Ici je pourrais, tout comme un autre, faire briller la somme équivalente en monnaie actuelle de France, pour la satisfaction des bibliomanes de nos jours, si j'étais bien sûr de la valeur de l'écu d'or, telle qu'on la comprenait à Tyrnau ou à Tarente en 1660, et si ce point méritait d'être éclairci. La somme, dans tous les cas, était assez considérable, puisqu'il s'agit d'or, vu la fortune assez bornée de Sambucus.
VIII.
Les manuscrits de Fr. Philelphe et de Hurtado de Mendoza.
Ce n'est pas cependant que ce manuscrit fût unique, mais il y a tout lieu de penser qu'il fut un de ceux sur lesquels s'exécutèrent successivement les premières copies destinées à passer les Alpes : ces copies, très peu nombreuses, après avoir peu voyagé en Europe, se réfugièrent enfin dans les bibliothèques publiques, où elles dorment aujourd'hui, à côté de l'édition princeps, fort rare aussi, sous une commune poussière.
Tout imparfait qu'il était, cet exemplaire était cependant conforme au manuscrit du treizième siècle que François Philelphe acheta en 1424, à Constantinople, de la femme de Jean Chrysoloras. Dans ce volumineux Codex, Nonnos se trouve en bonne compagnie, et admis d'avance, comme il devait l'être plus tard, dans le corps des poètes grecs (17). Il occupe sous cette honorable enveloppe, sur le parchemin in-4° transcrit à deux colonnes, 164 pages, ce qui paraîtra peu considérable quand il est question de plus de vingt mille vers. On le voit ainsi côte à côte avec Théocrite, Apollonios de Rhodes, Oppien, Moschus, Nicandre, Tryphiodore, saint Grégoire de Nazianze, les Oracles d'Apollon, les Énigmes, les Épigrammes sur l'hippodrome de Constantinople, toutes poésies qui sembleraient appartenir à l'école d'Alexandrie, si l'on n'y remarquait aussi Phocylide et Hésiode, le second ou peut-être le premier en date des poètes grecs (18).
Avant d'aller
plus loin, je dois à ce précieux manuscrit, et à tous ceux qui ont
la bonté de me lire, de venir en aide aux embarras du bibliographe
Bandini, dans son exacte description de ce Codex si mélangé. « On
lit à la fin des Dionysiaques,» dit-il,
«
de l'écriture de Fr. Philelphe, ces paroles : Acheté à
Constantinople, de la femme du célèbre Jean Chrysoloras, en 1423
(ἀπὸ τῆς γυναικός). Et,
»
continue-t-il en note,
«
il y a
au-dessus de ce dernier mot grec un autre mot, μεθίσου, qu'il se
garde bien de traduire, car il est inintelligible; c'est μητείρας,
mère, qu'il faut lire, puisque Philelphe, ayant épousé, peu de temps
après l'acquisition du manuscrit, la fille de Chrysoloras, la belle
Théodora, dont il était éperdument épris, ajouta de sa main à son
empiète le titre de mère, qu'il donnait tout naturellement
ainsi à Manfredina Auria, la femme de son maître de grec,
Chrysoloras; noble et vertueuse matrone, dont il nous a fait, en
prose comme en vers, un pompeux
éloge.
Quoi qu'il en soit, la dernière ligne de la 164e page, qui termine ce lourd manuscrit des Dionysiaques, n'est pas le vers final du poème, mais bien une exclamation du copiste, joyeux d'être parvenu à la fin de sa tâche, et que je tremble d'entendre répéter à mes lecteurs : Gloire à vous, Seigneur, qui m'en avez délivré (19) !
Or, si, à
l'occasion de ce Codex de la bibliothèque Laureutienne, je
m'étends avec trop de complaisance sur quelques détails de la vie
intime de son acquéreur originel, c'est d'abord parce que ce
manuscrit des Dionysiaques me
paraît être le premier qui ait quitté la Grèce pour l'Italie; c'est
ensuite, faut-il l'avouer? parce que Philelphe a été pour moi
longtemps un type et un modèle. Secrétaire de légation à
Constantinople, il en rapporta de nombreux manuscrits grecs. Ainsi
devais-je, quatre cents ans plus tard, secrétaire d'ambassade
moi-même, en rapporter, manuscrits aussi, les Chants populaires
de la Grèce moderne : mais là, malheureusement pour ma
renommée littéraire, s'arrête le parallèle; et ces hautes facultés
d'écrire en vers et en prose grecs, dont il était si fier, cette
vaste et piquante érudition qui lui valut alternativement la haine
et l'estime, les récompenses et les persécutions, les couronnes et
les poignards des petits princes italiens, amis des lettres autant
qu'ombrageux, ne sauraient trouver leur pendant dans mon obscure
existence.
On pourrait croire aussi, ce me semble, que l'exemplaire de Sambucus qu'il avait payé si cher, et qui avait appartenu à Arsénios, était une copie soeur de celles de Hurtado de Mendoza. Le savant Espagnol, modèle des grands seigneurs, poète et historien remarquable lui-même, fit d'abord transcrire, à grands frais, de nombreux manuscrits dans la collection grecque du cardinal Bessarion, ensuite recopier ceux que lui envoya le sultan Soliman, en reconnaissance de la liberté rendue à l'un de ses fils, de la race impériale d'Osman, qu'il avait racheté. En ce cas, Arsénios, archevêque de Monembasie, n'aurait-il pas été pris par Falkenburg pour son homonyme Arnold Arsénios, que le célèbre Castillan, honneur de la diplomatie, employa en qualité de copiste? ou mieux encore, pour son frère Aristobule Arsénios; car cet Arnold, cité par M. Abel Rémusat (20), m'est suspect, vu son nom si peu hellénique. L'archevêque aurait ainsi gardé ou fait redoubler pour lui-même la copie des Dionysiaques dont il s'agit.
Quoi qu'il en soit de mes vétilleuses conjectures, c'est le manuscrit d'Arsénios, lu légèrement et nullement corrigé par le prélat, que rebuta sans doute ce thème trop peu analogue à ses méditations habituelles; c'est, dis-je, cet exemplaire qui a servi à la première impression d'Anvers, et qui repose aujourd'hui sous les verrous impériaux de la bibliothèque de Vienne.
IX.
Utenhove, premier lecteur de Nonnos.
Chargé du manuscrit acheté à Tarente, d'un détenteur inconnu et illettré, ainsi que le dit d'Ansse de Villoison (21), Sambucus en grossit encore le fardeau par plusieurs précieuses conquêtes, grecques aussi, telles qu'Eunape, Aristénète, Stobée, puis par un grand nombre de lettres de saint Grégoire de Nazianze et de saint Jean Chrysostome. restées inédites jusqu'ici. Enfin il revint en Hongrie, mais seulement après avoir dirigé ses pas vers la Belgique et la Hollande, patries ou rendez-vous des philologues les plus habiles et les plus studieux.
Le premier littérateur qui, dans ces provinces rapprochées entre elles moins encore par leur position géographique que par le goût de l'érudition, s'occupa de Nonnos, soit pour en faire son profit, soit pour en faciliter la lecture aux autres, fut un patricien de Gand, Charles Utenhove, un Sambucus au petit pied, dont on sait assez peu de chose : et c'est sans doute par suite de l'obscurité de ce personnage que, dans un article très court, la Biographie universelle le fait naître vers 1536, d'un père que, dix lignes plus bas, elle fait mourir en 1527. Charles Utenhove consacrait ses loisirs et sa fortune aux honorables travaux des lettres. Il projeta une traduction latine des Dionysiaques; et il les avait, dans ce but, tant feuilletées, qu'il en avait usé les pages, en papyrus, en coton peut-être, et non en parchemin (22) : sort tout pareil à celui de l'exemplaire de l'édition de Leiptick, dont je me suis servi moi-même pour une semblable élucubration ; car le papier allemand de l'an de grâce 1819 n'a pas eu grande peine à céder au bec de fer de mes plumes correctrices.
« Et personne, » ajoute Falkenburg, qui avait eu avec Utenhove des relations à Paris et en Angleterre, « personne n'était plus propre à la tâche de traducteur qu'un homme si versé dans la lecture assidue de tous les poètes, et qui possédait d'ailleurs plusieurs manuscrits des Dionysiaques. »
Ces manuscrits si soigneusement compulsés par Utenhove, et que probablement il avait acquis ou rapprochés dans le cours de ses voyages, étaient au nombre de quatre. Et si ce chiffre, dont j'ai été surpris, vu la rareté des copies qui ont circulé en Europe, est exact, je n'en suis que mieux disposé à regretter la perte des travaux de cet amateur zélé de la philologie. Néanmoins leur confrontation n'a pas pu apporter au texte des améliorations notables, car ils devaient être tous de la même époque, et, comme ceux de l'Escurial, appartenir au seizième siècle. Au surplus, Guillaume Canter, ayant adressé à Falkenburg pour calmer son impatience, et pour apaiser sa faim, un extrait qu'il avait transcrit lui-même sur l'exemplaire favori d'Utenhove, savoir l'exorde du premier chant, un an avant que le manuscrit de Sambocus fût remis dans les mains de l'éditeur primitif, celui-ci ne trouva plus tard sur cette copie partielle que bien peu de différence avec l'autre dans les textes, et aucune matière sérieuse à rectification.
X.
Falkenburg, premier éditeur de Nonnos.
C'est donc, je le répète, le manuscrit des Dionysiaques, appartenant à Sambucus le Hongrois que le Hollandais Falkenburg entreprit de donner au public. Il régnait alors en Allemagne, entre les érudits, une sorte de fraternité communicative que ce docte éditeur se plaint de ne rencontrer ni en Italie ni en France.
« Votre libéralité, » dit-il à Sambucus, « est d'autant plus magnifique, que bien des Français et des Italiens surtout, quand ils possèdent de vieux manuscrits, les réservent pour eux, comme s'ils savaient seuls les apprécier, ou du moins ils ne les abandonnent aux imprimeurs qu'après les avoir vendus à haut prix.»
Falkenburg déclare encore qu'il se servit uniquement du manuscrit de Sambucus, et qu'il mit tous ses soins à le faire reproduire le plus exactement possible. Or, peut-être faut-il regretter les trop consciencieux scrupules de ce premier éditeur des Dionysiaques, bien qu'il les ait spirituellement justifiés. « Si tout le monde agissait ainsi,» dit-il, « les anciens auteurs nous seraient mieux connus. Car, dans toutes ces corrections de texte, ou ne saurait croire combien notre propre jugement nous égare, et nous expose à rejeter aujourd'hui ce que nous avons adopté hier. J'approuve fort, pour mon compte, la réponse de cet homme à qui l'on demandait quelle était la meilleure édition d'Homère. La moins corrigée, répondit-il. » — Au reste, ce protecteur timoré de l'intégrité des textes, nous a lui-même tracé la route qui conduit à leur révision. — « Il m'était facile, » ajoute-t-il, « d'apercevoir, dans l'original qui vous appartient, bien des blessures qu'un médiocre grécisant lui-même aurait pu guérir; mais j'ai mieux aimé rassembler à part mes conjectures sur les endroits suspects, que de risquer de faire glisser dans le texte mes témérités. J'ai voulu seulement rendre plus aisée la lecture de Nonnos, jusqu'à ce que d'autres viennent, qui, sur l'autorité des vieux manuscrits, rempliront les lacunes, et recoudront les déchirures. »
Je me figure parfois que ces dernières paroles ont été écrites à mon intention ; que Falkenburg m'entrevoyait ainsi dans l'avenir, à travers les nuages de trois siècles ; et, bien qu'il m'ait été impossible de rencontrer ensemble on séparément les quatre Codex qu'avait réunis Utenhove, ou même de me trouver face à face avec ceux que renferment les bibliothèques étrangères, je me persuade que mon prédécesseur hollandais me pardonnerait, s'il vivait encore, les égratignures que j'ai fait subir à son texte, et m'approuverait,à défaut de ces lumières qui peuvent jaillir des manuscrits quand ils remontent les âges, et ne sont pas eux-mêmes de modernes copies, d'avoir usé du simple bon sens, ou de ma familiarité avec son poète favori, pour en réhabiliter la mémoire, et pour établir les Dionysiaques dans une plus grande pureté.
XI.
Plantin, premier imprimeur de Nonnos, à Anvers. — Séb. Cramoisy, à Paris, Oporin, à Bâle, Alde-Manuce, à Rome, s'en sont également occupés.
Plantin se chargea de l'impression; Plantin, le Tourangeau, établi en Belgique, l'un des plus célèbres imprimeurs de l'époque; ce même Plantin dont, le 15 août 1853, j'ai lu l'épitaphe et contemplé le marbre funéraire, loin des bords de la Loire, sous les voûtes de cette superbe cathédrale d'Anvers, pendant qu'un peuple saint en foule en inondait les portiques. Notre compatriote joignit de son propre mouvement, à sa publication, les corrections de Canter, mais séparées, pour se conformer à la méthode méticuleuse de Falkenburg; et c'est ce même Guillaume Canter, amant passionné de l'archéologie, imperturbable réviseur des manuscrits grecs, passé maître en l'art des corrections, dont il a révélé le procédé et dressé le système (23), qui, à l'âge de trente-trois ans, mourut à la peine, célibataire, tant il redoutait les distractions forcées qu'une femme et des enfants auraient pu apporter dans ses études. Plantin, en insérant les leçons très bornées de Canter, qui s'étendent d'ailleurs uniquement sur les vingt-quatre premiers chants, les annonça à la fin de l'édition en quelques lignes latines; car, à cette époque, les imprimeurs savaient et écrivaient le latin comme les critiques : et j'en pourrais nommer de nos jours d'aussi célèbres qui conservent fidèlement dans leurs familles ces précieuses traditions du noble métier.
Les Dionysiaques parurent donc imprimées pour la première fois en 1569 ; et, sans recourir à l'arsenal si varié des armes dont se couvre l'art moderne de l'édition, elles firent grand bruit tout d'abord. Cette apparition émut le monde savant, bien plus nombreux qu'aujourd'hui, et surtout bien plus sensible aux découvertes antiques, si l'on en juge par le peu d'effet qu'ont produit sur nous les manuscrits échappés récemment du mont Athos. Et cependant les nouvelles de la république des lettres ne circulaient pas alors accolées aux nouvelles politiques. L'épître dédicatoire ou la préface d'un livre en était tout à la fois le prospectus ou l'annonce; et pour réclame efficace, il suffisait d'un paradoxe, ou même de la nouveauté.
A ces divers titres, Falkenburg méritait l'attention générale; puisque, dans sa dédicace à Sambucus, avec cette ardeur et cet emportement qu'il mettait dans tous ses goûts, il proclame tout uniment Nonnos le plus heureux imitateur et le rival d'Homère, et ne lui refuse à peu près aucune des vertus du style poétique, que déjà certains critiques commençaient à lui contester. Grands furent l'étonnement, et partant la colère des érudits à cette prétention ridicule : suivant la mode du temps, on opposa des injures aux éloges; et, les personnalités s'ensuivant, on fit connaître à la postérité que ce Falkenburg, hérésiarque en philologie, ancien élève de Cujas, avait d'abord quitté l'étude du code Justinien pour la poésie antique, ensuite qu'il avait pratiqué médiocrement lui-même l'hexamètre et l'ïambe helléniques, dans quelques essais conservés par Douza; enfin, qu'il n'avait laissé de son savoir-faire d'autre témoignage que cette même édition des Dionysiaques, ornées d'un si présomptueux panégyrique. On ajoutait aussi, comme un dernier trait de satire, que, trop pénétré de son sujet, il avait poussé l'admiration et le zèle pour Bacchus jusqu'à ses dernières limites, puisqu'il venait de mourir d'une chute de cheval, due à l'ivresse.
Et néanmoins cet engouement de Falkenburg pour Nonnos allait être dépassé encore. Peu de temps après, le premier directeur de l'Imprimerie royale, que le cardinal de Richelieu établit au Louvre, Sébastien Cramoisy, s'écriait, à Paris :
« Rien de plus abondant que sa parole, de plus élégant que sa composition. Pour le fil et la méthode de ses discours, rien de plus magnifique, de plus élevé, de plus auguste. Il égale la majesté d'Homère, la sublimité de Pindare, la gravité de Sophocle, la sagesse sentencieuse d'Euripide, la douceur de Callimaque, les parures de Musée, l'harmonie de Nicandre, la simplicité d'Hésiode, la sagacité de Théognis, la tendresse d'Anacréon, le sel d'Aristophane, l'urbanité de Ménandre. Les philosophes trouvent en lui le génie de la nature ; et c'est là le poète que Platon cherchait sans le trouver (24). »
Pour réduire à de plus justes proportions les éloges de Sébastien Cramoisy, et pour calmer son effervescence, il me faut dire tout de suite que les Dionysiaques présentent tour à tour des imitations de presque tous les grands postes de la Grèce, et quelques heureux essais dans des genres de poésie bien divers. C'est ainsi qu'elles cherchent à se rapprocher d'Homère dans la peinture des combats, d'Hésiode dans les détails généalogiques de sa Théogonie; de Théocrite dans les divers tons de ses Idylles; de Callimaque et d'Orphée par ses hymnes; d'Eschyle et d'Euripide dans leurs drames religieux, tels que Prométhée et les Bacchantes, de l'élégie de Sapho et de Mimnerme dans les plaintes des amants et des veuves. Enfin, Lucrèce et Virgile ont prêté à Nonnos leurs tableaux physiques ou champêtres, et Ovide ses fables; mais il les a suivis en inaugurant, pour ainsi dire, dans le dernier âge de la décadence hellénique, le genre descriptif tel que nous l'avons reproduit à la fin du dix-huitième siècle, et que nous le pratiquons au dix-neuvième en l'exagérant; de sorte qu'il semble avoir marié l'emploi des machines épiques de l'antiquité aux ressources de notre poésie didactique et pittoresque.
Le fougueux imprimeur de Louis Xlll, qui pourtant ne comprit pas les Dionysiaques dans ses éditions d'auteurs anciens, termine cette apothéose par une assertion non moins glorieuse qu'il me faut reléguer, de compagnie avec toutes ses exagérations, parmi les rêves de sa pensée. « C'est Nonnos, dit-il, qui a converti sainte Pélagie, et ramené des portes de l'enfer vers le ciel trente mille Sarrasins. »
Toujours est-il que le baron de Baufremont célébra en quelques distiques ces divers miracles; et qu'à cette même époque, où les gentils hommes tenaient à honneur de savoir le latin, voire même le grec, Alexandre de Cossé adressa à la mémoire de Nonnos cette épigramme plus digne du cavalier Marini que de Martial : - « Après avoir célébré Bacchus dans un poème héroïque, Nonnos a enchaîné Jean de ses mélodieuses paroles. » Pourquoi s'étonner quand « il lance la foudre, ou qu'il brille du feu plus « doux des éclairs? Si la foudre arracha Bacchus du sein de sa mère, Nonnos devait être aussi le fils d'un tonnerre divin (25). » Quelquefois un seul critique, se chargeant des deux rôles, attaque et défend Nonnos à la fois. C'est ainsi que Tristan, le plus savant des gentils hommes ordinaires de Louis XIII, déclare qu'il y a a beaucoup d'extravagance en ses imaginations, plus d'impiété et d'hypocrisie que de rectitude en sa croyance ; » et le bouillant numismate, qui ne sait souffrir d'autre contradicteur que lui-même, dit cependant, à quelques pages de distance : « La vérité est qu'il est fort docte, relevé et très ingénieux, plein de fougues poétiques et curieux ; il nous apprend beaucoup de choses que lui seul se trouve avoir remarquées. »
Enfin un dernier critique, érigeant en système une hérésie littéraire, a fait des défauts du style de la décadence et de Nonnos autant de vertus, ou du moins autant de titres à la curiosité :
« Peut-on ignorer, dit-il, que, comme il y a plus d'un fléau dans le monde, il y a aussi plus d'une forme dans le style? » (Quel début et quel rapprochement !) « Le style varie suivant l'époque, le siècle et l'âge de l'écrivain. Dans les temps d'Auguste lui-même, la parole était tantôt digne et châtiée comme une matrone, tantôt libre et allongée comme la toilette d'une jeune fille. Mécène, Tibère, et avant eux Antoine parlaient chacun à leur mode ; et leur diction était pleine de hardiesse, d'une pompe creuse, d'ambition et d'inégalité. Qui donc ne ferait cas de Pindare, qui n'aimerait Nonnos? Et pourtant, si vous comparez les infatigables métaphores dé l'un, l'enflure et la redondance de l'autre, avec la simplicité et la modeste économie d'Hésiode et d'Eschyle, vous direz, comme le judicieux Scaliger pour Thucydide et Tite-Live, que ceux- ci sont des chevaux ailés, et que leur vaisseau vogue à pleines voiles, quand les autres jouissent timidement d'une mer tranquille. Les imperfections, fruit de l'audace, ne blessent pas ; car les roses qui viennent rares et hors de saison n'en sont que plus appréciées, et Ovide affirme qu'une tache rehausse encore la beauté du visage (26). »
Disons tout de suite, pour n'avoir pas à y revenir, que les travaux de Plantin et de Falkenburg avaient été précédés eux-mêmes des tentatives d'Oporin (27); lequel, muni depuis de longues années d'un manuscrit des Dionysiaques rencontré en Italie, en avait préparé ou plutôt annoncé l'impression, qu'il ne commença jamais.
Un demi-siècle auparavant, le célèbre Alde-Manuce avait également reculé devant la même tâche, distrait qu'il était sans cesse par tant d'autres importants travaux; et, faute de temps, il n'avait pu faire honneur à la recommandation de Jean Lascaris, qui avait signalé les Dionysiaques à sa sollicitude typographique.
XII.
Daniel Heinsius, premier critique de Nonnos. Canter, Joseph Scaliger, Saumaise.
Ici se
présente, dans l'ordre des temps, au premier rang des partisans et
des critiques de Nonnos, l'illustre Daniel Heinsius, traducteur de
la paraphrase de l'Évangile selon saint Jean. Il a accompagné ce
travail des commentaires les
plus développés et les plus théologiques du texte de Nonnos, sous le
titre d'Exercices sacrés; et il semblerait qu'après s'être
occupé des préfaces des Dionysiaques avec toute la fougue de
la jeunesse, il ne les a plus considérées, sur ses vieux jours, que
comme une étude obligée pour mieux arriver à l'intelligence du
poète, et comme un acheminement à ses pieux travaux. Mais
laissons-le parler lui-même.
« Je me souviens encore avec plaisir, » dit-il, dans un latin élégant entrecoupé de grec, « du penchant, de l'entraînement, de l'ardeur même qui me portaient vers Nonnos. La première fois que je vins à Leyde, il y a onze ans, comme je lisais avec une très grande attention la plupart des poètes grecs, lui seul semblait manquer à la pleine jouissance que je retirais de ce genre d'écrits. Aussi, quand j'ai fini par le trouver, je m'en suis saisi avidement, et ne l'ai quitté qu'après l'avoir dévoré d'un bout à l'autre. Je ne me contentais même pas de le lire : par une ferveur de mon âge, j'y exerçais déjà mes facultés critiques, et je me réputais fort heureux lorsque, après Falkenburg, homme bien plus versé dans la lecture des poètes grecs que ne le croit le commun des savants, je rencontrais quelques toutes petites corrections ( emendatiunculas ), ou quelques conjectures probables à y ajouter. Je n'en ressentais pas moins de joie que d'une fille unique magnifiquement dotée que j'aurais gardée dans ma maison pour l'offrir à un mari d'un caractère excellent. C'est ainsi que j'admirais mon auteur, et que j'en chantais partout et toujours les louanges. Or elles me paraissaient d'autant plus naturelles à cette époque de ma vie, que j'avais pour m'appuyer dans mon jugement Ange Politien et Marc Antoine Muret. Le premier a qualifié Nonnos de poète merveilleux (mirificum ), le second a vanté son érudition et la noblesse de son style (eruditum et grandiloquum), et tous les deux affirment qu'il est d'une valeur rare parmi les anciens auteurs parvenus en nos a mains.
« Ce fut le célèbre Joseph Scaliger qui, le premier, amortit mon ardeur ou mou intempérance. Son goût admirable et presque céleste en ces matières nous apprit dans ses lettres le cas qu'il fallait faire de Nonnos. »
Ici, je demande à Heinsius la permission de l'interrompre, pour intercaler dans son récit le texte même des lettres de Scaliger qu'il rappelle. Dans la première, adressée de Leyde à Saumaise, en 1607, le professeur français de belles-lettres en Hollande s'exprime ainsi, avec l'outrecuidance qui lui est habituelle :
« Les poètes de l'époque suivante, en cherchant l'abondance, n'ont pu trouver que le vain son des mots et un style ampoulé. Parmi ceux qui se sont aventurés le plus loin en ce genre, Nonnos de Panopolis occupe sans doute le premier rang; et, dans les Dionysiaques, la nature de son sujet pourrait servir d'excuse à sa diffusion, si, dans la paraphrase de l'Évangile, il n'eût, en quelque sorte, abjuré toute pudeur. Je le lis avec le même sentiment qui nous fait regarder les comédiens, et ne nous en amuser qu'autant qu'ils sont ridicules. »
Dans une seconde lettre, que le critique d'Agen écrit sur le même sujet, et presque sur le même ton à Heinsius adolescent (admodum adolescenti), il lui dit : « Si vous étiez près de moi, je pourrais vous faire voir de montueuses (immanes) transpositions qui se sont glissées dans les vers de ce poète. Je vous montrerais aussi les défauts, les impropriétés de son style, et comment il faut le lire ou s'en servir, car je ferais tout un énorme volume (encore immane) de mes critiques. Je lui ai cependant rendu service en mille endroits : car, s'il ne faut pas l'imiter, il faut au moins le lire. »
On reconnaîtra aisément ici l'exagération familière aux habitants des bords du fleuve méridional qui, faut-il en prévenir le lecteur? m'a vu naître aussi. Cet énorme volume, ces corrections infinies de Scaliger devaient se borner à deux ou trois cents mutations de mots, quelques-unes fort contestables, lesquelles remplissent à peine treize pages petit in-12, au bout du pamphlet de Cunaeus.
Je rends à Heinsius la parole :
« Et cependant les conseils du divin vieillard n'avaient pas encore éteint en moi l'ardeur de nonniser. Chaque fois que je m'amusais à faire des vers grecs, j'y exprimais mes pensées à l'imitation de Nonnos, et m'assimilais à lui tellement que, si mon amour-propre ou ma mémoire ne m'abusent, j'aurais pu insérer mes vers au milieu des siens, et en imposer ainsi aux lecteurs médiocrement expérimentés. Insensiblement, néanmoins, le goût vint avec l'âge. Je puisai dans la lecture des autres écrits un jugement plus sain. Je me réconciliai peu à peu avec la raison et avec moi-même. Je parvins à secouer. cette fureur bachique ; et comme nous sommes dans un siècle pauvre et misérable, où nous regrettons la plupart de leurs ouvrages, nous devons, selon moi, aux écrivains de l'antiquité, d'accueillir avec joie le peu que Dieu nous en a conservé; il faut les étudier pour en tirer profit, bien plutôt que pour briguer hors de saison la gloriole de mettre à nu leurs je ne sais quelles taches, ou certaines vétilleuses négligences ; et pourtant rien de plus digne, à mon sens, d'un érudit, que d'user de la plénitude de son jugement au sein même de cette antiquité, et de peser, ce qui est donné à peu de personnes, les formes du langage hellénique, de façon à en discerner aisément les qualités et les défauts. C'est là le plus haut point que puissent atteindre d'heureuses facultés naturelles, unies à une solide érudition; car, lorsque le style possède une si grande affinité avec l'esprit et la parole, que les Grecs ont exprimé ces trois choses par un même mot (λόγος) : Juger le style d'un homme, c'est juger l'homme lui-même : et le style n'est pas le signe distinctif des hommes seulement; il l'est encore de toute une époque. C'est ce qui fait qu'on reconnaît chaque siècle à sa façon de s'exprimer. »
Ne dirait-on pas ici que Heinsius a soufflé à Buffon l'axiome immortel de son discours à l'Académie, et que le critique de Leyde a dit, cent cinquante ans avant le grand naturaliste français : Le style est l'homme même.
Je reviens un moment à cette perversité littéraire de sa jeunesse, que confesse ingénument Heinsius, pour dire que j'ai cru, en effet, en apercevoir plus d'une trace sur l'exemplaire de l'édition primitive de 1569, qui lui a appartenu. On le conserve très précieusement à Leyde à côté d'un autre exemplaire de même date, que Falkenburg a chargé des remarques ou des corrections dont il se proposait sans doute de grossir une seconde édition; mais les reproductions de 1605 et de 1610 n'ont profité ni des unes ni des autres, pas plus que celle de Genève, en 1606.
Ces deux exemplaires, sans doute très soigneusement compulsés par M. Graëfe, au bénéfice de son édition de 1819, n'avaient rien à m'apprendre. J'ai lu néanmoins, sur celui qui fut la propriété de Heinsius, au milieu de notes marginales multipliées et confuses, à côté d'un petit Index des traits d'esprit de Nonnos (Dicta Nonni ingeniosa) et de ses sentences (γνῶμαι), indiquées de la main même dé Heinsius sur les feuillets blancs de la fin (scriptus et in tergo) ; j'ai lu, dis-je, une épître latine où son admiration pour Nonnos déborde. Or je n'ai pas su la retrouver dans le recueil imprimé de ses oeuvres poétiques. Serait-ce donc que son fils Nicolas Heinsius, moins ami des lettres grecqués, n'aurait pas jugé cette inspiration enthousiaste digne d'y figurer, en raison de son sujet, l'éloge de Nonnos, toujours dédaigné des érudits?
J'en ai retenu ces quatre vers (28) :
« Les choeurs légers des égipans, des dryades et des satyres ont juré que ce poète a dérobé leurs chansons; et il me semble à moi-même que toutes les divinités, nées dans les montagnes chères aux Muses, résident dans son sein. »
Ne trouvera-t-on pas comme moi que, pour avoir été un partisan si fanatique de Nonnos, Daniel Heinsius a poussé trop loin l'esprit de chicane, quand il a reproché à son ancien favori le titre même de son poème ? C'est Dionysiade (29), prétend-il, qu'il fallait dire, et non Dionysiaques; comme on appelle Iliade, le récit des exploits des armées autour ou dans Ilion; que si Nonnos a voulu intituler son livre Dionysiaca, en sous-entendant πράγματα, les faits et gestes de Bacchus, c'est une ineptie de plus, que la grammaire et le bon sens réprouvent...» Je ne vais pas plus loin, et une seule chose m'étonne dans tout ceci, c'est que Heinsius s'en prenne à Nonnos pour un prétendu crime dont bien d'autres écrivains s'étaient rendus coupables avant le quatrième siècle, et qu'il n'ait pas songé, entre autres, à Apollonios de Rhodes, dont le souvenir devait se présenter de lui-même. Or, sans en traiter plus particulièrement ici, je me propose de faire ressortir dans mes notes, par quelques citations, les emprunts ou les dissemblances des deux épopées.
Je rappelle, en attendant, que ce poète, alexandrin aussi, contre lequel Nonnos a lutté, parfois heureusement, a nommé son poème des exploits des Argonautes, Argonautica, et nul, que je sache jusqu'ici, n'a cherché à y redire. Il en est de même de tant d'autres poèmes anciens ou nouveaux, perdus ou conservés sous la même désinence, Troica, Bassarica, etc., précurseurs ou contemporains des Dionysiaques, sur les quelles il y a tant à gloser, du reste, qu'il eût été de bon goût de ménager leur irréprochable intitulé.
Et pourtant Heinsius ne s'est pas arrêté là : comme dans les grandes passions, son amour s'est changé en haine, et ses déclarations en injures, bien qu'elles s'adressent plus particulièrement à la Paraphrase de l'Évangile. Saumaise s'en émut. « On ne s'attendait pas, » dit-il, «à la méchanceté et à la virulence des insultes que Heinsius a accumulées contre Nonnos, qu'il appelle, en toute occasion, absurde, mais, entaché d'arianisme, et qu'il accuse d'ignorance de la langue grecque/ Mais quoi ! Nonnos aura ses vengeurs. Sed reperiet suos vindices.
XIII.
Cunaeus, zoïle de Nonnos, et autres critiques.
A côté de Heinsius, ou plutôt bien au-dessus de lui, si l'injuste amertume quand elle s'exerce contre Nonnos constituait le vrai mérite, vient Cunæus (Van der Kuhn), lequel, latinisant sa dénomination hollandaise, dirigea contre les Dionysiaques à peine imprimées les accès de sa verve atrabilaire. Piqué de la faveur qui accueillait Nonnos à sa renaissance, il chercha à démontrer que « cet auteur, dont les princes du génie et de la science, Politien, Muret et presque tous les autres, ne faisaient rien moins qu'un grand et supérieur écrivain, était beaucoup moins entendu qu'ils ne le disaient en connaissance des choses, et qu'il lui manquait à la fois l'usage dans le style, et l'habileté dans l'imitation. » Puis, mêlant aux excès de la satire les principes d'une critique éclairée, il s'attaqua minutieusement aux imperfections grammaticales des premiers chants, et ménagea les derniers, soit qu'il eût, dès le début, épuisé tous les traits de sa colère, soit que l'ironie et l'injure parviennent à lasser même l'esprit qui les prodigue. Dans ses animadversions croisées de rares louanges, il refit, malgré les injonctions de Falkenburg, à sa façon et pas toujours à propos, quelques vers grecs, sous le prétexte d'éclaircir les obscurités, de dégonfler l'enflure, on même de suppléer aux lacunes supposées de l'original. il ne s'occupa guère, comme Canter et Scaliger, de corriger les leçons et d'apurer les mots : aussi plus d'une fois son indignation, prenant à partie une faute des copistes ou une lacune des manuscrits, tombe à faux, quand il suffit d'une plus sérieuse attention donnée au texte, ou d'une plus intime familiarité avec là façons de Nonnos, pour redresser le sens vicieux et réparer tout le dommage. Or c'est ce que je n'ai pas manqué de pratiquer soigneusement dans mon édition, quand Graëfe, dans la sienne, ne l'avait pas fait avant moi.
Ce serait néanmoins être injuste envers Canaeus que de ne pas reconnaître en lui, au milieu de ses assauts les plus acharnés, un jugement formé sur l'étude des grands modèles, et sur ces principes du goût en poésie épique que Vida et Boileau allaient, à l'imitation d'Horace, proclamer en si beaux vers. Je n'en dis pas davantage sur ce principal zoïle de Nonnos, qui ne dédaigna pas néanmoins de l'annoncer et de le recommander au public dans la préface de la réimpression de 1610; mais je me réserve de relever successivement dans mes notes ce qu'il a de plus remarquable dans ses blâmes fréquent comme dans ses rares éloges.
XIV.
Caractère de l'époque où Nonnos fut imprimé pour la première fois.
On pourrait justement prétendre aussi que la réputation de Nonnos n'a pas seulement souffert des outrages du temps envers ses manuscrits mais encore de l'époque où ils ont été confiés à la presse. C'était le moment où les hautes études grecques commençaient à passer de mode, et la langue latine à prédominer. Certes, Jules-César Scaliger, qui a comparé Nicandre à Lucain, s'ii eût connu les Dionysiaques, qui n'étaient pas encore imprimées à sa mort, n'eût pas manqué de leur donner place en sa Poétique et d'en signaler quelques beautés. Joseph Scaliger, moins versé que son père dans les lettres helléniques, s'est contenté, comme on vient de le voir, d'en corriger imparfaitement le texte, et Heinsius, l'élève de ce dernier, qui s'en est le plus occupé, et qui a pris le titre d'Aristarque sacré de la paraphrase selon saint Jean, n'a pas cherché à contrebalancer la sévère critique de son ami Cunaeus.
Au reste, cette diversité d'appréciation, je le dis tout de suite, devait se reproduire avec moins d'éclat dans les siècles qui vont suivre. Si Pierson (30) reproche avec colère aux philologues hollandais de n'avoir pas repoussé Nonnos tout d'abord, Bentley, le plus célèbre critique de l'Angleterre, le recherche pour l'érudition variée et le talent d'écrivain déployés dans les Dionysiaques (31). Quand P. Francius l'attaque (32), J. Schrader le défend (33) ; et tous s'accordent en ce seul point, qu'il devient à peu près impossible d'asseoir un jugement certain sur cet auteur, tel qu'il se présente, et qu'il y a lieu avant tout, ainsi le veut Ruhukenius, de s'occuper à le laver de l'amas de souillures qu'il doit à ses copistes (34).
En résumé, Nonnos est fastidieux, disaient alors et disent encore aujourd'hui presque tous les érudits qui ne l'ont pas lu, ou qui n'ont pas su le lire, et le nombre en est grand. Quant à ceux qui ont poussé jusqu'au bout des Dionysiaques, ou qui seulement en out exploité une moitié, s'ils se sont attachés à comprendre cette poésie nonnique, qui avait ses difficultés sans doute, mais dont j'espère avoir dégagé les énigmes, ils peuvent encore, et cela est tout simple, lui préférer les vrais chefs-d'oeuvre; mais ils ont appris à moins le dédaigner, car les esprits les plus récalcitrants à se former un jugement nouveau sur les auteurs antiques conviennent qu'il dédommage amplement de la curiosité, peu contagieuse jusqu'ici, qui fait tourner vers lui un regard attentif; enfin chez l'homme qui affronte pour le feuilleter la réputation de lecteur bizarre ou frivole, il en reste au moins une profonde connaissance de la langue, de la poésie et de la mythologie grecques. J'ose ajouter, pour en avoir fait l'expérience, qu'il rend la lecture de tous les autres poêles plus facile, soit en familiarisant avec l'élégance et l'harmonie du bel idiome, soit par les études préalables et l'abondance des mots dont il enrichit la mémoire, copia verborum, soit enfin, si l'on veut, par la comparaison.
XV.
Les traducteurs : Lubinus Eilhartus, Boitet.
Après ces principaux critiques, négligeant les témoignages des nombreux philologues de la même époque qui, tous, à son apparition, ont payé un tribut quelconque à Nonnos, j'en viens à ses traducteurs. Le nombre en est beaucoup plus restreint ; et comme je ne saurais mettre en ligne de compte des essais de traduction partielle, soit en vers, soit en prose, qui ne s'étendent guère, en aucune langue, au delà d'une page ou deux, je ne puis faire état que de Lubinus Eilhartus, traducteur latin primitif et jusqu'à présent unique, et de Boitet, traducteur français de Lubinus plus que de Nonnos, resté jusqu'ici lui-même sans rival dans notre langue.
Je dois ajouter néanmoins qu'au moment où Eilbart, plâtré du nom de Lubinus, dénaturait Nonnos, un autre traducteur s'annonçait à la république des lettres, déguisé lui-même sous le nom de Forestius. «Nous aussi, dit-il, s'il plaît aux Dieux » (pourquoi pas à Dieu, Nonnos a-t-il cessé, tout seul, d'être païen ? ), « nous essayons, malgré notre faiblesse, de grandes choses, pendant que nous sommes vert encore (35). Nous traduisons les Dionysiaques de Nonnos en latin, et nous y joindrons quelques légères annotations avec nos conjectures : car il est inondé d'un torrent de fautes les plus dégoûtantes. »
Jean Forest s'est-il donc plus tard effrayé de la concurrence si peu redoutable de Lubin Eilhart? Je ne le sais pas; mais sa traduction n'a jamais vu le jour, pas plus que ses corrections et ses notes.
Bah ! me dira-t-on, si Nonnos n'est pas traduit, c'est qu'il n'en vaut pas la peine ! - C'est que personne, répondrais-je (qu'on me passe cette parodie de l'objection), n'en a encore pris la peine ; car c'est un labeur véritable, de longue haleine, hérissé de difficultés sans cesse renaissantes. Beaucoup de passionnés hellénistes ont reculé devant l'entreprise; quelques-uns ont perdu courage après avoir résolument débuté, et l'on va voir que le latin inintelligible d'Eilhartus, comme le gaulois vieilli et à contresens de Boitet, laissaient encore l'oeuvre à tenter et à finir.
Ce fut donc l'édition princeps d'Anvers que Lubinus Eilhartus, professeur à l'université de Rostock, médiocre littérateur, mais traducteur très abondant, entreprit d'interpréter en même temps que les deux mille épigrammes connues alors de l'Anthologie, et les épîtres des philosophes Démocrite, Héraclite, Diogène et Cratès, surmontées de quelques lettres d'Hippocrate. Soit par surcharge de tant d'élaborations, soit par précipitation, ou peut-être par respect pour le texte grec, Lubinus ne chercha point, à l'exemple de Scaliger, Canter, et même de Cunaeus, à percer les obscurités des Dionysiaques, à en rajuster les lacunes, à en faire disparaître les innombrables incorrections, enfin à donner une signification aux endroits où l'informe manuscrit n'en avait pas laissé : il se borna à cogner dans une même ligne, à grands coups de dictionnaire, le mot latin, correspondant bien ou mal, avec le mot grec, à la même place qu'il occupe dans l'hexamètre, sans s'embarrasser de la forme ni même du sens de la phrase. Je donnerai dans mes notes quelques échantillons de ce procédé, mais ici j'en fais grâce au lecteur. Je le prie seulement de considérer quelle peut être cette traduction bâtarde et quasi interlinéaire d'un texte grec si corrompu : il comprendra facilement alors que Lubinus Eilhartus n'a pas peu contribué à épaissir les ténèbres jetées :comme à plaisir sur le poète de Panopolis, et il se souviendra de cette réflexion d'un goût si pur, qui échappe de saint Jérôme comme un souvenir profane de son penchant pour la littérature : « Qu'on essaye » « dit-il, « de traduire mot à mot Homère en latin. J'irai plus loin, qu'on le traduise en prose dans sa propre langue. « — lci j'interromps saint Jérôme, pour dire que je possède en effet en grec moderne deux traductions, l'une de l'Iliade en vers, l'autre en prose de l'Odyssée, mais très prosaïques toutes deux. — « Vous n'aurez là, » continue saint Jérôme, « qu'une oeuvre ridicule; et le plus éloquent des poètes paraîtra à peine bégayer (36). » Ce que le saint et judicieux docteur de l'Église disait si à propos pour Homère. serait-il donc moins vrai pour Nonnos?
Eh bien ! voilà la version étrangère à tout sentiment poétique, subversive de toute élégance, éteignoir de l'épopée en un mot, que Boitet a jugé convenable de suivre à peu près pas à pas dans son travail ; s'il est permis d'appeler ainsi ce qui n'est qu'une suite de détours pour éviter tout travail. Il s'est attaché presque toujours à traduire bien plutôt le latin littéral de Lubinus que le grec harmonieux de Nonnos : accident plus commun en version grecque, qu'on ne le croit généralement, car il est de ceux qui ne s'avouent jamais. Parfois aussi, il a puisé en lui-même ses contresens et les abréviations de telle sorte qu'il semble n'avoir volé de ses propres ailes que pour raccourcir celles de Nonnos. Enfin, ce qui me choque le plus dans cette interprétation, c'est sans doute le trivial et le burlesque revenant sans cesse sous sa plume, et ce langage du commencement du règne de Louis XIII, qui a perdu la naïveté d'Amyot dans ses traductions grecques, et n'a pas encore gagné la précision et la clarté de Boileau, l'interprète de Longin. Je vais en fournir deux ou trois exemples seulement ; et j'userai d'autant de réserve dans mes notes par égard pour mon unique devancier sans doute, mais surtout, pour ne pas accabler le lecteur sous le nombre et la masse de mes démonstrations, beaucoup trop justificatives. Ainsi. dans le vingt quatrième chant, et je le prends au hasard, Boitet défigure les plaintes de la jeune Indienne, qui rappellent Racine et la tendresse de la douce Iphigénie, voici le texte. « Ah ! ton fils que j'aurai fait naître s'il me demande un jour son père, comment pourrai-je le lui montrer quand il balbutiera ton nom? » - Écoutons Boitet : - « Je suis à terme. Mais quand je serais accouchée, et que mon fils voulût chercher son père, en criant papa, on le lui montrerait. »
Puis, au lieu du « nouveau Protésilas d'une autre Laodamie, » il délaye de cette façon ce souvenir mythologique compris en trois mots dans le texte grec : - « Comme Laodamie regretta la mort de Protésilas, en mourant entre les bras de son mari dont l'ombre lui apparut, par le moyen de la faveur des dieux. »
Voici tout à côté un échantillon de sa narration habituelle : « Mais comme Bacchus passait le fleuve, Deriades, qui lui avait déclaré la • ferre (s'il voulait usurper son pays et y apporter ses vignes, et y apporter ses pampres, comme il le menaça par le satyre que Bacchus avait envoyé en ambassade), se prépara à le soutenir, et pour cet effet il assembla tous les régiments des Indiens, et leur donna ordre de se camper auprès; du fleuve pour empêcher que l'armée ne passât. »
Je passe à mon tour dans ce vingt-quatrième chant, l'un des plus gracieux du poème, bien des contresens accumulés, afin de ne pas appauvrir, en y puisant, une source seule. On va voir dans le second livre comment Boitet s'exprime, lors même qu'il est le plus exact interprète de la pensée. - Je choisis les beaux vers qui présentent la grande image de la lutte olympienne, et qui sont loués sans restriction même par Cunaeus :
« C'est ce que proféra Typhon, d'une voix menaçante. Jupiter se moquait de ces rodomontades. Le combat étonna les deux ennemis : Typhon avait la déesse de Discorde qui l'assistait ; et Jupiter était accompagné de la Victoire. Le sujet de leur guerre n'était pas pour un troupeau de moutons ou de boeufs : ni pour la beauté de quelque déesse; ni pour l'usurpation d'une ville; mais il était question de tout l'empire du ciel et du commandement absolu sur la terre. C'est pourquoi Jupiter n'oubliait pas à se bien défendre. »
Or, comme je ne veux pas laisser le lecteur sous l'impression d'une prose si humiliante pour Nonnos, je prends la liberté de répéter ici la mienne :
« Telles furent ses clameurs. Le fils de Saturne en sourit; leur courage bouillonne. La Discorde conduit Typhée à la bataille. La Victoire guide le roi des dieux. Il ne s'agit ici ni d'un troupeau de boeufs ou de brebis, ni de la beauté d'une nymphe, ni d'une ville chétive, mais bien de l'Olympe lui-même. Le prix que décernera la Victoire, et qu'elle tient sur ses genoux, c'est le trône et le sceptre de Jupiter. »
XVI.
Pierre de Marcassus, imitateur.
Peu de temps après ces Voyages, amours et conquêtes de Bacchus aux Indes, second titre explicatif du premier, qu'avait imaginé pour attirer le lecteur, Claude Boitet de Franville, traducteur d'Homère, de Coïntos de Smyrne, historien, et avocat au parlement d'Orléans, parut une sorte de contrefaçon des huit premiers chants des Dionysiaques, due à la plume abondante de Pierre de Marcassus. Ici le style est aussi enflé et précieux que celui de Boitet est prosaïque et trivial. Tout en cherchant à jeter du ridicule sur l'auteur auquel il fait ses emprunts, Marcassus semble avoir pris plaisir à en exagérer les défauts ; il renchérit sur les jeux d'esprit, les confusions de pensée, les antithèses qu'il redouble à sa manière. Et bien que ce littérateur vantard, qui prenait le titre de Principal historiographe du roi, se défende, dans un avis au lecteur, d'avoir copié Nonnos, « qui, dit-il,dans la liberté qu'il s'est donnée de faire des vers, a la plupart du temps fait banqueroute au jugement, » les deux premiers livres de ces aventures, inspirées par les Dionysiaques, en sont des imitations lointaines, si l'on veut; et les six derniers en présentent des paraphrases chimériques. Ces épisodes, étrangers au sujet, sont beaucoup plus près des romans de Scudéry que des historiens grecs, avec lesquels cependant Marcassus prétendait rivaliser.
On en jugera par le parti qu'il a tiré d'une charmante comparaison, et je ne crains pas de la signaler d'avance, car elle est destinée à reposer agréablement notre imagination, lasse des combats célestes du premier chant :
« Comme un amant à qui la fortune présente la possession des beautés après lesquelles il a longuement soupiré, perd la mémoire de tant de maux qu'il a soufferts, tant les biens présents le possèdent. Tantôt il admire l'âme des deux soleils qui faisaient ses jours heureux ou malheureux. » — Ai-je besoin de dire qu'il s'agit ici des yeux de la belle? - « Tantôt, comme pour lui reprocher le mal qu'ils lui ont fait, il oppose sa bouche à leur clarté et les empêche de voir. Tantôt, jetant son imagination sur tout ce qu'il voit d'aimable, il promène son désir et sa passion partout où l'un et l'autre peuvent trouver leur contentement; enfin, pour être entièrement à ce qu'il adore, il n'est aucunement à lui. »
Ne faut-il pas appliquer aussi à Pierre de Marcassus, qui a défié ses successeurs de mieux faire, ces paroles de Grade :
« Les hallucinations et les fantaisies de Lubinus en latin, et de Boitet en français, ont poussé si loin les omissions, abréviations et interpolations du texte de Nonnos, qu'il en reste à peine une ombre. »
XVII.
Muret, Balzac, Caspar Barth, critiques.
En même temps que des interprètes et des imitateurs malhabiles parodiaient Nonnos, le sieur de Balzac, premier du nom, l'attaquait avec une grande amertume. Je transcris le passage entier de ses Dissertations critiques, pour distraire un moment le lecteur.
« Muret .... avait des chagrins et des fantaisies, comme les autres... Je voudrais pour le moins qu'il fût constant en ses mauvaises humeurs. Et en vérité je ne puis comprendre qu'ayant méprisé si fort les épigrammes de Martial, il ait fait tant de cas des Dionysiaques de Nonnus.
« Ce Nonnus était un Égyptien dont le style est sauvage et monstrueux. C'était un peintre de chimères et d'hippocentaures. Ses images, je dis les plus réglées et les plus sobres, vont bien au delà de l'extravagance ordinaire. En certains endroits, on le prendrait plutôt pour un Démoniaque que pour un poète; il paraît bien moins inspiré des Muses, qu'agité par les Furies. Les poètes de Clérac et de Bergerac étaient moins extravagants, avant même qu'ils eussent passé la Dordonne, et qu'ils eussent dit de l'éloquence de la reine Marguerite :
« J'entends un torrent
précieux
« Qui verse en terre tous les cieux.
« Le beau spectacle, mon révérend père, de voir les cieux fondus et liquides rouler sur la face de la terre ; de voir ces grands globes dans un si petit espace, c'est-à-dire quelque chose de plus que la mer, dans quelque chose de moins que n'est le basin d'une fontaine.
« Ces poètes néanmoins écrivaient plus raisonnablement que Nonnus; et je ne doute point qu'il n'eût admiré ce qu'ils écrivaient, et que quelques courtisans trouvèrent si beau, - que les rois ne se doivent expliquer que par la bouche des canons. Non pas même, dit le commentaire, quand ils font l'amour à leurs maîtresses; quand ils donnent audience aux ambassadeurs; quand ils sont assis dans leur lit de justice, et qu'ils font entendre leur volonté à leurs peuples; non pas même quand ils prient Dieu dans leur, oratoire. - Ces poètes de Gascogne et de Périgord étaient sages et modestes, en comparaison de ce poète d'Égypte, que mon voisin Muret estime si fort (37). »
Eh ! mon Dieu, non, cher rival de l'élégant Voiture, ce qu'on pourrait reprocher à Nonnos, ce n'est pas cette furie d'imagination qui serait cependant assez conforme à la nature de son sujet. Et c'est bien à tort, je vous jure, qui vous le représentez emporté, comme Horace, par le dieu dont il est plein. Quo me, Bacche, rapio tui plenum ! Barth, un grand critique, votre contemporain, a pris soin de le venger de vos accusations. « Nonnos, dit-il, serait un heureux écrivain, si le style tempéré suffisait pour écrire les triomphes de Bacchus (38). » Hélas ! bien au contraire, cette allure de Nonnos, trop égale et toujours uniforme, est accompagnée, même dans les épisodes et dans les traits de sentiment, d'une diction modérée bien plus que des mouvements de la passion. Et pour tout vous dire à vous, honneur de la ville d'Angoulême, pardonnez si je crois, à mon tour, reconnaître un peu de chagrin et de fantaisie dans votre Dissertation, et si j'y vois un critique plus jaloux du voisin Muret, que lecteur sérieux du poète d'Égypte. N'en doutez plus, s'il a mérité un blâme, c'est celui que la postérité a adressé déjà à certain écrivain d'une autre époque, qui vous est connu, trop loué de son siècle, trop dédaigné depuis; et auquel, vous m'avez déjà deviné, Voltaire reproche aussi d'avoir sacrifié parfois à l'arrangement des mots la justesse des pensées.
XVIII.
Silence de cent cinquante années. Point de bons traducteurs dans le siècle de Louis XIV.
Après ces deux inintelligents traducteurs, ce paraphraste ridicule, ce critique trop sévère et tous les glossateurs qui s'étaient groupés autour des Dionysiaques à leur apparition, Nonnos reposa pendant cent cinquante ans d'un sommeil interrompu à peine par les légères piqûres des frelons qui bourdonnaient en petit nombre autour de ses oeuvres sans y pénétrer. Disons mieux, le dix-septième siècle l'oublia ; soit que, trop naturellement occupés des chefs-d'oeuvre de la Grèce antique, les arbitres de notre Parnasse n'aient prêté aucune attention aux écrivains d'un mérite contesté et d'une valeur secondaire, soit que le style précieux et encombré de périphrases s'éloignât de leur élégante simplicité. En effet, la manie des antithèses et des jeux de mots, léguée par l'école poétique d'Alexandrie à l'Italie des Seicentisti, comme on les nomme par delà des Alpes, et à la France de Henri III, s'éteignit pour un temps sous la satire, et ne devait reparaître que plus tard.
D'ailleurs, il faut bien le dire, les meilleurs écrivains des grandes époques littéraires ne traduisaient pas les chantres immortels de la Grèce antique, encore bien moins les poètes de la décadence. Ils se contentaient d'en étudier l'esprit, et de s'inspirer de leurs beautés pour rivaliser avec leur génie. Ainsi Homère créa Virgile, qui ne songea, pas à traduire l'Iliade; Pindare, Horace, qui ne fit pas redire les Néméennes aux échos de Tibur ; Euripide, Racine, qui éleva la criminelle passion de Phèdre sur les bords de la Seine plus haut que la chaste vertu de l'Hippolyte de l'Ilissus. Enfin jamais le siècle d'Auguste n'a transmis au siècle de Louis XIV, ni celui-ci à nous, une fidèle interprétation des chefs-d'oeuvre primitifs ; et quand leurs imitations excellent, leurs traductions défigurent. Après un long silence, vers la fin du dernier siècle, l'intrépide pionnier des mines obscures où pouvait reluire encore quelque filon de l'or hellénique, d'Ansse de Villoison, rouvrit la lice, et attira de nouveau la curiosité sur Nonnos. Ce fut néanmoins à travers bien des réticences et beaucoup d'injures que le laborieux investigateur des trésors enfouis à Weymar et à Venise reconnut lui-même « qu'il y avait lieu de puiser aux sources peu fréquentées des Dionysiaques des enseignements vainement cherchés dans d'autres écrits, et que leur lecture initiait aux mystères de la mythologie, en même temps qu'elle donnait une plus complète connaissance de l'antiquité (39). »
A cette annonce, l'Allemagne s'éveilla, cette Allemagne qui naissait alors elle-même aux études philosophiques, et héritait du penchant vers la littérature antique, que la Hollande, sa voisine, voyait s'éteindre. Ajoutons qu'elle en a gardé fidèlement la précellence, si j'ose emprunter ce vieux mot à Henri Estienne, notre maître à tous humbles grécisants. Et, qu'il me soit permis de le remarquer, ces laborieuses méditations sur les écrivains grecs sont restées le domaine des savants d'outre- Rhin ; aujourd'hui même, à l'exception de deux ou trois doctes commentateurs que Paris vante encore, et qui à eux seuls soutiennent dignement la comparaison, c'est en Allemagne qu'ils se multiplient; c'est là que s'exerce et règne l'art de recueillir les fragments, d'étudier les textes, de recoudre les lambeaux, enfin de réparer les dommages du temps, et de rallumer le flambeau presque éteint du génie hellénique.
XIX.
Godefroi Hermann, vengeur de Nonnos. Les Épithètes sacrées ;— descriptives; — composées.
Ce que d'Anse de Villoison balbutiait à peine sur l'importance des Dionysiaques, en faisant toutes ses réserves, Godefroi Hermann plus hardi, Hermann, le plus savant et le plus perspicace explorateur de l'art rythmique, l'étendit et l'amplifia.
« La poésie épique, chez les Grecs, » dit-il, « s'éloignait de l'ancienne élégance, de telle sorte qu'il fallut un changement notable dans sa marche pour la préserver de la mort : cette innovation, bien qu'on ne puisse en désigner l'auteur et le guide, je n'hésite pas à la faire remonter à Nonnos. En effet, celui qui indiqua la voie où on le suivit comme un autre Homère devait l'avoir ouverte par une grande et célèbre composition. Et l'imitation de Nonnos est si évidente chez les poètes qui se soumirent à la nouvelle forme du vers héroïque, qu'il les a très certainement devancés dans cette carrière.
« Si je ne me trompe, ses Dionysiaques acquirent bientôt une telle renommée qu'elles devinrent le modèle des vers contemporains : et Proclus n'en est-il pas une preuve, quand la lecture de ses hymnes démontre qu'il a touché à l'époque de Nonnos, et qu'il a lu les Dionysiaques ? Or les poètes épiques » (et Hermann appelle épiques tous les poètes qui ont employé le vers d'Homère, à l'exception des bucoliques et de Callimaque) « ne furent pas les seuls à s'emparer du nouvel hexamètre de Nonnos, il faut y joindre aussi les épigrammatistes : Paul le Silentiaire, Léontios, Macédonios, etc. A cette école appartenaient encore Musée, Tryphiodore, Coluthus, Jean de Gaza, Apollinaire, et bien des poésies anonymes de l'Anthologie.
« C'est donc l'auteur de cette méthode perfectionnée, et, selon moi, c'est Nonnos qui a échangé la lourdeur des spondées contre la rapidité des dactyles (40), qui a introduit la césure au troisième pied, en chassant le trochée du quatrième, qui a délivré l'hexamètre des abréviations attiques, retranché de son mieux l'apostrophe, et poursuivi à outrance l'hiatus en ne le tolérant, et très rarement encore, que dans les expressions empruntées à Homère.
« C'est Nonnos qui a banni totalement l'abus des syllabes brèves devenant longues en faveur de la césure ; de telle façon que, si le vers héroïque avait perdu sa dignité originelle, il retrouva du moins son rythme élégant et nombreux ; et dès lors il fut soumis à des règles si sévères qu'il fallut désormais, avant de s'attaquer à l'épopée, en étudier sérieusement la science. »
Voilà bien, si je ne m'abuse, Nonnos posé définitivement en véritable réformateur de la poésie; et, qu'on ne s'y trompe pas, cette école dont Nonnos est le chef proclamé par l'arbitre le plus expérimenté du rythme antique, cette école, dis-je, n'a pas seulement étendu son empire sur la prosodie. A la pureté régulière de son hexamètre, Nonnos a joint encore une élégance soutenue et une imperturbable harmonie. Écartant les obscurités systématiques des pensées ou de la diction, comme les énigmes naturelles ou cherchées dont Lycophron fut le propagateur et le malheureux modèle; repoussant ces productions subtiles dressées en forme d'autel, de hache et de chalumeau, où le poète, peintre difforme, veut frapper les yeux sans émouvoir le coeur ; rejetant enfin cette frénésie égyptienne des poèmes lipogrammatiques, où le compositeur se prive alternativement, en pure perte, du secours d'une consonne ou d'une voyelle, et enchaîne son inspiration à un alphabet mutilé, il dédaigne ces abus du style qui néanmoins devaient reparaître longtemps encore après lui : car, j'en ai moi-même, sur les rives du Bosphore, dans un cercle de certains littérateurs oisifs de la Grèce moderne, retracé quelques vestiges; mais sans doute les rayons du soleil qui illumine de nouveau le Parthénon auront chassé ces nuages arriérés des bords du Céphise affranchi. Il est vrai que pour remplacer ces tours de force qui ne furent jamais des ornements, Nonnos a parfois donné trop de place aux jeux des paroles, à leur cliquetis étymologique, ou même au calembour, et qu'il a couru avec trop de hâte au-devant de l'antithèse, honneur du style quand elle est clairsemée, fatigue de l'intelligence quand elle se prodigue. « C'est là, » me disait M. de Chateaubriand, « en toute langue le signe du déclin des bonnes lettres ; et c'est aussi le cachet de notre dix-huitième siècle.» Or, cet écueil, l'auteur vieillissant de la Vie de Rancé et des Mémoires d'Outre-Tombe, l'a-t-il évité toujours, et n'a-t-il pas trop souvent lui-même sacrifié à la fausse divinité?
Mais quoi ! Nonnos, renchérissant sur cet excès du dix-huitième siècle, s'est rapproché plus encore du dix-neuvième, quand il a marqué pour ainsi dire ses phrases l'une après l'autre au coin d'un trait alambiqué, d'un terme imagé bizarrement, ou d'une acception trop érudite, et principalement quand il a surchargé ses vers d'une multitude d'épithètes que nul écrivain n'avait avant lui si richement déployée? A cette objection que je bâtis à l'aide des objections d'autrui, et que je m'adresse à moi-même, je m'arrête pour traiter à fond ce port caractéristique du talent de Nonnos : la prodigalité de l'épithète; vertu, si l'on en croit Conrad Dinner, le plus patient collecteur des adjectifs grecs, qui représente Nonnos comme un autre Midas convertissant tout ce qu'il touche en épithètes (Midam alterum); vice, s'il faut s'en rapporter à quelques critiques d'un goût plus sévère, entre autres au rigoureux Cunaeus.
Et pour commencer par les épithètes sacrées, que je mets presque en dehors de la question, il est très vrai, comme l'observent Heinsius et d'autres experts philologues, que l'abondance des adjectifs ou des attributs de la Divinité est une propriété spéciale des livres saints : on pourrait dire pour la glorifier, ou l'excuser du moins, que Dieu lui-même en a donné l'exemple, et qu'il a désigné la forme du style qui lui est le plus agréable, lorsqu'il s'empare par la bouche de Moïse (41) de ses nombreux apanages : Misericors, Verax, etc., enfin tardus ad iram, lent à punir, sublime prérogative de la Providence, que saint Jérôme a faiblement rendue, à mon sens, par le mot patiens.
Chez les Grecs, certains hymnes ne sont aussi que des colliers d'épithètes dont les perles se touchent les unes les autres; et certes, si ce n'était un rapprochement trop profane, et si les saintes mélodies de nos églises pouvaient nous attendrir jusque dans ces pages, de telles invocations rappelleraient les litanies que j'ai entendu avec une si vive émotion à Bethléem, retentir sous les voûtes élevées par sainte Hélène sur le berceau d'un Dieu. Mais ces hymnes eux-mêmes, et les chants surchargés de pieux adjectifs d'Onomacrite, caché sous le nom d'Orphée, sont d'une époque voisine de Nonnos comme de la décadence, et peuvent sans anachronisme porter quelque trace de la poésie, ou même de l'histoire des Hébreux. Homère, convenons-en, dans les moindres poèmes qu'on lui attribue en l'honneur de ses dieux favoris, comme ses imitateurs anonymes ou les disciples du véritable Orphée dans les autres, n'ont point eu recours à l'amas des épithètes pas, plus que Callimaque, et ils n'ont admis les surnoms des habitants de l'Olympe, ou les signes distinctifs de leur puissance, qu'avec une certaine sobriété.
J'arrive à Nonnos, auteur d'une longue épopée, et non point d'un court dithyrambe; il n'a pas, quant à lui, mis en jeu les épithètes sacrées de la même manière que ses prédécesseurs. Au lieu d'enchaîner sans ordre et suivant l'exigence de la prosodie les titres conquis par son Héros à l'adoration des humains, il les a disséminés au hasard, et, dans le cours de son ouvrage, il a fait entrer presque sans exception les quatre-vingt-seize attributs de Bacchus ; bataillon symétrique que nous présente l'Anthologie, en colonne serrée, par quatre de profondeur, sur vingt-quatre lignes, commandée chacune par une lettre de l'alphabet. Mais il ne les a fait apparaître à nos yeux qu'après en avoir rompu les rangs, au moment et à la place à ses récits devaient le plus naturellement les amener.
Quant aux épithètes descriptives ou purement poétiques qui foisonnent en effet chez notre auteur, je ne sais si, sur ce point, il ne prête pas à louer plus qu'à médire : à part un ou deux adjectifs oiseux, dont le sens même a pu rester vague et énigmatique en raison des incorrections du texte, si on laisse de côté certaines expressions favorites, que l'on pourrait appeler les idiotismes de la langue nonnique, toutes les autres sont significatives, énergiques, et ne s'offrent nulle part comme les plus terribles ennemies du substantif. Ses Aristarques, il est vrai, ont relevé chez lui péniblement certains vers formés en entier de quatre épithètes, et ils les ont, chemin faisant, arrondis en boules de neige, pour les jeter à sa face et en insulter sa renommée : c'est bien là, je ne me le dissimule pas, ce qu'Aristote reproche si justement à Alcidamas, quand il dit, par une sorte de jeu de mots cette fois-ci bien placé, que « cet orateur se sert de l'épithète, non comme d'un assaisonnement qui plaît, mais comme d'un aliment perpétuel qui lasse (42). » Or, ce défaut d'Alcidamas, Nonnos paraîtrait l'avoir ambitionné ; il l'aurait même poussé si loin, dit l'un de ses plus sévères critiques, qu'il donne des épithètes à ses épithètes même. Je conviens, si l'on veut, que parfois il les double, bien que ce méfait soit assez peu commun, et que j'en puisse trouver l'exemple et en même temps l'excuse dans Homère (43). Mais je demande à faire observer à mon tour que, quand Nonnos triple les épithètes, c'est que, presque toujours, il a élevé un de ses adjectifs à la dignité de verbe, et que l'attribut est devenu actif. Or c'est sur cette connaissance acquise pour moi de sa manière que j'ai construit en partie ma méthode de correction; et je crois lui avoir dit quelques rencontres assez plausibles.
Je ne nie pas néanmoins qu'en plus d'une circonstance ce concours d'épithètes n'arrive à enténébrer l'image qu'il devrait éclaircir; mais la plupart du temps il ne projette sur elle qu'une lumière antithétique. Mes notes en citeront quelques exemples ; mais elles ne pourront dire tous les embarras dans lesquels ces termes nouveaux ont jeté le traducteur. Que de fois ne me suis-je pas écrié avec Ronsard ?
Combien je suis marri que la
langue françoise
Ne fasse pas des mots comme fait la grégeoise :
Ocymore, Dispotme, Oligochronien.
Je prétends ici seulement, et d'avance au risque de contredire sur ce point encore de savants critiques, que si les épithètes, chez Nonnos, sont parfois surabondantes, elles ne sont jamais impropres; et cette observation, je le répète, m'a également guidé maintes fois dans ma révision.
Restent les épithètes composées, à double mot, et Nonnos en ce genre est, en effet, un très puissant, et quelquefois un très heureux créateur. Quand elles présentent ainsi de temps en temps plusieurs images agréables fondues en une seule expression, elles donnent à la fois de la couleur et de l'ampleur au style; mais, quand on les multiplie, cette ampleur touche de bien près à l'enflure. « Cependant, ajoute un autre critique, les lecteurs les plus choqués des défauts de Nonnos ne peuvent s'empêcher de rendre justice au tour ingénieux, à la fécondité et à l'érudition de ses épithètes, même les plus hasardées (44). »
Il faut le dire d'ailleurs à la décharge de Nonnos, ces mots où se réunissent deux images, ces épithètes composées appartenaient surtout au style consacré à Bacchus, parce qu'ils dénotaient l'inspiration et ajoutaient à la vivacité du dithyrambe, accessoire tumultueux des orgies :
« Les grâces, suivant Démétrios de Phalères naissent souvent d'un terme composé et dithyrambique (45). » Et aucune langue ne prête à ces alliances de mots autant que la langue grecque, source immense qui, semblable à l'océan d'Homère (46), a fait rejaillir les flots de ses richesses sur les idiomes les plus reculés.
Quant à moi, qui mets en présence toutes les opinions, pressé que je suis de conclure après une digression si longue jetée en travers de ma narration historique, je me réunis encore à Aristote,à qui il faut revenir sans cesse pour apprendre à discerner le vrai du faux, comme pour réglementer le goût, et je soutiens avec lui qu'en cette matière les poètes ont des libertés ou même des licences refusées aux autres écrivains.
XX.
Dupuis et son système astronomique tiré de Nonnus. Frérot.
A peine Hermann, ce juge si fin et si exercé de l'antiquité, ce philosophe de l'érudition, avait-il, dans ses méditations métriques, dressé un trône ou plutôt une chaire au poète égyptien, à peine l'avait-il ainsi dans l'art de la versification couronné chef d'école, qu'aussitôt l'enthousiaste Dupuis l'érigea en professeur d'astronomie transcendante. Déjà Nonnos n'est plus uniquement cet arrangeur de dactyles, habile à faire rendre an rythme grec tout ce qu'il contient d'harmonie; il est aussi le contemplateur des astres, le scrutateur de la sphère, l'interprète des constellations ; c'est dans les Dionysiaques que Dupuis va puiser l'idée originelle de son système; système monstrueux, qu'il a dès son début appuyé sur ces impies aphorismes, comme sur deux indestructibles colonnes. - « C'est la terre qui a fait le ciel. - L'éducation qui nous dégrade nous livre tous à l'imposture. » - Et certes, de ces deux propositions qui, je me hâte de l'affirmer, ne se trouvent pas même en germe dans les Dionysiaques, Dupuis n'eût pas aimé sans doute à voir la dernière rétorquée contre cette propre éducation exubérante à laquelle il doit une si vaine érudition.
C'est néanmoins, pour une grande part, du poème de Nonnos, feuilleté et refeuilleté avec une patience qui, je le crains, trouvera bien peu d'imitateurs, et, pour l'autre part, de son cerveau encombré, que Dupuis a fait jaillir l'amas confus de ses observations sidérales. Il semblé que, comme les sorcières de Macbeth, faisant bouillonner dans une vaste chaudière où il les a vu fondre, avec sa raison, les ingrédients hétérogènes de tous les cultes, il en a exprimé je ne sais quelle religion universelle sans nom, autre Babel édifiée par son immense incrédulité.
« La Grèce, » dit le blasphémateur, « était trop peu instruite pour nous conserver les traits que l'ancienne fiction avait avec les lieux et avec la marche du soleil, le véritable et le seul Bacchus dont l'antiquité ait jamais célébré les bienfaits. C'est en Égypte qu'il nous faut chercher les sources de cette histoire, et dans un vieux poème égyptien que Nonnos, né à Panople, a réchauffé en grec dans les premiers siècles de notre ère. » (T. Il, p. 27.)
« Ce vieux poème réchauffé n'est point un corps d'ouvrages de l'esprit, » ajoute- t-il, « ce n'est qu'un amas de légendes égarées dans la nuit des temps, » et Dupuis nous cite dans une note quelques collecteurs primitifs de ces légendes : Linus, Orphée, Musée, Pronopidès, dont il fait un précepteur d'Homère, assez peu connu jusqu'ici. Certes il lui eût été facile de grossir sa nomenclature; et, sans parler des tragiques parmi lesquels figurent en première ligne Eschyle pour une tragédie perdue, Euripide pour ses admirables Bacchantes, sans tenir compte des nombreux comiques où l'on remarque Eubule, Épicharme, Timoclès et même Aristophane, tous chantres des exploits de Bacchus, dont les oeuvres ont disparu à nos yeux, mais que la bibliothèque d'Alexandrie a placées sous les regards de Nonnos ; il aurait pu nommer plus d'une épopée, le Dionysos d'Euphorion, les Faits et geste; de Bacchus, par Théolyte, et enfin les Bassariques d'un certain Dionysos, dont on a réuni depuis peu les lambeaux, et que l'on dit avoir prêté au poète égyptien quelques hémistiches.
Mais ces titres de poèmes, exhumés pour la plupart des vastes catacombes constamment ouvertes dans Athénée ou Stobée, ne me semblent enlever aucun mérite à l'oeuvre de Nonnos, oeuvre qu'il a fondée sur un sujet national déjà traité sans doute par un grand nombre d'écrivains ; car, loin de se laisser aller à l'invention dans un sujet si favorable aux écarts, il a pris à tâche de suivre pas à pas les traditions mystiques, de les relier entre elles, et de dresser une sorte de code du culte de Bacchus. Je poursuis.
« Ce poème, » dit Dupuis, « peu connu, quoique infiniment digne de l'être, sinon pour ses qualités poétiques, au moins pour ses traits mythologiques, ses rapports suivis avec la marche de la nature, et surtout avec celle du soleil, qui y sont en grande partie conservés » (là commence à pointer le rêve), « est composé de quarante-huit chants, qui renferment en eux presque toute la mythologie ancienne ; c'est dans ce poème que nous suivrons la marche du soleil ou de Bacchus dans ses conquêtes et ses voyages autour du monde. Nous y trouverons encore une preuve complète que Bacchus est le soleil, puisque ce n'est qu'aux cieux et dans le zodiaque que l'on peut suivre ses traces, comme c'est dans le zodiaque que nous avons suivi celles d'Hercule, d'Osiris, d'Isis, de Thésée et de Jason. »
Ce programme, écrit tout d'une haleine comme un oracle de la sibylle, est suivi d'une analyse sèche, froide et séparée de chacun des quarante-huit chants, renfermant (il les a comptés) 21,895 vers. Dupuis a accompagné ce résumé prosaïque des Dionysiaques de tant d'allégories et d'allusions astronomiques, qu'à part quelques idées ingénieuses que j'ai eu soin de relever dans mes notes, son travail sur Nonnos ne peut être d'aucune utilité pour le traducteur. Il est en outre semé d'épigrammes directes, ou même de traits sournois décochés à la Voltaire contre la religion chrétienne; et, en effet, l'auteur faisait un tel cas du prince des incrédules, qu'il l'avait érigé dans son esprit en divinité favorite, sans doute en lieu et place du Dieu qu'il tentait de détrôner; on ne peut lire sans stupéfaction, dans son épître dédicatoire à son épouse bien-aimée, cette phrase :
« L'éloge le plus grand qu'on puisse faire de ton goût, c'est ton estime pour Voltaire, à qui tu consacres tout le temps que te laissent les soins économiques de ta maison.»
Cela me rappelle ce que me confiait à Constantinople un Levantin sur les exigences des musulmans en ménage; ils réprouvent chez leurs femmes la dévotion, et je ne sais plus quel poète oriental, prédécesseur de Parny, exige de son Iris qu'elle ne fasse aucun cas du Coran.
Que dirait-on aujourd'hui de cette preuve des vertus d'une ménagère et de la galanterie de Dupuis, qui, au bout de cette amoureuse et philosophique déclaration de quelques lignes en tête de ses trois volumineux in-quarto, ajoute en madrigal, comme dans le couplet final de nos vaudevilles : Je tiens plus à cette épître qu'à tout le reste de l'ouvrage.
Après de si bizarres idées sur l'éducation ou du moins sur les lectures des femmes, je ne puis m'empêcher cependant d'admirer la merveilleuse érudition de Dupuis, acquise et accrue durant nos troubles civils. Il y assistait cependant, et y prenait une part active, tantôt député de la province, tantôt mandataire de la capitale. Et comme il n'y a pas, de notre temps surtout, une question tellement littéraire, soit même une dissertation si poétique, où la politique ne se fisse jour et où l'opinion de l'écrivain n'agite un moment sa plume, on me pardonnera de dire qu'il faut honorer Dupuis pour son rôle courageux dans l'horrible drame de 1793 et pour son vote négatif dans le grand procès régicide.
L'Europe et la postérité, s'écria-t-il. à la Convention, jugeront le roi et ses juges. Et c'est à ses systèmes déjà dédaignés du public, et aux distractions mentales qu'on en croyait la conséquence, qu'il dut de ne pas payer de son sang sa noble témérité.
Et pourtant ces fictions qui placent à la tête de toutes les divinités du paganisme le soleil et la lune, ne sont pas la création de Dupuis; il les a puisées dans des sources antiques. Mais quant à son système d'étendre et de prolonger l'empire des deux astres jusque sur nos consciences, quant à ses hypothèses métamorphosées en règles théologiques et en axiomes sur l'influence de l'apparition ou disparition simultanées des constellations, lui seul en est le créateur responsable, et l'on aurait tort d'en rejeter une part sur Nonnos.
D'un autre côté, les citations si nombreuses qu'en a faites Dupuis pour étayer son échafaudage sembleraient de nature à établir la réponse astronomique de Nonnos : son savoir, en effet, en sa qualité d'Égyptien et d'élève de l'école d'Alexandrie, devait être grand sur cette matière ; mais il ne peut rien pour sa renommée poétique. Le fougueux démonstrateur l'invoque presque toujours comme une autorité, mais il ne s'attache aucunement à faire valoir ou à reproduire l'élégance de l'écrivain, pas même dans les trente-huit vers (car je les compte aussi) que publia le Nouvel Almanach des Muses de 1805. J'ai cherché, non sans peine, dans ce recueil de poésies éphémères, ces alexandrins que, sur la foi de M. Auguis, biographe et éditeur de Dupuis, je devais croire une traduction ou tout au moins une imitation d'un fragment des Dionysiaques; et il m'a été impossible d'y reconnaître autre chose qu'une invocation à Hercule à propos de ses douze travaux, peut-être le début de cette Héracléide qui tient une si grande place dans le premier volume de Dupuis, poème sacré sur le Calendrier, qu'il méditait et dont il avait par avance emprunté le titre à Panyasis, Pisandre et Cléophile, chantres d'Hercule dans les siècles grecs; ou bien enfin une inspiration rimée et détachée, dont l'infatigable érudit interrompait le cours de ses incessantes compilations.
Parmi les critiques qui ont refusé de voir avec Dupuis, dans le tissu des Dionysiaques, une série de faits uniquement astronomiques, Fréret (et ce nom, sans annoncer une infaillibilité qui n'est le partage de personne en conjectures antiques surtout, doit porter cependant tout lecteur judicieux à s'arrêter avant de contredire un tel érudit), Fréret, dis-je, ne pensait point que là fût précisément la source où Nonnos avait puisé la matière fondamentale de son épopée. Il croyait bien plutôt que les traditions suivies par le poète égyptien établissaient Bacchus en personnage vraiment historique, qui avait réellement existé. Il le rattachait ainsi au système d'Évhèmere, dans lequel « toutes les divinités du paganisme ont été sans exception des hommes élevés par l'apothéose au rang des dieux, et toutes les fables des événements d'une ancienne histoire, que les partisans d'Évhémère placent comme ils peuvent, soit pour le temps, soit pour le lieu (47). »
XXI.
Schow, Fuesli, Gottlob Weichert, Moser, Creuzer et autres critiques allemands.
Bientôt, tandis que la France, même dans ses accès d'impiété ou d'indifférence religieuse, repoussait l'étrange théorie du Bacchus, dieu universel, dont on cherchait à rajeunir le culte, l'Allemagne érudite dirigeait, une fois encore, ses regards vers ce poème des Dionysiaques qui avait fourni à Dupuis la première idée, sinon les développements, de son système. A son exemple, mais sans les faire suivre des mêmes extravagances, Schow, Fuesli et quelques autres philologues publièrent de courts abrégés des Dionysiaques, plutôt pour essayer d'en tirer un corps de doctrines et en établir l'importance scientifique que,pour en faire apprécier le mérite littéraire ou la diction.
On peut citer aussi parmi les partisans que Nonnos enrôla, à longs intervalles, sous sa bannière dédaignée, Gaspard Ursini, à la fin du dix-septième siècle, et Weichert au commencement de celui-ci.
Le sentiment de ce dernier philologue a été signalé par le célèbre Harles dans son édition de la Bibliothèque grecque de Fabricius, comme la sentence la plus éclairée qu'ait portée jusqu'ici la critique sur le mérite de Nonnos. A ce titre, elle a droit de paraître dans cette introduction, et en voici un extrait :
« Quelques lecteurs, » dit Weichert, « effrayés de l'épaisseur du livre, se sont persuadé qu'il est surchargé de narrations superflues et disposées sans aucun ordre. Il faut pardonner à ces hommes qui ne prennent plaisir qu'aux écrits de courte haleine (libellorum brevitate), et s'épouvantent d'une oeuvre de quelque ampleur, même quand elle a été applaudie par son siècle. Je déclare que nul de ceux qui lisent les Dionysiaques attentivement n'accuseront l'auteur de confusion. L'unité de l'action, et, pour me servir des paroles d'Aristote, la composition, qui consiste en un début, un milieu et une fin, y est parfaitement observée.
« Tout y est si habilement rattaché à un seul fil que l'art du poète y brille autant que son esprit ; et il est clair qu'avant d'écrire, Nonnos avait tout son plan dans sa tête. D'un autre côté, si plusieurs des conditions que l'esthétique, comme on dit, exige d'une épopée, se trouvaient omises ou employées mal à propos, ce n'est pas à Nonnos qu'il en faudrait faire un crime. Tout occupé à tirer de ses réservoirs l'érudition qu'il y avait entassée, et à s'en faire honneur, sans s'inquiéter du temps et des hommes qui pourraient n'y voir plus tard que des futilités, il lui a suffi qu'une circonstance appartenant à son sujet pût jeter quelque agrément sur son poème pour s'en emparer et la mettre en oeuvre, et si nous considérons les Dionysiaques sous ce point de vue, il faudra bien avouer que le poète a complètement exécuté le plan qu'il s'est prescrit, et que par l'étendue de son savoir, comme par la fécondité de son imagination il mérite les éloges et l'admiration de tous. Mais, quoique Nonnos ait trouvé dans son thème l'occasion d'ouvrir toutes les sources de son érudition, il faut convenir aussi que, par la grâce du récit, l'harmonie du rythme, comme par la variété des épisodes et l'éclat des images, il charme également le lecteur. »
Ici je m'arrête pour déclarer que, loin de traduire exactement les louanges latines de Weichert, j'amortis son enthousiasme, et je me hâte de dire avec lui : « Je confesse néanmoins, pour ne pas être accusé d'aveuglement ou de connivence avec les défauts de ce poème, que j'aurais voulu en retrancher quelques détails, et que je n'y ai pas retrouvé toujours le parfum d'Athènes. »
Puisque j'ai commencé de modérer moi-même l'ardeur nonnique de Gottlob Weicbert, il faut poursuivre et tirer de tant de controverses une raisonnable conclusion. Oui, sans doute, parmi tous ces hommes qui, dans un siècle épuisé, ont cherché à imiter les inspirations des chantres des héros et de la nature primitive, et qui demandaient l'érudition et l'art des mots aux travaux des écoles et aux voûtes des bibliothèques, parmi tous ces écrivains venus après les génies disparus sous l'empire de Rome et sous la domination d'un seul maître, comme le dit Tacite (48), parmi ces talents qu'Alexandrie, asile des muses grecques, rendit à Athènes et à Constantinople dans le quatrième siècle, nourris de ses science, mais énervés sous les vices de sa décrépitude, enfin parmi ces versificateurs spirituels qui donnèrent au style épique, non sans doute son énergie originelle, mais une constante élégance, Nonnos est certes le poète le moins connu et pourtant le plus digne de l'être.
On le voit, dans mes revues de la critique ultra-rhénane, j'ai passé par-dessus quelques expressions d'humeur que le célèbre Heyne semble lancer contre Nonnos, seulement comme l'écho d'une boutade d'Hemsterhuys; celui-ci, après avoir déclaré que l'autorité de Nonnos ne doit compter pour rien en matière archéologique, convient néanmoins qu'on ne saurait en juger impartialement dans l'état si informe où il nous est parvenu. Et M. Creuzer a reproché, en mon lieu et place, à ce vengeur des muses grecques mises en fuite par l'école de Juste-Lipse, de n'avoir pas apprécié et médité autant qu'il le méritait ce sujet des Dionysiaques, le plus magnifique canevas du monde fabuleux (49). Quant à Heyne, à travers certaines injures qui tiennent plus à l'emportement habituel de son caractère qu'à la réflexion, il déploie une érudition trop sagace et trop spéculative pour n'avoir pas deviné, sous l'imperfection des manuscrits, la véritable valeur du poète, et il a prononcé ces paroles qui ont été pour moi un puissant encouragement. « Celui-là aurait bien mérité des lettres et serait le digne objet d'une grande reconnaissance, qui réunirait tout ce qu'il y a de meilleur dans les Dionysiaques, et, supprimant les inepties, ferait un seul corps de tout le le reste. »
Ici se présente plus qu'il ne brille M. Moses que Graëfe a stigmatisé plus tard du titre de fléau de Nonnos, en l'accolant à Lubinus Eilhartus, « couple bien digne de s'allier, » dit-il.
M. Moser, annotateur de six chants des Dionysiaques (8, 9, 10, 11, 12 et 13), a dédaigné de les traduire en latin ou même en allemand, comme s'il n'y eût cherché qu'un thème à commentaire pour exercer sa juvénile érudition. Car sans doute M. Fréd. Creuzer, le plus savant et le plus perspicace des mythologues de nos jours, n'a fait, en signant la préface de cet essai, qu'encourager les efforts d'un de ses élèves, et il n'a pu par avance, pour cette seule tentative, lui assigner un rang parmi les philologues distingués. M. Moser ne me paraît pas avoir fait assez de cas des travaux de ses prédécesseurs ; et entre autres inexactitudes, car je n'entre pas dans le fond de la querelle et m'en tiens aux peccadilles, il signalé, parmi les manuscrits des Dionysiaques qu'il faut consulter, un manuscrit parisien, lequel, je m'en suis assuré par bien des recherches, n'a jamais existé dans notre capitale. C'est un avis que je voudrais transmettre en passant à M. Louis Dindorf ; car je l'ai vu, l'automne dernier, à Leipsick, très disposé, sur la foi de M. Moser, à faire un voyage à Paris pour y consulter l'introuvable manuscrit. Or ce serait dommage, et M. L. Dindorf nous démontre tous les jours qu'il peut faire un bien meilleur usage de son temps. A ce propos, je ferai observer qu'il faut se défier parfois de cette gravité allemande que madame de Staël, en matière plus sérieuse, appelle le pédantisme de la légèreté; elle recouvre parfois d'un amas de savoir des propositions très conjecturales, et couche sur un lit épais de citations grecques et latines des assertions à demi fantasques, quand elles ne sont pas de tout point erronées, de sorte que la vérité et le bon sens y demeurent entièrement étouffés sous l'épaisseur de l'érudition.
Tous ces apprentis docteurs, épris tout à coup du culte bachique, à l'exemple du maître, le savant Fréd. Creuzer, illustre auteur du Dionysos, et mieux encore de la Symbolique, prirent à tâche de démontrer les qualités du dieu bien plus que celles de son poète; ils expliquèrent une à une les épithètes et les surnoms de Bacchus, avec une grande exactitude archéologique, sans aucun souci du style; et, dans leur énumération technique et décolorée, ils me rappellent les disciples de Mahomet que j'ai vus, accroupis, rouler dans leurs mains flegmatiques le jouet oriental (combologio), en guise de diversion à la lenteur de leurs entretiens, comme s'ils égrenaient, l'une après l'autre, les vertus de leur Prophète.
XXII.
Graëfe et M. Ouwaroff.
Enfin Graëfe
parut; ou, pour mieux dire, on vit surgir en 1819, des presses de
Leipsick, un volume grec, corrigé par ses soins, contenant les
vingt-quatre premiers chants des Dionysiaques, sans préface,
traduction ni considérants. Graëfe, en 1813, avait fait précéder ce
premier volume d'un exercice de traduction allemande, entrepris sur
une partie détachée du quinzième chant, en vers assez semblables
d'intention à ceux de la merveilleuse traduction de
l'Iliade de Voss.
Cette tentative d'interprétation poétique n'avait eu d'autre suite que certains fragments épars dans l'analyse littéraire, et toujours en langue allemande, que donna, sur un plan plus étendu, M. Ouvaroff, auquel je vais arriver; on lit ceci dans le court avant-propos de cet écrit, que Graëfe a intitulé : Hymnos et Nicée :
« Un préjugé accrédité depuis des siècles veut que Nonnos ne soit point un poète, mais seulement un curieux collecteur de fables et d'archéologie. Il est triste de voir le grand poète étouffé sous le savant mythographe. Sans doute, quand Nonnos, pour se conformer à son siècle, accumule des frais excessifs d'érudition dans des expressions chargées d'antithèses, sa poésie devient ampoulée, froide et fatigante; mais, quand il use de la mythologie comme l'Arioste de l'histoire, alors ses vers prennent un essor rapide et puissant. Son rythme, plus correct et plus riche, atteint parfois l'enthousiasme lyrique, et s'élève jusqu'aux plus brillantes peintures; en un mot, son enflure et son affectation dans l'épopée sont de son époque; à lui seul appartiennent sa riante imagination et cette singulière abondance de pensées et de sentiments qui donnent une vie nouvelle même aux traditions éteintes (50). »
C'était ouvrir une large voie à la réhabilitation de Nonnos, et les philologues du Nord se hâtèrent d'y marcher. Parmi eux, et avant tous, pressé d'apporter à cette proposition presque neuve une seconde série d'arguments, et au poète un autre tribut de suffrages, M. Ouvaroff, aujourd'hui président de l'Académie des sciences de Pétersbourg, fit paraître en 1817, sous le titre de Nonnos de Panopolis, poète, ou bien Supplément à l'histoire de la poésie grecque, une étude aussi savante qu'honorable pour la mémoire du chantre de Bacchus. J'en extrairai, dans mes notes, quelques fragments, pour les admirer, rarement pour les combattre. Bien que le savant correspondant de l'Institut de France nous ait prouvé, par plus d'une dissertation, imprimée à Paris, sa facilité à manier notre langue, c'est en allemand, et à Pétersbourg, qu'il lit parâtre ce travail, qui passe en revue les quarante-huit chants des Dionysiaques : je vais transcrire quelques lignes du commencement et de la fin :
« Mon but, » dit M. Ouvaroff dans ce qu'il nomme son anthologie nonnique, « a été de faciliter, autant qu'il est en moi, l'étude des Dionysiaques, et de défendre le poète de Panopolis et son talent contre les préjugés du monde érudit; pour être universels, ils n'en sont pas moins souverainement injustes... Le poème de Nonnos est condamné, depuis des siècles, à n'être qu'un galetas plein de rouille et de poussière, où ne pénètrent de temps en temps que les plus intrépides mythographes.... Et cependant, » termine M. Ouvaroff, « peut-être les amis de la poésie grecque trouveront-ils un nouveau motif de juger moins sévèrement le chantre de Panopolis, dans cette réflexion qu'avec ses derniers vers résonnent aussi les derniers accents de la poésie antique. C'est le touchant adieu d'un ami qui va disparaître pour toujours. Ses paroles suprêmes nous sont alors doublement précieuses et douces. Il faut donc les retenir. »
XXIII.
L'édition grecque de 1819-1826. Wakefield en Angleterre. Bernardhy ea Allemagne.
Ces éloges préliminaires, de telles réclamations publiques en faveur de Nonnos, semblaient une annonce de l'édition de Grade, et lui servaient d'heureux avant-coureurs. Celui-ci, sept ans après avoir publié les vingt-quatre premiers chants du texte grec, fit paraître les vingt-quatre derniers, et cette fois avec un avertissement qui expliquait bien plutôt tout ce qu'on se promettait de faire qu'il ne rendait compte de ce qu'on avait fait. Les deux volumes complets maintenant ne présentaient au bas des pages que les versions corrigées ou choisies parmi les conjectures, soit des premiers commentateurs Falkenburg, Cunaeus et Scaliger, soit des derniers, tels que d'Ansse de Villoison en France, Hermann en Allemagne, et même en Angleterre le fougueux Wakefield, dans sa Forêt de bilieuse critique (51).
Certes ce n'est pas l'érudition qui a manqué à Graëfe pour donner plus de perfection à son texte grec; c'est seulement de n'avoir pas traduit lui-même le poète qu'il éditait : les incorrections qui échappent au lecteur et que méconnaît le glossateur auraient dû nécessairement céder devant les recherches et les efforts de l'interprète (52).
Graëfe préparait un commentaire général, pareil sans doute au fragment qu'il avait donné en 1813, à la suite de deux cent cinquante-deux vers de l'épisode détaché d'Hymnos et Nicée. Il parlait de dissertations sur le siècle et les écrits de Nonnos, sur les sources mythologiques où le poète était censé avoir puisé ses légendes, sur les vertus et les vices de son style, sur ses idiotismes; il annonçait une notice historique des éditions, un aperçu sur le système métrique, enfin un résumé de notes grammaticales, toutes choses que j'ai essayé de traiter à mon tour dans ma préface comme dans les remarques dont j'ai fait suivre chaque chant séparé. Et c'est avec une grande confiance dans ce travail commencé déjà qu'il provoque la curiosité des glossateurs futurs et les renvoie à son Lexique universel de Nonnos. Pourquoi faut-il que, trente ans encore après, nous ayons à en regretter l'absence; que ces lumières, qui sans doute nous eussent guidés heureusement dans plus d'un recoin ténébreux, se soient éteintes au moment de briller, et qu'enfin Graëfe lui-même ait disparu avant d'accomplir sa promesse (53) ?
C'est à Graëfe cependant, il faut le reconnaître, qu'est dû principalement ce retour si marqué de l'Allemagne savante vers Nonnos; car, avec Hermann son maître, il l'a intronisé irrévocablement en véritable pontife du culte de l'hexamètre. Oui, Nonnos a fait école ; et cet événement des annales poétiques du monde, que j'essaye de constater à mon tour, vient d'être proclamé récemment par le célèbre Bernardhy ; non dans une de ces thèses éphémères ou capricieuses que les étudiants de l'Allemagne, jaloux d'exercer leur érudition, se posent à eux-mêmes pour se faire mieux connaître à leurs confrères des Universités, mais dans un de ces livres destinés à vivre, que les consciencieux philologues du Rhin combinent et mûrissent pendant vingt années, et qui, en perpétuant le mérite du scrutateur opiniâtre, signalent doublement les progrès de la grande histoire de l'esprit humain.
« Bientôt, » dit M. Bernardhy, « vint l'influence dominatrice d'un homme doué d'un talent rare qui attira vers lui les études de ses voisins, et les enchaîna à ses règles, ce Nonnos qui, pour son honneur, donne son nom à la dernière époque poétique de l'école égyptienne. Son oeuvre est une réforme préméditée du mètre épique, unie à un coloris merveilleux et liée à un plan si ferme que rien ne le déconcerte, et que le poète lui-même n'a pu, sans un grand art et un labeur obstiné, soutenir et souder entre eux tous les matériaux de son édifice. Peu de poètes grecs peuvent se vanter d'une imagination aussi créatrice et pourtant toujours asservie au sujet. Elle se déploie pendant quarante-huit chants sans s'égarer, sans languir, et s'enrichit de traits brillants, de tours expressifs et d'une prodigieuse surabondance d'images. Avec de telles qualités, il ne faut pas s'étonner si, malgré la constante application du fruit de ses études, Nonnos est resté original (54). »
Quoi qu'il en soit de cet enthousiasme, c'est l'édition de Grade, la seconde en date, car les reproductions de 1606 et 1610 ne sont pas une édition nouvelle, ce sont ses deux volumes imprimés à Leipsick, éloignés de deux cent quatre-vingts ans de l'édition primitive d'Anvers, que j'ai pris pour base de la mienne, sans m'interdire néanmoins le droit d'y admettre les leçons des annotateurs du seizième siècle, même lorsque Graëfe a jugé à propos de les repousser. J'ai dû ne pas me priver non plus des essais des critiques modernes venus après lui, tels que M. Riegler dans ses Études grammaticales sur Nonnos (55), et surtout M. Koehler dans sa savante analyse des Dionysiaques (56). Leurs corrections, concordant presque toujours avec les miennes, m'imposent l'obligation de parler d'eux avec modestie peut-être, mais toujours avec gratitude. C'est surtout dans mon système de reconstruction, échafaudage dressé pour réparer les lézardes de l'édifice, que je me suis séparé de Graëfe, en prenant à tâche de supprimer les nombreuses lacunes qu'il signale, établit ou laisse subsister. Je ne voudrais pas paraître trop présomptueux en avançant que ma méthode donne au poème de Nonnos une tout autre physionomie, ou du moins une régularité et une cohésion dont il manquait; on en jugera. Mais il est temps d'expliquer en quoi consistent mes procédés.
XXIV.
Mes procédés de correction.
Il doit eu être des Dionysiaques, on me l'accordera facilement, sous le rapport de la conservation matérielle du texte, comme de la Paraprase de l'Évangile. Les deux manuscrits, venus de la même époque, du même pays, de la même ville, du même auteur, peut-être aussi des mêmes copistes, doivent avoir eu une même destinée. Or, si la Paraphrase, commentée et interprétée tant de fois à l'époque de la renaissance italienne des lettres grecques, époque plus naturellement avide des écrits inspirés par la religion chrétienne à son aurore que des derniers accents de sa rivale mourante; si, dis-je, cette Paraphrase si souvent corrigée est pourtant à corriger encore, qu'y a-t-il d'étonnant qu'une production du même auteur, repoussée d'abord en raison de son thème purement mythologique, soit demeurée dans ce costume informe ou négligé d'où sa soeur jumelle, malgré tant de secours, n'a pu tout à fait sortir?
Certes, si j'étais l'érudit que je voudrais être, j'aurais dû, avant de donner une édition d'un poète aussi maltraité que Nonnos, compulser tous ses manuscrits moi-même; voici mes excuses pour m'être dispensé en partie de ce travail : suffiront-elles pour adoucir la colère des critiques, à laquelle, par cette négligence forcée, je nie suis imprudemment exposé?
D'abord, on ne voit aucun vestige de ces manuscrits dans nos bibliothèques de Paris les plus vastes, encore moins dans nos collections de province.
A Florence, distrait par le palais Pitti, la galerie, et peut-être aussi par le Castine, ne prévoyant pas alors ma passion tardive pour les Dionysiaques, je ne songeai pas à demander à la Laurentienne le manuscrit que j'ai déjà décrit. Aurais-je oublié, par hasard, de dire qu'il portait sur sa dernière page, en trois iambes grecs fort incorrects, ceci :
Par grand
bonheur ce manuscrit
Vient d'achever d'être transcrit :
Manuel l'entama ; Maxime de sa main,
Grâce au ciel, en a fait la fin.
Or dans cette inscription finale je n'ai pu voir, comme Bandini, les noms des possesseurs du manuscrit; je maintiens qu'il s'agit de copistes, et de mauvais copistes encore, qui, malgré leurs appellations impériales, ne méritent, pour leur honneur, que l'oubli. Du reste, Bandini affirme que cet exemplaire concorde avec l'édition où Lectius a reproduit lui-même, dans son Corpus des poètes grecs, le volumineux in-12 de 1605. Ainsi l'in-folio de Genève suppléait pour moi ce codex (57).
Quand j'étais à Rome, je m'y occupais bien moins de Nonnos que de l'ambassadeur de France, qui s'appelait alors Chateaubriand ; et je ne traversais le Vatican que pour aller voir dans ce cabinet qui domine la ville éternelle, resplendissant pour toute parure d'un crucifix, le pape si pieux, si spirituel et si habile réformateur qui avait pris le titre de Léon XII. Depuis, pour suppléer à mon incurie, j'ai dû voir, par les yeux éclairés d'un autre, les manuscrits des bibliothèques de la ville sainte et de Naples. Un ami, helléniste exercé, car de nos jours encore, comme au temps de Louis XIII, le gentilhomme, après avoir manié l'épée, sait tenir aussi la plume du voyageur et le crayon de l'archéologue, M. le comte Adolphe de Caraman, le restaurateur ingénieux d'Anet, a bien voulu collationner sur les copies italiennes certains passages les plus mutilés que j'avais signalés à son zèle pour les lettres, et il n'y a recueilli aucune nouvelle version.
Les copies de Venise, de Milan et de Munich répètent exactement la Palatine; et les recherches de d'Anse de Villoison à Weymar ne lui ont révélé que des variantes en très petit nombre, dont Graëfe, avant moi, n'avait pu tirer aucun parti.
Je n'ai pu compulser moi-même que la copie palatine restituée à Heidelberg. C'est donc sur ce manuscrit que je m'arrête un moment ; in quarto voyageur, revêtu d'un vieux maroquin à tranches dorées, écrit sur papier de coton, assez nettement, et portant encore les timbres du Vatican et de Paris, où il a séjourné. Je l'ai lu très attentivement, malgré la méthode qui place chaque distique sur une seule ligne dans les deux colonnes, le second vers en regard du premier, ce qui en rend la lecture très contrariante. Je l'ai scrupuleusement collationné avec le texte de Graëfe, qui dit n'en avoir eu que des communications indirectes, comme avec l'édition princeps d'Anvers, et les deux reproductions qu'en ont données soit Lubinus Eilbartus en 1605-10, soit Lectius à Genève, en 1606. Cette opération longue et difficile, que je regrette de n'avoir pu faire subir aux neuf ou dix copies seules cataloguées en Europe, car j'en comprends toute l'utilité, m'a démontré néanmoins que, pareille aux autres, et sous la même date, celle-ci était un calque très exact des manuscrits de Sambucus et de Philelphe; le calligraphe, quand il se trouve embarrassé, ou qu'il perpétue des ratures, loin de recourir à une autre copie ou d'innover, a soin de dire à la marge, en mauvais latin : sic erat in exemplari mihi communicato. J'y ai relevé seulement un ou deux traits qui ont échappé à la perspicacité de Graëfe ou de ses correspondants. Les yeux de M. E. Miller, bibliothécaire du palais Bourbon, plus clairvoyants que les miens, en ont extrait aussi quelques notes marginales dont il m'a fait profiter. N'a-t-il pas, en outre, et sans prévoir que sa bienveillante expérience viendrait à mon secours, feuilleté en Espagne les quatre copies du seizième siècle, partielles ou totales, que le grec Lascaris a léguées de Messine à l'Escurial, ou qu'Hurtado de Mendoza y a envoyées de Venise ?
Falkenburg ne m'a-t-il pas donné également, dans son édition primitive (hélas ! beaucoup trop fidèle), le manuscrit de Sambucus, inutile maintenant à vienne? Et ne résulte-t-il pas toujours de ses perquisitions et des miennes que les rares copies dispersées en Europe portent toutes à peu près les mêmes imperfections, pour avoir été prises sur un seul et même original ?
A défaut des lumières qui ne peuvent jaillir de ces copies primitives, les seules retrouvées jusqu'à présent, Graëfe m'a fait jouir plus tard tout à mon aise du résumé des travaux de grammaire qui, jusqu'en 1826, se sont accumulés autour de Nonnos.
Sans doute la réforme si pénible du texte grec, bien que je lui aie donné tout l'achèvement dont j'étais capable, n'est pas encore parfaite, et, quand il y a eu tant à rectifier après des hommes tels que Falkenburg, Scaliger et Graëfe, je ne saurais me flatter qu'après moi il ne reste plus rien à faire : mais, si mes leçons nouvelles, si nombreuses qu'elles ne s'élèvent pas à moins de quinze cents, n'ont pas effacé toutes les taches, j'ai du moins indiqué à mes successeurs la base ou la règle qui peuvent servir dans cette difficile opération.
Je pars de ce principe que, bien qu'il affectionne deux ou trois épithètes dont l'acception est de temps en temps obscure pour nous, Nonnos n'a point admis sciemment dans ses vers une proposition dénuée de sens, rarement une répétition de l'expression quand elle n'est pas indispensable à la clarté, et jamais, tranchons le mot, une trivialité ou une ineptie, comme dit Heyne. Je pourrais même affirmer, et ici je ne serais pas le seul de mon avis, que jamais une faute de quantité n'a volontairement fait grincer les cordes de sa lyre. Aussi, pour peu que, dans un hexamètre soumis à mes méditations préalables, j'aie rencontré :
. . Une
voyelle, à courir trop hâtée,
Qui fût d'une voyelle en son chemin heurtée ;
ou, pour parler moins bien mais plus positivement que la périphrase imitative de Boileau, dès que j'ai entrevu l'ombre d'un hiatus, je me suis presque toujours arrêté tout court, et n'ai plus quitté le vers suspect que je n'eusse retrouvé ou hasardé la version qui devait faire disparaître la tache, disons mieux, l'irrégularité inaperçue chez les potes primitifs, mais devenue tache dans les siècles de la décadence. Car je savais que l'élève était bien plus scrupuleux observateur de la prosodie que ses maîtres eux-mêmes, et que, sous ce rapport presque insignifiant, Nonnos l'emportait sur Hésiode comme sur Homère (58).
D'un autre côté, si l'élision venait choquer mes yeux ou mon oreille, je remettais sur l'enclume le vers mal forgé, selon le précepte d'Horace (59) ; enfin quand l'hexamètre m'a paru pécher par défaut d'élégance ou d'euphonie, que les mêmes termes se sont retrouvés dans la même phrase rapprochés sans nécessité les uns des autres, et s'il y a eu insignifiance dans la pensée, inaptitude ou contresens dans l'épithète, je me suis fait une loi de chercher une leçon nouvelle. Car je savais encore que mon poète, imbu des préceptes de l'école d'Alexandrie, et fils d'un siècle où la forme du langage était particulièrement soignée et enrichie, fuyait les répétitions qui déparent le style bien plus encore que l'abondance et les périphrases ne le rendent languissant.
Ainsi, pour ne citer d'un seul coup que trois exemples de ces incorrections entre mille, quand le lecteur verra la nymphe inventrice des guirlandes et de bien d'autres rites mystiques qui ont entraîné de plus graves perturbations chez les érudits, comme on en jugera par mes notes; quand il verra, dis-je, Mystis (liv. XIII, v. 141) qualifiée brusquement du nom inintelligible de mère de Corinthe, au lieu de mère de la guirlande (Κορίνθου pour Κορύμβου); lorsque Silène, loin de défier Apollon, se mettra à célébrer Bacchus (Μελιζομένου Διονύζῳ pour Ἐρίζεται Ἀργυροτόξῳ, ch. X1X, v. 325); puis, quand une flûte dansera sur le sol au lieu d'un berger (ch. XIV, v. 290) ; enfin, quand je prends au hasard ces trois absurdities ( expression employée vis-à-vis de moi par certains Écossais en pareille occurrence (60), mais qui n'est guère chez eux plus polie que chez nous), et que ces absurdités du texte primitif sont scrupuleusement conservées dans la dernière édition de Graëfe, est-ce la faute de Nonnos, et faut-il que sa réputation pâtisse à jamais et sans vengeur de l'insouciance des glossateurs ou de la négligence des protes?
Que si moi-même, plus obstiné que mes prédécesseurs, peut-être parce que j'ai profité de leurs premiers travaux, lassé néanmoins comme eux de chercher inutilement la clef d'une énigme fruit d'une erreur d'écriture, j'ai admis une ou deux fois seulement, si j'ai bonne mémoire, on équivalent satisfaisant à moitié, accuserons-nous d'abus de langage, de confusion ou d'imbécillité l'un des écrivains les plus spirituels du quatrième siècle, trop escorté peut-être d'épithètes, mais pourtant d'épithètes toujours significatives? Si donc j'ai renchéri sur les corrections de l'édition de Leipzick, et si, loin des manuscrits, je le répète, j'ai surchargé d'un grand nombre de rectifications les verbes, substantifs, et adjectifs principalement du texte grec, c'est que, pour élever jusqu'au faite cet édifice dont on avait à peine construit le premier étage, j'ai été presque toujours dirigé par une certaine habitude des allures de Nonnos, que les méditations inséparables d'une traduction exacte ont dû me rendre familière; ensuite par le bon sens, car je ne pouvais supposer que le poète d'une époque si spirituelle eût fréquemment et de gaieté de coeur, pour ainsi dire, péché contre les règles; parfois aussi, l'avouerai-je? je me suis laissé guider dans ces corrections par une sorte d'instinct et de sentiment dont j'aurais peine à me donner à moi-même la raison.
XXV.
Lacunes. Intervenions.
Je ne crois pas non plus Nonnos coupable des lacunes que Graëfe a introduites fréquemment pour subvenir à ses embarras; et je n'ai pu me résoudre à en laisser subsister une seule dans mon texte. Je peux bien croire parfois qu'il y a eu désordre, transversion, si l'on veut, mais jamais lacune, ni vers restés inachevés, comme dans l'Énéide. Le copiste maladroit a brouillé le texte, mais il n'a pas omis ; et ces vers que Graëfe a remplacés par des points on par des astérisques, je les ai toujours retrouvés avant ou après, dans le même chant ou dans les chants voisins, sans recourir à l'insuffisante ressource des vers ou des hémistiches supplétifs.
Les lacunes, sans doute, ne sont pas toujours invraisemblables dans les manuscrits grecs, et il faut chez le correcteur presque autant de perspicacité pour les découvrir que d'art pour y remédier. Mais ici elles m'ont paru hors de saison; et les trois premiers livres comme les deux derniers n'en ayant pas signalé une seule, on pourrait en conclure que Graëfe et Falkenburg ont pris pour des lacunes les négligences de copistes moins exercés que ceux du début et de la fin. D'ailleurs cette lacune, supposant une connexion entre le fragment prétendu et la pensée du critique, plus qu'avec celle du poète, ne saurait être mise en avant qu'en désespoir de cause ; et l'on doit se défier du penchant trop naturel de trancher les difficultés sans les résoudre, et de substituer sa propre manière à celle de l'auteur.
An reste, le caractère de la poésie nonnique, ou plutôt la mémoire du poète me semble avoir souffert plus encore des interversions du manuscrit que de ses autres incorrections, si nombreuses pourtant ; c'est principalement, j'en suis plus que jamais convaincu, aux transpositions d'un texte mal transcrit, si communes dans les chants intermédiaires, que Nonnos doit sa réputation de ressasseur, terme expressif inventé par d'Alembert, mais nullement à l'occasion de notre poète, qu'il n'avait pas lu. On va me comprendre.
Quand, par exemple, le trait final d'une des harangues se trouve placé au centre de l'allocution, la série toujours si prolongée chez Nonnos des images et des allusions mythologiques, laquelle paraissait terminée quand elle n'est que maladroitement interrompue, semble recommencer; et le raisonnement reste en l'air privé de toute conclusion. Or ces étourderies du copiste deviennent, aux yeux des aristarques, un vice habituel de style chez un auteur dont ils ont souvent, à bon droit, blâmé l'abondance et le manque de sobriété.
Qu'on se figure le quatrième livre de l'Énéide interverti de la même façon. Les fragments des pudiques aveux de Didon mêlés à ses passionnés emportements ou à ses touchants adieux, les plaintes d'Iarbas confondues avec les exhortations de Mercure ; dès lors, on en conviendra, l'admirable drame va mériter les plus justes critiques; le goût de Virgile paraîtra suspect, et son génie recevra une première atteinte, que ce même procédé, s'il se renouvelle dans les autres chants, aura bientôt transformé en négligence de manière et en décousu de composition.
Je le demande, quel chef-d'oeuvre ou quelle renommée de poète résisteraient à de tels outrages? Et voilà pourtant, sur les marches inférieures du temple dont le prince des poètes latins occupe le sanctuaire, ce qui advient à Nonnos. Or l'Égyptien est d'autant plus soupçonné de ces mauvaises habitudes que les retours et la superfétation des paroles descriptives rentrent dans les défauts familiers aux écrivains de son siècle. Mais que l'on n'exige pas de moi une démonstration catégorique de la manière dont l'interversion a dû s'opérer, ni que j'explique par quel genre de négligence les vers se sont égarés sous la main du copiste. Quand des distiques et même des paragraphes entiers, une fois rétablis à l'endroit que je leur ai assigné sans les altérer jamais, présentent un sens naturel, un ordre d'idées continu et satisfaisant, cela me suffit, je n'en veux pas davantage, et ne vais rien chercher au delà.
Ainsi, lorsque dans une longue narration, je le dis encore une fois pour mieux manifester ma pensée, la réflexion ou l'idée dont le poète a voulu marquer et sceller la fin se rencontrent à l'exorde; quand, en outre, la partie animée du discours ou le paragraphe interrogatif se trouve scindé en deux tronçons par une autre suite de raisonnements, il est évident que cette rabâcherie, comme disait J. J. Rousseau, peut lasser la patience; et qu'alors l'auteur, déjà chargé du fardeau de ses propres faiblesses, succombe sous le poids des fautes du scribe, dont il devient solidaire auprès des lecteurs.
J'ai donc dû consacrer une grande portion du temps que je vouais aux Dionysiaques à ce classement du texte, pour lequel mes scrupules de traducteur consciencieux m'étaient d'un véritable secours. Ces deux labeurs, allant d'un même pas, marchaient de front pour ainsi dire; et, après m'être livré ardemment au métier de redresseur de mots et de rajusteur de phrases, je n'ai pas voulu laisser aux hellénistes qui viendront après moi cette tâche à recommencer. Je me suis donc bravement déterminé à donner moi-même une édition grecque, en la faisant suivre du tableau complet de mes corrections et de leurs principaux motifs, comme de la méthode que j'ai suivie. Cette forêt obscure et touffue que le premier éditeur avait trop scrupuleusement respectée, dont les critiques du seizième siècle avaient dégagé quelques abords, et qu'au dix-neuvième le dernier éditeur avait nettoyé de ses ronces, j'y ai mis la cognée à mon tour, et je l'ai éclaircie pour tenter d'y ramener la lumière et la vie. Or j'ai dû lutter d'autant plus obstinément contre cette imperfection du texte que c'est là l'écueil dont je redoute par-dessus tout le péril, et contre lequel il est probablement dans ma destinée de faire naufrage; car c'est aussi de là que vient cette fatale prévention contre Nonnos et ce stigmate de médiocrité qu'on lui a infligé jadis, sans jamais tenter sérieusement de réviser ni son texte ni une telle sentence. Pour combattre ces préjugés séculaires, je n'exige pas de mes lecteurs qu'ils me sachent gré de tous mes soins à poser des appareils sur tant de blessures, à réparer et à enduire d'un vernis nouveau ces tableaux poudreux : je demande simplement qu'au lieu de feuilleter des vers méconnaissables dans les premières éditions, et accablés sous le dédain de trois siècles, on les lise attentivement dans le texte tel que je l'ai reconstruit à l'aide de ses propres matériaux, et comme s'il venait d'échapper sous cette nouvelle forme aux tas des parchemins vermoulus du mont Athos.
XXVI.
Révision du texte. Ma traduction.
Je termine par quelques dernières considérations cette préface où j'ai entrelacé ce que je savais depuis longtemps sur le compte du poète de Panopolis avec ce que j'en ai appris depuis peu. Et tout d'abord je dis encore que, si j'ai poussé plus avant que mes devanciers ma révision du texte des Dionysiaques, je le dois surtout à la mission que je m'étais imposée de les traduire. Or il n'en est pas d'une traduction comme d'une lecture, même la plus réfléchie. Il peut arriver que, par impatience, par distraction, par ennui peut-être, le lecteur, même le plus bénévole, passe par-dessus certaines longueurs ou obscurités; et il n'est personne qui n'ait, en certains cas, sans malice et presque involontairement, avancé le signet et oublié de le faire rétrograder ensuite. Un traducteur est bien autrement gêné dans ses allures; il doit se rendre compte de toute chose, lire et relire sans cesse pour cet effet ; tendre sans relâche son attention ; car il lui faut tout approfondir et tout soumettre au creuset de sa propre intelligence, chargée d'éclairer celle des autres. L'un abandonne sans remords à ses ténèbres l'endroit mal arrangé, surtout quand il s'agit d'un écrivain du second ordre; mais l'autre est à l'affût des difficultés, s'y arrête sans s'en irriter jamais, car le dépit les redouble; enfin il lutte flegmatiquement mais intrépidement contre elles, puisqu'il s'est prescrit le rigoureux devoir de les surmonter.
Mais pourquoi, me dira-t-on, ne pas vous attacher de préférence aux chefs-d'oeuvre, et, avant tout, à l'éternel modèle, Homère, que, dans vos voyages et dans vos précédents écrits, vous avez si souvent rapproché vous-même de la nature qui l'inspira ?
Ah ! Homère ! Homère ! Mais d'abord, s'il est encore le plus grand des poètes, il n'est plus modèle. Ensuite Homère, ne l'oubliez pas, est et restera intraduisible en vers comme en prose français ; et c'est là faute de notre langue. Hyperbolique, dégénérée, elle est impuissante à exprimer la divine simplicité du grec primitif. Elle se prête mieux aux façons du grec précieux, raffiné, épuré jusqu'à l'exagération. Elle rendra bien plus fidèlement les vers contournés et antithétiques d'un poète plus éloigné de la nature; notre décadence s'accommode de la sienne... J'en ai conclu que je pouvais lutter en français contre ce poète grec, déjà un peu français en Égypte, et qu'en allant le chercher dans son siècle pour le faire redescendre dans le nôtre, je ne l'exposais pas à perdre sa physionomie dans le cours d'un trop long voyage.
Je le déclare, effrayé d'abord moi-même de ma propre témérité et de la longueur de l'oeuvre, j'avais voulu ne donner que des extraits de Nonnos, arracher ainsi à l'oubli ce que les siècles passés lui ont reconnu de valeur, ou ce qui me paraissait avoir des droits incontestables à survivre, enfin procurer à mes lecteurs le plaisir de juger, dégagé de la peine de choisir. Mais j'ai réfléchi que les Dionysiaques n'avaient encore été traduites en entier dans aucune langue vivante, car leur travestissement en gaulois, opéré par Boitet, n'est pas une traduction sérieuse ; et il est advenu que moi-même, dans mon travail assidu à séparer le bon du médiocre, je me suis trouvé conduit insensiblement jusqu'au bout, en passant d'un chant à l'autre, pour la clarté et la facilité de ma critique, quand je n'avais songé, dans l'origine, qu'à en extraire des fragments et à les écrémer en quelque sorte.
Aurais-je besoin d'expliquer aussi pourquoi la pensée ne m'est pas venue de traduire en vers les Dionysiaques? C'est que d'abord l'entreprise eût été au-dessus de mon pouvoir; ensuite, il faut bien le dire, la condition de ces vingt-deux mille hexamètres, plus érudits et descriptifs peut-être que dramatiques, justifie mieux encore l'emploi de la prose, tout à fait forcé pour mon compte. Hélas ! Nonnos n'est pas un Homère, pour faire naître ou grandir à son ombre des Pope et des Voss ! Serait-il vrai, d'un autre côté, que, pour faire goûter quelque chose du génie des poètes antiques, la prose fût préférable aux vers? En tout cas, cette proposition, que je ne nommerai point un paradoxe, a été soutenue récemment et gagne chaque jour des partisans nouveaux.
J'aurais pu sans doute rivaliser avec Lubinus Eilhartus dans une traduction latine moins subversive de l'original, et j'aurais peut-être cédé à cette tentation plus favorable à ma paresse, si elle ne m'eût évidemment éloigné de mon but ; car ce n'est pas seulement une explication continue du sens des Dionysiaques que j'ai voulu donner; c'est aussi et principalement une image fidèle de leur style. L'interprétation ad verbum n'y pouvait rien, pas plus que les exactes versions des traducteurs latins d'Homère ne réfléchissent les beautés de l'Iliade et de l'Odyssée.
J'ai donc cru que le latin, langage commun à la littérature et à la science dans le siècle où Nonnos a été livré à la typographie, n'était plus aujourd'hui que le dialecte d'un petit nombre d'érudits. Il m'a semblé que le français, par son universalité, ayant usurpé la plupart des fonctions de l'idiome dont il dérive, c'était en français qu'il fallait traduire directement et sans ricochet le poème grec; car enfin ce ne pourrait être un obstacle à sa diffusion en Europe, pas même dans ce pays, qui n'est pas le nôtre, où le latin a conservé le plus de prérogatives et d'autorité.
« La langue française, » me disait mon ami M. Michaud, l'historien des croisades, « est devenue en Europe la langue de la bonne compagnie. » N'est-ce pas dire qu'elle doit être la langue favorite des littérateurs?
Ce que j'ai ambitionné, j'en conviens, c'est que ce même Nonnos, qui comptait pour si peu dans les études antiques, et dont les plus intrépides scoliastes osaient seuls souder les profondeurs, ouvrit à son tour une source féconde et accessible de notions en mythologie ou même en linguistique, et devint désormais l'un des lexiques obligés des antiquaires ou des philologues. Encore un coup, je suis loin de vouloir qu'on me tienne compte de toute la peine que j'ai prise à corriger, coordonner le texte du poème et à le comprendre d'un bout à l'autre; je sollicite pour tout dédommagement, je le répète, qu'on le juge comme si, tel que je le représente dégagé de ses ténèbres et de ses souillures, il était sorti hier des ruines de la Grèce ou même des décombres de Panopolis.
XXVII.
Méthode suivie dans la traduction.
Mais, de grâce, que l'on ne vienne pas m'accuser d'avoir, pour la bonté de ma cause, afin d'affaiblir l'attaque et de prévenir la critique, raccourci les longueurs, limé les aspérités, dissimulé l'antithèse, escamoté le jeu de mots. Je me suis, bien an contraire, assujetti à les reproduire dans toute leur crudité, et à calquer la pensée et l'expression aussi exactement que la clarté, premier devoir du traducteur, le permettait, afin que le lecteur fût à même déjuger par son propre discernement et sans recourir au texte grec des défauts on des qualités du poète.
Or, si je venais à succomber sons une telle tâche, souffrira-t-on que je m'en excuse d'avance? et voudra-t-on reconnaître que, tandis que mes contemporains, mes rivaux en interprétation des poèmes de l'antique Grèce, ont eu, pour les soutenir dans l'accomplissement de leur labeur, de nombreuses traductions antérieures plus on moins secourables, dans toutes les langues de l'Europe, et, mieux encore, les gloses accumulées des plus habiles philologues, je n'ai eu, pour ma part, qu'un seul mot-à-mot latin, inepte, plat, surchargé de contresens, et son raccourci en gaulois, dénués l'un et l'autre de tout commentaire; de telle sorte que les inexactitudes de ma version, seraient toutes à mon compte, sans qu'il me fût loisible d'en rejeter la faute sur personne. Ne me devrait-on pas une indulgence plus prononcée en raison de ces défavorables antécédents?
Bref, et c'est la dernière objection que je soulève ainsi contre moi-même, votre style, me dira-t-on, n'est pas assez constamment épique, et n'est pas toujours assez sérieux. Vous avez l'air de ne pas prendre en grande considération les prodiges de Bacchus. S'il était vrai, répondrais-je, je me croirais en cela, une fois de plus, au niveau de mon auteur. Car ce n'est pas ici un Homère imbu de la sainteté de sa mythologie et enthousiaste de son Olympe : ce n'est pas un Pindare, fanatique croyant en ses religieuses allégories : c'est an païen an bord du christianisme, sans foi dans les miracles bachiques, et dont le récit, je viens de le dire, ne saurait être mieux comparé, pour l'élégance ou la longueur, pour le ton comi-tragique et sérieux à demi, qu'à l'Arioste. Ah! que n'a-t-il les antres qua¬lités du chantre de Roland !
XXVIII.
Mes remarques générales. Notes séparées sur les corrections du texte. — Index.
Cependant le reproche ne me paraît pas tout a fait dénué de justesse, et je pourrais convenir, en effet, que je n'ai pas toujours dans mes notes, et peut-être même dans cette préface, qu'il est bien temps d'achever, gardé la dignité du traducteur, renfoncé le sourire qui arrivait sur mes lèvres, repoussé la légèreté de l'homme superficiel, et que je ne me suis pas constamment refusé l'arme on le jouet de l'ironie en matière de mythologie on d'érudition, peut-être pour mieux déguiser mon insuffisance. Mais ces notes, faut il le dire? ont été mon encouragement ou ma consolation dans ma longue épreuve. Je ne pouvais me pardonner de passer autant de temps à scander des vers d'une langue morte, ou à ruminer les pensées d'autrui, qu'en faveur des remarques où j'allais donner toute carrière à ma fantaisie, ou du moins à ma mémoire : aussi, dès qu'un nom propre, une désignation locale, une allusion de la Fable, sont venus frapper la touche du clavier, j'en ai laissé la corde vibrer longtemps, trop longtemps peut-être; or, pour prévenir les attaques contre ma prolixité, je rappelle qu'il a toujours fallu une certaine étude pour entendre les auteurs grecs et même latins, à plus forte raison pour traduire Nonnos, dont je ne puis mieux comparer l'érudition qu'à celle de Properce. J'ai, je le confesse, visé plus haut que l'interprétation de ses obscurités mythologiques; et j'ai voulu, autant qu'il était en moi, faire juges de son mérite épique et de son imagination tous ceux qui, sachant le français, peuvent avoir oublié le latin ou le grec. Je me suis donc vu entraîné à donner à mes observations techniques un grand développement. Quant à mes réminiscences orientales, si je les explique, je ne les justifie pas ; je prie seulement mes lecteurs de me les pardonner.
Oui, si j'ai mêlé à mes dissertations philologiques mes aperçus de voyageur, si j'ai mis le récit de mes pérégrinations sous la protection de la marche triomphale des armées de Bacchus, sur ce point je ne saurais me défendre qu'en invoquant l'un des plus invincibles défauts de mon âge, le désir de se reporter vers le passé quand le présent échappe, et de rappeler les jours de l'active jeunesse, quand on n'a plus devant soi que le déclin et l'inaction.
Ainsi donc, quant au texte, je ne puis me reconnaître, dans mon interprétation, coupable d'atténuation ni de redites : je l'ai sans cesse très scrupuleusement côtoyé. Mais si, dans les considérations qui en forment la suite et l'accessoire, j'ai vogué en pleine mer et affronté les orages de la critique ; si j'ai usé et abusé peut-être des facilités de digression que semblait mettre à ma portée ce poème tout rempli de légendes et d'allusions levantines; si, le nom d'une ville on d'un héros rouvrant tout à coup la source de mes impressions classiques, je m'y sois abandonné sans songer à mal; je n'ai pas, je le répète, l'intention de les excuser : le crime est entièrement prémédité. J'ai espéré que le lecteur ne se plaindrait pas de ces innocentes récréations qui se produisent de temps en temps pour le distraire. J'ai cru que la monotonie des accords épiques, résonnant pendant la durée de quarante-huit chants consécutifs, pourrait être ainsi favorablement suspendue ou dissimulée; et que moi-même enfin, après avoir si longuement chanté sur les cordes de la lyre, j'avais acquis le droit d'errer autour de mon sujet, et de parler plus bas.
On remarquera néanmoins que si, dans ces notes, qui m'ont coûté trop d'études pour ne pas sembler peut-être trop étudiées (on voit que le penchant de mon auteur pour les jeux de mots me gagne), quand il m'aurait fallu sans doute une érudition bien précise et bien plus profonde pour éviter toute apparence de pédantisme; si dans ces notes, dis-je, afin de débrouiller le texte et de varier la critique, j'ai cru devoir entasser les notions mythologiques et géographiques de l'antiquité, les citations des historiens, les rapprochements des poètes grecs, latins ou modernes, et les jugements des philologues, j'en ai du moins retranché presque toujours les explications spéciales sur ma révision du texte grec, puisque j'en ai présenté séparément le tableau aussi fastidieux que nécessaire. De sorte que si, d'un côté, dans cette élaboration préliminaire des corrections que j'ai placées le plus loin possible des yeux du lecteur, j'ai dû m'astreindre à parcourir le cercle entier des minuties grammaticales, et à faire la guerre aux syllabes et aux virgules ; de l'autre, j'en ai eu l'esprit d'autant plus libre dans mes remarques, reléguées à la fin de chaque chant, pour secouer tout à fait la poussière de l'école, pour donner carrière à mes digressions, enfin pour mettre en relief les procédés poétiques de l'écrivain, comme le génie de l'antiquité.
Dans cette double opération, j'ai cherché, je l'avoue, à ressusciter le commentaire, bien qu'il ne soit plus de mode; le commentaire que, sans croire déroger, les plus grands esprits du seizième siècle ont pratiqué avec tant de succès; le commentaire, ce père de la critique, que sa fille a étouffé ; ce guide précieux de la littérature, qui tient si peu de place chez nous, soit que notre vanité nous porte à ne pas nous arrêter longtemps sur la pensée ou les procédés d'autrui, soit qu'il exige une patience ou des recherches dont nos habitudes de composition nous éloignent, quand le génie de notre langue pourrait les rendre si profitables et si claires, soit enfin parce qu'il en résulte un mérite modeste, une gloire secondaire, pour ainsi dire, quand nous ambitionnons toujours les premiers honneurs, et que nous ne nous contentons plus du péristyle d'un temple dont les abords sont assiégés de toutes parts et le sanctuaire rempli.
En dernière tâche, et ce n'est pas la moins pénible, pour ces notions si multipliées et si diverses, il fallait un fil qui empêchât de s'égarer dans un tel labyrinthe, ou plutôt un signal qui appelât l'attention sur chaque point d'archéologie et de critique, traité dans le poème ou développé dans la glose. Pour cet effet, j'ai dressé aussi exactement qu'il m'a été possible un Index de l'ouvrage, et je me persuade qu'il présente ainsi, en même temps que la quintessence des Dionysiaques, une sorte de dictionnaire abrégé de la Fable, à l'usage des littérateurs et surtout des poètes.
XXIX.
Poètes contemporains de Nonnos : Coluthus, Tryphiodore, Jean de Gaza, Mutée, Cointos de Smjrrne, Poètes de l'Anthologie . Claudien, Ausone.
Mais quand, par une défiance toute naturelle de moi-même, dont l'inconvénient néanmoins ne devrait pas rejaillir jusqu'à Nonnos, je décline la tâche de prononcer, dans un paragraphe raisonné et distinct, ma propre sentence sur le poète que je traduis ; si je me dérobe à l'ombre des jugements et de la critique, dont les pages précédentes reflètent suffisamment les clartés; si enfin je me décharge ainsi sur le lecteur de cette partie de mes obligations, je ne puis me soustraire aussi hardiment à un autre usage encore mieux établi. La coutume qui régit les préfaces veut que tout traducteur sérieux s'y livre à des comparaisons suivies entre son auteur et les œuvres du même genre et du même âge. Mais ici même, il est aisé de le voir, je ne saurais me soumettre tout à fait à ces exigences : comment tracer autour d'un écrivain dont l'époque est si peu précise, un cercle exact de contemporanéité (61)? et ne dois-je pas en éliminer tout d'abord Coluthus, qui, sans contestation, a vécu un siècle après Nonnos, et Tryphiodore, dont la naissance indécise lui est aussi néanmoins, selon Hermann, très postérieure?
L'un, Coluthus, né à Lycopolis, la Siout moderne, dont j'ai vu les palmiers immenses se réfléchir dans les ondes du Nil, part de l'Égypte à la tête de trois cent quatre-vingt-cinq vers pour enlever Hélène ; et il n'a conquis, même aux yeux de ses épurateurs, que la réputation d'un faible imitateur d'Homère et d'un médiocre disciple de Nonnos (62). Or, si les savants efforts de M. Stanislas Julien n'ont pu tout à fait sauver de l'oubli le disciple, j'ai fort à craindre que le maître ne disparaisse aussi sans laisser plus de traces, malgré toutes mes tentatives pour le rajeunir.
L'autre, Tryphiodore, échappé de je ne sais quelle contrée inconnue, mais toujours Égyptien, en renversant Ilion à l'aide de six cent soixante-dix-sept hexamètres, n'a donné qu'une froide esquisse des merveilleux tableaux du second livre de l'Énéide; analyse décolorée, que le mérite d'une diction harmonieuse a seul préservée du temps.
Il me faut mettre de côté Jean de Gaza, imprimé pour la première fois au début du dix-huitième siècle, plagiaire effronté de Nonnos. (Ses vers, qui, au nombre de sept cent un, décrivent une carte cosmographique d'Antioche, nous ont été révélés par Rutgers (63), et n'ont laissé que bien peu de trace dans le souvenir des plus opiniâtres hellénistes.
Mais si ces trois poètes, épiques à demi, venus longtemps après Nonnos et ses zélateurs, ont pris à tâche de lui dérober certaines épithètes, un plus grand nombre de tournures de phrase, ou même, de temps en temps, un hémistiche, Musée, qui paraît être son contemporain, lui a emprunté aussi quelques images et jusqu'à des vers complets. Or cette dernière considération suffirait seule pour trancher le différend qui s'est élevé entre les commentateurs jaloux de déterminer les relations respectives et personnelles de l'un avec l'autre : car jamais Nonnos, pour son compte, n'emprunta un vers entier à d'autres qu'à Homère. La plupart des philologues ont fait du poète de Panopolis le précepteur du chantre d'Héro, et Bernardhy intitule expressément celui-ci « le plus heureux imitateur de Nonnos (64). » Un seul s'est rencontré (65) qui, renversant cet ordre naturel, fait de Musée le professeur, tandis qu'un autre, plus téméraire encore, a voulu que Musée fut Nonnos lui-même (66), mais Nonnos, ajoute un troisième, guéri d'une surabondance de style peu réfléchie, et revenu à un goût meilleur (67).
Je conviendrai sans peine, à mon tour, qu'aidé par le choix d'un sujet plus restreint et plus émouvant, Musée a déployé plus de sensibilité et de grâce sous des teintes souvent vraies, parfois exagérées ; mais, dans ce poème, qui égale tout au plus l'importance d'un épisode des Dionysiaques, je ne puis avouer qu'il a dépassé Nonnos et les chants nombreux où celui-ci laisse dominer la passion ; et je maintiens, en tout état de cause, que l'Égyptien l'emporte toujours par son harmonieuse flexibilité. Quant au talent de l'invention, ce point n'est douteux pour personne : je n'ai nul besoin, ce me semble, pour démontrer la supériorité de mon auteur, de recourir à son esprit foudroyant et sublime (68), expression sous laquelle j'ai eu peine a reconnaître les traits caractéristiques de Nonnos; et cependant ces termes sont consignés et répétés sans hésitation dans la préface d'un docte commentateur de Musée, lequel, certes, ne se montre pas ailleurs partisan fanatique du poète égyptien. Serait-ce donc qu'il aurait lu ou apprécié seulement les deux premiers chants des Dionysiaques, où la scène se passe effectivement au sein des airs, au milieu des éclats de la foudre et des roulements du tonnerre?
Quoi qu'il en soit, l'élève devait être plus heureux que le maître auprès de la postérité. Les plus célèbres poètes du siècle qui vit la renaissance de Musée l'accueillirent avec pompe et lui firent cortège. Boscan, qui venait de remanier le système de la métrique espagnole, et de créer ou de perfectionner du moins, pour la patrie des vieilles romances, le vers endécasyllabique, en charma la cour de Charles-Quint.
Ah! pourrais-je oublier Boscan ? N'est-ce pas loi qui m'a révélé le poème de Musée bien avant que la langue grecque m'eût dit assez de secrets pour le lire sous sa forme originelle ; ce Boscan, qui me suivait au bord des ruisseaux, toujours uni a Garcilasse, lorsque, dans mes rêves juvéniles, j'invoquais pour tout avenir un voyage aux terres orientales. Initié, presque enfant, à l'idiome sonore qui règne au delà des Pyrénées, et dont le dialecte gascon, le premier que j'aie balbutié, est le frère comme le voisin, je ne quittais les plaintes pastorales de Nemoroso que pour jeter aux échos de ma vallée les soupirs de l'intrépide nageur de Sestos. Savais-je alors que mon cœur allait bientôt battre sur la rive où fut la tour d'Héro, et que j'entendrais bruire les flots de l'Hellespont, où mourut Léandre?
Plus tard, je devais retrouver la triste aventure sur les rives de l'Arno, quand un petit volume, étalé sous les portiques de la galerie de Florence, me la montrait retracée dans les stances italiennes de Bernardo Tasso, le père du chantre divin de Jérusalem.
Enfin Clément Marot, dans son style naïf, leur donna la rime gauloise, et fit verser les larmes de François 1er et de sa cour galante sur ces amours imaginaires.
Rien ne devait manquer à Musée, pas même l'étrange honneur qu'il partagea avec Virgile des travestissements burlesques de Scarron. Ce rimeur facile et hardi, riant de tout, même de sa femme qu'un heureux veuvage allait élever aux plus hautes destinées, voulut aussi rire de la triste Héro, comme il avait ri de l'infortunée Didon.
Et, pendant ces triomphes de son disciple, Nonnos dédaigné, incompris, languissait rongé des vers sous la poudre; et maintenant encore, puni pour mon peu de génie (caret quia vate sacro), il attend tristement que ma modeste prose essaye d'entrouvrir pour lui la porte du monde littéraire. Dans ce tableau raccourci de l'école de Nonnos, mes lecteurs auront peut-être remarqué d'eux-mêmes que la plupart des poètes héroïques grecs de la dernière époque étaient égyptiens, et appartenaient à la haute Égypte, comme si la vie extatique des ascètes de la Thébaïde voisine leur eût communiqué l'exaltation de la pensée et l'habitude de la méditation. Ils y mêlaient, il est vrai, tout ce que l'éducation et les connaissances acquises à Alexandrie pouvaient y ajouter de réel. C'est ainsi sans doute que l'intérêt se porta sur les faits et gestes de Bacchus, le dieu dithyrambique, le père de l'enthousiasme, parce qu'ils rappelaient les conquêtes si populaires en Grèce, et même en Égypte, d'Alexandre le Grand.
J'arrive enfin à Quintus de Smyrne, qui figure bien ici, et sans jeu de mots, le cinquième parmi les poètes dont j'entrelace la couronne autour de la tête de Nonnos. Il fut trouvé en Calabre accolé à Tryphiodore et à Coluthus, soit que la nature du sujet, soit qu'on caprice du copiste eussent cimenté leur alliance, bien plus qu'une date chronologique ou même une analogie de style. Quintus, de plus que ses deux collègues, rapporta du monastère où ils gisaient enfouis le surnom de Calaber, joint à sa désignation latine, qu'on imagina dans le but de dissimuler l'appellation mal déterminée de Coïntos, et dans l'embarras où l'on était d'en inventer une autre. J'ajoute aussi, par suite de cette guerre acharnée que le seizième siècle faisait aux noms propres grecs pour les convertir en us; hostilités déclarées sur toute la ligne, dont Nonnos a eu tant à souffrir pour son propre compte.
Les quatorze livres des Paralipomènes de Coïntos, supplément, si l'on n'aime mieux dire rebuts d'Homère, ne se rapprochent des Dionysiaques que par leur volume et le nombre des vers, triples pourtant de notre côté. Cette seconde Iliade affecte toutes les allures de la première, et copie même les irrégularités du rythme, telles que l'hiatus et le vers spondaïque, que Nonnos, protecteur déclaré du dactyle, a toujours si scrupuleusement évités, « Coïntos, » dit M. Tourlet, » a de la noblesse, du feu, de l'enthousiasme et du génie; il règne dans l'ouvrage un goût sain, une touche nerveuse, un ton vraiment épique (69). »
Je me garderai bien assurément de rien ôter à cet engouement d'un traducteur, de peur qu'on ne vienne à m'accuser plus tard d'un travers tout semblable en ma propre cause. Mais, jalousie de métier à part, Nonnos m'a toujours semblé plus correct, plus élégant, plus mélodieux, surtout moins servile copiste des expressions homériques que Coïntos, dont la simplicité, en travaillant à se rendre primitive, n'a pu s'exercer dans le quatrième siècle, sans paraître souvent dure, raboteuse, et trop empreinte d'archaïsme. Je ne ferme point cependant les yeux, par une sorte d'opposition systématique, au mérite spécial de ce continuateur de l'Iliade, qui, sans préambule, sans invocation à la Muse, sans exposition de son sujet, tous accompagnements obligés de l'épopée, prend le récit où Homère l'a laissé, comme Mafféo Vegio, l'Italien, a allongé l'Énéide, et Th. May, l'Anglais, la Pharsale. Je conviais que la diction de Coïntos est parfois énergique, ornée même, et je reconnais qu'il a do moins un certain avantage sur le poète que je croit son prédécesseur, dans les comparaisons, charme et diversion de l'épopée, qu'il prodigue, tandis que l'auteur des Dionysiaques les a beaucoup trop ménagées, à mon sens.
Faut-il l'avouer et risquer le paradoxe? de tous les écrivains issus de l'école poétique d'Alexandrie à sa seconde époque, celui qui ma semble le plus incontestablement rapproché de Nonnos par l'âge, comme par les manières, les vertus ou les vices du style, c'est Claudien: mais, comme les œuvres qui nous restent de loi sont presque exclusivement latines, je n'ai que peu de choses à en dire ici, si ce n'est pour regretter ses descriptions en vers grecs de Nicée et de Béryte. Si elles nous étaient parvenues, elles auraient pu, ne fût-ce que par la confrontation, jeter quelques lumières sur la date des Dionysiaques, où sont traités les mêmes sujets. Je ferai observer seulement que les parures exotiques dont certains Aristarques lui reprochent la profusion, peu convenable, disent-ils, au dialecte latin, se trouvent mieux placées dans l'idiome hellénique, car l'ampleur orientale se prête à toute l'abondance des images. Claudien et Nonnos ont cherché l'un et l'autre à rehausser par la richesse des couleurs, et des expressions trop constamment élevées pour n'être pas outrées quelquefois, les thèmes de la politique ou de la Fable. Tous les deux, trop partisans d'une fausse grandeur, sous une diction facile et harmonieuse, mais parfois monotone, ont développé jusqu'à l'excès la fantaisie d'un esprit orné, fécond, avec plus d'énergie, de verve et de prétention au sublime chez le Latin, avec plus de douceur, de sentiments et d'abus de langage chez le Grec. Je ne sais ce que l'avenir réserve à Nonnos, s'il parvient jamais à être lu attentivement; mais certes ce n'est pas un mérite médiocre pour Claudien, originaire de l'Égypte, d'avoir su manier une langue étrangère de façon à se faire un nom parmi les poètes héroïques de Rome, trois siècles après Stace, le dernier d'entre eux, et d'avoir obtenu qu'une statue dressée dans le Forum de Trajan, par un sénat même servile, ait perpétué sa mémoire.
Après Claudien, on pourrait encore citer Ausone parmi les contemporains de Nonnos, plutôt pour ne rien omettre que pour les comparer. Ausone a certes autant d'érudition et d'esprit que le poète de Panopolis ; mais cet esprit tient beaucoup plus des saillies attribuées vulgairement à l'influence des rives de la Garonne où il était né, que des bords du Nil où semblait s'être réfugiée l'intelligence, fuyant devant l'invasion des Visigoths. Cependant, si mon compatriote n'était parfois obscur, j'aimerais à lui faire hommage de cette remarque de Cicéron : « La négligence d'un écrivain qui est en travail des choses plus que des mots, ne manque pas de grâce (70). » Son style est tourmenté, difficile, et de temps en temps dur autant que celui de Nonnos est harmonieux et coulant. Ils ont cela de commun, qu'on peut douter de l'un et de l'autre s'ils étaient chrétiens. En ce qui touche Ausone, on l'affirmerait quand on lit ses éphémérides, on pourrait le nier quand on parcourt ses épigrammes et ses centons. Mais, sur ce point, pour nos deux poètes tout est conjecture ; et quand à cette même époque tant de ténèbres recouvrent pour nous cet Occident où arrivait la lumière, faut-il s'étonner qu'on ignore ce qui se passait à la limite de l'Éthiopie d'où elle allait se retirer? Pour tout concilier, il y aurait lieu de croire que, comme Nonuos, Ausone fut, suivant l'expression de saint Grégoire de Naxianze, «» engagé d'abord dans les voies de l'erreur, puis disciple fidèle et zélé du Christ (71).» Et à cette époque, comme dans les révolutions qui l'ont suivie, il en fut ainsi de beaucoup d'hommes de cœur et de talent, qui demandèrent à la seule religion consolatrice un abri contre les désordres et l'avilissement de leur siècle, et qui, après avoir été païens ou esprits forts, termes devenus synonymes, ont fini par être sincèrement chrétiens.
A la suite des contemporains reconnus ou contestés de Nonnos, encore un mot d'un poète son ami, j'ai presque dit d'un émule de ses recherches littéraires et de sa conversion religieuse, qui lui survécut, si je ne me trompe, et fut son élève. Oui, dans ce Synèse, l'illustre Africain descendant d'Hercule, qui, d'abord épris des idées mythologiques et des beaux génies de la Grèce, sut porter la vérité aux pieds du troue du faible Arcadius, puis devint évêque de Cyrène, sa patrie, pour la défendre par son courage et l'honorer par ses écrits, je vois encore une image et un disciple de Nonnos, qu'il admirait et dont il a du connaître la vieillesse ; car jusque dans ses hymnes où la parole platonicienne exprime la sublime métaphysique du christianisme, où l'ïambe anacréontique est consacré à la louange de l'Être un, Dieu principe, le pieux évêque semble avoir profité de la méthode perfectionnée de Nonnos, et montre une sorte de reflet de l'élégance et de l'euphonie de l'hexamètre, que le poète de Panopolis venait d'inaugurer (72).
L'un des traits caractéristiques de cette sorte de renaissance égyptienne, que j'appellerais volontiers la quatrième et dernière phase de la littérature grecque antique, c'est son respect profond pour ses prédécesseurs. Et ce n'est pas seulement à l'ère homérique ou au siècle de Périclès qu'elle porte en hommage son admiration et ses emprunts; c'est encore à l'école poétique qui parut avant elle à Alexandrie. Il semble, en effet, que plus elle s'éloigne par l'affectation de l'idée et la parure exagérée du style, de la simplicité héroïque de l'âge primitif, ou de la dignité et de la grandeur de l'âge civilisé, plus elle les vénère et y cherche soigneusement ses modèles. Ce n'est point à ses propres annales déshonorées par des révolutions humiliantes et souillées par tant de servilité, qu'elle va demander ses inspirations ou la lumière ; elle remonte sans cesse vers son passé, se nourrit de la gloire fabuleuse on historique de la Grèce; et il faut lui savoir gré de ne pas s'être aveuglée sur son propre mérite, et d'avoir su recourir, même quand elle les imite de si loin, aux véritables types du beau. C'était là, si je ne me trompe, le symptôme d'un penchant à lutter contre la décadence et contre l'envahissement du mauvais goût; car il appartient surtout aux esprits supérieurs de se défier d'eux-mêmes et de confesser noblement tout ce qu'ils doivent à leurs devanciers. Le plus original des génies modernes a dit : « Nous ne saurions aller plus loin que les anciens; ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre (73). »
XXX.
Emprunts de Nonnos. Ses imitations. Les Bassariques de Dionysios.
Les poèmes indiens.
Comme la mémoire chez Nonnos domine l'invention, je n'irai pas sans doute, pour faire honneur à la seconde de ces facultés aux dépens de l'autre, nier qu'il n'ait mis en œuvre les traditions fabuleuses de ses prédécesseurs. Quelle fiction, produit de sa pensée, aurait-il pu glisser avec bonheur ou convenance dans la mythologie, au quatrième siècle de l'ère chrétienne? J'ai cru inutile de suivre en ceci l'exemple de quelques abréviateurs allemands, et de rechercher, une à une, les sources archéologiques où il a puisé ses légendes ; je n'indiquerai plus tard que les principales. On l'accuse surtout d'avoir mis à contribution les Bassariques d'un certain Dionysos : mais, puisqu'on ne connaît ni l'époque, ni la patrie, ni même suffisamment le nom de cet auteur confondu peut-être avec celui de son héros, on n'a pas bien établi encore lequel de ces deux chantres de Bacchus a inspiré l'autre. Au reste, je serais assez porté moi-même à céder à Dionysos, dit le Samien, les honneurs du pas, et ce ne serait pas faire un grand tort à Nonnos; car les Bassariques ne nous sont parvenues qu'à l'état de vers isolés, on même d'hémistiches frustes, échappés pour la plupart des citations d'Etienne de Byzance. Leur mérite est purement ethnographique, et ne saurait donner aucune idée précise du plan ou de l'exécution de l'ouvrage.
« Ces Bassariques, » dit le colonel Wilford (74), « contenaient l'histoire de la grande guerre indienne, Maha-Barata, écrite en vers grecs. Elle est perdue; mais, à la vue du petit nombre de fragments qui en restent, il parait que cette œuvre était à peu près semblable aux poèmes de Nonnos ; les Dionysiaques, ajoute-a t-il, remplacent les lacunes du Maha-Barata sanscrit. »
Sir W. Jones pensait autrement sur les Dionysiaques, bien qu'il fût disposé à les rapprocher d'une autre composition hindoue, le Ramayana; il ne doutait pas qu'une confrontation suivie des deux poèmes n'établit l'identité de Bacchus avec l'un des plus anciens héros de l'Inde, Rama.
Ce double système a été combattu par H. Wilson. Tout en reprochant à ses adversaires d'avoir lu seulement une moitié des Dionysiaques, celui-ci confesse qu'il les a parcourues à la hâte, seulement pour se former une idée générale des détails : méthode commode, et qui s'est perfectionnée de nos jours, en ce qu'elle dispense même de feuilleter; elle consiste maintenant à lire soigneusement la table des matières ou l'intitulé des chapitres : après quoi, le livre est jugé.
Malgré son rapide examen, H. Wilson établit victorieusement, ce me semble, qu'il n'y a, entre les poèmes hindous et les Dionysiaques, nulle ressemblance, pas plus dans les héros, leurs noms ou leurs attributs, que dans le cours des événements. Il est moins heureux lorsqu'il cherchée retrouver dans la géographie moderne les villes et les peuplades du dénombrement indien, au chant vingt-sixième; et cela tient, en partie, à ce que les noms cités par Nonnos ont été presque tous défigurés ou grécisés par le copiste des Dionysiaques.
Je me récuse tout à fait en présence de ce point litigieux, et me retranche derrière ma complète ignorance du sanscrit; il est néanmoins difficile de croire que la Grèce, qui connaissait si mal les Indes avant comme après l'expédition d'Alexandre, ou l'Égypte même, à qui le commerce n'en apportait que des notions, soit imparfaites, soit exagérées, eût résolument pénétré alors dans cette mystérieuse littérature hindoue, tout récemment dévoilée à nos regards. La Grèce, il ne faut pas l'oublier, a fait remonter sa régénération aux Phéniciens et aux Égyptiens, et prétendait avoir répandu, à son tour, la lumière dans les Indes, à l'aide des exploits d'Hercule, et mieux encore des triomphes de Bacchus, le génie civilisateur par excellence; mais elle ne gardait pas le souvenir primitif des bords du Gange, et ses traditions historiques présentent bien peu de vestiges distincts d'une origine indienne.
D'un autre coté, le peu que j'ai lu des poèmes indiens antiques, à travers les traductions françaises ou anglaises, me persuade que la poésie sanscrite, si elle entasse les faits et exagère les images, simplifie pourtant le style et ménage les figures et l'épithète. Il n'y a pas en elle la confusion bizarre et le luxe de coloris qui rayonne incessamment dans la poésie arabe ou persane. Sa hardiesse est dans l'imagination ; mais l'expression est presque toujours claire et naïve, même dans les tableaux les plus fantastiques ; on retrouverait mal dans Nonnos ces caractères des vieilles épopées hindoues.
Nonnos, en résumé, est essentiellement imitateur, mais imitateur à sa manière; il affaiblit quelquefois ses modèles, mais c'est en essayant de les rajeunir. Il est sans doute un grand fabricant d'épithètes : il les forge, il est vrai, de plusieurs métaux, et sa fusion s'étend même parfois jusqu'au verbe; mais il ne se sert jamais de ces adjectifs de remplissage, de ces surnoms tout faits, ou de ces attributs invariables consacrés et reçus dans le glossaire poétique : il emprunte à Homère des locutions ou des hémistiches proverbiaux; mais, d'abord, le fait se produit rarement; et quant aux épithètes, loin de les puiser dans l'Iliade et l'Odyssée, loin même d'adopter celle des autres poètes qu'il a imités aussi, il se fait une loi de les éviter partout, d'en produire un équivalent de sa façon, ou plutôt alors de composer un terme nouveau pour mieux exprimer sa pensée : tel est son procédé habituel, et il en résulte que l'étude de sa poésie est un excellent exercice d'helléniste. Pour mon compte, ma traduction m'a tellement initié aux secrets de la versification grecque et a meublé ma mémoire de tant d'expressions épiques, que la lecture des grands poètes m'est devenue désormais bien moins laborieuse, et par conséquent bien plus douce.
XXXI.
Plan et caractère de l'épopée de Nonnos.
En général, les chantres des actes héroïques et des merveilles d'un culte expirant, qui, dans cette décadence avancée, ont cherché à lutter avec les armes de la mythologie contre le christianisme, soit que, comme ceux-ci, ils aient tenté d'exhausser leur théogonie décrépite sur les débris de leur Olympe, tandis que Synèse plaçait déjà le siège de la religion nouvelle par delà tous les deux ; soit que, comme Palladas (75) et Paul le Silentiaire, ils aient mis au service d'une morale empreinte déjà du dogme chrétien l'érudition de la Fable et les dernières élégances du langage hellénique : tous ces grecs, dis-je, païens encore, sceptiques, ou chrétiens déjà, étaient sortis des mêmes écoles qui virent naître les vers naïfs et fleuris de saint Grégoire de Nazianze, l'élégant créateur du genre des méditations poétiques et religieuses que Lamartine a portées si haut de nos jours ; et ils saluaient un guide et un modèle dans ce même Nonnos, qui, à cette grande époque de rénovation, avait conduit sa muse au Parnasse comme au Calvaire, et puisé aux deux sources : car, nous ne saurions trop le redire avec ses juges de l'Allemagne moderne, il avait dans les Dionysiaques, comme dans la Paraphrase de l'Évangile, porté la forme artistique du rythme à sa perfection ; et, s'il déparait parfois l'idée par une emphase excessive, il devait du moins à la mélodie et au poli de son style une véritable originalité.
Que de peine prise pour un poète d'un siècle inférieur après tout! et quel dommage que les vingt-six mille vers de Nonnos nous soient restés en deux poèmes, lorsque tant de tragédies de Sophocle et toutes les comédies de Ménandre ont disparu ! Sans doute, la compensation n'est pas satisfaisante et nos regrets demeurent irréparables; mais s'ensuit-il que, par un respect exclusif pour les maîtres de l'art antique, il faille laisser languir dans l'oubli leur trop tardif et leur dernier imitateur? L'auteur de tant d'hexamètres harmonieux, ou, si l'on veut, le collecteur de tant de mythes poétiques, de tant de tours de phrase élégants, doit-il périr inconnu, parce que ces tours et ces phrases se sont quelquefois chargés d'exprimer des pensées recherchées, disons mieux, le précieux ridicule de son siècle? Si l'on ne veut pas considérer les Dionysiaques comme une épopée, pourquoi ne pas y voir, sous une enveloppe religieuse et mythologique toutefois, un de ces romans primitifs, contemporains ou prédécesseurs des érotiques d'Héliodore, plus fertiles en épisodes et en digressions, semblables peut-être aux romans rimes qui usurpent depuis quelques années le nom de poèmes; enfin un long drame versifié, s'éloignant par sa nature sacrée et nationale des contes milésiens, et rachetant par la belle fabrique du vers, et le ton soutenu de la diction, la mythologie surannée du sujet?
Non, il n'y a point chez Nonnos, ainsi qu'on a pu le dire, plusieurs poèmes en un seul ; il a une méthode exacte, un plan bien conçu, tracé sans confusion, suivi sans désordre. Il a mis en action et en préambule ce qui ailleurs est en récit, voilà tout. Avant de montrer le Dieu bienfaiteur, il fallait expliquer de quel chaos sa présence allait faire sortir le monde. De là, au début, la lutte du bien ou du mal, ou de Jupiter contre Typhée ; puis les essais de Cadmus, qui, suivi d'Harmonie, porte au sein de la Grèce le culte et les arts de la Phénicie et de l'Égypte.
Après Zagrée disparu dans la conjuration des Titans, second effort de l'élément malfaiteur, parait enfin le grand Bacchus, Bacchus le Thébain, le génie civilisateur engendré par la foudre; il échappe à la demeure d'Athamas, à la jalousie de Junon, et grandit à coté de la mère universelle, Rhéa. Puis le Dieu dompte lei monstres fléaux de la terre, assouplit son corps aux exercices auxiliaires des combats, et crée la vigne, arme pacifique et conquérante. Bientôt il rassemble de tous les points du monde et recrute dans les rangs des races divines une armée immense; il part à sa tête pour asservir les Indes, par le même chemin que prit Alexandre. Viennent alors les journées du lac Astacide et des défilés du Liban, qui sont pour Bacchus les batailles d'Ipsus et du Granique : on suit lentement la marche envahissante de la vigne dans ce pompeux itinéraire du fond du golfe de Nicomédie jusqu'aux rives de l'Hydaspe à travers les embûches ennemies, ou l'hospitalité de la chaumière et du palais. Dans les Indes, la guerre se développe avec toutes ses péripéties, les avantages, les défaites, les trêves, les surprises et lei stratagèmes. Enfin Bacchus l'emporte, et il constitue son culte et son empire chez les peuples de l'Orient indien. Dès lors, il revient aux bords de la Méditerranée, où il n'a pins d'autre armée que son cortège habituel ; il visite, chemin faisant, Tyr, la patrie de son aïeul Cadmus, comble de ses dons la brillante Béryte et les vallées du Liban ; puis, traversant de nouveau la Cilide et la Lydie, il porte en Europe son influence et ses bienfaits, descend de l'Illyrie et de la Macédoine vers Thèbes, où il est né, et où sa divinité et son pouvoir se manifestent par le châtiment d'un roi incrédule ; il initie bientôt Athènes à ses mystères, console à Naxos une amante délaissée, car il possède l'art de sécher les larmes et de calmer les douleurs. Ensuite il lutte contre son éternelle ennemie Junon au sein d'Argos, centre terrestre de la puissance de la reine des dieux, dompte les géants de la Thrace ou les monts infertiles, soumet Pallène, ou son sol, rebelle à la culture; revenu en Phrygie, domaine de sa nourrice Cybèle, d'où il est parti, il y combat les insalubres émanations des airs qu'il adoucit, et quitte enfin la terre pour occuper un trône dans l'Olympe, au sein des immortels.
Tout cet ensemble, on en conviendra, ne manque ni de grandeur ni de liaison. Ce n'est pas, sans doute, l'unité de lieu ni la courte durée de l'Iliade, tableau le plus parfait et le mieux ordonné des querelles des dieux et des héros. Les Dionysiaques se rapprochent bien davantage de l'Odyssée, peinture si touchante et si variée des traverses de la vie humaine, ou de son immortelle continuation, le Télémaque.
XXXII.
Conclusion.
Ainsi donc, cette traduction si longue et parfois si difficile, je ne puis regretter de l'avoir entreprise. Je reconnais, et c'est peut-être mon excuse, que je n'avais pas, pour me soutenir et m'encourager dans mon labeur, l'enthousiasme qui excite et le feu qui anime les interprètes des épopées d'Homère. Mon principal stimulant était la curiosité. En imitant ces formes d'un style presque toujours tempéré et qui offrent peu de prétexte aux fortes émotions du cœur, en analysant ces vers spirituels, nombreux, brillantes d'images, tels que la décadence ou l'épuisement d'un idiome en produisent, mais en même temps dépourvus de l'énergie du début ou de l'apogée, je n'avais devant l'esprit, au lien d'éclatantes lumières, que le reflet du coloris poétique.
Eh bien! je pousse si loin l'entêtement dans mes illusions littéraires, qu'il me suffirait d'avoir fait reculer sur un seul point les limites de nos connaissances mythologiques, ou diminué d'un seul assaillant le nombre des adversaires de Nonnos, pour me féliciter d'avoir pris les armes en sa faveur, et mené à fin ma périlleuse entreprise. Après tout, l'art de noircir la blancheur du papier a-t-il donc été inventé seulement pour défaire les réputations, égarer les jugements, perpétuer les préventions, ou, si l'on veut, pour défendre à tout homme réputé profane, même sans examen, les abords du temple des lettres et des sciences? Ne puis-je, à mon tour, charger mes feuillets d'encre pour réhabiliter une renommée, aplanir l'accès du Parnasse, et y relever un autel détruit?
Enfin lorsque, au sein de cette région de notre bruyante capitale, où fleurissent en paix les études, j'ai vu, sur la façade de la bibliothèque qui partage avec le Panthéon le nom de la sainte protectrice de Paris, comme le Panthéon des faux dieux se cache à Rome sous le nom de Sainte-Marie de la Rotonde; quand j'ai vu, dis-je, Nonnos reluire en lettres d'or au soleil parmi les plus grands écrivains de tous les siècles, j'ai conçu le projet de l'arracher au sommeil dont il dort sur des rayons poudreux encore de l'autre coté de ce mur rajeuni ; et j'ai tenté de le dégager de la rouille des temps. Sauver des ténèbres un monument de cette belle langue qui fut la mère de la civilisation, et fit entendre, pendant douze cents ans, les plus nobles accents de la gloire et de la liberté, c'est, je l'ai cru du moins, concourir à honorer la pensée humaine et à affranchir l'intelligence.
On va savoir, pour tout dire sur ce caprice qui m'a pris de remettre Nonnos en lumière, quelle circonstance de ma jeunesse m'en adonné l'éveil, et pourquoi la pensée en était toujours demeurée au fond de mon esprit.
ÉPILOGUE.
Maison de campagne de l'empereur Julien. Yacobaki Rizo Néroulos.
C'était en 1818, à Constantinople; j'étais allé visiter les îles des Princes entre un courrier et l'autre. Alors, qui le croirait aujourd'hui ? la Turquie troublait peu la politique. L'internonce autrichien expédiait deux fois par mois un des janissaires dépendant de sa légation à RottenThurm (c'est la Tour rouge qui sépare la Valachie de la Transylvanie, sert de limite entre de grands États, et domine ces campagnes si tristes des deux parts, dont les saisons ne varient guère l'aspect désolé). Cette poste imparfaite portait à Paris, en trente-cinq jours, notre correspondance, hérissée de toutes les précautions qu'imagina la science diplomatique pour essayer de garder son secret. Nos communications pacifiques et régulières avec la Turquie et les puissances européennes n'exigeaient que bien rarement l'emploi de mesures plus promptes ou plus directes. Or, comme les secrétaires de l'ambassade ne tenaient qu'une plume française, destinée à commenter le langage turc traduit par les interprètes, ceux-ci restaient nécessairement charges des grosses comme des petites affaires ; et pendant qu'ils préparaient la matière à nos rapports périodiques, ils ne nous laissaient d'autre occupation que l'observation des mœurs ottomanes, difficiles à pénétrer, l'étude des annales turques, peu attrayantes, ou les fantaisies de notre curiosité. Pour ma part, je ne manquais pas de me prévaloir de ces loisirs, soit en faveur de la chasse, soit pour des explorations archéologiques dans les vieux quartiers de la ville de Constantin ou dans les solitudes de l'Asie.
J'étais à Prinkipo, la moins petite des Démonèses, l'une des îles habitées au milieu des grands écueils déserts, qui se groupent en avant du dernier promontoire asiatique sur la Propontide, et qui semblent jalonner pour les barques amies du rivage la route du golfe de Nicomédie ; riants asiles où, loin du tumulte et des périls de In capitale, les Hellènes cherchaient le repos, le silence et une ombre de liberté.
On m'avait beaucoup vanté les fêtes de ces îles à l'époque annuelle du 1er mai. Ce jour, que le calendrier grec plaçait douze jours après le nôtre, ne me parut amener aucune de ces joies expansives et bruyantes que voient chaque dimanche les barrières de Paris. Malgré le calme des flots, les haleines embaumées de la saison naissante, le luxe de la végétation et la limpide transparence des airs de ces îles fortunées, un très petit nombre d'étrangers avait partagé ma curiosité. Les Grecs du continent, peu nombreux sur la rive opposée, n'avaient pas quitté leurs pauvres foyers; et les insulaires, laissés à eux-mêmes, semblaient jouir pour tout divertissement de l'absence des Turcs. Ils s'étaient contentés de parer de quelque verdure le haut des portes de leurs maisons : leurs distractions étaient la visite du monastère, dont ils ont fait un hospice pour les insensés, et la promenade dans les sentiers rocailleux qui conduisent à ce sommet, le point le plus élevé de toutes les îles. Le soir, au son de quelques rares instrumente d'Europe, on dansa nonchalamment des romaikas mélancoliques, et la fête prit fin sans avoir commencé. Les Hellènes étaient-ils donc encore trop près de la Sublime Porte pour se montrer gais et heureux ? Et l'ombre de ce sérail qu'on apercevait à l'horizon, en pesant sur leurs yeux, refroidissait-elle leurs plaisirs?
J'allais retrouver à Calki, la plus pittoresque de ces îles, un Grec que j'avais vu assidûment dans nos fraîches demeures du canal de Thrace pendant l'été, et au Fanar pendant l'hiver. C'était Yacobaki Rizo Néroulos, dont je goûtais chaque jour davantage la conversation et l'expérience. Bien des fois, sortant par la grande porte du parc des Ypsilantis, où flotte, depuis 1808, l'étendard français, et qui ouvre sur de vastes bruyères inhabitées, en même temps que Rizo s'échappait du village grec de Kalender, nous remontions ensemble les petites vallées solitaires du long désert qui commence à quelques pas du Bosphore; là, il m'initiait aux mystères de son antique littérature, mère des nôtres.
Après avoir été grand postelnick on premier ministre en Valachie, Rizo était alors à Constantinople secrétaire traducteur du grand drogmanat au ministère des affaires étrangères ; il avait tenté, soit par des réformes administratives dans l'éducation de ses concitoyens, soit par ses heureux exemples, de développer chez eux, avec le penchant des sentiments élevés, le goût des lettres, et il aimait à démontrer, par ses raisonnements comme par ses essais, que la langue grecque moderne, bien que parlée uniquement jusqu'alors par des esclaves, n'était néanmoins dépourvue ni d'élégance ni de dignité.
Dans le cours de nos promenades, tantôt Yacobaki me répétait, d'une voix mélodieuse, les accents d'Homère et de Sophocle; tantôt il m'interrogeait sur nos tragiques, et ne se lassait pas du me faire redire les grandes scènes d'Andromaque, de Phèdre et A'Iphigénie; poétiques annales de ses aïeux, disait-il avec fierté, que savait alors réciter presque en entier ma jeune mémoire. Jaloux de toutes les gloires pour son infortunée patrie, il avait lui-même assoupli son idiome moderne aux formes de la tragédie. C'est là qu'il me fit connaître Aspasie et Polyxène (76), filles de son amour pour nos chefs-d'oeuvre dramatiques, élevées à l'ombre de Racine, plus encore que d'Euripide, et dont il devait faire répéter les plaintes aux théâtres d'Odessa et de Corfou. Tant l'influence de ce grand siècle de Louis XIV a su dominer, et porter, à son tour, jusqu'au bord de l'Asie l'art et le goût de l'Occident ! Parfois, pour nous distraire de ces hautes inspirations, il citait quelques passages d'un poème héroï-comique, où il avait cherché à rivaliser avec la Lutrin plus qu'avec le Combat des rats et des grenouilles. Là, comme Boileau, il avait mêlé à des descriptions burlesques les notions d'une saine critique; et, sous l'apparence triviale du Dindon enlevé (77), il avait essayé de détourner les Hellènes des intérêts frivoles de la vie vulgaire, et murmuré à leur oreille un chant de liberté. Enfin, dans ces collines désertes que ne traverse aucun sentier, au sein de ces prairies abandonnées que nul troupeau ne consomme, nous avions ri bien souvent de cette satire grammaticale, que, sous le nom de Korakistica (78), nouveau patois des savants, ou langage des corbeaux (car le titre prête à cette double acception), il avait opposée à l'empiétement trop subit de l'idiome antique et au mélange des dialectes, que Coraï, son savant compatriote, tentait prématurément à Paris
— « Venez me voir, » m'avait-il dit, « pendant ce peu de jours que je dispute à grand'peine aux affaires, dans nos îles des Princes, retraite plus libre, où nos pas ne sont plus épiés, et où nos paroles n'ont point d'écho. Je vous montrerai, sur la côte asiatique, les ruines de la villa, ou plutôt de la petite ferme de l'empereur Julien : je pense en avoir retrouvé l'emplacement. Croyez-moi, quelques heures à la campagne font plus pour l'amitié que des mois entiers à la ville. »
Ai-je besoin de dire que Rizo parlait déjà la langue française avec cette abondance et cette pureté, mêlées d'un léger accent méridional, qui plus tard le faisait prendre pour un habitant de l'antique Phocée? Déjà il l'écrivait avec cette clarté et cette élégance qui ont dicté son histoire de la Révolution grecque, et le cours de Littérature hellénique dont Genève s'émerveilla.
J'étais fidèle au rendez-vous. Parti de Prinkipo où j'avais pris m'a demeure chez un Grec de l'Archipel qui avait autrefois servi l'ambassade de France, j'abordai après une demi-heure de navigation à Calki. J'aperçus de loin Rizo contemplant la mer du haut de la terrasse du monastère de la Triade, à l'ombre de ces vieux et robustes cyprès dont la charpente naturelle soutient les cloches, affranchies dans les îles des Princes, mais proscrites à Stamboul. Il descendit promptement les pentes qui séparent le couvent du rivage. Ainsi que nous en étions convenus la veille, je m'étais muni à Prinkipo plus peuplé que Calki, d'un caïque sans voiles qui devait nous porter au rivage d'Asie.
C'était une de ces nacelles effilées où trois jeunes Grecs agitaient six longues rames. C'est le plus rapide véhicule du Bosphore; il dépasse en célérité même la barque impériale où quarante Bostandgis frappent chacun d'une seule rame les flots qui s'ouvrent devant la tente de pourpre et d'or de leur souverain ; mais il ne se hasarde que dans le canal étroit de la Thrace et sur les bords de la Propontide, où la mer, brisée par les îles et les écueils, n'amène pas ses grandes vagues.
Nous nous étendîmes, l'un tout près de l'autre, mais vis à vis et en contre-poids, dans le fond de celle svelte coquille toujours noire au dehors, comme les gondoles masquées de Venise : la couleur blanche est sévèrement réservée aux caïques du Sultan, qui doit briller seul dans la foule de ses obscures sujets. Nous étions ainsi en quelque sorte couchés sous les flots que nos têtes seules dominaient.
« Le ciel, » me dit Rizo, « favorise notre course sur la mer, comme notre promenade sur le continent asiatique. Voyez; la brise légère qui vient de l'Olympe pousse lentement la flotte des pécheurs de Nicomédie, et soulève à peine les ondes; déjà le plus radieux soleil illumine le promontoire où nous allons aborder. Nous laissons à droite Prinkipo, qui doit son nom à l'exil de nos impératrices. Sainte Irène y habita un palais dont vous avez vu les décombres, et plus d'une Théodore vint y mourir loin du trône. Mais remontons dans l'histoire plus haut que ces souvenirs sanglants du huitième siècle.
« J'ai promis de vous faire connaître le modeste et paisible domaine de l'empereur Julien : examinons d'abord comment il le désigne. Voyez-vous cet étui ? il termine l'écritoire que suspend à sa ceinture tout bon kiatib (scribe) ottoman, et nous avons adopté ce commode usage, en même temps que leur robe, nous leurs humbles secrétaires: j'y porte la lettre que Julien adressait peu de temps après son accession à l'empire à un ami inconuu. Je l'avais copiée pour me guider moi-même dans cette solitude, la première fois que j'y vins; la voici » (79).
Et Rizo lut en grec, d'une voix harmonieuse, cette élégante épître que j'essaye de traduire :
« J'ai reçu de ma grand'mère une propriété qui n'est pas très petite, car elle se compose de quatre fermes; et j'en fais don à ton amitié. Ce présent ne saurait sans doute enrichir celui qui le possède, ou même ajouter beaucoup à l'aisance; mais il n'est pas sans quelques avantages, que nous allons passer en revue ensemble, car rien ne m'empêche de m'égayer un instant avec un favori des Muses et des Grâces tel que toi. Ce domaine n'est pas à plus de vingt stades de la mer; c'est assez pour éviter les importunités des commerçants ou le bruit des disputes des matelots; mais il ne perd pas tout à fait pour cela les bonnes grâces de Nérée. On y a toujours le poisson frais et palpitant; et dès que l'on sort de l'habitation, si on avance vers une des éminences voisines, on a devant soi la mer, la Proponide, les îles, et la ville qui porte le nom de l'auguste empereur. On ne foule pas sous ses pieds les algues, les mousses et tous ces rebuts pénibles à nommer, que les ondes rejettent sur le sable des rives, mais bien le liseron, le thym, et les herbes odoriférantes. Quand tu te seras courbé laborieusement sur un livre, et que tu voudras récréer tes yeux fatigués d'une trop longue lecture, la vue de la mer et des vaisseaux t'enchantera. »
Nous passions en ce moment auprès d'une de ces lourdes caravelles qui embarquent à Katerti, pour Constantinople, les neiges de l'Olympe. Les matelots, sur la foi de deux voiles triangulaires, qu'arrondissaient quelques haleines favorables, avaient cessé de peser sur les rames : ils chantaient, assis oisifs sur leurs bancs; et ces paroles arrivaient jusqu'à nous : « Ah! la vie libre d'une heure seule, plutôt que quarante année d'esclavage et de captivité (80) ! » — « Entendez- vous ce cri d'indépendance? » me dit Rizo en s'interrompant. « Ce sont les vers de notre infortuné Riga, le Tyrtée moderne. Ainsi, c'est en invoquant la liberté que mes malheureux frères vont chercher aux pieds de l'Arganthon les glaces de la montagne pour les plaisirs de leurs maîtres et les festins du sérail ! Croyez-vous que nous ayons à souffrir longtemps encore? Vivrons-nous donc toujours asservis dans le beau pays de nos ancêtres? » Et il répéta ces deux vers du même hymne de guerre: « Sois vizir, drogroan, prince même, l'injuste tyran ne te fait pas moins tomber (81) ! »
Il frémissait à ces mots; et, tandis que les chants s'affaiblissaient dans le lointain, un long soupir que je crois entendre encore souleva sa noble poitrine. Enfin, après une méditation muette dont je devinais et partageais l'émotion, il passa la main sur son front, comme pour en chasser une pensée importune, et il reprit sa lecture:
« Dans mon adolescence, » disait Julien, « ce « petit pavillon faisait mes délices, en raison de ses sources qui ne sont point à dédaigner, d'un bain qui n'est pas sans charmes, de son jardin et de ses arbres. Dans l'âge viril, j'ai gardé le même goût, et j'y suis venu souvent. Son revenu même n'a pas été nul. Il y a là un petit souvenir de mes penchants et de mes travaux agricoles. C'est an vignoble très circonscrit ; mais il produit un vin parfumé, doux, et qui n'a pas besoin du temps pour acquérir ces qualités. Tu y auras donc à la fois Bacchus et les Grâces, là, soit qu'elle tienne encore au cep, soit qu'elle s'écrase sous le pressoir, la grappe répand l'odeur des rosés :
Car le moût dans la ente est déjà le nectar.
si l'on en croit Homère. — Mais pourquoi dès lors n'avoir pas étendu la culture de vignes pareilles sur plus d'espace? — C'est que d'abord je ne suis jamais parvenu à être un fort habile agriculteur; ensuite c'est que, pour moi, la coupe de Bacchus est toujours largement mêlée du tribut des nymphes; de sorte que je n'ai voulu avoir de vin que ce qu'il m'en faut pour moi et pour mes amis, variété d'hommes assez rare. Maintenant, tête chérie, je te le donne volontiers tel qu'il est. C'est un fort petit cadeau assurément; mais il est doux quand il passe d'un ami à an ami, et qu'il va de chez soi chez soi, comme dit Pindare, le sage poète.
« Je t'écris cette lettre furtivement, à la lueur de ma lampe. Si donc tu trouvais à y reprendre, ne sois pas trop sévère, et ne va pas juger le rhéteur en rhéteur. »
Cependant nous avions franchi l'espace azuré qui s'étend entre Calki et l'Asie : nous avions doublé le cap Maltépé, et laissé à droite le village turc qui lui donne et porte ce nom. Notre caïque côtoyait le rivage en dirigeant sa pointe vers l'isthme que surmonte le fanal de Chalcédoine; nous atteignîmes l'embouchure d'un ruisseau, sans nom antique, qui descend des hauteurs de Semendéré et traverse le hameau de Boyoukli -, c'est ainsi que le désignait lui-même Rizo, obligé de recourir à ces appellations turques, quand nos bateliers grossissaient ces gouttes d'eau du nom générique de fleuve, potamos. C'est là que notre barque nous fit toucher la rive. Nous longeâmes quelque temps ce sillon creusé dans de vertes campagnes, dont les ardeurs de l'été allaient tarir tout à fait les ondes bien appauvries déjà; puis, vers un pont de pierre construit pour le passage de la caravane qui va porter annuellement à la Mecque le tribut des expiations musulmanes, nous quittâmes le lit du ruisseau et le parfum mielleux du jeune feuillage de ses peupliers, pour traverser sa courte vallée et gravir le revers oriental de sa colline.
Le printemps répandait autour de nous ses premiers enchantements. Avec les dernières violettes nous cueillîmes ces lichnis que les Grecs modernes nomment les œillets de Dieu, et les cistes blancs et rouges dont les fleurs émaillent les taillis. Nous traversâmes d'abord quelques champs cultivés par les habitants de Boyoukli, puis de petits bois, enfin des bruyères désertes; et là, la robe traînante et les babouches du drogman avaient peine à s'affranchir des obstacles que bravaient mes vêtements européens et ma chaussure de chasseur. Enfin, après une heure d'une marche pénible, entrecoupée de bien des pauses, nous gagnâmes le penchant d'une colline prolongée vers la mer, où des pierres amoncelées ne méritaient même pas le nom de ruines.
« Arrêtons-nous ici, » me dit Rizo, « nous sommes sur l'une des ondulations de cette montagne qui s'arrondit gracieusement au nord-est de Constantinople, toute chargée d'ombrages, et dont les pieds baignés du Bosphore se frangent de kiosques si élégants et si pressés. Elle domine le faubourg asiatique, tellement vaste qu'il prend fièrement le titre de ville de Scutari ; et nous avons oublié sa dénomination antique pour l'appeler nous-même du nom bien peu sonore que lui donnent nos vainqueurs, Boulgourion. d'est ici que je me suis flatté de retrouver tous les signalements du site indiqué par l'empereur Julien. Et d'abord, ne reconnaissez-vous pas à notre lassitude que nous avons parcouru vingt stades depuis que nous avons quitté notre caïque ? Cette source qui s'échappe ignorée de ces rochers et qui nous désaltère aujourd'hui, n'a-t-elle pas pu alimenter autrefois les bains chers au prince philosophe? Sans doute il n'y a plus là les vignes dont il glorifie les produits ; mais ces figuiers sauvages, dont les tiges se font jour à travers ces rochers et ces décombres, ne seraient-ils pas les rejetons des figuiers favoris de Julien, qui se perpétuaient d'eux-mêmes ? Avez-vous oublié le pompeux éloge qu'il a fait de cet arbre et de son fruit? Il rappelle que, dans son dédain pour certaines peuplades sauvages, Hérodote a dit d'elles, qu'elles ne connaissaient ni les figues, ni rien de ce qui est bon; et qu'Aristote a fait de la figue le contre-poison de toute substance vénéneuse? — C'est encore le plus riche produit de Damas, la cité vaste et sacrée, l'œil de l'Orient. Oui, c'est là, s'écrie l'empereur enthousiaste, qu'il faut contempler ces belles tiges quand elles présentent l'aspect de leurs fruits pendants sur leurs queues à chaque rameau, Rallongeant en forme de calices, et cet arbre qui, pour s'embellir de ses propres dons, les range, pour ainsi dire, l'un après l'autre autour de lui comme un magnifique collier. — L'image du figuier suivit Julien jusqu'à Lutèce; et vous n'avez pas oublié comme il plaisante agréablement vos Parisiens sur leur façon d'élever les figuiers, en les revêtant d'une robe de paille. »
— Convenez, dis-je à mon tour à Rizo, qu'il y a quelque trace d'exagération dans cette description poétique de l'impérial rhéteur; et pourtant il n'a rien dit de la perle d'or qui pare et trahit la maturité de la figue. Dans mon pays de l'Occident, ce fruit n'atteint pas peut-être la succulence qu'il doit aux eaux abondantes du Liban et au soleil de la Syrie ; mais, chez nous encore, en raison de sa salubrité, on le sert au début comme à la fin du repas. Vous souvenez-vous vous-même de Caton, apportant au sénat romain des figues d'Afrique dans toute leur fraîcheur? — « il n'y a pas trois jours, » disait-il, « qu'elles ont été cueillies à Carthage. Sachez donc combien l'ennemi est près de nous. »
— « Sans doute, » reprit Rizo en riant, « mais, n'en déplaise au rigide censeur de Rome, ou à mon auguste contradicteur de Damas, les figues d'Asie, dont Xerxès ne sut pas se contenter, ne valent pas nos figues grecques qui déterminèrent le voluptueux roi de Perse à envahir nos provinces helléniques. J'ai toujours cru que cette passion du sobre Julien pour la figue au mépris du raisin, avait ému la bile de Nonnos, le chantre de Bacchus? Il m'a semblé qu'inspiré par une haine politique et religieuse qui survivait à l'empereur, le poète de Panopolis avait décoché indirectement plus d'un vers satirique contre cet ascète de la religion de Jupiter; entre autres, cet hémistiche qui est encore pour nous un adage moderne: Le goût de la figue et de la pomme ne va pas plus loin que les dents (82).»
— Qu'est-ce donc, interrompis-je, que ce Nonnos? et de quel poète voulez-vous parler?
— « Eh ! quoi? » me répondit-il, « vous ne connaissez pas les Dionysiaques, cet arsenal de science mythologique et d'harmonieux langage? Ah! lisez Nonnos, pour juger de tout ce que peuvent la richesse et la mélodie de notre langue. Il vous faudra sans doute quelque patience, et vous aurez à écarter bien des épines ; mais, pour nous être égarés dans ces détours avant de gagner ces ruines, et pour nous être embarrassés dans ces buissons, notre promenade en est-elle moins douce? Lisez Nonnos. Je ne vous dis pas de l'imiter; il n'est point modèle, si ce n'est peut-être dans l'emploi d'un rythme qui n'offre aucune ressource à la poésie de nos jours. Mais vous verrez sous quelles entraves, bien plus étroites que la rime moderne, les anciens avaient enchaîné l'art des vers. Ah! si j'avais pu mener ma vie à mon gré, j'aurais aimé a montrer Nonnos tel qu'il a dû être, lorsqu'il a donné le signal d'une réformation poétique. J'aurais voulu faire ressortir cette école d'euphonie, où les poètes de notre décadence, et surtout les anthologues, puisèrent la perfection de l'hexamètre. Heureux Nonnos, si, quand il a dégagé les abords du Parnasse des haches, des flûtes, des autels, des anagrammes, et de tous ces abus puérils d'une métrique qui cherche à surprendre les yeux, au lieu de charmer l'oreille, il en eût banni également les jeux de mots, les calembours, les répétitions affectées, enfin toutes ces fausses étincelles de l'esprit grammatical. Mais quoi ? c'est ce qu'imitent encore mes infortunés compatriotes. Notre avilissement et notre esclavage s'opposent à tout essor de l'âme et à tout éclat de ces pensées que fait germer le soleil de la liberté. A l'ombre du despotisme, comme jadis Nonnos et mieux encore ses successeurs, nous jouons avec les mots et les lettres, parce que la haute éloquence du cœur nous est interdite, en même temps que l'indépendance et les droits de l'humanité.
— « Allons, » continua-t-il en se levant de la pierre mutilée sur laquelle nous nous étions assis, achevons notre pèlerinage, et suivons le conseil de Julien. Éloignons-nous de ces débris, qui furent, si je ne me trompe, le pavillon qu'il nous a décrit; élevons-nous, comme il le veut, sur cette éminence pour y jouir de l'aspect qu'il nous a vanté. Ses vignes favorites ont disparu ; mais le thym et le liseron, qui n'ont pas besoin de la main des hommes, y sont encore. »
Bientôt, quelques pas au milieu des tiges d'asphodèles et des touffes de daphnés nous amenèrent au sommet de la colline, d'où la vue régnait au loin sur la mer, sur les frontières de l'Asie, le Bosphore et la grande ville de Constantin.
Après quelques instants d'une muette contemplation : — « Quel merveilleux spectacle ! » s'écria Rizo. « Voyez au midi resplendir sons les feux du soleil la Propontide, le plus vaste lac du monde ancien, que se partagent l'Europe et l'Asie, maintenant confondues dans leurs limites sous un même joug. Derrière nous, l'Olympe, ses neiges éternelles, et, plus près, ces îles riantes d'où nous venons, jetées comme des fleurs sur la mer : sous nos yeux, les champs des aveugles Chalcédoniens qui méconnurent les ports de Byzance et les charmes de la Corne d'or. Ici, à notre droite, les montagnes de l'Anatolie, qui étendent jusqu'à l'Euxin leurs flancs torturés par les convulsions volcaniques. A l'occident, les ombres de ces noires forêts de cyprès qui cachent près de Scutari les tombes musulmanes ; puis l'entrée du Bosphore animé par ces mille voiles qui nous apportent les inventions de l'Europe et les trésors de la Scythie fertilisée. Considérez ensuite la grande ville fondée par le héros que Julien a surnommé l'empereur par excellence; enfin à l'horizon, se dressant comme un éternel reproche pour notre faiblesse et pour la chrétienté, ce dôme de Sainte-Sophie que surveillent, comme d'immobiles sentinelles, quatre minarets de Mahomet ! !
« Non. » murmura Rizo, « je ne me résignerai jamais à tant de honte. Le plus beau pays de la terre entre les mains de ces hordes barbares qui ne savent que l'opprimer I Trois siècles d'infortune ont-ils donc effacé notre caractère de fils de l'Évangile, et nos titres de descendants d'hommes jadis libres et glorieux? Je ne puis, comme le fanatisme de nos prêtres, tourner mes regards vers le Nord pour en attendre l'affranchissement et la lumière. Ce ne serait que changer de maîtres et prolonger l'obscurité. Non, maintenant usée par le frottement de l'Europe envahissante, la population turque doit se replier sur son territoire originel, et laisser la place aux idées, à la religion et à la nation grecque, qu'elle accable. Il est temps que l'islamisme et son fatalisme abrutissant reculent devant la religion chrétienne et le génie de l'Europe. Quoi donc? cette civilisation immortelle dont nous fûmes les fils aînés, et que le monde, après l'avoir reçue de nous, nous renvoie, n'enfantera-t-elle jamais notre indépendance? Un nouveau Miltiade, un autre Thémistocle, tarderont-ils de naître pour chasser encore de Marathon et de Salamine les descendants des Perses, et mettre en fuite ce Xerxès dont le sceptre de fer perpétue chez nous l'ignorance et la servilité? Ah ! je payerais de tout mon sang ce jour où la croix reluirait encore sur ces voûtes que Justinien n'a pas élevées pour le prophète de la Mecque ! Pardonnez ; cet amphithéâtre est le plus beau qui soit au monde, et, quand il vous arrache des cris d'admiration, mes yeux n'ont pour lui que des larmes de douleur et de regret. »
Rizo pleurait en prononçant ces mots : il baissa la tête comme s'il refusait de regarder au loin, et s'accroupit dans nue sombre méditation, affaissé sous le poids de ses pensées. Je respectai ses angoisses patriotiques, et je restai debout près de lui, aussi attendri à sa vue qu'émerveillé du grand spectacle qu'il m'avait signalé... — « Reprenons nos chaînes, » dit-il après un long silence : « le soleil penche vers les collines abandonnées qui ceignent Constantinople; notre barque nous attend, allons retrouver dans nos îles les joies imparfaites du 1er mai. Vous le voyez, mon ambition pour mon pays et mes souvenirs ne me laissent y mêler que des amertumes. »
Pour retracer dans toute leur vérité ces accents, qui ne furent pas des vœux stériles, je n'ai eu qu'à feuilleter ou relire mon journal oriental du 13 mai 1818, et en détacher le récit de mon excursion asiatique en compagnie de Rizo. Yacobaki Rizo Néroulos, premier ministre de l'hospodar de Moldavie, en 1821, après la funeste issue de l'entreprise d'Ypsilanti, se retira en Bessarabie; puis il partit en 1823 de Kischneff, séjourna en Toscane, à Genève, en 1826, et, après l'exil, occupa à Athènes d'importants emplois publics. Il porta dans ces fonctions ce caractère observateur, et cette expérience des choses du Levant, science rare et méconnue, que lui donnaient ses longues études des dialectes asiatiques, son habile direction des provinces danubiennes, ses angoisses, ses sacrifices dans une sanglante révolution, et sa constance à poursuivre à travers tant d'obstacles l'affranchissement de son pays. Enfin ambassadeur d'un roi hellène et chrétien près d'un fils de Mahomet, il mourut libre à Constantinople, où il était né esclave, ainsi qu'il disait lui-même, soixante-dix ans auparavant.
J'avais promis dès lors à mon guide et à mon maître
en littérature hellénique de lire Nonnos jusqu'au bout, sans me
rebuter des aspérités de son texte, et je mis moi-même plus de doux
ans à accomplir toute ma promesse, tant mes devoirs officiels
prenaient sur mes loisirs, et tant cette lecture me semblait
sérieuse, même en matière frivole, quand il s'agissait d'un à long
poème écrit dans une langue qu'on ne parle plus. Ce fut bien plus
tard encore que je revins une seconde fois à Nonnos. Après avoir
encadré l'hymne d'Homère de gloses fantastiques, les épigrammes de
Palladas de réflexions morales et littéraires, enfin les chants du
peuple en Grèce de descriptions et d'études de mœurs orientales;
quand je cherchais encore pour assouvir ma soif de l'idiome
hellénique un sujet neuf, que nos artistes en interprétation moderne
n'eussent traité jamais, les Dionysiaques me parurent porter
ces signes primitifs.
«
C'est le seul poète que nos écrivains aient négligé,
»
m'écriai-je, en parodiant Horace (83);
et il me sembla que, du haut de ce magnifique promontoire de
Chalcédoine, auprès duquel, ministre cette fois d'une sorte de
monarchie grecque, le généreux Rizo est revenu mourir, son ombre
silencieuse m'indiquait encore du doigt le poème de Nonnos.
FIN.
(01) Orig., Praef. in Joann. - St. Irénée, l. III, ch. 1.
(02) A la vente des livres de M. de Bure, en décembre 1853, un exemplaire des Dionysiaques, de la mauvaise édition de 1605, a été cédé au prix de 120 fr.
(03)
Walter Savage Landor (Dialog. athén., 1831). Ausone a dit, en
parlant de du latin, ignoré des Grecs :
Cecropiis ignota notis furiale sonans U. (Épigr.)
(04) Vers imités du 31e vers, chant XVI, des Diosysiaques, et du 372 du XXe : Αἶθε πατήρ, κ. τ. λ.
(05) Σοφιστὰς μὲν καὶ σοφοὺς ἔλεγον τοὺς ποιητάς. (In Isth. V, v. 36.) On appelait les poètes sages ou sophistes.
(06) Σοφισταὶ οἱ ῥήτορες, καὶ ἀπατεῶνες, κ. τ. λ. (Schol, d'Arist., Nuées, v. 330) « Les sophistes, qui sont des rhéteurs et des imposteurs. »
(07) Ecclesiae Edessenae divinus ille praefuit Nonnos. (Trad. de Nicéphore, liv. XIV, ch. 30.)
(08) « Je ne suis pas, dit Bentley, l'admirateur de Nonnos » (qui pourrait l'être dans l'état où se trouvait alors le texte de son poème?) « et je pense sur son compte comme Scaliger, Cunaeus et Heinsius. Néanmoins son érudition est variée, profonde ; et, s'il est un poète médiocre, il est au moins un fort savant littérateur. Je ne me résoudrai donc jamais à le croire auteur de ce commentaire plein de tant et de si honteuses inexactitudes. » Nec unquam a me impetrare potero, ut scriptorem eum putem istius commentarii tot pudendis pleni erroribus. (Bentley, e resp. ad Phal. epist. Boyle cens. proaemio.)
(09) Nonnos, adjectif, est l'équivalent de vénérable; ainsi disait en 542 la règle de saint Benoît : « Priores juniores suos fratres nominent; juniores autem priores suos nonnos vocent, quod intelligitur paterna reverentia. »
(10) C'est ainsi, si je ne me trompe, qu'il faut entendre ici le mot οἰκέων, dans lequel certains commentateurs ont vu une énigme. On pourrait dire aussi : compositions qui lui sont propres ou dont il aurait pris l'idée chez lui ; ce serait alors ce que le rhéteur Himérius appelait ἐκ τῆς οἰκείας μούσης (Ap. Phot., p. 2027).
(11) Οὐ γὰρ ἐστι ταὐτὸν ἐς πλῆθος ἀποστηθιζειν, καὶ γράφειν ἐς κάλλος. (Suidas, in voce Sallust.)
(12) Villemain, Tableau de l'éloquence chrétienne au quatrième siècle, p. 91.
(13) Saint Jean Chrysostome, de Virginitate, § 82.
(14) Dans un de ces Emblèmes, dont la mode avait saisi le seizième siècle, et que l'on recherche encore, moins pour les lire que pour les regarder, Sambucus a pris soin de se représenter lui-même chevauchant entre ses deux chiens, tantôt dans des campagnes incultes, tantôt à travers des forêts que figure un grand arbre à lui seul. Au second plan, Bombo et Madel sautent les premiers dans une barque attachée à la rive, et se retournent vers leur mettre comme pour l'engager à le suivre. Puis on les voit, dans le lointain, s'avancer avec lui vers les remparts des villes qui bordent l'horizon. Cette image est dédiée à la fidélité. On lit an bu quelques iambes en langue latine, oeuvre de Sambucus, dont j'ai extrait ces vers tout aussi mauvais que les siens :
Ils m'ont suivi partout, sur
mer comme sur terre.
Ils vinrent souvent à Paris,
Ils ont connu Néapolis,
Ils ont vu Rome et ne s'en doutaient guère.
Par la Belgique ils prennent leur chemin ;
Et, grâce à leur instinct fidèle,
Vers mon dons pays qui m'appelle
Ils vont me ramener demain.
(15) Mode tout au rebours de celle qu'a préconisée Molière par la bouche de M. Caritidès :
Il n'est rien si commun qu'un
nom à la latine ;
Ceux qu'on babille en grec ont bien meilleure mine.
Les Fâcheux, act. III, sc. II.
(16) Καὶ ὡς ἄλλος Πελίας, πρὸς ἀνακαινισμὸν, ἑτέρας Μηδέίας δεόμενον. (Philé, 1533, editio princeps.)
(17) Corpus poetarum graeorum. Lectius, Genève, 1606, in-fol.
(18) « Tout le monde, » dit Sextus Empiricus, « ne « reconnaît pas dans Homère le plus ancien des poètes ; et plusieurs auteurs prétendent qu'Hésiode l'a précédé. » Ἔνιοι γὰρ Ἡσίοδον προήκειν τοῖς χρόνοις λέγουσιν. (Sext. Emp., liv. I, ch. 10.)
(19) Δόξα σοι ὁ Θεός, ὅτι μὲ τὸ ἀπεξέβαλες.
(20) Biographie univ., art. H. de Mendoza.
(21) Τινὶ ἀμούσῳ. (d'Anse, Epist. Vinar.)
(22) Multas ilium paginas pervolutando manibus contrivisse. (Falkenburg, Epist. dedic. ad Sambacum )
(23) De Ratione emendandi autores graecos syntagma. Excellente méthode, dont j'ai reconnu tout le prix dans mes perplexités, et que Canter a rejetée humblement, comme un hors-d'oeuvre, à la fin et même après l'Index de ses commentaires sur les harangues du rhéteur Aristide.
(24) Eum poetam habuerunt, quem Plato magis expetit quam invenit. (Paraphrase de saint Jean, commentée par le R. P. Abram, jésuite, en 1623 ; préface de l'éditeur-imprimeur Sébastien Cramoisy.)
(25)
Épigrammes qui précèdent l'édition de 1623 de la paraphrase de
l'Évangile.
(27) La manie de travestir les noms propres, dont j'ai relevé tant d'exemples dans cette introduction, me paraît avoir pesé doublement sur le célèbre imprimeur de Bâle. Il traduisit d'abord en grec son appellation allemande, Herbst, qui signifie l'automne (opora) ; puis il s'accoutra de la désinence latine, comme pour s'embellir d'une seconde parure. Dans sa passion pour les lettres antiques, il empruntait ainsi quelque chose de son nom « aux deux plus belles langues que les hommes aient jamais parlées, » selon les nobles expressions du cygne d'Orléans, ces langues « qui se formaient à redire un jour à la terre les choses du ciel. » (M. Dupanloup, discours de réception prononcé, le 9 décembre 1854, à l'Académie française.)
(28)
Quem Pani, Dryadumque leves Satyrumque chorae,
Jurarunt numeros eripuisse suos
Quemque ego Pimplaei de montibus orta putarim
Numina cuncta suo continuisse sinu.
(29) Ce mot de Dionysiade, le nom d'un homme et non d'une oeuvre, le docte Heinsius aurait pu le retrouver chez le poète cité par l'exact Héphestion dans son traité de Metris.
(30) Piersonii, Verisimil., lib. I, ch. IV p. 52.
(31) Bentleii, Proeemium in Phal. Epist. p. 10.
(32) Petri Francii, in Museum Dav. Whitfordi conjecturae.
(33) Schrader, Musaei praefatio, 1742
(34) De ipso poemate, ut nunc est, in neutram partem, arbitror judicari posse; ante, turpissima scripturae emenda quibus singuli versus inquinantur, detergendum est. (Ruhukenius, Opusc., t. II, p. 613.)
(35) Nos quoque si diis placet, dum γόνυ χλωρόν ἐστιν, conamur tenues grandia. Nonni Dionysiaca in latinum sermonem vertimus, adnotatiunculasque quasdam et conjecturas nostras addemus. Scatet enim faedissima proluvie mendorum. (Job. Forestius in Epist. ad El. Putschium, 1605.)
(36) Quod si quis... Homerum ad verbum exprimat in latinum. Plus aliquid dicam; eumdem sua in lingua prosae verbis interpretetur, videbis ordinem ridiculum, et poetam eloquentissimum vis loquentem. (S. Hieron., ad Pammachium, epist. XXXIII.)
(37) Balzac, Dissertations critiques, au R. P. Andr de Saint-Denis, feuillant ; Oeuvres, t. II, p. 596.
(38) Scriptor felix in talibus, si temperate scribi Bacchica potuissent. (Barth., Advers, liv. VII, ch. 21.)
(39) Sed ex quo tamen multa erui possunt ad mythologiam reconditam et pleniorem antiquitatis notitiam quae frustra in alio scriptore quærerentur. (Vill. Epist. Vinar. ded.)
(40)
En ce qui touche l'introduction du dactyle presque obligé au
quatrième pied de l'hexamètre grec, Nonnos en est le promoteur, sans
l'avoir inventée; il a seulement appliqué plus sévèrement au vers
épique la méthode de Théocrite, si favorable au vers bucolique et à
la mélodie :
«
Plurimos hoc pollet Siculae telluris alumnus. »
(Terentianus Maurus, de Metr.)
Et ici je crois et soutiens, en opposition à quelques-uns de ses commentateurs, que Théocrite a consulté sur ce point son génie naturel, son oreille surtout, et qu'il n'a point observé comme une règle absolue ce procédé métrique, contrarié plus d'une fois, même dans les premiers vers de sa première idylle. Or c'est chez moi une opinion héréditaire. (Voir la préface des Idylles du comte de Marcellus. Paris, 1820.)
(41) Exode, ch. XXXIV, v. 6.
(42) Οὐ γὰρ ἡδύσμασι χρῆται, ἀλλ' ὡς ἐδέσμασι. (Arist., Rhétor.)
(43)
Πολλὰ μάλ' εὐχομέῳ γοιηόχῳ Ἐννοσιγαίῳ.
(Hom., Iliad., IX-183.)
(44) Casp. Barthius, Adversaria, liv. XX, ch. 21,
(45) Ἐκ συνθέτου ὀνόματος, κ. τ. λ. (Dem, Phal. de Eloc.
(46)
Ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα,
καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν.
(Il., liv. XXI. v. 197.)
(47) Fréret, Mémoires de l'Académie des belles-lettres, vol. XX.
(48) Postquam omnem potestatem ad unum conferri pacis interfuit, magna illa ingenia cessere. (Tacite, Hist., liv. I.)
(49) Sed tamen ipsa gravitas argumenti Dionysiacarum, quo nullum unquam per universum fabulerum orbem latius patuit, sibi hoc videbatur quodammodo poscere, ut illud poema studiosius aliquanto tractaretur (Fred. Creuser, Praef. sex libr. Nonni a Moser edit.)
(50) N'est-ce pas là à peu près ce que disait Quintilien des vieux tragiques du Latium. « Coeterum : nitor et summa in excolendis operibus manus magis videri temporibus quam ipsis defuisse. (Inst. orat., l. X, ch. 6.)
(51) Gilb. Wakefield, Sylva critica, cive in auctores sacros profanosque commentarius philologus, 1789.
(52) Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple de ces reproches qu'ont valus à Nonnos les fautes de ses copistes, et contre lesquels Graëfe n'a pas protesté, Daniel Heinsius, le plus redoutable de ses épilogueurs dans une dissertation qui a fait autorité, a dit ceci :
« C'était la coutume chez les anciens, que, dans les luttes de l'arène, le vaincu levât la main; c'est ce que les Grecs nommaient πρίσχεσθαι τῷ χειρε, et les Latins dare, dedere ou même tollere manum. C'est ainsi que Cicéron, dans la douleur de la mort de sa fille, se reconnaît terrassé, et vaincu par la fortune ; tollo manum, dit-il, je cède, je lève la main. (Voyez parmi les fragments de Cicéron conservés par Lactance.) Voilà ce que Nonnos appelle très sottement frapper le vainqueur de la main πατάξας (Dionys., liv. XXXVIII, v. 609), ce qui est l'action d'un triomphateur ou d'un homme qui se bat encore mais non pas d'un vaincu. Il a cru peut-être que πετάσσειν signifiait adoucir, caresser. Certes je ne voudrais pas faire sur ma personne la double expérience de ce verbe..., etc. Ô Heinsius ! qu'est devenu ce bon goût qu'on prêche aux autres ? Eh bien ! c'est moi qui vais essayer de répondre à l'aristarque hollandais. Au lieu de ἀνέρα νικήσαντα κατηφέϊ χειρὶ πατάξας, lisez ἀνέρι νικήσαντι κατηφέα χεῖρα πετάσσας ( ecression homérique), et vous aurez des vers raisonnables, élégants même, et surtout très conformes à la coutume antique qu'ils rappellent en la confirmant. C'est là très certainement une correction qui n'eût pas échappé à Graëfe, si, au lieu d'éditer, il eût traduit.
(53) Peu de mois avant que l'interruption de toute relation politique avec la Russie eût fait cesser, ou du moins eût rendu bien difficile le commerce littéraire, j'ai appris, par une note émanée de l'université de Pétesbourg « que le commentaire dont feu M. Graëfe avait promis de faire suivre son édition des Dionyaques n'a jamais paru, et ne se trouve pas même entièrement achevé dans la succession littéraire du savant philologue. »
(54) Bernardhy, Grundriss der Griech. Lift., t. II, p. 254
(55) Meletemata Nonniana, Potsdam, 1852.
(56) Koelher, Ueber die Dionysiaka, Halle, 1853.
(57) Bandini, Catalogus manuscriptorum qui jussu Petri Leopoldi in Laurentianam translata sunt. Florentiae,1792.
(58) « L'élégance du vers héroique, qui fut restaurée et merveilleusement pratiquée par Nonnos (insigniter exculta), à ce point qu'elle ne laisse rien à désirer, si ce n'est peut-être une variété plus grande, fit naître, dans ce même genre de poésie et dans quelques autres, de nombreux poètes : ceux-ci, s'élançant aussitôt sur la route que Nonnos venait de a leur tracer, ont paré les fables antiques de ces précieux ornements. L'épigramme du sixième siècle et surtout du temps de Justinien en profita : ainsi se distinguent Marien, Christodore, Julien l'Égyptien, Paul le Silentiaire, le consul Macédonius et Agathias le Scolastique. » (Fréd. Jacobs, Préf. de l'Anthol., 1826. )
(59)
Et male tornatos incudi reddere versus.
(Hor., Art poet., v. 441.)
(60) Voir Edinburg Review, avril 1853, et ma réplique, Revue contemporaine du 18 mai suivant.
(61) Montaigne a dit : les François, mes contemporanées; mais quand il employait celte expression tant soit peu gasconne, que je cite uniquement pour faire excuser la mienne, il savait et nous savons tous ce qu'il voulait dire. Il n'en est pas de même pour Nonnos ; car l'époque où à son tour il a fleuri (et ici ce terme d'usage n'est point déplacé ) est demeurée fort nuageuse. Or, si je l'ai résolument porté tout au bout du quatrième siècle, malgré mes devanciers qui le fixent aux premières années du cinquième, ce n'est pas seulement pour me rapprocher de tous les deux et pour la vérité chronologique, mais c'est encore pour donner raison aux deux opinions, sans trop d'effort et à la fois.
(62) Quod licet note non sit optimae carmen, nec decoribus suis, et nativa quadam simplicitate sese magnopere commendet. (J. D. a Lennep., Coluthi preefatio.
(63) Rutgersii variae Lectiones. Lejde, 1704, in-4°.
(64) Er was der glücklichste nachahmer des Nonnus, welchem er den Wohlklang seines weichen, fein und kunstgerecht gepllechten rythmus abgewann. (Benardhy, Gundr., p. 261.)
(65) Kromayer, ad Musaeum, Diss., p. 7.
(66) Francius, ad Mus., edit. de Dav. Whitford : Multa habet hic autor cum Nonno communia nisi ipse sit Nonnus.
(67) Nonnum ipsum, meliori judicio, temperantem naturales sive inconsultae luxuriae morbos. (Casp. Barthius, Adv. lib. XX, cap. 21.)
(68) Nonni folminantis spiritus et sublimis. (Schrader, ad Mut., praef.)
(69) Tourlet, trad. de Coïntos de Smyrne.
(70) S. Greg., Poème sur sa vie, vers 55.
(71) Nec ingrata negligentia hominis de re, magis quam de verbis, laborantis. (Cic., de Orat., § 23.)
(72) Dans l'Histoire du Bas-Empire, parfois diffuse et incorrecte, a coté de ce jugement sur Synèse : « Écrivain pur, élégant, ingénieux, mais un peu trop chargé de métaphores... Dans le langage chrétien, il conserva, pour ainsi parler, l'accent du paganisme », on lit cette appréciation de Nonnos : « Les ouvrages de Nonnos, postérieurs à Théodose, non a plus que quelques romans en vers grecs, sans goût et sans génie, ne méritent pas d'être mis au nombre des productions de l'art. » — On pourrait s'étonner de cette sévérité de Lebeau, si l'on ne remarquait qu'il écrivait en 1762, dans la seconde époque des ténèbres qui se firent autour de Nonnos. Et sans doute l'historiographe n'avait jamais lu ni les Dionysiaques, ni les romans en vers grecs qu'il place entre les deux Théodose, quand les seuls qui nous restent appartiennent au douzième siècle.
(73) La Fontaine, Note sur la fable 15 du liv. 1er.
(74) Asiatic Researches, Calcutta, tom. IX.
(75) Voir mes traductions et notes des épigrammes de Palladas. (Épit. littér, en Orient., t. II.)
(76) Ἀσπασία, Πολυξένη, tragédies de Yacobaki Rizo Néroulos, 1814.
(77) Κούρκας ἁρπαγή, poème héroï-comique, 1816.
(78) Κορακίστικα, comédie. Imprimerie grecque de Mahmoud-Pacha, 1813.
(79) Un jour, à Londres, en 1822, comme je racontais à M. de Chateaubriand ce trait semi-politique, semi-littéraire de ma vie orientale, il me dit : « Je me suis beaucoup occupé de Julien l'Apostat, à qui ce surnom fait autant de tort que si la chose était rare. Mais dans mes recherches préliminaires du Génie du christianisme, cette lettre m'avait échappé ; j'en prends note. Ah! je comprends mieux qu'un autre tout le charme de ces souvenirs de l'antiquité cités sur place. Je n'oublierai jamais que j'ai lu à haute voix, comme si le peuple hébreu m'entendait, les Lamentations de Jérémie sur la colline en face de JérusaIem, et à Colone, les chœurs de Sophocle, que M. Fauvel m'avait prêtés. Que n'ai-je pu, comme vous, faire répéter Homère aux échos du Simoïs. »
(80)
Καλήτερα μιᾶς ὥρας ἐλευθέρη ζωὴ
παρὰ σαράντα χρόνων σκλαβιὰ καὶ φυλακή.
(81)
Βεζιρης, δραγουμάνος, αὐθέντης κ' )ὰν γενῇς
ὁ τύραννος ἀδίκως σὲ κάμνει νά χαθῇς.
(Ρηγα Θουριος)
(82)
Σῦκον ὁμοῦ λαὶ μῆλον ἔχει χάριν ἄχρις ὀδόντων.
(Nonnos, Dionys., liv. Xll, v. 236.)
(83)
Hunc intentatum nostri liquere...
(Horace, Art poét. v. 285 )