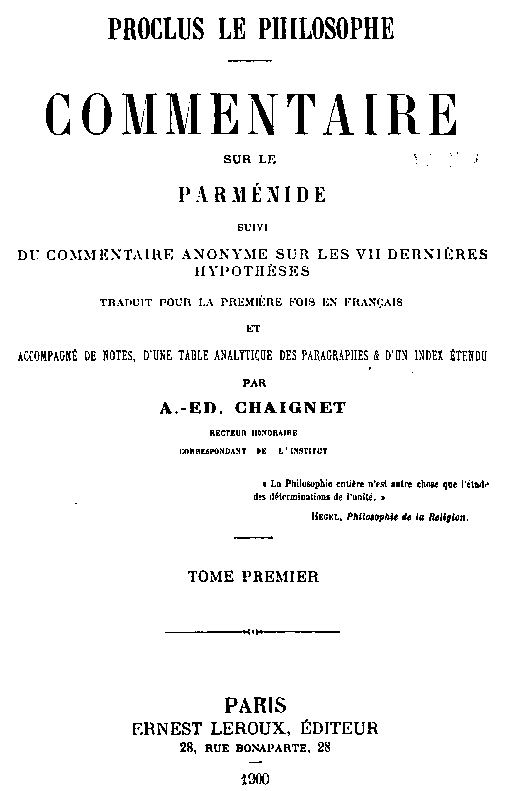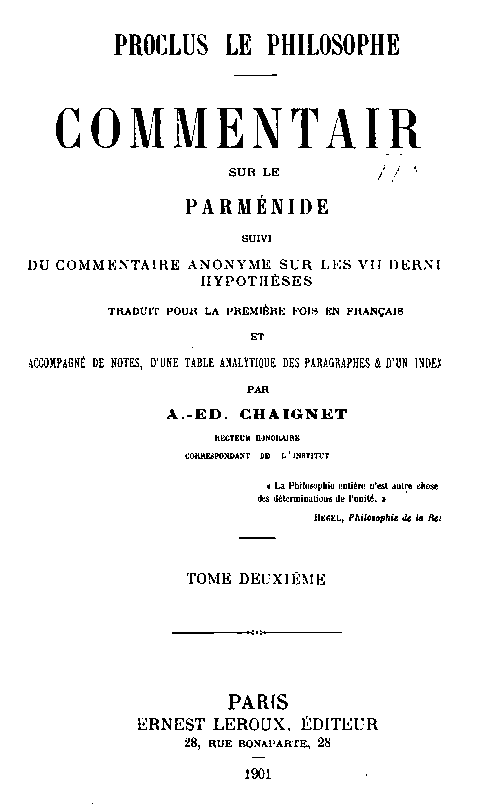|
PROCLUS
COMMENTAIRE DE PROCLUS SUR LE PARMÉNIDE
LIVRE UATRIÈME
livre I - livre II - livre II (bis) - livre III - livre V
COMMENTAIRE DE PROCLUS SUR LE PARMÉNIDE Sept Livres sur le Parménide LIVRE QUATRIÈME § 63. « Quoiqu'il en soit de cette question , dis-moi maintenant ceci : il te semble donc, à ce que tu dis, qu'il y a certaines espèces dont les autres choses, les choses d'ici-bas prennent les surnoms, parce qu'elles en participent . » Socrate ayant dit dans son entretien avec Zénon, qu'il y a des espèces et qu'elles sont participées par les choses d'ici-bas, et remontant à la communauté des espèces par l'intermédiaire des choses d'ici-bas qui sont participées, quelques-uns ont immédiatement par là pensé que Parménide, pour réfuter Socrate et renforcer la critique de Zénon, combat les deux opinions de Socrate, et l'hyparxis des espèces et le mode de participation; que par les arguments précédents, il a objecté qu'il n'y a pas d'espèces, et par ce qu'il va dire, qu'elles ne sont pas participées par les sensibles, et déclare, pour ainsi dire ouvertement, que si on leur accordait l'hyparxis et la substance, le mode de participation est impossible. Donc les espèces ne sont pas, et, si elles sont, elles ne sont pas parti- ciliées par les choses sensibles. Voilà l'opinion de ces philosophes, à savoir, que tout ce que Parménide tire des arguments antérieurement exprimés, c'est qu'il n'y a pas d'espèces, et du moins qu'il n'y en a pas de toutes choses, comme, d'ailleurs, Socrate lui-même le pense. Donc il n'y a pas d'espèces; pour tout le monde, telle est la signification du passage et de la critique de Parménide, qui lui prouve qu'il ne faut pas faire produire par les espèces certaines des choses sensibles, les autres par le hasard ; mais que, s'il y a des espèces, toutes en dérivent. Pour nous, en ce qui concerne le reproche fait à Socrate, nous avons, par les raisons précédemment exposées, fait connaître notre sentiment; en ce qui concerne tout le système des arguments mis en œuvre nous disons que la discussion de Parménide a pour but d'organiser les opinions de Socrate en un tout, de les élever, de louer la fermeté inébranlable de ses pensées, de mettre la perfection à ce qu'elles ont d'imparfait, et, dans la mesure où elles sont éparses et confuses, de les ramener à un système organisé. D'après la division que nous avons faite, quatre problèmes se posent concernant les Idées. Sur le premier, s'il y en a, il ne le discute pas en détail, puisqu'il admet l'hypothèse; - sur le deuxième, de quelles choses, il y en a, il l'interroge, pour savoir s'il rattache tout à la cause spécifique, ou s'il connaît une autre cause plus haute que celle-là, et la critique, comme nous l'avons dit plus haut, visait précisément cette cause première. Il parcourt ainsi tous les stades, en partant d'en haut, c'est-à-dire des espèces les plus universelles, en passant. par les plus particulières et les plus indivisibles, et arrive enfin à celles qui ne subsistent pas selon une espèce intellectuelle, mais ont procédé de la monade de tous les êtres : et s'étant ainsi avancé depuis les plus hautes jusqu'aux dernières et ayant tout suspendu à la cause paternelle, ayant mis la dernière fin à l'opinion de Socrate sur ce point, il passe au troisième problème, relatif à la participation, et là, de nouveau, pratique la méthode maïeutique : car partout le procédé du dialogue est maïeutique et non réfutatif ; il est paternel et non polémique. Il varie on ce que, tantôt il procède de haut en bas jusqu'aux derniers degrés, tantôt il s'élève de bas en haut, jusqu'aux raisons qui tiennent aux causes divines : mais dans les deux directions et les deux catégories d'espèces, il achève la pensée de Socrate, le fait remonter aux principes, et constitue les opinions qu'il professe à ce sujet en un ensemble organisé et bien articulé. Ainsi donc, comme nous l'avons dit, voilà la marche et le caractère de la discussion : elle provoque les pensées spontanées, elle organise les imparfaites, elle fait remonter ceux qui sont réellement capables de la suivre; elle imite la cause paternelle, qui, placée au sommet de l'hypostase des êtres, conserve tout, achève tout, enlève et ravit en haut tout, par ses propres puissances inconnaissables. Il nous faut donc encore une fois nous retourner vers la considération des choses, dire quelle est cette participation et comment nous concevons qu'elle se réalise; ensuite nous étudierons de la même manière, les termes mêmes de Platon, ayant préalablement expliqué qu'ici, comme lorsqu'il s'est agi de l'union et de la distinction des espèces, notre recherche porte sur le comment: car, qu'elles sont participées, s'il y a des espèces, tout le monde en conviendrait; mais comment elles sont participées, c'est là la difficulté, et c'est cette difficulté qu'examiné ici Parménide, comme plus haut, Socrate avait recherché comment les espèces sont à la fois distinguées et confondues, si elles sont simples, et non semblables aux choses visibles, dans lesquelles cela est facile à reconnaître pour tout le monde : après ces observations préliminaires, passons au sujet même. Disons donc que les participations des espèces intellectuelles ressemblent aux images qui apparaissent dans le miroir : car de même que dans celles là l'attitude et la position font que le simulacre du visage est vu dans le miroir, de même la disposition favorable de la matière qui se tend pour ainsi dire vers la raison démiurgique et s'apprête à entrer en elle, est remplie par elle des espèces. Disons encore que la participation ressemble aux empreintes des cacheta dans la cire; car celles-là, je parle des espèces, communiquent une sorte de trace d'elles-mêmes, une empreinte, et cette empreinte n'est pas identique au cachet qui a produit l'empreinte, comme l'espèce matérielle n'est pas la même que l'espèce immatérielle et divine : ce dernier mode de participation diffère de celui qui le précède, en ce que celui ci montre une certaine modification passive dans le réceptacle, tandis que dans l'autre, le miroir ne subit aucune modification sensible, comme celle que subit ici la cire. C'est pour cela que ceux qui considèrent que, dans la participation des espèces, la matière est impassible, la comparent à un miroir et appellent les espèces, des images et des reflets. Ceux au contraire, qui croient que la matière est susceptible de modifications passives, disent qu'elle reçoit une empreinte, comme la cire du cachet, et appellent les espèces, des états passifs de la matière, πάθη. Les uns ne considèrent que la matière première, quand ils prétendent qu'elle est impassible, par la raison que, si elle était susceptible de modifications passives, c'en serait fait de sa simplicité; car le simple n'a pas une partie par laquelle il pourrait subir une modification et un changement, et une, autre par laquelle il demeurerait. Les autres regardent à la corporéité : car c'est par elle que la matière peut recevoir une empreinte des qualités corporelles. On peut dire encore que la participation ressemble aux ressemblances des portraits exécutés soit par la peinture soit par la plastique soit par quelque autre art : car les choses d'ici-bas, créées par la démiurgie divine et recevant une forme des espèces deviennent semblables aux dieux, et c'est par là que tout le diacosme sensible dans son tout est appelé l'image du diacosme intelligible. Cette définition diffère des précédentes en ce que celle-ci distingue du paradigme la cause efficiente, et celles-là exagèrent l'analogie des deux, comme s'ils ne faisaient qu'un. Et il faut que ceux qui aiment à connaître le fond des choses, sachent que chacune des opinions dont il a été question est imparfaite par elle-même, et qu'elle est impuissante à elle seule, à fournir à nos pensées la vérité tout entière sur cette participation. Car d'abord on voit que le mode d'action du miroir implique des distances et une étendue, par laquelle subsiste l'image. Donc il est impossible que dans une chose qui ne serait pus étendue, une telle apparition se produise. Ensuite, la personne se tourne elle même vers le miroir, tandis que la cause intellectuelle regarde on elle-même et non vers les choses du dehors, et si elle parait transmettre quelque chose, cette transmission n'est pas réelle. Maintenant les réflexions des rayons se produisent sur la personne même, comme le diraient les philosophes qui croient qu'aucune image venant de ceux qui regardent ne s'évanouit. Il est donc évident que ceci est étranger à la participation des espèces, puisque s'il y a participation, il y a image ; c'est dans le miroir que se produisent certaines effluves émanées de la personne qui tombent dans le miroir, ce qui ne convient pas aux espèces: car rien ne se divise et ne se sépare des espèces pour tomber dans les choses d'ici-bas, rien ne s'en écoule, puisqu'elles sont incorporelles et indivisibles. En ce qui regarde la seconde explication, l'empreinte du cachet convient aux hypothèses des Stoïciens, qui tiennent que tout ce qui fait une action la fait corporellement, que tout ce qui la souffre, la souffre corporellement ; car l'un et l'autre exige une pression, une réaction, un point d'appui : autrement le fait ne se produirait pas ; car il faut que l'agent pousse, que le patient repousse, pour qu'ainsi l'empreinte du sceau soit déposée dans la cire ; ensuite, c'est du dehors que l'agent agit, que le patient pâtit, tandis que l'espèce pénètre dans tout le substrat, et que son acte sur lui est tout interne. C'est du dedans que la nature informe le corps, et non du dehors, comme l'art, et en toutes choses c'est le participé qui s'approche lui-même du participant. Il faut en outre que les espèces soient détachées et élevées au dessus des substrats, et ne se mêlent à aucune des autres choses et même si le sceau recevait en lui quelque chose de la cire, il s'en faudrait de beaucoup qu'Il ressemblât aux espèces, dont la substance est sans mélange et ne peut rien recevoir d'étranger. Troisièmement: nous voyons encore que l'analogie tirée des images agit tout superficiellement tandis que les espèces informent, par une action interne. les substrats tout entiers, et qu'elle montre aussi, avant eux et séparément, le paradigme et la cause efficiente: car la cause paradigmatique séparément n'engendre pas une chose semblable à elle-même et la cause efficiente séparément n'assimile pas à elle même l'objet qui devient : mais les espèces divines sont en même temps paradigmatiques et démiurgiques des ressemblances: car elles ne ressemblent pas aux figures modelées par les ouvriers en cire : elles ont la substance efficiente et la puissance d'assimiler à elles-mêmes les choses inférieures Tout cela, comme nous l'avons dit, les visions dans un miroir, les sceaux, les images, il faut les considérer en premier lieu premier lieu comme un moyen de venir au secours des esprits plus faibles. et dire qu'ils nous servent tous à faire comprendre que c'est a leur ressemblance avec les idées que les choses spécifiées doivent leur hypostase: (car il n'y a qu'un mode pour toutes et c'est celui qui se montre par la ressemblance. Il faut savoir que ces explications métaphoriques n'ont rien de vraiment scientifique, qu'aucune ne saisit vraiment la participation véritable des espèces divines. Il semble donc que Platon, par ces explications en appelant les espèces images, tantôt les assimile à des peintures, tantôt à des empreintes, tantôt à des simulacres, puisque dans le Timée il dit que le Dieu, par le dodécaèdre, nous a représenté comme dans une peinture le Tout, que le réceptacle universel reçoit l'empreinte des idées, et dans le Sophiste, que le non réellement non être est un simulacre, parce qu'aucune de ces manières d'expliquer la participation ne peut par elle-même et par elle seule embrasser le vrai processus de la participation, et ne suggère aucun autre mode que ceux-ci. Sans doute si nous parvenons à découvrir le mode propre et souverain de la participation, nous verrons en quoi chacun de ceux-ci a touché la vérité, mais n'a pas su saisir le caractère particulier de la participation universelle. Il faut donc affirmer qu'une cause de cette participation est la puissance des espèces mêmes, des espèces primitives et divines, et qu'une autre cause est le désir de spécification des choses informées selon les espèces et participant d'elles : en effet d'une part la vertu efficiente et agissante des espèces n'est pas à elle seule suffisante pour opérer la participation ; car quoiqu'elles soient partout d'une manière semblable, les choses ne participent pas toutes d'une manière semblable; - d'autre part, la faculté de désirer des participants n'est pas non plus suffisante pour opérer la participation sans l'action efficiente des espèces; car le désir par lui-même est imparfait, et ce sont des principes parfaits et générateurs qui président a la spécification. Ceux donc qui font de la raison la cause finale, mais une cause qui n'est pas aussi démiurgique, ne saisissent qu'à moitié la vérité; car en attribuant aux choses sensibles le désir, ils ôtent à l'élément divin la puissance de l'action efficiente, et font l'hypostase des sensibles, œuvre du hasard . Et d'où leur vient donc le désir, si ce n'est du principe d'où vient leur hypostase et leur être? Et comment désireraient-ils une chose impuissante à engendrer, qui ne peut rien leur donner et ne leur donne en effet rien? Ceux qui font ce principe capable d'engendrer, mais qui refusent aux choses la faculté de le désirer, à leur tour, présentent un argument imparfait et absurde. Car d'abord, tout ce qui a une force efficiente exerce son efficace sur une chose qui est par nature capable de subir cette action de lui, sur ce qui peut recevoir son acte, de sorte que c'est le démiurge qui exercera cette action, et le sujet disposé, à quoi qu'il soit disposé, par cette disposition môme se porte lui-même vers ce qui peut exercer l'action, et cela par le désir : car le rapprochement a pour cause le désir de ce vers quoi il se rapproche. Ensuite toutes choses seraient constamment dans le même état, si chacune devenait uniquement selon l'action efficiente divine; car celle-ci étant toujours dans le même état, et présente à toutes choses, si la différence ne se produisait pas selon l'aptitude propre des choses, d'où viendrait la diversité qui a lieu en elles, et le fait que les unes participent toujours de la même manière, les autres de manières différentes selon les circonstances différentes ; car il est certain que dans les unes le substrat subsiste toujours de telle sorte qu'il est capable de retenir l'espèce et de toujours recevoir des espèces l'acte démiurgique; dans les autres, il est tantôt apte à participer aux espèces, tantôt à participer à leurs contraires ; car en puissance l'être est tout, en acte rien : il est plus ou moins saturé d'indétermination ; il admet tantôt ces raisons, tantôt des raisons diverses, désireux de jouir de toutes, impuissant à participer à la fois de toutes. Ainsi donc nous devons poser comme cause de la spécification non seulement le principe générateur de la démiurgie de la raison, (mais en outre le désir même que les choses éprouvent pour les espèces et les différences de leur aptitude; l'une de ces causes est agente; la nature du substrat est réceptive; elle n'use pas de pressions mécaniques, car elle est incorporelle, ni de penchants indéfinis, comme nous, car elle est impassible, ni d'une sorte de mouvements irréfléchis; car elle est parfaite : elle est réceptive par son être même. C'est pourquoi ce qui devient est l'image de la cause efficiente, confondue avec la pensée existant là-haut pour produire la substance : et voilà ce qui fait que, comme elle pense, elle agit et comme elle agit, elle pense et elle fait toujours l'un et l'autre. Ainsi le devenir devient toujours par elle : car le devenir est, en toute chose accompagné de la cause efficiente. De là vient que dans les choses qui subsistent selon le temps, instantanément se présente à côté d'elles l'espèce, les productions antérieures à sa présence ne faisant que supprimer les obstacles à cette présence. Car cette suppression, qui se fait instantanément, imite la génération en bloc et éternelle de toutes les choses, par l'aptitude qu'elle donne au réceptacle. D'où vient elle donc et comment devient-elle ? C'est le point qu'il faut examiner à la suite. Nous dirons qu'elle vient de la cause paternelle et efficiente : car toute la nature qui est le substrat sur lequel opère le démiurge, pour fonder notre opinion sur ceux qui ont la science des choses divines, est produite d'une part, par le Père intelligible, quel qu'il puisse être ; celui qui envoie dans cette nature des manifestations, c'est un autre père, qui est en même temps cause efficiente ; celui-ci qui est en même temps ποιητής;, cause efficiente et père, donne à cette nature l'ordre d'une façon universelle: - celui qui est seulement cause efficiente, parfait cette création par la démiurgie divisée, et la génération vient par les quatre causes suivantes: l'une est la matière, antérieure à toute spécification, qui est une sorte d'espèce informe, capable de tout recevoir, d'après le Timée; l'autre est ce qui a reçu les traces des espèces, et est quelque chose de grossier et de désordonné; l'autre est le monde en son tout, composé de touts, ἐξ ὅλων, et servant de paradigme unique en son genre et parfait ; l'autre est le monde composé de tous les animaux qui sont en lui et de toutes les causes diverses qui, avant le monde en son tout, créent tous les animaux immortels et mortels. Mais que sont ces causes, c'est ce que nous apprennent les enfants des Théologiens. Il ne faut donc pas se demander avec étonnement d'où viennent les diversités d'aptitudes ; car les choses d'ici-bas qui paraissent être plus permanentes sont les effets de puissances plus souveraines qui sont dans les intelligibles, par suite de la plénitude incirconscrite de ceux-ci, qui peuvent procéder jusque dans les choses du dernier degré, et qui par l'élément indéfini de leur propre nature peuvent imiter l'hyparxis ineffable de ces principes Le substrat possède ainsi des manifestations de ces principes j'entends l'un et pluralité des aptitudes différentes qui leur donnent le désir des espèces, le désir d'être comme saturées des raisons démiurgiques, et le désir de cette sorte de combinaison: aptitudes qui leur permettent de recevoir tout le monde visible et de participer à toute l'action de la cause efficiente. Et si maintenant nous désirons voir la force qui rassemble en soi la puissance démiurgique et l'aptitude des choses propres à la recevoir, nous trouverons que c'est le bien même, parce qu'il est la cause de toute union: car les choses destinées à recevoir, à cause de leur désir du bien, procèdent par des causes cosmiques, et les espèces démiurgiques opèrent par le bien même leur procession dans les choses inférieures, imitant la source de tous les biens, qui fait subsister tous les ordres divins par sa propre bonté, s'il est permis de le dire. Nous avons donc trois sortes de causes de la participation : la bonté parfaite des espèces, qui est la première; la puissance démiurgique des espèces; enfin l'aptitude des choses capables de recevoir les illuminations qui en viennent. La participation se produisant selon ces causes, tu vois comment il est possible de la comparer à un reflet et à une réflexion ; car l'aptitude et le désir qui leur vient d'en haut, devient à son tour la cause de leur conversion vers leurs causes ; et si on la compare à un sceau, c'est d'une autre manière ; car la puissance efficiente des causes communique aux choses capables de les recevoir les traces des espèces et les empreintes visibles produites par les invisibles ; enfin on peut, la comparer aussi aux images; car nous avons dit que la cause démiurge est celle qui produit la combinaison et comme le mélange des deux. Et c'est quelque chose de semblable que fait celui qui crée une image : il ramasse et fait en quelque sorte un tout du substrat et du paradigme : car en faisant le substrat susceptible de se prêter à l'action, il dépose en lui une empreinte semblable à celui-là de paradigme, de sorte que cette explication touche en quelque partie la vérité. Et si chacune à part est impuissante à faire comprendre le fait (de la participation) dans son tout, il ne faut pas s'en étonner. Car toutes ces explications sont divisibles et sensibles, et elles sont incapables d'embrasser la nature particulière et propre des causes invisibles et divines: mais ce serait déjà une chose heureuse, si, à l'aide du raisonnement , nous pouvions seulement la montrer. Et puisque, comme nous l'avons rappelé plus d'une fois, toujours les choses inférieures sont suspendues à celles qui les précédent, il est clair que nous suspendrons aux espèces divines les espèces célestes, que nous affirmerons que c'est d'elles qu'elles reçoivent toutes leur spécification, qu'a leur tour les espèces mortelles reçoivent des célestes l'infinie diversité de leurs générations et qu'ainsi le Cosmos dans son tout a reçu, comme dans son héritage, des espèces universelles tout l'ordre visible et phénoménal et l'espèce une qui enveloppe elle-même toutes les autres. Sur ce point donc ces explications suffiront . Puisqu'on établit habituellement trois modes de participation, l'empreinte, le reflet et la ressemblance, (car la cire participe de la forme empreinte par le cachet : l'eau reçoit les reflets des choses visibles, simulacres qui paraissent être et n'ont aucune existence réelle, et, troisièmement, la cire façonnée par le modeleur ou le tableau peint par le peintre, deviennent semblables à Socrate), et puisqu'il est clair en quoi diffèrent ces trois modes de participation, de cela seul, un des plus beaux esprits , a conclu tout de suite que la participation avait lieu de toutes ces manières : car les choses sensibles participent des espèces, mais des espèces physiques, à la manière d'une empreinte, puisque ces raisons pénètrent en elles à la manière d'un cachet; elles reçoivent des reflets , à la manière d'une spécification, mais des espèces psychiques : d'où vient qu'elles deviennent pour ainsi dire des simulacres des âmes, que ces espèces vivifient en leur donnant plus clairement la vie ; et en tant qu'images, elles sont faites semblables à ces espèces intellectuelles : c'est ainsi que Timée a dit que l'animal sensible est l'image de l'animal intelligible. C'est pourquoi dit-il, elles sont images des espèces intellectuelles, reflets, ἔνοπτρα, des espèces psychiques, empreintes, τυπώματα, des espèces physiques. Cela me paraît très ingénieux et surtout parce qu'il est facile de voir en toute chose ces trois modes liés et tissés les uns dans les autres ; car d'abord le corps d'un homme vertueux et sage apparaît certainement aussi lui même beau et aimable, parce qu'il participe immédiatement, directement, de la beauté physique qui imprime son empreinte dans la masse corporelle ; il reçoit des reflets de la beauté psychique, dont il porte la dernière trace, par l'intermédiaire de l'âme tournée vers le beau en soi. C'est pourquoi, par ce reflet, l'espèce de l'âme se montre être ou sage ou courageuse ou grave et digne, ou ayant quelque qualité semblable. C'est ainsi que la statue animée participe, à la manière d'une empreinte, si le cas se présente, de l'art qui lui imprime telle ou telle forme, soit à l'aide du travail du tour ou du ciseau ou d'un moule ; elle a des reflets de vie qu'elle tient du tout, et par lesquels elle est dite être animée, ψυχοῦσθαι, et elle est dans son tout devenue semblable au dieu dont elle est le portrait. Car les symboles par lesquels le magicien, τελεστής, le théurge, a consacré cette statue et l'a faite semblable à cet ordre, il les a travaillés et faits, les yeux fixés sur cet ordre, et par là il occupe un rang analogue à celui qui crée le monde comme une image selon le paradigme qui lui appartient en propre. Et sans doute il est plus beau et plus conforme à la théologie de ne pas traiter de ces modes de participation divisément, et de dire que les choses sensibles participent des espèces sensibles par leur présence, qu'elles en reçoivent des reflets, et que, comme images, elles leur sont rendues semblables. Car Platon dans cet ouvrage même a dit que les choses d'ici-bas participent purement des espèces, comme si ces espèces premières étaient participées selon tous les modes par les sensibles. Il y a trois ordres intermédiaires de dieux, l'un des Encosmiques, l'autre des Indépendants, ἀπόλυτοι, le troisième des Directeurs, ἡγεμονικοί. Par l'ordre des dieux Encosmiques, les choses d'ici-bas participent des espèces à la façon d'une empreinte; car ces dieux sont ceux qui président immédiatement à ces choses; par l'ordre des Indépendants, elles reçoivent des reflets ; car ces dieux les touchent parfois de quelque manière, parfois ne les touchent pas, et par leurs propres puissances, supérieures et détachées, fournissent aux sensibles des simulacres des espèces premières. Par l'ordre des dieux Assimilateurs, (car ce sont ceux que nous avons appelés hégémons) les choses sensibles sont faites semblables aux intellectuelles. Donc c'est par la source et la cause démiurgique une et première qu'ont lieu l'action de l'empreinte, le reflet, la ressemblance, et aussi par la bonté de cette source, qui est télésiurgique de l'univers. Voilà les considérations concises que nous avions à formuler sur ce sujet. Venons maintenant au texte et essayons, à l'aide de ces considérations, d'expliquer chaque mot en détail. Disons donc en commençant : les mots : il te semble, évoquent la maxime socratique, et poussent Socrate à regarder en lui-même ; car en examinant d'un regard plus continu cette hypothèse des Idées, il en a pris une intelligence plus parfaite ; le : comme tu dis, indique qu'il veut mener l'entretien selon les principes dont ils sont tombés en commun d'accord. Car il ne s'agit pas maintenant de le rejeter violemment hors de ses propres opinions, mais de découvrir les preuves qui sont la conséquence des principes qui leur sont communs : car c'est ici un accouchement, et non une réfutation, comme nous l'avons rappelé plus d'une fois. Les mots : qu'il y a certaines espèces, ont été dits plus haut par eux, parce qu'il s'agit des espèces de certaines choses et non de toutes, ni même de toutes celles dont l'un est cause. Quant au membre de phrase: « dont celles-ci, les autres », par le mot celles-ci, il indique leur caractère sensible et particulier, et par celui-là : les autres, leur nature séparée et divisée. Car leur éloignement de leurs vrais principes, les a fait, de leur totalité, tomber dans la particularité, et de leur union procéder dans toute espèce de déchirements et de différences : car ici règnent la discorde d'Empédocle et la guerre des Géants ; là-haut, l'amitié, l'union, et la déesse qui crée l'unité de toutes les choses. Il a été dit en outre que « les surnoms » de ces espèces, aussi bien que leur substance, ont été communiqués d'une façon tout à fait merveilleuse, δαιμονίως, et conformément aux principes de Platon, aux choses d'ici-bas. Car tous ceux qui estiment que les mots n'existent que par convention, θέσει, ont fait le peuple maître de cette convention, et prétendent que les noms tirent leur origine des choses sensibles. En effet ces choses, qui tombent sous les sens de la multitude, ont été les premières à recevoir les noms qui leur conviennent; et c'est décès noms, qu'en suivant certaines analogies, des gens avisés ont tiré et imposé des noms même aux substances manifestes. Si donc le Dieu est nommé chez eux : un animal éternel, c'est-à-dire sensible, celui-ci possédera principalement et éminemment cette dénomination, l'autre, (le Dieu), secondairement, et puisque c'est nous qui transportons le nom, en suivant l'analogie, il n'y a aucune importance à l'appeler animal, ou de quelque autre nom qu'on voudra lui imposer par convention. Mais à ceux qui disent que des noms différents sont adaptés par une convenance interne à des choses différentes, et que chacun porte une sorte d'image de la chose à laquelle il a été imposé, et porte en outre les significations, la valeur des éléments dont il a été formé et même de leur composition, telle qu'elle est, et aussi leur nombre, à ceux-là il a plu défaire de chaque nom une image de l'objet qui se présente par hasard : car la chose est précisément tout ce qui se présente par hasard. Ceux là feront donc remonter l'invention des noms à des gens sages et savants, comme le dit dans le Cratyle Socrate, qui rapporte au dialecticien l'invention des noms, et ils estiment que chaque nom est imposé primairement aux espèces immatérielles, secondairement aux sensibles. Car puisqu'on suppose que les inventeurs du langage sont des personnages instruits, versés dans la dialectique, il est clair qu'ils connaissent les espèces immatérielles et savent qu'elles sont certainement ce qu'elles sont, avant les espèces matérielles et phénoménales, et qu'il est plus possible de connaître et de nommer celles-là que celles-ci. En effet, ce que nous appelons ici-bas égal est rempli de son contraire : comment donc ce qui n'est pas purement égal, aurait il, dans le sens propre, le nom d'égal? C'est comme si on appelait feu, ce qui ressemble au feu, mais ne garde pas l'essence propre du feu. Tu as beau dire : homme, ce mot ne convient pas proprement à l'homme sensible : car l'homme phénoménal se dit en plusieurs sens et n'est pas l'homme. En effet les parties qui sont en lui et dont il est composé ne sont pas des hommes ; donc étant homme d'une seule manière, il est non homme en plusieurs ; mais l'homme en soi n'est pas homme sous un rapport et non nomme sous un autre : il est tel tout entier et dans toutes ses parties: quoi que tu saisisses de lui, c'est l'homme, de même que toute partie du beau est belle, et toute partie du mouvement est mouvement. En un mot aucune des espèces n'est formée de ses contraires : la raison ne consiste pas de choses sans raison, la vie de choses non vivantes, le mouvement de non mouvements, le beau de non beaux, de sorte que l'homme ne consiste pas de non hommes, ni aucune autre espèce de choses qui ne sont pas telles qu'elle est elle-même; car si elle vient de choses qui ne sont pas telles que l'espèce est dite être et est, elle sera un composé et n'aura la particularité qui la détermine qu'épisodiquement. Tu vois donc que le mot homme est dit au propre de l'espèce intellectuelle, et qu'appliqué à l'homme sensible, il n'est pas le nom propre et absolument vrai. Donc les noms, s'ils sont les représentations figurées rationnelles des choses, sont primairement les noms des espèces immatérielles, secondairement ceux des espèces sensibles. C'est donc des intellectuelles que les choses d'ici-bas tiennent leur substance et leur dénomination, comme le dit Platon et ailleurs et ici, où il prouve parles dénominations que le nom leur a été donné postérieurement, comme l'être leur a été postérieurement créé : c'est comme si quelqu'un s'efforce de donner un nom honorable à une chose qui n'est pas honorable : le nom donné à la chose non honorable n'exprime pas pour lui la même chose. Ici, l'homme, j'entends le mot, signifie autre chose comme portrait de l'espèce -divine, et autre chose comme portrait de l'espèce sensible. Et cependant beaucoup ont cru que Platon donne les mêmes prédicats et aux intelligibles et aux sensibles, ceux-ci croyant qu'il les emploie synonymiquement, les autres homonymement. Pour moi, je pense qu'il en fait des homonymes, mais dans un tout autre sens que celui qu'ils entendent. Car l'homme n'est pas un homonyme en tant que nom indifférent donné à deux choses distinctes, mais comme rendu semblable à l'une primairement, à l'autre secondairement; c'est pourquoi l'homme n'est pas la même chose lorsque nous l'entendons de l'intelligible et lorsque nous l'entendons du sensible. Car l'un est l'image d'une chose divine, l'autre d'une chose sensible. C'est comme si quelqu'un voyant Athéna elle-même, telle que la représente Homère : « Elle laissa tomber, sur le seuil de son père, son beau voile richement brodé , qu'elle même avait fait et décoré de ses mains ; elle revêtit la cuirasse de Zeus, l'assembleur de nuages, et se couvrit des armes pour la guerre ». Si quelqu'un ayant rencontra; cette déesse voulait peindre l'image de l'Athéna qu'il a vue et s'il la peignait en effet, et qu'un autre ayant contemplé l'Athéna de Phidias, — admettons qu'elle ait la même forme, — voulait lui aussi transporter et transportait cette forme sur un tableau leurs images, à des regards superficiels, paraîtront ne différer en rien, et cependant l'une, celle de celui qui a vu la Déesse, a une autre expression que l'image de celui qui imite la statue de bronze, laquelle a une ressemblance comme refroidie, par ce qu'elle est celle d'une chose sans âme. C'est par la même raison que le mot homme, qui est dit des dieux, est une image des deux, mais non de la même manière; car ce dont l'un est l'image est un paradigme : ce dont l'autre est l'image est le simulacre d'un simulacre. C'est ainsi que Socrate dans le Phèdre, interprète le nom l'Amour, tantôt d'une façon, en fixant son regard sur le divin Éros et l'appelant ailé, tantôt d'une autre façon, en ne considérant que son simulacre et la puissance du désir qui fait qu'on l'appelle amour, ἔρως. De même donc que l'être n'est pas le même, de même aussi le nom n'est pas le même: et de même que l'être vient aux êtres improprement êtres, de ceux qui sont proprement êtres, de même le nom vient aux choses inférieures de celles qui leur sont antérieures et supérieures . Et un mot. puisque nous voulons par les mots exprimer les conceptions distinctes que nous avons des choses, la distinction et la parfaite pureté langage appliquerait les noms primairement aux choses mêmes, mais non à ce qui enferme en soi un grand mélange avec son contraire, au blanc mêlé avec du noir, à l'égal mêlé avec l'inégal, et ainsi des autres qui sont de la même espèce. Et en effet, si l'on admet que c'est le peuple qui a imposé les noms, et non les hommes instruits, Platon dira que, comme les gens du Gorgias qui font ce qu'ils veulent, le peuple donne aux choses les noms qu'il lui plaît, mais non les noms qu'il veut : car lorsqu'il nomme ceci l'égal avec le sens primaire éminent, parce qu'il a la notion de l'égalité purement égalité, il impose à cet autre le nom de l'égal et croit le nommer lui-même a, tandis qu'il se réfère à ce qui est primairement égal ; car celui-là est exclusivement égal ou inégal. Mais que les noms s'appliquent primairement aux espèces intelligibles, et viennent de là avec la substance aux sensibles, c'est ce qui est évident par ce qui vient d'être dit. Il faut de plus savoir que tout cela est dit des noms des choses que notre âme est capable de connaître ; car il y a beaucoup de classes ordonnées des noms comme de nos connaissances ; les uns sont dits divins : ce sont ceux par lesquels les Dieux inférieurs dénomment ceux qui sont avant eux; d'autres sont angéliques, ce sont ceux par lesquels les anges se nomment eux-mêmes et nomment les Dieux : d'autres, démoniques, d'autres humains. Certaines choses sont exprimables, même à nous; les autres, ineffables, et en général, comme l'enseigne le Cratyle , et, même avant le Cratyle, une tradition venue d'en haut, il y a chez les Dieux une faculté de connaître et une faculté de nommer, ὀνομασία, qui diffèrent des nôtres et leur sont bien supérieures. § 64. -- « (Tu dis donc) par exemple, que les autres choses, (celles d'ici-bas), ayant participé de la ressemblance, deviennent semblables, ayant participé de la grandeur, deviennent grande?, de la beauté et de la justice, deviennent justes et belles? — Parfaitement, dit Socrate ». A l'occasion de la ressemblance il a été déjà dit plus haut , que sa fonction particulière est de rendre les choses deuxièmes semblables aux premières et de conserver l'unité du lien qui lie le tout: de là vient qu'elle n'est pas un pur accident des choses d'ici-bas, mais que c'est une force qui achève de constituer la substance des choses individuelles ; car le parfait pour chaque chose vient s'ajouter à elle, selon son assimilation à l'espèce intellectuelle. Car de même que la fin, τέλος, (la perfection) de l'âme, est sa ressemblance à la raison, de même le bien de toutes les choses sensibles est leur ressemblance aux espèces intellectuelles et divines. D'où leur vient donc cet élément commun, qui achève leur essence, si ce n'est de la ressemblance intellectuelle, ou, si tu aimes mieux, d'où vient cette puissance qui complète leur substance? car l'être de chaque chose est déterminé par cela, je veux dire, par le fait qu'elle ressemble aux intelligibles, et c'est par là que chacune est ce qu'elle est. En ce qui concerne la grandeur, il faut que ceux qui aiment la vérité sachent qu'elle n'est pas purement la cause de l'étendue; car la grandeur n'est pas ce que les enfants des géomètres entendent par là : ceux-ci appellent grandeur tout ce qui a une extension quelconque, soit ligne, soit plan, soit solide. Mais Platon n'a pas l'habitude de nommer grandeur l'espèce cause de toutes les étendues, mais celle qui communique aux choses un excédent dans chaque sens : ainsi que dans le Phédon, il nomme habituellement une chose grande à cause de sa grandeur, et dit qu'une chose devient plus petite par la petitesse, quoique dans la plus petite il y ait encore quelque étendue : et si même il y a en elle de la grandeur géométrique, ce n'est pas la grandeur en soi. mais pour ainsi dire la cause de l'excédent et d'une supériorité de puissance qui commence aux dieux et procède jusqu'aux derniers degrés des choses. C'est ainsi que lui même dans le Phèdre surnomme Zeus le Grand hégémon, comme surpassant les autres hégémons et étant plus hégémon qu'eux tous, et dans le Banquet, il surnomme Éros le grand Démon, parce qu'il enferme en lui la sommité du démonique, et si nous habituellement disons, des âmes qu'elles sont magnanimes, qu'elles ont un grand esprit, ce grand est en elles quelque chose de tout à fait propre : et nous le disons surtout, par suite de la grandeur de leurs actions et de la grandeur de leur valeur morale : c'est pour cela qu'il attribue, dans la République , une grande valeur morale aux natures philosophes, parce qu'elles possèdent la grandeur et la hauteur. Et si dans les corps, l'un est plus grand que l'autre et le surpasse par la même grandeur, comme dit Socrate dans le Phédon, le grand signifie ici le rang et l'ordre de ces choses. C'est donc d'en haut qu'elle descend et pénètre jusque dans les choses dernières : dans les dieux, sous le mode unié, c'est-à-dire qu'on la considère ici selon l'excédent de l'union ; dans les démons, dans le sens de puissance, δυνατῶς, c'est-à-dire d'après leur puissance; car il y a une puissance propre aux démons, et le plus grand en eux est le plus puissant ; dans les âmes, sous le mode vital ; car le plus grand en elles se détermine selon l'espèce la plus haute de leur vie: dans les corps, selon l'extension. Car que l'excédent se montre selon l'union, ou qu'il se montre selon la puissance, qu'il se montre selon l'espèce de la vie, qu'il se montre uniquement selon le combien grand et selon l'extension, partout la grandeur communique le même caractère particulier. Si donc elle est quelque chose de commun, quelque chose qui pénètre en tout, elle a une cause intellectuelle qui est placée avant elle et la domine. Autre considération : la beauté en soi est pour les espèces le chorège de l'harmonie des proportions et de l'union, de l'aimable perfection, qui donne même aux âmes le beau qui leur appartient, qui allume d'elle-même la lumière qui fait la beauté des corps et ce qui est pour ainsi dire leur fleur ; elle plane et voyage au-dessus de la pluralité des espèces, et y crée une raison plus puissante que les causes matérielles; car il faut que la prédominance de la raison et de l'espèce devance et gouverne la présence de la beauté ; c'est pour cela que les choses célestes sont plus belles que celles d'ici-bas ; car l'espèce là-haut prédomine complètement et maîtrise la nature qui sert de substrat; et c'est pour cela aussi que les choses intelligibles sont plus belles que les célestes, car elles sont uniquement espèces. C'est donc là ce primairement beau, dont la splendeur se manifeste le plus évidemment, le beau au sens propre et le souverainement beau ; car le beau ici-bas est mélangé avec la laideur ; car de même que partout la matière participe du beau par l'influence de l'espèce, de même, l'espèce se remplit de laideur par l'influence de la matière ; car elle est par elle-même laide et privée de beauté, il reste donc la justice dont nous disons qu'elle est cause, pour les espèces, de leur action propre. Car c'est par la justice que chaque espèce est en elle-même et crée ce qui est son objet propre à elle-même : car on ne peut pas dire que la grandeur fait les choses petites, que la petitesse communique aux choses l'excédent, ni que la ressemblance divise et sépare les choses premières des choses secondes, ni que la dissemblance rassemble en un et unit: chacune des idées accomplit son œuvre propre, met en jeu son acte propre, se retourne sur elle-même et s'appartient à elle-même. Et il en est ainsi non seulement des espèces intelligibles, mais même dans le ciel, toutes les puissances font chacune ce qu'il leur appartient de faire, comme Socrate le dit dans le Phèdre, et parmi nous, hommes, il y a justice lorsque les parties observent et conservent leur acte propre et la forme qui leur convient, et il en est de même de l'État. Le juste est donc télésiurge des espèces et de la vie, quelque chose de commun et qui pénètre à travers toutes choses. Donc il y a avant le juste et qui le domine, une sorte d'image de lui, une et intellectuelle, selon laquelle toutes les choses justes sont dites justes et le sont. § 65. — « Ainsi donc chaque participant participe ou de l'espèce totale ou d'une partie, à moins qu'il n'y ait une autre manière que celles-là de participer? -- Et comment y en aurait-il une autre, dit-il. » Sur l'argument précédent et sur celui qui est proposé maintenant je vois, dans les commentaires, la même divergence sentiments ; les uns acceptent les deux propositions conjointes (du jugement hypothétique) , mais repoussent la mineure, et les autres, acceptant la mineure, contestent la position des deux propositions mêmes du jugement hypothétique. Ainsi le premier argument étant composé par eux à peu près comme il suit : s'il y a des espèces, il y a des espèces de tout : or il n'y en a pas de tout, comme tu le reconnais toi-même : donc il n'y a pas d'espèces. Ceux-là acceptent la position du jugement hypothétique : ce sont ceux qui admettent qu'il y a des idées de tout; mais ils n'admettent pas la mineure, et disent que par là même Socrate est justement attaqué, comme ne posant pas des idées de tout : ce sont ceux qui approuvent Parménide, et considèrent que les ménagements qu'il emploie vis-à-vis de Socrate n'ont pas de raison d'être. D'autres, à l'inverse, acceptent la mineure, mais repoussent comme non fondée toute la proposition hypothétique : car ils disent que ce συνημμένον «s'ily a des espèces, il y a des espèces de tout», est faux ; tandis que la mineure : « or il n'y a pas des espèces de tout est vrai ; » ceux-là approuvent Socrate dans son refus, et repoussent l'objurgation de Parménide. Nous avons dit plus haut comment se justifie le refus de Socrate, et que l'objurgation et la critique de Parménide sont néanmoins divinement fondées, et en outre que l'argument ne va pas à nier les espèces, mais se propose seulement l'examen du deuxième problème. Maintenant, d'après le second argument du troisième problème, qui est celui-ci : « Si les espèces sont participées par les sensibles, ou elles sont dans leur totalité participées par eux, ou seulement en partie : or elles ne sont ni tout entières, ni en partie participées : donc elles ne sont pas du tout participées », d'après cet argument dis-je, les unes (de ces interprétations) adoptent les propositions de l'argument hypothétique, mais suppriment la mineure, les autres font le contraire. Les unes disent: le συνημμένον est vrai : « Si les choses d'ici-bas participent des espèces, ou elles participent d'elles dans leur entier, ou seulement de parties d'entre elles » ; car il n'y a pas d'intermédiaire entre le tout et la partie, puisque partie pour elles, c'est le non tout. Mais la mineure : « Or elles ne participent ni des espèces entières, ni de parties d'entre elles »est fausse : car elles participent d'elles dans leur totalité ; comment l'homme tout entier ne serait-il pas dans chacun des hommes particuliers ? comment l'espèce du cygne ne serait-elle pas tout entière dans les cygnes, et ainsi des autres espèces. Celles qui contestent le συνημμένον en admettant la mineure, disent : il est faux de dire : « Si les choses d'ici-bas participent des espèces, elles en participent dans leur totalité ou en partie » ; car, disent-ils, il y a d'autres modes de participation : mais la mineure est vraie, qui ajoute : « or, elles n'en participent ni dans leur totalité ni partiellement », elles ont un autre mode de participation qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux-ci. Si ces argumentations sont exactes, il en résulte que ces deux interprétations condamnent les deux interlocuteurs, Socrate et Parménide lui-même, l'un parce qu'il fait un sophisme, l'autre parce qu'il s'y laisse tromper. Parménide avertit Socrate de ne pas prendre en considération les opinions des hommes, mais d'avoir toujours les regards fixés sur la nature même des choses. Et ce n'est sans doute pas par une raison spécieuse et vulgaire, qu'il blâme Socrate en le voyant éloigné de la vérité des choses. Il vaut donc mieux dire que par cet exercice dialectique. sur le deuxième problème, partant dans sa discussion d'en haut, des espèces les plus universelles, il est arrivé dans le développement de son raisonnement en passant par les espèces moyennes et les espèces indivisibles divines, à celles qui, par leur faiblesse et leur abaissement ne sont pas susceptibles d'avoir une cause spécifique, et ne peuvent être placées que dans l'ordre des choses qui naissent des espèces. Inversement, en partant d'en bas, dans le troisième problème, après avoir montré de quelle manière a lieu la participation des espèces, qu'il ne faut la croire ni corporelle ni matérielle, ni toute autre de celles qui conviennent aux hypostases secondes, troisièmes et divisibles, il fait comprendre qu'il faut en concevoir une distincte et séparée, supérieure, convenant uniquement aux espèces démiurgiques, primaires et autres. Car, à ce qu'il me semble, il y a beaucoup de modes des participations : et en effet les dieux sont dits participer des dieux par un certain mode ; par un autre, les anges participent des dieux; par un autre, les démons, des anges ou des dieux ; par un autre, les âmes, des démons ou des dieux ; par un autre, les choses sensibles, des âmes, des anges ou des genres supérieurs, ou des dieux mêmes ; par un autre, les corps, des corps. Il faut donc que nous examinions quel mode de participation nous devons admettre pour les espèces, afin de résoudre parfaitement le troisième problème, et avant tout, si la participation des espèces est corporelle, et si les choses d'ici-bas participent des espèces, comme le corps participe du corps. Il est dans la nature de celui-ci de participer de deux manières ; car il attire en lui-même le corps participé tout entier ou une partie : en effet lorsque nous avons faim, nous participons de l'aliment tout entier ; car le participé étant plus petit peut pénétrer et entrer dans le plus grand ; et puisque nous sommes composés d'éléments tout entiers, nous participons de chaque partie de ces éléments; car le feu qui est en nous vient du feu universel, de même l'eau et ainsi de chacun des deux autres. Et c'est nous qui participons de ces touts, et non les touts qui participent de nous, comme Socrate le dit dans le Philèbe. Donc dans les participations corporelles, la participation a lieu du tout ou d'une partie, et si le corps ne participait ni du tout ni d'une partie, il n'y aurait pas de participation corporelle des espèces; et ainsi on passera à un autre mode, puis encore à un autre mode, jusqu'à ce qu'on ait démontré qu'aucun ne convient à la participation des espèces proposée. C'est donc pour cette raison que Parménide, dans cet endroit, excitant Socrate à une conception plus parfaite, ajoute « à moins qu'il n'y ait quelque autre participation, outre celles-ci », l'accouchant pour ainsi dire, et le poussant à concevoir la participation incorporelle. Et celui-ci, voyant qu'il en est ainsi dans les incorporels, se prête à l'interrogation et s'abandonne au courant des preuves des hypothèses, qui vont lui faire faire un pas en avant, en se développant : car il a été démontré que les choses d'ici bas ne participent des espèces ni en totalité ni en partie, de la même manière dont les choses corporelles participent de celles qui leur sont semblables, puisqu'il est possible qu'elles en participent d'une autre manière, comme nous l'expliquerons clairement en poursuivant notre exposition. FIN DU PREMIER VOLUME PROCLUS COMMENTAIRE SUR LE PARMÉNIDE LIVRE QUATRIÈME (suite). § 66. — « Crois-tu donc que l'espèce tout entière, qui est une, soit dans chacun des plusieurs, et comment y sera-t-elle? — Mais, dit Socrate, qu'est ce qui empêche, Parménide, qu'elle y soit? — Alors, étant une et la même dans plusieurs choses qui sont séparées, elle y sera cependant tout entière, et ainsi elle sera séparée d'elle-même. » Si l'on n'entend pas corporellement l'unité du tout et de la partie, mais comme il convient aux espèces intelligibles et immatérielles, on verra que les choses d'ici-bas participent du tout et de chaque partie de leur propre paradigme. Mais puisque celui-ci a la fonction de cause, que celles-là viennent de la cause. et que nulle part les causés ne reçoivent la puissance totale de leurs causes, les choses d'ici-bas ne participent pas de l'espèce tout entière. Car comment le sensible peut-il recevoir les vies et les puissances de l'espèce? Comment est-il possible que se produise dans la matière le caractère uniforme et indivisible de l'espèce? Et cependant puisque les choses d'ici-bas gardent le caractère particulier et propre selon lequel le juste intelligible est dit juste, le beau intelligible est dit beau, selon leur propre puissance et signification, on devrait dire au contraire qu'elles participent des espèces dans leur totalité et non de parties d'elles : car le caractère particulier du beau est partout et dans toutes, mais ici intellectuellement, là matériellement. Et il est clair que les participations des espèces plus parfaites participent plus que celles des plus éloignées, que les unes en participent selon un plus grand nombre de puissances, les autres selon un moins grand nombre;car le beau en soi est une espèce intellectuelle, cause vivifiante de la proportion. Donc l'espèce et ce qui crée la proportion se trouve dans tout beau; car c'est là un caractère particulier et propre de la beauté en soi, de sorte que chaque chose individuelle participe de son caractère particulier tout entier; mais l'espèce intellectuelle, elle, n'est plus présente en tout beau, mais au beau psychique; car le beau, en elle, est semblable à l'un, (ἑνοειδές) ; l'espèce vitale non plus n'existe pas dans tout beau, mais dans le beau céleste; et s'il y a quelque part quelque chose de tel parmi les choses engendrées, on pourra dire que la lumière du beau se trouve dans l'or et dans certaines pierres précieuses. Ainsi donc les choses participent, les unes de l'espèce intellectuelle et vitale, les autres de l'espèce vitale sans l'intellectuelle, les autres, seulement du caractère particulier propre du beau: les plus immatérielles reçoivent un plus grand nombre do puissances que les matérielles, et par conséquent les choses inférieures participent des espèces qui leur sont propres, soit en totalité soit par partie. Voilà ce que doivent dire ceux qui peuvent fixer leurs regards sur la substance incorporelle des espèces. Ceux qui croient que la participation est corporelle doivent dire qu'il n'est pas possible que les choses d'ici-bas participent soit de la totalité soit des parties de l'espèce. C'est ce que montre Parménide guidant Socrate et le menant comme par la main à la découverte du mode le plus vrai de la participation des espèces. Et d'abord il montre que la participation n'est pas la participation de la totalité des espèces ; car c'est là ce que dit d'abord Socrate, que rien n'empêche de les poser ; mais Parménide conteste qu'on les puisse poser, par la raison : « qu'une seule et même chose sera à la fois tout entière dans plusieurs qui sont séparées », ce qui est souverainement absurde. En effet « il y aura quelque chose qui sera en dehors de lui-même ». En effet si ce doigt ou quelqu'une des choses qui sont dans quelque autre, soit partie corporelle soit puissance, est en même temps dans plusieurs qui sont séparées, elle sera en dehors et séparée d'elle-même; car la puissance, qui est dans un substrat, sera séparée des substrats et d'elle-même ; mais si elle est dans les deux, elle ne pourra être séparée ni de l'un ni de l'autre. Or le corps est tout entier dans tel ou tel lieu, et il est impossible qu'il soit dans un autre. Car si on ne nie pas que plusieurs corps puissent être dans un seul et même lieu, il est impossible que le même soit dans des lieux différents. Il est donc impossible que l'espèce puisse être corporellement tout entière dans plusieurs substrats. Et fais-moi bien attention au sens précis et rigoureux des termes : il ne s'est pas contenté de dire que partout une seule chose, mais il a ajouté: « et la même » ;il ne s'est pas contenté de dire: « dans plusieurs », il a ajouté « séparés » ; il ne s'est pas contenté de dire « elle sera tout entière », il a ajouté; « en même temps » ; car il est possible qu'elle soit dans plusieurs sous différents rapports, mais non selon le même. Au contraire dans les choses qui dépendent les unes des autres, elle sera selon le même : par exemple : la lumière immatérielle et divine est à la fois dans le lieu de l'air et dans l'air même. Puis ensuite, il montre qu'elle ne sera pas tout entière, mais qu'une partie sera dans une chose, une autre dans l'autre, les deux étant à part l'une de l'autre ; et à son tour, qu'elle n'y sera pas en même temps; car il est possible que la même chose se trouve dans des choses différentes en des temps différents; et qu'elle est une, ἕν : car elle ne sera pas telle si elle est dans quelque chose, mais si elle est dans elle-même, et alors il est possible qu'elle soit partout, et en toutes également. Et si tu veux voir le fond mystérieux de la vérité, divise le texte de Platon, et représente-toi la chose comme il suit : Puisque les espèces ont primairement leur hypostase dans le paradigme des intelligibles, comme nous l'avons appris dans le Timée, assurément chacune des espèces premières est et une et étant, ἕν, et entière, ὅλον ; or étant telle, il est possible qu'elle soit et la même dans plusieurs séparés et qu'elle y soit en même temps la même, mais cela d'une manière particulière et supérieure, ἐξῃρημενως, qui lui permet d'être et partout et nulle part, d'être présente à toutes les choses sans être mêlée, à elles, et sans être soumise à la loi du temps, ἀχρόνως. Le terme ἔνεσται ajouté, elle sera dans, qui fait l'espèce être dans un autre lieu, démontre la parfaite absurdité du raisonnement : c'est pour cela qu'il conclut par induction : « et ainsi elle sera elle-même en dehors d'elle-même ». Car ceci ne se trouve pas dans les premières hypothèses, à savoir que chacune des espèces divines étant en elle-même est aussi présente en toutes choses; et ce qui est cause qu'elle n'est pas dans plusieurs, c'est qu'elle n'est pas en elle-même : car ce qui. par sa nature, est la chose de celui ci, il n'est pas possible qu'il soit la chose d'un autre : voilà les arguments de Parménide. Les réponses de Socrate essaient de réfuter ces instances : sont-elles justes ou non, c'est ce que le cours du dialogue montrera ; car il ne s'arrêtera pas à ce mode de participation ; mais il maintient la même hypothèse, quoique Parménide ait cherché, par beaucoup d'objections, à l'ébranler déjà plus haut, par la phrase : « à moins qu'il n'y ait quelqu'autre participation, outre celles-ci » et plus loin, en ajoutant : « Et comment,» car ces mots ne sont pas ajoutés en vain et amenés par l'entraînement habituel de la conversation: mais ils veulent stimuler l'esprit qu'on veut accoucher, pour le faire passer à des considérations plus hautes. §. 67. «Non pas dit-il, si du moins il en est d'elle comme du jour, qui, tout en étant un et le même, est cependant en plusieurs lieux à la fois, et n'est en rien pour cela séparé davantage de lui même, — si, dis-je, il en est ainsi, chacune des espèces sera en toutes les choses (qui lui sont subordonnées) en même temps la même . » Socrate croit avoir trouvé quelque chose qui peut être en même temps en toutes les choses (qui lui sont subsumées) et qui sont séparées les unes des autres ; car dans toutes les choses qui sont sous le même méridien, qui sont plusieurs et à part les unes des autres, le jour se trouve à la fois le même et en même temps le même. Si donc, maintenant, le bien est analogue au soleil, si les espèces sont analogues au jour et à la lumière (car elles aussi éclairent l'élément ténébreux de la matière, et chacune est lumière comme celle-là est ténèbres, et elles sont rattachées à l'un par le fait qu'elles sont suspendues à leur principe propre), tu pourras affirmer que l'image est parfaitement juste. Mais comme il n'a pas fait attention qu'il ne conserve plus le tout présent le même et un dans les plusieurs, sur ce point Parménide relève son erreur. Car si l'on dit que le jour est une partie du temps, il ne sera pas vrai qu'il est présent à toutes choses tout entier : car le point au sommet est, rigoureusement parlant, diffèrent selon les différentes circonstances, et si ce point diffère, tous les centres seront différents : car c'est par rapport à lui que tout le reste est déterminé ; et si tu définis le jour : l'air rempli de lumière, celui-ci encore davantage n'est pas tout entier présent en toutes choses, mais il se rapproche, par différentes parties de lui-même, de différentes parties de l'espace. Voilà donc les objections que Socrate oppose à l'argument de Parménide. Et d'abord il est clair qu'il emprunte son exemple à l'argumentation de Zénon : car celui-ci voulant montrer que les plusieurs participent de quelque un et ne sont pas dépouillés de l'un, quand même ils seraient séparés les uns des autres par une longue distance, a dit dans son discours qu'une seule et unique blancheur est présente à nous et aux antipodes, comme la nuit et le jour. Toutefois si Socrate a fait usage de l'exemple de Zénon, ce n'est pas afin que ce ne soit pas Zénon qui soit réfuté par son chef d'École, comme ayant pris un exemple qui ne convient pas à l'hypothèse des espèces, mais afin que ce soit Socrate au lieu de Zénon, comme certains l'ont pensé : car qu'est ce qui empêchait Parménide, s'il n'était pas satisfait de l'exemple, de faire voir plus tôt à Zénon cette négligence et de la rectifier avant la lecture. Mais, à ce qu'il me semble, Zénon, entendant son exemple de l'espèce matérielle qui, dans la réalité vraie, est un et non un, et participée divisément en tant que subordonnée et n'existant pas par elle-même, s'est servi très correctement et sans s'exposer à être réfuté, de l'exemple du jour et de la nuit pour cette sorte d'espèce, Mais Socrate a tort de s'en servir, parce qu'il l'applique à l'espèce en soi, à l'espèce qui, étant indivisible et une, est à la fois présente aux plusieurs. C'est pour cela que Parménide relève son erreur, parce qu'il ne maintient pas , par cet exemple du jour et de la nuit, l'unité et l'identité de l'espèce, et qu'au lieu de l'indivisible, il produit dans l'argumentation le divisible, au lieu de l'un ce qui est à la fois un et non un; telle que la blancheur qui est chez nous et aux antipodes. En effet nous avons dit précédemment que le but du discours de Zénon n'est pas de remonter à l'espèce une des séparables, en faisant voir la contradiction impliquée dans la thèse de la pluralité, mais de remonter à l'un qui coexiste avec les plusieurs et qui en est inséparable ; mais Socrate a posé une espèce autre que celle qui est chez nous, et dont l'hypostase ne saurait être comme celle du blanc, qui est chez nous et aux antipodes, et qui est celle que Zénon a comparée au jour et à la nuit. Voilà comment il faut entendre ce passage. Maintenant il nous faut examiner le texte, dont la constitution a quelque difficulté Et d'abord il faut lier le tout ensemble par la figure de l'hyperbate. Car Socrate dit que l'absurdité que signale Parménide ne se produirait pas « Si, ainsi que l'est le jour, chacune des espèces était à la fois en toutes choses la même » ; il faut deuxièmement observer que le : « si ainsi » doit être, par l'épanalepse, compris comme : « si cette espèce, dont il s'agit ». Car dans les apodoses, qui sont exprimées par plusieurs mots, les épanalepses sont fréquentes. Troisièmement le membre de la phrase:« est à la fois en plusieurs choses, tout en étant un et le même » qui est placé au milieu, doit être entendu par la figure de l'apostase, et interprété dans le sens selon lequel :« un seul est en même temps présent en plusieurs ». Et si l'on entend ainsi le texte, on en verra la beauté, qui naît du membre intermédiaire par l'apostase, et de l'apodose qui suit, par l'épanalepse. §. 68. « Tu as une manière tout à fait ingénieuse, dit-il, mon cher Socrate, de faire qu'une seule et même chose soit à la fois en plusieurs : c'est comme si, étendant un voile sur plusieurs hommes, tu disais qu'il est un et tout entier sur les plusieurs : n'est-ce pas ainsi que tu l'entends? — Sans doute, dit-il. — Mais est-ce donc que le voile serait tout entier sur chacun des hommes, ou une de ses parties sera t-elle sur l'un d'eux, une autre sur un autre? — Une de ses parties. ». Parménide a bien vu le fond de vérité qui est dans les pensées spontanées de Socrate, mais aussi ce qu'elles ont d'incomplet et d'inexact : il reconnaît l'un et veut le développer ; mais il veut aussi redresser et compléter l'autre. Car puisqu'il a imaginé la procession de l'espèce une en toutes choses et sa présence une partout, pour cette raison, il lui dit qu'il a une manière tout à fait spirituelle de faire qu'une seule chose soit tout entière dans plusieurs, en entendant que le mot : spirituellement, veut dire : naturellement et ne signifie ni niaisement ni ridiculement. Il part d'une âme qui se représente en imagination la cause intelligible présente à la fois partout, et qui se tourne déjà vers l'entendement et vers la raison. Car selon la nature de la faculté qu'on met en acte, on comprend que telle est la nature des êtres ; si c'est la sensation qu'on met en acte, on admettra que telle est la nature des êtres, c'est-à-dire divisible et matérielle ; si c'est seulement l'entendement, leur nature sera à la fois indivisible et divisible ; si c'est la raison, leur nature restera uniquement indivisible. Ainsi donc, puisque Socrate a exprimé les pensées qui partent du fond do son âme, il a déjà soupçonné la présence une et complète en toutes choses des espèces intellectuelles: mais comme il n'a pas donné à sa pensée son développement complet, et a conçu la présence comme une présence dans l'espace, Parménide le renvoie au voile, et lui montre qu'il n'est pas un et tout entier dans plusieurs, mais qu'il est en communication par ses parties avec les plusieurs. Et il n'a pas dit : Est-ce quelque chose de tel que tu conçois ? Car il connaît l'état de grossesse où il se trouve, et la pensée qu'il a formée spontanément sur ce sujet ; mais il lui dit : Est-ce quelque chose de tel que tu veux dire, comme trompé par l'imagination, et concevant une chose et en disant une autre, parce qu'il n'a pas encore pu voir les différentes parties dont se compose sa pensée intérieure. C'est ainsi que pris des deux côtés, par ses pensées qui naissent du fond de son esprit et par les représentations mobiles de son imagination, il a prononcé un mot qui témoigne de ses hésitations ; car le « sans doute » dit quelque chose de semblable ; il ne veut pas en effet affirmer absolument qu'il en est ainsi, parce qu'il est ébranlé par sa propre pensée qui est poussée en sens divers à ce sujet, et qu'il ne peut pas renoncer à sa représentation d'une participation que l'imagination lui montre dans l'étendue. De là vient la réponse équivoque qu'il fait à Parménide. Le voilà donc poussé à dire que la participation est la participation de parties des espèces et non des espèces tout entières, parce que Parménide, par un chemin silencieux au moyen de l'exemple du voile, a eu l'art de l'amener à l'autre partie de la division ; c'est pour cela qu'il ajoute comme conclusion : § 69. — « Les espèces en soi, dit-il, mon cher Socrate, sont donc divisibles, et les choses qui en participent, participent d'une partie d'elles : l'espèce n'est pas toute entière en chacune, mais seulement une partie de chacune. — Il semble que la chose est ainsi. — Voudras-tu donc, dit-il, mon cher Socrate, que l'espèce une soit réellement divisée en parties par nous, et qu'elle reste cependant encore une ? — Nullement, dit il ». Le second membre de la division montre qu'il n'est pas possible que les choses d'ici-bas participent d'une partie ou de parties des espèces, parce qu'il pose, comme moyen, l'indivisibilité des espèces et par là détruit l'hypothèse présentée. Car si les espèces sont indivisibles et sont des monades, comment sont-elles encore par des parties d'elles-mêmes participées par des choses différentes : par exemple, l'homme, s'il est un. comment est-il divisé en plusieurs ? et comment chacun de nous est-il dit homme, et non partie d'homme, puisque chacun de nous n'a qu'une partie et non le tout de l'homme ? Et si nous sommes séparés les uns des autres, si de cet homme ceci est en moi, cela est en toi, cela est encore dans un autre, la participation étant conçue s'opérant à la manière d'une chose étendue, comment l'espèce demeurera-t-elle une, puisqu'elle est partagée et répartie en nous, qui sommes divisés et séparés les uns des autres ? Ainsi le feu n'est pas un , parce qu'une partie de lui est ici, une autre partie dans un autre lieu : l'eau, semblblement et aussi l'air ; ces choses sont divisibles par leur propre nature : l'espèce est indivisible; elles sont pluralité, possédant l'un comme ajouté: l'espèce est quelque chose d'un, enveloppant la pluralité sous la forme de l'unité. Dans les choses divines, c'est de l'un et de l'hyparxis que la procession commence ; car si la pluralité préexistait à l'un, l'un n'aura qu'une existence adventice, inessentielle. Donc en disant : « Les espèces seront donc divisibles », et en ajoutant : « Voudras-tu donc que l'espèce une soit réellement divisée », il nous fait entrer, avec une sorte de honte, dans la pensée de cette hypothèse absurde. Car si nous disons que l'homme d'ici-bas et chacune des espèces matérielles est divisible, il est absurde de dire que les espèces en soi, qui sont immatérielles, soient divisibles, et si nous disons que l'espèce en soi est divisée parce qu'elle est participée divisément par les choses d'ici bas, ce ne sera pas une division réelle et vraie. Tu comprendras par là comment les mythes parlent de dieux divisés, de dieux déchirés, quand les choses inférieures participent d'eux divisément, se répartissant entre elles les causes indivisibles des choses divisibles présubsistant en eux. Car en réalité ce ne sont pas les dieux qui se divisent, mais les choses qui se divisent en eux. § 70. — « Regarde en effet, dit-il : si tu viens à diviser la grandeur en soi, et si chacune des choses plusieurs grandes est grande par une partie de la grandeur plus petite que la grandeur en soi, est ce que cela ne te paraîtra pas absurde? — Absolument, dit-il. » Comme il veut démontrer qu'il est absurde de poser la substance spécifique comme une chose divisible, il applique son raisonnement à la grandeur et à la petitesse, parce que chacune de ces notions est conçue sous la catégorie de la quantité. Mais la quantité ne peut avoir une partie identique au tout, tandis que la partie de la qualité semble conserver la même puissance que le tout ; de là vient qu'une partie du feu est plus petite selon le quantum, mais conserve l'essence du feu selon le quale. Donc quand il s'agit de la grandeur, de l'égalité, et naturellement aussi de la petitesse, il réfute ceux qui disent que les espèces sont divisibles, afin de fortifier par là le développement de son argumentation. Car si les espèces qui paraissent le plus être divisibles, parce qu'elles impliquent la notion de la quantité, si celles-là, qui sont dans les choses sensibles, ne peuvent pas être divisées, à plus forte raison, assurément, seront absolument indivisibles celles dans lesquelles il n'est pas possible de faire entrer la notion du combien grand, telles que le juste en soi, le beau en soi, le semblable et le dissemblable en soi ; il pose donc la question : comment les espèces qui appartiennent à la grandeur en soi, sont participées par les choses d'ici bas. Ainsi donc, c'est réellement sur les choses qui paraissent être de la catégorie de la quantité, et non sur d'autres, quelles qu'elles soient, qu'il fait porter son argument. Et d'abord sur la grandeur. Supposons que la grandeur soit corporellement divisible: alors la partie est plus petite que le tout ; par conséquent le tout est plus grand que la partie, de sorte que si la partie grande ici bas est devenue grande parce qu'elle a participé de la partie grande de là-haut, cette partie est dite grande par quelque chose de plus petit; car la partie est plus faible et plus petite que la grandeur en soi ; or il a été admis que les choses participant du grand sont grandes, et petites celles qui participent du petit; car nous avons dit que les dénominations des choses participantes leur viennent des participés. Voilà l'argument. Mais nous, concevant la grandeur en soi existant par elle même et dérobée à la division corporelle, ne devrons-nous pas dire qu'elle a pluralité et qu'elle n'est pas exclusivement un? Et si elle a pluralité, est-ce que nous appellerons grandeur en soi chacune de ses parties, ou dirons nous, que tout en étant plus faible, ἔλαττον, elle n'est pas vraiment petite; car si la partie est grandeur en soi, elle n'est en rien inférieure au tout, et la procession ira à l'infini; car elle aura toujours les mêmes propriétés, et les parties de ces parties, les mêmes, puisque les parties sont toujours identiques aux touts. Et si la grandeur a pour parties des grandeurs, l'un ne sera qu'un attribut ajouté, et le tout sera formé de parties qui ne lui appartiennent pas en propre. Il est donc nécessaire que ces pour ainsi dire parties de la grandeur en soi soient, il est vrai, des grandeurs, et aient comme la même couleur que le tout, mais ne soient pas cependant ce qu'est le toul. La partie du feu sans doute est feu, mais la puissance du tout est plus grande, et ni le tout n 'est composé de parties froides, ni chaque partie n'est égale en puissance au tout. Voyons en effet si la grandeur en soi avait des puissances, la puissance qui dépose dans les incorporels un excédent sur des incorporels, (car même là il y a quelque grandeur et celle qui dépose un excédent dans les corps relatif aux corps, ou toute autre mesure d'excédent qui se trouve en ces choses, n'est-il pas nécessaire, l'espèce une pouvant les deux, que chacune des deux puissances soit diminuée selon une seule et même proportion: mais la diminution ne fait pas la puissance petite, et la grandeur en soi montre que cette puissance peut la même chose et dans les choses diminuées et dans les autres, et ainsi, quoique l'espèce ait de nombreuses puissances, elle ne perd pas son caractère particulier et propre dans la pluralité des puissances qui sont en elle. Mais cela n'est vrai que si l'on entend au sens intellectuel les parties et les touts ; au contraire si l'on conçoit comme corporelle la soustraction de la partie, on tombera dans les absurdités qu'objecte Parménide. § 70 bis. « Mais quoi ! chaque partie de l'égal ayant pris en soi un certain petit, contiendra-t-elle en soi ce quelque chose qui est plus petit que l'égal en soi, mais par lequel elle sera faite égale à une chose quelconque?— Cela est impossible ». On a rappelé parce qui précède quelle puissance a la grandeur dans les hypostases incorporelles et dans les corporelles, et que c'est elle qui est le chorège en toutes choses de l'excédent et de la perfection supérieure, soit intellectuelle, soit vitale, soit dans l'espace et l'étendue. Appelons l'égal, — car c'est la première fois que ce mot est prononcé — ce qui est cause en toutes choses de l'harmonie et de la proportion. Car c'est de l'égalité que toutes les médianités se manifestent, aussi bien les psychiques que les physiques, et sa fin est l'amitié et l'union. Puis donc que le démiurge emploie toutes les médianités pour donner au tout l'ordre et la beauté, et les liens (les lois ou rapports qui enchaînent les phénomènes) qui en naissent, liens arithmétiques, géométriques, harmoniques, en disant que la cause intellectuelle une de ces médianités, celle qui les engendre et leur impose la loi de l'ordre, est l'égalité démiurgique, on ne s'écartera pas, à mon sens, de la vérité sur ce sujet. Car de même que la monade là-haut crée l'hypostase de tous les nombres physiques, de même 1'égalité là-haut a engendré toutes les médianités d'ici-bas, puisque c'est même l'égalité qui est en nous qui engendra les médianités. Or s'il en est ainsi dans les images, à beaucoup plus forte raison l'égalité dans les espèces intellectuelles, sera la mère de toute la variété et la diversité des médianités qui procèdent dans le monde. Ainsi donc l'égalité est pour toutes les choses encosmiques la cause de ces médianités ; mais elle est de plus, pour les êtres, chorège de l'ordre qui met les choses sur la même ligne et au même rang, de même que le plus grand est cause de la perfection supérieure et détachée (des substrats), et le plus petit, de l'abaissement substantiel. Et il est clair que tous les êtres reçoivent l'ordre et la beauté de la triade de ces espèces, qui fournit aux uns, qui sont supérieurs, leur propre supériorité , aux deuxièmes, leur abaissement, à ceux qui sont sur la même ligne, la communauté qui les met au même rang. Et il est évident que c'est selon cette triade qu'ont été engendrées les séries éternellement indissolubles des touts. Car toute série a besoin de ces trois choses: supériorité, abaissement, égalité de rang, de sorte que s'il y a certaines processions de chacune des espèces, procédant d'en haut jusqu'aux choses dernières, qui conservent avec la communauté la distinction qui distingue les premières des deuxièmes, c'est par ces trois moments qu'elles se réalisent parfaitement ; ce sont eux qui fournissent aux espèces la procession de chacune qui, de la sommité qui lui est propre , procède dans chaque chose particulière. Car nécessairement le beau en soi, le juste en soi, et chaque espèce précède et commande sa série particulière, et est dans tous les êtres intellectuels, psychiques et même corporels ; dans les âmes, selon un mode différent suivant leurs différences divines, démoniques, humaines, et dans les corps sous un mode différent selon leurs différences : c'est ainsi que, par exemple, le beau est dans les corps divins, démoniques ou ceux qui sont abaissés au-dessous de ceux-ci. On conçoit par là ce qu'est l'égalité, et tu peux voir ici comment Parménide réfute ceux qui pensent que les choses égales d'ici-bas participent corporellement d'une partie de l'égalité. Car supposons que ce sensible ci à qui on a retranché quelque chose, participe, si l'on veut, d'une partie de l'égalité: s'il participe d'une partie, il est clair qu'il participe de quelque chose qui est moindre que le toul. S'il en est ainsi, ce qui a participé du moindre, n'est plus moindre, mais égal. Mais qu'il n'en soit pas ainsi est une nécessité : car il a été posé que les espèces donnent aux sensibles leurs propres dénominations. Donc, quelque chose qui a participé du moindre ne doit pas être appelé égal, mais moindre, ni ce qui a participé de l'égal ne peut être appelé moindre, mais égal; ni ce qui a participé du plus grand ne peut être appelé égal ou moindre, mais plus grand. Et tu vois encore comment, pour ce qui concerne la participation corporelle, a procédé le raisonnement. Ce qui a pris quelque petit, par le fait du retranchement, crée une participation corporelle, et dépose à la division dans les espèces mêmes, indivisibles et immatérielles. Mais si tu considères l'égalité par elle-même, la partie en elle sera encore égalité, car l'égal n'est pas formé de choses non égales; mais autre est l'espèce acquise par surcroît : ce qui en fait un composé et non l'égalité en soi, l'égal simplement égal. Nécessairement donc, la partie de l'égal en soi doit être égale; car l'égalité en soi étant une, a en elle-même les causes de toutes les égalités, de l'égalité dans les poids, de l'égalité dans les masses, de l'égalité dans les pluralités, de l'égalité dans les valeurs des choses, de l'égalité dans les générations. De sorte que chacune de ces choses qui sont si diverses est quelque chose d'égal et possède la puissance et la valeur du tout, mais abaissée. En effet, rien n'empêche, l'espèce une produisant tous les caractères particuliers des puissances qui sont en elle, que l'une soit dans une chose, l'autre dans une autre avec toute sa force et sa vérité, et qu'ainsi toutes les égalités, quoique plusieurs, soient subsumées sous une seule. Et si toutes sont des égalités et abaissées au-dessous de leur propre hénade, et si elles ont subi cet abaissement par la participation du petit en soi, il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque toutes les espèces participent à toutes les espèces. Et puisque la grandeur en soi est moindre que la somme des autres, elle participe de la petitesse, et le petit en soi, en tant qu'il dépasse l'autre (petit), participe de la grandeur en soi. Mais chacune est participée par les choses d'ici-bas en tant qu'elle est ce qu'elle est, mais non en tant qu'elle a communauté avec les autres. § 70 ter. « Mais supposons que quelqu'un de nous ait une partie du petit : le petit en soi sera plus grand que cette partie, qui est une partie de lui-même ; et ainsi ce à quoi on aura ajouté ce qui a été ôté, deviendra plus petit et non, (comme il semble que cela devrait être) plus grand qu'auparavant. — Voilà une chose, dit-il, qu'on ne saurait admettre ». Maintenant le petit, quel il est et quelle puissance il a, c'est ce que nous devons d'abord rechercher. Car de même que nous disons que la grandeur est, pour tous les êtres ensemble, la cause de leur excédent, de leur valeur supérieure, de leur puissance élevée au dessus des autres, et que l'égal est générateur de toutes les analogies et de tout ce qui est placé sur la même ligne ; de même nous disons que le petit est la cause, si tu veux, de l'abaissement qui se produit dans toutes les espèces, ou si tu le préfères, le chorège, en chacune, de son indivisibilité, de la force qui les contient dans leur système propre et de la puissance qui les fait incliner vers lui. C'est par lui que les âmes peuvent s'avancer de l'extension dans l'espèce indivisible de la vie, que les corps se ramassent et se contractent, et sont contenus dans leur système par les causes indivisées qu'ils contiennent en eux-mêmes, que le monde tout entier est un et possède la vie universelle dans un milieu qui est un. et où elle tend par son inclination naturelle. C'est de lui que naissent les pôles, les centres, toutes les sections indivisibles, les tangences des cycles, les limites des douze parties du Zodiaque, et toutes les mesures indivisibles que la raison démiurgique a fondées et a faites constantes dans les choses divisibles. Voilà donc quelle puissance a la petitesse en soi ; et l'argument présent montre aussi pour elle, qu'il est impossible que les choses d'ici bas participent d'une partie d'elle corporellement. Car si la petitesse en soi avait quelque partie en général, elle sera plus grande que sa propre partie i . Car la partie du petit, en tant que partie, est plus petite que le tout : de sorte que le petit est manifestement plus grand que sa propre partie qui est plus petite : mais il est impossible que le petit, purement petit, soit plus grand : nous considérons ici la petitesse en et par elle-même, sans toucher en rien à la communauté qu'elle peut avoir avec la grandeur. Voilà une des conséquences par lesquelles il démontre l'absurdité qui résulte pour ceux qui divisent en parties la petitesse en soi, considérée dans son espèce même; en voici une autre, qu'il fait ressortir de son examen des choses participantes : puisque nous avons divisé le petit en soi et montré que cette partie de lui est plus petit que son tout, il est évident que ce à quoi sera ajoutée cette partie enlevée du tout que forme le petit, cela, qui a reçu cette addition sera plus petit et non plus grand qu'il n'était auparavant : car ayant reçu le plus petit, nécessairement il devient plus petit, et cependant nous voyons qu'une chose quelconque ajoutée à telle ou telle grandeur, quoique plus petite que cette grandeur, fait le tout plus grand. Il ne faut donc pas diviser le petit; car en le maintenant indivisible, tu ne pourras plus ajouter à une grandeur quelconque le tout comme partie et ainsi faire ce qui le reçoit plus grand au lieu de plus petit. Car il a été démontré qu'il n'est pas possible qu'il soit en tant qu'espèce, tout entier dans plusieurs. Voilà donc une manière d'interpréter et d'expliquer le texte cité. Mais on peut aussi, comme l'a fait notre disciple Périclès, l'expliquer en considérant le tout dans l'espèce en soi. Une chose à laquelle on ajoute ce qui a été ôté du petit, comme partie, devient nécessairement plus grande ; mais cependant le petit ajouté à ce qui reste après la soustraction du petit divisé, fait le tout petit et non plus grand qu'auparavant. Car l'espèce est a priori posée petite. Il est donc absurde de croire le petit divisible; car la partie qu'on lui enlève, puisqu'elle est plus petite que le tout, démontre nécessairement que le tout est plus grand, et puisqu'elle est ajoutée au reste, elle fait plus grand ce qui reçoit l'addition : et il en résulte que, dans un cas comme dans l'autre, le tout n'est pas petit. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la seconde des objections présentées : elle a paru si difficile à comprendre dans ses termes que quelques uns ont placé ce passage parmi ceux qui sont supposés, et l'ont supprimé du texte de Platon . Mais laissons cela de côté. Que le texte lui-même, en faisant intervenir certaines soustractions et certaines additions, montre que la participation réfutée est la participation corporelle, est chose reconnue de tous, et je ne crois pas que nous ayons besoin d'y consacrer nous-même un commentaire plus développé. Disons en général sur ces trois espèces, la grandeur, la petitesse, l'égalité, et plutôt sur toutes les idées 'ensemble, qu'elles sont sans parties et qu'elles ont reçu une substance incorporelle: car toute chose corporelle ayant son hyparxis déterminée selon l'extension, il est impossible qu'elle soit la même et de la même manière présente en des choses plus grandes et plus petites Or l'égal, le plus grand, le moindre et semblablement chacune des autres espèces est présente aux choses qui en participent, quelle que soit leur dimension dans l'espace. Donc toutes les espèces échappent aux conditions de l'extension dans l'espace. Par la même raison, le fondement de leur existence est au dessus de tout lieu : car elles sont présentes, sans éprouver aucun obstacle, à toutes les choses qui partout en participent. Les choses qui sont sous la loi de l'espace, sont par nature privées de participer à cette présence qui ne connaît pas d'obstacle. Car il est impossible qu'elles soient participées par toutes les choses qui sont placées dans des lieux différents. Par la même raison elles planent au-dessus de tous les temps : car elles sont présentes en bloc et sans distinction de temps, ἀχρόνως, en toutes choses. Et tandis que les générations sont comme des états préalables et préparatoires de la participation des espèces, comme nous l'avons dit plus haut, et qu'elles sont nécessairement dans le temps, les espèces donnent aux choses du devenir la participation d'elles-mêmes, sans avoir du tout besoin de l'extension dans le temps, mais elles se communiquent indivisément dans l'instant en soi indivisible : ce qui est l'image de leur hypostase éternelle. Ne transportons donc pas, des participants aux participés, soit le temps, soit la circonscription locale, soit la division corporelle, et en un mot qu'on ne conçoive pas en elles des compositions ni des divisions corporelles : car ces conditions sont très éloignées de la simplicité immatérielle des espèces, de la pureté de leur hypostase indivisible, contenue et retenue dans l'éternité. § 71. — « De quelle manière donc, dit-il, mon cher Socrate, crois-tu que les autres choses participeront des espèces, si elles ne peuvent participer ni d'une partie d'elles ni du tout d'elles ? ». Tout ce genre de discours a un caractère d'invitation, un caractère maïeutique, et sert à accoucher les pensées de Socrate. C'est pour cela, et non pour se poser en antagoniste ni parce qu'il désire vaincre, qu'il ajoute : Donc les choses d'ici-bas ne participent pas des espèces ; mais il veut ébranler l'esprit de Socrate, l'exciter à découvrir la participation véritable, et après lui avoir fait parcourir toutes les solutions sans force ni valeur, ne laisser debout que celle qui convient réellement à l'action causatrice des espèces divines. Il a été déjà dit antérieurement que ceux qui n'entendent pas le tout et la partie dans le sens corporel, mais dans le sens qui convient aux substances immatérielles et intellectuelles, verront que les choses d'ici-bas participent du tout des espèces et de leurs parties ; car en tant que la propriété particulière de chacune pénètre dans les participants jusqu'aux derniers degrés de ceux-ci, la participation est une participation de l'espèce totale; entant que les choses inférieures ne reçoivent pas toute la puissance de leurs causes, la participation est une participation de parties. C'est pour cela que les plus hauts des participants reçoivent un plus grand nombre des puissances du paradigme, les plus bas, un plus petit nombre. De sorte que s'il y avait, dans d'autres parties du tout certains hommes qui fussent supérieurs à nous, ceux-là étant plus rapprochés de l'idée de l'homme, participeraient davantage de cette idée et selon un plus grand nombre de puissances. De là vient que le lion céleste est intellectuel, et que celui qui est au dessous de la lune est privé de raison; car celui là est plus rapproché de l'idée du lion. Cependant le caractère particulier et propre descend jusqu'aux mortels, et par ce caractère les choses d'ici-bas sont sympathiques aux choses célestes. Car l'unité de l'espèce et la communauté selon cette espèce une, crée la sympathie. Que peut-on dire à cela ? Si tu prends la lune elle-même, tu verras, il est vrai, une déesse céleste ; mais tu verras aussi que l'espèce séléniaque ici-bas conserve, elle aussi, même dans les pierres , la puissance propre à cet ordre, qui est dans sa nature, et qu'elle croît et décroît régulièrement. Ainsi la propriété particulière descend d'en haut jusque dans le dernier bas, mais évidemment en traversant des intermédiaires ; car si cette espèce une est et dans les Dieux et dans les pierres, à beaucoup plus forte raison elle sera dans les générations intermédiaires, par exemple celles des démons ou d'autres animaux. Car il y a des séries qui, des Dieux intellectuels descendent dans le ciel, et de celles-ci dans la génération, se modifiant selon chaque élément et s'abaissant jusqu'à la terre. Les termes les plus élevés de ces séries participent plus largement des paradigmes, ceux qui sont plus terrestres, dans un moindre degré, mais la propri"té particulière une s'étend sur tous: ce qui fait l'unité de la série tout entière. Maintenant, partons d'un autre point de vue, si tu veux, et disons que les choses d'ici-bas participent du tout des espèces et de leurs parties : du tout, en ce que l'action cuusatrice des espèces est indivisible; c'est pourquoi elle est d'abord présente partout en toutes choses la même et tout entière et s'appartenant à elle-même, remplissant ensuite de sa puissance propre la substance des participants; des parties, en tant qu'elles participent, non des espèces mêmes, mais de leurs simulacres ; car les simulacres sont des parties de leurs paradigmes propres. En effet l'image est à son paradigme dans le même rapport que la partie au toul. Et si quelqu'un adoptant cette explication, y applique les arguments quenous avons plus haut développés, il verra clairement qu'aucune des choses que nous avons écrites n'est impossible. Car comment serait-il impossible qu'un tout fût le même en toutes choses, si tu réfléchis que l'espèce immatérielle et intellectuelle n'est qu'en elle-même, que n'ayant besoin ni d'une demeure ni d'un lieu, elle peut être également en toutes les choses qui peuvent participer d'elle; comment serait il impossible que l'espèce indivisible, préexistant par soi et étant une, soit divisée dans les choses qui en participent et subissent le déchirement titanique ? N'est-ce pas au contraire la chose la plus véritable, que ce qui a participé de la grandeur en soi a participé du moindre ; car la grandeur, qui est en lui, étant soumise à la loi de l'étendue, est une image de la grandeur en soi, et l'image est moindre que le paradigme d'une certaine partie. Pourquoi donc, de la même manière, ne diras-tu pas que le sensible égal est appelé égal parce qu'il a participé de l'égal en soi moindre? Car ce qu'on appelle ici-bas égal est moindre que la puissance de l'égal en soi. Et comment l'image du petit ne sera t-elle pas plus petite que celui-ci, en tant que lui fait défaut la perfection complète de celui ci; car celui-ci est plus grand que celui là, en tant que sa puissance est plus parfaite; et en un mot chacune des trois espèces, puisqu'elle est rattachée à ses participants et donne la mesure de leur essence, leur communique la cause de leur abaissement; par l'excédent intelligible, d'un côté, elle jouit de la grandeur ; par la puissance mesurante, de l'égal; par la communication de l'abaissement, du plus petit. Toutes donc coopèrent les unes avec les autres pour produire les choses secondes. Et si la grandeur fournit la puissance qui s'étend sur tout, et le petit, l'indivisibilité (car ils sont par essence liés l'un à l'autre, l'indivisible pénétrant en un plus grand nombre de choses est éminemment sans parties), et si tous les deux sont éminemment égaux, parce qu'ils sont par excellence les mesures des autres, il n'y a rien là d'absurde ni d'impossible, si tu entends, de la manière qu'il faut, le tout et la partie; au contraire tout cela est la conséquence vraie des hypothèses. C'est pour cela, je pense, que Parménide pose immédiatement à la suite, ces questions: Comment les choses d'ici-bas participent elles aux espèces, comment le tout et comment la partie doivent-ils être entendus dans les espèces, parce qu'il veut qu'il s'élève à la vraie manière de les concevoir. § 72. — « Non, par Zeus, dit-il, non, il ne me paraît pas facile, et rien moins que facile, d'en découvrir une telle » Dans le premier problème relatif à l'hypostase des idées, Parménide n'a point attaqué la solution de Socrate comme imparfaite et en un mot n'a rien eu à y objecter. Dans le deuxième : de quelles choses y a-t-il des idées, il a soulevé des objections, mais avec mesure et sans y insister fortement. Mais dans ce troisième, il soulève des objections nombreuses et fortes, à cause de la profondeur du sujet à examiner; car ce n'est pas ici seulement que l'on montre la profondeur du problème, mais encore dans le Timée, où Timée lui-même dit que la manière dont la matière participe de l'être est des plus difficiles à comprendre. Il est donc tout naturel que la notion, ὁ λόγος, de cette participation paraisse à Socrate difficile à saisir et inexplicable, non pas seulement, semble-t il, lors qu'il est jeune, mais encore presque à la fin de sa vi. Aussi dit-il dans le Phédon que son opinion est loin d'être ferme et sûre à l'égard du mode de la participation des espèces: il parle là des espèces du grand et du petit. Et c'est là ce que nous disions plus haut, que sur cette espèce et sur beaucoup d'autres, il importait de rechercher le comment, C'est ce que nous avons dit que Socrate cherchait, lorsqu'il posait la question : comment les espèces en soi se distinguent-elles et se mêlent-elles ; car il accordait que celles-ci, quoi qu'étant plusieurs, sont unies et divisées et qu'il n'y en a pas qui soient privées de l'union; mais il cherchait comment, étant simples, elles étaient soumises à l'une et à l'autre de ces propriétés, et s'il en est d'elles comme des plusieurs visibles, car ceux-ci sont composés, et, parce qu'ils sont composés, il n'y a pas de difficulté à expliquer leur distinction et leur mélange selon et par les différentes relations où elles se trouvent ; mais quand il s'agit des simples, il est très difficile de concevoir comment se produisent ces différences de rapports (qui expliquent leur union et leur distinction). Il recherchait donc comment aussi dans ces espèces, les deux sont possibles : il ne recherchait pas si la chose est, mais comment elle est. C'est comme ici. dans notre passage, la question est, non pas s'il y a participation, mais comment il y a participation : et c'est ce que Socrate dit qu'il n'est pas facile de voir, parce qu'il est contraint par les réfutations de considérer la difficulté de ce problème. Et ce n'est pas en vain qu'il ajoute à l'expression de sa pensée un serment; mais Platon établit pour ainsi dire Socrate dans le Dieu par lequel il jure, et par là lui rend accessible la connaissance scientifique, et en y regardant de près, tu verras que cette addition du serment n'est pas différente de la recherche sur les espèces; car c'est dans Zeus qu'apparaît d'abord la source et l'hénade des idées démiurgiques et tout leur nombre. Donc en Invoquant Zeus et en le faisant témoin des doutes qui le tourmentent, il se montre et se rend apte à saisir la science tout entière et s'élève à la cause séparée des phénomènes. § 73 — « Eh bien ! que dis-tu a ceci? — A quoi? — J'imagine que si tu crois que chaque espèce est une, c'est peut-être par une raison comme celle-ci : lorsqu'il te semble qu'il y a un grand nombre de certaines choses grandes, en les considérant toutes , d'un seul coup d'oeil, il te vient peut-être la pensée qu'il y a une seule et même idée de ces choses, qui fait que tu penses qu'il y a un grand qui est un ? — Tu dis vrai, répondit-il ».
Nous avons suffisamment,
dans ce qui précède, démontré qu'il ne faut pas admettre une participation
corporelle des espèces : d'où l'on doit conclure qu'il ne faut pas considérer
leur mode d'action corporellement, et la ramener à des poussées mécaniques ou à
l'action de leviers, tels que sont les mouvements des corps. S'il en est ainsi,
il est évident que le monde des espèces est incorporel. C'est ainsi que, dans le
Sophiste, l'argumentation a démontré que l'un est incorporel ; car s'il
est corps, il a besoin de quelque chose qui le fasse un, et Socrate démontre là
que l'être réellement être et les espèces intellectuelles ont une hypostase
indivisible ; dans les Lois, il est démontré par leur hypostase
automotrice, que les âmes sont incorporelles. Voilà les trois diacosmes
antérieurs aux choses sensibles, le diacosme des âmes, celui des substances
intellectuelles, et celui des hénades, auxquels tous il attribue l'incorporel
par des arguments irréfutables : mais assez sur ce point. De là, Parménide
s'élève à une autre hypothèse plus parfaite : à savoir que peut-être les choses
d'ici-bas participent des idées comme de raisons physiques, parce qu'elles sont
au même rang d'ordre et de même origine que les choses qui participent d'elles,
quoiqu'elles soient incorporelles. Car la difficulté présentée avant celle-ci
considérait comme corporelle la participation des idées qui se différencient en
nous, mais sont cependant corporelles, et y sont présentes de la manière qu'il
est possible que des corps soient présents en d'autres corps. Il s'élève donc à
une espèce de raison, λόγον, incorporelle, que nous dirions une raison physique,
si nous voulions une définition qui touchât le fond des choses, et if propose un
mode de participation incorporel, il est vrai, mais ayant quelque chose de
commun avec les participants; car si, outre la participation incorporelle, nous
admettons que les participés sont absolument hors des participants, il ne
resterait plus aucune difficulté au sujet de la participation. Deux choses en
effet constituent la difficulté : C'est en cela, que consiste la différence fondée de cette objection avec celle qui la précède. Car celle-là portait sur l'espèce présente aux participants et étant elle-même le participé ; celle-ci porte sur le fait qu'il y a une autre chose différente du participé et qui a néanmoins de nombreux points communs avec lui. C'est pourquoi dans l'une, l'argument s'appuie sur ce que l'espèce ne peut ni être présente tout entière ni donner une partie d'elle-même ; dans celle ci, ce n'est pas la même chose : l'argument s'appuie sur ce que, du commun qui est dans les deux ensemble, on remonte encore à un autre commun, plus commun que l'espèce une et les plusieurs, et ainsi l'explication de la participation par la présence et celle qui se fonde sur la communauté sont réfutées de deux manières différentes, l'une parce qu'elle suppose que l'idée est dans les participants, l'autre parce qu'elle pose qu'elle n'est pas dans les participants mêmes, mais cependant se porte vers les participants pour communiquer avec eux. Il n'y aurait donc qu'un seul moyen de se rendre compte scientifiquement de la participation: ce serait d'ôter à la participation tout caractère corporel, et à l'incorporéité la communauté, et d'établir par là que les choses d'ici-bas participent des idées à peu près comme il suit : les idées seraient présentes incorporellement dans les participants, mais sans être subjuguées au point de ne faire qu'une essence avec eux, afin qu'elles soient partout les mêmes par leur propriété incorporelle, et nulle part par le fait qu'elles sont séparées et au-dessus de leurs participants ; car la communauté avec les participants supprime leur supériorité et leur séparation. Il faut sans doute qu'il y ait communauté, mais non pas telle que les participants soient au même plan d'ordre que les participés, mais qu'ils soient seulement suspendus à ceux ci, qui restent absolument séparés d'eux et supérieurs à eux. La présence corporelle fait disparaître la présence universelle indivisible ; car les corps sont des choses qui ne peuvent pas être tout entières dans plusieurs , tandis que les incorporels en soi sont présents tout entiers à toutes les choses qui peuvent participer d'eux, et mieux encore, ils ne sont pas eux mêmes présents en elles, ce sont les participants qui sont présents en eux. Et c'est là ce que Socrate indique vaguement par les mots : soit qu'il y ait présence, soit qu'il y ait communauté, soit quelque autre cause de la participation des espèces, afin que nous écartions ce qui fait la difficulté de l'une et de l'autre solution. Il convient donc d'admirer l'hésitation que montre Socrate dans le Phédon, et qui a son point de départ dans les deux difficultés qu'il a appris à connaître dans sa jeunesse par Parménide, puis ensuite l'intuition inspirée de Platon, qui d'avance détruit les écarts qui se sont plus tard produits dans l'interprétation de la théorie des espèces. Carde même que la raison divine enveloppe selon la cause une et unique tout ce qui sera, de même la science de Platon pressent et guérit toutes les altérations de ses divines doctrines, en introduisant dans le débat Socrate jeune, mais d'un esprit très pénétrant, et qui seul se montre hésitant au sujet de choses pour lesquelles ceux qui sont venus après lui ont été si passionnés et si vifs ; car beaucoup ont rapporté la démiurgie à des raisons corporelles, et cependant il a été montré qu'il est impossible que les espèces soient corporelles et qu'elles soient participées corporellement. Il ne faut donc pas poser les espèces comme produits et rejetons de la matière, comme quelques-uns le soutiennent, ni admettre que leur hypostase consiste dans le mélange mutuel des éléments simples, ni accorder qu'elles ont la même substance que les raisons séminales ; car tout cela est corporel et imparfait, et révèle une hypostase divisible. D'où donc la perfection vient-elle aux choses imparfaites? D'où vient aux choses absolument divisées et dispersées, l'union? D'où les choses qui sans cesse deviennent, tirent-elles la présence d'une substance indéfectible, s'il ne préexistait pas, avant elles toutes, le diacosme incorporel et parfait des espèces? D'autres à leur tour, ont fait du commun dans les choses individuelles la cause de la persistance permanente des espèces; (car l'homme engendre l'homme et le semblable naît du semblable). Mais ils auraient du concevoir en outre, d'où vient l'hypostase du commun dans les choses individuelles ; que ce genre ne peut pas être matériel et divisible et qu'il n'est pas possible qu'il ne soit pas parfaitement éternel, ni qu'il soit l'effet d'une autre cause, c'est à dire d'une cause mue et changeante; car ce genre serait absolument changeant, et cependant en tant qu'espèce il demeure toujours le même, comme le même cachet imprimé dans beaucoup de morceaux de cire demeure le même et non altéré dans ces morceaux qui changent. Qu'est ce donc qui dépose immédiatement cette empreinte ? si l'on regarde la cire, c'est la matière ; si l'on a égard à l'effigie, c'est l'homme d'ici-bas ; si on considère l'anneau qui s'enfonce dans la cire, dans quelle catégorie d'êtres le placerons nous, sinon comme une nature qui pénètre à travers la matière et informe ainsi le sensible par ses propres formes; si on considère la main qui se sert de l'anneau, c'est l'âme qui dirige la marche de la nature, soit l'âme universelle qui dirige la nature universelle, soit l'âme particulière qui dirige la nature particulière ; si on considère cette âme même, qui par la main et l'anneau imprime le sceau sur la raison, laquelle par l'âme et la nature remplit de ses espèces le sensible, c'est elle qui est le vrai semeur, générateur des raisons qui descendent jusque dans la matière. Il ne faut donc pas s'arrêter aux communs qui sont dans les choses individuelles, mais en chercher les causes. Car pourquoi les hommes ont-ils participé de telle communauté, d'autres animaux d'une autre, si ce n'est par des raisons invisibles? Car la nature est la mère unique de tous. Mais quelles sont les causes des ressemblances déterminées et pourquoi disons nous que la génération est selon la nature lorsque l'homme vient d'un homme? N'est-ce pas parce que la raison de l'homme est dans la nature, en tant que tous les hommes d'ici- bas y sont. Car ce n'est pas parce que ce qui a été engendré est animal, puisque si cet animal était un lion, ce serait un animal naturel mais non selon la nature, excepté dans un sens particulier. Il faut donc qu'avant les semblables, il y ait une autre chose qui soit la cause des semblables, et par cette raison, il faut, des communs dans les choses individuelles, remonter à cet un qui est le principe qui crée, sans médiation, l'hypostase des sensibles et auquel Parménide lui-même nous ramène, et il fera voir clairement, par ce qui suit, qu'il ne veut pas que nous nous arrêtions à cette cause. Car si, regardant ces communautés, nous voulions réellement, en partant d'elles, imaginer la nature des Idées, sans nous en apercevoir, nous remonterions également non seulement à celles dont il y a des idées, mais à celles dont il n'y a pas d'idées, par exemple, des choses contre nature, contre l'art, contre la raison, des choses non substantielles, des choses qui sont en soi sans hypostase, par exemple des hircocerfs et des hippocentaures; car il a aussi de ces choses des communautés : et ainsi nous poserons des idées des non êtres, bien plus encore, des infinis, par exemple des lignes irrationnelles, ou des rapports irrationnels dans les nombres : car il y a une infinité de lignes et de rapports irrationnels dans les nombres, dont il y a des communautés. Si donc nous imaginons, de ces choses certaines idées, nous créerons infiniment de fois l'infini. Et cependant il faut que les idées des choses individuelles soient en nombre moindre que celles qui participent d'elles, puisque les êtres qui participent de chacune d'elles sont en plus grand nombre. C'est donc avec raison que Parménide corrige cette méthode de s'élever aux idées, parce qu'elle n'est pas scientifique, parce que en partant des recherches suc la participation, elle s'appuie sur les communautés des choses d'ici-bas; car il est possible de concevoir des communautés toujours différentes les unes des autres, et on va ainsi à l'infini ; c'est ce qu'il montre par ce qui suit : § 71. — « Mais le grand en soi et les autres grands, si tu les vois par l'âme i être en toutes choses de la même manière, n'apparaîtra t-il pas de nouveau un certain grand un, par lequel nécessairement tous ceux-ci apparaissent grands. — Il semble. — Nous verrons donc apparaître et naître une autre espèce de grandeur outre la grandeur en soi et les choses qui en participent, et une autre au-dessus de ces deux-ci, par laquelle tous ceux-ci seront grands, et chacune des espèces ne sera plus - pour toi une et unique, mais elle sera infinie en nombre ». Ce qu'il se propose ici est de montrer que le passage des communautés aux idées, comme nous l'avons dit antérieurement, n'est pas conçu comme il doit l'être, mais remonte à quelque autre chose de commun, et de nouveau à un autre commun. C'est pour cela que Socrate n'a pas cru, comme nous l'avons dit que la cause de la participation fût la communauté. Car s'il y a quelque chose de commun au participant et au participé, nous devrons, de nouveau, en partant de ceux-ci, passer à quelque chose qui sera la cause de la communauté des deux,et ainsi on va à l'infini. En effet les choses qui ont quelque chose de commun doivent avoir avant elles la cause de cette communauté, et si nous voulions de cette objection recueillir quelque fruit pour la théorie qui veut remonter aux idées, nous remarquerons que, par ce procédé logique, se révélera, comme nous l'avons dit, le caractère propre et particulier de l'idée, à savoir qu'elle n'est pas identique aux raisons séminales, ni en général aux raisons physiques qui sont au même rang que les raisons matérielles, mais qu'elle est quelque chose d'autre, qui précède celles-ci et ne peut être coordonnée avec tout ce qui est divisé dans les plusieurs. Car l'un, celui qui est dans la nature et qui a la vertu d'engendrer les espèces dans les sensibles, n'est pas de nature à se séparer et à s'élever au-dessus des choses phénoménales, mais il a avec elles de nombreux points communs et une très petite différence, et une si grande communauté qu'il parait, par suite, ne différer en rien des espèces matérielles, mais être, lui aussi, quelque chose de matériel et de divisible. De même donc que la nature elle même est inséparable des choses qu'elle gouverne, de même les raisons de cette nature sont inséparables des choses spécifiées. C'est comme si tu imaginais l'art lui-même, avec ses instruments propres, pénétrant dans les choses fabriquées par lui et réalisant intérieurement tout ce que maintenant il fait du dehors. Ainsi donc la raison du grand dans la nature, parce qu'elle n'est pas séparée et élevée au-dessus des grands d'ici-bas, mais au contraire est comme baignée en eux et coordonnée avec eux, réclame quelque autre nature qui la précède, à savoir, la cause de la grandeur même et des grandeurs phénoménales ; car la véritable cause en tout est absolument séparée et supérieure à ses effets et c'est à celle là que Parménide veut faire remonter Socrate: et il est là dans la vérité ; mais ce qu'il ajoute ensuite et présente comme absurde, à savoir qu'il faut concevoir une autre espèce encore après celle-ci, et encore une autre, et qu'il y en a un nombre infini, cela est faux. C'est pour cela qu'il a dit plus haut : « que tous ceux-là doivent nécessairement apparaître grands ». Car il faut qu'il y ait quelque raison séparable et invisible qui soit la cause de ces phénomènes, et quand il ajoute la conséquence absurde, il dit : « et ainsi chacune des espèces ne sera plus, pour toi, une: car le : « pour toi, σοί, » a été ajouté, non pas par recherche d'une beauté vaine, mais pour montrer que, à celui qui n'a pas encore vu où sont primairement les espèces, c'est une nécessité de remonter à l'infini. S'il faut donc qu'avant l'espèce physique, il y en ait une certaine autre, l'espèce psychique, et avant celle-ci, l'espèce intellectuelle, cela ne va pas à l'infini. Il y a une certaine hénade une et unique des idées, de laquelle toutes procèdent, mais au-delà de laquelle il ne faut plus en chercher une autre. Qu'est-ce qui peut aller plus haut que son hénade propre? Car le corps n'est pas en dehors du Tout ni avant son hénade propre, et l'idée n'est pas avant l'hénade des idées. Tu vois donc qu'il nous élève des raisons physiques aux psychiques, et qu'il nous invite à ne pas remonter à l'infini, mais a chercher la monade une et unique des idées. Car d'un côté la raison physique, afin de pouvoir être la même chose dans tous les plusieurs séparés et de planer la même sur eux, contient la pluralité des liens auxquels elle est contiguë , et de l'autre, afin que les choses qui participent de l'idée demeurent toujours et ne fassent jamais défaut, il faut quelque autre cause qui ne soit pas en eux, qui ne soit pas mue, mais soit fondée en elle-même, qui soit immobile avant les choses mues, et qui, par sa stabilité propre, communique libéralement aux choses mues une participation indéfectible. Tous les philosophes recherchent et désirent cette cause : les uns, comme. ceux du Portique, croyant qu'elle est ces raisons séminales, les ont faites impérissables ; les autres ont posé les désirables immobiles avant toutes les choses extérieures mues, par lesquels les choses mues sont mues, comme les Péripatéticiens. Platon réunissant et fondant en un les deux systèmes et admettant que les idées sont des raisons intellectuelles, leur a rattaché et suspendu toute la démiurgie ; car ni les raisons séminales ne sont capables, à elles seules, de sauver les choses du devenir, parce qu'elles ne peuvent passe replier sur elles-mêmes ni se conserver elles mêmes dans leur essence, ni on un mot se parfaire, mais sont imparfaites ; car elles sont en puissance et dans un sujet. Il est également certain que les désirables immobiles non plus qui sont seulement désirables, ne sont la cause de la diversité, selon l'espèce des choses du devenir. Mais les deux propriétés d'être intellectuelles et immuables selon la substance, appartiennent aux idées, parce qu'elles sont installées dans le fondement sacré de la raison pure : elles donnent leur complément et leur perfection aux êtres en puissance, et sont les causes de la spécification. De là vient qu'étant remonté à ces principes, il y a suspendu toute la génération, comme le dit Xénocrate, qui a défini l'idée la cause exemplaire des choses selon la nature qui subsistent toujours : car il ne pouvait pas la poser dans des causes concomitantes, je veux dire, instrumentales ou matérielles ou spécifiques : c'est pourquoi il a dit qu'elle est cause purement cause ; ni dans celles des causes qui sont purement finales ou purement efficientes ; car, quoique nous disions qu'elle (l'idée) est efficiente par son être et que la fin des choses du devenir est l'assimilation à elle, néanmoins la vraie cause finale de tout ce en vue de quoi tout est, τὸ οὗ ἕνεκα, est avant les idées, et la cause proprement efficiente est après les idées ; car il regarde le paradigme comme le critérium et la règle : elle est un milieu entre les deux : elle désire l'un et est le désirable de l'autre. Si donc elle est la cause paradigmatique des choses qui subsistent selon la nature, il n'y a pas d'idée des choses contre la nature ou faites selon l'art. Et si elle est la cause des choses qui subsistent toujours, elle n'est pas la cause de celles qui deviennent et qui périssent alternativement. Xénocrate a donc donné une définition de l'idée conforme à l'opinion du maître, en la posant comme une cause divine et séparable. Et Socrate ici, entendant Parménide lui dire : « Si tu vois en esprit le grand en soi et les plusieurs, il apparaîtra quelque chose d'un et au-dessus de ceux-ci il y aura une autre chose commune à l'un et aux plusieurs », mis en éveil par ces paroles, a compris que les espèces ne sont certes pas primairement dans l'âme, et que ce n'est pas de la sorte que les sensibles participent des espèces, et aussi de l'âme. Lors donc qu'on essaie de ruiner l'hypothèse des idées, soit en faisant valoir l'argument du troisième homme ou l'homme composé vide de plusieurs riens, en tant que n'étant que conçu par la pensée réfléchie, l'un le plaçant au dessus de l'espèce une de l'homme et des plusieurs, l'autre au-dessus de chacun des riens particuliers, nous réfuterons ces arguments et toutes les malveillantes critiques de cette nature en disant que l'argument de l'ascension à l'infini des ressemblances a sa place contre ceux qui admettent que les espèces sont coordonnées avec les choses qui en participent et que les communs sont connumérés avec les plusieurs, mais non contre ceux qui soutiennent que les espèces génératrices elles-mêmes sont au-delà et séparées des plusieurs, en accordant que ce mouvement ascensionnel, qui part des choses divisées, s'opère, non par des privations, mais par des espèces et dans des espèces jusques aux espèces premières et qui subsistent par soi. Comment en effet remonterions-nous à l'espèce, à la limite, à l'essence par l'intermédiaire de choses indéfinies et non spécifiées ? En nous élevant des choses matérielles aux raisons séminales, nous rencontrons quelque chose qui leur est commun, l'imperfection ; en remontant de celles ci aux raisons physiques, nous trouvons qu'elles ont un acte corporel ; en remontant de celles-ci aux raisons psychiques, nous trouvons que leur activité efficiente est dans le temps ; mais si nous nous élevons aux véritables espèces, alors nous ne trouvons plus rien de commun à celles-ci et à celles là. Celles-ci sont parfaites, leur acte est absolument incorporel, elles sont éternelles et au delà de toute génération ; car ce qui caractérise toute génération, c'est l'imperfection qui lui est inhérente, le divisible, le fait d'être dans le temps. Les vraies espèces sont pures, séparées de toutes les choses d'ici-bas avec lesquelles elles n'ont rien de commun, de sorte qu'il n'est plus possible d'opérer une transition qui s'élève à quelque autre chose de commun. C'est cela que saisit Parménide et qui lui permet de produire l'objection de la communauté, dont Socrate disait qu'elle lui faisait naître des doutes au sujet de la participation des espèces. De même donc que dans l'objection précédente, nous disions que les espèces sont présentes aux choses qui en participent par le fait qu'elles leur donnent, et qu'elles ne leur sont pas présentes à cause de leur hypostase séparée, de même, dans la deuxième, nous dirons que les espèces ont et n'ont pas de communauté avec les choses qui en participent : elles en ont une, parce qu'elles les illuminent de leur propre essence, et elles n'en ont pas par ce qu'elles ne se mêlent pas aux choses qu'elles illuminent. De sorte que ce n'est pas à elles mêmes, mais à ce qui émane d'elles, qu'on peut saisir quelque ressemblance avec les choses. C'est à cause de cela qu'il est dit même par ceux qui acceptent ces principes, que par là elles ont en quelque sorte une communauté avec les choses, qu'il y a bien une communauté, mais qui n'est pas celle qu'on trouve dans les synonymes, mais celle qu'on trouve entre les choses secondes et les choses premières. Reconnaissons donc qu'il en est ainsi. Que Platon considère comme absurde l'infinité en nombre (des espèces), il le montre clairement ici. Donc, selon lui, il n'y a pas d'espèces des choses particulières : car alors elles seraient infinies en nombre ; la partie n'est pas identique au tout : car il résulterait de cela l'indivisibilité numérique , toutes les parties étant posées également le même que le toul. C'est donc dans un autre sens qu'il faut admettre dans les espèces l'infini, c'est-à-dire l'infini en puissance, mais non l'infini en nombre. Car il n'est pas possible qu'immédiatement après l'un soit la pluralité infinie, puisque le fini est plus près de l'un, et que, même dans les nombres, les nombres au-dedans de la décade sont plus près de la monade que ceux qui sont en dehors d'elle. D'où vient en effet la tétrade dans les décades, si ce n'est de celle qui est dans la monade? d'où vient la pentade et chacun des nombres entiers décadiques, si ce n'est des nombres monadiques ? Donc les choses qui sont plus près du principe ont une pluralité plus restreinte, mais une puissance plus simplifiée que celles qui en sont plus éloignées ; par le quantum, elles sont limitées et finies; par la présence de la cause génératrice, elles ne sont pas enveloppées dans les choses au-dessous d'elles : dominées par leur propre hénade, elles dominent tous les nombres qui viennent a leur suite. § 75. — « Mais, dit Socrate, mon cher Parménide, ne pourrait-on pas admettre que chacune de ces espèces est un concept de l'entendement, et qu'il lui appartient en propre de ne se produire nulle part ailleurs que dans les âmes? Car alors chacune serait un, et ne serait pas soumise aux conséquences que tu as exprimées. » Nous avons dit en commençant cette recherche sur les Idées, qu'il y a quatre problèmes à poser à leur égard. Le premier de ces quatre pose seulement la question de savoir s il y a des idées et si elles sont autre chose que celles qui sont en nous; le deuxième pose seulement la question de quelles choses il y a des idées, sans tenir compte ici des objections, si ce n'est que, vers la lin, il a réfuté ceux qui les mettent exclusivement dans les choses visibles, et dans certaines d'entre elles ; le troisième qui a pour objet le mode de la participation, a été soumis à un examen sévère dans les deux apories qui précèdent; après avoir écarté, de la manière que nous avons dit plus haut, ces objections, nous pourrons voir comment les idées sont participées par les choses qui ont leur nom. Le quatrième qui est de savoir ou il faut les placer, est l'objet de l'examen des deux objections qui vont être immédiatement discutées, à savoir si elles sont dans les âmes ou avant les âmes, et on étudiera quelles conséquences inadmissibles résultent de ces deux alternatives. Que cette troisième aporie, qui fait monter jusqu'à l'âme, est la conséquence de la deuxième qui se porte sur la nature, est parfaitement évident, de sorte qu'elle revient, sur les traces des arguments de Parménide, à cette hypothèse. Celui ci donc l'ayant séparée des espèces physiques, et ayant dit : « Si du regard de ton âme tu considères toutes les choses et les plusieurs et l'un qui les engendre, il t'apparaîtra, avant elles, un autre un, » Socrate, plaçant cet un dans l'âme, appelle l'Idée un concept psychique et détermine! âme comme lieu de l'idée; car l'espèce qui est dans l'âme est un et est incorporelle et ne saurait être soumise aux mêmes doutes que celles dont on a traité précédemment : car elle est séparée et au-dessus des plusieurs, n'est pas coordonnée aux plusieurs, puisque les uns ont leur hypostase dans la matière, les autres dans l'âme : il n'y a donc pas communauté entre elle et les plusieurs, comme l'argument qui amène à l'objection forçait de l'admettre : elle n'est dans les choses qui en participent ni tout entière, ni par aucune de ses parties, afin qu'il soit démontré ou bien qu'elle est en soi, ne dépendant que d'elle même, à part des choses, ou que son hyparxis est divisible. Cette solution évite donc les difficultés exposées précédemment et par là est soustraite aux prises des mêmes doutes que les précédentes hypothèses, puisque chaque espèce est un concept et qu'elle demeure un en dehors des plusieurs. Et cette doctrine par laquelle Socrate conçoit que les idées sont substantialisées dans certains concepts, a pour elle une forte apparence de nécessité. Mais lorsqu'il dit : concept, νόημα, n'allons pas comprendre qu'il veut dire : le noumène, τὸ νοούμενον, comme nous appelons objet sensible, αἴσθημα, ce qui est saisi par la sensation, ni qu'il appelle concept, la pensée, νόησις, qui pense l'espèce, en sorte que ce qu'on appelle le concept, νόημα, serait l'objet de la connaissance scientifique, ou de l'opinion, apparaissant dans les âmes et se formant à l'occasion des choses que nous comprenons par l'opinion, ou des choses divines. C'est pour cela que Parménide le forcera de dire que ce sont les choses pensées, τὰ νοούμενα, les noumènes, qui sont plutôt les idées. C'est donc ce concept qu'il dit se produire, ἐγγίνεσθαι, dans nos âmes, montrant par ce mot « se produire » qu'il n'est pas en elles selon la substance. Et c'est là ce que les Péripatéticiens se représentent, quand ils nous rebattent les oreilles de leur espèce engendrée postérieurement, ὑστερογενές, qui est absolument différente de la raison psychique, et j'entends par raison psychique, celle qui demeure selon la substance dans les âmes, celle que nous avons en vue quand nous disons que l'âme est toutes les espèces, que l'âme est le lieu des espèces, qui sont en elle non pas seulement en puissance, comme le dit Aristote, mais on acte, et selon la première forme de l'acte, comme il le dit lui-même. Ainsi donc cette pensée qu'on appelle engendrée postérieurement est naturellement différente de la raison substantielle: car ce qui est né postérieurement a une vertu plus faible que les plusieurs, puisqu'il est en eux et non avant eux, et le substantiel est plus parfait. C'est pourquoi celui-là est moins substance que les plusieurs, celui-ci l'est plus, et on ne saurait dire de combien il est plus parfait que les sensibles. Et qu'il ne faille pas s'arrêter aux espèces postérieurement nées, mais aller jusqu'aux raisons substantielles, raisons internes, qui dès l'éternité possèdent l'hypostase, est manifeste pour tous ceux qui regardent à la nature même des choses. Car d'où vient que l'homme a cette puissance, je veux dire de réunir en un par un acte de raisonnement ce qui vient de plusieurs sensations, et de poser avant les choses phénoménales et séparées les unes des autres l'espèce une, identique, invisible, et qu'on ne voit aucun tel commun à tous les autres animaux mortels que nous connaissons? C'est qu'ils n'ont pas une substance raisonnable, mais n'ont à leur usage que la sensation, les désirs, les représentations de l'imagination. D'où vient que les âmes raisonnables engendrent ces universaux, remontent des sensibles à la notion constituée par l'opinion, si ce n'est parce qu'elles ont, selon la substance, les raisons des choses? C'est que de même que la nature possède la cause efficiente des choses sensibles, parce qu'elle possède les raisons (séminales) et qu'elle façonne et maintient dans leur essence les choses sensibles: par l'œil interne, l'œil externe, et de la même manière, le doigt et chacune des autres choses externes, de même ce qui les connaît sous une notion commune, voit leurs communautés parce qu'il en a anticipé les raisons ; ce n'est pas des sensibles eux-mêmes qu'il tire le commun ; car ce qui est tiré des sensibles est un fantôme imaginé et non une chose connue par l'opinion et doit demeurer au dedans tel qu il a été saisi tout d'abord, afin qu'il ne soit pas un mensonge et le non être, mais tel aussi qu'il ne peut pas devenir plus parfait et plus élevé en dignité ; il n'est pas engendré d'une autre cause que de l'âme, et l'on ne peut certes pas dire que la nature qui engendre, engendre par des raisons et des mesures physiques, et que l'âme qui engendre n'engendrera pas par des raisons et par des causes physiques . Et si ce que la matière a de commun dans les plusieurs est une chose substantielle, ou plutôt est la substance des indivisibles (car cela est éternel et chacun de ceux ci des individus; est périssable, et c'est de ce commun que vient aux individus leur essence, τὸ τί ἐστιν ; car c'est par l'espèce que chacun participede la substance, et si l'âme n'a en commun que les espèces postérieurement nées, comment éviter de la faire plus basse dans l'ordre des choses que la matière, puisque l'espèce placée dans la matière est plus parfaite et plus substance que celle qui est dans l'âme. Car celle ci est cela même quelle est dite, postérieurement née: celle-là est éternelle; celle ci est au-dessus des plusieurs: celle là contient dans l'unité et rapproche les plusieurs ; enfin celle-ci est le fruit de celle-là. Le fantôme en nous, qui est commun, tire son hypostase de la considération du commun dans les choses individuelles; c'est pour cela qu'il se porte vers lui, (car toute chose se suspend et se tient attachée à son principe), et n'est dit être rien autre chose qu'un prédicat, κατηγόρημα, et n'être que par cela seul qu'il est affirmé des plusieurs. Ajoutons encore que l'universel qui est dans les plusieurs est moindre que chacun d'eux; car chacun des indivisibles se multiplie par certaines additions et certains accidents, tandis que l'hystérogène est susceptible d'embrasser chacun des plusieurs. De là vient qu'il est affirmé de chacun d'eux, et que l'individuel est dans ce tout que forme l'universel ; car ce commun n'est pas affirmé seulement de ce commun là, mais de tout le sujet. Comment donc en pourrait il provenir et être tiré, comme par une opération artificielle, de la communauté qui est dans les plusieurs? Si nous le tirons des plusieurs mêmes, où verrons nous les hommes infinis, à chacun desquels nous ajoutons et attribuons le même prédicat, et si nous le tirons de la communauté qui est dans les plusieurs, comment celui-ci est il capable d'embrasser dans son extension sa propre cause? Donc c'est d'ailleurs qu'il tire son hypostase, c'est d'un autre principe qu'il a reçu cette puissance de comprendre dans son extension chaque espèce. Ce dont il y a image, a une hypostase supérieure à la notion qu'on s'en forme: cette hypostase a pour cause une réminiscence de la cause interne qui a été mise en mouvement et comme réveillée par les phénomènes. Disons en outre que toute démonstration part de propositions antérieures d'un ordre d'essence plus relevé et plus universel. Mais comment l'universel sera-t-il d'ordre plus noble, s'il est hystérogène; car, dans les hystérogènes, le plus universel est le plus dépourvu de substance ; de là vient que l'espèce est plus substance que le genre. Il faudra donc supprimer les règles de la démonstration véritable, si nous voulons mettre dans les âmes exclusivement les hystérogènes comme universaux; car assurément ils ne sont pas plus nobles que les choses plus particulières, ni leurs causes ni antérieurs à elles selon la nature. Or si cela est absurde, il faut qu'avant les hystérogènes existent les raisons substantielles, toujours il est vrai, projetées et en acte dans les âmes divines et dans les âmes des genres supérieurs à nous, mais qui en nous, sont parfois cachées, parfois en acte, parfois seulement agissant d'un acte théorétique, tantôt exerçant une action providentielle sur les choses, lorsque concentrés et comme ramassés dans les dieux, nous administrons avec eux le monde universel. Disons maintenant où nous en sommes parvenus de la question proposée : c'est que la véritable espèce est un concept, νόημα ; disons aussi que le véritable concept est espèce, mais d'abord comme pensée, νόησις. de la raison vraie, c'est-à-dire de la raison paternelle, dans laquelle les êtres sont des pensées et les pensées des êtres. Ce sont ces idées, subsistant primairement dans cette raison, que les Oracles, pour nous en interpréter le sens , ont appelées les notions, ἔννοιαι, paternelles mêmes, parce qu'elles sont des pensées démiurgiques, parce que l'hypostase de ces pensées ne fait qu'un avec les objets qu'elles pensent (les noumènes). C'est pourquoi ils disent. « Nous, les Pensées du Père, nous te rendons hommage, Feu pur ». Car ces pensées là haut ne sont pas différentes suivant qu'elles sont les pensées de choses différentes : elles sont les pensées d'elles mêmes. C'est pourquoi elles sont réellement substances et réellement pensées, et à la fois les deux ensemble, et sont par là les conceptions du Père. Après les idées paternelles, qui sont dans toutes les substances intellectuelles placées après le Père, selon leur ressemblance avec lui, chaque idée, à son tour, est un concept ; mais même en celles-ci, il n'est ni le concept d'un acte sans substance ni d'une substance sans acte, mais d'une pensée connumérée (συναρίθμου) avec la substance ; mais elles s'accouplent chacune avec leurs intelligibles du même rang, sont seulement les pensées de choses supérieures, mais ne sont pas identiques à ces intelligibles qui sont plus haut placés que les êtres qui les pensent. — Après toutes les substances intellectuelles qui sont dans des âmes qui pensent toujours, il y a les concepts et les intelligibles séparés et distincts les uns des autres ; car tes uns pensent, les autres sont pensés, les pensées étant transitives, les raisons substantielles qui sont en elles, demeurant toujours les mêmes. Enfin, dans les âmes particulières les concepts, νοήματα, sont de deux espèces : les uns consistant en des raisons substantielles, les autres réunis et rassemblés par le raisonnement en un et tirés de plusieurs sensations réelles; or c'est par ceux-ci que Socrate dit que chaque espèce se produit, ἐγγίνεσθαι, dans l'âme; car ce qui se produit dans une chose n'est pas en elle selon la substance : c'est l'écho dernier de la première pensée en tant qu'il est et est universel et a son hypostase dans l'âme qui le pense. Si nous appelons concepts les projections des raisons substantielles d'après lesquelles nous connaissons que l'âme est le plérome de toutes les idées, il faut donner un autre sens au mot concepts, et ne pas appeler ainsi ceux qui se produisent dans l'âme par la projection d'une pluralité de sensibles : car ceux-là sont les concepts de choses qui subsistent et sont toujours en nous et sont les images des êtres en soi réellement existant; et lorsque nous sommes en présence de ceux-là, alors nous sommes pleins des concepts réels, qui ne se produisent pas, mais qui se projettent et que nous possédons sans en avoir conscience. Il ne faut donc pas considérer ce que quelques-uns appellent des concepts, comme identiques avec ces concepts des raisons substantielles, quoique le plus souvent ils aient des dénominations communes; car ceux-là sont des produits d'actes tirés des représentations de l'imagination ; ni comme identiques aux λεκτά incorporels ; car la substance de ceux-ci paraît être, aux yeux même de ceux qui l'ont posée, comme dépourvue d'hypostase propre et être chose impuissante; ni en un mot comme identiques aux espèces non substantielles qui sont dans les âmes, mais comme identiques à celles qui subsistent en elles substantiellement et contribuent à constituer leur vie dans son tout. Il faut donc, comme nous l'avons dit, remonter des raisons physiques aux raisons psychiques, non pas celles seulement qui sont hystérogènes, mais aussi à celles qui sont substantielles; car les hystérogènes sont les images de celles-ci et ne sont pas engendrées des plusieurs sensibles; car il n'y a pas de commun qui embrasse tous les plusieurs; en effet nous ne posons pas pour les choses mauvaises des raisons universelles ni pour les monadiques, parce que nous refusons de concevoir les monadiques comme un commun. C'est donc du dedans, c'est de notre substance et non des sensibles que se produisent les projections des espèces; car autrement les choses sues par la science seraient plus obscures et plus impuissantes que les sensibles. Maintenant comme la science est plus puissante que la sensation, les choses sues sont d'un ordre plus élevé que les choses perçues par la sensation : or les universaux sont connus par la science et ce sont eux qui sont l'objet des sciences : ils sont donc plus puissants, plus nobles que les sensibles : car il est contre la raison que les causants soient plus pauvres que les causés : ainsi donc, comme nous l'avons dit, nous possédons au dedans de nous les espèces, et nous les possédons selon la substance. Elles sont, dans un sens différent, des νοήματα, des objets de notre pensée, et non des pensées, νοήσεις : car puisqu'elles sont engendrées de notre raison, nous avons le droit de les appeler νοήματα en tant que produits de la raison, comme nous appelons art la forme produite del'art, et nature la forme tirée de la nature. De plus, puisque toutes les raisons psychiques sont suspendues aux espèces divines et aspirent à les concevoir parla pensée, elles peuvent être par là aussi qualifiées de νοήματα. Car on appelle νόημα et l'intelligible même pensé et l'acte réalisé du pensant et sa faculté de connaître, de même qu'on appelle κίνημα l'acte réalisé de l'objet mû; mais dans la raison, comme nous l'avons dit, les deux choses coexistent l'une avec l'autre. Les intelligibles dans l'âme, par rapport aux νοήματα qui sont en elle, pourraient être dits pensés par eux, νοούμενα ὑπ' αὐτῶν; par rapport aux espèces qui sont les véritables et réels intelligibles, ils ont la valeur, le rôle de choses pensantes, parce que ceux-ci deviennent étant par eux. En tout ordre, les pensants ont, par essence, nécessairement, une fonction immédiatement au-dessous des choses intelligibles; car la nature de la raison a une alunite d'essence avec la connaissance des espèces. Dans l'univers, la raison est créatrice des espèces, et toute la démiurgie, la beauté et l'ordre des choses phénoménales est réalisée par le règne de la raison, et si l'on rejette la cause intellectuelle on ne pourra plus voir comment la substance des espèces est antérieure à l'hypostase du tout, et si on renonce à l'hypothèse des idées, on ne pourra plus conserver l'action créatrice intellectuelle sur les choses d'ici-bas; car la raison et les espèces sont accouplées les unes aux autres; et, à ce qu'il me semble, c'est en considérant cette parenté intime, que Socrate a défini les espèces des νοήματα. Il est bien évident qu'il faut les poser d'une manière propre selon chaque raison, universellement ou particulièrement, psychiquement ou intellectuellement; mais il est parvenu à accoucher, pour ainsi dire, de la substance intellectuelle; il a déposé dans la raison psychique ces νοήματα, pour y devenir incessamment et toujours, en remontant d'en bas, et en passant par des intermédiaires qui forment un continu. Car l'âme est la raison qui n'a pas encore accompli son évolution, et les νοήματα qui sont en elle ne sont que les images des premiers. Maintenant Parménide va faire remonter Socrate de ces νοήματα psychiques aux espèces intellectuelles mêmes, en disant : » § 76. — « Mais quoi! dit-il, une chacune de ces pensées, est-elle une pensée sans être la pensée de quelque chose ? — C'est impossible répondit-il. — Donc c'est la pensée de quelque chose ? —Oui. — De quelque chose qui est ou qui n'est pas ? — De quelque chose qui est.— Ne serait-ce pas de quelque chose un, que cette pensée pense comme étant dans tous, et qui est une idée, ἰδέαν, une — Oui.— Ensuite cette espèce ne sera-t elle pas ce qui est pensé être un, qui est toujours le même en toutes choses? — C'est encore ce qui paraît nécessaire. » Des choses communes, qui sont dans les individuelles, nous sommes remontés à quelque chose autre, mais qui leur est lié par un lien de continuité, telle qu'est l'espèce physique; ensuite de celle là encore, à la raison qui est dans l'âme, qui est capable de penser quelqu'un des êtres, tel que nous avons compris l'hystérogène, qui devient véritablement dans les âmes. Maintenant à partir de celle-ci, il faut arrivera la pensée même, νόημα, à la pensée de la raison substantielle, et enfin de celle-ci passer à l'être en soi, par un mouvement transitif auquel maintenant est amené Socrate par les discours maïeutiques de Parménide; car, puisque nous, nous posons que la raison dans l'âme est une pensée de quelque chose ou de rien, et que ce qui est la pensée de rien est absolument vide et une fiction imaginaire, comme lorsqu'on essaie de penser un hippocentaure ou un bouc-cerf, ou mieux encore lorsqu'on essaie de penser un scindapsus, ou quelqu'une des autres choses qui n'ont absolument aucune hypostase: car nous avons encore de ces choses une certaine représentation par l'imagination, il reste donc que la notion dans l'âme soit la pensée, νόημα, de quelque chose ; si elle est la pensée de quelque chose, il faut se demander si c'est de quelque chose qui est ou qui n'est pas. Or il est évident que la notion dans l'âme est la pensée de quelque chose qui est; ensuite il faut (se demander) si cette espèce qui plane au dessus de toutes les espèces psychiques et physiques, que nous disons que la pensée pense et qui est une idée une, n'est pas de beaucoup antérieure (à la précédente); car celle-là a beaucoup plus de force et d'affinité- pour l'être que la pensée seule. Mais maintenant l'espèce et la pensée, qui sont deux espèces, comment seront-elles antérieures à un? S'il faut faire l'une des deux, espèce, il est évident que la plus puissante sera espèce, et telle est cette pensée que nous disons être planant au-dessus de toutes les choses conçues par Ie νόημα comme homogènes (de même espèce) ; car celle-ci est la cause de l'être pour les semblables, et ce n'est pas le νόημα qui a la faculté de penser celle-ci. Car la pensée qui a pour objet mon père, qui pense qu'il est père,. n'est pas la cause de moi : c'est le père qui est cette cause. Il en est ainsi de toutes les causes : ce n'est pas les pensées qu'on s'en forme qui sont les causes des êtres qui sont selon ces pensées : les causes sont avant les νοήματα qui, eux, sont les causes de la vérité des νοήματα qui nous disent que ceux-là sont causes de l'existence de certains effets. Ainsi donc tous ceux qui conçoivent les idées comme seulement et purement des pensées, νοήσεις, ceux-là en disant que toute pensée est la pensée de quelque chose (τινός;) entendent que c'est la pensée de quelque chose qui pense, (d'un sujet pensant) : c'est comme si tu disais qu'il n'y a pas d'αἴσθημα (c'est-à-dire d'objet interne présent à l'esprit, à la suite d'une sensation) entendant que la sensation, αἴσθησις;, est seulement la sensation (l'acte) de la faculté de sentir. Et c'est pour cela qu'on dit que Parménide fait un paralogisme. Mais tous ceux qui posent que les pensées se confondent avec les intelligibles, conçoivent que le νόημα appartient et au pensant et à l'étant, tous étant unifiés les uns avec les autres : le pensant, la pensée, l'intelligible ; et il ne faut pas alors s'étonner qu'on dise que. dans les choses sensibles, la sensation, αἴσθησις, qu'ils nomment αἴσθημα, est identique au sensible, τὸ αἰσθητόν. Mais si le νόημα de l'intelligible est non seulement en nous, mais encore dans la raison divine, dans la raison vraie, il est évident que l'intelligible est antérieur au νόημα, et c'est parce qu'elle se fonde sur lui que la notion dans l'âme est un νόημα. Car la nature concentrée des notions dans l'âme et leur caractère divisé et transitif dans les actes, montrent suffisamment qu'elles diffèrent de l'espèce intelligible, qui, sous un mode unifié et indivisible, embrasse la cause de toutes les notions. C'est cette espèce qu'il appelle ici Un, et qu'il place au-dessus de toutes, capable de saisir les diacosmes spécifiques et qu'il dit être pensée par le νόημα comme étant une seule idée une. Par là on peut comprendre que la pensée de toute raison est aussi la pensée de tous les intelligibles préexistants, que la pensée n'est pas une connaissance vide, mais la pensée de quelque chose qui est, et que les intelligibles ne sont pas au-dessous et après les pensants ; car ainsi les pensées seraient avant les pensants qui ne sont pas encore ou seraient telss avant ceux qui pensent les intelligibles, et par là avant les pensées ; (car de toute nécessité les pensées sont dans les pensants, comme les sensations dans les sentants, et toutes les connaissances dans les connaissants, et non en dehors des connaissants,) ou bien elles sont dans les pensants mêmes, puisqu'elles ne sont pas après les intelligibles, afin d'éviter que les pensées étant en acte avant que les intelligibles soient, elles ne soient les pensées de rien. Or si les intelligibles sont avant les pensants, il faut qu'il y ait en ceux-ci un autre, puisque tout pensant se pense lui-même, et que ce qui se pense soi-même pense par sa propre pensée, sans avoir besoin de regarder en dehors de lui. Il faut donc, des termes de Platon, conclure ceci : qu'il y a un νόημα existant, et il n'ajoute pas que l'être est en dehors du νόημα, parce que la raison est double, l'une se pensant seulement elle-même, l'autre se pensant elle-même et pensant aussi les choses qui sont avant elle et celles qui sont après elle, et qu'aucune ne les pense si ce n'est parce qu'elle en possède les causes. Car l'intelligible est de trois manières : selon la participation, dans la raison qui pense les choses qui sont avant elle ; selon l'hyparxis, dans la raison qui se pense elle même, et selon la cause, dans la raison qui pense les choses qui sont après elle. Et là où l'intelligible est selon la participation, est aussi l'intelligible selon l'hyparxis : car nécessairement ce qui pense les choses antérieures à lui, se pense aussi lui même ; mais là où est l'intelligible selon l'hyparxis. il n'est pas nécessaire que soit l'intelligible selon la participation ; car la raison absolument première se pense seulement elle-même, parce qu'elle n'a. avant elle-même, aucun intelligible ; là où est l'intelligible selon la cause, là est aussi l'intelligible selon l'hyparxis ; car par le fait qu'une chose se pense elle-même, elle peut aussi penser les intelligibles qui sont après elle ; mais là où est l'intelligible selon l'byparxis, il ne faut pas dire qu'est l'intelligible selon la cause, s'il y a quelque raison dernière, n'ayant après elle aucun intelligible qu'elle puisse penser, mais se pensant elle même selon la cause et étant intelligible à elle même. C'est là, comme je le disais, ce que tu peux comprendre dans les paroles de Parménide qui dit : que le νόημα est le νόημα de quelque chose qui est : ce que, dans le Théétète il appelle \' opinion de quelque chose. C'est pourquoi le non être n'est pas opinable, et tout connaître est connaître quelque chose et non pas rien, et puisque l'un est présent dans tous les êtres, à plus forte raison il est rattaché et suspendu au νόημα en soi; car tel est l'effet que produit l'un planant sur toutes les choses. Nous ne nous arrêterons donc pas en remontant d'espèces à des espèces différentes avant d'avoir atteint, dans notre course ascensionnelle, les êtres véritablement êtres. Car si nous trouvons unifiés par une sorte de coalescence, συμφυῶς, la raison et les intelligibles, la raison sera le plérome des espèces selon l'intelligible qui est en elle même; et de même que nous unifions l'un à l'autre la raison et l'intelligible, de même nous identifierons les νοήματα avec les êtres; car la raison étant en elle même et se pensant elle même est en même temps remplie des intelligibles ; et de même que dans les choses sensibles ce qui paraît en quelque manière un, est, dans la vérité, pluralité, de même dans les intelligibles la dualité du νόηά et de l'être a une hypostase uniée. C'est donc ainsi que l'âme passant de ses propres νοήματα aux êtres, comme de choses différentes à des choses différentes, éprouve des changements, tandis que les νοήματα de la raison sont les êtres, par suite de la conversion intellectuelle et de l'identité qui domine en eux. § 77. — « Eh! bien, dit Parménide, si tu reconnais que les autres choses participent des espèces, ne te trouveras-tu pas obligé d'admettre que chacune est composée de pensées et pense tout i, ou que, tout en étant des pensées, νοήματα, elles ne pensent pas? — Ceci, dit-il, est contre la raison. » En s'appuyant sur deux arguments il transporte le sujet des νοήματα psychiques aux espèces intelligibles qui sont intelligibles aux νοήματα et appelées pour cette raison νοήματα. Le premier est tiré du νόημα lui-même ; car l'être qui a la faculté noématique est réellement. Cet être donc est l'espèce véritable, l'espèce qui est au-dessus de toutes les espèces, toujours étant et la même et un, et par là même pensable, νοούμενον, et non pas seulement pensante, comme le νόημα psychique; car il est évident que le νόημα pensant est diffèrent du νόημα pensé, de sorte que celui-ci, et non le νόημα sera l'espèce ; ou bien alors tous les deux seront des espèces, et il y aura deux premières espèces, et non une seule idée une de chaque chose. Par le deuxième argument, tout ce qui participe du νόημα, en tant que νόημα, doit nécessairement penser ; or les choses d'ici bas participent des espèces, de sorte que si les espèces premières sont des νοήματα, et si les choses d'ici- bas participent des espèces, toutes choses, en tant que νοήματα, sont noétiques(capables de penser) ; car ce qui a participé de la pensée, νόησις, qui est le νόημα, pense, de même que ce qui a participé de la vie, vit, et ce qui a participé de l'être, est. Donc les espèces ne sont pas des νοήματα, du moins de ces νοήματα qui ont la fonction et l'ordre de pensées, νοήσεις et il n'y a rien d'absurde à dire que ce qui participe des νοήματα, ne pense pas. Si donc toutes choses participent des espèces, et que toutes choses ne participent pas des νοήματα, les espèces ne seront pas des νοήματα; car il en résulterait une de ces trois choses : ou bien les choses participant du νόημα ne participent pas de l'acte de penser, τοῦ νοεῖν, ou les espèces ne sont pas des νοήματα, ou les choses impensables et non pensantes ne participent pas des espèces : les deux premières conclusions sont absurdes; car tout ce qui participe du νόημα, pense, νοεῖ: le νόημα implique et révèle la pensée, νόησις ; et les choses impensables et non pensantes participent des espèces, comme les choses inanimées participent de l'égal, du moindre, du plus grand, qui sont des espèces. Les espèces ne sont donc pas des νοήματα; elles ne sont pas substantiflées dans les νοήματα mais dans les intelligibles. Remontons donc des choses divisibles aux raisons non divisées de la nature, à l'hyparxis de laquelle il n'appartient pas de penser les choses qui sont avant elle; car non seulement la nature est non pensante, ἀνόητος, mais elle est dénuée de raisonnement et d'imagination; de ces raisons, remontons aux intelligibles placés au-dessus des espèces physiques, (de la nature), parce qu'ils sont des produits réalisés des actes de l'âme pensante, d'après la thèse posée par Socrate à leur sujet; car il a dit qu'ils deviennent et se produisent dans l'âme et sont des νοήματα de l'âme, en tant que pensées, νοήσεις. De ceux-ci remontons encore aux intelligibles réellement intelligibles : car ce sont ceux-ci qui peuvent être les causes des choses spécifiées, et non ceux qui sont seulement des νοήματα. De sorte que si la raison démiurgique est dite créatrice du Cosmos et cause de tout, c'est selon l'intelligible qui est en elle qu'elle est cause, pour toutes choses, de l'être, c'est selon la vie, qu'elle est cause du vivre seul, et par une conséquence nécessaire, c'est selon la raison qu'elle est cause du penser seul. Il faut donc que les choses tiennent leur principe non des choses pensantes, mais des choses pensées (des noumènes), afin qu'elles soient causes de toutes, de celles qui sont capables de penser et de celles qui ne le sont pas: car l'être est commun à toutes : or l'acte de penser n'est pas commun à toutes: donc les νοήματα psychiques ne sont pas les premières des espèces ; mais ce sont les espèces pensées par ces νοήματα, les espèces principales et premières qui sont, pour toutes choses, causes de la substance, de l'union, et de la perfection. Il est bon ici d'insister sur ce point-ci : pour quelle raison toutes choses étant intellectuellement dans la raison, toutes les choses d'ici bas, qui participent aux espèces, ne pensent pas, et pour quelle raison toutes celles là étant vivantes, toutes celles qui sont assimilées à celles-là ne vivent pas. Disons donc que l'abaissement des êtres, s'abaissant depuis les causes premières jusqu'aux dernières, affaiblit et obscurcit les participations des substances universelles et parfaites, et que la démiurgie, passant à travers tout, crée toutes choses selon les différentes mesures de la substance, que toutes ne participent pas de la même manière de la même espèce, mais les unes dans une plus grande, les autres dans une moindre mesure : les unes sont assimilées à l'espèce selon une seule puissance, les autres selon deux, les autres selon un plus grand nombre. Voilà comment se manifestent certaines séries liées qui s'étendent depuis le haut jusques en bas : je dis par exemple l'espèce de la lune. Car parlons d'elle. D'un côté on la voit figurer au nombre des Dieux selon l'un de son espèce et selon sa bonté; car tout ce qui est divinisé vient du Bien, comme dit Socrate dans la République, par la lumière de la vérité; mais on la voit aussi figurer parmi les anges, selon son caractère intellectuel, et si tu l'aimes mieux, parmi les démons, qui, par la pensée, représentent l'image de cette espèce et sont des animaux noétiques, (pensants), mais qui ne peuvent pas l'imiter intellectuellement mais seulement vitalement. Et tu vas voir se présenter à ton examen une innombrable série d'animaux séléniaques ; tu auras à chercher à connaître l'Apis Égyptien, puis le poisson sélénite, et beaucoup d'autres animaux qui imitent les uns d'une façon, les autres d'une autre, l'espèce céleste de la lune qui est vue, au dernier degré, dans les pierres, de sorte qu'il y a certaine pierre qui est suspendue à cette espèce, sujette à des accroissements et à des diminutions qui accompagnent ceux de la lune céleste, quoiqu'elle ne participe pas à la vie. Partout donc, conçois-moi que c'est la même chose. Ne vas pas croire que toutes choses reçoivent toutes les puissances des espèces : elles les reçoivent avec un abaissement qui leur est propre, les unes en plus grand nombre, les autres en plus petit. Donc il ne faut pas dire que toutes les propriétés qui sont dans les espèces se retrouvent en nombre égal dans toutes les images. Il n'y a nécessairement dans toutes qu'une image conforme à chaque espèce, imitation qui est la marque propre de l'espèce elle-même, en tant qu'elle est distincte des autres; car, quoique les espèces soient toutes un πάντα ἔν, celui qui se présente le plus manifestement en chacune est un certain un qui définit son hyparxis propre, à laquelle participe tout ce qui a pris son origine selon lui. C'est cet un qui fait la série une; la participation des puissances qui sont dans l'espèce, selon qu'elles sont en plus grand nombre ou en plus petit nombre participées, met au jour les membres premiers, moyens. extrêmes de la série, parce que la même espèce est participée, ici dans une certaine mesure, là dans une autre La raison paternelle, qui est unique et une, détermine pour toutes les choses les mesures de leur participation et les concours que chacune apporte au monde, parce qu'elle possède par anticipation les premiers, les moyens, les membres extrêmes de la série de chacune des espèces, et par la nécessairement elle détermine d'avance, jusque dans sa mesure numérique, la propriété particulière de chacune d'elles. Ajoutons à ceci que la participation étant sujette à des différences, les propriétés particulières les plus abaissées des espèces abandonnent les premières leurs participants; celles qui sont plus universelles sont les deuxièmes à les abandonner ; et cependant dans tous leurs effets, apparaissent également les participations principales et premières et qui sont le plus apparentées à l'un: car chaque espèce est un et pluralité, non pas par suite' d'une composition de la pluralité qui constituerait l'un, mais parce que c'est l'un qui crée dans cette pluralité les plusieurs propriétés particulières qu'elle renferme. C'est donc cette espèce, qui, sous le mode de l'unité, est, vit et pense; des choses qui sont engendrées selon elle, les unes participent de toutes ces propriétés, les autres d'une seule, de l'être ; car les espèces elles-mêmes reçoivent l'intellectuel de l'un : la vie vient de la vie imparticipable, l'être de l'un être, de même que l'un leur vient de l'hénade placée au delà des êtres. Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur ces doctrines. Des deux arguments dont il use pour remonter de l'âme à l'être en soi, l'un est formulé dans les mots cités du texte, où il dit que le noumène même sera donc espèce, parce qu'il est toujours et le même en toutes les espèces et qu'il est plus noble et plus élevé (dans la série' des choses) que le νόημα (notion pure) qui est dans l'âme, puisque le pensable, τὸ νοούμενον, est supérieur au pensant. Car si le pensant est âme et le pensable raison, la raison est supérieure, et si le pensant est raison, et le pensable, intelligible, l'intelligible est supérieur à la raison. Le deuxième, il l'a expliqué tout entier en disant : que si les choses d'ici-bas participent des espèces et si les espèces sont des νοήματα, les choses d'ici bas participent des νοήματα : or il est nécessaire que les choses qui participent du νόημα pensent; mais si les νοήματα participent des espèces, cette conséquence n'est plus nécessaire. Donc les espèces, du moins les espèces premières ne sont pas des νοήματα. Et cet argument nous montre non seulement que les espèces ne sont pas dans l'âme, mais même qu'elles sont antérieures à la raison ; car la raison se pensant elle même et aussi ses intelligibles, est en tant que raison, le désirant, et en tant qu'intelligible, le désirable, et de ces deux, l'un est plus apparenté au bien, l'autre l'est moins; car désiré est le bien et non désirant. Il est donc nécessaire, puisque les raisons physiques ne sont ni intelligibles ni capables de penser, que l'ascension aux espèces intelligibles s'opère, pour nous, par des termes moyens. Tout ce qui est capable de penser est donc placé avant la nature qui ne pense pas, et celui-là est de deux sortes : ou il est capable d'un mode de penser transitif, ou il ne l'est pas; car chacun des deux pensants désire l'intelligible qui lui est apparié et accouplé, comme nous l'avons dit. Or je dis que l'intelligible est avant cette nature, parce que ni la nature ni le corps ne sont choses pensantes ; ensuite avant celui-là, est ce qui est à la fois pensant et pensé, telle qu'est l'espèce intellectuelle ou psychique; puis avant ceux-ci, est l'intelligible même. Car il faut que même avant cette espèce qui laisse encore apparaître une certaine dualité, il y ait l'intelligible en soi, le primairement intelligible, et que la raison participe de celui ci, et par l'intermédiaire de la raison, l'âme. Ainsi donc non seulement il faut monter et passer des espèces psychiques aux espèces intellectuelles, en tant que pensables, mais de celles-ci aux intelligibles au sens propre et éminent, desquels l'être vient à toutes les espèces. C'est ainsi que le procédé maïeutique de Parménide transporte la discussion des dernières espèces aux premières de toutes, en montrant qu'il ne faut concevoir la participation des espèces ni comme corporelle ni comme physique (naturelle) ni comme psychique, mais sous un mode qui soit en affinité avec les espèces intellectuelles et intelligibles. § 78. — « Aussi, mon cher Parménide, ce qui me semble le plus admissible, c'est qu'il en soit ainsi : c'est-à-dire que ces espèces existent dans la nature (des choses) comme paradigmes, que les autres choses leur ressemblent et n'en soient que des imitations ressemblantes, et que cette participation des espèces ne soit pour les autres choses que leur ressembler. »
Ramené à la substance
intelligible des espèces, Socrate, dont l'art maïeutique de Parménide guide tous
les pas, s'imagine ici avoir atteint une solution excellente relativement au
rôle et en même temps au mode de la participation, en disant que les espèces
elles-mêmes sont dans la nature, et que les autres deviennent par un rapport à
elles, ne faisant par là rien autre chose que reconnaître aux espèces une
substance immobile et immuable et aux choses qui n'existent que par une relation
à elles, une substance qui roule dans le devenir : car par là il oppose, en les
divisant, l'être au devenir, en les divisant en choses qui sont toujours les
mêmes et selon la même manière d'être, et choses qui ne sont jamais dans le même
état et ne font que devenir. De même que Timée et l'hôte d'Élée, dans le
Sophiste-, ont distingué et séparé le devenant et l'étant, de même il a
conçu et cru avoir atteint le rang (qu'occupent dans la série des êtres) les
espèces. Puis il propose un mode de participation qui résout les difficultés
présentées plus haut et qu'il pose comme la ressemblance, afin de n'être pas
contraint de reconnaître que les choses d'ici-bas ne participent des espèces ni
en totalité ni partiellement, et de pouvoir dire que les espèces ne sont pas au
même rang que les choses d'ici-bas, car le paradigme n'est pas présent dans
l'image ni au même rang d'essence qu'elle. La participation est donc par
ressemblance. C'est là le sentiment qu'il expose en appelant les espèces
paradigmes et les choses qui en participent des imitations, et disant par là
même que la participation est une ressemblance. Et il a une telle confiance dans
cette hypothèse, que lui, qui, tout à l'heure, jurait qu'il n'était pas facile
de définir ce qu'est la participation et comment les espèces arrivent et se
produisent dans les sensibles, dit maintenant que le mode de participation qu'il
a découvert dans la ressemblance5 lui semble très vraisemblable, et par le mot μάλιστα
(très) et par le verbe καταφαίνεσθαι qu'il emploie au lieu de dire seulement φαίνεσθαι,
il montre qu'il a une très grande confiance dans son hypothèse. Cet état
d'esprit a été en lui le résultat de sa propre pénétration d'esprit et du
puissant génie de Parménide, qui donne leur achèvement et leur complément
parfait aux pensées spontanées de Socrate sur les choses divines. Par quoi il
est évident que la méthode de ces entretiens est la méthode maïeutique, et non
un système de critique et de réfutation ; car il n'aurait pas représenté
l'interlocuteur faisant des progrès dans la recherche, et arrivant à des
conceptions plus parfaites. En effet le but de la maïeutique est de faire sortir
au dehors la connaissance interne, tandis que le but de la discussion éristique
(ἀγών) est de vaincre et d'acculer celui qui répond, à toute sorte d'absurdités.
Si donc à chaque objection qui lui est faite Socrate s'élève plus haut, devient
plus parfait, analyse et organise les notions qui sont en lui touchant les
espèces primordiales, il faut dire qu'il est accouché par Parménide plutôt que
terrassé, et que ce débat est plutôt un moyen de le rendre plus parfait que de
le combattre. Tel est, comme nous l'avons plusieurs fois fait remarquer, tel est
le caractère de la tournure de ces entretiens. Voyons aussi comment l'hypothèse
de Socrate est un progrès vers la vérité, mais ne la possède pas encore parfaite
et complète : car il a raison de se rattacher aux espèces intellectuelles et aux
paradigmes réels ; il a bien défini leur essence particulière, en disant
qu'elles sont et que les autres choses s'assimilent à elles ; car le fait de
posséder une vertu génératrice et une essence qui est toujours de la même
manière, est le propre de ces espèces qui sont et qui sont éternellement en
acte. L'hôte d'Élée dit lui aussi que être toujours dans le même état et de la
même manière convient aux plus divines des choses et à elles seules, et que leur
être en repos (ἑστάναι) n'est rien autre chose que être dans le même état et de
la même manière : c'est la définition qu'il a donnée dans le Sophiste. Si
donc Socrate dit que les espèces sont immobiles et s'il est dit dans le Sophiste
que les choses qui sont immobiles, ἑστῶτα sont dans le même état et de la même
manière, et si les choses qui sont dans le même état et de la même manière sont
définies dans le Politique les plus divines de toutes, il est évident que
les espèces sont les plus divines des choses et ne sont pas exclusivement, par
elles mêmes, des pensées, νοήματα, des âmes, mais sont détachées et affranchies
et indépendantes de toutes les choses de cette nature. Tout cela est juste,
comme aussi quand il pose l'union en elles avant la pluralité ; car la locution
ἐν φύσει, dans la nature, exprime l'hénade une de ces espèces: Platon a en effet
l'habitude de transporter le nom de nature aux intelligibles. C'est ainsi que
Socrate lui même dans le Philèbe dit que la raison royale, que l'âme
royale ont leur hyparxis dans la nature de Zeus; et LeTlimée: «
Ainsi donc la nature, ἡ φύσις, de l'animal se trouva être éternelle », et il
appelle encore nature la monade des idées intelligibles, et démontre qu'elle
(cette nature) est immuable en disant qu'elle est éternelle. Car le ἑστός de
cette nature montre qu'elle demeure dans l'un pendant l'éternité, tandis qu'il
ajoute que le temps est mobile, et qu'il a possédé l'hypostase en même temps que
la génération ; c'est ainsi qu'ici Socrate attribue le devenir aux choses qui
participent des idées. Tel est donc ce qu'on appelle ici nature : une hénade une
qui embrasse et enveloppe les espèces intellectuelles Tout cela, comme je l'ai
dit, est très exact. Mais en attribuant la propriété paradigmatique seule aux
espèces, et non la puissance télésiurgique et la fonction de garder, par là il
pourra sembler qu'il ne comprend qu'imparfaitement encore le système des idées ;
chaque espèce n'est pas seulement paradigme des sensibles, mais elle est la
cause de leur hypostase ; car elles n'ont pas besoin d'une autre chose, autre
qu'elles mêmes, qui produise les choses d'ici-bas et les assimile à elles mêmes,
tandis qu'elles demeureraient elles mêmes i inertes et immobiles, n'ayant aucune
puissance efficiente, mais ressemblant aux ébauches informes modelées en cire;
au contraire ce sont les espèces qui produisent et engendrent en elles leurs
propres images. Et on effet il serait absurde, que les raisons dans la nature
eussent une puissance créatrice et que les espèces intelligibles se trouvassent
dépourvues de la cause efficiente. Donc toute espèce divine est non seulement
paradigmatique (exemplaire), mais encore cause paternelle et par son être même
génératrice des plusieurs, et non seulement cela, mais en outre télésiurgique ;
car c'est elle qui amène les choses d'ici-bas de l'état imparfait à l'état de
perfection, qui crée en elles un état bon, remplit leur insuffisance et leur
indigence, pousse la matière, qui est tout en puissance, à devenir en acte tout
ce qui était en puissance avant la spécification. Les espèces possèdent donc en
elles-mêmes la puissance télésiurgique. Et pourquoi n'auraient elles pas aussi
la puissance de garder et de protéger? Et d'où vient donc cette organisation
ordonnée, indissoluble du Tout, si ce n'est des espèces? d'où viennent les
raisons permanentes qui conservent le lien un de la sympathie ineffable de
toutes les choses, par lesquelles le monde demeure toujours parfait, sans qu'au
cune espèce vienne à lui faire défaut, si ce n'est de causes qui persistent dans
leur état, comme le fait de changer vient de causes changeantes? et les corps
dont le caractère est d'être divisibles et de se disperser, d'où vient qu'ils
sont resserrés et con tenus dans l'unité, si ce n'est parla puissance
indivisible des espèces ? Car en soi et par soi le corps est divisible et a
besoin , de la puissance des raisons qui Ie maintienne dans son système. Et si
l'union précède cette puissance qui retient les choses dans leur système, (car
tout ce qui a cette puissance de maintenir les choses dans leur état propre a
besoin d'être lui-même d'abord un et indivisible) l'espèce sera non seulement
génératrice, comme nous l'avons dit, et gardienne et protectrice et
télésiurgique, mais encore capable de maintenir et de conserver l'unité de
toutes les choses secondes. Mais alors, dira-t-on, il aurait fallu qu'il i eût
égard non pas à une seule puissance des espèces, la puissance assimilatrice,
mais qu'il tint compte aussi des autres puissances, et qu'en définissant quel
est le mode de la participation, tout en disant que la participation est une
assimilation, il ajoutât qu'elle est la puissance de maintenir dans leur état
les choses assimilées, de les protéger, de les mener à leur perfection finale,
ce que le Timée nous enseigne, quand il nous dit que le monde est devenu, mais
parfait, indissoluble, par son assimilation à l'animal en soi, à l'animal
parfait et complet. Mais il est bien clair qu'en disant que la participation est
assimilation, Socrate a compris tous ces caractères : car les choses assimilées
à des choses qui persistent dans leur être sont nécessairement indissolubles et
sont contenues dans leurs propres raisons et protégées par elles en ce qui
concerne leur substance, ou bien alors elles ne seraient pas semblables à des
choses stables et persistantes ; elles seraient confondues ensemble par un
devenir instable, et complètement dispersées et séparées d'elles-mêmes; et les
espèces non plus ne seraient pas paradigmes, dans le sens d'immobiles, s'il n'y
avait pas d'autres choses semblables dont elles sont les paradigmes, pour
permettre à celles-là d'être semblables aux paradigmes immobiles. De là vient
que nous disons qu'il n'y a pas d'idées des choses qui deviennent
particulièrement, mais seulement des choses éternelles qui sont dans les choses
engendrées et instables. Qu'on ne nous reproche donc pas d'employer ce nom de
paradigmes comme par métaphore, en considérant les paradigmes d'ici-bas qui sont
sensibles, dont l'hypostase est inerte et impuissante,et qui ont besoin d'autres
choses pour les faire tels. Car Socrate n'a pas dit simplement que les espèces
sont paradigmes, mais comme des paradigmes. Et ce mot supprime la forme
inféconde et inanimée des paradigmes, (modèles) comme nous les entendons
habituellement, et révèle dans les espèces le principe primordial des images.
Qu'on n'aille pas non plus mettre à part le paradigme et la cause efficiente,
qu'on les rassemble et qu'on les voie réunis en un. Car le paradigme par sa
substance même donne l'hypostase à ce qui devient conformément à lui ; et la
cause efficiente, créant par son être même et assimilant à elle même la chose
§ 79. — Si donc, dit-il, quelque chose ressemble à l'espèce. est-il possible que cette espèce ne soit pas semblable à la chose qui lui ressemble, puisqu'elle a été rendue semblable à elle? ou y a-t-il quelque expédient qui empêche que le semblable ne soit pas semblable au semblable? — Il n'y en a pas. — Mais n'est-il pas de toute nécessité que le semblable au semblable participe d'une seule et même espèce? - De toute nécessité. — Mais ce dont les semblables participent et par quoi ils sont semblables 5 , cela n'est il pas l'espèce même ? — Absolument ». Socrate ayant posé les espèces comme paradigmes existant à l'état de permanence, en soi, et ayant appelé les choses d'ici-bas des imitations de ceux-ci, et par suite définissant la participation une assimilation, et semblant sur tout cela n'avoir que des notions imparfaites, — car ni les espèces ne sont pas seulement paradigmes, mais elles sont de plus génératrices et gardiennes des choses sensibles, comme nous venons de le dire, ni les choses d'ici-bas ne sont seulement des imitations, mais encore des productions des espèces, qui les veillent et les défendent, leur apportent d'en haut toute leur perfection et la force d'adhérence qui fait d'elles un tout continu, à moins que, par la ressemblance des choses qui deviennent à leurs paradigmes stables, comme nous l'avons dit, la définition de Socrate n'ait réuni et compris toutes ces propriétés, — Socrate donc, ayant ainsi formulé son opinion sur ce point, Parménide, avec un art tout à fait divin, a accordé que ces paradigmes subsistent dans la nature, comme l'a dit Socrate, comme si celui-ci, dans ses paroles, avait touché l'hypostase intellectuelle de ces paradigmes, puisqu'il croit résoudre les premières objections concernant la participation en introduisant l'imitation et la participation par ressemblance, qui nous délivre de la difficulté fondée sur le tout et la partie, Parménide, voulant montrer la cause primordiale et universelle du paradigme, et celle qui est en même temps au delà de toute relation avec les choses qui lui ont été assimilées, fait voir que si le sensible est semblable à l'espèce intelligible, il ne faut pas convertir le rapport, et dire que celui-ci est aussi semblable à celui-là, afin que nous ne soyons pas obligés de chercher avant ces deux semblables l'un à l'autre, encore quelqu'autre espèce différente, qui serait cause aux deux de leur ressemblance. Car les choses qui sont semblables les unes aux autres, nécessairement participent en commun de quelque chose et d'une même chose, et c'est parce même qui est en elles qu'elles sont dites être semblables. En effet si l'on accorde que le participé et le participant sont semblables l'un à l'autre comme le paradigme et ce qui est fait à son image, il y aura avant eux quelqu'autre chose qui les rendra semblables, et cela à l'infini. Pour répondre à cela, Socrate aurait dû dire qu'il y a deux sortes de semblables, le semblable qui est au même rang d'ordre que son semblable, et le semblable qui est abaissé par rapport à son archétype, que l'un est conçu dans et par l'identité d'une certaine notion et d'une seule et même notion, tandis que l'autre a non seulement le semblable, mais en même temps le différent, parce qu'il est semblable en tant que tenant de l'autre, ἄπό, la possession de la même espèce, mais ne la possédant pas avec lui, μετά. C'est là un argument présenté sous une forme logique et aporétique. Mais si tu veux ramener ces deux sortes de semblables aux nombreuses classes des espèces, tu pourras en voir la profondeur ; car autres sont les espèces physiques, qui sont avant les choses sensibles; autres les psychiques, autres les intellectuelles : mais avant celles-ci, il n'y en a plus d'autres. Celles-ci sont donc uniquement paradigmes, et ne sont nullement semblables aux choses qui viennent après elles ; les psychiques sont et paradigmes et images; et en tant qu'images, et elles-mêmes et les choses qui viennent après elles, sont semblables les unes aux autres, parce que leur hypostase naît de leur rapport aux mêmes espèces, les espèces intellectuelles. Et de même, les espèces physiques; car elles sont au milieu des psychiques et des sensibles : elles sont semblables aux sensibles, non pas en tant qu'elles en sont les paradigmes, mais en tant que tous les deux sont les images de celles qui sont au-dessus d'elles : mais celles qui sont seulement paradigmes ne sont plus semblables à leurs images : car ce sont les choses qui ont subi une même modification qui sont semblables : or ces espèces, étant premières, n'en ont subi aucune. C'est ici un argument d'ordre philosophique. On peut présenter la preuve sous une autre forme, la forme théologique; car autres sont les espèces dans la raison cosmique, autres celles qui sont dans la raison démiurgique, autres celles qui sont au milieu de ces deux ; celles-ci étant placées dans la raison participable mais hyper-cosmique, qui lie et réunit les espèces dans la raison cosmique avec celles placées dans la raison imparticipable. Les espèces étant ainsi divisées en ces classes, il y en a dans lesquelles la relation du semblable est réciproque et convertible, d'autres où elle ne l'est pas, comme par exemple, dans les espèces démiurgiques ; car elles sont au-delà de l'ordre assimilateur des espèces, qui appartient, avons-nous dit, à la raison participable, quoique hypercosmique. Donc les unes, subordonnées à cet ordre sont, sous un certain rapport, assimilées les unes aux autres et à celles qui les précèdent ; les autres espèces. celles de la raison imparticipable, sont supérieures à cet ordre, de sorte que les choses sensibles sont assimilées à elles, mais elles, elles ne sont pas assimilées aux sensibles ; car si elles leur étaient assimilées, nous ne pourrions plus nous arrêter; nous irions à l'infini, ne pouvant trouver nulle part le principe de la ressemblance. A ceux qui commencent par le bas, il est possible de dire que les intellectuelles dans le Tout et les psychiques sont semblables les unes aux autres, en tant que toutes sont au-dessous des raisons assimilatrices, et, pour ainsi dire, sœurs les unes des autres; mais pour ceux qui remontent à la raison imparticipable elle-même, il n'est plus possible de le dire; car l'ordre assimilateur est un ordre intermédiaire et n'est pas supérieur à tous les deux. En effet étant intermédiaire, il assimile uniquement les sensibles qui sont d'une dignité plus pauvre que lui même, mais il ne fait pas l'inverse : il n'assimile pas les intellectuelles aux sensibles; car il n'est pas permis par la justice des choses, que le conséquent donne quelque chose à l'antécédent, ni que l'antécédent reçoive quelque chose des conséquents. Voulant donc prouver à Socrate que ces paradigmes sont, sans doute, intellectuels, mais qu'ils ont leur racine et leur fondement avant les raisons assimilatrices et dans la raison imparticipable, Parménide montre qu'il ne faut pas que la relation des espèces aux choses d'ici-bas soit convertible; car cette propriété (de convertibilité) appartient aux choses qui sont au-dessous de la cause assimilatrice, par laquelle elles sont conjointes et liées ensemble, parce que son acte s'étend d'en haut sur les deux, et sur les choses assimilées et sur celles auxquelles elles sont assimilées. C'est là la méthode théologique de traiter ce sujet dans laquelle nous divisons et intimerons les nombreux ordres des espèces physiques et intellectuelles, et celles-ci, comme nous l'avons dit, disposées et classées ou selon la raison participable mais encosmique, ou selon la raison participable et hypercosmique, ou selon la raison imparticipable et l'ordre assimilateur des raisons, dans la raison hypercosmique et imparticipable, comme nous le rendra évident la deuxième hypothèse, et comme la tradition révélée par les Dieux aux Théologiens l'a enseigné à ceux qui l'ont comprise dans son vrai sens. Il nous est donc permis, dans les espèces qui ne sont qu'espèces, prenant le semblable en soi et le dissemblable, qui sont des moyens entre les espèces généralissimes et les espèces individuelles, de voir, au point de vue philosophique, qu'elles se subordonnent aux généralissimes pour opérer les assimilations en agissant sur les seuls participants, et comment elles apportent par leur action un concours aux espèces individuelles, et donnent à celles-ci et aux choses qui deviennent selon elles, la participation d'elles mêmes, leur communiquent la ressemblance et la dissemblance, de sorte que, dans celles-ci on peut établir une conversion vraie du semblable, mais non dans toutes : qu'ainsi c'est une erreur d'étendre la conversion sans exception ni réserve à toutes les espèces. Mais comment démontre-t-il cela? Si, dit-il, les choses d'ici-bas sont semblables aux espèces, les espèces aussi seront nécessairement semblables à ces choses : et Parménide sachant bien que c'est faux, interroge de nouveau Socrate en l'invitant à bien analyser la ressemblance dans toutes ses parties : « y a-t-il quelque moyen que le semblable ne soit pas semblable au semblable; » puis à cette prémisse il ajoute ensuite : « que les semblables participent d'une seule et même espèce, selon laquelle a lieu la ressemblance. » Donc il y aura avant les espèces quelqu'autre espèce qui sera la plus propre de toutes. Or tu vois que si la discussion et l'examen portaient sur les deuxièmes espèces de l'ordre assimilaient', comme il a été dit, et sur les espèces les plus particulières, qui ont rang après le semblable et le dissemblable, il n'y aurait rien d'étonnant que toutes les espèces deuxièmes participassent de la cause assimilatrice qui est plus parfaite qu'elles ; mais si la question est sur les espèces imparticipables, cela n'est plus vrai : et c'est sur celles-là que Parménide réfute Socrate ; car il faut que les espèces premières n'aient aucune autre espèce qui leur soit supérieure : s'il en est ainsi, la relation n'est pas convertible pour elles. S'il en est ainsi, elles sont des êtres intellectuels et imparticipables : car ces espèces sont immédiatement au-dessus de ces dieux (assimilateurs) Nous dirons donc que les choses d'ici-bas sont semblables aux espèces premières, sont liées et réunies à elles par l'intermédiaire de la cause assimilatrice, mais que la réciproque n'a pas lieu; Car le semblable est parfois semblable au semblable. lors que les deux participent d'une seule chose qui les assimile l'une avec l'autre; parfois le semblable est semblable au paradigme, lorsque l'assimilé est différent de ce à quoi il est assimilé, l'un en tant que plus élevé, l'autre comme plus pauvre; l'un, en tant que semblable au paradigme, l'autre comme étant le paradigme du semblable. C'est ainsi que les idées démiurgiques sont supérieures aux assimilatrices, parce qu'elles sont intellectuelles selon la substance, qu'elles possèdent leur hypostase dans la raison imparticipable, et par là sont exclusivement paradigmes, mais ne sont plus semblables à celles qui sont devenues après elles. Voilà donc une chose d'une parfaite évidence. Mais maintenant chaque espèce en soi, faut-il dire qu'elle est semblable ou dissemblable aux choses qui sont devenues selon elle? Car il y a eu des gens qui ont dit qu'elle est dissemblable; d'autres, qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, parce que le semblable et le dissemblable ne sont pas des opposés contradictoires. Pour moi, je pense qu'il faut d'abord diviser le dissemblable ; on appelle dissemblable et ce qui participe de la dissemblance et ce qui est exprimé par une négation, ce à quoi est identique le non semblable. Après cette distinction, je dis que le caractère négatif est propre aux espèces : car c'est une négation que nous posons quand nous disons qu'elles ne sont pas semblables aux choses sensibles, quoique celles-ci soient assimilées à celles-là, mais que le caractère de participant à l'espèce de la dissemblance ne leur convient pas; car cela nous mettrait dans la même posture que lorsqu'il s'est agi de la ressemblance, et le raisonnement irait à l'infini. Nous examinerons donc au sujet de la dissemblance en soi, si elle est semblable aux choses qui participent d'elle, ou si elle leur est dissemblable. Si elle leur est semblable, il y aura de nouveau avant elles, la ressemblance; et si elle leur est dissemblable, alors, comme n'étant pas selon la substance de la dissemblance, c'est la dissemblance qui sera avant elles, et cela à l'infini. Il ne reste donc de vrai, si le dissemblable est identique au non semblable, qu'à dire que les paradigmes sont dissemblables à leurs images. Voici comment résoudre la difficulté qu'on formule habituellement comme il suit : Est-ce que l'homme crée l'homme d'ici-bas seulement, ouïe crée-t-il aussi semblable à lui-même? lui donne-t-il seulement la substance ou lui donne-t il aussi la ressemblance à lui-même? Car s'il lui donne la substance seule, il ne crée pas sa propre image, puisqu'il ne le fait pas semblable à lui même ; mais s'il crée aussi la ressemblance, que restera-t il encore a faire à la ressemblance, puisque chacune des espèces suffit pour rendre ce qui devient d'elle semblable à elle même? A cela je répondrai que toutes les espèces agissent les unes avec les autres et engendrent en même temps : il ne faut pas séparer leurs opérations, mais voir en elles une conspiration (σύμπνοια) parfaitement une et indivisible. Ainsi l'homme, en tant qu'il participe de l'espèce de la ressemblance, assimile à lui-même l'être qui devient ; la ressemblance en fait autant, et leur acte n'en fait qu'un. Le cheval de même, et chaque espèce agit par soi-même et avec la ressemblance. Celle-ci coagit, συνέργει, avec toutes, comme étant différente de toutes, et fait l'homme et le cheval, non pas en tant que cheval et en tant que homme, mais en tant que la ressemblance au paradigme est quelque chose qui leur est commun, de même que celles- là font l'un et l'autre, uniquement selon l'idée qui leur est propre, et les plus élevées des espèces par le semblable et le dissemblable. C'est pour cela que celles-ci s'étendent également sur toutes choses, quoiqu'aux unes, en tant que supérieures, elles donnent la fonction de cause instrumentale; aux autres, en tant que plus pauvres, la fonction de cause concomitante. Tu pourras dire encore d'une façon plus rigoureuse, que l'homme, il est vrai, assimile à lui-même, le devenant, comme le chien et chacune des espèces; mais que la ressemblance assimile à elle-même les ressemblances elles-mêmes ; car de même que les hommes sont les images de l'homme, de même en toutes choses les ressemblances sont images de la ressemblance en soi; par l'homme en soi, les hommes sont assimilés à l'espèce intellectuelle de l'homme, et par la ressemblance, toutes les ressemblances d'ici-bas sont assimilées à leur paradigme propre, je veux dire le paradigme de la ressemblance. Et voilà l'œuvre de la ressemblance, c'est-à-dire d'agir et avec les autres espèces et par elle-même ; car elle est dans quelqu'une d'elles - ; son œuvre est d'assimiler à elle même les ressemblances d'ici-bas, et c'est selon cette assimilation que chacune de ces ressemblances est l'image de la ressemblance intellectuelle. Et il faut en dire autant de la dissemblance ; car elle aussi produit à la fois toutes les dissemblances des participants, et les unes avec les autres et avec les participés : quoique une, elle crée la pluralité de ces dissemblances; quoique séparée et indépendante, elle crée la coordination des dissemblances. § 80. — « Il n'est donc pas possible que quelque chose soit semblable à l'espèce, ni que l'espèce soit semblable à quelqu'autre chose : sinon, au-delà et en dehors de l'espèce, nous verrons toujours apparaître une autre espèce, et si celle-là est semblable à quelque chose, une autre apparaîtra encore; et jamais ne cessera de devenir successivement une autre espèce, si l'on admet que l'espèce devient semblable à ce qui participe d'elle. — Ce que tu dis est parfaitement vrai. — Donc ce n'est pas par la ressemblance que les autres choses participent des espèces, et il faut chercher quelqu'autre chose par quoi elles en participent. — Sans doute. » La proposition que l'espèce est semblable au participant, celle que le participant est semblable à l'espèce, sont deux propositions erronées qu'il réfute par la procession à l'infini; or l'hypothèse de Socrate qui pose que le semblable est nécessairement semblable à son semblable contient la proposition que l'espèce est semblable au participant; de sorte que toutes deux sont en même temps fausses par l'absurdité de la conséquence, et l'une par l'autre, selon l'hypothèse de Socrate ; et c'est ainsi que Parménide fait arriver la discussion à une réfutation, et conclut finalement que ce n'est pas par le semblable que les choses d'ici-bas participent des espèces, mais par une autre cause plus propre : et il dit vrai. En effet, la cause qui crée l'unité du tout réunit la puissance efficiente des espèces avec l'aptitude des choses d'ici-bas à les recevoir, pour faire l'œuvre une et complète de la démiurgie. Donc les causes péricosmiques ont la puissance de tisser et d'unir la fonction assimilatrice des espèces, avec les choses qui participent d'elles: les espèces intellectuelles principales et celles qui participent d'elles rassemblent, par la vertu du moyen d'un côté, ce genre, qui fournit aux secondes une relation aux premières, et d'un autre côté, par en haut et d'une façon supérieure et libre, les plus puissantes d'entre elles rapprochent et rassemblent les intelligibles et la cause en soi qui donne l'unité à tout. Et si tu veux trouver une troisième cause de la ressemblance dans l'aptitude du réceptacle, tu ne te tromperas pas ; car c'est parce que celui-ci (le réceptacle) est en puissance ce que l'espèce est en acte que le devenant devient semblable à l'espèce. De sorte qu'il y a trois causes de l'assimilation : l'une, par en bas, c'est le substrat ; l'autre, par en haut, qui réunit ensemble les causes qui donnent aux choses leur fin et celles qui la reçoivent, une autre enfin, intermédiaire entre celles-ci, qui a la vertu de lier les extrêmes. Tu vois donc l'exactitude de ce raisonnement ; car en recherchant la cause une et la plus propre de la participation, tu affirmeras que ce n'est pas la ressemblance, mais une cause supérieure aux espèces intellectuelles elles mêmes : car ces espèces sont supérieures à celles qui subsistent selon le semblable et le dissemblable, de sorte que non seulement elles sont intellectuelles en tant que, placées dans la raison, elles préexistent et aux raisons psychiques et aux raisons physiques et aux raisons sensibles, mais elles sont aussi dans la raison imparticipable i et dans ce qu'on appelle, au sens propre, les Dieux intellectuels. Car le raisonnement nous a fait remonter jusqu'à eux. § 81. — « Tu vois donc, dit-il, mon cher Socrate, quelle grosse difficulté s'élève si on définit les espèces comme étant en soi et par soi. — Oui, certes. — Sache donc bien, dit-il, que, pour dire le mot, tu ne saisis pas encore toute la portée, toute l'étendue de la difficulté que tu soulèves en posant comme une espèce une chacune des choses qui sont, et en la distinguant toujours comme quelque chose à part . — Et comment cela, dit il? » Il montre ici la substance des espèces divines que nos conceptions ne peuvent circonscrire et dont elles ne peuvent déployer et développer le nombre et l'essence. Car ceux qui les posent ne peuvent, par le raisonnement, déterminer leur substance, leur ordre, leur puissance avec exactitude, ni voir où elles sont d'abord, ni où elles procèdent, ni quelle propriété particulière elles prennent selon chaque genre de dieux, ni comment elles sont participées par les choses du dernier degré, ni quelles séries elles créent, ni toutes les attributions qu'au point de vue théologique on pourrait leur donner. Et c'est pour montrer cela que Parménide dit que Socrate n'a pas encore saisi la gravité et les difficultés de cette solution : car il veut non seulement en commençant d'en bas déterminer leur rang, mais, en partant d'en haut, voir leur essence particulière. Car il a été question précédemment des espèces physiques, des espèces simplement intellectuelles, et des espèces proprement intellectuelles. Il va maintenant être traité de ce qu'on appelle les intelligibles et intellectuelles, et en dernier lieu de celles qui sont seulement intelligibles. Comment le dialogue traite de ce sujet, et l'expose en n'ayant l'air que de soulever des objections, les personnes de quelqu'intelligence le comprendront clairement, même d'après seulement ce qui a été déjà dit. § 82. — « Il y en a beaucoup d'autres, dit-il, mais la plus grande difficulté est celle-ci : Si quelqu'un vient à soutenir qu'il n'est pas admissible que les espèces soient connues si elles sont telles que nous les disons être, à celui qui soutiendrait cette opinion, on ne pourra pas démontrer qu'il est dans l'erreur, à moins que celui qui combattrait son sentiment, ne soit profondément versé dans la dialectique, ne soit doué d'un très puissant esprit, et en état de suivre les arguments aussi nombreux que subtils et tirés de loin, de son adversaire. Sans cela, il lui serait impossible de réfuter celui qui, par des arguments nécessaires, soutient que les espèces sont inconnaissables ». Que la question des idées soit pleine d'objections aussi difficiles que nombreuses, est prouvé par les opinions en nombre infini qu'on a présentées sur ce sujet, les uns concluant à nier leur existence, les autres à l'affirmer, et parmi ceux qui l'admettent, les uns leur donnant telle substance, les autres, une autre, et différant en outre de sentiment sur les questions de savoir de quelles choses il y a des idées, quel est le mode de la participation, enfin sur les autres problèmes extrêmement divers qu'on pose à cet égard. Néanmoins Parménide s'abstient de se laisser aller à la multitude des objections et de descendre dans la complexité infinie des considérations, mais il embrasse dans les deux plus grandes objections toute la recherche à ce sujet et par leurs conséquences, fait voir que nous ne pouvons ni comprendre ni connaître les espèces, et que les espèces ne sont susceptibles ni de connaître les choses sensibles ni d'exercer sur elles une action providentielle. Cependant si nous avons admis leur substance spécifiante, c'est surtout parce que. comme êtres intellectuels, nous avons une action sur cette substance, et que nous pouvons voir en elles des causes qui ont sur le Tout la faculté de prévision et de providence. Or si elles ne sont pas connues de nous, il est vain de dire qu'elles sont;car nous ne savons même pas cela, si elles sont, puisque nous ignorons leur nature, que nous ne pouvons pas par conséquent les saisir, et que nous n'avons pas de moyen pour fonder sur leur substance une connaissance spéculative, une théorie de ces idées. Car de même que celui qui supprime du nombre des choses qui sont, la science, ne mérite d'être cru sur aucune des choses qu'il exprime, car il nous a enlevé la puissance de mettre en œuvre les seuls moyens par lesquels les choses sont connues, de même celui qui supprime en nous la connaissance des principes, ne nous permet plus de connaître ensuite pas même s'ils sont. Car nous sommes tous dans la même situation à l'égard des principes, s'il n'appartient à personne de les connaître. Telles sont les objections. Toutes deux sont fondées sur la substance absolue, indépendante, des espèces, que nous croyons tellement être affranchie du reste, qu'elle est sans communauté avec les choses secondes. Leur manière d'être nous est étrangère; nous ne pouvons pas la connaître, et elle ne peut pas nous connaître. Mais si ce caractère absolu des espèces possédait, avec la supériorité, la faculté d'être présentes en toutes choses, notre connaissance serait sauvée, et aussi la connaissance intellectuelle que celles-ci ont des choses secondes. Car si elles sont présentes en toutes choses, il est possible de les retrouver en tout, à la condition seule de se faire soi-même apte à les saisir et à les comprendre. Et si elles donnent :i toutes choses l'ordre et la beauté, elles ont anticipé intellectuellement la cause des choses ordonnées par elles. Il est donc nécessaire à ceux qui veulent défendre cette théorie, de poser les espèces inébranlables et absolues, et aussi de les faire pénétrer en tout . Et tu vois que ceci est la conséquence de ce que nous disions il y a peu d'instants, quand nous. montrions le caractère des espèces qui ne supportent aucune relativité. Car ni leur caractère démiurgique n'a la puissance de leur imposer des relations aux choses secondes, ni leur non relativité et leur caractère absolu ne les oblige à être sans aucune communauté et absolument étrangères aux choses d'ici-bas. Mais c'est ce que nous avons dit plusieurs fois, à savoir que le système de Platon maintient et garde le complet et le tout. Ceux qui sont venus après lui n'ont compris qu'à moitié la vérité : les uns conservant la fonction providentielle de la cause divine en même temps que la relation matérielle : ce sont ceux qui disent que le divin pénètre à travers la matière; les autres, imaginant la non relativité sans la providence; les autres, supprimant la puissance efficiente et providentielle, et soutenant que les intelligibles sont certains êtres séparables des Dieux, qui ne sont ni causes démiurgiques des choses secondes, ni leurs paradigmes, ni causes d'une autre catégorie, a moins qu'on ne les dise les désirables des sensibles, car c'est autour d'eux que le monde tourne comme un chœur dansant, et que par le désir qu'il a pour eux il possède la félicité; mais la thèse de Platon maintient la fonction providentielle des espèces divines, et si tu veux, la non relativité et le caractère absolu et indépendant des causes immobiles, leur faculté de connaître et de prévoir les choses secondes, et ni par leur présence en toutes choses, il ne supprime leur supériorité, qui les détache et les élève au-dessus d'elles, ni par leur essence non relative, il ne supprime leur gouvernement providentiel. Ainsi donc, maintenant avec raison tout cela, il a démontré, dans les parties antérieures du dialogue, au moyen des apories, qu'il est absurde d'attribuer aux paradigmes des relations avec les choses qui en participent, et ici, comme si quelqu'un voulait maintenir les espèces elles mêmes, mais sans ajouter qu'elles sont absolument exemptes de relation, il prouve qu'elles sont élevées au-dessus et séparées des choses et pénètrent en toutes, et qu'elles sont partout, selon leur action providentielle, et nulle part selon leur hypostase, que nous n'avons pas d'elles de connaissance, ni elles de nous, si ce n'est une pensée selon la cause, une pensée séparée et élevée au-dessus de nous. Voilà ce que nous disons habituellement à ceux qui ne veulent pas faire les intelligibles causes efficientes des choses secondes. Car comment le Ciel désire-t-il le divin, s'il ne tient pas de lui son origine? Son désir sera donc un pur accident, s'il n'y a pas de cause génératrice, et si ce n'est pas d'elle qu'il possède l'hyparxis. Car dans les choses qui sont dans cette condition, l'engendré naturellement désire ce qui est sa cause et sa source. Il est tout à fait selon la nature que le second se retourne vers la puissance qui l'a créé et qui veille sur lui. Mais lorsque la cause n'est pas génératrice, et qu'il y a un causé, qu'est-ce qui peut faire que l'un soit désirable à l'autre? Comment le désire-t-il s'il n'en a rien reçu? Car tout ce qui est capable de désirer désire nécessairement obtenir quelque chose : mais s'il la possédait, le désir d'une chose présente serait inutile et vain; s'il ne la possède pas, le désir naît nécessairement du manque de ce qu'il n'a pas. De sorte que si rien de l'objet désirable ne vient s'ajouter à ceux qui désirent, le désir, de nouveau, se trouve sans objet, puisqu'il n'en peut rien recevoir. Et comment aussi le dernier imite-t-il seulement le premier? car le dernier est impuissant à engendrer; toutes les choses qui sont au milieu entre celui-ci et celui-là, toutes désirent engendrer, et engendrer chacune selon son rang d'ordre ; car ce qui appartient au premier selon sa propre nature, est ce qu'il y a de plus estimable, et étant le plus estimable, il ne saurait être dans le dernier; mais il sera dans les choses intermédiaires qui sont plus parentes du premier. Donc le désirable est dans les intermédiaires, mais n'est pas dans le dernier. Mais comment celui-là reste-t-il immobile, inerte, impuissant, tandis que le Ciel, qui l'imite, montre une telle puissance démiurgique sur les choses qui sont au-dessous de lui, que tout son mouvement et toute sa configuration agissent sur la génération tout entière, lui impriment toutes sortes de formes et l'embellissent de toute espèce de formes par l'intermédiaire de toutes les espèces d'animaux enveloppés dans les éléments, en descendant jusqu'aux plantes et aux choses sans vie. Car si c'est un bien de ne pas engendrer, pourquoi, puisqu'il est lui aussi Dieu, n'imite-t il pas ce qui est avant lui. et qu'il désire l'imitation de ce bien : et si ce n'est pas un bien, comment, dans celui-là se trouve t-il le non bien, et dans celui-ci le bien? Et comment nous-mêmes connaissons nous celui-là, si notre hypostase ne vient pas de lui, si nous ne participons pas des raisons réellement existantes, desquelles, par l'intermédiaire de la réminiscence, nous tirons la science? car nous serons privés de toute union avec lui ; nous lui serons étrangers et serons dépouillés de l'hypostase que nous tenons de lui. Voilà donc à peu près ce qu'il faut répondre à ceux qui soutiennent cette opinion. Mais la conception inspirée de Platon, il faut l'adopter avec empressement, parce que, par ces apories, elle supprime d'avance tous les doutes injurieux et impies contrôles espèces divines, fondés sur leur ressemblance à la raison en soi, conception qui, avant le semblant d'hypostase des maux, a créé les puissances qui les suppriment. Donc, qu'il ne faut pas mettre la puissance génératrice des espèces dans une relation avec l'engendré, ni leur puissance paradigmatique dans une sorte d'équivalence avec les choses qu'elles administrent, c'est ce que nous a suffisamment rappelé Parménide, par les raisonnements qui précèdent. Car toute relation a besoin d'une autre cause qui en rassemble et tisse ensemble les termes, de sorte qu'avant les espèces il y aura une autre espèce qui lie les deux par la ressemblance : car il y a relation du semblable au semblable. Et que le caractère absolu et affranchi de relation des espèces n'est pas l'inertie ni l'imprévision ni l'indifférence à l'égard des choses secondes, c'est ce que montrent ces apories. Sans doute en ne tenant compte que de leur non relativité, on pourra dire que les espèces ne connaissent pas les choses qui participent d'elles et qu'elles ne sont pas elles-mêmes connues de nous. C'est en élevant cette difficulté que Parménide amène Socrate à examiner le caractère particulier de la puissance absolue des espèces divines, et comment il prouve que les choses d'ici-bas ne sont pas connues par elles, nous le verrons clairement plus tard ; mais que nous, nous ne pouvons pas les connaître, c'est ce qu'il veut prouver auparavant, et ce qu'il prouve d'une façon tout à fait admirable, en posant que la science chez nous, est la science des choses susceptibles d'être connues de nous, et que la science divine est la science des choses divines. Ceci semble supprimer pour nous la connaissance des choses divines, et, sous un certain rapport, cela est vrai, et même de plusieurs manières différentes, selon que la recherche a un caractère philosophique ou un caractère théologique. Mais admettons que la science chez nous soit la science des choses qui peuvent être sues par nous, qu'est-ce qui empêche que les choses sues par nous soient les images des choses divines, et que par elles nous connaissions les choses divines. C'est ainsi que les enfants des Pythagoriciens ont vu dans les nombres et les figures, les simulacres de l'ordre divin, et en portant toutes leurs études sur ces objets , ont tenté d'en tirer, comme d'une sorte d'empreintes, la connaissance des choses divines. Quoi d'étonnant si la science chez nous est dite relativement à la chose sue par nous, et forme avec elle un couple, σύζυγος;; car une chose est placée au même rang, συστοιχος que ce par rapport à quoi elle est dite ; mais la connaissance peut essayer de saisir même les choses intelligibles, non pas comme étant sur le même rang qu'elles, mais comme abaissée au-dessous d'elles; car autres sont les connaissances de toutes les choses qui sont au même rang; autres, celles qui ont un rang différent des choses connues, et qui s'emparent, selon un mode éminent, de la nature des choses inférieures, comme l'opinion saisit la nature des sensibles, ou qui s'emparent, selon un mode inférieur et abaissé, des choses supérieures, comme l'opinion saisit l'objet de la science. Ainsi celui qui possède la science, et celui qui a une opinion juste, connaissent les mêmes choses, mais l'un d'une connaissance supérieure, l'autre dune connaissance plus faible et plus pauvre. Il n'y a donc rien d'étrange que la science soit dite, non relativement au su de là-haut, mais au su qui est en elle, et avec lequel elle est appariée, et vers lequel se porte son effort de connaître, selon un mode secondaire, mais non selon la science qui est au même rang que l'intelligible de là-haut. Et d'ailleurs, Platon lui même, dans ses Lettres, disant que l'espèce intelligible n'est pas connaissable par la science, mais par la connaissance, ne nous donne-t-il pas à entendre que l'espèce est pour nous connaissable, mais qu'elle n'est pas de nature à être sue par nous, et que c'est par une pensée de la raison jointe au raisonnement que nous la pouvons saisir: car il y a une connaissance scientifique plus composée, si on la compare à l'intuition intellectuelle, et la raison, νοῦς est la faculté qui contemple réellement les espèces, puisque par nature elles sont intellectuelles, νοερά, et que, en toutes choses, nous connaissons le semblable parle semblable, par la raison, les intelligibles, par l'opinion, les choses opinables, par la science, les choses qui peuvent être sues. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'il n'y ait pas des espèces, science, et qu'il y ait un autre mode de les connaître , tel que celui que nous disons être la pensée rationnelle, νόησις. Et si tu veux prendre des formes plus théologiques, et dire qu'en remontant jusqu'aux espèces intelligibles, il montre que les espèces, qui sont au-delà de celles-là et qui sont absolues, telles que sont les intelligibles et intellectuelles, dépassent notre connaissance, (Ce sont en effet les âmes arrivées à une purification parfaite qui leur sont conjointes, et qui suivent le cortège des douze Hégémons qu'il amène à la contemplation parfaite de ces idées) — certainement tu ne méconnaîtras pas la doctrine inspirée par les Dieux, de Platon. Ainsi donc, puisqu'avant l'ordre assimilateur, il y a trois genres d'espèces, les intellectuelles, celles qui sont à la fois intelligibles et intellectuelles, et enfin les intelligibles, les ordres intellectuels se rattachent sans solution de continuité aux choses secondes et, par la distinction qu'ils renferment, et parce que la cause de notre ordre est rattachée et conjointe à l'hénade de cette catégorie d'idées, sont à nous plus connaissantes : « Après les idées paternelles, moi, l'Âme, j'habite. » dit L'Oracle; car Platon a connu cet ordre, comme il a été prouvé ailleurs. Les ordres à la fois intelligibles et intellectuels sont supérieurs à notre connaissance divisée des choses coordonnées à nous ; et delà vient le caractère propre de ces espèces, de nous être inconnaissables, par suite de leur supériorité absolue. Car nous ne pouvons pas maintenant projeter la connaissance qui leur appartient en propre. Voilà ce qu'il y avait à dire de ces espèces intermédiaires, Parménide montrant qu'il ne faut pas détacher complètement les espèces intellectuelles des choses qui en participent, comme on fait celles des dieux intelligibles et intellectuels : car celles-ci sont absolument au-dessus de notre connaissance, mais qu'il est nécessaire que les hénades spécifiques que nous posons soient connaissables même par nous. On peut donc aborder l'examen de notre sujet, philosophiquement et théoriquement : au point de vue philosophique, il ne faut pas dire que, parce que nous avons supprimé tous les modes précédemment supposés de la participation, par là même tout mode de communauté est supprimé entre les sensibles et les intelligibles; car ainsi ceux-ci ne nous seraient pas connaissantes, et ne seraient pas capables de nous connaître, puisquela faculté de connaître et la propriété d'être connu ont une certaine communauté entre elles. Au point de vue théologique il faut dire qu'il est nécessaire de séparer les idées intellectuelles de leurs réalisations effectives, comme étant les idées au-delà, inconnaissables à nos manières de connaître qui sont divisées, et desquelles les nôtres ont procédé. Voilà donc, comme je l'ai déjà dit, les observations qu'il y avait à faire en vue de l'étude générale de notre sujet. Mais en examinant le texte même, disons que les termes en démontrent ce qu'est l'auditeur digne d'entendre un tel enseignement, et ce qu'est celui qui est apte à le donner. Car il faut que l'auditeur se distingue par une belle intelligence naturelle, afin d'être un philosophe par nature, d'être rempli d'un vif enthousiasme pour la substance incorporelle, de poursuivre par le raisonnement, avant tout ce qui se voit, toujours quelqu'autre chose, de ne pas se satisfaire de la perception des choses présentes et en un mot d'être tel que celui dont Socrate, dans la République, nous ébauche le portrait, tel que ce contemplateur, passionné par essence, des choses universelles. Il faut ensuite qu'il ait recueilli de nombreuses expériences, non pas certes relatives aux choses humaines, car elles sont de petite valeur et ne sont pas utiles pour la vie divine, mais concernant les théorèmes de la logique, de la physique, des mathématiques ; car toutes les choses que notre entendement est impuissant à contempler dans les Dieux eux-mêmes, nous pouvons les voir dans ces sciences qui en sont les images; et après les avoir vues, il acquiescera à ces doctrines, et aura foi aussi dans ce qui est enseigné sur les intelligibles. Voici ce que je veux dire : si, par exemple, il s'étonne que dans un soient plusieurs, et toutes les choses dans l'indivisible, il réfléchira à la monade et comment en elle, tout est démontré être, le pair et l'impair, le cercle et la sphère et les autres espèces des nombres ; s'il s'étonne comment le divin crée par son être même, il réfléchira que dans les choses physiques le feu est échauffant, la neige réfrigérante, et de même pour le reste ; s'il s'étonne comment les causants sont partout dans les causés, il verra dans la logique une parfaite image de cette vérité. Car les genres sont nécessairement affirmés de ce dont les espèces sont affirmées, tantôt les espèces avec les genres, tantôt sans eux. Et il en est ainsi de chaque chose où, ne pouvant pas regarder le divin en soi, on pourra le voir par l'intermédiaire de ces connaissances d'un autre ordre, qui en sont les images. Il faut donc qu'il possède d'abord, une belle intelligence naturelle, qui est proche parente des êtres véritablement êtres, qui peut prendre des ailes, et, comme à des cordes sûres, s'attacher aux concepts concernant l'être réel. Carde même que pour chaque profession, nous avons besoin d'une sorte d'apprentissage, de même pour nous élever à l'être, nous avons besoin d'une connaissance claire et purifiée, d'une aptitude préexistante qu'on peut appeler un génie naturel, par ce qu'il sort de la nature universelle et de la nature particulière des âmes qu'on appelle heureusement douées. Il faut donc que le maître soit, comme nous«l'avons dit, doué par la nature, d'une telle belle intelligence; qu'il possède ensuite une connaissance expérimentale étendue à beaucoup de sujets divers, par laquelle il sera comme emporté à la conception des intelligibles, et en troisième lieu, une grande ardeur, une puissance de tension d'esprit pour la science, de telle sorte que l'antécédent seul lui étant montré, il soit capable de poursuivre par le raisonnement les conséquences, grâce à cette ardeur qui rend l'attention plus intense. Ce sont là les trois conditions qu'il dit être nécessaires à celui qui veut connaître cette nature : une belle intelligence, l'expérience, l'ardeur. Par sa belle intelligence, il projettera spontanément la foi à l'égard du divin; par l'expérience des doctrines les plus paradoxales, il sera plus assuré de posséder la vérité qu'il a acquise ; par son ardeur, il mettra en mouvement sa propre faculté d'aimer la science, afin que, même ici-bas il y ait foi, vérité et amour, vertus qui conservent les âmes, par l'aptitude qui les relie à ces trois vertus; ou encore, si tu le préfères, par l'expérience, il possédera l'aptitude de lu faculté de l'âme de connaître; par l'ardeur, ce mouvement, cet effort tendu de la faculté vitale qui emporte vers les intelligibles; par les dons heureux de l'intelligence, cette disposition préalable et antérieure aux deux autres conditions, qui naît d'une génération antérieure et des notions universelles qui lui ont été par elle transmises. Tel doit donc être l'auditeur, telle est la triade dont il doit être rempli. Quant au maître, qui a, beaucoup avant lui, fait ce chemin, il se refusera à professer la vérité divine par une exposition verbeuse, mais il voudra dire beaucoup de choses en peu de mots, conformant son langage aux pensées, n'allant pas prendre son point de départ dans les choses faciles à entendre et connues de tous, mais partant d'en haut, des principes les plus semblables à l'un, et s'efforçant de voir de loin les choses, parce qu'il s'éloigne des réalités présentes, et s'est rapproché du divin ; il ne s'exprimera pas, comme s'il voulait qu'on ait de lui l'opinion qu'il a un style lumineux et brillant : il se contentera de démonstrations ; car il faut enseigner les vérités mystiques dans, un langage mystique et ne pas donner une forme vulgaire aux concepts ineffables relatifs aux Dieux. Tel doit être l'auditeur, tel doit être le maître dans ces sortes d'entretiens. Et tu peux voir un tel maître parfaitement tel, dans Parménide lui-même. Ainsi tu pourras voir dans la méthode qu'il pratique dans ces discours, qu'il dira beaucoup de choses en peu de mots, qu'il traitera son sujet en partant d'en haut , et que son enseignement portera exclusivement sur les choses divines ; quant à l'auditeur, il a reçu de la nature une belle intelligence, il est plein d'amour, mais il n'a pas encore une suffisante expérience. C'est pourquoi Parménide lui conseille de s'exercer dans la dialectique, afin d'acquérir la connaissance pratique de ses théorèmes, louant son heureux naturel, sa passion pour la vérité, mais ajoutant le conseil de corriger ce qui lui fait défaut. Et quelle est la fin de cette triple puissance, il l'a dit lui-même, c'est l'évidence et la certitude de la science qui a pour objet les choses divines. Car celui à qui manque quelqu'une de ces conditions, sera contraint d'accepter comme vraies beaucoup de choses fausses, parce qu'il n'aura fait qu'aborder superficiellement l'examen et la recherche des faits. § 83. — « Comment cela, mon cher Parménide, dit Socrate? — C'est que, mon cher Socrate, je pense que toi et tous ceux qui affirment que, de chaque chose en soi. il y a une certaine substance par elle-même et en elle même, vous reconnaîtrez qu'aucune de ces substances n'est en nous. — Et comment alors serait-elle en soi5, dit Socrate. — Tu as raison, dit-il. » A partir d'ici l'entretien passe à d'autres difficultés, dont l'une ôte a notre âme la connaissance des êtres réellement êtres, et l'autre veut montrer que la connaissance des êtres divins concernant les choses d'ici-bas manque de tout fondement. Par ces deux arguments est supprimée la possibilité que nous procédions d'eux, et la possibilité de notre conversion à eux. Les choses secondes et les choses premières apparaissent alors complètement séparées les unes des autres, celles-là n'ayant point part aux premières, celles-ci impuissantes à engendrer les secondes. La vérité est que tout est dans tout, mais selon un mode propre : dans les premiers genres sont, selon la cause, les genres moyens et les derniers des universaux; c'est pourquoi ils sont connus par eux. comme ils existent en eux. Selon la participation, les premiers sont dans les moyens et ces deux là sont tous deux dans les derniers : c'est pourquoi les âmes connaissent tous les êtres, mais d'une manière appropriée à chacun d'eux ; par leurs images, ceux qui sont avant elles ; selon la cause, ceux qui sont après elles; par une communauté d'essence et par ce qu'elles sont au même rang d'ordre, les raisons qui sont en elles mêmes. Voilà les deux apories qui ont été présentées avant la question de l'ordre des idées, et qui ont été discutées avant elle. C'est par là que Socrate et quiconque pose les idées, ont été amenés à cette hypothèse par la connaissance selon la cause, par la connaissance scientifique de toutes les choses qui sont dans le monde. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un en raillant, qu'ils ont cru connaître les êtres en les doublant, et en pensant les intelligibles avant les sensibles. Et cependant celui qui a fait cette critique n'a pas pu expliquer la raison du mouvement perpétuel des choses mues circulairement autrement qu'en plaçant avant elles, autant d'immobiles qu'il y a de choses mues circulairemen. C'est donc pour fonder scientifiquement la connaissance de toutes les choses qui sont dans le monde, qu'ils ont recouru à la substance des idées, et à la cause qui exerce une action providentielle sur les choses qui deviennent selon ces idées. Aussi ceux qui suppriment les idées ont également supprimé le gouvernement providentiel des intelligibles en faisant retourner les sensibles vers les intelligibles comme désirables, et disant que rien ne vient de ceux-ci dans ceux- là. Telles étant donc, comme il a été dit, les deux objections contre ceux qui posent les idées, par les raisons que nous avons dites, dans toutes les recherches qui vont suivre, il se propose de démontrer comment le fait de poser les idées des êtres, seulement comme séparées et au-dessus d'eux, contraint de les faire inconnaissables, puisque nous n'avons plus aucune communauté avec elles, ni aucune connaissance qu'elles sont ou ne sont pas, ni si elles sont participées et comment, quel rang d'ordre elles possèdent, si on se borne à dire qu'elles sont séparées, et si, outre leur non relativité, on n'ajoute pas qu'elles sont causes des choses secondes. Pour examiner ce point, le dialogue pose au préalable certains axiomes et certaines notions commîmes : Et d'abord que si elles sont absolument séparées et absolument en soi, καθ' ἑαυτάς;, elles ne sont réellement pas, par conséquent. Car comment seraient-elles, séparées absolument et de nous et de toutes les autres choses? La raison est le lieu des idées, un lieu, non pas en ce sens qu'elles auraient besoin d'un fondement, comme les accidents ont besoin de la substance, comme les espèces matérielles ont besoin de la matière, ni comme si la raison les enveloppait et qu'elles fussent comme ses parties entassées et amassées selon une composition; mais elles est leur lieu comme le centre a en lui-même les multiples points extrêmes des lignes qui sont tirées de lui, et comme la science contient la pluralité des théorèmes, non qu'elle soit un composé de ces plusieurs, mais comme étant avant ces plusieurs et tout entière dans chacun. Car c'est ainsi, c'est-à-dire indivisément, que la raison est un plusieurs, ayant la pluralité dans l'un, parce qu'elle n'est pas l'un même subsistant avant toute pluralité, mais est en même temps un et pluralité. C'est ainsi qu'elle est le lieu des idées. Si donc la raison et l'âme ne sont pas une seule et même chose, il n'y a pas en nous d'idées, puisque c'est la raison qui en est le lieu. Et il est évident d'après cela, que, suivant Platon, il faut enlever des âmes le monde intelligible et que la discussion sur les idées s'agrandit et s'élève, en remontant à certaines hypostases des idées ayant un caractère plus semblable à l'un ; car il ne les pose pas comme corporelles, ni physiques, ni comme pensées, νοήματα, des âmes, mais avant toutes ces choses ; car elles ne sont pas, dit-il, en nous, ni au même rang que nos manières de connaître. On pourrait dire, dans la langue philosophique, qu'elles sont séparées absolument des choses et qu'elles ne sont pas en nous, et aussi qu'elles sont présentes partout, et sont participées par nous sans être devenues en nous qui en participons ; car étant en elles mêmes, elles sont situées, pour être participées, en toutes les choses qui peuvent jouir d'elles et il y a une aptitude en nous, quelle qu'en soit la nature, à se rencontrer avec elles qui sont présentes partout : car ce par l'intermédiaire de quoi nous possédons (une chose), nous en participons. Et il en va ainsi non seulement de nous, mais aussi de ceux qui, supérieurs à nous, possèdent en eux-mêmes les images substantielles des idées et qui, apportant ces images qui sont en eux-mêmes, pour ainsi dire, les traces des paradigmes, connaissent ces paradigmes par l'intermédiaire des choses dont ces traces sont les images; car ils pensent en même temps la substance de ces images et conçoivent qu'elles sont les images d'autres choses. Et nécessairement en pensant cela, ils touchent et atteignent par leurs pensées, les paradigmes eux mêmes. Si l'on veut s'exprimer dans la langue théologique, on dira que celles des espèces qui sont séparées et au-dessus des espèces intellectuelles, ont un fondement placé complètement au-dessus de notre ordre; car des espèces intellectuelles mêmes, nous voyons les images et en elles mêmes et dans les choses sensibles ; mais la substance des intelligibles, par suite de son unification, est absolument séparée et hors de nous et de toutes les autres choses et par suite inconnaissable en soi. Elle remplit d'elle-même et les dieux et les raisons: mais nous, nous hommes heureux de participer psychiquement des espèces intellectuelles. C'est ce que montre Platon, lorsqu'il distingue en nous deux vies, la vie (pratique ou politique et la vie théorétique ou spéculative) et deux espèces de félicités : il ramène l'une de ces vies au règne patronymique de Zeus, et l'autre à l'ordre de Kronos et à la raison pure. Il est évident par là qu'il fait remonter toute notre vie jusqu'aux rois intellectuels. Car l'une de ces vies détermine et définit le principe, l'autre la fin de cet ordre. Tout ce qui est au-delà, il dit que ce sont des visions des âmes excitées par l'enthousiasme, initiées et qui peuvent être admises à voir les intelligibles. De sorte qu'ainsi serait vraie la proposition présentée plus haut, qui aborde un certain ordre spécifique. Voilà ce qui concerne le fond des choses. En ce qui a rapport au texte : les mots : « Comment donc, mon cher Parménide», sont la question de Socrate, qui exprime un extrême étonnement que l'espèce intellectuelle soit inconnaissable , et qui n'a pas encore pris conscience de la transition qui s'est opérée, ni vu que Parménide va parcourir toute la largeur des espèces, jusqu'à ce qu'étant parvenu aux espèces absolument premières, il s'arrête. Quant aux mots : « Car comment serait-elle encore par elle-même et à part », ils sont entendus selon les notions communes. Car tout absolu n'appartient qu'à lui-même et est par lui-même, puisqu'il n'est ni en nous ni en quelqu'autre chose. En outre, il fait connaître la vérité entière sur les espèces par ces trois caractères : l'identité, le en soi, la substance : car il laisse de côté les autres : la simplicité, la supériorité séparable, la perfection qui est fondée sur ce qu'elles sont seulement. S'il en est ainsi, ne va pas croire que, dans les espèces, chacun de ces caractères est différent des autres; que chacune est autre chose que sa substance; par exemple, que la substance est autre chose que l'essence de la substance, que la pensée est autre chose que l'essence de la pensée; car ces propriétés sont, avec raison, distinguées dans les choses composées : mais elles n'ont aucune raison d'être dans les simples. Si donc chacune est seulement, il est nécessaire qu'elle demeure dans la simplicité et dans l'union, et qu'on ne transporte pas à elle, les caractères particuliers et propres des composés. Il reste donc, après cela, les mots : « tu as raison », qui n'expriment pas, comme peut être on le dira, une ironie de Parménide et comme un commencement de réfutation, mais où il approuve la pensée spontanée de Socrate et la conception qu'il se fait des choses divines. Car la proposition est vraie aussi, qu'énonce Timée et par laquelle il dit que l'être véritable ne reçoit rien en lui-même, comme la matière reçoit la forme, ni ne va quelque part ailleurs, comme l'espèce va dans la matière; il reste donc à part, en lui-même, même quand il est participé, ne devient pas un des participants, mais étant à part, avant les participants, il leur donne tout ce qu'ils peuvent recevoir. Il n'est pas davantage en nous; car nous en participons sans l'admettre lui-même en nous; ce qui vient de lui est différent de lui ; il ne devient pas non plus en nous, car il ne reçoit aucun devenir. § 84. — « Ainsi donc toutes celles des idées qui sont ce qu'elles sont par leur relation les unes aux autres, ont leur substance par ce rapport à elles-mêmes, et non par un rapport aux choses qui sont en nous, qu'on les appelle des simulacres ou sous quelqu'autre mode qu'on les pose, et ce sont celles par la participation desquelles nous recevons des noms particuliers et individuels ? Celles qui sont en nous et homonymes aux autres, à leur tour sont ce qu'elles sont parleur rapport à elles-mêmes, mais non par leur rapport aux espèces en soi, εἴδη; elles sont à elles mêmes et non à celles-là, qui en portent à leur tour le nom. — Comment l'entends-tu, dit Socrate ? » C'est la seconde proposition qui lui sert à compléter la théorie du sujet proposé. La précédente était : que les espèces ne sont pas du tout en nous mais en elles-mêmes; voici la seconde qui est, que les espèces ici-bas sont dites des relatifs, les unes par rapport aux autres; celles de là haut sont dites par rapport les unes aux autres, mais non par rapport à celles d'ici bas, pas plus que celles d'ici-bas par rapport aux autres. Car ceux qui ont l'habitude de voir les choses à un point de vue logique, ont raison de dire qu'il faut rapporter les relatifs universaux aux universaux,les relatifs individuels, aux individuels, la science purement science, à l'objet purement su, la science déterminée à l'objet déterminé su, les indéfinis aux indéfinis, les déterminés aux déterminés, les (relatifs) en puissance aux en puissance, les en acte aux en acte. Les traités de logique et de physique des anciens sont pleins de ces règles. Si donc dans les universaux et les individuels, car c'est de cela qu'il va être question, il ne faut pas admettre la réciprocité dans les conséquences, à beaucoup plus forte raison, il ne faut l'admettre sous aucune forme, en ce qui concerne les idées et les images des idées; mais nous rapporterons les choses d'ici-bas aux choses d'ici-bas, les choses de là-haut aux choses de là-haut. Or ceci est nécessairement vrai, si nous considérons chaque chose en tant qu'elle est ce qu'elle est, mais non en tant qu'elle crée quelque chose ou devient quelque chose. Car ainsi nous expliquerons les choses d'ici bas comme devenues par un rapport à celles-là (qui les créent) et celles-là, comme produisantes, par un rapport à celles d'ici-bas (comme produites) et celles ci comme images, aux idées, et leurs idées comme des paradigmes. Si donc nous prenons la maîtrise en soi, si nous l'entendons en tant qu'elle est maîtrise, elle sera dite par rapport à l'esclavage en soi; si nous l'entendons comme paradigme, elle sera dite par rapport au semblable à la maîtrise en soi. Cependant nous avons l'habitude d'appeler les dieux nos maîtres, de sorte qu'il y aura là haut une maîtrise qui sera dite par rapport à l'esclavage qui est chez nous ; mais il est vrai aussi de dire que nous participons de l'esclavage en soi, par rapport auquel la maîtrise en soi contient comme antécédent conditionnant la raison de la conclusion. Et tu vois que la maîtrise là haut fait connaître comme nos maîtres les meilleurs que nous, parce que nous participons à l'esclavage en soi, tandis que ce qu'on appelle chez nous la maîtrise par son rapport à l'esclavage chez nous, n'est plus dite aussi par rapport à l'esclavage là haut, parce que l'essence de l'esclavage là haut ne tient pas son hyparxis de l'esclavage chez nous, mais au contraire ; car nécessairement ce qui commande aux meilleurs, commande aussi aux pires. Il faut donc, comme il a été dit, que les choses qui sont là-haut et par soi soient dites par rapport à celles d'ici-bas; mais nous reviendrons encore sur ce sujet. Concluons de toutes ces apories ce qu'est l'idée absolument première. De la première aporie, il faut conclure qu'elle est incorporelle : car il n'est pas possible que, si elle était corps, elle fût participée soit en totalité soit en partie. De la deuxième, qu'elle n'est pas au même rang que les choses participantes ; car si elle était au même rang, elle aurait quelque chose de commun avec elles, de sorte que nous concevrions avant elle encore une autre idée. De la troisième, qu'elle n'est pas une pensée, νόημα, de la substance, mais qu'elle est substance et être, afin que ce qui participe d'elle ne soit pas participant de la connaissance. De la quatrième, qu'elle est seulement paradigme, mais non aussi image, comme la raison psychique, afin que n'étant pas semblable à ce qui vient d'elle, elle n'introduise pas une autre idée avant elle; car la raison psychique est substance, mais comme elle n'est pas exclusivement paradigme, elle est aussi image; car l'âme n'est pas seulement substance, mais aussi génération. De la cinquième, qu'elle n'est pas immédiatement et directement intelligible à nous, mais par l'intermédiaire de ses images ; car la science en nous n'est pas au même rang qu'elle. De la sixième, qu'elle est susceptible de concevoir immédiatement les choses qui viennent après elle, et par le fait qu'elle-même se sait leur cause. En résumé donc, l'idée véritable est cause incorporelle, séparée, au-dessus des choses qui en participent ; elle est substance immobile; elle est uniquement et réellement paradigme, intelligible aux âmes par l'intermédiaire des images, capable de penser les choses qui subsistent selon la cause, par une relation à elles, de sorte que de toutes ces apories nous pouvons saisir la définition une de l'idée véritablement idée. Si donc quelques-uns veulent élever des contradictions contre les idées, qu'ils contredisent cette définition, et qu'ils ne forgent pas des raisons sophistiques, en en donnant des représentations corporelles, comme si elles étaient au même rang (dans l'ordre des êtres) que les choses d'ici-bas, ou comme si elles étaient vides de substance, ou du même ordre que nos connaissances, ou en imaginant tout autre mode d'être pour elles, mais qu'ils remarquent que Parménide a dit que les idées sont des dieux, qu'elles sont un, et qu'elles ont leur hypostase en Dieu, comme le dit l'Oracle : « La raison du Père, ayant pensé, a projeté avec force, par un acte puissant de volonté, les Idées avec leurs formes universelles ». Car la source des Idées, est Dieu, et elle est contenue dans un dieu qui est la raison démiurgique, et si c'est là l'idée, la première de toutes, c'est elle qui a été déterminée par la définition dont les éléments réunis sont tirés des apories de Parménide. Ceci dit, il faut examiner d'abord, s'il y a dans les intelligibles un relatif, et comment cette définition est vraie, et pour quelles Idées elle est vraie ; car il faut que chaque aporie nous introduise dans une certaine nature des êtres. Que le terme : relatif, πρός τι, a beaucoup de significations, on peut le comprendre d'après ce que l'on dit habituellement : car les accidents et toutes les choses dont la relation est absolument sans substance sont une catégorie toute particulière de relatifs : tels sont le double, la moitié, et tous les autres de cette sorte, que la plupart ont l'habitude de concevoir uniquement au point de vue logique. Autres sont les relatifs en tant que substances et dont la relation est substantielle, tels le droit et le gauche dans la nature ; car dans l'animal, le droit n'est pas un accident vide de réalité, mais une notion substantielle, en tant que le droit est dit principe de mouvement, et a certaines propriétés particulières que n'a pas le gauche, et qu'il a reçues de la nature. Il est évident que dans ces relatifs pris isolément, il y en a de deux espèces ; car le droit et le gauche par accident et non créés par la nature, échangent leur position ; mais dans les animaux, dans lesquels la disposition du composé est selon la nature, il est impossible qu'ils soient autrement qu'ils ne sonτ. C'est ainsi que Timée a posé le droit et le gauche dans les mouvements circulaires cosmiques, en déposant en eux des puissances substantielles, une puissance principale, et une secondaire, une puissance initiale et antécédente, et une conséquente. Les relatifs sont encore dits dans un sens plus parfait et qui les rapproche encore plus des choses qui subsistent par elles-mêmes : ce sont ceux dans lesquels chacun des deux est d'abord la chose de lui-même et ensuite de l'autre, celui-ci à son tour étant d'abord la chose de lui-même: tel l'intelligible qui est l'intelligible de lui-même, et la raison qui est la raison d'elle-même, et par cela même la raison est unifiée à l'intelligible et l'intelligible à la raison, et la raison et l'intelligible ne sont qu'un. Le père ici-bas, quoiqu'il soit père selon la nature n'est pas cela de lui-même ; il est donc père d'un autre, et ce qu'il est, il l'est seulement d'un autre. Mais là-haut, s'il y a là quelque causant paternel, il est d'abord ce qui achève et complète sa propre substance, et c'est ensuite et par là qu'il donne aux choses secondes, de lui-même, leur procession : et s'il y a quelque rejeton de lui , ce n'est qu'ainsi qu'il procède d'un autre. Lors donc que certaines choses de là-haut sont dites relativement l'une à l'autre, il faut supprimer en elles les relations nues et sans substance : car rien de tel ne convient aux Dieux : il faut concevoir là l'identité au lieu de la relation, et avant même cette identité, concevoir l'hyparxis de chacun, oui est en eux-mêmes. Car chaque chose est d'abord à elle-même et pour elle-même et est unifiée aux autres ; car chaque chose même de ce qu'on appelle des relatifs est une espèce une, par exemple, l'espèce substantielle du droit est le causant de cette relation, et il en est de même du gauche : de sorte qu'une certaine notion une et la même fournit aux choses d'ici-bas, dans lesquelles elle est introduite, une espèce quelconque de relationi. Ainsi donc là-haut l'hypostase est affranchie de la relation, mais elle crée une certaine relation ; car il n'y en a aucune antérieure autre que le droit et le gauche dans les intelligibles ; et cependant il est possible que même en eux, on dise : le à droite et le à gauche, l'un par rapport à l'autre et qu'ils soient plus unifiés l'un à l'autre qu'à d'autres espèces, parce qu'ils opèrent nécessairement leur acte l'un avec l'autre, et que où est l'un, est aussi l'autre. Car des espèces, les unes agissent nécessairement à part les unes des autres, comme tous les relatifs des contraires; les autres ont toujours leur acte uni l'un à l'autre, comme tous les relatifs dans l'intelligible; les autres sont de telle sorte qu'ils sont nécessairement participés l'un avec l'autre, mais la réciproque n'a pas lieu dans ceux où l'un est un tout, l'autre partie. Ainsi donc, la communauté selon les participations caractérise la puissance des relatifs de là-haut; et ce qui, dans les choses d'ici-bas, est relation, là haut est identité. Car si, comme on le dira dans ce qui suit toute chose par rapport à toute chose est tout ou partie, ou identique ou différente, il est évident que le tout et la partie sont conçus dans ces espèces où l'un des relatifs est participé avec l'autre, mais sans que la réciproque ait lieu; l'autre est conçu éminemment et exclusivement dans les contraires, où la présence de l'un fait habituellement disparaître l'autre ; l'identique est conçu dans les choses où la participation est nécessairement selon la conspiration, le parfait accord de l'un avec l'autre et où il n'est pas possible que les deux ne soient pas ensemble là où ils sont présents, et ne soient pas tous deux absents là où ils sont absents. Il faut donc concevoir chacun de ce qu'on appelle les relatifs dans l'intelligible, comme une espèce une, capable de créer une relation mais non d'avoir une relation à ses substrats, quoi qu'on les dise relatifs, selon la notion commune, l'un à l'autre, comme l'a indiqué l'exposé. Car qu'il faille comprendre ainsi les relatifs là haut et non comme dans les choses d'ici-bas, est évident. Ici-bas le semblable est semblable à son semblable, l'égal égal à l'égal, et les semblables et les égaux l'un à l'autre sont au moins deux. Mais là-haut il n'y a qu'une similitude, qu'une égalité, et celle-ci n'est que la similitude ou l'égalité d'elle-même et non d'une autre chose ; elle ne se trouve pas dans les choses divisées et qui sont suspendues à une autre, mais elle est dans elle-même. Chacune des deux espèces est de telle nature qu'elle a la substance fondée en elle-même, qu'elle est monadique, qu'elle est elle-même, en soi et non dans d'autres. Caries principes les plus propres des espèces et de tous les êtres sont la limite et l'illimitation; dans les choses séparées, la limite crée la monade et l'infinité crée la pluralité; dans les choses continues, la limite crée le point, l'infinité, la distance et l'intervalle ; dans les rapports, la limite crée l'égalité, l'infinité, les proportions; dans les qualités, la limite crée la similitude et l'infinité la dissemblance. Et Socrate lui-même dans le Philèbe nous a enseigné que le plus et le moins sont du genre de l'infini. Partout l'image de la limite, qui a reçu ce que lui donne l'infinité, fait finies et limitées les choses jusque là infinies par leur propre nature; la monade vient nombrer la pluralité, le point, déterminer la distance, l'égalité mesurer les rapports; car l'égalité est une égalité de proportions. La ressemblance fonde le plus et le moins par la similitude des tensions et des détentes. Donc là-haut l'égal et le semblable sont monadiques, parce qu'ils sont limite, l'un des qualités, l'autre, des rapports, puisque le point est limite des continus, et la monade des divisés. Donc ce qui est ici bas selon la relation, il faut le concevoir là haut selon l'identité ; les choses qui ici bas sont seulement relatives l'une à l'autre, il faut les concevoir là haut comme n'appartenant qu'à elles-mêmes et beaucoup plus tôt dans elles mêmes, et ensuite par là ayant une communauté aussi avec les autres; les relatifs d'ici-bas sont sans substance et pour ainsi dire des épisodes; ceux de là-haut sont substantiels ; enfin ceux dont les noms sont tirés de ceux-ci, ont là haut une existence antérieure à ceux à côté desquels ils existent selon une seule cause. Voilà donc quelle est la nature des relatifs dans les intelligibles : je veux dire qu'ils ne sont pas selon une relation nue. ni selon l'accident ; mais ils sont dans l'intelligible sous un mode absolu tout ce que sont, dans le sensible, les relatifs selon la relation; ils sont par eux-mêmes et en soi ce que sont les sensibles dans un autre; ils sont selon la substance ce que les autres sont selon l'accident, et ils sont purement tout cela à un degré plus haut que ceux qui sont dans les effets. Car l'abaissement des choses qui deviennent par rapport à celles qui sont nous révèle des relations produites par des non relatifs, des composés issus de simples, des hypostases épisodiques, venant de choses qui subsistent substantiellement. De toutes les déterminations que nous avons données plus haut, il est utile de remarquer encore que, dans la pensée de Parménide, il faut poser à part, des idées même des choses qui paraissent des accidents, puisque lui-même nous dit que, dans certains cas, il y a des idées de relations. Mais il le dit de celles qui contribuent primairement à former la substance ou la perfection ; quant à celles, où l'hypostase purement épisodique est dans d'autres choses, il explique que ce sont des hypostases vides et d'accidents ; car les relations substantielles sont supérieures aux relations non substantielles, qu'elles contribuent à l'être des choses qui participent des idées ou à leur perfection; c'est comme êtres et comme parfaites que les choses d'ici bas participent des idées ; c'est pourquoi il y a deux ordres d'idées, l'un créateur de substances, l'autre élaborant leur perfection. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le fond des doctrines. Quant aux paroles du texte, celles-ci : « toutes celles des idées qui sont ce qu'elles sont par leur rapport les unes aux autres, » montrent que des idées les unes sont plus séparées les unes des autres, gardant leur état propre parfaitement pur, les autres sont plus unifiées les unes aux autres. Celles-ci sont donc par elles mêmes, le contenu d'elles-mêmes et non d'autres, et elles ne sont pas cela seulement (c'est-à-dire idées) les unes des autres. Le mot homonymes. d'après le système de Platon, est appliqué aux choses sensibles par leur rapport aux intelligibles, système qui veut que les dénominations des choses d'ici-bas leur viennent des intelligibles, comme dans les choses venant de un et aboutissant à un, qu'on appelle homonymes; car Aristote habituellement les fait entrer dans la classe des homonymes. Qu'on ne réclame donc pas une même définition pour les uns et pour les autres (relatifs), puisqu'ils ne sont pas coordonnés entre eux, que les uns sont absolument en dehors des autres, comme les causants sont séparés, supérieurs, et en dehors de leurs causés, ou plutôt qu'on ne cherche pas à donner aucune définition de ces espèces, puisqu'elles sont parfaitement simples et indivisibles ; car les définitions portent sur les composés, et ont pour objet les différences des espèces coordonnées ; mais nous contions la conception des autres aux seules pensées de notre âme, pures et venues des dieux, et nous disons que Platon a appelé et défini les choses d'ici bas homonymes à celles d'en haut, et homonymes en tant qu'elles en participent; et c'est pourquoi il proclame leur ressemblance, comme l'a dit Socrate, lorsqu'il a prétendu que les Idées sont des paradigmes dans la nature. Mais ayant égard aux objections posées, il a ajouté « ou de quelqu'autre nom qu'on veuille les désigner », comme s'il voulait dire qu'il est possible de les appeler ressemblances et non ressemblances, puisque la ressemblance est de deux sortes et est celle du semblable ou du dissemblable au paradigme. § 85. — « Voici, dit Parménide, si quelqu'un de nous est maître ou esclave de quelqu'autre, il n'est assurément pas l'esclave du maître en soi, de l'essence du maîtri, ni non plus le maître n'est pas le maître de l'esclave en soi, de l'essence de l'esclave : mais comme chacun est un homme, il est l'un ou l'autre (esclave ou maître) d'un homme. La maîtrise en soi est ce qu'elle est de l'esclavage en soi, et de même l'esclavage en soi est l'esclavage de la maîtrise en soi. Mais les choses chez nous n'ont pas de puissance, δύναμις, par rapport à celles d'en haut, ni celles d'en haut par rapport à nous; mais, c'est là mon sentiment, celles-là sont à part, les objets d'elles-mêmes, et sont par rapport à elles-mêmes, et les choses chez nous de même, ne sont que par rapport à elles-mêmes : — Comprends-tu ce que je dis ? — Je le comprends parfaitement, dit Socrate ». Comment il faut concevoir les relatifs même dans les espèces, je crois que cela est devenu clair par ce qui a été dit ci-dessus. On peut trouver à poser là l'espèce du maître, et l'espèce de l'esclave ; car quelle autre chose appartient aux maîtres que de commander absolument à leurs esclaves, et de coordonner tout ce qui appartient à ceux-ci avec leur bien propre, et quelle autre chose appartient aux esclaves, que d'être commandés par d'autres et d'être soumis aux volontés de leurs maîtres. Comment donc cela ne serait-il pas, et dans un sens beaucoup plus éminent même, dans les espèces, les unes étant subordonnées aux autres, celles-ci étant plus puissantes et se servant des plus abaissées, les autres obéissantes et coopérant aux puissances des supérieures. Ainsi donc la puissance du maître est une puissance de se servir (d'un autre) et la puissance de l'esclave est d'obéir et de servir. Les deux sont là haut selon la substance et non selon le sort, comme il en est dans leurs images ; car dans ces images, la maîtrise et l'esclavage sont comme des échos de celles qui sont selon la substance. Et si tu ne veux pas considérer cela dans les espèces, seulement au point de vue philosophique, mais le voir dans sa signification éminente et primaire, dans les diacosmes divins eux-mêmes, conçois encore ces diacosmes comme à la fois intelligibles et intellectuels, et conçois en eux les espèces, et tu trouveras comment ces deux conditions conviennent à ces ordres des espèces; car étant intermédiaires, ils commandent primairement et sont les maîtres de toutes les choses qui sont immédiatement au-dessous d'eux, et ils sont suspendus aux diacosmes qui les précèdent; ils agissent pour le bien de ceux-ci et sont ce qu'ils sont de ceux-ci. Car les ordres procédant d'eux, qui se sont manifestés les premiers, sont dominés par eux et demeurent en eux, et ceux-ci gouvernent à leur tour les substances et les puissances de ceux qui viennent après eux-mêmes. D'où il résulte que dans les deuxièmes ordres les choses les plus universelles sont maîtresses des plus particulières, les plus monadiques des plus plurifiées, les absolues et affranchies de toute relation, sont maîtresses de celles qui font partie d'un ordre sérié; ainsi par exemple, dans les générations démiurgiques, Zeus tantôt est placé au-dessus d'Athéna, tantôt d'Apollon, tantôt d'Hermès, tantôt d'Iris; et tous ceux-ci obéissent aux volontés de leur père, communiquent, selon la règle démiurgique, leurs propres actes providentiels aux dieux du degré inférieur, puisque même la tribu angélique et tous les genres supérieurs sont dits être les esclaves, δουλεύειν, des dieux et obéir à leurs puissances. Qu'avons-nous besoin d'ajouter, là où les Oracles, avec la plus grande clarté; parlant des dieux eux-mêmes qui sont avant cet ordre intelligible et intellectuel, se servent de ces mots : « Aux fulgurations intellectuelles du feu, toutes choses cèdent, esclaves de la volonté persuasive du Père. » Et encore : « Mais toutes les choses qui sont les esclaves des Συνοχεῖς matériels. » Ceux-ci donc sont dits être esclaves par rapport à ceux qui sont avant eux, et ceux-là être leurs maîtres, et dominer ceux qui viennent après eux comme étant leurs esclaves ; car ces termes sont, comme nous l'avons dit, les noms des puissances primaires et des puissances secondaires, des puissances absolues et séparées et des puissances coordonnées à leurs produits, des puissances qui ont la fonction de causes efficientes et de celles qui sont dans la catégorie des causes instrumentales, dans leurs productions communes. Que tout cela est selon la nature et non l'effet du hasard, tu peux le voir des entretiens tenus dans le Phédon ; car c'est la nature qui a prescrit au corps d'obéir et à l'âme de commander. Si donc, dans ces sortes de choses, ces relations sont selon la nature, il n'y a rien d'étonnant que nous introduisions là-haut la maîtrise en soi, et l'esclavage en soi, puisque les Théologiens emploient ces termes pour faire voir chez les dieux des puissances dominantes et des puissances sujettes, de même que là-haut l'espèce paternelle et l'espèce maternelle se présentent sous une certaine forme , selon la propriété particulière divine, sous une autre forme, selon la cause spécifique, parce que là, la relation n'est pas vide et nue, mais est une puissance génératrice et une substance qui convient aux dieux. Ainsi donc, il y a, même chez nous, comme quelqu'un l'a dit, une espèce maîtresse et une espèce servile, non seulement par le hasard du sort, mais avant cela, et par un choix libre : à beaucoup plus forte raison dans l'univers des choses, il y a une espèce qui est maîtresse ou esclave selon la substance, comme ici-bas selon la nature, et une qui est maîtresse ou esclave selon la volonté, comme ici-bas selon le libre choix, parce que la puissance selon la substance concourt avec la volonté et des maîtres et des esclaves : car c'est par l'effet de la persuasion, que les maîtrisés sont maîtrisés, et que les gouvernants gouvernent : « Toutes choses, dit aussi l'Oracle, cèdent aux fulgurations intellectuelles et obéissent à la volonté persuasive du Père ». C'est pourquoi chacun est ce qu'il est selon la substance et selon la nature, tous les deux étant persuadés d'en haut par le père intelligible d'être soumis à un maître et d'être maître, et parce qu'ils ont par rapport l'un à l'autre cette maîtrise, comme dit Parménide, et cet esclavage. Mais quoi ! les Dieux ne sont ils pas aussi nos maîtres, puisque Socrate, dans le Phédon, a dit que les Dieux sont nos maîtres, et que nous sommes leur propriété? Disons donc à ce sujet notre propre opinion : cela est vrai, mais sous un mode différent; car ils sont les maîtres de nous, en demeurant séparés et élevés au-dessus de nous, tandis que les Dieux plus universels sont les maîtres des plus particuliers de là-haut, parce qu'ils sont coordonnés à eux et ils sont nos maîtres par l'intermédiaire, comme il a été dit, de l'esclavage de là-haut, qui nous rapproche des Dieux et en fait nos maîtres. Maintenant comme tous les deux agissent sur tous les deux, il nous montre le principe supérieur agissant plutôt sur les supérieurs, c'est-à-dire sur les Dieux qui sont nos maîtres, et le principe inférieur agissant sur les inférieurs, c'est-à-dire sur nous qui sommes maîtrisés par les Dieux . Le mode de maîtrise là haut est donc différent, et n'est pas tel que le mode de domination comme il s'exerce chez nous. De même le mode d'esclavage diffère. Les Dieux se rapprochent eux-mêmes de leurs causants, et s'il y a quelque part un esclavage volontaire, c'est bien parmi eux; car c'est par un acte de volonté que les Dieux abaissés sont dominés par les plus parfaits parce que le fait d'être la propriété des meilleurs ne leur fait pas perdre la félicité qui leur appartient, et le fait d'être à eux-mêmes les place encore davantage parmi ceux qui sont au-dessus d'eux. C'est ainsi que la raison commande, selon le Timée, à la nécessité dans le monde, parce qu'elle la persuade de regarder le plus possible vers le meilleur, comme dit aussi Socrate dans le Phédon . Ces deux principes étant les causes de la composition du monde, la génération a lieu par la nécessité sans doute, mais selon la raison, parce que la nécessité est esclave de la raison, afin que le tout demeure gouverné par la raison. Ainsi donc les Dieux sont les maîtres des Dieux, et les hommes des hommes, les uns selon la substance, les autres selon la fortune, parce que l'esclavage là-haut est subordonné aux Dieux ; car toute la série de l'esclavage est sous la maîtrise divine, puisque la maîtrise n'est pas au même rang de dignité dans l'essence que l'esclavage ; mais elle est au-dessus d'elle, autant qu'il peut y avoir de priorité entre des choses coordonnées, et il est nécessaire que les choses plus élevées commandent à toutes celles qui sont plus pauvres dans l'essence. Ainsi donc toute la série selon l'esclavage en soi étant subordonnée à la maîtrise en soi, il est rationnel que les Dieux soient les maîtres selon leur propre puissance despotique, et que les plus universels soient les maîtres, non seulement des Dieux plus particuliers, mais encore des hommes qui participent, selon l'extension, de l'esclavage en soi qui fait les choses pires esclaves des meilleures. § 86. — « Ainsi donc, dit-il, la science, la science en soi, qui est l'essence de la science, sera la science de cette vérité, la vérité en soi, qui est l'essence de la vérité. — Parfaitement. — Et encore chacune des sciences qui est science en soi, sera la science de chacun des êtres, qui est être en soi ? oui ou non? — Oui . » Socrate a célébré aussi dans le Phèdre ,la science divine, lorsqu'il fait remonter toutes les âmes aux ordres intelligibles et intellectuels, et lorsqu'il dit qu'elles contemplent là la justice en soi, la sagesse en soi, la science en soi, consubstantifiées à cet ordre moyen des Dieux; il a lui même établi que là est la vérité, qui procède des intelligibles et fait briller la lumière intelligible dans tous les genres moyens des Dieux et a suspendu cette science là à cette vérité là. Et cela a été prouvé par moi et par mon maître quand nous avons expliqué les divines intentions de Socrate dans le Phèdre. Si donc traitant ici des diacosmes spécifiques, il dit que la science en soi est la science de la vérité en soi, il n'y a pas lieu de s'étonner. Là haut, la science, la vérité et toutes les espèces qui sont là, participent de la science en soi, et de la vérité en soi, l'une faisant intellectuelles toutes celles qui sont là-haut — car cette science est la pensée éternelle et monoïde des choses éternelles, — l'autre les faisant intelligibles ; car la lumière de la vérité étant un intelligible leur communique sa puissance intelligible. Et puisqu'il y a de ces espèces moyennes un grand nombre de classes, [car les unes, comme on dit, sont les sommités, ont le caractère de l'un et sont intelligibles; les autres ont la vertu de contenir toutes les choses dans leur système propre et d'en lier le contenu; les autres sont télésiurgiques et ont la vertu de faire retourner,] - par cette raison, après la science une, il a fait mention des sciences plusieurs ; car elles procèdent d'en haut, à travers tous les genres, accompagnées de la lumière de la vérité. Cette lumière, c'est l'un, qui est, dans chaque ordre, et l'intelligible auquel il est conjoint et la pensée. De même donc que la pensée dans son tout est la pensée du tout intelligible, de même les pensées plusieurs sont unifiées aux intelligibles plusieurs. Donc ces espèces, qui sont complètement éloignées et au-dessus de notre connaissance ont des pensées unifiées à leurs propres intelligibles; car les intellectuelles, quoique séparées et au dessus de nous, cependant parce que notre hypostase procède sans solution de continuité d'elles, sont en quelque manière en nous; nous en possédons une connaissance, et par elles une connaissance de la suprématie inconnaissable même des choses plus divines. Et il ne faut pas dire, comme le font certains des amis de Platon, qu'on ne sait pas cette science divine elle-même, mais que c'est elle qui procure, d'elle même, ce savoir, aussi aux autres. Car chacune des choses divines agit primairement sur elle-même, et tire d'elle-même, le principe de son essence particulière, propre: le causant de la vie se remplit lui-même de vie, le causant de la perfection se fait lui même plus parfait : par conséquent ce qui fournit aux autres le connaître, possède lui-même, avant tous autres, la connaissance des êtres, puisque même la science chez nous, image de la science en soi, connaît les autres choses et avant ces autres choses se connaît elle même. Ou bien y a t-il quelque autre connaissance qui nous dise qu'est-ce qu'est cela même : la science ? Et comment n'appartiendrait il pas à la même puissance de connaître à la fois les relatifs puisqu'ils sont à la fois ? Ainsi donc la science qui connaît les choses susceptibles d'être sues par la science, se connaît aussi elle même, comme étant la science de ces choses. Mais il ne faut pas dire que les autres sciences sont les sciences des choses susceptibles d'être sues, mais que la science divine est cela même, science des sciences, et non connaissance des choses susceptibles d'être sues et que c'est là son caractère éminent et absolu; car si les autres sciences sont sur le même rang que la science une et unique, celle-ci connaîtrait et les sciences elles-mêmes et les objets susceptibles d'être sus qui leur sont tous correspondants par essence, par le fait qu'elle connaît celles là, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, par leur relation réciproque. Mais si la science une et unique est séparée des sciences plusieurs et ne se retourne pas vers elles, elle a son hypostase en acte en elle-même, et n'a pas d'objet purement susceptible d'être su, apparié à elle-même. Et de même que la connaissance de cette science est simple et parfaitement semblable à l'un, de même l'objet connaissable est unié et embrasse dans sa compréhension, tous ces objets accouplés à la science. Il y a donc une science en soi qui est cause, pour ce qui participe d'elle et encore beaucoup plus tôt pour elle-même, du savoir; car sa substance est .substantifiée dans le fait qu'elle est connaissance et d'elle même et de l'être; car cette science là haut n'est pas une habitude, ἕξις, ni une qualité, mais une hyparxis indépendante, n'appartenant qu'à elle-même, solidement fixée en elle même, et par le fait de se connaître elle-même, connaissant l'objet primairement connaissable, scientifiquement, c'est-à-dire le purement être. Car elle est accouplée à cet objet comme la raison purement raison à l'intelligible purement intelligible, comme la sensation purement sensation, &u sensible purement sensible. Les sciences en soi plusieurs qui viennent après celle-là, sont comme des processions procédant de la science une et unique, accouplées aux pluralités des êtres qu'embrasse l'être, objet de cette science une, et qui est l'un plusieurs, comme l'est également la science. L'élément unié de cette science est unilié à l'un de l'être, connaît cet un, et l'un d'elle-même, tandis que sa pluralité connaît les pluralités des êtres qu'embrasse cet un, et se connaît elle même. Les unes sont des substances capables de connaître, les autres des hypostases capables d'être connues, et leur union parfaitement une constitue un caractère propre aux hypostases simples des espèces. § 87.— « Mais la science chez nous ne sera-t-elle pas la science de la vérité chez nous, et de nouveau à chacune des sciences chez nous, ne lui arrivera-t-il pas d'être la science de chacun des êtres chez nous ? — Nécessairement. » Nous participons nous aussi à la vérité, non à celle dont participent ces espèces, mais à celle qui a été donnée à notre ordre par la démiurgie, et la science chez nous est la science de cette vérité là. Il y a aussi des connaissances plus particulières que cette science, les unes qui expliquent tel objet connaissable, les autres tel autre connaissable, les unes tournées vers la génération et ses espèces diverses, les autres scrutant la nature dans son tout, les autres contemplant les hypostases surnaturelles des êtres ; et les unes employant les sens et n'accomplissant qu'avec eux leur œuvre propre, les autres ayant besoin des notions représentatives et des formes de l'imagination, les autres se contentant de notions fournies par l'opinion, les autres repliant sur lui même l'entendement pur en lui-même, les autres élevant l'entendement qui est en nous, à la hauteur de la raison : c'est celles-là que définit Socrate dans le Philèbe où il distingue en elles l'élément pur et sans mélange de l'élément qui ne l'est pas, et dit que celles qui emploient les sens et se remplissent du vraisemblable ne sont pas pures, tandis que celles qui opèrent sans les sens sont des connaissances pures et exactes. C'est là qu'il place, avant tous les autres arts, les trois arts : de l'arithmétique, de l'artmétrique, et de l'art statique et avant ces arts, les arts philosophes différents de ceux qui ont cours dans le vulgaire, et avant ceux-ci, la dialectique qui est ce qu'il y a de plus pur dans la raison et dans la science. Puisqu'il y a une si grande différence dans les sciences, il est évident que les unes ont la fonction de juger de certains objets de la science, les autres d'autres, et aussi d'objets qui contribuent à éveiller en nous la réminiscence de l'être, par exemple la géométrie qui étudie la notion de la figure chez nous, l'arithmétique qui explique et développe par ses démonstrations propres l'espèce une des nombres, une autre qui porte ses investigations sur quelqu'autre des objets particuliers de la connaissance scientifique, qui existent parmi nous. Il faut donc entendre le mot de science dans un sens sûr et précis, ne pas introduire au milieu des sciences les arts et rechercher les idées de ces arts auxquels les besoins ont donné naissance chez nous et qui ne sont que les images d'images : car ils ne font que copier les sciences véritables. De même donc que nous disons qu'il y a des idées des accidents qui parfont la substance, mais non de ceux, issus des premiers, qui n'ont qu'une hypostase accidentelle et seulement dans d'autres choses et s'introduisent dans des espèces déjà parfaites, comme nous l'avons expliqué plus haut ; — car ce ne sont que des échos de ceux qui tiennent primairement leur hypostase d'en haut; — de même les arts, qui sont des simulacres des sciences, ont leur origine ici bas ; mais les sciences elles-mêmes procédant des sciences qui présubsistent là-haut, leur sont supérieures, car c'est par elles que même chez nous il s'opère une ascension vers les sciences véritables et une assimilation in la raison. Et de même qu'il y a nécessairement, là-haut la science une et unique avant les plusieurs sciences, qui est la science de ce qui est vérité en soi, comme les sciences plusieurs de là haut sont les sciences des plusieurs vérités de là-haut (car l'objet propre de la science de chacune est une certaine vérité) de même il faut, pour les sciences chez nous qui sont plusieurs, concevoir par elle même l'espèce une et entière de la science, qui n'est ni complétée par les plusieurs sciences ni coordonnée avec elles, mais présubsiste en soi et par soi, et concevoir les sciences plusieurs se répartissant le domaine un de la science, et chacune différente, ayant un rang différent selon les différents connaissables qu'elles ont pour objet, mais se rapportant toutes à la science première et recevant d'elle leurs principes. Il y a ainsi parmi nous une science distincte de la science divine, mais qui nous sert d'intermédiaire pour remonter jusqu'à elle. Il ne faut donc pas poser en nous le monde intelligible, comme quelques uns l'ont dit afin que nous connaissions qu'il y a des intelligibles en nous ; car les intelligibles sont séparés et au dessus de nous, et sont la cause de notre substance. Il ne faut pas dire non plus que quelque chose de l'âme demeure en haut, afin que par cette partie de notre âme nous ayons un contact avec les intelligibles ; car ce qui demeure toujours en haut ne saurait jamais être accouplé avec ce qui s'éloigne et s'écarte de la vraie pensée, et ne saurait constituer avec lui la même substance, ni en parfaire la substance. Il ne faut pas non plus poser l'âme comme consubstantielle aux dieux; car le Père qui l'a engendrée a produit notre hypostase primitive des éléments du deuxième et du troisième degré : car ce sont là des opinions qu'ont été contraints de poser ceux qui, cherchant à expliquer comment nous, qui sommes tombés dans ce lieu ici-bas, nous connaissons les êtres, et cela, quand la connaissance de ces êtres n'appartient pas à des êtres déchus et tombés, mais au contraire à des êtres qui se sont réveillés et se sont conservés sobres de l'ivresse de la chute. Mais il faut dire que nous, demeurant à notre rang propre et ayant des images substantielles des principes universels, par elles, nous nous retournons vers ces principes et par les marques caractéristiques que nous en avons, nous nous formons un concept des êtres, qui est de la même série que les êtres mêmes, mais qui est inférieur relativement à leur valeur propre, tandis que nous nous formons des espèces qui sont chez nous un concept égal en dignité à l'objet, parce que nous pouvons embrasser dans un seul (être ou notion) les connaissables et la connaissance. § 88. — « Or, tu le reconnais, les espèces en soi, nous ne les possédons pas et il n'est pas possible qu'elles soient en nous. — Non ! Certes. — Mais les genres en soi sont connus ce qu'ils sont chacun, par l'espèce en soi de la science? — Oui — Espèce que nous ne possédons pas? — Non, vraiment. — Donc aucune des espèces n'est connue, par nous du moins, puisque nous ne possédons pas la science en soi ? — Cela n'est pas vraisemblable. » Ici, s'appuyant sur les propositions développées plus haut, il amène, à peu près comme il suit, la conclusion qu'il se proposait : les espèces absolues et séparées (des choses) sont en soi ; les choses en soi sont à elles mêmes et ne sont pas en nous; les choses qui ne sont pas en nous ne sont pas du même rang que notre science ; les choses qui ne sont pas correspondantes, par leur rang, à notre science sont inconnaissables à notre science : donc les espèces absolues sont inconnaissables à notre science; car elles ne sont visibles qu'à la raison seule, et cela est vrai de toutes les espèces, mais éminemment de toutes celles qui sont au-delà des dieux intellectuels ; car ni la sensation, ni la connaissance par l'opinion, ni l'entendement pur, ni notre connaissance intellectuelle, ne réunissent l'âme à ces espèces Seule l'illumination venue des dieux intellectuels, nous rend capables de nous unir à ces espèces intelligibles la et aux espèces intellectuelles, comme quelqu'un le dit quelque part dans une inspiration divine : donc la nature de ces espèces nous est inconnaissable, parce qu'elle est d'un ordre supérieur à notre intelligence, et aux pouvoirs de connaître de notre âme. C'est pourquoi Socrate dans le Phèdre, comme nous le disions plus haut , compare la connaissance intuitive de ces espèces aux visions des mystères, des initiations, des épopties, quand il décrit la marche ascensionnelle des âmes vers la voûte qui est sous le ciel, vers le ciel lui-même et vers le lieu hypercéleste, et là il appelle les visions de ces espèces, des simulacres purs, sûrs, simples, bienheureux. Nous avons, depuis longtemps, montré dans notre écrit sur la Palinodie, que tous ces ordres sont intermédiaires entre les dieux intellectuels et les premiers intelligibles , et cela par des preuves si claires, a mon sens, qu'il doit être évident comment ce que nous disons ici ne peut manquer de posséder quelque vérité. Ainsi donc, comme je l'ai dit plus haut, la connaissance des espèces intellectuelles, c'est le démiurge lui même et le Père des âmes qui l'a déposée en nous ; de celles qui sont au dessus de la raison, telles que sont les espèces dans les ordres supérieurs, la connaissance nous en est dérobée et est au-dessus de nos facultés de connaître; elle naît d'elle-même, connaissable uniquement aux âmes saisies par l'inspiration divine, de sorte que même les conclusions où nous arrivons ici maintenant, sont les conséquences de nos conceptions touchant les espèces à la fois intelligibles et intellectuelles : conclusions qui portent que nous ne participons pas à la science en soi qui, dit-il, connaît les genres en soi des êtres et chacun d'eux. Il ne faut donc pas comprendre comme genres des êtres les notions que nous nous représentons communes à plusieurs choses, ni toutes celles qui ne sont dues qu'aux notions communes, (car ces représentations sont postérieures aux êtres) ; mais bien toutes celles qui ont une puissance génératrice plus générale et supérieure, selon la cause, aux générations qui se produisent dans des espèces plus particulières ; car de même qu'ici-bas les genres des espèces ou sont conçus par l'imagination dans plusieurs, ou sont affirmés de plusieurs, de même ceux qui sont là haut, ont, plus marqué , le caractère de principes , sont plus parfaits et embrassent un plus grand nombre d'autres espèces, et l'emportent sur celles qu'ils contiennent par la simplicité et la puissance génératrice ; ceux-là, il faut dire qu'ils sont connus par l'espèce de la science qui a son principe là haut, qui rassemble sous le mode unifié tous les plurifiés et sous le mode universel tous les particuliers, selon une seule connaissance qui a la forme de l'unité. C'est la ce que veut faire la science chez nous, qui, par les causes, prend successivement connaissance des processions des êtres, science qui n'obtient qu'un rang inférieur. § 89. — « Donc nous est inconnaissable et le beau en soi dans son essence, et le bien, et tout ce que nous concevons comme étant Idées en soi. » — Cela en a tout l'air. » Le beau et le bien procèdent d'en haut, du faite le plus élevé des intelligibles et descendent dans tous les genres du deuxième degré des dieux; les diacosmes intermédiaires reçoivent donc la procession des espèces mêmes et cette procession est magnifique, puisque selon le bien, ils sont pleins de leur propre perfection, de la puissance de se suffire à eux-mêmes et de n'éprouver aucun besoin ; et que selon le beau, ils sont désirables et aimés des choses qui viennent après eux, qu'ils possèdent la puissance de faire remonter celles qui ont procédé et de lier ensemble les causes divisées ; car la conversion vers le beau rassemble et unit tout, et est comme un centre puissant où tout s'appuie. Ces espèces, — c'est le bien et le beau dont je parle, — sont donc dans les premiers intelligibles, mais à l'état latent et caché, et sous un mode qui ressemble à l'unité; puis ils en sortent ensemble et passent dans des ordres différents, mais sous une forme coordonnée à chacun. De sorte qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a quelque beau connaissable par la sensation seule, un autre connu par l'opinion, un autre par la pensée accompagnée de raisonnement, un autre par la pensée pure, un autre inconnaissable par lui-même, absolument séparé et ne pouvant être connu que par sa propre lumière. § 90. — « Considère encore quelque chose de plus grave que cela: — Quoi donc? — Accorderas-tu ou non, que s'il y a quelque genre en soi absolu de la science, il sera de beaucoup plus exact que la science chez nous, et qu'il en sera de même de la beauté et de tous les autres genres? — Oui. » Les idées précédemment exposées par nous dans une recherche qui a eu un caractère plus particulièrement théologique, nous ont fait arriver jusqu'aux diacosmes spécifiques, à la fois intelligibles et intellectuels : car si elles sont fausses ou au moins douteuses, appliquées seulement aux diacosmes intellectuels, elles se sont montrées toutes vraies, et inspirées par les dieux, appliquées à ceux dont il s'agit maintenant, et elles nous font remonter à la nature particulière et caractéristique des espèces qui est dans l'intelligible, quoiqu'elles aient la forme d'objections et de doutes, en tant que procédant des intellectuels, mais exprimant en réalité la marque particulière et caractéristique des espèces primordiales. L'argument qui, dans son développement, montre qu'elles ne connaissent pas les choses d'ici-bas et n'exercent pas sur elles la puissance d'un maître, appliqué aux idées démiurgiques. est une proposition fausse; car c'est de ces idées que les choses d'ici-bas tiennent leur hypostase; ce sont elles qui président, avec un empire souverain, à leur création et à leur division multiple en espèces indivisibles, de sorte qu'elles ont anticipé en elles-mêmes l'action providentielle et la domination sur ces choses; mais appliquée aux idées primordiales et qui sont le plus semblables à l'un et qui sont réellement intelligibles, la proposition est parfaitement vraie; ce sont elles qui, sous la forme monoïde, unifiée et universelle ont apparu les premières dans la raison intelligible, sortant de l'être. Car embrassant les causes paternelles des genres les plus communs et dont l'extension est la plus grande, elles sont plus riches et plus puissantes que la connaissance divisée des choses d'ici bas et que cette domination immédiate sur les sensibles qui est celle d'un maître; car ces dieux intelligibles sont les maîtres des dieux qui sont manifestement émanés d'eux, et leur connaissance est au-delà de toutes les autres connaissances divines. C'est en ayant les regards fixés sur ces espèces que Platon conclut d'elles, que les Dieux ne sont pas nos maîtres et qu'ils ne connaissent pas les affaires humaines ; car les causes de ces choses et les puissances qui les dominent, comme nous l'avons expliqué, sont dans les dieux intellectuels ; celles des intelligibles ont leur fondement au-dessus de toutes ces divisions, et produisent toutes choses selon les causes unifiées et les plus simples : leur mode de créer, comme leur mode de connaître est un, concentré en lui même et uniforme (ἐνοειδής). Ainsi la cause là haut, la cause intelligible du genre céleste produit les choses célestes : les dieux, les anges, les démons, les héros, les âmes, non en tonique démons ou anges (car ceci est le caractère particulier et propre des causes divisées et des idées divisées, dont les dieux intellectuels ont opéré la division en pluralité), mais en tant que tous ces genres sont, en quelque manière, divins et célestes, et en tant qu'ils ont reçu, dans leur lot, une hyparxis unifiée avec les Dieux. Et il en est de même de chacune des autres idées ; ainsi on ne doit pas dire par exemple, que l'espèce intelligible de tout ce qui a des pieds et vit sur la terre, gouverne en maître les choses divisées selon leur espèce individuelle et une — car ceci est la fonction des espèces émanées d'elle et divisées en pluralité — mais il faut dire qu'elle gouverne toutes les choses en tant qu'elles ne font qu'un seul genre. Car les espèces plus proches de l'un créent des hypostases plus universelles et plus semblables à l'un, et toutes celles qui sont après celles là, créent des hypostases plus particulières et plus plurifiées. Et il en est de même des autres idées intelligibles qu'enveloppe la raison intelligible Mais en avançant dans le cours de cette discussion nous examinerons cela davantage. L'opinion de Platon sur la Providence a été très clairement exposée par l'hôte d'Athènes, là où il professe par ses paroles que les dieux connaissent tout, et ont un pouvoir de gouvernement surtout; mais même ici, et peut être n'était-ce pas le moment opportun de le faire, on fait habituellement entrer la question de la Providence dans le cercle des discussions des difficultés que soulève la théorie des Idées. Pour nous, nous nous expliquerons très sommairement sur ce sujet. Il est évident que, si quelqu'un conteste que la connaissance et l'empire des Dieux s'étende et pénètre en tout, Parménide a montré l'absurdité de cette hypothèse immédiatement et dès le premier mot : car appeler plus grave la conclusion où elle aboutit, plus grave que celle où aboutit la précédente, exprime, je crois, avec une précision suffisante, qu'il condamne tous les raisonnements qui suppriment la providence. Car il est grave d'affirmer que les Dieux ne sont pas connus de nous, qui sommes des êtres raisonnables, intellectuels et qui possédons quelque chose de divin, selon notre substance. Mais il est plus grave de supprimer chez les êtres divins la connaissance même; car l'un vient de gens qui ne se retournent pas vers les Dieux, l'autre de gens qui empêchent la bonté des Dieux de procéder en toutes choses; l'un ne touche que notre substance à nous, l'autre se porte outrageusement contre la cause divine. Et le mot plus grave n'est pas entendu dans le sens d'une objection plus forte, comme on a coutume d'appeler graves les gens qui sont supérieurs par la force de leurs raisons, mais comme devant inspirer à ceux qui possèdent leur raison, une plus grande crainte et une plus grande réserve; car cette hypothèse déchire l'union des êtres et sépare et retranche du monde le divin ; elle limite la puissance divine, comme ne descendant pas en toutes choses, et circonscrit leur puissance intellectuelle comme n'étant pas complète et parfaite ; elle renverse toute la démiurgie et l'ordre qui, des causes séparables, se communique au monde, et la bonté, qui, partant d'une seule et unique volonté, remplit tout, selon le mode unié, de biens. Plus grand encore que ces maux est le renversement de la piété : car quelle communauté les hommes auront ils avec les Dieux, si l'on supprime la connaissance qu'ils ont des choses d'ici-bas. Disparaîtront donc et seront réduites à rien toutes les cérémonies d'adoration envers le divin, toutes les prescriptions des choses saintes, tous les serments où on appelle les Dieux en témoignage, et les notions que nous avons d'eux sans qu'on nous les ait apprises et qui sont inhérentes à nos âmes. Quel don restera-t-il aux Dieux à faire aux hommes, s'ils ne possèdent pas par anticipation les mesures intellectuelles du mérite de ceux qui les reçoivent, s'ils n'ont pas connaissance de ce qu'ils font, de ce que nous souffrons, de ce que nous pensons, même quand nous ne passons pas à l'action. C'est donc bien justement qu'il appelle grave le raisonnement qui amène à de telles conséquences, non pas parce qu'il est très fort et difficile à réfuter, mais parce qu'il doit nous inspirer toute sorte de craintes. Car s'il est impie de renverser n'importe lequel des commandements divins, parce que l'opinion que nous avons des dieux mêmes est par là tout entière renversée, comment verrait-on sans effroi s'établir un tel changement, un tel bouleversement? Mais qu'il a condamné une telle hypothèse, qui professe l'ignorance (des Dieux) à l'égard de l'administration des choses humaines, cela résulte encore évidemment de ce qui suit. Puisque lui-même (Platon) veut que Dieu connaisse et fasse tout, et que quelques uns de ceux qui sont venus après lui, ont tenté de renverser complètement cette doctrine, eh !bien, disons à ce propos tout ce qui suffit au sujet que nous proposons. Quelques uns de ceux qui se rattachent à lui, se laissent troubler par la remarque que l'instabilité des choses qui sont emportées tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, ne paraît pas impliquer la Providence et un Dieu qui y président ; car ce qu'on appelle les événements venus du hasard, l'inégalité dans les conditions de la vie, l'agitation désordonnée des choses matérielles leur fournissent de nombreux arguments pour établir et reconnaître l'absence d'une Providence. En outre la pensée de ne pas causer à Dieu des soucis en l'engageant dans les complications des raisons (des choses) si nombreuses et si diverses, de lui faire perdre sa propre félicité, les a amenés à cette opinion coupable : car l'état de trouble qu'éprouve notre âme, quand elle s'abaisse au souci des choses corporelles, i!s ont cru qu'il se produirait aussi chez les Dieux, s'ils l'obligeaient à avoir une telle sollicitude pour les choses d'ici-bas. Outre cela, par le fait que les connaissances des choses connaissables diverses et différentes sont elles-mêmes sujettes à la diversité et au changement, puisque les choses sensibles sont connues par la sensation, les choses opinables par l'opinion, les choses susceptibles d'une connaissance scientifique, par la science, les intelligibles par la raison, comme ils n'admettent en Dieu ni la sensation ni l'opinion ni la science, mais seulement la raison pure et sans matière, ils lui ont refusé la connaissance de tout ce qui n'est pas les intelligibles. En effet s'il est en dehors de la matière, il est nécessaire de le purifier de toutes les conceptions tournées vers la matière, et nécessairement s'il est pur de ces conceptions, il ne connaît pas les choses qui sont dans la matière. Voilà donc pourquoi les uns lui ont ôté, comme je le disais, la connaissance des choses sensibles et la Providence, non pas par suite de la faiblesse, mais au contraire de la supériorité de son énergie gnostique : de même que ceux qui ont les yeux remplis de la lumière sont dits ne pas pouvoir voir les choses de ce monde, cette impuissance n'étant qu'une supériorité et un excès dans la faculté de vision. De plus ils disent qu'il y a beaucoup de choses qu'il est beau de ne pas connaître, par exemple à ceux qui sont possédés par l'enthousiasme, il est beau ne pas voir ce qui dissipera cet état surnaturel, ou, aux gens versés dans les sciences tout ce qui flétrirait la pure hauteur de leur science. Les autres, en lui accordant la connaissance des choses sensibles afin d'affirmer sa providence, tournent ses conceptions sur les choses externes et le font descendre et pénétrer à travers les sensibles et entrer en contact avec les choses qu'il administre, imprimer des impulsions par le choc, et être présent en elles localement, car autrement il ne pourrait, juger que ces choses sont dignes de sa providence de quelque manière qu'elle doive s'exercer. D'autres disent qu'il se connaît lui-même , mais qu'il n'a pas besoin, pour exercer sa providence sur les choses sensibles, de les connaître, mais qu'il connaît et ordonne tout ce qu'il produit par son être seul, sans avoir la connaissance des choses qu'il produit, et que cela n'a rien d'étonnant, puisque la nature, sans la connaissance, sans même une représentation de l'imagination, crée aussi, et que Dieu diffère d'elle en ce qu'il a la connaissance de lui-même, s'il n'a pas la connaissance de ce qu'a produit son acte démiurgique. Les raisons qui persuadent certains ou de ne pas séparer Dieu des choses encosmiques, ou de lui retirer la connaissance des choses secondes et la providence qui est unie à cette connaissance, sont à peu près celles que nous avons dites. Pour nous, nous disons qu'ils ont raison et qu'ils n'ont pas raison. Car il est impossible que le désordre existe, si la Providence existe, et que Dieu éprouve des soucis, encore moins qu'il connaisse les sensibles par une sensation qui implique une passivité, de sorte que de ce côté ils ont raison. Mais en ne reconnaissant pas chez les Dieux une connaissance absolue et affranchie de relation et ayant la forme de l'un, en cela ils me paraissent s'écarter de la vérité. Nous leur poserons ces questions très topiques. Est-ce que tout ce qui agit n'agit pas selon sa propre puissance et sa nature, et selon l'ordre de substance qu'il possède et qu'ainsi il y a en lui une activité selon son ordre? Par exemple, la nature a un acte physique, la raison un acte intellectuel, l'âme un acte psychique, et quoique une même chose devienne par des causants plusieurs et divisés, chacun n'agit-il pas selon sa propre puissance et non selon la nature des choses devenues ? Est-ce que l'homme et le soleil engendrent l'homme de la même manière? Et est-ce que l'un et les causes efficientes produisent le devenir de la même manière et non selon la nature propre de chacun d'eux, c'est-à-dire celles-ci particulièrement, imparfaitement et avec des tracas et des soucis, l'autre sans aucune sollicitude ni peine, par son être même et universellement ? Mais il serait absurde de soutenir cette thèse : car le genre divin possède un certain mode d'acte et le genre mortel, un mode d'acte tout diffèrent. Or, s'il en est ainsi, si tout ce qui agit agit selon sa propre nature, selon son ordre, l'un divinement et par un mode au dessus de la nature, l'autre physiquement, l'autre d'une autre manière quelconque,il est clair que le connaissant connaît selon sa propre nature; mais il ne faut pas dire que, parce que le connu est un et identique, pour cette raison, les sujets connaissants appréhendent les choses selon un mode semblable aux objets connus. Car la sensation connaît le blanc: l'opinion et notre raison le connaissent aussi, mais pas de la même manière, puisqu'il n'est pas possible que la sensation connaisse l'essence du blanc. Et l'opinion n'appréhende pas ses connaissables propres, comme la raison; car l'une connaît selon la cause, l'autre connaît seulement le ὅτι, le que (la chose est). C'est ainsi que nous disons que l'opinion droite diffère de la science, l'une connaissant cela seulement par soi, c'est-à-dire le que (il est), et c'est en cela que consiste sa faiblesse, l'autre saisissant le connaissable avec sa cause et pouvant ainsi le comprendre beaucoup mieux. La raison elle-même, qu'on vante tant, ne connaît pas l'intelligible en soi et si nous le connaissons. comme il a été dit plus haut, ce n'est pas de la même manière, mais par une modification de notre puissance de connaître. Ainsi telle est la nature du sujet connaissant, telle est la nature de la connaissance; et ce n'est pas la manière d'être du connaissable qui détermine chez tous ceux qui le connaissent leur mode naturel de le connaître : il est connu d'une façon supérieure par les genres supérieurs, d'une façon abaissée par les genres plus pauvres. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que Dieu connaisse tout selon sa nature, indivisément les choses divisibles, monoïquement les plurifiées, éternellement les choses engendrées, universellement les particulières, et pour le dire simplement, autrement que ne se comporte chacune des choses ; et qu'il possède un mode de produire tout, concordant à ce mode de connaître, et par le fait même qu'il connaît toutes choses par des connaissances simples et unifiées, qu'il donne à chacune l'être et la procession dans l'être. Car les choses susceptibles d'être entendues sont connues par l'ouïe d'une certaine manière ; d'une autre manière sont connues par le sens commun, toutes les choses sensibles d'un ordre supérieur à celles-là ; de nouveau encore, au dessus de ce sens commun, autre est le mode de connaissance dont l'entendement connaît ces objets sensibles et tous ceux que ne connaît pas la sensation ; et de nouveau encore, puisque la connaissance désire certaines choses, que la passion aspire à certaines autres, que la volonté oppose les uns aux autres ses objets, il y a une certaine vie une qui meut l'âme, vers tous ces objets, vie par laquelle nous disons : Je désire — J'ai telle passion — Je prends cette résolution ; car notre âme a une inclination pour toutes ces choses ; elle vit en commun avec elles, parce qu'elle est une puissance de se porter vers tout ce qui est désirable. Et avant ces deux principes, il y a l'un de l'âme, qui dit souvent: Je sens — Je réfléchis — Je désire — Je veux, qui accompagne toutes ces énergies et dont l'acte agit concurremment avec elles. Car nous ne les connaîtrions pas toutes, et nous ne pourrions pas dire en quoi elles diffèrent, s'il n'y avait pas en nous un certain un indivisible qui les connaît toutes, qui plane sur le sens commun, qui est avant l'opinion, avant la connaissance, avant la volonté, qui connaît leurs pensées, qui concentre indivisément leurs désirs, qui dit, à l'occasion de chacune : le moi et le j'agis. Comment aurions nous le droit de refuser de croire que la connaissance indivise de Dieu, parce qu'elle n'est pas une connaissance sensible, connaisse les sensibles parce qu'elle n'est pas divisible, connaisse les divisibles sous un mode qui lui est propre à elle- même, parce qu'elle n'est pas localement présente à toutes les choses qui sont dans le lieu, connaisse ces choses avant toute présence dans le lieu, et leur donne à toutes ce que chacune de celles qui reçoivent peut en prendre, et que cette connaissance soit séparée d'elles et au-dessus d'elles. Ainsi donc ni l'instable des choses phénoménales n'est connu par lui sous un mode instable, mais sous un mode déterminé et fixé ; ni ce qui est sujet à mille changements ne lui est connu sous un mode variable et incertain, mais au contraire toujours de la même manière ; ni la connaissance de la variété et de la diversité ne lui occasionne de soucis et de travail ; car par le fait seul qu'il se connaît lui-même, il connaît tout ce dont il est la cause efficiente, parce qu'il en a une connaissance plus exacte que si on lui assignait des connaissances coordonnées aux objets connus. Car connaître chaque chose selon la cause l'emporte sur toute autre connaissance. Donc la connaissance est pour lui sans effort ni travail, parce que le sujet connaissant demeure en lui-même, et en se connaissant seulement lui-même, connaît tout, sans avoir besoin ni de la sensation ni de l'opinion pour connaître les choses sensibles ; car c'est lui qui les a toutes produites ; c'est lui qui, par ses propres pensées, d'une profondeur insondable, pensées selon la cause, et dans une simplicité parfaitement une, embrasse et enveloppe la connaissance unifiée de toutes. Par exemple, si un homme ayant construit un vaisseau, y embarquait des hommes dont il serait lui-même le créateur, ὑποστάτης, et s'il mettait son vaisseau à la mer et si. possédant l'art d'Éole, il faisait souffler autour de lui certains vents et ainsi laissait périr son navire, et s'il faisait tout cela par sa seule pensée; si, ayant conçu ces représentations dans son imagination, il créait extérieurement ce qu'il avait en lui sous forme d'image, il est évident que de tout ce qui arrivera à son vaisseau dans la mer, frappé par les vents, il possède lui même la cause, et qu'en regardant ses propres pensées, il crée à la fois et connaît les choses externes, sans avoir besoin de se retourner vers elles. C'est ainsi, et dans un degré supérieur encore, que l'esprit divin, possédant les causes de toutes choses, les crée en même temps qu'il les voit, sans sortir de sa sublimité. Si la raison est, l'une plus universelle, l'autre plus particulière, il est évident que la conception ne sera pas la même pour toutes ; mais là où les intelligibles sont plus universels et indivisibles, la conception est universelle et indivisible ; là où le nombre des espèces a procédé dans la pluralité et l'extension, là la connaissance est à la fois une et pluriforme; et alors nous ne serons pas surpris d'entendre les vers Orphiques, où le Théologien dit : « Elle est sous les yeux de Zeus, Roi et Père... » (En elle) habitent les dieux immortels, les hommes mortels, et tout ce qui a été et tout ce qui sera un jour... » Car il est plein de tous les intelligibles; il a les causes divisées de toutes les choses, de sorte qu'il engendre les hommes et toutes les autres choses selon leurs caractères particuliers et propres, mais non en tant que chacune est divine, comme le Père Intelligible, qui est avant lui. C'est pourquoi celui-là (Zeus) est appelé le père des choses divisées selon l'espèce, et est dit pénétrer en toutes, tandis que celui-ci, (le père intelligible, Phanès) est le père des choses divisées selon les genres et le père des touts, quoiqu'il soit beaucoup antérieurement le père de toutes, mais de toutes en tant que chacune participe de la puissance divine. A l'un appartient la connaissance des choses humaines et dans leur particularité et dans leur communauté avec tes autres; car en lui est la cause des hommes, séparée des autres et unifiée à toutes les causes ; à l'autre, appartient la connaissance de toutes à la fois sous le mode unié et indivis, par exemple la connaissance de l'homme en tant que l'homme est un animal pédestre. Car de même que là-haut le pédestre est cause en bloc de tous, Dieux, anges, démons, héros, âmes, animaux, plantes, de tout ce qui est dans la terre, de même là-haut il y a une connaissance une de toutes ces choses réunies ensemble, parce qu'elles constituent un seul genre, mais non une connaissance à part et divisément des choses humaines. Et de même que chez nous, les connaissances plus universelles sont causes de celles qui leur sont subordonnées selon ce que dit Aristote, et surtout les sciences et les connaissances qui ont une plus grande parenté avec la raison, (car elles aboutissent à des conclusions qui ont une plus grande extension) de même chez les Dieux, les pensées supérieures et plus simples anticipent la diversité des secondes. Ainsi donc la connaissance absolument première de l'homme est chez les Dieux, de lui comme être; c'est une connaissance une qui connaît selon une seule union tout l'être comme un ; la deuxième, est de lui comme étant toujours ; cette connaissance embrasse selon une seule cause et sous le mode un, tout le étant toujours: celle qui vient après celle-ci, est la connaissance de lui, comme animal, car elle pense l'animal selon l'union; celle qui vient après, est la connaissance de lui, comme placé sous ce genre déterminé, par exemple, comme pédestre ; car il y a une pensée une qui pense tout ce genre comme un, et c'est dans cette pensée que se produisent d'abord la division et la diversité, accompagnées de la simplicité. Mais cependant même en elle, il n'y a pas la pensée de l'homme seulement. Car ce n'est pas la même chose de concevoir comme quelque chose d'un, tout le genre terrestre et de concevoir l'homme. Ainsi donc, dans les espèces démiurgiques et en général dans les espèces intellectuelles, Il y a une certaine pensée de l'homme comme homme, parce que cette espèce, dans ces ordres (démiurgiques et intellectuels), est distinguée des autres. Il a donc été démontré comment Dieu a la connaissance des choses humaines, comment il est le maître de toutes et en tant que toutes sont divines et en tant qu'elles participent de quelque caractère particulier divin. Mais il me semble que j'ai suffisamment expliqué cette question. Que c'est dans le premier ordre des Idées que sont la maîtrise en soi et la science en soi, cela est évident; car là-haut est la connaissance divine de tout, sous le mode unié, et la puissance qui est maîtresse de tout : l'une, source de toute connaissance, l'autre, cause primordiale de toute maîtrise, qu'elle soit ou dans les Dieux ou dans les genres supérieurs à nous, ou dans les âmes. Et il est probable que par ces mots : « le genre de science » il désigne ici la pensée, voulant désigner ce qui d'elle appréhende ces espèces et ce qui d'elle a la forme de l'unité, et en remontant plus haut, il l'a appelé seulement espèce, en parlant des idées moyennes; car c'est par la connaissance intelligible que sont remplis de la pensée, qui se porte sur les intelligibles, et les diacosmes moyens et toutes les raisons ; et la pensée en ceux-ci est à la pensée qui est en ceux là, dans le même rapport que l'espèce est au genre. Et si en partant de cette science, il est dit qu'elle est « plus exacte », il est évident que cette épithète nous représente son caractère d'être plus semblable à l'un. Car cela est exact, qui enveloppe tout et ne laisse rien en dehors de lui-même. § 90. — « Donc s'il y a quelqu'autre chose qui participe de la science en soi, tu ne saurais dire qu'un autre plutôt que Dieu possède la science la plus exacte?— Nécessairement. » Toutes les raisons divines et tous les ordres des Dieux ont anticipé en eux-mêmes et la connaissance et la cause du tout des choses ; car on ne peut dire ni que les connaissances qu'ils en ont sont languissantes et débiles, parce que dans leur acte de connaître est impliqué l'indéterminé : au contraire ils connaissent tous les biens et nous fournissent tous les biens, et le primairement bon veut faire briller dans les choses secondes la lumière des choses qu'il tire de lui-même et leur fournit. On ne peut dire non plus que leurs productions sont dépourvues de raison et en dehors de la connaissance : car c'est là l'œuvre de la nature et de la vie dernière, non l'œuvre de la production divine qui produit les substances pensantes elles-mêmes. Ainsi donc ils connaissent tout et font tout en même temps ; et avant ces créations, faites selon leur volonté propre, ils ont aussi anticipé la connaissance de tout, et la puissance créatrice de tout. De sorte que par la volonté, par la connaissance, par la puissance, ils président à tout, et par cette triade toutes les choses jouissent de leur action providentielle; ou si tu le préfères, réunissant les choses qui subsistent divisément dans les choses secondes, pour les ramener à la cause divine, peut-être saisiras-tu sur ce point la vérité plus exacte. Ainsi la nature paraît avoir des raisons efficientes et non gnostiques ; l'entendement discursif possède une connaissance qui a en elle même sa fin ; le libre arbitre possède le bien et la volonté du bien. Rassemblant donc toutes ces choses en un, la faculté de vouloir, de connaître, d'effectuer, et ayant conçu avant ces puissances leur hénade divine, remonte et retourne-toi vers le Divin, puisque c'est en lui que toutes ces choses présubsistent ensemble sous le mode de l'unité. Si toutes ces puissances sont possédées par les Dieux, c'est éminemment dans les Intelligibles que parait être la pensée primordiale, la puissance primordiale de la génération de tout, et la bonté primordiale de la volonté. Car en tant que ces puissances viennent immédiatement après la source des biens, elles deviennent, par rapport aux Dieux qui leur sont inférieurs, ce que le Bien est au Tout, imprimant en eux le type de la cause suprême du bien, τὸ ὑπεραίτιον, par la puissance paternelle, le Bien, par sa volonté pleine de bonté, et ce qui est au-dessus de toute connaissance, par la pensée cachée et unifiée. Et c'est pour cette raison, il me semble, qu'ici il nomme pour la première fois les espèces, Dieux, parce qu'il est remonté à leur source primordiale, parce qu'elles ont la forme de l'un, qu'elles sont le plus près du Bien, et parce qu'ainsi elles ont la faculté de connaître et de gouverner tout, en tant que chacune participe de la puissance divine et en tant que toutes sont rattachées et unies aux Dieux. § 91. -- « Dieu serait donc capable de connaître les espèces qui sont chez nous, puisqu'il possède la science en soi? — Pourquoi pas? — C'est que, dit Parménide, nous sommes convenus, mon cher Socrate, que les espèces intelligibles n'ont pas la puissance qu'elles ont, par rapport à celles qui sont chez nous, ni celles qui sont chez nous, par rapport à celles-là, mais qu;) -chacune de ces catégories n'a sa puissance que par rapport à elle-même. — Nous en sommes convenus — ». Comment ces objections, quand il s'agit des espèces intellectuelles, doivent être résolues, il n'est pas besoin de le dire, car Dieu se connaît lui-même. Il est donc évident qu'en tant qu'il est le causant de tout, par son être même il embrasse et contient la cause génératrice de tout. En tant donc qu'il est le causant de tout, en même temps qu'il se connaît lui même et contemple en lui-même les espèces causales primordiales, il connaît aussi tout, selon la notion divine, selon la raison parfaite, et la compréhension une de toul. Et il ne faut pas s'étonner que Dieu qui est par lui-même raison, connaisse les non-intelligibles et les divisibles, quoiqu'il ne soit pas divisible, et les sensibles quoique posé au dessus du monde, et de plus les choses laides et en général le mal ; car ces choses ne sont pas de tous points mauvaises, mais bonnes aussi, et non seulement pour la raison, mais aussi non mauvaises pour le monde. Ainsi par la connaissance une du Bien, il a anticipé en lui-même toutes les choses qui sont bonnes primairement, toutes celles qui le sont secondairement, toutes celles qui le sont purement, et toutes celles qui le sont pour certaines choses et toutes celles qui ne sont aucunement bonnes pour certaines choses, et en un mot toutes les processions des biens. Car de même que par la connaissance une du semblable, il connaît tout ce qui est, sous quelque forme que ce soit, semblable, représenté soit dans les incorporels soit dans le corps, de même en lui, la connaissance une du bien, anticipe, sous le mode de l'unité, toutes les choses dont le bien est, sous quelque rapport que ce soit, le causant. C'est donc nous qui opérons la division de la connaissance et qui examinons sous quel rapport la chose est mauvaise, tandis que, chez Dieu, la connaissance ayant lieu selon la monade du Bien est une, simple, indivisible. Et il en est de même des autres espèces ; étant selon sa propre nature, indivisible, et possédant les causes indivisées des choses divisibles, par la connaissance de ces causes, il anticipe toutes les espèces, même les divisibles. Et il est nécessaire qu'il en soit ainsi : car lequel de ces axiomes supprimerons nous? Est-ce celui que les causes des divisibles sont indivisibles? Mais nous voyons que la monade est la cause des nombres, que la nature qui est incorporelle est la cause des corps, que le point est la cause des grandeurs, et partout que les principes le plus semblables à l'un, communiquent l'hypostase aux plurifiés et à ceux qui ont procédé davantage dans l'étendue. Sera-ce celui-ci, que la raison possède indivisément les causes des divisibles? Mais il a été démontré déjà antérieurement que le démiurge, parce qu'il crée les choses semblables à lui-même, est aussi celui qui leur fournit à toutes le bien être. Est-ce celui-ci : que posséder les causes indivisibles, c'est, en les possédant, les connaître? Et qu'y a t-il d'étonnant que la raison se connaisse elle-même, puisque, même en nous, le vivre intellectuellement est contenu essentiellement dans le se connaître soi-même. Il n'y a donc rien d'irrationnel si la raison connaît indivisément les divisibles et si elle les connaît mieux que la connaissance corrélative et correspondante à son objet. Car connaître par la cause est connaître beaucoup plus exactement que par l'appréhension sans la cause. Je néglige de dire que même les théologiens nous enseignent une sensation intellectuelle, selon laquelle la raison divine gouverne et connaît tout le sensible, dissipant ainsi et écartant loin de nous toutes ces sortes d'objections, qui portent sur ce qu'il connaîtrait sensiblement les sensibles ; car il les connaît en tant qu'ils sont intellectuels; en lui, en effet la sensation est une forme intellectuelle de la vie. Car tout ce qui est dans la raison est intellectuel selon sa propre nature : en effet, dans la raison en acte, il n'y a rien qui soit sans intelligence, sans vie, sans pensée. Ainsi, comme je le disais, il a été répété à plusieurs reprises comment il faut réfuter ces objections, quand il s'agit des espèces intellectuelles. Et puisque Dieu, en se connaissant lui-même le causant de tout ce qui vient après lui, connaît aussi les choses dont il est le causant, en nous appuyant sur cette vérité, nous nous opposerons à Aristote et nous montrerons que la raison, telle qu'il la définit, se sachant elle-même être l'objet désirable à toutes choses, et se sachant elle-même d'une notion déterminée, sait aussi d'une pensée déterminée les choses qui la désirent ; car il est impossible que celui qui connaît d'une connaissance déterminée l'un des deux relatifs ne connaisse pas d'une connaissance déterminée, l'autre. Car celui là, en se connaissant lui-même d'une façon déterminée possédera une connaissance déterminée. Il ne faut donc pas ôter à la raison, qui a la connaissance de tout, la connaissance d'elle-même, par la possession de laquelle elle sait qu'elle est désirable à tous. Rappelons encore une fois comment les raisons de Parménide sont vraies et appliquées à quelle nature d'espèces elles le sont : en effet les espèces intelligibles n'ont pas une connaissance de nos affaires semblable à celle qu'en ont les espèces intellectuelles, c'est-à-dire une connaissance déterminée des choses humaines en tant qu'humaines, par suite, des espèces individuelles, et par suite, des espèces sensibles; mais elles ont une connaissance qui a la forme de l'unité, universelle et monadique, de toutes les choses ensemble, placées sous un seul genre, je veux dire : le genre céleste et aérien, ou le genre aquatique, ou pédestre, le système qui embrasse soit les Dieux, soit les genres supérieurs, soit les mortels, en tant qu'êtres divins, et en tant qu'animaux purement animaux, et en tant qu'inséparables les uns des autres. Ainsi donc la science et la pensée primordiale n'est pas la science particulière et propre des choses qui sont chez nous, (car ces choses sont particulières, ou plutôt encore les plus particulières) . mais la science du tout des choses dans son universalité, de toutes les choses prises dans leur ensemble et sous le mode de l'unité, et qui sont indivisément dans la raison. C'est de ces espèces intelligibles qu'il est vrai de dire « qu'elles n'ont pas de puissance par rapport à nous, ni nous par rapport à elles »; car elles nous sont inconnaissables : leur fondement est placé au-dessus de notre pensée ; elles sont cachées dans le sanctuaire mystérieux du Père, et comme dit le Théologien, connaissables uniquement à l'ordre des Dieux qui vient immédiatement après elles. Et leur puissance est trop haute pour être directement et immédiatement génératrice de nous, hommes : car ce qu'elles créent, c'est des Dieux, comme il a été dit plusieurs fois; elles préside aux Dieux, mais non aux âmes, et c'est des genres et des espèces intellectuelles que deviennent les multitudes des âmes et les processions des hommes et de tous les autres animaux. § 92. — « Ainsi donc, si en Dieu se trouve la maîtrise en soi dans le sens le plus exact, et la science en soi dans le sens le plus exact, ni la maîtrise des dieux ne saurait être maîtresse de nous, ni leur science ne saurait nous connaître, nous ni aucune autre des choses qui sont chez nous ; et de même nous n'avons pas de pouvoir sur eux par le pouvoir qui est en nous, nous ne connaissons rien du divin par notre science. Les dieux, à leur tour et par la même raison, ne sont pas maîtres de nous, ni ne connaissent les affaires humaines, quoi qu'étant dieux. — Mais, dit-il, ce sera une idée par trop étrange, si l'on prive Dieu de la puissance de savoir. » Il a lié ensemble la science à la maîtrise pour poser le fondement et le principe de la démonstration qu'il va faire, à nous et aux autres, à savoir que les dieux connaissent nos affaires, et sont les maîtres de nous, intellectuellement, et par suite qu'ils nous connaissent certainement; car s'ils ne nous connaissent pas, ils ne sont pas nos maîtres : ce qui est la chose la plus absurde du monde. Car les hommes ont très certainement une espèce d'habitude et de plaisir à appeler maîtres, les dieux, lorsqu'ils ont recours à eux dans leurs maladies corporelles, lorsqu'ils invoquent l'aide des dieux dans les situations où ils ne peuvent pas, par leurs actions propres, être les maîtres des résultats, tandis que eux peuvent exercer sur toutes choses également un empire souverain. On conteste encore s'ils connaissent nos affaires et s'ils ont quelque notion des choses humaines : car on admet bien que c'est une surabondance de puissance de commander également sur tout, d'exercer sur tout un pouvoir de domination et que c'est la perfection de la connaissance de connaître les choses parfaites ; car on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il est meilleur de ne pas connaître. On affirme ainsi la maîtrise des dieux, leur pouvoir souverain sur toutes choses ; mais on leur en enlève la connaissance; il est en effet nécessaire de rapporter à la cause divine l'amour que l'âme a pour Dieu et qui lui paraît ce qu'il y a de plus beau en elle. Cela est parfaitement exact ; mais il ne fallait pas se borner a voir les choses procédantes ; il fallait voir encore les causes de tout qui sont en lui , en qui sont unies les unes avec les autres et en quelque sorte semblables, les choses qui ici-bas sont très différentes, très différentes puisque l'œuvre du bien est extrêmement différente, et on ne peut pas dire de combien, de l'œuvre du mal : mais la connaissance, chez les gens qui la possèdent de la vertu et de la méchanceté ne diffère pas sensiblement. Agir par méchanceté n'est pas une bonne chose ; mais connaître la méchanceté est une bonne chose, puisque c'est connaître aussi la vertu ; car la connaissance des contraires est une seule connaissance. Il est donc meilleur pour la raison de connaître tout : car tout ce qu'elle connaît est en elle. Or, il est meilleur pour elle de connaître tout cela, afin qu'elle se connaisse elle-même tout entière. Sans doute pour ceux qui ont le regard fixé sur les choses externes, il y a beaucoup de choses qu'il est meilleur de ne pas connaître ; car ce qui tombe démesurément dans la matière se remplit de la laideur matérielle sur laquelle ils fixent leurs regards; mais pour ceux qui se replient sur eux-mêmes, toutes les choses connaissables ont la même valeur, et la différence porte sur l'universalité de la connaissance et non sur le fait même de connaître ou de ne pas connaître. Maintenant les mots « quoiqu'étant dieux » qu'il ajoute, expriment avec une grande force l'objection ; car tout ce qui est divin est bon, et veut tout remplir de biens. Comment donc pourra-t-il ou ignorer ce qui a lieu chez nous, ou ne pas être maître des choses inférieures à lui, et comment n'exercera-t il pas, selon sa propre puissance, un pouvoir de domination sur les choses dont il est le causant ? comment n'exercera t il pas, selon sa propre puissance son action providentielle? comment n'exercera-t-il pas sa providence selon sa propre connaissance ? Et il me semble que Parménide a ajouté ce mot à la phrase précédente, parce que c'est la chose la plus absurde de toutes de dire que ceux qui sont dieux ignorent nos affaires, dont il sont les maîtres, par la raison profonde que, aux dieux en tant que dieux, il appartient de droit de tout connaître, de penser d'avance les espèces de tout, parce que, en tant qu'espèces, elles sont les causants universels de l'être ; en tant que divines, elles connaissent tout selon l'un qui leur est propre. Car c'est une fonction divine d'être une Providence, et c'est une œuvre intellectuelle de créer les espèces universelles et de les conserver et garder. C'est ainsi que même dans les Lois, il dit que les âmes universelles ont une action providentielle ; mais il ne le prouve qu'en leur donnant une raison divine, parce que la Providence est un attribut propre à Dieu et non à la raison ; car il y a d'autres choses qui participent à la raison ; mais les âmes divines participent à la raison divine. Tout le raisonnement contenu dans l'objection qui précède revient à ceci: Les dieux possèdent la science en soi et la maîtrise en soi; les principes qui possèdent la science en soi et la maîtrise en soi, ne sont pas dits posséder la science et la maîtrise relativement à nous. Donc les dieux n'ont pas, par rapport a nous, ni la science ni la maîtrise; ils ne nous connaissent pas et ne sont pas pour nous des maîtres ; car alors ils posséderaient une science de nous, et nous serions pour eux des objets de science, et ils posséderaient la maîtrise par rapport à nous, qui sommes leurs esclaves : ce qui est la plus absurde des propositions plus haut énoncées. Il a voulu surtout, il me semble, faire connaître clairement la contradiction de nos conceptions vicieuses, qui consiste à donner le nom de Dieu et celui des dieux tantôt aux idées elles-mêmes, tantôt à celui qui possède les Idées ; car ôter la maîtrise ou la connaissance aux Idées purement idées et à la raison qui les possède est absolument vrai, si nous appelons tout et les choses qui subsistent selon les idées et toutes celles qui sont en dehors d'elles; car la raison, en tant que raison, n'est pas capable de connaître tout, mais seulement les choses universelles, et les Idées ne sont pas causes de tout, mais seulement des choses qui sont toujours et sont selon la nature. De sorte qu'appliqué à celles-ci, le raisonnement n'est pas complètement faux, qui leur ôte la connaissance et la maîtrise relativement aux choses humaines, en tant que nous sommes des êtres particuliers, mais non en tant que nous sommes hommes et possédons une seule espèce une. Mais Dieu et les dieux connaissent nécessairement tout, et les choses en soi et les choses particulières, et celles qui sont toujours et celles qui sont parfois ; et ils sont les maîtres de tout, non seulement des choses prises en général, mais même des particulières, puisque la providence chez eux est une et pénètre en toul. Ainsi donc les espèces en tant que dieux et la raison en tant que Dieu, ont la connaissance de tout et la maîtrise de tout, et la raison est Dieu selon l'un, et les espèces (sont dieux) en tant que la lumière issue du bien est en elles. D'après cela donc, étant supérieures en puissance à la cause spécifique, elles créent et produisent la connaissance et la providence de toul. C'est pourquoi le raisonnement qui leur refuse ces attributs, en disant que les dieux ne sont pas les maîtres de nous est plus absurde et en contradiction plus flagrante avec nos notions communes. C'est pour confirmer cela, que Parménide ajoute avec une grande force les mots : « étant dieux ». Car là-haut chacune (des espèces) est plus unifiée à sa propre divinité, tandis que dans le diacosme intellectuel, elles en sont plus séparées selon la mesure différente de leur abaissement. Et Socrate appelle : « bien extraordinaire » le raisonnement qui prive les dieux du savoir. Cependant d'abord il ne fallait pas dire privation, mais excès de connaissance ; car cette connaissance, nous avons dit qu'elle est de beaucoup plus parfaite que les autres. Ensuite, s'il fallait dire privation, il aurait fallu poser la privation de la connaissance de notre activité pratique, et non simplement de la connaissance, et ce n'est pas là non plus la conclusion du raisonnement. Mais il semble en s'appliquant exclusivement aux espèces intellectuelles, ne toucher que très imparfaitement la théorie de Parménide, qui fait remonter l'hypothèse des espèces, des sensibles à la sommité intelligible même, dans laquelle sont d'abord les espèces et le nombre des idées qui est unifié et vu par la lumière qui vient du bien, proposition d'où enfin il peut facilement passer à l'un être et au foyer central des êtres. Il faut en effet, afin de faire connaître toute la série (chaîne) des idées, avant le nombre des idées poser l'hypostase de la cause uniée des êtres, l'être sous son mode latent et semblable à l'un, qui est au dessus de l'espèce, duquel a procédé, dans tous les ordres et les diacosmes du second degré, le nombre des idées qui sont le plus un. Car les espèces absolument premières sont les intelligibles; les deuxièmes sont encore les intelligibles, mais en tant que placées dans les intellectuels ; les troisièmes, sont celles qui embrassent les choses universelles; les quatrièmes, celles dont la fonction est de mener à leur perfection tous les intellectuels et les hypercosmiques; après celles-ci, les espèces intellectuelles et qui possèdent cette même propriété particulière par elle-même; le sixième rang est occupé par les assimilatrices, par lesquelles toutes les choses secondes sont rendues semblables aux espèces intellectuelles; le septième rang est celui des espèces indépendantes, supra célestes, qui ont la puissance de réunir et de rassembler les espèces divisées dans le monde ; les encosmiques sont au dernier rang. Et de ces espèces, les unes sont intellectuelles, les autres psychiques; les autres, physiques ; les autres sensibles ; et de celles-ci, les unes sont immatérielles, les autres matérielles ; c'est jusqu'à celles-ci que va la procession des espèces, partie par en haut des intelligibles, se manifestant pour la première fois à la limite des intelligibles, et se terminant à la limite extrême des sensibles. Maintenant de tous les diacosmes spécifiques, descend nécessairement quelque caractère particulier et propre qui pénètre dans les dernières espèces procédantes jusqu'aux espèces sensibles ; par exemple, des espèces intelligibles vient l'immuabilité ; car elles sont éternelles primairement; de l'ordre absolument premier des intelligibles et intellectuelles, chacune emporte la marque symbolique inconnaissable de ses paradigmes propres, selon que chacune a reçu dans son lot un caractère particulier divin; de l'ordre moyen vient le caractère que, chacune étant un tout contient dans la totalité la pluralité de ses propres parties; du troisième diacosme, la propriété que toutes les espèces complètent et parfont l'être antérieurement en puissance; de celles qui sont dans les intellectuels, la propriété d'être divisées selon tous les nombres, et de diviser ainsi ce qui participe d'elles; de celles qui appartiennent aux hypercosmiques, la propriété d'être assimilées chacune à son paradigme propre ; de celles qui sont à la fois hypercosmiques et encosmiques, la propriété de pouvoir rassembler les choses individuelles pluriflées dans les communautés auxquelles chacune appartient; des encosmiques, la propriété de n'être pas séparables de la nature qui leur sert de substrat et celle d'achever, avec cette nature, la génération des composés ; car il faut que de chacune, une certaine propriété particulière d'entre toutes, vienne et pénètre dans les espèces qui sont dans le sensible, et y sont les limites extrêmes de la série spécifique. Et l'on ne trouvera, c'est ma conviction, rien autre chose à dire de sensé sur ce sujet que ce que nous en avons dit: — que toutes les espèces sensibles ont besoin d'une autre assise et d'un réceptacle ; — que toutes sont dans les plusieurs leurs participants, et que si elles sont éternelles, c'est que les participants, par rapport à l'acte de participer primairement, ont le rang des choses qui viennent d'un et vont a un, que toutes subsistent par une ressemblance avec les espèces séparables et ont leur hypostase selon cette ressemblance même : — que toutes les espèces indivisibles sont celles après lesquelles il n'y a plus que l'espèce réellement indivisible, qui procède dans la division extrême et du dernier degré, dans la division matérielle ; — que toute espèce constitue un plein achèvement de la nature qui lui sert de substrat et était en puissance, et qu'elle amène à l'acte par sa présence ; — que toute espèce est un tout, qui a reçu en lui même l'influence de l'un qui l'a modifié, mais n'est pas l'un même, mais possède une pluralité de substances et de puissances; — que toute espèce a quelque marque caractéristique divine absolument inconnaissable: c'est pourquoi chacune a un rang différent dans le tout, un lieu et une période de développement différents selon son nombre propre et sa forme propre; car chacune a été répartie dans ce rang, ce lieu, cette période par la démiurgie, selon une certaine parenté secrète avec les dieux; — que toute espèce est toujours de la même manière dans le monde et n'a fait jamais défaut au tout ; mais que, quoiqu'elle ait son hypostase dans les choses qui deviennent, cette hypostase est inengendrée. Voilà ce qu'on dit habituellement de ces espèces qui contribuent ou sont nécessaires au plein achèvement du monde, attributs qui leur sont communiqués par tous les diacosmes spécifiques, comme je l'ai dit, et nous ne trouverons pas, à leur sujet quelqu'autre chose qui ait été dite par ceux qui ont étudié cette nature. De sorte qu'il est rationnel que nous ramenions chacune à son propre principe, en remontant d'en bas jusqu'aux principes absolument premiers. Tels sont donc les rangs des espèces, à en parler d'une manière générale; dans chacune d'elles, en haut, se place la totalité intelligible et la monade de l'être; — en bas, le premier substrat, qui est l'image de cette totalité, et ce qui est au dernier degré de tout, ce qu'on appelle le simulacre de l'être. § 93. « — Voilà, mon cher Socrate, dit Parménide,avec un grand nombre d'autres encore, les caractères que doivent nécessairement posséder les espèces si elles sont vraiment les idées des êtres et si on définit chaque espèce comme une certaine chose en soi. » Avec un art admirable, par les apories qu'il a présentées, Parménide ramenant la discussion des choses sensibles à la première manifestation des espèces, et sous le prétexte de formuler des instances, en démontrant les nombreuses classes et descendant plus profondément au fond des choses et exposant l'ordre de chacune, persuade à la fin, par des arguments nécessaires, Socrate de ne pas se laisser entraîner trop facilement ni sans examen sévère à l'hypothèse des Idées, mais de se frayer un chemin par un long exercice pratique de la dialectique, afin d'être capable de résoudre toutes les objections présentées et toutes celles qu'on pourra présenter à ce sujet, et d'établir la vérité vraie sur cette théorie. Et merveilleuse aussi est l'habileté avec laquelle il admet dans sa discussion tous les arguments des objections, lieux topiques dont se sont servis après lui certains philosophes, qui ont essayé de ruiner l'hypothèse des Idées ; car si l'on veut en faire un examen sérieux, on distinguera celles qui concernent ce qu'il y a de commun dans les choses individuelles, celles qui se rapportent aux notions dérivées, (ὑστερογεγενεῖς, post rem), celles qui s'arrêtent aux raisons psychiques, celles qu'on place dans la raison, mais en les faisant mortes et immobiles, parce qu'elles ne possèdent pas la puissance efficace de créer et d'assimiler à elles-mêmes les choses qui deviennent par elles mêmes : de sorte que j'admire ceux qui croient dire toujours quelque chose de nouveau dans leurs objections contre cette opinion, tandis que Platon n'a laissé de côté aucun des arguments qui peuvent contribuer à constituer une objection à lui-même. Mais sur ce point, ceci est suffisant. D'après le texte, Parménide indique qu'on peut trouver encore d'autres objections qui auraient leur point de départ dans celles qui ont été déjà faites ; car les mots : « encore outre celles-ci » montrent la facilité qu'auraient les douteurs sceptiques à en tirer de nouvelles. Il montre aussi que les raisons qui ont l'apparence d'objections sont, sous un autre aspect, des vérités. Car il est nécessaire, dit-il, que les espèces aient tous les caractères. que nous avons dit qu'elles ont : et l'inconnaissable, et de ne rien connaître de nos affaires et en un mot qu'il y ait un rapport de convenance de toutes les propriétés susdites avec un certain ordre des espèces ; car il n'y a rien de surprenant que ce qui est vrai appliqué à l'une d'o'!»«. soit faux si on l'étend à d'autres. Non seulement donc le texte expose les apories (car s'il avait voulu montrer cela seulement, il aurait dit qu'il était nécessaire d'entendre cela des espèces) ; mais il fait voir, dans toutes ces apories, la vérité cachée sur les espèces. Car nécessairement les espèces ont pour caractères, non l'absurde, mais le vrai. Et en disant : « si elles sont réellement (αὐταί) les idées des êtres » ce ne sont pas les choses sensibles qu'il appelle des êtres, comme s'il disait qu'il y a des idées de ces choses (sensibles), mais il veut montrer ceci, que les Idées ont rang parmi les êtres, et ne sont pas seulement des mots appliqués à des concepts vides de réalité. En s'exprimant ainsi il a donc bien fait voir que pour ceux qui font des espèces, des choses postérieurement produites (ὑστερογενῆ , ou les placent dans les sensibles, ces absurdités n'en résultent pas et que ce sont ceux qui comptent les idées dans le nombre des choses réellement existantes, pour lesquels il est difficile de soutenir et de faire accepter leur thèse. Et en ajoutant la proposition : « Si l'on définit chaque espèce comme une certaine chose en soi, αὔτό τι, il nous a fait clairement voir en quoi diffèrent ceux qui affirment l'existence des Idées et ceux qui posent qu'elles ne sont pas. Car les uns disent que la raison est avant le monde et la nomment Dieu, mais nient qu'il y ait des Idées - : ils n'admettent pas que cette Raison possède les causes déterminées et distinctes des choses encosmiques, de l'homme et du cheval et du lion, et de toutes les autres espèces qui sont dans les choses mortelles. Voilà donc en quoi diffèrent ceux qui nient et ceux qui affirment l'existence des Idées, à savoir, que les uns conservent les causes distinctes, les causes intellectuelles, immobiles et divines, les autres soutiennent qu'il n'y a qu'une seule cause une, implurifiée et immobile en tant que désirable, rattachant et liant à la raison ce que nous, nous disons de la cause fondée au-dessus de la raison et du monde intelligible, lui tant qu'ils ont conçu cette cause comme première, ils ont raison : car il ne faut pas que les êtres soient mal gouvernés, ni que le principe des êtres soit la pluralité :il faut que ce soit l'un. Mais en tant qu'ils conçoivent comme identiques la raison et l'un, ils ont tort. Ainsi donc le caractère le plus particulier de la cause spécifique, c'est la distinction selon les pluralités des êtres, et par suite, même dans les principes, où se trouve l'être à l'état latent et indistingué, l'espèce n'est pas encore ; où apparaît d'abord la distinction, là se montrent les premières des espèces, par exemple : toutes les célestes forment toutes une seule espèce, et les pédestres, une autre, différente; où la distinction est plus grande, là président et commandent aux plus particulières certaines causes déterminées paradigmatiques propres, et là où la procession du diacosme spécifique arrive à sa fin, les dernères des espèces créatrices, c'est-à-dire les parties et les accidents, ont là leurs causes distinctes et distinguées : caries raisons, dans la nature, de l'œil, du pied, du cœur, du doigt ont des causes déterminées et distinctes : de sorte qu'eu haut sont les causes les plus, générales, en bas celles des parties; au milieu, les causes disposées d'après des rapports proportionnels. Car les intellectuels ne sont pas divisés de la même manière que les principes assimilateurs ; ni ceux-ci comme les indépendants; mais en tant qu'intermédiaires entre les choses sensibles et les intellectuelles, ils sont plus divisés que celles-ci, plus unifiés que celles là, plus universels que les sensibles, plus particuliers que les intellectuelles. Ainsi donc la phrase :« si l'on vient à déterminer », comme nous l'avons dit, signifie la même chose que : si l'on vient à poser des causes distinctes, et non la même chose, que : si l'on vient à poser des définitions. Le texte indique que les principes intelligibles créent plus de divisions que ceux d'ici-bas, et c'est là la marque particulière et propre de la théorie des Idées. Quant au mot : « chacune par elle-même », il a été dit plusieurs fois qu'il exprime l'immatérialité et la pureté des Idées ; car chaque chose en soi, αὐτὸ ἕκαστον, est celle qui n'appartient qu'à elle-même, qui n'est pas quelque chose d'une autre, qui n'a pas ce qu'on appelle un surnom étranger. Quant au « quelque, τί, » qu'on y ajoute, il signifie le caractère monadique (de l'espèce), ce qui en préexiste et fait fonction de principe. Car le « quelque, τί » n'est pas ajouté comme appliqué aux espèces matérielles et individuelles, (mais c'est le symbole de l'unité et de la limite, et en tant que l'espèce est particulière, si on la compare à l'un être en soi, on a raison d'ajouter « quelque » à son nom .) § 94. — « De sorte que l'auditeur conteste, et dans le doute, est porté à croire qu'il n'y a pas d'idées et que si elles existaient, ce serait une nécessité absolue qu'elles fussent inconnaissables à la nature humaine. » Ceci encore est d'un art admirable, et dit par égard à la nature humaine. Car l'esprit le plus élevé et le plus versé dans la science, ne saurait se dépouiller absolument de toute dualité, quand il s'agit de la science des choses divines ; la raison est la seule qui connaisse, sans éprouver de difficultés, les intelligibles ; mais notre ordre s'écarte de la nature vraie de son ordre, dans la mesure où il est plus dépourvu de la connaissance intellectuelle. - De sorte que le plus incomplet des hommes, le plus fils de la terre est celui qui n'a pas la notion de la cause spécifique. Car que regarde-t-on en pensée, quand on qualifie le phénomène comme infini ment changeant et divers, si l'on n'a pas en soi-même une anticipation exacte et vraie de la substance réellement substance. Entre ces deux extrêmes, se placent, celui qui conteste, celui qui doute, et celui qui nie. Celui qui conteste, ὁ ἀπορῶν, porte plutôt son esprit sur l'existence des espèces (qu'il conteste), mais considère les raisons contraires (en tient compte) ; celui qui doute, est entraîné avec une force égale vers les deux opposés, par les arguments pour ou contre l'existence ; celui qui nie est plutôt porté vers la non existence, mais au fond de son esprit, mu par une pensée que rien n'a pu altérer, il se dit tout bas qu'elles sont ; et s'il en supprime l'hyparxis, c'est parce que l'oubli a répandu un nuage sur cette pensée. Si elles ne sont pas, elles ne sont pas, et si elles sont et si elles nous sont inconnaissables, celui qui en affirme la connaissance n'est pas digne d'être cru ; car celui qui soutient l'existence de choses qu'il ne connaît pas réfute sa propre opinion. Vois donc comment il reconnaît la force des objections présentées, et comment il nous invite encore à en chercher la solution. Car nous aussi nous avons lieu de craindre de tomber dans cet état qui, dit il, est celui de ceux qui entendent les arguments contraires, et d'arriver, soit en contestant l'existence soit en en doutant, à supprimer complètement cette hypothèse, puisque si les Idées sont, leur existence nous est inutile, puisque nous ne la connaissons pas en soi. Enfin, il a été démontré que tout cela est vrai et que s'il se trouve là quelqu'erreur, on peut facilement et parfaitement y remédier. § 95. — « Et en s'exprimant ainsi il me parait qu'il dira des choses raisonnables, et il est étonnant combien son raisonnement sera difficile à réfuter. » Il a été dit plus haut en termes parfaitement clairs que celui qui n'aborde pas l'examen de ces questions avec une puissance et une préparation suffisantes ne fera que rendre plus probable l'opinion de celui qui prouve par des arguments nécessitants que les espèces sont inconnaissables, plus probable que celle de celui qui tente de soutenir qu'elles sont. Car en toute chose, le semblable tend par nature à aller vers son semblable ; ce qui est pour nos yeux obscur et ténébreux, mais clair pour la philosophie, ne saurait être conçu et compris par des âmes imparfaites, mais par celles-là seulement qui, par la perfection de leur nature, par leur application supérieure, par leur ardeur, se sont donné à elles mêmes une puissance qui est à la hauteur de l'examen de ces questions. Car il n'est pas possible que la recherche spéculative des intelligibles se produise dans des états d'âme qui lui sont étrangers, ni qu'à ceux qui n'ont pas une raison purifiée apparaissent et se manifestent clairement les Idées, qui ont leur hyparxis et leur siège dans la raison pure, puisqu'en toute chose le semblable est appréhendé par le semblable. § 96. — « Et qu'il n'appartient qu'à un homme doué d'un très grand esprit, d'apprendre (d'un autre) qu'il y a un certain genre pour chaque chose, et une substance existant par elle-même, et qu'à un génie plus merveilleux encore, de découvrir et de pouvoir enseigner toutes ces doctrines à un autre qui les aurait profondément examinées et analysées lui-même. » Par ces mots il nous enseigne encore une fois quel est l'auditeur le plus et le mieux en rapport avec ces questions : car il n'écrit pas en vain le mot « homme, ἀνδρά», mais pour indiquer qu'il est semblable (à son sujet) par l'espèce de sa vie, et montrer la grandeur comme la hauteur de ces problèmes. Car à celui qui veut concevoir les dieux, il importe de n'avoir aucune pensée basse ou petite. En l'appelant « doué d'un très beau génie » il le désigne comme pourvu de toutes les supériorités d'une nature de philosophe, et ayant reçu de la nature de nombreuses ressources pour arriver à la conception intellectuelle des choses divines. Ensuite il rappelle encore ce que doit être celui qui est le guide dans la science de ces choses, que ce doit être un esprit fécond et inventif dans l'art d'enseigner. Car il y a des esprits qui ne font do progrès dans la science que dans la mesure qui leur suffit à eux-mêmes ; d'autres qui sont capables de réveiller chez les autres le sou venir des notions vraies des choses : c'est pourquoi il appelle celui-ci un génie encore plus admirable. L'un a de l'analogie avec Poros ; l'autre qui apprend, avec Pénia, et entre les deux est Éros qui réunit et lie le plus parfait au plus imparfait. Enfin pour terminer, il nous explique quelle est la lin de l'enseignement, à savoir qu'il faut que celui qui apprend et qui reçoit d'un autre la science ait profondément examiné et distingué les genres des êtres, et ait vu complètement les causes distinctes et séparées des choses, d'où elles tirent leur principes, combien il y en a de classes, comment elles existent dans chaque ordre d'êtres, comment elles sont participées, comment elles anticipent toutes les choses, et en un mot qu'il ait étudié chacune des questions dans lesquelles nous avons plus haut divisé tout le problème. En voilà suffisamment sur ce point.
En ce qui concerne le
texte, le mot : après les avoir examinées à fond, et nettement déterminées,
exprime l'appréhension de chacune de ces questions, pure et sans confusion ; car
la parfaite distinction, εὐκρίνεια, est une sorte d'évidence qui définit la
nature particulière de chaque chose. Le mot « un certain genre, γένος τι, de
chacune » exprime la cause primordiale de chaque série, cause préexistante dans
les choses divines; car l'espèce, par rapport à quelqu'autre chose individuelle,
en tant qu'espèce en elles, est genre, parce qu'elle est plus universelle que
les espèces sensibles et embrasse des choses qui ne sont pas parfaitement de
même espèce les unes que les autres; car comment l'homme terrestre serait-il de
même espèce que celui qui a reçu du sort son hypostase dans le ciel ou dans un
autre élément. |