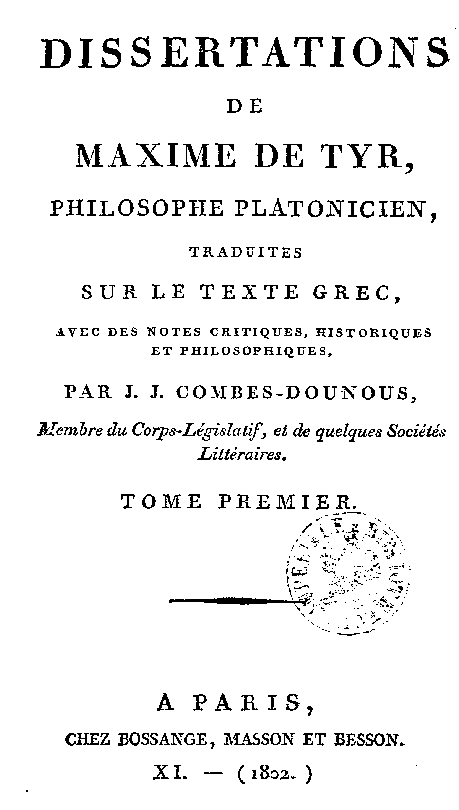|
MAXIME DE TYR
DISSERTATIONS
DISSERTATION X. Quels sont ceux qui ont eu les idées les plus saines touchant les dieux, des poètes ou des philosophes. Il est étonnant qu'il y ait conflit d'opinion entre les hommes, non seulement en matière de principes politiques, non seulement en matière de formes de gouvernement, et des inconvénients attachés aux uns et aux autres (1), mais encore sur les choses qui en. devaient être les plus éloignées du monde, la poésie et la. philosophie. Ces deux choses, diverses quant à la dénomination, n'en forment qu'une seule quant à l'essence, et n'ont entre elles aucune différence réelle. C'est tout comme si l'on disait que le jour est autre chose que la lumière du soleil qui éclaire la terre, ou que la lumière du soleil qui éclaire la terre est autre chose que le jour. Il en est ainsi de la poésie et de la philosophie. Car qu'est-ce que la poésie, sinon la philosophie, antique sous le rapport de l'origine, harmonique sous le rapport de la mesure, allégorique sous le rapport du fond des choses ? Qu'est-ce aussi que la philosophie, sinon la poésie plus récente sous le rapport de l'origine, plus régulière (2) sous le rapport de la mesure, et plus à découvert pour le fond des choses? La poésie et la philosophie n'étant donc différentes que par rapport à l'époque de leur origine, et à leur forme respective, quelle autre différence y chercherait-on, car d'ailleurs les uns et les autres parlent des dieux, les poètes et les philosophes. II. Se livrer à l'examen d'une pareille question, ce serait comme si, comparant la médecine de l'antiquité à celle qui se pratique aujourd'hui dans le traitement des maladies, on recherchait ce qu'elles ont l'une et l'autre de pis et de mieux. Esculape nous répondrait (3) : « Le temps ne change rien dans les autres arts. Leur emploi est perpétuellement identique. Ils produisent des ouvrages toujours à peu près de même nature. Mais la médecine doit s'adapter à la constitution des corps, chose qui n'a ni assiette fixe ni uniformité, mais qui varie, qui se diversifie, selon la nature des aliments, et le genre de vie, et par conséquent approprier ses médicaments et ses régimes aux diverses données qui se présentent. Ne pensez donc pas que mes successeurs (4), l'illustre Machaon et le célèbre Podalyre, fussent moins habiles dans l'art de guérir, que ceux qui se sont adonnés dans les temps modernes à la même profession, et qui ont introduit avec succès la variété des remèdes. Seulement, alors, la médecine n'ayant affaire qu'à des corps, uniformément, identiquement constitués et qui ne s'abandonnaient point à toute sorte de dissolution, leur administrait ses secours avec plus de facilité. Tout se bornait pour elle à une opération fort simple, à arracher le fer des blessures, et à appliquer les plus doux topiques (5). Mais aujourd'hui que les corps out dégénéré, qu'on a mis beaucoup de variété dans la manière de vivre, et produit une mauvaise complexité dans les humeurs, la médecine a dû varier elle-même, et passer de son antique simplicité à la diversité des modifications qui en ont pris la place ». III. Voyons que le poète et le philosophe nous répondent, chacun de son côté, sur l'objet de son travail, dans le même sens qu'Esculape (6). Le premier souffrira d'abord très impatiemment que l'on regarde Homère, ou Hésiode, ou Orphée, ou tout autre poète de ce temps-là, comme moins éclairé des lumières de la sagesse, qu'Aristote de Stagyre, que Chrysippe de la Cilicie, que Clitomaque de la Libye, ou tout autre de ceux qui ont les premiers dit ou écrit de si belles choses sur la philosophie; et il trouvera mauvais qu'on ne pense pas que les premiers étaient au moins aussi habiles sous ce rapport, s'ils ne l'étaient davantage. De même qu'en ce qui concerne le corps humain, la manière dont il était constitué anciennement, à l'aide d'un régime sainement ordonné, le rendait très facile à être traité par les gens de l'art, au lieu qu'aujourd'hui les méthodes compliquées sont devenues nécessaires; de même dans les temps antiques, l'âme encore en possession de sa simplicité native, et de ce qu'on appelle son goût inné pour les bonnes mœurs (7), avait besoin d'une philosophie en quelque façon musicale, pleine de douceur, qui la gouvernât, qui la dirigeât à la faveur des fictions, de la même manière que les nourrices forment l'esprit de leurs nourrissons avec les fables qu'elles leur content. Mais à mesure que l'âme a fait des progrès, qu'elle a acquis de la vigueur, que l'incrédulité et les vices se sont emparés d'elle, qu'elle a cherché à pénétrer les fictions, qu'elle n'a plus voulu se payer d'énigmes, elle a mis la philosophie à découvert, elle l'a dépouillée de toutes ses brillantes enveloppes, elle a mis de la nudité dans son langage. Ce dernier ne diffère de celui d'autrefois que par les formes harmoniques; mais les opinions touchant les dieux, dont l'origine remonte à l'antiquité la plus reculée, sont communes à rune et l'antre philosophie. IV. À l'exception d'Épicure, que je ne range ni parmi les poètes, ni parmi les philosophes, les autres avaient le même objet et tendaient au même but. Si ce n'est qu'on ne croira pas peut-être qu'Homère ait vu les dieux lancer des flèches, dialoguer entre eux, se livrer aux plaisirs de la table (8), ou faire toutes autres choses de cette nature, dont il parle dans ses poèmes. On ne pensera pas davantage que Platon ait vu Jupiter tenir les rênes d'un char ailé (9) sur lequel il était porté, ni l'armée des dieux distribuée en onze phalanges, ni les dieux célébrant par de splendides festins les noces (10) de Vénus dans le palais de Jupiter, lorsque le dieu qui fait venir l’Argent (11) s'approcha clandestinement de la Pauvreté, et lui fit engendrer l'Amour. On n'admettra pas non plus, qu'il ait contemplé de ses propres yeux, ni le Pyriphlégéthon (12), ni l'Achéron, ni le Cocyte, ni les fleuves qui roulent sens dessous dessus des torrents d'eau et de feu. On ne s'imaginera pas, enfin, qu'il ait vu Clotho et Atropos, ni le fuseau roulant, ni les sept révolutions en sens inverse du Peson (13). Qu'on jette les yeux, d'un autre côté, sur la Théogonie de Phérécyde (14), poète Syrien, et qu'on voie ce qu'il dit de son Jupiter, de sa Chthonie, de son Amour, qu'il place entre l'un et l'autre, de sa naissance d'Ophionée, de sa guerre des dieux, de son arbre, de son voile de femme. Héraclite n'a-t-il pas aussi ses dieux mortels, et ses hommes immortels ? V. Tout est plein d'énigmes et d'allégories chez les poètes, et chez les philosophes; et j'aime bien mieux le respect qu'ils ont montré pour la vérité en l'enveloppant, que l'état de nudité dans lequel elle a été présentée par les modernes. Car la faiblesse humaine ne permet point de contempler les choses sous l'évidence de la réalité; et alors les mythes (15) en sont les emblèmes les plus décents. Si d'ailleurs les modernes ont étendu les lumières de leurs prédécesseurs, c'est un bonheur dont il faut les féliciter. Mais, si sans rien ajouter sous ce rapport, ils n'ont fait qu'écarter les voiles, et donner le mot des énigmes, je crains qu'on n'ait le droit de leur reprocher d'avoir indiscrètement révélé le secret des choses (16). Car à quoi d'ailleurs seraient bons les mythes, s'ils n'étaient des discours destinés à cacher une vérité sous des ornements étrangers, semblables aux représentations, aux images des dieux, que les prêtres entourent d'incrustations d'or, d'argent, qu'ils couvrent de vêtements magnifiques, pour en accroître la majesté ? L'âme de l'homme est constituée de manière qu'elle contemple avec une sorte d'arrogance les choses qui sont à sa portée, et qu'elle en fait peu de cas ; tandis qu'elle attache du merveilleux à tout ce qu'elle ne peut atteindre. Guidée par la conjecture vers ce qu'elle ne voit point, elle cherche, à l'aide du raisonnement, d'en acquérir la connaissance. Si elle éprouve des difficultés, elle fait des efforts pour les vaincre; et lorsqu'elle est parvenue à apprendre ce qu'elle voulait savoir, elle n'y attache pas plus d'intérêt qu'aux choses qui sont l'objet de ses fonctions les plus naturelles. VI. Les poètes, qui connaissaient cette manière d'être de l'âme, inventèrent ce moyen de l'entretenir des choses qui appartiennent aux dieux, le langage des mythes, moins clair que celui du discours ordinaire, moins obscur que celui des énigmes, et tenant le milieu entre la science et l'ignorance; déterminant la crédulité par les charmes de sa contexture, et la repoussant par ses paradoxes ; inspirant à l'âme l'amour de la recherche de la vérité, et le désir de faire constamment vers elle de nouveaux progrès. On fut longtemps à s'apercevoir (17), que ces hommes, en s'emparant de nos oreilles par les agréments de leurs ouvrages, philosophes en réalité, et poètes de nom, avaient mis à la place d'une chose qui aurait été mal accueillie, une invention agréable à la multitude. Car le nom de philosophe est lourd et mal sonnant aux oreilles du vulgaire; c'est ainsi que le pauvre ne voit point avec plaisir le spectacle de l'opulence, ni le libertin le tableau de la tempérance, ni le lâche le modèle du courage. Les vices n'aiment pas davantage de voir les vertus se complaire dans leur propre mérite, et s'enorgueillir d'amour-propre. Au lieu que le nom de poète est doux à entendre. Le peuple aime ce nom-là. Il l'aime par l'idée du plaisir qu'il en attend, sans se douter de sa puissance. Semblable à ces médecins, qui, voyant des malades avoir un grand dégoût pour les remèdes, administrent les drogues amères enveloppées dans des choses d'une saveur agréable, et dissimulent ainsi ce qui rebuterait dans le médicament destiné à produire un effet salutaire; l'ancienne philosophie déposa la substance de sa doctrine dans des mythes, dans des vers, dans des hymnes, et l'on ne se douta point de la tournure qu'elle avait prise pour s'insinuer dans l'esprit des hommes et les diriger, en masquant ce qui aurait repoussé sous un appareil didactique. VII. Qu'on ne demande donc pas quels sont ceux qui ont le mieux pensé des dieux, des poètes ou des philosophes. Qu'on laisse plutôt la concorde et la bonne intelligence régner entre les ouvrages des uns. et des autres ; et qu'on les considère comme n'ayant qu'une fin unique et un même objet. Nommer un poète, c'est parler d'un philosophe; nommer un philosophe, c'est parler d'un poète. On donne également le nom d'intrépide guerrier, et à Achille armé d'un bouclier d'or, chef-d'œuvre de l'art, et à Ajax qui ne portait qu'un bouclier de cuir. Le courage donne aux exploits de l'un et de l'autre le même caractère de grandeur et d'éclat, sans nul égard à ce qui fait la matière des armures. Que dans la question qui nous occupe (18), on assimile donc les formes métriques et musicales à l'or du bouclier d'Achille, et le discours simple et naturel au cuir du bouclier d'Ajax. Mais, laissant de côté l'or et le cuir, qu'on ne considère que le mérite de celui qui est dans l'arène. Qu'il s'agisse de la vérité, et alors que ce soit un poète qui parle, qu'il emploie le langage des mythes, qu'il l'embellisse des agréments de la musique, je m'attacherai à ses énigmes, je m'efforcerai d'en pénétrer le sens, et le charme des formes ne m'en imposera point. Qu'il soit question de la vérité, et alors que ce soit un philosophe qui nous la présente tout bonnement et sans enveloppe, je ne me plaindrai point de la facilité qu'il me donne de l'entendre. Mais si ni l'un ni l'autre, ni le poète ni le philosophe, ne m'offrent la vérité, les vers du premier ne sont à mes yeux que de grossières rapsodies; et les beaux discours du second, que des mythes. Car, si l'on ôte la vérité, on n'aura pas plus de confiance dans les mythes du poète que dans les dissertations du philosophe. VIII. En effet, Épicure traite à la vérité les matières de la philosophie; mais c'est dans un langage encore plus inconcevable que celui des mythes. Si bien que j'aime mieux en croire Homère, lorsqu'il nous dit de Jupiter, qu'il pesait dans une balance d'or les âmes de deux vaillants guerriers (19), « celle d'Achille, et celle d'Hector, dont le bras faisait tant de carnage (20) » : et qu'il tenait le fléau de la balance de la main droite. Car la main de Jupiter est à mes yeux l'emblème du signe de tète, du Dieu qui règle la destinée des mortels : « Ce signe de tête irrévocable, qui ne trompe jamais, qui ne reste jamais sans être accompli, lorsqu'il a été une fois donné (21) ». Je sens qu'il s'agit là de la volonté de Jupiter, de cette volonté suprême, qui maintient la terre dans son immobilité (22), qui retient la mer dans ses limites, qui fait circuler l'air, monter le feu, rouler le firmament, produire les animaux, végéter les plantes. La vertu même des hommes et leur félicité sont l'ouvrage de la volonté de Jupiter (23). J'entends aussi ce que c'est que Minerve, qui, tantôt vient auprès d'Achille, calme sa colère et se tient derrière lui; tantôt est à côté d'Ulysse, « au milieu de tous ses dangers (24) ». J'entends aussi ce que c'est qu'Apollon, ce Dieu qui lance des flèches, et qui préside à la musique. Je l'aime sous ce dernier rapport, je le redoute sous le premier. D'un autre côté, Neptune ébranle la terre de son trident, Mars range ses escadrons en bataille, Vulcain fait retentir les enclumes. Mais ce n'est point pour Achille seul qu'il met tout en mouvement dans son ardent atelier. Tel est le langage des poètes, tel est le langage des philosophes. Transposez les noms, et vous verrez qu'ils vous disent les uns et les autres la même chose, et vous trouverez que leur doctrine est semblable. Entendez par Jupiter, cette intelligence qui est la plus ancienne de toutes, à laquelle toutes les autres doivent leur origine, à l'empire de laquelle tout ce qui existe est soumis ; par Minerve, entendez la prudence ; par Apollon, le soleil ; par Neptune, les vents qui se promènent sur mer et sur terre, et qui les maintiennent l'une et l'autre dans une mutuelle harmonie, dans un réciproque équilibre. IX. Si l'on dirige son attention sur d'autres objets, on trouvera que tout est affaire de noms chez les poètes, et que tout consiste en discours chez les philosophes. Mais, ce que débite Épicure, à quel genre de mythe le comparerons-nous ? Où est le poète dont le langage soit aussi futile, aussi décousu, et aussi étranger aux idées relatives à la connaissance des dieux? L'Être immortel n'a rien et faire de son chef, pas plus qu'il ne donne affaire ci un autre (25). Que veut dire un semblable mythe ? Quelle idée nous ferons-nous de Jupiter ? Quelles imaginerons-nous que sont ses actions, ses volontés, ses jouissances ? Sans doute chez Homère il boit, mais il fait aussi des harangues; il tient des conseils pour régler les choses humaines, comme en tient le grand Roi (26) pour administrer les affaires de l'Asie, comme les Athéniens tiennent leurs comices pour la conduite des affaires de la Grèce. Car les délibérations du grand Roi régissent l'Asie, celles du Peuple d'Athènes régissent la Grèce, celles du pilote régissent le vaisseau, celles du général régissent l'armée, celles du législateur régissent la Cité, celles de l'agriculteur régissent ses propriétés, celles du chef de famille régissent sa maison; et pour le salut du vaisseau, de l'armée, de la Cité, des propriétés, de la maison, le pilote, le général, le législateur, l'agriculteur, le père de famille, ont des soins à prendre. Et du ciel, de la terre, de la mer, et des autres parties du monde, dites-nous donc, Épicure, qui s'en occupe ? Où sont le pilote, le général, le législateur, l'agriculteur, le père de famille ? Mais Sardanapale lui-même n'était pas sans avoir quelque chose à faire. Quoique les portes de son palais fussent constamment fermées, quoiqu'il fût toujours étendu sur des lits magnifiques, et entouré d'un sérail, il s'occupait néanmoins des moyens de sauver Ninive, et de faire le bonheur des Assyriens. Et, à vous en croire, Jupiter sera plus inertement enfoncé dans les voluptés que le fameux Sardanapale ! Ô l'incroyable conte que vous nous faites là, et auquel ne se prêteront jamais les charmes de l'harmonie poétique ! DISSERTATION XI. S'il faut adresser des prières aux dieux (27). UN Phrygien qui vivait dans l'oisiveté (28), et qui aimait beaucoup l'or, prit un jour, suivant ce que la fable raconte, un Satyre (29), espèce de dieu, qui aime beaucoup le vin. Pour le prendre, il avait jeté une quantité de cette liqueur dans la fontaine où ce dieu venait boire quand il avait soif. L'insensé Phrygien pria le dieu son prisonnier, et lui adressa un vœu tel qu'il était probable qu'il le formerait; un vœu, qui était d'ailleurs de nature à être accompli par le dieu, savoir, que toutes les campagnes de ses États fussent convertis en or, que les arbres, que les guérets, que les prés et les fleurs dont ils étaient émaillés, que tout devînt or. Le Satyre lui accorda ce qu'il demandait. Mais le territoire de la Phrygie n'eut pas été plutôt changé en or, que les peuples furent en proie à la famine. Midas alors pleura sur ses richesses. Il chanta la palinodie de son vœu. Il supplia, non plus le Satyre, mais les dieux et les déesses du premier ordre, de lui rendre son ancienne médiocrité, de rétablir la fécondité de ses campagnes, et d'envoyer son or à ses ennemis. C'est là ce qu'il demandait aux dieux en les implorant. Mais il n'en était pas plus exaucé (30). Je loue cette fable sous le rapport de son agrément, et sous celui de la vérité morale où elle conduit. Car quel autre emblème nous présente-t-elle, sinon celui de la démence d'un homme qui demande aux dieux une chose qui ne peut lui être bonne à rien, et qui croyant demander ce qui doit faire son bonheur, se repent de l'avoir demandé, aussitôt qu'il l'a obtenu. Quand la fable parle de la prise du Satyre, des liens dont il fui chargé, du vin qui servit à le prendre, elle fait allusion aux stratagèmes, aux moyens violents que mettent en oeuvre, pour satisfaire leurs désirs, pour remplir leurs vœux, ceux qui n'y sont pas plutôt parvenus, qu'ils se hâtent de vouloir rendre aux dieux les dons qu'ils ne veulent point garder. Car les dieux ne nous dispensent rien de ce qui ne nous est pas bon. Les dons de cette nature nous viennent de la fortune. Ce sont des dons que la clémence adresse à la folie, comme les caresses que distribuent en passant les gens pris de vin. II. Et ce Roi de Lydie, qui ne fut pas moins insensé que le Phrygien, ne demanda-t-il point à Apollon qu'il lui accordât de renverser l'Empire des Perses : ne fit-il pas tout son possible pour se concilier ce dieu à force d'or, comme un potentat capable de se laisser corrompre par des présents (31). II savait que l'oracle de Delphes avait dit plusieurs fois, «Que Crésus en passant le fleuve Halis, renverserait un grand empire (32) ». Il prit cet oracle à son profit : il passa le fleuve, et son empire en Lydie fut renversé. J'entends dans Homère un Grec qui s'adresse à Jupiter en ces mots : « Ô Jupiter ! fais tomber le sort ou sur Ajax ou sur le fils de Tydée ou même sur le roi de l'opulente Mycènes (33). Et Jupiter accomplit son vœu : le nom que le sort fait tirer du casques est celui d'Ajax qu'ils désiraient (34) ». Tandis que Priam, qui implore aussi Jupiter pour sa patrie, qui lui sacrifie tous les jours des bœufs et des moutons, ne fait que des vœux inutiles. Le même dieu promet à Agamemnon, et lui assure par un signe de sa tête, au moment où ce prince s'embarque pour une région étrangère, « qu'après avoir renversé les fortes murailles de Troie, il retournera chez lui (35) ». D'un autre côté, Apollon ne venge pas d'abord Chrysès de l'injure qu'il a reçue dans le camp des Grecs; mais aussitôt que Chrysès lui a librement raconté ce qui vient de se passer (36), et qu'il lui a rappelé les holocaustes qu'il fait fumer sur ses autels, le dieu lance, pendant neuf jours, ses flèches contre les Grecs, exterminant leurs mulets, leurs moutons, et leurs chiens. III. Incomparable poète, que voulez-vous dire ? Quoi ! les dieux sont cupides, ils sont susceptibles de se laisser gagner par des présents; et à cet égard, ils ne diffèrent point du commun des hommes ! Devons-nous vous en croire, lorsque vous nous dites que « les dieux eux-mêmes ne sont point inflexibles » : ou bien croirons-nous, au contraire, qu'ils ne se laissent ni toucher, ni attendrir, ni émouvoir ? Changer de volonté, passer d'une affection à une autre, ne convient pas plus aux dieux qu'à l'homme de bien. Car l'homme versatile dans ses volontés ne peut passer du mal au bien, que parce que sa première intention était mauvaise; et, si c'est du bien au mal qu'il passe, le vice est dans son changement de volonté. Or, rien de mauvais, rien de vicieux n'entre dans la notion de la divinité. Ou bien, celui qui lui demande quelque chose mérite de l'obtenir, ou bien il ne le mérite pas. S'il le mérite, il l'obtiendra, quoiqu'il ne l'ait pas demandé. S'il ne le mérite pas, il ne l'obtiendra pas, quoiqu'il le demande. Car celui qui mérite d'obtenir, et qui néglige de s'adresser aux dieux, n'en devient point indigne, parce qu'il ne s'adresse point à eux. De même que celui qui ne mérite point d'obtenir, et qui invoque les dieux, ne devient point digne de leurs bienfaits parce qu'il les invoque. C'est tout le contraire. Celui qui mérite la bienfaisance des dieux, s'en rend encore plus digne en s'abstenant de les fatiguer. Celui qui ne la mérite pas, s'en rend d'autant plus indigne qu'il les fatigue davantage. Ajoutons que le premier a de la vénération pour les dieux, et qu'il place en eux sa confiance. Ce dernier sentiment fait qu'il se repose en leur bonté, comme s'il en avait déjà éprouvé les effets; et le premier ferme sa bouche au murmure, lors même que les Dieux ne font rien pour lui. Celui, au contraire, qui est indigne de leurs bienfaits, réunit la méchanceté au défaut de lumières. Ce défaut l'empêche de voir qu'il n'est pas nécessaire de prier les Dieux, sa méchanceté empêche que ses vœux ne soient exaucés. Quoi donc ! si dieu était un général d'armée, et qu'un des goujats demandât à ce général de l'envoyer dans les rangs au milieu du champ de bataille, tandis qu'un des combattants se tiendrait à l'écart et en repos, le général, fidèle aux lois de la discipline militaire, ne ferait-il point retourner le goujat à ses fonctions serviles, et ne laisserait-il pas le combattant à son poste ? Or, un général d'armée peut ne pas tout savoir. Il peut se laisser gagner par des largesses. Il peut être trompé. Auprès de la divinité rien de semblable ne peut avoir lieu. Autant elle s'abstiendra de verser ses bienfaits sur ceux qui le lui demandent, lorsqu'ils ne le mériteront pas, autant elle les répandra sur ceux qui ne le lui demandent pas, lorsqu'ils le mériteront. IV. Mais parmi les choses que les hommes demandent aux dieux, les unes émanent de leur providence, les autres sont nécessairement produites par le sort ; celles-ci dépendent des vicissitudes de la fortune ; celles-là sont l'effet de l'industrie des humains. Or la providence est l'œuvre des dieux; le sort est l'œuvre de la nécessité; l'industrie est l'œuvre de l'homme; et la fortune l'œuvre du hasard. Les parties intégrantes de la vie de l'homme sont, par l'effet du destin, pour chacune de ces choses, l'objet de leur activité, de leurs résultats respectifs (37). Tout ce que nous demandons se rapporte donc ou à la providence des dieux, ou à la nécessité du sort, ou à l'industrie de l'homme, ou au cours de la fortune. Si ce que nous demandons regarde la providence, qu'avons-nous besoin de le demander ? Car si dieu agit par sa providence, ou bien il l'étend sur l'univers entier, sans s'occuper de ses différentes parties, (ainsi que les Rois de la terre régissent les peuples par les lois et par la justice, sans entrer dans les détails relatifs aux individus) ou bien sa providence en surveille jusqu'aux plus petites parties. Que dirons-nous donc ? Veut-on que DIEU n'embrasse que le tout ? Il est donc inutile de l'importuner par des vœux. Il ne les écoutera point, si l'on demande quelque chose de contraire à la conservation du tout. Quoi donc ! si les membres du corps recevaient le don de la parole, lorsque, dans une maladie, le médecin. veut faire amputer l'un d'entre eux, pour la conservation du malade, ce membre-là demanderait-il au médecin de ne point le faire amputer ? Le disciple d'Esculape ne lui répondrait-il point : « Malheureux, ce n'est point sur ton intérêt que celui du corps doit être réglé. Il faut qu'il se sauve, même à tes dépens ». Il en est de même de cet univers. Les Athéniens éprouvent la famine; les Lacédémoniens sont ébranlés par un tremblement de terre; la Thessalie est submergée par des inondations ; l'Etna vomit ses torrents de flamme. On crie à la destruction, à l'anéantissement. Mais le médecin sait bien pourquoi tout cela. II ne s'arrête point aux vœux particuliers, aux supplications individuelles. Il ne voit que la conservation du tout. Il ne songe qu'à l'opérer. Dira-t-on, au contraire, que DIEU étend sa providence, jusque dans les détails ? Il est donc inutile encore ici de rien demander. Il en est comme d'un médecin à qui un malade demanderait, ou un médicament, ou quelque chose à manger. Selon que l'un ou l'autre conviendra, ou ne conviendra pas au malade, il l'ordonnera sans qu'on le demande, ou ne l'ordonnera pas, quand même on le demanderait. En ce qui concerne la providence de DIEU, on n'a donc rien à lui demander, ni aucune prière à lui adresser.
V. Que dirons-nous des choses qui dépendent du sort ? Faire des vœux à cet
égard, serait la chose du monde la plus ridicule. On obtiendrait plutôt ce
qu'on demanderait à un roi, ou à un tyran. Le sort est une puissance
tyrannique, qui n'est subordonnée à aucune autre, et dont les décrets sont
immuables. C'est comme s'il attachait la bride et le frein à l'espèce humaine,
s'il l'entraînait avec violence, s'il la forçait de suivre, de toute
nécessité, le chemin qu'il voudrait lui faire prendre. C'est Denis qui
commande, à Syracuse. C'est Pisistrate qui commande à Athènes. C'est
Périandre qui commande à. Corinthe. C'est Trasibule qui commande à Milet. Car
chez les peuples où le gouvernement est démocratique, les discours éloquents,
les prières, l'intrigue (38), les supplications, peuvent quelque chose. Mais
chez les tyrans, c'est comme à la guerre, le pouvoir n'appartient qu'à la
force. « Prenez-moi vivant, fils d'Atride, et recevez le juste prix de ma
rançon (39) ». Mais, quelle rançon donnerons-nous au sort pour nous
soustraire au joug de la nécessité, pour échapper à ses chaînes ? Quelle
somme en or lui offrirons-nous ? Par quels bons offices nous concilierons-nous
sa bienveillance ? Quelles oblations lui présenterons-nous ? Quels vœux lui
adresserons-nous ? Mais Jupiter lui-même est sans moyens pour faire révoquer
ses décrets. Il pousse des cris de douleur : « Malheureux que je suis »,
s'écrie-t-il, « que le Destin ait réglé que Sarpédon, celui des mortels qui
m'est le plus cher, périrait de la main de Patrocle (40) fils de Mendetide ! »
Lequel des Dieux Jupiter implore-t-il pour son fils ? Thétis aussi s'écrie, «
Que je suis malheureuse, d'avoir mis un héros au monde, et de le voir périr
ainsi ! (41) » Tel est le sort. Telles sont Atropos, Clotho, Lachésis, à qui
l'empire de la vie des hommes est échu. Elles sont inflexibles, inexorables.
Qui donc leur adressera des vœux ? VII. Que demander donc aux dieux qui ne dépende, ou de leur providence, ou du sort, ou de la fortune, ou de l'industrie humaine ? Demandera-t-on de l'argent ? Mais qu'on n'importune point les Dieux. Ce n'est rien demander de ce qui nous est bon. Qu'on n'importune point le sort. Ce n'est rien demander de ce qui nous est nécessaire. Qu'on ne fatigue point la fortune. Elle n'en donne point à ceux qui lui en de-mandent. Qu'on ne fatigue point l'industrie humaine: Qu'on écoute Ménandre, qui dit : « Quand on vit de sa profession, on n'a pas une belle vieillesse, si l'on n'a pas aimé l'argent (43). N'est-ce pas le cours des choses humaines? Êtes-vous homme de bien? changez de mœurs; commencez à devenir un méchant homme; mettez-y tous vos soins, et amassez de l'argent à faire l'un de ces métiers, à servir de courtier d'amour, à donner du vin frelaté, à détrousser sur les grands chemins, à commettre toute sorte de mauvaises actions, à vendre un faux témoignage, à jouer le rôle de sycophante, à laisser acheter votre conscience (44). Demandez-vous de vaincre vos adversaires ? vous le pouvez, en achetant, pour faire la guerre, des mercenaires, pour parler devant les tribunaux, des sycophantes. Demandez-vous quelque espèce de denrée ? Les vaisseaux, la mer, les vents vous la fourniront. Les marchés vous sont ouverts. On en vend partout. Pourquoi donc harceler les Dieux ? Bravez toute espèce d'infamie, et vous vous enrichirez, fussiez-vous un Hipponicus; et la victoire sera pour vous, fussiez-vous un Cléon; et vous gagnerez votre procès, fussiez-vous un Mélitus. Mais si vous vous amusez à vous adresser aux dieux, c'est tout comme si vous vous adressiez à un tribunal sévère et inexorable. Aucun des immortels ne supportera que vous veniez lui demander des choses qui ne peuvent être demandées ; aucun ne vous accordera ce qui ne peut vous être accordé. Toutes les demandes seront examinées, contrôlées à la rigueur, et elles seront ramenées à la mesure de l'intérêt particulier. On ne parviendra point à se concilier les dieux. On aura beau s'ouvrir un accès auprès d'eux, comme ou le pratique dans nos tribunaux, on aura beau prendre le ton suppliant, faire entendre les accents de la pitié, de la commisération, se couvrir la tête de beaucoup de cendre (45), leur rappeler même, s'il en est besoin, « qu'on a prodigué à leurs autels des sacrifices qui ont dû leur être » agréables (46) » . Les Dieux répondront ; « Si vous demandez de bonnes choses à bonne fin, et que vous méritiez de les obtenir, les voilà ». Dès lors, vous n'avez pas besoin de les demander. Vous les obtiendrez, quoique tous gardiez le silence. VIII. Et cependant Socrate allait au Pirée, pour y faire ses prières à la Déesse (47) ; il y invitait ses concitoyens. Il paraît d'ailleurs que, durant le cours de sa vie, il ne fit que prier. Et Pythagore aussi pria; et Platon aussi; et tous les, philosophes qui rendaient hommage à l'existence des Dieux. Mais pensez-vous que la prière du philosophe ait pour objet de demander aux dieux les choses qu'il n'a point ? Je pense, au contraire, qu'elle consiste à s'entretenir, à causer avec eux, sur les choses qu'il possède, et à leur présenter ainsi le tableau de sa vertu. Certes, pensez-vous que Socrate ait demandé aux dieux de lui envoyer une grande fortune, ou de lui donner le pouvoir suprême, à Athènes ? Bien loin de là. Sans doute Socrate honorait les dieux ; mais c'était en lui-même qu'il cherchait, sous leurs auspices, les moyens de se rendre vertueux, de mener une vie tranquille, d'avoir des mœurs irréprochables, d'attendre la mort avec confiance ; dons admirables, dont les dieux devraient être les dispensateurs (48). Si quelqu'un s'avisait de demander au continent une heureuse navigation, à la mer une abondante récolte, à un tisserand une charrue, à un charron une pièce de toile, il demanderait en vain : il serait éconduit sans rien obtenir. Ô Jupiter! ô Minerve ! ô Apollon ! ô vous, qui surveillez la conduite de tous les mortels, vous avez besoin d'avoir pour disciples des philosophes, dont les âmes vigoureuses et énergiques se plaisent à devenir vos émules, et recueillent de leur zèle, à cet égard, les fruits d'une vie heureuse et prospère. Mais les résultats de ce genre de culture sont une chose assez rare : à peine sont-ils sensibles, au déclin des ans. Quoi qu'il en soit, les hommes ont besoin de voir paraître de temps en temps chez quelques-uns de leurs semblables des étincelles de ce feu divin, quelque rares, quelque faibles qu'elles puissent être, ainsi qu'au milieu d'une profonde nuit, on a besoin d'un peu de lumière. Le beau dans le moral de l'homme n'est qu'en très petite mesure; mais, toute petite qu'elle est, elle suit pour la conservation de l'espèce humaine entière. Ôtez à l'homme la philosophie, vous lui ôtez le feu qui l'anime, qui le sou-tient, qui lui donne la vie. Vous lui ôtez la seule chose qui lui enseigne à (49) honorer les dieux. Il en est, comme du corps humain, lorsqu'on lui ôte l'âme; c'est en faire un cadavre : comme d'une contrée à qui l'on ôte sa fécondité; c'est la changer en désert : comme du soleil à qui l'on ôte sa lumière; c'est anéantir le jour.
NOTES. Paris; le 4 floréal en IX. (24 avril 1801.) N O T E S.
(27)
Platon, dans son second Alcibiade, autrement intitulé, de la Prière,
nous a transmis l'ancien formulaire d'une prière très courte, que Socrate dit
qu'il emprunte d'un poète, sans le nommer. La voici. « Roi de l'univers,
accorde-nous ce qui nous est bon, soit que nous te le demandions, soit que nous
ne te le demandions pas, et éloigne de nous les maux, quand même nous te les
demanderions ». Dans les diverses liturgies qui ont paru, ou qui paraîtront
sur la terre, ou trouvera bien, je crois, des prières plus longues que
celle-là. Je doute qu'on en trouve de plus majestueuse, de plus auguste, de
plus digne du Grand Être qui est prié, et de l'homme qui le prie. D'ailleurs,
les philosophes en général n'ont guère été les partisans de la prière. Les
Péripatéticiens, les Cyrénaïques, et tous ceux qui niaient la providence de
DIEU, lorsqu'ils admettaient son existence, ou qui attribuaient tout à un
destin aveugle, ont regardé la prière comme absolument inutile. On peut
consulter là-dessus, Origène contre Celse; liv. II, pag. 68, et son Traité
sur la Prière, § 11 ; Lucien, in Jove confut. tom. II, pag. 120;
St. Jérôme sur St. Mathieu, chap. 6 ; Proclus sur le Timée de
Platon, liv. II, pag. 64; et Hiéroclès, sur les vers dorés de
Pythagore, ch. 49.
Paris, le 8 floréal an IX. (28 avril 1801.) |