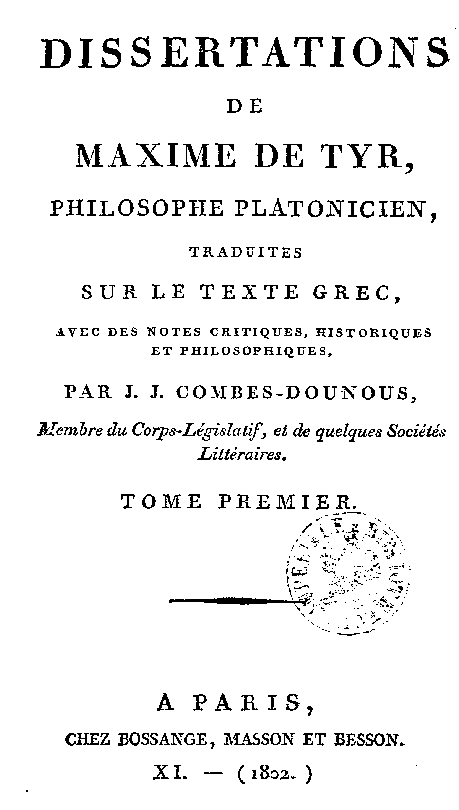|
MAXIME DE TYR DISSERTATIONS
DISSERTATION XII. Qu'est-ce que la Science (1) ? EN quoi consiste ce qui constitue la différence entre l'homme et la brute? En quoi consiste, d'un autre côté, ce qui constitue la différence entre les Dieux (2) et l'homme ? Quant à moi, je pense que c'est par la science que l'homme est au-dessus de la brute, et que c'est par les vices qu'il est au-dessous des Dieux. Car, sous le rapport de la vertu (3), les Dieux valent mieux que les hommes; sous le rapport de la science, l'homme vaut mieux que la brute. Est-ce une raison de penser que la science soit autre chose que la sagesse ? Non, par Jupiter, pas plus que de penser que la vie soit autre chose que la vie. Elle est quelque chose de commun à tous les êtres, soit mortels, soit immortels ; mais si, envisagée sous ce point de vue de qualité, elle est une seule et même chose; envisagée sous le rapport de son plus ou moins de durée, elle se divise en deux espèces. Car les Dieux ne meurent jamais, et l'homme n'a qu'une existence éphémère. De même que s'il était possible à certains yeux de demeurer toujours ouverts, d'avoir la vue dans une activité continuelle, et de recevoir perpétuellement l'impression de la lumière, sans avoir besoin que des paupières vinssent les envelopper, que le sommeil vînt leur donner du repos, et que la nuit leur apportât du relâche, l'action de la vue serait commune sous ce rapport, et à ces yeux, et aux yeux ordinaires, en différant sous le rapport de la durée : de même, sans doute, la science, qui est quelque chose de commun aux Dieux et aux hommes, a néanmoins quelque rapport de différence eu égard aux uns et aux autres. Peut-être ailleurs traiterons-nous de la science en ce qui concerne le Dieux. Quant à présent, occupons-nous d'une question plus ordinaire et plus connue; et recherchons ce que c'est, pour l'homme, que savoir, que connaître, qu'apprendre; et toutes autres expressions de ce genre, par lesquelles on place l'âme dans un état de contemplation. II. Ce que les sens rassemblent dans un cadre étroit de contemplation, (à quoi l'on donne le nom d'expérience), ce qu'ils soumettent aux yeux de l'âme, et sur quoi la raison applique son cachet, après l'avoir examiné, appellerons-nous cela Science? Comme lorsque je dis : les premiers hommes ne savaient point encore ce que c'était qu'un vaisseau. Ils désiraient communiquer ensemble. Le besoin les y portait, mais la mer y mettait obstacle. Ils virent un oiseau descendre des airs et nager. Ils virent quelque chose de pesant, d'ailleurs, flotter légèrement sur les ondes. Peut-être virent-ils quelque part un arbre porté par un fleuve dans la mer. Peut-être quelqu'un d'entre eux tomba-t-il dans l'eau sans le vouloir, et en remuant ses membres parvint-il à surnager et à se sauver; peut-être même s'exerça-t-il à la nage par amusement. Quoi qu'il en soit, l'expérience recueillit la première pensée de la navigation, et construisit d'abord une méchante barque des premiers, des plus légers matériaux, qui lui tombèrent sous la main. Cet aperçu ne tarda pas à être perfectionné par les combinaisons du raisonnement ; et l'on eut bientôt une espèce de char creux que des rames firent mouvoir, que des voiles et les vents poussèrent, qu'un gouvernail dirigea, et auquel on s'abandonna uniquement sur la foi de la science acquise dans cet art-là. Voici comme on raconte que la médecine a été jadis inventée. Les parents d'un malade allaient le déposer dans un des passages les plus fréquentés (4), les passants s'approchaient, faisaient des questions sur la maladie, et selon qu'ils avaient été atteints du même mal, et qu'ils avaient été guéris, ou en avalant quelque chose, ou en se cautérisant, ou en faisant une amputation, ou en se mettant à la diète, chacun de ceux qui avaient été malades, indiquait le remède qui lui avait rendu la santé. L'identité des maladies fixa dans la mémoire l'identité des médicaments qui les avaient guéries; et une courte habitude de l'ensemble de ce résultat fut la mère de la science. C'est ainsi que les autres arts, celui du charron, celui de l'armurier, celui du tisserand, celui du peintre, naquirent de l'expérience. III. À la bonne heure, appelons Science l'habitude de l'âme appliquée aux ouvrages, aux opérations quelconques de l'homme. Mais cette science, s'étend-elle jusqu'aux brutes? Sans doute, car le sens interne (5) et l'expérience ne sont pas exclusivement propres à l'homme. Les brutes reçoivent dès sensations, apprennent certaines choses par l'expérience, de manière qu'il est une sorte de sagesse qu'elles ont soin d'acquérir. En été, les grues quittent l'Égypte (6) dont elles ne peuvent supporter les chaleurs. Elles étendent leurs ailes comme des voiles, et les vents les portent tout droit dans la Scythie. La structure de ces animaux n'est point d'ailleurs régulière. Ils ont le milieu du corps lourd ; le col long ; le côté de la queue léger ; la partie, où les ailes sont attachées, grêle; les jambes écarquillées. Dans leur vol, ils sont ballottés, comme l'est un vaisseau par les vagues. Instruite de cet inconvénient, la grue ne s'envole point qu'elle n'ait pris dans, son bec une pierre, qui lui sert comme de lest, au milieu des airs ; soit qu'elle ait imaginé cet expédient d'elle-même, soit qu'elle le doive à l'expérience (7). Les biches de la Sicile traversent, en été, la mer, à la nage, pour aller pâturer dans la campagne de Reggio (8). Ce long trajet épuise la force des biches, qui sont forcées de tenir la tête toujours au-dessus de l'eau. Voici le moyen à l'aide duquel elles s'épargnent cette fatigue. Elles nagent, rangées sur une seule ligne, l'une à la queue de l'autre, comme une armée qui marche en colonne. Elles nagent, ayant chacune leur tête appuyée sur le flanc de celle qui la précède. Celle qui fait le chef de file, lorsqu'elle est fatiguée, se détache pour se placer la dernière ; et c'est ainsi qu'alternativement elles passent de la tête à la queue. C'est ainsi que, dans son expédition (9), Xénophon commandait l'arrière-garde, et Chirisophe l'avant-garde; de manière que les brutes ont des notions de la tactique militaire. IV. Que le sens interne donc, et que l'expérience ne soient pas exclusivement propres à l'homme, l'homme a du moins cet avantage, en ce qui concerne la raison ; et, sous ce point de vue, la science n'est autre chose que la raison qui soumet, longtemps, et sans distraction, les mêmes objets à ses opérations; qui cherche dans les choses les rapprochements divers, qui sépare ce qu'elles ont de dissemblable, qui réunit ce qu'elles ont d'identique, qui met ensemble celles qui ont de l'affinité, qui distingue celles qui sont confondues, qui divise celles qui sont hétérogènes, qui met en ordre celles qui sont désordonnées, qui fait concorder celles qui n'ont entre elles aucune harmonie. Telles sont, sans doute, l'Arithmétique, la Géométrie, la Musique, et toutes les autres parties des connaissances humaines, étrangères à toute action mécanique, et qui, enfantées par la force de la raison, n'ont eu d'autre berceau, d'autre moule, que l'intelligence humaine. Et cependant, ces sciences ne passent pas pour les plus anciennes aux yeux d'Homère, cet homme recommandable par son antiquité, et qui d'ailleurs mérite pleine confiance. Il admire uniquement, il regarde comme seuls Sages (10), « Les Devins, les Médecins, les Charpentiers, ou les divins Chanteurs ». Ô quel parallèle ! Un devin, un médecin, un charpentier, un chanteur, dans le nombre des Sages ! Apollon et Esculape sur la même ligne d'honneur et de recommandation, qu'Epéus et que Phémius (11) ! Mais Homère, dans ce passage, ne dispense-t-il point l'éloge aux sciences dont il parle, - plutôt en considérant l'époque de leur origine, que leur utilité réelle? Quant à nous, nous ne prendrons point cette route. Mais nous dirons : l'âme de l'homme est de tous les êtres celui qui se meut avec le plus de facilité, et le plus de vélocité. Elle est un mélange de substance mortelle et de substance immortelle (12). Sous le rapport de la première substance, elle tient de la brute. Car elle se nourrit, elle croît, elle se meut, elle a de l'instinct. Sous le rapport de la substance immortelle, elle tient de la Divinité. Car elle est intelligente, raisonnable, susceptible d'apprendre, de savoir. Lorsque chez elle la substance mortelle s'accorde avec la substance immortelle, cet accord s'appelle prudence, et il tient le milieu entre la science et l'instinct. En tant que l'âme est dénuée de raison, elle agit par instinct. En tant que la substance divine la dirige, son action est de l'intelligence. En tant que ces deux mobiles sont combinés comme ils le sont dans la nature humaine, l'action de l'âme est de la prudence. L'instinct recueille l'expérience; la prudence recueillie la raison; l'intelligence recueille l'évidence immuable ; et j'appelle science, la combinaison harmonique de ces trois éléments. S'il faut une comparaison pour nous faire mieux entendre (13) ; que l'on considère l'instinct comme la partie mécanique dans l'art de la construction, l'intelligence comme la géométrie ou la partie ordonnatrice, la prudence comme la personne même des architectes. La partie qui tient le milieu entre la partie géométrique et la partie mécanique est une sorte de science, eu égard à cette dernière ; mais eu égard à la partie géométrique, elle lui est inférieure sous le rapport de l'évidence immuable. V. Or, les facultés de l'homme se partagent entre la science ; la prudence, et l'expérience. Cette dernière, en s'exerçant sur le feu, sur le fer, et sur tous les autres objets physiques, les approprie à tous les besoins de la vie, à l'aide du parti que les arts en tirent. La prudence a l'empire des passions de l'âme, et les gouverne, à l'aide du raisonnement. Considérée dans son rapport avec l'expérience, elle tient lieu de science, mais elle est inférieure à la science proprement dite, en tant que s'appliquant à une nature d'objet, qui n'a ni consistance, ni uniformité ; elle prend, si l'on peut s'exprimer ainsi, la forme de sa manière d'être. Quant à l'intelligence (14), elle est la partie la plus importante de l'âme. C'est elle qui a le suprême droit à l'empire, ainsi que la loi dans la Cité ; non pas la loi qui est écrite sur des tables, qui est imprimée sur des colonnes, qui est votée par des suffrages, qui est délibérée dans des comices, qui est sanctionnée par le peuple ; non pas celle qui est consacrée dans les tribunaux; non pas celle qui est l'ouvrage de Solon ou de Lycurgue ; mais la loi que Dieu lui-même a promulguée; loi, qui n'a jamais été écrite ; qui ne doit son autorité à aucun vote ; qui ne doit aucun compte de son empire. Cette loi est la seule qui en mérite le nom. Celles d'ailleurs qui le portent, ne sont que des opinions, fausses, erronées, trompeuses. Ce furent ces lois qui condamnèrent Aristide au bannissement, Périclès à une amende, Socrate à la mort. Et néanmoins, aux yeux de cette loi divine, Aristide était un homme juste, Périclès un grand homme, et Socrate un philosophe. Les effets de ces lois sont des Gouvernements démocratiques, des tribunaux, des comices, des fermentations populaires, de la vénalité parmi les démagogues, des révolutions de toute espèce, des calamités de tout genre. Les résultats de l'autre loi sont, au contraire, la liberté, la vertu, une vie exempte de maux, une félicité immuable. Les premières lois assemblent les tribunaux, équipent des galères, mettent des flottes à la voile, ravagent les terres, portent la guerre sur mer, détruisent Aegine, entourent Dékélie de murailles, entraînent la perte de Mélos (15), la prise de Platée, la servitude de Skione (16), et le bouleversement de Délos. L'autre loi, au contraire, fait devenir vertueux ; elle remplit l'âme d'instruction et de connaissances ; elle fait régner le bon ordre dans les familles, l'harmonie dans les Cités; elle entretient la paix sur mer et sur terre; elle ne produit rien de sinistre, rien de funeste à l'espèce humaine, rien qui appartienne aux Barbares. On ne voit partout que les fruits de la paix, de la concorde, de la science, de la philosophie, et des arts libéraux. VI. Ô Loi, plus ancienne que les autres Lois ! Ô Législateur, plus pacifique que les autres Législateurs ! Celui qui s'abandonne spontanément à vous, conserve sa liberté, reste à son aise, sans avoir aucun besoin, ni de ces lois éphémères, ni de leurs insensés ministres. S'il est des hommes capables de vous offenser, de commettre contre vous quelques attentats, ils sont punis ; non qu'ils soient traduits devant les tribunaux des Athéniens (17), non que les onze les conduisent eu prison (18), non que le bourreau leur présente la ciguë, mais ils trouvent leur châtiment en eux-mêmes (19), dans leurs vices innés, dans leur méchanceté spontanée; « Car les malheurs qu'ils éprouvent, ils les doivent à leurs propres forfaits (20) ». Ce fut à la transgression de cette loi qu'Alcibiade dut ses malheurs, non point lorsque les Athéniens le rappelèrent de la Sicile, ni lorsqu'il fut dévoué aux Dieux infernaux par les hérauts et les Eumolpides (21), ni lorsqu'il se sauva de l'Attique. Tout cela était peu de chose ; un jugement et une condamnation assez méprisables. Car Alcibiade fugitif joua un plus grand rôle que ceux de ses concitoyens qui restaient à Athènes ; il fut accueilli avec distinction par les Lacédémoniens : il fortifia Dékélie; il devint l'ami de Tissapherne, et obtint le commandement d'une année de Péloponnésiens. Mais le châtiment d'Alcibiade remontait bien plus haut. Il était l'œuvre d'une bien plus ancienne loi, de juges bien plus anciens. Ce fut lorsqu'il abandonna le Lycée, lorsqu'il fut condamné par Socrate, lorsqu'il fut éconduit par la philosophie. C'est de là. que date son bannissement. C'est là que remonte sa condamnation. Ô le cruel anathème ! Ô les irrévocables imprécations ! Ô l'erreur digne de commisération ! Que les Athéniens aient dans la suite sollicité le retour d'Alcibiade. Mais la Philosophie ! mais la Science ! mais la Vertu ! Elles demeurent à jamais implacables et inaccessibles, vis-à-vis de ceux qu'elles ont une fois réprouvés. Telle est la science. Telle est l'ignorance. VII. Quant à moi, je donne le nom de science aux lois de Minos, qui furent enseignées par Jupiter à ce Prince, pendant neuf ans, lois dans lesquelles Minos se rendit habile, et avec lesquelles il fit le bonheur des Crétois. J'appelle aussi science digne d'un Roi, la vertu de Cyrus, de laquelle, à la vérité, il donna des leçons, mais des leçons que Cambyse et Xerxès ne surent point mettre à profit. Cyrus gouverna les Perses, comme un berger gouverne son troupeau (22). Il veilla sur leur conservation, sur leur nourriture. Il fit la guerre aux Mèdes. Il s'empara de Babylone. Il ne permit à aucun loup barbare et ravisseur, de faire sur son bercail aucune incursion. Tandis que (23) Cambyse et Xerxès ne furent que des loups dévastateurs, au lieu de bons bergers qu'ils auraient dû être. Ils exterminèrent leur troupeau de leurs propres mains (24). Ils se montrèrent tout à fait étrangers à la science dont Cyrus leur avait donné l'exemple. J'appelle aussi les lois de Lycurgue une science harmonique et musicale (25). NOTES.
(1) Tel
est le sujet du Traité de Platon, intitulé, le Théaetète. Socrate
d'ailleurs n'y détermine, n'y statue rien. Il se contente de combattre les
définitions de son interlocuteur.
Quelles sont les plus fâcheuses maladies, celles du corps, ou celles de l'âme (26) ? ON chante dans une hymne antique, en guise de prière, « O Santé! la plus ancienne des Déesses! puissé-je passer avec toi les jours qui me restent (27) » ! Je voudrais bien que l'auteur de cette hymne daignât me dire quelle est cette santé qu'il invoque, avec laquelle il puisse habiter. J'imagine que c'est quelque Divinité, digne qu'on lui adresse un semblable vœu. Car ce n'est, ni sans sujet, ni au hasard, que le poète lui a consacré ces vers, et que l'on continue de les chanter. Or, si cette Divinité est telle que je l'imagine, la saine raison va nous répondre pour justifier le poète. II y a deux choses dans l'harmonique organisation de l'homme, l'âme et le corps. Si l'âme n'était point naturellement susceptible d'être malade, le vœu en question ne concernerait que le corps, destiné à être tantôt malade, tantôt bien portant. Mais si la nature a combiné l'âme et le corps ensemble, de manière qu'étant l'un et l'autre dans le meilleur état, ils puissent néanmoins éprouver réciproquement le désordre que chacun d'eux peut éprouver par le dérèglement de son voisin; ce qui arrive, lorsque l'un prend le dessus sur l'autre, comme le peuple sur le chef du Gouvernement, ou le chef du Gouvernement sur le peuple, dans une Cité, (car nous distinguons ces deux genres de prépondérance, et nous appelons l'une, prépondérance de l'âme sur le corps, et l'autre, prépondérance du corps sur l'âme, lesquels considérés l'un et l'autre, en eux-mêmes, ont également besoin de santé, égalité de condition qui n'a pas lieu lorsqu'on les envisage dans leurs rapports respectifs) entre les puissances conservatrices de l'harmonie et de la santé du corps et de l'âme, quelle sera celle à laquelle nous donnerons le nom de la plus ancienne des Déesses (28) ? Afin donc que du contraste de la maladie du corps, et de la maladie de l'âme, puisse sortir la solution de notre question, savoir, quelle est celle des deux qui est le plus grand mal pour l'homme, nous la discuterons sous le point de vue que voici. II. L'âme et le corps composent l'homme. L'un des deux commande, l'autre obéit. Il en est comme dans une Cité, où les uns ont l'autorité, et les autres doivent l'obéissance. Les uns et les autres font également partie de la Cité. Quelle est celle de ces deux parties dont la maladie nuit à la Cité ? Que le peuple d'Athènes soit malade de démagogie; mais que Périclès, habile dans la science de gouverner, entreprenne de les guérir, il relèvera les Athéniens de leur maladie (29). Qu'à Syracuse, Denis soit malade de tyrannie, quoique le peuple soit sain en ce qui le concerne lui-même, il manquera de moyens pour rendre la santé à Denis. Veut-on que le corps joue le rôle du peuple, et l'âme celui du chef du Gouvernement ? Qu'on voie, qu'on compare. Les gouvernés ont plus de masse que les gouvernails, le corps a plus de masse que l'âme. Le peuple n'a point de bon sens. Il eu est de même du corps. Le peuple n'a aucune tenue, ni dans son opinion, ni dans son langage, ni dans ses affections (30). Le corps est encore à cet égard comme le peuple. Le peuple est une agrégation d'éléments nombreux et de qualités diverses. Le corps est encore un assemblage, un mélange du même genre. Le peuple est véhément dans ses transports, impétueux dans ses désirs, sans retenue dans la volupté, désespéré dans la douleur, insupportable dans son exaspération. Telles sont les passions du corps; il est continuellement en proie à des désirs, à des appétits, aux amorces de la volupté, à l'ardeur que les passions inspirent. D'un autre côté, comparons la partie qui commande dans la Cité, avec la partie qui commande dans l'homme. Dans la Cité, le chef du Gouvernement a la suprême autorité, les suprêmes honneurs, le suprême pouvoir. Dans l'homme, la suprême autorité, les suprêmes honneurs, le suprême pouvoir appartiennent à l'âme. Le chef du Gouvernement est celui qui, par la nature de ses fonctions, a le plus de sollicitude, le plus à penser. Il en est de même de l'âme. Le chef du Gouvernement, comme l'âme, est pleinement indépendant. Cela posé, de laquelle de ces deux parties dans la Cité, comme dans l'homme, dirons-nous que la maladie est la plus nuisible ? Lorsque la partie la plus importante est malade, n'est-ce pas ce qui peut le plus nuire au tout? Que le peuple soit malade, pendant que le chef du Gouvernement est en pleine santé, la liberté de la Cité n'en souffrira point. Que le chef du Gouvernement soit malade, la Cité tombe dans la servitude. En un mot, l'âme est plus importante que le corps. Or, le bien de la partie la plus importante est le plus grand bien, et ce. qui est contraire au plus grand bien, est le plus grand mal. La santé de l'âme est donc un plus grand bien que la santé du corps; et la maladie de l'âme un plus grand mal que la maladie du corps. La santé du corps est l'ouvrage de l'art, la santé de l'âme est l'ouvrage de la vertu. La maladie de l'âme est le vice (31). La maladie du corps est l'effet de quelque accident physique. Le vice est volontaire ; les accidents physiques sont involontaires. Ce qui est involontaire, excite la commisération; ce qui est volontaire, provoque la haine. On vient au secours de ce qui excite la commisération; on s'arme du châtiment contre ce qui provoque la haine. Il vaut mieux être dans le premier cas, que dans le second (32). III. Considérons la santé de l'âme et la santé du corps sous un autre point de vue. La santé de l'âme n'a besoin de rien ; la santé du corps a besoin de tout. La santé de l'âme produit le bonheur; la santé du corps mène à l'infortune. La santé de l'âme ne connaît peint les vices; la santé du corps en fraye le chemin. La santé de l'âme n'est point périssable; la santé du corps ne dure qu'un jour. La santé de l'âme est ferme et solide; la santé du corps n'a nulle stabilité. La santé de l'âme est immortelle ; la santé du corps a son terme. Considérons à présent les maladies. Les maladies du corps sont faciles à guérir avec les secours de l'art ; les maladies de l'âme cèdent difficilement aux remèdes de la morale. Les maladies du corps, par la douleur qu'elles causent, rendent les malades plus dociles à la guérison ; les maladies de l'âme, par la satisfaction avec laquelle le malade s'y complaît, ne font que le disposer davantage à braver les lois. Les Dieux viennent au secours des premières. Les autres sont l'objet de leur haine. Les maladies du corps n'allument point le feu de la guerre ; les maladies de l'âme l'ont très-souvent allumé. Pendant qu'on est attaqué d'une maladie corporelle, on ne fait point le métier de Sycophante, on ne fouille point les tombeaux, on ne brigande point, on ne commet nul autre grand attentat de cette nature (33). Dans les maladies du corps, le malade seul souffre de son mal; dans les maladies de l'âme, le prochain souffre aussi du mal du malade. IV. Ce que nous venons de dire deviendra plus frappant dans un développement politique. À Athènes, dans le temps que son Gouvernement avait les formes démocratiques, dans le temps qu'elle avait une brillante population, que son empire s'étendait au loin, qu'elle possédait beaucoup de richesses, qu'elle abondait en habiles Généraux, et que Périclès la gouvernait, la peste survint. Née dans l'Éthiopie (34), elle avait parcouru les états du grand Roi, elle avait fini par se jeter dans l'Attique, où elle s'enracina. Elle fit un grand ravage à Athènes. À ce fléau vint se joindre la guerre du Péloponnèse. Pendant que les campagnes étaient dévastées par le fer ennemi, que la pestilence régnait dans la ville, que les citoyens y périssaient, que le marasme attaquait l'empire extérieur de la république, et que le corps entier de la Cité paraissait près de succomber, un seul homme, comme s'il eût été l'âme de la Cité, ce célèbre Périclès, inaccessible à toute maladie, conservant sa pleine santé, soutint les forces expirantes de la République, les lui fit recouvrer par degrés, lui rendit insensiblement sa vigueur, et fit face à la peste et à la guerre (35). Remarquez un second exemple. Lorsque la peste eut disparu, lorsque les pertes de la population eurent été réparées, lorsque la République eut repris son éclat au dehors, une maladie grave attaqua la partie qui avait le gouvernement de la Cité. Ce fut une maladie voisine de la démence. Elle se répandit dans la multitude, et rendit nécessairement le peuple malade de la maladie de ses chefs. En effet, le peuple d'Athènes ne partagea-t-il point la frénésie de Cléon, la démence d'Hyperbolus, l'exaltation d'Alcibiade ? Ne finit-il point par se dessécher, par succomber, par périr avec ces insensés démagogues, qui entraînaient cette infortunée République, les uns d'un côté, les autres de l'autre? « Venez, belle Nymphe, et vous verrez des merveilles (36) ». Alcibiade lui montre la Sicile. Cléon lui montre Sphactérie (37). Un troisième lui montre telle ou telle expédition sur mer ou sur terre, comme qui montre des fontaines ou des bains à quelqu'un qui a la fièvre. Malheureux, telles sont vos merveilles ! Des désastres, des renversements, le comble des calamités, l'exaspération de la maladie. Tels sont les résultats des maladies de l'âme, mises en parallèle avec les maladies du corps. Que le corps soit malade, qu'on le mutile, qu'on le déchire : attachez-lui une âme vigoureuse et robuste ; il méprise la maladie, il brave toutes les souffrances. C'est ainsi que les brava Phérécyde de Scyros. Tandis que les chairs de son corps étaient déchirées, son âme conserva sa fermeté, son courage, dans l'attente d'être délivrée de cette malheureuse enveloppe (38). V. J'oserai même dire que c'est sans répugnance qu'une grande âme voit la dissolution du corps. Qu'on se figure un prisonnier qui voit crouler et tomber en ruine les murs pourris de sa prison, dans l'impatience où il est d'être dégagé de sa gêne, de recouvrer sa liberté, et de passer des épaisses et profondes ténèbres, où il a été plongé jusqu'alors, au grand air, et à la brillante contemplation de la lumière. Pensera-t- on qu'un homme qui se serait parfaitement exercé, et dont le corps aurait acquis l'habitude des plus pénibles fatigues, trouvât mauvais de voir tomber ses vêtements en lambeaux; et qu'au contraire, il ne se fît pas un plaisir de les mettre à bas, et de présenter son corps nu et libre à un air libre aussi, au milieu duquel il n'éprouverait aucun obstacle, aucune contrainte, dans ses mouvements (39) ? Que croira-t-on donc que soient, à l'égard de l'âme, cette peau, ces os, ces chairs, qui la recèlent, sinon un vêtement éphémère, un faible tissu de guenilles et de haillons? Le fer les met en pièces, le feu les consume, les plaies les dévorent. Une grande âme qui a su se donner de l'énergie et de la vigueur, méprise un pareil vêtement. Elle désire d'en être au plutôt dépouillée. C'est à l'homme qui possède une âme de cette trempe, que l'on peut appliquer, lorsqu'on voit son corps attaqué d'une maladie, ces paroles de l'Odyssée : « O le vigoureux genou que montre ce vieillard, au travers de ces haillons (40) » ! Une âme lâche, au contraire, est enterrée dans le corps, ainsi qu'un paresseux reptile est enterré dans son trou. Elle s'y complaît. Elle ne veut point qu'on l'en fasse sortir. Elle n'en sort jamais d'elle-même. Qu'on applique au corps le fer et le feu, elle supporte le fer et le feu. Qu'il soit en proie à la douleur, elle la partage. Qu'il pousse des cris, elle en pousse avec lui. « O mon pied, me séparerai-je de toi» ! s'écrie Philoctète (41). Homme! sépare-toi de ton pied, et ne crie point. N'invective point contre tes amis. Ne tourmente point l'île de Lemnos. « O mort, médecin de nos maux (42)» ! si tu n'entends par-là que passer d'un mal à un autre, je n'admets point le vœu que tu fais. Mais si tu penses que la mort est vraiment notre médecin, qu'elle nous délivre de cette malheureuse hospitalité, où nous sommes perpétuellement assaillis par les besoins et les maladies, à la bonne heure. Invoque la mort : appelle ton médecin. VI. Mon sujet me conduit à un exemple encore plus sensible, dont je désire depuis longtemps avoir occasion de faire usage. Les Grecs avaient autrefois une armée nombreuse. Elle était composée d'autant de guerriers, «que le printemps produit de fleurs et de feuilles (43) ». Tous étaient bien portails, en pleine santé, vigoureux, intacts. Ils campaient autour des murailles de leurs ennemis. Pendant le cours de dix années, il ne résulta rien, ni des prouesses d'Achille, ni des exploits d'Ajax, ni du carnage fait par Diomède, ni du sang versé par les flèches de Teucer, ni des ordres d'Agamemnon, ni des discours de Nestor, ni des prophéties de Calchas, ni des sages conseils d'Ulysse. Jupiter leur dit : « O magnanimes et illustres nourrissons de la Grèce, vous vous tourmentez en vain, vous livrez en vain des batailles. Vous lancez en vain des flèches. En vain vous tenez des conseils. Vous ne vous rendrez jamais maîtres de ces remparts, avant que vous n'ayez pour auxiliaire un homme dont l'âme est pleine de vigueur et d'énergie, mais dont le corps malade répand une mauvaise odeur, ne se traîne qu'en boitant, et s'épuise chaque jour par ses souffrances (44) ». Les Grecs entendirent le langage de Jupiter, et ils allèrent chercher à Lemnos le compagnon d'armes qui leur était désigné (45). VII. Veut-on à présent contempler les maladies de l'âme dans un corps sain? L'âme est malade de la maladie de la volupté. Elle en est consumée. Elle en est dans le marasme. Quel avantage le malade en retire-t-il ? Quel bien peut faire au corps une âme pareille? Sardanapale est atteint de cette maladie. Voyez-vous comme le mal attaque toutes les parties de son corps? Le malheureux ! Il se laisse épuiser, exténuer; ses yeux en deviennent creux et livides. Il ne peut plus résister à l'excès de sa maladie. Il se précipite dans les flammes. Alcibiade est malade aussi. Un feu ardent et cruel le dévore. Il trouble sa raison au point de le rendre fou. Cette aliénation le jette tantôt d'un côté, tantôt d'un autre; du Lycée dans les comices d'Athènes, des comices sur les flots, des flots en Sicile, de la Sicile à Lacédémone, de Lacédémone chez les Perses, de chez les Perses à Samos, de Samos à Athènes, d'Athènes il retourne sur l'Hellespont et ailleurs. Critias (46) aussi est attaqué d'une maladie funeste sous plusieurs rapports, maladie incurable et qu'on ne saurait supporter dans une Cité quelconque (47). Cependant Sardanapale, Alcibiade et Critias, avaient un corps sain, et jouissaient d'une santé parfaite. Sardanapale avait un tempérament robuste (48), Alcibiade était un très beau garçon, et Critias était d'une force extraordinaire. Mais malheur à la santé de Sardanapale, d' Alcibiade et de Critias. Que Critias soit malade, et qu'Athènes respire de sa tyrannie. Qu'Alcibiade soit malade, et que les Athéniens n'entreprennent point leur expédition de Sicile. Que Sardanapale soit malade : il lui vaut mieux mourir par la maladie que par la volupté. Périsse plutôt quiconque reçoit les continuelles influences d'une méchanceté incurable. Car, de même que les ulcères qui rampent, font chaque jour des progrès dans les corps auxquels ils s'attachent, en corrodant continuellement les parties saines, et résistent à. tous les remèdes, jusqu'à ce que les gens de l'art aient porté le scalpel à l'endroit même, dans le siège même de la maladie; de même, chez ceux qui ont une âme virulente, putride, gangrenée, l'ulcère moral s'enracine toujours davantage, et ronge par degrés les parties voisines. Il faut donc leur amputer, leur arracher les parties du corps qui en sont les puissances physiques, savoir, les mains à celui qui vole, les yeux à celui qui croupit dans le libertinage, le ventre à celui qui se vautre dans la crapule. On aurait beau, d'ailleurs, employer contre la maladie, des juges, des prisons; des bourreaux, elle irait son train, elle cheminerait, elle gagnerait sans cesse. Car il n'y a point de remède contre les progrès de la méchanceté, lorsqu'une fois imprégnée dans l'âme, elle trouve pour se nourrir un aliment homogène, avec une puissance sans bornes, et une impudeur qui n'a point de frein (49).
NOTES.
|