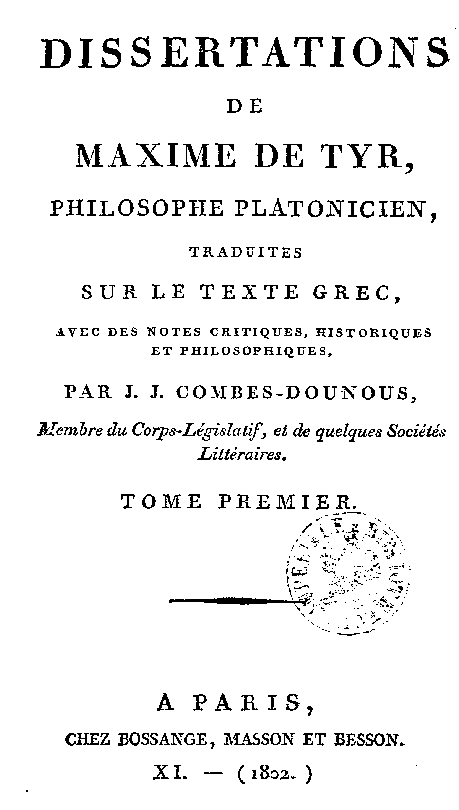|
MAXIME DE TYR
DISSERTATIONS
DISSERTATION VII. La philosophie s'approprie à toutes les situations de la vie (1). QUOI donc ! ceux qui représentent les pièces de théâtre dans les fêtes de Bacchus, lorsqu'ils prennent tantôt le rôle d'Agamemnon, tantôt celui d'Achille, lorsqu'ils jouent tantôt le personnage de Télèphe, tantôt celui de Palamède, ou tout autre quelconque, selon que le drame l'exige, ne sont censés rien faire ni contre les bienséances, ni contre les mœurs, quoique les mêmes individus se montrent sous des formes si variées : et si, mettant à part ces divertissements, ces jeux de théâtre, et les renfermant dans le cercle de ce qui appartient aux fêtes, nous réfléchissons qu'il est un drame politique où nous avons un rôle à jouer ; non point un drame en vers ïambes qu'un poète ait habilement composé à l'unique occasion de quelque fête ; ni en musique dont un chœur doive faire briller l'harmonie ; mais le drame de tous les événements de la vie que le philosophe regarde comme plus vrai sous le rapport du sujet, comme plus long sous le rapport de la durée, et d'ailleurs comme l'ouvrage et la leçon des Dieux mêmes ; si ensuite nous disposant à figurer dans ce drame, et nous plaçant à la tête du chœur, nous gardons les bienséances des situations, nous n'offrons que le caractère, nous ne parlons que le langage, convenables à la nature de l'action dramatique dont les Dieux eux-mêmes ont tracé le plan ; nous reprochera-t-on d'être incohérents, de faire plusieurs personnages, de ressembler à ce Protée dont parle Homère, à ce héros marin, qui se métamorphosait de tant de manières (2) ? Ou bien en est-il comme de la supposition où il faudrait que les hommes, pour être heureux, fussent musiciens de profession et en même temps susceptibles des impressions musicales ; comme de la supposition où l'on ne ferait nulle part nul cas d'un musicien, capable à la vérité de briller seul dans le mode dorien, mais qui resterait muet s'il s'agissait de faire aller ensemble plusieurs parties, et de mettre en harmonie le ton ïastien avec le ton aeolien ? II. Mais, puisque les hommes font peu d'usage de la musique, et qu'ils sont peu sensibles aux affections attrayantes que l'âme en reçoit, puisqu'il leur faut une autre muse plus digne d'eux, sous le nom de Calliope, pour parler le langage d'Homère, sous le nom de Philosophie, pour parler le langage de Pythagore, ou sous tout autre nom ; les Auteurs et leurs ouvrages, dirigés par l'influence de cette muse, doivent-ils être moins capables que les musiciens de se prêter à cette variété d'harmonie, à cette diversité de tons qui lui sont propres, sans porter jamais atteinte à la beauté de ses inspirations, et en même temps sans se laisser déconcerter, ni réduire au silence ? Car, si dans le cours étendu, si dans la longue durée de la vie, il est quelques intervalles auxquels les principes de la philosophie ne soient point nécessaires (3), nous n'avons nul besoin de cette muse capable de se prêter à divers accents, de cette harmonie susceptible de varier ses modulations. Il en serait de même, si les choses humaines allaient toujours le même train, sous une forme unique, si elles n'établissaient point d'alternative, de la volupté à la douleur, et de la douleur à la volupté, si elles ne formaient point entre les passions une réciprocité de succession et de correspondance, si elles ne bouleversaient pas, si elles ne mettaient pas sens dessus dessous les têtes de chacun des hommes, « car chaque jour les pensées des mortels sont ce que le père des mortels et des immortels veut qu'elles soient (4) ». Il est dans le décret des Dieux que les choses humaines soient dans un état continuel de vicissitudes, et que chaque manière d'être n'ait qu'une durée éphémère. De même que les fleuves qui prennent leur origine dans des sources qui coulent continuellement, n'ont qu'un nom unique, tels que le Sperchius, l'Alphée, ou tout autre; et que la succession de leurs eaux qui se remplacent et se renouvellent sans cesse en impose aux yeux par la continuité du courant, comme s'il restait toujours le même sans se mouvoir ; de même les choses humaines naissent, se suivent, comme si elles émanaient d'une source intarissable. Elles marchent avec une célérité vive et désordonnée. Leur cours est insensible. Elles produisent sur les yeux de l'esprit la même illusion que l'aspect des fleuves sur les yeux du corps ; et la raison appelle tout cela une seule et même vie. C'est néanmoins une chose très diverse, très variée, modifiée par une infinité d'accidents, de conjonctures, de circonstances. A la vérité, elle a été soumise à l'empire de la raison, qui s'accommode toujours au présent : semblable à un médecin habile vis-à-vis d'un corps qui n'a point de consistance (5), qui se porte d'une extrémité à l'autre, qui se jette tour à tour dans les excès de la satiété ou de l'inanition, et qu'il doit gouverner de manière à prévenir l'une et l'autre. Telle est la fonction des principes de la philosophie à l'égard de la vie de l'homme ; ils se mettent en harmonie avec les passions, ils mitigent ce qu'elles ont de hideux, ils applaudissent à ce qu'elles ont d'agréable. III. Si la vie n'avait qu'une même marche, qu'une même manière d'être, il ne faudrait qu'une seule règle, qu'un identique plan de conduite. Mais il n'est qu'un moment unique marqué pour le musicien qui sait marier les doux accents de sa voix aux tendres sons de la guitare, c'est celui où les tables regorgent « de mets et de vins, et où les échansons versent à boire à la ronde (6) ». II n'est qu'un moment unique marqué pour l'orateur, c'est celui où le tribunal qui doit l'entendre est en séance. Il n'est qu'un moment unique marqué pour le poète dramatique, c'est celui où dans les fêtes de Bacchus on demande un chœur (7). Au lieu que les discours philosophiques n'ont aucun moment propre qui leur ait été spécialement assigné. Ils s'appliquent à tous les moments de la vie. Ils en embrassent toutes les circonstances. Il en est comme de la lumière, à l'égard des yeux. Car, quelle fonction imaginerait-on que pussent remplir les yeux, si on ôtait la lumière ? Encore même les yeux aident-ils à quelque chose en pleine nuit. A peine discernent-ils les objets les uns des autres ; ils ont néanmoins comme la main leur tâtonnement au milieu des ténèbres. Tandis que, si on ôte à la vie humaine la droite raison destinée à la guider, elle se jettera au travers de routes, inconnues, scabreuses, funestes, qui la conduiront dans des précipices : routes, auxquelles ne peuvent point s'arracher, tant qu'ils demeurent étrangers aux principes de la droite raison, les Barbares, sans cesse livrés au brigandage, à l'impudicité (8), aux affections mercenaires, aux égarements de tout genre. Éloignez d'un troupeau de chèvres le berger, ôtez au berger son flageolet, vous dispersez le troupeau. Si vous ôtez à l'espèce humaine cette droite raison qui doit lui servir de régulateur et de guide, que faites-vous autre chose que jeter dans le désordre et la perdition des êtres d'une aménité naturelle, mais qu'une mauvaise éducation pervertit facilement (9), et qui demandent à être gouvernés avec ordre et mesure, sans que pour châtier leur indocilité ou réprimer leurs écarts, on se serve ou d'aiguillons, ou de verges. Ceux donc qui ne pensent pas qu'il n'y a pas un seul moment où le philosophe n'ait occasion de faire usage des principes de la droite raison (10), ressemblent à peu près à ceux qui prescriraient à un guerrier habile dans tous les détails du métier de la guerre, également propre à combattre au milieu de l'infanterie, ou parmi les troupes légères, à cheval, ou sur un char, de ne charger son ennemi qu'à une époque déterminée, sans avoir égard aux accidents, aux conjonctures de tout genre, que produit la guerre, la chose du monde la plus féconde en vicissitudes, et sur les règles de laquelle on est le moins unanime. IV. Un athlète qui a combattu dans les Jeux Olympiques peut dédaigner les Jeux Isthmiques. Dans ce cas-là même, on ne laisse pas de lui reprocher sa nonchalance. Une âme qui a l'amour de la gloire ne supporte point la paresse. Elle ne renonce point au désir de s'illustrer dans toutes les occasions; elle ambitionne non seulement la couronne d'olivier d'Olympie, mais encore la couronne de pin des Jeux Isthmiques, la couronne d'ail des Jeux de l'Argolide, et la couronne de pommier des Jeux Pythiques ; et cela, non que l'âme soit personnellement intéressée dans ces combats, mais elle habite avec le corps, elle est avec lui dans des relations si étroites, qu'elle est sensible aux acclamations dont il est l'objet, qu'elle jouit de sa victoire. Et dans les choses où l'âme est proprement intéressée, dans les combats où le rôle est tout entier pour elle, où la victoire n'appartient qu'à elle seule, elle laissera échapper l'occasion d'acquérir de la gloire, elle s'abandonnera spontanément à l'indolence, lorsque ce n'est ni de rameaux d'olivier, ni de branches de pommier qu'elle doit être couronnée, mais lorsque le prix qui l'attend est bien plus propre par son éclat à flatter son ambition, à frapper les regards des spectateurs sous le rapport de l'utilité, et à faire marcher avec plus de sécurité dans la carrière de la vie celui qui l'obtient ! Dans ces combats, les circonstances, les lieux, varient. Quelquefois on les proclame à l'improviste. La Grèce (11) ne s'y réunit pas de son pur mouvement. Elle ne s'y rassemble pas sans y être convoquée. On ne vient point s'y repaître d'une vaine volupté. On s'y engage dans l'espérance d'y recueillir la vertu, ce qui a bien plus de rapport avec l'âme de l'homme que la volupté. Dans les autres combats, on voit en quoi consistent ceux qui ont pour objet la force et les autres dons du corps, et on y remarque que dans la foule des spectateurs qui ont mis de l'intérêt à s'y rendre, il n'en est pas un seul qui songe à se piquer d'émulation, et à imiter ce qu'il voit. C'est dans la critique situation d'autrui que les yeux puisent les plaisirs qu'ils y goûtent ; et dans la multitude de ceux qui assistent au spectacle, il n'est personne qui voulût être du nombre de ceux qui se couvrent de poussière, qui courent, qui froissent, qui sont froissés, qui succombent sous les coups au milieu de l'arène, à moins d'avoir une âme d'esclave. Au lieu que les combats de l'âme me paraissent d'autant plus nobles que les autres combats, au lieu que les fatigues auxquelles on s'y livre me paraissent d'autant plus utiles que les autres fatigues, au lieu que l'intérêt des spectateurs me paraît d'autant plus vif en faveur des athlètes, qu'il n'est aucun de ceux qui sont témoins de ce qui s'y passe, s'il a une raison saine, qui ne désire de quitter son rôle, et de se mettre au nombre des combattants. V. Quelle en est donc la cause ? C'est que toutes les complexions physiques ne sont point susceptibles des dons du corps, ni des violentes épreuves auxquelles ils donnent lieu. Ce n'est pas d'ailleurs quelque chose d'absolument volontaire. Cela vient de soi-même. C'est ta nature qui le dispense, et même elle n'en favorise qu'un petit nombre d'individus. Car il faut être né ou avec l'énorme taille de Titorme, ou avec la vigueur de Milon, ou avec la force de Polydamas, ou avec la vélocité de Lasthène (12). Or, si quelqu'un plus faible qu'Épée, plus hideux que Thersite, plus petit que Tydée, plus lourd qu'Ajax, et réunissant toutes les autres défectuosités corporelles, avait envie de se mettre sur les rangs, certes ce serait être animé d'un désir vain et impossible à satisfaire. C'est tout le contraire des combats de l'âme. Ils sont rares ceux qui n'apportent point en naissant les qualités nécessaires pour y figurer. Il est petit le nombre de ceux qui ne peuvent point se rendre vertueux. Car les vertus ne viennent pas d'elles-mêmes : elles ne sont point innées dans l'âme. A la vérité, la nature y fait bien quelque chose, mais il en est comme d'un mince fondement sous un large mur, ou d'une petite quille sous un grand vaisseau. Les Dieux ont associé à nos facultés intellectuelles l'amour et l'espérance, le premier, semblable à des ailes légères, propres à s'élancer dans les plus sublimes régions, pour enlever l'âme, pour lui faire prendre un facile et rapide essor, et lui frayer une route vers l'objet de ses désirs; (les philosophes appellent cet élan, cet essor chez l'homme, impulsion de l'appétit) : la seconde, l'espérance, qui n'est point aveugle, suivant la pensée du poète d'Athènes (13), mais qui a au contraire des yeux très perçants, les Dieux l'ont attachée à l'âme pour soutenir son courage, dans la poursuite de ses désirs, pour lui défendre de se relâcher au milieu. de ses efforts, dans la certitude d'obtenir complètement ce qu'elle désire. Sans l'espérance il y a longtemps que le commerçant aurait cessé le commerce, que le stipendiaire aurait cessé de porter les armes, que le navigateur aurait cessé de naviguer, que le brigand aurait cessé de courir après le butin, que l'impudique aurait cessé de corrompre la femme d'autrui. Mais ils sont dupes de l'espérance ceux. qui n'entreprennent les choses impossibles qu'elle leur commande, - que parce qu'ils comptent, le commerçant qu'il s'enrichira, celui qui porte les armés qu'il remportera des victoires, celui qui navigue qu'il ne fera point naufrage, le déprédateur qu'il fera une grande fortune, l'adultère qu'il ne sera point découvert. Un accident imprévu, un malheur inopiné, surviennent à chacun d'eux et voilà le commerçant ruiné, le guerrier mort, le navigateur submergé, le déprédateur chargé de chaînes, l'adultère publiquement signalé, et les désirs de tous anéantis avec leurs espérances. Car les Dieux n'ont déterminé la mesure, n'ont posé la limite, ni des richesses, ni de la volupté, ni de nul autre des objets des désirs de l'espèce humaine. Ces objets ne connaissent point de bornes (14). D'où il arrive que ceux qui les poursuivent en sont d'autant plus affamés qu'ils en regorgent davantage (15). Car ce qu'ils ont déjà est toujours au-dessous de ce qu'ils attendaient. Au lieu que, lorsque l'âme tend à un objet qui a de la consistance, dont le mérite n'est point équivoque, qui est bien défini, bien déterminé (16), beau de sa nature (17), dont on peut venir à bout par le travail, que l'entendement peut saisir, auquel l'amour peut s'attacher, et qui peut être embrassé par l'espérance ; alors l'âme triomphe dans le combat où elle s'engage ; elle atteint son but ; elle remporte la victoire. Tel est l'unique motif pour lequel les philosophes rassemblent des spectateurs autour d'eux. VI. J'ai besoin encore de cette allégorie des athlètes. Chacun d'eux désirerait que nul compétiteur ne se présentât avec eux dans l'arène. Il voudrait vaincre sans se couvrir de poussière. Car entre plusieurs, la victoire ne peut appartenir qu'à un seul. Dans les autres combats au contraire le comble de la gloire est d'attirer à soi un grand nombre de concurrents. Car, si les Dieux faisaient que quelqu'un de ceux qui m'écoutent se lançât à côté de moi dans la même carrière, et que dans la même arène (18) il vînt se couvrir de la même poussière, et se livrer aux mêmes efforts, c'est alors que j'acquerrais de la gloire, c'est alors que je ceindrais mon front de couronnes, c'est alors que je serais proclamé avec honneur dans toute la Grèce. Mais j'avoue que jusqu'à ce jour, je n'ai obtenu ni couronne, ni proclamation de ce genre, de quelques applaudissements que je sois d'ailleurs honoré. Car quel fruit ai-je recueilli de tant de discours, et de ma continuelle assiduité dans la carrière? Des éloges ? j'en ai assez. De la gloire ? j'en suis rassasié. En un mot, loue-t-on l'art oratoire, sans en faire usage, lorsqu'on a de la voix et des oreilles ? Loue-t-on la philosophie sans en pratiquer les leçons, lorsqu'on a une âme à morigéner, et un maître pour remplir cette tâche ? Mais il en est comme de ces belles choses dont la flûte, ou la guitare, ou toute autre harmonie musicale, relève l'éclat, dans les représentations de tragédie, ou de comédie, aux fêtes de Bacchus ; tout le monde les couvre d'éloges, et personne ne les imite. VII. Certes, dans ces représentations-là même, il y a une grande distance entre l'éloge et la volupté. Car tous ceux qui écoutent, éprouvent de la volupté. Celui-là seul décerne vraiment l'éloge qui se laisse emporter à l'émulation. Jusqu'alors nul éloge n'a été décerné. On a vu des hommes qui ne s'étaient jamais occupés de musique, montrer, au son de la flûte, de la disposition pour cet art ; on les a vus avec de l'oreille retenir les airs exécutés sur cet instrument, et les fredonner, à voix basse. Avec de l'émulation pour un pareil exemple, peut-être prendrait-on du goût pour la flûte. Un homme qui aimait les bêtes avait des oiseaux, de ceux qui sont dressés à donner agréablement le bon jour avec leur langage ; non toutefois sans quelque imperfection, mais aussi bien que des oiseaux peuvent le faire. Cet homme avait pour voisin un joueur de flûte. Ces oiseaux qui l'entendaient s'exercer sur son instrument, s'étant accoutumés à le suivre chaque jour, formèrent leurs oreilles au son de la flûte, et finirent par être en état de l'accompagner et de faire chorus avec lui, dans l'air qu'il jouait, lorsqu'il commençait à l'exécuter. Et des hommes ne feront point vis-à-vis de nous ce que firent ces oiseaux, tandis que nous leur faisons si souvent entendre non pas de vains sons, mais des discours qui s'adressent à leur raison, des discours composés selon les règles de l'art, pleins de principes féconds et de leçons faciles à pratiquer! Si donc jusqu'à ce moment j'ai gardé le silence vis-à-vis de tout le monde touchant nos intérêts les plus chers, si je n'ai rien dit de grand, d'élevé, soit en particulier, soit en public, je crois devoir aujourd'hui, à votre considération, traiter les matières les plus sublimes et les plus transcendantes. O jeunes gens, je vous offre une foule de moyens d'instruction très étendus, très variés, sur toute sorte de sujets, à la portée de tous les degrés d'intelligence, propres à toutes les inclinations, à tous les goûts, à tous les systèmes d'éducation, moyens que chacun peut mettre à contribution à son gré, sans se constituer en frais, sans que la négligence puisse être excusée, sans qu'on ait à redouter l'envie, et qui sont à la discrétion de quiconque veut en profiter ! Quelqu'un a-t-il du goût pour la rhétorique ? la carrière de l'éloquence s'ouvre devant lui. Il peut apprendre à se mettre à la hauteur de plusieurs sujets, à être abondant, élevé, énergique, soutenu, vigoureux, et facile. Quelqu'un a-t-il du goût pour la poésie ? Qu'il vienne avec la seule précaution de se munir d'ailleurs de poèmes. Il recueillera ici toutes les instructions sur l'art poétique. On lui enseignera en quoi consistent la pompe, l'éclat, le brillant, le sublime. On lui enseignera à bien dessiner un plan, à le bien conduire, à fuir la recherche dans les expressions, à ne pas pécher contre les règles de l'harmonie. Un autre désire-t-il de s'instruire dans la politique, d'apprendre l'art de manier le peuple, de parler dans ses assemblées ? Pour remplir son but, il n'a besoin que de lui-même. Qu'il observe le peuple : qu'il assiste à ses délibérations : qu'il entende ses orateurs : qu'il soit témoin de ce qui persuade, de ce qui fait impression. Un autre méprise-t-il tout cela, veut-il embrasser la philosophie, offrir ses hommages à la vérité ? Ici, je cesse de me faire valoir. J'avoue mon insuffisance : je ne suis plus en mesure. Il s'agit d'une chose de haute importance, qui veut, de par tous les Dieux, être dirigée par quelqu'un qui soit au-dessus du vulgaire, qui n'aille point terre à terre, et qui ne soit point encroûté de la rouille de la multitude. VIII. Si quelqu'un dit donc que la philosophie consiste en mots, en paroles, en discours artificieux, en controverses, en disputes, en sophismes, et en futilités de cette nature, il n'est pas difficile alors de trouver un maître. On rencontre partout de pareils sophistes. Ils abondent de toutes parts. Il s'en sera bientôt présenté. J'oserai même dire que les professeurs d'une semblable philosophie sont en plus grand nombre que les disciples. Mais si ce n'est là qu'une petite partie de la philosophie, une partie telle, qu'à la vérité il soit honteux de l'ignorer, mais dont la science ne donne aucune recommandation, évitons la honte de l'ignorance ; mais en remplissant ce but, ne nous en faisons pas accroire à nous-mêmes. Car certes ceux-là même qui donnent les premières leçons de la lecture, mériteraient beaucoup de considération, quoiqu'ils ne s'occupent que de syllabes, et qu'à faire bégayer des troupes d'enfants lorsqu'ils sont le plus dépourvus d'intelligence. Ce qui constitue la partie fondamentale de la philosophie, le chemin qui y conduit, exigent un maître qui sache donner de l'élévation à l'âme des jeunes gens, régler leurs désirs, et leur faire sentir que la douleur et la volupté en sont l'unique mesure : selon la méthode de ceux qui dressent les jeunes chevaux, qui n'éteignent point toute leur fougue, et qui ne leur permettent pas non plus de s'y laisser entièrement emporter. Si d'ailleurs l'impétuosité des jeunes chevaux est gouvernée par le frein, par les rênes, par le manège du cavalier, ou du cocher, l'âme de l'homme est gouvernée par le discours, non point par un discours insignifiant, abject, dénué d'intérêt, mais par un discours où le pathétique est allié à la saine morale, qui ne donne point à ceux qui l'entendent le temps d'occuper leur attention à ce qui concerne le style, et le plaisir qu'il peut faire, mais qui produit une espèce de transport, une sorte d'enthousiasme, semblable à celui des trompettes qui sonnent tantôt la charge, tantôt la retraite. IX. Si tel est le genre d'éloquence nécessaire à ceux qui embrassent l'étude de la philosophie, il faut chercher avec soin celui qui en a le talent, l'éprouver, et le choisir, soit vieux, soit jeune, soit pauvre, soit riche, soit qu'il ait, ou qu'il n'ait point de réputation. Ce n'est pas qu'à mon avis la vieillesse ne le cède à la jeunesse, la pauvreté à l'opulence, et l'obscurité à la renommée. Mais les hommes songent plus volontiers à devenir philosophes (19), lorsqu'ils pèchent par tous ces désavantages ; et les disgrâces de la fortune sont regardées comme le véhicule de la philosophie. Parce que Socrate était pauvre, le pauvre s'empressera donc de marcher sur les traces de Socrate ? Nous serons heureux, si ceux qui, comme Socrate, ont un petit nez et un gros ventre, ne viennent pas se mettre aussi sur les rangs. Que personne d'ailleurs ne reproche à Socrate de ne s'être exclusivement occupé que des pauvres, et de n'avoir fait aucune attention à ceux qui se distinguaient par leurs richesses, leur réputation, et l'illustration de leur origine (20). Car Socrate pensait, je crois, que la République d'Athènes ne recueillerait que peu de fruit des élucubrations philosophiques d'Eschine ou d'Antisthène, et que même nul de leurs contemporains n'en recueillerait plus d'avantages, que n'en produirait vis-à-vis de nous, qui devions leur succéder (21), la mémoire de leurs discours. Mais si, en effet, ou Alcibiade, ou Critias, on Cléobule, ou Cailias, eussent été philosophes, les Athéniens de ce temps-là n'auraient point éprouvé les maux qui leur arrivèrent. Il ne suffit pas, pour ressembler à Diogène, de porter comme lui une besace et un bâton (22 ). On peut avec cet attirail n'être pas moins malheureux que Sardanapale. Le célèbre Aristippe, vêtu de pourpre, et embaumé de parfums, n'a voit pas moins de tempérance que Diogène. Car de même que celui qui parviendrait à mettre son corps à l'épreuve de l'action du feu, pourrait, sans rien craindre, s'élancer dans les gouffres du mont Etna ; de même celui qui s'est pleinement mis en mesure contre les impressions de la volupté, n'a rien à craindre au milieu de ses prestiges, de ses amorces, de ses séductions. X. La pierre de touche du philosophe n'est donc ni son costume, ni son âge, ni sa situation sous le rapport de la fortune. Ce sont les opinions, les principes, la manière d'être sous le rapport de l'âme, qui seuls en constituent, en déterminent le vrai caractère. Tout le reste dont la fortune fait les frais, ressemble aux décorations et aux habits de théâtre pendant les fêtes de Bacchus. La beauté des ouvrages des poètes est toujours une, toujours la même, que ce soit un Roi, que ce soit un esclave qui parle. Le costume dépend des rôles. On donne à Agamemnon un sceptre, à un homme des champs un gilet de peau, à Achille une armure, à Télèphe des haillons et une besace. Les spectateurs ne prêtent pas plus d'attention à Agamemnon qu'à Télèphe. L'âme embrasse le poème entier, et non point la situation isolée des interlocuteurs. Qu'on pense de même que dans les discours des philosophes, ce qui en fait le beau n'est ni cisaillé, ni morcelé, mais toujours un, mais toujours en cohésion avec lui-même. Ceux qui entrent dans la carrière de la vie dont il est le but (23), s'y présentent avec la diversité de costume dont la fortune les a revêtus. Tels on vit Pythagore avec un habit de pourpre, Socrate avec un mauvais manteau, Xénophon avec la cuirasse et le bouclier, le champion de Sinope (24), comme Télèphe, dont nous parlions tout à l'heure, avec une besace et un, bâton. Leur costume même prêtait à leurs rôles. En effet, Pythagore répandait l'admiration, Socrate le reproche, Xénophon la docilité, et Diogène le sarcasme. O heureux les personnages de ces drames ! heureux les spectateurs qui les entendirent en scène ! Où trouverons-nous aujourd'hui un acteur et un personnage, non point de ceux dont le costume n'a rien d'agréable, et qui sont condamnés aux rôles muets, mais de ceux qui auraient pu se présenter sur le théâtre des Grecs ? Cherchons-le, peut-être le trouverons-nous quelque part, et si cela nous arrive, il n'aura point à se plaindre d'avoir été dédaigné. DISSERTATION VIII. S'il faut représenter les Dieux sous des emblèmes sensibles (25). LES Dieux ont toujours été regardés comme les conservateurs, comme les gardiens tutélaires des hommes; d'abord tous les Dieux comme les conservateurs de tous les hommes, et ensuite tel Dieu, selon sa dénomination, comme le gardien de tel homme en particulier. De leur côté, les hommes ont consacré aux Dieux des honneurs solennels, des objets pour les représenter, selon que les bienfaits qu'ils en avaient reçus les touchaient, sous les rapports divers de leur intérêt personnel. C'est ainsi que les matelots consacrèrent aux Dieux de la mer des timons de navire qu'ils placèrent sur des points élevés au bord du rivage, de manière que les vagues n'y pussent atteindre. C'est ainsi que les bergers honorèrent le Dieu Pan, en lui consacrant ou un grand sapin, ou une profonde grotte. C'est ainsi que les agriculteurs rendirent hommage à Bacchus, en plantant dans leur jardin le tronc d'un arbre venu de lui-même, genre d'emblème vraiment agreste. On consacra à Diane les fontaines d'eau vive, les coteaux et les vallons couverts de forêts, les prés où les chasseurs sont si à leur aise (26). Jupiter aussi reçut de la part des premiers mortels des offrandes de cette nature. On lui consacra les points les plus éminents des montagnes, le mont Olympe, le mont Ida, et tous ceux qui s'approchaient le plus du ciel.Les fleuves eux-mêmes ne restèrent point sans honneurs, ou lorsqu'ils furent utiles, comme le Nil en Égypte, ou lorsqu'ils offrirent à là vue un beau coup d'œil, comme le Pénée en Thessalie, ou lorsqu'ils en imposèrent par leur majesté, comme le Danube chez les Scythes, ou lorsque quelque événement fabuleux les eut rendus recommandables, comme l'Acheloüs chez les Étoliens, ou lorsque les lois de l'État s'en mêlèrent, comme l'Eurotas à Lacédémone, ou lorsqu'ils entrèrent pour quelque chose dans une institution religieuse, comme l'llissus à Athènes. L'usage que faisaient les peuples des eaux des fleuves fut une autre source des honneurs qu'ils leur décernèrent. Les arts eurent aussi chacun leurs Dieux particuliers, auxquels ils consacrèrent des monuments. Et s'il est des hommes, qui ne soient ni épars sur les rivages de la mer, ni répandus dans les campagnes, mais réunis dans des cités, vivant dans des relations communes sous une même forme de gouvernement, les Dieux n'en obtiendront-ils ni honneurs ni hommages ? Ou bien les révéreront-ils seulement de bouche, et penseront-ils d'ailleurs que les Dieux n'ont nul besoin ni d'autels, ni d'emblèmes qui les représentent ? Car les emblèmes et les autels ne paraissent pas plus nécessaires aux Dieux, que les images des grands hommes aux gens de bien. II. De même, à mon avis, qu'en ce qui concerne la parole et le langage nous n'avons nul besoin qu'il consiste en caractères, ou Phéniciens, ou Ioniens, ou Attiques, ou Assyriens, ou Égyptiens, et que tous ces signes ont été inventés par la faiblesse humaine, comme un supplément à l'imperfection de l'intelligence, et comme une ressource pour la mémoire; de même, sans doute, les Dieux n'ont nul besoin ni d'emblèmes, ni d'autels. Mais les hommes, dans l'excès de leur faiblesse, éloignés comme ils le sont des Dieux, autant que le ciel l'est de la terre (27), imaginèrent ce genre de signes auxquels ils imposèrent les noms des Dieux, et auxquels ils attachèrent ce qu'ils en disaient. Ceux donc qui ont de la vigueur dans l'intelligence (28), et qui peuvent faire prendre à leur âme un essor direct vers le ciel, et s'y aller mettre en commerce avec les Dieux, ceux-là peut-être peuvent se passer d'emblèmes. Mais le nombre en est assez rare parmi les hommes, et il serait impossible de trouver une nation entière qui eût la connaissance des Dieux, et à laquelle un tel secours ne fût point nécessaire. De même que ceux qui enseignent à lire aux enfants pratiquent certains artifices, comme de crayonner à leurs yeux les caractères dans une forme très défectueuse, pour leur donner lieu de rectifier eux-mêmes ces défectuosités, et s'imprimer par ce moyen dans la mémoire le souvenir de ces caractères; de même les législateurs, tout ainsi que s'ils avaient eu affaire à des troupeaux d'enfants, me paraissent avoir inventé pour les hommes ces représentations, ces images des Dieux, comme des signes du culte qui leur est dû, comme un moyen propre à conduire, à diriger vers ce souvenir. III. D'ailleurs, il n'existe nulle uniformité touchant ces images, ces représentations des Dieux, ni dans l'objet fondamental de l'institution religieuse qu'on leur attache, ni dans le mode du cérémonial qu'on leur approprie, ni dans la forme même qu'on leur donne, ni dans la matière dont on les compose (29). Les Grecs, par exemple, ont jugé convenable de consacrer à leurs Dieux les premiers genres de beau qui sont sur la terre, la matière la plus pure, la forme humaine, l'art le plus parfait. Et ce n'est pas sans raison qu'on a imaginé de faire ressembler à l'homme les représentations, les images des Dieux. Car si l'âme de l'homme est ce qui approche le plus de la Divinité, ce qui lui ressemble davantage, il n'y avait nulle apparence de représenter la Divinité, qui lui ressemble le plus à elle-même, sous les figures les plus difformes, mais sous celle qui par sa prestance, sa légèreté, sa mobilité devait être appropriée à des âmes immortelles (30); mais sous la figure du seul des êtres qui sont sur la terre, qui soit capable de tourner ses regards vers le ciel, qui ait de la dignité, de la majesté, une régulière ordonnance; qui n'épouvante point par sa grandeur, qui n'en impose point par sa force (31); qui n'est ni par son poids difficile à mouvoir, ni par sa légèreté facile à renverser; qui ne repousse point par ses aspérités; qui ne se traîne point terre à terre à cause de sa frigidité; qui n'a point de chaleureuse impétuosité; qui n'est réduit, ni à vivre dans l'eau à cause du peu de consistance de son organisation, ni à manger de la chair crue, à cause de sa férocité, ni à se nourrir d'herbe, à cause de sa faiblesse; mais harmoniquement doué de toutes les qualités propres à sa destination, offrant un aspect terrible au méchant, montrant de l'aménité à l'homme de bien; ayant toujours ses pieds attachés à la terre, mais s'élançant dans les airs sur les ailes de l'intelligence, au milieu des mers sur les ailes de la navigation (32); vivant des productions de la terre, la cultivant par ses labeurs, se nourrissant des fruits qu'il lui fait produire, ne présentant à l'œil que des agréments sous le rapport de la teinte de la carnation, sous le rapport de la stature et sous celui de la physionomie (33). C'est en représentant les Dieux sous la forme d'un pareil être, que les Grecs crurent les honorer. IV. Quant aux Barbares, admettant tous également l'existence des Dieux, ils les représentèrent les uns sous une figure, les autres sous une autre. Les Perses sous l'image fugitive du feu, élément dévorateur et insatiable. Dans les sacrifices, ils lui offrent son aliment ordinaire, en lui disant : « Feu, souverain maître, mange.». Ils mériteraient ces Perses qu'on leur dît,« O les plus insensés des hommes, qui, dédaignant de prendre pour représenter vos Dieux les nombreux, les divers objets que vous offrait la nature, ou cette terre nourricière (34), ou ce brillant soleil, ou cette mer, théâtre de la navigation, ou ces fleuves pères de la fécondité, ou cet air qui donne la vie, ou le ciel lui-même, ne vous êtes principalement occupés que de celui-là seul qui en est le plus violent, le plus propre à la destruction; et qui, sans vous contenter d'offrir à ce Dieu que vous vous êtes choisi, à cet emblème sous lequel il vous a plu de le représenter, ce qui est son naturel aliment, ou des sacrifices, ou des parfums, lui avez donné à dévore Érétrie, Athènes, les temples de l'Ionie, et les statues de la Grèce » ! V. Je n'approuve pas davantage les institutions de l'Égypte. On y adore un bœuf, un oiseau, un bouc, les reptiles du Nil, êtres dont les corps sont périssables, l'existence abjecte, la vue rampante, les fonctions serviles, et qu'il est honteux d'adorer. Chez les Égyptiens, les Dieux meurent : on porte leur deuil. On voit à la fois et leurs tombeaux et leurs temples. Chez les Grecs (35), dans les solennités célébrées en l'honneur des héros, on offre des hommages à leurs vertus, mais on ne parle point des maux qui ont pu être leur ouvrage. Mais en Égypte, dans le culte qu'on rend aux Dieux, on mêle quelquefois les pleurs aux offrandes (36). Une femme égyptienne élevait un petit crocodile. Les Égyptiens regardaient comme un grand bonheur pour elle d'être la nourrice d'un Dieu. Quelques-uns même allaient jusqu'à faire des caresses (37) à cette femme et à son nourrisson. Cette Égyptienne avait un fils, encore impubère, du même âge que le Dieu, avec lequel il était accoutumé de prendre ses ébats et de manger. Tant que le Dieu fut faible, il eut de la mansuétude. En grossissant, il développa sa férocité naturelle. Un jour il dévora l'enfant. L'infortunée Égyptienne envisagea comme un bonheur pour son fils son genre de mort, d'avoir été la proie d'un Dieu domestique. Voilà pour ce qui concerne l'Égypte. VI. Le célèbre Alexandre, après s'être rendu maître de la Perse, s'être emparé de Babylone, et avoir fait Darius prisonnier, poussa jusqu'aux Indes, où jusqu'alors nulle autre armée étrangère, d'après ce que disent les Indiens, n'avait pénétré, à l'exception de celle de Bacchus. Porrus et Taxile, Rois de cette contrée, prirent les armes. Porus fut fait prisonnier, et Taxile rechercha la bienveillance d'Alexandre. Il lui fit parcourir toutes les merveilles de l'Inde. Il lui fit admirer la grandeur des fleuves, la variété des oiseaux, les parfums des plantes, et tout ce qui pouvait piquer la curiosité d'un Grec. Entre autres choses prodigieuses, il lui montra un animal d'une grandeur au-dessus de toutes les proportions de la nature, que les Indiens regardaient comme la représentation de Bacchus, et auquel ils offraient des sacrifices. C'était un dragon d'une longueur et d'une grosseur monstrueuse (38). On le nourrissait dans un lieu creux, profond, et entouré de murailles qui dominaient toutes les hauteurs d'alentour. Il absorbait les troupeaux de l'Inde. On lui amenait des bœufs et des moutons à manger, plutôt comme à un tyran que comme à un Dieu. VII. Les Libyens occidentaux habitent une langue de terre étroite et longue que la mer cerne des deux côtés. A l'extrémité de cette langue de terre, la mer qui la baigne fait du fracas par le tourbillonnement et l'impétuosité de ses vagues. L'Atlas est le Dieu de ce peuple. Il est lui-même sa représentation. Or l'Atlas est une montagne creuse, d'une médiocre hauteur, et dont l'ouverture s'offre du côté de la mer, comme l'ouverture d'un théâtre s'offre vis-à-vis de l'atmosphère (39). Dans le milieu de la montagne est un court boyau d'une terre féconde, et couvert de beaux arbres. Ces arbres portent du fruit. En regardant du sommet de la montagne on voit comme dans le fond d'un puits. D'ailleurs, il n'est pas possible d'y descendre à cause de la raideur de la pente, et d'un autre côté cela n'est pas permis. Ce qu'il y a là de plus merveilleux, c'est que quand le flux de l'Océan gagne le rivage, les ondes se répandent à droite et à gauche au travers des terres, tandis qu'en face de l'Atlas elles s'amoncellent; et l'on voit les flots s'entasser les uns sur les autres comme une muraille, sans se diriger vers la cavité de la montagne, et sans toucher à la terre ferme, entre laquelle et les flots sont un air extrêmement dense, et des bois enfoncés. Tel est le temple, tel est le Dieu des Libyens. C'est par lui qu'ils jurent. C'est à lui qu'ils rendent leurs adorations. VIII. Les Celtes adorent Jupiter, et le Jupiter des Celtes est un grand chêne (40). Les Poeons adorent le soleil, et le soleil des Poeons est un petit disque pendu à une longue perche. Les Arabes adorent aussi, niais je ne sais quoi. Quant à l'objet sensible de leurs adorations, je l'ai vu, c'est une pierre quadrangulaire (41). Vénus était adorée à Paphos. La figure sous laquelle on la représentait ne ressemblait guère qu'à une pyramide blanche, de l'on ne sait quelle matière. Chez les Lyciens, le mont Olympe jette des flammes, mais non point à l'instar de l'Etna. Ce sont des flammes périodiques et qui ne font aucun mal. Ce feu est pour eux l'objet de leur culte. Il leur représente leur Dieu. Les Phrygiens, qui habitent Célène, rendent leurs hommages à deux fleuves que j'ai vus, le Marsyas et le Méandre. Ils partent de la même source. L'eau qui en sort, après avoir traversé une montagne, disparaît à côté de la ville. Elle reparaît au delà, et se distribue en deux courants sous des noms divers. Celui qui se dirige vers la Lydie est le Méandre. L'autre va se perdre dans les campagnes. Les Phrygiens sacrifient à ces fleuves, les uns à tous les deux, les autres au Méandre, et les autres au Marsyas. Ils jettent leurs offrandes dans la fontaine qui leur sert de source, en prononçant à haute voix le nom du fleuve auquel elles sont destinées. Ces offrandes suivent le courant des eaux au travers de la montagne, s'engloutissent, ressortent avec elles, et l'on ne voit point que celles qui sont adressées au Méandre prennent le chemin du Marsyas, ni que celles qui doivent appartenir au Marsyas prennent le chemin du Méandre. Si elles sont pour l'un et pour l'autre, elles se partagent entre eux (42). C'est une montagne qui est le Dieu des habitants de la Cappadoce. C'est par elle qu'ils jurent. C'est elle qui leur représente la Divinité. Chez les peuples qui habitent les rivages du Palus-Méotide, c'est le Palus-Méotide lui-même. Chez les Massagètes, c'est le Tanaïs. IX. O quelles différences, quelle variété dans les images des Dieux, dans les signes qui les représentent ! Tantôt c'est la main des arts qui les a élaborés. Tantôt ce sont les services du besoin qui ont déterminé les hommages. Les uns se sont conciliés le respect des mortels par le bien réel qu'ils leur faisaient, les autres par des impressions imposantes. Ici le culte a été commandé par l'énormité des formes; là, il a été. l'ouvrage de leur régularité, de la beauté de leur coup d'œil. D'ailleurs il n'est aucun peuple, ni Grec, ni Barbare (43), ni placé sur les bords de la mer, ni reculé dans l'intérieur des terres, ni nomade, ni civilisé, qui n'ait senti le besoin d'avoir sous les yeux des symboles quelconques propres à rappeler l'idée des hommages que l'on doit aux Dieux. A quoi bon mettre donc en question s'il faut représenter les Dieux sous des emblèmes sensibles ? Si nous avions à. donner des lois à des hommes qui nous fussent totalement étrangers, qui vécussent dans une autre atmosphère que la nôtre; qui fussent récemment sortis du sein de la terre (44), ou pétris par un nouveau Prométhée, sans aucune expérience de notre manière de vivre, de nos habitudes, de notre langage, peut-être aurions-nous besoin de nous livrer à cette recherche, et d'examiner s'il conviendrait de permettre à une semblable génération de prendre pour symboles de la Divinité ceux que la nature présente, et d'adorer non de l'ivoire, ni de l'or, ni des chênes, ni des cèdres, ni des fleuves, ni des oiseaux, mais le soleil à son lever, la lune dans son plein, le firmament dans sa variété brillante, ou même la terre, l'air, ou le feu universel, ou les eaux en masse. Aimerions-nous mieux les réduire à la nécessité d'adorer du bois, de la pierre, de la toile ? Mais si telle est la condition commune de tous les peuples, laissons les choses comme elles sont; respectons les opinions reçues sur le compte des Dieux, et conservons leurs symboles ainsi que leurs noms. X. Car il est un DIEU, père et créateur de tout ce qui existe, plus ancien que le soleil, plus ancien que le firmament, antérieur aux temps, aux âges, et à toutes les générations qui en ont émané; législateur supérieur à toutes les lois, dont le langage des mortels ne peut pas plus énoncer le nom, que leurs yeux n'en peuvent contempler l'essence. Dans l'impuissance où nous sommes de nous faire une idée de sa nature, nous cherchons un appui dans les mots, dans les dénominations, dans les animaux, dans les images d'or, d'argent et d'ivoire, dans les plantes, dans les fleuves, dans les hauteurs des montagnes, dans les fontaines. Nous sommes avides de le connaître, mais la faiblesse de notre intelligence nous réduit à nous le représenter sous l'emblème du beau à nos veux (45). Il en est comme de ce qu'on éprouve en amour. Ce qu'on voit avec le plus de plaisir est le portrait de l'objet qu'on aime. On se plaît encore à fixer ses regards sur la lyre dont il tirait de si agréables sons, sur la lance dont il s'armait avec tant de grâce, sur le siège où il venait se reposer, sur le lieu où il jouissait de la promenade; en un mot, sur tout ce qui peut en rappeler le souvenir. Que servirait donc d'aller plus avant et de nous ériger eu législateurs sur cette matière? Il suffit que l'entendement humain ait l'idée de DIEU. D'ailleurs, que le ciseau de Phidias soit employé chez les Grecs pour en retracer la mémoire, qu'en Égypte le culte qu'on rend aux animaux soit chargé de la même fonction, que chez certains peuples on adore un fleuve, chez d'autres le feu, qu'importe la différence ? Elle ne me choque pas. C'est assez pour moi que les nations sachent qu'il est des Dieux. Il suffit qu'elles les honorent. Il suffit qu'elles en conservent le souvenir. DISSERTATION IX. Si Socrate fit bien de ne rien dire pour sa défense (46). C'EST une chose inconcevable, que dans chaque profession on puisse décliner la juridiction commune : que le marin, qui a pris le commandement d'un vaisseau et qui l'a dirigé à sa guise d'après ses connaissances nautiques, puisse ne pas rendre compte de sa conduite à des hommes qui n'entendent rien à la navigation; qu'il ne soit point permis aux malades de se constituer juges des ordonnances de leur médecin, des remèdes qu'il commande, du régime qu'il prescrit; que, ni ceux qui fabriquent des vases, ni ceux qui fabriquent des armes, ni aucun des autres artisans qui font des métiers bien moins relevés, ne soumettent le jugement de leurs ouvrages qu'à la juridiction respective de leurs pairs; et que Socrate, qui ne fut point regardé comme dénué de lumières et de connaissances, au tribunal même d'Apollon, de ce Dieu « qui savait le nombre des grains de sable, » et qui devinait juste, au-delà même des mers (47) », soit poursuivi encore aujourd'hui sans relâche de la part des Sycophantes qui le traduisent devant eux ; et que parmi de pareils accusateurs et de pareils juges, qui se succèdent sans interruption, il trouve plus d'animosité, plus d'acharnement, que ne lui en montrèrent jadis Anytus, Mélitus, et les Athéniens ses contemporains. S'il eût été ou peintre comme Zeuxis, ou sculpteur comme Polyclète et Phidias, à la faveur de la réputation dont il aurait joui dans son art, ses ouvrages auraient été admirés comme ceux de ces artistes célèbres. Car, en contemplant ces derniers, non seulement on n'ose pas leur reprocher des défauts ; on n'ose pas même y appliquer l'œil de la critique. Chacun au contraire les comble à l'envi d'éloges. Mais qu'un homme qui fut étranger aux arts de la main, qui ne fut ni statuaire ni peintre, dont le talent consista à mettre de la symétrie, de l'harmonie dans ses mœurs, et à les soumettre à la plus parfaite régularité, à l'aide de la raison, du travail, de l'habitude, de la frugalité, de l'honnêteté, de la tempérance et de toutes les autres vertus ; que cet homme n'ait point obtenu une gloire solide, des éloges unanimes, des juges qui n'aient eu qu'une voix, mais que chacun ait eu de cet homme une opinion différente, c'est ce dont nous allons en ce moment faire l'objet de notre examen (48). II. Socrate fut accusé par Mélitus, traduit en jugement par Anytus, poursuivi par Lycon, condamné par les Athéniens, chargé de fers par les onze (49), et réduit à avaler la ciguë : et Socrate dédaigna Mélitus qui l'accusait, et Socrate couvrit de mépris Anytus qui le traduisait en justice, et Socrate se moqua de Lycon qui parlait contre lui ; et tandis que les Athéniens le jugeaient, il les jugeait lui-même ; et tandis qu'ils prononçaient une condamnation contre lui, il en prononçait une contre eux. Lorsque les onze se présentèrent pour le charger de chaînes, il leur abandonna son corps, un des plus faibles, sous le rapport des forces physiques. Mais il ne leur abandonna point son âme ; sous le rapport des forces morales, il l'emportait sur tous les Athéniens. L'aspect du bourreau ne l'effraya point. La vue du poison ne fit aucune impression sur lui. Les Athéniens le condamnèrent à contrecœur, et lui, il reçut la mort sans répugnance. La preuve qu'il ne répugna point à la mort, c'est qu'étant le maître d'en être quitte pour une amende (50), ou de se sauver par une évasion clandestine, il aima mieux mourir. La preuve que les Athéniens le condamnèrent à contrecœur, c'est qu'ils ne tardèrent pas à se repentir de l'avoir condamné. Or, peut-il rien arriver à des juges de plus propre à les couvrir de ridicule ? III. Vous désirez donc d'examiner si Socrate, dans ces circonstances, se conduisit bien ou mal. Si quelqu'un s'approchait de vous, et vous disait : « Il fut un homme à Athènes, avancé en âge, Philosophe de profession, mal à son aise du côté de la fortune, doué d'ailleurs d'excellentes qualités morales, bon orateur, ayant beaucoup de sagacité, actif, sobre, incapable de rien faire ni de rien dire, sans avoir un objet déterminé ; ayant parcouru une assez longue carrière en se conciliant sous le rapport des mœurs les éloges des plus recommandables d'entre les Grecs, et d'Apollon entre les Dieux. L'envie, l'animosité, la haine du beau moral, soulevèrent contre lui, parmi les poètes comiques Aristophane, parmi les Sophistes Anytus, parmi les sycophantes Mélitus, parmi les orateurs Lycon, parmi les Grecs les Athéniens (51) ; et tandis qu'il était ainsi joué sur le théâtre par l'un, accusé par l'autre, tandis que celui-ci le traduisait en jugement, que celui-là parlait contre lui, et qu'il était d'ailleurs en présence du tribunal, il commença par user de représailles vis-à-vis d'Aristophane, il le mit à son tour sur la scène durant les fêtes de Bacchus, pendant que les spectateurs étaient encore échauffés par la licence des orgies. De là, il se rendit vers ses propres juges, il parla à son tour contre ceux qui avaient parlé contre lui, il entra dans de très longs détails ; son but principal dans sa défense fut de se concilier le tribunal, de gagner sa bienveillance dès le début de son discours, de le convaincre par l'exposition des faits, de faire éclater l'évidence à ses yeux, par la force et la vérité de ses preuves, par la justesse des rapprochements, par le témoignage de ses concitoyens les plus recommandables, et les plus dignes de faire foi devant des juges athéniens. Dans sa péroraison, il eut recours aux supplications, aux prières, il excita la pitié, il laissa échapper de temps en temps quelques larmes ; à tout cela, il finit par ajouter l'apparition de Xantippe, le tableau de ses lamentations, celui des pleurs et des cris de ses enfants ; et par le concours de tous ces moyens, ses juges, fléchis, attendris, touchés de commisération, se décidèrent en sa faveur, et le renvoyèrent absous ». IV. O la brillante victoire ? Certes, en sortant de là, il eût pu reparaître ou au Lycée, ou à l'Académie, ou dans les autres lieux de ses rendez-vous, avec autant d'hilarité que ceux qui ont échappé sur mer à quelque tempête. Mais, de quel oeil la Philosophie eût - elle vu un pareil homme revenir vers elle ? Du même oeil qu'un chef de gymnase verrait revenir de l'arène un athlète tout parfumé, qui aurait obtenu sa couronne, sans éprouver aucune fatigue, sans se couvrir de poussière, sans avoir été ni meurtri, ni blessé, sans rapporter aucune preuve de son courage. Et pour quel motif Socrate se serait-il défendu devant des juges tels que ceux qui le jugèrent à Athènes ? Était-ce parce qu'ils pouvaient prononcer selon la justice ? mais ils ne connaissaient que l'iniquité. Était-ce parce que c'étaient des hommes remplis de sagesse ? mais ils n'avaient aucun bon sens. Était-ce parce qu'ils étaient susceptibles de bienveillance ? mais ils étaient pleins d'animosité contre lui. Était-ce parce qu'ils avaient quelque point de commun avec sa manière d'être ? c'était tout le contraire. Était-ce parce qu'ils valaient mieux que lui ? mais il valait lui-même beaucoup mieux qu'eux. Était-ce parce qu'ils avaient moins de mérite que lui ? et quel est l'homme qui, sentant sa supériorité sur ses juges, en pareil cas, s'abaisserait à se défendre devant eux? Et s'il eût voulu se défendre, qu'aurait-il pu dire ? Qu'il n'avait point professé la philosophie? mais il aimait proféré un mensonge. Qu'il avait fait la profession de Philosophe? mais c'était de cela même qu'on l'accusait. V. A la bonne heure, qu'il n'eût rien dit de cela ; mais il devait repousser les chefs de son accusation, se justifier d'avoir corrompu la jeunesse, et d'avoir introduit de nouveaux dieux. Mais où est l'artiste qui, sur les matières qui appartiennent à son art, portera la conviction dans l'esprit de celui qui n'en a pas les premiers principes ? Et comment les Athéniens auraient- ils entendu en quoi consistait la corruption de la jeunesse, en quoi consistait la vertu, quelles notions on devait avoir des Dieux, quel culte on devait leur rendre ? Les milliers de juges que le sort des fèves (52) appelle à cette fonction, n'examinent point des questions de cette nature. On ne trouve rien de réglé là-dessus dans les lois de Solon. Dracon n'en dit pas un mot dans son code. Il n'y est question que de citations en justice, de défenses judiciaires, d'accusations, de mise en jugement des comptables, de serments à prêter respectivement par les parties (53), et de tous les détails de cette nature, qui composent la juridiction de l'héliée (54). C'est comme dans les groupes d'enfants, lorsqu'ils prennent querelle entre eux, et qu'ils se débattent au sujet de leurs osselets qu'ils s'enlèvent les uns aux autres (55), et lorsqu'ils éprouvent des injustices dont ils sont réciproquement les auteurs. Mais la vérité, mais la vertu, mais les bonnes mœurs, demandent d'autres juges, d'autres lois, d'autres orateurs. Alors Socrate triomphera, alors la palme lui sera décernée, alors il sera couvert de gloire. VI. Et combien ne serait-il donc point ridicule de voir un homme avancé en âge, un philosophe, jouer avec des enfants ? Et quel est le médecin qui a jamais persuadé à des malades ayant la fièvre, que la faim et la soif sont un bien ? Et qui a jamais persuadé à un homme livré à la débauche, que ce genre de volupté est un mal ? Qui a jamais persuadé à celui qui est adonné aux opérations mercantiles, qu'il n'y a nul. bien dans le but qu'il se propose ? Certes, Socrate n'aurait pas eu beaucoup de peine à persuader aux Athéniens, que ce n'est pas pervertir les jeunes gens, de les dresser à la vertu, et que ce n'est point pécher contre les dieux, de propager les lumières en ce qui les concerne. Ils en savaient là-dessus autant que Socrate ; ou bien, tandis que Socrate avait là-dessus les plus saines notions, les Athéniens étaient à cet égard dans une pleine ignorance. Or, s'ils étaient aussi savants que lui, qu'avait-il à leur apprendre ? S'ils étaient, au contraire, dans une profonde ignorance, ce n'était pas de plaidoyer, mais de leçons qu'il devait s'agir auprès d'eux. Dans les débats judiciaires, c'est des témoignages, des ouï-dire, des preuves, des pièces de conviction, des épreuves que l'on fait subir à l'accusé (56), et d'autres semblables détails, que dépend devant les tribunaux la manifestation de la vérité. Mais lorsqu'il s'agit des principes de la vertu et de la morale, il n'est qu'une source de preuves, c'est le respect qu'on a pour l'une et pour l'autre. Or, ce respect étant alors banni d'Athènes, que pouvait avoir à dire Socrate ? VII. Il devait dire du moins ce qu'il fallait pour éviter la mort. Mais, si mourir est un accident, dont l'homme de bien doive se garder sur toutes choses, non seulement Socrate aurait dû songer à se défendre devant le tribunal des Athéniens qui le jugeaient, mais il aurait antérieurement (57) dû s'abstenir de montrer de l'animosité contre Mélitus, de démasquer Anytus, de dérouler le tableau du dérèglement et de l'inconduite de ses concitoyens, de passer en revue toute la ville d'Athènes, de scruter toutes les conditions, toutes les professions, toutes les occupations, toutes les ambitions, de se constituer l'amer et inexorable censeur de tout le monde, ne prononçant vis-à-vis de qui que ce soit aucun mot sentant la bassesse, la flagornerie, la servilité, l'humiliation. Le soldat bravera la mort au milieu des batailles, et le nautonier au milieu des flots ; l’un et l'autre désirera de mourir avec gloire pour l'honneur de sa profession, et le Philosophe sera un lâche qui désertera son poste, qui abandonnera son vaisseau, et pour sauver sa vie, il jettera sa vertu comme un bouclier à la guerre ? Et où serait le juge qui le louerait d'une semblable conduite ? Et qui supporterait de voir Socrate en présence d'un tribunal, dans la contenance de l'humiliation, de l'abattement, sollicitant, mendiant aux pieds de ses juges quelques jours de vie ? Était-ce là le genre dans lequel il devait diriger sa défense ; ou bien devait-il, dans son discours, écartant toute bassesse, toute crainte, toute défiance, prendre le ton de la liberté, et parler un langage digne de la philosophie? Mais ce n'eût point été répondre à ses accusateurs. Il n'eût fait qu'enflammer l'animosité, que l'exaspérer davantage. Et comment une défense de cette nature aurait-elle été reçue de la part d'un tribunal composé de pervers, insolents par la forme de leur gouvernement, capables de tous les excès de la licence par le sentiment de leur autorité, ennemis de cette intrépidité de pensée et de discours qui est l'apanage de la liberté, et accoutumés uniquement au langage d'une continuelle adulation ? Elle ne l'aurait pas été mieux que ne le serait dans une orgie de débauchés la conduite d'un ami de la tempérance, qui ferait emporter les coupes, qui ferait mettre à la porte la musicienne jouant de la flûte, qui ferait enlever les couronnes, et qui voudrait empêcher ses convives de s'enivrer. II n'y eut donc aucun danger pour Socrate de garder le silence dans une conjoncture, où il ne pouvait parler avec la dignité convenable. Il ne dégrada point sa vertu. Il n'irrita point les passions de ses juges, et il leur endossa la honte et l'infamie de l'avoir condamné sans l'entendre. VIII. Socrate avait donc grand besoin de discourir auprès des Athéniens qui le jugeaient ! Il était âgé de soixante-dix ans. Il avait consacré cette longue carrière à l'étude de la philosophie et à la pratique de la vertu. Il n'avait jamais nui à personne. Pas un vice à lui reprocher. Les mœurs les plus pures. Les liaisons les plus honnêtes. Visant à l'utile dans toutes ses relations, et améliorant tous ceux qui l'approchaient. Tout cela ne l'arracha ni au tribunal, ni à la prison, ni à la mort ; et le court espace de quelques clepsydres (58), qu'on lui aurait accordé pour sa défense, l'aurait sauvé ? - Non, les clepsydres ne l'auraient pas pu, et cela leur eût-il été possible, Socrate n'en aurait point fait usage. Non, par Jupiter ; non, par tous les Dieux ! C'est tout comme si quelque sycophante sous les armes, admis dans le conseil du célèbre Léonidas lacédémonien, eût été d'avis de céder un peu de terrain, et de laisser faire une irruption à Xerxès ; Léonidas aurait repoussé cette proposition. Il eût mieux aimé périr à son poste, avec sa vertu, les armes à la main, que de se sauver en tournant le dos à un roi barbare. Eh ! qu'aurait été la défense de Socrate, que tourner le dos, que se. sauver avec lâcheté, que prendre une honteuse fuite ? Il resta donc ferme, il soutint le choc, il acquitta la dette de la valeur et du courage. Les Athéniens pensaient l'avoir condamné à la mort. Et Xerxès aussi pensait avoir vaincu Léonidas. Mais, par la mort de Léonidas, Xerxès fut vaincu lui-même ; par la mort de Socrate, les Athéniens aussi ont été condamnés à l'infamie. Ils l'ont été au tribunal des dieux, au tribunal de la vérité. Voici l'acte d'accusation de Socrate contre eux. Le peuple d'Athènes attente à la religion. Il ne regarde point comme dieux, ceux que Socrate regarde comme tels. Il en introduit de nouveaux. Socrate pense que Jupiter est le dieu de l'Olympe. Les Althèniens pensent que c'est Périclès (59). Socrate croit à Apollon (60), et les Athéniens jugent l'inverse de ce qu'a jugé ce dieu. Le peuple d'Athènes attente à la morale. Il corrompt les jeunes gens. C'est lui qui a perdu. Alcibiade, Hypponicus, et une infinité d'autres. O combien il y a de vérité dans cette accusation ! Combien il y a d'équité à ce tribunal ! Combien elle est grave cette condamnation ! Les impiétés envers Jupiter amenèrent la peste et la guerre du Péloponnèse. La corruption de la jeunesse produisit la catastrophe de Decélie, les revers en Sicile, et les désastres sur l'Hellespont. C'est ainsi que juge le tribunal des Dieux. Tels sont les arrêts qui en émanent. NOTES.
(1) Pacci
a traduit, omni subjecto philosophicum convenire sermonem. Heinsius n'a
fait que copier Pacci, omni subjecto convenire philosophiam. Lorsqu'on
aura lu la Dissertation, et qu'on en aura bien saisi l'objet, on choisira avec
connaissance de cause, entre ces deux versions et la mienne.
Paris, le 26 germinal an IX. (16 avril 1801.)
NOTES. Paris, le 28 Germinal an IX. (18 avril 1801.) NOTES.
(46) (1)
Platon et Xénophon nous ont laissé chacun une apologie de Socrate. Il résulte
de ces deux monuments de l'amitié et de la vénération, que Socrate, en
présence de ses juges, tint quelques discours pour répondre à ses
accusateurs. Il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre le titre de cette
Dissertation, et penser que Maxime de Tyr se soit mis en contradiction avec les
deux disciples de Socrate, qui ont écrit son apologie. Notre auteur a seulement
voulu dire que Socrate n'employa point pour sa défense, cet ensemble, ce
concours, cet appareil de moyens de tout genre qu'on met ordinairement en oeuvre
devant les tribunaux criminels. Paris, le 30 germinal an IX. (20 avril 1801) |