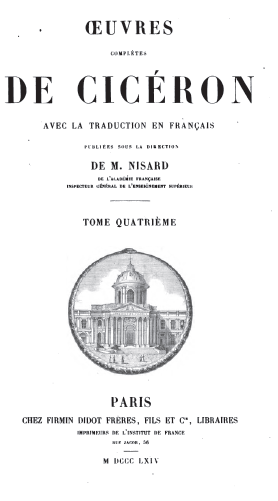|
Liber Secundus
1. Quem ad modum officia ducerentur ab honestate,
Marce fili, atque ab omni genere virtutis, satis explicatum arbitror libro
superiore. Sequitur, ut haec officiorum genera persequar, quae pertinent ad
vitae cultum et ad earum rerum, quibus utuntur homines, facultatem, ad opes, ad
copias [; in quo tur quaeri dixi, quid utile, quid inutile, tur ex utilibus quid
utilius aut quid maxime utile]. De quibus dicere aggrediar, si pauca prius de
instituto ac de iudicio meo dixero. Quamquam enim libri nostri complures
non modo ad legendi, sed etiam ad scribendi studium excitaverunt, tamen interdum
vereor, ne quibusdam bonis viris philosophiae nomen sit invisum mirenturque in
ea tantum me operae et temporis ponere. Ego autem, quam diu res publica per eos
gerebatur, quibus se ipsa commiserat, omnis meas curas cogitationesque in eam
conferebam; cum autem dominatu unius
omnia tenerentur neque esset usquam consilio aut auctoritati locus, socios
denique tuendae rei publicae, summos viros, amisissem, nec me angoribus dedidi,
quibus essem confectus, nisi iis restitissem, nec rursum indignis homine
docto voluptatibus. Atque utinam res publica stetisset, quo coeperat, statu nec
in homines non tam commutandarum quam evertendarum rerum cupidos incidisset!
Primum enim, ut stante re publica facere solebamus, in agendo plus quam in
scribendo operae poneremus, deinde ipsis scriptis non ea, quae nunc, sed
actiones nostras mandaremus, ut saepe fecimus. Cum autem res publica, in qua
omnis mea cura, cogitatio, opera poni solebat, nulla esset omnino, illae
scilicet litterae conticuerunt forenses et senatoriae. Nihil agere autem
cum animus non posset, in his studiis ab initio versatus aetatis existimavi
honestissime molestias posse deponi, si me ad philosophiam rettulissem. Cui cum
multum adulescens discendi causa temporis tribuissem, posteaquam honoribus
inservire coepi meque totum rei publicae tradidi, tantum erat philosophiae loci,
quantum superfuerat amicorum et rei publicae temporibus; id autem omne
consumebatur in legendo, scribendi otium non erat.
2. Maximis igitur in malis hoc tamen boni
assecuti videmur, ut ea litteris mandaremus, quae nec erant satis nota nostris
et erant cognitione dignissima. Quid enim est, per deos, optabilius sapientia,
quid praestantius, quid homini melius, quid homine dignius? Hanc igitur qui
expetunt, philosophi nominantur, nec quicquam aliud est philosophia, si
interpretari velis, praeter studium sapientiae. Sapientia autem est, ut a
veteribus philosophis definitum est, rerum divinarum et humanarum causarumque,
quibus eae res continentur, scientia; cuius studium qui vituperat, haud sane
intellego, quidnam sit, quod laudandum putet. Nam sive oblectatio
quaeritur animi requiesque curarum, quae conferri cum eorum studiis potest, qui
semper aliquid anquirunt, quod spectet et valeat ad bene beateque vivendum? sive
ratio constantiae virtutisque ducitur, aut haec ars est aut nulla omnino, per
quam eas assequamur. Nullam dicere maximarum rerum artem esse, cum minimarum
sine arte nulla sit, hominum est parum considerate loquentium atque in maximis
rebus errantium. Si autem est aliqua disciplina virtutis, ubi ea quaeretur, cum
ab hoc discendi genere discesseris? Sed haec, cum ad philosophiam cohortamur,
accuratius disputari solent, quod alio
quodam libro fecimus; hoc autem tempore tantum nobis declarandum fuit, cur
orbati rei publicae muneribus ad hoc nos studium potissimum contulissemus.
Occurritur autem nobis, et quidem a doctis et eruditis quaerentibus,
satisne constanter facere videamur, qui, cum percipi nihil posse dicamus, tamen
et aliis de rebus disserere soleamus et hoc ipso tempore praecepta officii
persequamur. Quibus vellem satis cognita esset nostra sententia. Non enim sumus
ii, quorum vagetur animus errore nec habeat umquam, quid sequatur. Quae enim
esset ista mens vel quae vita potius non modo disputandi, sed etiam vivendi
ratione sublata? Nos autem, ut ceteri alia certa, alia incerta esse dicunt, sic
ab his dissentientes alia probabilia, contra alia dicimus. Quid est igitur,
quod me impediat ea, quae probabilia mihi videantur, sequi, quae contra,
improbare atque affirmandi arrogantiam vitantem fugere temeritatem, quae a
sapientia dissidet plurimum? Contra autem omnia disputatur a nostris, quod hoc
ipsum probabile elucere non posset, nisi ex utraque parte causarum esset facta
contentio. Sed haec explanata sunt in Academicis nostris satis, ut arbitror,
diligenter. Tibi autem, mi Cicero, quamquam
in antiquissima nobilissimaque
philosophia Cratippo auctore versaris iis simillimo, qui ista
praeclara pepererunt, tamen haec nostra finitima vestris ignota esse nolui. Sed
iam ad instituta pergamus.
3. Quinque igitur rationibus propositis
officii persequendi, quarum duae ad decus honestatemque pertinerent, duae ad
commoda vitae, copias, opes, facultates, quinta ad eligendi iudicium, si quando
ea, quae dixi, pugnare inter se viderentur, honestatis pars confecta est, quam
quidem tibi cupio esse notissimam.
Hoc autem, de quo nune agimus, id ipsum est, quod “utile” appellatur. In quo
verbo lapsa consuetudo deflexit de via sensimque eo deducta est, ut honestatem
ab utilitate secernens constitueret esse honestum aliquid, quod utile non esset,
et utile, quod non honestum, qua nulla pernicies maior hominum vitae potuit
afferri. Summa quidem auctoritate philosophi severe sane atque honeste
haec tria genera confusa cogitatione distinguunt. [Quicquid enim iustum sit, id
etiam utile esse censent, itemque quod honestum, idem iustum; ex quo efficitur,
ut, quicquid honestum sit, idem sit utile.] Quod qui parum perspiciunt, ii saepe
versutos horines et callidos admirantes malitiam sapientiam iudicant.
Quorum error eripiendus est opinioque omnis ad eam spem traducenda, ut honestis
consiliis iustisque factis, non fraude et malitia se intellegant ea, quae velint,
consequi posse. Quae ergo ad vitam hominum tuendam pertinent, partim sunt
inanima, ut aurum, argentum, ut ea, quae gignuntur e terra, ut alia generis
eiusdem, partim animalia, quae habent suos impetus et rerum appetitus. Eorum
autem alia rationis expertia sunt, alia ratione utentia; expertes rationis equi,
boves, reliquae pecudes, [apes,] quarum opere efficitur aliquid ad usum hominum
atque vitam; ratione autem utentium duo genera ponunt, deorum unum, alterum
hominum. Deos placatos pietas efficiet et sanctitas, proxime autem et secundum
deos homines hominibus maxime utiles esse possunt. Earumque item rerum,
quae noceant et obsint, eadem divisio est. Sed quia deos nocere non putant, iis
exceptis homines hominibus obesse plurimum arbitrantur. Ea enim ipsa, quae
inanima diximus, pleraque sunt hominum operis effecta; quae nec haberemus, nisi
manus et ars accessisset, nec iis sine hominum administratione uteremur. Neque
enim valetudinis curatio neque navigatio neque agri cultura neque frugum
fructuumque reliquorum perceptio et conservatio sine hominum opera ulla
esse potuisset. Iam vero et earum rerum, quibus abundaremus, exportatio et
earum, quibus egeremus, invectio certe nulla esset, nisi his muneribus homines
fungerentur. Eademque ratione nec lapides ex terra exciderentur ad usum nostrum
necessarii, nec “ferrum, aes, aurum, argentum” effoderetur “penitus abditum”
sine hominum labore et manu.
4. Tecta vero, quibus et frigorum vis pelleretur
et calorum molestiae sedarentur, unde aut initio generi humano dari potuissent
aut postea subveniri, si aut vi tempestatis aut terrae motu aut vetustate
cecidissent, nisi communis vita ab hominibus harum rerum auxilia petere
didicisset? Adde ductus aquarum, derivationes fluminum, agrorum
irrigationes, moles oppositas fluctibus, portus manu factos, quae unde sine
hominum opere habere possemus? Ex quibus multisque aliis perspicuum est, qui
fructus quaeque utilitates ex rebus iis,quae sint inanimae,percipiantur,eas
nosnullo modo sine hominum manu atque opera capere potuisse. Qui denique ex
bestiis fructus aut quae commoditas, nisi homines adiuvarent, percipi posset?
Nam et qui principes inveniendi fuerunt, quem ex quaque belua usum habere
possemus, homines certe fuerunt, nec hoc tempore sine hominum opera aut pascere
eas aut domare aut tueri aut tempestivos fructus ex iis capere possemus; ab
eisdemque et, quae nocent, interficiuntur et, quae usui possunt esse, capiuntur.
Quid enumerem artium multitudinem, sine quibus vita omnino nulla esse potuisset?
Qui enim aegris subveniretur, quae esset oblectatio valentium, qui victus
aut cultus, nisi tam multae nobis artes ministrarent? quibus rebus exculta
hominum vita tantum distat a victu et cultu bestiarum. Urbes vero sine hominum
coetu non potuissent nec aedificari nec frequentari; ex quo leges moresque
constituti, tum iuris aequa discriptio certaque vivendi disciplina; quas res et
mansuetudo animorum consecuta et verecundia est effectumque, ut esset vita
munitior, atque ut dando et accipiendo mutuandisque facultatibus et commodandis
nulla re egeremus.
5. Longiores hoc loco sumus, quam necesse
est. Quis est enim, cui non perspicua sint illa, quae pluribus verbis a Panaetio
commemorantur, neminem neque ducem bello nec principem domi magnas res et
salutares sine hominum studiis gerere potuisse? Commemoratur ab eo Themistocles,
Pericles, Cyrus, Agesilaus, Alexander, quos negat sine adiumentis hominum tantas
res efficere potuisse. Utitur in re non dubia testibus non necessariis. Atque ut
magnas utilitates adipiscimur conspiratione hominum atque consensu, sic nulla
tam detestabilis pestis est, quae non homini ab homine nascatur.
Est Dicaearchi liber de
interitu hominum, Peripatetici magni et copiosi, qui collectis ceteris
causis eluvionis, pestilentiae, vastitatis, beluarum etiam repentinae
multitudinis, quarum impetu docet quaedam hominum genera esse consumpta, deinde
comparat, quanto plures deleti sint homines hominum impetu, id est bellis aut
seditionibus, quam omni reliqua calamitate. Cum igitur hie locus nihil
habeat dubitationis, quin homines plurimum hominibus et prosint et obsint,
proprium hoc statuo esse virtutis, conciliare animos hominum et ad usus suos
adiungere. Itaque, quae in rebus inanimis quaeque in usu et tractatione beluarum
fiunt utiliter ad hominum vitam, artibus ea tribuuntur operosis, hominum autem
studia ad amplificationem nostrarum rerum prompta ac parata [virorum
praestantium] sapientia et virtute excitantur. Etenim virtus omnis tribus
in rebus fere vertitur, quarum una est in perspiciendo, quid in quaque re verum
sincerumque sit, quid consentaneum cuique, quid consequens, ex quo quaeque
gignantur, quae cuiusque rei causa sit, alterum cohibere motus animi turbatos,
quos Graeci πάθη nominant, appetitionesque, quas illi ὁρμάς, oboedientes
efficere rationi, tertium iis, quibuscum congregemur, uti moderate et scienter,
quorum studiis ea, quae natura desiderat, expleta cumulataque habeamus, per
eosdemque, si quid importetur nobis incommodi, propulsemus ulciscamurque eos,
qui nocere nobis conati sint, tantaque poena afficiamus, quantam aequitas
humanitasque patitur.
6. Quibus autem rationibus hanc facultatem
assequi possimus, ut hominum studia complectamur eaque teneamus, dicemus, neque
ita multo post, sed pauca ante dicenda sunt. Magnam vim esse in fortuna in
utramque partem, vel secundas ad res vel adversas, quis ignorat? Nam et, cum
prospero flatu eius utimur, ad exitus pervehimur optatos et, cum reflavit,
affligimur. Haec igitur ipsa fortuna ceteros casus rariores habet, primum ab
inanimis procellas, tempestates, naufragia, ruinas, incendia, deinde a bestiis
ictus, morsus, impetus; haec ergo, ut dixi, rariora. At vero
interitus exercituum, ut proxime
trium, saepe multorum, clades imperatorum,
ut nuper summi et singularis viri,
invidiae praeterea multitudinis atque ob eas bene meritorum saepe civium
expulsiones, calamitates, fugae, rursusque secundae res, honores, imperia,
victoriae, quamquam fortuita sunt, tamen sine hominum opibus et studiis neutram
in partem effici possunt. Hoc igitur cognito dicendum est, quonam modo hominum
studia ad utilitates nostras allicere atque excitare possimus. Quae si longior
fuerit oratio, cum magnitudine utilitatis comparetur; ita fortasse etiam
brevior videbitur. Quaecumque igitur homines homini tribuunt ad eum
augendum atque honestandum, aut benivolentiae gratia faciunt, cum aliqua de
causa quempiam diligunt, aut honoris, si cuius virtutem suspiciunt, quemque
dignum fortuna quam amplissima putant, aut cui fidem habent et bene rebus suis
consulere arbitrantur, aut cuius opes metuunt, aut contra, a quibus aliquid
exspectant, ut cum reges popularesve homines largitiones aliquas proponunt, aut
postremo pretio ac mercede ducuntur, quae sordidissima, est illa quidem ratio et
inquinatissima et iis, qui ea tenentur, et illis, qui ad eam confugere conantur;
male enim se res habet, cum, quod virtute effici debet, id temptatur pecunia.
Sed quoniam non numquam hoc subsidium necessarium est, quem ad modum sit utendum
eo, dicemus, si prius iis de rebus, quae virtuti propiores sunt, dixerimus.
Atque etiam subiciunt se homines imperio alterius et potestati de causis
pluribus. Ducuntur enim aut benivolentia aut beneficiorum magnitudine aut
dignitatis praestantia aut spe sibi id utile futurum aut metu ne vi parere
cogantur, aut spe largitionis promissisque capti aut postremo, ut saepe in
nostra re publica videmus, mercede conducti.
7. Omnium autem rerum nec aptius est
quicquam ad opes tuendas ac tenendas quam diligi nec alienius quam timeri.
Praeclare enim Ennius:
Quem metuunt, oderunt; quem quisque odit, periisse
expetit.
Multorum autem odiis nullas opes posse obsistere,
si antea fuit ignotum, nuper est cognitum. Nec vero huius tyranni solum, quem
armis oppressa pertulit civitas ac paret cum maxime mortuo, interitus declarat,
quantum odium hominum valeat ad pestem, sed reliquorum similes exitus tyrannorum,
quorum haud fere quisquam talem interitum effugit; malus enim est custos
diuturnitatis metus contraque benivolentia fidelis vel ad perpetuitatem.
Sed iis, qui vi oppresses imperio coercent, sit sane adhibenda saevitia, ut eris
in famulos, si aliter teneri non possunt; qui vero in libera civitate ita se
instruunt, ut metuantur, iis nihil potest esse dementius. Quamvis enim sint
demersae leges alicuius opibus, quamvis timefacta libertas, emergunt tamen haec
aliquando aut iudiciis tacitis aut occultis de honore suffragiis. Acriores autem
morsus sunt intermissae libertatis quam retentae. Quod igitur latissime
patet neque ad incolumitatem solum, sed etiam ad opes et potentiam valet
plurimum, id amplectamur, ut metus absit, caritas retineatur. Ita facillime,
quae volemus, et privatis in rebus et in re publica consequemur. Etenim qui se
metui volent, a quibus metuentur, eosdem metuant ipsi necesse est. Quid
enim censemus superiorem ilium Dionysium quo cruciatu timoris angi solitum, qui
cultros metuens tonsorios candente carbone sibi adurebat capillum? quid
Alexandrum Pheraeum quo animo vixisse
arbitramur? qui, ut scriptum legimus, cum uxorem Theben admodum diligeret,
tamen ad ear ex epulis in cubiculum veniens barbarum, et eum quidem, ut scriptum
est, compunctum notis Thraeciis, destricto gladio iubebat anteire
praemittebatque de stipatoribus suis, qui scrutarentur arculas muliebres et, ne
quod in vestimentis telum occultaretur, exquirerent. O miserum, qui fideliorem
et barbarum et stigmatiari putaret quam coniugem! Nec eum fefellit; ab ea est
enim ipsa propter pelicatus suspicionem interfectus. Nec vero ulla vis imperii
tanta est, quae premente metu possit esse diuturna.
Testis est Phalaris, cuius est
praeter ceteros nobilitata crudelitas, qui non ex insidiis interiit, ut is, quem
modo dixi, Alexander, non a paucis, ut hic noster, sed in quem universa
Agrigentinorum multitude impetum fecit. Quid? Macedones nonne Demetrium
reliquerunt universique se ad Pyrrhum contulerunt? Quid? Lacedaemonios
iniuste imperantes nonne repente omnes fere socii deseruerunt spectatoresque se
otiosos praebuerunt Leuctricae calamitatis?
8. Externa libentius in tali re quam domestica
recordor. Verum tamen, quam diu imperium populi Romani beneficiis tenebatur, non
iniuriis, bella aut pro sociis aut de imperio gerebantur, exitus erant bellorum
aut mites aut necessarii, regum, populorum, nationum portus erat et refugium
senatus, nostri autem magistratus imperatoresque ex hac una re maximam
laudem capere studebant, si provincias, si socios aequitate et fide defendissent;
itaque illud patrocinium orbis terrae verius quam imperium poterat nominari.
Sensim hanc consuetudinem et disciplinam iam antea minuebamus, post vero Sullae
victoriam penitus amisimus; desitum est enim videri quicquam in socios iniquum,
cum exstitisset in cives tanta crudelitas. Ergo in illo secuta est honestam
causam non honesta victoria; est enim ausus dicere, hasta posita cum bona in
foro venderet et bonorum virorum et locupletium et certe civium, “praedam se
suam vendere.” Secutus est,
qui in causa impia, victoria etiam foediore non singulorum civium bona
publicaret, sed universas provincias regionesque uno calamitatis iure
comprehenderet. Itaque vexatis ac perditis exteris nationibus ad exemplum amissi
imperii portari in triumpho Massiliam vidimus et ex ea urbe triumphari, sine qua
numquam nostri imperatores ex Transalpinis bellis triumpharunt. Multa praeterea
commemorarem nefaria in socios, si hoc uno quicquam sol vidisset indignius, lure
igitur plectimur. Nisi enim multorum impunita scelera tulissemus, numquam ad
unum tanta pervenisset licentia; a quo quidem rei familiaris ad paucos,
cupiditatum ad multos improbos venit hereditas. Nec vero umquam bellorum
civilium semen et causa deerit, dum homines perditi hastam illam cruentam et
meminerint et sperabunt; quam P. Sulla cum vibrasset dictatore propinquo suo,
idem sexto tricesimo anno post a sceleratiore hasta non recessit;
alter autem, qui in illa dictatura
scriba fuerat, in hac fuit quaestor urbanus. Ex quo debet intellegi talibus
praemiis propositis numquam defutura bella civilia. Itaque parietes modo urbis
stant et manent, iique ipsi iam extrema scelera metuentes, rem vero publicam
penitus amisimus. Atque in has clades incidimus (redeundum est enim ad
propositum), dum metui quam carl esse et diligi malumus. Quae si populo
Romano iniuste imperanti accidere potuerunt, quid debent putare singuli? Quod
cum perspicuum sit, benivolentiae vim esse magnam, metus imbecillam, sequitur,
ut disseramus, quibus rebus facillime possimus eam, quam volumus, adipisci cum
honore et fide caritatem. Sed ea non pariter omnes egemus; nam ad cuiusque
vitam institutam accommodandum est, a multisne opus sit an satis sit a paucis
diligi. Certum igitur hoc sit, idque et primum et maxime necessarium,
familiaritates habere fidas amantium nos amicorum et nostra mirantium; haec enim
una res prorsus, ut non multum differat inter summos et mediocris viros, aeque
utrisque est propemodum comparanda. Honore et gloria et benivolentia
civium fortasse non aeque omnes egent, sed tamen, si cui haec suppetunt,
adiuvant aliquantum cum ad cetera, tum ad amicitias comparandas.
9. Sed de amicitia alio libro dictum est, qui
inscribitur Laelius; nunc dicamus de gloria, quamquam ea quoque de re
duo sunt nostri libri, sed
attingamus, quandoquidem ea in rebus maioribus administrandis adiuvat plurimum.
Summa igitur et perfecta gloria constat ex tribus [0] his: si diligit multitude,
si fidem habet, si cum admiratione quadam honore dignos putat. Haec autem, si
est simpliciter breviterque dicendum, quibus rebus pariuntur a singulis, eisdem
fere a multitudine. Sed est alius quoque quidam aditus ad multitudinem, ut in
universorum animos tamquam influere possimus. Ac primum de illis tribus,
quae ante dixi, benivolentiae praecepta videamus; quae quidem capitur beneficiis
maxime, secundo autem loco voluntate benefica benivolentia movetur, etiamsi res
forte non suppetit; vehementer autem amor multitudinis commovetur ipsa fama et
opinione liberalitatis, beneficentiae, iustitiae, fidei omniumque earum virtutum,
quae pertinent ad mansuetudinem morum ac facilitatem. Etenim illud ipsum, quod
honesturn decorumque dicimus, quia per se nobis placet animosque omnium natura
et specie sua commovet maximeque quasi perlucet ex iis, quas commemoravi,
virtutibus, idcirco illos, in quibus eas virtutes esse remur, a natura ipsa
diligere cogimur. Atque hae quidem causae diligendi gravissimae; possunt enim
praetcrea non nullae esse leviores. Fides autem ut habeatur, duabus rebus
effici potest, si existimabimur adepti coniunctam cum iustitia prudentiam. Nam
et iis fidem habemus, quos plus intellegere quam nos arbitramur quosque et
futura prospicere credimus et, cum res agatur in discrimenque ventum sit,
expedire rem et consilium ex tempore capere posse; hanc enim utilem homines
existimant veramque prudentiam. Iustis autem et fidis hominibus, id est bonis
viris, ita fides habetur, ut nulla sit in iis fraudis iniuriaeque suspicio.
Itaque his salutem nostram, his fortunas, his liberos rectissime committi
arbitramur. Harum igitur duarum ad fidem faciendam iustitia plus pollet,
quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis, prudentia sine iustitia
nihil valet ad faciendam fidem. Quo enim quis versutior et callidior, hoc
invisior et suspectior est detracta opinione probitatis. Quam ob rem
intellegentiae iustitia coniuncta, quantum volet, habebit ad faciendam fidem
virium; iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit
prudentia.
10. Sed ne quis sit admiratus, cur, cum
inter omnes philosophos constet a meque ipso saepe disputatum sit, qui unam
haberet, omnes habere virtutes, nune ita seiungam, quasi possit quisquam, qui
non idem prudens sit, iustus esse, alia est illa, cum veritas ipsa limatur in
disputatione, subtilitas, alia, cum ad opinionem communem omnis accommodatur
oratio. Quam ob rem, ut volgus, ita nos hoc loco loquimur, ut alios
fortes, alios viros bonos, alios prudentes esse dicamus; popularibus enim verbis
est agendum et usitatis, cum loquimur de opinione populari, idque eodem modo
fecit Panaetius. Sed ad propositum revertamur. Erat igitur ex iis tribus,
quae ad gloriam pertinerent, hoc tertium, ut cum admiratione hominum honore ab
iis digni iudicaremur. Admirantur igitur communiter illi quidem omnia, quae
magna et praeter opinionem suam animadverterunt, separatim autem, in singulis si
perspiciunt necopinata quaedam bona. Itaque eos viros suspiciunt maximisque
efferunt laudibus, in quibus existimant se excellentes quasdam et singulares
perspicere virtutes, despiciunt autem eos et contemnunt, in quibus nihil
virtutis, nihil animi, nihil nervorum putant. Non enim omnes eos contemnunt, de
quibus male existimant. Nam quos improbos, maledicos, fraudulentos putant et ad
faciendam iniuriam instructos, eos haud contemnunt quidem, sed de iis male
existimant. Quam ob rem, ut ante dixi, contemnuntur ii, qui “nec sibi nec alteri,”
ut dicitur, in quibus nullus labor, nulla industria, nulla cura est.
Admiratione autem afficiuntur ii, qui anteire ceteris virtute putantur et cum
omni carere dedecore, tum vero iis vitiis, quibus alii non facile possunt
obsistere. Nam et voluptates, blandissimae dominae. maioris partis animos a
virtute detorquent et, dolorum cum admoventur faces, praeter modum plerique
exterrentur; vita mors, divitiae paupertas omnes homines vehementissime
permovent. Quae qui in utramque partem excelso animo magnoque despiciunt, cumque
aliqua iis ampla et honesta res obiecta est, totos ad se convertit et rapit, tum
quis non admiretur splendorem pulchritudinemque virtutis?
11. Ergo et haec animi despicientia
admirabilitatem magnam facit et maxime iustitia, ex qua una virtute viri boni
appellantur, mirifica quaedam multitudini videtur, nec iniuria; nemo enim iustus
esse potest, qui mortem, qui dolorem, qui exsilium, qui egestatem timet, aut qui
ea, quae sunt his contraria, aequitati anteponit. Maximeque admirantur eum, qui
pecunia non movetur; quod in quo viro perspectum sit, hunc igni spectatum
arbitrantur. Itaque illa tria, quae proposita sunt ad gloriarm omnia iustitia
conficit, et benivolentiam, quod prodesse vult plurimis, et ob eandem causam
fidem et admirationem, quod eas res spernit et neglegit, ad quas plerique
inflammati aviditate rapiuntur. Ac mea quidem sententia omnis ratio atque
institutio vitae adiumenta hominum desiderat, in primisque ut habeat, quibuscum
possit familiares conferre sermones; quod est difficile, nisi speciem prae te
boni viri feras. Ergo etiam solitario homini atque in agro vitam agenti opinio
iustitiae necessaria est, eoque etiam magis, quod, eam si non habebunt, [iniusti
habebuntur,] nullis praesidiis saepti multis afficientur iniuriis.
Atque iis etiam, qui vendunt emunt, conducunt locant contrahendisque negotiis
implicantur, iustitia ad rem gerendam necessaria est, cuius tanta vis est, ut ne
illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla particula
iustitiae vivere. Nam qui eorum cuipiam, qui una latrocinantur, furatur aliquid
aut eripit, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum, ille autem, qui
archipirata dicitur, nisi aequabiliter praedam dispertiat, aut interficiatur a
sociis aut relinquatur; quin etiam leges latronum esse dicuntur, quibus pareant,
quas observent. Itaque propter aequabilem praedae partitionem et
Bardulis Illyrius latro, de quo
est apud Theopompum, magnas opes habuit et multo maiores Viriathus Lusitanus;
cui quidem etiam exercitus nostri
imperatoresque cesserunt; quem C. Laelius, is qui Sapiens usurpatur, praetor
fregit et comminuit ferocitatemque eius ita repressit, ut facile bellum
reliquis traderet. Cum igitur
tanta vis iustitiae sit, ut ea etiam latronum opes firmet atque augeat, quantam
eius vim inter leges et iudicia et in constituta re publica fore putamus?
12. Mihi quidem non apud Medos solum, ut ait
Herodotus, sed etiam apud maiores nostros iustitiae fruendae causa videntur olim
bene morati reges constituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui
maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem;
qui cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis
pari iure retinebat. Eademque constituendarum legum fuit causa, quae regum.
Ius enim semper est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius. Id si ab
uno iusto et bono viro consequebantur, erant eo contenti; cum id minus
contingeret, leges sunt inventae, quae cum omnibus semper una atque eadem voce
loquerentur. Ergo hoc quidem perspicuum est, eos ad imperandum deligi solitos,
quorum de iustitia magna esset opinio multitudinis. Adiuncto vero, ut idem etiam
prudentes haberentur, nihil erat, quod homines iis auctoribus non posse consequi
se arbitrarentur. Omni igitur ratione colenda et retinenda iustitia est cum ipsa
per sese (nam aliter iustitia non esset), turn propter amplificationem honoris
et gloriae. Sed ut pecuniae non quaerendae solum ratio est, verum etiam
collocandae, quae perpetuos sumptus suppeditet, nec solum necessaries, sed etiam
liberales, sic gloria et quaerenda et collocanda ratione est. Quamquam
praeclare Socrates hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat
esse, si quis id ageret, ut, qualis haberi vellet, talis esset. Quodsi qui
simulatione et inani ostentatione et ficto non modo sermone, sed etiam voltu
stabilem se gloriam consequi posse rentur, vehementer errant. Vera gloria
radices agit atque etiam propagatur, ficta omnia celeriter tamquam flosculi
decidunt, nee simulatum potest quicquam esse diuturnum. Testes sunt permulti in
utramque partem, sed brevitatis causa familia contenti erimus una.
Ti. enim Gracchus P. f. tam diu
laudabitur, dum memoria rerum Romanarum manebit; at eius filii nec vivi
probabantur bonis et mortui numerum optinent iure caesorum.
13. Qui igitur adipisci veram gloriam volet,
iustitiae fungatur officiis. Ea quae essent, dictum est in libro superiore.
Sed ut facillime, quales simus, tales esse videamur, etsi in eo ipso vis maxima
est, ut simus ii, qui haberi velimus, tamen quaedam praecepta danda sunt. Nam si
quis ab ineunte aetate habet causam celebritatis et nominis aut a patre acceptam,
quod tibi, mi Cicero, arbitror contigisse, aut aliquo casu atque fortuna, in
hunc oculi omnium coniciuntur atque in eum, quid agat, quem ad modum vivat,
inquiritur et, tamquam in clarissima luce versetur, ita nullum obscurum potest
nec dictum eius esse nec factum. Quorum autem prima aetas propter
humilitatem et obscuritatem in hominum ignoratione versatur, ii, simul ac
iuvenes esse coeperunt, magna spectare et ad ea rectis studiis debent contendere;
quod eo firmiore animo facient, quia non modo non invidetur illi aetati, verum
etiam favetur. Prima igitur est adulescenti commendatio ad gloriam, si qua ex
bellicis rebus comparari potest, in qua multi apud maiores nostros exstiterunt;
semper enim fere bella gerebantur. Tua autem aetas incidit in id bellum, cuius
altera pars sceleris nimium habuit, altera felicitatis parum. Quo tamen in bello
cum te Pompeius alae [alteri] praefecisset, magnam laudern et a summo viro et ab
exercitu consequebare equitando, iaculando, omni militari labore tolerando.
Atque ea quidem tua laus pariter cum re publica cecidit. Mihi autem haec oratio
suscepta non de te est, sed de genere toto; quam ob rein pergarnus ad ea, quae
restant. Ut igitur in reliquis rebus multo maiora opera sunt animi quam
corporis, sic eae res, quas ingenio ac ratione persequimur, gratiores sunt quam
illae, quas viribus. Prima igitur commendatio proficiscitur a modestia cum
pietate in parentes, in suos benivolentia. Facillime autem et in optimam partem
cognoscuntur adulescentes, qui se ad claros et sapientes viros bene consulentes
rei publicae contulerunt; quibuscum si frequentes sunt, opinionem afferunt
populo eorum fore se similes, quos sibi ipsi delegerint ad imitandum.
P. Rutili adulescentiam ad opinionem et innocentiae et iuris scientiae
P. Muci commendavit domus. Nam
L. quidem Crassus, cum esset admodum adulescens, non aliunde mutuatus est,
sed sibi ipse peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili et gloriosa, et,
qua aetate qui exercentur, laude affici solent, ut de Demosthene accepimus, ea
aetate L. Crassus ostendit id se in foro optime iam facere, quod etiam tum
poterat domi cum laude meditari.
14. Sed cum duplex ratio sit orationis,
quarum in altera sermo sit, in altera contentio, non est id quidem dubium, quin
contentio [orationis] maiorem vim habeat ad gloriam (ea est enim, quam
eloquentiam dicimus); sed tamen difficile dictu est, quantopere conciliet animos
comitas affabilitasque sermonis. Exstant epistulae et Philippi ad Alexandrum et
Antipatri ad Cassandrum et Antigoni ad Philippum filium, trium prudentissimorum
(sic enim accepimus); quibus praecipiunt, ut oratione benigna multitudinis
animos ad benivolentiam alliciant militesque blande appellando [sermone]
deliniant. Quae autem in multitudine cum contentione habetur oratio, ea saepe
universam excitat [gloriam]; magna est enim admiratio copiose sapienterque
dicentis; quem qui audiunt, intellegere etiam et sapere plus quam ceteros
arbitrantur. Si vero inest in oratione mixta modestia gravitas, nihil
admirabilius fieri potest, eoque magis, si ea sunt in adulescente. Sed cum
sint plura causarum genera, quae eloquentiam desiderent, multique in nostra re
publica adulescentes et apud iudices et apud populum et apud senatum dicendo
laudem assecuti sint, maxima est admiratio in iudiciis. Quorum ratio duplex est.
Nam ex accusatione et ex defensione constat; quarum etsi laudabilior est
defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est. Dixi paulo ante de Crasso;
idem fecit adulescens M. Antonius.
Etiam P. Sulpici eloquentiam accusatio illustravit, cum seditiosum et inutilem
civem, C. Norbanum, in iudicium vocavit. Sed hoc quidem non est saepe
faciendum nec umquam nisi aut rei publicae causa, ut ii, quos ante dixi, aut
ulciscendi, ut duo Luculli, aut patrocinii, ut nos pro Siculis, pro Sardis
in Albucio Iulius.
In accusando etiam M'. Aquilio
L. Fufi cognita industria est. Semel igitur aut non saepe certe. Sin erit, cui
faciendum sit saepius, rei publicae tribuat hoc muneris, cuius inimicos ulcisci
saepius non est reprehendendum; modus tamen adsit. Duri enim hominis vel
potius vix hominis videtur periculum capitis inferre multis. Id cum periculosum
ipsi est, turn etiam sordidum ad famam, committere, ut accusator nominere; quod
contigit M. Bruto summo genere nato, illius filio, qui iuris civilis in primis
peritus fuit. Atque etiam hoc praeceptum officii diligenter tenendum est,
ne quem umquam innocentem iudicio capitis arcessas; id enim sine scelere fieri
nullo pacto potest. Nam quid est tam inhumanum quam eloquentiam a natura ad
salutem hominum et ad conservationem datam ad bonorum pestem perniciemque
convertere? Nec tamen, ut hoc fugiendum est, item est habendum religioni
nocentem aliquando, modo ne nefarium impiumque, defendere; vult hoc multitude,
patitur consuetudo, fert etiam humanitas. Iudicis est semper in causis verum
sequi, patroni non numquam veri simile, etiamsi minus sit verum, defendere; quod
scribere, praesertim cum de philosophia scriberem, non auderem, nisi idem
placeret gravissimo Stoicorum, Panaetio. Maxime autem et gloria paritur et
gratia defensionibus, eoque maior, si quando accidit, ut ei subveniatur, qui
potentis alicuius opibus circumveniri urguerique videatur, ut nos et saepe alias
et adulescentes contra L. Sullae dominantis opes pro Sex. Roscio Amerino
fecimus, quae, ut scis, exstat oratio.
15. Sed expositis adulescentium officiis,
quae valeant ad gloriam adipiscendam, deinceps de beneficentia ac de
liberalitate dicendum est; cuius est ratio duplex; nam aut opera benigne fit
indigentibus aut pecunia. Facilior est haec posterior, locupleti praesertim, sed
illa lautior ac splendidior et viro forti claroque dignior. Quamquam enim in
utroque inest gratificandi liberalis voluntas, tamen altera ex area, altera ex
virtute depromitur, largitioque, quae fit ex re familiari, fontem ipsum
benignitatis exhaurit. Ita benignitate benignitas tollitur; qua quo in plures
usus sis, eo minus in multos uti possis. At qui opera, id est virtute et
industria, benefici et liberales erunt, primum, quo pluribus profuerint, eo
plures ad benigne faciendum adiutores habebunt, dein consuetudine beneficentiae
paratiores erunt et tamquam exercitatiores ad bene de multis promerendum.
Praeclare in epistula quadam Alexandrum filium Philippus accusat, quod
largitione benivolentiam Macedonum consectetur:“Quae te, malum!” inquit, “ratio
in istam spem induxit, ut eos tibi fideles putares fore, quos pecunia
corrupisses? An tu id agis, ut Macedones non te regem suum, sed ministrum et
praebitorem sperent fore?” Bene “ministrum et praebitorem,” quia sordidum
regi, melius etiam, quod largitionem “corruptelam” dixit esse; fit enim deterior,
qui accipit, atque ad idem semper exspectandum paratior. Hoc ille filio,
sed praeceptum putemus omnibus. Quam ob rem id quidem non dubium est, quin illa
benignitas, quae constet ex opera et industria, et honestior sit et latius
pateat et possit prodesse pluribus; non numquam tamen est largiendum, nec hoc
benignitatis genus omnino repudiandum est et saepe idoneis hominibus
indigentibus de re familiari impertiendum, sed diligenter atque moderate; multi
enim patrimonia effuderunt inconsulte largiendo. Quid autem est stultius quam,
quod libenter facias, curare, ut id diutius facere non possis? Atque etiam
sequuntur largitionem rapinae; cum enim dando egere coeperunt, alienis bonis
manus afferre coguntur. Ita, cum benivolentiae comparandae causa benefici esse
velint, non tanta studia assequuntur eorum, quibus dederunt, quanta odia eorum,
quibus ademerunt. Quam ob rem nec ita claudenda res est familiaris, ut eam
benignitas aperire non possit, nec ita reseranda, ut pateat omnibus; modus
adhibeatur, isque referatur ad facultates. Omnino meminisse debemus, id
quod a nostris hominibus saepissime usurpatum iam in proverbii consuetudinem
venit, “largitionem fundum non habere”; etenim quis potest modus esse, cum et
idem, qui consuerunt, et idem illud alii desiderent?
16. Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri
prodigi, alteri liberales: prodigi, qui epulis et viscerationibus et gladiatorum
muneribus, ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt in eas res, quarum
memoriam aut brevem aut nullam omnino sint relicturi, liberales autem, qui
suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt aut aes alienum suscipiunt
amicorum aut in filiarum collocatione adiuvant aut opitulantur in re vel
quaerenda vel augenda. Itaque miror, quid in mentem venerit Theophrasto in eo
libro, quem de divitiis scripsit; in quo multa praeclare, illud absurde: est
enim multus in laudanda magnificentia et apparatione popularium munerum
taliumque sumptuum facultatem fructum divitiarum putat. Mihi autem ille fructus
liberalitatis, cuius pauca exempla posui, multo et maior videtur et certior.
Quanto Aristoteles gravius et verius nos reprehendit! qui has pecuniarum
effusiones non admiremur, quae fiunt ad multitudinem deliniendam. Ait enim,
“qui ab hoste obsidentur, si emere aquae sextarium cogerentur mina, hoc primo
incredibile nobis videri, omnesque mirari, sed cum attenderint, veniam
necessitati dare, in his immanibus iacturis infinitisque sumptibus nihil nos
magnopere mirari, cum praesertim neque necessitati subveniatur nec dignitas
augeatur ipsaque illa delectatio multitudinis ad breve exiguumque tempus
capiatur, eaque a levissimo quoque, in quo tamen ipso una cum satietate memoria
quoque moriatur voluptatis.” Bene etiam colligit, “haec pueris et
mulierculis et servis et servorum simillimis liberis esse grata, gravi vero
homini et ea, quae fiunt, iudicio certo ponderanti probari posse nullo modo.”
Quamquam intellego in nostra civitate inveterasse iam bonis temporibus,
ut splendor aedilitatum ab
optimis viris postuletur. Itaque et P. Crassus cum cognomine dives, turn copiis
functus est aedilicio maximo munere, et paulo post L. Crassus cum omnium hominum
moderatissimo Q. Mucio magnificentissima aedilitate functus est, deinde C.
Claudius App. f., multi post, Luculli, Hortensius, Silanus; omnes autem P.
Lentulus me consule vicit superiores; hunc est Scaurus imitatus;
magnificentissima vero nostri Pompei munera secundo consulatu; in quibus
omnibus quid mihi placeat, vides.
17. Vitanda tamen suspicio est avaritiae.
Mamerco, homini divitissimo, praetermissio aedilitatis consulatus repulsam
attulit. Quare et, si postulatur a populo, bonis viris si non desiderantibus, at
tamen approbantibus faciundum est, modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus,
et, si quando aliqua res maior atque utilior populari largitione acquiritur,
ut Oresti nuper prandia in
semitis decumae nomine magno honori fuerunt. Ne M. quidem Seio vitio datum est,
quod in caritate asse modium populo dedit; magna enim se et inveterata invidia
nec turpi iactura, quando erat aedilis, nec maxima liberavit. Sed honori summo
nuper nostro Miloni fuit, qui gladiatoribus emptis rei publicae causa, quae
salute nostra continebatur, omnes P. Clodi conatus furoresque compressit. Causa
igitur largitionis est, si aut necesse est aut utile. In his autem ipsis
mediocritatis regula optima est. L. quidem Philippus Q. f., magno vir ingenio in
primisque clarus, gloriari solebat se sine ullo munere adeptum esse omnia,
quae haberentur amplissima. Dicebat idem Cotta, Curio. Nobis quoque licet in hoc
quodam modo gloriari; nam pro amplitudine honorum, quos cunctis suffragiis
adepti sumus nostro quidem anno, quod contigit eorum nemini, quos modo nominavi,
sane exiguus sumptus aedilitatis fuit. Atque etiam illae impensae meliores,
muri, navalia, portus, aquarum ductus omniaque, quae ad usum rei publicae
pertinent. Quamquam, quod praesens tamquam in manum datur, iucundius est; tamen
haec in posterum gratiora. Theatra, porticus, nova templa verecundius reprehendo
propter Pompeium, sed doctissimi non probant, ut et hic ipse Panaetius, quem
nultum in his libris secutus sum, non interpretatus, et Phalereus Demetrius, qui
Periclem, principem Graeciae, vituperat, quod tantam pecuniam in praeclara illa
propylaea coniecerit. Sed de hoc genere toto in iis libris, quos de re publica
scripsi, diligenter est disputatum. Tota igitur ratio talium largitionum genere
vitiosa est, temporibus necessaria, et turn ipsum et ad facultates accommodanda
et mediocritate moderanda est.
18. In illo autem altero genere largiendi,
quod a liberalitate proficiscitur, non uno modo in disparibus causis
affecti esse debemus. Alia causa est eius, qui calamitate premitur, et eius, qui
res meliores quaerit nullis suis rebus adversis. Propensior benignitas
esse debebit in calamitosos, nisi forte erunt digni calamitate. In iis tamen,
qui se adiuvari volent, non ne affligantur, sed ut altiorem gradum ascendant,
restricti omnino esse nullo modo debemus, sed in deligendis idoneis iudicium et
diligentiam adhibere. Nam praeclare Ennius:
Bene facta male locata male facta arbitror.
Quod autem tributum est bono viro et grato,
in eo cum ex ipso fructus est, tum etiam ex ceteris. Temeritate enim remota
gratissima est liberalitas, eoque eam studiosius plerique laudant, quod summi
cuiusque bonitas commune perfugium est omnium. Danda igitur opera est, ut iis
beneficiis quam plurimos afficiamus, quorum memoria liberis posterisque prodatur,
ut iis ingratis esse non liceat. Omnes enim immemorem beneficii oderunt eamque
iniuriam in deterrenda liberalitate sibi etiam fieri eumque, qui faciat,
communem hostem tenuiorum putant. Atque haec benignitas etiam rei publicae est
utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores; quod quidem
volgo solitum fieri ab ordine nostro in oratione Crassi scriptum copiose videmus.
Hanc ergo consuetudinem benignitatis largitioni munerum longe antepono; haec est
gravium hominum atque magnorum, illa quasi assentatorum populi multitudinis
levitatem voluptate quasi titillantium. Conveniet autem cum in dando
munificum esse, tum in exigendo non acerbum in omnique re contrahenda, vendundo
emendo, conducendo locando, vicinitatibus et confiniis, aequum, facilem, multa
multis de suo iure cedentem, a litibus vero, quantum liceat et nescio an paulo
plus etiam, quam liceat, abhorrentem. Est enim non modo liberale paulum non
numquam de suo iure decedere, sed interdum etiam fructuosum. Habenda autem ratio
est rei familiaris, quam quidem dilabi sinere flagitiosum est, sed ita, ut
illiberalitatis avaritiaeque absit suspicio; posse enim liberalitate uti non
spoliantem se patrimonio nimirum est pecuniae fructus maximus. Recte etiam a
Theophrasto est laudata hospitalitas; est enim, ut mihi quidem videtur, valde
decorum patere domus hominum illustrium hospitibus illustribus, idque etiam rei
publicae est ornamento, homines externos hoc liberalitatis genere in urbe nostra
non egere. Est autem etiam vehementer utile iis, qui honeste posse multum
volunt, per hospites apud externos populos valere opibus et gratia. Theophrastus
quidem scribit Cimonem Athenis etiam in suos curiales Laciadas hospitalem
fuisse; ita enim instituisse et vilicis imperavisse, ut omnia praeberentur,
quicumque Laciades in villam suam devertisset.
19. Quae autem opera, non largitione
beneficia dantur, haec turn in universam rem publicam, turn in singulos cives
conferuntur. Nam in iure cavere [, consilio iuvare,] atque hoc scientiae genere
prodesse quam plurimis vehementer et ad opes augendas pertinet et ad gratiam.
Itaque cum multa praeclara maiorum, turn quod optime constituti iuris civilis
summo semper in honore fuit cognitio atque interpretatio; quam quidem ante hanc
confusionem temporum in possessione sua principes retinuerunt, nunc, ut honores,
ut omnes dignitatis gradus, sic huius scientiae splendor deletus est, idque eo
indignius, quod eo tempore hoc contigit,
cum is esset, qui omnes
superiores, quibus honore par esset, scientia facile vicisset. Haec igitur
opera grata multis et ad beneficiis obstringendos homines accommodata.
Atque huic arti finitima est dicendi [gravior] facultas et gratior et ornatior.
Quid enim eloquentia praestabilius vel admiratione audientium vel spe
indigentium vel eorum, qui defensi sunt, gratia? Huic [quoque] ergo a maioribus
nostris est in toga dignitatis principatus datus. Diserti igitur hominis et
facile laborantis, quodque in patriis est moribus, multorum causas et non
gravate et gratuito defendentis beneficia et patrocinia late patent.
Admonebat me res, ut hoc quoque loco intermissionem eloquentiae, ne dicam
interitum, deplorarem, ni vererer, ne de me ipso aliquid viderer queri. Sed
tamen videmus, quibus exstinctis oratoribus quam in paucis spes, quanto in
paucioribus facultas, quam in multis sit audacia. Cum autem omnes non possint,
ne multi quidem, aut iuris periti esse aut diserti, licet tamen opera prodesse
multis beneficia petentem, commendantem iudicibus, magistratibus, vigilantem pro
re alterius, eos ipsos, qui aut consuluntur aut defendunt, rogantem; quod qui
faciunt, plurimum gratiae consequuntur, latissimeque eorum manat industria.
Iam illud non sunt admonendi (est enim in promptu), ut animadvertant, cum iuvare
alios velint, ne quos offendant. Saepe enim aut eos laedunt, quos non
debent, aut eos, quos non expedit; si imprudentes, neglegentiae est, si scientes,
temeritatis. Utendum etiam est excusatione adversus eos, quos invitus offendas,
quacumque possis, quare id, quod feceris, necesse fuerit nec aliter facere
potueris, ceterisque aperis et officiis erit id, quod violatum videbitur,
compensandum.
20. Sed cum in hominibus iuvandis aut mores
spectari aut fortuna soleat, dictu quidem est proclive, itaque volgo loquuntur,
se in beneficiis collocandis mores hominum, non fortunam sequi. Honesta oratio
est; sed quis est tandem, qui inopis et optimi viri causae non anteponat in
opera danda gratiam fortunati et potentis? a quo enim expeditior et celerior
remuneratio fore videtur, in eum fere est voluntas nostra propensior. Sed
animadvertendum est diligentius, quae natura rerum sit. Nimirum enim inops ille,
si bonus est vir, etiamsi referre gratiam non potest, habere certe potest.
Commode autem, quicumque dixit, “pecuniam qui habeat, non reddidisse, qui
reddiderit, non habere, gratiam autem et, qui rettulerit, habere et, qui habeat,
rettulisse.” At qui se locupletes, honoratos, beatos putant, ii ne obligari
quidem beneficio volunt; quin etiam beneficium se dedisse arbitrantur, cum ipsi
quamvis magnum aliquod acceperint, atque etiam a se aut postulari aut
exspectari aliquid suspicantur, patrocinio vero se usos aut clientes appellari
mortis instar putant. At vero ille tenuis, cum, quicquid factum sit, se
spectatum, non fortunam putet, non modo illi, qui est meritus, sed etiam illis,
a quibus exspectat (eget enim multis), gratum se videri studet neque vero verbis
auget suum munus, si quo forte fungitur, sed etiam extenuat. Videndumque illud
est, quod, si opulentum fortunatumque defenderis, in uno illo aut, si forte, in
liberis eius manet gratia; sin autem inopem, probum tamen et modestum, omnes non
improbi humiles, quae magna in populo multitude est, praesidium sibi paratum
vident. Quam ob rem melius apud bonos quam apud fortunatos beneficium
collocari puto. Danda omnino opera est, ut omni generi satis facere possimus;
sed si res in contentionem veniet, nimirum Themistocles est auctor adhibendus;
qui cum consuleretur, utrum bono viro pauperi an minus probato diviti filiam
collocaret: “Ego vero,” inquit, “malo virum, qui pecunia egeat, quam pecuniam,
quae viro.” Sed corrupti mores depravatique sunt admiratione divitiarum;
quarum magnitudo quid ad unum quemque nostrum pertinet? Illum fortasse adiuvat,
qui habet. Ne id quidem semper; sed fac iuvare; utentior sane sit, honestior
vero quo modo? Quodsi etiam bonus erit vir, ne impediant divitiae, quo minus
iuvetur, modo ne adiuvent, sitque omne iudicium, non quam locuples, sed qualis
quisque sit! Extremum autem praeceptum in beneficiis operaque danda, ne quid
contra aequitatem contendas, ne quid pro iniuria; fundamentum enim est perpetuae
commendationis et famae iustitia, sine qua nihil potest esse laudabile.
21. Sed, quoniam de eo genere beneficiorum
dictum est, quae ad singulos spectant, deinceps de iis, quae ad universos
quaeque ad rem publicam pertinent, disputandum est. Eorum autem ipsorum partim
eius modi sunt, ut ad universos cives pertineant, partim, singulos ut attingant;
quae sunt etiam gratiora. Danda opera est omnino, si possit, utrisque, nec
minus, ut etiam singulis consulatur, sed ita, ut ea res aut prosit aut certe ne
obsit rei publicae. C. Gracchi frumentaria magna largitio; exhauriebat igitur
aerarium; modica M. Octavi et rei publicae tolerabilis et plebi necessaria;
ergo et civibus et rei publicae salutaris. In primis autem videndum erit
ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis
privatorum publice deminutio fiat. Perniciose enim Philippus, in tribunatu cum
legem agrariam ferret, quam tamen antiquari facile passus est et in eo
vehementer se moderatum praebuit—sed cum in agendo multa populariter, tum illud
male, “non esse in civitate duo milia hominum, qui rem baberent.” Capitalis
oratio est, ad aequationem bonorum pertinens; qua peste quae potest esse maior?
Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque
constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur hominess, tamen spe
custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant. Danda etiam opera est,
ne, quod apud maiores nostros saepe fiebat propter aerarii tenuitatem
assiduitatemque bellorum, tributum sit conferendum, idque ne eveniat, multo ante
erit providendum. Sin quae necessitas huius muneris alicui rei publicae
obvenerit (malo enim quam nostrae ominari; neque tamen de nostra, sed de
omni re publica disputo), danda erit opera, ut omnes intellegant, si salvi esse
velint, necessitati esse parendum. Atque etiam omnes, qui rem publicam
gubernabunt, consulere debebunt, ut earum rerum copia sit, quae sunt necessariae.
Quarum qualis comparatio fieri soleat et debeat, non est necesse disputare; est
enim in promptu; tantum locus attingendus fuit. Caput autem est in omni
procuratione negotii et muneris publici, ut avaritiae pellatur etiam minima
suspicio. “Utinam,” inquit C. Pontius Samnis, “ad illa tempora me fortuna
reservavisset et tum essem natus, quando Romani dona accipere coepissent! non
essem passus diutius eos imperare.” Ne illi multa saecula exspectanda fuerunt;
modo enim hoc malum in hanc rem publicam invasit. Itaque facile patior tum
potius Pontium fuisse, siquidem in illo tantum fuit roboris. Nondum centum et
decem anni sunt, cum de pecuniis repetundis
a L. Pisone lata lex est,
nulla antea cum fuisset. At vero postea tot leges et proximae quaeque duriores,
tot rei, tot damnati, tantum [Italicum] bellum propter iudiciorum metum
excitatum, tanta sublatis legibus et iudiciis expilatio direptioque sociorum, ut
imbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus.
22.
Laudat Africanum Panaetius,
quod fuerit abstinens. Quidni laudet? Sed in illo alia maiora; laus
abstinentiae non hominis est solum, sed etiam temporum illorum. Omni Macedonum
gaza, quae fuit maxima, potitus [est] Paulus tantum in aerarium pecuniae invexit,
ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributorum. At hic nihil domum suam
intulit praeter memoriam nominis sempiternam. Imitatus patrem Africanus nihilo
locupletior Carthagine eversa. Quid? qui eius collega fuit in censura. L.
Mummius, numquid copiosior, cum
copiosissimam urbem funditus sustulisset? Italiam ornare quam domum suam
maluit; quamquam Italia ornata domus ipsa mihi videtur ornatior. Nullum
igitur vitium taetrius est, ut eo, unde egressa est, referat se oratio, quam
avaritia, praesertim in principibus et rem publicam gubernantibus. Habere enim
quaestui rem publicam non modo turpe est, sed sceleratum etiam et nefarium.
Itaque, quod Apollo Pythius oraclum edidit, Spartam nulla re alia nisi avaritia
esse perituram, id videtur non solum Lacedaemoniis, sed etiam omnibus opulentis
populis praedixisse. Nulla autem re conciliare facilius benivolentiam
multitudinis possunt ii, qui rei publicae praesunt, quam abstinentia et
continentia. Qui vero se populares volunt ob eamque causam aut agrariam
rem temptant, ut possessores pellantur suis sedibus, aut pecunias creditas
debitoribus condonandas putant, labefactant fundamenta rei publicae,
concordiam primum, quae esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur
pecuniae, deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum cuique non
licet. Id enim est proprium, ut supra dixi, civitatis atque urbis, ut sit libera
et non sollicita suae rei cuiusque custodia. Atque in hac pernicie rei
publicae ne illam quidem consequuntur, quam putant, gratiam; nam cui res erepta
est, est inimicus, cui data est, etiam dissimulat se accipere voluisse et maxime
in pecuniis creditis occultat suum gaudium, ne videatur non fuisse solvendo; at
vero ille, qui accepit iniuriam, et meminit et prae se fert dolorem suum, nec,
si plures sunt ii, quibus inprobe datum est, quam illi, quibus iniuste ademptum
est, idcirco plus etiam valent; non enim numero haec iudicantur, sed pondere.
Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut etiam saeculis ante
possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem habuit, amittat?
23. Ac propter hoc iniuriae genus
Lacedaemonii Lysandrum ephorum expulerunt, Agim regem, quod numquam antea apud
eos acciderat, necaverunt, exque eo tempore tantae discordiae secutae sunt,
ut et tyranni exsisterent
et optimates exterminarentur et praeclarissime constituta res publica
dilaberetur; nec vero solum ipsa cecidit, sed etiam reliquam Graeciam evertit
contagionibus malorum, quae a Lacedaemoniis profectae manarunt latius. Quid?
nostros Gracchos, Ti. Gracchi summi viri filios,
Africani nepotes, nonne
agrariae contentiones perdiderunt? At vero Aratus Sicyonius iure laudatur,
qui, cum eius civitas quinquaginta annos a tyrannis teneretur, profectus Argis
Sicyonem clandestine introitu urbe est potitus, cumque tyrannum Nicoclem
improviso oppressisset, sescentos exsules, qui locupletissimi fuerant eius
civitatis, restituit remque publicam adventu suo liberavit. Sed cum magnam
animadverteret in bonis et possessionibus difficultatem, quod et eos, quos ipse
restituerat, quorum bona alii possederant, egere iniquissimum esse arbitrabatur
et quinquaginta annorum possessiones moveri non nimis aequum putabat, propterea
quod tam longo spatio multa hereditatibus, multa emptionibus, multa dotibus
tenebantur sine iniuria, iudicavit neque illis adimi nec iis non satis fieri,
quorum illa fuerant, oportere. Cum igitur statuisset opus esse ad eam rem
constituendam pecunia, Alexandream se proficisci velle dixit remque integram ad
reditum suum iussit esse, isque celeriter ad Ptolomaeum, suum hospitem, venit,
qui turn regnabat alter post Alexandream conditam. Cui cum exposuisset patriam
se liberare velle causamque docuisset, a rege opulento vir summus facile
impetravit, ut grandi pecunia adiuvaretur. Quam cum Sicyonem attulisset,
adhibuit sibi in consilium quindecim principes, cum quibus causas cognovit et
eorum, qui aliena tenebant, et eorum, qui sua amiserant, perfecitque aestimandis
possessionibus, ut persuaderet aliis, ut pecuniam accipere mallent,
possessionibus cederent, aliis, ut commodius putarent numerari sibi, quod tanti
esset, quam suum recuperare. Ita perfectum est, ut omnes concordia constituta
sine querella discederent. O virum magnum dignumque, qui in re publica
nostra natus esset! Sic par est agere cum civibus, non, ut bis iam vidimus,
hastam in foro ponere et bona civium voci subicere praeconis. At ille Graecus,
id quod fuit sapientis et praestantis viri, omnibus consulendum putavit, eaque
est summa ratio et sapientia boni civis, commoda civium non divellere atque
omnis aequitate eadem continere. Habitent gratis in alieno. Quid ita? ut,
cum ego emerim, aedificarim, tuear, impendam, tu me invito fruare meo? Quid est
aliud aliis sua eripere, aliis dare aliena? Tabulae vero novae quid habent
argumenti, nisi ut emas mea pecunia fundum, eum tu habeas, ego non habeam
pecuniam?
24. Quam ob rem ne sit aes alienum, quod rei
publicae noceat, providendum est, quod multis rationibus caveri potest, non, si
fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum; nec enim ulla
res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi
erit necessaria solutio rerum creditarum. Numquam vehementius actum est quam me
consule, ne solveretur; armis et castris temptata res est ab omni genere hominum
et ordine; quibus ita restiti, ut hoc totum malum de re publica tolleretur.
Numquam nec maius aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est;
fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est. At vero
hic nunc victor, tum quidem
victus, quae cogitarat, ea perfecit, cum eius iam nihil interesset. Tanta in
eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret, peccare, etiamsi causa non
esset. Ab hoc igitur genere largitionis, ut aliis detur, aliis
auferatur, aberunt ii, qui rem publicam tuebuntur, in primisque operam dabunt,
ut iuris et iudiciorum aequitate suum quisque teneat et neque tenuiores propter
humilitatem circumveniantur neque locupletibus ad sua vel tenenda vel
recuperanda obsit invidia, praeterea, quibuscumque rebus vel belli vel domi
poterunt, rem publicam augeant imperio, agris, vectigalibus. Haec magnorum
hominum sunt, haec apud maiores nostros factitata, haec genera officiorum qui
persequentur, cum summa utilitate rei publicae magnam ipsi adipiscentur et
gratiam et gloriam. In his autem utilitatum praeceptis Antipater Tyrius Stoicus,
qui Athenis nuper est mortuus, duo praeterita censet esse a Panaetio,
valetudinis curationem et pecuniae; quas res a summo philosopho praeteritas
arbitror, quod essent faciles; sunt certe utiles. Sed valetudo sustentatur
notitia sui corporis et observatione, quae res aut prodesse soleant aut obesse,
et continentia in victu omni atque cultu corporis tuendi causa [praetermittendis
voluptatibus], postremo arte eorum, quorum ad scientiam haec pertinent.
Res autem famniliaris quaeri debet iis rebus, a quibus abest turpitude,
conservari autem diligentia et parsimonia, eisdem etiam rebus augeri. Has res
commodissime Xenophon Socraticus persecutus est in eo libro, qui Oeconomicus
inscribitur, quem nos, ista fere
aetate cum essemus, qua es tu nunc, e Graeco in Latinum convertimus. Sed
toto hoc de genere, de quaerenda, de collocanda pecunia (vellem etiam de utenda),
commodius a quibusdam optimis viris
ad Ianum medium sedentibus
quam ab ullis philosophis ulla in schola disputatur. Sunt tamen ea cognoscenda;
pertinent enim ad utilitatem, de qua hoc libro disputatum est.
25. Sed utilitatum comparatio, quoniam hic
locus erat quartus, a Panaetio praetermissus, saepe est necessaria. Nam et
corporis commoda cum externis [et externa cum corporis] et ipsa inter se
corporis et externa cum externis comparari solent. Cum externis corporis hoc
modo comparantur, valere ut malis quam dives esse, [cum corporis externa hoc
modo, dives esse potius quam maximis corporis viribus,] ipsa inter se corporis
sic, ut bona valetudo voluptati anteponatur, vires celeritati, externorum autem,
ut gloria divitiis, vectigalia urbana rusticis. Ex quo genere
comparationis illud est Catonis
senis: a quo cum quaereretur, quid maxime in re familiari expediret,
respondit: “Bene pascere”; quid secundum: “Satis bene pascere”; quid tertium:
“Male pascere”; quid quartum: “Arare”; et cum ille, qui quaesierat, dixisset:
“Quid faenerari?”, tum Cato: “Quid hominem,” inquit, “occidere?” Ex quo et
multis aliis intellegi debet utilitatum comparationes fieri solere, recteque hoc
adiunctum esse quartum exquirendorum officiorum genus. Reliqua deinceps
persequemur.. |
LIVRE SECOND.
I. Je crois, mon fils, avoir assez
expliqué dans le livre précédent comment de l'honnête et des vertus
dérive toute une série de devoirs. Il me reste maintenant à parler
d'une nouvelle espèce de devoirs, de ceux qui se rapportent aux
divers soins de la vie, à l'acquisition de tout ce qui est utile à
l'homme, aux richesses, au pouvoir. C'est ici que nous devons
rechercher ce qui est utile ou nuisible , et entre plusieurs choses
utiles, laquelle l'est le plus, laquelle l'est souverainement.
Toutes ces questions vont nous occuper, quand j'aurai dit d'a-
464 bord quelques
mots du dessein que j'ai formé d'écrire cet ouvrage, et des raisons
qui m'y ont déterminé. Quoique mes livres aient développé chez mes
concitoyens le goût de la lecture, quoiqu'ils aient même formé
quelques auteurs, parfois il m'arrive encore de craindre que
certains hommes de bien ne secouent l'oreille au seul mot de
philosophie, et ne s'étonnent que je consacre tant de veilles et
d'application à cette étude Je leur pourrais dire qu'aussi longtemps
que la république fut gouvernée par ceux aux mains de qui elle s
était remise, tous mes soins, toutes mes pensées furent pour elle.
Mais lorsque tout fut soumis à la domination d'un seul, lorsqu'il
devint impossible de consacrer ses lumières et son autorité au
service de son pays, lorsqu'enfin j'eus perdu ces grands hommes avec
qui j'avais défendu la république, je ne voulus point me livrer au
chagrin qui m'eût accablé si je n'avais recueilli mon courage, ni
m'abandonner à des voluptés indignes d'un homme éclairé. Plût à Dieu
que la république se fût maintenue dans son premier état, et qu'elle
eût échappé aux mains de ces hommes plus jaloux de la ruiner que
d'en changer la face! Alors, comme à l'époque où elle était encore
debout, je serais plutôt occupé à agir qu'à écrire ; et quand
j'écrirais, je ne composerais pas comme en ce moment des livres de
philosophie, mais je rédigerais, comme je l'ai fait souvent, mes
discours publics. Mais du moment où la république, à qui je vouais
tous mes soins, toutes mes pensées, tous mes travaux, a été
anéantie, il n'a plus fallu songer à méditer et à écrire pour le
barreau ou pour le sénat. Cependant mon esprit ne pouvait souffrir
l'inaction; et j'ai pensé qu'il n'y avait pas de parti plus honnête
pour m'arrachera mes peines, que de me reporter aux études qui
avaient nourri ma jeunesse, et de me tourner de nouveau vers la
philosophie. Dans les premiers temps de ma vie, je m'y étais
appliqué longuement et avec un grand zèle; une fois entré dans la
carrière des honneurs et dévoué tout entier aux affaires de mon
pays, je réservais encore pour la philosophie le temps que ne
réclamaient ni mes amis ni la république; mais je l'employais
uniquement en lectures ; il faut pour écrire des loisirs que je
n'avais pas.
II. Au milieu de si grandes
infortunes, je regarde cependant comme un bonheur d'avoir pu
répandre par mes écrits des connaissances qui n'étaient pas assez
familières à mes concitoyens, et qui méritaient cependant au plus
haut degré de provoquer leur attention. Qu'y a-t-il en effet, au nom
des Dieux , de plus désirable que la sagesse? Qu'y a-t-il de plus
excellent? Quoi de meilleur pour l'homme et de plus digue de lui?
Ceux qui la recherchent sont nommés philosophes, et la philosophie
n'est rien autre chose, si vous voulez entendre la signification du
mot, que l'étude de la sagesse. Or, la sagesse, selon la
définition des anciens philosophes, est la connaissance des choses
divines et humaines, et des causes de tout ce qui existe. Si l'on
blâme une telle étude, je ne sais vraiment laquelle on tiendra digne
d'estime. En effet, si l'on cherche à récréer son esprit et à faire
trêve aux graves soucis du monde, peut-on mieux s'adresser qu'à
cette étude dont l'unique but est de nous apprendre à bien vivre et
de nous faire rencontrer le bonheur? Si l'on veut fortifier son
courage et sa vertu, ou c'est à la philosophie qu'il faut recourir,
ou il n'est 465 aucun
art pour seconder nos efforts. Dire qu'il n'est point d'art dans les
grandes choses, tandis qu'il y en a pour les plus petites, ce serait
parler fort légèrement et se tromper sur un point capital. Si l'on
accorde qu'il y a des règles pour parvenir à la vertu, où les
trouver hors de la science dont nous parlons? Ce sont là des vérités
sur lesquelles nous insistons davantage, quand nous exhortons les
hommes à la philosophie ; et c'est ce que nous avons fait dans un
autre ouvrage. Ici j'ai seulement voulu déclarer pourquoi, lorsque
la carrière politique m'a été fermée, je me suis tourné de
préférence vers ces études. Mais je dois encore répondre à quelques
hommes instruits et éclairés qui me demandent s'il est bien
conséquent, à un philosophe qui soutient qu'on ne peut rien
connaître avec certitude, de venir disserter sar divers sujets, et
d'entreprendre ici même de donner des préceptes de momie. Je
voudrais que le fond de ma pensée leur fût mieux connu; car je ne
suis pas de ceux dont l'esprit flotte dans une incertitude absolue,
et ne sait où se prendre. Que deviendrait l'intelligence, ou plutôt
la vie elle-même, si nous n'avions plus aucune règle non-seulement
pour nous former des opinions, mais pour diriger notre conduite? Les
autres philosophes soutiennent qu'il y a des choses certaines et des
choses incertaines ;nous soutenons, nous, qu'il y a seulement des
choses probables et des choses improbables; voilà toute la
différence. Qu'est-ce donc qui pourrait m'empêcher de suivre ce qui
me paraît probable et de condamner ce qui a le caractère opposé,
tout en évitant d'affirmer les choses avec cette confiance téméraire
et ce ton tranchant qui convient si peu au sage? Nos philosophes ont
soin de discuter contre chaque pro-
465 position, parce que la
vraisemblance que nous cherchons ne peut jaillir que du choc des
sentiments opposés. Mais nous avons, je crois, suffisamment éclairci
toutes ces questions dans nos Académiques. Pour vous, mon cher
enfant, quoique la philosophie la plus ancienne et la plus noble
vous soit enseignée par Cratippe, par un maître si semblable aux
premiers chefs de cette belle école, je n'ai pas voulu cependant que
vous fussiez dans l'ignorance de nos maximes, qui ont tant de
rapports avec les vôtres. Mais revenons à notre sujet.
III. Nous avons divisé toute la
question des devoirs en cinq chefs principaux : les deux premiers
comprennent ce qui touche l'honnêteté et la bienséance ; les deux
suivants, ce qui est relatif à l'utile, à la richesse, aux biens, au
pouvoir ; le cinquième a pour objet de régler notre choix entre
l'utile et l'honnête, lorsqu'ils semblent se combattre. Notre tâche
est accomplie en ce qui regarde l'honnête ; et je souhaite que vous
graviez dans votre mémoire tout ce qui en a été dit. Nous devons
nous occuper maintenant de ce qu'on nomme l'utile. L'usage a
détourné ce mot de sa véritable acception, au point
qu'insensiblement on en est venu à séparer l'utile de l'honnête, et
à penser qu'il y a des choses honnêtes qui ne sont pas utiles, et
des choses utiles qui ne sont pas honnêtes. Il n'est pas de préjugé
plus déplorable que celui-là. Des philosophes d'une très-grande
autorité distinguent par la pensée seulement ces trois choses, le
juste, l'honnête et l'utile, et prouvent excellemment qu'au fond
elles ne sont qu'une même chose. Selon eux, tout ce qui est juste
est utile; et, d'un autre côté, tout ce qui est honnête étant juste,
ii s'ensuit que tout ce qui est honnête
466 est utile. Ceux à qui
ces vérités échappent admirent souvent les hommes fourbes et
habiles, et prennent leur malice pour de la sagesse. Il faut leur
ôter cette erreur; il faut leur donner cette conviction et cette
belle espérance, qu'ils arriveront au terme de leurs désirs par des
vues honnêtes et de bonnes actions, et jamais par le mal et
l'injustice. Parmi les objets qui nous peuvent être utiles, il en
est d'inanimés, comme l'or, l'argent, les productions de la terre et
bien d'autres du même genre ; il en est d'animés qui ont leurs
mouvements propres et des impulsions naturelles. De ceux-ci, les uns
sont doués de raison, les autres en sont privés. Il faut ranger
parmi ces derniers les chevaux, les bœufs, les autres quadrupèdes,
les abeilles, qui sont nos serviteurs, ou dont les travaux nous
profitent. Les êtres doués de raison se divisent en deux classes,
les hommes et les Dieux. La piété et la sainteté de la vie nous
rendent les Dieux propices : mais immédiatement après les Dieux, ce
sont les hommes qui peuvent être le plus utiles à leurs semblables.
La même division s'applique aux êtres qui nous sont nuisibles et
hostiles. Toutefois, il faut en excepter les Dieux, qui jamais ne
font de mal aux hommes. Mais aussi les plus grands maux que nous
éprouvions nous viennent de nos semblables. La plupart des choses
utiles sont l'ouvrage de l'homme ; nous en sommes redevables au
travail de nos mains et au génie des arts, et pour en faire usage,
les hommes doivent s'entr'aider. La médecine, la navigation,
l'agriculture, la récolte et la conservation des grains et des
autres fruits de la terre, sont entièrement l'ouvrage de l'homme.
Sans l'industrie des hommes, il ne faudrait pas songer à
l'exportation des objets que nous avons en abondance, nia
l'importation de ceux qui nous manquent. Comment les pierres
sortiraient-elles du sein de la terre pour nos usages? comment le
fer, le cuivre, l'argent et l'or, si profondément enfouis,
paraîtraient-ils au jour sans le travail de la main des hommes?
IV. Quant aux maisons, qui nous
mettent à l'abri du froid et nous défendent contre les chaleurs
excessives, comment l'homme aurait-il pu d'abord les construire et
ensuite les relever, quand les tempêtes ou les tremblements de terre
les auraient renversées, ou qu'elles seraient tombées de vétusté, si
la vie commune n'avait appris aux hommes à se prêter leurs de
mutuels secours pour ces divers travaux? Ajoutons id la conduite des
eaux, la dérivation des fleuves, l'irrigation des champs, les digues
opposées aux flots, les ports que la nature n'avait pas creusés: à
qui revient l'honneur de tous ces bienfaits, si ce n'est aux hommes
et à leurs travaux ? On voit clairement par ces exemples et par une
foule d'autres que toute l'utilité que nous tirons des objets
inanimés, nous ne pourrions y prétendre sans le secours de
l'industrie humaine. On en peut dire autant des animaux ; nous ne
pourrions nom en servir sans l'aide de nos semblables. Ce sont les
hommes qui ont découvert l'usage que Ton peut faire de chaque animal
; ce sont les hommes qui domptent les animaux sauvages, qui font
paître les troupeaux, les gardent, leur font rendre, suivant les
saisons, les services et les profits attendus; ce sont eux qui
détruisent les animaux nuisibles, et prennent ceux qui peuvent
devenir utiles. Est-il besoin d'énumérer toute cette multitude
d'arts 467 sans
lesquels la vie de l'homme ne pourrait se soutenir? Quels
soulagements aurions-nous dans la maladie, quelles jouissances dans
la santé, quelle nourriture, quels vêtements, si des arts de toutes
sortes ne s'empressaient à nous servir? Ce sont eux qui ont embelli
la vie des hommes et l'ont rendue si différente de celle des bêtes.
Les villes, sans le concours des hommes, n'auraient pu être ni
bâties ni habitées. Mais les cités se forment, les lois et les
coutumes prennent naissance; les règles du droit s'établissent, et
avec elles les maximes publiques et la discipline des mœurs. C'est
de cette façon que les esprits des hommes s'adoucirent, qu'ils
vinrent à se respecter mutuellement, qu'ils vécurent avec sécurité,
et qu'en donnant et en recevant ils purent, par un échange mutuel de
services et de biens, satisfaire à tous les besoins de la vie.
V. Je me suis étendu ici plus qu'il
n'était nécessaire. Il n'est pas besoin, en effet, d'écouter les
longues démonstrations de Panétius pour comprendre que
très-certainement les chefs d'armée et les politiques n'auraient pu
rien faire de grand et d'utile sans le secours des hommes Panétius
cite Thémistocle, Périclès, Cyrus, Agésilas, Alexandre, et soutient
que jamais ils n'auraient fait de si grandes choses, s'ils n'avaient
été secondés par les peuples. Il n'est guère de vérité plus
évidente, et dans une telle cause les témoins étaient fort inutiles.
Mais si les hommes peuvent retirer les plus grands biens de leur
union et de la communauté de leurs efforts, par contre il n'est
sorte de mal que l'homme ne fasse à son semblable. Un habile et
savant péripatéticien, Dicéarque, a écrit sur la destruction de
l'homme un livre où il énumère d'abord tous les déluges, les pestes,
les ravages de toutes sortes, les incursions des bêtes féroces qui
viennent en troupe. détruire des peuplades entières; puis il montre
que les guerres et les séditions, en un mot la fureur de leurs
semblables, a fait périr bien plus d'hommes que toutes les autres
calamités réunies. Puisqu'il est hors de doute que les hommes ne
puissent s'aider ou se nuire beaucoup les uns aux autres, nous
devons reconnaître en premier lieu que le propre de la vertu est de
nous concilier l'esprit de nos semblables et de le tourner à notre
avantage. L'utilité que l'on retire pour les divers besoins de la
vie, soit de la matière inerte, soit des animaux, nous la devons à
des arts dont la pratique est en général très-pénible ; mais c'est à
la sagesse et aux vertus des grands hommes que nous devons la
bienveillance de nos semblables, et ce zèle que nous leur voyons
souvent pour nos intérêts. Il faut comprendre que la vertu se
reconnaît nécessairement à l'un de ces trois offices : ou elle
découvre la véritable nature de chaque chose, et nous fait
comprendre quelles en sont les propriétés, les tendances, l'origine,
la cause, les effets; ou bien elle réprime les mouvements déréglés
de l'âme, que les Grecs appellent πάθη, et soumet au joug de la
raison les appétits, qu'Us nomment ὁρμάς; ou
enfin elle se manifeste par une telle modération et une telle
prudence à l'égard de ceux avec qui nous vivons, que nous puissions
par leur concours nous procurer tous les biens que demande la
nature, repousser les injures dont nous serions menacés, nous venger
de ceux qui auraient entrepris de nous nuire, et les punir autant
que la justice et l'humanité le permettent.
VI. Nous dirons dans un moment par
quels 468 moyens
l'homme peut se concilier et conserver la bienveillance de ses
semblables; mais une observation est nécessaire auparavant. Personne
n'ignore combien la fortune a de part à nos prospérités et à nos
adversités. Lorsqu'elle nous est favorable, tout nous succède à
souhait ; et lorsqu'elle nous devient contraire, les malheurs
fondent sur nous. Le hasard seul amène certains accidents graves,
mais assez rares ; les uns nous viennent des choses inanimées, comme
les orages, les tempêtes, les naufrages, les écroulements, les
incendies; les autres delà part des animaux, comme leurs coups,
leurs morsures, leurs violences. Mais des malheurs tels que la
destruction des armées, catastrophe que nous avons eu à déplorer
trois fois naguère, et dont l'histoire nous montre tant d'exemples;
ou bien encore les revers signalés des généraux, comme ceux du grand
homme que nous avons vu succomber dernièrement ; la haine acharnée
de la multitude et ses tristes effets, tels que l'exil, la fuite,
les infortunes des hommes qui ont bien mérité de leur patrie , et,
d'un autre côté, les succès, les honneurs, les commandements, les
victoires ; toutes ces choses-là, quoique dépendant du hasard, sont
aussi le fait de la volonté des hommes et de leurs dispositions
envers nous. Cette vérité reconnue, nous allons expliquer par quels
moyens l'homme peut captiver la bienveillance de ses semblables et
les rendre propices à ses intérêts. Si les développements où je vais
entrer vous paraissent un peu longs, songez à l'importance du sujet,
et peut-être les trouverez-vous encore trop courts. Tout ce que font
les hommes pour servir ou pour honorer un de leurs semblables, ils
le font ou par bienveillance , lorsqu'ils ont un attachement
particulier pour sa personne; ou par respect, lorsqu'ils ont conçu
une haute idée de sa vertu, et qu'ils le jugent digne delà plus
brillante fortune ; ou parée qu'ils ont confiance en lui, et le
croient bien porté pour leurs propres intérêts; ou parce qu'ils
craignent sa puissance, ou encore parce qu'ils attendent quelque
fruit de ses services, comme les rots ou les hommes populaires,
quand ils promettent de répandre des largesses ; ou enfin parce
qu'ils vendent leurs bons offices et ont quelque récompense pour
appât : mobile odieux, et qui souille également ceux qu'il conduit
et ceux qui sont réduits à le mettre en jeu. C'est un grand malheur
en effet que d'acheter à prix d'or ce qu'on devrait obtenir par
l'ascendant de la vertu. Comme il faut cependant employer
quelquefois ce fâcheux auxiliaire, nous dirons de quelle manière on
doit l'employer, après avoir parlé des biens qui sont plus
particulièrement réservés au crédit de la vertu. Les hommes se
soumettent de même au pouvoir et au commandement d'un autre homme
par plusieurs motifs : ce qui les y porte, c'est tantôt la
bienveillance, tantôt les bienfaits considérables qu'ils ont reçus ;
c'est le grand nom do chef, ou l'espoir défaire leur chemin, ou la
crainte d'être forcés plus tard à prendre ce parti, ou l'attrait des
largesses et des récompenses, ou enfin, comme nous l'avons vu
souvent dans notre république, l'argent qui fait d'eux des
mercenaires.
VIL Pour réussir en ce monde et
arriver à la fortune, il n'est pas de meilleur moyen que de se faire
aimer, et de pire que de se faire craindre. En-ni us a parfaitement
dit : «Celui qu'on craint, on le hait; et celui que l'on hait, on
voudrait le voir mort. » Aucune fortune ne peut résister à la haine
publique : si nous l'avions ignoré jusqu'à ces der-
469 niers temps, nous
devons le savoir aujourd'hui. Et la fin tragique du tyran dont les
armes ont asservi notre patrie, et qui la tient encore opprimée tout
mort qu'il est, ne prouve pas seule combien est fatale la haine d'un
peuple ; mais tous les tyrans au besoin en feraient foi, car il n'en
est guère qui n'aient péri de mort violente. La crainte qu'on
inspire est un mauvais satellite, tandis que la bienveillance est
une gardienne fidèle, qui nous donnerait l'immortalité, s'il était
possible. Sans doute ceux qui gouvernent des peuples opprimés par la
force doivent user de rigueur, s'ils ne peuvent les tenir autrement
dans l'obéissance, et imiter la conduite des maîtres envers leurs
esclaves ; mais que, dans une ville libre, on se comporte de façon à
se faire craindre, c'est le comble de la démence. Vous aurez bien le
pouvoir d'imposer silence aux lois et d'intimider la liberté ; mais
elles se réfugieront dans le sanctuaire des consciences, et
prendront leur revanche dans les suffrages secrets pour les charges
publiques. Les morsures de la liberté ne sont jamais plus terribles
que lors¬qu'on lui a mis des entraves. Prenons donc la voie la
meilleure, non pas seulement pour couler nos jours en sûreté, mais
pour vivre fortunés et puissants; faisons-nous aimer, et veillons à
n'inspirer jamais de crainte. C'est ainsi que nous arriverons le
plus facilement au terme de nos entreprises, et dans la vie privée
et dans la carrière politique. Celui qui veut qu'on le craigne doit
nécessairement craindre lui-même ceux qui tremblent sous lui. Que
penserons-nous d'un Denys l'Ancien? Quelles n'étaient pas les
terreurs de cet homme, qui, redoutant jusqu'à la main d'un barbier,
se brûlait la barbe avec des charbons ardents ! Et Alexan¬dre
dePhères, dans quelles angoisses ne vivait-il pas? Jugez-en par ce
que l'histoire nous rapporte : il aimait éperdument sa femme Thébé,
et cependant il ne quittait jamais la salle du festin pour venir la
trouver, qu'il ne se fît précéder d'un soldat Thrace, au front
couvert de stigmates, l'épée nue à la main, et qu'il n'eût envoyé à
l'avance quelques-uns de ses gardes visiter tous les meubles de sa
femme, et chercher s'il n'y avait pas d'arme cachée dans ses
vêtements. Malheureux, qui se fiait plutôt à la fidélité d'un
barbare, d'un esclave couvert de flétrissures, qu'à celle de sa
femme? Et ses pressentiments ne le trompèrent point; car celle dont
il se défiait l'assassina sur un soupçon d'infidélité. Quelque
empire que vous ayez, si vous régnez par la crainte, il ne peut être
de longue durée ; témoin Phalaris, dont la cruauté est passée en
proverbe, et qui ne périt point par trahison, comme cet Alexandre,
ou bien sous les coups de quelques conjurés, comme notre tyran, mais
qui fut assailli par le peuple d'Agrigente tout entier. Ne vit-on
pas les Macédoniens abandonner Démétrius et remettre la couronne aux
mains de Pyrrhus? Lacédémone, exerçant un empire inique, ne vit-elle
pas tous ses alliés déserter sa cause, et demeurer spectateurs
indifférents du coup terrible qui lui fut porté à Leuctres?
VIII. J'aime mieux, en un tel
sujet, choisir mes exemples chez les étrangers que parmi nous.
Cependant, il faut bien le dire, tant que l'empire du peuple romain
se maintenait par des bienfaits et non par des traitements indignes,
nous ne combattions que pour nos alliés ou pour l'honneur de la
république ; tous nos triomphes étaient marqués par la douceur, à
moins que la nécessité ne nous forçât la main ; les rois, les
peuples, les nations trouvaient un port et un
470 refuge assuré dans le
sénat de Rome ; nos proconsuls et nos généraux ne connaissaient pas
de plus beau titre de gloire que de gouverner nos provinces ou de
défendre nos alliés avec équité et bonne foi. N'était-ce pas là
plutôt le patronage que l'empire du monde ? Peu à peu on cessa de se
régler suivant ces belles maximes, et l'ancienne discipline fut
ébranlée; mais la victoire de Sylla leur porta le coup fatal. On
exerça tant de cruautés sur les citoyens, que désormais rien ne
parut injuste contre les alliés. Sylla défendait une belle cause,
mais il déshonora sa victoire par ses iniquités. Il poussa l'audace
jusqu'à vendre à l'encan sur la place publique les biens d'une foule
d'honnêtes gens, d'hommes considérables qui certes étaient citoyens
de Rome, et jusqu'à dire qu'il vendait son butin. Bientôt vint un
autre tyran, soutien d'une cause impie, qui souilla sa victoire plus
encore que Sylla, et ne se contenta pas de dépouiller les
particuliers de leurs biens, mais vendit à l'encan des provinces et
des nations entières. Après avoir désolé et ruiné les peuples, nous
l'avons vu porter en triomphe l'image de Marseille comme un signe de
l'anéantissement de notre empire, et triompher de cette ville, sans
le secours de laquelle jamais nos généraux ne remportèrent une
victoire dans les guerres transalpines. Je pourrais citer encore une
foule de traitements indignes faits à nos alliés, si le soleil en
avait éclairé un plus infâme que celui-là. Aujourd'hui nous portons
la peine de nos fautes. Si nous n'avions pas souffert les crimes de
tant d'autres, jamais ce dernier tyran ne serait venu à cet excès de
licence. Malheureusement encore s'il a laissé peu d'héritiers de ses
biens, il en a laissé un grand nombre de ses funestes passions.
Jamais le germe des guerres civiles ne sera étouffé, tant que des
hommes sans honneur et sans frein se rappelleront et croiront
pouvoir relever cette pique sanglante qui s'agitait dans la main de
Sylla, sous la dictature de son parent, et qui reparut trente-six
ans après dans cette même main, plus abominable encore. Un autre qui
n'était que greffier sous la première dictature, était questeur de
Rome sous la seconde. Il n'est que trop certain qu'avec l'exemple de
pareilles fortunes, les guerres civiles ne manqueront Jamais. Que
reste-t-il de Rome? Je ne vois plus rien debout que ces murailles
qui vont s'écrouler, je le crains, sous le coup de nouveaux
attentats; mais la république est entièrement anéantie. Pour en
revenir à notre proposition, nous ne sommes tombés dans ces étranges
malheurs que parée que nous avons mieux aimé inspirer la crainte que
la bienveillance et l'affection. Si le peuple Romain a été conduit à
de telles calamités par son injuste domination, que doivent donc
attendre les tyrans? Puisqu'il est démontré que la bienveillance de
nos semblables est notre plus ferme appui, et que nous ne sommes
jamais plus faibles qu'alors qu'on nous redoute, il faut que nous
indiquions ici par quels moyens nous pouvons, sans blesser l'honneur
ni la bonne foi, nous concilier l'affection des hommes. Mais nous
n'en avons pas tous un égal besoin ; et c'est la nature même de
notre condition qui nous apprendra s'il nous faut beaucoup d'amis,
ou si un petit nombre nous peut suffire. Ce qu'il y a de certain
avant tout, c'est que rien ne-nous est plus nécessaire que d'avoir
des amis dévoués, et qui s'intéressent vivement à tout ce qui nous
touche. Il n'y a guère sur ce point essentiel de différence entre
les grands et les petits; tous les hommes doivent montrer à peu prés
un égal empressement 471
à se faire des amis. Nous n'en dirons pas autant des honneurs, de la
gloire, et de la faveur publique; tous n'en ont pas un égal besoin :
mais ceux qui en jouissent peuvent en tirer mille avantages et
surtout celui de s'acquérir plus facilement des amis.
IX. Mais j'ai traité de l'amitié
dans celui de mes livres qui porte le nom de
Lélius. Parlons
maintenant de la gloire ; j'ai composé aussi deux livres sur ce
sujet : mais il faut en toucher ici quelque chose, car la gloire est
d'un très-grand secours pour l'exécution des plus grandes
entreprises. On reconnaît qu'un homme a la gloire souveraine et
parfaite à ces trois caractères : il est aimé de la multitude, elle
a confiance en lui, elle l'admire et le croit digne des plus grands
honneurs. On pourrait dire tout simplement et en deux mots qu'on
inspire ces sentiments à la multitude comme on les inspire aux
particuliers, et par les mêmes moyens. Mais la bienveillance de la
multitude peut se captiver encore d'une autre manière, et nous
pouvons parvenir par une autre route à nous emparer de son esprit.
Des trois sentiments dont je viens de parler, voyons d'abord comme
on obtient le premier, qui est la bienveillance. Elle se gagne
surtout par les bienfaits; souvent même, quand on n'a pas les
ressources nécessaires pour faire du bien, le vif désir qu'on en
témoigne suffit pour nous attacher les cœurs. Mais ce qui enlève
surtout l'amour du peuple, c'est la réputation de libéralité, de
bienfaisance, de justice, de bonne foi, et de toutes ces vertus qui
tiennent à l'agrément et à la facilité des mœurs. Et voici pourquoi
: c'est que ce beau caractère d'honnêteté et de bienséance , dont
nous avons parlé , nous charme par lui-même et séduit naturellement
tous les esprits ; et comme il brille surtout dans les vertus que je
viens de nommer, nous nous trouvons entraînés par la nature même à
aimer ceux que nous en croyons doués. Voilà quels sont les
principaux moyens de nous attirer l'amour du peuple ; il en est
d'autres encore, mais qui sont beaucoup moins importants. Pour la
confiance, nous ne manquons pas de l'inspirer quand nous avons la
réputation de réunir la prudence à la justice. Nous avons en effet
de la confiance dans ceux que nous estimons plus éclairés que nous,
à qui nous reconnaissons le génie de la prévoyance, le talent de
conduire habilement les affaires, de se tirer des périls, de juger
sainement des circonstances; car c'est là ce que les hommes
regardent comme l'utile et la véritable prudence : d'un autre côté,
l'homme juste et de bonne foi, c'est-à-dire l'honnête homme, nous
inspire une telle confiance que nous le tenons pour absolument
incapable de la moindre fraude et de la moindre injustice. C'est à
de tels hommes que nous commettons au besoin, et avec une sécurité
parfaite, notre salut, notre fortune, nos enfants. Des deux vertus
que nous avons nommées, celle qui contribue le plus à nous attirer
la confiance d'autrui est la justice, car elle se recommande déjà
d'elle-même sans le secours de la prudence, tandis que la prudence,
sans la justice, n'est pas faite pour donner de la sécurité aux
esprits. Plus un homme est habile et fin, plus il devient suspect et
même odieux, quand on ne lui croit pas de probité. Ainsi donc la
justice unie aux lumières inspirera aux hommes toute la confiance
qu'on voudra ; la justice sans la prudence aura encore beaucoup de
crédit: mais la prudence sans la justice sera fort éloignée d'en
avoir.
472 X. Mais j'emploie ici un langage dont on s'étonnera
peut-être. En effet, c'est un principe admis par tous les
philosophes, et que j'ai plus d'une fois soutenu moi-même, que celui
qui a une vertu les a toutes ; et voilà maintenant que je les
sépare, et semble admettre qu'un homme peut avoir la prudence sans
avoir la justice : à quoi je réponds qu'autre chose est de montrer
la vérité dans toute sa rigueur, autre chose d'accommoder son
langage aux opinions communes. Nous parlons en ce moment comme tout
le monde, et nous disons : les hommes magnanimes, les hommes justes,
les hommes prudents; car il faut se servir des expressions usitées
et populaires, lorsqu'on parle des sentiments et des idées du
peuple. Nous ne faisons que suivre d'ailleurs l'exemple de Panétius.
Mais revenons à notre sujet. Nous avons dit que la gloire se
composait de trois éléments, et que le dernier c'était l'admiration
des hommes pour celui qu'ils croient digne d'être honoré. Les hommes
admirent en général tout ce qui leur paraît grand et extraordinaire,
et en particulier ils admirent dans chaque homme les rares qualités
qui les surprennent. C'est pourquoi ils comblent d'éloges et portent
jus¬qu'aux nues ceux en qui ils croient apercevoir des vertus
éminentes, un mérite incomparable. Ils dédaignent, au contraire, et
méprisent ceux en qui ils ne voient ni vertu, ni âme, ni vigueur.
Ils ne dédaignent pas tous ceux dont ils pensent mal, ceux, par
exemple, qu'ils jugent méchants, médisants, perfides et toujours
prêts à nuire; ils ne les dédaignent pas, mais ils en ont mauvaise
opinion. Ceux-là seuls sont dédaignés qui, comme on dit, ne sont
capables de rien ni pour eux-mêmes ni pour les autres, et en qui on
ne voit ni courage, ni industrie, ni ressort. Noue admirons, au
contraire, ceux dont la vertu nous paraît avoir quelque chose de
rare et d'excellent, dont la conduite est sans tache, et qui n'ont
point ces faiblesses auxquelles le commun des hommes se laisse si
facilement entraîner. La plupart des esprits, en effet, sont
détournés de la vertu par la volupté qui les tyrannise en les
flattant, et effrayés outre mesure quand la douleur les menace de
ses atteintes. Combien pourrez-vous compter d'hommes qui ne
tressaillent pas quand il est question de la vie ou de la mort, de
la richesse ou de la pauvreté ? Aussi quand on voit une âme assez
élevée et assez grande pour mépriser tout ce qui nous émeut de cette
sorte, et pour embrasser en toute circonstance avec une vive ardeur
le parti le plus noble qui se présente à elle, comment se défendre
d'admirer la beauté et l'éclat d'une telle vertu ?
XI. Cette fière élévation de l'âme
inspire donc une grande admiration ; mais ce qui paraît sur¬tout
merveilleux aux yeux de la multitude, c'est la justice, cette vertu
qui semble constituer à elle seule l'homme de bien ; et ce sentiment
de la multitude est très-fondé. Car il est impossible qu'un homme
soit juste et qu'il craigne la mort, la douleur, l'exil, la
pauvreté, ou que jamais il préfère à l'équité quelqu'un des biens du
monde. On admire surtout celui qui méprise la richesse, et l'homme
dont le parfait désintéressement est connu passe pour aussi pur que
le métal éprouvé au feu. Ainsi donc la justice sait inspirer aux
hommes ces trois sentiments qui, réunis, font la gloire : d'abord là
bienveillance, parce que 473
l'homme juste cherche à se rendre utile au plus grand nombre;
ensuite la confiance, qui a la même origine ; enfin l'admiration,
parce qu'il dédaigne et néglige ce qui enflamme la cupidité de la
plupart des hommes. Mais, à vrai dire, il n'est pas de condition où
l'homme n'ait besoin du secours de ses semblables, et où il ne lui
faille surtout quelques amis avec qui il puisse s'entretenir
librement. Or, comment être secouru et aimé, si Ton ne passe pour
honnête homme? Je tiens donc qu'une bonne réputation est nécessaire,
même à l'homme qui vit seul et coule ses jours au milieu des champs
; d'autant plus nécessaire, que si vous n'avez une bonne réputation,
vous passez pour de malhonnêtes gens, et dès lors tout appui vous
manque et vous restez exposés à toutes les injures. D'un autre côté,
ceux qui vendent ou achètent, qui donnent on prennent à loyer, qui
sont engagés d'une manière ou de l'autre dans les transactions
commerciales, ne peuvent conduire leurs affaires à bonne fin sans la
justice. Mais ce qui prouve mieux que tout le reste combien la
justice est essentielle à l'homme, c'est que ceux mêmes qui vivent
de brigandages et de crimes ne sauraient jamais la répudier
entièrement. Qu'un voleur exerce son industrie sur quelqu'un des
gens de sa bande, on ne l'y souffrira pas un seul instant de plus ;
qu'un capitaine de pirates fasse un injuste partage du butin, il
sera bientôt mis à mort ou abandonné. On dit même que les brigands
ont des lois qu'ils observent très-fidèlement. C'est l'équité dans
le partage du butin qui fit la grande fortune de Rar-dylis, ce
brigand d'Illyrie, dont parle Théopompe; et la puissance bien
autrement merveilleuse de Viriate le Lusitanien, qui alla jusqu'à
triompher des armées romaines et de plusieurs de nos généraux. Mais
Lélius, que nous appelons le Sage, mit enfin un terme à ses succès,
porta un tel coup à sa puissance et réprima si bien son audace,
qu'il ne laissa à ses successeurs qu'une guerre facile à terminer.
Si donc la justice a ce crédit de faire la fortune des brigands et
d'affermir leur puissance, quels ne doivent pas être ses effets au
milieu d'une cité, sous la protection des tribunaux et des lois?
XII. Je crois que non-seulement les
Mèdes, comme le dit Hérodote, mais encore nos propres ancêtres
n'instituèrent autrefois la royauté et n'ap-pelèrent au trône des
hommes de bien que pour jouir des bienfaits de la justice. Comme
dans le principe la multitude était opprimée par les plus puissants,
elle.eut recours à quelque homme d'une vertu éminente, et lui confia
le soin de protéger les faibles, d'établir les règles du droit, et
de rendre les grands comme les petits égaux devant la justice.
L'établissement des lois s'explique par les mêmes motifs que
l'institution de la royauté. On a toujours cherché à s'abriter sous
un droit égal pour tous; car sans égalité il n'y a plus de droit.
Tant que les peuples durent ce bienfait à la justice et à la sagesse
d'un seul, ils ne souhaitèrent rien de plus; mais quand la royauté
devint infidèle à son institution, on inventa les lois, qui devaient
tenir à tous les hommes et en tout temps un seul et même langage. Il
est donc manifeste que partout les nations choisirent, pour leur
donner le pouvoir, les hommes qui avaient une grande réputation de
justice. Si on les regardait en outre comme des hom-
474 mes d'une rare
prudence, les peuples espéraient tout du gouvernement de tels chefs.
Mettez donc tous vos soins à pratiquer la justice; cultivez-la
d'abord pour elle-même, car autrement ce ne serait plus la justice,
et ensuite parce que c'est elle qui nous conduit aux honneurs et à
la gloire. Mais, tout comme il ne suffit pas de faire fortune, et
qu'il faut encore placer son argent de manière à en retirer toute sa
vie des revenus qui suffisent et à nos besoins matériels et à des
dépenses plus libérales, de même nous ne devons pas nous contenter
d'acquérir de la gloire, nous devons encore la bien placer. Socrate
disait excellemment qu'il n'y avait pas de chemin plus court ni plus
sûr pour arriver à la gloire que d'être réellement ce qu'on voudrait
paraître. Croire que Ton puisse acquérir une gloire durable par la
dissimulation, par une vaine ostentation , en prenant le masque et
le langage de la vertu, c'est s'abuser étrangement. La vraie gloire
jette des racines, grandit et s'étend ; tout ce qui est mensonger,
au contraire, se flétrit rapidement comme les fleurs, et rien de
faux ne peut avoir de durée. Ce sont là des vérités que mille
témoignages confirmeraient au besoin ; mais, pour être plus court,
nous ne chercherons nos exemples que dans une seule famille. Le nom
de Tibérius Gracchus, fils de Publius, sera couvert d'éloges tant
que la mémoire de Rome subsistera ; mais ses deux enfants, qui
excitèrent l'indignation des gens de bien pendant leur vie, sont
comptés après leur mort au nombre des hommes dont le trépas a été un
juste châtiment.
XIII. Ainsi donc, pour acquérir la
véritable gloire, il faut s'acquitter des devoirs qu'impose la
justice. Nous avons dit dans le livre précédent en quoi ces devoirs
consistent; mais je dois indiquer ici comment il faut s'y prendre
pour paraître tel que Ton est réellement, tout en rappelant que le
meilleur moyen de paraître honnête homme, c'est de l'être. Si un
homme, dès sa jeunesse, a déjà une célébrité et un nom glorieux
qu'il ait reçu de son père (comme vous je pense, mon cher fils), ou
qu'il doive à la fortune ou à quelque événement extraordinaire, tous
les yeux sont tournés vers lui ; on s'informe de ce qu'il fait, de
la conduite qu'il tient ; toute sa vie est en lumière ; aucune de
ses paroles, aucune de ses actions ne peut demeurer dans l'ombre.
Pour ceux qui naissent dans une humble condition et dans une fa*
mille obscure, et dont le premier âge est ignoré des hommes, ils
doivent, dès qu'ils sont parvenus à l'adolescence, aspirer à de
grandes choses, et s'ouvrir la carrière par de nobles efforts; ils
le feront avec d'autant plus de confiance que cet âge n'est point
exposé à l'envie et ne trouve que faveur. Le premier titre de gloire
pour un jeune homme, ce sont les succès militaires; ils ont fondé
bien des réputations dans les anciens temps de la république; car
alors les guerres étaient presque continuelles. Pour vous, mon fils,
vous êtes venu à une époque où d'un côté les armes étaient impies,
et de l'autre malheureuses. Cependant, au milieu de cette guerre,
Pompée vous ayant mis à la tête d'un corps de cavalerie, vous vous
êtes acquis le suffrage de ce grand homme et de l'armée entière par
votre habileté à manier le cheval, à lancer le javelot, et votre
courage & supporter tous les travaux de la guerre. Mais la gloire
que vous réservaient les armes, la république en périssant l'a
emportée avec elle. D'ailleurs ce n'est pas pour vous seul, mais
pour tous les hommes, que j'ai entrepris d'écrire ce livre.
Poursuivons donc. En toute chose les travaux de l'esprit ont
475 beaucoup plus
d'importance que ceux du corps, et les objets auxquels s'appliquent
notre intelligence et notre raison sont de beaucoup supérieurs à
ceux qui ne réclament que des forces. Un jeune homme se rend d'abord
recommandable par sa modestie, par son pieux amour pour ses parents
et sa tendresse pour tous les siens. A cet âge le meilleur moyen
d'attirer les yeux sur soi et de se faire connaître en bonne part,
c'est de s'attacher à des hommes célèbres, et qui réunissent la
sagesse à un grand zèle pour le bien de leur pays. Le peuple, qui
voit un jeune homme fréquenter une telle société, espère
naturellement qu'il deviendra semblable à ces grands citoyens qu'il
a pris pour modèles. P. Rutilius fréquentait dans sa jeunesse la
maison de C. Mucius; et ce est là l'origine de sa réputation d'homme
probe et d'habile jurisconsulte. Mais l'illustration que L. Gras-sus
acquit dans sa première jeunesse, il ne la dut à personne qu'à
lui-même, et à cette noble accusation si glorieusement soutenue. A
cet âge où c'est déjà un titre à la gloire que de s'exercer loin du
monde à la pratique d'un art, témoin la jeunesse de Démosthène ; à
cet âge, L. Crassus montra qu'il pouvait donner, en plein forum, des
preuves d'un talent consommé, tandis que déjà il eût été honorable
pour lui de se former à l'ombre du foyer domestique.
XIV. Il y'a deux sortes de
discours, le discours familier et le discours soutenu. Le dernier,
où se montre plus particulièrement ce que nous appelons l'éloquence,
est sans nul doute un des plus puissants moyens d'arriver à la
gloire. Cependant, il serait difficile de dire combien les grâces et
l'urbanité du discours familier ont de vertu pour nous concilier les
esprits. Il nous reste des lettres de Philippe à Alexandre,
d'Antipater à Cassandre, d'Antigone à Philippe, où ces trois
princes, si fameux par leur prudence, recommandent à leurs fils de
gagner la bienveillance de la multitude par l'affabilité de leurs
discours, et d'adresser à leurs soldats de douces et flatteuses
paroles : mais une harangue peut souvent remuer tout un peuple. On
admire singulièrement ceux qui parlent avec abondance et sagesse; en
les entendant, on ne peut s'empêcher de croire qu'ils ont plus
d'intelligence et qu'ils voient plus loin que le reste des hommes.
Un discours qui allie la modération à la force est la chose la plus
admirable du monde, surtout dans la bouche d'un jeune homme.
Plusieurs carrières sont ouvertes à l'éloquence, et beaucoup de
jeunes Romains se sont il lustrés en parlant soit au barreau, soit
au sénat ; mais c'est surtout au barreau que brille le talent de
l'orateur. L'éloquence judiciaire peut remplir deux rôles bien
différents, je veux parler de l'accusation et de la défense; il y a
quelque chose de plus glorieux dans la défense , mais plus d'une
fois l'accusation a recueilli des éloges. Je vous citais tout à
l'heure l'exemple de Crassus. M. Antonius s'acquit le même honneur
dans sa jeunesse. C'est encore l'accusation qui mit en lumière
l'éloquence de P. Sulpicius, lorsqu'il appela en jugement le
séditieux et dangereux Norbanus. Mais on ne doit se porter
accusateur que très-rarement, et lorsqu'il s'agit ou des intérêts de
la république, comme dans les exemples que je viens de rappeler, ou
de ses propres injures que l'on veut venger, comme firent les deux
Lucullus, ou de clients à défendre, comme il m'est arrivé pour les
Siciliens, et à Jules-César pour les Sardes contre A lbucius. On
peut citer 476 encore
,avec éloge L. Fufius, l'accusateur de M. Aquilllus. Il ne faut donc
se faire accusateur qu'une seule fois, ou du moins bien rarement ;
il ne peut y avoir nécessité de prendre souvent ce rôle, que si
l'intérêt de la république y est engagé; car on doit être le bien
venu à poursuivre souvent les ennemis de son pays. Cependant il faut
encore y apporter une certaine mesure; il semble en effet qu'il
n'appartienne qu'à un homme cruel, ou plutôt à un barbare qui n'a
plus de sentiment humain, de vouloir envoyer un grand nombre de ses
concitoyens au bourreau. A ce métier on joue sa vie et même sa
réputation, car on s'expose au surnom de délateur; ce qui est arrivé
à un homme d'une illustre famille, M. Brutus, le fils du grand
jurisconsulte. Un de nos devoirs les plus sacrés, c'est de
n'intenter jamais d'accusation capitale à un innocent ; dans quelque
circonstance que l'on se trouve, on ne peut le faire sans
crime. Qu'y a-t-il de plus barbare que de faire servir à la perte et
à la ruine des gens de bien cette éloquence que la nature nous a
donnée pour le salut et la conservation des hommes? Mais s'il faut
s'interdire à tout jamais d'accuser un innocent, on ne doit pas se
faire un scrupule de défendre quelquefois un coupable, pourvu que ce
ne soit pas un scélérat, un sacrilège. La multitude l'approuve,
l'usage l'autorise, l'humanité y engage. Un juge ne doit chercher
dans une cause que la vérité; un avocat peut quelquefois ne
s'attacher qu'à la vraisemblance, quand même il serait en dehors de
la vérité. Ce sont là des aveux que je n'oserais faire, surtout dans
un livre de philosophie, si je n'avais pour moi l'autorité de
Panétius, l'un des plus graves Stoïciens. Rien ne nous attire plus
de reconnaissance et de gloire qu'une défense éloquente, surtout
quand elle vient au secours d'un malheureux que poursuit et que veut
opprimer quelque homme puissant. J'ai plaidé souvent de telles
causes, et j'ai défendu entre autres, pendant ma première jeunesse,
Sex. Roscius d'Amérie contre le crédit et la toute-puissance de
Sylla. Vous savez que j'ai conservé ce discours.
XV. Après avoir expliqué par quels
moyens le jeune homme peut arriver à la gloire, je dois parler de la
bienfaisance et de la générosité. On peut être bienfaisant de deux
manières, ou en rendant des services, ou en donnant de l'argent. Ce
dernier moyen est le plus facile, surtout pour un riche; mais le
premier est plus noble, plus relevé, plus digne d'un homme de cœur
et d'un grand citoyen. On reconnaît dans tous les deux la volonté de
faire du bien, la marque de la générosité; mais il y a cette
différence qu'ici c'est la bourse qui est en jeu, et là c'est la
vertu. Et d'ailleurs les largesses que vous tirez de votre fortune
tarissent la source même des bienfaits. De cette manière la
bienfaisance s'épuise elle-même, et plus vous avez rendu de
services, moins vous êtes capable d'en rendre encore. Celui au
contraire qui exerce sa générosité par ses bons offices, qui est
surtout libéral par sa vertu et son zèle, acquiert dans ceux qu'il
oblige des amis qui l'aideront à en obliger d'autres; et l'habitude
de la bienfaisance le rend plus disposé et plus habile à répandre
des bienfaits. C'est avec beaucoup de raison que Philippe, dans une
de ses lettres, reproche à son fils Alexandre de chercher à gagner
par des largesses la bienveillance des Macédoniens. « Quel mauvais
génie, lui dit-il, vous a donc inspiré l'idée que le moyen de rendre
les 477 hommes fidèles
c'est de les corrompre par l'argent? Vous voulez donc que les
Macédoniens vous regardent non comme leur roi, mais comme leur homme
d'affaires et leur pourvoyeur? » Il disait vrai : c'est là l'office
d'un homme d'affaires et d'un pourvoyeur, et nullement celui d'un
roi. Mais j'applaudis surtout à cette pensée que les largesses
corrompent les hommes ; car celui qui reçoit se gâte, et il est
toujours prêt à tendre la main. Cet avis que Philippe donnait à son
fils est une leçon qui s'adresse à tout le monde. Il est donc hors
de doute que la bienveillance qu'on exerce par ses bons offices et
en payant de sa personne a quelque chose de plus relevé, de plus
fécond, et peut s'étendre à un plus grand nombre de personnes. Il y
a cependant des circonstances où l'on doit foire des largesses; il
ne faut pas s'interdire absolument ce genre de libéralités;
quelquefois on trouve dans l'indigence d'honnêtes gens qu'il but
secourir de sa bourse. Mais je recommanderai toujours de n'y puiser
qu'avec modération et à bon escient, car je connais bien des hommes
qui ont dissipé leur patrimoine par des largesses inconsidérées.
Vous aimez à faire du bien, et vous vous empressez de vous mettre
dans l'impossibilité d'en faire: qu'y a-t-il de plus insensé?
Souvent aussi les largesses conduisent aux rapines; ceux que leurs
prodigalités ont ruinés finissent par porter la main sur le bien
d'autrui. Ils ont voulu gagner les cœurs par leurs bienfaits ;
niais, en fin décompte, ils se sont bien moins attiré la
reconnaissance de leurs obligés que la haine de leurs dupes. La
sagesse demande donc que votre bourse ne soit ni tellement close que
la bienfaisance ne puisse l'ouvrir, ni tellement ouverte que tout le
monde ait le droit d'y puiser. Donnez avec mesure et selon vos
moyens; sou-venez-vous de cette maxime si fréquemment répétée dans
notre république, et déjà passée en proverbe : Que la prodigalité
n'a point de fond. Où s'arrêter en effet, quand il faut
satisfaire à la fois et ceux qui sont habitués à nos largesses, et
les nouveaux venus qui font appel à notre générosité?
XVI. Il faut distinguer deux sortes
de largesses : les prodigalités et les libéralités. Le prodigue se
ruine en festins, en distributions publiques, en pompes et
spectacles, jeux de gladiateurs, chasses; vanités de toutes sortes,
dont le souvenir est de courte durée, et qui, le plus souvent, sont
oubliées le lendemain. L'homme libéral emploie sa fortune à racheter
les captifs des mains des pirates, à payer les dettes de ses amis ;
il les aide à doter leurs filles, à acquérir quelques biens, ou à
augmenter ceux qu'ils ont. Théophraste a écrit un livre sur les
Richesses, où l'on trouve beaucoup de belles choses, mais où il
s'est laissé entraîner, je ne sais par quel travers d'esprit, à un
paradoxe bien étrange. Il fait de grands éloges de l'appareil et de
la splendeur des fêtes que l'on donne au peuple, et il soutient que
les richesses ne peuvent être mieux employées qu'à cette destination
magnifique. Pour moi, je crois que les employer à cette destination
libérale dont je citais quelques exemples, c'est en tirer un fruit
bien meilleur et bien plus certain. Combien j'aime mieux Aristote,
qui nous reproche avec tant de raison et une sévérité si bien fondée
de ne point nous effrayer de toutes les profusions destinées à
l'amusement du peuple " Lorsque nous apprenons, dit-il, que dans une
ville assiégée on paye une mine le setier d'eau,
478 nous nous récrions
d'abord, et le fait nous paraît incroyable; nous réfléchissons
cependant, et finissons par comprendre que la nécessité a de dures
lois qu'il faut subir; mais toutes ces dépenses excessives et ces
folles prodigalités nous surprennent peu, quoiqu'elles ne soient
point commandées par la nécessité, qu'elles n'ajoutent rien & la
dignité de ceux qui les font, qu'elles ne donnent à la multitude
qu'un amusement de bien courte durée, amusement dont tout le charme
est pour les esprits futiles, qui en perdent même le souvenir dès
que la satiété est venue. " Il nous fait très-bien observer que ces
spectacles ne plaisent qu'aux enfants, aux femmes, aux esclaves ou à
ceux qui leur ressemblent ; mais qu'un homme grave, et qui apprécie
tout à sa juste valeur, ne saurait jamais les approuver. Cependant
je vois que dans Rome, et par un usage qui remonte aux beaux jours
de la république, les meilleurs citoyens veulent que les édiles
s'acquittent de leur charge avec magnificence. Aussi P. Crassus le
riche, dont les trésors justifiaient bien le surnom, fit-il des
merveilles pendant son édilité ; peu de temps après, L. Crassus et
son collègue Q. Mucius, le plus modéré des hommes, remplirent ces
fonctions avec beaucoup de splendeur; C. Claudius, fils d'Appius, et
plusieurs autres, tels que les deux Lucullus, Hortensius, Silanus,
surent se distinguer après eux. P. Lentulus, sous mon consulat, les
effaça tous, et fut depuis imité par Scaurus. Notre grand Pompée
donna aussi, pendant son second consulat, des jeux d'une
magnificence incroyable. Vous savez ce que je pense de toutes ces
prodigalités.
XVII. Il ne faut pourtant pas se
faire soupçonner d'avarice. Le riche Mamercus se vit repous-
478 ser du consulat
pour n'avoir point demandé l'édilité. On peut répondre quelquefois
aux désirs du peuple, et faire quelques-unes de ces dépenses que les
sages n'approuvent pas, mais qu'ils tolèrent, pourvu toutefois que
l'on n'excède point ses facultés, et qu'on se renferme dans la
mesure que j'ai su garder naguère. On doit surtout ne point hésiter,
quand une largesse faite au peuple peut produire de grands et de
sérieux avantages. C'est ainsi que dernièrement Oreste s'acquit
beaucoup d'honneur par ces repas, sous le nom de dîmes, qu'il fit
servir au peuple dans les rues. M. Séius ne fut point blâmé, que je
sache, d'avoir vendu le blé au peuple, dans un temps de disette , à
un as le boisseau. Il était depuis longtemps odieux à la multitude,
et il se remit en faveur par cette libéralité, qui ne fut ni
déplacée, puisque Séius était alors édile, ni excessive pour ses
ressources. Milon, notre ami, se couvrit de gloire lorsqu'il acheta
des gladiateurs pour veiller au salut de la république qui dépendait
du nôtre, et réprima par la force les attentats et les fureurs de
Clodius. On ne peut donc en aucune manière blâmer les largesses
quand elles sont ou nécessaires ou utiles; mais, en aucun cas, il m
faut y mettre d'excès. L. Philippus, fils de Quintus, homme d'un
beau génie et d'une grande naissance, se glorifiait d'être parvenu
aux premières dignités de la république sans aucune largesse. Cotta
et Curion en disaient autant : je puis me vanter d'avoir eu en
quelque façon le même privilège, car, pour tous les honneurs qui me
furent accordés à l'unanimité des suffrages, et l'année même où
j'avais droit d'y prétendre, ce qui n'est arrivé à aucun de ceux que
je viens de nommer, je n'ai fait en tout que les modiques dé -
479 penses de ma charge
d'édile. L'argent le mieux placé de cette sorte est celui qu'on
emploie à construire des ouvrages d'utilité publique, tels que les
murs des villes, les ports, les chantiers maritimes, les aqueducs.
Sans doute ce que Ton donne dans la main fait plus de plaisir, mais
les travaux de ce genre excitent plus de reconnaissance dans la
postérité. Quant à ceux qui élèvent des théâtres, des portiques, de
nouveaux temples, je n'oserais trop les blâmer, à cause de Pompée;
mais beaucoup d'hommes très-éclairés ne les approuvent pas ; et de
ce nombre est Panétius, que j'ai suivi dans ce traité, sans tenir
toutefois à une imitation servile, ainsi que Démétrius de Phalère,
qui ne peut excuser Périclès, ce prince de la Grèce, d'avoir dépensé
tant d'argent aux magnifiques propylées d'Athènes. Mais j'ai
expliqué avec soin tout ce qui concerne cette matière dans mes
livres de la République. Concluons que toutes les largesses de ce
genre sont vicieuses en elles-mêmes, que les circonstances les
rendent quelquefois nécessaires, et qu'alors il faut les
proportionner à ses facultés et n'y mettre jamais d'excès.
XVIII. Pour l'autre sorte de
largesses qui conviennent mieux à la pure libéralité, il faut leur
donner un tour et une mesure différente, suivant les motifs qui les
inspirent. La condition de l'homme qui est accablé par l'infortune
ne ressemble en rien à celle de l'homme qui, sans être malheureux,
veut améliorer son sort. On doit être plus disposé à secourir les
infortunés, pourvu toutefois qu'ils n'aient point mérité de tomber
dans le malheur. Quant à ceux qui demandent notre aide, non pour
sortir de la misère, mais pour se faire une position plus brillante,
nous ne devons pas la leur refuser opiniâtrement; mais il faut
démêler avec un grand soin ceux qu'il convient réellement d'obliger.
Ennius a fort bien dit: « Un bienfait mal placé est une mauvaise
action à mes yeux. » Rendre service à un honnête homme qui est
capable de reconnaissance, c'est obliger tous ses concitoyens en
même temps que lui. La libéralité, lorsqu'on l'exerce avec prudence,
est la vertu qui nous attire le mieux les cœurs; elle est d'autant
plus appréciée, que la bienfaisance d'un homme puissant est comme un
refuge pour tout le peuple. Faisons du bien, prodiguons surtout les
bienfaits, dont le souvenir se transmet aux enfants et à toute une
postérité, et leur fait une loi de la reconnaissance. Tout le monde,
en effet, déteste les ingrats ; tout le monde pense que
l'ingratitude tarit la bienfaisance et rejaillit sur l'infortune; il
n'est personne qui ne regarde ceux qui en sont coupables comme les
ennemis de tous les malheureux. Une générosité qui est utile à la
république, c'est de racheter les captifs et de soutenu les pauvres.
Celle-là, l'ordre des chevaliers l'a toujours pratiquée , comme vous
pouvez le voir démontré fort au long dans un discours de Crassus.
C'est une telle générosité que je mets fort au-dessus des plus
éclatantes largesses. L'une est le propre des hommes graves et des
grands citoyens; les autres ne conviennent qu'aux flatteurs du
peuple, qui veulent séduire une frivole multitude en la
chatouillant, pour ainsi dire, à l'endroit le plus sensible. S'il
est convenable de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins de
demander ce qui nous est dû sans exigence ni dureté : et dans toute
espèce de transactions, dans les ventes et les achats, en donnant ou
en prenant à loyer, avec les propriétaires des maisons ou des terres
voisines, il faut se montrer équitable et facile, céder quelque
480 chose de ses droits,
avoir pour les procès toute l'aversion qu'ils doivent inspirer, et
je crois même un peu plus encore. Non-seulement la libéralité
commande que nous ne maintenions pas toujours nos droits dans toute
leur rigueur, mais quelquefois même l'intérêt nous y engage. Sans
doute nous devons prendre soin de notre fortune, qu'il est honteux
de laisser dilapider ; mais il faut éviter de se faire une
réputation de petitesse et d'avarice. Pouvoir faire beaucoup de bien
sans dissiper son patrimoine, c'est là certainement le plus beau
fruit de la richesse. La générosité se manifeste encore plus dans
une vertu que Théophraste a louée avec raison, je veux parler de
l'hospitalité. Il n'est rien, à mon avis, de plus honorable pour un
homme illustre que de voir sa maison remplie d'illustres hôtes; et
c'est un titre de gloire pour une république, que les étrangers
trouvent facilement chez elle ce genre de libéralité. Rien de plus
avantageux d'ailleurs pour ceux qui ont une grande et légitime
ambition, que d'avoir chez les peuples étrangers des hôtes puissants
et dévoués. Théophraste nous apprend que Cimon, établi à Athènes,
exerçait l'hospitalité envers ses compatriotes de Lacia; qu'il avait
si bien disposé les choses dans sa maison de campagne et laissé de
tels ordres à ses gens, que tout citoyen de Lacia y était reçu en
tout temps et parfaitement traité.
XIX. Quant aux services que l'on
rend, non plus par ses largesses, mais en payant de sa personne, ils
peuvent s'adresser ou à la république entière, ou à chaque citoyen
en particulier. Rien n'est plus propre à augmenter notre crédit et à
nous concilier la faveur du peuple, que d'éclairer les citoyens sur
leurs droits, les aider de ses conseils, les guider en habile
jurisconsulte dans le dédale de leurs affaires. Aussi voyons-nous
que nos ancêtres, parmi beaucoup d'autres coutumes dignes d'éloges,
ont toujours tenu à grand honneur la science et l'interprétation de
ce droit civil qu'ils avaient si admirablement établi. Avant la
confusion de ces derniers temps, on n'aurait pas trouvé dans Rome un
homme éminent qui ne fût versé dans cette science ; mais elle est
déchue aujourd'hui de son ancien éclat, comme tous les honneurs et
toutes les distinctions de la république; chose d'autant plus
indigne, que nous avons aujourd'hui parmi nous un homme égal en
dignité à tous les anciens jurisconsultes, et qui leur et bien
supérieur par l'étendue de ses lumières. Voilà donc une espèce de
services très*propres à obliger les hommes et à nous les attacher.
Auprès de la science du droit vient se placer l'art de bien dire,
plus brillant encore, et qui a de plus grands effets. Que peut-on
comparera l'éloquence, à l'admiration qu'elle excite, aux espérances
qui reposent sur elle, à la reconnaissance de ceux qu elle a sauvés?
Aussi nos pères l'ont-ils mise au premier rang parmi les arts de la
paix. Est-il un homme qui puisse répandre autant de bienfaits et
exercer un patronage aussi honorable que l'orateur qui réunit le
talent à l'amour du travail, et qui est toujours prêt à défendre
gratuitement les pauvres accusés? Le sujet m'engagerait de lui-même
à déplorer ici l'état de souffrance, pour ne pas dire la ruine de
l'art oratoire, si je ne craignais de paraître déplorer mon propre
malheur. Tout le monde voit cependant quels orateurs nous avons
perdus, combien peu donnent des espérances, combien moins encore ont
un vrai talent, et quel grand nombre d'autres ne se font distinguer
que par leur présomption. 481
Comme tons les hommes ne sauraient être orateurs ou jurisconsultes,
et que fort peu même sont appelés à le devenir, la plupart ont à
rendre d'autres services; ils peuvent implorer la bienveillance
d'autrui pour les malheureux, recommander les accusés aux juges, aux
magistrats, veiller aux intérêts des hommes du peuple, s'employer
pour eux près des jurisconsultes et des avocats. Voilà comment ils
rendront une foule de services et se gagneront bien des cœurs. Tout
le monde comprendra, je pense, sans qu'il soit besoin d'en rien
dire, qu'il faut se garder, en voulant obliger les uns, de faire
tort aux autres. Souvent, en offensant les hommes, on manque au
respect qu'on leur doit, ou l'ou blesse ses propres intérêts; si on
le fait par imprudence, c'est une négligence coupable ; si on le
fait de propos délibéré, c'est une témérité insupportable. Il tout
s'excuser, autant qu'on le peut, près de ceux que l'on a offensés
sans le vouloir, leur montrer qu'on a été contraint par la
nécessité, qu'il eût été impossible d'agir autrement; il faut enfin
réparer avec empressement les torts et le mal qu'on a commis.
XX. Pour rendre service, on peut
avoir égard ou au mérite ou à la fortune des personnes. Il est
facile de dire, et c'est ce que l'on entend répéter partout, que
pour obliger les gens on ne considère point leur fortune, mais leur
mérite. C'est là un fort beau langage. Mais en est-il beaucoup qui
préfèrent les intérêts d'un citoyen pauvre et honnête à la
reconnaissance d'un homme riche et puissant? On penche presque
toujours du côté où le prix du service se montra et le moins éloigné
et le plus certain. Il faudrait cependant examiner les choses sans
prévention. L'homme pauvre, s'il est honnête, pourra bien ne pas
s'acquitter, mais 481
il sera reconnaissant. Je ne sais quel auteur a dit fort
ingénieusement : « Celui qui a de l'argent prêté ne l'a pas rendu ;
celui qui Ta rendu ne l'a plus : mais pour la reconnaissance, celui
qui Ta témoignée l'a encore, et celui qui l'a la témoigne. » Ceux
qui se voient riches, honorés, heureux, ne veulent pas même se tenir
pour obligés d'un bienfait ; bien plus, ce sont eux qui croient vous
obliger quand ils reçoivent de vous un service, quelque grand qu'il
soit; et ils soupçonnent toujours que vous leur demandez ou que vous
attendez d'eux quelque chose. C'est une mort pour de tels hommes, de
penser qu'ils ont eu recours à vos bons offices et que vous pouvez
les regarder comme vos clients. Mais quand vous vous employez pour
le pauvre, il est bien convaincu que c'est réellement à lui que vous
pensez, et non à sa fortune ; et le voilà dévoué non-seulement à
vous qui lui rendez un service, mais à tous ceux qui peuvent lui en
rendre, et ils sont nombreux ; le voilà prêt à vous servir vous-même
en toute occasion, et qui, loin de faire sonner bien haut les bons
offices, en atténuera plutôt la valeur. Autre considération : si
vous venez en aide à un homme riche et puissant, lui seul, ou tout
aù plus ses enfants, vous en auront de la reconnaissance ; si c'est
au contraire à un citoyen pauvre, mais honnête, tous ceux qui sont
dans la même condition que lui, et qui composent la plus grande
partie du peuple, vous regardent comme leur génie tutélaire. Je
tiens donc qu'un bienfait est mieux placé sur l'honnête homme que
sur le riche. Le mieux serait incontestablement de pouvoir servir
tout le monde ; mais, s'il vous faut opter, suivez l'exemple de
Thémistocle. Quelqu'un lui demandait quel parti il aimerait le mieux
pour sa fille, ou d'un homme 482
pauvre mais honnête, ou d'un homme riche mais sans considération :
«J'aime mieux, répondit-il, un homme sans argent, que de l'argent
sans homme. » C'est l'idolâtrie des richesses qui a corrompu et
dépravé les mœurs. Vous admirez les grands trésors, mais à quoi vous
servent-ils? Vous me répondrez qu'ils servent beaucoup à celui qui
les possède. Peut-être, mais du moins pas toujours. Admettons ce que
vous dites; la fortune rendra l'homme plus puissant, mais le
rendra-t-elle meilleur? Si cependant ii est homme de bien, ses
richesses ne doivent pas nous empêcher de le servir; mais il ne faut
pas qu'elles noue y engagent. Ce n'est jamais à la fortune, mais au
mérite de l'homme, qu'il faut avoir égard. Le dernier précepte à
donner pour l'exercice de la bienfaisance, c'est de ne rien
entreprendre contre l'équité, de ne se permettre aucune injustice;
car le fondement d'une solide estime et d'une réputation durable,
c'est la justice, hors de laquelle vous ne trouverez rien qui soit
digne d'éloge.
XXI. Nous avons parlé des bienfaits
qui s'adressent à chaque homme en particulier : il me reste à vous
entretenir des services que Ton peut rendre à tous les citoyens
ensemble et au corps de l'État. Parmi ces derniers bienfaits, il en
est que l'État recueille plus particulièrement, et d'autres qui se
répandent sur chacun des citoyens, et qui par cela même sont plus
agréables à la multitude. Il faut autant que possible servir chacun
et tout le monde ; mais je ne voudrais pas que Ton pensât trop à
l'État et trop peu aux citoyens ; occupons-nous d'eux, pourvu qu'en
les obligeant nous ayons soin de nous rendre utiles à la république,
ou pour le moins de ne pas blesser ses intérêts. Caïus Gracchus fils
de grandes distributions de blé ; mais il épuisait le trésor public.
M. Octavius en fit de plus modérées, qui ne furent point trop
onéreuses à la république, et qui étaient nécessaires aux besoins du
peuple; c'était pourvoir à la fois au bien de l'État et à celui des
citoyens. Un sage politique veillera surtout à ce que chacun
conserve ce qui lui appartient, et à ce qu'il ne soit porté, au nom
de l'intérêt public, aucune atteinte aux propriétés privées. Le
tribun Philippus remua de bien mauvaises passions en proposant la
loi agraire ; il est vrai qu'il la laissa facilement rejeter, et en
cela il se montra d'une modération étonnante ; mais en la soutenant
dans un esprit tout populaire, il eut grand tort de dire qu'il n'y
avait pas dans Rome deux mille citoyens qui eussent un patrimoine.
C'était là un discours incendiaire et qui n'allait à rien moins qu'à
l'égalité des biens, c'est-à-dire au plus grand fléau du monde. Car
les États et les cités se sont établis surtout afin que chacun pût
jouir de sa propriété. S'il est vrai que les hommes se sont d'abord
rassemblés par une impulsion naturelle, ils n'ont cependant cherché
un abri derrière les murailles des villes que dans l'espoir de mieux
conserver leurs biens. Il faut encore éviter avec soin de charger le
peuple d'impôts, comme nos ancêtres y furent souvent contraints par
l'épuisement du trésor et la continuité des guerres ; c'est une
nécessité qu'il faut savoir conjurer longtemps à l'avance. Si
cependant elle se présente un jour et impose ce dur fardeau à
quelque république (j'aime mieux faire cette supposition pour
d'autres que pour nous, et d'ailleurs
483 je ne parle pas
seulement de Rome, mais de tous les États en général), on devra
avoir grand soin de. faire entendre à tous les citoyens qu'ils n'ont
plus d'autre moyen de salut que de se soumettre à cette nécessité.
Ceux qui gouvernent les peuples doivent pourvoir à ce qu'il y ait
toujours abondance des choses nécessaires à la vie. Par quels moyens
y parviendront-ils? c'est ce que je n'ai pas besoin d'expliquer ici,
et qui est à la connaissance de tout le monde ; il suffisait à mon
dessein d'indiquer ce devoir. II est on ne peut plus essentiel, dans
toute gestion des affaires et des intérêts publics, d'éviter
jusqu'au moindre soupçon d'avarice. « Plût au ciel, disait C.
Pontius le Samnite, que la fortune ne m'eût point encore fait
naître, et m'eût réservé pour les jours où les Romains auraient
commencé à recevoir des dons ! je n'eusse pas souffert que leur
empire durât plus longtemps. » Il aurait eu quelques siècles à
attendre ; car c'est depuis peu que ce mal a gagné la république.
Pour moi, j'aime beaucoup mieux que Pontius ait vécu dans ces temps
anciens , s'il avait réellement tout le mérite qu'on lui donne. Il
n'y a pas encore cent dix ans qu'une loi contre les concussions fut
portée par L. Pison ; et c'était la première. Mais depuis on en a
porté un si grand nombre, il a fallu déployer une telle sévérité
contre le progrès du mal, il y a eu tant d'accusés et tant de
condamnés, on a vu une guerre si violente soulevée en Italie par
ceux qui redoutaient le glaive de la justice, on a tellement pillé
et rançonné nos alliés au mépris des tribunaux et des lois, que nous
ne sommes plus rien que par la faiblesse des autres, et ne comptons
plus par notre propre valeur.
XXII. Panétius loue Scipion
l'Africain de son désintéressement. Il a raison; mais je trouve dans
l'Africain des vertus encore plus dignes d'éloge. Ce n'est pas lui
seulement, mais tout son siècle, qui était désintéressé. Paul-Émile
vit entre ses mains tous les trésors de la Macédoine, qui ; étaient
immenses. Il en remplit si bien le trésor public, que ce butin d un
seul général suffit pour mettre fin aux impôts; mais il n'en
rapporta rien dans sa maison, si ce n'est une gloire impérissable.
L'Africain imita son père, et rentra chez lui les mains vides après
avoir détruit Carthage. Et son collègue dans la censure, L. Numérius,
en fut-il plus riche pour avoir renversé la plus opulente des
villes? Il aima mieux orner l'Italie que sa propre maison ; quoique,
à mon goût, sa maison soit tout ornée par les merveilles mêmes dont
il a rempli l'Italie. Je dis donc, pour en revenir au point d'où
nous sommes partis, qu'il n'y a pas de défaut plus honteux que
l'avarice, surtout pour les premiers citoyens et les chefs des
États. Exploiter la république à son profit, c'est non-seulement une
chose honteuse, mais un crime abominable. L'oracle d'Apollon Pythien
avait annoncé à Sparte qu'elle ne périrait que par son avarice :
mais la prédiction ne s'adressait pas seulement aux Lacédémoniens ;
elle était faite pour toutes les nations opulentes. Ceux qui
gouvernent les États ne peuvent se concilier plus sûrement la
bienveillance de la multitude que par l'intégrité et le
désintéressement. Ceux qui veulent devenir populaires, et qui, par
ce motif, proposent des lois agraires pour expulser de leurs biens
les possesseurs légitimes, ou demandent avec instance que toutes les
dettes soient remises, au détriment des créanciers; ceux-là sapent
les fondements de la république, en détruisant d'abord la concorde,
qui ne peut exister lorsqu'on dépouille les uns pour gratifier les
autres ; et en- 484
suite l'équité, qui est anéantie du moment que chacun ne peut
conserver sa propriété. Nous avons dit, en effet, que la condition
essentielle de toute cité, c'est de permettre à chacun de posséder
ses biens librement et avec une entière sécurité. Et, en ruinant
ainsi l'État, les hommes dont nous parlons n'obtiennent pas même
cette faveur publique qu'ils espéraient. Celui qu'ils dépouillent
devient leur ennemi, celui qu'ils enrichissent dissimule la
satisfaction qu'il éprouve; le débiteur surtout cache sa joie, de
peur qu'on ne pense qu'il était insolvable. Mais l'homme à qui l'on
a fait injustice s'en souvient, et laisse éclater son
mécontentement; et quand même ceux qui ont reçu une gratification
inique seraient en plus grand nombre que ceux dont les droits ont
été indignement méconnus, ils ne seraient pas pour cela le parti le
plus important; car ici ce n'est pas le nombre, c'est le poids qu'il
faut voir. Quelle sorte d'équité est-ce là que d'enlever au
possesseur un champ qui est la propriété de sa famille depuis
longues années ou même depuis des siècles, pour en faire jouir un
intrus?
XXIII. C'est pour quelque injustice
de ce genre que les Lacédémoniens chassèrent l'éphore Lysandre et
mirent â mort leur roi Agis, ce qu'on n'avait pas encore vu chez
eux. A dater de cette époque Sparte fut déchirée par des troubles
continuels; des tyrans s'élevèrent, les meilleurs citoyens furent
exterminés, et l'admirable constitution de cette république
s'écroula de toutes parts. Sparte ne périt pas seule; le mal qui
l'anéantissait gagna de proche en proche, comme un fléau contagieux
; et, parti de Lacédémone, il infesta bientôt toute la Grèce. Et
nous, n'avons-nous pas vu les Grecques , fils de Tib. Gracchus, cet
excellent citoyen , et petits-fils du premier Africain, perdus par
leur zèle coupable pour la loi agraire ? Le Sicyonien Aratus, au
contraire, a mérité les plus grands éloges. Sa patrie était, depuis
cinquante ans, sous le joug des tyrans, lorsqu'il partit d'Argos
pour Sicyone, s'y introduisit secrètement, s'en rendit le maître,
surprit et mit à mort le tyran Nicoclès: aussitôt après il rappela
six cents exilés qui avaient été les plus riches citoyens de la
ville, et rendit à l'État son ancienne liberté. Mais bientôt il
aperçut de grandes difficultés pour le règlement des propriétés;
d'une part, il regardait comme très-injuste de laisser dans
l'indigence ceux qu'il avait rappelés, et dont les biens étaient
possédés par autrui; de l'autre, il ne pensait pas qu'il fût
très-équitable de troubler une possession qui remontait à cinquante
ans, surtout parce que la plupart de ces biens étaient passés par
héritage, par achat, ou sous forme de dot, dans les mains de gens
qui en jouissaient de bonne foi ; il jugea donc qu'on ne devait ni
dépouiller les nouveaux propriétaires , ni laisser les anciens sans
une juste indemnité. Voyant bien qu'il fallait de l'argent pour
arranger l'affaire, il annonça qu'il allait partir pour Alexandrie,
et demanda qu'on ne touchât à rien jusqu'à son retour. Arrivé en
toute hâte près de Ptolémée son hôte, le second roi d'Alexandrie, il
lui exposa qu'il voulait rendre sa patrie à la liberté, et lui fit
connaître l'état des choses. Ce grand homme obtint facilement de
l'opulent monarque un secours d'argent considérable. De retour à
Sicyone, il se fit un con- 485
seil de quinze citoyens principaux, examina avec eux les titres de
ceux qui avaient été dépouillés, et des nouveaux possesseurs; et
après avoir évalué les biens en litige, il vint à bout de persuader
aux uns de les restituer moyennant indemnité, et aux autres d'en
recevoir la valeur et de renoncer à leurs titres. De cette façon
tout le monde fut satisfait et la concorde se rétablit. Ο grand
homme, vous étiez digne d'appartenir à notre république! Voilà comme
il convient d'agir avec des citoyens, et non pas, comme nous l'avons
vu deux fois, de planter la pique au milieu du forum et de vendre
leurs biens à l'encan. Mais ce Grec pensa, en homme sage et
excellent qu'il était, qu'on devait ménager les intérêts de tous; et
jamais un bon citoyen n'aura d'autre politique et d'autre sagesse
que de maintenir dans l'État la plus parfaite égalité de droit, et
de ne mettre jamais aux prises les intérêts de ses concitoyens. Quoi
! vous habiterez gratuitement la propriété d'autrui ? Qu'est-ce à
dire? voilà une maison que j'ai achetée ou bâtie, que j'entretiens,
où je fais des dépenses continuelles, et vous viendrez de force vous
y installer? N'est-ce pas là évidemment ce qui arrive, quand on
dépouille les uns pour enrichir les autres? Et ces nouvelles lois
sur l'abolition des dettes, que signifient-elles, sinon que vous
achetez une terre avec mon argent, que vous gardes la terre, et que
je perds l'argent?
XXIV. Il faut donc arrêter dans ses
progrès ce fléau de la dette, qui fait tant de mal aux États. On le
peut de plusieurs manières, pourvu que ce ne soit pas en frustrant
les créanciers et en gratifiant les débiteurs du bien d'autrui. La
société n'a pas de plus solide appui que la confiance réciproque des
citoyens, confiance qui s'évanouit du moment où l'on n'est
plus obligé d'acquitter ses dettes. Jamais les droits des créanciers
ne furent plus violemment attaqués que sous mon consulat. Des hommes
de tout ordre et de toute condition prirent les armes, formèrent des
camps; je leur résistai si bien, que la république fut délivrée de
ce grand fléau. Jamais les dettes n'avaient été plus considérables,
jamais elles ne furent mieux ni plus facilement acquittées. L'espoir
de frustrer ses créanciers une fois perdu, il fallut bien songer à
les payer de bel argent. Mais cet homme qui triomphe aujourd'hui, et
dont j'étais alors le vainqueur, exécute le dessein qu'il avait
conçu depuis longtemps, et dont il ne pouvait plus tirer aucun
fruit. Il avait tant de goût pour le mal, qu'il trouvait sa
jouissance aie commettre même sans motif. Ceux qui seront appelés à
gouverner la république auront donc une juste aversion pour ces
largesses qui consistent à dépouiller les uns pour gratifier les
autres. Ils veilleront avec un soin extrême à ce que les lois et les
tribunaux assurent à chacun la libre possession de ses biens; à ce
qu'on n'opprime pas les pauvres citoyens, impuissants à se défendre;
à ce que l'envie n'empêche point les riches d'user à leur aise de
leur fortune et de poursuivre le recouvrement de leurs créances.
Mais les hommes d'État peuvent augmenter les ressources de leur pays
; la guerre et la paix leur offrent mille moyens d'étendre ses
revenus, son territoire, son empire. Voilà comment se signalent les
grands hommes; voilà ce que nos ancêtres ont si souvent pratiqué.
Ceux qui rendent de tels services à la république lui procurent les
plus solides avantages, et arrivent eux-mêmes au comble de la faveur
et de la gloire. Parmi ces préceptes relatifs à l'utile, Antipater
de Tyr, 486 qui
est mort dernièrement à Athènes, reprochait à Panétius d'en avoir
négligé deux : le soin de la santé et celui de la fortune. Je pense
que ce grand philosophe n'a omis d'en parler que parce qu'ils
n'échappent à personne. Quant à leur utilité, elle est
incontestable. La santé se conserve par la connaissance de notre
tempérament, par l'observation de ce qui peut lui être favorable ou
nuisible, par la tempérance et les divers soins qu'il faut prendre
du corps, par la pureté des mœurs, et enfin par l'art de ceux qui
ont le secret de la rappeler et la rétablir. Quant à la fortune, il
faut la chercher par des voies légitimes, la conserver par sa
vigilance et son économie, l'augmenter par les mômes moyens.
Xénophon le Socratique a parfaitement traité toute cette matière
dans son livre intitulé l'Économique, que j'ai traduit du grec en
latin lorsque j'avais à peu près votre âge.
XXV. Il est souvent nécessaire de
comparer entre elles les choses utiles; c'est là, comme vous le
savez, la quatrième partie de notre sujet, et Panétius l'a passée
sous silence. On compare assez fréquemment les biens du corps avec
les biens extérieurs, et réciproquement les biens extérieurs avec
ceux du corps ; on compare aussi les biens du corps entre eux et les
biens extérieurs, les uns avec les autres. C'est ainsi que l'on
com¬pare les biens du corps avec les biens extérieurs quand on
demande si la santé vaut mieux que la richesse ; les biens
extérieurs avec ceux du corps, lorsqu'on demande s'il vaut mieux
être riche qu'avoir la force d'un athlète ; les biens corporels se
comparent entre eux de cette sorte : la santé est-elle préférable au
plaisir? la force à l'agilité? Enfin on compare entre eux les biens
extérieurs, comme la gloire avec les richesses, les revenus de
la ville avec ceux de la campagne. C'est à cette dernière espèce de
comparaison qu'appartiennent les réponses fameuses de Caton
l'ancien. On lui demandait quelle était la première richesse dans un
patrimoine : « Les bons troupeaux, répondit-il. — Et la seconde? —
Les troupeaux pas* sables. — Et la troisième ? — Les mauvais
troupeaux. — Et ensuite? — Le labourage. » Celui qui l'interrogeait
lui dit alors : « Et de prêter à usure, qu'en pensez-vous?» Caton
repartit: « Et de tuer un homme, que vous en semble? » Tous ces
exemples et bien d'autres encore prouvent que l'on compare souvent
entre elles les choses utiles, et que nous avons eu raison d'ajouter
cette quatrième partie à la division de Panétius. Mais pour tout ce
qui regarde l'argent, les moyens de le gagner, de le placer,
j'ajouterai volontiers de s'en servir ; je vous conseillerai d'aller
prendre des leçons auprès de ces excellentes gens qui se tiennent
vers le milieu des portiques de Janus, plutôt que de venir en
chercher dans une école de philosophie. Ce sont des choses pourtant
qu'il est bon de connaître ; car elles concernent l'utile auquel ce
livre était consacré. Nous réservons pour le troisième la dernière
partie de notre sujet.
|