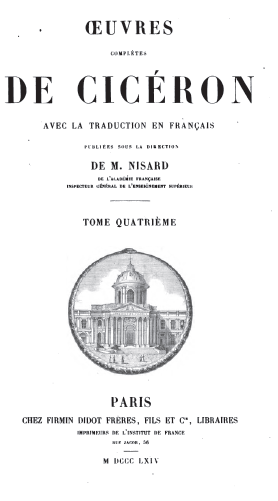ŒUVRES
COMPLÈTES
DE CICÉRON,
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,
PUBLIÉES
SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD,
DE L'ACADÉMIE
INSPECTEUR GÉNÉRAL DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
TOME QUATRIEME

PARIS,
CHEZ FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET Cie, LIBRAIRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE
RUE JACOB, .
M DCCC LXIV
356
TRAITÉ DES LOIS
PRÉFACE
Lorsque Platon eut tracé le plan d'une cité parfaite, dans ce Traité de
morale qu'il nomma la République, il composa les douze Livres des
Lois, ouvrage moins brillant et peut-être plus solide, où se fait sentir
déjà la main de la vieillesse, qui refroidit le poète et mûrit le
philosophe. Cicéron, son disciple et son imitateur, après avoir écrit six
Livres sur la République, voulut aussi, dans un Traité particulier,
donner la législation positive du gouvernement dont il avait exposé la
théorie. Dans la République de Platon, l'imagination semble avoir
dicté presque autant de lignes que la réflexion; et le sage Athénien,
étranger aux affaires politiques, a peut-être cherché dans la liberté de la
spéculation une perfection imaginaire. Ses Lois ne sont point celles
de sa République. En observant les diverses constitutions des États
delà Grèce, particulièrement celles de Crète et de Lacédémone, Platon s'est
proposé de rechercher le but de la législation, et les moyens d'atteindre ce
but; et son ouvrage n'est qu'un recueil de considérations générales et de
vues pratiques sur l'économie de la société. Le consul romain n'avait pas
formé le plan de sa République d'une manière aussi indépendante,
aussi abstraite que le philosophe des idées; il ne l'a pas suivi davantage
dans ses Lois. Dans le premier Traité, Scipion, après avoir discuté
les principes de la politique, en présentait, comme l'application la plus
fidèle, l'antique constitution de Rome. Lié par cet engagement, lorsque
Cicéron voulut faire un système de lois, il n'eut qu'à développer l'esprit
des lois romaines, dont son ouvrage, excepté le premier Livre, n'est, à peu
de chose près, qu'un commentaire.
Un jour d'été, Platon, en parcourant le chemin ombragé de platanes qui
conduit de Gnosse à la grotte où fut nourri Jupiter, s'entretient sur la
législation avec un Crétois et un Spartiate qui suivent la même route, et
cet entretien est le Traité des Lois. Cicéron, le matin aussi d'un
jour d'été, se promène dans les environs de sa maison de campagne d'Arpinum,
avec Quintus Cicéron son frère, et son ami T. Pomponius Atticus. Là, près du
Fibrène, obscur ruisseau qu'il a rendu célèbre, ils rencontrent un chêne
qu'Atticus croit reconnaître pour celui sur lequel Marius avait vu un
étonnant présage; ainsi du moins le racontait le poëme que Cicéron avait
consacré à sa gloire. Cette circonstance amène la conversation sur la
différence de la véracité du poète et de celle de l'historien; et Atticus en
prend occasion d'exhorter son ami à donner à leur patrie ce qu'elle n'avait
point, une histoire digne d'elle. Cicéron répond qu'il réserve ce travail
pour l'âge où, renonçant à la plaidoirie, il se bornera aux fonctions de
jurisconsulte. Mais pourquoi, lui dit Atticus, n'écririez-vous pas dès
aujourd'hui sur la jurisprudence, et ne publieriez-vous pas les résultats de
votre expérience des affaires et de vos méditations sur le droit? Cicéron
fait sur-le-champ ce qu'Atticus lui propose; et le fruit de cette promenade
d'une journée sur les bords du Liris et du Fibrène, est le Traité des
Lois.
Le premier Livre est purement philosophique. Après le préambule, remarquable
par l'élégance et le charme du style, Cicéron se propose, le premier sans
doute des jurisconsultes romains, la grande question morale de l'origine du
droit. C'est déjà un mérite que d'avoir compris qu'une solution quelconque
de cette question était un préalable nécessaire à toute étude du droit
écrit, puisque en effet, selon cette solution, la législation devient une
combinaison changeante comme les circonstances, ou une science immuable
comme la vérité.
C'est ce que beaucoup de jurisconsultes et de publicistes ont paru ignorer
ou du moins oublier, même parmi les modernes. Il a fallu presque toujours
qu'à leur défaut les philosophes se chargeassent d'asseoir la jurisprudence
sur une base solide; il a fallu que les métaphysiciens l'élevassent au rang
des sciences rationnelles, en lui imprimant le sceau de la conséquence et de
la certitude.
Au temps et dans le pays de Cicéron, c'était une innovation, c'était une
véritable découverte que d'établir, que de soupçonner seulement une relation
intime, une dépendance nécessaire entre le droit positif et la question de
la nature même du droit.
Cette question est celle de l'origine ou des fondements de la justice, de la
réalité des distinctions morales, des limites du bien et du mal, de la
raison du devoir, de l'immutabilité de la vertu: tous ces noms reviennent au
même.
Sous des noms divers aussi, les philosophes grecs l'avaient agitée longtemps
avant Cicéron, et presque toutes les opinions soutenues depuis par les
modernes avaient été développées ou du moins commencées par eux. Adam Smith
les ramène à trois principales, dans un examen critique placé à la fin du
livre où il a exposé la sienne, qui assurément n'en forme pas une quatrième.
Selon lui, les philosophes ont donné à la vertu l'un de ces trois principes:
l'intérêt ou l'amour de soi, la raison
357
ou le droit, le sentiment ou le sens moral. La sympathie, qu'il croit
avoir découverte comme un principe nouveau, se confond évidemment avec le
dernier, et ce dernier lui-même se confond avec l'un des deux premiers; car
si l'on dit que la pratique de la vertu a pour cause unique le désir de
satisfaire ce penchant naturel qu'on appelle sentiment, on revient au
principe de l'amour de soi. Si l'on dit que ce penchant naturel est
constant, qu'il est une prédisposition de notre nature, on donne pour hase à
la morale la vérité, et à la vertu la raison: c'est adopter un principe de
droit. On peut donc simplifier plus que Smith ne l'a fait, et ne reconnaître
que deux doctrines, que j'appellerai la doctrine du droit et la doctrine de
l'intérêt.
En effet, toute doctrine qui fonde la morale, et par suite la législation et
la politique, soit sur l'utilité individuelle ou commune, soit sur la
crainte du châtiment actuel ou même à venir, soit enfin sur l'amour du
plaisir, s'appuie d'un principe d'intérêt: car c'est un intérêt même qu'un
plaisir. Toute doctrine qui fait reposer la justice sur l'essence de la
raison humaine, sur sa ressemblance, sa conformité avec la raison divine,
sur la nature même des choses, enfin sur tout rapport fixe et absolu,
reconnaît un principe de droit. Par conséquent, l'une est arbitraire,
l'autre invariable.
Aussi, chez les Grecs, tous ceux qui soutenaient la première, comme les
cyrénaïques et les épicuriens, étaient ou devaient être forcés d'admettre
que la morale étant arbitraire, les lois l'étaient aussi; qu'elles
décidaient du juste et de l'injuste selon les lieux et les temps; que le bon
et l'honnête dépendaient de l'opinion, de la convention, du caprice. Dans ce
système, l'homme n'est obligé au devoir moral qu'à raison des inconvénients
qui en suivent la violation; il n'est astreint aux lois civiles que par le
châtiment; le lien de la société c'est la crainte, et la vertu publique ou
privée n'est plus qu'un calcul.
Dans le système opposé, dans celui des trois grandes sectes qui modifièrent,
sans la dénaturer, la tradition de Socrate, l'Académie, le Lycée, le
Portique, l'homme n'est obligé aux devoirs de tous genres que par la vérité
qui est dans chacun de ces devoirs, et par sa raison qui la lui fait
connaître. Cette sympathie naturelle, qui existe entre le bien et nous, est
la source unique de l'obligation morale.
Nulle part la différence des deux doctrines ne se montre mieux que dans la
fameuse discussion sur le souverain bien. Qu'est-ce que le souverain bien?
en d'autres termes, qu'est-ce que l'homme doit rechercher avant toutes
choses? quel est le mobile de ses déterminations morales, ou bien enfin
quelle est sa loi? — La volupté, disaient Aristippe et Épicure; — l'absence
de la douleur, d'après Hiéronyme de Rhodes; — la jouissance des choses
naturelles, selon Carnéade; — la ressemblance avec Dieu (ὁμοίωσις
τῷ Θεῷ), suivant l'expression de Platon; — la
jouissance de la vie sous le gouvernement de la vertu, s'il faut en croire
Aristote; — l'honnête, répondaient Zénon et Chrysippe. — Il y avait aussi,
comme il arrive presque toujours, des philosophes qui s'efforçaient de
concilier sans succès les deux opinions. Ainsi Calliphon plaçait le
souverain bien dans la réunion de la vertu et de la volupté; Diodore, dans
la vertu jointe à l'absence de la douleur. Mais ces opinions moyennes
inclinaient, au gré du philosophe, vers l'une ou vers l'autre des opinions
extrêmes, selon qu'elles donnaient la prééminence au droit ou à l'intérêt.
Carnéade, par exemple, quoiqu'il n'ait pas prononcé les mots d'intérêt ni de
volupté, doit être compté, a cause des doutes qu'il a élevés sur la réalité
de la morale, du côté des épicuriens; tandis qu'il serait injuste de placer
dans les mêmes rangs les péripatéticiens, quoique leur définition du
souverain bien se rapproche de la sienne. Ils disaient (et là-dessus Polémon
et les Platoniciens s'écartaient peu de leur opinion) que le bonheur du
sage, le souverain bien, était de vivre selon la nature, et de jouir de ses
dons suivant la vertu. Les Stoïciens affirmaient que le souverain bien
consistait à se conformer à la nature. Or, Cicéron observe avec raison qu'au
fond la différence est faible, et réside entièrement dans les termes. Mais
ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas fait voir du moins, c'est que
l'équivoque est tout entière dans le mot nature. Suivant Aristote, il
faut vivre selon la nature, c'est-à-dire obéir aux penchants
naturels, en les soumettant néanmoins à une loi, qui est la vertu. Selon les
Stoïciens, il faut se conformer à la nature, c'est-à-dire à la vertu:
car la nature d'un être est sa loi; or, la loi de l'homme, c'est la raison,
la droite raison; et l'application delà raison à la conduite, c'est
indifféremment la sagesse ou la vertu, en observant que la sagesse est
plutôt une science, et la vertu une pratique. Ainsi, les deux systèmes
reconnaissent également une loi indépendante, préexistante, absolue: en ce
point, ils se confondent.
Il suit de là que soutenir que le juste existe par lui-même, qu'il est dans
la nature, qu'il y a un droit naturel, que l'honnête est louable et
désirable en lui-même, que la vertu n'est que la nature parfaite, que la
nature est une loi, que la loi est la raison; c'est soutenir une seule et
même opinion, c'est traduire diversement une seule et même pensée.
Telle est la pensée fondamentale de tout le premier Livre des Lois de
Cicéron; et pour la développer, il a emprunté ses preuves et son
argumentation aux Stoïciens, qu'il combat et qu'il raille souvent dans ses
écrits, mais auxquels il est bien forcé de recourir toutes les fois qu'il
veut élever et affermir la morale: témoin le Traité des Devoirs. Les
Stoïciens sont, en effet, les philosophes de l'antiquité qui ont le mieux
dévoilé le principe même du devoir. Il y a un rapport essentiel, ont-ils
dit, entre la raison, loi de l'homme, et la raison suprême ou la vérité, loi
de la raison: l'une est l'image de l'autre. Car, bien qu'ils aient nié les
idées innées, ils n'ont point méconnu ces notions élémentaires, ces faits
primitifs de l'entendement, que Cicéron appelle des intelligences
commencées, et qui communiquent aux vérités qu'elles révèlent
immédiatement, la certitude qui s'attache au sentiment de l'existence même.
Or, la raison suprême la vé- 358 rité,
n'est pas distincte de la volonté divine; c'est Dieu même, selon le sens de
ces belles paroles attribuées à Orphée: «Il est un Dieu, et la vérité est
coéternelle à Dieu.» II suit de là qu'il y a ressemblance de l'homme avec
Dieu, puisque la raison est essentiellement la même en Dieu et dans l'homme;
or, si la raison est la même, la loi est la même; la vertu, qui n'est que
l'observation de cette loi, est aussi la même. Et comme la loi d'un être est
sa nature, et que la raison est la loi de l'homme, il suit que la vertu
n'est que la conformité des actions à la nature, n'est que la nature
perfectionnée en soi, c'est-à-dire la nature ramenée à elle-même. Si donc il
y a entre Dieu et l'homme communauté de raison, de loi, de vertu, de nature,
il y a aussi, non-seulement ressemblance, mais liaison, mais parenté, mais
amitié; et même, au dire de Sénèque: «L'homme de bien ne diffère de Dieu que
par la durée.» Ainsi du moins la perfectibilité humaine a pour type la
perfection divine, et c'est en ce sens que l'on a pu dire que le sage est
Dieu.
Le sage est Dieu; la raison ou la loi est la reine des choses créées et
incréées; la vertu consiste à se conformera la nature: telles sont plusieurs
des principales maximes que l'ignorance ou la mauvaise foi ont si souvent
défigurées, et qui n'en font pas moins la gloire du Portique. Pour qui les
entend dans leur vrai sens, elles ne recèlent point d'impiété ni
d'immoralité; elles ne cachent que des vérités que le christianisme a
prêchées depuis par toute la terre. Elles n'ont point échappé à Cicéron; et
s'il n'en a pas saisi toute la portée, s'il n'a pu, dans cet ouvrage, leur
donner toute la démonstration à laquelle elles ont droit, s'il s'est
contenté quelquefois d'affirmer au lieu de déduire, il faut se rappeler que
cette partie delà philosophie morale n'était pas l'objet direct du Traité,
qu'elle n'y était discutée que par circonstance et pour une application
particulière, et qu'enfin il l'a plus sérieusement approfondie dans un
ouvrage fort supérieur, le Traité de Finibus, où peut-être, en
donnant à la doctrine académique la préférence sur celle des Stoïciens, il a
été moins heureusement inspiré.
On trouvera du moins que Cicéron, dans le premier Livre des Lois,
établit d'une manière suffisante pour les besoins du sujet ce principe de
droit, que ses adversaires ont appelé, avec quelque dérision, principe de
l'ascétisme, et sans lequel cependant la morale et la politique tombent
sans force et sans appui. «II y a donc une raison primitive,» dit
Montesquieu, au commencement de son livre. Cette raison primitive est la loi
des lois; et la raison humaine en est la perpétuelle révélation; elle la
reconnaît en elle, et elle s'y conforme; selon l'expression de saint Paul,
«lle se sert à elle-même de loi.» Cette vérité, qui semble si simple, ne
saurait être trop répétée: les publicistes l'ont si souvent attaquée ou
obscurcie! Grotius lui-même, qui l'avait entrevue, n'a pas su toujours la
prouver ni la suivre. Puffendorf et son commentateur Barbeyrac l'ont presque
niée, substituant au droit l'intérêt, et à la vérité la convention. D'autres
ennemis les sceptiques, parmi lesquels on regrette de trouver Pascal, ont
attaqué à leur tour ce dogmatisme tutélaire, alliance admirable de la raison
et de la foi. Ils ont été jusqu'à se liguer avec Puffendorf, avec Hobbes
lui-même, pour ébranler l'immutabilité du droit. Il y a déjà longtemps que
Leibnitz avait répondu aux uns et aux autres, en remontrant à ce même
Puffendorf la vanité des principes de sa science: «La science du droit
naturel, avait-il dit, expliquée selon les principes du christianisme, et
même selon les principes des vrais philosophes, est trop sublime et trop
parfaite pour mesurer tout aux avantages de cette vie présente Dans la
science du droit, si l'on veut donner une idée pleine de la justice humaine,
il faut la tirer de la justice divine comme de sa source. L'idée du juste,
aussi bien que celle du vrai et du bon, convient certainement à Dieu, et lui
convient même plus qu'aux hommes, puisqu'il est la règle de tout ce qui est
juste, vrai et bon. La justice divine et la justice humaine ont des règles
communes, qui peuvent sans doute être réduites en système; et elles doivent
être enseignées dans la jurisprudence universelle, dont les préceptes
entreront aussi dans la théologie naturelle.» Ce que prescrit ici ce grand
philosophe, plus de seize siècles auparavant Cicéron l'avait fait, ou du
moins l'avait tenté; et quelques-uns des arguments qu'il a fait valoir sont
encore au nombre des meilleurs qu'on puisse opposer au principe de
l'utilité, même depuis que David Hume et Jérémie Bentham l'ont armé de
forces nouvelles. Si ses démonstrations ne sont ni complètes ni
péremptoires, il faut se rappeler que les Stoïciens, qu'il a suivis,
n'avaient point trouvé la métaphysique de leur morale; il était réservé à
notre siècle de la découvrir. D'ailleurs, la doctrine contraire était moins
habilement défendue; et la discussion, moins difficile, était aussi moins
féconde. Il a fallu que Hobbes plaidât d'une manière nouvelle et puissante
la cause de l'instabilité de la morale et la théorie de la convention, pour
que Rodolphe Cudworth, en le réfutant, rétablît l'immutabilité du juste et
de l'injuste, la préexistence du droit primitif, et préparât les voies à la
vérité, telle que Richard Priée l'a reconnue, telle que Kant l'a démontrée.
Cet exposé très-sommaire de l'état des questions morales entre les
différentes sectes de l'antiquité n'est nullement superflu. On verra qu'il
était nécessaire pour que l'on comprît bien ce que Cicéron avait à faire, ce
qu'il a fait, ce qu'il a laissé à faire après lui.
Le droit naturel une fois établi, la suite des idées nous conduit avec lui
au droit positif. Ici nous le verrons changer de rôle; le philosophe
deviendra publiciste; les principes se convertiront en lois, et la théorie
sera décrétée. Il nous semble qu'il a moins bien réussi dans ce nouveau
travail, et le politique nous fait regretter le moraliste. Après avoir fait
preuve, dans la spéculation, d'indépendance et d'esprit philosophique, il
rentre, en parlant des lois écrites, sous l'empire des préjugés, et
peut-être des intérêts. Le disciple de Platon et de Chrysippe disparaît, et
le sénateur romain le consu- 359
laire, l'augure même, prennent sa place. Après avoir trouvé les vrais
principes de la législation, il n'ose en faire l'application librement, et
sans recevoir d'autre joug que celui de leurs conséquences. Après avoir
appuyé les lois sur leurs fondements naturels, il n'imagine rien au-dessus
de la législation de Rome, non pas même considérée d'une manière générale,
mais littéralement transcrite, avec toutes ses incohérences, avec toutes ses
complications, toutes ses puérilités; armé de ce seul raisonnement que,
puisque, dans la République, le gouvernement de Rome a été reconnu
comme le meilleur des gouvernements, sa législation doit être aussi la
meilleure de toutes. Il semble qu'il devrait au moins en donner les preuves,
la rapporter aux principes énoncés dans le premier Livre, et montrer qu'elle
en est une déduction exacte et naturelle; mais il ne se demande même pas
s'il n'y aurait point un meilleur moyen de traduire en lois cette justice
fondamentale dont il a précédemment établi l'existence, de constituer la
société sur ces rapports d'égalité et de bienveillance qu'il a reconnus, de
conformer la loi à la morale, d'affranchir enfin la religion de toute
crainte et de toute superstition, le devoir de tout calcul et de tout
préjugé. Il lui suffit d'affirmer que les lois romaines sont les meilleures;
et il les expose ensuite textuellement, à quelques modifications près, non
dans l'ordre logique qui doit toujours guider le philosophe, mais selon une
méthode arbitraire de classification qui suffit au jurisconsulte.
Quand le Traité des Lois fut composé, Rome n'était point tranquille,
ni surtout assurée; le souvenir des séditions des Gracques, des divisions
sanglantes de Marius et de Sylla, des tentatives de Drusus, de Cinna, de
Catilina, les rivalités déjà menaçantes de César et de Pompée, faisaient
redouter et prévoir aux citoyens éclairés, à ceux surtout qui s'attribuaient
par privilège le titre de bons citoyens, enfin aux partisans du sénat et de
la noblesse, des déchirements nouveaux et de nouvelles guerres civiles, la
ruine même de la république, par les excès de la démocratie et l'usurpation
militaire. Aussi les citoyens de cette opinion s'attachaient-ils
religieusement aux restes de la constitution ébranlée. Point de nouveauté si
nécessaire et si légitime qu'ils ne crussent de leur devoir de repousser;
point d'usage reçu, point d'abus même, pourvu qu'il fut ancien, qu'on ne les
vît s'efforcer à tout prix de conserver où de restaurer. L'antiquité, la
sagesse de leurs pères, étaient pour eux la règle infaillible. Ils ne
négligeaient aucune occasion d'assurer le moindre droit, le moindre
privilège à l'ordre sénatorial et au corps des patriciens, comme aux
défenseurs des mœurs et des lois du passé. Le maintien ou le rétablissement
du gouvernement aristocratique, le retour à ce qu'ils regardaient comme
l'ancien régime, était leur seul effort et leur unique doctrine. Elle aurait
pu se réduire à ces deux mots: les douze Tables et les honnêtes gens.
Sous l'influence de ces circonstances et de ces opinions, Cicéron composa et
sa République et ses Lois. Sa vie passée, ses liaisons, ses
amitiés, ses ressentiments, Pompée et Catilina, Caton et Clodius, tout
l'attachait à la cause du sénat: elle était devenue pour lui une cause
personnelle. L'idée de ses propres périls s'unissait dans son esprit à celle
des dangers de la patrie. L'opinion démocratique était pour lui synonyme de
confiscation et de bannissement. Il n'est pas étrange que, dans sa retraite
d'Arpinum, dans ses conversations familières, dans le silence de l'étude, il
n'ait point abandonné les doctrines qu'il avait professées dans le sénat et
dans les comices, celles qui avaient illustré son exil et son consulat. Sa
position liait, pour ainsi dire, sa raison; et peut-être que les devoirs du
citoyen ne laissaient point au philosophe la liberté du choix des théories
politiques. Il aurait cru trahir sa cause; une idée nouvelle eût été une
désertion. C'est pourquoi il embrasse si étroitement les lois de la
république des anciens Romains, ou plutôt de celle qu'il leur attribue; car
jamais, dans l'ancienne Rome, la législation ne fut aussi systématique, la
liberté aussi paisible, le gouvernement aussi réglé. Cicéron suppose souvent
le passé, en croyant le décrire; il invente ce qu'il revendique; et il y a
de l'imagination jusque dans ses préjugés.
Le second Livre des Lois a aussi un préambule, écrit avec beaucoup de
soin comme celui du premier. La beauté du lieu où se passe l'entretien, le
charme de la campagne, de la patrie, de l'amitié, occupent les premières
pages, qui sont pleines de sentiment et de grâce. Puis, après avoir conduit
ses auditeurs dans une île du Fibrène, Cicéron reprend le fil de son
discours par un résumé assez remarquable de la doctrine du premier Livre;
et, passant ensuite, non à la composition des lois, mais aux lois mêmes, il
donne la constitution religieuse de la société. C'est un recueil d'articles
choisis parmi les règlements des Romains sur le culte. Cicéron se flatte
d'avoir supprimé beaucoup de choses puériles ou superstitieuses; on trouvera
sans doute encore que la superstition ne manque point à ses lois, ni la
puérilité à ses raisonnements. Le Livre est curieux comme un exposé assez
complet de la religion des Romains, et par de nombreux détails sur les
fêtes; les cérémonies, l'art augurai, le droit des pontifes, sur
quelques-unes des plus importantes questions de leur juridiction; enfin sur
les funérailles et les sépultures. Mais, du reste, le défaut d'ensemble et
l'aridité de ces renseignements, précieux seulement pour l'érudit et
l'antiquaire, rendent la lecture du Livre aussi pénible que la traduction en
est difficile. Il est triste de voir Cicéron insister avec tant de soin sur
les règles de discipline d'une religion qu'on sent bien qu'il ne croit pas.
En effet, il ne la respecte qu'à titre de coutume, il ne la conserve qu'à
titre d'institution. Et comment celui qui voulait une religion pure
aurait-il cru à celle de Liber et de Vénus? Il soumet non-seulement les
rites, mais les dogmes même, à la puissance du sénat et du peuple: lui qui,
dans le premier Livre, avait justement contesté au pouvoir politique le
droit de lé- 360 gitimer l'injustice,
il lui arroge, dans le second, le droit de décréter des dieux.
Le troisième Livre, rédigé malheureusement dans la même forme, et défiguré
par de grandes lacunes, offre cependant beaucoup plus d'intérêt. Il est tout
politique. Sans préparation, sans préambule, l'auteur développe
l'organisation du pouvoir, c'està-dire la distribution des magistratures,
leurs fonctions et leurs droits respectifs, leurs relations; enfin, toutes
les choses dont l'habile ménagement constitue, selon lui, la nature du
gouvernement. Ses vues à cet égard, quoique incomplètes, sont remarquables.
Il avait compris que c'est la nature même du pouvoir qui fait la liberté, et
que la sûreté de la société est moins dans les droits individuels que dans
la forme du gouvernement. Il avait conçu la nécessité de la balance des
pouvoirs, système qui, sans être la vérité, est un acheminement à la vérité.
Enfin, il est impossible de méconnaître l'intention de justice qui préside à
l'ordonnance et à la combinaison de pouvoirs qu'il propose comme modèle, et
qui n'est, au reste, que la copie du gouvernement de Rome. Quoique ses lois
et le commentaire qui les accompagne soient entièrement dans l'intérêt de
l'autorité des grands, il affecte cependant de ne point pousser à l'extrême
les opinions aristocratiques; et soit par la modération naturelle à son
esprit, plus fait pour les lettres que pour la politique, soit par ce désir
de popularité qui le domina toujours, et rendit quelquefois sa position si
fausse et ses discours si subtils, il tâche de tenir un milieu entre les
deux partis, et défend de temps en temps les droits et les institutions
démocratiques contre son frère Quintus, qu'il représente, ainsi qu'il
l'était en effet, comme un partisan ardent et exclusif des maximes
patriciennes. On reconnaît dans cet effort d'impartialité celui qui fut
toute sa vie l'ami de Pompée, sans négliger la moindre occasion de faire
l'éloge de César.
Trois Livres, dont aucun n'est sans lacune, et quelques fragments
très-courts, sont tout ce qui reste du Traité des Lois. Il en
contenait au moins cinq; cela se prouve par l'étendue du sujet, et par les
passages que Lactance, saint Augustin et Macrobe nous ont conservés. Le
dernier cite quelques mots comme faisant partie du cinquième Livre; et rien
n'empêche de l'en croire. Un des interlocuteurs, Atticus sans doute, fait
remarquer que l'ombre des jeunes arbres qui les couvrent les défend mal
contre les rayons du soleil déjà incliné au-dessous du point de midi, et il
exhorte ses amis à descendre jusqu'au Liris, pour y continuer leur entretien
sous des feuillages plus épais. La proposition et le tour même de la phrase
rappellent le commencement du second Livre, et c'était apparemment le début
du cinquième. L'existence de ce Livre est seule constatée; mais on peut
conjecturer qu'il n'était pas le dernier; et je crois, avec un commentateur
d'une grande autorité, que l'ouvrage était divisé en six Livres, dont le
premier traitait du droit naturel; le second, du droit de la religion et des
pontifes; le troisième, de la distribution du pouvoir; le quatrième, du
droit politique; le cinquième, du droit criminel et des jugements; le
sixième enfin, du droit civil. Tous ces objets sont annoncés à la fin du
troisième Livre, ch. 20. Cicéron rappelle, ou se fait rappeler par Atticus,
les points qu'il n'a pas traités, et il les ramène à trois: le droit des
magistrats, c'est-à-dire, sans doute, les lois qui constituent leur
juridiction; les jugements, c'est-à-dire, apparemment, les lois pénales et
la procédure, en un mot, tout le droit criminel ou public; enfin, le droit
civil ou privé, celui qui a donné naissance à toute la discussion, et sur
lequel, en toute occasion, Atticus rappelle à Cicéron qu'il a promis de
s'expliquer. On ne peut trop regretter ces trois parties, que nul autre de
ses ouvrages ne saurait suppléer.
Les savants s'accordent assez sur l'époque des Lois, quoique aucun
renseignement ne la donne avec précision. Mais l'ouvrage est évidemment
postérieur au consulat de Cicéron, an de Rome 690; à son exil et à son
retour, 695 et 696; au plaidoyer pour Balbus,697; à la composition du Traité
de la République, 699; à la mort de Clodius, mois de février, 701:
car il y est question de tous ces faits. D'une autre part, Pompée et
Caton,morts, l'un en 705, l'autre en 707, y sont nommés comme encore
vivants; et le traité de Finibus y est annoncé comme un projet. Or,
on prouve que ce projet ne put être accompli qu'après la mort de Caton.
C'est donc entre l'an 701 et l'année 707 qu'il faut placer la composition du
Traité des Lois. L'an de Rome 702, Cicéron fut obligé d'aller dans
son gouvernement de Cilicie; il n'en partit qu'à la fin de l'année suivante.
En 704, César avait passé le Rubicon, la guerre civile était commencée, et
Cicéron, qui essaya d'y prendre part, avait un commandement. L'année
d'après, celle de la bataille de Pharsale, il était en Grèce, auprès de
Pompée; il employa presque toute l'année 706 à faire sa paix avec César: ce
n'est qu'au mois de novembre qu'il revint à Rome, et qu'il se remit à
l'étude, ou, comme il l'écrit lui-même à Varron, qu'il se réconcilia avec
les livres. On connaît quels furent les ouvrages qu'il fit l'année
suivante: ce sont tes Partitions oratoires, l'éloge de Caton,
et le Brutus. Par toutes ces raisons, qui sont des faits, Turnèbe
conjecture que les Lois furent écrites dans l'espace de temps qui
sépara la mort de Clodius du commencement des guerres civiles, et M. Schütz
n'hésite pas à en fixer la date à l'année 701, au commencement de laquelle
Clodius avait péri: c'est, en effet, dans tout cet intervalle, la seule où
Cicéron dut avoir quelque loisir. Et cela explique en même temps pourquoi il
n'est point question des Lois dans les Lettres à Atticus: car
nous n'en avons aucune des années 700 et 701. Telle est aussi l'opinion de
Wagner, un des meilleurs éditeurs, et de Chapman, savant anglais, qui a
composé une dissertation spéciale sur la date du Traité des Lois.
La seule difficulté, c'est que les Lois ne figurent point dans le
dénombrement que l'auteur donne de ses ouvrages au commencement du second
Livre de là Divination, qui cependant est postérieur; car il y est
parlé des augures Marcellus et Appius comme s'ils étaient morts, et ils sont
représentés comme vivants dans les Lois. Mais cette circonstance
361
ne doit faire naître aucun doute ni sur l'extrême probabilité de cette
date, ni sur l'authenticité de l'ouvrage. Celle-ci, d'abord, est prouvée par
le style, par mille passages où se retrouvent les opinions habituelles de
Cicéron; enfin, par les témoignages des anciens, et nommément de Lactance.
C'est, d'ailleurs, l'avis des plus doctes interprètes, que l'ouvrage ne fut
jamais achevé. L'insuffisance de certaines parties, qui ne sont
qu'indiquées, la faiblesse de quelques déductions, la négligence du style en
plusieurs endroits, annoncent assez une simple ébauche à laquelle Cicéron ne
mit point la dernière main, et dont peut-être il ne remplit jamais le plan
dans son entier. On observe de plus que l'ouvrage n'a point de préface,
quoiqu'il se fit une loi d'en mettre une à chacun de ses écrits
philosophiques. On pourrait ajouter que la différence si marquée du style
des préambules des deux premiers livres et de celui de la discussion, montre
assez que l'une est restée imparfaite, tandis que les autres, extraits de ce
recueil de prologues et d'exordes tout faits, qu'il avait composés à
l'exemple des Grecs, sont des morceaux finis, et même avec beaucoup d'art.
L'ouvrage fut probablement publié après sa mort par quelqu'un de ses amis ou
de ses affranchis, qui peut-être, obligé de mettre en ordre des fragments
épars, se crut en droit de suppléer des lacunes, et de hasarder dos
additions ou des suppressions; ce qui expliquerait les obscurités, les
vides, les fautes même que les commentateurs ont cru apercevoir, et qu'ils
ont eu la hardiesse de relever.
Il y a, en effet, peu d'écrits de Cicéron dont le texte offre plus de
difficultés et d'altérations; et les efforts inventifs des interprètes ne
l'ont pas toujours rendu plus clair. Le choix entre les diverses leçons,
tant des manuscrits que des éditions, est souvent douteux; l'obscurité des
matières se joint souvent à celle de l'expression. Cicéron fait
continuellement allusion à des usages dont quelques-uns sont peu connus, et
sur lesquels les érudits ne s'accordent pas. La tâche du traducteur en est
plus pénible, et cependant la récompense de son travail en est moins
assurée. Quel gré les lecteurs peuvent-ils lui savoir d'avoir compris et
rendu ce qu'ils ne trouvent aucun plaisir à connaître? En écrivant la
nouvelle traduction, on n'a même pas eu le mérite si faible aux yeux du
public de pénétrer les mystères d'un texte encore peu critiqué. On doit
reconnaître que plusieurs des principales difficultés ont été en partie
aplanies par d'excellents commentateurs; et sans compter Schütz et Görenz,
on a trouvé un guide sûr dans Frédéric Wagner, dont le travail sur le Traité
des Lois est à la fois savant et philosophique.
Avec de tels secours, l'intelligence du texte devenait facile, et il ne nous
restait qu'à traduire. Nous avions peu de modèles à suivre. Depuis Jean
Collin, en 1541, les Lois n'ont pas eu d'autre traducteur français
que Morabin, en 1719. Tout en reconnaissant ce que nous devons à ce savant
homme, il est inutile d'exposer ici les raisons qui nous engagent à donner
une traduction entièrement nouvelle. M. Bcrnardi a fait aussi entrer dans sa
République de Cicéron une grande partie du Traité des Lois;
mais ce n'est le plus souvent qu'une imitation.
ARGUMENTS.
LIVRE PREMIER.
PARTIE I. RECHERCHE des sources de la science
du droit: définition de la loi en général. — Que l'origine du droit est dans
la Divinité même: preuves. — Que la raison est commune à Dieu et à l'homme;
qu'il y a relation et affinité entre l'un et l'antre. — Que le droit a sa
source dans la nature humaine: preuves. Égalité et ressemblance des hommes
entre eux. Bienveillance mutuelle et naturelle, base de la société, qui
n'existe que par le droit.
PARTIE II. Que le droit en général ou le juste
existe par lui-même dans la nature, et non dans l'opinion. Preuves prises
dans la conscience, dans le sentiment de tous les hommes. — Pourquoi le
juste n'est point l'ouvrage dos lois, contre les épicuriens. — Démonstration
semblable relativement à l'honnête en général: preuves. Que l'honnête est
comme la perfection en tout genre; que l'honnête est aussi réel que le bien.
Causes de l'opinion contraire. — Nouvelles preuves du même principe, prises
dans la notion commune de l'honnête homme, dans l'existence des vertus
particulières, dans l'excellence incontestable de la vertu. — Question dû
souverain bien: aperçu de la doctrine des Académiciens et de celle des
Stoïciens sur cette question. — Conclusion générale par forme de résumé.
LIVRE SECOND.
ENTRETIEN sur la beauté du lieu où se passe la
scène, et sur la patrie de Cicéron. — Récapitulation du premier Livre. —
Nouvelle définition de la loi. — De la loi, ou de la raison primitive et
absolue; de la loi, ou de la raison humaine. — Constitution de la religion.
— Préambule de la loi: vérité et utilité des croyances religieuses. — Texte
de la loi. — Commentaire de la loi. — Du culte des dieux. — Du choix des
dieux. — Des fêtes. — Des prêtres, et particulièrement des augures. — Des
sacrifices nocturnes. — Des jeux publics. — Des rites paternels. — Des
quêtes. — De la peine du sacrilège: digression. — De la consécration des
champs. — De la perpétuité des sacrifices: digression. — Du droit des mânes,
et des sépultures.
LIVRE TROISIÈME.
ORIGINE et nécessité du pouvoir. — Texte de la
loi sur la distribution et les droits des diverses magistratures. —
Importance de cette distribution, ou de la constitution du pouvoir. — Des
écrivains politiques. — Comment ils ont traité du pouvoir royal ou
souverain. — Commentaire de la loi. — Lacune. — De l'administration des
provinces. — Des légations libres. — Des tribuns du peuple: discussion entre
Quintus et Cicéron sur le tribunal. — Auspices et juridiction des divers
magistrats. — Composition, autorité et dignité du sénat. — Des suffrages:
discussion sur le vote public et le vote secret. — Règles pour les
délibérations du sénat et pour celles du peuple. — Des privilèges, et des
Jugements pour causes capitales. — De la promulgation des lois et de la
discussion des affaires. — De la corruption et de la brigue. — De la garde
des lois.