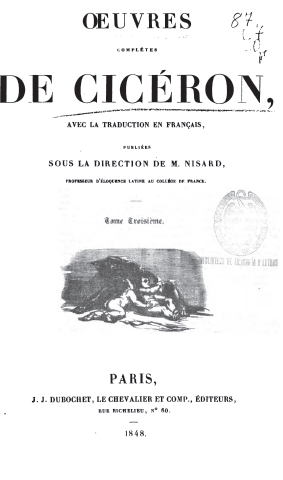|
précédent
XXVI. Quid ego de nave ; vidi enim a te remum
contemni : maiora fortasse quaeris. Quid potest sole maius, quem mathematici
amplius duodeviginti partibus confirmant maiorem esse quam terram : quantulus
nobis videtur ; mihi quidem quasi pedalis ; Epicurus autem posse putat etiam
minorem esse eum quam videatur, sed non multo ; ne maiorem quidem multo putat
esse, vel tantum esse quantus videatur, ut oculi aut nihil mentiantur [tamen]
aut non multum – mentiantur <tamen> : ubi igitur illud est «semel» ? – sed ab hoc
credulo, qui numquam sensus mentiri putat, discedamus, qui ne nunc quidem, cum
ille sol, qui tanta incitatione fertur ut celeritas eius quanta sit ne cogitari
quidem possit, tamen nobis stare videatur. Sed ut minuam controversiam, videte
quaeso quam in parvo lis sit. Quattuor sunt capita quae concludant nihil esse
quod nosci percipi conprehendi possit, de quo haec tota quaestio est. E quibus
primum est esse aliquod visum falsum, secundum non posse id percipi, tertium
inter quae visa nihil intersit fieri non posse ut eorum alia percipi possint
alia non possint, quartum nullum esse visum verum a sensu profectum cui non
adpositum sit visum aliud quod ab eo nihil intersit quodque percipi non possit.
Horum quattuor capitum secundum et tertium omnes concedunt ; primum Epicurus non
dat, vos, quibuscum res est, id quoque conceditis ; omnis pugna de quarto est.
Qui igitur P. Servilium Geminum videbat, si Quintum se videre putabat, incidebat
in eius modi visum quod percipi non posset, quia nulla nota verum distinguebatur
a falso ; qua distinctione sublata quam haberet in
C. Cotta, qui bis cum Gemino
consul fuit, agnoscendo eius modi notam quae falsa esse non possit ? Negas tantam
similitudinem in rerum natura esse ; pugnas omnino, sed cum adversario facili. Ne
sit sane : videri certe potest ; fallet igitur sensum. Et si una fefellerit
similitudo, dubia omnia reddiderit ; sublato enim iudicio illo quo oportet
agnosci, etiam si ipse erit quem videris qui tibi videbitur, tamen non ea nota
iudicabis qua dicis oportere ut non possit esse eiusdem modi falsa. Quando
igitur potest tibi P. Geminus Quintus videri, quid habes explorati cur non
possit tibi Cotta videri qui non sit, quoniam aliquid videtur esse quod non est
?
Omnia dicis sui generis esse, nihil esse idem quod sit aliud. Stoicumst id
quidem nec admodum credibile, nullum esse pilum omnibus rebus talem qualis sit
pilus alius, nullum granum. Haec refelli possunt, sed pugnare nolo ; ad id enim
quod agitur nihil interest omnibusne partibus visa re nihil differat an
internosci non possit etiam si differat. Sed si hominum similitudo tanta esse
non potest, ne signorum quidem ? Dic mihi : Lysippus eodem aere eadem
temperatione, eodem caelo aqua ceteris omnibus centum Alexandrus eiusdem modi
facere non posset ? Qua igitur notione discerneres ? Quid si in eius modi
cera centum sigilla hoc anulo inpressero, ecquae poterit in agnoscendo esse
distinctio ? An tibi erit quaerendus anularius aliqui, quoniam gallinarium
invenisti Deliacum illum, qui ova cognosceret ?
XXVII. Sed adhibes artem advocatam etiam sensibus
:
«pictor videt quae nos non videmus» et «simul inflavit tibicen a perito carmen
adnoscitur». Quid hoc nonne videtur contra te valere, si sine magnis artificiis,
ad quae pauci accedunt, nostri quidem generis admodum, nec videre nec audire
possimus ? Iam illa praeclara, quanto artificio esset sensus nostros mentemque et
totam constructionem hominis fabricata natura – cur non extimescam opinandi
temeritatem ? Etiamne hoc adfirmare potes Luculle, esse aliquam vim, cum
prudentia et consilio scilicet, quae finxerit vel ut tuo verbo utar quae
fabricata sit hominem ? Qualis ista fabrica est, ubi adhibita, quando cur quo
modo ? Tractantur ista ingeniose, disputantur etiam eleganter ; denique videantur
sane, ne adfirmentur modo. Sed de physicis mox, et quidem ob eam causam, ne tu,
qui id me facturum paulo ante dixeris, videare mentitus. Sed ut ad ea quae
clariora sunt veniam, res iam universas profundam, de quibus volumina inpleta
sunt non a nostris solum sed etiam a Chrysippo (de quo queri solent Stoici, dum
studiose omnia conquisierit contra sensus et perspicuitatem contraque omnem
consuetudinem contraque rationem, ipsum sibi respondentem inferiorem fuisse,
itaque ab eo armatum esse Carneadem) ; ea sunt eius modi, quae a te
diligentissime tractata sunt. Dormientium et vinulentorum et furiosorum visa
inbecilliora esse dicebas quam vigilantium siccorum sanorum. Quo modo ? Quia cum
experrectus esset Ennius non diceret se vidisse Homerum sed visum esse, Alcmeo
autem
Sed mihi neutiquam cor consentit...
Similia de vinulentis. Quasi quisquam neget et qui
experrectus sit eum <non> somniare, et cuius furor consederit putare non fuisse
ea vera quae essent sibi visa in furore. Sed non id agitur ; tum cum videbantur
quo modo viderentur, id quaeritur. Nisi vero Ennium non putamus ita totum illud
audivisse
O pietas animi...
(si modo id somniavit), ut si vigilans audiret.
Experrectus enim potuit illa visa putare, ut erant, et somnia ; dormienti vero
aeque ac vigilanti probabantur.
Quid Iliona somno illo
Mater te appello...
nonne ita credit filium locutum ut experrecta
etiam crederet ? Unde enim illa : Age
Adsta, mane audi ; iteradum eadem istaec mihi ?
num videtur minorem habere visis quam vigilantis
fidem ?
XXVIII. Quid loquar de insanis : qualis tandem fuit
adfinis tuus Catule Tuditanus, quisquam sanissimus tam certa putat quae videt
quam is putabat quae videbantur ? Quid ille qui
Video video te ; vive Ulixes dum licet
nonne etiam bis exclamavit se videre, cum omnino
non videret ; quid apud Euripidem Hercules, cum ut Eurysthei filios ita suos
configebat sagittis, cum uxorem interemebat, cum conabatur etiam patrem, non
perinde movebatur falsis ut veris moveretur ; quid ipse Alcmeo tuus, qui negat
cor sibi cum oculis consentire, nonne ibidem incitato furore
Unde haec flamma oritur ?
et illa deinceps
Incede incede, adsunt me expetunt.
Quid cum virginis fidem implorat :
Fer mi auxilium, pestem abige a me,
flammiferam hanc vim, quae me excruciat,
caeruleae incinctae angui incedunt,
circumstant cum ardentibus taedis,
num dubitas quin sibi haec videre videatur ? Itemque cetera
Intendit crinitus Apollo
arcum auratum, luna innixus,
Diana facem iacit a laeva» :
Qui magis haec crederet si essent quam credebat
quia videbantur ; apparet enim iam cor cum oculis consentire. Omnia autem haec
proferuntur ut illud efficiatur, quo certius nihil potest esse, inter visa vera
et falsa ad animi adsensum nihil interesse. Vos autem nihil agitis, cum illa
falsa vel furiosorum vel somniantium recordatione ipsorum refellitis. Non enim
id quaeritur, qualis recordatio fieri soleat eorum qui experrecti sunt aut eorum
qui furere destiterint, sed qualis visio fuerit aut furentium aut somniantium
tum cum movebantur. Sed abeo a sensibus ; quid est quod ratione percipi possit ?
Dialecticam inventam esse dicitis veri et falsi quasi disceptatricem et iudicem.
Cuius veri et falsi, et in qua re ? In geometriane quid sit verum aut falsum
dialecticus iudicabit an in litteris an in musicis ? At ea non novit. In
philosophia igitur : sol quantus sit quid ad illum ? Quod sit summum bonum quid
habet ut queat iudicare ? Quid igitur iudicabit ? Quae coniunctio quae diiunctio
vera sit, quid ambigue dictum sit, quid sequatur quamque rem quid repugnet : si
haec et horum similia iudicat, de se ipsa iudicat ; plus autem pollicebatur. Nam
haec quidem iudicare ad ceteras res, quae sunt in philosophia multae atque
magnae, non est satis. Sed quoniam tantum in ea arte ponitis, videte ne contra vos tota nata sit
;
quae primo progressa festive tradit elementa loquendi et ambiguorum
intellegentiam concludendique rationem, tum paucis additis venit ad soritas,
lubricum sane et periculosum locum, quod tu modo dicebas esse vitiosum
interrogandi genus.
XXIX. Quid ergo ? Istius vitii num nostra culpa
est ? Rerum natura nullam nobis dedit cognitionem finium, ut ulla in re statuere
possimus quatenus, nec hoc in acervo tritici solum, unde nomen est, sed nulla
omnino in re minutatim interrogati, dives pauper clarus obscurus sit, multa
pauca magna parva longa brevia lata angusta, quanto aut addito aut dempto certum
respondeamus non habemus. «At vitiosi sunt soritae.» Frangite igitur eos si
potestis, ne molesti sint ; erunt enim nisi cavetis. «Cautum est» inquit ; «placet
enim Chrysippo, cum gradatim interrogetur verbi causa tria pauca sint anne
multa, aliquanto prius quam ad multa perveniat quiescere» (id est quod ab his
dicitur ἡσυχάζειν). «Per me vel stertas licet» inquit Carneades «non modo
quiescas.» Sed quid proficit ? Sequitur enim qui te ex somno excitet et eodem
modo interroget : «quo in numero conticuisti, si ad eum numerum unum addidero,
multane erunt ?» progrediere rursus quoad videbitur. Quid plura ; hoc enim
fateris, neque ultimum te paucorum neque primum multorum respondere posse. Cuius
generis error ita manat, ut non videam quo non possit accedere. «Nihil me
laedit» inquit ; «ego enim ut agitator callidus priusquam ad finem veniam equos
sustinebo, eoque magis si locus is quo ferentur equi praeceps erit. Sic me»
inquit «ante sustineo nec diutius captiose interroganti respondeo.» Si habes
quod liqueat neque respondes, superbe ; si non habes, ne tu quidem percipis. Si
quia obscura, concedo ; sed negas te usque ad obscura progredi ; <in> inlustribus
igitur rebus insistis. Si id tantum modo ut taceas, nihil adsequeris ; quid enim
ad illum qui te captare vult, utrum tacentem inretiat te an loquentem ? Sin autem
usque ad novem verbi gratia sine dubitatione respondes pauca esse, in decumo
insistis, etiam a certis et inlustrioribus cohibes adsensum ; hoc idem me in
obscuris facere non sinis. Nihil igitur te contra soritas ars ista adiuvat, quae
nec augendi nec minuendi quid aut primum sit aut postremum docet. Quid quod eadem illa ars quasi Penelopae telam retexens tollit ad extremum
superiora : utrum ea vestra an nostra culpa est ? Nempe fundamentum dialecticae
est, quidquid enuntietur (id autem appellant ἀξίωμα, quod est quasi ecfatum) aut
verum esse aut falsum. Quid igitur haec vera an falsa sunt : «si te mentiri dicis
idque verum dicis, mentiris * verum dicis» ? Haec scilicet inexplicabilia esse
dicitis ; quod est odiosius quam illa quae nos non conprehensa et non percepta
dicimus
XXX. Sed hoc omitto, illud quaero : si ista
explicari non possunt nec eorum ullum iudicium invenitur, ut respondere possitis
verane an falsa sint, ubi est illa definitio, effatum esse id quod aut verum aut
falsum sit ? Rebus sumptis adiungam †ex iis sequendas esse alias inprobandas†
quae sint in genere contrario. Quo modo igitur hoc conclusum esse iudicas : «si
dicis nunc lucere et verum dicis, <lucet ; dicis autem nunc lucere et verum
dicis ;> lucet igitur» ? Probatis certe genus et rectissime conclusum dicitis,
itaque in docendo eum primum concludendi modum traditis. Aut quidquid igitur
eodem modo concluditur probabitis, aut ars ista nulla est. Vide ergo hanc
conclusionem probaturusne sis : «si dicis te mentiri verumque dicis, mentiris ;
dicis autem te mentiri verumque dicis ; mentiris igitur». Qui potes hanc non
probare, cum probaveris eiusdem generis superiorem ? Haec Chrysippea sunt, ne ab
ipso quidem dissoluta. Quid enim faceret huic conclusioni «si lucet, <lucet ;>
lucet autem ; lucet igitur» ? Cederet scilicet ; ipsa enim ratio conexi cum
concesseris superius cogit inferius concedere. Quid ergo haec ab illa
conclusione differt «si mentiris, mentiris ; mentiris autem ; mentiris igitur» ?
Hoc negas te posse nec adprobare nec inprobare ; qui igitur magis illud ? Si ars
si ratio si via si vis denique conclusionis valet, eadem est in utroque. Sed hoc
extremum eorum est : postulant ut excipiantur haec inexplicabilia.
Tribunum
aliquem censeo videant ; a me istam exceptionem numquam inpetrabunt. Etenim cum
ab Epicuro, qui totam dialecticam et contemnit et inridet, non inpetrent ut
verum esse concedat quod ita effabimur «aut vivet cras Hermarchus aut non
vivet», cum dialectici sic statuant, omne quod ita disiunctum sit quasi «aut
etiam aut non» <non> modo verum esse sed etiam necessarium (vide quam sit cautus
is quem isti tardum putant : «si enim» inquit «alterutrum concessero necessarium
esse, necesse erit cras Hermarchum aut vivere aut non vivere ; nulla autem est in
natura rerum talis necessitas») – cum hoc igitur dialectici pugnent, id est
Antiochus et Stoici ; totam enim evertit dialecticam : nam si e contrariis
disiunctio (contraria autem ea dico, cum alterum aiat alterum neget) – si talis
disiunctio falsa potest esse, nulla vera est. Mecum vero quid habent litium, qui
ipsorum disciplinam sequor ? Cum aliquid huius modi inciderat, sic ludere
Carneades solebat : «si recte conclusi, teneo ; sin vitiose, minam Diogenes
reddet» ; ab eo enim Stoico dialectica didicerat, haec autem merces erat
dialecticorum. Sequor igitur eas vias quas didici ab Antiocho, nec reperio quo
modo iudicem «si lucet, <lucet>» verum esse ob eam causam quod ita didici, omne
quod ipsum ex se conexum sit verum esse, non iudicem «si mentiris, mentiris»
eodem modo esse conexum : aut igitur hoc ut illud, aut nisi hoc ne illud quidem
iudicabo. |
précédent
461
XXVI. Mais à quoi bon parler de ce vaisseau, puisque vous méprisez
l'objection de là rame ? Sans doute, vous voulez de plus grands
exemples. Quoi de plus grand que le soleil ? Les mathématiciens nous
apprennent qu'il est dix-huit fois plus considérable que la terre.
Mais comme il paraît petit à nos yeux! Pour moi, il méfait l'effet
d'avoir un pied de dimension. Épicure pense qu'il est peut-être
encore plus petit qu'il ne paraît, mais pas de beaucoup ; ou
peut-être un peu plus grand ou exactement aussi grand que nous le
voyons ; il veut que nos yeux ne nous trompent pas, ou ne nous
trompent que de fort peu. Mais que devient alors cette affirmation
absolue : Une seule fois ? Mais laissons là cet esprit crédule
qui prétend que les sens nous disent toujours vrai ; toujours, lors
même que ce soleil, emporté par un mouvement si rapide que nous n'en
pouvons concevoir la vitesse, nous semble immobile, à les en croire.
Mais pour ramener la controverse à de justes proportions, voyez, je
vous prie, combien le véritable sujet de la discussion est
restreint. Il y a quatre points fondamentaux au nom desquels on
conclut qu'il n'est rien que l'on puisse connaître, percevoir et
comprendre ; et c'est sur cette conclusion que tout le combat est
engagé. Le premier point est qu'il y a des représentations fausses
;
le second, qu'elles ne peuvent nous donner de connaissances ; le
troisième, qu'entre des représentations semblables, il est
impossible que les unes nous donnent des connaissances et les autres
non ; le quatrième enfin, qu'il n'est pour les sens aucune
représentation vraie, à laquelle ou ne puisse en opposer une fausse,
qui lui ressemble de tous points, et que cependant il soit
impossible de connaître. De ces quatre points, le second et le
troisième sont accordés par tout le monde. Épicure conteste le
premier. Vous, avec qui nous discutons, vous l'accordez aussi. Toute
la controverse roule donc sur le quatrième. Or celui qui voyait P.
Servilius Géminus, croyant voir Quintus, tombait précisément sur une
représentation qui ne pouvait lui donner de connaissance ; car il n'y
avait aucune marque pour distinguer le faux du vrai ; et dès que
cette distinction est impossible, comment reconnaître, par exemple,
G. Cotta, qui fut deux fois consul avec Géminus, à un signe certain
qu'un faux Cotta ne pût usurper ? Vous dites qu'il n'y a point de
ressemblance aussi complète dans la nature. Voilà le débat engagé ;
mais votre adversaire est fort traitable. Qu'elles ne soient pas
réelles, je vous l'accorde ; mais du moins peuvent-elles être
apparentes. Cette apparence trompera nos sens ; et une seule
ressemblance qui nous trompe rend tout douteux. Dès que vous ne
pouvez plus porter de jugement en vertu d'une lumière certaine,
quand même la personne que vous voyez serait bien celle que vous
pensez, vous ne la reconnaissez pas cependant à cette marque
infaillible dont vous dites que l'erreur ne peut jamais se prévaloir
à vos yeux. Puisque vous pouvez prendre P. Géminus pour Quintus son
frère, comment serez-vous certain de ne jamais prendre pour Cotta un
autre que lui ? Car enfin il est des apparences qui nous trompent.
Vous dites que tout être appartient à une espèce particulière ;
qu'aucun individu n'est identique avec un autre. C'est une maxime
stoïcienne, qui me semble peu croyable, qu'il n'y ait pas dans toute
la nature deux poils ou deux graines absolument semblables. On
pourrait prouver le contraire ; mais je n'en suis pas tenté ; il
importe peu 462 à ma thèse
qu'il n'y ait aucune différence entre les objets visibles, ou que
cette différence, si elle existe, ne puisse être aperçue. Mais si la
ressemblance des hommes n'est jamais complète, celle des statues ne
peut-elle pas l'être ? Dites-moi si Lysippe avec le même métal, dans
les mêmes proportions, avec le même air, la même qualité d'eau,
toutes les autres conditions pareilles, ne pouvait pas faire cent
Alexandres exactement semblables ? Par quelle marque les
distingueriez-vous donc ? Si je grave sur la même cire cent fois
l'empreinte de mon anneau, comment reconnaîtrez-vous ces diverses
empreintes ? Irez-vous chercher quelque fabricant de cachets, pour
faite pendant à votre éleveur de poules de Délos, qui savait
distinguer ses œufs ?
XXVII. Mais vous nous parlez de l'art, qui vient au secours des
sens. Le peintre, voit ce qui nous échappe ; et au premier son de la
flûte, l'oreille habile reconnaît la pièce que l'on joue. Eh quoi!
ne voyez-vous pas que c'est un argument contre votre doctrine, que
sans de grandes études, auxquelles la plupart d'entre nous restent
étrangers, nous ne puissions ni voir, ni entendre ? Vous nous dites
ensuite de très-belles choses sur le grand art qu'a déployé la
nature en fabriquant nos sens, notre esprit et toute la machine
humaine. S'ensuit-il que je ne doive pas redouter l'habitude
téméraire des conjectures ? Pouvez-vous donc m'affirmer, Lucullus,
qu'il existe une puissance douée d'intelligence et de raison qui
aurait formé, ou, pour me servir de votre expression, fabriqué
l'homme ? Quel est cet art créateur ? Ou a-t-il opéré ? à quelle
époque ? Pourquoi ? De quelle manière ? On dit sur tout cela des choses
très-ingénieuses, on développe de fort belles opinions. Je ne
demande pas mieux qu'elles plaisent à l'esprit, pourvu qu'on n'en
fasse pas des dogmes. Mais je parlerai bientôt de la physique,
surtout pour ne pas vous faire mentir, vous qui avez dit tout à
l'heure que j'en parlerai. Mais pour en venir à des choses plus
claires, je veux dérouler l'ensemble de tous ces points sur lesquels
tant de volumes ont été écrits, non-seulement par les nôtres, mais
par Chrysippe. Les Stoïciens se plaignent de ce qu'il ait rassemblé
avec soin tous les arguments qu'on peut diriger contre les sens et
l'évidence, contre l'expérience en général et contre la raison
; et
de ce que, se répondant à lui-même, il n'ait pas su triompher de ses
propres objections ; ils l'accusent d'avoir ainsi fourni des armes à
Carnéade. Vous avez traité avec beaucoup de soin vous-même des
principaux chefs de ces objections. Vous avez dit que les
impressions, dans les rêves, l'ivresse et la démence, sont plus
incertaines que dans l'état de veille et de santé, et lorsque les
sens sont rassis. De quelle manière ? Vous nous citiez l'exemple
d'Ennius qui, à son réveil, ne disait pas qu'il avait vu Homère,
mais qu'il lui avait semblé le voir ; Alcméon s'écriait : “Mon cœur
dément le rapport de mes yeux.” II en était de même de l'ivresse.
Comme si quelqu'un niait que, lorsque le sommeil et la fureur se
sont dissipés, l'esprit reconnaisse la vanité de ses visions et de
ses songes. Mais la question n'est pas là ; on demande quelle
est la nature de ces visions quand elles nous possèdent. Est-ce que
nous ne pensons pas qu'Ennius entendit toute cette belle allocution
: “ O
piété!....” (Si toutefois ce songe n'est point une fiction), comme
il l'avait entendu pendant la veille.
463
Il put sans doute à son réveil penser, et avec raison, que c'étaient
là des visions et des rêves ; mais, dans son sommeil il les prenait
tout à fuit au sérieux, llione dans son rêve, “Ma mère, c'est moi
qui te parle,” n'est-elle pas tellement persuadée qu'elle entend la
voix de son fils, qu'éveillée elle le croit encore et lui dit : “Arrête
;
ne fuis pas ; écoute-moi ; que je t'entende encore ?”
Parait-elle accorder moins de foi aux impressions de son rêve qu'à
celles de la veille ?
XXVIII. Que dirai-je des gens en démence ? Tel, Catulus, que fut
Tuditanus votre parent ? Est-il un homme sain d'esprit qui soit aussi
certain de ce qu'il voit que ce malheureux l'était de ses visions
?
Et celui qui s'écrie : “Je vous vois, je vous vois. Vivez, Ulysse,
puisque le destin le permet,” n'affirme-t-il pas deux fois qu'il
voit ce qui pourtant n'est point devant ses yeux ? Et lorsque, dans
Euripide, Hercule perce de ses flèches ses propres fils, comme s'ils
étaient les enfants d'Eurysthée, lorsqu'il donne la mort à son
épouse, lorsqu'il porte les mains jusque sur son père, n'est-il pas
agité par ces vaines images comme il le serait par la réalité ? Et
votre Alcméon lui-même qui dit : “Mon cœur dément le rapport de mes
yeux,” ne s'écrie-t-il pas dans un accès de fureur : “D'où sort cette
flamme ?” Et ensuite : “Approche, approche ; les voilà, les voilà :
c'est moi, c'est moi qu'elles poursuivent.” Et lorsqu'il implore
cette jeune vierge : “Viens à mon secours, délivre-moi de ce
fléau, dissipe ces flammes qui me torturent. Le front armé de
serpents livides, elles s'avancent, elles m'entourent avec des
torches ardentes ;” pensez-vous qu'il ne croie pas à ce terrible
spectacle! Et la suite encore : “Apollon à la longue chevelure
prépare sa flèche, appuyé sur son arc courbé ; Diane lance de sa main
gauche un trait brûlant.” Comment la réalité pourrait-elle le
frapper davantage que ne le font ces apparences ? Il paraît alors, ce
me semble, “que son cœur ne dément pas le rapport de ses yeux.” Je
réunis tous ces exemples pour établir cette maxime tout à fait
indubitable, que pour le consentement de l'esprit, il n'est aucune
différence entre les représentations vraies et fausses. Il ne vous
sert à rien de montrer que la fureur ou le sommeil dissipés, on
reconnaît que l'on était en proie à des illusions ; car la question
n'est pas de savoir ce que l'on pense au réveil, ou lorsque la
fureur s'est apaisée ; mais ce que l'on pensait, assailli par les
visions de la fureur ou des songes. Mais en voilà assez sur les
sens. Qu'est-ce que, de son côté, la raison peut percevoir ? Vous
dites que l'on a inventé la dialectique, qui est comme l'arbitre et
le juge du vrai et du faux. Mais de quelle sorte de vrai et de faux
? Et dans quelle matière ? Est-ce dans la géométrie que le dialecticien
décidera de ce qui est vrai ou faux ? Est-ce dans les lettres ou dans
la musique ? Mais il ne connaît ni l'une ni les autres. Ce sera donc
dans la philo- 464 sophie
? La
question de la grandeur du soleil le concerne-t-elle ? Et celle du
souverain bien, a-t-il un secret particulier pour la résoudre ? De
quoi donc jugera-t-il ?de la liaison et de la séparation des termes,
de l'ambiguïté du langage, de la conséquence et de l'inconséquence
dans le discours ? Si c'est là le domaine de la dialectique, c'est
d'elle-même qu'elle est juge. Mais elle nous promettait plus que
cela ; car décider de telles questions, ce n'est pas assez pour
résoudre les autres, aussi nombreuses qu'importantes, que contient
la philosophie. Mais puisque vous attachez un si grand prix à cet
art, prenez garde qu'il n'ait été inventé précisément contre vous.
La dialectique en effet commence par nous expliquer rapidement les
éléments du langage, l'ambiguïté des termes, les règles du
raisonnement, et bientôt après, elle en vient aux sorites, sorte
d'argumentation perfide et pleine d'écueils, que vous accusiez
vous-même tout à l'heure d'être une très-mauvaise méthode
d'interrogation.
XXIX. Est-ce donc notre faute, si elle est mauvaise ? La nature ne
nous a fait connaître les bornes de rien en ce monde, et nous ne
pouvons, pour quoi que ce soit, enseigner les vraies limites. Ce
n'est pas seulement pour un monceau de blé, d'où vient le nom de
Sorite, c'est pour tout sans exception, que nous reculons devant
une interrogation qui procède par degrés insensibles. Demandez-nous
ce qu'il faut ajouter ou retrancher pour produire la richesse, ou la
pauvreté ; la célébrité, ou l'obscurité ; la multitude, ou la rareté
;
la grandeur, ou la petitesse ; la longueur, ou la brièveté ;
l'ampleur, ou le rétrécissement : nous n'avons rien de fixe à vous
répondre. — Mais les sorites sont des arguments vicieux. —
Rompez-les, si vous le pouvez, pour qu'ils ne vous blessent pas
; car
vous en souffrirez si vous n'y prenez garde. Les précautions sont
prises, dira-t-on. En effet, lorsqu'on demande à Chrysippe, par
gradation insensible, si trois c'est peu ou beaucoup, il est d'avis
qu'avant d'arriver à ce terme de beaucoup, il faut se reposer, ou,
comme on dit en grec ἡσυχάζειν. Pour Dieu! lui dit Carnéade, ronfle si tu veux ; c'est
mieux encore que de se reposer. Mais à quoi cela te servira-t-il ? On
va te réveiller et te demander : Si au nombre où tu t'es arrêté, on
ajoute un, sera-ce un grand nombre ? Avançons encore, si vous voulez.
Mais enfin, vous êtes forcé de déclarer que vous ne savez ni où
finit le petit nombre, ni où commence le grand. Et cette ignorance,
source de tant d'erreurs, s'étend si loin, que je ne sache pas un
sujet qu'elle n'atteigne. Elle n'a rien qui m'effraye, dit
Chrysippe ; semblable à un écuyer habile, avant de venir au terme,
j'arrêterai mes chevaux ; et d'autant plus énergiquement que je les
verrai emportés sur une pente. C'est ainsi, ajoute-t-il, que je
m'impose un arrêt dans la discussion, et que je cesse de répondre à
des questions captieuses. Si tu sais que dire, et que tu te taises,
c'est de la vanité. Si tu ne sais que dire, ta connaissance est donc
en défaut. Si l'obscurité du sujet t'empêche de répondre, à la bonne
heure. Mais tu déclares que tu ne t'avances pas dans les régions
obscures ; tu demeures donc au milieu de la pleine lumière. Si tu
gardes le silence uniquement pour le garder, tu n'y gagnes rien.
Qu'importe à celui qui veut t'embarrasser, que tu entres dans ses
filets en te taisant, ou en parlant ? Si, par exemple, tu réponds
jusqu'à neuf sans hésiter que c'est un petit nombre, et qu'arrivé à
dix tu t'arrêtes, tu t'abstiens de juger dans un sujet parfaitement
clair et lumineux, et tu ne veux pas que je m'abstienne dans des
sujets obscurs ? La dialectique ne te donne donc aucun secours contre
les sorites ; car elle ne te fait con-
465
naître ni le dernier terme de la petitesse, ni le premier
de la grandeur. Bien plus, semblable à Pénélope qui défait sa toile,
elle détruit à la fin l'ouvrage du commencement. Est-ce là, je vous
le demande, votre faute ou la nôtre ? Le fondement de la dialectique
est que toute proposition (en grec,
ἀξίωμα que
nous pouvons traduire par effatum) est ou vraie ou fausse. Eh
bien! dites-moi si celle-ci est vraie ou fausse ? Si vous dites
que vous mentez, et que vous disiez vrai, vous meniez et vous dites
la vérité. C'est là, dites-vous, une difficulté inextricable
;
votre langage est bien plus dur que le nôtre : nous disons seulement
des choses, qu'elles sont incompréhensibles et inconnues.
XXX. Mais je n'insiste pas. Je vous demande seulement, si ce sont
là, comme vous le dites, des difficultés inextricables et qu'il soit
impossible de déclarer si de telles propositions sont vraies ou
fausses, et que devient votre définition : Une proposition est ce
gui est vrai ou faux ? Ajoutons que, si l'on accorde certaines
propositions, il faut conséquemment en admettre certaines autres, et
en rejeter d'autres, d'une nature opposée à celles qu'on admet. Or,
que dites-vous de la valeur de ce raisonnement : “Si vous
dites que maintenant il fait jour et que vous disiez vrai, il fait
donc jour ?” Vous dites qu'il est en bonne forme, et que la
conclusion en est excellente ; aussi, dans votre enseignement,
exposez-vous cette forme de raisonnement la première. Ainsi de deux
choses l'une ; ou vous approuverez tous les raisonnements faits dans
cette forme, ou votre dialectique n'est qu'une chimère. Voyez donc
si vous trouvez ce raisonnement bon : “Si vous dites que vous mentez,
et que vous disiez vrai, vous mentez. Or, vous dites que vous
mentez, et vous dites vrai. Donc vous mentez.” Comment pourriez-vous
le trouver mauvais, puisque vous avez trouvé bon le premier, du même
genre ? Ce sont là des difficultés proposées par Chrysippe et qu'il
n'a pas pu résoudre. Que dirait-il de ce raisonnement : “S'il fait
jour, il fait jour ; or, il fait jour, donc il fait jour ?” II le
trouverait concluant, sans doute. La connexion même des propositions
vous force à recevoir la seconde, des que vous avez accordé la
première. Mais en quoi ce. Raisonnement-là diffère-t-il de celui-ci
:
“Si vous mentez ; vous mentez. Or vous mentez ; donc vous mentez.”
Vous dites que vous ne pouvez trouver ce raisonnement ni bon ni
mauvais. Mais qu'a donc l'autre de plus pour que vous l'approuviez
?
Si vous vous rendez à l'art, à la méthode, à la disposition, à la
force d'un raisonnement, il y en a tout autant dans l'un que dans
l'autre. Mais voici leur dernier refuge ; ils demandent que l'on
fasse une exception pour ces propositions inexplicables. Qu'ils
aillent trouver un tribun du peuple ; pour moi, je déclare que je
n'accorderai jamais cette exception. Épicure, qui méprise la
dialectique et la tourne en ridicule, ne leur accordait pas que
cette proposition fût vraie : “Ou Hermachus vivra demain, ou il ne
vivra pas ;” tandis que
les dialecticiens établissent que toute proposition de ce genre où
l'on présente l'alternative en ces termes, “Ou la chose sera, ou
elle ne sera pas,” est non-seulement vraie, mais nécessaire ; voyez
combien en cela, Épicure qu'ils tiennent pour un esprit grossier,
fut prudent. Si j'accorde, dit-il, que l'un des deux est nécessaire,
il sera nécessaire que de-
466
main Hermachus vive ou ne vive pas. Mais il n'y a dans la nature
aucune nécessité semblable. Que les dialecticiens, c'est-à-dire
Antiochus et les stoïciens, se battent avec lui ; car il renverse
toute la dialectique. En effet, si l'opposition absolue établie
entre deux contraires (j'appelle contraires deux propositions dont
l'une nie et l'autre affirme), si une telle opposition peut être
fausse, il n'y en a aucune de vraie. Mais quelle querelle
pourrait-il avoir avec moi, puisque je suis leurs règles ? Lorsqu'ils
voulaient soulever quelque engagement de ce genre avec Carnéade,
celui-ci leur répondait en plaisantant : “Si j'ai bien raisonné, ma
cause est gagnée ; sinon, Diogène me rendra ma mine.” Ce Diogène
était un stoïcien qui lui avait enseigné la dialectique ; et l'on
payait une mine les leçons d'un dialecticien. Je me conforme donc
aux règles qu'Antiochus m'a apprises ; et je ne comprends pas comment
tout en trouvant vraie cette proposition, “S'il fait jour, il fait
jour,” en vertu de ce principe que l'on m'a enseigné, que tout ce
qui découle ainsi naturellement de soi-même, est vrai, je pourrais
ne pas déclarer que cette autre proposition, “Si vous mentez, vous
mentez” n'est pas démontrée par le même principe. Il faut que
j'admette l'une et l'autre ; ou si je doute de celle-ci, je dois
douter de celle-là.
|
|
XXXI. Sed ut omnes istos aculeos et totum
tortuosum genus disputandi relinquamus ostendamusque qui simus, iam explicata
tota Carneadis sententia Antiochea ista conruent universa. Nec vero quicquam ita
dicam ut quisquam id fingi suspicetur ; a Clitomacho sumam, qui usque ad
senectutem cum Carneade fuit, homo et acutus ut Poenus et valde studiosus ac
diligens ; et quattuor eius libri sunt de sustinendis adsensionibus, haec autem
quae iam dicam [quae] sunt sumpta de primo. Duo placet esse Carneadi genera visorum
; in uno hanc divisionem, alia visa
esse quae percipi possint <alia quae non possint,> in altero autem, alia visa
esse probabilia alia non probabilia. Itaque quae contra sensus contraque
perspicuitatem dicantur ea pertinere ad superiorem divisionem, contra
posteriorem nihil dici oportere. Quare ita placere, tale visum nullum esse ut
perceptio consequeretur, ut autem probatio multa. Etenim contra naturam esset,
<si> probabile nihil esset ; sequitur omnis vitae ea quam tu Luculle commemorabas
eversio. Itaque et sensibus probanda multa sunt, teneatur modo illud, non inesse
in is quicquam tale quale non etiam falsum nihil ab eo differens esse possit –
sic quidquid acciderit specie probabile, si nihil se offeret quod sit
probabilitati illi contrarium, utetur eo sapiens, ac sic omnis ratio vitae
gubernabitur. Etenim is quoque qui a vobis sapiens inducitur multa sequitur
probabilia non conprehensa neque percepta neque adsensa sed similia veri, quae
nisi probet omnis vita tollatur. Quid enim conscendens navem sapiens num
conprehensum animo habet atque perceptum se ex sententia navigaturum ? Qui
potest ? Sed si iam ex hoc loco proficiscatur Puteolos stadia triginta probo
navigio bono gubernatore hac tranquillitate, probabile videatur se illuc
venturum esse salvum. Huius modi igitur visis consilia capiet et agendi et non
agendi faciliorque erit ut albam esse nivem probet quam erat Anaxagoras, qui id
non modo ita esse negabat, sed sibi, quia sciret aquam nigram esse unde illa
concreta esset, albam ipsam esse ne videri quidem, et quaecumque res eum
sic attinget ut sit visum illud probabile neque ulla re impeditum, movebitur.
Non enim est e saxo sculptus aut e robore dolatus, habet corpus habet animum,
movetur mente movetur sensibus, ut ei vera multa videantur neque tamen habere
insignem illam et propriam percipiendi notam. Eoque sapientem non adsentiri,
quia possit eiusdem modi existere falsum aliquod cuius modi hoc verum. Neque nos
contra sensus aliter dicimus ac Stoici, qui multa falsa esse dicunt longeque
aliter se habere ac sensibus videantur.
XXXII. Hoc autem si ita sit, ut unum modo sensibus
falsum videatur, praesto est qui neget rem ullam percipi posse sensibus. Ita
nobis tacentibus ex uno Epicuri capite altero vestro perceptio et conprehensio
tollitur. Quod est caput Epicuri ? «si ullum sensus visum falsum est, nihil
potest percipi.» quod vestrum ? «sunt falsa sensus visa.» quid sequitur ? Ut
taceam, conclusio ipsa loquitur : «nihil posse percipi». «Non concedo» inquit
«Epicuro». Certa igitur cum illo, qui a te totus diversus est, noli mecum, qui
hoc quidem certe, falsi esse aliquid in sensibus, tibi adsentior. Quamquam nihil
mihi tam mirum videtur quam ista dici, ab Antiocho quidem maxime, cui erant ea
quae paulo ante dixi notissima. Licet enim haec quivis arbitratu suo reprehendat
quod negemus rem ullam percipi posse, certe levior reprehensio est, quod tamen
dicimus esse quaedam probabilia. Non videtur hoc satis esse vobis. Ne sit ; illa
certe debemus effugere, quae a te vel maxime agitata sunt : «nihil igitur cernis,
nihil audis, nihil tibi est perspicuum».
Explicavi paulo ante Clitomacho auctore quo modo
ista Carneades diceret ; accipe quem ad modum eadem dicantur a Clitomacho in eo
libro quem ad C. Lucilium scripsit poetam, cum scripsisset isdem de rebus ad L.
Censorinum eum qui consul cum M›. Manilio fuit. Scripsit igitur his fere verbis
(sunt enim mihi nota propterea quod earum ipsarum rerum de quibus agimus prima
institutio et quasi disciplina illo libro continetur) – sed scriptum est ita :
Academicis placere esse rerum eius modi dissimilitudines ut aliae probabiles
videantur aliae contra. Id autem non esse satis cur alia posse percipi dicas
alia non posse, propterea quod multa falsa probabilia sint, nihil autem falsi
perceptum et cognitum possit esse. Itaque ait vehementer errare eos qui dicant
ab Academia sensus eripi, a quibus numquam dictum sit aut colorem aut saporem
aut sonum nullum esse, illud sit disputatum, non inesse in iis propriam quae
nusquam alibi esset veri et certi notam. Quae cum exposuisset, adiungit
dupliciter dici adsensus sustinere sapientem, uno modo cum hoc intellegatur,
omnino eum rei nulli adsentiri, altero cum se a respondendo ut aut adprobet quid
aut inprobet sustineat, ut neque neget aliquid neque aiat. Id cum ita sit,
alterum placere ut numquam adsentiatur, alterum tenere ut sequens
probabilitatem, ubicumque haec aut occurrat aut deficiat, aut «etiam» aut «non»
respondere possit. †nec ut† placeat eum qui de omnibus rebus contineat se ab
adsentiendo moveri tamen et agere aliquid, reliquit eius modi visa quibus ad
actionem excitemur, item ea quae interrogati in utramque partem respondere
possimus sequentes tantum modo quod ita visum sit, dum sine adsensu ; neque tamen
omnia eius modi visa adprobari sed ea quae nulla re inpedirentur. Haec si vobis
non probamus, sint falsa sane, invidiosa certe non sunt. Non enim lucem eripimus
sed ea quae vos percipi conprehendique eadem nos, si modo probabilia sint,
videri dicimus.
XXXIII. Sic igitur inducto et constituto
probabili, et eo quidem expedito soluto libero nulla re inplicato, vides
profecto Luculle iacere iam illud tuum perspicuitatis patrocinium. Isdem enim
hic sapiens de quo loquor oculis quibus iste vester caelum terram mare
intuebitur, isdem sensibus reliqua quae sub quemque sensum cadunt sentiet. Mare
illud, quod nunc favonio nascente purpureum videtur, idem huic nostro videbitur,
nec tamen adsentietur, quia nobismet ipsis modo caeruleum videbatur mane ravum,
quodque nunc qua a sole conlucet albescit et vibrat dissimileque est proximo ei
continenti, ut etiam si possis rationem reddere cur id eveniat tamen non possis
id verum esse quod videbatur oculis defendere. «Unde memoria, si nihil
percipimus ?» sic enim quaerebas.
Quid meminisse visa nisi conprensa non possumus ?
Quid Polyaenus, qui magnus mathematicus fuisse dicitur, is postea quam Epicuro
adsentiens totam geometriam falsam esse credidit, num illa etiam quae sciebat
oblitus est ? Atqui falsum quod est id percipi non potest, ut vobismet ipsis
placet. Si igitur memoria perceptarum conprensarumque rerum est, omnia quae
quisque meminit habet ea conprensa atque percepta ; falsi autem conprendi nihil
potest ; et omnia meminit Seiron Epicuri dogmata ; vera igitur illa sunt nunc
omnia. Hoc per me licet ; sed tibi aut concedendum est ita esse, quod minime vis,
aut memoriam mihi remittas oportet et fateare esse ei locum etiam si
conprehensio perceptioque nulla sit. «Quid fiet artibus ?» Quibus ? Iisne quae
ipsae fatentur coniectura se plus uti quam scientia, an iis quae tantum id quod
videtur secuntur nec habent istam artem vestram qua vera et falsa diiudicent ?
Sed illa sunt lumina duo quae maxime causam istam
continent. Primum enim negatis fieri posse ut quisquam nulli rei adsentiatur. At
id quidem perspicuum est, cum Panaetius, princeps prope meo quidem iudicio
Stoicorum, ea de re dubitare se dicat quam omnes praeter eum Stoici certissimam
putant, vera esse <responsa> haruspicum auspicia oracula somnia vaticinationes,
seque ab adsensu sustineat – quod is potest facere vel de iis rebus quas illi a
quibus ipse didicit certas habuerint, cur id sapiens de reliquis rebus facere
non possit ? An est aliquid quod positum vel inprobare vel adprobare possit,
dubitare non possit ? An tu in soritis poteris hoc cum voles, ille in reliquis
rebus non poterit eodem modo insistere, praesertim cum possit sine adsensione
ipsam veri similitudinem non inpeditam sequi. Alterum est quod negatis
actionem ullius rei posse in eo esse qui nullam rem adsensu suo conprobet.
Primum enim videri oportet, in quo sit etiam adsensus (dicunt enim Stoici sensus
ipsos adsensus esse, quos quoniam adpetitio consequatur actionem sequi) – tolli
autem omnia si visa tollantur.
XXXIV. Hac de re in utramque partem et dicta sunt
et scripta multa †vide superiore†, sed brevi res potest tota confici. Ego enim
etsi maximam actionem puto repugnare visis obsistere opinionibus adsensus
lubricos sustinere, credoque Clitomacho ita scribenti, Herculi quendam laborem
exanclatum a Carneade, quod ut feram et inmanem beluam sic ex animis nostris
adsensionem id est opinationem et temeritatem extraxisset, tamen, ut ea pars
defensionis relinquatur, quid impediet actionem eius qui probabilia sequitur
nulla re inpediente ? «Hoc» inquit «ipsum inpediet, quod statuet ne id quidem
quod probet posse percipi». Iam istuc te quoque impediet in navigando et in
conserendo, in uxore ducenda in liberis procreandis, plurumisque in rebus, in
quibus nihil sequere praeter probabile. Et tamen illud usitatum et saepe
repudiatum refers, non ut Antipater, sed ut ais pressius ; nam Antipatrum
reprensum quod diceret consentaneum esse ei qui adfirmaret nihil posse conprendi
id ipsum saltem dicere posse conprendi. Quod ipsi Antiocho pingue videbatur et
sibi ipsum contrarium ; non enim potest convenienter dici nihil conprendi posse,
<si quicquam conprendi posse> dicatur illo modo potius putat urguendum fuisse
Carneadem, cum sapientis nullum decretum esse possit nisi conprehensum perceptum
cognitum, ut hoc ipsum decretum qui sapientis esse <diceret>, nihil posse
percipi, fateretur esse perceptum. Proinde quasi sapiens nullum aliud decretum
habeat et sine decretis vitam agere possit. Sed ut illa habet probabilia non
percepta, sic hoc ipsum nihil posse percipi. Nam si in hoc haberet cognitionis
notam, eadem uteretur in ceteris ; quam quoniam non habet, utitur probabilibus.
Itaque non metuit ne confundere omnia videatur et incerta reddere. Non enim quem
ad modum si quaesitum ex eo sit stellarum numerus par an impar sit, item si de
officio multisque aliis de rebus, in quibus versatus exercitatus<que sit>,
nescire se dicat. In incertis enim nihil est probabile ; in quibus autem est, in
iis non deerit sapienti nec quid faciat nec quid respondeat. Ne illam quidem
praetermisisti Luculle reprehensionem Antiochi (nec mirum, in primis enim est
nobilis), qua solebat dicere Antiochus Philonem maxime perturbatum. Cum enim
sumeretur unum esse quaedam falsa visa, alterum nihil ea differre a veris, non
adtendere superius illud ea re esse concessum quod videretur esse quaedam in
visis differentia, eam tolli altero quo neget visa a falsis vera differre –
nihil tam repugnare. Id ita esset, si nos verum omnino tolleremus. Non facimus ;
nam tam vera quam falsa cernimus. Sed probandi species est, percipiendi signum
nullum habemus.
XXXV. Ac mihi videor nimis etiam nunc agere
ieiune. Cum sit enim campus in quo exultare possit oratio, cur eam tantas in
angustias et Stoicorum dumeta compellimus ? Si enim mihi cum Peripatetico res
esset, qui id percipi posse diceret quod inpressum esset e vero, neque adhaerere
illam magnam accessionem «quo modo inprimi non posset a falso», cum simplici
homine simpliciter agerem nec magno opere contenderem atque etiam si, cum ego
nihil dicerem posse conprendi, diceret ille sapientem interdum opinari, non
repugnarem, praesertim ne Carneade quidem huic loco valde repugnante. Nunc quid
facere possum ? Quaero enim quid sit quod conprendi possit. Respondet mihi
non Aristoteles aut Theophrastus, ne Xenocrates quidem aut Polemo,
sed mihi minor est, tale verum quale falsum esse non possit. Nihil eius modi invenio :
itaque incognito nimirum adsentiar id est opinabor. Hoc mihi et Peripatetici et
vetus Academia concedit, vos negatis, Antiochus in primis. Qui me valde movet,
vel quod amavi hominem sicut ille me, vel quod ita iudico, politissimum et
acutissimum omnium nostrae memoriae philosophorum. A quo primum quaero, quo
tandem modo sit eius Academiae cuius esse se profiteatur. Ut omittam alia, haec
duo de quibus agitur quis umquam dixit aut veteris Academiae aut
Peripateticorum, vel id solum percipi posse quod esset verum tale quale falsum
esse non posset, vel sapientem nihil opinari : certo nemo. Horum neutrum ante
Zenonem magno opere defensum est ; ego tamen utrumque verum puto, nec dico
temporis causa, sed ita plane probo. |
XXXI. Mais laissons là toutes ces subtilités et ce labyrinthe de
chicanes, et montrons-nous enfin ; dès que j'aurai mis au jour la
vraie doctrine de Carnéade, tout l'édifice élevé par Antiochus
s'abîmera d'un seul coup. Je ne veux rien dire que l'on puisse me
soupçonner d'inventer à plaisir ; c'est d'après Clitomaque que je
parlerai ; il a vécu jusqu'au temps de la vieillesse avec Carnéade
;
il avait toute la pénétration d'un Carthaginois, et de plus beaucoup
de goût pour l'étude et d'application. Il nous a laissé quatre
livres sur la nécessité de suspendre nos jugements. Ce que je vais
dire est emprunté au premier de ces livres. Carnéade distinguait
deux genres de représentations ; il divisait les premières en
représentations certaines et incertaines ; les secondes en
représentations probables et improbables. Tout ce qu'il dit contre
les sens et l'évidence s'adresse à la première classe de
représentations ; il n'y a pas d'objections à diriger contre la
seconde. Selon lui donc, la connaissance ne peut sortir d'aucune
représentation, mais la probabilité peut venir d'un grand nombre.
Car il serait contraire à la nature qu'il n'y eût rien de probable
;
de là résulterait, comme vous le disiez fort bien, Lucullus,
l'anéantissement de la vie entière. On doit donc se fier souvent au
témoignage des sens, à la condition toutefois qu'on ne pense pas que
parmi les objets sensibles il y en ait quelqu'un dont l'erreur ne
puisse un jour reproduire exactement les traits. Ainsi donc, toutes
les fois que les apparences nous offriront des probabilités, que
rien ne combattra pour l'instant, le sage acceptera ces probabilités
et se gouvernera d'après elles. Et le sage lui-même dont vous nous
tracez le portrait, suit beaucoup de probabilités qui ne sont pour
lui ni comprises, ni connues, ni affirmées, mais seulement
vraisemblables ; autrement, il faudrait renoncer à vivre. Il est
certain que le sage, lorsqu'il s'embarque, ne sait point et ne voit
point s'il aura une heureuse navigation ; comment cela se
pourrait-il ? Mais s'il part d'ici pour Pouzzole, n'ayant que trente
stades à parcourir, sur un bon vaisseau, avec un habile pilote, et
467 le calme qui règne
maintenant, il lui semblera probable qu'il arrivera à bon port.
C'est suivant des apparences de ce genre qu'il réglera toutes ses
actions ; il admettra la blancheur de la neige plus facilement
qu'Anaxagore, qui non-seulement prétendait que la neige n'était pas
blanche, mais soutenait même qu'il ne la voyait pas ainsi, parce
qu'il connaissait la couleur noirâtre de l'eau dont elle était
formée. Toutes les apparences qui porteront le cachet d'une grande
probabilité et que rien ne combattra, inclineront l'esprit du sage.
Car il n'a pas été façonné avec le chêne ou taillé dans le roc ; il a
un corps, il a une âme ; son intelligence parle, ses sens
l'entraînent et lui montrent l'apparence de la vérité dans une foule
de représentations, où cependant il ne trouve point ce signe
précieux et inimitable qui devrait fonder la connaissance ; aussi
croit-il sans affirmer, parce qu'il sait que l'erreur pourrait
ressembler de tous points à cette vérité probable. Nous ne disons
contre les sens rien de plus que les stoïciens ; car ils déclarent
que souvent leur témoignage est faux, et que beaucoup de choses sont
eu réalité tout autres qu'ils ne nous les représentent.
XXXII. Mais s'il est vrai que les sens puissent une seule fois nous
tromper, voici venir qui déclarera que jamais ils ne nous donneront
de connaissance véritable. Ainsi, sans que nous prononcions un seul
mot, un principe d'Épicure s'unissant à l'un des vôtres, la
certitude et la connaissance s'évanouissent. Quel est ce principe
d'Épicure ? “Si nos sens nous trompent une seule fois, on ne peut
rien connaître.” Quel est le vôtre ? “Les sens nous trompent
quelquefois.” Quelle est la conséquence ? je puis me taire ; elle
criera assez haut qu'on ne peut rien connaître. Je conteste la
proposition d'Épicure, direz-vous. Attaquez-vous donc à lui qui
n'est d'accord avec vous absolument sur aucun point, et non à moi
qui conviens comme vous que les sens nous trompent. J'avoue
cependant que je suis on ne peut plus surpris d'entendre tenir ce
langage, surtout par Antiochus, qui connaissait parfaitement tout ce
que j'ai dit il n'y a qu'un instant. Il est loisible à chacun de
reprendre comme il l'entend cette maxime de notre école, que l'on ne
peut rien connaître ; mais toutes ces critiques n'ont rien de bien
redoutable. Nous accordons qu'il y a des choses probables ; mais ce
n'est pas encore assez pour vous. Vous êtes les maîtres ; mais il est
fort injuste de nous adresser ces reproches qui retentissaient si
vivement dans votre bouche, Lucullus : “Vous ne voyez donc rien ? Vous
n'entendez rien ? Il n'y a donc que ténèbres pour vous ?”
Je viens de reproduire, d'après Clitomaque, l'argumentation même de
Carnéade ; je vais maintenant vous faire connaître comment Clitomaque
traite ce sujet dans le livre qu'il a dédié à C. Lucilius le poète,
après en avoir dédié un autre sur les mêmes questions à L.
Censorinus, collègue de M. Manilius dans le consulat Voici à peu
près ses termes ; j'en ai la mémoire assez fraîche, parce que c'est
dans le livre dont je parle qu'il faut chercher les premiers
éléments et comme le corps de la doctrine que je soutiens ; voici
donc comme il s'exprime : “Les académiciens estiment que, selon leurs
différences, les choses nous paraissent les unes probables, les
autres improbables ; mais que cela ne suffit pas pour déclarer que
les unes peuvent être connues et les autres non ; parce qu'il y a
beaucoup d'erreurs probables,
468
et qu'aucune erreur ne peut donner lieu à une perception et à
une connaissance.” C'est pourquoi, dit-il, c'est se tromper
étrangement que de soutenir que l'Académie aille jusqu'à anéantir
les sens ; elle n'a jamais avancé qu'il n'y eût au monde ni saveur,
ni couleur, ni son ; mais elle a cherché à démontrer que dans aucune
des représentations sensibles ne se trouve un signe de vérité,
inimitable à l'erreur. A près cette explication, il ajoute que la
maxime, le sage doit suspendre son jugement, s'entend de deux
manières ; elle signifie d'abord qu'il ne donne son assentiment à
rien ; et ensuite qu'il ne répond positivement à aucune question,
parce qu'il évite d'affirmer ou de nier quoi que ce soit. En
conséquence, le sage se détermine en premier lieu à ne jamais rien
recevoir comme certain ; en second lieu, à recueillir en toute
circonstance les probabilités qui se présentent, pour pouvoir,
d'après elles, répondre cependant oui ou non à ceux qui
l'interrogent. Et pour ne pas tomber dans la contradiction de
laisser s'émouvoir et agir celui qui ne doit porter de jugement sur
rien, Clitomaque réserve les représentations qui vous excitent à
l'action et celles aussi qui vous permettent de répondre dans un
sens ou dans l'autre aux questions qu'on nous adresse, pourvu que,
prenant ces apparences pour guides seulement, nous n'y enchaînions
jamais notre esprit. Mais encore ce ne sont pas toutes les
représentations probables qui doivent nous guider, ce sont celles
que rien ne combat. Si nous ne pouvons vous convaincre de la
justesse de ces règles, tout en les déclarant fausses, vous
reconnaîtrez du moins qu'elles ne veulent pas déshériter l'esprit.
Nous ne lui retirons point la lumière ; mais ce que vous tenez pour
connu et pour certain, nous le regardons comme vraisemblable, si la
probabilité s'y montre.
XXXIII. Ayant ainsi établi et fonde la règle du probable,
c'est-à-dire, à le bien entendre, d'un guide dégagé, sans entraves,
sans embarras, auquel rien ne fait obstacle, vous voyez sans doute,
Lucullus, que toute votre belle défense de l'évidence est hors de
propos. Car le sage dont je parle contemplera des mêmes yeux que le
vôtre le ciel, la terre et la mer, et sentira avec les mêmes sens
tous les autres objets qui viennent les frapper. Ces flots qui
maintenant, au lever du zéphyr, se teignent de pourpre, il les verra
comme nous, mais il n'affirmera pas que ce soit là leur couleur
; il
n'y a qu'un moment, en effet, ils nous semblaient un champ d'azur,
et le matin ils reflétaient une teinte dorée ; et voyez comme ceux-ci
qui les touchent, parce que le soleil se réfléchit dans leur nappe,
blanchissent et étincellent de lumière. Rendez compte, si vous le
pouvez, de cette variété d'apparences ; vous ne prouverez jamais
qu'elle soit la vérité.
Vous nous demandiez d'où vient la mémoire, si nous ne connaissons
rien ? Car il est impossible de se souvenir d'une représentation qui
n'aurait pas été saisie par notre esprit. Pensez-vous donc que
Polyénus, le grand mathématicien, après avoir, sur la foi d'Épicure,
regardé la géométrie entière comme un tissu d'erreurs, ait oublié en
même temps tout ce qu'il savait ? Mais ce qui est faux ne peut être
connu, vous le déclarez vous-même. Si donc il n'y a de mémoire que
d'objets connus et parfaitement compris, tout ce dont on se souvient
a été compris et connu. Mais on ne
469
peut connaître rien de faux, et Scyron sait par cœur tous
les dogmes d'Épicure ; tous ces dogmes sont donc vrais. Je ne demande
pas mieux. Vous voilà dans l'alternative ou de donner gain de cause
à Épicure, ce qui ne vous plaît nullement, ou de m'accorder que je
ne détruis point la mémoire et qu'elle subsiste parfaitement, lors
même qu'il n'y a pas de connaissance ni de certitude. Vous me
demandez ce que deviennent les arts! lesquels ? Ceux qui avouent
eux-mêmes qu'ils ont plus à demander aux conjectures qu'à la
science ; ou ceux qui n'ont pour guide que les apparences et ne
connaissent pas ce beau secret qui vous apprend à distinguer le vrai
du faux ?
Mais voici vos deux grands cris de guerre qui disent tout à eux
seuls. Vous déclarez d'abord qu'il est impossible de ne rien
affirmer. Mais voici un exemple qui vous convainc : c'est celui de
Panétius, que j'oserais presque nommer le prince des stoïciens,
doutant de ce qui avait fait un article de foi pour toute son école,
de la vérité des augures, des auspices, des oracles, des songes, des
prophéties, et retenant son jugement dans toutes ces matières. Le
doute que Panétius a pu se permettre sur des vérités indubitables
aux yeux de ses maitres, pourquoi le sage ne pourrait-il le
transporter dans tous les autres sujets ? Comment! il lui serait
permis d'attaquer ou de défendre toute maxime et interdit d'en
douter ? Vous pourrez dans les sorites vous arrêter quand il vous
plaira, et lui ne jouira point de la même liberté en tout ordre de
questions, lorsque surtout il peut prendre pour guide les
vraisemblances que rien ne combat ? En second lieu, vous soutenez
qu'il est impossible d'agir, lorsque l'esprit ne consent à rien.
Car, avant toute action, il faut, selon vous, qu'une représentation
frappe l'esprit et qu'elle entraîne son assentiment. Les stoïciens
disent en effet que dans la sensation même il y a de l'affirmation
;
qu'il en résulte un mouvement de l'esprit, d'où l'action naît enfin
;
que si l'on supprime la perception, tout s'évanouit avec elle.
XXXIV. Les deux partis opposés ont dit et écrit beaucoup de choses
sur ce sujet ; mais ou peut vider le démêlé en peu de mots. Pour moi,
je suis convaincu que c'est la plus énergique des actions que de
lutter contre les sensations, de résister aux conjectures, de
retenir son jugement sur la pente de l'affirmation, et je crois avec
Clitomaque que Carnéade accomplit un véritable travail d'Hercule, en
purgeant notre esprit d'un monstre des plus terribles, je veux dire
de cette affirmation, qui précède la lumière et vient de la
légèreté ; mais j'abandonne cette partie de la défense, et je demande
ce qui pourrait empêcher d'agir l'homme qui prend pour guides les
probabilités que rien ne combat ? Ce qui l'empêchera, dites-vous,
c'est sa maxime constante qu'il n'y a de certitude dans rien de ce
qu'il approuve. Mais à ce compte, vous seriez vous-mêmes empêchés de
naviguer, de semer, de prendre femme, de devenir pères, et de tenter
bien d'autres entreprises où l'homme ne peut entrer que sur la foi
des probabilités.
Vous ne dédaignez pas ensuite de relever une objection bien usée, et
souvent abandonnée, non dans les mêmes termes qu'Antipater, mais, à
ce que vous dites, sous une forme plus pressante ; car on a repris
Antipater d'avoir avancé que celui qui déclare qu'on ne peut rien
connaître certainement, doit avouer au moins que l'on peut
470 connaître certainement cette
ignorance ; Antiochus lui-même trouvait que c'était là un
raisonnement bien épais et contradictoire. On ne peut en effet
déclarer sans inconséquence que toute connaissance est impossible,
si cette impossibilité même est un objet de connaissance. Antiochus
pense qu'il vaut mieux presser Carnéade en ces termes : Puisque le
sage ne peut recevoir aucune maxime qu'il ne comprenne, n'entende et
ne connaisse certainement, il faut donc avouer que le sage
professant cette maxime “qu'on ne peut rien connaître,” en connaît
la certitude ; comme si le sage n'avait pas d'autres maximes, et
comme s'il pouvait vivre sans maximes! Mais de même qu'il tient pour
probables beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, ainsi fait-il de
cette maxime, qu'on ne peut rien connaître. Car s'il trouvait en ce
dogme la marque certaine de la vérité, il ferait usage de ce signe
précieux dans tout le reste ; mais il en est privé, et se sert des
probabilités. Il ne craint donc pas de paraître tout confondre et
rendre tout incertain. Demandez-lui si le nombre des étoiles est
pair ou impair, il avouera son ignorance ; mais parlez lui dès
devoirs et de beaucoup d'autres sujets qui lui sont familière, il
saura vous répondre. Là où règne l'incertitude, rien n'est probable
;
mais dans les régions où s'offre la probabilité, le sage ne sera
jamais embarrassé de répondre ou d'agir. Il est une autre objection
que vous n'avez pas oubliée non plus, Lucullus ; et je ne m'en étonne
pas, car c'est une des plus fameuses ; et Antiochus répétait souvent
qu'aucune autre ne troublait Philon au même point. Vous invoquez
deux principes, lui disait-il ; le premier est qu'il y a des
représentations fausses ; le second, qu'elles ne diffèrent en rien
des représentations vraies ; mais vous ne faites pas attention que si
nous tombons d'accord du premier de ces principes, c'est parce que
nous remarquons certaines différences entre les représentations, et
que ces différences sont détruites par le second principe qui les
nie : or, y a-t-il rien de plus contradictoire ? Antiochus aurait
raison si nous anéantissions toute vérité ; nous en sommes bien
éloignés, car il y a pour nous de la vérité et de l'erreur ; mais
nous les reconnaissons aux apparences probables, sans en être
assurés par des signes certains.
XXXV. Mais il me semble que toute cette discussion est bien sèche.
Puisque nous avons un champ où elle pourrait se déployer à l'aise,
pourquoi la mettre à la gêne dans ces gorges étroites et la traîner
dans les ronces du stoïcisme ? Si j'avais affaire à un péripatéticien
déclarant que l'on peut connaître ce gui est imprimé en nous
par une représentation vraie ; sans ajouter ce complément d'une
énorme conséquence qu'une telle impression ne pourrait être
reproduite par une représentation fausse, je parlerais tout
simplement bon sens à un homme de bon sens, et je ne contesterais
pas beaucoup avec lui ; et si, en m'entendant soutenir qu'on ne peut
rien connaître, il disait qu'alors les opinions ne sont pas
interdites au sage, je n'en disconviendrais pas, fort de l'autorité
de Carnéade, qui était assez enclin à l'accorder. Mais maintenant,
que puis-je faire ? Je demande : que peut-on connaître ? On me
répond, et ce n'est ni Aristote, ni Théophraste, ni même Xénocrate
ou Polémon, mais un philosophe bien inférieur à eux qui me fait
cette réponse : tout objet vrai auquel l'erreur ne puisse pas
ressembler. Mais je ne trouve rien de tel dans le monde ; il faut
donc que j'affirme ce que
471
je ne connais pas, c'est-à-dire, que je me livre aux conjectures.
Les Péripatéticiens et l'ancienne Académie me le permettent ; vous me
le défendez, vous, et Antiochus à votre tête ; j'avoue que son
autorité me fait impression, soit parce qu'une amitié mutuelle nous
a unis, soit parce que je le regarde comme le plus bel esprit et le
plus ingénieux des philosophes de cet âge. Je lui demande d'abord de
quelle manière il appartient à cette Académie dont il se prétend le
disciple ? Pour négliger le reste, qui, je vous prie, dans l'ancienne
Académie ou dans le Lycée, a jamais avancé les deux principes en
question : d'abord que l'on ne puisse connaître qu'au moyen de
représentations vraies, inimitables à l'erreur ; ensuite que le sage
ne puisse faire de conjectures ? Personne sans aucun doute. Ni l'un
ni l'autre de ces principes n'ont trouvé de chaud défenseur avant
Zénon. Cependant je les crois vrais l'un et l'autre ; et ce que j'en
dis n'est pas une tactique de circonstance, c'est le fond de ma
pensée.
|
|
XXXVI. Illud ferre non possum : tu cum me incognito
adsentiri vetes idque turpissimum esse dicas et plenissimum temeritatis, tantum
tibi adroges ut exponas disciplinam sapientiae, naturam rerum omnium evolvas,
mores fingas, fines bonorum malorumque constituas, officia describas, quam vitam
ingrediar definias, idemque etiam disputandi et intellegendi iudicium dicas te
et artificium traditurum – perficies ut ego ista innumerabilia conplectens
nusquam labar nihil opiner ? Quae tandem ea est disciplina ad quam me deducas si
ab hac abstraxeris ? Vereor ne subadroganter facias si dixeris tuam ; atqui ita
dicas necesse est. Neque vero tu solus, sed ad suam quisque rapiet. Age
restitero Peripateticis, qui sibi cum oratoribus cognationem esse, qui claros
viros a se instructos dicant rem publicam saepe rexisse, sustinuero Epicureos,
tot meos familiares, tam bonos tam inter se amantes viros : Diodoto quid faciam
Stoico, quem a puero audivi, qui mecum vivit tot annos, qui habitat apud me,
quem et admiror et diligo, qui ista Antiochea contemnit. «Nostra» inquies «sola
vera sunt». Certe sola, si vera ; plura enim vera discrepantia esse non possunt.
Utrum igitur nos inpudentes, qui labi nolumus, an illi adrogantes qui sibi
persuaserint scire se solos omnia ? «Non me quidem» inquit «sed sapientem dico
scire.» Optime : nempe ista scire quae sunt in tua disciplina. Hoc primum quale
est, a non sapiente explicari sapientiam ? Sed discedamus a nobismet ipsis, de
sapiente loquamur, de quo ut saepe iam dixi omnis haec quaestio est. In tres
igitur partes et a plerisque et a vobismet ipsis distributa sapientia est.
Primum ergo si placet quae de natura rerum sint quaesita videamus – vel, ut
illud ante : estne quisquam tanto inflatus errore ut sibi se illa scire
persuaserit ? Non quaero rationes eas quae ex coniectura pendent, quae
disputationibus huc et illuc trahuntur, nullam adhibent persuadendi
necessitatem ; geometrae provideant, qui se profitentur non persuadere sed
cogere, et qui omnia vobis quae describunt probant. Non quaero ex his illa
initia mathematicorum, quibus non concessis digitum progredi non possunt,
punctum esse quod magnitudinem nullam habeat, extremitatem et quasi libramentum
in quo nulla omnino crassitudo sit, liniamentum <longitudinem> sine ulla
latitudine * * carentem. Haec cum vera esse concessero, si adigam ius iurandum
sapientem, nec prius quam Archimedes eo inspectante rationes omnes descripserit
eas quibus efficitur multis partibus solem maiorem esse quam terram, iuraturum
putas ? Si fecerit, solem ipsum,
quem deum censet esse, contempserit. Quod si
geometricis rationibus non est crediturus, quae vim adferunt in docendo vos ipsi
ut dicitis, ne ille longe aberit ut argumentis credat philosophorum – aut si est
crediturus, quorum potissimum ? Omnia enim physicorum licet explicare, sed longum
est ; quaero tamen quem sequatur. Finge aliquem nunc fieri sapientem, nondum
esse ; quam potissimum sententiam [melius] eliget <et> disciplinam ? Etsi
quamcumque eliget insipiens eliget ; sed sit ingenio divino : quem unum e physicis
potissimum probabit ? Nec plus uno poterit. Non persequor quaestiones infinitas
;
tantum de principiis rerum e quibus omnia constant videamus quem probet ; est
enim inter magnos homines summa dissensio.
XXXVII. Princeps Thales unus e septem, cui sex
reliquos concessisse primas ferunt, ex aqua dixit constare omnia. At hoc
Anaximandro populari et sodali suo non persuasit ; is enim infinitatem naturae
dixit esse e qua omnia gignerentur. Post eius auditor Anaximenes infinitum aera,
sed ea quae ex eo orerentur definita ; gigni autem terram aquam ignem, tum ex iis
omnia. Anaxagoras materiam infinitam, sed ex ea particulas similes inter se
minutas, eas primum confusas postea in ordinem adductas mente divina. Xenophanes
paulo etiam antiquior unum esse omnia, neque id esse mutabile, et id esse deum
neque natum umquam et sempiternum, conglobata figura. Parmenides ignem qui
moveat, terram quae ab eo formetur. Leucippus plenum et inane. Democritus huic
in hoc similis, uberior in ceteris. Empedocles haec pervolgata et nota quattuor.
Heraclitus ignem. Melissus hoc quod esset infinitum et inmutabile et fuisse
semper et fore. Plato ex materia in se omnia recipiente mundum factum esse
censet a deo sempiternum. Pythagorei e numeris et mathematicorum initiis
proficisci volunt omnia. Ex is eliget vester sapiens unum aliquem credo quem
sequatur, ceteri tot viri et tanti repudiati ab eo condemnatique discedent.
Quamcumque vero sententiam probaverit eam sic animo conprensam habebit ut ea
quae sensibus, nec magis adprobabit nunc lucere quam, quoniam Stoicus est, hunc
mundum esse sapientem, habere mentem quae et se et ipsum fabricata sit et omnia
moderetur moveat regat ; erit ei persuasum etiam solem lunam stellas omnes terram
mare deos esse, quod quaedam animalis intellegentia per omnia ea permanet et
transeat ; fore tamen aliquando ut omnis hic mundus ardore deflagret.
XXXVIII. Sint ista vera (vides enim iam me
fateri aliquid esse veri), conprendi ea tamen et percipi nego. Cum enim tuus
iste Stoicus sapiens syllabatim tibi ista dixerit, veniet flumen orationis
aureum fundens Aristoteles qui illum desipere dicat ; neque enim ortum esse
umquam mundum, quod nulla fuerit novo consilio inito tam praeclari operis
inceptio, et ita esse eum undique aptum ut nulla vis tantos queat motus
mutationemque moliri, nulla senectus diuturnitate temporum existere ut hic
ornatus umquam dilapsus occidat. Tibi hoc repudiare, illud autem superius sicut
caput et famam tuam defendere necesse erit : mihi ne ut dubitem quidem
relinquatur ? Ut omittam levitatem temere adsentientium, quanti libertas ipsa
aestimanda est non mihi necesse esse quod tibi est. <quaero enim> cur deus,
omnia nostra causa cum faceret (sic enim vultis), tantam vim natricum
viperarumque fecerit, cur mortifera tam multa <ac> perniciosa terra marique
disperserit. Negatis haec tam polite tamque subtiliter effici potuisse sine
divina aliqua sollertia ; cuius quidem vos maiestatem deducitis usque ad apium
formicarumque perfectionem, ut etiam inter deos
Myrmecides aliquis minutorum
opusculorum fabricator fuisse videatur. Negas sine deo posse quicquam : ecce tibi
e transverso Lampsacenus Strato, qui det isti deo inmunitatem – magni quidem
muneris ; sed cum sacerdotes deorum vacationem habeant, quanto est aequius habere
ipsos deos – : negat opera deorum se uti ad fabricandum mundum, quaecumque sint
docet omnia effecta esse natura, nec ut ille qui asperis et levibus et hamatis
uncinatisque corporibus concreta haec esse dicat interiecto inani : somnia censet
haec esse Democriti non docentis sed optantis, ipse autem singulas mundi partes
persequens quidquid aut sit aut fiat naturalibus fieri aut factum esse docet
ponderibus et motibus. Ne ille et deum opere magno liberat et me timore. Quis
enim potest, cum existimet curari se a deo, non et dies et noctes divinum numen
horrere et si quid adversi acciderit, quod cui non accidit, extimescere ne id
iure evenerit ? Nec Stratoni tamen adsentior nec vero tibi ; modo hoc modo illud
probabilius videtur.
XXXIX. Latent ista omnia Luculle crassis occultata
et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare
in caelum, terram intrare possit. Corpora nostra non novimus, qui sint situs
partium, quam vim quaeque pars habeat ignoramus ; itaque medici ipsi, quorum
intererat ea nosse, aperuerunt ut viderentur, nec eo tamen aiunt empirici
notiora esse illa, quia possit fieri ut patefacta et detecta mutentur. Sed
ecquid nos eodem modo rerum naturas persecare aperire dividere possumus, ut
videamus terra penitusne defixa sit et quasi radicibus suis haereat an media
pendeat.
Habitari ait Xenophanes in luna, eamque esse terram multarum urbium et montium :
portenta videntur ; sed tamen nec ille qui dixit iurare posset ita se rem habere,
neque ego non <ita. Vos> [enim] etiam dicitis esse e regione nobis, e contraria
parte terrae qui adversis vestigiis stent contra nostra vestigia, quos ἀντίποδας
vocatis : cur mihi magis suscensetis qui ista non aspernor quam is qui cum
audiunt desipere vos arbitrantur ?
Hicetas Syracosius, ut ait Theophrastus,
caelum solem lunam stellas supera denique omnia stare censet, neque praeter
terram rem ullam in mundo moveri ; quae cum circum axem se summa celeritate
convertat et torqueat, eadem effici omnia quasi stante terra caelum moveretur.
Atque hoc etiam Platonem in Timaeo dicere quidam arbitrantur, sed paulo
obscurius. Quid tu Epicure, loquere : putas solem esse tantulum ? «Egone ? Nobis
quidem * * tantum». Et vos ab illo inridemini et ipsi illum vicissim eluditis.
Liber igitur a tali inrisione Socrates, liber Aristo Chius qui nihil istorum
sciri putat posse. Sed redeo ad animum et corpus. Satisne tandem ea nota sunt
nobis, quae nervorum natura sit quae venarum ? Tenemusne quid sit animus ubi sit,
denique sitne an ut Dicaearcho visum est
ne sit quidem ullus ; si est, trisne
partes habeat ut Platoni placuit, rationis irae cupiditatis, an simplex unusque
sit ; si simplex, utrum sit ignis an anima an sanguis an ut Xenocrates numerus
nullo corpore, quod intellegi quale sit vix potest ; et quidquid est, mortale.
Sit an aeternum, nam utramque in partem multa dicuntur. Horum aliquid vestro
sapienti certum videtur, nostro ne quid maxime quidem probabile sit occurrit ;
ita sunt in plerisque contrariarum rationum paria momenta.
XL. Sin agis verecundius et me accusas non quod
tuis rationibus non adsentiar sed quod nullis, vincam animum cuique adsentiar
deligam – quem potissimum, quem ? Democritum ;
semper enim ut scitis studiosus
nobilitatis fui. Urgebor iam omnium vestrum convicio : «tune aut inane quicquam
putes esse, cum ita conpleta et conferta sint omnia, <ut> et quod movebitur
<corpus> * * corporum cedat et qua quidque cesserit aliud ilico subsequatur, aut
atomos ullas, e quibus quidquid efficiatur illarum sit dissimillimum, aut sine
aliqua mente rem ullam effici posse praeclaram ; et, cum in uno mundo ornatus hic
tam sit mirabilis, innumerabilis supra infra dextra sinistra ante post alios
dissimiles alios eiusdem modi mundos esse ; et ut nos nunc simus ad Baulos
Puteolosque videamus sic innumerabiles paribus in locis esse isdem nominibus
honoribus rebus gestis ingeniis formis aetatibus isdem de rebus disputantes ; et,
si nunc aut si etiam dormientes aliquid animo videre videamur, imagines
extrinsecus in animos nostros per corpus inrumpere. Tu vero ista ne asciveris
neve fueris commenticiis rebus adsensus ; nihil sentire est melius quam tam prava
sentire.» Non ergo id agitur ut aliquid adsensu meo comprobem, <sed ut
eadem> quae tu vide ne inpudenter etiam postules non solum adroganter,
praesertim cum ista tua mihi ne probabilia quidem videantur. Nec enim
divinationem quam probatis ullam esse arbitror, fatumque illud esse quo omnia
contineri dicitis contemno ; ne exaedificatum quidem hunc mundum divino consilio
existimo. Atque haud scio an ita sit ; |
XXXVI. Voici ce que je ne puis souffrir. Vous me défendez d'affirmer
ce que je ne connais pas, vous dites que rien n'est plus honteux et
ne décèle un esprit plus vain ; et en même temps, vous vous arrogez
une telle science que nous n'hésitez pas à nous exposer toute la
doctrine de la sagesse, à dévoiler les secrets de l'univers entier,
à fixer la règle des mœurs, à déterminer la fin dernière des biens
et des maux, à tracer le code des devoirs, à m'enseigner quelle
carrière je dois fournir, à nous promettre enfin l'art de bien
raisonner et la méthode pour ne nous tromper jamais. Et vous pensez
me donner le secret d'embrasser ces objets innombrables sans faillir
une seule fois, sans faire une seule conjecture. Dans quelle école
me conduisez-vous, dites-moi, si vous m'enlevez à mon Académie ? Je
crains fort que vous ne puissiez sans un peu de présomption me dire
que c'est dans la vôtre. Il faut que vous le disiez. Cependant ce
n'est pas vous seul qui voudrez m'enrôler, mais tous les partis
l'essayent. Eh bien! soit ; je résisterai aux péripatéticiens qui se
vantent de leur affinité avec les orateurs et citent les grands
hommes qui ont passé de leur école au gouvernement des États ; je
tiendrai ferme contre les épicuriens, au milieu de qui je compte
tant d'amis, je vois tant d'hommes excellents, tant de cœurs si
noblement liés ; mais comment m'armer contre Diodote le stoïcien, que
j'ai entendu dès l'enfance, qui vit avec moi depuis longues années,
dont ma maison est la demeure, que j'admire et que j'aime, et qui
méprise tout ce mouvement d'Antiochus ? Notre doctrine seule est la
vraie, me direz-vous. Bien certainement si elle est vraie, elle est
la seule ; car la vérité ne peut! se trouver dans plusieurs camps à
la fois. Sommes-nous donc des gens bien osés, nous qui redoutons de
faillir ; et la présomption n'est-elle pas du côté de ceux qui se
flattent d'avoir seuls la science universelle ? Ce n'est pas moi,
dites-vous, qui ai cette science, c'est le sage. Parfaitement ; mais
cette science du sage, c'est dans votre doctrine qu'il la puise. Je
pourrais vous demander comment on peut comprendre qu'un autre que le
sage donne des leçons de sagesse ; mais laissons là toute question
personnelle et parlons du sage ; car c'est lui, comme je l'ai déjà
dit souvent, qui est l'objet de toute cette discussion.
Nous divisons, comme la plupart des écoles, la philosophie en trois
parties. Voyons d'abord, si vous voulez, les recherches qui ont eu
pour objet la nature ; mais demandons-nous d'abord s'il existe un
esprit assez gonflé de vanité et d'erreur pour croire qu'il
connaisse les véritables secrets du monde. Je ne parle pas de ces
systè- 472 mes hypothétiques,
soumis aux fluctuations des controverses et tout à fait incapables
de commander la certitude. Que les géomètres eux-mêmes songent au
fondement de leur autorité, eux qui font profession non pas de
convaincre, mais d'enchaîner l'esprit, et qui ne marchent qu'avec
l'appareil de la démonstration. Je ne veux pas les inquiéter sur les
premiers éléments des mathématiques, qu'il faut leur accorder si
l'on veut qu'ils fassent un seul pas ; qu'ils définissent le
point, ce qui n'a aucune dimension ; la surface et en
quelque façon le niveau du plan, ce qui n'a aucune épaisseur ; la
ligne, une longueur sans largeur. Quand j'accorderais tous ces
principes, croyez-vous que le sage, à qui je demanderais de me dire
sa pensée sous le sceau du serment, déclarerait, avant d'avoir vu
Archimède lui en expliquer toutes les raisons, que le soleil est de
beaucoup plus considérable que la terre ? Le déclarer, ce serait
mépriser ce soleil qu'il tient pour un dieu. S'il ne se rend pas aux
démonstrations de la géométrie qui cependant font violence à
l'esprit, comme vous le dites vous-mêmes, il sera certes bien
éloigné de se rendre aux arguments de la philosophie ; ou s'il leur
prête enfin créance, quel système embrassera-t-il ? Je pourrais vous
exposer les diverses théories des physiciens ; mais ce serait un peu
long. Je demande pourtant quelle doctrine obtiendra la préférence.
Imaginez un homme qui travaille à acquérir la sagesse, mais qui ne
l'ait pas encore ; quel système choisira-t-il ? Quelque choix qu'il
fasse, il est vrai, ce ne sera pas encore celui d'un sage. Mais je
le suppose doué d'un esprit divin ; parmi les doctrines des
physiciens, laquelle adoptera-t-il ? Il ne peut en adopter plus
d'une. Je ne veux point m'engager dans un cercle infini de
questions ; je demande seulement sur les principes des choses et les
sources premières du monde entier, quelle doctrine il recevra. Car
de très-grands hommes sont fort divisés sur ces questions.
XXXVII. A leur tête, Thalès, l'on des sept sages, à qui l'on dit que
les six autres, d'un commun accord, abandonnèrent le premier rang,
prétendit que tout est formé avec l'eau. Mais il ne put faire goûter
cette manière de voir à Anaximandre, son contemporain et son ami,
qui avait pour principe de toutes choses la nature infinie.
Anaximène, disciple d'Anaximandre, vit ce principe dans l'air
infini, en ajoutant que ce qui en sortait, était déterminé ; que
l'air formait d'abord la terre, l'eau et le feu, et que ces éléments
formaient tout le reste. Le premier principe d'Anaxagore, c'est une
matière indéterminée, de laquelle sont composées de petites
molécules, semblables entr'elles, primitivement confuses, mais dans
le cahos desquelles l'ordre a été introduit par l'esprit divin.
Xénophane, dont l'époque est un peu plus ancienne, disait que le
monde entier était un seul être, immuable, qu'il appelait Dieu, et à
qui il attribuait l'éternité et la forme sphérique. Pour Parménide,
le principe des choses, c'est le feu, le mobile de la terre, qui est
formée par lui. Pour Leucippe, c'est le plein et le vide ; Démocrite,
partout ailleurs beaucoup plus riche, tient ici le même langage.
Pour Empédocle, ce sont les quatre éléments connus de tout le monde
;
pour Heraclite, c'est le feu ; pour Mélissus, l'être infini, immua-
473 ble et éternel. Platon
pense que Dieu a tiré d'une matière capable de toutes les formes un
monde impérissable. Les pythagoriciens veulent que tout sorte des
nombres et des premiers éléments mathématiques. Parmi ces grands
hommes, votre sage choisira, je pense, celui qu'il veut croire, et
tous les autres seront condamnés et répudiés par lui. Mais quelque
doctrine qu'il approuve, il sera tout aussi certain des principes
qu'elle enseigne, que des objets dont les sens témoignent, et il ne
sera pas plus convaincu qu'il fasse jour maintenant, qu'il ne le
sera, puisque vous en faites un stoïcien, que le monde est doué de
sagesse et renferme une intelligence qui l'a formé, lui et le reste
des êtres, et qui contient, anime et gouverne tout. Il sera
convaincu également que le soleil, la lune, les étoiles, la terre et
la mer sont des dieux, parce qu'une âme intelligente est
répandue et se meut en eux tous ; mais que cependant un jour le monde
sera consumé dans une conflagration générale.
XXXVIII. Admettons que toutes ces choses soient vraies (vous voyez
que j'accorde qu'il y a de la vérité), je nie qu'on puisse les
connaître, et s'en assurer. Lorsque votre sage stoïcien aura
articulé syllabe à syllabe toute la série de ces dogmes, alors
viendra Aristote, versant à flots sa riche parole comme un fleuve
d'or, qui l'accusera de folie ; en disant que le monde n'a pas eu de
commencement, parce qu'il est impossible que ce soit par un conseil
nouveau, que l'esprit divin ait un jour mis la main à un si
magnifique ouvrage, et qu'il est si parfaitement ordonné, de tous
points, que jamais il n'y aura de force assez prodigieuse pour
opérer le bouleversement dont vous parlez, jamais d'âge assez long
pour miner et faire crouler de vieillesse ce bel édifice de
l'univers. Vous serez obligé de combattre Aristote et de défendre
mon principe avec autant de chaleur que s'il s'agissait de votre
réputation et de votre tête ; et il ne me sera pas permis à moi de me
tenir au moins dans le doute ? Pour ne rien dire de la légèreté de
ceux qui jugent sans connaître, quel prix ne dois-je pas faire de
cette liberté de mon esprit, affranchi de la nécessité qui vous
enchaîne ? Pourquoi Dieu, qui, selon vous, a tout disposé pour
l'homme, a-t-il donné aux serpents et aux vipères leur affreux
venin ? Pourquoi a-t-il répandu dans les eaux et sur la terre tant de
semences de mort ? Vous dites qu'il y a trop d'art dans le monde et
qu'on y voit trop de merveilles pour ne pas y reconnaître la main
d'un ouvrier divin, et vous abaissez cette majesté divine jusqu'à la
vouloir trouver dans l'organisation délicate des abeilles et des
fourmis ; comme s'il y avait parmi les dieux quelque Myrmécide,
chargé de la fabrication de tous les menus ouvrages. Vous prétendez
que sans Dieu rien ne peut se faire. Voici Straton de Lampsaque qui
affirme le contraire, et qui décharge Dieu d'une tâche véritablement
énorme. Puisque, dit-il, les prêtres des dieux ont le privilège de
ne point travailler, n'est-il pas bien plus juste encore d'étendre
ce privilège jusqu'aux dieux eux-mêmes ? Je n'ai pas besoin,
ajoute-t-il, du concours des dieux pour fabriquer le monde. Tout ce
qui existe est l'ouvrage de la nature, non pas qu'elle ait opéré
avec ces petits corps semés d'aspérités ou polis armés de crochets
ou de bras, et le vide entre deux. Ce sont là, dit Straton, des
rêves de Démocrite ; c'est de l'imagination et non de la
474 science. Pour lui,
interrogeant l'une après l'autre les diverses parties du monde, il
prouve que rien ne se fait et n'existe qu'en vertu de poids et de
mouvements naturels. Ainsi il affranchit Dieu d'un grand travail et
me délivre d'une grande crainte. Comment penser en effet que Dieu
gouverne notre destin sans trembler nuit et jour devant cette
puissance suprême ; et sans craindre, lorsque le malheur fond sur
nous (et quel homme en est épargné), que nous ne soyons justement
frappés ? Cependant je ne suis pas partisan de Straton, je ne le suis
pas non plus de votre doctrine. Tantôt l'une, tantôt l'autre des
deux opinions me semble la plus probable.
XXXIX. Ce sont là, Lucullus, des questions enveloppées de profondes
ténèbres, et nul génie humain n'a le coup d'œil assez perçant pour
pénétrer dans le ciel et sonder les entrailles de la terre. Nous ne
connaissons pas notre propre corps, nous ignorons comment en sont
disposées les diverses parties, et quelles fonctions remplit chacune
d'elles. Aussi les médecins l'ont-ils ouvert pour demander à leurs
yeux une connaissance d'un si haut prix pour eux. Et cependant les
empiriques prétendent qu'ils n'en sont pas plus savants pour cela,
parce qu'il se peut faire qu'on altère les organes, en les rendant
visibles et les mettant au grand jour. Mais pouvons-nous porter le
scalpel sur la nature entière, l'ouvrir, la partager, pour voir si
la terre repose sur un fond stable où elle soit en quelque façon
fixée par ses racines, ou si elle est suspendue dans l'espace ?
Xénophane dit que la lune est habitée, et que c'est une autre terre
couverte de villes et de montagnes. Cela semble une nouveauté bien
étrange ; cependant nous ne pourrions affirmer par serment, lui,
qu'il en est ainsi, et moi, que c'est une imposture. Vous dites,
vous, qu'il est une région de la terre directement opposée à
celle-ci, et dont les habitants se trouvent naturellement sur le sol
dans une position inverse à la nôtre, en telle sorte que vous les
nommez nos antipodes. Pourquoi vous indigner plutôt contre
moi qui ne méprise pas vos conjectures, que contre ceux qui, en les
entendant, les taxent de folie ? Nicétas de Syracuse soutient, au
rapport de Théophraste, que le ciel, le soleil, la lune, les
étoiles, en un mot tous les corps qui se trouvent au-dessus de nous,
sont immobiles, et que rien n'est en mouvement dans le monde, si ce
n'est la terre, qui tournant et roulant avec une extrême rapidité
sur son axe, produit exactement les mêmes phénomènes que si le ciel
entier tournait autour de la terre immobile. Quelques-uns pensent
que Platon exprime la même opinion dans le Timée, mais en termes
plus obscurs. Mais vous, Épicure, parlez : croyez-vous le soleil
aussi petit qu'il paraît ? Je n'accorderai pas qu'il soit deux deux
fois aussi grand. Le voilà qui vous raille, et à votre tour vous
riez de lui. Mais on ne peut rire de Socrate, on ne peut rire
d'Ariston de Chios qui pensent que, sur de tels sujets, il n'y a pas
de savoir possible. Mais je reviens à l'âme et au corps.
Connaissons-nous bien la nature des nerfs et celle des veines.
Savons-nous bien ce que c'est que l'âme ? Où elle est ? Savons-nous
mêmes! elle existe véritablement, ou si, comme le pensait Dicéarque,
elle n'a absolument aucune réalité ? Si elle existe, a-t-elle trois
parties comme l'enseignait Platon, la raison, la nature irascible,
et le siège des passions ; ou bien est-elle une et simple ? Si elle
est une et simple, est-elle un feu, un air, ou du sang ? Ou selon la
définition de Xénocrate, un nombre incorporel (chose dont
475 il est bien difficile de se
faire une idée) ; et enfin, de quelque nature qu'elle soit, est-elle
mortelle ou impérissable ? Car les deux opinions ont été abondamment
soutenues. Sur toutes ces questions, votre sage trouve quelqu'une de
ces solutions certaines ; le nôtre ne voit pas même laquelle est la
plus probable, tant pour la plupart les raisons opposées sont d'une
égale valeur.
XL. Si vous me tenez un langage plus modeste, et m'accusez non plus
de ne pas me rendre à vos raisons, mais de ne me rendre à aucune, je
ferai un effort sur moi-même et choisirai un système. Lequel
adopterai-je de préférence ? Vous me demandez lequel ? Celui de
Démocrite ; car vous savez que j'ai toujours eu beaucoup de goût pour
la noblesse. Mais j'entends déjà vos critiques fondre sur moi ; vous
allez vous écrier tous : “Comment pouvez-vous admettre le vide, quand
tout dans la nature est si plein et si pressé, qu'un corps mis en
mouvement cède sa place qu'à l'instant même un autre corps occupe
? Admettre des atomes, qui ne ressemblent à aucune de leurs
productions ? Comment pouvez-vous penser qu'un bel ouvrage ne doive
pas avoir une certaine intelligence pour auteur ? Et voyant dans ce
monde tant de beautés et de merveilles, croire qu'il y ait en haut,
en bas, à droite, à gauche, avant et après, un nombre infini de
mondes différents ou semblables. Nous voilà réunis à Baules en face
de Pouzzole, et vous croyez qu'il y a maintenant dans un nombre
infini de lieux exactement pareils, des réunions d'hommes portant
les mêmes noms, revêtus des mêmes honneurs, ayant fourni la même
carrière, d'esprit, de figures et d'âges tout à fait semblables aux
nôtres, et discutant sur le même sujet ? Comment encore pouvez-vous
soutenir que si, dans ce moment ou pendant le sommeil, il nous
semble voir quelque chose en esprit, c'est que des images venues du
dehors ont fait invasion dans l'âme en traversant nos organes ?
Rejetez bien loin ces opinions, si vous ne voulez consentir à de
grossières erreurs. Il vaut mieux ne rien croire que d'ajouter foi à
une doctrine si pitoyable.” — Ce que vous me demandez, ce n'est donc
pas d'approuver un système quelconque. Il y aurait alors dans votre
demande plus que de la présomption et presque de la tyrannie ; car
vos dogmes ne me paraissent pas même probables. Vous croyez à la
divination, et moi je la conteste ; ce destin qui, selon vous,
étreint tout, moi je le méprise. Je ne pense même pas que ce monde
ait été formé par la sagesse divine ; mais je ne suis pas non plus
certain du contraire.
|
|
XLI. Sed cur rapior in invidiam ? Licetne per vos
nescire quod nescio, an Stoicis ipsis inter se disceptare, cum is non licebit ?
Zenoni et reliquis fere Stoicis aether videtur summus deus, mente praeditus qua
omnia regantur ; Cleanthes, qui quasi maiorum est gentium Stoicus, Zenonis
auditor, solem dominari et rerum potiri putat : ita cogimur dissensione
sapientium dominum nostrum ignorare, quippe qui nesciamus soli an aetheri
serviamus. Solis autem magnitudinem (ipse enim hic radiatus me intueri videtur
admonens ut crebro faciam mentionem sui) vos ergo huius magnitudinem quasi
decempeda permensi refertis ; ego me, quasi malis architectis, mensurae vestrae
nego credere : dubium est uter nostrum sit, leviter ut dicam, verecundior ? Nec
tamen istas quaestiones physicorum exterminandas puto. Est enim animorum
ingeniorumque naturale quoddam quasi pabulum consideratio contemplatioque
naturae : erigimur, altiores fieri videmur, humana despicimus cogitantesque
supera atque caelestia haec nostra ut exigua et minima contemnimus. Indagatio
ipsa rerum cum maximarum tum etiam occultissimarum habet oblectationem ; si vero
aliquid occurrit quod veri simile videatur, humanissima conpletur animus
voluptate. Quaeret igitur haec et vester sapiens et hic noster, sed vester ut
adsentiatur credat adfirmet, noster ut vereatur temere opinari praeclareque agi
secum putet si in eius modi rebus veri simile quod sit invenerit. Veniamus nunc
ad bonorum malorumque notionem ; et paulum ante dicendum est. Non mihi videntur
considerare cum physici ista valde adfirmant earum etiam rerum auctoritatem si
quae inlustriores videantur amittere. Non enim magis adsentiuntur nec adprobant
lucere nunc quam cum cornix cecinerit tum aliquid eam aut iubere aut vetare, nec
magis adfirmabunt signum illud si erunt mensi sex pedum esse, quam solem, quem
metiri non possunt, plus quam duodeviginti partibus maiorem esse quam terram. Ex
quo illa conclusio nascitur : «si sol quantus sit percipi non potest, qui ceteras
res eodem modo <quo> magnitudinem solis adprobat is eas res non percipit ;
magnitudo autem solis percipi non potest ; qui igitur id adprobat quasi
percipiat, nullam rem percipit». Respondebunt posse percipi quantus sol sit : non
repugnabo, dum modo eodem pacto cetera percipi conprehendique dicant. Nec enim
possunt dicere aliud alio magis minusve conprendi, quoniam omnium rerum una est
definitio conprehendendi.
XLII. Sed quod coeperam : quid habemus in rebus
bonis et malis explorati ? Nempe fines constituendi sunt ad quos et bonorum et
malorum summa referatur. Qua de re est igitur inter summos viros maior
dissensio ? Et omitto illa quae relicta iam videntur,
Erillum qui in cognitione
et scientia summum bonum ponit ; qui cum Zenonis auditor esset vides quantum ab
eo dissenserit et quam non multum a Platone. Megaricorum fuit nobilis
disciplina, cuius ut scriptum video princeps Xenophanes quem modo nominavi,
deinde eum secuti Parmenides et Zeno ( * * itaque ab is Eleatici philosophi
nominabantur), post Euclides Socratis discipulus Megareus, a quo idem illi
Megarici dicti, qui id bonum solum esse dicebant quod esset unum et simile et
idem semper ; hi quoque multa a Platone
a Menedemo autem, quod is Eretria fuit,
Eretriaci appellati, quorum omne bonum in mente positum et mentis acie qua verum
cerneretur, Erilli similia, sed opinor explicata uberius et ornatius. Hos si
contemnimus et iam abiectos putamus, illos certe minus despicere debemus :
Aristonem, qui cum Zenonis fuisset auditor re probavit ea quae ille verbis,
nihil esse bonum nisi virtutem nec malum nisi quod virtuti esset contrarium ; in
mediis ea momenta quae Zeno voluit nulla esse censuit. Huic summum bonum est in
is rebus neutram in partem moveri, quae ἀδιαφορία ab ipso dicitur. Pyrrho autem
ea ne sentire quidem sapientem, quae ἀπάθεια nominatur. Has igitur tot
sententias ut omittamus, haec videamus, quae nunc diu multumque defensa sunt.
Alii voluptatem finem esse voluerunt, quorum princeps Aristippus, qui Socratem
audierat, unde Cyrenaici, post Epicurus, cuius est disciplina nunc [disciplina]
notior nec tamen cum Cyrenaicis de ipsa voluptate consentiens. Voluptatem autem
et honestatem finis esse Callipho censuit, vacare omni molestia Hieronymus, hoc
idem cum honestate Diodorus, ambo hi Peripatetici. Honeste autem vivere fruentem
rebus is quas primas homini natura conciliet et vetus Academia censuit, ut
indicant scripta Polemonis quem Antiochus probat maxime, et Aristoteles eiusque
amici huc proxime videntur accedere. Introducebat etiam Carneades, non quo
probaret sed ut opponeret Stoicis, summum bonum esse frui rebus is quas primas
natura conciliavisset. Honeste autem vivere, quod ducatur a conciliatione
naturae, Zeno statuit finem esse bonorum, qui inventor et princeps Stoicorum
fuit.
XLIII. Iam illud perspicuum est, omnibus is
finibus bonorum quos exposui malorum fines esse contrarios. Ad vos nunc refero
quem sequar ; modo ne quis illud tam ineruditum absurdumque respondeat
«quemlubet, modo aliquem» : nihil potest dici inconsideratius. Cupio sequi
Stoicos. Licetne – omitto per Aristotelem, meo iudicio in philosophia prope
singularem – per ipsum Antiochum, qui appellabatur Academicus, erat quidem si
perpauca mutavisset germanissimus Stoicus. Erit igitur res iam in discrimine ;
nam aut Stoicus constituatur sapiens aut veteris Academiae – utrumque non
potest ; est enim inter eos non de terminis sed de tota possessione contentio ;
nam omnis ratio vitae definitione summi boni continetur, de qua qui dissident de
omni vitae ratione dissident ; non potest igitur uterque esse sapiens, quoniam
tanto opere dissentiunt, sed alter – : si Polemoneus, peccat Stoicus rei falsae
adsentiens (vos quidem nihil esse dicitis a sapiente tam alienum [esse]) ; sin
vera sunt Zenonis, eadem in veteres Academicos Peripateticosque dicenda. Hic
igitur neutri adsentiens * si numquam, uter est prudentior ? Quid cum ipse
Antiochus dissentit quibusdam in rebus ab his quos amat Stoicis, nonne indicat
non posse illa probanda esse sapienti ? Placet Stoicis omnia peccata esse paria
;
at hoc Antiocho vehementissime displicet. Liceat tandem mihi considerare utram
sententiam sequar. «Praecide» inquit, «statue aliquando quidlibet.» Quid quae
dicuntur quom et acuta mihi videntur in utramque partem et paria,
nonne caveam
ne scelus faciam ? Scelus enim dicebas esse Luculle dogma prodere ; contineo
igitur me, ne incognito adsentiar, quod mihi tecum est dogma commune. Ecce multo
maior etiam dissensio. Zeno in una virtute positam beatam vitam putat. Quid
Antiochus ? «etiam» inquit «beatam, sed non beatissimam». Deus ille qui nihil
censuit deesse virtuti, homuncio hic qui multa putat praeter virtutem homini
partim cara esse partim etiam necessaria. Sed <et> ille vereor ne virtuti plus
tribuat quam natura patiatur, praesertim Theophrasto multa diserte copioseque
dicente, et hic metuo ne vix sibi constet, qui cum dicat esse quaedam et
corporis et fortunae mala tamen eum qui in his omnibus sit beatum fore censeat
si sapiens sit : distrahor, tum hoc mihi probabilius tum illud videtur, et tamen
nisi alterutrum sit virtutem iacere plane puto. Verum in his discrepant.
XLIV. Quid illa in quibus consentiunt num pro
veris probare possumus, sapientis animum numquam nec cupiditate moveri nec
laetitia ecferri ? Age haec probabilia sane sint ; num etiam illa, numquam timere
numquam dolere : sapiensne non timeat ne patria deleatur, non doleat si deleta
sit ? Durum, sed Zenoni necessarium, cui praeter honestum nihil est in bonis,
tibi vero Antioche minime, cui praeter honestatem multa bona, praeter
turpitudinem multa mala videntur, quae et venientia metuat sapiens necesse est
et venisse doleat. Sed quaero quando ista fuerint Academia vetere †dunttia, ut
animum sapientis commoveri et conturbari negarent : mediocritates illi probabant
et in omni permotione naturalem volebant esse quendam modum.
Legimus omnes
Crantoris veteris Academici de luctu ; est enim non magnus verum aureolus et ut
Tuberoni Panaetius praecipit ad verbum ediscendus libellus. Atque illi quidem
etiam utiliter a natura dicebant permotiones istas animis nostris datas, metum
cavendi causa, misericordiam aegritudinemque clementiae ; ipsam iracundiam
fortitudinis quasi cotem esse dicebant – recte secusne alias viderimus ;
atrocitas quidem ista tua quo modo in veterem Academiam inruperit nescio. Illa
vero ferre non possum – non quo mihi displiceant, sunt enim Socratica pleraque
mirabilia Stoicorum, quae παράδοξα nominantur ; sed ubi Xenocrates, ubi
Aristoteles ista tetigit (hos enim quasi eosdem esse vultis) : illi umquam
dicerent sapientes solos reges solos divites solos formosos ; omnia quae ubique
essent sapientis esse ; neminem consulem praetorem imperatorem, nescio an ne
quinquevirum quidem quemquam nisi sapientem ; postremo solum civem solum liberum,
insipientes omnes peregrinos exules servos, furiosos denique ; scripta Lycurgi
Solonis, duodecim tabulas nostras non esse leges, ne urbis quidem aut civitatis
nisi quae essent sapientium. Haec tibi Luculle, si es adsensus Antiocho
familiari tuo, tam sunt defendenda quam moenia, mihi autem bono modo tantum
quantum videbitur.
XLV. Legi apud Clitomachum, cum Carneades et
Stoicus Diogenes ad senatum in Capitolio starent, A. Albinum, qui tum P.
Scipione et M. Marcello cos. Praetor esset, eum qui cum avo tuo Luculle consul
fuit, doctum sane hominem ut indicat ipsius historia scripta Graece, iocantem
dixisse Carneadi : «ego tibi Carneade praetor esse non videor, quia sapiens non
sum, nec haec urbs nec in ea civitas ?» tum ille : «huic Stoico non videris».
Aristoteles aut Xenocrates, quos Antiochus sequi volebat, non dubitavisset quin
et praetor ille esset et Roma urbs et eam civitas incoleret ; sed ille noster est
plane ut supra dixi Stoicus perpauca balbutiens. Vos autem mihi verenti ne labar
ad opinionem et aliquid adsciscam et conprobem incognitum, quod minime vultis,
quid consilii datis ? Testatur saepe Chrysippus tris solas esse sententias quae
defendi possint de finibus bonorum ; circumcidit et amputat multitudinem. Aut
enim honestatem esse finem aut voluptatem aut utrum<que>. Nam qui summum bonum
dicant id esse, si vacemus omni molestia, eos invidiosum nomen voluptatis fugere
sed in vicinitate versari ; quod facere eos etiam qui illud idem cum honestate
coniungerent, nec multo secus eos qui ad honestatem prima naturae commoda
adiungerent. Ita tris relinquit sententias quas putet probabiliter posse
defendi. Sit sane ita – quamquam a Polemonis et Peripateticorum et Antiochi
finibus non facile divellor nec quicquam habeo adhuc probabilius. Verum tamen
video quam suaviter voluptas sensibus nostris blandiatur ; labor eo ut adsentiar
Epicuro aut Aristippo : revocat virtus vel potius reprendit manu, pecudum illos
motus esse dicit, hominem iungit deo. Possum esse medius, ut, quoniam Aristippus
quasi animum nullum habeamus corpus solum tuetur, Zeno quasi corporis simus
expertes animum solum conplectitur, ut Calliphontem sequar – cuius quidem
sententiam Carneades ita studiose defensitabat ut eam probare etiam videretur ;
quamquam Clitomachus adfirmabat numquam se intellegere potuisse quid Carneadi
probaretur – sed si eum ipsum finem velim sequi, nonne ipsa severitas et
gravitas et recta ratio mihi obversetur : «tune, cum honestas in voluptate
contemnenda consistat, honestatem cum voluptate tamquam hominem cum belua
copulabis ?» |
XLI. Pourquoi donc me faire mon procès ? Ne pouvez-vous pas me
permettre d'ignorer ce que j'ignore ? Les stoïciens pourront ne pas
s'entendre ensemble, et je serai forcé de m'entendre avec eux
? Zénon
et presque tous les autres stoïcien voient dans l'éther le Dieu
suprême, doué de cette intelligence qui gouverne tout. Un disciple
de Zénon, Cléanthe, que l'on pourrait appeler le stoïcien des
grandes maisons, pense que le soleil est le maître et le roi de
l'univers. Ainsi donc nous voilà réduits par ce dissentiment des
sages à ignorer quel est notre maître, à ne pas savoir si nous
sommes les sujets du soleil ou de l'éther. Quant à la grandeur du
soleil (car il semble tourner vers moi sa face étincelante et
m'engager à parler souvent de lui) ; quant à cette grandeur, vous
nous en donnez l'exacte proportion, comme si vous l'aviez mesurée à
la toise ; mais moi qui vous regarde comme de mauvais architectes, je
refuse de m'en rapporter à votre
476
mesure. Est-il donc difficile de juger lequel de vous ou
de moi témoigne le plus de retenue ? Je ne voudrais pas cependant
proscrire ces recherches des physiciens. Car c'est comme une
nourriture naturelle de nos esprits et de nos âmes que la
contemplation et l'étude de la nature ; avec elles notre pensée
s'élève ; nous recevons une grandeur nouvelle, nous regardons d'en
haut les choses humaines ; et, méditant sur ces objets sublimes et
célestes, nous prenons en pitié toutes ces affaires et ces intérêts
mesquins et misérables. Poursuivre tous ces grands et ces profonds
mystères, c'est un travail plein de charme. Et lorsque nous voyons
se lever quelque aurore de la vérité, notre esprit est pénétré de la
plus exquise des jouissances. Votre sage et le nôtre interrogeront
donc ces mystères ; mais le vôtre, pour croire, pour se prononcer,
pour affirmer ; tandis que le nôtre redoutera toujours de porter à la
légère des jugements peu fondés, et se croira fort heureux dans de
tels sujets, de rencontrer la vraisemblance.
Venons-en maintenant à la doctrine des biens et des maux. Mais avant
de l'aborder, nous avons encore une courte réflexion à présenter.
Nos adversaires ne considèrent pas, à ce qu'il semble, qu'en
affirmant avec tant d'assurance leurs divers dogmes de physique, ils
compromettent l'autorité de ces choses même qui paraissent les plus
évidentes. Ils affirment avec une égale conviction que maintenant il
fait jour, et que le chant de la corneille, c'est un ordre ou une
défense ; et ils ne déclareront pas avec plus d'assurance, après
avoir mesuré cette statue, qu'elle à six pieds de hauteur, qu'ils ne
soutiendront que le soleil, dont ils ne peuvent prendre la mesure,
est plus de dix-huit fois plus grand que la terre. D'où l'on tire
cette conclusion toute naturelle ; si l'on ne peut connaître la
grandeur du soleil, celui qui juge de cette grandeur et de toute
autre chose avec la même assurance, celui-là ne connaît rien. Or on
ne peut connaître la grandeur du soleil, donc celui qui en juge,
comme s'il la connaissait, ne connaît rien. Ils répondront que l'on
peut connaître quelle est la grandeur du soleil ; je ne le
contesterai point, pourvu qu'ils conviennent que tout le reste est
perçu et connu de la même manière. Car ils ne peuvent dire qu'il est
des choses plus ou moins certaines les unes que les autres ; puisque
la définition de la certitude est pour tout invariablement la même.
XLII. Mais j'étais arrivé à la morale : ici je demanderai ce que nous
connaissons d'incontestable sur les biens et les maux ; il s'agit
d'établir une fin dernière à laquelle toute la variété des uns et
des autres soit rapportée ; eh bien, sur quelle question a surtout
éclaté le dissentiment entre les plus grands philosophes ? Je veux
laisser dans l'ombre les systèmes qui y sont tombés ; je ne parlerai
pas d'Hérillus qui mettait le souverain bien dans la connaissance et
la science, pour un disciple de Zénon, vous voyez combien il s'est
éloigné de son maître et rapproché de Platon. Mais l'école de Mégare
ne manque pas de célébrité ; Xénophane que j'ai déjà nommé en fut le
fondateur, selon certains écrivains ; après lui vinrent Parménide et
Zénon ; et c'est d'eux que cette philosophie reçut le nom
d'Eléatique ; mais depuis Euclide de Mégare, disciple de Socrate,
elle prit celui de Mégarique. Elle enseignait que le souverain bien
c'est ce qui est un, toujours semblable à soi-même, et qui ne change
477 pas. Cette école avait
emprunté beaucoup à Platon. Ménédème d'Érétrie fut le chef des
érétriens pour qui tout bien résidait dans l'esprit et dans le coup
d'œil perçant qui saisit la vérité ; cette théorie ressemble beaucoup
à celle d'Hérillus, mais elle était, j'imagine, plus complètement et
plus élégamment développée. Si nous méprisons ces divers systèmes et
les croyons complètement hors de cause, en voici du moins dont nous
devons faire plus de cas. Je citerai d'abord celui d'Ariston, qui,
après avoir reçu les leçons de Zénon, fit descendre au fond des
choses la rigueur que son maître avait mise surtout dans les mots,
en déclarant comme lui qu'il n'y a de bien que dans la vertu, et de
mal que dans le vice, et en supprimant les intermédiaires auxquels
Zénon accordait tant de crédit. Ariston fait consister le souverain
bien à n'être incliné d'aucun côté par ces mobiles secondaires
;
c'est ce qu'il nomme indifférence. Pyrrhon va jusqu'à
prétendre qu'ils ne se font pas même sentir au sage ; c'est ce qu'il
appelle ἀπάθεια. Mais laissons de côté toutes ces
doctrines, et voyons celles qui ont eu de nombreux et d'ardents
défenseurs. Les uns mettent le bien suprême dans la volupté ; à leur
tête est Aristippe, l'un des disciples de Socrate, et chef des
cyrénaïques. Ensuite vient Épicure dont le système est maintenant
plus connu, mais qui cependant ne peut s'entendre avec Aristippe sur
la volupté elle-même. Calliphon voit le souverain bien dans la
volupté jointe à la vertu ; Hiéronyme, dans l'absence de toute peine
;
Diodore dans l'absence de la peine et la vertu combinées. Ces deux
derniers sont péripatéticiens. Vivre honnêtement, en usant de ces
choses que la nature nous assortit le plus évidemment, tel était le
précepte de l'ancienne Académie, comme nous le prouvent les écrits
de Polémon, l'auteur favori d'Antiochus, et, à très peu de chose
près, la maxime d'Aristote et de ses amis. Carnéade mit en avant une
autre théorie, non pour se l'imposer à lui-même, mais pour l'opposer
aux stoïciens ; c'était qu'il fallait vivre en usant des choses qui
nous sont le plus manifestement assorties par la nature. Zénon pensa
que le souverain bien dans la vie, c'est la vertu, qu'il regarde
aussi comme la conformité à la nature. C'est lui qui fut le
fondateur et le chef de l'école stoïcienne.
XLIII. Il va sans dire que dans tous ces systèmes le souverain mal
est l'opposé du souverain bien. Je vous le demande maintenant,
lequel suivrai-je ? J'espère bien que personne ne me fera cette
réponse aussi ignorante qu'absurde : Prenez quel système vous
voudrez, pourvu que vous en ayez un. On ne peut rien dire de plus
inconsidéré. Je désire embrasser la morale stoïcienne ; y serai je
autorisé (je ne dis pas par Aristote que je regarde comme un génie
lors de ligne dans la philosophie) mais par Antiochus, qui se disait
académicien, et qui était en vérité, à de bien légères différences
près, un pur stoïcien ? Nous voilà déjà dans le doute. Il faut être
un sage du Portique, ou un sage de l'ancienne Académie ; car d'être
l'un et l'autre à la fois, il n'y faut pas songer ; entre les deux
écoles, il n'y a pas seulement une contestation de limites, mais de
propriété tout entière. En effet, toute la doctrine des mœurs est
renfermée dans la définition du souverain bien, et ceux qui ne
s'entendent pas sur le principe, ne peuvent s'entendre sur aucune
conséquence ; le véritable sage ne peut être à la
478 fois académicien et stoïcien,
puisque la différence entre les deux écoles est si tranchée ; il faut
qu'il choisisse. S'il suit la doctrine de Polémon, il condamnera le
stoïcien qui prend l'erreur pour la vérité ; car vous dites qu'il n'y
a rien de plus indigne du sage. Si c'est au contraire Zénon qui dit
vrai, il faudra faire les mêmes reproches aux anciens académiciens
et aux péripatéticiens. Celui qui ne veut se rendre ni à l'un ni aux
autres serait-il donc le plus prudent ? Antiochus lui-même qui combat
en quelques points la doctrine des stoïciens qu'il aime. Ne
prouve-t-il pas que le sage ne peut accepter tous leurs dogmes ? Les
stoïciens veulent que toutes les fautes soient égales ; mais cette
maxime soulève Antiochus. Laissez-moi donc délibérer mûrement le
choix que je veux faire entre ces deux systèmes. Coupez court,
dites-vous, et prenez enfin un parti. Quoi! les raisons apportées de
part et d'autre me paraissent ingénieuses et également plausibles
;
et je ne me garderais pas de commettre un crime ? Car vous disiez,
Lucullus, que c'était un crime de trahir un seul dogme de la
philosophie. Je retiens donc mon jugement, pour ne pas affirmer ce
que je ne connais pas, et je ne fais en cela que ce que vous
conseillez vous-même. Mais voici encore un bien plus grave
dissentiment. Zénon pense que le bonheur réside dans la seule vertu.
Et Antiochus ? Oui, dit-il, je tiens que la vertu rend la vie
heureuse, mais non pas parfaitement heureuse. N'est-ce pas un dieu
qui juge ainsi que rien ne manque à la vertu ? N'est-ce pas un pauvre
et faible mortel, celui qui croit qu'en dehors de la vertu beaucoup
de choses encore nous sont précieuses ou nécessaires ? Mais je crains
que l'un n'accorde à la vertu plus que notre nature ne permet,
surtout quand j'écoute toutes les réflexions sensées et profondes de
Théophraste. Et je ne sais trop si l'autre est conséquent avec lui
même ; car il avoue que les maladies et les revers de fortune sont
des maux, et en même temps il déclare que l'on peut en être frappé
sans cesser d'être heureux, si l'on est sage. Je ne sais auquel
croire ; tantôt une doctrine me parait plus probable, tantôt l'autre,
et cependant je suis persuadé que si l'une des deux n'était vraie,
c'en serait fait de la vertu. Voilà donc les points sur lesquels ils
ne sont pas d'accord.
XLIV. Mais trouverons-nous la vérité dans ces maximes qu'ils
s'accordent à défendre ? Dirons-nous avec eux que l'âme du sage n'est
jamais agitée par les désirs, ni transportée par la joie ? Admettons,
si vous voulez, que ce soit là une vérité probable, en dirons-nous
autant de ce dogme que le sage ne craint rien et ne souffre de rien
?
Le sage ne craint rien ? Pas même lorsque la patrie est dans un
imminent péril ? Il ne souffre de rien ? Pas même de la voir anéantie
? C'est là un langage très-dur ; mais Zénon est forcé de le tenir
puisqu'il ne reconnaît d'autre bien que la vertu : pour vous,
Antiochus, rien ne vous y oblige, puisque vous admettez en dehors de
la vertu un grand nombre de biens, en dehors du vice, un grand
nombre de maux dont le sage peut redouter l'approche, et dont les
coups doivent l'affliger. Mais je demande où vous avez vu que
l'ancienne Académie ait décrété que l'âme du sage est inaccessible à
l'émotion et au trouble ? Ils recommandaient un juste tempérament, et
voulaient dans toute émotion une certaine mesure naturelle. Nous
avons tous lu ce que Cranter, de l'ancienne Académie, a écrit sur le
deuil. Ce traité n'est pas grand ; mais c'est un livre d'or, que tout
le monde devrait savoir par cœur, comme
479 Panétius le recommandait à Tubéron. Ces philosophes
disaient que toutes les émotions nous ont été données sagement par
la nature, parce qu'elles servent, la crainte à nous mettre sur
notre garde ; la pitié et le chagrin à nous rendre cléments ; la
colère elle-même, à aiguiser notre courage. Avaient-ils tort ou
raison, c'est ce que nous examinerons plus tard. Ce que je ne puis
comprendre, c'est comment vous avez pu charger l'ancienne Académie
de la rudesse de vos maximes. Je déclare que je ne puis les
recevoir, non pas qu'elles me déplaisent, car ce sont pour la
plupart des préceptes socratiques que ces dogmes étranges des
stoïciens que l'on nomme paradoxes ; mais où les trouvez vous dans
Xénocrate et dans Aristote (car vous voulez que l'Académie et le
Lycée ne soient qu'une même école) ? Auraient-ils jamais dit que les
sages seuls sont rois, sont riches et sont beaux ? Que tout ce qui
existe au monde appartient au sage ? Que personne n'est consul,
préteur, empereur, et peut-être même quinquévir, si ce n'est le
sage ? Enfin, que le sage seul est citoyen, seul est libre ? Et que
tous les autres hommes sont des fous, des étrangers, des exilés, des
esclaves, des furieux ? Auraient-ils dit encore que les lois de
Lycurgue, de Solon, et que nos Douze Tables ne sont pas des lois ? Et
qu'il n'y a ni villes ni sociétés, si ce n'est celles que composent
les sages ? Voilà tout autant de propositions, Lucullus, qu'il vous
faut défendre comme des remparts, si vous adoptez la doctrine de
votre ami Antiochus. Pour moi, j'ai une condition meilleure, je ne
suis tenu à les soutenir qu'autant qu'elles me paraîtront vraies.
XLV. J'ai lu dans Clitomaque que lorsque Carnéade et le stoïcien
Diogèue furent admis devant l'assemblée du sénat, au Capitole, A.
Albinus, alors préteur sous le consulat de P. Scipion et de M.
Marcellus, et qui depuis fut consul avec votre aïeul Lucullus, homme
d'ailleurs fort savant, comme le témoigne l'histoire qu'il a écrite
en grec, dit en riant à Carnéade : “II vous semble donc, Carnéade,
que je ne suis pas préteur, puisque je n'ai point la sagesse ; que
Rome n'est pas une ville et ne renferme pas un État.” Carnéade
répondit : “C'est ce stoïcien qui juge ainsi.” Aristote et Xénocrate,
dont Antiochus se1 disait le disciple, n'auraient pas mis en doute
qu'Albinus fût préteur, que Rome fût une ville et renfermât une
véritable société. Mais, comme je l'ai déjà dit, Antiochus est un
pur stoïcien, sauf quelques médiocres changements qu'il balbutie ça
et là. Mais vous qui paraissez craindre que je ne me laisse
entraîner à quelque opinion sans fondement, et que mon jugement trop
léger ne précède la lumière, ce que vous regardez comme une grande
faute, quel conseil me donnez-vous ? Chrysippe déclare souvent qu'il
n'y a sur le souverain bien que trois thèses que l'on puisse
défendre ; il retranche et jette au vent toutes les autres. Voici ces
trois thèses : “Ou la vertu est le souverain bien, ou la volupté ; ou
toutes deux réunies. “Ceux qui disent que le souverain bien consiste
dans l'absence de la peine, veulent éviter de prononcer le nom
scabreux de la volupté ; mais ils touchent la chose de bien près. On
en peut dire autant de ceux qui joignent l'absence de la peine à la
vertu, et même, sans se tromper beaucoup, de ceux qui mettent la
vertu en compagnie de ces choses que la nature nous a le plus
manifestement assorties. Il ne reste donc, selon Carnéade, que trois
opinions que l'on
480 puisse
défendre d'une manière plausible. J'en conviens volontiers.
Quoiqu'on ne puisse facilement me détacher de la doctrine de
Polémon, des péripatéticiens et d'Antiochus, et que je n'en voie
aucune de plus probable, cependant je reconnais avec quelle
séduction la volupté flatte nos sens, et je me laisse aller à penser
comme Épicure ou Aristippe. La vertu me rappelle ou plutôt elle me
ressaisit de la main ; elle me dit que ce sont là les emportements
des brutes ; elle rapproche l'homme de la divinité. Je puis tenir le
milieu. Aristippe, comme si nous n'avions point d'âme, ne s'occupe
que du corps ; Zénon, comme si nous étions incorporels, ne songe qu'à
l'âme ; Calliphon me présente une opinion moyenne, défendue naguère
par Carnéade avec tant de chaleur qu'on pouvait l'en croire
véritablement convaincu. Cependant Clitomaque affirmait qu'il
n'avait jamais pu découvrir quelle était au fond la pensée de
Carnéade. Mais si je voulais me rendre à cette doctrine, est-ce que
la vérité, la sévère et droite raison ne s'y opposeraient point
? Comment! médiraient-elles, quand la vertu consiste à mépriser la
volupté, vous voulez associer volupté et vertu, et marier, pour
ainsi dire, l'homme avec la bête ?
|
|
XLVI. Unum igitur par quod depugnet relicum est,
voluptas cum honestate ; de quo Chrysippo sunt, quantum ego sentio, non * * magna
contentio. Alteram si sequare, multa ruunt et maxime communitas cum hominum
genere, caritas amicitia iustitia reliquae virtutes, quarum esse nulla potest
nisi erit gratuita ; nam quae voluptate quasi mercede aliqua ad officium
inpellitur, ea non est virtus sed fallax imitatio simulatioque virtutis. Audi
contra illos qui nomen honestatis a se ne intellegi quidem dicant (nisi forte
quod gloriosum sit in volgus id honestum velimus dicere), fontem omnium bonorum
in corpore esse, hanc normam hanc regulam hanc praescriptionem esse naturae, a
qua qui aberravisset eum numquam quid in vita sequeretur habiturum. Nihil igitur
me putatis, haec et alia innumerabilia cum audiam, moveri ? Tam moveor quam tu
Luculle, nec me minus hominem quam <te> putaveris ; tantum interest, quod tu cum
es commotus adsciscis adsentiris adprobas, verum illud certum conprehensum
perceptum ratum firmum fixum fuisse vis deque eo nulla ratione neque pelli neque
moveri potes, ego nihil eius modi esse arbitror cui si adsensus sim non
adsentiar saepe falso, quoniam vera a falsis nullo visi discrimine separantur,
praesertim cum iudicia ista dialecticae nulla sint. Venio enim iam ad tertiam
partem philosophiae. Aliud iudicium Protagorae est qui putet id cuique verum
esse quod cuique videatur, aliud Cyrenaicorum, qui praeter permotiones intumas
nihil putant esse iudicii, aliud Epicuri, qui omne iudicium in sensibus et in
rerum notitiis et in voluptate constituit ; Plato autem omne iudicium veritatis
veritatemque ipsam abductam ab opinionibus et a sensibus cogitationis ipsius et
mentis esse voluit. Num quid horum probat noster Antiochus ? Ille vero ne maiorum
quidem suorum. Ubi enim [et] Xenocraten sequitur, cuius libri sunt de ratione
loquendi multi et multum probati, aut ipsum Aristotelem, quo profecto nihil est
acutius nihil politius ; a Chrysippo pedem nusquam.
XLVII. Qui ergo Academici appellamur (an abutimur
gloria nominis ?) aut cur cogimur eos sequi qui inter se dissident ? In hoc ipso
quod in elementis dialectici docent, quo modo iudicare oporteat verum falsumne
sit si quid ita conexum est ut hoc «si dies est lucet», quanta contentio est :
aliter Diodoro, aliter Philoni, Chrysippo aliter placet. Quid cum Cleanthe
doctore suo quam multis rebus Chrysippus dissidet ; quid duo vel principes
dialecticorum Antipater et Archidemus
spinosissimi homines nonne multis in rebus
dissentiunt ? Quid me igitur Luculle in invidiam et tamquam in contionem vocas,
et quidem ut seditiosi tribuni solent occludi tabernas iubes ? Quo enim spectat
illud cum artificia tolli quereris a nobis nisi ut opifices concitentur ; qui si
undique omnes convenerint facile contra vos incitabuntur. Expromam primum illa
invidiosa, quod eos omnes qui in contione stabunt exules servos insanos esse
dicatis. Deinde ad illa veniam, quae iam non ad multitudinem sed ad vosmet ipsos
qui adestis pertinent. Negat enim vos Zeno, negat Antiochus scire quicquam. «Quo
modo ?» inquies ; «nos enim defendimus etiam insipientem multa conprendere». At
scire negatis quemquam rem ullam nisi sapientem. Et hoc quidem Zeno gestu
conficiebat. Nam cum extensis digitis adversam manum ostenderat, «visum»
inquiebat «huius modi est» ; dein cum paulum digitos contraxerat, «adsensus huius
modi» ; tum cum plane conpresserat pugnumque fecerat, conprensionem illam esse
dicebat, qua ex similitudine etiam nomen ei rei, quod ante non fuerat,
κατάλημψιν imposuit ; cum autem laevam manum admoverat et illum pugnum arte
vehementerque conpresserat, scientiam talem esse dicebat, cuius compotem nisi
sapientem esse neminem. Sed qui sapiens sit aut fuerit ne ipsi quidem solent
dicere. Ita tu nunc Catule lucere nescis, nec tu Hortensi in tua villa nos esse.
Num minus haec invidiose dicuntur ? Nec tamen nimis eleganter ; illa subtilius.
Sed quo modo tu si conprendi nihil posset artificia concidere dicebas nec mihi
dabas id quod probabile esset satis magnam vim habere ad artes, sic ego nunc
tibi refero artem sine scientia esse non posse. An pateretur hoc Zeuxis aut
Phidias aut Polyclitus, nihil se scire, cum in iis esset tanta sollertia ? Quod
si eos docuisset aliquis quam vim habere diceretur scientia, desinerent irasci ;
ne nobis quidem suscenserent, cum didicissent id tollere nos quod nusquam esset,
quod autem satis esset ipsis relinquere. Quam rationem maiorum etiam conprobat
diligentia, qui primum iurare ex sui animi sententia quemque voluerunt, deinde
ita teneri si sciens falleret, quod inscientia multa versaretur in vita ; tum qui
testimonium diceret ut arbitrari se diceret etiam quod ipse vidisset, quaeque
iurati iudices cognovissent ut ea non aut esse <aut non esse> facta sed ut
videri pronuntiarentur.
XLVIII. erum quoniam non solum nauta significat
sed etiam favonius ipse insusurrat navigandi nobis Luculle tempus esse, et
quoniam satis multa dixi, sit mihi perorandum. Posthac tamen cum haec [tamen]
quaeremus, potius de dissensionibus tantis summorum virorum disseramus <de>
obscuritate naturae, deque errore tot philosophorum qui de [in] bonis
contrariisque rebus tanto opere discrepant ut, cum plus uno verum esse non
possit, iacere necesse sit tot tam nobiles disciplinas, quam de oculorum
sensuumque reliquorum mendaciis et de sorite aut pseudomeno, quas plagas ipsi
contra se Stoici texuerunt.
Tum Lucullus, Non moleste, inquit, fero nos haec
contulisse. Saepius enim congredientes nos, et maxume in Tusculanis nostris, si
quae videbuntur requiremus. Optume, inquam, sed quid Catulus sentit, quid
Hortensius ? Tum Catulus, Egone, inquit, ad patris revolvor sententiam, quam
quidem ille Carneadeam esse dicebat, ut percipi nihil putem posse, adsensurum
autem non percepto id est opinaturum sapientem existumem, sed ita ut intellegat
se opinari sciatque nihil esse quod conprehendi et percipi possit. †per epochen
illam omnium rerum conprobans† illi alteri sententiae, nihil esse quod percipi
possit, vehementer adsentior. Habeo, inquam, sententiam tuam nec eam admodum
aspernor. Sed tibi quid tandem videtur Hortensi ?Tum ille ridens, Tollendum.
Teneo te, inquam ; nam ista Academiaest propria sententia.
Ita sermone confecto Catulus remansit, nos ad
naviculas nostras descendimus.
|
XLVI. Il ne reste donc plus que deux combattants, la volupté et la
vertu. Et je crois que Chrysippe n'eut pas grande difficulté à
soutenir la lutte. Si vous suivez la volupté, bien des choses
périssent, et surtout ces beaux liens qui nous unissent à nos
semblables, l'amour des hommes, l'amitié, la justice et les autres
vertus ; car, sans le désintéressement, ce ne sont plus là que des
chimères. Lorsque nous sommes portés à remplir nos devoirs par
l'attrait du plaisir, et l'appât de la récompense, ce n'est pas de
la vertu, c'en est un faux-semblant et comme un plagiat. Écoutez
maintenant ceux qui déclarent ne pas même comprendre ce nom de
vertu, à moins que nous n'entendions par là ce qui est applaudi de
la foule ; ils nous disent que la source de tous les biens est dans
le corps ; que c'est là la règle, la loi, la volonté certaine de la
nature ; que s'en écarter, c'est se priver du seul guide qui nous
puisse diriger dans la vie. Croyez-vous donc que, lorsque j'entends
toutes ces raisons et des milliers d'autres, elles ne fassent aucune
impression sur mot ? Mon esprit est aussi capable d'impression que le
vôtre, Lucullus ; et je vous prie de croire que je ne suis pas moins
homme que vous. Toute la différence qu'il y a entre nous, c'est que
vous, dès qu'une impression vous frappe, vous consentez, vous
affirmez, vous vous prononcez ; ce que vous affirmez ainsi, vous le
déclarez vrai, entendu, connu, certain, sans retour, sans variation,
sans appel ; aucune raison ne pourra vous en détacher, ni même vous
émouvoir ; tandis que moi je pense qu'il n'est rien que je puisse
affirmer certainement sans m'exposer à affirmer souvent l'erreur,
attendu qu'entre l'erreur et la vérité il n'est aucune distinction
constante, et ce critérium proposé parla dialectique pour les
reconnaître, n'est qu'une imagination sans fondement.
J'arrive maintenant à la troisième partie de la philosophie. Je vois
ici un principe de certitude pour Protagoras, qui pense que pour
chacun la vérité, c'est sa manière de voir les choses ; un autre pour
les cyrénaïques, qui enseignent qu'à l'exception de nos émotions
intérieures, nous ne devons nous fier à rien ; un autre encore pour
Épicure, selon qui toute vérité est dans le témoignage des sens,
dans les images des choses et dans la volupté. Platon enlève aux
sens le discernement de la vérité qu'il place bien au-dessus de leur
481 sphère et de la région des
opinions, et dont il fait l'objet propre de la pensée et de
l'entendement. Est-ce qu'Antiochus reçoit quelqu'un de ces
principes ? Il est infidèle, même à ceux des premiers académiciens,
ses maîtres. Quand l'avons nous vu suivre Xénocrate de qui nous
avons sur la logique beaucoup de livres et des livres très-estimés ?
Ou Aristote qui nous a laissé un chef-d'œuvre de pénétration et
d'élégance ? Il ne s'écarte jamais de Chrysippe d'un seul pas.
XLVII. Pour nous, qui nous appelons académiciens, est-ce que nous
abusons de ce beau titre ? Pourquoi veut-on nous forcer à penser
comme des gens qui ne peuvent s'entendre ? Sur cette première règle
que les dialecticiens nous donnent dans leurs éléments, et qui est
relative aux jugements à porter sur le vrai et le faux dans des
propositions conjonctives comme celle-ci : “S'il fait jour, il
fait clair” ; que d'opinions diverses! Diodore pense d'une façon,
Philon d'une autre ; Chrysippe d'une autre encore. Chrysippe résout
une foule de questions autrement que Cléanthe, son maître. Et ces
deux dialecticiens, que l'on pourrait nommer les princes de leur
art, Antipater et Archidémus, les plus féconds des hommes en
jugements hardis et précipités, ne sont-ils pas en guerre
continuelle ? Pourquoi donc, Lucullus, me faire un procès aussi
terrible, et me citer en quelque façon devant le tribunal du peuple
?
Par Hercule, pourquoi, comme les tribuns séditieux, voulez-vous
faire fermer les boutiques ? Vous nous reprochez de supprimer d'un
coup tous les travaux : à quoi tend cette accusation, si ce n'est à
ameuter les artisans contre nous ? Eh bien! que de tous côtés ils
accourent, qu'ils s'assemblent ; c'est contre vous qu'il sera facile
de tourner leur colère. Je leur dirai d'abord avec quel mépris vous
les traitez ; je leur apprendrai que vous les regardez tous comme des
exilés, des esclaves et des insensés ; puis j'en viendrai à ce genre
d'attaque qui n'est pas pour faire impression sur la multitude, mais
sur vous qui m'écoutez. Au nom de Zénon et d'Antiochus, je prouverai
que vous ne savez rien. Comment donc! direz-vous, nous prétendons
que l'on peut connaître beaucoup de choses sans être sage. Mais vous
soutenez que l'on ne peut avoir de rien au monde une science
certaine sans la sagesse. Zénon exprimait tout cela par gestes. Il
étendait les doigts, et montrait le revers de la main ainsi
déployée," Voilà, disait-il, la simple Représentation”. Il
pliait ensuite un peu les doigts, et c'était l'Assentiment.
Il fermait la main et montrait le poing, c'était l'image de la
Compréhension. Et c'est de là qu'il nomme d'un nom tout-à fait
nouveau, cette opération de l'esprit,
κατάληψις.
Il approchait ensuite la main gauche de la droite ainsi fermée, et
serrait son poing de toutes ses forces, et parla, disait-il, il
représentait la science, que personne ne possède si ce n'est le
sage. Mais quels sont les sages d'aujourd'hui, quels sont ceux des
temps passés ? Les stoiciens n'en disent rien. Ainsi donc vous ne
savez pas maintenant, Catulus, que le soleil luit, ni vous,
Hortensius, que nous sommes dans votre maison de campagne. Eh bien!
cette accusation-là ne vaut-elle pas l'autre ? Il est vrai qu'elle
n'est ni aussi ingénieuse ni aussi éloquente. Vous me disiez aussi,
que si l'on ne peut rien connaître, tous les arts périssent, et vous
ne vouliez pas m'accorder que les probabilités fussent suffisantes
pour guider la main d'un artiste ; et moi je soutiens main-
482 tenant que sans la science
certaine il n'y a point d'arts. Zeuxis, Phidias et Polyclète se
seraient-ils laissé dire qu'ils ne savaient rien, eux qui
possédaient si admirablement tous les secrets de leur art ? Mais si
quelqu'un leur eût appris en quoi consistait cette parfaite science
dont on parlait, leur emportement serait tombé. Et je pense même
qu'ils ne s'indigneraient pas contre nous, si on leur expliquait que
nous leur refusons ce qui n'existe nulle part, et que nous leur
laissons ce qui peut suffire à leurs travaux. Je puis invoquer
encore à l'appui de notre doctrine les précautions prises par nos
sages ancêtres, qui voulurent d'abord que chacun déposât en justice
d'après sa propre conviction ; ensuite que l'on ne fût
coupable que si l'on avait trompé sciemment ; tant la vie leur
paraissait offrir de chances naturelles d'erreur! enfin, que chacun
en donnant son propre témoignage dit qu'il croyait, même en
parlant de ce qu'il avait vu ; et que les juges enchainés à la
justice par serment, après avoir connu de chaque cause, ne
rendissent leur arrêt qu'en ces termes :.Telle chose parait avoir
été faite, et non pas : telle chose s'est faite.
XLVIII. Mais le matelot nous appelle, Lucullus, le zéphyr lui-même
semble nous murmurer qu'il est temps d'entrer dans nos barques, et
je crois d'ailleurs en avoir assez dit ; je termine donc ce discours.
Mais si dans la suite nous renouons ces entretiens, nous ferons bien
de nous occuper surtout de cette divergence si grave d'opinions
entre les plus grands génies, de l'obscurité de la nature, et de
l'erreur de tant de philosophes qui soutiennent sur les biens et les
maux des doctrines si opposées, dont la plupart, malgré tout leur
célébrité, doivent ne point supporter le regard de la vérité qui ne
peut se reconnaître que dans une seule. Voilà les sujets qui
méritent de nous occuper plutôt que les erreurs de la vie et des
autres sens, le sorite et le sophisme du Menteur, qui sont
autant de filets que les stoïciens n'ont tissus que pour s'y prendre
eux-mêmes.
Je suis loin de regretter, dit alors Lucullus, que nous ayons eu
cette conférence. Lorsque nous nous trouverons réunis, surtout dans
nos jardins de Tusculum, nous pourrons souvent débattre ensemble ces
belles questions. — Parfaitement, lui dis-je. Mais que pense
Catulus ? Que pense Hortensius ? — Ce que je pense, dit Catulus, je
reviens à l'opinion de mon père, qu'il disait être celle de
Carnéade ; je crois qu'on ne peut rien connaître ; je crois aussi que
le sage donnera quelquefois son assentiment à ce qui ne lui sera pas
démontré, c'est-à-dire qu'il aura recours aux opinions, mais de
telle sorte qu'il comprenne bien que ce sont des opinions, et que
rien au monde ne peut être saisi, ni parfaitement connu ; j'approuve
sans réserve l'arrét de tout jugement et par là je me montre
un très-vif partisan de cette maxime qu'on ne peut rien connaître. —
Me voilà instruit de votre opinion, lui dis-je, et j'avoue que je ne
la trouve pas trop à dédaigner. Mais la vôtre, Hortensius, quelle
est-elle donc ? — Je désire un plus ample informé, répondit-il en
riant. — Je vous tiens alors ; car c'est le plus pur sentiment de
l'Académie.
Ici finit l'entretien ; Catulus demeura ; et nous, nous descendîmes
vers nos barques. |